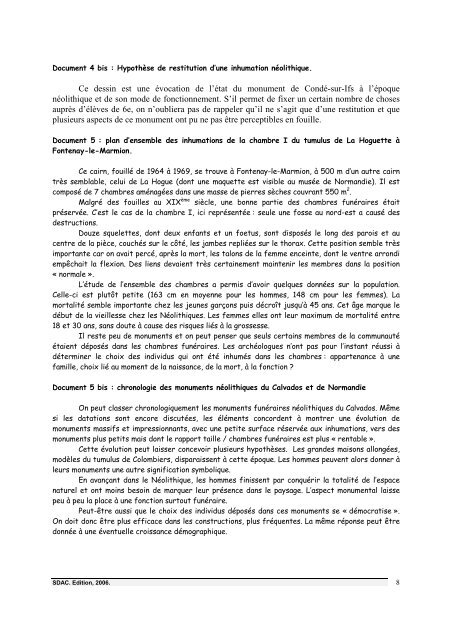(La Révolution Néolithique en Normandie)
(La Révolution Néolithique en Normandie)
(La Révolution Néolithique en Normandie)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Docum<strong>en</strong>t 4 bis : Hypothèse de restitution d’une inhumation néolithique.<br />
Ce dessin est une évocation de l’état du monum<strong>en</strong>t de Condé-sur-Ifs à l’époque<br />
néolithique et de son mode de fonctionnem<strong>en</strong>t. S’il permet de fixer un certain nombre de choses<br />
auprès d’élèves de 6e, on n’oubliera pas de rappeler qu’il ne s’agit que d’une restitution et que<br />
plusieurs aspects de ce monum<strong>en</strong>t ont pu ne pas être perceptibles <strong>en</strong> fouille.<br />
Docum<strong>en</strong>t 5 : plan d’<strong>en</strong>semble des inhumations de la chambre I du tumulus de <strong>La</strong> Hoguette à<br />
Font<strong>en</strong>ay-le-Marmion.<br />
Ce cairn, fouillé de 1964 à 1969, se trouve à Font<strong>en</strong>ay-le-Marmion, à 500 m d’un autre cairn<br />
très semblable, celui de <strong>La</strong> Hogue (dont une maquette est visible au musée de <strong>Normandie</strong>). Il est<br />
composé de 7 chambres aménagées dans une masse de pierres sèches couvrant 550 m 2 .<br />
Malgré des fouilles au XIX ème siècle, une bonne partie des chambres funéraires était<br />
préservée. C’est le cas de la chambre I, ici représ<strong>en</strong>tée : seule une fosse au nord-est a causé des<br />
destructions.<br />
Douze squelettes, dont deux <strong>en</strong>fants et un foetus, sont disposés le long des parois et au<br />
c<strong>en</strong>tre de la pièce, couchés sur le côté, les jambes repliées sur le thorax. Cette position semble très<br />
importante car on avait percé, après la mort, les talons de la femme <strong>en</strong>ceinte, dont le v<strong>en</strong>tre arrondi<br />
empêchait la flexion. Des li<strong>en</strong>s devai<strong>en</strong>t très certainem<strong>en</strong>t maint<strong>en</strong>ir les membres dans la position<br />
« normale ».<br />
L’étude de l’<strong>en</strong>semble des chambres a permis d’avoir quelques données sur la population.<br />
Celle-ci est plutôt petite (163 cm <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne pour les hommes, 148 cm pour les femmes). <strong>La</strong><br />
mortalité semble importante chez les jeunes garçons puis décroît jusqu’à 45 ans. Cet âge marque le<br />
début de la vieillesse chez les <strong>Néolithique</strong>s. Les femmes elles ont leur maximum de mortalité <strong>en</strong>tre<br />
18 et 30 ans, sans doute à cause des risques liés à la grossesse.<br />
Il reste peu de monum<strong>en</strong>ts et on peut p<strong>en</strong>ser que seuls certains membres de la communauté<br />
étai<strong>en</strong>t déposés dans les chambres funéraires. Les archéologues n’ont pas pour l’instant réussi à<br />
déterminer le choix des individus qui ont été inhumés dans les chambres : appart<strong>en</strong>ance à une<br />
famille, choix lié au mom<strong>en</strong>t de la naissance, de la mort, à la fonction ?<br />
Docum<strong>en</strong>t 5 bis : chronologie des monum<strong>en</strong>ts néolithiques du Calvados et de <strong>Normandie</strong><br />
On peut classer chronologiquem<strong>en</strong>t les monum<strong>en</strong>ts funéraires néolithiques du Calvados. Même<br />
si les datations sont <strong>en</strong>core discutées, les élém<strong>en</strong>ts concord<strong>en</strong>t à montrer une évolution de<br />
monum<strong>en</strong>ts massifs et impressionnants, avec une petite surface réservée aux inhumations, vers des<br />
monum<strong>en</strong>ts plus petits mais dont le rapport taille / chambres funéraires est plus « r<strong>en</strong>table ».<br />
Cette évolution peut laisser concevoir plusieurs hypothèses. Les grandes maisons allongées,<br />
modèles du tumulus de Colombiers, disparaiss<strong>en</strong>t à cette époque. Les hommes peuv<strong>en</strong>t alors donner à<br />
leurs monum<strong>en</strong>ts une autre signification symbolique.<br />
En avançant dans le <strong>Néolithique</strong>, les hommes finiss<strong>en</strong>t par conquérir la totalité de l’espace<br />
naturel et ont moins besoin de marquer leur prés<strong>en</strong>ce dans le paysage. L’aspect monum<strong>en</strong>tal laisse<br />
peu à peu la place à une fonction surtout funéraire.<br />
Peut-être aussi que le choix des individus déposés dans ces monum<strong>en</strong>ts se « démocratise ».<br />
On doit donc être plus efficace dans les constructions, plus fréqu<strong>en</strong>tes. <strong>La</strong> même réponse peut être<br />
donnée à une év<strong>en</strong>tuelle croissance démographique.<br />
SDAC. Edition, 2006. 8