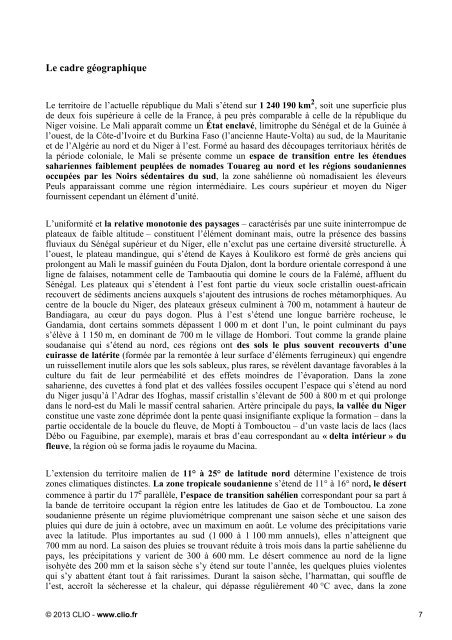Imprimer la chronologie - Clio
Imprimer la chronologie - Clio
Imprimer la chronologie - Clio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Le cadre géographique<br />
Le territoire de l’actuelle république du Mali s’étend sur 1 240 190 km 2 , soit une superficie plus<br />
de deux fois supérieure à celle de <strong>la</strong> France, à peu près comparable à celle de <strong>la</strong> république du<br />
Niger voisine. Le Mali apparaît comme un État enc<strong>la</strong>vé, limitrophe du Sénégal et de <strong>la</strong> Guinée à<br />
l’ouest, de <strong>la</strong> Côte-d’Ivoire et du Burkina Faso (l’ancienne Haute-Volta) au sud, de <strong>la</strong> Mauritanie<br />
et de l’Algérie au nord et du Niger à l’est. Formé au hasard des découpages territoriaux hérités de<br />
<strong>la</strong> période coloniale, le Mali se présente comme un espace de transition entre les étendues<br />
sahariennes faiblement peuplées de nomades Touareg au nord et les régions soudaniennes<br />
occupées par les Noirs sédentaires du sud, <strong>la</strong> zone sahélienne où nomadisaient les éleveurs<br />
Peuls apparaissant comme une région intermédiaire. Les cours supérieur et moyen du Niger<br />
fournissent cependant un élément d’unité.<br />
L’uniformité et <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tive monotonie des paysages – caractérisés par une suite ininterrompue de<br />
p<strong>la</strong>teaux de faible altitude – constituent l’élément dominant mais, outre <strong>la</strong> présence des bassins<br />
fluviaux du Sénégal supérieur et du Niger, elle n’exclut pas une certaine diversité structurelle. À<br />
l’ouest, le p<strong>la</strong>teau mandingue, qui s’étend de Kayes à Koulikoro est formé de grès anciens qui<br />
prolongent au Mali le massif guinéen du Fouta Djalon, dont <strong>la</strong> bordure orientale correspond à une<br />
ligne de fa<strong>la</strong>ises, notamment celle de Tambaoutia qui domine le cours de <strong>la</strong> Falémé, affluent du<br />
Sénégal. Les p<strong>la</strong>teaux qui s’étendent à l’est font partie du vieux socle cristallin ouest-africain<br />
recouvert de sédiments anciens auxquels s‘ajoutent des intrusions de roches métamorphiques. Au<br />
centre de <strong>la</strong> boucle du Niger, des p<strong>la</strong>teaux gréseux culminent à 700 m, notamment à hauteur de<br />
Bandiagara, au cœur du pays dogon. Plus à l’est s’étend une longue barrière rocheuse, le<br />
Gandamia, dont certains sommets dépassent 1 000 m et dont l’un, le point culminant du pays<br />
s’élève à 1 150 m, en dominant de 700 m le vil<strong>la</strong>ge de Hombori. Tout comme <strong>la</strong> grande p<strong>la</strong>ine<br />
soudanaise qui s’étend au nord, ces régions ont des sols le plus souvent recouverts d’une<br />
cuirasse de <strong>la</strong>térite (formée par <strong>la</strong> remontée à leur surface d’éléments ferrugineux) qui engendre<br />
un ruissellement inutile alors que les sols sableux, plus rares, se révèlent davantage favorables à <strong>la</strong><br />
culture du fait de leur perméabilité et des effets moindres de l’évaporation. Dans <strong>la</strong> zone<br />
saharienne, des cuvettes à fond p<strong>la</strong>t et des vallées fossiles occupent l’espace qui s’étend au nord<br />
du Niger jusqu’à l’Adrar des Ifoghas, massif cristallin s’élevant de 500 à 800 m et qui prolonge<br />
dans le nord-est du Mali le massif central saharien. Artère principale du pays, <strong>la</strong> vallée du Niger<br />
constitue une vaste zone déprimée dont <strong>la</strong> pente quasi insignifiante explique <strong>la</strong> formation – dans <strong>la</strong><br />
partie occidentale de <strong>la</strong> boucle du fleuve, de Mopti à Tombouctou – d’un vaste <strong>la</strong>cis de <strong>la</strong>cs (<strong>la</strong>cs<br />
Débo ou Faguibine, par exemple), marais et bras d’eau correspondant au « delta intérieur » du<br />
fleuve, <strong>la</strong> région où se forma jadis le royaume du Macina.<br />
L’extension du territoire malien de 11° à 25° de <strong>la</strong>titude nord détermine l’existence de trois<br />
zones climatiques distinctes. La zone tropicale soudanienne s’étend de 11° à 16° nord, le désert<br />
commence à partir du 17 e parallèle, l’espace de transition sahélien correspondant pour sa part à<br />
<strong>la</strong> bande de territoire occupant <strong>la</strong> région entre les <strong>la</strong>titudes de Gao et de Tombouctou. La zone<br />
soudanienne présente un régime pluviométrique comprenant une saison sèche et une saison des<br />
pluies qui dure de juin à octobre, avec un maximum en août. Le volume des précipitations varie<br />
avec <strong>la</strong> <strong>la</strong>titude. Plus importantes au sud (1 000 à 1 100 mm annuels), elles n’atteignent que<br />
700 mm au nord. La saison des pluies se trouvant réduite à trois mois dans <strong>la</strong> partie sahélienne du<br />
pays, les précipitations y varient de 300 à 600 mm. Le désert commence au nord de <strong>la</strong> ligne<br />
isohyète des 200 mm et <strong>la</strong> saison sèche s’y étend sur toute l’année, les quelques pluies violentes<br />
qui s’y abattent étant tout à fait rarissimes. Durant <strong>la</strong> saison sèche, l’harmattan, qui souffle de<br />
l’est, accroît <strong>la</strong> sécheresse et <strong>la</strong> chaleur, qui dépasse régulièrement 40 °C avec, dans <strong>la</strong> zone<br />
© 2013 CLIO - www.clio.fr<br />
7