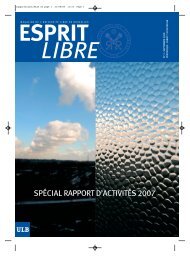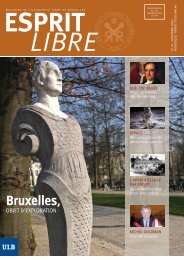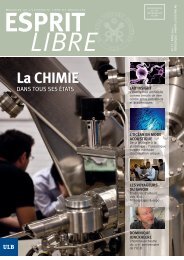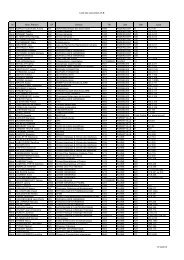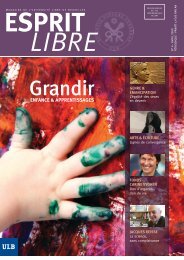Slavica Bruxellensia - Université Libre de Bruxelles
Slavica Bruxellensia - Université Libre de Bruxelles
Slavica Bruxellensia - Université Libre de Bruxelles
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Slavica</strong> <strong>Bruxellensia</strong><br />
Revue polyphonique <strong>de</strong> littérature, histoire et culture slaves<br />
<strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> <strong>Libre</strong> <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong><br />
Quadrimestriel - n°3 – juin 2008<br />
ISSN : 2031-7654
Édito p. 4<br />
Articles<br />
Joanna Goszczyńska<br />
La nation<br />
dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža p. 7<br />
Julja Černjavskaja<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
(sur la base <strong>de</strong> contes biélorusses du quotidien) p. 17<br />
Marc Peeters<br />
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie p. 34<br />
Olivier Santamaria<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien p. 48<br />
Jeremy Lambert<br />
Le towianisme en France. La France dans le towianisme p. 61<br />
Entretien<br />
avec Aleksandr Aveličev p. 74<br />
Traduction<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la (extraits) <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
par Nataša Džigurski-Dubajić p. 90<br />
Excellensia p. 101<br />
Recensions p. 105
Comité scientifique :<br />
Dr. Eric Metz<br />
Pr. Jan Rubeš<br />
Pr. Dana Slabochová<br />
Pr. Marek Tomaszewski<br />
Dr. Dorota Walczak<br />
Dr. Nadia Zhirovova<br />
Comité <strong>de</strong> rédaction :<br />
Sarah Flock<br />
Jeremy Lambert (Rédacteur technique)<br />
Dr. Eric Metz<br />
Katia Van<strong>de</strong>nborre<br />
Dr. Dorota Walczak (Rédacteur en chef)<br />
Contact :<br />
<strong>Slavica</strong>.bruxellensia@ulb.ac.be
Édito<br />
Dorota Walczak
[5]<br />
Édito<br />
Dorota Walc zak<br />
Chers Lecteurs, dans ce troisième numéro <strong>de</strong> « SLAVICA BRUXELLENSIA », le<br />
<strong>de</strong>rnier <strong>de</strong> cette année académique, nous vous proposons un ren<strong>de</strong>z-vous hors du<br />
commun avec le clair obscur <strong>de</strong> la pensée humaine. Le tableau soumis à votre<br />
regard exhibe <strong>de</strong>s dimensions imposantes, <strong>de</strong>s techniques mixtes et une texture<br />
complexe. Étrangement, les plus fous et les plus raisonnés <strong>de</strong>s concepts examinés<br />
par les auteurs <strong>de</strong>s articles présentés dans ce numéro (Julja Černjavskaja, Joanna<br />
Goszczyńska, Jeremy Lambert, Marc Peeters, Olivier Santamaria, Clélia Van<br />
Lerberghe) se placent en équilibre et en harmonie dans l’univers <strong>de</strong> la réflexion et<br />
dans l’Histoire humaine.<br />
Ainsi, aussi surprenants qu’ils soient, le mysticisme slovaque et le<br />
messianisme polonais, plai<strong>de</strong>nt pour une comparaison apparente, mais pas du tout<br />
évi<strong>de</strong>nte. Le mystérieux ésotérisme slave tente d’équilibrer l’image du possible en<br />
présence <strong>de</strong> l’école logique <strong>de</strong> Lvov-Varsovie et <strong>de</strong> la phénoménologie tchèque,<br />
excellant encore une fois, comme au XV e siècle, dans l’imagerie <strong>de</strong> l’hérésie<br />
salvatrice…<br />
Une part <strong>de</strong> découverte nous est réservée également dans les présentations<br />
<strong>de</strong> six ouvrages (rubrique : recension) et dans la traduction d’une pièce serbe <strong>de</strong><br />
Slobodan Selenić par Nataša Džigurski-Dubajić.<br />
Dans la maîtrise <strong>de</strong> ce clair-obscur, les auteurs <strong>de</strong> ce numéro démontrent<br />
l’évolution <strong>de</strong> l’homme <strong>de</strong> façon transversale à travers les siècles et les pays et <strong>de</strong><br />
manière linéaire au travers <strong>de</strong>s évènements historiques. Et ce à l’encontre <strong>de</strong>s<br />
obstacles biographiques et biologiques.<br />
Les chercheurs mettent en lumière et réexaminent <strong>de</strong>s individualités, <strong>de</strong>s<br />
personnages, <strong>de</strong>s maîtres et <strong>de</strong>s disciples (Andrzej Towiański, Boris Mouravieff, Jan<br />
Patočka, Michal Miloslav Hodža, Stanisław Leśniewski et tant d’autres) qui<br />
représentent chacun une histoire particulière.<br />
La tentative toujours renouvelée <strong>de</strong> dépasser les règles et les co<strong>de</strong>s établis,<br />
l’effort <strong>de</strong> passer outre la peur par la sagesse, l’astuce, la dérision ou la force <strong>de</strong><br />
pensée insoumise, si bien racontés par Aleksandr Aveličev dans l’interview menée<br />
par Katia Van<strong>de</strong>nborre et Eric Metz, constituent aussi une part <strong>de</strong> la tâche qui<br />
s’impose aux protagonistes et aux auteurs <strong>de</strong>s articles.<br />
À l’exemple <strong>de</strong>s personnalités qu’ils décrivent, les auteurs nous <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />
réfléchir à notre tour sur la place <strong>de</strong> l’individu dans société, dans la nation et dans<br />
l’ensemble <strong>de</strong> l’humanité.<br />
D’ailleurs, y a-t- il plus courageux et plus insolite que la quête <strong>de</strong> l’essence <strong>de</strong><br />
l’être et la façon d’agir <strong>de</strong> l’homme face à l’inconnu ?<br />
Y a-t-il audace plus gran<strong>de</strong> que <strong>de</strong> vivre par la pensée en naviguant sans<br />
cesse entre la raison et l’émotion dans cette soif inassouvie <strong>de</strong> saisir et <strong>de</strong><br />
comprendre… ?
Articles
Joanna Goszczyńska<br />
La nation<br />
dans les conceptions messianiques <strong>de</strong><br />
Michal Miloslav Hodža<br />
D<br />
ans les années 1930, Milan Pišút (1908-1984) présenta « Slovenské<br />
iskrice » (L’étincelle slovaque, 1856), poème jusqu’alors inconnu <strong>de</strong><br />
Samo Bohdan Hroboň (1820-1894), en le plaçant dans le contexte du<br />
messianisme. Le critique et historien <strong>de</strong> la littérature slovaque <strong>de</strong> renom voulait<br />
ainsi exprimer que le messianisme slovaque loin d’être un « extrémisme poétique »<br />
avait en réalité imprégné toute une génération et lui avait fourni un soutien spirituel<br />
fondamental à une époque <strong>de</strong> magyarisation accrue 1 . Durant <strong>de</strong> longues années, ce<br />
point <strong>de</strong> vue ne fut pas partagé. La critique slovaque, <strong>de</strong> la fin du XIX e siècle<br />
jusqu’aux années soixante du vingtième siècle, l’a soit ignoré volontairement, soit<br />
déprécié car elle considérait toute manifestation <strong>de</strong> la pensée<br />
messianique comme idéologiquement inutile. Le messianisme, qui, à la<br />
lumière <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s actuelles, apparaît comme un élément constitutif du<br />
romantisme slovaque, était perçu dans le meilleur <strong>de</strong>s cas comme un<br />
phénomène périphérique. Toutefois, il n’était pas rare qu’il fût<br />
également perçu comme un phénomène pathologique, comme une<br />
tumeur sur le corps sain <strong>de</strong> la littérature <strong>de</strong> la renaissance nationale 2 .<br />
Selon les thèses les plus courantes, reprises par les générations<br />
successives <strong>de</strong> critiques, la poésie messianique était non seulement<br />
incompréhensible, prophétique et visionnaire, mais également détachée<br />
1 - Pišút M.,<br />
« Mesianistická báseň<br />
Sama Bohdana Hroboňa<br />
“Slovenské iskrice” »<br />
(« Slovenské iskrice », un<br />
poème messianique <strong>de</strong><br />
Samo Bohdan Hroboň),<br />
in : « SBORNIK MATICE<br />
SLOVENSKEJ XIX », 1936,<br />
p. 390.<br />
2 - Voir Čepan O., Premeny<br />
ducha a predmetnosti v<br />
slovenskom romantizme<br />
(Les changements d’esprit<br />
et <strong>de</strong> réalité dans le<br />
romantisme slovaque),<br />
in : « LITTERARIA », n° XVI :<br />
Literárny romantizmus,<br />
Bratislava, 1974, p. 102.
Joann a Goszczyńsk a<br />
La nation dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža<br />
<strong>de</strong>s réalités et <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> la nation. La prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> ces besoins<br />
nationaux ne pouvait trouver un écho que dans la « poésie slave », telle que la<br />
concevait Ľudovit Štúr (1815-1856), le principal idéologue <strong>de</strong> la renaissance<br />
nationale slovaque, qui basait ses conceptions sur la mythification du folklore.<br />
Les messianistes slovaques<br />
Ce diagnostique étonnant peut être partiellement expliqué, nous osons<br />
l’affirmer par la mauvaise connaissance <strong>de</strong>s textes, restés pour la plupart à l’état<br />
d’archives (certains le sont d’ailleurs encore) 3 . La lecture <strong>de</strong> ces textes démontre en<br />
effet quelque chose <strong>de</strong> tout à fait différent. Les poésies <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux plus importants<br />
représentants du messianisme slovaque, Hroboň et Michal Miloslav Hodža (1811-<br />
1870), proposent non seulement un diagnostique <strong>de</strong> la réalité <strong>de</strong> l’époque, mais<br />
également <strong>de</strong>s propositions concrètes pour résoudre les problèmes <strong>de</strong> nationalité.<br />
Quelque soit la manière avec laquelle ces conceptions on pu être jugées,<br />
il est indéniable qu’elles constituaient une voix importante dans les<br />
discussions <strong>de</strong> l’époque sur le thème <strong>de</strong> la place et du rôle <strong>de</strong>s Slaves en<br />
Europe. Les rédacteurs <strong>de</strong>s journaux contemporains l’avaient d’ailleurs<br />
très bien compris : s’ils ne permettaient pas que ces textes fussent<br />
imprimés, c’était non seulement parce que ceux-ci étaient, selon eux,<br />
incompréhensibles mais également, ce dont ils ne se cachaient pas, à<br />
cause <strong>de</strong> leur orientation clairement panslaviste, ce qui était le cas <strong>de</strong>s<br />
poèmes <strong>de</strong> Hroboň par exemple 4 . C’est autant la langue parfois<br />
hermétique <strong>de</strong> ces textes que la peur <strong>de</strong> la censure qui rendirent<br />
impossible leur intégration dans le circuit littéraire. D’autant plus<br />
qu’après l’écrasement <strong>de</strong>s révolutions du Printemps <strong>de</strong>s Peuples, à<br />
l’époque du régime néo-absolutiste d’Alexan<strong>de</strong>r Bach, la censure se<br />
faisait intransigeante sur la question du panslavisme dont elle empêchait<br />
toute manifestation.<br />
Hroboň eut finalement plus <strong>de</strong> chance que Hodža. Quelques-unes<br />
<strong>de</strong> ses œuvres furent publiées dans les colonnes <strong>de</strong>s journaux <strong>de</strong><br />
l’époque, d’autres, comme « Slovenské Iskrice », dont il a été fait<br />
mention plus haut, parurent durant l’entre-<strong>de</strong>ux-guerres. Elles<br />
n’éveillèrent cependant pas un grand intérêt, hormis celui <strong>de</strong> Pišút.<br />
Quelques sérieux recueils d’œuvres <strong>de</strong> Hroboň, ainsi que sa<br />
correspondance et <strong>de</strong>s fragments <strong>de</strong> son journal, furent publiés dans les<br />
années 1950. Sa poésie commença alors à susciter l’intérêt d’un plus<br />
grand nombre <strong>de</strong> lecteurs et à être commentée par les chercheurs. On a<br />
même commencé à voir en lui un précurseur <strong>de</strong>s principes tardifs du<br />
surréalisme. Hroboň, auparavant considéré comme un poète<br />
périphérique, excentrique et oublié, prit une position centrale dans le<br />
canon <strong>de</strong> la littérature romantique slovaque.<br />
[8]<br />
3 - Nous pouvons<br />
également considérer<br />
comme correcte l’opinion<br />
du chercheur slovaque<br />
Oskár Čepan, qui associe<br />
l’appréciation du<br />
messianisme aux<br />
réductions et aux<br />
altérations que l’on<br />
rencontre dans tout le<br />
romantisme slovaque. La<br />
raison est à chercher dans<br />
ce que les générations<br />
ultérieures <strong>de</strong> critiques<br />
s’i<strong>de</strong>ntifièrent à<br />
l’argumentation <strong>de</strong>s<br />
romantiques qui s’étaient<br />
fixé comme but <strong>de</strong> ne pas<br />
affaiblir les forces<br />
nationales. C’est ainsi<br />
qu’est né un jugement<br />
positiviste et réaliste au<br />
sujet du romantisme, selon<br />
lequel seuls les actes<br />
« constructifs » <strong>de</strong> la<br />
génération romantique sont<br />
considérés comme positifs.<br />
Voir Čepan O., Op. cit.,<br />
p. 102.<br />
4 - Voir la lettre <strong>de</strong> Jozef<br />
Viktorin, l’éditeur <strong>de</strong><br />
l’almanach Concordia, à qui<br />
Hroboň envoya son<br />
« Slovenské iskrice ».<br />
L’auteur n’y cache pas sa<br />
crainte <strong>de</strong> la censure en ce<br />
qui concerne la résonance<br />
panslaviste <strong>de</strong> sa poésie.<br />
Čepan cite cette lettre dans<br />
son article « Romantický<br />
mesianismus a Samo<br />
Bohdan Hroboň » (Le<br />
messianisme romantique et<br />
S. B. Hroboň),<br />
in : K problematike<br />
slovenského romantizmu<br />
(De la problématique du<br />
romantisme slovaque),<br />
Matica Slovenká, Martin,<br />
1973, p. 102.
La nation dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža<br />
Joann a Goszczyńsk a<br />
L’œuvre <strong>de</strong> Hodža connut un sort bien moins enviable. Il développa son idée<br />
messianiste dans <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses compositions : la première intitulée « Matora » 5 (qu’il<br />
produisit entre 1853 et 1857) ne fut publiée intégralement qu’en 2003 ; l’autre,<br />
« Vieroslavin » (écrite dans les années 1867-1870), enrichit encore actuellement les<br />
archives slovaques. Il est intéressant <strong>de</strong> souligner que, dans le poème « Matora »,<br />
Hodža tenta d’allier l’inspiration folklorique à l’idéologie messianique en faisant du<br />
brigand Juraj Jánošik, héros folklorique célèbre, un Messie slovaque. À l’époque, le<br />
mythe <strong>de</strong> Jánošik était enraciné tant dans les textes littéraires que dans la<br />
conscience collective. L’utilisation <strong>de</strong> ce portrait littéraire était presque une<br />
obligation tacite <strong>de</strong>s a<strong>de</strong>ptes <strong>de</strong> l’art scriptural. Entre parenthèses, notons que ce ne<br />
fut pas sans être encouragé par Štúr qui postulait expressis verbis le recours aux<br />
héros populaires. Jánošik, élevé au rang <strong>de</strong> héros national par la littérature d’avant<br />
le Printemps <strong>de</strong>s Peuples, <strong>de</strong>vint un idéologème attrayant pour les créateurs qui<br />
voulaient faire coïnci<strong>de</strong>r les idées messianiques avec les inspirations folkloristes 6 . Un<br />
autre poète slovaque, Ján Botto (1829-1881), suivra la même voie quelques années<br />
plus tard. Son poème « Smrť Jánošiková » (La Mort <strong>de</strong> Jánošik, 1862) <strong>de</strong>vint un<br />
classique du romantisme slovaque. Cependant dans le poème <strong>de</strong> Botto, fortement<br />
ancré dans la tradition populaire, les liens avec les idées messianistes sont<br />
dissimulés <strong>de</strong>rrière l’héroïsation du brigand qui est traité comme un modèle<br />
national, porteur <strong>de</strong> l’idée <strong>de</strong> liberté. Ce sont ces aspects du poème sur lesquels la<br />
critique s’attarda, dépréciant la trame messianique. Cela explique la popularité<br />
qu’acquit le poème et le rang exceptionnellement élevé auquel il s’éleva aux yeux<br />
<strong>de</strong>s commentateurs. Le lien qui unit le Jánošik <strong>de</strong> Hodža à celui <strong>de</strong>s récits<br />
populaires est plutôt convenu : le poète le présente avant tout comme une<br />
incarnation <strong>de</strong> l’idée messianiste ainsi que comme une relecture <strong>de</strong><br />
celle-ci. Jánošik, en tant que sauveur potentiel <strong>de</strong> la nation, subit en<br />
effet une défaite totale, il n’est pas en mesure <strong>de</strong> réaliser les hauts<br />
espoirs qui sont placés en lui, il ne peut mener sa nation au combat, et il<br />
n’est plus capable non plus d’incarner durablement l’humilité et la<br />
souffrance. Il se dégage <strong>de</strong> la protection divine et retourne à<br />
l’incarnation satanique du brigand. Le brigandage est en effet perçu<br />
négativement dans le poème <strong>de</strong> Hodža, au contraire <strong>de</strong>s textes<br />
folkloriques. Jánošik est traité ici comme un criminel, un brigand<br />
malfaiteur qui pactise avec le diable; il doit conclure une alliance avec<br />
Dieu et expier ses erreurs pour mériter sa mission, qui consiste à sauver<br />
la nation. En cela, il s’inscrit dans un mo<strong>de</strong> contraire à celui <strong>de</strong>s<br />
aventures populaires, qui l’héroïsent complètement, et <strong>de</strong> la majorité<br />
<strong>de</strong>s textes qui construisent le mythe du héros national.<br />
La défaite <strong>de</strong> Jánošik n’est pas uniquement la débâcle <strong>de</strong> l’attitu<strong>de</strong><br />
messianique. Il est également la manifestation du manque <strong>de</strong> foi en la<br />
possibilité <strong>de</strong> transformer la nation slovaque dont le représentant est un<br />
bandit. Par endroits, l’auteur soumettait sa nation à une critique si<br />
sévère qu’il n’est pas étonnant que l’on ne se fut pas empressé <strong>de</strong><br />
[9]<br />
5 - Le titre est un<br />
néologisme forgé par<br />
l’auteur du poème, il<br />
signifie « celui qui vient <strong>de</strong><br />
la mère », « la famille issue<br />
<strong>de</strong> la mère ». Le héros <strong>de</strong><br />
l’œuvre, le brigand Juraj<br />
Jánošik, est le « fils <strong>de</strong> la<br />
mère ». Celle-ci représente<br />
l’humilité et le pardon, en<br />
opposition au personnage<br />
du père qui est le<br />
protecteur <strong>de</strong> la vengeance.<br />
6 - J’ai consacré une<br />
monographie aux<br />
transformations du mythe<br />
<strong>de</strong> Jánošik :<br />
Goszczyńska J., Mit<br />
Janosika w folklorze i<br />
literaturze słowackiej XIX<br />
wieku (Le Mythe <strong>de</strong> Jánošik<br />
dans le folklore et la<br />
littérature slovaque du XIX e<br />
siècle), Uniwersytet<br />
Warszawski, Instytut<br />
Filologii słowiańskiej,<br />
Varsovie, 2001, 302 p.<br />
Cet ouvrage a été traduit<br />
en slovaque sous le titre<br />
mytus o Jánošikovi vo<br />
folklóre a slovenskej<br />
literature 19. storočia,<br />
JUGA, Bratislava, 2003<br />
(trad. du polonais par<br />
Bogumił Suwar).
Joann a Goszczyńsk a<br />
La nation dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža<br />
publier son poème. Hodža remit en question le mythe national <strong>de</strong> la mission<br />
historique <strong>de</strong>s Slovaques considérés comme une nation choisie, mythe créé par Štúr<br />
et répandu surtout avant 1848. Il présenta en effet une vision <strong>de</strong> sa nation dans<br />
laquelle celle-ci était poussée par l’histoire au plus bas échelon <strong>de</strong> la hiérarchie <strong>de</strong>s<br />
nations. Au reproche <strong>de</strong> dénationalisation et <strong>de</strong> dégradation <strong>de</strong> la langue nationale<br />
vinrent s’ajouter <strong>de</strong>s accusations d’un autre ordre. Hodža accusait également les<br />
Slovaques d’être une nation à l’âme soumise, d’être <strong>de</strong>s serviteurs coincés dans un<br />
esclavage vers lequel les pousse leur nature.<br />
« Matory » et « Vieroslavina », <strong>de</strong>ux poèmes messianiques <strong>de</strong> Hodža<br />
Le jugement porté sur la nation est l’un <strong>de</strong>s motifs les plus importants <strong>de</strong>s<br />
poèmes « Matory » et « Vieroslavina », il s’exprime dans les problématiques <strong>de</strong> la<br />
possibilité laissée à la nation d’exister dans l’histoire et du rôle qu’elle doit tenir sur<br />
le territoire européen. Dans les <strong>de</strong>ux poèmes, l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Hodža est<br />
caractérisée par une antinomie. Il semble pourtant que les sources <strong>de</strong><br />
celle-ci soient différentes dans les <strong>de</strong>ux poèmes.<br />
Hodža mit plusieurs années à produire « Matora », ce qui n’est pas<br />
surprenant au vu <strong>de</strong>s quelques 20 000 vers que compte le poème (soit<br />
environ 600 pages). La vision <strong>de</strong> la nation qui s’en dégage est confuse,<br />
elle comporte <strong>de</strong> nombreuses incohérences et contradictions. Elle<br />
témoigne <strong>de</strong>s luttes et <strong>de</strong>s hésitations du poète qui ne croyait plus au<br />
succès du mouvement national. Hodža écrivit son poème à une époque<br />
<strong>de</strong> frustration durant laquelle le sentiment <strong>de</strong> défaite était très présent.<br />
Cette ambiance était propice au développement d’une pensée<br />
messianique. La foi qu’avaient placés les Slovaques en l’Autriche durant<br />
la révolution <strong>de</strong> 1848-1849 et leur association durant cette pério<strong>de</strong><br />
s’étaient en effet avérées être <strong>de</strong>s erreurs historiques 7 . Hodža n’était pas<br />
un observateur impartial mais véritablement un activiste engagé dans<br />
les affaires nationales. Et ce, dans plusieurs domaines 8 . En 1848, il<br />
s’engagea directement dans la création d’une division <strong>de</strong> fantassins<br />
slovaques, soumise à l’État-major autrichien, et prit part à la première<br />
expédition menée contre les Hongrois. Elle ne se termina pas <strong>de</strong> manière<br />
glorieuse pour lui puisqu’il quitta la division après la première<br />
échauffourée, ce qui lui valut <strong>de</strong> passer <strong>de</strong>vant un tribunal militaire pour<br />
désertion. Cela ne freina toutefois pas son engouement : il continua à<br />
participer à la préparation <strong>de</strong> ce que l’on appelle les « insurrections<br />
slovaques » contre les Hongrois. Le gouvernement hongrois <strong>de</strong> Lajos<br />
Kossuth ordonna son arrestation et publia un mandat d’arrêt contre lui<br />
(tout comme il l’avait fait contre les autres meneurs <strong>de</strong>s insurrections,<br />
Štúr et Hurban). Les autorités <strong>de</strong> Vienne l’honorèrent néanmoins en lui<br />
[10]<br />
7 - L’attitu<strong>de</strong> prise par les<br />
Slovaques durant la<br />
révolution <strong>de</strong> 1848 trouve<br />
ses racines dans le conflit<br />
qui les opposait aux<br />
Hongrois et qui s’était<br />
intensifié durant les années<br />
1840. Deux idées<br />
s’opposaient : celle du<br />
mouvement national<br />
slovaque qui entrait à cette<br />
époque dans une phase <strong>de</strong><br />
cristallisation <strong>de</strong> son<br />
programme politique et<br />
considérait le royaume <strong>de</strong><br />
Hongrie comme une patrie<br />
commune, et celle du<br />
mouvement national <strong>de</strong>s<br />
Hongrois qui voulaient<br />
transformer leur État<br />
multiethnique en État<br />
national. L’unification <strong>de</strong> la<br />
langue, décidée par décret<br />
en 1840, <strong>de</strong>vait servir ce<br />
but : la langue hongroise<br />
<strong>de</strong>vait être utilisée non<br />
seulement dans les écoles<br />
et dans l’administration,<br />
mais également dans les<br />
églises.<br />
8 - Il est à l’origine, avec<br />
Štúr et Jozef Miloslav<br />
Hurban, d’un projet <strong>de</strong><br />
codification <strong>de</strong> la langue<br />
slovaque (1843) ; en 1844,<br />
il fut le cofondateur <strong>de</strong><br />
l’association Tatrín ; il fut,<br />
en mai 1848, l’un <strong>de</strong>s<br />
initiateurs <strong>de</strong>s « Žiadosti<br />
slovenského národa » (Les<br />
Deman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la nation<br />
slovaque), une pétition<br />
<strong>de</strong>stinées aux autorités<br />
viennoises par laquelle les<br />
Slovaques se déclaraient<br />
pour l’égalité <strong>de</strong>s droits<br />
avec les Hongrois et la<br />
délimitation d’un territoire<br />
propre au sein du royaume<br />
<strong>de</strong> Hongrie.
La nation dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža<br />
Joann a Goszczyńsk a<br />
accordant en 1850 la Croix d’Or du mérite <strong>de</strong> l’empereur François-Joseph I er .<br />
La politique <strong>de</strong>s Slovaques se révéla imprévoyante et inefficace. La politique<br />
autrichienne ne résultait pas <strong>de</strong> ses obligations envers les nations slaves qui la<br />
constituaient, bien au contraire. Le régime mis en place par Bach écrasa les<br />
mouvements nationaux et culturels, augmenta la censure et réprima les activistes<br />
nationalistes les plus actifs (ou en « normalisa » une partie en leur offrant <strong>de</strong>s<br />
postes bien rémunérés dans l’administration). Pour Hodža comme pour beaucoup<br />
d’autres hommes qui avaient pris part à la vie nationale, le régime néo-absolutiste<br />
furent une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> défaitisme, <strong>de</strong> perte <strong>de</strong>s illusions et <strong>de</strong> la foi en la possibilité<br />
<strong>de</strong> relever une nation qui avait laissé passer sa chance. Dans le cas <strong>de</strong> Hodža, cela<br />
se traduisit par une révision <strong>de</strong>s conceptions antérieures ayant pour objet la nation<br />
et par une démythification <strong>de</strong> la vision romantique selon laquelle la nation slovaque<br />
avait un rôle particulier à jouer dans l’histoire.<br />
Hodža situait la nation slovaque au bas <strong>de</strong> l’échelle <strong>de</strong>s nations slaves et ne<br />
lui fit par conséquent jouer aucun rôle dans l’histoire, moins encore celui <strong>de</strong> nation<br />
choisie. Il soulignait en effet qu’une nation qui se noie dans un élément étranger<br />
perd la chance <strong>de</strong> renaître. À ce jugement négatif s’alliait pourtant une tentative <strong>de</strong><br />
justification, elle-même associée à la volonté <strong>de</strong> rejeter une partie <strong>de</strong> la<br />
responsabilité sur l’autre, sur l’étranger, c’est-à-dire sur les Hongrois qui vivaient<br />
sur le même territoire. Hodža les accusait d’ôter sa mémoire historique au peuple<br />
slovaque, <strong>de</strong> ridiculiser et <strong>de</strong> déformer ses traditions qui légitimaient pourtant son<br />
droit à la différenciation i<strong>de</strong>ntitaire. Il évoquait par exemple la légen<strong>de</strong>, répandue<br />
par l’historiographie hongroise, <strong>de</strong> la soumission <strong>de</strong>s terres slovaques par<br />
Svatopluk I en échange d’un cheval blanc à l’harnachement d’or. Il reprochait à ce<br />
fait légendaire, dont la représentation picturale était accrochée aux murs <strong>de</strong><br />
nombreuses maisons <strong>de</strong> Hongrois et <strong>de</strong> Slovaques magyarisés, d’être une<br />
falsification <strong>de</strong> la mémoire historique.<br />
Il faut souligner que Hodža ne revendiquait pas pour les Slovaques le droit <strong>de</strong><br />
se déclarer nation historique. Il affirmait cependant que le fait qu’ils n’étaient pas<br />
une nation politique, établie dans les limites d’un état, ne gageait en rien leurs<br />
aspirations nationales. Mais il considérait également que les Slovaques, par leur<br />
politique conciliatrice envers l’Autriche et l’alliance <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>stin à celui <strong>de</strong> celle-ci<br />
lors <strong>de</strong> la révolution, avaient eux-mêmes enterré leur espoir <strong>de</strong> voir se réaliser leur<br />
programme national qui, comme le remarque Miroslav Hroch dans ses étu<strong>de</strong>s sur<br />
les phases <strong>de</strong>s mouvements nationalistes, peut passer pour un programme politique<br />
<strong>de</strong> substitution 9 .<br />
Il semble que déjà avant que n’éclate la révolution Hodža n’estimait pas<br />
l’Autriche outre mesure. Lorsqu’il apprit, en juillet 1848, que les Hongrois<br />
cherchaient à s’entendre avec les nations slaves qui peuplaient le<br />
royaume <strong>de</strong> Hongrie et qu’ils s’apprêtaient à arrêter le principe <strong>de</strong> leur<br />
égalité, le poète ne cacha pas qu’il considérait cette option plus proche<br />
<strong>de</strong> ses idées que celle qui consistait à pactiser avec les dirigeants<br />
viennois. Il se rapportait avec un certain scepticisme à cette issue <strong>de</strong>s<br />
[11]<br />
9 - Hroch M., V národnim<br />
zájmu. Požadavky a cíle<br />
evropských národních hnutí<br />
<strong>de</strong>vatenáctého století<br />
v komparativní perspektivě<br />
(Dans l'intérêt national.<br />
Revendications et buts <strong>de</strong>s<br />
mouvements nationaux du<br />
XIX e siècle selon une<br />
approche comparative),<br />
NLN, Prague, 1995, p. 98<br />
et suiv.
Joann a Goszczyńsk a<br />
La nation dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža<br />
événements car il ne voyait pas d’autre option que le conflit armé 10 . Notons qu’en<br />
juillet 1849, la position <strong>de</strong>s Hongrois, plutôt désunis sur les questions nationales au<br />
début <strong>de</strong> la révolution, se modifia sensiblement : ils publièrent en effet un<br />
communiqué garantissant <strong>de</strong>s droits élargis aux différentes nations du royaume <strong>de</strong><br />
Hongrie. Mais la situation était déjà trop avancée pour que le cours <strong>de</strong>s événements<br />
puisse être arrêté.<br />
La manière dont le poète slovaque juge la situation dans les années 1850 est<br />
l’expression d’un sentiment <strong>de</strong> désespoir et d’inutilité. Hodža ne voit plus <strong>de</strong><br />
perspectives pour le mouvement national écrasé, il cherche donc dans l’individualité<br />
le secours à apporter à sa nation, il transporte le problème <strong>de</strong> la lutte pour les<br />
droits nationaux sur le terrain du messianisme individuel. Cette voie lui semble la<br />
plus évi<strong>de</strong>nte, car le héros <strong>de</strong> « Matora », le brigand Jánošik, ne se réalise pas en<br />
tant que Messie. La croyance messianique en un plan divin concernant l’Histoire est<br />
elle aussi discréditée.<br />
Le poète propose une version révisée <strong>de</strong> ses idées sur les possibilités <strong>de</strong> sa<br />
nation dans sa <strong>de</strong>rnière œuvre, son testament poétique comme il l’appelle lui-<br />
même, le poème (jamais publié) intitulé « Vieroslavin » 11 , titre que l’on pourrait<br />
traduire très librement par « glorification <strong>de</strong> la foi ». Il l’écrivit à Cieszyń, ville située<br />
alors en Autriche, où il passa les trois <strong>de</strong>rnières années <strong>de</strong> sa vie dans un exil<br />
volontaire, qu’il avait accepté en échange d’une retraite hautement rémunérée par<br />
l’État. Le prix à payer fut son engagement à ne plus agir publiquement, ce qui<br />
signifiait son retrait <strong>de</strong> la vie nationale.<br />
La question <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong> sa propre nation pose problème au poète. Celui-ci<br />
tente cette fois d’inscrire le développement <strong>de</strong> sa nation dans un schéma<br />
messianique <strong>de</strong> l’histoire. Sa conception historiosophique se base sur une vision en<br />
trois temps <strong>de</strong> l’Histoire, vision répandue à l’époque romantique, on la retrouve par<br />
exemple dans le Livre <strong>de</strong> la nation Polonaise d’Adam Mickiewicz (1799-1855) ou<br />
dans l’historiographie d’Andrzej Towiański (1799-1878). Soulignons que l’œuvre <strong>de</strong><br />
Mickiewicz, tout comme l’action <strong>de</strong> Towiański, étaient connus du milieu romantique<br />
slovaque. Conformément à cette vision en trois temps, la nation doit passer par les<br />
étapes <strong>de</strong> la chute, <strong>de</strong> la <strong>de</strong>struction et enfin <strong>de</strong> l’expiation et <strong>de</strong> la renaissance.<br />
Hodža situait la chute <strong>de</strong> la nation slovaque à l’époque <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong>-Moravie,<br />
c'est-à-dire aux temps mythiques <strong>de</strong> sa création. C’est alors que commença, après<br />
une courte pério<strong>de</strong> fastueuse, un millénaire d’esclavage qui constitue le <strong>de</strong>uxième<br />
maillon <strong>de</strong> l’Histoire. À cette époque, la nation subit, dans le domaine politique, une<br />
<strong>de</strong>struction systématique conduite par les Hongrois qui limitaient les<br />
droits linguistiques <strong>de</strong>s Slaves et ne reconnaissaient pas le rôle <strong>de</strong> ceux-<br />
ci dans la mise en place d’un état commun, s’en remettant à eux avec<br />
hauteur et dédain comme à <strong>de</strong>s représentants d’une nation plébéienne.<br />
Le poète slovaque faisait allusion à une expression qui s’était enracinée<br />
dans la conscience collective et qui affirmait que « Tot nem ember »,<br />
[12]<br />
10 - Voir Vongrej P.,<br />
Vyhnanec. Prípad Michal<br />
M. Hodža (L’Émigré. Le cas<br />
<strong>de</strong> M. M. Hodža), Spolok<br />
slovenských spisovateľov,<br />
Bratislava, 2000, p. 39.<br />
11 - Un choix <strong>de</strong> fragments<br />
tirés <strong>de</strong> la première partie<br />
<strong>de</strong> l’œuvre, un quart du<br />
total environ, fut publié au<br />
début du XX e siècle dans le<br />
périodique « SLOVENSKÉ<br />
POHĽADY ».
La nation dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža<br />
Joann a Goszczyńsk a<br />
« le Slovaque n’est pas un homme » 12 . Nous nous servons ici d’une conception<br />
nationale que nous associons à Hodža, mais nous nous <strong>de</strong>vons <strong>de</strong> souligner que<br />
cette idée était déjà largement répandue avant cette étape <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> la<br />
communauté ethnique slovaque. Ajoutons encore que le mythe <strong>de</strong> l’esclavage<br />
millénaire, très fortement ancré dans la conscience collective slovaque, est<br />
aujourd’hui encore l’un <strong>de</strong>s mythes politiques les plus utilisés dans la sphère<br />
publique 13 .<br />
La disparition <strong>de</strong> leur nation avait été favorisée par l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Slovaques<br />
eux-mêmes. Hodža incriminait les représentants <strong>de</strong> toutes les classes sociales, du<br />
peuple soumis jusqu’au clergé, en passant par la bourgeoisie et la noblesse. La<br />
bourgeoisie parce qu’elle s’était germanisée et la noblesse parce qu’elle s’était<br />
magyarisée, ce qui eut pour conséquence que ces <strong>de</strong>ux classes s’étaient d’elles-<br />
mêmes éliminées <strong>de</strong> l’univers national ; le clergé parce qu’il avait perdu son contact<br />
avec Dieu et n’avait pas mis en pratique les décrets divins. Selon le poète, cet état<br />
<strong>de</strong> fait était toutefois justifié. La nation slovaque suivait le plan <strong>de</strong> la Provi<strong>de</strong>nce,<br />
elle avait en effet été nommée, choisie pour souffrir durant mille ans. Cette pério<strong>de</strong><br />
d’esclavage, <strong>de</strong> « Châtiment », était une condition essentielle à sa renaissance<br />
future. Sans elle, la nation slovaque ne pourrait pas prendre une place<br />
exceptionnelle dans l’histoire <strong>de</strong> l’humanité. Cette place exceptionnelle serait<br />
partagée par les Slovaques et les autres Slaves. Les Péchés, les tourments avaient<br />
une signification supérieure, le mal donnerait naissance au bien tandis que <strong>de</strong> la<br />
douleur viendrait la gran<strong>de</strong>ur.<br />
L’idée selon laquelle les Tatras étaient le berceau <strong>de</strong>s Slaves et les Slovaques<br />
la plus ancienne nation formée par ceux-ci était enracinée dans la conscience <strong>de</strong> la<br />
génération romantique slovaque. On la rencontrait dans la quasi-totalité <strong>de</strong>s<br />
conceptions missionistes, elle permettait <strong>de</strong> légitimer l’idée selon<br />
laquelle les Slovaques avaient été pré<strong>de</strong>stinés à l’importante mission<br />
historique qu’ils <strong>de</strong>vaient remplir. Dans son historiosophie messianiste,<br />
Hodža introduit toutefois un nouvel élément, en accord avec l’idée même<br />
<strong>de</strong> messianisme : c’était le fait d’avoir souffert durant mille ans qui<br />
pré<strong>de</strong>stinait les Slovaques à être une nation choisie. Le poète soulignait<br />
que les Slovaques avaient souffert pour les autres nations slaves, que<br />
c’était une souffrance voulue par Dieu et que ce sera également par Sa<br />
volonté que l’antique gloire reviendra à tous les Slaves. La renaissance<br />
<strong>de</strong>s nations slaves était cependant la condition sine qua non <strong>de</strong> la<br />
réalisation <strong>de</strong>s plans divins : elles <strong>de</strong>vaient réaliser la mission divine qui<br />
leur avait été assignée afin que les volontés <strong>de</strong> Dieu soient exaucées.<br />
Cette mission était, dans le projet <strong>de</strong> Hodža, la construction d’une<br />
communauté <strong>de</strong> nations européennes basée sur la foi dans le Christ.<br />
Sa vision d’une Europe commune étonne aujourd’hui par son<br />
actualité. Hodža voyait l’Europe commune comme la patrie idéale <strong>de</strong><br />
toutes les nations, germaniques, romanes et slaves, qui la peuplaient.<br />
Cette communauté <strong>de</strong>vait être basée sur l’idée d’unification, <strong>de</strong><br />
[13]<br />
12 - C’est une partie du<br />
dicton hongrois : Kása nem<br />
etel, taliga nem szekér, tót<br />
nem ember (La kacha n’est<br />
pas un repas, une charrette<br />
à <strong>de</strong>ux roues n’en est pas<br />
une, le Slovaque n’est pas<br />
un homme). Voir Hensel L.,<br />
« Przebudzenie narodowe<br />
Słowaków » (Le réveil<br />
national <strong>de</strong>s Slovaques),<br />
in : Przemiany fomuły<br />
polskości w drugiej połowy<br />
XIX wieku (Les<br />
modifications du concept <strong>de</strong><br />
polonité durant la secon<strong>de</strong><br />
moitié du XIX e siècle) (Sous<br />
la direction <strong>de</strong><br />
Maciejewski J.), Instytut<br />
Badań Literackich,<br />
Varsovie, 1999, p. 291.<br />
13 - Andrzej Findor<br />
présente ces relectures<br />
dans son article<br />
« Tisicročná poroba? » (Une<br />
servitu<strong>de</strong> millénaire ?), in :<br />
Mýty naše slovenské (Nos<br />
mythes slovaques) (Sous la<br />
direction <strong>de</strong> Krekovič E.,<br />
Mannová E. &<br />
Krekovičová E.), AEP,<br />
Bratislava, 2005,<br />
pp. 71-76.
Joann a Goszczyńsk a<br />
La nation dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža<br />
compréhension mutuelle et <strong>de</strong> respect <strong>de</strong>s différences. Les valeurs chrétiennes<br />
étaient les fon<strong>de</strong>ments sur lesquels elle <strong>de</strong>vait reposer. C’était ces valeurs qui<br />
définissaient l’i<strong>de</strong>ntité européenne commune.<br />
Cette vision globalisante doit cependant être nuancée. Le projet <strong>de</strong> Hodža ne<br />
se limitait en effet pas à décrire une union supraéthnique <strong>de</strong> communautés<br />
nationales basée sur le principe du bon vouloir. À l’intérieur <strong>de</strong> cette large<br />
communauté, le poète distinguait un territoire plus petit, celui <strong>de</strong> l’Autriche, qui<br />
<strong>de</strong>vait lier, unir les nations slaves. Il voyait en l’Autriche chrétienne la garante <strong>de</strong><br />
l’aplanissement <strong>de</strong>s conflits et du maintien <strong>de</strong>s différences nationales.<br />
Dans cette œuvre, l’auteur exprimait une attitu<strong>de</strong> envers l’Autriche que l’on<br />
pourrait qualifier <strong>de</strong> loyalisme radical, voire soumis. Dans son poème, Hodža fit une<br />
déclaration <strong>de</strong> loyauté envers la patrie autrichienne, il se définit lui-même comme<br />
son fils fidèle, il souligna le mérite <strong>de</strong>s dirigeants autrichiens, <strong>de</strong> la l’impératrice<br />
Marie-Thérèse et <strong>de</strong> l’empereur François-Joseph dans le règlement <strong>de</strong> la situation<br />
juridique <strong>de</strong>s paysans. On voit affleurer ici très clairement le mythe du bon<br />
empereur répandu dans toute la Galicie, et habilement étayé par la propagan<strong>de</strong><br />
autrichienne.<br />
Le poète présentait l’Autriche comme un territoire pour les Slaves dans leur<br />
ensemble, comme la patrie <strong>de</strong> tous les Slaves. Mais surtout, il soulignait fortement<br />
sa signification pour les Slovaques. Le Slovaque « tué » dans le royaume <strong>de</strong><br />
Hongrie, « ressuscitera » en Autriche. Sa vision <strong>de</strong> la réorganisation du territoire<br />
européen s’opposait clairement avec les projets panslavistes qui plaçaient leurs<br />
espoirs en la Russie. Hodža en appelait au concept dominant <strong>de</strong> « Všeslavi », c'est-<br />
à-dire <strong>de</strong>s « slaves dans leur ensemble », sur lequel se basaient diverses variantes<br />
<strong>de</strong> l’idée slave, et liait cette conception à l’Autriche. En appelant les Slaves à se<br />
relever <strong>de</strong> leur chute, à renaître, il montre l’Autriche comme étant le lieu « <strong>de</strong> tous<br />
les Slaves » (v Rakusii mas tiež Všeslaviu : « en Autriche aussi, tu trouves tous les<br />
slaves »). Une fois encore, il tirait sa conception <strong>de</strong> la tradition gran<strong>de</strong>-morave,<br />
associée à celle <strong>de</strong> Cyrille et Métho<strong>de</strong> tout en se limitant cependant à sa version<br />
mythifiée. Hodža en soulignait <strong>de</strong>ux aspects. Il considérait la Gran<strong>de</strong>-Moravie<br />
comme, d’une part, le territoire qui fut le fon<strong>de</strong>ment (l’embryon) <strong>de</strong> la communauté<br />
slave, et d’autre part comme le lieu <strong>de</strong> la mémoire à partir duquel se répandit la<br />
mission chrétienne <strong>de</strong> Cyrille et Métho<strong>de</strong>.<br />
Dans la construction <strong>de</strong> cette communauté slave considérée comme une<br />
partie <strong>de</strong> la communauté européenne, le poète assignait un rôle particulier aux<br />
Slovaques. Ce rôle provenait du fait qu’ils étaient les héritiers <strong>de</strong> la tradition<br />
gran<strong>de</strong>-morave et qu’ils étaient une nation qui avait souffert, ce qui avait poussé<br />
Dieu à les choisir pour réaliser son plan. Cet argument principal était accompagné<br />
d’autres, qui s’inscrivaient dans le problème toujours vivace <strong>de</strong>s relations<br />
tchécoslovaques. Celles-ci avaient été fondamentalement modifiées après la<br />
codification <strong>de</strong> la langue slovaque. Hodža rappelait que c’était <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong><br />
la nation slovaque, Pavel Jozef Šáfárik, Ján Kollár et Ján Hollý qui avaient été les<br />
premiers à formuler <strong>de</strong>s idées concernant la communauté slave. À cette occasion, il<br />
[14]
La nation dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža<br />
Joann a Goszczyńsk a<br />
en appelait aux Tchèques pour qu’ils acceptassent, pour le bien <strong>de</strong> cette<br />
communauté, la particularité <strong>de</strong> la langue slovaque.<br />
Dans la construction <strong>de</strong> sa conception <strong>de</strong> la communauté européenne idéale,<br />
Hodža n’oubliait pas les questions délicates, celles qui exigeaient d’être résolues au<br />
préalable. À côté <strong>de</strong>s relations slovaco-tchèques, celles qu’entretenaient les<br />
Slovaques avec les Hongrois méritaient qu’on y prêtât attention. Sa conception<br />
d’une patrie slave commune créée dans le cadre <strong>de</strong> l’Autriche ne s’élevait pas<br />
uniquement à l’encontre <strong>de</strong>s projets panslavistes mais également contre l’idée,<br />
chère aux Hongrois, d’un État national indépendant qui limiterait le droit national et<br />
linguistique <strong>de</strong>s Slovaques (ainsi que <strong>de</strong>s autres nations non hongroises placées<br />
dans le périmètre du royaume <strong>de</strong> Hongrie). Hodža s’opposait très violemment à<br />
cette conception politique <strong>de</strong> la nation, car il voyait en elle la manifestation <strong>de</strong> ce<br />
que l’on appellerait actuellement un colonialisme pour le moins injustifié. Dans un<br />
geste chrétien d’unification et <strong>de</strong> pardon, il considérait cependant que les Hongrois<br />
pécheurs avaient une place dans l’Europe transformée.<br />
L’utopie messianique qu’exprima Hodža considérait donc les Slovaques, et<br />
plus largement les Slaves, comme une nation choisie pour faire renaître l’Europe,<br />
elle <strong>de</strong>vait par la force <strong>de</strong>s choses influer sur la situation <strong>de</strong>s autres nations<br />
européennes qui <strong>de</strong>vaient quitter l’arène <strong>de</strong> l’Histoire. Contrairement à la majorité<br />
<strong>de</strong>s projets slavophiles ou panslavistes, le poète n’exposait pas une opposition entre<br />
Slaves et Européens, il n’opposait pas frontalement un Occi<strong>de</strong>nt « déchu » à un<br />
jeune Orient en expansion, il considérait plutôt le Slave comme un élément <strong>de</strong><br />
l’Europe et l’Europe occi<strong>de</strong>ntale vieillissante comme un territoire qui <strong>de</strong>mandait<br />
défense et soutien. Il est vrai qu’il reprochait à l’Europe son attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> colonisatrice<br />
envers les nations slaves, mais il tentait aussi <strong>de</strong> la justifier par le fait que l’Europe<br />
ne comprenait pas les vraies valeurs que possédaient ces nations. À la liste <strong>de</strong>s<br />
traits communs qu’il assignait aux Slaves, il ajoutait leur rôle <strong>de</strong> remparts du<br />
christianisme. Cet argument lui servait à légitimer la communauté élargie formée<br />
par les Slaves et le reste <strong>de</strong> l’Europe, née <strong>de</strong> la volonté <strong>de</strong> Dieu dans le but <strong>de</strong><br />
s’opposer à la dégradation causée par l’Islam. C’est dans ce contexte<br />
qu’apparaissait aux yeux du poète la valeur fondamentale <strong>de</strong>s Slaves : la foi<br />
remplaçait chez eux les systèmes philosophiques en vigueur. Nous revenons ici à un<br />
problème déjà évoqué qui est le fait que Hodža basait tout son projet<br />
historiosophique sur sa foi dans le Christ. Puisqu’ils étaient ceux qui croient en la<br />
religion du Christ, les Slaves construiraient une nouvelle communauté, une<br />
« Nouvelle Jérusalem ». La Figure du Christ, incarnation du verbe divin, <strong>de</strong>vait<br />
<strong>de</strong>venir un modèle pour les nations appelées à renaître. Elle était un modèle pour le<br />
poète lui-même, qui s’imaginait être la nouvelle incarnation du verbe, l’homme <strong>de</strong><br />
Dieu, auquel fut assignée la mission <strong>de</strong> réveiller les nations slaves et <strong>de</strong> montrer la<br />
voie, indiquée par le Christ, qu’ils <strong>de</strong>vaient suivre pour être sauvés. C’est l’amour et<br />
la souffrance, qui faisaient partie <strong>de</strong> sa vie, qui le pré<strong>de</strong>stinaient pour ce rôle.<br />
[15]
Joann a Goszczyńsk a<br />
La nation dans les conceptions messianiques <strong>de</strong> Michal Miloslav Hodža<br />
L’historiographie <strong>de</strong> Hodža se rapproche <strong>de</strong> la variante polonaise <strong>de</strong> la pensée<br />
messianique, telle que l’incarne Towiański, en ceci que son prophétisme unilatéral<br />
expose le rôle du Christ et que la philosophie <strong>de</strong> l’histoire présentée dans le poème<br />
se base sur un fon<strong>de</strong>ment fortement religieux. Dans sa typologie du messianisme<br />
polonais, Adam Sikora décrit ce type <strong>de</strong> messianisme comme un messianisme <strong>de</strong> la<br />
foi 14 . Les <strong>de</strong>ux penseurs se retrouvent également sur d’autres conceptions telles<br />
que l’idée du développement historique en trois temps et la critique <strong>de</strong> « l’Église<br />
institutionnalisée ». Cette <strong>de</strong>rnière a été, comme on le sait, présentée dans ses<br />
cours au Collège <strong>de</strong> France (1840-1844) par Mickiewicz qui, à différents moments<br />
<strong>de</strong> sa conception historiosophique évolutive, lia le messianisme individuel,<br />
personnel, au messianisme national. De multiples trames <strong>de</strong> « Vieroslavín » vont<br />
dans le sens <strong>de</strong> la pensée <strong>de</strong> Towiański et <strong>de</strong> Mickiewicz, on ne peut pas exclure<br />
non plus que les conceptions <strong>de</strong> Jozef Hoene-Wroński 15 (1778-1853) étaient<br />
connues <strong>de</strong> Hodža. Ce thème s’inscrit toutefois déjà dans la problématique plus<br />
large <strong>de</strong>s inspirations polonaises du messianisme slovaque.<br />
Nous avons présenté rapi<strong>de</strong>ment, par la force <strong>de</strong>s choses,<br />
comment un <strong>de</strong>s messianistes slovaques, qui était d’ailleurs assez peu<br />
connu comme tel, considérait sa nation. Ses conceptions jettent une<br />
lumière nouvelle sur la position <strong>de</strong>s poètes et <strong>de</strong>s penseurs slovaques<br />
au sujet <strong>de</strong> leur vision du futur et du rôle <strong>de</strong>s Slaves. Dans les<br />
conceptions historiosophiques, comme dans les conceptions<br />
messianistes (notamment celles <strong>de</strong> Hroboň, surtout dans sa<br />
composition poétique intitulée « Slovenské iskrice ») ou missionistes<br />
(dont « Slovanstvo a svet budúcnosti » 16 <strong>de</strong> Štur est un bon exemple)<br />
qui se cristallisèrent après la révolution, la mission <strong>de</strong>s Slaves était<br />
rattachée au rôle directeur <strong>de</strong> la Russie. Hodža quant à lui situait son<br />
projet dans un autre horizon politique en voyant le futur <strong>de</strong>s Slaves<br />
dans l’orbite autrichienne. Et ce après l’accord austro-hongrois <strong>de</strong><br />
1867 qui fit <strong>de</strong> la monarchie <strong>de</strong>s Habsbourg un double État, au<br />
moment où même František Palacký, le créateur <strong>de</strong> l’austroslavisme,<br />
croyait <strong>de</strong> moins en moins à la réalisation <strong>de</strong> ses propositions et qu’il<br />
Joanna GOSZCZYŃSKA<br />
est Professeur, directrice<br />
<strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong><br />
Slavistique (Europe<br />
centrale et méridionale)<br />
<strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong><br />
Varsovie (Pologne)<br />
écrivait sa célèbre phrase : « Nous [= les Tchèques]<br />
étions là avant l’Autriche, nous seront encore là après<br />
elle », lui qui avait auparavant déclaré que si l’Autriche<br />
n’existait pas, il faudrait l’inventer.<br />
(Traduit du polonais par Jeremy Lambert)<br />
[16]<br />
14 - Sikora A., Myśliciele<br />
polskiego romantyzmu (Les<br />
Penseurs du romantisme<br />
polonais), Verba, Chotomów,<br />
1992, p. 10.<br />
15 - Le but recherché par Hœne-<br />
Wroński était la réforme du<br />
savoir humain et l’établissement<br />
<strong>de</strong> la vérité absolue sur la terre.<br />
Ce penseur extrêmement fécond<br />
en terme <strong>de</strong> publications se dit<br />
l’inventeur du concept <strong>de</strong><br />
« messianisme ». (NdT)<br />
16 - En français : « Les Slaves et<br />
le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’avenir » (milieu<br />
<strong>de</strong>s années 1850). Ce texte fut<br />
d’abord écrit en allemand puis<br />
traduit en russe, il fut publié<br />
dans cette langue en 1867. Les<br />
œuvres <strong>de</strong>s Hroboň et celles <strong>de</strong><br />
Štúr ont tant <strong>de</strong> points communs<br />
dans leur expression idéologique<br />
que l’on peut les considérer<br />
comme <strong>de</strong>s variantes poétiques<br />
et publicistes <strong>de</strong> la fascination<br />
qu’exerçait le panslavisme. À ceci<br />
près toutefois que le traité <strong>de</strong><br />
Štúr propose un projet<br />
historiosophique élargi et montre<br />
d’assez larges convergences avec<br />
les idéologues russes <strong>de</strong> l’époque<br />
<strong>de</strong> l’empereur Nikolaj I, alors que<br />
l’œuvre <strong>de</strong> Hroboň se concentre<br />
principalement sur le rôle <strong>de</strong> la<br />
Russie dans la future renaissance<br />
<strong>de</strong>s Slaves qui doivent, selon la<br />
mission que Dieu leur a assigné,<br />
faire renaître l’humanité. Je<br />
développe ce thème dans<br />
Synowie Słowa. Myśl<br />
mesjanistyczn w słowackiej<br />
literaturze romantycznej (Les Fils<br />
du Verbe. La pensée messianique<br />
dans la littérature romantique<br />
slovaque), Wyd. Uniwersytetu<br />
Warszawskiego, Varsovie, 2008,<br />
220 p.
Julja Černjavskaja<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie<br />
biélorusse :<br />
la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
La situation historico-confessionnelle en Biélorussie du X e au XX e siècle<br />
Avant <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’analyse <strong>de</strong> la religion traditionnelle du peuple<br />
biélorusse, il conviendrait d’esquisser brièvement les origines historiques <strong>de</strong> la<br />
situation confessionnelle en Biélorussie, laquelle a été marqué par <strong>de</strong> fréquents<br />
troubles. Ce territoire est passé <strong>de</strong> nombreuses fois <strong>de</strong> la Pologne à la Russie et vice<br />
versa, impliquant <strong>de</strong> ce fait une « recoloration » confessionnelle <strong>de</strong> la population.<br />
Ainsi, quand elle faisait partie <strong>de</strong> la Rus’ <strong>de</strong> Kiev, la population <strong>de</strong>s terres<br />
biélorusses se convertit à l'orthodoxie, et la religion officielle <strong>de</strong>vint un marqueur <strong>de</strong><br />
conscience, du moins pour l’élite <strong>de</strong> la société : la paysannerie, c’est-à-dire la<br />
majorité, était principalement <strong>de</strong> confession païenne. C’est notamment pendant le<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Rus’ <strong>de</strong> Kiev que commença à se constituer sur le territoire <strong>de</strong> la<br />
Biélorussie tout un panthéon <strong>de</strong> nečistiki (les divinités païennes), qui plus tard<br />
accompagnèrent le Biélorusse tout au long <strong>de</strong> sa vie. Le rapport à celles-ci était<br />
ambivalent, allant <strong>de</strong> l’inimité à la sympathie.<br />
Quand les terres biélorusses furent intégrées au Grand-duché <strong>de</strong> Lituanie, la<br />
population <strong>de</strong> Biélorussie occi<strong>de</strong>ntale commença dès 1251 à se convertir
Julj a Če rnjav skaj a<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
progressivement au catholicisme conformément à l’oukase <strong>de</strong> Mindaugas. Du reste,<br />
il ne convient pas <strong>de</strong> situer le schisme entre les orthodoxes et les catholiques à ce<br />
moment-là : ils gardaient un ensemble considérable <strong>de</strong> croyances païennes ainsi<br />
que les normes et les valeurs <strong>de</strong> vie, <strong>de</strong> droit et d’éthique qui en découlaient. En<br />
général, dans le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s paysans, la transformation confessionnelle n’était<br />
pas tout à fait consciente : les gens continuaient à recourir à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s nečistiki et à<br />
expliquer leurs chances et malchances par les actions <strong>de</strong> ceux-ci.<br />
La pério<strong>de</strong> suivante était celle <strong>de</strong> l’union du Grand-duché <strong>de</strong> Lituanie et <strong>de</strong> la<br />
Couronne polonaise (1569). La conséquence en fut une conversion massive et – à la<br />
différence <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte – consciente <strong>de</strong> la noblesse du Grand-duché au<br />
catholicisme. Le noble catholique recevait <strong>de</strong>s privilèges juridiques qui lui donnaient<br />
la possibilité non seulement <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong>s honneurs, mais aussi <strong>de</strong> s’enrichir. En<br />
ce qui concerne les serfs, leur conversion au catholicisme avait un caractère forcé et<br />
était déterminé par les volontés du noble (le « pan »). Dans les milieux<br />
professionnels et artisans <strong>de</strong>s villes, la « catholicisation » était assurée par<br />
l’enseignement en polonais (souvent gratuit) dans les collèges et les écoles jésuites.<br />
L’union <strong>de</strong> Brest-Litovsk (1596) qui tenta <strong>de</strong> réconcilier les confessions en mettant<br />
en place un moyen terme, l’uniatisme, se solda par un échec sur les terres<br />
biélorusses, contrairement à l’Ukraine.<br />
Suite au traité <strong>de</strong> Tilsit en 1807, le territoire ethnique <strong>de</strong> Biélorussie actuel fut<br />
intégré à l’empire russe. À partir <strong>de</strong> cette époque, l’orthodoxie commença à<br />
pénétrer la population aussi brutalement qu’elle en avait été extirpée. Les<br />
persécutions du catholicisme et dans l’ensemble du « début d’occi<strong>de</strong>ntalisation » <strong>de</strong><br />
la culture biélorusse acquirent un caractère particulièrement aigu après les<br />
soulèvements <strong>de</strong> 1831 et <strong>de</strong> 1863.<br />
Ainsi, les perturbations confessionnelles sur les terres biélorusses<br />
s’exprimaient « par le fer et par le feu » et portèrent préjudice en premier lieu à la<br />
paysannerie, la couche la plus nombreuse et la plus opprimée <strong>de</strong> la population.<br />
Malgré que cette couche fût à peine consciente <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong>s tempêtes qui se<br />
déchaînaient sur sa terre, les conséquences considérables <strong>de</strong> celles-ci se firent<br />
sentir sur les conceptions religieuses <strong>de</strong>s paysans biélorusses et, dans<br />
l’ensemble, sur leur image du mon<strong>de</strong>. Comme l’a montré notre étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s contes du quotidien 1 , mis par écrit au tournant <strong>de</strong>s XIX e et XX e<br />
siècles (ici nous allons profiter <strong>de</strong>s notes <strong>de</strong> l’ethnographe et folkloriste<br />
Aleksandr Seržputovski [1864-1940]), une <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong><br />
l’opposition confessionnelle sur le territoire <strong>de</strong> la Biélorussie a été la<br />
formation d’une « religion paysanne » originale. Celle-ci s’est construite<br />
pas tant sur la base <strong>de</strong>s sermons <strong>de</strong> l’Église que sur la fusion<br />
symbiotique du Biélorusse avec sa terre natale. Ce type local et indigène<br />
d’i<strong>de</strong>ntité (ainsi que le type <strong>de</strong> religiosité qui lui correspond) est apparu<br />
comme le résultat <strong>de</strong> l’impossibilité <strong>de</strong> s’i<strong>de</strong>ntifier à une religion stable 2<br />
ou à un tout étatique stable.<br />
[18]<br />
1 – Černjavskaja J. V.,<br />
Belorus : štrihi k avtoportretu<br />
(Etničeskij<br />
samoobraz belorusa<br />
v skazkah) (Le Biélorusse :<br />
traits pour un autoportrait<br />
[Autoimage ethnique <strong>de</strong><br />
Biélorusse dans les<br />
contes]), Éd. Četyre<br />
četverti, Minsk, 2006,<br />
244 p.<br />
2 - Il faut ajouter que le<br />
processus d’i<strong>de</strong>ntification<br />
religieuse sur le territoire<br />
<strong>de</strong> la Biélorussie a été<br />
compliqué par une certaine<br />
différence <strong>de</strong> conceptions<br />
<strong>de</strong>s populations <strong>de</strong>s régions<br />
occi<strong>de</strong>ntales (traditionnellement<br />
plus catholiques)<br />
et centrales, mais aussi<br />
orientales (principalement<br />
orthodoxes). Dans le<br />
présent article, nous allons<br />
étudier plus spécialement<br />
les contes <strong>de</strong>s régions<br />
orientales et centrales <strong>de</strong> la<br />
Biélorussie.
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
Julj a Če rnjav skaj a<br />
Bases théoriques et méthodologiques <strong>de</strong> l’analyse<br />
Nos recherches sont interdisciplinaires : elles comprennent <strong>de</strong>s éléments<br />
d’analyse sémiotico-culturelle, <strong>de</strong> sociologie du quotidien, mais aussi <strong>de</strong> folklore et<br />
d’anthropologie culturelle. Cela conditionne l’approche générale, qui, par analogie à<br />
l’aphorisme du « retour à la nature » <strong>de</strong> Jean-Jacques Rousseau, peut être définie<br />
comme « un retour au texte ». Le texte nous apparaît comme un champ particulier<br />
<strong>de</strong> « compréhension » ou comme un prétexte à l’empathie culturologique.<br />
Ici se pose le problème du rapport entre la « compréhension » et<br />
« l’interprétation », et ce notamment dans la question <strong>de</strong> ses limites (question<br />
posée par Susan Sontag dans Contre l’interprétation en 1966). C’est pourquoi, en<br />
matière d’outil méthodologique <strong>de</strong> base, nous sommes guidée par le principe<br />
« d’idéal-type » <strong>de</strong> Max Weber 3 . Celui-ci considère que l’analyse la plus méticuleuse<br />
n’est pas capable <strong>de</strong> saisir tous les aspects du phénomène étudié. Par conséquent,<br />
la prétention à l’authenticité et à l’universalité ne doit pas être le but <strong>de</strong> l’analyse,<br />
mais bien la création d’un type idéal <strong>de</strong> « fantaisie scientifiquement disciplinée »<br />
(termes <strong>de</strong> Weber). Toutefois, cette fantaisie ne doit pas <strong>de</strong>venir « lâche » ou<br />
« étouffante » (termes <strong>de</strong> Sontag) : elle est obligée <strong>de</strong> proposer un certain<br />
« germe » invariable. De cette manière, l’idéal-type est le résultat<br />
d’une analyse scrupuleuse <strong>de</strong>s situations types, <strong>de</strong>s rapports sociaux<br />
ainsi que <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> comportement et <strong>de</strong> perception <strong>de</strong>s agents<br />
<strong>de</strong> l’action et <strong>de</strong> l’interaction, ce qui nous apparaît comme<br />
fondamental. Nous considérons que <strong>de</strong> tels modèles se reflètent dans<br />
les textes du folklore, qui, à leur tour, se présentent comme <strong>de</strong>s<br />
segments d’un texte plus large, un texte du quotidien <strong>de</strong>s paysans<br />
biélorusses.<br />
Nous adopterons une approche double qui est celle, d’une part,<br />
<strong>de</strong> l’anthropologie culturelle et, d’autre part, du folklore. Du point <strong>de</strong><br />
vue <strong>de</strong> l’anthropologie culturelle, nous partons du principe classique<br />
« at a distance » 4 <strong>de</strong> l’école « Culture et personnalité », qui propose<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la culture à distance. Mais si Ruth Benedict, Geoffrey Gorer,<br />
Margaret Mead 5 et <strong>de</strong> nombreux autres chercheurs ont analysé la<br />
culture <strong>de</strong> pays qu’ils ne fréquentaient pas par le biais <strong>de</strong>s textes issus<br />
<strong>de</strong> cette culture, alors dans notre cas la distance entre le chercheur et<br />
l’objet est encore plus insurmontable puisqu’elle s’avère temporelle<br />
(les contes dont nous parlons ont été écrits entre les XVII e et XIX e<br />
siècles et mis par écrits par <strong>de</strong>s ethnographes à la fin du XIX e et au<br />
début du XX e siècle).<br />
Puisque nous nous basons sur <strong>de</strong>s sources folkloriques, il s’est<br />
avéré nécessaire <strong>de</strong> se référer aux travaux <strong>de</strong> mythologues et <strong>de</strong><br />
folkloristes. Les travaux <strong>de</strong> Vladimir Propp, d’Eleazar Meletinskij, <strong>de</strong><br />
Sergej Nekljudov, fondateur <strong>de</strong> l’école mo<strong>de</strong>rne du « postfolkore »,<br />
dont l’activité se développe au sein <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> sciences<br />
[19]<br />
3 – Weber M., « Obektiv-nosť<br />
poznanija v oblasti socjal’nyh<br />
nauk i socjal’noj politiki »<br />
(L’objectivité <strong>de</strong> la<br />
connaissance dans le domaine<br />
<strong>de</strong>s sciences sociales et <strong>de</strong> la<br />
politique sociale),<br />
in : Kul’turologija. XX vek<br />
(Culturologie. Le XXe siècle),<br />
Univer-sitetskaja kniga,<br />
Moscou, 1995, pp. 557-603.<br />
4 – Mead M., Metraux Ph.,<br />
The study of Culture at a<br />
Distance (L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
culture à distance), University<br />
of Chicago Press, Chicago,<br />
1953, 480 p.<br />
5 - I<strong>de</strong>m ; Gorer G.,<br />
Rickman J., The people of<br />
Great Russia : a Psychological<br />
Study (Le peuple <strong>de</strong><br />
Gran<strong>de</strong> Russie : une étu<strong>de</strong><br />
psychologique), The Gresset<br />
Press, London, 1949, 235 p. ;<br />
Dubois C., The People of Alor<br />
: a Socio-Psychological Study<br />
of an East Indian Island (Le<br />
peuple d’Alor : une étu<strong>de</strong><br />
socio-psychologique d’une île<br />
indienne orientale), University<br />
Minnesota Press, Minneapolis,<br />
1944, 654 p. ; Benedict R.,<br />
Hrizantema I meč : mo<strong>de</strong>li<br />
japonskoj kul’tury (Le<br />
chrysanthème et le saber : les<br />
modèles <strong>de</strong> la culture<br />
japonaise), ROSSPEN,<br />
Moscou, 2004, 256 p. ;<br />
Mead M., Kul’tura I mir<br />
<strong>de</strong>tstva. Izbrannye<br />
proizve<strong>de</strong>nija (La culture et le<br />
mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’enfance. Œuvres<br />
choisies), Nauka, Moscou,<br />
1988, 429 p.
Julj a Če rnjav skaj a<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
humaines d’État russe <strong>de</strong> Moscou (RGGU) 6 . Le recours à la méthodologie <strong>de</strong> ces<br />
auteurs se justifie par le fait que, travaillant dans la tradition folklorique, ils placent<br />
leurs recherches dans un contexte anthropologique bien plus large que l’étu<strong>de</strong><br />
traditionnelle du folklore. Ils étudient le folklore comme un réservoir d’habitus qui<br />
déterminent le tableau du mon<strong>de</strong>, les modèles quotidiens <strong>de</strong> vie ainsi que les<br />
stratégies <strong>de</strong> comportement et d’action <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong> la culture.<br />
La théorie <strong>de</strong> l’habitus <strong>de</strong> Pierre Bourdieu est pour nous fondamentale.<br />
L’habitus est un système <strong>de</strong> dispositions transposables (d’orientations,<br />
<strong>de</strong> valeurs, <strong>de</strong> schémas <strong>de</strong> perception et d’action), qui se structurent<br />
<strong>de</strong> l’extérieur (par le pouvoir, la situation socioculturelle, la langue,<br />
etc.) et qui en même temps structurent « <strong>de</strong> l’intérieur » 7 le champ <strong>de</strong><br />
la culture. Le concept d’habitus est irremplaçable pour l’analyse <strong>de</strong><br />
textes <strong>de</strong> la culture traditionnelle : il indique le mécanisme <strong>de</strong><br />
conservation <strong>de</strong> cette tradition ainsi que <strong>de</strong>s changements qui y ont<br />
été apportés par les gens. « L’habitus du sacré » est, dans n’importe<br />
quelle culture, un <strong>de</strong>s plus importants. L’agent <strong>de</strong> la culture le traite à<br />
la fois comme le plus haut <strong>de</strong>ssein et comme une activité quotidienne.<br />
Le but <strong>de</strong> l’article sera <strong>de</strong> définir l’habitus du sacré dans la culture<br />
traditionnelle biélorusse.<br />
Pour ce faire, notre étu<strong>de</strong> s’appuiera sur <strong>de</strong>s textes folkloriques<br />
et plus particulièrement <strong>de</strong>s contes biélorusses du quotidien. Notre<br />
choix a été motivé par une série <strong>de</strong> raisons. Premièrement, le folklore<br />
donne la représentation d’un ordre stable <strong>de</strong>s choses et, par<br />
conséquent, du quotidien, compris comme une sphère spécifique du<br />
rapport entre le sacré et le séculier. Deuxièmement, c’est précisément<br />
dans le folklore (et surtout dans les contes) que se transmet<br />
concrètement le lien entre les rôles social et linguistique, mais aussi<br />
sacré et profane, <strong>de</strong>s agents. Troisièmement, les contes révèlent <strong>de</strong>s<br />
modèles typiques <strong>de</strong> comportement qui font office <strong>de</strong> point <strong>de</strong> repère<br />
pour les nouvelles générations. Enfin, le plus important : les contes<br />
donnent une image vivante du héros. Dans notre cas, il s’agit <strong>de</strong><br />
l’image <strong>de</strong> Dieu, <strong>de</strong>s saints, <strong>de</strong>s prêtes et <strong>de</strong>s « saints hommes ». Les<br />
sources servant <strong>de</strong> matériel pour l’article sont constituées <strong>de</strong>s contes<br />
réunis par Seržputovskij ainsi que d’une série <strong>de</strong> textes <strong>de</strong> la même<br />
époque provenant <strong>de</strong>s recueils d’autres chercheurs.<br />
L’image <strong>de</strong> Dieu dans le conte biélorusse : mystique et pragmatique<br />
La religion traditionnelle du Biélorusse se construit autour <strong>de</strong> son<br />
lien avec la terre, comprise comme un capital tant économique que<br />
symbolique. C’est <strong>de</strong> là que proviennent non seulement les<br />
représentations païennes 8 liées aux esprits impurs (les nečistki que<br />
[20]<br />
6 – Bogdanov K.,<br />
Povsednevnosť i mifologija.<br />
Issledovanie po semiotike<br />
foľklornoj <strong>de</strong>jstvuteľnosti (Le<br />
quotidien et la mythologie.<br />
Recherches sur la sémiotique<br />
<strong>de</strong> la réalité folklorique),<br />
Isskustvo, Saint-<br />
Pétersbourg, 2001, 438 p. ;<br />
Nekljudov S. J., « Istoričeskij<br />
narrativ : meždu “reaľnoj<br />
<strong>de</strong>jstvitel’nosťju” i foľklornomifologičeskoj<br />
shemoj »<br />
(« La narration historique :<br />
entre "réalité réelle" et<br />
schéma mytho-folklorique »),<br />
in : Mifologija i<br />
povsednevnosť (Mythologie<br />
et quotidien), RGGU, Saint-<br />
Pétersbourg, 1998,<br />
pp. 288-292 ;<br />
Nekludov S. J., Struktura<br />
i funkcija mifa (Structure et<br />
fonction du mythe), in : Mify<br />
v sovremennoj Rossii (Les<br />
mythes dans la Russie<br />
mo<strong>de</strong>rne), AIRO-HH,<br />
Moscou, 2000, pp. 17-38 ;<br />
Meletinskij E. M., Poetika<br />
mifa, Vostočnaja literatura<br />
RAN, Moscou, 1995, 408 p. ;<br />
Propp V. J., Morfologija<br />
skazki (La morphologie du<br />
conte merveilleux), Nauka,<br />
Moscou, 1969, 128 p. ; etc.<br />
7 – Bourdieu P., Načala (Le<br />
début), Socio-Logos, Moscou,<br />
1994, pp. 193-194.<br />
8 - Du reste, nous sommes<br />
loin <strong>de</strong> considérer le<br />
paganisme comme une<br />
« religion véritablement<br />
biélorusse », comme le<br />
pensent <strong>de</strong> nombreux<br />
chercheurs biélorusses<br />
contemporains, qui<br />
l’opposent au christianisme.<br />
À notre avis, <strong>de</strong> telles<br />
opinions ne se basent pas<br />
tant sur <strong>de</strong>s objectifs<br />
scientifiques<br />
qu’idéologiques : ils<br />
opposent à l’orthodoxie<br />
« russe » le paganisme<br />
« biélorusse », réclamé en<br />
qualité <strong>de</strong> base<br />
métaphysique pour se<br />
distancier <strong>de</strong> la Russie<br />
contemporaine. De cette<br />
manière, nous avons affaire<br />
ici à un phénomène <strong>de</strong><br />
« téléologie rétrospective »<br />
(termes <strong>de</strong> Louis Althusser).
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
Julj a Če rnjav skaj a<br />
sont les gumennik 9 , ovinnik 10 , hlevnik 11 , rusalki 12 , vodjaniki 13 , etc.), mais surtout<br />
l’image du Dieu « terrestre », « paysan ».<br />
Dans la conscience populaire, l’image <strong>de</strong> Dieu est polysémique. Les<br />
contes contiennent une image « déiste » <strong>de</strong> Dieu, qui a créé la terre ainsi<br />
que tout ce qui s’y trouve pour les hommes ; pour lui-même il a créé le<br />
ciel, où il s’est caché <strong>de</strong>s péchés humains. Il existe aussi une image<br />
« apocryphe » <strong>de</strong> Dieu, propre à <strong>de</strong> nombreuses cultures traditionnelles :<br />
« Dieu est juste, mais très fâché. Il ne pardonnera jamais le mal. » 14 Ici le<br />
problème <strong>de</strong> théodicée est résolu par <strong>de</strong>s « moyens locaux » : « Si Dieu le<br />
voulait, il anéantirait tous les diables, tous les esprits malins et<br />
l’abomination, il ne le fait cependant pas pour que les gens aient peur,<br />
sinon ils oublieraient Dieu lui-même. » 15 Il y a également une image<br />
« transcendante » <strong>de</strong> Dieu : la légen<strong>de</strong> insiste sur le fait qu’il y a<br />
simplement <strong>de</strong>s dieux et un Dieu au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s dieux 16 . À la différence<br />
<strong>de</strong>s « simples dieux », le Dieu qui est au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s dieux ne possè<strong>de</strong> pas<br />
d’apparence anthropomorphe, il est plutôt i<strong>de</strong>ntique au Destin, au Fatum.<br />
Toutefois, l’image du « Dieu terrestre, paysan » est la plus<br />
répandue. La création du mon<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’homme, l’accoutumance <strong>de</strong><br />
l’homme au travail et l’établissement d’un ethos du travail, constituant le<br />
cœur <strong>de</strong> la vie du paysan biélorusse, sont notamment liés à celle-ci.<br />
« Jadis les gens étaient bêtes ; ils ne pouvaient rien faire » 17 , c’est<br />
pourquoi le Christ et la Mère <strong>de</strong> Dieu se sont rendus sur terre et ont<br />
enseigné « comment vivre sur terre, comment cultiver la terre pour que<br />
chaque chose profite à l’homme » 18 . Le travail tout comme l’esprit<br />
pratique sont jugés agréables à Dieu.<br />
L’exemple <strong>de</strong> Dieu se ressent dans la concrétisation <strong>de</strong> l’activité<br />
humaine. Pendant l’âge d’or, Dieu (le Christ) est venu chez les hommes<br />
et, « comme un frère, il leur enseigna comment vivre sur terre et<br />
comment engendrer <strong>de</strong>s enfants, engendrer et élever <strong>de</strong>s enfants et<br />
combler la terre… Les gens, comme <strong>de</strong>s fleurs, fleurissaient, vivaient<br />
comme <strong>de</strong>s oiseaux dans le ciel ou <strong>de</strong>s poissons dans l’eau. Ils se<br />
servaient <strong>de</strong> ce qu’ils trouvaient et ne craignaient ni le malheur, ni la<br />
pauvreté. Mais qu’est-ce que la vie ? Ainsi vivent les bêtes <strong>de</strong>s forêts et<br />
les morceaux <strong>de</strong> bois. L’ayant remarqué, Dieu se mit à apprendre aux<br />
hommes comment attraper plus facilement du gibier, comment se faire<br />
<strong>de</strong>s vêtements, comment s’abriter lors <strong>de</strong>s intempéries, comment attraper<br />
les poissons, <strong>de</strong>s bêtes, <strong>de</strong>s oiseaux. Et les hommes comprirent que celui<br />
que Dieu avait pourvu <strong>de</strong> raison pouvait faire ce qu’il voulait » 19 . C’est<br />
cependant le travail qui est reconnu comme le plus honorable sur terre : il<br />
est réformateur comme les actions <strong>de</strong> Dieu qui a créé la terre. De cette<br />
manière, Dieu sanctionne « le rapport au mon<strong>de</strong> tout comme à<br />
l’exploitation <strong>de</strong> la terre » 20 et, par conséquent, un respect particulier pour<br />
le travail <strong>de</strong>s paysans.<br />
[21]<br />
9 - Dans la mythologie<br />
russe, le gumennik est un<br />
esprit démoniaque <strong>de</strong> la<br />
grange (gymno), lieu où l’on<br />
séchait le blé. Le gumennik<br />
peut y mettre le feu s’il est<br />
mécontent. (NdT)<br />
10 - L’ovinnik est un esprit<br />
féroce qui se cache dans le<br />
séchoir à blé. Selon les<br />
régions, il est représenté<br />
sous les traits d’un chat noir<br />
aux yeux noirs, d’un mouton<br />
ou d’un mort. Il est difficile<br />
d’amadouer l’ovinnik, dont<br />
le rôle principal est <strong>de</strong><br />
surveiller la grange. La<br />
croyance aux méfaits <strong>de</strong><br />
l’ovinnik vient du fait que le<br />
séchoir à blé (ovin)<br />
fonctionne avec un feu<br />
ouvert, lequel a plus d’une<br />
fois fait <strong>de</strong>s ravages. (NdT)<br />
11 - Le hlevnik est l’esprit<br />
<strong>de</strong> l’étable (hlev). (NdT)<br />
12 - Sous ses apparences<br />
<strong>de</strong> belle jeune fille, la<br />
rusalka est une ondine,<br />
proche <strong>de</strong> la sirène, vivant<br />
dans les rivières. (NdT)<br />
13 - Esprit malin <strong>de</strong>s eaux,<br />
le vodjanik est aussi appelé<br />
vodjanoj. Ressemblant à un<br />
vieillard, il pousse les gens<br />
dans l’eau et les noie. (NdT)<br />
14 - Seržputojskij A. K.,<br />
Prymh i zabobony belarusajpalešukoj<br />
(Croyances et<br />
superstitions du peuple<br />
biélorusse polésien),<br />
Universiteckae, Minsk,<br />
1998, p. 236.<br />
15 - I<strong>de</strong>m.<br />
16 - Legendy i padannyi<br />
(Légen<strong>de</strong>s religieuses et<br />
légen<strong>de</strong>s locales),<br />
Grynblat M. & Gruski A.<br />
(dir.), Navuka i Tehnika,<br />
Minsk, 1983, p. 40.<br />
17 - Seržputojski A. K.,<br />
Kazki i anavjadanni<br />
belarucaj Sluckaga poveta<br />
(Contes et récits du district<br />
<strong>de</strong> Sluck), Universiteckae,<br />
Minsk, 2000, p. 105.<br />
18 - I<strong>de</strong>m.<br />
19 – Seržputojski A. K.,<br />
Prymh... Op. cit., p. 125.<br />
20 - En Biélorussie, par le<br />
mot russe « hozjajstvo »<br />
(« gaspadarka » en<br />
biélorusse), on entend la<br />
propriété paysanne (la<br />
maison, la parcelle <strong>de</strong> terre,<br />
le potager, le bétail<br />
domestique, etc.).
Julj a Če rnjav skaj a<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
Dans le conte « Le chasseur et le pêcheur », <strong>de</strong>ux frères refusaient <strong>de</strong> suivre<br />
le même parcours que leur père : l’agriculture. L’un <strong>de</strong>vint chasseur : « Les gens<br />
allaient au travail alors que lui, il épaulait son fusil et, hop, allait dans la forêt ou le<br />
marais. Il traînait là toute la journée et revenait à la maison les mains vi<strong>de</strong>s, affamé<br />
comme un loup. » 21 Le <strong>de</strong>uxième frère « restait assis jour et nuit au bord <strong>de</strong> la<br />
rivière et pêchait <strong>de</strong>s poissons. Il attrapait un tas <strong>de</strong> tout petits poissons : <strong>de</strong> quelle<br />
utilité étaient-ils pour le ménage ? » 22 Il n’y eut rien d’étonnant à ce que, quand le<br />
père se fit vieux, la propriété <strong>de</strong>vint si délabrée qu’il n’avait plus rien à offrir au<br />
sage voyageur qui se présenta. Le pèlerin partagea sa propre aumône avec les fils<br />
et dit avec du bon sens : « Ainsi, vous voyez, il [le père] est vieux, il s’est nourri et<br />
vous a nourri grâce à son exploitation ; sans cette exploitation, vous, jeunes et<br />
robustes que vous êtes, ne pouvez pas survivre. » 23 Remarquons que sous les traits<br />
<strong>de</strong> « sage », <strong>de</strong> « pèlerin » se cache souvent Dieu en personne.<br />
Ainsi, le travail peut porter ses fruits ; s’il ne le peut, il n’est pas considéré<br />
comme véritable car, étant donné par Dieu, il dépend, bien que dans une moindre<br />
mesure que l’agriculture, <strong>de</strong>s efforts journaliers et <strong>de</strong> la conséquence <strong>de</strong>s actions.<br />
C’est pourquoi tant le chasseur que le pêcheur (et d’autres professions <strong>de</strong> village<br />
comme le forgeron, le meunier, etc.) sont constamment associés au diable dans la<br />
conscience populaire, car ils font contrepoids au paysan (ou comme il s’appelle lui-<br />
même le « moujik »), qui accomplit un travail saint. Il est probable que le rejet <strong>de</strong><br />
l’image <strong>de</strong> « l’étranger » (du pan, du citadin, du soldat, du juif, etc.), liée à <strong>de</strong>s<br />
professions non-champêtres, joue ici un rôle significatif.<br />
En raison <strong>de</strong> l’égoïsme humain, Dieu apparaît <strong>de</strong> plus en plus rarement sur<br />
terre sous sa « vraie » apparence traditionnelle et il ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> plus en plus rarement<br />
l’homme dans ses détresses : « Avant, quand les hommes respectaient Dieu et lui<br />
obéissaient, Il leur donnait tout ce qu’il fallait, mais maintenant les jeunes ont<br />
complètement oublié Dieu, et c’est <strong>de</strong> là que viennent tous les malheurs… » 24 Par<br />
contre, si l’homme croit en Dieu et suit ses conseils, il reçoit une récompense.<br />
Comme nous l’avons déjà noté, au moment où ces contes dont nous parlons furent<br />
couchés sur le papier (fin du XIX e – début du XX e siècle), Dieu est représenté, en<br />
règle générale, sous la forme d’un misérable pèlerin, d’un vieillard. Il voyage parce<br />
qu’il est nécessaire à chacun et qu’il doit partager son attention entre tous. C’est<br />
pourquoi il existe une représentation selon laquelle les rapports entre Dieu et les<br />
hommes se développent non pas avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Église, mais « face à face ». C’est<br />
<strong>de</strong> là que vient le sujet le plus populaire <strong>de</strong>s contes, qui est justement lié au contact<br />
direct entre Dieu et l’homme.<br />
Dans un conte, une femme qui avait donné du kvas à Dieu (qui s’était<br />
présenté sous la forme d’un pèlerin) est guérie <strong>de</strong> sa stérilité. Elle voit en rêve une<br />
haute montagne (image du paradis). Trois jeunes filles s’y promènent : ce sont trois<br />
déesses du Sort (Doli). L’une tresse une couronne <strong>de</strong> chardon et <strong>de</strong> sonchus, la<br />
<strong>de</strong>uxième d’épines et <strong>de</strong> branches, la troisième <strong>de</strong> seigle et <strong>de</strong> blé avec <strong>de</strong>s fleurs.<br />
Les jeunes filles débattent pour savoir à laquelle d’entre elles échoira<br />
l’enfant conçu. Finalement, elles déci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> faire comme Dieu<br />
[22]<br />
21 - Seržputojski A. K.,<br />
Kazki..., Op. cit., p. 74.<br />
22 - I<strong>de</strong>m.<br />
23 - Ibid., p. 76.<br />
24 - Seržputojski A. K.,<br />
Prymh..., Op. cit., p. 237.
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
Julj a Če rnjav skaj a<br />
l’ordonnera. Dans ce but, elles jettent une fleur en l’air. La troisième l’attrape. Un<br />
petit garçon naît et connaît une vie heureuse <strong>de</strong> paysan 25 . Ici s’entrelacent<br />
étroitement <strong>de</strong>s symboles culturels populaires : la récompense pour la bienveillance<br />
envers un faible vieillard (en effet, la femme ignore qu’elle donne du kvas à Dieu en<br />
personne), envers Dieu et le Sort, le fatalisme <strong>de</strong> ce qui est écrit « dans la<br />
<strong>de</strong>stinée », l’appel à Dieu dans une situation <strong>de</strong> choix. Deux moments méritent une<br />
attention particulière.<br />
Le premier tient au fait que Dieu est plus fort que le Sort. Il est comparable<br />
aux mythes grecs où le Destin antique est au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s dieux. Il est probable que<br />
les rapports inversés <strong>de</strong> Dieu et du Sort soient liés au monothéisme chrétien.<br />
L’immense force <strong>de</strong> Dieu peut s’expliquer par le fait que le Sort se présente sous la<br />
forme d’une femme et Dieu sous l’apparence d’un homme rendu sage par la vie. Le<br />
<strong>de</strong>uxième moment concerne les modèles <strong>de</strong> la vie future, symbolisés par les<br />
couronnes <strong>de</strong>s jeunes filles : la couronne <strong>de</strong> sonchus et <strong>de</strong> chardon présume une vie<br />
<strong>de</strong> pêcheur ou <strong>de</strong> voyageur ; la couronne d’épines et <strong>de</strong> branches évoque celle <strong>de</strong><br />
chasseur ; la couronne <strong>de</strong> seigle, <strong>de</strong> blé et <strong>de</strong> fleurs celle <strong>de</strong> paysan. Dieu fait<br />
comprendre que c’est précisément au <strong>de</strong>rnier type d’activité que va sa préférence.<br />
Remarquons que dans la couronne sont entrelacées <strong>de</strong>s fleurs : cela signifie que le<br />
travail du paysan ne suppose pas seulement <strong>de</strong>s efforts, mais aussi la joie <strong>de</strong> vivre<br />
dans un mon<strong>de</strong> merveilleux :<br />
Il gar<strong>de</strong> les oies et il regar<strong>de</strong> le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> Dieu, les alentours sont tellement beaux<br />
qu’il en est joyeux. Le soleil lumineux brille et dégage <strong>de</strong> la chaleur comme une<br />
mère sur son enfant. Un petit vent berce doucement les vertes branches sur les<br />
saules, la rivière luit à travers les rares buissons <strong>de</strong> noisetier comme un miroir… 26<br />
Comme nous le voyons, Dieu ne donne pas ses recommandations <strong>de</strong> manière<br />
littérale. Il préfère un « chemin détourné », une forme symbolique d’expression. En<br />
vérité, c’est en cela que se trouve le mysticisme, que se fait sentir l’essence<br />
ésotérique, laquelle se manifeste à travers les normes pragmatiques et prosaïques<br />
<strong>de</strong> la vie champêtre.<br />
Le fait suivant est lui aussi remarquable : malgré le « déplacement »<br />
purement païen <strong>de</strong> Dieu sur terre, ces caractéristiques <strong>de</strong> l’image <strong>de</strong> Dieu se<br />
reflètent dans la conception du mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse. Celles-ci sont<br />
propres au christianisme canonique : Dieu est sage, tout-puissant, omniscient et<br />
surtout bienveillant. L’homme a été créé à Son image. Dieu n’a pas seulement créé<br />
l’homme, Il a aussi créé le mon<strong>de</strong> : la création biblique du mon<strong>de</strong> se concrétise à<br />
peine, émanant d’un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie unique, qui est un signe à la paysannerie<br />
biélorusse mais ne s’oppose pas à l’enseignement du Christ.<br />
[23]<br />
25 - Ibid., p. 285.<br />
26 - Seržputojski A. K.,<br />
Kazki..., Op. cit., p. 213.
Les médiateurs « entre le mon<strong>de</strong> et la vérité » 27<br />
Julj a Če rnjav skaj a<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
À l’analyse du phénomène <strong>de</strong> dévotion populaire du Biélorusse, le rapport<br />
ironique et souvent négatif aux serviteurs du culte et même aux saints canoniques<br />
saute aux yeux. Il est probable que cela soit lié à leur rôle d’intermédiaire :<br />
Dieu n’écoute pas celui qui est capable <strong>de</strong> bien le solliciter sans le prier, il écoute<br />
celui qui soupire sincèrement et lève les yeux vers Lui. Dieu n’écoute jamais les<br />
popes et les prêtres parce qu’ils ne prient pas, ils ne font que radoter et chanter<br />
comme <strong>de</strong>s coqs qui ont sorti leur queue. 28<br />
Il est remarquable que les prêtres orthodoxes et catholiques soient mentionnés<br />
ensemble. La raison <strong>de</strong> la méfiance envers eux est évi<strong>de</strong>nte : comme<br />
nous l’avons montré plus haut, pendant plusieurs siècles, le paysan<br />
biélorusse a plus d’une fois été contraint <strong>de</strong> se convertir soit à l’une soit<br />
à l’autre religion. Le modèle <strong>de</strong> l’office divin, sa langue et surtout l’esprit<br />
même du culte changeaient. C’est pourquoi la relation « face à face »<br />
est <strong>de</strong>venue le seul lien possible avec Dieu : en venant à l’homme<br />
« comme un frère », Dieu en personne lui donnait cette possibilité.<br />
La caractéristique la plus fondamentale du prêtre est paradoxale,<br />
car on dit qu’il fréquente les esprits maléfiques :<br />
Le pope a une force diabolique (…) Le diable suit le pope comme son<br />
ombre. C’est pourquoi si le pope ne prie pas et ne s’asperge pas d’eau<br />
bénite, il a <strong>de</strong>s pensées coupables et un corps pécheur. Et tous les gens<br />
qui sont avec lui pèchent et surtout les femmes qui aiment tourner autour<br />
du pope et lui autour d’elles. 29<br />
En réalité, la cause principale d’une telle antipathie est très ancienne,<br />
elle est liée à la partition mythique du réel et du surnaturel, à la<br />
bénédiction <strong>de</strong>s mon<strong>de</strong>s où le serviteur du culte joue le rôle <strong>de</strong><br />
médiateur : dans les contes, le prêtre apparaît plus que tout comme un<br />
maillon reliant non seulement les mon<strong>de</strong>s d’en bas et d’en haut, mais<br />
aussi le troisième, le « nav’ » 30 . Cela explique le sujet <strong>de</strong> nombreux<br />
contes, dans lesquels il est question du séjour constant du (ou <strong>de</strong>s)<br />
diable(s) à l'église. En fait, la spécificité « livresque » du travail <strong>de</strong> « cet<br />
homme instruit dans le village » 31 fait que l’on lui attribue un lien avec<br />
les forces maléfiques : dans la culture traditionnelle, la connaissance, et<br />
tout particulièrement la connaissance sacrée, recèle un certain danger,<br />
constitue une forme <strong>de</strong> transgression. C’est pourquoi, d’après les<br />
représentations paysannes, il ne sert à rien au saint homme d’aller à<br />
l’église.<br />
En effet, le prêtre, <strong>de</strong> la même manière que les autres créatures<br />
liées aux forces <strong>de</strong> l’au-<strong>de</strong>là, éveille la peur. Le rire est un moyen <strong>de</strong><br />
freiner cette peur. Ainsi, l’image du serviteur du culte dans les contes<br />
[24]<br />
27 - Jurij Lotman a appelé<br />
les serviteurs du culte <strong>de</strong>s<br />
« médiateurs entre le<br />
mon<strong>de</strong> et la vérité ».<br />
Voir : Lotman J. M.,<br />
« “Izgoj” i “izgojničestvo”<br />
kak socjal’nopsikhologičeskaja<br />
pozicija<br />
v russkoj kul’ture<br />
preimuščestvenno<br />
dopetrovskogo perioda »<br />
(Le “proscrit” et la<br />
“proscription” comme une<br />
position sociopsychologique<br />
dans la<br />
culture russe<br />
principalement pendant la<br />
pério<strong>de</strong> d’avant Pierre I er ),<br />
in : Istorija i tipologija<br />
russkoj kul’tury (Histoire et<br />
typologie <strong>de</strong> la culture<br />
russe), Iskusstvo, Saint-<br />
Pétersbourg, 2002, p. 225.<br />
28 - Seržputojski A. K.,<br />
Prymh..., Op. cit., p. 72.<br />
29 - I<strong>de</strong>m.<br />
30 - Ce mot vient <strong>de</strong> la<br />
mythologie slave. Aux<br />
temps du paganisme, le<br />
mon<strong>de</strong> se divisait en<br />
« jav’ » et en « nav’ », en<br />
un mon<strong>de</strong> réel et un mon<strong>de</strong><br />
métaphysique, magique.<br />
Quand les Slaves <strong>de</strong> l’Est se<br />
sont convertis au<br />
christianisme, le « jav’ »<br />
est tout simplement <strong>de</strong>venu<br />
le mon<strong>de</strong> d’en bas, celui<br />
dans lequel les hommes<br />
vivent. Par contre, le<br />
« nav’ » est <strong>de</strong>venu le<br />
mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s enchantements,<br />
<strong>de</strong> la sorcellerie, le mon<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s anciens dieux païens,<br />
<strong>de</strong>s rusalki (voir note 11) et<br />
<strong>de</strong>s sorcières. Dans le<br />
présent contexte, l’auteur<br />
veut dire que le prêtre<br />
combine ses propres<br />
fonctions avec celle <strong>de</strong><br />
chamane. (NdT)<br />
31 - Ulaščyk М., Vybranae<br />
(Œuvres choisies),<br />
Belaruski knigazbor, Minsk,<br />
2001, p. 31.
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
Julj a Če rnjav skaj a<br />
est comique voire satirique. Le bon sens du paysan ne peut ignorer l’inadéquation<br />
<strong>de</strong> l’image réelle du pope (assez souvent rusé, âpre au gain et corrompu) et <strong>de</strong> son<br />
rôle d’intermédiaire entre les mon<strong>de</strong>s. De plus, le sentiment <strong>de</strong> dignité du moujik,<br />
qui comprend littéralement sa place « en-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> Dieu », ne lui permet pas <strong>de</strong><br />
prendre au sérieux ces intermédiaires. À cela s’ajoutent d’autres éléments qui<br />
jouent un rôle non négligeable : la proximité du pope avec les forts <strong>de</strong> ce mon<strong>de</strong>,<br />
principalement avec le pan, la figure la plus négative du folklore biélorusse ; le fait<br />
que le pope et le prêtre reçoivent <strong>de</strong> l’argent réel, <strong>de</strong>s biens ; la possibilité qu’il a<br />
d’avoir une relation avec la femme d’un autre en « ca<strong>de</strong>au pour sa sainteté », etc.<br />
De ce fait, une telle tournure est caractéristique <strong>de</strong>s contes :<br />
Autrefois, les prêtres erraient <strong>de</strong> par le mon<strong>de</strong> et tournaient la tête aux gens pour<br />
qu’ils écoutent les pan, travaillent sans relâche et donnent [<strong>de</strong> l’argent] à la gloire<br />
<strong>de</strong> Dieu. Et Dieu a-t-il vu cet argent là-bas ? Les gens donnent et les prêtres<br />
bouffent avec les pan. 32<br />
À cet égard, le pope ne se différencie en rien du prêtre.<br />
Au vu d’un tel rapport à la prêtrise, l’Église ne joue pas un rôle très important<br />
dans la vie du paysan. Cela explique la <strong>de</strong>scription ironique voire satirique du<br />
service religieux dans les contes :<br />
Ne voilà-t-il pas que le clerc menait les “chérubins”, il faisait toutes les fioritures<br />
nécessaires, allongeait son long cou comme une cigogne, se mit sur la pointe <strong>de</strong>s<br />
pieds et s’allongea <strong>de</strong> tout son long, comme s’il voulait voler, pour chanter d’une<br />
petite voix délicate comme celle <strong>de</strong>s anges qui chantent dans le ciel. 33<br />
Le fait d’aller à l’église est un attribut souhaitable mais pas obligatoire <strong>de</strong> la vie du<br />
paysan, il a beaucoup moins <strong>de</strong> signification que le travail : « Le travailleur n’a pas<br />
le temps d’aller à l’église, en plus les travailleurs <strong>de</strong>s popes n’y vont jamais. » 34 Les<br />
chercheurs et les mémorialistes (Mikalaj Ulaščyk, Vladimir Korotkevič, Aleksandr<br />
Bogdanovič, etc.) en témoignent : si en hiver, pendant la pério<strong>de</strong> creuse, les gens<br />
allaient à l’église, en été, ils n’avaient pas le temps. Par contre, il faut remarquer<br />
que la communauté russe allait à l’église même pendant la pério<strong>de</strong> la plus chau<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la moisson.<br />
Les images <strong>de</strong> saints dans les contes ne sont pas univoques. D’un côté, la<br />
mission du saint est <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à Dieu la clémence pour les gens (saint Nikolaj et<br />
la Mère <strong>de</strong> Dieu remplissent très souvent cette fonction). D’un autre côté, les<br />
images <strong>de</strong> saints sont souvent trop terrestres. Saint Pëtr, par exemple, aime se<br />
remplir le ventre <strong>de</strong> nourriture gratuite, il vole même du pain à saint Boris ou, dans<br />
une autre variante <strong>de</strong> la légen<strong>de</strong>, au Christ (« D’où sont venus les champignons »).<br />
En général, le vol par les saints est un thème fréquent dans le folklore. Les saints<br />
n’ont pas seulement <strong>de</strong>s défauts (fainéantise, égoïsme, etc.), ils accomplissent en<br />
plus <strong>de</strong>s choses qui sont considérées par le peuple comme <strong>de</strong> véritables péchés.<br />
Dans le conte « Le mal passe, et ne dépasse pas le bien », les saints refusent <strong>de</strong><br />
[25]<br />
32 - Seržputojski A. K.,<br />
Kazki..., Op. cit., p. 238.<br />
33 – Ibid., pp. 65-66.<br />
34 - Ibid., p. 177.
Julj a Če rnjav skaj a<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
rendre visite à une pauvre veuve qui compte sur eux pour redonner vie à son fils<br />
qui se meurt. Ils préfèrent rester couchés sur le poêle dans une maison riche, « seul<br />
le Christ eut pitié et s’en alla dans la boue jusqu’au bout du village, chez la pauvre<br />
veuve. » 35<br />
L’essence terrestre <strong>de</strong>s saints se révèle dans le fait qu’ils sont souvent égaux<br />
aux hommes voire plus faibles qu’eux. Il existe une série <strong>de</strong> contes où l’on punit les<br />
saints, notamment en leur donnant les verges. Pour le paysan, le saint est un<br />
moujik pris, grâce à son succès, sous la protection <strong>de</strong> Dieu. À la différence du<br />
moujik, le saint peut accomplir <strong>de</strong>s miracles, mais secondaires : ils ne résultent pas<br />
<strong>de</strong> la nature particulière du saint, mais du fait que Dieu les leur a appris. Souvent,<br />
les miracles ne se produisent pas sur la volonté du saint, mais, au contraire, <strong>de</strong> son<br />
non-vouloir, dans le but <strong>de</strong> l’exhorter. Ainsi, d’après le conte « D’où sont venus les<br />
champignons », les champignons sont apparus grâce à l’égoïsme et la faiblesse<br />
d’esprit <strong>de</strong> saint Pëtr qui n’avait pu s’empêcher <strong>de</strong> chiper du pain :<br />
Le Christ apprit ce qu’avait fait Pëtr et lui <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> servir les gens. Pëtr voulut<br />
lui répondre, mais ne le put : il s’était bourré la bouche <strong>de</strong> pain, il le recracha et, à<br />
cet endroit, se mirent à pousser les champignons. Le Christ regarda et dit : « que<br />
cela serve les gens » 36 .<br />
Soulignons d’emblée que le Christ apparaît toujours en qualité <strong>de</strong> Dieu paysan, <strong>de</strong><br />
maître diligent : ses actions « servent » les gens. Observons les contextes dans<br />
lesquels apparaissent les motifs chrétiens. Le Christ ne punit pas ni même ne<br />
conscientise Pëtr. Étant donné que la raison d’une telle bonté n’est en rien explicitée<br />
dans le texte, la possibilité <strong>de</strong> l’expliquer est placée <strong>de</strong> manière latente dans la<br />
culture et se présente comme un « savoir original <strong>de</strong> fond » : la maxime du pardon<br />
chrétien est entrée dans la pratique spirituelle du peuple. La manière <strong>de</strong> faire le<br />
bien est remarquable : elle n’implique pas <strong>de</strong> « révolution » radicale et vient <strong>de</strong><br />
l’idée que tout mal peut être changé en bien au moyen <strong>de</strong> pensées bonnes. Cette<br />
transformation du mal en bien (le pain volé se métamorphose, par l’enchantement<br />
du Christ, en nourriture pour tous) renvoie sans aucun doute aux miracles du<br />
Christ. Toutefois, le plus important ici tient sans doute au choix que fait le<br />
Biélorusse dans sa façon <strong>de</strong> lutter contre l’injustice. En effet, que ce soit dans les<br />
contes ou dans la vie ordinaire, il opte précisément pour <strong>de</strong>s pensées bonnes et,<br />
dans l’ensemble, pour un modèle détourné <strong>de</strong> comportement. Ceci est possible car<br />
le mal s’autodétruit par la force seule <strong>de</strong> sa nature diabolique. « Il n’y a rien à faire,<br />
il faut subir car tu n’arriveras pas à vaincre le mal. » 37 Nous présumons que c’est <strong>de</strong><br />
là que vient la gran<strong>de</strong> patience, historiquement célèbre, du Biélorusse. Malgré la<br />
relativement faible religiosité du Biélorusse, on ne peut le qualifier d’athée ou<br />
d’agnostique. Il croit, mais cette foi est spécifique.<br />
[26]<br />
35 - Ibid., p. 42.<br />
36 - Ibid., p. 260.<br />
37 - Ibid., p. 201.
Deux formes <strong>de</strong> foi<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
Julj a Če rnjav skaj a<br />
En reprenant le titre d’un <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> Martin Buber 38 , nous pouvons dire<br />
que <strong>de</strong>ux formes <strong>de</strong> foi ont coexisté (et, dans une certaine mesure, existent encore<br />
aujourd’hui) sur le territoire biélorusse. La première est une manière <strong>de</strong> se<br />
comporter au quotidien qui consiste essentiellement à suivre les normes chrétiennes<br />
au quotidien. Le <strong>de</strong>uxième type <strong>de</strong> foi est personnifié par la figure du « saint<br />
homme ». Les <strong>de</strong>ux formes <strong>de</strong> foi se réunissent dans une conception globale selon<br />
laquelle le mon<strong>de</strong> est multiple, que son remplissage est symbolique voire mystique<br />
et que la principale fonction <strong>de</strong> l’homme est <strong>de</strong> déchiffrer les signes divins dans la<br />
vie <strong>de</strong> tous les jours. La distinction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux formes <strong>de</strong> foi et <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong><br />
conduite leur correspondant peut se comprendre comme suit : la première (celle<br />
d’une morale ordinaire) se base sur l’acceptation du mal comme une part<br />
nécessaire <strong>de</strong> la vie et postule la patience comme réaction au mal, la <strong>de</strong>uxième se<br />
construit sur la distinction intuitive et claire du bien et du mal.<br />
Le premier type <strong>de</strong> foi repose sur l’idée fataliste <strong>de</strong> l’invincibilité du mal par<br />
l’homme et, en partie, sur la conviction que le mal est condamné à se détruire.<br />
Dans les contes, c’est exprimé <strong>de</strong> manière univoque <strong>de</strong>puis les simples histoires<br />
d’homme cupi<strong>de</strong> et lâche (ou <strong>de</strong> diable) qui se porte préjudice à lui-même sans le<br />
vouloir jusqu’à celles qui mettent en scène <strong>de</strong>s massacres <strong>de</strong> masse entre les<br />
membres d’une famille <strong>de</strong> bandits (« La tribu <strong>de</strong>s loups »). Dans la vision du paysan<br />
biélorusse, il est vain <strong>de</strong> punir le mal du <strong>de</strong>hors : premièrement, il s’autodétruit<br />
dans un délai fixé non pas par l’homme mais par Dieu ; <strong>de</strong>uxièmement, la tentative<br />
<strong>de</strong> l’extirper par la force produit un mal encore plus grand : « Il est bien connu que<br />
si tu détruis le mauvais, le bien disparaît. » 39<br />
Ainsi, poussé par les meilleurs motifs, le héros du conte « Les massepains »<br />
déci<strong>de</strong> d’obtenir l’égalité pour tous ; cependant, au final <strong>de</strong> ses actions, les gens se<br />
retrouvent privés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> droits encore. L’idée centrale <strong>de</strong> ce conte, comme <strong>de</strong><br />
tant d’autres, est la suivante : les tentatives <strong>de</strong> transformations sociales radicales<br />
par le biais d'actions directes mènent à la violence (ce n’est pas un hasard si<br />
l’auxiliaire du héros dans ce conte n’est pas Dieu, mais le diable). En fait, le mal n’a<br />
pas <strong>de</strong> localisation claire, il est dispersé dans le mon<strong>de</strong>, mêlé au bien et, <strong>de</strong> ce fait,<br />
il est impossible <strong>de</strong> le distinguer : « Les gens ont raison lorsqu’ils disent qu’on ne<br />
<strong>de</strong>vinera jamais où est le mal et où est le bien… » 40<br />
La <strong>de</strong>uxième forme <strong>de</strong> foi est éloignée du quotidien. Elle est représentée par<br />
<strong>de</strong>s images <strong>de</strong> gens proches <strong>de</strong> la sainteté (dans les variantes <strong>de</strong> contes « L’homme<br />
saint », « Le groin <strong>de</strong> cochon », « Le pope et l’ermite », etc.).<br />
Le héros du conte « L’homme saint » se trouve dans une situation marginale,<br />
entre les <strong>de</strong>ux formes <strong>de</strong> foi. C’est un homme calme vivant à l’extrémité du village,<br />
ne refusant à personne ni nourriture ni logement. Les voisins le<br />
considèrent comme un saint parce qu’il est bon et qu’il va régulièrement<br />
à l’église. Un jour, un vieillard qui allait <strong>de</strong> par le mon<strong>de</strong> passa chez lui.<br />
Le « saint homme » se rendit avec lui à l’office. Pour cela, ils <strong>de</strong>vaient<br />
[27]<br />
38 - Buber M., Dva obraza<br />
very (Deux formes <strong>de</strong> foi),<br />
trad. <strong>de</strong> l’allemand par<br />
Gurevič P. S., Levit S. J. et<br />
Lezov S. V., Izdateľstvo<br />
« Respublika », Moscou,<br />
1995.<br />
39 - Seržputojski A. K.,<br />
Kazki..., Op. cit., p. 108.<br />
40 - Ibid., p. 185.
Julj a Če rnjav skaj a<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
traverser la rivière à gué. Le vieillard (un saint homme ou Dieu en personne, mais,<br />
dans le conte, ce n’est pas évi<strong>de</strong>nt à distinguer) frappa l’eau avec un bâton et elle<br />
s’écarta. Prenant conscience <strong>de</strong> la noble origine <strong>de</strong> l’hôte, le moujik refusa d’entrer<br />
dans l’église : « Je ne mérite pas d’aller avec toi dans l’église <strong>de</strong> Dieu. Vas-y seul, je<br />
resterai à la porte. » 41 Pour son humilité, le vieillard le gratifia du don <strong>de</strong> marcher<br />
sur l’eau sans se mouiller et sans être vu. Cependant, les gens ne remarquèrent pas<br />
ces changements puisqu’ils ne voyaient pas le héros quand il se trouvait dans les<br />
alentours <strong>de</strong> l’église. Dans le village le bruit courait que le saint homme avait cessé<br />
d’aller à l’office. Il n’était vu que par les diables qui vivaient dans l’église. Leur<br />
fonction était d’inscrire les péchés humains sur une peau <strong>de</strong> bœuf afin <strong>de</strong> les révéler<br />
aux forces d’En-Haut. En voyant leur zèle, notre héros sourit, il <strong>de</strong>vint visible et<br />
corporel à tel point qu’en revenant <strong>de</strong> l’église, il s’enfonça dans la rivière jusqu’à la<br />
ceinture. Toutefois, seul lui remarqua sa chute morale : c’est précisément après<br />
cela que les gens recommencèrent à le considérer comme saint (car ils le virent <strong>de</strong><br />
nouveau à l’église). Le message du conte est le suivant : « Il est bien connu que les<br />
gens ne considèrent un homme comme saint que quand il pèche car le cœur <strong>de</strong><br />
l’homme est fait <strong>de</strong> ténèbres, personne ne voit sa conscience, excepté Dieu. » 42<br />
Mais la pensée centrale du conte est plus profon<strong>de</strong>. Que reçoit l’homme en<br />
récompense pour sa « sainteté » ? Un don non applicable dans la vie. Il n’est<br />
récompensé « par rien » puisque la récompense matérielle lui pèserait dans la vie<br />
<strong>de</strong> tous les jours. Remarquons que notre héros <strong>de</strong>meure, dès le début, à l’écart, loin<br />
du voisinage. Rappelons qu’il est la personnification <strong>de</strong> l’imperceptible. Il souligne<br />
symboliquement son invisibilité : il <strong>de</strong>vient une « âme » dans la vie. Le saint ne<br />
peut rési<strong>de</strong>r dans le mon<strong>de</strong>. Il est plus facile à l’invisible <strong>de</strong> se maintenir à la<br />
hauteur <strong>de</strong> l’ascèse. Le rapprochement vers les hommes et les institutions<br />
humaines (même cultuelles) est lourd <strong>de</strong> péché. Il leur apparaît comme un rire<br />
déplacé.<br />
Dans une autre variante du conte, la situation est exprimée <strong>de</strong> manière plus<br />
précise : le héros ne rencontre pas <strong>de</strong> vieillard, n’a jamais fréquenté l’église et prie<br />
<strong>de</strong> façon païenne à la maison. Cela met en évi<strong>de</strong>nce le fait qu’il est saint<br />
précisément jusqu’au moment où il va à l’église. La preuve <strong>de</strong> sa sainteté est la<br />
même que dans la première variante : la capacité <strong>de</strong> traverser la boue sans se salir.<br />
Cela vaut la peine qu’il aille à l’église, voie le diable et sourie quand il se salit dans<br />
la boue. Toutefois, le final du conte donne <strong>de</strong> l’espoir : le pope lui permet <strong>de</strong> prier à<br />
la maison car là-bas sa prière est plus agréable à Dieu. Remarquons que cet<br />
homme ne possè<strong>de</strong> pas les merveilleuses qualités du héros du premier conte. La<br />
seule preuve <strong>de</strong> sa sainteté rési<strong>de</strong> dans le fait qu’il ne se salit pas. Par contre, son<br />
étrangeté est accentuée dans sa caractérisation « d’imbécile heureux » 43 .<br />
L’étrangeté du héros est encore plus soulignée dans le conte « Le pope et<br />
l’ermite » 44 . Depuis son enfance, il se distinguait <strong>de</strong> son entourage : dans sa<br />
jeunesse, il n’était pas étranger aux tendances révolutionnaires, puis il <strong>de</strong>vint<br />
guérisseur. Il avait une chemise qui « ne portait pas la honte » ; il priait, en sautant<br />
par-<strong>de</strong>ssus le puits et en répétant : « À toi, Dieu, à moi, Dieu ». Il était<br />
[28]<br />
41 - Ibid., p. 56.<br />
42 - Ibid., p. 57.<br />
43 - Ibid., pp. 175-177.<br />
44 - Ibid., pp. 112-116.
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
Julj a Če rnjav skaj a<br />
capable d’aller sur l’eau sans se mouiller les pieds, à la différence du pope qui était<br />
venu chez lui en le sermonnant et qui avait failli se noyer dans une flaque. De plus,<br />
il soignait les gens et les instruisait, ce qui le distinguait aussi <strong>de</strong>s autres.<br />
En somme, les contes nous proposent trois images <strong>de</strong> la sainteté. Le premier<br />
héros est bon, hospitalier, pieux et respectueux <strong>de</strong> la vieillesse. Un tel modèle <strong>de</strong><br />
conduite idéale est, en principe, accessible à tous. Par contre, cet homme ne<br />
supporte pas l’épreuve : la récompense ne lui profite pas. Le <strong>de</strong>uxième ne possè<strong>de</strong><br />
pas les mérites du premier. Le seul qu’il partage est la prière particulière. Malgré le<br />
fait qu’il commette le même péché que le héros précé<strong>de</strong>nt, il gar<strong>de</strong> l’espoir <strong>de</strong><br />
retourner à la prière « domestique ». On suppose qu’après cela le don miraculeux<br />
lui reviendra. Quant à l’ermite, sa conduite n’entre pas dans le champ <strong>de</strong>s valeurs<br />
du peuple visiblement parce qu’il ne va pas à l’église. Ici, <strong>de</strong>ux moments sont<br />
particulièrement remarquables : premièrement, tous les trois sont réunis par la<br />
capacité <strong>de</strong> marcher sur l’eau ; <strong>de</strong>uxièmement, l’homme le plus estimable apparaît<br />
comme le moins saint. La racine <strong>de</strong> sa tragédie est sans doute l’absence<br />
d’indépendance : il est doté <strong>de</strong> qualités merveilleuses, mais, en principe, ne se<br />
distingue pas <strong>de</strong> ses voisins. Ce n’est pas un hasard que ce soit précisément lui qui<br />
soit récompensé par un don miraculeux, tandis que les <strong>de</strong>ux autres en jouissent<br />
<strong>de</strong>puis le début. Ils se sont choisi une prière dans laquelle ils peuvent réaliser leur<br />
originalité, sans ressentir la dépendance <strong>de</strong> la société. Autrement dit, il n’est pas<br />
simple pour le saint homme d’être bon : il doit avoir le courage <strong>de</strong> vivre selon ses<br />
propres mesures.<br />
Le saint est un homme capable <strong>de</strong> distinguer le bien du mal. Dans la première<br />
variante, il est doué <strong>de</strong> cette capacité en récompense pour son comportement<br />
digne ; dans la <strong>de</strong>uxième, il la possè<strong>de</strong> dès le début. Il est significatif que dans les<br />
<strong>de</strong>ux versions <strong>de</strong> conte, il est le seul qui voit le ou les diable(s) dans l’église. Outre<br />
cela, il comprend la nécessité <strong>de</strong> sa (ou leur) présence précisément dans ce lieu : la<br />
raison en est la complémentarité du bien et du mal. C’est pourquoi même le saint<br />
homme n’est pas en droit d’extirper directement le mal.<br />
Le seul moyen que le conte préconise pour combattre le mal est <strong>de</strong> lutter avec<br />
soi-même. Penchons-nous encore sur une image <strong>de</strong> l’homme idéal, telle qu’elle est<br />
présentée dans le conte « Le groin <strong>de</strong> cochon ». Le héros principal est le fils d’un<br />
apiculteur 45 , lequel était perçu comme différent. L’apiculteur vivait retiré, « seul<br />
comme un poteau. Les voisins disaient <strong>de</strong> lui qu’il n’était pas normal parce qu’il il ne<br />
vivait pas comme les gens. » 46 La mère du héros se distinguait par son goût pour la<br />
solitu<strong>de</strong>, son amour pour la nature et son inadaptation au quotidien : « On la<br />
<strong>de</strong>mandait en mariage et elle ne voulait pas en entendre parler, répliquant qu’elle<br />
n’aimait que les fleurs et les abeilles <strong>de</strong> Dieu. » 47 Le fils <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux ermites qui<br />
s’aimaient était un beau jeune homme. En raison <strong>de</strong> sa beauté, les <strong>de</strong>ux tsarines<br />
(Ekaterina II et la « tsarine polonaise ») se battaient pour le jeune homme. Le<br />
jeune homme supplia Dieu <strong>de</strong> lui prendre sa beauté et d’arrêter la guerre : en vain.<br />
Ekaterina, victorieuse, ne rencontra cependant pas le bonheur : le<br />
visage du jeune homme se changea en groin <strong>de</strong> cochon au moment où<br />
[29]<br />
45 - Il s’agit d’un bortnik,<br />
c'est-à-dire d’un apiculteur<br />
<strong>de</strong>s bois. Il ne prélève que<br />
le miel d’abeilles <strong>de</strong>s bois.<br />
46 - Seržputojski A. K.,<br />
Kazki..., Ibid. p. 239.<br />
47 - Ibid. p. 240.
Julj a Če rnjav skaj a<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
l’impératrice voulut l’embrasser. Elle eut tellement peur qu’elle en mourut. Et le<br />
jeune homme, qui garda cette apparence <strong>de</strong> cochon, s’installa dans la forêt,<br />
instruisit et soigna les gens. « Et ils se mirent tous à dire : “Malgré son groin, il est<br />
un saint homme.” » 48 Le saint homme peut donc se sacrifier, en anéantissant le mal<br />
(qu’est ici la beauté) non pas du <strong>de</strong>hors, mais seulement à l’intérieur <strong>de</strong> lui-même.<br />
Il est significatif que tous les « saints hommes » vivent loin <strong>de</strong> leurs voisins,<br />
qu’ils ne sont pas semblables aux autres et capables <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s miracles. Ce n’est<br />
pas un hasard si la vie du saint au groin <strong>de</strong> cochon soit proche du canon <strong>de</strong>s vies <strong>de</strong><br />
saints. Les contes laissent transparaître l’idée que seul un homme qui se distingue<br />
<strong>de</strong>s autres peut améliorer le mon<strong>de</strong> soit en instruisant, soit en soignant, soit <strong>de</strong><br />
manière plus « visible » (rappelons la mort <strong>de</strong> Catherine).<br />
De cette manière, dans le conte biélorusse, la différence entre les <strong>de</strong>ux<br />
formes <strong>de</strong> foi s’inscrit très clairement : la justice du quotidien et la connaissance<br />
ésotérique qui se base sur la révélation. Du reste, il n’est pas tout à fait légitime <strong>de</strong><br />
limiter la version populaire biélorusse <strong>de</strong> la religion exclusivement à ces <strong>de</strong>ux<br />
variantes. Il existe un troisième aspect <strong>de</strong> la foi populaire qui réunit ces <strong>de</strong>ux<br />
formes extrêmes : la recherche du contenu métaphysique dans la vie <strong>de</strong> tous les<br />
jours.<br />
La métaphysique et le quotidien<br />
Dans les contes biélorusses du quotidien, il est remarquable que les héros<br />
expriment rarement <strong>de</strong>s jugements catégoriques. Aussi, dans une situation <strong>de</strong><br />
conflit, le paysan gagne-t-il le combat grâce au fait qu’il n’agit jamais ouvertement.<br />
Des moyens divers sont alors mis en œuvre : la ruse, la dissimulation, le<br />
louvoiement, etc. Dans « Les massepains », nous avons montré que ce modèle<br />
concerne non seulement <strong>de</strong>s situations particulières, mais aussi le rapport aux<br />
changements radicaux en général. Le chemin détourné est privilégié au détriment<br />
<strong>de</strong>s actions directes, même quand elles sont entreprises au nom du bien. Un tel<br />
modèle <strong>de</strong> conception du mon<strong>de</strong> et <strong>de</strong> comportement s’est sans doute formé en<br />
conséquence <strong>de</strong> la vie privée <strong>de</strong> tout droit qu’était celle <strong>de</strong>s paysans sous le<br />
servage. C’est <strong>de</strong> là que vient le « mysticisme paysan », original en soi, qui suppose<br />
que chaque phénomène a un double-fond : pragmatique et sacré. Il en découle un<br />
style <strong>de</strong> pensée « à la Ésope » qui crée une métaphysique particulière, parfois bien<br />
plus raffinée, qui détruit le stéréotype du Biélorusse pragmatique, peu enclin aux<br />
matières supérieures 49 .<br />
Comme nous l’avons montré plus haut, le paysan considère que le chemin<br />
détourné du raisonnement et <strong>de</strong> l’action a été donné par Dieu. La tâche <strong>de</strong> Dieu est<br />
<strong>de</strong> « co<strong>de</strong>r » le mon<strong>de</strong>, celle <strong>de</strong> l’homme est « d’enlever les scellés » du sens<br />
empaqueté dans une forme symbolique et <strong>de</strong> démasquer l’impératif <strong>de</strong><br />
l’action et du comportement. Dans cette tâche <strong>de</strong> décodage, <strong>de</strong> tous les<br />
personnages du conte biélorusse du quotidien, ce ne sont pas les<br />
[30]<br />
48 - Ibid., p. 243.<br />
49 - Le pragmatisme est<br />
souvent considéré comme<br />
une <strong>de</strong>s qualités mentales<br />
<strong>de</strong> base du Biélorusse : il<br />
apparaît comme un topos<br />
dans son genre dans les<br />
recherches nationales et<br />
internationales.
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
Julj a Če rnjav skaj a<br />
hommes instruits qui réussissent, mais l’unique disciple <strong>de</strong> Dieu : le moujik.<br />
Dans le conte « Le moujik et le fils du pan », un paysan entre en conflit avec<br />
un étudiant en voulant déterminer lequel <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux avait le plus grand savoir. Tandis<br />
que l’étudiant expliquait le tonnerre et l’éclair par l’électricité, le moujik les voyait<br />
comme la puissance <strong>de</strong> Dieu. Pour le jeune « savant », le feu dans le poêle restait<br />
un phénomène naturel, pour le moujik c’était la beauté même ; le chat qui se lavait<br />
avec sa patte ce n’était pas animal, mais la pureté même, la soupente la hauteur,<br />
l’eau la grâce. À la différence du jeune homme, nourri au lait <strong>de</strong>s Lumières et vivant<br />
dans le mon<strong>de</strong> limité <strong>de</strong>s lois <strong>de</strong> la nature, le moujik voyait le double-fond <strong>de</strong><br />
chaque phénomène.<br />
Dans ce contexte, le fait le plus curieux est que le pragmatisme du Biélorusse<br />
<strong>de</strong>s contes constitue une image paradoxale sur la base <strong>de</strong> la métaphysique. Le<br />
travail <strong>de</strong> la terre est sanctionné par Dieu, le laboureur, et c’est pourquoi la moisson<br />
n’est pas seulement perçue comme la garantie d’une relative satiété mais aussi<br />
comme un miracle. Le paradis n’est pas perçu comme un jardin, par contre le jardin<br />
cultivé par le paysan est comme le paradis 50 . C’est pourquoi, dans la conscience<br />
populaire, la nécessité du travail acquiert un caractère bien plus sacré que le fait<br />
d’aller régulièrement à l’église. Et finalement, Dieu en personne est pragmatique :<br />
ses intentions, qui à première vue peuvent paraître absur<strong>de</strong>s, possè<strong>de</strong>nt toujours<br />
un plan soli<strong>de</strong> et précis et, quand son plan est violé, Dieu ne dédaigne pas refaire la<br />
création ratée. Ainsi, par exemple, le diable, s’étant assis sur la charrue pour<br />
déranger l’homme dans son travail, est transformé par Dieu en cheval 51 : par là, la<br />
force diabolique est changée en bien. Un sens caché similaire anime tous les objets<br />
et les phénomènes avec lesquels l’homme est confronté au quotidien. Et c’est<br />
pourquoi la vie <strong>de</strong> tous les jours est présentée comme importante non pas en soi,<br />
mais en tant que rapport constant <strong>de</strong>s mon<strong>de</strong>s indissolubles, le sacré et le profane,<br />
ainsi que comme la réalisation <strong>de</strong> cette indissolubilité.<br />
Du point <strong>de</strong> vue du décodage <strong>de</strong>s sens cachés, le conte « Tout n’entre pas<br />
dans la tête » présente le plus grand intérêt. Un certain jeune homme, qui voulait<br />
savoir tout au mon<strong>de</strong>, rencontra Dieu. « “Comment veux-tu tout savoir au mon<strong>de</strong><br />
alors que tu ne vois pas ce qu’il y a <strong>de</strong>vant tes yeux ? Tout n’entre pas dans la<br />
tête”, lui dit Dieu qui prit le garçon en apprentissage. » 52 S’étant élevé dans le<br />
ciel, le disciple <strong>de</strong> Dieu vit <strong>de</strong>s choses étonnantes : un moujik qui était assis seul<br />
sur une immense hata 53 et qui criait : « Oh, comme c’est étroit ! » ; <strong>de</strong>s moutons<br />
épuisés paissant dans un pré luxuriant et <strong>de</strong>s moutons gras paissant sur une terre<br />
inculte ; un homme s’efforçant en vain d’attraper un oiseau ; et finalement, une<br />
charogne pourrissante juste aux portes du paradis. Il cracha <strong>de</strong> dégoût et alla chez<br />
Dieu, qui lui expliqua le sens tant ésotérique que moral <strong>de</strong>s faits :<br />
Que l’homme qui crie soit à l’étroit ! Il a chassé tous ses frères <strong>de</strong> la<br />
maison. Les gros moutons et les maigres, ce sont les âmes justes et les<br />
âmes pècheresses <strong>de</strong>s hommes. L’homme qui essaye d’attraper l’oiseau,<br />
c’est l’homme qui tente d’attraper son âme… Tu as craché sur la<br />
[31]<br />
50 - Seržputojski A. K.,<br />
Kazki..., Op. cit., pp. 76-<br />
77.<br />
51 - Legendy i padannyi,<br />
Op. cit., p. 443.<br />
52 - Seržputojski A. K.,<br />
Kazki..., Op. cit., p. 221.<br />
53 - Habitation paysanne<br />
d’Ukraine. (NdT)
Julj a Če rnjav skaj a<br />
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
charogne et, en cela, tu as péché car il s’agit <strong>de</strong> ton père-sorcier et ta mère-<br />
sorcière. 54<br />
Voici comment se présente en bref le canevas du conte. Il y a néanmoins <strong>de</strong>s<br />
détails sur lesquels je souhaiterais m’arrêter.<br />
Tout d’abord, c’est l’homme qui attrape l’oiseau (l’âme) qui vole <strong>de</strong> nid en nid.<br />
Notre héros lui conseille <strong>de</strong> cacher un <strong>de</strong>s nids avec sa main, mais après leur<br />
nombre est multiplié par <strong>de</strong>ux. Dieu juge l’acte du jeune garçon ainsi : « Tu voulais<br />
l’ai<strong>de</strong>r et tu as fais pire. » 55 L’homme doit faire seul le choix entre le bien et le mal<br />
(les nids) et une ai<strong>de</strong> extérieure empêche <strong>de</strong> faire un tel choix. Cela ajoute <strong>de</strong>s<br />
couleurs supplémentaires à l’image du paysan biélorusse : en raison <strong>de</strong> tous ses<br />
asservissements <strong>de</strong> l’extérieur, l’homme est compris comme une créature<br />
intérieurement libre et autosuffisante.<br />
Le <strong>de</strong>uxième détail remarquable du conte est le moment où Dieu donne son<br />
appréciation sur le crachat du héros. Il semblerait qu’il <strong>de</strong>vait imposer au jeune<br />
homme le dégoût pour la charogne (pour les cadavres <strong>de</strong> ses parents sorciers).<br />
Toutefois, ce geste est jugé comme un péché. Ici, nous avons affaire à la collision<br />
<strong>de</strong> valeurs <strong>de</strong> niveaux différents : la valeur <strong>de</strong>s parents dans la culture biélorusse<br />
traditionnelle est d’autant plus importante qu’elle vainc l’aspiration à une pureté<br />
morale. Outre cela, le souhait <strong>de</strong> ne pas être sali par le péché a, pour le Biélorusse,<br />
sans doute moins d’importance que la charité, la compassion. En témoigne l’épiso<strong>de</strong><br />
où le garçon <strong>de</strong>scend en enfer et, au lieu <strong>de</strong> ressentir du dégoût pour les âmes<br />
pécheresses qui se tor<strong>de</strong>nt dans le chaudron <strong>de</strong> goudron, il les prend en pitié :<br />
De quoi sont-ils coupables pour que Dieu les ait faits tels et qu’il les <strong>de</strong>stine à<br />
cela ? Non, Dieu leur pardonnera leurs péchés parce qu’il est bon, charitable et<br />
qu’il ne voudra jamais que ce qu’il a créé se change en mal. À peine pensa-t-il<br />
cela que les chaudrons s’ouvrirent, que les âmes pècheresses en sortirent et se<br />
mirent à louer Dieu. 56<br />
Soulignons que le changement du sort <strong>de</strong>s pécheurs dépend <strong>de</strong> la prière <strong>de</strong><br />
l’homme, en accord, non pas formel mais substantiel, avec les idéaux chrétiens du<br />
pardon et du salut. Rappelons également que l’homme, tout comme Dieu, est<br />
capable <strong>de</strong> lancer le mécanisme apocalyptique <strong>de</strong> transformation du mal en bien.<br />
Toutefois, nous insistons encore, le mécanisme à l’ai<strong>de</strong> duquel le héros du conte<br />
transfigure la situation n’est pas une action, mais une bonne pensée : la pitié et la<br />
compassion. Si nous approfondissons ce raisonnement, nous en arrivons à expliquer<br />
cette qualité que les chercheurs appellent « mollesse sociale », « passivité »,<br />
« fatalisme », « indifférence » et qu’ils rapportent fréquemment au « caractère<br />
national » biélorusse. Le paysan biélorusse n’est pas indifférent : il est persuadé<br />
que les changements pour un mieux sont possibles, avant tout grâce à<br />
l’autoéducation et au perfectionnement moral. D’où, le Biélorusse n’est pas enclin<br />
aux transformations globales <strong>de</strong> la réalité : il comprend que seule une révolution<br />
anthropologique intérieure ai<strong>de</strong>ra à améliorer le mon<strong>de</strong>. La charité rééduque le<br />
pécheur et l’oblige à honorer Dieu : ainsi, une marraine, qui, parce qu’elle a<br />
[32]<br />
54 - 1 Seržputojski A. K.,<br />
Kazki..., Op. cit., p. 223.<br />
55 - I<strong>de</strong>m.<br />
56 - I<strong>de</strong>m.
La religion <strong>de</strong> la paysannerie biélorusse : la métaphysique <strong>de</strong> l’ordinaire<br />
Julj a Če rnjav skaj a<br />
abandonné un petit orphelin à son sort, souffre mortellement dans le chaudron <strong>de</strong><br />
l’enfer, est libérée sur sa parole (« Gusli » 57 ). C’est sans doute pourquoi, dans les<br />
contes biélorusses, la seule exception qu’est l’image du pan n’est, en fait, pas la<br />
représentation <strong>de</strong> gens tout à fait corrompus 58 . Et si le mal ne vient pas <strong>de</strong>s gens,<br />
mais <strong>de</strong> la loi inébranlable qui prédétermine le changement constant du bien en mal<br />
et vice versa, alors la manière <strong>de</strong> traiter sa propre vie et celle <strong>de</strong>s autres <strong>de</strong>vient<br />
pru<strong>de</strong>nte, détournée.<br />
Il n’est pas possible <strong>de</strong> vaincre ouvertement l’injustice <strong>de</strong> la vie, on ne peut<br />
que l’accepter comme dû. On peut améliorer la vie par <strong>de</strong>s mesures locales, dans<br />
<strong>de</strong>s lieux particuliers : sur sa parcelle <strong>de</strong> vie, dans son cercle, dans sa famille. Dans<br />
le cas extrême, on peut « rouler » l’injustice et ainsi la vaincre, non pas <strong>de</strong> manière<br />
rationnelle, mais en pénétrant au fond <strong>de</strong> l’être. Or, ce n’est possible qu’en refusant<br />
Julja ČERNJAVSKAJA<br />
est professeur extra-<br />
ordinaire <strong>de</strong> l’Unive-<br />
rsité biélorusse d’État<br />
<strong>de</strong> culture et art <strong>de</strong><br />
Minsk<br />
l’ingérence dans le cours <strong>de</strong>s choses et dans les<br />
réalisations <strong>de</strong>s tâches données par Dieu, non pas<br />
l’essence transcendante, ni l’icône à l’église, mais le Dieu<br />
paysan qui apparaît à l’homme « comme un frère ».<br />
(Traduit du russe par Katia Van<strong>de</strong>nborre)<br />
[33]<br />
57 - Instrument <strong>de</strong><br />
musique à cor<strong>de</strong>s pincées.<br />
(NdT)<br />
58 - Même le pope se<br />
change parfois pour un<br />
mieux. Cela se produit le<br />
plus souvent quand il est<br />
pauvre et donc proche du<br />
paysan, par sa situation<br />
matérielle. Par là, la<br />
pauvreté est comprise<br />
comme une condition et un<br />
engagement <strong>de</strong> probité.
Marc Peeters<br />
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École<br />
<strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
§<br />
1. Quiconque regar<strong>de</strong>rait un panorama <strong>de</strong> la philosophie actuelle en<br />
Pologne, ne pourrait qu’avoir son attention attirée par le poids, certes<br />
moins prégnant que dans l’entre-<strong>de</strong>ux guerres, mais toujours d’actualité,<br />
<strong>de</strong> l’Âge d’Or <strong>de</strong> l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie 1 . Il n’entre pas dans notre intention <strong>de</strong><br />
refaire l’histoire <strong>de</strong> cette École, travail qui a été réalisé par Jan<br />
Woleński 2 . Notre propos est plus mo<strong>de</strong>ste : il s’agit <strong>de</strong> montrer<br />
l’influence <strong>de</strong> l’« anti-irrationalisme » polonais, face à quelques courants<br />
philosophiques majeurs <strong>de</strong> cette époque 3 . Pour ce faire, nous<br />
analyserons le schème <strong>de</strong> « l’anti-irrationalisme » tel que déployé par<br />
Kazimierz Ajdukiewicz, ensuite nous verrons une <strong>de</strong>s spécificités <strong>de</strong> la<br />
logique polonaise dans la théorie <strong>de</strong>s définitions <strong>de</strong> Stanisław Leśniewski<br />
par rapport à celle <strong>de</strong> Jan Łukasiewicz, enfin nous verrons quelques<br />
développements <strong>de</strong> la logique paraconsistante développée par Stanisław<br />
Jaskowski, réintroduisant une forme « d’irrationalisme » au cœur même<br />
<strong>de</strong> la logique.<br />
1 – Przełęcki M.,<br />
Jadacki J. J., « Pologne »,<br />
in : La philosophie en<br />
Europe (Sous la dir. <strong>de</strong><br />
Klibanski R. et Pears D.),<br />
Gallimard, Folio,<br />
coll. « Essais », Paris,<br />
1993, pp. 323-347.<br />
2 – Woleński J., Logic and<br />
Philosophy in the Lvov-<br />
Warsaw School (Logique et<br />
philosophie dans l’École <strong>de</strong><br />
Lvov-Varsovie), Kluwer,<br />
Dordrecht, 1989 (éd. pol. :<br />
1985).<br />
3 - L’expression « antiirrationalisme<br />
» est reprise<br />
à Kazimierz Ajdukiewicz.<br />
Voir « Der logistische<br />
Antiirrationalismus<br />
in Polen » (L’antiirrationalisme<br />
logique en<br />
Pologne),<br />
in : « ERKENNTNIS », V,<br />
1935, pp. 151-161 ;<br />
Bibliographie :<br />
pp. 199-203.
« L’anti-irrationalisme » selon Ajdukiewicz.<br />
Marc P ee te rs<br />
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
§2. On le sait, pour <strong>de</strong>s raisons tant idéologiques que politiques, la<br />
philosophie polonaise <strong>de</strong>s confins <strong>de</strong>s XIX e et XX e siècles fut marquée par le<br />
catholicisme nationaliste ; basée sur une Weltanschauung (vision du mon<strong>de</strong>)<br />
romantique déterminée par <strong>de</strong>s circonstances extérieures à la philosophie elle-<br />
même. Ce qui suppose l’existence d’une Philosophia Perennis qui, protéiforme, a le<br />
<strong>de</strong>stin <strong>de</strong> se déployer actuellement dans la métaphysique analytique et l’ontologie<br />
formelle anglo-saxonnes, mâtinées <strong>de</strong> logique, standard ou non standard, alors<br />
même que le Wiener Kreis (Cercle <strong>de</strong> Vienne) avait eu comme ambition <strong>de</strong> montrer<br />
l’inanité <strong>de</strong>s questions métaphysiques. La philosophie polonaise, telle que l’a décrite<br />
Ajdukiewicz a, sur <strong>de</strong> nombreux points, précédé les conclusions extrêmes du<br />
positivisme logique <strong>de</strong>s philosophes viennois (principalement Rudolph Carnap), tant<br />
dans la rigueur formelle que dans l’approche épistémologique. Destin étrange et<br />
paradoxal <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la philosophie, qui après le Linguistic Turn britannique <strong>de</strong>s<br />
années 1960, s’est tournée vers la métaphysique formelle, à la suite <strong>de</strong> Edmund<br />
Husserl et <strong>de</strong> Kazimierz Twardowski, fondateur <strong>de</strong> l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie. Il est<br />
remarquable que ce soient les plus grands logiciens polonais qui, à l’heure actuelle,<br />
soient précisément ceux qui sont à la base <strong>de</strong> ce revirement métaphysique. Je<br />
songe ici plus particulièrement aux travaux <strong>de</strong> Łukasiewicz et <strong>de</strong> Leśniewski. Le<br />
premier ne s’est jamais départi <strong>de</strong> la question du déterminisme et <strong>de</strong> la liberté<br />
humaine ; le second, à travers ses trois systèmes que sont la protothétique,<br />
l’ontologie et la méréologie, a voulu penser une logique générale qui résolve les<br />
paradoxes qui grevaient la crise <strong>de</strong>s fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> l’arithmétique, et plus<br />
particulièrement l’antinomie <strong>de</strong> Russell <strong>de</strong>s classes qui ne se contiennent pas elles-<br />
mêmes, à travers le réaménagement <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> classe elle-même, distinguant<br />
les classes distributives russelliennes et les classes méréologiques qui se<br />
contiennent toutes elles-mêmes, ce qui suppose un nominalisme radical (que l’on<br />
distinguera soigneusement <strong>de</strong> l’Acquaintance réaliste russellienne <strong>de</strong>s Principles of<br />
Mathematics). Ce qui caractérise, au premier chef, l’œuvre <strong>de</strong> Leśniewski, c’est la<br />
puissance <strong>de</strong> son métalangage formalisé, la notation polonaise, une précision et une<br />
ironie désarçonnantes, et enfin une authentique métaphysique dans la méréologie<br />
extensionnelle classique et axiomatisée à partir <strong>de</strong> 1916. Dès les articles <strong>de</strong><br />
jeunesse (1911-1913), Leśniewski a mis en question le principe du tiers exclu et<br />
conçu une nouvelle théorie <strong>de</strong> la définition.<br />
§3. A l’heure du néo-logicisme et du néo-frégianisme, l’ontologie <strong>de</strong><br />
Leśniewski est une alternative crédible à ces courants, puisqu’elle permet <strong>de</strong> rendre<br />
compte <strong>de</strong> l’axiomatique <strong>de</strong> Peano, et par là <strong>de</strong> répondre aux réquisits du projet<br />
logiciste sans tomber dans les antinomies, dont celle <strong>de</strong> Russell, qui fut pour<br />
Leśniewski un véritable tourment au sujet <strong>de</strong> la réalité. Après une mise en situation<br />
<strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> Leśniewski, j’en estimerai la pertinence par rapport à la logique<br />
standard ; enfin, j’en viendrai à la question <strong>de</strong>s définitions. Ce point n’est pas<br />
[35]
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
Marc P ee te rs<br />
anecdotique si l’on veut bien se rappeler que les définitions sont le lieu d’une<br />
extension du savoir formel.<br />
§4. Comme à l’accoutumée chez Leśniewski, le questionnement strictement<br />
philosophique, s’il n’a jamais vraiment abandonné le logicien, plonge ses racines<br />
dans l’œuvre <strong>de</strong> jeunesse (1910-1913). Leśniewski y soutient que si le mot<br />
« métaphysique » dénote le système <strong>de</strong>s propositions vraies concernant tous les<br />
objets en général – à ne pas confondre avec les noms généraux, nous obtiendrons<br />
la thèse suivante : la métaphysique peut être construite seulement comme un<br />
système <strong>de</strong> propositions catégoriques. Leśniewski en déduit qu’il y a trois types <strong>de</strong><br />
science : 1° la science systématique <strong>de</strong>s propositions concernant les objets en<br />
général – à ne pas confondre avec les objets généraux - (en fait les objets<br />
individuels) ou métaphysique sive ontologie ; 2° la science dont les propositions<br />
traitent <strong>de</strong> ces objets (sciences particulières et méréologie) ; 3° la science<br />
propositionnelle et systématique <strong>de</strong>s propositions en tant qu’elles sont vraies ou<br />
fausses (logique stricto sensu 4 ). L’ontologie a donc comme objet d’étu<strong>de</strong> les<br />
individus constitutifs <strong>de</strong> l’univers, ou plus précisément, eu égard à la neutralité<br />
ontologique forte, les objets que sont les noms qui dénotent le mon<strong>de</strong> et connotent<br />
ses propriétés 5 . Ce qui soulève une double question : 1° quel est le principe<br />
d’individuation <strong>de</strong> ces objets comme non divisés (indivisio) ; 2° quel est le statut <strong>de</strong><br />
l’unité <strong>de</strong> cette science ? Si le principe d’individuation est donné dans l’axiome <strong>de</strong><br />
l’ontologie, celle-ci considère que la manière <strong>de</strong> parler <strong>de</strong>s choses (et non les choses<br />
elles-mêmes) dénote une multiplicité objective donnée dans l’intuition <strong>de</strong>s choses 6 .<br />
D’autre part, l’ontologie permet, à partir <strong>de</strong> son axiome et <strong>de</strong> la constante du<br />
« quelque chose » (aliquid), <strong>de</strong> construire l’objet contradictoire Λ. Ce point sera<br />
important pour qualifier les logiques leśniewskiennes d’universelles (Cf.<br />
infra). D’autre part, rappelons la définition <strong>de</strong> la science :<br />
J’appelle un agrégat systématisé <strong>de</strong> propositions qui possè<strong>de</strong>nt une<br />
fonction symbolique (en d’autres termes, <strong>de</strong>s propositions vraies),<br />
science. Le but <strong>de</strong> n’importe quelle partie <strong>de</strong> science est <strong>de</strong> symboliser<br />
<strong>de</strong>s objets donnés au moyen <strong>de</strong> propositions. Le but <strong>de</strong> toute critique<br />
scientifique d’une proposition ou d’un système <strong>de</strong> propositions consiste à<br />
répondre à la question <strong>de</strong> savoir si ces propositions possè<strong>de</strong>nt une<br />
fonction symbolique, i.e. si elles sont vraies. Une critique scientifique<br />
consistante doit exclure du système <strong>de</strong>s propositions considérées en vue<br />
<strong>de</strong> constituer cette science, toutes les propositions qui ne possè<strong>de</strong>nt pas<br />
<strong>de</strong> fonction symbolique, i.e. toutes les propositions fausses 7 .<br />
Pour Leśniewski, les théorèmes et les définitions sont <strong>de</strong>s thèses <strong>de</strong>s<br />
systèmes, chacun étant le déploiement <strong>de</strong> l’opérateur d’éternité « ε ».<br />
Reste alors à se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si les définitions sont <strong>de</strong>s propositions<br />
vraies ?<br />
[36]<br />
4 - La méréologie est la<br />
logique <strong>de</strong>s objets réels. En<br />
ce sens, elle est<br />
extralogique.<br />
5 - Il convient <strong>de</strong> ne pas<br />
oublier qu’après 1914 et<br />
l’étu<strong>de</strong> minutieuse par<br />
Leśniewski <strong>de</strong>s Principia<br />
Mathematica <strong>de</strong> Bertrand<br />
Russel et Alfred North<br />
Whitehead, celui-ci<br />
abandonna la définition <strong>de</strong><br />
la proposition en termes <strong>de</strong><br />
relation d’inhérence.<br />
6 - Nous ne pouvons entrer<br />
ici dans la discussion<br />
épistémologique du statut<br />
<strong>de</strong> l’ontologie <strong>de</strong> la<br />
maturité. Notre propos est<br />
plus mo<strong>de</strong>stement <strong>de</strong><br />
mettre en évi<strong>de</strong>nce une<br />
pratique hénologique chez<br />
Leśniewski, au sein même<br />
<strong>de</strong> sa directive<br />
métalangagière <strong>de</strong><br />
définition protothétique.<br />
7 – Leśniewski St.,<br />
Collected Works,<br />
(Barnet D. I. et alii éd.),<br />
Kluwer – PWN, Dordrecht,<br />
p. 35.
Marc P ee te rs<br />
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
§5. Leśniewski n’a pas directement participé au projet logiciste <strong>de</strong> Gottlob<br />
Frege, Bertrand Russell et Alfred North Whitehead. Formaliste radical, autant<br />
qu’intuitiviste 8 , Leśniewski a développé ses trois systèmes logiques – protothétique,<br />
ontologie, méréologie – en liaison étroite avec l’élaboration <strong>de</strong> son métalangage<br />
purement formel (les T.E. pour Terminological explanations) qui donne les règles<br />
d’écriture et d’insertion <strong>de</strong>s thèses <strong>de</strong> n’importe quel système dans le langage L <strong>de</strong><br />
la protothétique et <strong>de</strong> l’ontologie. Je montrerai un résultat <strong>de</strong>s T.E. XXXII-XXXIII<br />
qui spécifient l’emboîtement <strong>de</strong>s systèmes, ou, plus précisément, l’inscription <strong>de</strong> la<br />
thèse qu’est l’axiome <strong>de</strong> l’ontologie dans sa base protothétique.<br />
§6. Leśniewski est un nominaliste radical, ce qui signifie que n’importe quel<br />
signe <strong>de</strong> son écriture logique et métalogique doit être pris comme token, objet<br />
déterminé par le temps <strong>de</strong> la construction et l’espace occupé par le signe concret.<br />
De la spatio-temporalité <strong>de</strong>s expressions logiques dans L, et donc <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong><br />
Leśniewski qui constituent ainsi autant d’ontologies partielles contextualisées 9 , nous<br />
pouvons tirer <strong>de</strong> l’individuation a priori <strong>de</strong> tout aliquid qu’il est équiforme à lui-<br />
même puisque l’équiformité est symétrique et transitive ; elle est donc aussi<br />
réflexive (il s’agit d’une réflexivité affaiblie par rapport à la réflexivité forte <strong>de</strong> la<br />
relation d’i<strong>de</strong>ntité) 10 .<br />
§7. Chaque axiome, et non schéma d’axiome, <strong>de</strong> ce système est une thèse<br />
organique, ce qui signifie qu’aucune <strong>de</strong> ses parties n’est logiquement équivalente à<br />
une autre, i.e. qu’il ne contient aucune partie qui, généralisée, puisse<br />
servir <strong>de</strong> thèse (un axiome n’est donc jamais pour Leśniewski une<br />
concaténation <strong>de</strong> thèses, même du système, ni a fortiori étrangères à<br />
celui-ci, ni une « simple » traduction ou transposition en langage L d’une<br />
axiomatique préexistante). Il ne requiert aucune référence<br />
extralinguistique ni n’implique l’existence <strong>de</strong> quelque objet que ce soit<br />
dans l’univers (ni l’univers lui-même bien que sans univers aucun<br />
axiome ne soit possible : mais c’est là une question extralogique). Un<br />
axiome est une thèse d’un système, comme une définition, sauf que<br />
l’axiome n’introduit aucune nouvelle constante mais fixe la catégorie<br />
sémantique, la signification et l’usage <strong>de</strong> la première constante non-<br />
définie, en l’occurrence le coimplicateur « ║ », le biconditionnel d’où<br />
viendra le problème <strong>de</strong>s définitions. Comme nous allons le voir, toute<br />
constante nouvelle doit pouvoir être définie au moyen <strong>de</strong> ce foncteur.<br />
§8. Il nous faut à présent expliquer l’emboîtement <strong>de</strong>s systèmes.<br />
(T.E.XXXII 11 ). Toute thèse A est relative à elle-même ou, ce qui est<br />
équivalent, appartient au champ <strong>de</strong> la relation « être une thèse<br />
précédant ou i<strong>de</strong>ntique à une thèse individuelle ». Luschei généralise<br />
T.E.XXXII <strong>de</strong> la manière suivante : « Si A est une thèse précédant ou<br />
i<strong>de</strong>ntique à B, alors une thèse quelconque relative à A est une thèse<br />
[37]<br />
8 - « Intuitiviste », pour ne<br />
pas dire « intuitionniste ».<br />
9 - On pourra rapprocher le<br />
concept d’ontologie<br />
partielle chez Leśniewski et<br />
celui d’ontologie régionale<br />
chez Husserl.<br />
10 - C’est dans l’optique<br />
d’assurer l’individuation <strong>de</strong>s<br />
aliqua concrets que<br />
Leśniewski a revu<br />
l’axiomatisation <strong>de</strong> Frege et<br />
réhabilité les classes<br />
collectives.<br />
11 – Leśniewski St.,<br />
Collected Works,<br />
pp. 476-477. Les thèses <strong>de</strong><br />
l’ontologie et <strong>de</strong> la<br />
méréologie sont notées<br />
« tho » et « thm ».<br />
Voir Ibid., pp. 477-478.<br />
[AB]∴ A ε thp(B) .= : A ε<br />
thp . B ε thp: A ε prcd(B) .<br />
v. A ε Id(B). T.E.XXXII<br />
définit le mot « thèse<br />
précédant ou i<strong>de</strong>ntique à<br />
une thèse <strong>de</strong> la protothétique<br />
» tel que pour tout<br />
A et B, A est une thèse<br />
précédant ou i<strong>de</strong>ntique à la<br />
thèse B <strong>de</strong> la protothétique<br />
ssi (1) A est une thèse <strong>de</strong><br />
la protothétique et B est<br />
une thèse <strong>de</strong> la protothétique<br />
; (2) A précè<strong>de</strong> ou<br />
est i<strong>de</strong>ntique à B.
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
Marc P ee te rs<br />
quelconque relative à B. » Puisque l’axiome Axp1 <strong>de</strong> la protothétique est une thèse<br />
relative à toute thèse dans le système S 5, il s’ensuit qu’une thèse quelconque du<br />
système S 5 en relation avec cet axiome est une thèse quelconque relative à toute<br />
thèse quelconque du système. Dans ces conditions, toute thèse relative à une tho<br />
est soit une thèse effectivement démontrée <strong>de</strong> la protothétique, soit une thèse <strong>de</strong><br />
l’ontologie et précè<strong>de</strong> ou est i<strong>de</strong>ntique à une thèse effective B <strong>de</strong> l’ontologie 12 . Tout<br />
système <strong>de</strong> l’ontologie « se greffe » sur une base protothétique qui a donc toujours<br />
une priorité théorique sur l’ontologie. Cela implique que l’ontologie est basée sur la<br />
protothétique qu’elle incorpore. Puisque la construction <strong>de</strong> l’ontologie dépend <strong>de</strong>s<br />
règles <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> sa base protothétique, toute thèse déjà obtenue<br />
conformément aux règles <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> la protothétique peut correspondre à<br />
une thèse <strong>de</strong> l’ontologie. C’est exactement en ce sens que l’ontologie contient la<br />
totalité <strong>de</strong> la protothétique.<br />
Nous avons montré le principe <strong>de</strong> l’emboîtement <strong>de</strong> l’ontologie dans la<br />
protothétique. Il nous faut à présent caractériser les systèmes <strong>de</strong> Leśniewski par<br />
rapport aux systèmes, au modèle standard. Nous suivons ici Denis Miéville qui<br />
épingle huit caractéristiques du modèle standard 13 .<br />
§9. Caractéristiques <strong>de</strong>s systèmes standards<br />
1. Les systèmes classiques ne constituent pas <strong>de</strong>s logiques<br />
universelles.<br />
Les systèmes classiques présupposent l’existence d’un domaine<br />
d’objets non vi<strong>de</strong>, comme le montre la classe universelle russellienne à<br />
la différence <strong>de</strong> la constante nominale du « quelque chose » chez<br />
Leśniewski. De la même manière, la classe distributive vi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Principia<br />
Mathematica, diffère profondément <strong>de</strong> la constante nominale du vi<strong>de</strong><br />
leśniewskienne. Si Russell évite le « monisme ontologique », chez<br />
Leśniewski ce problème ne se pose pas, grâce à l’axiome <strong>de</strong> l’ontologie.<br />
Exclure le cas d’un univers vi<strong>de</strong> entraîne que la notion d’existence est<br />
indissociable <strong>de</strong> la quantification, ce qui mène naturellement à la <strong>de</strong>vise<br />
<strong>de</strong> Quine : « Être, c’est être la valeur d’une variable liée. » Certes,<br />
utiliser la logique formelle pour parler d’un fragment du mon<strong>de</strong> nous<br />
engage dans un postulat d’existence et, par conséquent, à conclure à<br />
l’existence d’au moins un objet. Parmi tous les mon<strong>de</strong>s possibles, dit<br />
Russell, « il y en aura ayant un, <strong>de</strong>ux, trois individus. Il n’apparaît même<br />
pas <strong>de</strong> nécessité logique pour qu’il doive y avoir un individu pour que le<br />
mon<strong>de</strong> puisse exister (…). Dans les Principia Mathematica, les<br />
propositions primitives sont telles qu’elles permettent d’inférer qu’un<br />
individu au moins existe. Mais aujourd’hui, je considère cela comme un<br />
défaut <strong>de</strong> pureté logique. » 14 Cet engagement enlève à la logique sa<br />
[38]<br />
12 - Conformément aux<br />
indications <strong>de</strong><br />
Leśniewski, nous suivons<br />
la numérotation <strong>de</strong>s T.E.<br />
<strong>de</strong> la protothétique en<br />
ajoutant un « o » pour<br />
celles <strong>de</strong> l’ontologie.<br />
Pour T.E.XXXIIo,<br />
T.E.XXXIIo : [AB]∴ A ε<br />
tho(B) .= : A ε efthp .v<br />
. A ε tho : B ε tho : A ε<br />
prcd(B) .v. A ε Id(B).<br />
T.E.XXXIIo définit le<br />
terme « thèse relative à<br />
une thèse <strong>de</strong><br />
l’ontologie » tel que pour<br />
tout A et B, A est une<br />
thèse relative à la thoB<br />
ssi (1) A est une thèse<br />
effectivement posée <strong>de</strong><br />
la protothétique ou A est<br />
une tho ; (2) B est tho ;<br />
(3) A est un individu<br />
précédant B ou est<br />
i<strong>de</strong>ntique à B.<br />
13 – Houdé O.<br />
& Miéville D., Pensée<br />
logico-mathématique.<br />
Nouveaux objets<br />
interdisciplinaires, PUF,<br />
Paris, 1993, 242 p.<br />
14 – Russel B.,<br />
Introduction à la<br />
philosophie mathématique,<br />
Payot, Paris, 1970,<br />
pp. 241-242.
Marc P ee te rs<br />
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
dimension <strong>de</strong> complète neutralité ontologique. Elle ne saurait donc être une logique<br />
universelle.<br />
2. L’engagement existentiel <strong>de</strong> ces théories est implicite.<br />
Dans la construction logique classique <strong>de</strong>s systèmes du premier ordre avec<br />
i<strong>de</strong>ntité et dans la perspective <strong>de</strong> leur interprétation objectuelle, l’engagement<br />
existentiel est tacite. En effet, tant les <strong>de</strong>ux quantificateurs que la relation d’i<strong>de</strong>ntité<br />
présupposent cet engagement. Chez Leśniewski, au contraire, la caractérisation<br />
sémantique, même sur <strong>de</strong>s noms vi<strong>de</strong>s, exclut, a priori, un tel engagement au profit<br />
d’un traitement du vi<strong>de</strong> tout à fait particulier : s’il est exclu <strong>de</strong> construire une classe<br />
vi<strong>de</strong> en méréologie, il est possible <strong>de</strong> calculer sur <strong>de</strong>s noms vi<strong>de</strong>s en ontologie, qui,<br />
je le rappelle, ne traite du mon<strong>de</strong> mais <strong>de</strong> la manière d’en parler.<br />
3. L’interprétation objectualise, individualise les éléments du domaine<br />
sémantique.<br />
Ces éléments sont appréhendés comme ayant une existence, qu’ils soient<br />
nombres, classes ou philosophes grecs, pour reprendre l’exemple <strong>de</strong> Miéville. Cette<br />
conception <strong>de</strong> l’existence n’opère pas <strong>de</strong> distinction entre un objet et son nom.<br />
L’objet se désigne <strong>de</strong> manière autonyme. Dans le processus interprétatif, chaque<br />
terme dénote un <strong>de</strong> ces objets particuliers. Ces théories logiques n’appartiennent<br />
donc pas à la famille <strong>de</strong>s logiques libres, ce qui signifie <strong>de</strong>s logiques interprétant<br />
certains termes comme <strong>de</strong>s noms vi<strong>de</strong>s, c’est-à-dire sans dénotation, comme le<br />
permet l’ontologie <strong>de</strong> Leśniewski. Les logiques classiques sont incapables <strong>de</strong> parler<br />
d’une non-référence. On peut choisir comme Russell : refuser d’associer aux termes<br />
<strong>de</strong>s objets dont ces termes nient l’existence, mais on peut aussi leur attribuer une<br />
certaine existence. Quelle que soit la solution choisie, le problème <strong>de</strong>s noms qui ne<br />
dénotent pas est évité mais il n’est pas résolu.<br />
4. La quantification est restreinte.<br />
Ces variables sont seulement <strong>de</strong>s variables individuelles ; elles ne disposent<br />
pas <strong>de</strong> quantificateurs qui opèrent sur <strong>de</strong>s variables <strong>de</strong> noms vi<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong> noms<br />
généraux.<br />
5 Les systèmes classiques sont <strong>de</strong> nature catégorielle.<br />
Toute expression est conçue sur la base d’un vocabulaire initial préalablement<br />
spécifié et dont l’appartenance catégorielle est précisément déterminée. Chaque<br />
symbole est un symbole type, et non un symbole token, comme c’est le cas chez<br />
Leśniewski.<br />
6. Ces systèmes ne permettent aucune liberté catégorielle et<br />
développementale.<br />
Ils sont fermés, c’est-à-dire qu’ils contiennent potentiellement à travers leur<br />
vocabulaire leurs expressions bien formées, axiomes et règles <strong>de</strong> tranformation. Un<br />
[39]
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
Marc P ee te rs<br />
système fermé s’oppose à un système ouvert ou développemental. Ils sont fermés<br />
en ce qu’ils contiennent potentiellement tout ce qu’ils sont capables <strong>de</strong> promettre. Il<br />
est certes possible <strong>de</strong> définir <strong>de</strong> nouvelles constantes, mais cette activité est<br />
métalinguistique. Son intérêt rési<strong>de</strong> essentiellement dans le fait qu’elles permettent<br />
<strong>de</strong> simplifier <strong>de</strong>s expressions encombrantes ou <strong>de</strong> marquer a posteriori l’importance<br />
subjective attachée à telle constante. Une définition reste une abréviation et n’a<br />
donc aucun pouvoir développemental.<br />
7. Les systèmes classiques permettent l’énoncé <strong>de</strong> principes excessifs qui<br />
semblent en désaccord avec les démarches <strong>de</strong> la pensée naturelle.<br />
Le principe du tiers-exclu associé uniquement à la négation propositionnelle<br />
rend possible l’applicabilité <strong>de</strong> tout prédicat à tout sujet. Il n’y a aucune possibilité<br />
d’opérer une distinction entre une propriété pertinente pour un objet (par exemple :<br />
3, pair, impair) et une propriété dont ce n’est pas le cas (par exemple : 3, potable,<br />
non potable) ; c’est ce que le logicien Corcoran nomme l’applicabilité universelle <strong>de</strong>s<br />
prédicats et qu’il dénonce comme une <strong>de</strong>s lacunes fondamentales <strong>de</strong>s logiques<br />
classiques. La sémantique standard présuppose <strong>de</strong>s domaines d’applicabilité pour<br />
tous les prédicats.<br />
8 Les logiques classiques sont restrictives parce qu’elles ont été conçues<br />
pour exprimer un nombre bien déterminé <strong>de</strong> connecteurs logiques : quatre<br />
opérateurs unaires, seize opérateurs binaires, <strong>de</strong>ux quantifications<br />
explicitables et rien d’autre.<br />
Il est important <strong>de</strong> noter que ce que propose la logique classique n’est qu’une<br />
partie <strong>de</strong> ce que doit couvrir le projet logique. Je cite McCawley :<br />
Je considère les propriétés logiques <strong>de</strong> "et", "ou", "non", "si, alors", "tout" et<br />
« quelque » comme ne formant ni le tout <strong>de</strong> la logique, ni même sa partie<br />
essentielle ; mais simplement comme la partie <strong>de</strong> la logique qui, notamment pour<br />
<strong>de</strong>s raisons historiques, a été la plus systématiquement étudiée et la mieux<br />
comprise.<br />
La logique standard, telle qu’elle vient d’être rapi<strong>de</strong>ment esquissée en suivant<br />
Miéville s’oppose à la logique développementale <strong>de</strong> Leśniewski. Ce <strong>de</strong>rnier n’a pas<br />
contribué directement au projet logiciste <strong>de</strong> Frege et Russell, je l’ai rappelé. Ce que<br />
cherche Leśniewski, partant du tourment intellectuel au sujet <strong>de</strong> l’antinomie <strong>de</strong><br />
Russell, c’est une théorie ouverte qui offre un nombre illimité <strong>de</strong> constantes<br />
logiques. Leśniewski n’est pas satisfait par le rôle classique qui est attribué à la<br />
quantification. Il ne voit aucune raison valable pour n’associer au nom que <strong>de</strong>s<br />
entités individuelles. La notion <strong>de</strong> classe distributive <strong>de</strong> Russell le déroute, comme<br />
le dit encore Miéville. Mais surtout il n’accepte pas <strong>de</strong> n’attribuer à la définition<br />
qu’un rôle <strong>de</strong> commodité linguistique, qu’une fonction abréviative. Il considère que<br />
la définition est une activité <strong>de</strong> pensée déterminante dans le développement d’une<br />
[40]
Marc P ee te rs<br />
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
connaissance nouvelle et que c’est son rôle inférentiel que le logicien doit respecter.<br />
C’est à travers elle qu’un système logique doit s’élaborer et cela à partir d’une base<br />
mo<strong>de</strong>ste en termes <strong>de</strong> signification primitive. Ce qui requiert trois opérations, ou<br />
plus exactement pose trois ordres <strong>de</strong> problèmes.<br />
Il s’agit d’abord <strong>de</strong> cerner les conditions nécessaires et suffisantes qui<br />
participent à la construction d’une définition.<br />
Puis, <strong>de</strong> penser l’activité définitoire comme une activité inférentielle interne au<br />
système considéré.<br />
Il y a enfin la nécessité <strong>de</strong> déterminer quelles significations primitives<br />
permettent à la fois d’être en accord avec une procédure définitoire inférentielle et<br />
d’être à même <strong>de</strong> donner progressivement accès à toute constante logique d’une<br />
quelconque catégorie syntaxico-sémantique souhaitée.<br />
§10. La protothétique est une théorie qui règle le discours du vrai et du faux.<br />
En cela, elle rejoint le projet <strong>de</strong> la logique classique <strong>de</strong>s propositions bivalentes.<br />
L’originalité <strong>de</strong> ce système rési<strong>de</strong> incontestablement dans la directive <strong>de</strong> définition.<br />
Toute activité définitoire est associée à un système et plus particulièrement à un<br />
état d’un système qui contient notamment <strong>de</strong>s signes primitifs. Cette activité<br />
permet alors d’inscrire dans le système un signe constant nouveau en établissant<br />
une relation d’équivalence entre <strong>de</strong>ux ensembles <strong>de</strong> signes. Cette mise en relation<br />
n’est pas quelconque ; elle doit répondre aux conditions minimales qui structurent<br />
toute définition explicite. Il s’agit d’établir une relation d’équivalence entre un<br />
<strong>de</strong>finiendum et un <strong>de</strong>finiens ; <strong>de</strong> construire le <strong>de</strong>finiens sur ce qui a été<br />
préalablement posé, voire défini ; d’inscrire un terme constant, nouveau, unique<br />
dans le <strong>de</strong>finiendum, terme qui n’appartient pas encore au système ; à veiller à ce<br />
qu’aucun signe du <strong>de</strong>finiendum ne soit répété.<br />
Pour bien comprendre le jeu entre <strong>de</strong>finiens et <strong>de</strong>finiendum, il faut procé<strong>de</strong>r à<br />
une analyse <strong>de</strong> l’équivalence logique. Deux propositions P et Q possè<strong>de</strong>nt entre<br />
elles la relation d’équivalence si et seulement si le résultat <strong>de</strong> la biconditionnelle qui<br />
leur est appliquée est une tautologie. Ainsi, admettre que l’équivalence logique est<br />
réalisée entre <strong>de</strong>ux propositions, c’est vérifier que le résultat d’un calcul logique<br />
fondé sur la biconditionnelle est une tautologie. Ce dont Leśniewski tire trois<br />
conséquences :<br />
fon<strong>de</strong>r un calcul <strong>de</strong>s propositions sur la biconditionnelle comme unique<br />
connecteur primitif.<br />
système.<br />
Admettre qu’une définition doit apparaître comme une thèse, un théorème du<br />
[41]
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
Marc P ee te rs<br />
Introduire une quantification qui porte sur les variables propositionnelles, ainsi<br />
que sur les variables d’une quelconque catégorie, pour autant qu’elle ait été<br />
préalablement introduite.<br />
§11. Le premier point a été découvert par Tarski en 1922. Nous l’avons vu, la<br />
quantification pour Leśniewski ne possè<strong>de</strong> pas le caractère existentiel implicite <strong>de</strong>s<br />
logiques classiques : elle ne saurait donc être objectuelle. L’existence et la<br />
quantification sont selon Leśniewski <strong>de</strong>ux notions distinctes. La base axiomatique <strong>de</strong><br />
la protothétique est extrêmement mo<strong>de</strong>ste en termes <strong>de</strong> catégories syntaxico-<br />
sémantiques et en termes <strong>de</strong> constantes logiques. En fait, seul un terme constant<br />
<strong>de</strong> la catégorie formateur <strong>de</strong> propositions à <strong>de</strong>ux arguments propositionnels y est<br />
inscrit, la biconditionnelle. Quant aux catégories, <strong>de</strong>ux seules apparaissent : S et<br />
S/SS. Sur cet acquis et à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> plusieurs règles d’inférence, dont celles <strong>de</strong><br />
détachement, <strong>de</strong> substitution et <strong>de</strong> définition, il est loisible <strong>de</strong> développer<br />
progressivement un système logique. Celui-ci donne potentiellement accès à toute<br />
constante d’une quelconque catégorie par induction. Cette qualité<br />
développementale ne saurait être possible si le système était catégoriel, c’est-à-dire<br />
si la caractérisation présémantique <strong>de</strong>s signes était déterminée par les ensembles<br />
auxquels ils appartiennent.<br />
§12. La solution qui ouvre au développemental passe par une détermination<br />
contextuelle. C’est la situation du signe au sein du contexte dans lequel il apparaît<br />
qui permet la détermination <strong>de</strong> son appartenance catégorielle. Il est donc<br />
indispensable <strong>de</strong> proposer un contexte <strong>de</strong> base par rapport auquel d’autres<br />
contextes pourront être inscrits grâce à la règle <strong>de</strong> définition.<br />
Soit une inscription parenthésée à <strong>de</strong>ux arguments que l’on considérera<br />
dorénavant comme le contexte primitif qui donne <strong>de</strong>ux informations :<br />
Toute entité inscrite dans ce contexte est <strong>de</strong>stinée à être <strong>de</strong> la catégorie <strong>de</strong>s<br />
propositions.<br />
Tout terme précédant ce contexte est <strong>de</strong>stiné à être <strong>de</strong> la catégorie <strong>de</strong>s<br />
foncteurs formateurs <strong>de</strong> propositions à <strong>de</strong>ux arguments propositionnels. Ainsi, les<br />
expressions équiformes à * et + dans l’expression parenthésée (*+) sont <strong>de</strong> la<br />
catégorie <strong>de</strong>s propositions. Elles appartiennent à cette catégorie non pas parce<br />
qu’elles sont liées à un ensemble <strong>de</strong> référence, qui réunit tous les termes <strong>de</strong> cette<br />
catégorie, mais uniquement parce qu’elles apparaissent dans une expression<br />
parenthésée à <strong>de</strong>ux arguments dont les parenthèses sont équiformes à « ( » et à<br />
« ) ». Tout développement à partir <strong>de</strong>s axiomes doit respecter ce jeu contextuel s’il<br />
se développe à partir <strong>de</strong> ces catégories-là et peut, via la règle <strong>de</strong> définition,<br />
introduire <strong>de</strong> nouveaux contextes <strong>de</strong> manière à ne générer ni confusion, ni<br />
ambiguïté 15 .<br />
[42]<br />
15 - Pour ce qui précè<strong>de</strong>,<br />
nous renvoyons aux<br />
travaux <strong>de</strong> Miéville et<br />
Joray.
Le problème <strong>de</strong> la définition 16 .<br />
Marc P ee te rs<br />
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
§13. Du débat entre les <strong>de</strong>ux fondateurs <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> Varsovie, Łukasiewicz<br />
et Leśniewski consacré à la définition, nous ne possédons que les comptes-rendus<br />
analytiques <strong>de</strong> conférences données par Łukasiewicz en 1928 et non la réponse <strong>de</strong><br />
Leśniewski. La conception <strong>de</strong> la définition explicite culmina dans les Principia<br />
Mathematica <strong>de</strong> Whitehead et Russell. La définition <strong>de</strong>s Principia est<br />
métalinguistique, et tant Leśniewski que Łukasiewicz s’opposèrent à cette vision.<br />
Toutefois, leur opposition ne se concrétisa pas <strong>de</strong> la même manière. Si Łukasiewicz<br />
tenta <strong>de</strong> donner <strong>de</strong> la définition le statut d’une procédure réglée à l’intérieur même<br />
<strong>de</strong> ces systèmes axiomatiques mais qui restait abréviative, Leśniewski eut une<br />
ambition plus gran<strong>de</strong>. Il chercha à faire <strong>de</strong> la définition un outil déductif nécessaire<br />
à la constitution <strong>de</strong> preuves. A l’ai<strong>de</strong> d’Alfred Tarski en 1922, il parvint à montrer<br />
que l’intégralité du calcul <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> vérité pouvait être captée par une<br />
axiomatique incluant l’unique terme primitif <strong>de</strong> la biconditionnelle. Ce résultat<br />
profondément novateur ouvrit la question qui se trouva au cœur <strong>de</strong> la polémique<br />
avec Łukasiewicz. Était-il justifié d’adopter <strong>de</strong>s définitions capables d’introduire dans<br />
un système axiomatique plus que <strong>de</strong> simples abréviations ?<br />
§14. Le statut métalinguistique <strong>de</strong> la définition constitue un paradoxe relevé<br />
par Russell en 1903 :<br />
C’est un curieux paradoxe, énigmatique pour l’esprit symbolique, que les<br />
définitions ne soient théoriquement rien d’autre que les énoncés d’abréviations<br />
symboliques, sans signification pour le raisonnement et introduites uniquement<br />
par commodité pratique, alors que, pourtant, dans le développement d’un sujet,<br />
elles exigent une contribution importante <strong>de</strong> la pensée et qu’elles incarnent<br />
souvent les plus grands succès <strong>de</strong> l’analyse.<br />
L’introduction, en 1910, <strong>de</strong>s Principia Mathematica ne mentionne plus le mot<br />
« paradoxe » :<br />
Théoriquement, il n’est pas nécessaire <strong>de</strong> donner une seule définition. Nous<br />
pourrions toujours utiliser le <strong>de</strong>finiens à sa place et nous dispenser ainsi<br />
totalement du <strong>de</strong>finiendum : Donc, bien que nous employions <strong>de</strong>s définitions et ne<br />
définissions pas l’expression “définition”, “définition” n’apparaît pas parmi nos<br />
idées primitives parce que les définitions ne font pas partie <strong>de</strong> notre sujet, mais<br />
sont, à strictement parler, <strong>de</strong> simples commodités pratiques.<br />
[43]<br />
16 – Joray P.,<br />
« Axiomatique et définition<br />
dans les systèmes logiques<br />
<strong>de</strong> Leśniewski, Tarski et<br />
Łukasiewicz », in : La<br />
philosophie en Pologne.<br />
1918-1939, (Sous la dir. <strong>de</strong><br />
Pouivet R. et Rebuschi M.),<br />
Vrin, Paris, 2006. Nous<br />
suivons ici l’argumentation<br />
<strong>de</strong> Joray.
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
Marc P ee te rs<br />
Pierre Joray insiste sur le fait que ni Łukasiewicz, ni Leśniewski « ne pouvaient se<br />
satisfaire d’une telle situation : s’ils pouvaient partager le réquisit <strong>de</strong> l’éliminabilité<br />
du <strong>de</strong>finiendum au profit du <strong>de</strong>finiens et reconnaître l’importance épistémique <strong>de</strong>s<br />
définitions (…), l’idée d’un usage externe <strong>de</strong>s définitions dénué <strong>de</strong> toute<br />
caractérisation formelle au sein <strong>de</strong> la théorie déductive, ne pouvait sans doute<br />
recevoir à leurs yeux aucune justification. » 17<br />
§15. Dans ces <strong>de</strong>ux conférences <strong>de</strong> 1928, Łukasiewicz entreprend d’exposer<br />
et <strong>de</strong> comparer les mérites et défauts <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux sortes <strong>de</strong> définitions en usage dans<br />
l’École <strong>de</strong> Varsovie. Il décrit la première comme étant celle utilisée dans les Principia<br />
Mathematica et la qualifie <strong>de</strong> définition comme règle. La secon<strong>de</strong> sorte est<br />
rapportée à Tarski et Leśniewski, c’est la définition comme thèse. Poser une<br />
définition comme règle, c’est agir au sein du système en intégrant officiellement un<br />
nouveau symbole au langage objet et en ajoutant aux côtés <strong>de</strong>s règles usuelles<br />
(détachement et substitution), une règle spécifique <strong>de</strong> remplacement susceptible<br />
d’intervenir <strong>de</strong> plein droit dans la preuve d’une thèse. En ce qui concerne la<br />
définition comme thèse, dans l’usage qu’en font Tarski et Leśniewski, Łukasiewicz<br />
écrit « on peut formaliser les définitions par l’usage <strong>de</strong>s termes primitifs et en en<br />
faisant <strong>de</strong>s thèses d’un système. On prend alors soin que ces thèses signifient une<br />
équivalence portant sur un <strong>de</strong>finiens (…) et un <strong>de</strong>finiendum (…). » La forme <strong>de</strong>s<br />
définitions dépend alors <strong>de</strong>s termes choisis comme primitifs.<br />
§16. Contrairement à la pratique définitoire, métalinguistique <strong>de</strong>s auteurs <strong>de</strong>s<br />
Principia, les <strong>de</strong>ux genres <strong>de</strong> définition décrits par Łukasiewicz, comme règle et<br />
comme thèse, présentent un aspect commun essentiel : <strong>de</strong> l’un et l’autre côtés, la<br />
définition se trouve pensée comme une procédure interne, relevant <strong>de</strong> l’appareil<br />
déductif du système, et permettant l’enrichissement effectif du langage logique par<br />
l’ajout <strong>de</strong> symboles nouveaux. Toutefois ce point commun ne doit pas masquer les<br />
différences essentielles entre les <strong>de</strong>ux conceptions <strong>de</strong> la définition. La différence la<br />
plus marquante tient à la manière dont les définitions peuvent être exploitées une<br />
fois qu’elles ont été posées. Dans le cas <strong>de</strong>s définitions comme règles, cette<br />
exploitation reste indépendante <strong>de</strong> l’axiomatique. Les remplacements que les règles<br />
autorisent se font toujours <strong>de</strong> la même manière, et ceci quels que soient les termes<br />
primitifs et les axiomes choisis. En revanche, dans le cas <strong>de</strong>s définitions comme<br />
thèses, la relation d’équivalence entre <strong>de</strong>finiendum et <strong>de</strong>finiens étant exprimée à<br />
l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s termes primitifs du système, l’exploitation <strong>de</strong>s définitions est forcément<br />
dépendante <strong>de</strong> la manière dont ces termes sont caractérisés dans l’axiomatique<br />
adoptée. « Autrement dit, une fois une définition posée comme thèse, son usage<br />
dans le cadre déductif se trouve entièrement réglé par la logique adoptée » 18 .<br />
§17. Łukasiewicz défendit contre ses collègues Tarski et Leśniewski sa<br />
conception <strong>de</strong>s définitions comme règles <strong>de</strong> remplacement. Pour ce faire, il invoqua<br />
en 1928 trois arguments : 1. La définition comme règle est plus conforme à la<br />
[44]<br />
17 – Joray P., Op. cit.,<br />
p. 206.<br />
18 - Ibid., p. 210.
Marc P ee te rs<br />
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
compréhension intuitive <strong>de</strong>s définitions. 2. Les définitions comme règles sont plus<br />
fortes que les définitions comme thèses. Dans un système comprenant la<br />
conditionnelle comme terme primitif et incluant parmi ces thèses la loi d’i<strong>de</strong>ntité, on<br />
peut toujours obtenir les expressions conditionnelles nécessaires à une définition<br />
comme thèse en exploitant une définition posée comme règle. 3. Łukasiewicz<br />
affirme que les définitions comme thèses jouent un rôle créatif et sont comme <strong>de</strong>s<br />
axiomes masqués 19 .<br />
§18. Il indique qu’une définition possè<strong>de</strong> un rôle créatif lorsqu’elle permet<br />
d’inférer à partir <strong>de</strong>s axiomes et par le seul moyen <strong>de</strong> règles <strong>de</strong> substitution et <strong>de</strong><br />
détachement, <strong>de</strong>s thèses qui ne contiennent que <strong>de</strong>s termes primitifs et qui sont<br />
pourtant indépendantes <strong>de</strong>s axiomes. Face à cet argument décisif <strong>de</strong> Łukasiewicz,<br />
Leśniewski eut une position inattendue. S’il n’admit jamais que l’on puisse qualifier<br />
ces définitions d’axiomes masqués, il revendiqua le caractère créatif <strong>de</strong> ces<br />
définitions comme étant une qualité à rechercher. Il affirme que « les définitions<br />
conduisent effectivement à <strong>de</strong>s thèses qui sont indépendantes <strong>de</strong>s axiomes », et il<br />
ajoute « ceci n’est pas un vice, bien au contraire. Si on inscrit <strong>de</strong>s définitions,<br />
celles-ci <strong>de</strong>vraient être les plus créatives possibles. »<br />
§19. En 1939, dans son article sur le calcul équivalentiel, Łukasiewicz pensa<br />
être en mesure <strong>de</strong> porter un coup fatal à la conception leśniewskienne <strong>de</strong>s<br />
définitions. C’est la loi d’i<strong>de</strong>ntité qui fait passer une définition créative en un axiome<br />
caché. Rickey a publié en 1975 un métathéorème attribué à Lin<strong>de</strong>nbaum, qui dit<br />
que si l’on entend par système propositionnel normal un système propositionnel non<br />
quantifié et incluant uniquement <strong>de</strong>s variables propositionnelles, le métathorème<br />
énonce : soit L un système propositionnel normal contenant E parmi ses termes<br />
primitifs ; si Epp est une thèse <strong>de</strong> L, alors aucune définition dans L ne peut être<br />
créative si elle est posée sous la forme Eab. Ce résultat indique que la crainte<br />
suscitée par la créativité <strong>de</strong> certaines définitions explicites dans le cadre <strong>de</strong> logiques<br />
propositionnelles normales, est tout simplement dénuée d’objet.<br />
§20. Comme l’indique encore Joray, la possibilité <strong>de</strong> définitions explicites et<br />
créatives n’existe en effet qu’en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s logiques discutées par Łukasiewicz,<br />
c’est-à-dire dans <strong>de</strong>s logiques quantifiées ou incluant au moins <strong>de</strong>s variables autres<br />
que propositionnelles. Toutefois, le résultat <strong>de</strong> Lin<strong>de</strong>nbaum n’évacue pas<br />
complètement la crainte <strong>de</strong> Łukasiewicz que les définitions créatives soient <strong>de</strong>s<br />
axiomes masqués. On sait aujourd’hui qu’il existe, hors <strong>de</strong>s logiques normales, <strong>de</strong>s<br />
définitions posées comme thèses qui sont à la fois explicites et créatives, comme<br />
celles <strong>de</strong> Leśniewski. Pourtant, pour être explicites, ces définitions doivent<br />
nécessairement être posées dans un cadre incluant une loi d’i<strong>de</strong>ntité. Or, comme<br />
Łukasiewicz lui-même l’a montré en 1928, dans son <strong>de</strong>uxième argument, les<br />
définitions posées comme règles <strong>de</strong> remplacement sont logiquement plus fortes que<br />
celles posées comme thèses. Il s’ensuit qu’au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s logiques normales, les<br />
[45]<br />
19 - Ibid., p. 211.
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
Marc P ee te rs<br />
définitions posées comme règles sont elles aussi susceptibles d’être créatives. Resté<br />
attaché à son idée qu’en aucune manière une définition explicite ne <strong>de</strong>vait pouvoir<br />
être assimilée à un axiome caché, Łukasiewicz ne s’est pas aperçu que sa propre<br />
conception <strong>de</strong>s définitions ne pouvait garantir sur ce point une plus gran<strong>de</strong> sûreté<br />
que celle <strong>de</strong> Leśniewski.<br />
Définitions et abstraction.<br />
§21. Il est possible <strong>de</strong> distinguer <strong>de</strong>ux familles <strong>de</strong> définitions explicites. Eu<br />
égard à la manière dont se trouve exprimée la relation d’équivalence entre<br />
<strong>de</strong>finiendum et <strong>de</strong>finiens, Joray parle respectivement <strong>de</strong> définitions externes ou<br />
internes.<br />
Les définitions externes sont conformes à l’usage <strong>de</strong>s Principia Mathematica ;<br />
la conception externe <strong>de</strong>s définitions explicites est encore aujourd’hui la plus<br />
couramment pratiquée par les logiciens, usant <strong>de</strong> métavariables ainsi que d’un<br />
relateur métalinguistique usuellement noté « =df ». On peut par exemple définir le<br />
connecteur <strong>de</strong> disjonction sur la base du conditionnel et <strong>de</strong> la négation<br />
propositionnelle. Joray épingle trois raisons pour lesquelles une définition <strong>de</strong> ce type<br />
mérite le qualificatif d’externe.<br />
La première est son caractère purement linguistique. Le fait que « =df »<br />
n’apparaisse pas parmi les primitifs du langage en question, en fait une constante<br />
qui n’est en aucune manière réglée par l’axiomatique fixant les significations<br />
logiques <strong>de</strong> base.<br />
La secon<strong>de</strong> raison tient à ce que le terme défini ne se trouve aucunement<br />
intégré au langage par lequel la définition est posée. De fait, insiste Joray, le<br />
langage-objet reste toujours le même ensemble <strong>de</strong> formules. Donné une fois pour<br />
toutes par son vocabulaire et ses règles <strong>de</strong> formation, le langage-objet n’est pas<br />
susceptible d’être élargi, sinon à être étendu à un langage distinct du premier.<br />
Troisièmement, avec un tel outil, il <strong>de</strong>meure impossible <strong>de</strong> rendre compte<br />
dans le cadre strict d’une théorie formalisée, <strong>de</strong> l’usage naïf qui est fait <strong>de</strong>s<br />
définitions dans la version informelle <strong>de</strong> cette théorie.<br />
§22. Le choix <strong>de</strong> Leśniewski consista à estimer que la définition explicite<br />
<strong>de</strong>vait être intégrée comme un moyen formel <strong>de</strong> démonstration <strong>de</strong>s thèses.<br />
Autrement dit, il fit le choix d’une conception <strong>de</strong>s définitions explicites comme<br />
internes au système formel. Dans cette conception, la relation d’équivalence entre<br />
le <strong>de</strong>finiendum et le <strong>de</strong>finiens doit être exprimée par <strong>de</strong>s moyens propres au<br />
langage-objet. L’usage d’un relateur métalinguistique comme « =df » se trouve<br />
alors proscrit au profit <strong>de</strong>s seuls termes primitifs du langage adopté. Ce que les<br />
[46]
Marc P ee te rs<br />
Le problème <strong>de</strong>s définitions dans l’École <strong>de</strong> Lvov-Varsovie<br />
réflexions <strong>de</strong> Leśniewski permettent <strong>de</strong> montrer, c’est qu’une définition éliminable<br />
peut néanmoins être créative et donc jouer un rôle incontournable dans les moyens<br />
démonstratifs d’un système formel.<br />
§23. Que conclure <strong>de</strong> ce débat ? Le modèle standard <strong>de</strong> la logique ne rend<br />
pas compte du caractère développemental <strong>de</strong> celui-ci, essentiellement au niveau<br />
<strong>de</strong>s définitions créatives. Or, la plasticité <strong>de</strong> la science logique et son inventivité<br />
semblent requérir <strong>de</strong> tels mouvements faibles. Ce sont <strong>de</strong>ux modèles qui<br />
s’affrontent : d’un côté, les Principia Mathematica essentiellement, et leur<br />
définitions métalinguistiques ad hoc ; <strong>de</strong> l’autre, un développement naturel mais<br />
Marc PEETERS<br />
est professeur <strong>de</strong><br />
philosphie à l’ULB. Il<br />
est membre du Centre<br />
<strong>de</strong> philosophie<br />
ancienne <strong>de</strong> l’ULB.<br />
codifié indépendant <strong>de</strong>s axiomes. La logique développementale est<br />
une dissi<strong>de</strong>nce qui ouvre à la possibilité d’une métaphysique en<br />
même temps qu’elle permet une réduction <strong>de</strong> l’arithmétique <strong>de</strong><br />
Peano à l’ontologie.<br />
[47]<br />
À suivre
Olivier Santamaria<br />
Boris Mouravieff<br />
et l'ésotérisme chrétien<br />
H<br />
istorien, philosophe, ésotériste et maître spirituel, Boris Mouravieff<br />
fut avant tout un homme inclassable. Professeur d’histoire à<br />
l’université <strong>de</strong> Genève, il quitte ses fonctions officielles pour se<br />
consacrer à l’enseignement ésotérique. Russe expatrié en Occi<strong>de</strong>nt, il n’affiche pas<br />
l’exclusivisme <strong>de</strong> certains orthodoxes à l’égard <strong>de</strong>s autres confessions chrétiennes.<br />
Slavophile, amoureux <strong>de</strong> la vieille Russie et <strong>de</strong> tout l’Orient chrétien, il ne réduit<br />
pourtant pas sa pensée religieuse à la Tradition chrétienne seule puisque, pour lui,<br />
la véritable Tradition n’est ni Russe ni Grecque et, plus largement, ni d’Orient ni<br />
d’Occi<strong>de</strong>nt : elle est universelle. Certains <strong>de</strong> ses commentateurs ont voulu faire <strong>de</strong><br />
lui un orthodoxe ; or, s’il est indéniable que Mouravieff a effectivement opté pour la<br />
religion <strong>de</strong> ses ancêtres, il est néanmoins toujours resté distant <strong>de</strong> toute Église<br />
institutionnelle. Pour lui, en effet, la foi du simple fidèle, si elle suffit au salut<br />
individuel, ne procure pourtant pas la pleine connaissance — Gnôsis. Seule la<br />
connaissance, entendue comme une connaissance initiatique, ésotérique, peut faire<br />
parvenir le fidèle à la secon<strong>de</strong> Naissance, aux portes du Royaume <strong>de</strong> Dieu, et lui<br />
permettre <strong>de</strong> gui<strong>de</strong>r l’humanité, par-<strong>de</strong>là la crise qui la menace, vers une <strong>de</strong>stinée<br />
heureuse. C’est à cette connaissance, transmise jusqu’à lui par la Tradition<br />
ésotérique <strong>de</strong> l’orthodoxie orientale, que Mouravieff consacrera la plus gran<strong>de</strong> part<br />
<strong>de</strong> ses œuvres et <strong>de</strong> son énergie.
[49]<br />
Oliv ier San tamaria<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
Pour lui, la « Tradition ésotérique », bien qu’universelle par nature, se révèle<br />
d’une façon différenciée en fonction <strong>de</strong>s époques et <strong>de</strong> la mentalité <strong>de</strong>s peuples<br />
auxquels elle s’adresse. Face à un public essentiellement Européen, il est naturel<br />
que Mouravieff ait présenté son enseignement sous une forme chrétienne car,<br />
chrétien ou non, croyant ou athée, l’homme européen est façonné par vingt siècles<br />
<strong>de</strong> culture chrétienne. Par ailleurs, contrairement aux autres religions qui, bien<br />
qu’issues <strong>de</strong> la Tradition unique, ne s’adressent toujours qu’à une fraction <strong>de</strong><br />
l’humanité, le christianisme a affirmé dès ses origines un caractère œcuménique et<br />
universaliste. Pour ces <strong>de</strong>ux raisons, l’enseignement <strong>de</strong> Mouravieff est donc<br />
« profondément chrétien » 1 .<br />
Quant à «l’ésotérisme », il signifie pour lui principalement une métho<strong>de</strong><br />
d’interprétation et <strong>de</strong> compréhension approfondie <strong>de</strong>s textes sacrés, associée à <strong>de</strong>s<br />
métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> perfectionnement <strong>de</strong> la « Personne ». La doctrine ésotérique est<br />
comprise comme un équivalent approximatif <strong>de</strong> « Gnose » ou <strong>de</strong> « Connaissance »,<br />
au sens d’une Connaissance vivante, qui procure <strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong> conscience élevés,<br />
et qui transforme le sujet lui-même, comme lors d’un processus initiatique 2 . Boris<br />
Mouravieff a d’ailleurs voulu organiser son système selon une structure <strong>de</strong><br />
mouvement initiatique : l’étudiant prend connaissance en premier lieu <strong>de</strong> l’aspect<br />
théorique et relativement extérieur <strong>de</strong> la doctrine ; ensuite il avance dans la<br />
connaissance <strong>de</strong> celle-ci par différents paliers ; enfin il est initié à la pratique, qui<br />
requiert une intériorisation, un approfondissement et une réalisation concrète, ce<br />
qui équivaut à une véritable secon<strong>de</strong> Naissance.<br />
Quelques éléments biographiques<br />
Boris Mouravieff est né à Kronstadt le 8 mars 1890 et décédé à Genève en<br />
1969, à l’âge <strong>de</strong> 79 ans. Située sur l’île Kotlin (Golfe <strong>de</strong> Finlan<strong>de</strong>) en Russie,<br />
Kronstadt était rattachée administrativement à Saint-Pétersbourg et servait<br />
principalement <strong>de</strong> base navale. La ville <strong>de</strong> Kronstadt est restée célèbre pour avoir<br />
été à l’avant-gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s révolutions <strong>de</strong> 1905 et <strong>de</strong> 1917, ainsi que le siège <strong>de</strong> la<br />
« Révolte » éponyme, qui opposa les marins anarchistes et révolutionnaires au<br />
pouvoir bolchevique en 1921.<br />
Fils du comte Pjotr Petrovič Murav’ev, amiral <strong>de</strong> la Flotte russe et <strong>de</strong>rnier<br />
secrétaire d’État à la Marine <strong>de</strong> Guerre impériale, Boris était <strong>de</strong>stiné à une carrière<br />
militaire ou politique. À l’abdication du tsar en mars 1917, alors qu’il n’a que 27<br />
ans, il est promu successivement capitaine <strong>de</strong> frégate puis chef <strong>de</strong> cabinet naval du<br />
ministre socialiste révolutionnaire Alexandr Fjodorovič Kerenskij dans le premier<br />
gouvernement provisoire (sous la direction du prince Georgij L’vov). Il <strong>de</strong>vient<br />
ensuite chef d’état-major adjoint <strong>de</strong> la flotte <strong>de</strong> la mer Noire, nommé<br />
par le même Kerenskij, qui était alors chef du gouvernement russe,<br />
jusqu’au renversement <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier lors du coup d'état du 7 novembre<br />
1 - Sur ces questions, voir<br />
Mouravieff B., Gnôsis,<br />
Neuchâtel (Suisse), Éd. <strong>de</strong><br />
La Baconnière, 1969, t. 1,<br />
pp. 13 et 14.<br />
2 – Voir Faivre A., « Boris<br />
Mouravieff », in : Dictionary<br />
of Gnosis & Western<br />
Esotericism, Lei<strong>de</strong>n<br />
(Pays-Bas), Londres, Brill,<br />
2005, t. 1, pp. 806-807.
[50]<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
Oliv ier San tamaria<br />
1917 qui marque le début <strong>de</strong> la « Gran<strong>de</strong> Révolution socialiste d'Octobre » et les<br />
premières heures du régime bolchevique.<br />
Ces événements marquent la fin <strong>de</strong>s activités politiques et militaires <strong>de</strong> Boris<br />
Mouravieff. Ses écrits et sa pensée <strong>de</strong>meureront néanmoins toujours empreints<br />
d’un intérêt réel pour la question politique ou métapolitique.<br />
L’influence spirituelle <strong>de</strong> son grand-oncle sera elle aussi — et peut-être même<br />
surtout — déterminante. Andrej Nikolaevič Murav’ev, homme <strong>de</strong> lettres issu <strong>de</strong> la<br />
noblesse russe, s’était attaché, lors <strong>de</strong> nombreux voyages en Orient, à retrouver<br />
une série <strong>de</strong> manuscrits anciens touchant aux fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> la tradition orthodoxe.<br />
Il sera l’auteur d’une Histoire <strong>de</strong> l’Église <strong>de</strong> Russie 3 ainsi que le fondateur du skite<br />
(groupe d’ermites vivant sous l’autorité d’un monastère) russe Saint André au Mont<br />
Athos. Boris Mouravieff évoque son souvenir et son influence en ces termes :<br />
Personnellement, je m’occupe <strong>de</strong> la Tradition en question <strong>de</strong>puis ma jeunesse ;<br />
j’en étais favorisé aussi par certaines indications dues à la tradition <strong>de</strong> ma famille,<br />
issue d’André Mouravieff (mort en 1874), Chambellan à la Cour impériale,<br />
membre du Saint-Syno<strong>de</strong>, fondateur du monastère <strong>de</strong> Saint-André au Mont-Athos.<br />
C’était un grand voyageur. Il parcourut l’Égypte, l’Asie Antérieure, l’Arménie, la<br />
Transcaucasienne, le Kurdistan et poussa jusqu’à la Perse, et au <strong>de</strong>là, les<br />
recherches <strong>de</strong>s détails <strong>de</strong> cette Tradition sublime et <strong>de</strong>s manuscrits <strong>de</strong>s premiers<br />
siècles <strong>de</strong> notre ère. 4<br />
Boris Mouravieff poursuivra la voie tracée par son grand-oncle, en<br />
s’attachant toute sa vie à retrouver puis à enseigner ce qu’il appellera lui-même la<br />
« Tradition ésotérique <strong>de</strong> l’orthodoxie orientale » ou plus simplement la<br />
« Tradition ».<br />
En 1920 il se rend à Constantinople pour y suivre <strong>de</strong>s conférences<br />
données par Pjotr Dem’janovič Uspenskij [Ouspensky] (Moscou, 1878 –<br />
Londres, 1947), philosophe et maître spirituel d’origine russe. Ce <strong>de</strong>rnier<br />
lui fera rencontrer Georgij Ivanovič Gjurdžiev [Gurdjieff] (Alexandropol<br />
[Russie], 1866 – Paris, 1949) qui l’introduira auprès <strong>de</strong> plusieurs<br />
personnes en France, dans son Prieuré <strong>de</strong> Fontainebleau ainsi qu’à Paris.<br />
Dans ses articles et livres touchant à l’ésotérisme, Mouravieff prendra<br />
certaines distances par rapport à ces auteurs, dont il juge les<br />
enseignements fragmentaires. La controverse autour <strong>de</strong>s Fragments<br />
d’un enseignement inconnu 5 , ouvrage dans lequel Uspenskij présentait<br />
le « système » <strong>de</strong> Gjurdžiev, est révélatrice d’une tension qui existait<br />
<strong>de</strong>puis le début entre les trois hommes 6 .<br />
Arrivé en France en 1924, Mouravieff s’installe à Bor<strong>de</strong>aux et y<br />
rencontre une Russe, Larisa Basov. Elle <strong>de</strong>viendra sa femme en 1936,<br />
année où ils s’installent à Paris. Jusqu’en 1941, il travaille comme<br />
ingénieur consultant dans diverses compagnies pétrolières, tout en se<br />
consacrant à l’étu<strong>de</strong> et à ses écrits. Il rencontre aussi fréquemment<br />
3 - Saint-Pétersbourg,<br />
1838. Le livre a été traduit<br />
en anglais par le Révérend<br />
R. W. Blackmore, Londres,<br />
éd. John Henry Parker,<br />
1842 (rééd. Montana,<br />
Éd. Kessinger<br />
Publishing Co, 2004).<br />
4 - Les quelques éléments<br />
biographiques sont tirés <strong>de</strong><br />
la préface à Mouravieff B.,<br />
Écrits sur Ouspensky,<br />
Gurdjieff, et sur la Tradition<br />
ésotérique chrétienne,<br />
Dervy, Paris, 2008, pp. 7-<br />
28, et du site <strong>de</strong><br />
l’Association Boris<br />
Mouravieff, « Éléments<br />
bibliographiques »,<br />
http://www.associationborismouravieff.com/in<strong>de</strong>x.html<br />
5 - Paris, Stock, 1950<br />
[1961].<br />
6 - Dans son article<br />
« Ouspensky, Gurdjieff et<br />
les Fragments d’un<br />
enseignement inconnu »<br />
(1957), in : Écrits…Op. cit.,<br />
pp. 95-138, Mouravieff<br />
explique les points qu’il<br />
juge problématiques dans<br />
la métho<strong>de</strong> d’enseignement<br />
<strong>de</strong> Gjurdžiev et dans le<br />
« système » d’Uspenskij.
[51]<br />
Oliv ier San tamaria<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
Gjurdžiev et quelques-uns <strong>de</strong> ses disciples au Café <strong>de</strong> la Paix sur les Grands<br />
Boulevards <strong>de</strong> Paris. Les débats et controverses qui y prennent place sont pour lui<br />
l’occasion d’affiner son propre point <strong>de</strong> vue. Pendant la Deuxième Guerre mondiale,<br />
en 1944, refusant <strong>de</strong> collaborer avec les Allemands, il est arrêté par la Gestapo,<br />
mais parvient à s’échapper en Suisse avec sa famille. Alors âgé <strong>de</strong> 55 ans, il<br />
entreprend un cursus universitaire à l’Institut <strong>de</strong>s Hautes Étu<strong>de</strong>s Internationales à<br />
Genève, où il défend en 1951 une thèse sur l’Alliance Russo-turque pendant la<br />
pério<strong>de</strong> napoléonienne. Quatre années plus tard, il <strong>de</strong>vient privatdozent (enseignant<br />
en attente d’une chaire universitaire) à l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Genève après avoir présenté<br />
une leçon sur « La politique <strong>de</strong> Pierre le Grand dans la question d’Orient ». Cette<br />
fonction universitaire couronne ses recherches d’historien qui s’étaient déjà vues<br />
concrétisées par la publication <strong>de</strong> plusieurs ouvrages, notamment Le Testament <strong>de</strong><br />
Pierre le Grand, légen<strong>de</strong> et réalité 7 et La Monarchie Russe 8 , ainsi que plusieurs<br />
articles 9 .<br />
L’ésotérisme, une philosophie <strong>de</strong> l’histoire<br />
Outre son intérêt pour l’histoire, Mouravieff s’intéresse à la spiritualité<br />
orthodoxe, ce qui lui vaut <strong>de</strong> donner un cours à l’université <strong>de</strong> Genève qu’il<br />
intitule « Introduction à la philosophie ésotérique d'après la tradition ésotérique <strong>de</strong><br />
l'Orthodoxie orientale ». Ce cours, qui réunit régulièrement une vingtaine d’élèves,<br />
sert <strong>de</strong> base à la publication en 1961 d’un premier volume <strong>de</strong> son œuvre principale,<br />
Gnôsis. Étu<strong>de</strong>s et commentaires sur la tradition ésotérique <strong>de</strong> l’orthodoxie orientale,<br />
volume auquel seront adjoints en 1962 et 1965 un <strong>de</strong>uxième puis un troisième<br />
tome. Respectivement sous-titrés « cycle exotérique », « cycle mésotérique » et<br />
« cycle ésotérique », Mouravieff y défend l’idée qu’une progression par <strong>de</strong>grés dans<br />
l’enseignement <strong>de</strong> la doctrine est indispensable pour accé<strong>de</strong>r au niveau ésotérique.<br />
Il s’agit selon lui <strong>de</strong> passer <strong>de</strong>s aspects externes (la profession <strong>de</strong> foi, les dogmes,<br />
qui sont vrais mais d’une façon relative car ils ne sont que l’expression formalisée<br />
d’un mystère) aux aspects internes <strong>de</strong> la doctrine, cachés au regard du profane, et<br />
qui constituent la véritable connaissance (gnôsis, en grec).<br />
Parallèlement à ses écrits, Mouravieff anime entre 1961 et 1967 un séminaire<br />
<strong>de</strong> recherches ésotériques <strong>de</strong>stiné à approfondir l’enseignement compilé dans<br />
Gnôsis. Le Centre d’Étu<strong>de</strong>s Chrétiennes Ésotériques (C.E.C.E.) se proposait en effet<br />
<strong>de</strong> développer et <strong>de</strong> mettre en pratique la doctrine ésotérique, et plus largement <strong>de</strong><br />
contribuer à l’émergence <strong>de</strong> « l’Homme Nouveau », expression qui fait référence au<br />
mot <strong>de</strong> l’Apôtre Paul :<br />
Il vous faut abandonner votre premier genre <strong>de</strong> vie et dépouiller le vieil homme,<br />
qui va se corrompant au fil <strong>de</strong>s convoitises décevantes, pour vous renouveler par<br />
7 - Neuchâtel (Suisse),<br />
Éd. <strong>de</strong> La Baconnière,<br />
1949.<br />
8 - Paris, Payot, 1962.<br />
9 - Pour une bibliographie<br />
complète, voir<br />
Mouravieff B., Écrits…,<br />
Op. cit., pp. 341-342.
[52]<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
Oliv ier San tamaria<br />
une transformation spirituelle <strong>de</strong> votre jugement et revêtir l'Homme Nouveau, qui<br />
a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté <strong>de</strong> la vérité. 10<br />
Pour faire émerger cet Homme Nouveau, celui dont l’intelligence est<br />
renouvelée par le don <strong>de</strong> l’Esprit, Mouravieff pense qu’il est nécessaire <strong>de</strong> rendre<br />
publique la doctrine ésotérique. Une nouvelle élite <strong>de</strong>vrait alors se mettre en place,<br />
consciente <strong>de</strong> la marche du mon<strong>de</strong> et du rôle qu’elle doit y jouer, c’est-à-dire<br />
œuvrer à faire progresser l’humanité dans une nouvelle phase, à tous<br />
égards décisive, <strong>de</strong> son évolution.<br />
Mouravieff combine en quelque sorte ses <strong>de</strong>ux domaines <strong>de</strong><br />
prédilection (l’histoire et la spiritualité) dans une conception théologique<br />
<strong>de</strong> l’histoire, à mi-chemin entre une conception cyclique et une<br />
conception strictement linéaire <strong>de</strong> l’évolution humaine. Pour lui, le temps<br />
peut être divisé en trois 11 phases qualitativement distinctes :<br />
Selon la Tradition, l’évolution humaine, après une longue pério<strong>de</strong><br />
préhistorique, se poursuit dans une succession <strong>de</strong> trois cycles : Cycle du<br />
Père, que l’histoire ne connaît qu’incomplètement ; Cycle du Fils, qui tend<br />
à sa fin ; enfin, Cycle du Saint-Esprit, auquel nous parvenons<br />
actuellement. 12<br />
Cette idée n’est pas neuve dans la pensée chrétienne. Le moine<br />
calabrais Joachim <strong>de</strong> Flore (1130 – 1202) avait, en effet, déjà exprimé<br />
une conception <strong>de</strong> l’histoire expliquant l’avancement <strong>de</strong> l’humanité<br />
comme un dévoilement progressif <strong>de</strong>s trois personnes <strong>de</strong> la sainte<br />
Trinité : l’âge du Père, associé à la Loi, l’âge du Fils, associé à la Grâce,<br />
à la Foi et à l’enseignement dogmatique <strong>de</strong> l’Église charnelle, l’âge <strong>de</strong><br />
l’Esprit saint, associé à la surabondance <strong>de</strong> la Grâce, à la plénitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
Connaissance et <strong>de</strong> l’Amour d’une Église purement spirituelle. La<br />
postérité spirituelle <strong>de</strong> cette doctrine, qui tend à affaiblir la confiance<br />
dans l’institution ecclésiastique et à favoriser les mouvements spirituels<br />
indépendants, fut particulièrement importante notamment dans<br />
l’émergence <strong>de</strong> l’idéalisme allemand. Jusqu’à aujourd’hui, elle <strong>de</strong>meure<br />
une référence incontournable — bien que le plus souvent inconsciente —<br />
pour nombre d’associations et <strong>de</strong> discours ésotériques 13 .<br />
Par ailleurs, dans la première moitié du XX e siècle et en particulier<br />
sous l’influence <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong> la « pensée Traditionnelle » 14 , la<br />
conception <strong>de</strong> l’histoire vue comme une succession <strong>de</strong> cycles fut ravivée<br />
par l’apport <strong>de</strong> la pensée hindoue et connut sous cette forme une<br />
certaine fortune en Occi<strong>de</strong>nt. Dans la bibliographie <strong>de</strong> Gnôsis, pourtant<br />
assez laconique, Mouravieff 15 cite notamment les œuvres <strong>de</strong> René<br />
Guénon, <strong>de</strong> Léo Schaya, <strong>de</strong> Titus Burckhardt et <strong>de</strong> Frithjof Schuon, ce<br />
qui atteste sans doute d’une bonne connaissance <strong>de</strong> ce courant <strong>de</strong><br />
pensée et, partant, <strong>de</strong> la doctrine <strong>de</strong>s « cycles cosmiques » qui y est un<br />
10 - Eph. 4, 22-24.<br />
11 - En réalité Mouravieff<br />
dénombre tantôt trois,<br />
tantôt cinq phases, selon le<br />
point <strong>de</strong> vue qu’il choisit.<br />
Les cinq phases sont (avec<br />
leur élément déclencheur) :<br />
1. Cycle préhistorique<br />
(chute d’Adam), 2. Cycle<br />
du Père (Déluge <strong>de</strong>s Eaux),<br />
3. Cycle du Fils<br />
(Destruction du Temple),<br />
4. Cycle du Saint-Esprit<br />
(Hiroshima), 5. Mille ans<br />
sans guerre = Millénium<br />
(l’Accomplissement : soit le<br />
Déluge du Feu, soit <strong>de</strong><br />
Nouveaux Cieux et une<br />
Nouvelle Terre). Voir<br />
Mouravieff B., Gnôsis,<br />
Op. cit., t. 2, p. 74.<br />
12 - Ibid, t. 1, p. 19.<br />
13 - Sur ce point on<br />
consultera <strong>de</strong> Lubac H., La<br />
Postérité spirituelle <strong>de</strong><br />
Joachim <strong>de</strong> Flore. 2 vol,<br />
Lethielleux, Paris, 1981.<br />
14 - Par cette expression<br />
nous désignons l’école <strong>de</strong><br />
pensée qui s’est formée<br />
dans le sillage et la<br />
continuation <strong>de</strong> l’œuvre du<br />
philosophe français René<br />
Guénon. Appelée « École<br />
Traditionnelle » par ses<br />
représentants, elle prend le<br />
nom <strong>de</strong> « Perennialism »<br />
dans le mon<strong>de</strong> anglo-saxon<br />
en référence à la<br />
Philosophia Perennis dont<br />
ils se veulent les héritiers<br />
et continuateurs. Pour<br />
l’histoire <strong>de</strong> ce mouvement<br />
on lira, récemment traduit<br />
en français :<br />
Sedgwick M. J., Contre le<br />
mon<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne. Le<br />
traditionalisme et l’histoire<br />
intellectuelle secrète du<br />
XX e siècle, Dervy, Paris,<br />
2008 [1 e éd. : 2004].<br />
15 - Il s’agit là d’une<br />
hypothèse. En effet, la<br />
bibliographie a été<br />
« préparée avec la<br />
collaboration du Docteur<br />
Albert-Jean Lucas », et il<br />
est difficile <strong>de</strong> connaître<br />
l’exacte mesure dans<br />
laquelle celle-ci reflète les<br />
sources authentiques <strong>de</strong><br />
Mouravieff.
[53]<br />
Oliv ier San tamaria<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
thème récurrent. Bien que témoignant <strong>de</strong> conceptions du temps et <strong>de</strong> l’histoire<br />
sensiblement différentes, tous s’accor<strong>de</strong>nt sur l’idée que le vingtième siècle<br />
constitue la fin d’un cycle décisif dans l’histoire <strong>de</strong> l’humanité. Comme les penseurs<br />
<strong>de</strong> l’École Traditionnelle, Mouravieff pense que le travail <strong>de</strong> renouvellement spirituel<br />
<strong>de</strong> l’homme est particulièrement important dans ce moment critique qu’il appelle<br />
« Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> transition », où les dangers qui menacent l’homme, le mon<strong>de</strong> et leur<br />
avenir sont très grands. Citant la secon<strong>de</strong> épître <strong>de</strong> Pierre, Mouravieff annonce que<br />
ce temps pourrait être celui d’une « catastrophe générale » 16 :<br />
En ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront,<br />
et la terre, avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée. 17<br />
Mais cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> crise, qui est en fait la Mo<strong>de</strong>rnité, est en même temps<br />
porteuse <strong>de</strong> grands espoirs puisqu’elle pourrait conduire l’homme à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés <strong>de</strong><br />
conscience jamais atteints auparavant : « l’ère du Saint-Esprit » pourrait ainsi<br />
également faire place, toujours selon la prophétie <strong>de</strong> Pierre, à « <strong>de</strong> nouveaux cieux<br />
et une nouvelle terre où la vérité habitera » 18 . Cela signifie premièrement, pour<br />
Mouravieff, que l’homme sera affranchi du travail et <strong>de</strong> la lutte pour l’existence :<br />
« Du simple fait <strong>de</strong> sa naissance, assure-t-il, l’homme sera doté <strong>de</strong> tout ce dont il<br />
aura besoin pour vivre. Le luxe sera gratuit » 19 . En plus <strong>de</strong> nouvelles conditions<br />
matérielles, l’homme, du moins l’homme d’élite, sera porteur <strong>de</strong> dons spirituels, et<br />
en particulier celui <strong>de</strong> discerner naturellement le vrai du faux, la vérité du<br />
mensonge 20 , ce qui signifie qu’il sera porteur <strong>de</strong> la vraie Connaissance.<br />
L’ésotérisme, une connaissance cachée<br />
En effet, pour Mouravieff, « la logique <strong>de</strong> l’Histoire réclame un<br />
esprit nouveau » 21 et cet esprit nouveau, il l’assimile à la « Gnose », la<br />
vraie Connaissance qui doit succé<strong>de</strong>r à la Foi, selon le mot <strong>de</strong> saint Paul.<br />
L’idée qu’il existe, à l’intérieur <strong>de</strong> la tradition chrétienne<br />
exotérique, une tradition gnostique, ésotérique, révélée par Jésus<br />
directement à ses Apôtres, puis transmise par l’intermédiaire <strong>de</strong> certains<br />
pères <strong>de</strong> l’Église à leurs successeurs, est un lieu commun <strong>de</strong> la<br />
littérature gnostique que notre auteur fait pleinement sien. Ainsi nous<br />
retrouvons cette idée déjà répandue à l’époque patristique, notamment<br />
chez Clément d’Alexandrie (c.150 – c.220). Auteur <strong>de</strong>s Stromates,<br />
maître <strong>de</strong> la Didascalée d’Alexandrie 22 , célèbre pour son exégèse<br />
allégorique <strong>de</strong>s Écritures, penseur à la charnière <strong>de</strong> nombreuses cultures<br />
(notamment <strong>de</strong>s cultures judéo-chrétienne et grecque, bien entendu),<br />
grand mystique, Clément est avec Irénée <strong>de</strong> Lyon le père du gnosticisme<br />
« orthodoxe » au sein <strong>de</strong> l’Église. Défenseur d’une vision résolument<br />
ésotérique <strong>de</strong> la doctrine chrétienne, son œuvre inspira beaucoup<br />
Mouravieff qui le cite à plusieurs reprises. C’est d’ailleurs en suivant son<br />
16 - On lira quelques-unes<br />
<strong>de</strong>s considérations sur ce<br />
point dans son article « Le<br />
problème <strong>de</strong> l’Homme<br />
nouveau », in : Écrits…,<br />
Op. cit., pp. 29-43.<br />
17 – 2 P., 3, 10-11<br />
18 – 2 P., 3, 13. Nous<br />
citons d’après la traduction<br />
<strong>de</strong> l’article cité en note 5.<br />
19 – Mouravieff B., « Le<br />
problème <strong>de</strong> l’Homme<br />
nouveau », Art. cit., p. 29.<br />
20 - Ibid., p. 39.<br />
21 - Voir Mouravieff B.,<br />
Gnôsis, Op. cit., t. 1.,<br />
p. 18.<br />
22 - La « Didascalée » (du<br />
grec διδασκαλει̃ον,<br />
« école ») était une célèbre<br />
école catéchétique et<br />
théologique où furent<br />
formés quelques-uns <strong>de</strong>s<br />
plus grands théologiens et<br />
Pères <strong>de</strong><br />
l’Église (notamment<br />
Origène, Basile le Grand,<br />
Grégoire le Thaumaturge,<br />
Grégoire <strong>de</strong> Naziance).<br />
Selon la Tradition, elle fut<br />
fondée, par saint Marc,<br />
mais plus<br />
vraisemblablement par<br />
Pantène au II e siècle,<br />
didascale (« maître »)<br />
auquel succédèrent<br />
Clément et Origène.
[54]<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
Oliv ier San tamaria<br />
exemple qu’il rédige lui aussi <strong>de</strong>s Stromates, sous titrées Recueil <strong>de</strong> notes sur<br />
l’enseignement chrétien ésotérique.<br />
Selon Clément, les « traditions secrètes » ou « mystères » compilés dans ses<br />
propres Stromates furent transmis jusqu’à lui par une lignée <strong>de</strong> maîtres spirituels,<br />
comme il l’explique :<br />
Ces maîtres, qui conservent la vraie tradition du bienheureux enseignement, issu<br />
tout droit <strong>de</strong>s saints Apôtres Pierre, Jacques, Jean et Paul, transmis <strong>de</strong> père en fils<br />
— mais peu <strong>de</strong> fils sont à l’image du père — sont arrivés jusqu’à nous, grâce à<br />
Dieu, pour déposer en nous ces belles semences <strong>de</strong> leurs ancêtres et <strong>de</strong>s<br />
Apôtres (…). Le Seigneur a consenti à faire part <strong>de</strong>s divins mystères <strong>de</strong> cette<br />
sainte lumière à “ceux qui pouvaient comprendre” [Mt., 19, 11]. Ainsi donc, ce<br />
n’est pas au grand nombre que le Christ a révélé ce qui n’était pas à la portée du<br />
grand nombre, mais simplement à une minorité qu’il savait adaptée, capable <strong>de</strong><br />
recevoir la parole et d’être façonnée selon elle. 23<br />
Sans aucun doute, cet enseignement ésotérique était à l’origine<br />
exclusivement oral, et c’est par la tradition orale qu’il s’est transmis jusqu’à<br />
Clément. Ce fait n’empêche pas le didascale alexandrin <strong>de</strong> coucher sur papier les<br />
« notes gnostiques » 24 que sont les Stromates, permettant ainsi au lecteur <strong>de</strong><br />
progresser par lui-même dans la connaissance du mystère <strong>de</strong> la foi et <strong>de</strong>s Écritures,<br />
et donnant par là même à la tradition écrite le statut particulier <strong>de</strong> transmetteur —<br />
aussi partiel et imparfait soit-il — <strong>de</strong> la tradition orale. De ce fait, tout en veillant à<br />
conserver son statut supérieur à l’enseignement oral (qu’il dispensait lui-<br />
même à ses catéchumènes), Clément n’exclut pas la possibilité pour la<br />
doctrine ésotérique d’être transmise — partiellement — par <strong>de</strong>s écrits.<br />
Boris Mouravieff explique ce principe <strong>de</strong> la façon suivante :<br />
L’hermétisation <strong>de</strong> la science ésotérique a été pratiquée <strong>de</strong> tout temps.<br />
Le Pentateuque et l’Évangile en sont un témoignage. Mais, tout en<br />
cachant le sens exact <strong>de</strong> la Doctrine, les Anciens prenaient soin <strong>de</strong> livrer<br />
aux profanes — sous une forme ou sous une autre — une part du vrai qui<br />
pouvait apparaître comme un schéma complet. C’est ainsi qu’à travers les<br />
siècles, ou même les millénaires, à travers les civilisations éteintes, ils<br />
donnaient aux chercheurs <strong>de</strong> l’avenir les indications suffisantes pour les<br />
inciter à <strong>de</strong>s investigations plus approfondies. 25<br />
Quelque dix sept siècles après Clément, notre auteur entend donc<br />
s’inscrire dans la même démarche, révélant par ses écrits et par son<br />
enseignement la « tradition secrète » <strong>de</strong>s Anciens : non pas une simple<br />
connaissance livresque, un savoir profane, mais la Connaissance<br />
vivifiante, « supérieure à la Raison et à la Foi » 26 . Mais contrairement à<br />
ce qu’affirmait son précurseur alexandrin, pour Mouravieff la Gnose<br />
divine n’est pas advenue avec le Christ. En effet, la Gnose avait déjà été<br />
précé<strong>de</strong>mment transmise à l’humanité au cours du Cycle du Père<br />
23 – Mouravieff B.,<br />
Stromates I, Éd. du Cerf,<br />
coll. « Sources<br />
Chrétiennes », Paris, 1951,<br />
p. 52.<br />
24 - Le titre complet <strong>de</strong><br />
son grand ouvrage est<br />
Stromates <strong>de</strong> notes<br />
gnostiques selon la vraie<br />
philosophie.<br />
25 - Mouravieff B., Gnôsis,<br />
t. 1, Op. cit., pp. 129-130.<br />
Il faut noter à cet endroit<br />
que ce principe tel<br />
qu’expliqué par Mouravieff<br />
ressemble <strong>de</strong> très près à ce<br />
que les penseurs <strong>de</strong> l’École<br />
Traditionnelle nomment<br />
« Tradition primordiale ».<br />
Sur ce point précis, on lira<br />
avec intérêt l’article<br />
d’Antoine Faivre : « Histoire<br />
<strong>de</strong> la notion mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong><br />
Tradition dans ses rapports<br />
avec les courants<br />
ésotériques (XV e -XX e<br />
siècles) », in : Symboles et<br />
Mythes dans les<br />
mouvements initiatiques et<br />
ésotériques (XVII e -XX e<br />
siècles) : Filiations et<br />
emprunts, Archè – La Table<br />
d’Émerau<strong>de</strong> (revue<br />
« ARIES », hors série),<br />
Milan-Paris, 1998,<br />
pp. 7-48.<br />
26 - Mouravieff B., Gnôsis,<br />
Op. cit., t. 1, p. 287.
[55]<br />
Oliv ier San tamaria<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
(l’humanité adamique), mais sous forme <strong>de</strong> mystères : Mystères <strong>de</strong> Promesse.<br />
Ceux-ci ne trouvèrent toutefois leur entière justification qu’avec l’Avènement <strong>de</strong><br />
Jésus-Christ, manifestation vivante et réalisation <strong>de</strong> la promesse : Mystère <strong>de</strong><br />
Réalisation. La Gnose et les initiés qui en étaient dépositaires furent, par cet<br />
événement capital, libérés <strong>de</strong> la consigne <strong>de</strong> silence qui pesait sur eux : un<br />
foisonnement <strong>de</strong> théories, d’enseignements et <strong>de</strong> systèmes put voir le jour, fondés<br />
à la fois sur les Mystères <strong>de</strong> la Promesse et sur le Mystère <strong>de</strong> Réalisation en Jésus,<br />
et qui tentaient principalement d’expliquer la raison <strong>de</strong> l’imperfection du Mon<strong>de</strong> et<br />
<strong>de</strong> la présence du Mal. Il résulta <strong>de</strong> ces multiples spéculations <strong>de</strong>ux courants<br />
majoritaires, que Mouravieff oppose <strong>de</strong> la façon suivante : une gnose hétérodoxe,<br />
qui attribuait cette imperfection à une catastrophe cosmique ou à la malveillance du<br />
Créateur, et une gnose orthodoxe, qui axait son enseignement sur la perfectibilité<br />
<strong>de</strong> l’homme qui marche à la suite <strong>de</strong> Jésus et sur la possible divinisation <strong>de</strong> son<br />
humanité par le moyen <strong>de</strong> la « <strong>de</strong>uxième naissance ». C’est, selon notre auteur,<br />
cette secon<strong>de</strong> — et seule légitime —Gnose qui survécut, grâce à l’œuvre <strong>de</strong>s<br />
Apôtres et <strong>de</strong>s grands docteurs œcuméniques <strong>de</strong> l’Église et en particulier <strong>de</strong><br />
l’orthodoxie orientale. Mouravieff pense que par ce fait, la tradition ésotérique elle<br />
aussi put être préservée dans sa pureté originelle, soit dans les temps anciens à<br />
l’abri <strong>de</strong> l’hermétisme, dans les monastères grecs et russes notamment, ainsi que<br />
dans les écrits philocaliques 27 ; soit dans le temps présent <strong>de</strong> façon dévoilée, dans<br />
sa propre œuvre littéraire (en particulier dans Gnôsis qui en est l’exposé complet)<br />
et spirituelle (les Stromates et la pratique enseignée dans le C.E.C.E.). Pour notre<br />
auteur, en effet,<br />
GNÔSIS est la première divulgation <strong>de</strong> l’ensemble, en abrégé, mais laissant au<br />
chercheur persévérant la possibilité d’aller en profon<strong>de</strong>ur, <strong>de</strong> la Gnôse<br />
communiquée par Jésus, après Sa Résurrection, à Pierre, Jean et Jacques, et qui<br />
constitue le contenu <strong>de</strong> la Tradition Chrétienne ésotérique. 28<br />
C’est donc aux « racines », à la « source » 29 <strong>de</strong> la Tradition<br />
ésotérique chrétienne que Mouravieff entend puiser afin <strong>de</strong> présenter la<br />
doctrine dans son intégralité : les textes sacrés <strong>de</strong> l’Ancien et du<br />
Nouveau Testament, les commentaires dont ils font l’objet<br />
(commentaires patristiques et en particulier ceux réunis dans la<br />
Philocalie), ainsi que l’enseignement et la discipline reçue par les<br />
personnes régulièrement investies dans leur fonction <strong>de</strong> maîtres<br />
spirituels (la « Gran<strong>de</strong> Confrérie Ésotérique ») 30 .<br />
À côté <strong>de</strong> ces enseignements écrits, il est nécessaire qu’il y ait<br />
également un enseignement oral afin <strong>de</strong> vivifier la lettre, <strong>de</strong> passer <strong>de</strong>s<br />
simples croyances, articles <strong>de</strong> foi, dogmes et credo (sans nier leur valeur<br />
pédagogique et relative), à une connaissance plus parfaite, une véritable<br />
secon<strong>de</strong> naissance, qui ouvre les yeux <strong>de</strong> l’intelligence « au vrai sens <strong>de</strong><br />
la vie, […à] la signification <strong>de</strong> la mission du chrétien dans l’Ère Nouvelle,<br />
[à] la possibilité [qui] est offerte <strong>de</strong> s’initier à cette Sagesse divine,<br />
27 - La tradition orthodoxe<br />
appelle « philocalique »<br />
(qui signifie littéralement<br />
« amour <strong>de</strong> la beauté »)<br />
tout texte spirituel, mais ce<br />
vocable s’applique avant<br />
tout à l’anthologie réalisée<br />
par Nicodème l'Hagiorite et<br />
Macaire <strong>de</strong> Corinthe<br />
en 1782, aujourd’hui<br />
appelée Philocalie <strong>de</strong>s Pères<br />
Neptiques ou, plus<br />
simplement, la Philocalie.<br />
Mouravieff y renvoie en <strong>de</strong><br />
nombreux endroits <strong>de</strong> son<br />
œuvre. En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s<br />
éditions complètes, il en<br />
existe en français une<br />
version abrégée et<br />
facilement accessible :<br />
Grouillard J., Petite<br />
Philocalie <strong>de</strong> la prière du<br />
cœur, Seuil, coll.<br />
« Points/Sagesse », Paris,<br />
1979.<br />
28 - Cité in : Mouravieff B.,<br />
Écrits… Op. cit., p. 8.<br />
29 - Mouravieff B., Gnôsis,<br />
Op. cit., t. 1, p. 10.<br />
30 – Voir I<strong>de</strong>m.
[56]<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
Oliv ier San tamaria<br />
mystérieuse et cachée » 31 . Mais, il faut le souligner, dans l’esprit <strong>de</strong> Mouravieff, il ne<br />
suffit pas <strong>de</strong> saisir en quelque sorte mentalement la doctrine exposée dans Gnôsis<br />
pour parvenir à cet état <strong>de</strong> plénitu<strong>de</strong> spirituelle. Gnôsis n’est que l’exposé <strong>de</strong> la<br />
doctrine : elle n’est ni son application, ni son interprétation, ni sa compréhension<br />
plénière. Aux élèves expérimentés du Centre d’Étu<strong>de</strong>s Chrétiennes Ésotériques, qui<br />
sont par le fait même <strong>de</strong>s lecteurs attentifs <strong>de</strong> Gnôsis, Mouravieff adresse <strong>de</strong>s<br />
Stromates, aussi appelées L’Art <strong>de</strong> Vaincre, dans l’introduction <strong>de</strong>squelles il rappelle<br />
que :<br />
La lecture spontanée <strong>de</strong> “Gnôsis”, même si elle est attentive, répétée, faite avec<br />
l’assiduité voulue, ne peut conduire qu’au Savoir <strong>de</strong> la Doctrine. Le lecteur sait<br />
que pour parvenir au niveau du Comprendre, il faut ajouter au Savoir quelque<br />
chose d’impondérable, un epsilon. Les préceptes et les exercices recommandés<br />
dans les Stromates ont pour but d’ai<strong>de</strong>r les étudiants à gagner cet epsilon. Il leur<br />
ouvrira les chemins du Comprendre qui, à son tour, les conduira vers le Savoir-<br />
faire. 32<br />
La voie est donc difficile, faite <strong>de</strong> travail personnel et <strong>de</strong> dispositions<br />
intérieures favorables. C’est la raison pour laquelle en <strong>de</strong> nombreux endroits<br />
Mouravieff indique que l’ésotérisme n’est pas une voie qui convient à tout le mon<strong>de</strong>,<br />
mais qu’elle est au contraire réservée à une élite : car si l’enseignement est<br />
transmissible dans ses formes, donc du point <strong>de</strong> vue extérieur, en réalité<br />
l’acquisition <strong>de</strong> la connaissance initiatique ne peut être le fait que du travail<br />
personnel <strong>de</strong> chaque étudiant. Ce travail comprend notamment un aspect <strong>de</strong> prière,<br />
dont il n’est pas inutile <strong>de</strong> dire ici quelques mots.<br />
La tradition hésychaste<br />
L’enseignement hésychaste est au centre <strong>de</strong> la pratique orthodoxe <strong>de</strong> la<br />
prière, et ce <strong>de</strong>puis les origines chrétiennes. Le terme « hésychasme » (du grec<br />
hésychia, la « quiétu<strong>de</strong> » au sens <strong>de</strong> « calme intérieur », <strong>de</strong> « paix <strong>de</strong> l’âme »)<br />
désigne une métho<strong>de</strong> spirituelle connue dans tout l’orient chrétien et en particulier<br />
dans les monastères d’Egypte ainsi que, plus tard, dans les monastères du mont<br />
Athos, mais aussi en occi<strong>de</strong>nt où, par l’intermédiaire <strong>de</strong> Jean Cassien, elle fut<br />
connue <strong>de</strong>s premiers moines bénédictins. Les Pères « neptiques » (du grec nepsis,<br />
« sobriété », « vigilance », « lucidité »), parmi lesquels figurent Évagre le Pontique,<br />
Maxime le Confesseur ou Jean Climaque, qui sont à l’origine <strong>de</strong> cette tradition,<br />
apprennent à rechercher et à maintenir un profond silence <strong>de</strong> l’âme et <strong>de</strong>s passions<br />
par la prière ininterrompue et le souvenir permanent <strong>de</strong> Dieu, et à gar<strong>de</strong>r le cœur<br />
en état <strong>de</strong> recevoir la présence <strong>de</strong> l’Esprit. Depuis le XIV e siècle, avec la victoire <strong>de</strong><br />
saint Grégoire Palamas (1296 – 1359) — qui pousse l’oraison hésychaste<br />
jusque dans ses conséquences ultimes avec la doctrine <strong>de</strong> la déification<br />
<strong>de</strong> la personne par sa participation aux énergies divines — contre les<br />
31 – I Co., 2, 6. Voir Ibid.,<br />
pp. 14-15.<br />
32 - Introduction à « L’Art<br />
<strong>de</strong> Vaincre. Les Stromates.<br />
Recueil <strong>de</strong> Notes sur<br />
l’enseignement chrétien<br />
ésotérique », in :<br />
Mouravieff B., Écrits…,<br />
Op. cit., p. 261.
[57]<br />
Oliv ier San tamaria<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
adversaires <strong>de</strong> cette pratique spirituelle et <strong>de</strong> la théologie qui l’accompagne,<br />
l’hésychasme <strong>de</strong>vient en quelque sorte la « doctrine officielle » <strong>de</strong> l’Église<br />
orthodoxe.<br />
La publication <strong>de</strong> la Philocalie <strong>de</strong>s pères neptiques viendra renforcer ce<br />
mouvement 33 . Ce livre, qui est une sorte d’anthologie <strong>de</strong> textes portant sur la prière<br />
hésychaste, verra le jour en grec à la fin du XVIII e siècle et sera, à travers sa<br />
traduction slavonne 34 , à l’origine du renouveau spirituel russe du XIX e siècle dont les<br />
Récits d’un pèlerin russe 35 sont l’exemple littéraire le plus célèbre. Comme l’écrit<br />
Elisabeth Behr-Siegel, la Philocalie « fut, pendant la première moitié du XIX e siècle<br />
[…] la nourriture spirituelle préférée <strong>de</strong>s moines russes » 36 . Il n’y a donc rien<br />
d’étonnant à ce que Boris Mouravieff le considère comme une source spirituelle <strong>de</strong><br />
premier ordre.<br />
Conformément à la tradition hésychaste, Mouravieff enseigne une technique<br />
<strong>de</strong> prière, en apparence simple, qui consiste à répéter inlassablement, jusqu’à dix<br />
ou vingt mille fois par jour, l’invocation suivante : « Seigneur Jésus-Christ, Fils <strong>de</strong><br />
Dieu, aie pitié <strong>de</strong> moi, pécheur ». Cette prière porte le nom <strong>de</strong> « prière <strong>de</strong> Jésus »,<br />
car sa puissance provient <strong>de</strong> l’invocation du nom divin, ou <strong>de</strong> « prière du cœur »,<br />
car elle se fait <strong>de</strong>puis la tête en direction du cœur considéré comme le<br />
centre <strong>de</strong> la personne et le réceptacle privilégié <strong>de</strong> la présence divine 37 .<br />
Les exercices spirituels, qui s’adressent nécessairement aux<br />
étudiants possédant un certain bagage théorique, ne s’arrêtent toutefois<br />
pas là. Sans entrer dans <strong>de</strong> nombreux détails qui risqueraient d’alourdir<br />
notre exposé, notons que Mouravieff leur assigne globalement trois<br />
objectifs, en conformité avec la structure tripartite <strong>de</strong> l’être humain :<br />
corps, âme, esprit. Ces objectifs sont la maîtrise du corps (le Moi<br />
corporel), la maîtrise <strong>de</strong> la Personnalité (le Moi personnel), et la prise <strong>de</strong><br />
contact avec les niveaux supérieurs <strong>de</strong> la conscience (le Moi réel) 38 . Il<br />
s’agit là d’une reprise <strong>de</strong> la classique tripartition établie par les stoïciens<br />
et reprise par les pères <strong>de</strong> l’Église : practikè, gnosis phusikè, theologikè.<br />
La fin <strong>de</strong> l’ésotérisme : l’Amour<br />
Si l’enseignement est intégré, vécu et réalisé jusqu’au bout, grâce<br />
à la pratique et à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la doctrine, alors selon Mouravieff l’étudiant<br />
est en mesure <strong>de</strong> passer <strong>de</strong> la Foi à l’Espérance puis, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> celle-ci,<br />
à la Connaissance ou Gnose :<br />
Ainsi, sans la Foi au cœur, il est impossible d’atteindre, au sens<br />
ésotérique, l’Espérance. Et sans l’une ni l’autre, on ne parvient jamais à<br />
Gnôsis, la connaissance vivante […]. Le langage imagé <strong>de</strong> la Tradition<br />
appelle la tria<strong>de</strong> : Foi, Espérance, Connaissance : l’Epée à triple<br />
tranchant, ou encore la Lame triangulaire. 39<br />
33 - Sur la réception <strong>de</strong> la<br />
Philocalie dans l’Église<br />
orientale, il est<br />
indispensable <strong>de</strong> lire<br />
Deseille P., La spiritualité<br />
orthodoxe et la philocalie,<br />
Albin Michel, coll.<br />
« Spiritualités vivantes »,<br />
Paris, 2003 [1997].<br />
34 - La Dobrotoljubie fut<br />
publiée à Saint-Pétersbourg<br />
en 1794 par les soins <strong>de</strong><br />
Paissij Veličkovskij.<br />
35 - Publiés anonymement<br />
et pour la première fois à<br />
Kazan en 1865. La<br />
traduction française <strong>de</strong>s<br />
quatre premiers récits fut<br />
éditée en 1943 aux Éd. <strong>de</strong><br />
la Baconnière. Sur le<br />
pèlerin russe et sur ce<br />
genre littéraire,<br />
voir Evdokimov M., Pèlerins<br />
russes et vagabonds<br />
mystiques, Éd. Du Cerf,<br />
coll. « Patrimoines », Paris,<br />
2004, pp. 145-192, passim.<br />
36 - Behr-Siegel E., « La<br />
prière à Jésus », in : Dieu<br />
vivant, n° 8, p. 71, cité<br />
in : Grouillard J., Op. cit.,<br />
p. 12.<br />
37 - Pour une clarification<br />
<strong>de</strong> ces notions, on lira avec<br />
profit Serr J & Clément O.,<br />
La prière du cœur,<br />
Éd. De l’Abbaye<br />
<strong>de</strong> Bellefontaine, Bégrolle<br />
(France), 1977.<br />
38 – Voir Mouravieff B,<br />
Gnôsis, Op. cit., t. 1,<br />
pp. 233 et sq.<br />
39 – Ibid., t. 2, p. 228.
[58]<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
Oliv ier San tamaria<br />
Mais cette tria<strong>de</strong> ne réalise pas encore à elle seule la secon<strong>de</strong> Naissance<br />
promise à l’homme d’élite. En effet, il ne s’agit là que d’étapes, certes nécessaires,<br />
mais non suffisantes, car le but ultime <strong>de</strong> toute réalisation spirituelle est l’Amour.<br />
Seul l’Amour, comme l’enseigne Mouravieff après saint Paul, est un état non plus<br />
partiel et transitoire, mais définitif. Pour lui, la Foi et la Connaissance seront<br />
amenées à disparaître lorsque sera accompli ce qui est parfait :<br />
Or le parfait, c’est l’Amour qui comprend en lui l’accomplissement <strong>de</strong><br />
toutes les vertus, <strong>de</strong> toutes les prophéties, <strong>de</strong> tous les mystères et <strong>de</strong> toute<br />
Connaissance [cf. I CO., 13] 40<br />
Il convient d’insister encore un instant sur ce point, car par celui-ci<br />
Mouravieff se distingue <strong>de</strong> la plupart <strong>de</strong>s auteurs « gnostiques » (qui s’arrêtent<br />
généralement à la question <strong>de</strong> la « connaissance »), tout en se rapprochant d’un<br />
discours qu’on dirait volontiers « mystique ». Il se conforme en cela à la Philocalie<br />
et, plus généralement, à toute pensée vraiment chrétienne, qui fait nécessairement<br />
<strong>de</strong> l’Amour le terme <strong>de</strong> l’économie du salut. Pour résumer ce qui a été dit sur ce<br />
sujet, et pour rappeler la vision cyclique <strong>de</strong> l’histoire précé<strong>de</strong>mment exposée, citons<br />
encore Mouravieff :<br />
La face du mon<strong>de</strong> change. Le Cycle du Fils, comme jadis celui du Père, arrive à<br />
son terme. Avec le Christ, la Loi reçue par Moïse prit fin (Rom. 10, 4) et fut<br />
remplacée par le régime <strong>de</strong> la Foi, <strong>de</strong> l’Espérance et <strong>de</strong> l’Amour (I Co. 13, 13). À<br />
présent, avec les guerres et les révolutions du siècle, avec les progrès<br />
extraordinaires <strong>de</strong> la science positive, nous sommes entrés dans la pério<strong>de</strong><br />
transitoire dont la signification est d’ouvrir l’accès au Cycle du Saint-Esprit. Au<br />
cours <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>, la Foi sera progressivement remplacée par la Connaissance<br />
et l’Espérance sera abolie dans l’Accomplissement. Ce sera le triomphe final <strong>de</strong><br />
l’Amour. 41<br />
Cette victoire <strong>de</strong> l’Amour, qui épargnera au genre humain la « catastrophe<br />
générale » prophétisée par saint Pierre, <strong>de</strong>vrait assurer la venue <strong>de</strong> l’Ère du Saint-<br />
Esprit et, par lui, apporter sur Terre la Lumière, la Vérité et la Vie 42 . C’est du moins<br />
l’espérance <strong>de</strong> Boris Mouravieff, et la phrase sur laquelle il conclut son cycle <strong>de</strong>s<br />
trois volumes <strong>de</strong> Gnôsis, soit l’exposé théorique <strong>de</strong> la « Tradition ésotérique ».<br />
L’enseignement pratique <strong>de</strong> la « gnose » : le C.E.C.E.<br />
L’aspect pratique, concret, <strong>de</strong> l’enseignement gnostique <strong>de</strong> Boris Mouravieff<br />
était assuré par le Centre d’Étu<strong>de</strong>s Chrétiennes Ésotériques ainsi que par les<br />
groupes <strong>de</strong> travail qu’il supervisait. Ces groupes <strong>de</strong>vaient être composés d’un<br />
maximum <strong>de</strong> douze membres — nombre dont la symbolique apostolique est<br />
certainement voulue — se réunissant une fois par semaine pour traiter d’un aspect<br />
particulier <strong>de</strong> la doctrine. Le principe <strong>de</strong> fonctionnement voulait que chaque membre<br />
40 – Ibid., t. 1, pp. 18 19.<br />
41 – Ibid., t. 1, p. 154.<br />
42 – Ibid., t. 3, p. 260.
[59]<br />
Oliv ier San tamaria<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
choisisse un passage <strong>de</strong> Gnôsis à propos duquel il méditait et préparait un exposé<br />
d’une trentaine <strong>de</strong> minutes. Il s’ensuivait une discussion à laquelle chacun <strong>de</strong>vait<br />
prendre part. Conformément à l’ordre que Mouravieff a voulu donner à son œuvre,<br />
les sujets <strong>de</strong>vaient être choisis d’abord dans Gnôsis I : cycle exotérique, en suivant<br />
l’ordre <strong>de</strong>s chapitres, puis dans Gnôsis II : cycle mésotérique, avant d’atteindre le<br />
volume <strong>de</strong> Gnôsis III : cycle ésotérique. Quelques réunions extraordinaires, au<br />
cours <strong>de</strong>squelles <strong>de</strong>s membres du Comité directeur du C.E.C.E. ou <strong>de</strong>s conférenciers<br />
extérieurs étaient reçus, <strong>de</strong>vaient également animer la vie <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong><br />
recherche 43 .<br />
Le fonctionnement interne du Centre et <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> travail, la fréquence<br />
et la procédure <strong>de</strong> leurs réunions, témoignent d’une certaine ambition <strong>de</strong> la part <strong>de</strong><br />
Mouravieff. Il s’y consacre d’ailleurs pleinement à partir <strong>de</strong> 1962, après avoir quitté<br />
l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Genève. Plusieurs branches secondaires du C.E.C.E. seront créées<br />
dans un certain nombre <strong>de</strong> villes, notamment à Paris, à Lille, à <strong>Bruxelles</strong>, et même<br />
au Caire et au Congo 44 . Le maître leur adresse régulièrement <strong>de</strong>s « Bulletins<br />
d’information » 45 , ainsi qu’occasionnellement <strong>de</strong>s conseils spirituels réunis sous le<br />
nom <strong>de</strong> Stromates. Hélas, quelques années plus tard, suite à <strong>de</strong> graves problèmes<br />
<strong>de</strong> santé, il meurt à Genève d'une crise cardiaque, le 28 septembre 1966. Le<br />
C.E.C.E., et a fortiori les groupes d’étu<strong>de</strong> constitués sous sa direction, cessent<br />
prématurément leurs activités. Sa veuve, Larisa Mouravieff se chargera <strong>de</strong> faire<br />
paraître plusieurs chapitres inédits <strong>de</strong>s Stromates et <strong>de</strong> veiller sur les archives du<br />
Centre, qu’elle dépose finalement à la Bibliothèque Publique et Universitaire <strong>de</strong><br />
Genève où un Fonds Boris Mouravieff est <strong>de</strong>stiné à l’usage <strong>de</strong>s chercheurs<br />
intéressés.<br />
Depuis le mois <strong>de</strong> mai 2000, l'Association Boris Mouravieff, créée à Paris, s'est<br />
fixée pour but principal <strong>de</strong> veiller à la continuité <strong>de</strong> la diffusion <strong>de</strong> l'œuvre<br />
ésotérique <strong>de</strong> Boris Mouravieff, notamment en rééditant les trois tomes <strong>de</strong> Gnôsis,<br />
ainsi qu’en réunissant en un volume divers articles qui étaient <strong>de</strong>venus<br />
introuvables 46 .<br />
Quelques conclusions<br />
Depuis sa jeunesse, mis sur la voie par son grand oncle ainsi que<br />
par diverses rencontres (notamment celles d’Uspenskij et <strong>de</strong> Gjurdjžiev),<br />
Boris Mouravieff s’est intéressé <strong>de</strong> près à l’ésotérisme et à la Tradition<br />
orthodoxe. À la fois dans ses cours à l’<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Genève, dans ses<br />
volumes <strong>de</strong> Gnôsis et au sein du C.E.C.E., il enseigne une doctrine qu’il<br />
estime être la « tradition ésotérique ». Cette Tradition, universelle dans<br />
son essence, aurait été révélée à l’humanité sous divers aspects, mais<br />
c’est sous sa formulation chrétienne qu’elle est véritablement parvenue<br />
à son niveau définitif, car le christianisme est lui-même universel. La<br />
doctrine aurait été enseignée par Jésus à ses Apôtres, puis par eux aux<br />
43 - Le règlement du<br />
C.E.C.E. et <strong>de</strong>s « groupes<br />
<strong>de</strong> travail » se trouve en<br />
annexe du troisième tome<br />
<strong>de</strong> Gnôsis, Op. cit.,<br />
pp. 261-264.<br />
44 - Association Boris<br />
Mouravieff, « Eléments<br />
bibliographiques »,<br />
http://www.associationborismouravieff.com/in<strong>de</strong>x.html<br />
45 - Plusieurs <strong>de</strong> ces<br />
bulletins sont édités dans<br />
Mouravieff B., Écrits…, Op.<br />
cit., pp. 313-340.<br />
46 - C’est ce volume qui<br />
constitue les Écrits sur<br />
Ouspensky…, Op. cit.
[60]<br />
Boris Mouravieff et l’ésotérisme chrétien<br />
Oliv ier San tamaria<br />
saints pères <strong>de</strong> l’Église : elle est donc, comme le dit Mouravieff,<br />
« fondamentalement chrétienne ». Il en expose les divers aspects en s’appuyant sur<br />
les textes bibliques vétéro- et néo-testamentaires, sur les commentaires<br />
patristiques compilés dans la Philocalie, ainsi que sur une série d’exercices spirituels<br />
conformes à la tradition hésychaste. L’enseignement <strong>de</strong> Boris Mouravieff,<br />
résolument initiatique, comprenait donc <strong>de</strong>s aspects théoriques (étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
doctrine) et pratiques (exercices spirituels et réalisation <strong>de</strong> l’enseignement). Le but<br />
<strong>de</strong> cet enseignement est <strong>de</strong> faire parvenir l’étudiant à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> conscience<br />
supérieurs et, finalement, à la réalisation plénière <strong>de</strong> sa Personnalité, par la<br />
Olivier SANTAMARIA<br />
est doctorant, aspirant<br />
FNRS, membre du<br />
Centre interdisciplinaire<br />
d'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s religions et<br />
<strong>de</strong> la laïcité (CIERL) <strong>de</strong><br />
l’ULB<br />
« secon<strong>de</strong> Naissance » qui assure l’entrée dans le Royaume <strong>de</strong> Dieu.<br />
L’étudiant, <strong>de</strong>venu homme d’élite, est alors chargé <strong>de</strong> préparer<br />
l’humanité à une phase cruciale <strong>de</strong> l’histoire : la « Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
transition » qui marque l’entrée dans le « Cycle du Saint-Esprit ».<br />
Retrouvez page 106 la recension d’Olivier Santamaria portant sur « Écrits sur<br />
Ouspensky, Gurdjieff et sur la Tradition ésotérique chrétienne » <strong>de</strong> Boris Mouravieff
Jeremy Lambert<br />
Le towianisme en France.<br />
La France dans le towianisme.<br />
a Révolution française et l’époque napoléonienne ont modifié durablement<br />
le visage <strong>de</strong> l’Europe, tant d’un point <strong>de</strong> vue politique que<br />
sociétal. « Tout le début du XIX e L<br />
siècle, qui est aussi celui d’une société<br />
nouvelle, (…) a été occupé par le souci <strong>de</strong> définir en doctrine les fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong><br />
cette société, la loi <strong>de</strong> son existence et <strong>de</strong> son avenir. Un mon<strong>de</strong> se trouvait ruiné,<br />
qu’avaient justifié d’antiques certitu<strong>de</strong>s. Le mon<strong>de</strong> nouveau aurait-il les siennes ? Le<br />
problème est le même pour toutes les familles spirituelles ; les réponses seules<br />
peuvent varier » 1 écrit Paul Bénichou. Pour les Polonais, la question générale <strong>de</strong><br />
l’héritage <strong>de</strong> l’épiso<strong>de</strong> révolutionnaire se posait en termes différents car leur nation,<br />
<strong>de</strong>puis la fin du XVIII e siècle, était privée d’État propre dans lequel ils auraient pu<br />
définir cette société. Andrzej Towiański (1799-1878) est l’une <strong>de</strong> ces voix qui<br />
s’élevèrent pour apporter une réponse originale au problème général <strong>de</strong> redéfinition<br />
<strong>de</strong> l’Europe <strong>de</strong>s hommes.<br />
L’action <strong>de</strong> Towiański se déroula sur trois temporalités successives, distinctes<br />
et corrélées. La première, qui s’étend du début du XIX e siècle à 1840, correspond à<br />
la cristallisation théorique <strong>de</strong> la doctrine. La <strong>de</strong>uxième est la plus courte (1841-<br />
1847) mais la plus fécon<strong>de</strong>, et partant la plus instructive. Elle est marquée par le<br />
rôle majeur joué par le poète Adam Mickiewicz (1798-1855) dans<br />
l’expression <strong>de</strong> la théorie et dans la publicité qui lui fut faite,<br />
principalement à Paris, surtout parmi les émigrés polonais qui avaient fui<br />
1 - Bénichou P., Le temps<br />
<strong>de</strong>s prophètes. Doctrines <strong>de</strong><br />
l'âge romantique,<br />
Gallimard, NRF,<br />
Bibliothèque <strong>de</strong>s Idées,<br />
Paris, 1977, pp. 8-9.
la répression tsariste consécutive à l’insurrection <strong>de</strong> novembre 1830 2 . La <strong>de</strong>rnière<br />
commence au moment où Mickiewicz se retire formellement du mouvement<br />
towianiste, en 1847, et s’étend jusqu’à la mort <strong>de</strong> Towiański.<br />
Nous nous focaliserons sur la <strong>de</strong>uxième pério<strong>de</strong>, celle durant laquelle le<br />
towianisme se développa surtout à Paris et <strong>de</strong>vint clairement une doctrine à vertu<br />
expansive propagée par <strong>de</strong>s a<strong>de</strong>ptes. Le développement du towianisme en France<br />
n’est pas un hasard. Nous envisagerons l’intérêt porté pour ce pays par Towiański,<br />
la place qu’il tient dans la doctrine <strong>de</strong> celui-ci et les liens qui unissent (et<br />
désunissent) le towianisme <strong>de</strong>s courants d’idées théosophiques français.<br />
La « pério<strong>de</strong> parisienne » peut être résumée comme suit : Towiański arriva<br />
dans la Ville-Lumière en mai 1841 après un voyage qui lui fit visiter l’Allemagne, la<br />
Belgique, l’Angleterre et l’Irlan<strong>de</strong>. En juillet, il rencontra Mickiewicz, qui le reconnut<br />
rapi<strong>de</strong>ment comme l’homme provi<strong>de</strong>ntiel qu’il avait « pressenti » 3 . Le 27 septembre<br />
1841, il s’adressa pour la première fois aux émigrés polonais <strong>de</strong> Paris en la<br />
cathédrale Notre-Dame. En juillet 1842, un an après son arrivée, et après avoir<br />
formé son groupe d’a<strong>de</strong>ptes appelé le « Cercle <strong>de</strong> l’Œuvre <strong>de</strong> Dieu » (Koło Sprawy<br />
Bożej), il fut expulsé <strong>de</strong> France, laissant seul Mickiewicz à la tête <strong>de</strong>s<br />
« towianistes ». Il continuera à surveiller les activités du groupe <strong>de</strong>puis la Belgique,<br />
où il habita un an, puis <strong>de</strong> la Suisse, où il s’installa définitivement en novembre<br />
1843. Mickiewicz se fera le relais entre le Maître et les disciples jusqu’à sa rupture<br />
avec son mentor en 1847.<br />
Introduction au towianisme<br />
Le discours à Notre-Dame constitue la première déclaration d’intentions<br />
towianiste dont <strong>de</strong>s témoignages nous sont parvenus. À cette occasion,<br />
Towiański expliqua aux émigrés polonais qu’il était chargé d’une mission<br />
divine qui consistait à rapporter les griefs faits par Dieu aux hommes<br />
parce qu’ils avaient « gaspillé » la parole du Christ. Il leur annonça<br />
également qu’ils étaient les premiers appelés à s’unir avec lui en esprit.<br />
La raison invoquée était leur qualité <strong>de</strong> fils d’une « partie particulière <strong>de</strong><br />
la race slave qui a conservé dans son âme, plus purement et plus<br />
chau<strong>de</strong>ment que les autres races, le feu du Christ, le trésor d’amour et<br />
<strong>de</strong> sentiment » 4 . La pensée towianiste est téléologique, elle tire <strong>de</strong>s<br />
conclusions concernant les causes à partir <strong>de</strong>s conséquences ; <strong>de</strong> plus,<br />
Towiański était persuadé que l’expiation était toujours proportionnelle à<br />
la gravité <strong>de</strong> la faute. Il considérait, comme les Émigrés, que l’exil était<br />
une peine très lour<strong>de</strong>, il en conclut donc que les Polonais avaient commis<br />
une faute très grave. Pour Towiański, les Polonais étaient issus d’une<br />
nation qui a conservé le christianisme en son âme plus purement que les<br />
autres ; donc Dieu <strong>de</strong>vait considérer qu’ils avaient quitté la voie indiquée<br />
par Lui, qu’ils avaient trahi la très haute confiance qu’Il avait mise en<br />
[62]<br />
2 - Insurrection <strong>de</strong>s<br />
Polonais contre le système<br />
tsariste dont ils relevaient<br />
politiquement. Elle<br />
commença en novembre<br />
1830 et se termina par la<br />
prise <strong>de</strong> Varsovie par les<br />
Russes en septembre 1831.<br />
Les Émigrés commencèrent<br />
à arriver en masse en<br />
France au début <strong>de</strong> l’année<br />
1832.<br />
3 - Voir Lettre <strong>de</strong> Adam<br />
Mickiewicz à Jan<br />
Skrzynecki, 23 mars 1842,<br />
in : Współudział Adama<br />
Mickiewicza w sprawie<br />
A. Towiańskiego. Listy i<br />
przemówienia,<br />
(L’Implication d’Adam<br />
Mickiewicz dans l’œuvre <strong>de</strong><br />
A. Towiański. Lettres et<br />
discours), Księgarnia<br />
Luksemburska, Paris, 1877,<br />
p. 17.<br />
4 - « Przemówienie<br />
w katedrze Notre-Dame »<br />
(Discours à la cathédrale<br />
Notre-Dame),<br />
in : Towiański A., Pisma<br />
(Lettres), t. I, Turin, 1882,<br />
p. 28. Notre traduction.
eux. Le prix à payer pour les Polonais est donc plus élevé que pour les autres<br />
nations. Ce qui explique leur exil. Mais si l’exil est une punition terrible, il est<br />
pourtant également un moyen <strong>de</strong> purification. Dans son discours, Towiański<br />
souligna ainsi le fait qu’il a plu à Dieu <strong>de</strong> préparer ces Émigrés « par une retraite <strong>de</strong><br />
dix ans sur une terre étrangère » 5 . C’est-à-dire la France, ce pays que<br />
la Vierge, affublée d’une croix blanche, lui avait indiqué lors <strong>de</strong> la<br />
vision datée du 23 juillet 1840 qu’il évoqua plus tard pour justifier son<br />
voyage 6 .<br />
Entre le moment où Towiański convainquit Mickiewicz <strong>de</strong> sa<br />
mission et celui où il rencontra les Émigrés, <strong>de</strong>ux mois s’étaient<br />
écoulés durant lesquels <strong>de</strong> nombreuses rumeurs avaient circulé,<br />
notamment celle selon laquelle « avant six mois, la Pologne serait à<br />
nouveau telle qu’elle avait été, et les Émigrés retourneraient au<br />
pays » 7 . Ceux-ci furent interloqués par cette nouvelle, alors que leur<br />
moral était très bas, surtout à cause <strong>de</strong> l’inaction et du désespoir <strong>de</strong><br />
ne plus jamais revoir leur terre 8 . Ils furent nombreux à être déçus par<br />
le discours <strong>de</strong> Towiański car les rumeurs propagées étaient largement<br />
gonflées par les espérances <strong>de</strong> ceux qui les colportaient. La lecture <strong>de</strong>s<br />
témoignages concernant la théorie <strong>de</strong> Towiański au moment <strong>de</strong> son<br />
séjour à Paris fait en effet clairement ressortir que le rétablissement<br />
politique <strong>de</strong> la Pologne n’est pas inscrit dans son programme. Le<br />
Maître considérait avant tout sa théorie comme « une plus haute<br />
intelligence <strong>de</strong> l’Évangile (…), un plus grand développement <strong>de</strong><br />
l’enseignement <strong>de</strong> l’Église » 9 . En tant que messager <strong>de</strong> Dieu, il se<br />
disait chargé <strong>de</strong> la réactualisation du message du Christ, il disait<br />
<strong>de</strong>voir expliquer au mon<strong>de</strong> que « l’heure d’être sauvé par Dieu avait<br />
sonné, que Son royaume approchait » 10 , qu’il fallait désormais<br />
dépasser l’idée <strong>de</strong> la Deuxième Alliance pour réaliser le « christianisme<br />
supérieur ». Pour que celui-ci se réalise, l’humanité <strong>de</strong>vait agir selon<br />
les principes évangéliques, mettre le catholicisme en actes. Autrement<br />
dit, lier politique et éthique religieuse. Il pensait que le but ultime était<br />
<strong>de</strong> « faire <strong>de</strong> la terre un ciel » 11 . Dans cette idée, la Pologne ne pourra<br />
être sauvée que si elle accepte la mission divine qui lui est assignée.<br />
Son rétablissement politique éventuel est totalement subordonné à<br />
cette participation au plan divin.<br />
La France et son rôle dans le towianisme<br />
Il est clair, à la lecture du discours à Notre-Dame, que Towiański<br />
considère que c’est parce qu’ils combinent le fait <strong>de</strong> provenir d’une<br />
nation élue et celui d’être en exil que les premiers vecteurs <strong>de</strong><br />
réalisation <strong>de</strong> ses thèses (donc <strong>de</strong>s <strong>de</strong>sseins <strong>de</strong> Dieu) sont les Polonais<br />
[63]<br />
5 - Ibid., p. 26. Notre<br />
traduction.<br />
6 - Pigoń St., Towiański na<br />
Litwie (1) (Towiański en<br />
Lituanie), in « PRZEGLAD<br />
WSPÓŁCZESNY », septembre,<br />
année XI, n° 125, Cracovie,<br />
1932, p. 325. Pigoń se base<br />
sur le témoignage d’un<br />
towianiste, Dominik<br />
Iwanowski.<br />
7 - Goszczyński S., Dziennik<br />
Sprawy Bożej (Le Journal <strong>de</strong><br />
l’Œuvre <strong>de</strong> Dieu) (Opracował i<br />
wstępem poprzedził<br />
Zb. Sudolski, przy współpracy<br />
W. Kordaczuk<br />
& M. M. Matusiak), Instytut<br />
Wydawniczy Pax, Varsovie,<br />
1984, t. 1, p. 22.<br />
8 - Voir Kalembka Sł., Wielka<br />
Emigracja. Polskie<br />
wychodźstwo polityczne<br />
w latach 1831-1862, Wiedza<br />
powszechna, Varsovie, 1971,<br />
p. 312 ; voir également<br />
« Relacya Stanisława<br />
Falkowskiego o stanie<br />
Emigracyi w Paryżu w chwili<br />
przybycia do niej Andrzeja<br />
Towiańskiego » (Notes <strong>de</strong><br />
Stanisław Falkowski au sujet<br />
<strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’Émigration<br />
à Paris au moment <strong>de</strong><br />
l’arrivée d’Andrzej Towiański<br />
parmi ses membres),<br />
in : Kilka aktów i dokumentów<br />
odnoszących się<br />
do działalności Andrzeja<br />
Towiańskigo, t. 1, Skład<br />
główny w ks. Gebethnera i<br />
Wolffa, Rome, 1898, pp. 3-6.<br />
9 - Semenenko P., Towiański<br />
et sa doctrine jugés par<br />
l'enseignement <strong>de</strong> l'Église,<br />
Sagnier et Bray, Paris, 1850,<br />
p. xi (Introduction).<br />
10 - « Przemówienie »,<br />
Art. cit., p. 27. Notre<br />
traduction. Towiański<br />
développa sa cosmogonie<br />
dans Biesiada. Nous ne nous<br />
y attar<strong>de</strong>rons pas. Les thèses<br />
<strong>de</strong> Towiański telles qu’elles<br />
sont exposées ici s’appliquent<br />
à sa mission <strong>de</strong><br />
« réactualisation » du<br />
message christique.<br />
11 - Voir Towiański A., Le<br />
Banquet, N. Béchet fils, Paris,<br />
s.d., p. 9. Il s’agit d’une<br />
édition française publiée par<br />
l’ordre <strong>de</strong>s Résurrectionnistes<br />
à la fin <strong>de</strong> l’année 1842.
<strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Émigration 12 . Cette combinaison est la preuve qu’ils ont été choisis<br />
pour réaliser « l’Œuvre <strong>de</strong> Dieu » (Sprawa Boża), selon la dénomination que<br />
Towiański donna à sa mission. En corollaire à cette assertion, nous pouvons<br />
comprendre que le lieu <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>sseins <strong>de</strong> Dieu n’est pas la Pologne,<br />
puisque l’exil <strong>de</strong> ses ressortissants est une condition nécessaire à leur réalisation,<br />
mais bien la terre d’accueil du pèlerinage expiatoire <strong>de</strong>s Polonais. C’est-à-dire la<br />
France.<br />
La France était, dans la première partie du XIX e siècle, le véritable centre<br />
intellectuel <strong>de</strong> l’Europe, elle exerçait une force d’attraction certaine sur les penseurs<br />
contemporains et restait une terre d’exil pour ceux qui ne pouvaient plus <strong>de</strong>meurer<br />
dans leur pays pour <strong>de</strong>s raisons souvent politiques 13 . Les Polonais ont maintes fois<br />
dans leur histoire été attirés par la France, mais c’est surtout la disparition <strong>de</strong> leur<br />
État suite aux trois Partages (1772, 1793 et 1795) et la Révolution française - et la<br />
concomitance <strong>de</strong> ces événements - qui renforça cette attraction. La société<br />
polonaise du début du XIX e siècle était très influencée par les Lumières françaises et<br />
c’est tout naturellement que les premiers exilés politiques, voyant en la France une<br />
cousine en termes <strong>de</strong> culture, décidèrent <strong>de</strong> s’y installer. Durant la Révolution<br />
française, la Pologne se considéra pleinement comme l’alliée <strong>de</strong> la France. Plus tard,<br />
Napoléon fut accueilli comme un triomphateur lorsqu’il créa le duché <strong>de</strong><br />
Varsovie 14 , lui qui avait déjà créé les Légions polonaises, seules<br />
émanations nationales <strong>de</strong>puis la disparition <strong>de</strong> la Rzeczpospolita. Aussi,<br />
la chute <strong>de</strong> l’empire français signifia pour les Polonais la fin <strong>de</strong> leurs<br />
espoirs concernant le rétablissement politique total <strong>de</strong> leur État dans la<br />
configuration <strong>de</strong> la République <strong>de</strong>s Deux-Nations. Durant les années<br />
1820, les Polonais se firent une idée particulière <strong>de</strong> la France, différente<br />
<strong>de</strong> celle qu’ils se faisaient d’elle durant la Révolution. Cette nouvelle<br />
conception naquit <strong>de</strong>s coïnci<strong>de</strong>nces qu’ils trouvaient entre leurs propres<br />
aspirations, aussi multiples qu’elles soient, et les divers mouvements<br />
politiques français. C’est dans cette atmosphère « que dans presque<br />
tous les milieux polonais une opinion positive unanime à propos <strong>de</strong> la<br />
France se développa. Elle ne fut pas déterminée par une connaissance<br />
entière <strong>de</strong> la réalité française, mais par les espérances politiques » 15 .<br />
Lorsque éclata la révolution <strong>de</strong> Juillet 1830, prélu<strong>de</strong> à l’insurrection<br />
polonaise <strong>de</strong> 1830-1831, les républicains français, partisans d’une<br />
guerre européenne qui aurait permis au peuple <strong>de</strong> prendre le pouvoir,<br />
promirent durant les négociations qui <strong>de</strong>vaient mener à la constitution<br />
d’un ministère qu’ils assisteraient tout peuple qui désirait se libérer <strong>de</strong> la<br />
tutelle monarchique. La France semblait donc une alliée <strong>de</strong> choix. C’est<br />
tout naturellement donc que les Émigrés se dirigèrent vers ce pays<br />
lorsqu’à la fin <strong>de</strong> l’année 1831 ils fuirent le leur, espérant pouvoir y<br />
continuer l’œuvre libératrice qu’ils avaient commencée.<br />
Towiański expliquait tout à fait autrement l’attraction <strong>de</strong>s Émigrés<br />
pour la France. Il considérait en effet les événements politiques comme<br />
[64]<br />
12 - On appelle ainsi le<br />
groupe d’émigrés polonais<br />
qui fuirent la répression<br />
tsariste après la chute <strong>de</strong><br />
l’insurrection <strong>de</strong> Novembre.<br />
13 - La communauté<br />
alleman<strong>de</strong> <strong>de</strong> Paris était<br />
plus nombreuse, et <strong>de</strong> loin,<br />
que la communauté<br />
polonaise lorsque Towiański<br />
y arriva : il y avait<br />
approximativement 8 000<br />
Polonais pour 30 000<br />
Allemands. Voir Charle<br />
Chr., Les Intellectuels en<br />
Europe au XIX e siècle. Essai<br />
d’histoire comparée,<br />
Le Seuil, coll. « Point<br />
histoire », Paris, 2001,<br />
p. 127-128.<br />
14 - Créé par le Traité <strong>de</strong><br />
Tilsit (1807) et démantelé<br />
par celui <strong>de</strong> Vienne (1815),<br />
le duché <strong>de</strong> Varsovie fut<br />
d’abord constitué <strong>de</strong>s terres<br />
polonaises appartenant à la<br />
Prusse (1807) auxquelles<br />
furent rattachées celles qui<br />
avaient été arrachées à<br />
l’Autriche (1809).<br />
15 - Skowronek J., «<br />
Regard <strong>de</strong>s émigrés<br />
polonais en France sur le<br />
mon<strong>de</strong> environnant (1772-<br />
1861) », in: Pologne-<br />
France : La vision <strong>de</strong><br />
l’autre, Actes du Colloque<br />
franco-polonais <strong>de</strong><br />
Montpellier, 22-24 juin<br />
1992, Uniwersytet<br />
Warszawski & <strong>Université</strong><br />
Montpellier III, Honoré<br />
Champion éd., Paris, 1994,<br />
p. 66.
<strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong> la volonté <strong>de</strong> Dieu sur la terre 16 , les Émigrés ne pouvaient donc<br />
pas se réunir n’importe où : c’est le plan divin qui les avait amené à se diriger vers<br />
la France.<br />
Pour Towiański, la France n’était toutefois pas uniquement le lieu <strong>de</strong><br />
l’expiation, elle était également (comme d’ailleurs la Russie) censée jouer un rôle<br />
actif primordial dans la réalisation <strong>de</strong> sa mission. Les Polonais en pèlerinage, en tant<br />
que premiers appelés, constituaient le « canal » par lequel la révélation <strong>de</strong>vait lui<br />
parvenir. Towiański envisageait la propagation <strong>de</strong> sa « science » par le biais <strong>de</strong> la<br />
« Loi d’harmonie » qui peut être résumée comme suit : l’homme doit vouloir sans<br />
cesse pousser son esprit vers Dieu, il doit vouloir briser les chaînes qui le tiennent à<br />
la « terre » et orienter son être vers la réalisation <strong>de</strong> la parole du Christ. Il doit pour<br />
cela réaliser le triple sacrifice : celui <strong>de</strong> l’esprit, celui du corps et celui <strong>de</strong> l’action.<br />
Lorsqu’il est disposé à ce sacrifice, l’homme élève son « ton » chrétien, il attire ainsi<br />
sur lui une « colonne lumineuse » composée d’esprits élevés (à tel point qu’ils ne<br />
peuvent plus exister dans une enveloppe corporelle) qui l’ai<strong>de</strong> à gar<strong>de</strong>r l’élévation<br />
<strong>de</strong> son « ton », mais il attire également les esprits d’autres hommes, ceux <strong>de</strong> ses<br />
contemporains disposés au sacrifice. Si les hommes se groupent pour élever leur<br />
« ton », ils attireront un plus grand nombre d’esprits enclins à les imiter.<br />
La « Loi d’harmonie » est donc celle par laquelle un esprit (ou un groupe<br />
d’esprits) qui élève ou cultive son « ton » attire d’autres esprits qui<br />
acceptent le sacrifice 17 . Les Polonais <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Émigration <strong>de</strong>vaient<br />
donc tous ensemble élever leur « ton » chrétien et convaincre ainsi<br />
d’autres nations <strong>de</strong> les imiter. Towiański pensait que certaines nations<br />
étaient élues par Dieu, il pensait aussi que, parmi celles-ci, la France<br />
jouait un rôle <strong>de</strong> premier plan car elle avait déjà été préparée 18 .<br />
Napoléon, précurseur et allié <strong>de</strong> « l’Œuvre <strong>de</strong> Dieu »<br />
Comment se fait-il que la France ait été préparée ? Et le cas<br />
échéant, par qui ou par quoi ? Cette préparation est due à Napoléon<br />
Bonaparte. Il n’est pas étonnant outre mesure que l’empereur ait été<br />
sujet aux extrapolations <strong>de</strong> Towiański tant son action avait marqué<br />
l’Europe <strong>de</strong> manière significative, tant les Polonais voyaient en lui celui<br />
qui aurait pu leur rendre un État indépendant, en tout cas libéré <strong>de</strong> la<br />
Russie. Le Maître ne péchait pas par extravagance en sanctifiant<br />
l’empereur déchu. La vénération pour celui-ci est d’ailleurs un élément<br />
qui aura un écho dans l’histoire future <strong>de</strong>s Polonais : Daniel Beauvois<br />
note que l’histoire « engendra chez eux l’attente vague et toujours vaine<br />
d’un “grand homme”, d’un dictateur luci<strong>de</strong> et juste, antidote aux vieilles<br />
traditions anarchiques. Chłopicki et Skrzynecki en 1831, Traugutt en<br />
1863, Piłsudski en 1926 aspireront à <strong>de</strong>venir ce surhomme sans y<br />
parvenir » 19 . Les élites n’étaient pas les seules à projeter leurs<br />
[65]<br />
16 - Powody dla których<br />
amnestya przyjęta być nie<br />
może przedstawione przez<br />
część emigracyi polskiej<br />
jego cesarskiéj mości<br />
Alexandrowi II, Drukarnia<br />
L. Martinet, Paris, 1857. De<br />
la même manière Towiański<br />
appréhen<strong>de</strong> la Russie<br />
comme étant l’instrument<br />
du châtiment divin envers<br />
les Polonais.<br />
17 - La nomenclature<br />
utilisée ici est composite : il<br />
est surtout fait mention <strong>de</strong>s<br />
« colonnes » dans le<br />
Banquet (1841), duquel le<br />
terme <strong>de</strong> « ton » est<br />
absent. Celui-ci est un<br />
concept plus tardif. Les<br />
arcanes <strong>de</strong> la pensée<br />
towianiste telles<br />
qu’explicitées ne<br />
contreviennent pas à<br />
l’esprit général <strong>de</strong> la<br />
doctrine.<br />
18 - « Actuellement,<br />
toutess les nations libérées<br />
en esprit sont appelées à<br />
joindre l’Œuvre, surtout la<br />
Pologne et la France. »,<br />
dans : « Przemówienie<br />
Adama Mickiewicza »<br />
(Discours <strong>de</strong> Adam<br />
Mickiewicz [au Cercle <strong>de</strong><br />
l’Œuvre <strong>de</strong> Dieu]), s.d.,<br />
in : Współudział …, Op. cit.,<br />
p. 69. Notre traduction. À<br />
ces <strong>de</strong>ux nations, il faut<br />
également rajouter Israël.<br />
19 - Beauvois D., La<br />
Pologne : Histoire, société,<br />
culture, Éditions <strong>de</strong><br />
La Martinière, Paris, 2004,<br />
p. 215.
aspirations sur le personnage <strong>de</strong> Napoléon, Mickiewicz a noté que sur les terres qui<br />
appartenaient à la Russie, l’empereur était associé à <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> « sorcellerie » 20 ,<br />
ce qui souligne bien le caractère finalement très abstrait dont il fut rapi<strong>de</strong>ment<br />
revêtu.<br />
Towiański vénérait tellement Napoléon que lorsqu’il se rendit <strong>de</strong> Lituanie à<br />
Paris, il passa par <strong>de</strong>s champs <strong>de</strong> bataille napoléoniens : Friedland, Eylau, Dres<strong>de</strong>,<br />
Leipzig, etc. 21 Il écrivit d’ailleurs Biesiada (Le Banquet, 17 janvier 1841), son<br />
premier texte programmatique, après un séjour sur le champ <strong>de</strong> bataille <strong>de</strong><br />
Waterloo. Il pensait que Napoléon avait joué un rôle important dans la future<br />
régénération <strong>de</strong> la société, d’une part en tant que « précurseur <strong>de</strong> l’Œuvre <strong>de</strong><br />
Dieu » 22 , et d’autre part en tant qu’allié <strong>de</strong> l’homme dans l’élévation <strong>de</strong> son « ton ».<br />
L’action <strong>de</strong> l’empereur est antérieure à celle <strong>de</strong> Towiański, c’est lui qui établit les<br />
fon<strong>de</strong>ments indispensables à la mission du Maître. Celui-ci l’explique clairement à<br />
l’empereur russe Nicolas I er dans une lettre datée du 15 août 1844 :<br />
Napoléon était pré<strong>de</strong>stiné à exécuter l’ordre du Verbe dans la vie <strong>de</strong>s<br />
peuples, et à arborer l’étendard <strong>de</strong> Jésus-Christ sur le champ païen <strong>de</strong> la<br />
politique. Pour le triomphe du Verbe, le Bras du Seigneur s’éleva.<br />
Napoléon triomphait. (…) Ce que l’homme a commencé l’esprit l’achève ;<br />
son empire plus vrai, plus puissant recommence sur la terre. Ainsi<br />
l’étendard <strong>de</strong> Jésus-Christ est planté sur un champ nouveau ; jusqu’à ce<br />
que <strong>de</strong> siècles en siècles, s’élevant plus haut et porté plus loin, il soit<br />
salué sur tous les champs qu’il est <strong>de</strong>stiné à dominer. Dans l’Œuvre <strong>de</strong><br />
Dieu qui se fait à présent, le Verbe occupe son nouveau terrain. 23<br />
Le thème <strong>de</strong> la lutte est récurrent dans l’œuvre <strong>de</strong> Towiański, elle<br />
tire probablement son origine dans le napoléonisme <strong>de</strong> son auteur. Ce<br />
<strong>de</strong>rnier s’opposait pourtant à la lutte armée, il n’avait pas pris part à<br />
l’insurrection <strong>de</strong> Novembre, et n’avait accepté qu’à contre cœur l’idée <strong>de</strong><br />
celle <strong>de</strong> janvier 1863 24 . La « lutte » towianiste est abstraite,<br />
métaphysique, elle est celle que l’homme mène contre lui-même et<br />
contre ceux qui refusent le triple sacrifice, celle du Bien contre le Mal,<br />
celle du ciel contre la terre, celle encore <strong>de</strong> la religion qui doit se faire<br />
accepter, par le travail spirituel <strong>de</strong>s hommes, comme fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la<br />
politique ; elle est le reflet <strong>de</strong> la lutte menée par Napoléon pour la liberté<br />
<strong>de</strong>s peuples et la défense <strong>de</strong>s idéaux. Cela démontre à quel point<br />
l’œuvre <strong>de</strong> Napoléon a été réduite au niveau du symbole par Towiański.<br />
On remarque cela également dans le fait qu’il ne s’interroge jamais sur<br />
l’action réelle <strong>de</strong> l’empereur envers la religion, il ne s’intéresse pas au<br />
catéchisme impérial, au financement du culte ou à l’emprisonnement du<br />
pape par exemple, car ce n’est pas dans l’Église institutionnalisée qu’il<br />
puise sa vérité mais bien dans le sentiment religieux <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong>s<br />
nations. L’histoire <strong>de</strong> l’Église ne le concerne pas, il fait uniquement appel<br />
à l’esprit <strong>de</strong> celle-ci. Napoléon a en somme été celui qui prépara la<br />
[66]<br />
20 - Note <strong>de</strong> Mickiewicz<br />
dans le Livre premier <strong>de</strong><br />
Pan Ta<strong>de</strong>usz. Voir<br />
Mickiewicz A., Pan Ta<strong>de</strong>usz<br />
ou La <strong>de</strong>rnière incursion<br />
judiciaire dans la Lithuanie,<br />
au sein <strong>de</strong> la noblesse<br />
pendant les années 1811 et<br />
1812, en douze livres, en<br />
vers (traduction, préface et<br />
notes par Roger Legras),<br />
L’Âge d’Homme, coll.<br />
« Classiques slaves »,<br />
Lausanne, 1992, p. 42.<br />
21 - Canonico T., Andrzej<br />
Towiański, Turin, 1897,<br />
p. 8.<br />
22 - I<strong>de</strong>m.<br />
23 - Chodźko A., « Écrit<br />
adressé à l’empereur<br />
Nicolas, 15 août 1844 ». En<br />
réalité, Chodźko n’est qu’un<br />
prête-nom, l’auteur <strong>de</strong><br />
cette lettre est Towiański<br />
lui-même. La traduction <strong>de</strong><br />
ce passage est <strong>de</strong> Henri<br />
Desmettres : Towiański et<br />
le messianisme polonais,<br />
t. 2 : Annexes et<br />
Bibliographie <strong>de</strong>s aspects<br />
philosophiques et<br />
théologiques du<br />
Messianisme polonais <strong>de</strong><br />
1800 à 1850, Thèse <strong>de</strong><br />
doctorat présentée à la<br />
Faculté <strong>de</strong> Théologie <strong>de</strong><br />
Lille, 1947, pp. 53-54. On<br />
remarque également la<br />
confirmation du choix <strong>de</strong> la<br />
France comme lieu <strong>de</strong><br />
réalisation du plan divin.<br />
24 - Szpotański St.,<br />
Andrzej Towiański. Jego<br />
Życie i nauka (Andrzej<br />
Towiański. Sa vie et sa<br />
science), Wydawnictwo<br />
Kasy im. Mianowskiego,<br />
Varsovie, 1938, pp. 127-<br />
129 & 277-279.
France à recevoir la vérité d’en haut car il l’a mobilisée tout entière - c'est-à-dire<br />
son peuple - dans une action commune que Towiański lisait comme une mission<br />
divine. La lecture téléologique <strong>de</strong>s événements historiques permet également <strong>de</strong><br />
comprendre pourquoi, s’il avait une mission divine, Napoléon fut démis et son<br />
action détruite : pour Towiański, il ne fait pas <strong>de</strong> doute que l’empereur, « dépassant<br />
les limites <strong>de</strong> sa mission, perdit son onction Divine » 25 . C’est donc à son orgueil<br />
d’homme qu’il doit sa chute.<br />
À la mort <strong>de</strong> Napoléon, son esprit ne put plus <strong>de</strong>meurer dans une enveloppe<br />
humaine tant il s’était élevé. Nous avons déjà établi que l’homme <strong>de</strong>vait, pour<br />
conserver la hauteur <strong>de</strong> son « ton » chrétien, se faire ai<strong>de</strong>r par les « colonnes<br />
lumineuses » composées d’esprits supérieurs. L’esprit <strong>de</strong> Napoléon participe à ces<br />
colonnes. C’est en ce sens qu’il peut ai<strong>de</strong>r les hommes, c’est en ce sens aussi qu’il<br />
faut comprendre que « ce que l’homme a commencé l’esprit l’achève » (voir supra).<br />
On retrouve cette idée <strong>de</strong> la supériorité <strong>de</strong> l’esprit <strong>de</strong> Napoléon dans Biesiada :<br />
Et toi, esprit <strong>de</strong> Napoléon, par un privilège spécial, tu es l’avant <strong>de</strong>rnier dans cette<br />
sainte colonne [lumineuse]. Il t’est permis <strong>de</strong> vivre, d’agir sur la terre, sans cesser<br />
d’être un pur esprit. 26<br />
C’est la mise en pratique du towianisme qui est exprimée ici. Napoléon est<br />
associé à l’action, à la réalisation <strong>de</strong> la volonté divine, au triple sacrifice. Son esprit<br />
a un caractère immanent et positif, présent pour l’homme. L’ancien empereur<br />
représente l’optimisme <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong> « l’Œuvre <strong>de</strong> Dieu ». Dans son Écrit<br />
adressé à l’empereur Nicolas, Towiański écrit en effet que « la volonté <strong>de</strong> Dieu est<br />
faite : l’idée <strong>de</strong> la liaison <strong>de</strong> la religion avec la politique a germé sur la terre » 27 ,<br />
voyant ainsi confirmé le bien-fondé <strong>de</strong> sa théorie messianique. La réalisation<br />
assurée <strong>de</strong>s <strong>de</strong>sseins <strong>de</strong> Dieu était donc en marche, mais encore fallait-il que<br />
l’homme le comprît, qu’il agît par le triple sacrifice, qu’il recherchât l’ai<strong>de</strong> d’esprits<br />
supérieurs, dont celui <strong>de</strong> Napoléon. C’est là toute la raison d’être <strong>de</strong> « l’Œuvre <strong>de</strong><br />
Dieu ». C’est ce que Mickiewicz résuma par une courte formule : « Notre action est<br />
politico-religieuse, notre ton est christico-napoléonien » 28 .<br />
Le towianisme considérait donc que la France était une nation choisie, qu’elle<br />
avait été préparée par l’action <strong>de</strong> Napoléon, et que l’esprit <strong>de</strong> celui-ci aidait les<br />
hommes <strong>de</strong> bonne volonté. Towiański, éternellement optimiste, pensait dès le début<br />
<strong>de</strong> son action que la France était avi<strong>de</strong> <strong>de</strong> continuer l’œuvre entamée par son<br />
empereur. Dans Biesiada en effet, il s’adressait à l’esprit <strong>de</strong> Napoléon en ces<br />
termes :<br />
Il t’est permis [par Dieu] <strong>de</strong> t’unir et <strong>de</strong> porter secours à tes instruments<br />
terrestres, pour que ta nation te reconnaisse, et, habituée à ta direction,<br />
avi<strong>de</strong> d’elle, accomplisse l’œuvre prescrite par le Seigneur, selon qu’il a<br />
plu au Seigneur <strong>de</strong> manifester en cela sa très sainte volonté et ses<br />
dispositions. 29<br />
[67]<br />
25 - Chodźko A.,<br />
Art. cit., p. 53.<br />
26 - Towiański A., Le<br />
Banquet, Op. cit., p. 14.<br />
27 - Chodźko A., Art. cit.,<br />
p. 53.<br />
28 - Lettre d’Adam<br />
Mickiewicz à Seweryn<br />
Goszczyński datée <strong>de</strong><br />
<strong>Bruxelles</strong> le 28 juillet 1843,<br />
in : Współudział…, Op. cit.,<br />
p. 105. Notre traduction.<br />
29 - Towiański A., Le<br />
Banquet, Op. cit., p. 14.
Les vintrasiens et la consécration du towianisme<br />
Avant même d’arriver en France, les idées <strong>de</strong> Towiański étaient bien arrêtées<br />
en ce qui concernait la raison du choix <strong>de</strong> la France comme terre d’exil, le rôle que<br />
ce pays avait à jouer dans « l’Œuvre <strong>de</strong> Dieu » et la place que Napoléon tenait dans<br />
celle-ci. Dans son discours aux Émigrés, le Lituanien ne fit toutefois aucune mention<br />
<strong>de</strong> la France. La raison n’en est pas claire, elle n’est pas non plus documentée. Tout<br />
ce qui est certain, c’est qu’il considérait la rencontre dans la cathédrale comme une<br />
première approche, une introduction ; les détails <strong>de</strong> sa théorie <strong>de</strong>vaient être révélés<br />
et expliqués par une lettre et d’autres rencontres. La lettre ne fut jamais écrite et<br />
les rencontres se firent attendre. Il ne reprit la parole en public qu’en décembre<br />
1841, à l’occasion <strong>de</strong> l’accrochage, dans l’église Saint-Séverin à Paris, d’un tableau<br />
représentant la vierge, copie <strong>de</strong> l’image <strong>de</strong> la Vierge d’Ostrabrama <strong>de</strong> Vilnius peinte<br />
par Walentyn Wańkowicz, un towianiste <strong>de</strong> longue date. Ensuite, il se fit très discret<br />
jusqu’à la fin du mois <strong>de</strong> mars 1842, époque à laquelle il commença ses<br />
conférences-rencontres mises en place pour créer la première « cohorte <strong>de</strong> Dieu »<br />
(Zastęp Pański). C’est-à-dire le Cercle, qui fut officiellement « fermé » le 1 er juin<br />
1842.<br />
En 1841 et 1842, la France ne constitue pas un axe majeur <strong>de</strong> l’action <strong>de</strong><br />
Towiański, ce sont plutôt les Slaves qui remportent ses suffrages. Il n’est pas<br />
toujours clair à ce sujet, mais il ne fait aucun doute qu’ils étaient l’objet <strong>de</strong> sa plus<br />
gran<strong>de</strong> attention. Les autorités russes présentes à Paris, très attentives aux faits et<br />
gestes <strong>de</strong> membres <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Émigration, furent mises au courant <strong>de</strong> la tenue<br />
<strong>de</strong> la conférence <strong>de</strong> Towiański dans la cathédrale Notre-Dame. Une enquête fut<br />
ouverte à son sujet. Après un interrogatoire du Lituanien, Nikolaj Dmitrijevič<br />
Kišiliev, le chargé d’affaire russe à Paris, nota dans son rapport que celui-ci « est<br />
venu en France, chargé, comme il s’énonce, d’une mission céleste, tendant à<br />
amener un rapprochement et une réconciliation entre les Russes et les Polonais » 30 .<br />
Dans les écrits towianistes <strong>de</strong> cette époque, les choses ne sont pas aussi claires ;<br />
cette propagan<strong>de</strong> <strong>de</strong>vait être principalement orale, car il est notable que les<br />
Émigrés considéraient les théories <strong>de</strong> Towiański comme un messianisme panslave.<br />
Ils ne pouvaient bien sûr pas souscrire à cette idée tant leur opposition à la Russie<br />
était féroce.<br />
La France acquit une importance croissante dans le towianisme à partir du<br />
<strong>de</strong>uxième semestre 1842 pour <strong>de</strong>venir un axe majeur durant l’année 1843. On peut<br />
imaginer que Towiański n’avait pas <strong>de</strong> plan prédéfini dans l’exposition <strong>de</strong><br />
ses théories et qu’il suivait les voies les plus intéressantes qui s’offraient<br />
à lui. La filière « slave » semblant difficile à exploiter dans le cadre<br />
russophobe <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Émigration, il tourna son intérêt ailleurs. Et il<br />
en sera récompensé. Durant le mois <strong>de</strong> novembre 1842, alors que le<br />
Maître habitait maintenant en Belgique <strong>de</strong>puis quelques mois, <strong>de</strong> pieux<br />
Français vinrent spontanément se mettre à sa disposition. Nulle part<br />
nous ne pouvons trouver la trace <strong>de</strong> la moindre interrogation à ce sujet<br />
[68]<br />
30 - Makowiecka Z.,<br />
Mickiewicz w Collège <strong>de</strong><br />
France. Kronika życia i<br />
twórczości Mickiewicza<br />
(październik 1840 – maj<br />
1844) (Mickiewicz au<br />
Collège <strong>de</strong> France.<br />
Chronique <strong>de</strong> la vie et <strong>de</strong><br />
l’œuvre <strong>de</strong> Mickiewicz<br />
[octobre 1840-mai 1844),<br />
Instytut Badań Literackich<br />
Polskiej Aka<strong>de</strong>mii Nauk,<br />
Państwowy Instytut<br />
Wydawniczy, Varsovie,<br />
1968, p. 263. Zofia<br />
Makowiecka se base sur les<br />
« Archives Mickiewicz » <strong>de</strong><br />
Samuel Fiszman.
<strong>de</strong> la part <strong>de</strong> Towiański, il est simplement ravi <strong>de</strong> l’arrivée provi<strong>de</strong>ntielle <strong>de</strong> ces<br />
nouveaux disciples, arrivée provi<strong>de</strong>ntielle qu’il considère bien sûr comme un<br />
satisfecit accordé à sa mission. Il se sentit ainsi sûr <strong>de</strong> sa force et du bien-fondé <strong>de</strong><br />
son action.<br />
Qui étaient ces Français ? Tancredo Canonico, un towianiste italien, écrivit<br />
dans sa biographie du Maître qu’il y avait en France, en 1842, « un homme du<br />
peuple qui, ayant <strong>de</strong> fréquentes extases, dépeignit sous <strong>de</strong> vives couleurs<br />
l’affaiblissement progressif <strong>de</strong> la foi dans les cœurs, ainsi que les conséquences<br />
terribles qui en résulteraient pour la France et pour le mon<strong>de</strong>. Depuis quelques<br />
années, il disait : “que <strong>de</strong>s temps nouveaux allaient commencer où le mon<strong>de</strong> serait<br />
poussé à retourner sur la voie <strong>de</strong> Jésus-Christ et à accomplir plus strictement sa<br />
loi ; que l’homme instrument <strong>de</strong> ce secours <strong>de</strong>vait sortir du fond <strong>de</strong> la Pologne”. Au<br />
mois <strong>de</strong> décembre 1840, sans jamais avoir entendu parler <strong>de</strong> Towiański,<br />
il ajouta : “que le saint slave, organe <strong>de</strong>s décrets <strong>de</strong> la miséricor<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Dieu pour le mon<strong>de</strong>, dépositaire du ton d’action, était déjà sur le sol<br />
français » 31 . Cet homme, c’est Pierre Michel Vintras (1807-1875), le chef<br />
d’une secte appelée « L’Œuvre <strong>de</strong> la Miséricor<strong>de</strong> ».<br />
Vintras était un aventurier qui vivait d’expédients, jusqu’au jour où<br />
il lui fut proposé <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir le gérant d’une usine <strong>de</strong> carton. Au début <strong>de</strong><br />
l’année 1839, il se rendit à Tilly-sur-Seulles, en Normandie, pour y<br />
prendre ses fonctions. C’est là qu’il eut, le 6 août, sa première vision. Ce<br />
sera le début d’une longue série. Il acquit rapi<strong>de</strong>ment quelques a<strong>de</strong>ptes<br />
dans toute la France, qui attendaient ar<strong>de</strong>mment les récits <strong>de</strong>s<br />
apparitions qu’il vivait ; il s’improvisa prêtre, fit apparaître <strong>de</strong>s hosties<br />
ensanglantées, etc. Sa théorie est mal définie, il prêchait une bonne<br />
nouvelle confuse et changeante dans laquelle le thème <strong>de</strong> la Vierge et<br />
du futur règne <strong>de</strong> l’esprit revenait régulièrement. Il organisa bien vite<br />
ses a<strong>de</strong>ptes en conventicules appelés « septaines », donna à chacun <strong>de</strong>s<br />
membres <strong>de</strong> sa secte <strong>de</strong>s noms angéliques (lui-même prit le nom <strong>de</strong><br />
Sthrathanaël) et publia un journal intitulé « LA VOIX DE LA SEPTAINE » 32 .<br />
Ses disciples entendirent parler <strong>de</strong> Towiański à la fin <strong>de</strong> l’année<br />
1841, après son discours à la cathédrale <strong>de</strong> Paris. La prophétie <strong>de</strong> leur<br />
mage évoquée plus haut commanda à une partie d’entre eux <strong>de</strong> prendre<br />
contact avec les towianistes, qui les orientèrent vers la Belgique, vers<br />
Osten<strong>de</strong> plus précisément, ville dans laquelle résidait alors Towiański.<br />
Peut-être celui-ci remarqua-t-il en la doctrine qui lui fut exposée <strong>de</strong>s<br />
coïnci<strong>de</strong>nces troublantes : lui aussi comptait sur l’action <strong>de</strong> la<br />
Miséricor<strong>de</strong> divine, lui aussi voyait en la croix blanche un symbole <strong>de</strong> son<br />
action, lui aussi utilisait le terme « canal » pour parler <strong>de</strong> l’homme, etc.<br />
33 Toujours est-il qu’il jugea « l’Œuvre <strong>de</strong> la Miséricor<strong>de</strong> » en accord avec<br />
« l’Idée du Seigneur » 34 . Mickiewicz recevait régulièrement <strong>de</strong>s<br />
vintrasiens, avec qui il échangeait ses opinions. Il profita <strong>de</strong> ces contacts<br />
inopinés pour modifier la structure du Cercle polonais : à la manière <strong>de</strong><br />
[69]<br />
31 - Canonico T., Op. cit.,<br />
p. 29 (<strong>de</strong> l’édition<br />
polonaise). Nous citons<br />
d’après Appolis E., « Les<br />
rapports entre <strong>de</strong>ux<br />
“prophètes” du XIX e siècle :<br />
Vintras et Towiański »,<br />
in : « REVUE D’HISTOIRE ET DE<br />
PHILOSOPHIE RELIGIEUSES »,<br />
t. XLV, Faculté <strong>de</strong> théologie<br />
protestante <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong><br />
<strong>de</strong> Strasbourg, Presses<br />
universitaires <strong>de</strong> France,<br />
Paris, 1963, pp. 335-336.<br />
32 - Voir Erdan A., La<br />
France mystique. Tableau<br />
<strong>de</strong>s excentricités religieuses<br />
<strong>de</strong> ce temps, t. 1, R. C.<br />
Meijer, Librairie étrangère,<br />
Vijgendam, Amsterdam,<br />
1858, pp. 163-183,<br />
Garçon M., Vintras,<br />
hérésiarque et prophète<br />
(1928), Éd. Jérôme Millon,<br />
Paris, 2007, 223 p. et<br />
Appolis E., Art. cit.,<br />
pp. 335-348. Erdan<br />
« trouve dans l’œuvre <strong>de</strong><br />
Pierre-Michel Vintras tous<br />
les caractères d’une<br />
mission divine » (p. 163) ;<br />
Garçon est beaucoup plus<br />
ironique.<br />
33 - Voir Lettre <strong>de</strong><br />
Mickiewicz à Towiański <strong>de</strong><br />
novembre 1842,<br />
in : Współudział..., Op. cit.,<br />
pp. 53-55 et Ujejski K., «<br />
Naudorf, Vintras i<br />
towiańszczyzna », in : «<br />
PAMIĘTNIK LITERACKI »,<br />
année 25, 1928, p. 412,<br />
n. 1. Ces coïnci<strong>de</strong>nces<br />
exceptées, il est toutefois<br />
difficile, en se basant sur<br />
les sources écrites, <strong>de</strong><br />
trouver une véritable<br />
concordance entre les<br />
doctrines <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
hommes.<br />
34 - 1 Lettre <strong>de</strong> Towiański à<br />
Mickiewicz du 5 décembre<br />
1842, in : Współudział...,<br />
Op. cit., pp. 57-58.
celui <strong>de</strong>s vintrasiens, celui-ci fut divisé en septaines. Elles <strong>de</strong>vaient permettre aux<br />
towianistes <strong>de</strong> travailler spirituellement en petits groupes. Donc plus efficacement.<br />
Rapi<strong>de</strong>ment, quelques vintrasiens quittèrent leur maître pour se mettre au service<br />
<strong>de</strong> Towiański et créer ainsi le Cercle français <strong>de</strong> Paris. Peut-être virent-ils en<br />
Towiański un homme motivé uniquement par son idéal christique et n’ayant aucun<br />
recours aux artifices dont était coutumier leur ancien chef. Peut-être donc le<br />
croyaient-ils touché par la grâce <strong>de</strong> manière plus efficiente. Le départ <strong>de</strong> ses<br />
disciples sera l’une <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> l’opposition du « Normand » et du « Lithuane » 35 .<br />
Leur conflit se fon<strong>de</strong> en réalité sur <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> doctrine et est alimenté par une<br />
volonté d’exclusive, la révélation ne pouvant être multiple. Towiański et Mickiewicz<br />
considéraient que les vintrasiens se limitaient à la jouissance <strong>de</strong>s visions <strong>de</strong> leur<br />
chef, qu’il leur manquait donc une qualité essentielle qui était la soif « d’action en<br />
esprit » 36 (czyn w duchu). Ils péchaient par passivité, ils ne hâtaient pas<br />
suffisamment le renouvellement du christianisme. De son côté, Vintras, qui purgeait<br />
une peine <strong>de</strong> cinq années <strong>de</strong> prison pour escroquerie (<strong>de</strong>puis le mois d’août 1842),<br />
refusait la qualité du « ton » towianiste qui, selon lui, « n’était autre, dans la preuve<br />
qu’ils en donnent, que ce ton reproché par le divin Sauveur aux Pharisiens » 37 . La<br />
brouille sera rapi<strong>de</strong>ment complète entre les <strong>de</strong>ux hommes, qui, par un effet du<br />
hasard, se trouvaient l’un comme l’autre éloignés <strong>de</strong> leurs disciples. Towiański eut<br />
la satisfaction d’avoir été le « vainqueur » dans sa lutte contre le faux prophète que<br />
représentait à ses yeux Vintras. Ce qui renforçait encore ses espérances et<br />
l’installait dans ses certitu<strong>de</strong>s.<br />
Le towianisme et la théosophie française<br />
Lorsqu’il décrit en parallèle les théories <strong>de</strong> Vintras et Towiański, Kornel Ujejski<br />
remarque, par <strong>de</strong>là les contradictions flagrantes, quelques « lieux communs<br />
mystiques » 38 . Le chercheur fait assurément allusion aux idées <strong>de</strong> régénération <strong>de</strong><br />
la société, <strong>de</strong> travail spirituel <strong>de</strong>s hommes à finalité séculière (terrestre), <strong>de</strong><br />
Provi<strong>de</strong>nce bienveillante, etc. Ces idées, dans la première partie du XIX e siècle,<br />
étaient liées à <strong>de</strong>s conceptions mo<strong>de</strong>rnes telles que la « Liberté » ou le « Progrès ».<br />
Towiański voit en effet le « christianisme supérieur » comme un progrès par rapport<br />
à la situation religieuse qu’il pouvait appréhen<strong>de</strong>r dans le mon<strong>de</strong> tel qu’il le<br />
connaissait. Et ce progrès, il le subordonne à l’idée <strong>de</strong> Liberté :<br />
l’homme doit, selon lui, se libérer <strong>de</strong>s liens qui le lient à la terre et il<br />
doit librement accepter le triple sacrifice pour y parvenir. Towiański<br />
n’innove donc pas. Il n’est pas exagéré <strong>de</strong> dire qu’il s’inscrit<br />
parfaitement dans le développement intellectuel du premier XIX e<br />
siècle. Si l’on excepte la composante slave <strong>de</strong> son messianisme, la<br />
théorie <strong>de</strong> Towiański présente <strong>de</strong> nombreuses analogies avec les<br />
théories françaises à vertu réformatrice qui transcendaient à l’époque<br />
romantique les courants majeurs que sont le libéralisme, la démocratie<br />
[70]<br />
35 - C’est-à-dire Vintras et<br />
Towiański. Ces dénominations<br />
sont <strong>de</strong> Vintras : voir<br />
Appolis E., Art. cit. p. 338.<br />
36 - Voir Lettre <strong>de</strong> Towiański<br />
aux frères français,<br />
10 septembre 1842,<br />
in : Współudział…, Op. cit,<br />
pp. 110-111.<br />
37 - Lettre <strong>de</strong> P. M. Vintras à<br />
l’abbé Antoine-Hilarion Héry,<br />
sd. (1844 ?), cité in :<br />
Appolis E., Art. cit., p. 339.<br />
38 - Ujejski K., Art. cit.,<br />
p. 412. Les italiques sont <strong>de</strong><br />
Ujejski, qui écrit ces mots en<br />
français.
et le nationalisme 39 . Paul Bénichou distingue trois gran<strong>de</strong>s tendances parmi ces<br />
nouvelles théories : le néo-catholicisme, l’utopie scientifique et l’humanitarisme.<br />
C’est dans cette <strong>de</strong>rnière catégorie que s’inscrit l’action <strong>de</strong> Towiański.<br />
Est « humanitaire » en ce temps-là tout ce qui pose comme valeur suprême<br />
l’accomplissement final du genre humain ; le sens ne s’est appauvri que plus tard,<br />
se réduisant au pis-aller d’une sensibilité charitable, quand le grand rêve a paru<br />
plus incertain. En attendant, le spiritualisme humanitaire, en tant que<br />
philosophie <strong>de</strong>s <strong>de</strong>stinées <strong>de</strong> l’espèce, établit la collectivité humaine à un<br />
niveau d’existence pour ainsi dire mystique, analogue au moins à celui où<br />
se situait Israël dans l’ancienne Loi, et l’Église dans la nouvelle : le Corps,<br />
revêtu d’une dignité spirituelle propre, transcen<strong>de</strong> les membres. 40<br />
Cette conception <strong>de</strong> l’humanité reflète la finalité que Towiański lui<br />
impute. Le caractère chrétien <strong>de</strong> son action ne le place pas dans la<br />
catégorie du néo-catholicisme, phénomène très français, dans le sens où<br />
celui-ci cherchait à adapter l’Église institutionnalisée à la société<br />
contemporaine, à l’établir dans le hic et nunc du mon<strong>de</strong> nouveau. Le<br />
Maître se borne à envisager le futur. Si sa conception <strong>de</strong> l’humanité ne<br />
se distingue pas par son originalité, sa conception du futur peut elle<br />
aussi être considérée comme banale : l’association assez paradoxale <strong>de</strong><br />
son inéluctabilité et <strong>de</strong> la lutte à mener pour le construire était<br />
fortement répandue dans la première moitié du XIX e siècle 41 . Il en va <strong>de</strong><br />
même en ce qui concerne Napoléon : en s’adonnant au mythe du grand<br />
homme, « Towiański rentre une fois <strong>de</strong> plus dans la ligne traditionnelle<br />
du mysticisme européen » 42 , conclut Henri Desmettres. Le towianisme<br />
s’inscrit donc dans une logique théosophique européenne 43 ,<br />
principalement celle qui s’établit sous la monarchie <strong>de</strong> Juillet, véritable<br />
vivier <strong>de</strong> théories <strong>de</strong> la régénération sociétale 44 . Ces théories ont<br />
maintes fois été décrites 45 , nous ne nous y attar<strong>de</strong>rons pas ; il nous<br />
paraît toutefois important <strong>de</strong> nous arrêter sur la typologie <strong>de</strong>s<br />
« nouvelles religions romantiques » françaises déterminée par Frank<br />
Paul Bowman. Il décrit leurs similitu<strong>de</strong>s comme suit :<br />
Théories apocalyptiques, messianisme souvent féministe ou androgyne,<br />
analyse mystique du langage et <strong>de</strong> l’étymologie, conception<br />
émanationiste <strong>de</strong> la création, rêve <strong>de</strong> promouvoir une nouvelle unité-<br />
fraternité, prétention <strong>de</strong> retourner à une certaine simplicité primitive du<br />
culte et <strong>de</strong> la doctrine. 46<br />
Towiański ne s’inscrit dans cette typologique que par les termes<br />
définissant le renouvellement <strong>de</strong> la religiosité sur le plan éthique. Il n’y a<br />
point d’élucubration étymologique chez Towiański, ni <strong>de</strong> redéfinition <strong>de</strong><br />
Dieu (il reste le Dieu <strong>de</strong>s chrétiens, et non un con<strong>de</strong>nsé <strong>de</strong> « principes »<br />
divers), les visions qu’il eut furent très peu nombreuses (les rêves sont<br />
[71]<br />
39 - Nous nous rapportons<br />
à l’ouvrage <strong>de</strong> René<br />
Rémond, Le XIX e siècle<br />
(1815-1914). Introduction<br />
à l’histoire <strong>de</strong> notre temps -<br />
2, Le Seuil, coll. « Point<br />
histoire », Paris, 1974,<br />
252 p.<br />
40 - Bénichou P., Op. cit.,<br />
p. 383.<br />
41 - Minois G., Histoire <strong>de</strong><br />
l’avenir (Des Prophètes à la<br />
prospective), Fayard, Paris,<br />
1996, p. 456.<br />
42 - Desmettre H.,<br />
Towiański et le<br />
messianisme polonais,<br />
t. 1 : Histoire et critique<br />
<strong>de</strong>s aspects philosophiques<br />
et théologiques du<br />
Messianisme polonais <strong>de</strong><br />
1800 à 1850, Thèse <strong>de</strong><br />
doctorat présentée à la<br />
Faculté <strong>de</strong> Théologie <strong>de</strong><br />
Lille, 1947, p. 263.<br />
43 - Dont les éléments<br />
constitutifs étaient issus, le<br />
plus souvent, <strong>de</strong>s théories<br />
<strong>de</strong> Jacob Bœhme (1575-<br />
1624), d’Emanuel<br />
Swe<strong>de</strong>nborg (1688-1772)<br />
et <strong>de</strong> Louis-Clau<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Saint-Martin (1743-1803)<br />
qui étaient propagées à<br />
travers toute l’Europe<br />
principalement par les<br />
loges maçonniques.<br />
44 - Voir Winocq M., Les<br />
voix <strong>de</strong> la liberté. Les<br />
écrivains engagés au XIX e<br />
siècle, Seuil, Paris, 2001,<br />
p. 132.<br />
45 - Voir Karr A., Les<br />
Guêpes, 4 t., 1853 ;<br />
Erdan A., La France<br />
mystique. Tableau <strong>de</strong>s<br />
exentricités religieuses <strong>de</strong><br />
ce temps, 2 t., 1858. Voir<br />
également, plus<br />
récemment, les travaux<br />
d’Auguste Viatte, d’Henri<br />
Desroche et <strong>de</strong> Frank Paul<br />
Bowman.<br />
46 - Bowman F. P., « Une<br />
lecture politique <strong>de</strong> la folie<br />
religieuse ou<br />
“théomanie” », in :<br />
« ROMANTISME PARIS »,<br />
vol. 9, n° 24, 1979, pp. 75-<br />
76.
eaucoup plus importants chez lui que les apparitions) et les artifices extrêmement<br />
réduits (les gestes cultuels catholiques étaient respectés, tout comme les<br />
sacrements). En comparaison avec les phénomènes théosophiques français, le<br />
towianisme est bien pâle en termes <strong>de</strong> « folie religieuse » (<strong>de</strong> « théomanie », pour<br />
reprendre l’expression <strong>de</strong> Bowman). Son initiateur était moins un « aliéné » qu’un<br />
« ascète intramondain » 47 borné, un homme qui vivait <strong>de</strong> manière maximaliste la foi<br />
qui l’animait dans le mon<strong>de</strong> qui l’accueillait. Ce qui explique que Mickiewicz ait cru<br />
- ou placé ses espérances, comme on voudra - en lui. La disparité entre l’éthique<br />
towianiste et la légen<strong>de</strong> noire qui l’entoure est immense. Celle-ci ne viendrait donc<br />
pas <strong>de</strong> celle-là, mais <strong>de</strong> la mythification <strong>de</strong> sujets tels que Mickiewicz et la Gran<strong>de</strong><br />
Émigration, symboles d’espoir et <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur que Towiański aurait, selon une<br />
historiographie vivace, incommensurablement salis.<br />
Conclusion<br />
La France joue un rôle essentiel dans le développement <strong>de</strong>s courants d’idées<br />
européens durant la première partie du XIX e siècle. Elle était presque une<br />
<strong>de</strong>stination obligée pour qui voulait s’adresser à l’Europe. C’est ce qu’avait très bien<br />
compris Towiański qui, à la fin <strong>de</strong> l’année 1843, insista auprès <strong>de</strong> Mickiewicz pour<br />
que celui-ci propage « l’Œuvre <strong>de</strong> Dieu » du haut <strong>de</strong> la Chaire <strong>de</strong> Littérature slave<br />
dont il était le titulaire au Collège <strong>de</strong> France. À cette époque, Towiański ne<br />
s’occupait déjà plus tant <strong>de</strong> la France, qu’il avait reléguée, comme Israël, au rang<br />
<strong>de</strong> nation privilégiée - l’action <strong>de</strong> ces nations avait déjà commencé (il existait un<br />
Cercle français à Paris et il avait quelques disciples juifs ou convertis qui<br />
propageaient ses théories). Elles n’avaient donc plus ses faveurs quasi exclusives.<br />
C’étaient <strong>de</strong> nouveau les Slaves qui attiraient son attention, et principalement la<br />
Russie. Il pressa Mickiewicz et ses a<strong>de</strong>ptes <strong>de</strong> le suivre en ce sens, ce qui provoqua<br />
l’hostilité à leur égard <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s Émigrés, qui considéraient exclusivement la<br />
Russie sur un plan politique et non comme une pièce du mystérieux jeu divin. Les<br />
Polonais virent ainsi en la lettre <strong>de</strong>s towianistes à l’empereur russe Nicolas I er<br />
(15 août 1844) une véritable insulte. Au Collège <strong>de</strong> France, Mickiewicz, proclamant<br />
ses idées concernant Napoléon, les Slaves et la Russie, exposa<br />
également les principes du towianisme. Ce qui lui valut d’être limogé. Il<br />
se consacra alors presque exclusivement à la direction d’un Cercle<br />
tourné sur lui-même, s’opposant <strong>de</strong> manière nette à une majorité<br />
d’Émigrés hostiles à son action. Et ce jusqu’en 1847, année où<br />
Mickiewicz délaissa les sirènes <strong>de</strong> la théosophie et du travail spirituel<br />
pour suivre celles du socialisme et <strong>de</strong> l’action directe. Towiański, entouré<br />
<strong>de</strong> quelques a<strong>de</strong>ptes qui n’avaient pas pris le virage socialiste, continua<br />
son action en Suisse, focalisant son attention sur le développement<br />
spirituel personnel et le rôle <strong>de</strong>s Slaves dans la régénération <strong>de</strong><br />
[72]<br />
47 - « “L’ascète<br />
intramondain” est un<br />
rationaliste, aussi bien en<br />
ce sens qu’il systématise<br />
rationnellement sa propre<br />
conduite <strong>de</strong> vie, qu’en ce<br />
sens qu’il refuse tout ce<br />
qui, dans le mon<strong>de</strong> et ses<br />
ordres, est éthiquement<br />
irrationnel. »,<br />
dans : Weber M., « Les<br />
voies du salut-délivrance et<br />
leur influence sur la<br />
conduite <strong>de</strong> vie », in :<br />
Sociologie <strong>de</strong>s religions<br />
(textes réunis, traduits et<br />
présentés par Jean-Pierre<br />
Grossein), Gallimard, coll.<br />
« TEL », Paris, 1996. Texte<br />
originellement placé dans le<br />
volume Économie et société<br />
(1910-1913).
l’humanité, idées qu’il répéta notamment dans son texte programmatique « Powody<br />
dla których amnestya przyjęta być nie może przedstawione przez część emigracyi<br />
polskiéj jego Cesarskiéj Mości Alexandrowi II » (Raisons pour lesquelles l’amnistie<br />
ne peut être acceptée, présentées par une partie <strong>de</strong> l’émigration polonaise à sa<br />
majesté impériale Alexandre II) le 27 décembre 1856 48 .<br />
Towiański était venu en France parce que les Émigrés s’y trouvaient et que le<br />
gouvernement français les laissait s’exprimer avec bien plus <strong>de</strong> liberté que s’ils<br />
étaient restés en Russie. Car c’est principalement en France que la culture polonaise<br />
se développait. La vision téléologique qu’avait le Maître <strong>de</strong>s événements politiques<br />
l’avait poussé à théoriser sur le rôle <strong>de</strong> la France dans la régénération <strong>de</strong> l’humanité<br />
et, par ce biais, l’avait intégré dans « l’Œuvre <strong>de</strong> Dieu ». Ces idées furent<br />
confirmées à ses yeux par l’arrivée provi<strong>de</strong>ntielle <strong>de</strong> quelques Français qui<br />
choisirent <strong>de</strong> suivre ses théories plutôt que celles <strong>de</strong> leur premier maître à penser.<br />
La concordance <strong>de</strong> ces cristallisations (théoriques et pratiques) le confirma dans sa<br />
mission. À un point tel qu’il décida d’en avertir le pape : c’est le but <strong>de</strong> son voyage<br />
à Rome d’août à octobre 1843. L’insuccès <strong>de</strong> cette expédition le fit se diriger vers la<br />
Suisse où il s’installa définitivement. Et c’est <strong>de</strong> cette Suisse, qu’il revint à sa<br />
théorisation sur les Slaves. En somme, sa certitu<strong>de</strong>, acquise par la France, <strong>de</strong> suivre<br />
la bonne direction le fit s’éloigner <strong>de</strong> ses a<strong>de</strong>ptes, ceux qu’il avait personnellement<br />
choisis, en France, pour continuer son œuvre. Il laissa Mickiewicz diriger le Cercle<br />
tandis que lui, focalisé sur une théorie qu’il savait <strong>de</strong>voir dorénavant porter seul,<br />
sans l’ai<strong>de</strong> d’une Église définitivement laissée <strong>de</strong> côté, s’isolait dans une<br />
conceptualisation dégagée <strong>de</strong> tout support pratique, humain. Towiański et ses<br />
Jeremy LAMBERT est<br />
doctorant en Langues et<br />
Littératures Slaves,<br />
membre du Centre d’Étu<strong>de</strong>s<br />
en Civilisations, Littératures<br />
et Lettres Étrangères<br />
(CECILLE) <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong><br />
Charles-<strong>de</strong>-Gaulle Lille3<br />
a<strong>de</strong>ptes ne vécurent plus dans le même contexte à<br />
partir <strong>de</strong> cette époque, ce qui les éloigna<br />
mutuellement. Le Lituanien résidait loin <strong>de</strong> Paris, la<br />
France n’avait déjà plus le même attrait. Et le Cercle,<br />
en France, s’éloigna <strong>de</strong> lui.<br />
[73]<br />
48 - Towiański A.,<br />
Powody…, W drukarni<br />
L. Martinet, Paris, 1857,<br />
32 p. Nous faisons<br />
référence à ce texte car<br />
Towiański lui-même le cite<br />
souvent après 1857, ce qui<br />
en fait un texte <strong>de</strong><br />
référence.
Traduction<br />
Nataša Džigurski-Dubajić
Présentation :<br />
Lorsqu’en 1968 Slobodan Selenić (1933-1995) publie son roman, Memoari<br />
Pere Bogalja (Mémoires <strong>de</strong> Pera l'infirme), il est déjà connu en tant que critique <strong>de</strong><br />
théâtre et journaliste. Dans ce premier roman, Selenić annonce ses grands thèmes,<br />
ses obsessions que l’on retrouvera dans les œuvres qui suivront. Comme tout<br />
écrivain « obsessionnel », il ne changera jamais <strong>de</strong> registre. Sa plume apportera à<br />
la littérature serbe <strong>de</strong>s romans poignants du réalisme critique, une triste saga sur le<br />
déclin <strong>de</strong> la bourgeoisie sous le poids <strong>de</strong> la révolution bolchevique.<br />
Dans tous les romans <strong>de</strong> Selenić, les circonstances historiques ont une<br />
influence déterminante sur le caractère <strong>de</strong>s idées, sur le développement <strong>de</strong> l’action<br />
et sur le <strong>de</strong>stin <strong>de</strong>s personnages car ils sont tous, sans exception, réalisés en tant<br />
qu’objets avec lesquels joue l’Histoire, <strong>de</strong> simples objets passifs nécessaires à la<br />
construction <strong>de</strong> ce refrain sur l’incapacité <strong>de</strong> l’homme à agir contre l’invasion<br />
d’idéologies désolatrices. Selenić est un écrivain qui possè<strong>de</strong> une conscience critique<br />
historique aiguë mais aussi une profon<strong>de</strong> compréhension du caractère dramatique<br />
<strong>de</strong>s changements <strong>de</strong> la morale au sein d’une société chamboulée par un<br />
enchaînement <strong>de</strong> faits historiques. D’une oeuvre à l’autre, il approfondit la question<br />
cruciale <strong>de</strong> l'intégrité morale <strong>de</strong> l’homme mo<strong>de</strong>rne sur les décombres <strong>de</strong> l’Histoire.<br />
En d’autres termes, l’auteur dépeint un drame <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> la civilisation<br />
actuelle, une conscience chargée d'actes contradictoires par un abandon trop facile<br />
à la violence aveugle qui s’est libérée au cours <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier siècle.<br />
Le mon<strong>de</strong> qu’il décrit est né <strong>de</strong> la collision entre la bourgeoisie serbe <strong>de</strong><br />
l’entre-<strong>de</strong>ux-guerres, qui n’a pas eu le temps <strong>de</strong> prendre racine, et d’une nouvelle<br />
classe, faite <strong>de</strong> révolutionnaires montagnards qui subira pourtant <strong>de</strong>s<br />
transformations en acceptant les bienfaits et les privilèges accordés aux vainqueurs<br />
et <strong>de</strong>viendra en quelques années ce que l'on appelle la « bourgeoisie rouge ». C’est<br />
<strong>de</strong> ce contact entre <strong>de</strong>ux cultures, <strong>de</strong>ux civilisations, <strong>de</strong>ux mentalités incompatibles<br />
que découlent pratiquement tous les thèmes obsessionnels <strong>de</strong> Selenić.<br />
C’est l’Histoire qui détermine le <strong>de</strong>stin <strong>de</strong>s personnages <strong>de</strong> Selenić, toujours<br />
tragique. La vérité objective est selon toute apparence une notion qui préoccupe<br />
l’auteur. Il n’a jamais prôné une vérité unique. C’est pour cela que dans ses<br />
romans, il confronte <strong>de</strong>s vérités individuelles. Le roman est, d’après l’auteur, le<br />
moyen parfait <strong>de</strong> donner forme à un système d’idées à travers <strong>de</strong>s personnages<br />
concrets.<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la (Outrage au peuple en <strong>de</strong>ux parties) est une pièce<br />
<strong>de</strong> théâtre et par conséquent une forme d’expression brève. Néanmoins, elle<br />
présente l’avantage <strong>de</strong> mettre en scène pratiquement tous les questionnements <strong>de</strong><br />
Selenić. Il s’agit d’une sorte <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong> toute sa poétique.<br />
La pièce a été écrite à une époque durant laquelle elle ne pouvait que se<br />
heurter au rejet. En cette fin <strong>de</strong>s années 1980, les nationalismes, sommeillant<br />
<strong>de</strong>puis longtemps, atteignaient leur apogée avant <strong>de</strong> se libérer dans la violence lors<br />
<strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière décennie du XX e siècle.<br />
Nataša Džigurski-Dubajić est lectrice <strong>de</strong> serbo-croate à l’<strong>Université</strong><br />
Charles-<strong>de</strong>-Gaulle Lille3 (Villeneuve d’Ascq, France).<br />
[91]
Traduction :<br />
(...)<br />
VI (Partie 1)<br />
Slobodan Selenić<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la<br />
Outrage au peuple en <strong>de</strong>ux parties<br />
(Extraits)<br />
----------<br />
Cellule numéro sept. Tous les prisonniers sont réunis<br />
[92]<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la, <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
Traduction d’extraits par Nataša Džigurski-Dubajić<br />
Jezdimir : Tu dis, Stevan, le 22 novembre 1* ? À Florence ? Je ne connaissais pas<br />
cette date jusqu’à ce jour. Puis le 1 er décembre 2 ! Un grand jour, terrible, pour les<br />
Serbes. Puis le 20 juin 3 … Eh, si seulement on avait d'autres Puniša<br />
Stevan : Et si seulement le 29 décembre 4 avait été accueilli comme il se doit.<br />
Obrad : Puis le 9 octobre 5 …<br />
Jezdimir : Comment sais-tu, toi, pour le 9 octobre, puisque tu n’étais même pas né<br />
alors…<br />
Obrad : J’étais né. Je suis venu au mon<strong>de</strong> et j'ai pleuré à chau<strong>de</strong>s larmes avec le<br />
peuple.<br />
Stevan : Puis la catastrophe, le 26 août 6 !<br />
Jezdimir : Puis la <strong>de</strong>uxième catastrophe, le 17 avril 7 ! Mais vient l’aube du 10 mai 8<br />
1941 !<br />
Stevan : Puis le 19 septembre à Struganik 9 , puis le 26 octobre à Brajić 10 ,<br />
finalement, le 2 novembre 11 près <strong>de</strong> Užice – le torchon brûle !<br />
Jezdimir : Ensuite le 12 septembre 12 noir du roi, espèce <strong>de</strong> mollasson au cul<br />
malpropre !<br />
Le pope Sava : Ne dites pas ça, mes enfants, il est comme il est, c’est notre roi<br />
tout <strong>de</strong> même !<br />
Stevan : Dites donc, le 7 août 13 à Rome a été pire. De la ville papale, jamais les<br />
bonnes nouvelles ne nous parvenaient, à nous autres Serbes !<br />
Čapajev : Hé, n’est-ce pas le jour où le camara<strong>de</strong> Maréchal a rencontré Alexan<strong>de</strong>r ?<br />
(Ils ne répon<strong>de</strong>nt pas, ils rient) Pour sûr qu’il a été noir pour vous !<br />
Stevan : Ça a été démontré, c’était clair comme <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong> roche : les plus grands<br />
ennemis <strong>de</strong>s Serbes sont les Anglais.<br />
Le pope Sava : C’est exact, mon fils, ils ne se soucient pas du Serbe, ils nous ont<br />
laissé sur le sable, mais ce ne sont pas les pires. Pour un Serbe, les pires tyrans,<br />
sans Dieu ni foi, ce sont les communistes russes.<br />
Obrad : Et les Turcs ?<br />
Jezdimir : On se fout <strong>de</strong>s Turcs ! Leur temps est révolu.<br />
Obrad : Tu parles ! Et nos Turcs 14 à nous ?<br />
Jezdimir : Eux, je ne dis pas, ce sont <strong>de</strong>s tyrans. Ils nous détestent tout<br />
autant.<br />
* - Étant donné le grand<br />
nombre <strong>de</strong> notes, celles-ci<br />
ont été placées après le<br />
texte. (NdlR)
Stevan : Et vous, qu’en dites-vous, Slavoljub ?<br />
[93]<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la, <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
Traduction d’extraits par Nataša Džigurski-Dubajić<br />
Slavoljub : Je ne sais pas. Personne ne mentionne les Magyars 15 , alors qu’ils en ont<br />
égorgé tant <strong>de</strong>s nôtres partout en Bačka 16 . Ici, en Serbie, ça ne compte pas. Nous<br />
n’avons <strong>de</strong> cesse <strong>de</strong> ressasser nos propres griefs, mais c’est peut-être le Magyar qui<br />
méprise le plus le Serbe.<br />
Stevan : Il le méprise peut-être, mais il ne le déteste pas autant que ne le fait<br />
l’Albanais.<br />
Obrad : Le Bulgare nous déteste encore plus.<br />
Čapajev : Ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> connards <strong>de</strong> tchetniks, et les Allemands, les Italiens, ils ne<br />
vous viennent pas à l’esprit !?<br />
Stevan : Ça, ça va <strong>de</strong> soi. Mais calcule bien, Čapajev, combien <strong>de</strong> Serbes ont été<br />
tués par les Allemands et les Italiens réunis, et puis regar<strong>de</strong> les Croates, combien<br />
en ont-ils massacrés. C’est le Croate, le pire ennemi <strong>de</strong>s Serbes.<br />
Jezdimir : Qu’ils aillent au diable ! Comme ennemi, suppôt <strong>de</strong> Satan, il n’y en a pas<br />
<strong>de</strong> pire. Sais-tu ce qu’il dit ce Croate, cette espèce <strong>de</strong> prêtre défroqué, celui qui a<br />
été curé catholique et qui a fini tchetnik… ?<br />
Le pope Sava : Vilović.<br />
Jezdimir : Voilà, lui. Il dit : Les Croates n’existent même pas. Ceux qui utilisent le<br />
dialecte kajkavien 17 , ce sont les Slovènes ; ceux qui utilisent le štokavien 18 sont <strong>de</strong>s<br />
Serbes venus <strong>de</strong> Bosnie en Dalmatie. Ce n’est même pas un peuple, qu’il aille se<br />
faire foutre, celui qui les a engendrés et qui les a dressés contre nous !<br />
Stevan : Attends, voïvo<strong>de</strong>, s’ils n’existent donc pas, qui nous égorgeait alors ?<br />
Čapajev (il rit) : Les Serbes štokaviens et les Slovènes kajkaviens !<br />
Jezdimir : Qu’est-ce que t’as à glousser comme ça, abruti ! De toute façon, ce sont<br />
<strong>de</strong>s renégats.<br />
Obrad : Non mais, toutes les conditions ont été réunies pour anéantir les Serbes<br />
jusqu’au <strong>de</strong>rnier ! Pour sûr, le Serbe est venu au mon<strong>de</strong> pour être la tête <strong>de</strong> Turc <strong>de</strong><br />
tous.<br />
Jezdimir : Allez, Obrad. Le chapelet serbe. Donne-moi dans l’ordre toutes les villes,<br />
sans oublier le moindre petit lieu.<br />
Obrad : Je commence à partir <strong>de</strong> Split ou <strong>de</strong> la Slovénie ?<br />
Jezdimir : Vas-y, <strong>de</strong> la Slovénie.<br />
Obrad : Banja Loka, Srpske Moravice...<br />
Jezdimir : Srpske Moravice, l’étoile <strong>de</strong> mer...<br />
Obrad : Vojnić, Vrgin most, Dubica...<br />
Jezdimir : Vrgin mos, Srpska kos.<br />
Obrad : Novska, Pakrac, Gradiška, Srbac...<br />
Jezdimir : Serbe, Srbac, du serbe, les Serbes…<br />
Obrad : Prnjavor, Popovići, Gračanica…<br />
Jezdimir : Gračanica, à l'image <strong>de</strong>s Serbes, ton prochain est <strong>de</strong> la ville d’Užice…<br />
Obrad : Čelić, Koraj, Zagoni…<br />
Jezdimir : Et, voilà…<br />
Obrad : Sremska Rača, Irig, Ruma…
[94]<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la, <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
Traduction d’extraits par Nataša Džigurski-Dubajić<br />
Jezdimir : … Tout en traversant le territoire du peuple serbe, tu es arrivé, mon<br />
Obrad, <strong>de</strong> Slovénie jusqu’à la fière ville <strong>de</strong> Šabac ! Le chapelet serbe, mon cœur<br />
s’en réjouit, nos héros serbes ! Allez, Stevan, je te le <strong>de</strong>man<strong>de</strong> comme à un frère,<br />
déclame ton Shakespeare. Pas un mot, vous autres ! Solennellement ! Je ne veux<br />
pas entendre une seule mouche voler !<br />
Stevan : « You blocks, you stones, you worse than senseless things !<br />
O you hard hearts, you cruel men of Rome,<br />
Knew you not Pompey? Many a time and oft<br />
Have you climb’d up to walls and battlements,<br />
To towers and windows, yea, to chimney-tops,<br />
Your infants in your arms, and there have sat<br />
The livelong day, with patient expectation,<br />
To see great Pompey pass the streets of Rome... » 19<br />
(…)<br />
VIII (Partie 1)<br />
Miloš dans le divan, à Kragujevac, en juin 1817. Arrive Vujica Vulićević.<br />
Vujica : Monseigneur, une missive <strong>de</strong> Karageorges.<br />
Miloš : Que dit-il ?<br />
Vujica : Il te salue, il invoque votre parenté.<br />
Miloš : Qu’est-ce que tu as à tourner autour du pot, là ? Passe !<br />
Vujica : Il est en colère, qu’il dit, car tu as assassiné ses voïvo<strong>de</strong>s.<br />
Miloš : Les voïvo<strong>de</strong>s ! De la fiente, pas <strong>de</strong>s voïvo<strong>de</strong>s !<br />
Vujica : Le Voïvo<strong>de</strong> Moler 20 …<br />
Miloš : Le bouffon autrichien, dilapidateur <strong>de</strong> l'argent du peuple ! Et puis, ce n’est<br />
pas moi qui l’ai tué, c’est le vizir qui l’a étranglé.<br />
Vujica : Le Voïvo<strong>de</strong> Pavle Cukić…<br />
Miloš : Cet agitateur et ce mamelouk ! Eh, ma foi, il a perdu la vue à force <strong>de</strong><br />
reluquer le con. Que veux-tu que je fasse d’un voïvo<strong>de</strong> bigleux ?<br />
Vujica : Le Capitaine Radič Petrović 21 …<br />
Miloš (d’un ton ironique) : Dieu l’a voulu. Ainsi, j’ai fait <strong>de</strong> lui un martyr !<br />
Vujica : L’Evêque Milentije Nikšić…<br />
Miloš : Ce n’est pas moi qui l’ai tué, Vujica, mais toi, enfant <strong>de</strong> catin !<br />
Vujica : Il est surtout en colère, qu’il dit, car tu as tué le prince Sima Marković !<br />
Miloš : Ce mollasson <strong>de</strong> Sima ! Il a soulevé une armée contre moi, fichtre ! Moi, je<br />
tuais pour épargner au peuple une plus gran<strong>de</strong> tuerie, pour obliger ces petits<br />
péteux à faire la paix avec les Turcs ! Et Karageorges, maudit soit-il, il vaudrait<br />
autant avoir affaire à un Turc. Il a tué son propre père d’une balle dans le front, à<br />
Crvena Jaruga ! Passons. Que dit-il d'autre ?<br />
Vujica : Il dit qu’il a l’intention <strong>de</strong> venir en Serbie et, avec ton ai<strong>de</strong>, <strong>de</strong> fomenter<br />
une nouvelle insurrection contre les Turcs.<br />
(Miloš bondit du divan. D'un signe <strong>de</strong> main, il ordonne à Vujica <strong>de</strong> se taire. Il<br />
arpente la pièce, perdu dans ses pensées.)
[95]<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la, <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
Traduction d’extraits par Nataša Džigurski-Dubajić<br />
Miloš : Et <strong>de</strong>s Russes ? Que dit-il ? Le Tsar va-t-il entrer en guerre contre la<br />
Turquie à ce moment-là ?<br />
Vujica : Pas tout <strong>de</strong> suite, qu’il dit, mais Philiki Hétaïrie 22 nous épaulera. En même<br />
temps que nous, ici, les Grecs se soulèveront en Hella<strong>de</strong> 23 .<br />
Miloš : Mon cul ! Les Grecs ! Nous ne pouvons pas battre la Turquie sans l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
la Russie. Nous pouvons seulement tous périr inutilement, comme jadis, en 1813,<br />
sous leurs ordres. Dis-lui qu’il reste où il est. Et moi, ma foi, comme je l’ai toujours<br />
fait, je monnaierai, pour le peuple, la paix avec les Turcs, avec Marachli Ali-pacha et<br />
Istanbul.<br />
Vujica : Il dit que c’est une honte.<br />
Miloš : Qu’est-ce qui est honteux ?<br />
Vujica : Eh bien, tout ça, avec les Turcs, les tyrans. Et il est honteux <strong>de</strong> porter le<br />
turban, comme tu le fais.<br />
Miloš (arrache la lettre <strong>de</strong>s mains <strong>de</strong> Vujica et la déchire) : Qu’il aille au diable,<br />
comment ose-t-il me parler <strong>de</strong> la sorte ! Il voudrait que les Turcs égorgent nos<br />
enfants et nous exterminent jusqu'au <strong>de</strong>rnier ? Cent têtes serbes orthodoxes contre<br />
une seule tête turque ! Comment a-t-il pu si vite oublier ce qui s’est passé en 1813,<br />
que les vautours lui arrachent le cœur ! Une fois <strong>de</strong> plus, et il ne restera ni Serbes<br />
ni Serbie. Et pour quelle satanée raison ? Pour que Karageorges gouverne la<br />
Serbie ! Le peuple ou Karageorges, qu’en dis-tu, Vujica, qui alors vaut-il mieux<br />
sacrifier ? Devons-nous tous périr ou lui seul ? (Il se calme brusquement, d’une voix<br />
basse) Sais-tu, Vujica Vulićević, qui est mon pire ennemi ?<br />
Vujica : Je le sais, monseigneur.<br />
Miloš : Dis-le.<br />
Vujica : Lui.<br />
Miloš : C’est ça, Vujica. Ce n’est pas le Turc qui m’inquiète, Vujica. Avec<br />
Karageorges, la cause <strong>de</strong> mes tourments, je ne sais que faire, Vujica.<br />
(...)<br />
XIX (Partie 2)<br />
Stevan et Slavoljub font la corvée <strong>de</strong> tinette. Ils prennent une tinette en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong><br />
la scène, renversent son contenu dans un coin et la rapportent vi<strong>de</strong>. A voir leur<br />
visage grimaçant <strong>de</strong> dégoût, nous comprenons que ça sent mauvais, mais ils n’en<br />
parlent pas.<br />
Stevan : Friends, Romans, countrymen, lend me your ears ! 24<br />
Slavoljub : Vous en connaissez déjà la moitié ?<br />
Stevan : Eh bien, oui, certains passages. Comme Uča connaît le « soulèvement<br />
contre les Dahis ».<br />
Slavoljub : Pourquoi précisément Jules César ?<br />
Stevan : Eh bien, j’apprécie cette pièce, mais le choix est arbitraire. J’aurais pu<br />
commencer à apprendre par cœur n’importe quelle autre pièce. Il faut s’éva<strong>de</strong>r. On<br />
<strong>de</strong>vient follement avi<strong>de</strong> <strong>de</strong> solitu<strong>de</strong> en compagnie <strong>de</strong> gens que l’on ne supporte pas.<br />
Slavoljub : Qu’est-ce qui vous a incité à vous y mettre ?
[96]<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la, <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
Traduction d’extraits par Nataša Džigurski-Dubajić<br />
Stevan : C’était par hasard. Ça m’amusait <strong>de</strong> voir le voïvo<strong>de</strong>, qui meuglerait s’il ne<br />
parlait pas serbe, pieusement m’écouter réciter. N’auriez-vous pas quelque mégot ?<br />
Slavoljub : Je n’en ai pas, Stevan, je vous ai tout donné.<br />
Stevan : Comment avez-vous pu abandonner le tabac ? Ici ! Dans le neuvième<br />
cercle <strong>de</strong> l’enfer ?<br />
Slavoljub : Cela m’est plus facile que <strong>de</strong> compter <strong>de</strong>s moitiés <strong>de</strong> cigarettes.<br />
Stevan : Je dois vous faire part <strong>de</strong> quelque chose, Slavoljub. Je suis content <strong>de</strong><br />
vous avoir ici. C’est idiot <strong>de</strong> dire cela à quelqu’un qui est en prison, mais moi, à côté<br />
<strong>de</strong> tous ces tchetniks, avec lesquels j’ai fait la guérilla pendant tant d'années, il n’y<br />
a qu’avec vous que je trouve <strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> conversation.<br />
Slavoljub : Pourquoi vous êtes-vous joint à eux ?<br />
Stevan : Cela semble être une question logique aujourd’hui. Je faisais alors quelque<br />
chose d'inévitable. Pour ne pas perdre toute ma dignité, voilà pourquoi je les ai<br />
rejoints. C’est exactement cela, oui. Le pays est occupé, il nous faut le libérer.<br />
L’idée <strong>de</strong> rejoindre les partisans ne m’a, bien entendu, même pas effleuré l’esprit ;<br />
en revanche, Draža avait toute la légitimité : soutenu par notre gouvernement<br />
légal, les alliés, la Radio <strong>de</strong> Londres, le peuple qui a fait <strong>de</strong> lui une légen<strong>de</strong> en un<br />
rien <strong>de</strong> temps. Admettez-le, comment aurait pu agir autrement un patriote, un<br />
homme <strong>de</strong> conscience, que <strong>de</strong> rejoindre la guérilla, en cette année 1941 ? J’ai été<br />
pris <strong>de</strong> peur, j’avais conscience <strong>de</strong>s expiations qui inévitablement m’attendaient,<br />
mais je n’ai pas pu faire autrement.<br />
Slavoljub : Et lorsque les tchetniks ont ôté au peuple le goût du pain, lorsqu’ils<br />
sont <strong>de</strong>venus pour lui <strong>de</strong>s égorgeurs, <strong>de</strong>s pilleurs…<br />
Slavoljub : Mais pas Draža. Ses commandants, ses voïvo<strong>de</strong>s, certes ; mais Draža,<br />
lui, il a joui jusqu’à la fin d’une notoriété au sein du peuple. D’une juste notoriété, je<br />
crois. Il était sincèrement convaincu que le plus important était <strong>de</strong> sauver le peuple<br />
<strong>de</strong> la chimère communiste. Cela ne veut point dire qu’il n’est pas coupable <strong>de</strong><br />
l’anéantissement du mouvement tchetnik <strong>de</strong> Ravna Gora. Étant lui-même un cul-<br />
terreux d’Ivanjica, il a laissé la paysannerie engloutir le mouvement. Et la bête<br />
paysanne a rompu les barreaux.<br />
Slavoljub : C’est donc la paysannerie qui est à l’origine <strong>de</strong> tout ?<br />
Stevan : Pas tout à fait. Ce sont les Anglais qui nous ont trahis. Dragiša Vasić<br />
promettait à l’époque qu’une fois la guerre finie, il fon<strong>de</strong>rait à l’université <strong>de</strong><br />
Belgra<strong>de</strong> le département <strong>de</strong> la haine envers les Anglais. Il n’a pas eu le temps <strong>de</strong> le<br />
faire, pauvre bougre. Les Croates l’ont assassiné. En revanche, bien avant que les<br />
Anglais ne nous trahissent, j’ai été envahi par la crainte que les partisans ne<br />
s’avèrent être plus forts que nous. La faute à ces barreaux ! Votre geste <strong>de</strong> dépit<br />
n’a pas lieu d’être. C’est bien à cause d’eux ! Enten<strong>de</strong>z cela ; nous avons levé, avec<br />
les partisans, une assemblée <strong>de</strong> mobilisation à Mionica. À cette époque, nous étions<br />
encore ensemble. Après l’assemblée, le commissaire Dudić, assis à une table, inscrit<br />
ceux qui voulaient rejoindre les partisans, et à une autre table, le capitaine Lečić<br />
inscrit ceux qui voulaient rejoindre les tchetniks. Arrive alors un paysan d’un certain<br />
âge qui dit : « Je voudrais m’inscrire chez les uns et chez les autres ». « Comment<br />
ça ? », qu’ils lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt, et lui : « Pour les partisans à Paune, j’enverrai <strong>de</strong>s<br />
chaussettes et <strong>de</strong>s souliers, et pour les tchetniks à Ravna Gora, j’enverrai <strong>de</strong>s<br />
brebis et <strong>de</strong> l’argent. » Après avoir ri un instant, le capitaine Lečić dit : « Ça me va
[97]<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la, <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
Traduction d’extraits par Nataša Džigurski-Dubajić<br />
comme ça ! » ; et Dudić fit sèchement : « Nous ne voulons ni <strong>de</strong> toi, ni <strong>de</strong> tes<br />
souliers ! Va-t’en chez eux !»<br />
Slavoljub : Vous voulez dire que les partisans ont gagné grâce au caractère<br />
exclusif du mouvement ?<br />
Stevan : Ils ont gagné parce qu’ils ont su gar<strong>de</strong>r <strong>de</strong>rrière les barreaux notre pègre<br />
paysanne : la poigne <strong>de</strong> fer <strong>de</strong> l’élite dirigeante communiste ou les barreaux<br />
horizontaux ; la promesse faite à cette ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> voyous qu’elle atteindrait le<br />
paradis sans classes ou les barreaux verticaux. Nos animosités étaient parfois<br />
vengeresses, mais souvent pillar<strong>de</strong>s, à <strong>de</strong>s fins personnelles. Les leurs, par<br />
définition, à quelques nuances près, avaient un caractère religieux, fanatique. Aussi<br />
cruels soient-ils, les crimes fanatiques se justifient par une prétendue cause<br />
supérieure. Et c’est par le biais <strong>de</strong> cette cause supérieure que les communistes ont<br />
brisé la raison <strong>de</strong> la foule. Dans le mouvement tchetnik, c’est la foule qui a eu<br />
raison <strong>de</strong> nous. Et croyez-moi, on comptait parmi nous <strong>de</strong>s hommes enthousiastes,<br />
purs, intelligents. Au début nous étions nombreux, puis <strong>de</strong> moins en moins. À la fin,<br />
nous n’avions plus <strong>de</strong> raison d’être. Un tchetnik, c’est ce paysan serbe qui a brisé<br />
lesdits barreaux, plein <strong>de</strong> haine envers la ville, la bourgeoisie, la culture, et qui fait<br />
fi <strong>de</strong> toute valeur sacrée dans une époque <strong>de</strong> violences irrépréhensibles. Il l’a<br />
emporté sur nous. La foule ignorante nous a engloutis, c’est ce que je veux dire. Je<br />
me suis mis à haïr, Slavoljub, non pas les tchetniks, non pas les partisans, mais le<br />
peuple. Les Serbes. À dire vrai, le peuple ne me supporte pas non plus. Il flaire tout<br />
<strong>de</strong> suite que je ne suis pas un <strong>de</strong>s leurs.<br />
Slavoljub : Qu’était votre grand-père ?<br />
Stevan : Le peuple.<br />
Slavoljub : Et votre père, votre mère, vos oncles paternels et maternels ?<br />
Stevan : Tous, jusqu’au <strong>de</strong>rnier, <strong>de</strong>s paysans.<br />
Slavoljub : Le peuple, Stevan, ce n’est pas un tramway dans lequel l’on monte ou<br />
l’on <strong>de</strong>scend selon nos désirs. Que vous le vouliez ou non, vous aussi, vous êtes<br />
partie intégrante <strong>de</strong> ce peuple. C’est orgueilleux et inexact, ce que vous dites. Notre<br />
peuple, tout furieux et tout déchaîné qu’il est, a, pour être tout à fait honnête, fait<br />
montre dans cette guerre d’une énergie fratrici<strong>de</strong> inouïe, mais aussi <strong>de</strong> patriotisme,<br />
Stevan, d’endurance. Votre rage à l’égard du peuple est superficielle et imprégnée<br />
<strong>de</strong> snobisme. Ce même peuple, que vous invectivez tant, a tout <strong>de</strong> même réussi, en<br />
l’espace d’une petite centaine d’années, à sortir <strong>de</strong> l’obscurité orientale épaisse et à<br />
entrer en Europe.<br />
Stevan : Avec tout le respect que je vous dois, la question <strong>de</strong> l’Europe n’a pas lieu<br />
d’être soulevée. Ce même peuple, le vôtre et le mien, ce peuple sauvage, aux<br />
mœurs orientales, n’est en Europe que géographiquement. Il est prêt à subir toute<br />
humiliation, puis il <strong>de</strong>vient irrespectueux, assoiffé <strong>de</strong> sang dès qu’il met le grappin<br />
sur la moindre parcelle <strong>de</strong> pouvoir. Le pouvoir, dans la vision serbe, consiste en<br />
effet à avoir le droit d’empaler son voisin, sans raison aucune, juste pour que l’on<br />
sache qui a le pouvoir. Regar<strong>de</strong>z le voïvo<strong>de</strong> ! Tuer tout ce qu’il y a <strong>de</strong> lettré à<br />
Toplica ! Afrikaner ! Regar<strong>de</strong>z Čapajev ! Il coupe les oreilles, il pille, il fait arrêter<br />
d’innocents maris pour pouvoir chevaucher leurs femmes puis, finalement, il se fait<br />
arrêter parce qu’il traitait la direction <strong>de</strong> tous les noms sous l’emprise <strong>de</strong> l’alcool.<br />
Voyez-vous à quel point lui et le voïvo<strong>de</strong> se ressemblent ? Et pas seulement parce
[98]<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la, <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
Traduction d’extraits par Nataša Džigurski-Dubajić<br />
qu’ils viennent <strong>de</strong> villages voisins ! Pourquoi donc nous plaignons-nous ? Ces<br />
sauvages, qu’ils soient tchetniks ou partisans, représentent quelque chose qui nous<br />
revient.<br />
Slavoljub : Fâchez-vous tant qu’il vous plaira, mais je dois vous le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r :<br />
n’êtes-vous pas en train <strong>de</strong> justifier une certaine…<br />
Stevan : … déchéance. Ne vous gênez pas…<br />
Slavoljub : … disons, une certaine nonchalance morale, par l’inexistence d’un ordre<br />
moral au sein du peuple ?<br />
Stevan : Slavoljub, ne me faites pas rire. Qu’est-ce que j’aurais à y gagner à me<br />
justifier, pour l’amour <strong>de</strong> Dieu !? Je vis, moi, d’un mégot à l’autre dont on me fait<br />
l’aumône. Ce que j’ai pu vous dire ne me concerne pas personnellement. Je n’existe<br />
pas, mais, hélas, je le sais : Des pratiques vertueuses se créent sur la durée, car<br />
elles n’ont <strong>de</strong> pire ennemi que la précipitation. À nous autres Serbes, c’est<br />
justement le temps qui nous manquait pour consoli<strong>de</strong>r les choses. Pour qu’on les<br />
gar<strong>de</strong> en mémoire. Pour que l’on s’y consacre.<br />
Slavoljub : Vous ne pouvez pas vivre avec tant <strong>de</strong> noirceur en vous.<br />
Stevan : De noirceur ? Ce n’est pas <strong>de</strong> la noirceur. Comment dirais-je…<br />
Slavoljub : Tant <strong>de</strong> haine ?<br />
Stevan : Tant <strong>de</strong> répugnance. Oui. De répugnance envers le mon<strong>de</strong>.<br />
Slavoljub : Il y a pire. La répugnance envers soi-même.<br />
Stevan : Vous vous démenez en vain, Slavoljub. Ne voyez-vous donc pas avec<br />
quelle rapidité on s’habitue au pire ? La réalité, c’est cette tinette.<br />
Ils vi<strong>de</strong>nt les tinettes.<br />
(…)<br />
XXIII (Partie 2)<br />
Miloš et Vujica dans le divan.<br />
Vujica : Il est chez moi, monseigneur.<br />
Miloš : Aferim 25 ! Il veut une insurrection ?<br />
Vujica : En effet. Il dit que la Russie apportera son ai<strong>de</strong>. Ainsi que Philiki Hétaïrie<br />
en Hella<strong>de</strong>.<br />
Miloš : Qu’il aille se faire foutre, tant que je ne vois pas l’armée russe <strong>de</strong> mes<br />
propres yeux, je n’y crois pas. Ne nous ont-ils pas trahis plus d’une fois ? Le Tsar<br />
russe se soucie du peuple russe, et du mien, il ne s’en soucie que lorsqu’il en a<br />
besoin. Si moi, je ne me soucie pas <strong>de</strong>s Serbes, personne ne le fera. Le peuple ou<br />
Karageorges, qu’en dis-tu Vujica, qui alors vaut-il mieux sacrifier ? Devons-nous<br />
tous périr ou lui seul ? C’est toi Vujica, et comment ! C’est toi qui vas le tuer !<br />
Trancher la tête, et comment ! L’offrir aux Turcs, et comment !<br />
Vujica : Epargne-moi ça, monseigneur, lui, je ne peux pas.<br />
Miloš : Si tu veux tant mieux. Si tu ne veux pas, tu n’auras pas le choix.<br />
Vujica : Voici ce que je pense, monseigneur ! Il est fini, notre gouverneur turc.<br />
Comme si je ne voyais pas dans quel état est son fief <strong>de</strong> Belgra<strong>de</strong>, à lui, le pacha à<br />
trois queues ? Ses fenêtres n’ont pas <strong>de</strong> carreaux, elles sont attachées avec <strong>de</strong>s<br />
cor<strong>de</strong>s afin qu’elles ne tombent pas. Des amas d’ordures empêchent l’accès au
[99]<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la, <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
Traduction d’extraits par Nataša Džigurski-Dubajić<br />
portail. Des chiens exorbités fouillent les ordures ; son armée est en haillons, les<br />
pieds nus, couchée dans la poussière au soleil à toute heure du jour. Il ne pourrait<br />
pas l’entretenir toute délabrée qu'elle est, si tu ne lui donnais pas d'argent. C’est lui<br />
qui dépend <strong>de</strong> toi, monseigneur, et pas toi <strong>de</strong> lui. Alors pourquoi lui offrirais-tu<br />
jusqu’à la tête <strong>de</strong> Karageorges ?<br />
Miloš : Voilà ! Pour ça ! Tu penses juste, Vujica, mon voïvo<strong>de</strong> ! Parce que le pacha<br />
dépend <strong>de</strong> moi ! Pierre par pierre, je comblerai le fossé, tout en monnayant les<br />
faveurs <strong>de</strong>s Turcs, doucement, doucement, je libérerai la Serbie, et c’est moi seul<br />
qui pourrai le faire ! Attendons que la Turquie décline encore un peu ! Lorsque le<br />
glas fatidique sonnera ! Lorsque les armées russes et autrichiennes chargeront !<br />
Miloš, il sait ce qu’il fait, tu entends !? Et si Karageorges fomente une insurrection,<br />
est-ce que Marachli Ali-pacha avec ses chiens et son armée somnolente restera seul<br />
ici ? Parle, diable, restera-t-il seul ?<br />
Vujica : Non. Le sultan enverra l’armée.<br />
Miloš (il se lève et fait <strong>de</strong> lentes allées et venues <strong>de</strong>vant Vujica) : C’est toi, Vujica,<br />
qui va le tuer...<br />
Vujica : Même si tu n’as ni âme…<br />
Miloš : … lui trancher la tête …<br />
Vujica : … ni foi…<br />
Miloš : … me l’apporter…<br />
Vujica : … ni Dieu…<br />
Miloš :… et moi, je l’enverrai au sultan comme présent !<br />
Vujica : … tu ne dois pas manquer <strong>de</strong> bon sens. Monseigneur, t’ai-je déjà mal<br />
conseillé ? Écoute-moi, puis tu feras comme il te plaira : le peuple te tuera.<br />
Miloš : Doucement, Vujica, ne mets pas la charrue avant les bœufs, maudits soient<br />
tes aïeux. Les poiriers seront décorés <strong>de</strong>s cadavres <strong>de</strong> rebelles, comme le sont les<br />
étals <strong>de</strong>s boucheries par les carcasses <strong>de</strong> mouton.<br />
Vujica : Je sais que tu es capable <strong>de</strong> le faire. Mais, ça ne changera rien. J’ai une<br />
autre idée.<br />
Miloš : Parle.<br />
Vujica : Lorsque la tête partira pour la ville d’Istanbul, notre seul secours sera<br />
celui-ci : que mes hommes <strong>de</strong> main laissent courir la rumeur que tu caches un<br />
Karageorges sain et sauf et que la tête envoyée aux Turcs n’est pas la bonne.<br />
Miloš : Est-ce que le peuple le croira ?<br />
Vujica : Il le croira, il te connaît.<br />
Miloš (il cesse <strong>de</strong> marcher, réfléchit) : L’ordure ! Tu es pire que moi. (Il le dit en<br />
compliment. Il réfléchit <strong>de</strong> nouveau, affiche un sourire.) Tu es vraiment une belle<br />
ordure. Mais, le premier a la primauté(Partie 2), comme disent les Turcs. Va<br />
chercher la tête du chef, Vujica, ma brave petite ordure !<br />
Œuvres <strong>de</strong> Slobodan Selenić traduites en français :<br />
- L’ombre <strong>de</strong>s aïeux (Očevi i oci, traduit du serbo-croate par Gojko Lukić et Gabriel<br />
Iaculli), Gallimard, coll. « Du mon<strong>de</strong> entier », Paris, 1999, 416 p.<br />
- Meurtre avec préméditation, (Ubistvo s predumišljajem, traduit du serbo-croate<br />
par Gojko Lukić et Gabriel Iaculli), Gallimard, coll. « Du mon<strong>de</strong> entier », Paris,<br />
1996, 240 p.<br />
- Ces <strong>de</strong>ux hommes (Prijatelji, trauit du serbo-croate par Mireille Robin), Robert<br />
Laffont, Paris, 1990, 304 p.
notes :<br />
Toutes les notes sont <strong>de</strong> la traductrice<br />
1 - Malgré tout le soin que<br />
nous avons apporté à essayer<br />
<strong>de</strong> trouver ce qui s’est passé à<br />
Florence un 22 novembre,<br />
nous n’y sommes pas<br />
parvenus.<br />
2 - 1 er décembre 1918 :<br />
proclamation <strong>de</strong> l’union <strong>de</strong> la<br />
Serbie et « <strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> l’État<br />
indépendant <strong>de</strong>s Slovènes,<br />
Croates, et Serbes dans un<br />
royaume uni » par le prince<br />
Alexandre, régent <strong>de</strong> Serbie.<br />
3 – 20 juin 1928 : en pleine<br />
assemblée, un député<br />
monténégrin, Puniša Račić, fait<br />
feu sur les députés du parti<br />
paysan croate. Deux meurent<br />
sur le coup, Stjepan Radić<br />
succombe à ses blessures un<br />
mois plus tard. Le parti paysan<br />
est désormais dirigé par<br />
Vladimir Maček.<br />
4 – 1932 : publication du<br />
« manifeste <strong>de</strong> Zagreb » signé<br />
par <strong>de</strong>s politiques croates mais<br />
aussi <strong>de</strong>s Serbes <strong>de</strong> Bosnie. Ils<br />
réclament la souveraineté<br />
populaire et le respect <strong>de</strong>s<br />
droits nationaux <strong>de</strong>s Serbes,<br />
<strong>de</strong>s Croates et <strong>de</strong>s Slovènes.<br />
S’ensuit l’internement <strong>de</strong>s<br />
signataires les plus en vue,<br />
dont le Croate Maček,<br />
condamné à trois ans <strong>de</strong> prison<br />
pour trahison le 24 avril 1933.<br />
5 - 9 octobre 1934 : attentat<br />
<strong>de</strong> Marseille. Alexandre I er<br />
tombe sous les balles d’un<br />
terroriste macédonien. Un<br />
conseil <strong>de</strong> régence présidé par<br />
le prince Paul exerce le pouvoir<br />
au nom du jeune roi Pierre II.<br />
6 - Négociations secrètes entre<br />
le prince Paul et Maček. Elles<br />
aboutissent à l’accord du<br />
26 août 1939 : création d’une<br />
province <strong>de</strong> Croatie comptant<br />
quatre millions d’habitants,<br />
dont 866 000 Serbes, avec à<br />
sa tête un gouverneur pourvu<br />
<strong>de</strong> pouvoirs étendus et paré du<br />
titre, hérité d’une histoire<br />
pluriséculaire, <strong>de</strong> ban <strong>de</strong><br />
Croatie. Un Sabor (Parlement)<br />
doté <strong>de</strong> compétences<br />
régionales est également<br />
institué. En d'autres termes, la<br />
Croatie accè<strong>de</strong> à l’autonomie<br />
tandis que Maček <strong>de</strong>vient vice-<br />
Premier ministre <strong>de</strong> l'État<br />
yougoslave.<br />
7 - 17 avril 1941 : la<br />
Yougoslavie se rend à<br />
l'Allemagne.<br />
8 – 10 mai 1941 : Draža<br />
Mihajlović, le chef <strong>de</strong>s<br />
tchetniks, établit l’état-major<br />
<strong>de</strong> la résistance à Ravna Gora.<br />
9 - 19 septembre 1941 :<br />
première rencontre en vue<br />
d'une collaboration entre Tito<br />
et Draža Mihajlović.<br />
10 - 26 octobre 1941 :<br />
<strong>de</strong>uxième rencontre entre Tito<br />
et Mihajlović. Celui-ci réussit à<br />
obtenir 500 fusils pour ses<br />
tchetniks.<br />
11 - 2 novembre 1941 : les<br />
tchetniks attaquent la ville<br />
d’Užice où se trouve le QG <strong>de</strong><br />
la résistance <strong>de</strong> Tito et qui est<br />
également le centre <strong>de</strong> la<br />
« République d'Užice », le<br />
territoire libre <strong>de</strong>s partisans.<br />
12 – 12 septembre 1944. Sous<br />
la pression anglaise, le roi<br />
Pierre II, qui avait confié en<br />
mai la responsabilité <strong>de</strong> son<br />
gouvernement au Dr Ivan<br />
Šubašić, ancien ban <strong>de</strong> Croatie,<br />
appelle par la radio ses sujets<br />
à se rallier à l’armée <strong>de</strong><br />
libération nationale et<br />
reconnaît Tito comme chef <strong>de</strong><br />
toutes les forces combattantes<br />
<strong>de</strong> Yougoslavie.<br />
13 - Il pense à la rencontre<br />
entre le maréchal Tito et le<br />
maréchal britannique Harold<br />
Alexan<strong>de</strong>r, commandant en<br />
chef <strong>de</strong>s armées alliées en<br />
Italie ; cette rencontre avait<br />
pour sujet la question <strong>de</strong><br />
Trieste.<br />
14 - Par « nos Turcs », Obrad<br />
comprend la population<br />
musulmane vivant dans ce coin<br />
<strong>de</strong>s Balkans.<br />
15 - Magyars : Hongrois.<br />
16 - Bačka, région <strong>de</strong> la<br />
Voïvodine, où, en hiver 1942,<br />
la population juive, serbe et<br />
tzigane, fut massacrée suite<br />
aux ordres <strong>de</strong> Miklos Horthy.<br />
17 - Kajkavien, le dialecte<br />
parlé au nord <strong>de</strong> Zagreb. Le<br />
serbo-croate comprend trois<br />
dialectes que l’on désigne<br />
d’après les trois formes<br />
respectives du pronom relatifinterrogatif<br />
« que » (šta ou<br />
što, kaj et ča) : le štokavien<br />
(štokavski), le kajkavien<br />
(kajkavski) et le čakavien<br />
(čakavski). Le dialecte<br />
kajkavien est à la base <strong>de</strong> la<br />
langue slovène.<br />
[100]<br />
Ruženje naroda u dva <strong>de</strong>la, <strong>de</strong> Slobodan Selenić<br />
Traduction d’extraits par Nataša Džigurski-Dubajić<br />
18 - Le dialecte štokavien est<br />
parlé dans le reste du pays<br />
(Slavonie, Centre, Lika et une<br />
partie <strong>de</strong> Dalmatie) et il est la<br />
base <strong>de</strong> la langue littéraire<br />
croate.<br />
19 - En anglais dans le texte<br />
original. « Romains sauvages,<br />
cœurs durs, blocs <strong>de</strong> pierre,<br />
pire que choses insensibles,<br />
n’avez-vous pas connu<br />
Pompée ? Que <strong>de</strong> fois, perchés<br />
aux murs et aux créneaux, aux<br />
tours et aux fenêtres, et<br />
jusque tout en haut <strong>de</strong>s<br />
cheminées, vos petits dans vos<br />
bras, vous attendiez un jour<br />
entier, long comme une vie,<br />
pour voir le grand Pompée<br />
passer les rues <strong>de</strong> Rome » :<br />
Shakespeare W., Jules César,<br />
acte I, scène 1. Nous utilisons<br />
la traduction anglaise<br />
d’Edmond Fleg :<br />
Shakespeare W., Œuvres<br />
complètes, t. II, Gallimard,<br />
Paris, 1959, p. 557.<br />
20 - Petar Nikolajević Moler,<br />
un <strong>de</strong>s voïvo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la première<br />
insurrection serbe, assassiné à<br />
Belgra<strong>de</strong> par le Vizir. Il a exigé<br />
<strong>de</strong> Miloš le partage du pouvoir<br />
et a proposé la tétrarchie où<br />
Miloš, lui-même et <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses<br />
collaborateurs, le voïvo<strong>de</strong><br />
Pavle Cukić et l’évêque<br />
Milentije Nikšić, auraient<br />
chacun trois districts à<br />
gouverner. Miloš, ne voulant<br />
pas partager le pouvoir, s’est<br />
occupé <strong>de</strong> l’ennemi intérieur à<br />
sa façon. Ils ont tous été<br />
assassinés.<br />
21 - Le voïvo<strong>de</strong> Radič Petrović<br />
a été l’un <strong>de</strong>s grands chefs <strong>de</strong><br />
la première insurrection serbe.<br />
22 - Philiki Hétaïrie ou Philiki<br />
Hétairia (« société <strong>de</strong>s amis »)<br />
est une organisation grecque<br />
<strong>de</strong> la fin du XVIII e -début du<br />
XIX e siècle qui avait pour but<br />
<strong>de</strong> libérer les pays chrétiens du<br />
joug ottoman.<br />
23 - La Grèce.<br />
24 - En anglais dans le texte<br />
original. « Amis, Romains,<br />
concitoyens, prêtez-moi vos<br />
oreilles. » : Shakespeare W.,<br />
Op. cit., acte III, scène 3,<br />
p. 587.<br />
25 - « Bravo », « bien joué »<br />
en turc.
Excellensia
Clélia Van Lerberghe<br />
Les Essais hérétiques sur la<br />
philosophie <strong>de</strong> l’histoire<br />
ou l’invention d’un style<br />
Les philosophes ne sont pas forcément <strong>de</strong>s écrivains. Et parmi eux, il en est<br />
sans doute qui le regrettent. Serait-ce le cas du célèbre phénoménologue tchèque<br />
Jan Patočka (1907-1977) ? Nous ne pourrions le dire catégoriquement, mais nous<br />
pouvons examiner certains indices qui vont en ce sens… Les Essais hérétiques sur la<br />
philosophie <strong>de</strong> l’histoire 1 – ouvrage le plus important <strong>de</strong> l’œuvre <strong>de</strong> Patočka –<br />
constituent à cet égard un indice massif. Dans les Essais hérétiques, le<br />
philosophe invente un nouveau style.<br />
De quoi parlent les Essais hérétiques et en quoi ce qu’ils disent<br />
nécessite-t-il une forme particulière ? Et puis, qu’est-ce que le style pour<br />
Patočka ? Les Essais hérétiques nous parlent <strong>de</strong> l’expérience suicidaire<br />
qui a traversé l’Europe au cours du XX e siècle et qui a signé son déclin,<br />
la fin <strong>de</strong> son hégémonie sur le mon<strong>de</strong>. Ils nous parlent du mon<strong>de</strong> dans<br />
lequel nous vivons, que les phénoménologues nomment « le mon<strong>de</strong><br />
naturel ». Ils nous parlent <strong>de</strong> la nuit originelle, nuit <strong>de</strong> l’être-étant d’où<br />
émerge tout ce qui est. Et puis ils nous parlent <strong>de</strong> la Nuit et <strong>de</strong> la Mort<br />
qui viennent transpercer <strong>de</strong> leurs flèches acérées l’ordre bien réglé du<br />
Jour. Ils nous parlent encore et toujours <strong>de</strong> la guerre, non seulement<br />
comme fait historique mais comme polemos, c’est-à-dire comme être-<br />
en-guerre <strong>de</strong> l’homme. Car, comme le dit Ernst Jünger dans La guerre<br />
comme expérience intérieure, « voilà ce que nous ne pouvons nier,<br />
quand bien même plus d’un le voudrait : le combat, père <strong>de</strong> toutes<br />
choses, est aussi le nôtre ; c’est lui qui nous a martelés, ciselés et<br />
trempés pour faire <strong>de</strong> nous ce que nous sommes » 2 . Ils nous parlent du<br />
[102]<br />
1 - Les Kacířské eseje o<br />
filosofii dějin sont parus à<br />
Prague en 1975 en<br />
samizdat aux Editions<br />
Petlice. Ils sont aujourd’hui<br />
repris dans le troisième<br />
volume <strong>de</strong>s Œuvres<br />
complètes tchèques (Péče o<br />
duši III – Sebrané spisy<br />
Jana Patočky, sv. 3 :<br />
Soubor statí a přednášek o<br />
postavení člověka ve světě<br />
a v dějinách. Ed. I. Chvatík<br />
a P. Kouba, OIKOYMENH,<br />
Praha, 2002). Première<br />
édition française :<br />
Patočka J., Essais<br />
hérétiques sur la<br />
philosophie <strong>de</strong> l’histoire<br />
(traduit du tchèque par<br />
Erika Abrams), Verdier,<br />
Lagrasse, 1981. L’ouvrage<br />
a déjà été réédité <strong>de</strong>ux<br />
fois, en 1999 et en 2007.<br />
2 – Jünger E., La guerre<br />
comme expérience<br />
intérieure (1922) (traduit<br />
<strong>de</strong> l’allemand par François<br />
Poncet), Christian Bourgois<br />
Éditeur, Paris, 2008, p. 32.<br />
Première édition chez<br />
Chr. Bourgois en 1997.
Clélia Van Le rberghe<br />
Les Essais hérétiques sur la philosophie <strong>de</strong> l’histoire ou l’invention d’un style<br />
sens : du sens <strong>de</strong> la vie et dans la vie, du sens du mon<strong>de</strong> et dans le mon<strong>de</strong>. Ils<br />
nous parlent <strong>de</strong> l’espoir d’une « conversion colossale » 3 par laquelle les hommes<br />
prendraient enfin conscience, collectivement, qu’il n’y a pas <strong>de</strong> sens sans quête du<br />
sens ou, pour le dire autrement, que l’expérience <strong>de</strong> la perte du sens, l’expérience à<br />
la fois universelle et toujours singulière <strong>de</strong> voir s’effondrer sous nos pieds le sol d’un<br />
sens que l’on croyait pourtant bien assuré, est essentielle à la vie du sens. L’être-<br />
en-guerre <strong>de</strong> l’homme n’est rien moins que cela : l’homme en tant qu’il assume sa<br />
« vie dans l’amplitu<strong>de</strong> » 4 est perpétuellement sur la « ligne <strong>de</strong> front » 5 , c'est-à-dire<br />
dans une position <strong>de</strong> déséquilibre entre sens et non-sens qui constitue l’exigence<br />
même <strong>de</strong> sa condition et qui ne peut trouver d’apaisement qu’au prix d’un<br />
reniement <strong>de</strong> soi. L’existence humaine est saisie dans le jeu du sens, dans le jeu<br />
pour ainsi dire pneumatique et non dialectique du sens ; et sa mission est<br />
d’assumer le perpétuel échange, le pur écart du sens s’accomplissant. Avec la<br />
naissance conjointe <strong>de</strong> l’histoire, <strong>de</strong> la politique et <strong>de</strong> la philosophie, l’homme prend<br />
quelque distance par rapport à la puissance ténébreuse <strong>de</strong> la vie finie que ne<br />
cessent <strong>de</strong> raconter les mythes et commence à comprendre « qu’on ne peut s’en<br />
remettre aux dieux parce que l’absolu n’est pas en <strong>de</strong>hors, mais au-<br />
<strong>de</strong>dans <strong>de</strong> nous » 6 . Telle est l’advenue du règne <strong>de</strong> la responsabilité et<br />
<strong>de</strong> la liberté – nous pourrions dire du far<strong>de</strong>au <strong>de</strong> la responsabilité et <strong>de</strong><br />
la liberté.<br />
Reprenons la question du style : en quoi tout ceci (la guerre, le<br />
sens, la liberté…) exige-t-il un style particulier ? Parlant <strong>de</strong> « style »,<br />
Patočka emmène cette notion bien loin <strong>de</strong> la notion habituelle <strong>de</strong> style.<br />
Dans Platon et l’Europe, il parle du style <strong>de</strong> la manifestation 7 , du style <strong>de</strong><br />
l’apparaître 8 qui fait en sorte que le grand mon<strong>de</strong>, le vaste mon<strong>de</strong> puisse<br />
<strong>de</strong>venir pour l’homme quelque chose comme une <strong>de</strong>meure, un chez-soi.<br />
Dans un petit texte <strong>de</strong> 1937, le jeune Patočka évoque le style en posant<br />
la question du style <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> l’homme total que vise à <strong>de</strong>venir le<br />
philosophe. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s’il est possible <strong>de</strong> donner au philosophe, pour<br />
lui servir d’appui, un modèle, un type, « un canon d’une vie<br />
parfaitement stylisée, unifiée, achevée en une totalité pointée sur une<br />
valeur où la vie reconnaît l’expression la plus haute <strong>de</strong> sa substance<br />
intérieure » 9 . On comprend que le style définit pour Patočka une certaine<br />
forme d’unité. Alors qu’il n’y a pas à proprement parler <strong>de</strong> « canon »<br />
définitif <strong>de</strong> la vie philosophique, il y a bien chez chaque grand penseur<br />
un « style » qui constitue l’unité dynamique tout-à-fait singulière <strong>de</strong> sa<br />
manière profondément personnelle <strong>de</strong> philosopher. Ce que définit le<br />
style est alors une unité jamais posée, une « unité sans sol ferme » 10 .<br />
On <strong>de</strong>vrait dire une unité MAIS jamais posée, une unité MAIS sans sol<br />
ferme. Contrairement au canon définitif, la véritable unité n’est pas<br />
sclérosée, elle ne peut être qu’une unité dynamique qui assume le<br />
négatif, se met constamment en question et se recrée sans cesse soi-<br />
même. Bref, le style épouse <strong>de</strong> manière effective le mouvement même<br />
du sens, l’éternelle crise du sens.<br />
Qu’est-ce que cette crise du sens ? En phénoménologue, Patočka<br />
définit la crise du sens comme la tension entre ces <strong>de</strong>ux possibilités que<br />
sont la rencontre ou la non-rencontre avec le phénomène : l’homme est<br />
[103]<br />
3 – Patočka J., Op. cit.<br />
(éd. <strong>de</strong> 1999), p. 102.<br />
4 – Voir Patočka J., Liberté<br />
et sacrifice. Écrits politiques<br />
(traduit du tchèque par<br />
Erika Abrams), J. Millon,<br />
Grenoble, 1990, pp. 27-39.<br />
5 –Jan Patočka.<br />
Philosophie,<br />
phénoménologie, politique,<br />
Richir M. et Tassin É.<br />
(dirs.), J. Millon, Grenoble,<br />
1992, p. 31. Cette<br />
expression est issue <strong>de</strong> la<br />
bouche même <strong>de</strong> Patočka<br />
qui affirme, dans l’entretien<br />
qu’il a consacré à l’occasion<br />
<strong>de</strong> son soixantième<br />
anniversaire, que « pour<br />
être pertinente, une pensée<br />
philosophique, quelle<br />
qu’elle soit, doit prendre<br />
position sur la ligne <strong>de</strong><br />
front ». Cela vaut aussi<br />
pour l’existence elle-même<br />
qui gagne ainsi en<br />
authenticité.<br />
6 – Patočka J., Liberté et<br />
sacrifice Ecrits politiques,<br />
Op. cit., p. 23.<br />
7 – Patočka J., Platon et<br />
l’Europe (séminaire privé<br />
du semestre d’été 1973)<br />
(traduit du tchèque par<br />
Erika Abrams), Verdier,<br />
Lagrasse, 1999, p. 26.<br />
8 - I<strong>de</strong>m.<br />
9 – Patočka J., « Existe-t-il<br />
un canon définitif <strong>de</strong> la vie<br />
philosophique ? »,<br />
in : Actualités scientifiques<br />
et industrielles : Travaux<br />
du IX e Congrès<br />
International <strong>de</strong> Philosophie<br />
(Congrès Descartes),<br />
n° 539, vol. X., 1937,<br />
pp. 186-187.<br />
10 – Patočka J., Liberté et<br />
sacrifice Ecrits politiques,<br />
Op. cit., p. 253.
Les Essais hérétiques sur la philosophie <strong>de</strong> l’histoire ou l’invention d’un style<br />
Clélia Van Le rberghe<br />
une liberté tendue entre <strong>de</strong>ux possibilités, réaliser l’excellence indépassable que<br />
constitue l’assomption <strong>de</strong> la finitu<strong>de</strong> ou bien la fuir ; il a donc à choisir à tout<br />
moment entre la responsabilité et la fuite. Cette crise du sens, dit Patočka, est<br />
partout présente, et la représenter par la pensée (philosophiquement) est sans<br />
doute « l’accomplissement que toute notre époque attend et à la recherche duquel<br />
elle tâtonne, sans réussir à le thématiser directement ». Il se peut cependant,<br />
ajoute-t-il, qu’une thématisation directe « entraîne la suppression <strong>de</strong> la chose<br />
même dont il s’agit ». Or, cette impossibilité <strong>de</strong> thématiser directement la chose<br />
même dont il s’agit dans l’existence, la liberté, signifie que cette possibilité<br />
essentielle qu’a l’homme <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir un être libre « doit être directement<br />
accomplie » 11 mais ne doit pas être directement représentée. Cette idée<br />
fondamentale, qui implique l’homme à chaque secon<strong>de</strong> <strong>de</strong> son <strong>de</strong>venir, impose à la<br />
phénoménologie l’exigence <strong>de</strong> créer un langage qui puisse invoquer (appeler) et<br />
évoquer (faire apparaître dans une forme concrète) la chose même dont il s’agit<br />
sans la broyer. C’est, croyons-nous, ce que fait Patočka dans « ces textes étranges,<br />
et à bien <strong>de</strong>s égards effrayants » 12 , que sont les Essais hérétiques.<br />
Dans un beau texte <strong>de</strong> 1992, Henri Declève (un <strong>de</strong>s commentateurs<br />
francophones <strong>de</strong> la première heure) avait d’ailleurs proposé une hypothèse qui<br />
mériterait d’être développée dans son détail. Il avait posé l’idée que les Essais<br />
hérétiques tentent <strong>de</strong> « mettre en œuvre une philosophie phénoménologique<br />
vraiment asubjective » 13 , c’est-à-dire d’accomplir réellement et d’inviter son lecteur<br />
à accomplir la transformation que Patočka appelle <strong>de</strong> ses vœux – vivre<br />
effectivement le drame que constitue la crise du sens, vivre sur la ligne <strong>de</strong> front.<br />
Declève parle à cet égard d’un coup d’audace <strong>de</strong> Patočka qui va jusqu’à trouver le<br />
langage qui peut mener à leur véritable manifestation les thèmes majeurs <strong>de</strong> sa<br />
philosophie que sont la liberté et la vérité. La reprise du langage mythique qu’opère<br />
Patočka n’obéit donc pas à un désir simplement rhétorique, elle est bien plutôt un<br />
<strong>de</strong>s moyens par lesquels la phénoménologie se met enfin à la hauteur <strong>de</strong> la libre<br />
force créatrice <strong>de</strong> l’humanité.<br />
Les Essais hérétiques constituent une œuvre littéraire. Chacun peut donc les<br />
lire, et s’il ne comprend pas tout, ce n’est pas grave, parce qu’il accepte <strong>de</strong> se<br />
laisser prendre par le style qui se veut cathartique (du grec catharsis : purification).<br />
Clélia VAN<br />
LERBERGHE est<br />
aspirante du FNRS à<br />
l’<strong>Université</strong><br />
Catholique <strong>de</strong><br />
Louvain (Belgique)<br />
D’où l’effet quasi magique <strong>de</strong> la lecture : lire les Essais<br />
hérétiques, c’est faire un pas en direction <strong>de</strong> sa propre<br />
liberté… Ainsi Patočka a-t-il inventé – mais en philosophe –<br />
un nouveau style.<br />
[104]<br />
11 – Patočka J., L’Écrivain,<br />
son « objet » (traduit du<br />
tchèque par Erika Abrams),<br />
POL, Paris, 1990 (rééd. :<br />
Pocket Agora, Paris, 1992),<br />
pp. 76 et 63.<br />
12 - Préface <strong>de</strong> Paul<br />
Ricœur aux Essais<br />
hérétiques, Op. cit., p. 8.<br />
13 – Declève H., « Le<br />
mythe <strong>de</strong> l’Homme-Dieu »,<br />
in : Jan Patočka.<br />
Philosophie,<br />
phénoménologie, politique,<br />
Op. cit., p. 136.
Recensions
Écrits sur Ouspensky, Gurdjieff et sur la Tradition ésotérique chrétienne<br />
Boris Mouravieff, Dervy, Paris, 2008, 342 p.<br />
La maison Dervy vient <strong>de</strong> publier, à l’initiative <strong>de</strong> l’Association Boris Mouravieff, un<br />
recueil d’une dizaine articles parus entre 1954 et 1961 notamment dans la « Revue<br />
Suisse d’Histoire » et dans la revue belge « Synthèses », lesquels étaient <strong>de</strong>venus à<br />
peu près introuvables. Les sujets abordés sont divers : certains articles traitent <strong>de</strong><br />
théologie politique (« Le problème <strong>de</strong> l’homme nouveau », « Liberté, égalité,<br />
fraternité », « L’Histoire a-t-elle un sens ? ») ou d’histoire religieuse (« Des<br />
croyances slaves pré-chrétiennes », « Sainte-Sophie <strong>de</strong> Constantinople »),<br />
d’exégèse spirituelle (« Le substantiel et l’Essentiel », « Du “pain quotidien” ») ou<br />
<strong>de</strong> figures importantes <strong>de</strong> l’ésotérisme (« Ouspensky, Gurdjieff et les Fragments<br />
d’un Enseignement inconnu », « Additif à l’article “Ouspensky…” »).<br />
De façon très opportune, les éditeurs <strong>de</strong> ce volume ont également décidé <strong>de</strong> publier<br />
quelques textes parus entre 1961 et 1972 qui étaient réservés jusqu’ici aux<br />
membres du Centre d’Etu<strong>de</strong>s Chrétiennes Esotériques (C.E.C.E.), fondé à Genève<br />
en 1961 par Mouravieff lui-même et <strong>de</strong>stiné à faire connaître son œuvre et en<br />
particulier les trois volumes <strong>de</strong> Gnôsis — Étu<strong>de</strong>s et commentaires sur la Tradition<br />
ésotérique <strong>de</strong> l’Orthodoxie orientale. Ces textes sont d’une part <strong>de</strong>s « bulletins<br />
d’information » assez courts, proposant aux « étudiants » conseils et exercices<br />
spirituels, d’autre part <strong>de</strong>s « Stromates » qui sont <strong>de</strong>s compléments, <strong>de</strong>s<br />
applications concrètes, ou <strong>de</strong>s clés <strong>de</strong> compréhension <strong>de</strong> la doctrine exposée dans<br />
Gnôsis.<br />
Le volume offre donc dans l’ensemble un aspect composite, non seulement parce<br />
que les textes ont été rédigés pour <strong>de</strong>s publics différents — puisque inégalement<br />
sensibilisés à la pensée <strong>de</strong> l’auteur — mais encore parce que les articles touchent à<br />
<strong>de</strong>s sujets variés. Néanmoins, l’unité est préservée par l’intention fondamentale <strong>de</strong><br />
Mouravieff, qui est celle <strong>de</strong> prendre pour point <strong>de</strong> départ la doctrine spirituelle (la<br />
« science ésotérique ») et d’en tirer <strong>de</strong>s conclusions applicables dans tous les<br />
domaines du savoir, ainsi que <strong>de</strong>s solutions concrètes et <strong>de</strong>s moyens pour agir sur<br />
la politique et sur l’histoire. L’auteur invite donc tant les chercheurs que les hommes<br />
d’État à dépasser certains cloisonnements mentaux et à répondre ensemble, sur <strong>de</strong><br />
nouvelles bases, aux problèmes <strong>de</strong> l’Humanité. Il s’agit bien, comme l’écrivent<br />
Clau<strong>de</strong> Thomas et Jean Poyard dans leur introduction, « <strong>de</strong> contribuer à la<br />
formation “d’hommes nouveaux” capables, selon l’expression <strong>de</strong> saint Paul, <strong>de</strong><br />
“renouveler l’esprit <strong>de</strong> leur intelligence” ».<br />
Olivier Santamaria<br />
<strong>Université</strong> <strong>Libre</strong> <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong><br />
L'ésotérisme et les sciences occultes en Russie.<br />
Aperçu historique et lexiques.<br />
François Le Guévellou, Éditions Le Manuscrit (éditions en ligne), 2007, 131 p.<br />
Professeur <strong>de</strong> linguistique russe à l'INALCO, François Le Guévellou s'est fait<br />
connaître du public spécialisé par la rédaction <strong>de</strong> dictionnaires français-russe /<br />
russe-français présentant <strong>de</strong>s lexiques quelque peu originaux (Dictionnaire <strong>de</strong>s gros<br />
mots russes ; Dictionnaire russe-français <strong>de</strong>s noms d’animaux et <strong>de</strong> plantes ; Les<br />
termes <strong>de</strong> couleurs en français et en russe. Etu<strong>de</strong> contrastive et lexiques ;<br />
Dictionnaire <strong>de</strong>s onomatopées et interjections russes), souvent accompagnés <strong>de</strong><br />
savantes étu<strong>de</strong>s introductives ainsi que <strong>de</strong> commentaires linguistiques et<br />
encyclopédiques.<br />
Le présent volume est remarquable à plusieurs égards. Avant tout, il est, à notre<br />
connaissance, le premier ouvrage à explorer ce lexique particulier qu’est celui <strong>de</strong><br />
[106]<br />
recensions
l’ésotérisme, <strong>de</strong> l’occultisme et <strong>de</strong>s sociétés initiatiques en Russie. Ensuite, le<br />
vocabulaire conceptuel ou technique <strong>de</strong> l’ésotérisme est accompagné <strong>de</strong> la<br />
translittération <strong>de</strong>s noms <strong>de</strong> personnages ou d’auteurs ayant joué un rôle significatif<br />
dans l’histoire <strong>de</strong> courants apparentés (avec la traduction <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> leurs<br />
principaux ouvrages). Cet usage offre un avantage pratique évi<strong>de</strong>nt pour la<br />
recherche, ainsi qu’une bonne possibilité <strong>de</strong> se familiariser avec la culture littéraire<br />
ésotérique et occultiste russe. Enfin, les quelque vingt et une pages d'introduction<br />
permettent à l’auteur <strong>de</strong> clarifier ce qu’il entend par « ésotérisme », « arts<br />
occultes » ou « sciences secrètes », et d’en brosser un aperçu historique assez<br />
convaincant. Il y explore la Russie « païenne » (les esprits, les génies, les vampires,<br />
mais aussi les mancies, les magiciens et guérisseurs), la Russie « hérétique » (avec<br />
ses « vieux-croyants », ses « douhobors », « hlysty », « skoptsy » et autres sectes<br />
ou mouvements religieux dissi<strong>de</strong>nts) et enfin la Russie « occultiste et ésotérique »<br />
(avec tout le vocabulaire lié aux Rose-Croix, Franc-Maçons et Martinistes : magie,<br />
théurgie, médiumnisme, théosophie, illuminisme, jusqu’aux mouvements néopaïens<br />
ou néo-spiritualistes sans attaches traditionnelles). Comme le dit l’auteur,<br />
son lexique « se trouve ainsi à la croisée <strong>de</strong> diverses disciplines : ethnographie,<br />
folklore, mythographie, histoire <strong>de</strong>s religions, histoire <strong>de</strong>s mentalités, philosophie ».<br />
Sans prendre en compte le vocabulaire technique <strong>de</strong> la religion orthodoxe stricto<br />
sensu, son « fil rouge » <strong>de</strong>meure néanmoins le lexique du « rapport au sacré, au<br />
surnaturel, à l’invisible, et qui est l’une <strong>de</strong>s composantes essentielles <strong>de</strong> “l’âme<br />
russe” ».<br />
Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes,<br />
[107]<br />
Olivier Santamaria<br />
<strong>Université</strong> <strong>Libre</strong> <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong><br />
László Földényi, Actes Sud, Paris, 2008, 64 p. Traduit du hongrois par Natalia<br />
Zaremba-Huzvai et Charles Zaremba.<br />
Ce bref essai <strong>de</strong> László Földényi, propose une lecture éclairante qui ouvre <strong>de</strong><br />
nouvelles perspectives dans l'exégèse <strong>de</strong> la poétique <strong>de</strong> Dostoevskij. Le penseur<br />
hongrois, qui est un spécialiste <strong>de</strong> philosophie esthétique et professeur <strong>de</strong><br />
littérature comparée à l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Budapest, s'y engage dans une entreprise<br />
originale et passionnée qui naît <strong>de</strong> la conviction d'avoir « <strong>de</strong>viné » les œuvres <strong>de</strong><br />
Hegel que l'écrivain russe aurait lu pendant son exil à Semipalatinsk, un bourg du<br />
Sud <strong>de</strong> la Sibérie. Celui-ci y avait été déporté au printemps 1854, après quatre ans<br />
<strong>de</strong> bagne. Földényi suppose (à partir du fait certain que le procureur Wrangel s’était<br />
lié d’amitié avec Dostoevskij et lui fournissait <strong>de</strong> nombreux livres, dont <strong>de</strong>s œuvres<br />
<strong>de</strong> Hegel) que l’écrivain eut l’occasion <strong>de</strong> lire les Leçons sur la philosophie <strong>de</strong><br />
l’histoire du philosophe allemand. Il imagine la réaction que l’auteur russe a pu<br />
avoir en découvrant que, selon Hegel, les idées pour lesquelles il avait été<br />
condamné à mort avant d’être gracié, envoyé au bagne et enfin exilé, que ses<br />
souffrances et celles <strong>de</strong> tous ses compagnons <strong>de</strong> mésaventure étaient dépourvues<br />
<strong>de</strong> signification en raison <strong>de</strong> leur situation géographique. En effet, Hegel considérait<br />
la Sibérie, tout comme l’Afrique, dépourvue <strong>de</strong> tout intérêt et, en conséquence,<br />
qu’elle ne pouvait pas entrer dans l’Histoire.<br />
Földényi présume qu’à la première réaction instinctive – les larmes <strong>de</strong> désespoir qui<br />
inspirent le titre du livre – aurait succédé une réaction intellectuelle, plus articulée,<br />
à l’origine d’un tournant dans la pensée <strong>de</strong> Dostoevskij. Ce fut peut-être alors que<br />
l’écrivain comprit que dans la vie il y a <strong>de</strong>s aspects qui ne peuvent pas être<br />
encadrés par l’Histoire. À ce moment là, il saisit que « l’Histoire ne révèle sa propre<br />
essence qu’à ceux qu’elle a au préalable exclus d’elle-même ». L’interprétation<br />
rationnelle <strong>de</strong> l’histoire délivrée par Hegel exclut tout ce qui échappe à la logique,<br />
tous les éléments incontrôlables <strong>de</strong> la vie humaine, tels que les souffrances, les<br />
instincts, les angoisses, les désirs, qui <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong> purs acci<strong>de</strong>nts (y compris la<br />
recensions
mort <strong>de</strong> milliers d’individus). Or, ces éléments bouillonnants que le penseur<br />
allemand essaie <strong>de</strong> refouler, <strong>de</strong> tenir à l’écart suscitent le plus grand intérêt chez le<br />
romancier russe.<br />
Pour Hegel, la Sibérie était effrayante parce qu’obscure, mystérieuse,<br />
incompréhensible pour l’esprit humain. Dostoevskij, lui, était convaincu que la<br />
Sibérie était l’Enfer avec toutes les horreurs que cela impliquait mais bénissait le<br />
sort d'y avoir été déporté car ce malheur lui avait permis <strong>de</strong> survivre à la rationalité<br />
grise du processus historique hégélien et donc, finalement, <strong>de</strong> gagner son salut. Il<br />
arriva jusqu'au paradoxe et affirma, en discutant avec Vsevolod Solov’ëv, le frère<br />
du philosophe, qu'en Sibérie il avait connu le véritable bonheur, que c'est à cette<br />
époque qu'il avait conçu ses meilleures idées : « c'est là que je me suis senti moimême,<br />
(…) que j'ai senti le Christ, (…) l'homme russe, et c'est là que j'ai senti que<br />
j'étais russe moi aussi, fils du peuple russe ». Les expériences vécues dans cet<br />
Enfer lui ont permis d'acquérir une connaissance approfondie <strong>de</strong> l'homme russe, <strong>de</strong><br />
découvrir les abîmes cachés <strong>de</strong> l'âme humaine. C'est en Sibérie qu'il apprit à son<strong>de</strong>r<br />
l'esprit humain, à explorer les contradictions et la complexité <strong>de</strong> la psyché sans<br />
craindre ce qu'il pouvait y déceler.<br />
Sa façon d'écrire change dans les œuvres composées après l'exil et il ne s'agit pas<br />
d'une coïnci<strong>de</strong>nce. Sans l'initiation sibérienne, <strong>de</strong>s personnages comme le prince<br />
Myškin et Nastaša Filipovna, Raskoľnikov et Ivan Karamazov n'auraient<br />
probablement pas existé. Dostoevskij détestait la conventionalité, la médiocrité, la<br />
grisaille du quotidien qui constituaient pour lui le véritable Enfer, « l'Enfer terne <strong>de</strong><br />
l'Europe » à fuir absolument. À l'Europe <strong>de</strong> Hegel qui le refusait, il oppose la<br />
Sibérie, qui était au moins « pittoresque » et vivante. C’est justement <strong>de</strong> la révolte<br />
contre l'aplatissement et l'ordinaire que naissent ses héros rebelles : <strong>de</strong>s<br />
personnages authentiques, imprévisibles, passionnés, tourmentés et contradictoires.<br />
Giulia Gigante<br />
Traductrice (<strong>Bruxelles</strong>)<br />
Paoustovski, l’homme du dégel<br />
Sophie Ollivier, L’Harmattan, Paris, 2008, 280 p.<br />
L’écrivain russe Konstantin Georgievič Paustovskij, né en 1892 et mort en 1968, est<br />
aujourd’hui, après avoir vu un certain nombre <strong>de</strong> ses œuvres publiées en français<br />
dans les années 1960 et 1970, largement méconnu.<br />
En mettant à l’honneur cet artiste dans une monographie <strong>de</strong> quelques 280 pages<br />
(comprenant, outre le texte, un certain nombre <strong>de</strong> photographies illustrant la vie et<br />
la carrière <strong>de</strong> l’écrivain), Sophie Ollivier entend donc combler un vi<strong>de</strong> regrettable<br />
dans l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la littérature russe mo<strong>de</strong>rne. Au fil <strong>de</strong>s pages, elle passe en revue la<br />
vie et surtout l’œuvre <strong>de</strong> Paustovskij selon un plan alliant le chronologique et le<br />
thématique. La tentative en soi mérite l’intérêt en ce qu’elle rappelle l’œuvre d’un<br />
écrivain retombé dans l’oubli. Par contre, on regrettera un ton qui, tout en n’étant<br />
pas totalement dépourvu <strong>de</strong> sens critique, tend sans doute quelque peu à<br />
l’hagiographie. Ainsi, tout en étant convaincante lorsqu’elle évoque la rébellion et le<br />
courage <strong>de</strong> l’écrivain défendant à plusieurs reprises ses pairs injustement attaqués,<br />
l’auteure l’est moins dans d’autres passages où il semble que toute originalité dans<br />
l’œuvre <strong>de</strong> Paustovskij doit être interprétée comme une révolte, comme s’il était<br />
nécessaire que l’écrivain soit un opposant, un dissi<strong>de</strong>nt avant la lettre pour mériter<br />
l’attention.<br />
De manière plus générale, le livre dégage l’impression d’un choix qui n’a pas pu ou<br />
pas voulu être fait entre une biographie littéraire et un livre strictement scientifique,<br />
tentant d’effectuer une narration et d’exprimer <strong>de</strong>s émotions relevant <strong>de</strong> la<br />
première, sans s’affranchir du style plus neutre du second, et si la passion <strong>de</strong><br />
l’auteure pour son sujet transparaît clairement dans le texte, on éprouve un peu <strong>de</strong><br />
[108]<br />
recensions
mal à la partager, la multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s détails biographiques et intertextuels peut faire<br />
perdre le fil <strong>de</strong>s idées.<br />
Cela dit, l’ouvrage gar<strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> qualité d’être, à notre connaissance, la première<br />
étu<strong>de</strong> francophone <strong>de</strong> cette ampleur consacrée à Paustovskij, et <strong>de</strong> remettre à<br />
l’honneur un <strong>de</strong> ces écrivains <strong>de</strong> l’époque soviétique qu’on a sans doute trop<br />
facilement tendance à enfermer dans une « parenthèse <strong>de</strong> l’histoire »…<br />
Kup kota w worku (work in progress)<br />
Ta<strong>de</strong>usz Różewicz, Biuro Literackie, Wrocław, 2008, 106 p.<br />
[109]<br />
Nicolas Litvine<br />
Étudiant <strong>de</strong> l’ULB en slavistique<br />
Avec ce nouvel ouvrage, Ta<strong>de</strong>usz Różewicz surprend le lecteur et l’emmène dans<br />
<strong>de</strong>s endroits inhabituels afin <strong>de</strong> lui faire découvrir sa perception du mon<strong>de</strong>.<br />
L’auteur enfile ses vielles chaussures et part se promener dans la réalité. Il observe,<br />
écoute et lit tout ce qui se passe autour <strong>de</strong> lui. Il regar<strong>de</strong> la réalité droit dans les<br />
yeux et nous la commente à travers le prisme d’une ironie piquante et d’un humour<br />
grinçant.<br />
La force <strong>de</strong> ce recueil tient notamment à sa composition. La prose, la poésie, les<br />
petites pièces <strong>de</strong> théâtre agrémentées <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins humoristiques et <strong>de</strong> notes<br />
manuscrites constituent un véritable patchwork bigarré.<br />
Dans Kup kota w worku (Achète un chat dans un sac), l’écrivain n’hésite pas à<br />
pointer du doigt les travers <strong>de</strong> notre société contemporaine. Il s’attaque à la culture<br />
<strong>de</strong> masse, dont le jeune Harry Potter fait bien souvent les frais, à la « globalisation<br />
<strong>de</strong>s sms », à la télévision et à l’internet.<br />
Par le pastiche et les jeux <strong>de</strong> mots, il s’en prend également à la jeune génération<br />
dégénérée pour laquelle le langage a cessé d’être communicatif et l’orthographe et<br />
la grammaire se pratiquent selon <strong>de</strong>s règles aléatoires. Sur le ton du sarcasme et<br />
avec une véritable verve linguistique, il s’amuse à parodier la langue polonaise qui a<br />
été prise en otage par les américanismes et les vulgarismes. Autant dire que<br />
personne n’échappe à l’humour tranchant du poète, que ce soit les « Don Juan du<br />
chat », les journalistes, les jeunes, les starlettes, les copywriters, les bloggeurs, les<br />
politiciens ou les artistes.<br />
Różewicz n’a certes jamais été un grand optimiste, cependant il a toujours conservé<br />
son sens <strong>de</strong> l’humour, un humour qui se veut tantôt émouvant et raffiné, tantôt<br />
acéré et sans pitié.<br />
C’est sans doute l’un <strong>de</strong>s volumes les plus singuliers et les plus étonnants <strong>de</strong><br />
l’auteur. Le lecteur aurait tort <strong>de</strong> ne pas prendre l’invitation <strong>de</strong> Różewicz au<br />
sérieux : enfiler ses vieilles chaussures à son tour et continuer à rêver un peu plus.<br />
Alexandra Dufour<br />
Étudiante <strong>de</strong> l’ULB en Slavistique<br />
recensions
Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz.<br />
Michał Januszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2009, 382 p.<br />
Depuis <strong>de</strong> nombreuses années, Michał Januszkiewicz s’intéresse aux relations entre<br />
la littérature et la philosophie. Dans son <strong>de</strong>rnier livre, il analyse la problématique du<br />
nihilisme dans la littérature polonaise d’après-guerre chez trois <strong>de</strong> ses<br />
représentants majeurs : Witold Gombrowicz, Ta<strong>de</strong>usz Borowski et Ta<strong>de</strong>usz<br />
Różewicz.<br />
Dans un premier temps, l’auteur examine la question du nihilisme sur un plan<br />
théorique. En s’appuyant sur les réflexions <strong>de</strong> Friedrich Nietzsche, Martin Hei<strong>de</strong>gger<br />
et Gianni Vattimo, il démontre combien le concept <strong>de</strong> nihilisme est complexe et<br />
pluriel. Il a pour but <strong>de</strong> sortir ce terme <strong>de</strong> son acceptation négative courante.<br />
Januszkiewicz se base sur la thèse <strong>de</strong> Nietzsche selon laquelle le nihilisme n’est pas<br />
une manière <strong>de</strong> voir le mon<strong>de</strong>, mais l’état <strong>de</strong> notre époque, état dans lequel les<br />
valeurs prégnantes ont perdu leur importance. Horyzonty nihilizmu (Les horizons du<br />
nihilisme) comprend également un chapitre consacré à la problématique <strong>de</strong> l’antihéros,<br />
jusqu’ici absent <strong>de</strong> la théorie littéraire polonaise.<br />
Dans son analyse <strong>de</strong> l’œuvre <strong>de</strong> Gombrowicz, Januszkiewicz traque les pensées<br />
communes à l’écrivain polonais et à Nietzsche. Il lit Pornografia (La Pornographie)<br />
comme un récit sur l’émergence du nihilisme. Dans Kosmos (Cosmos) et Ślub (Le<br />
Mariage), il interprète la lutte du protagoniste avec la forme comme l’illustration <strong>de</strong>s<br />
problèmes <strong>de</strong> l’humanité après « la mort <strong>de</strong> Dieu ». Étudiés selon la perspective<br />
choisie, <strong>de</strong>s fragments <strong>de</strong> Dziennik (Journal) révèlent l’attitu<strong>de</strong> négative <strong>de</strong> l’auteur<br />
par rapport au développement <strong>de</strong> la technique, en laquelle il voyait une possible<br />
menace, préambule à la réification <strong>de</strong> l’homme et à la consommation <strong>de</strong> l’art.<br />
Dans la partie consacrée à l’œuvre <strong>de</strong> Borowski, le chercheur résume les querelles<br />
qui concernent l’écrivain jusqu’à maintenant. Il soutient que les arguments qui<br />
servaient à prouver le nihilisme <strong>de</strong> l’auteur provenaient d’une compréhension<br />
populaire du terme et qu’ils étaient basés principalement sur sa biographie.<br />
Januszkiewicz tente <strong>de</strong> dégager l’écrivain du discours habituel qui l’associe à la<br />
littérature <strong>de</strong>s camps <strong>de</strong> concentration et au réalisme socialiste. Il postule que la<br />
création du Borowski-écrivain est différente <strong>de</strong> celle du Borowski-publiciste. Pour<br />
interpréter les œuvres du premier groupe, il les place dans le courant <strong>de</strong> la critique<br />
<strong>de</strong> la culture occi<strong>de</strong>ntale, qui comporte l’élément génoci<strong>de</strong>. Le <strong>de</strong>uxième groupe <strong>de</strong><br />
textes témoigne quant à lui <strong>de</strong> la recherche <strong>de</strong> nouvelles valeurs à même <strong>de</strong><br />
remplacer le « Dieu mort » ; il montre ainsi qu’en voulant échapper à la réalité,<br />
Borowski s’est orienté vers la métaphysique et l’idéologie. Il arrive à la conclusion<br />
que Borowski est <strong>de</strong>venu nihiliste malgré ses efforts pour l’éviter.<br />
Dans le contexte <strong>de</strong> ce débat, Różewicz est placé entre « nihilisme et moralisme ».<br />
Januszkiewicz postule une reformulation favorable du concept <strong>de</strong> nihilisme en se<br />
basant sur <strong>de</strong>s poèmes <strong>de</strong> Różewicz pour prouver que le moralisme peut être une<br />
stratégie <strong>de</strong> nihilisme. Januszkiewicz analyse le « rien », tellement présent dans<br />
l’œuvre du poète, et soutient qu’il ne s’agit pas simplement d’une négation mais<br />
également d’une ouverture vers <strong>de</strong>s significations positives. En réfléchissant à<br />
l’éloignement <strong>de</strong> Różewicz par rapport à la métaphysique, il montre que l’auteur est<br />
en fait un « nihiliste positif ».<br />
Januszkiewicz examine les domaines qui l’intéressent avec application en respectant<br />
les interprétations <strong>de</strong> ceux qu’il évoque mais en les élargissant considérablement. Il<br />
échappe ainsi au simplisme.<br />
Przemysław Zdrok<br />
Étudiant <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> Adam Mickiewicz <strong>de</strong> Poznań, en Philologie polonaise<br />
et en théâtrologie<br />
[110]<br />
recensions