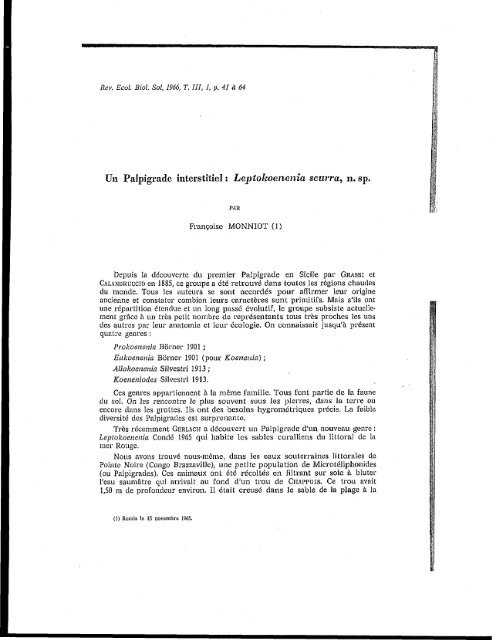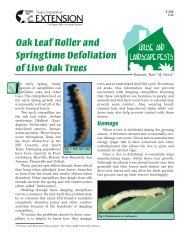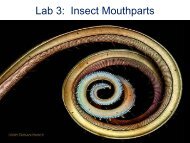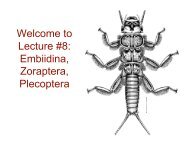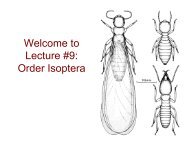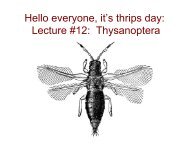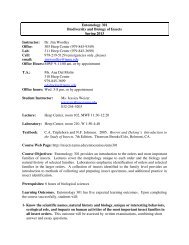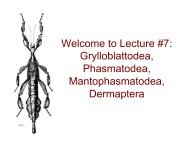Un Palpigrade interstitiel Leplokoenenia scwrra, n. sp,
Un Palpigrade interstitiel Leplokoenenia scwrra, n. sp,
Un Palpigrade interstitiel Leplokoenenia scwrra, n. sp,
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rev. Ecol. Biol Sol, 1966, T. III, 1, p. 41 à 64<br />
<strong>Un</strong> <strong>Palpigrade</strong> <strong>interstitiel</strong> <strong>Leplokoenenia</strong> <strong>scwrra</strong>, n. <strong>sp</strong>,<br />
PAR<br />
Françoise MONNIOT (1)<br />
Depuis la découverte du premier <strong>Palpigrade</strong> en Sicile par GRASSI et<br />
CALANDRUCCIO en 1885, ce groupe a été retrouvé dans toutes les régions chaudes<br />
du monde. Tous les auteurs se sont accordés pour affirmer leur origine<br />
ancienne et constater combien leurs caractères sont primitifs, Mais s'ils ont<br />
une répartition étendue et un long passé évolutif, le groupe subsiste actuellement<br />
grâce à un très petit nombre de représentants tous très proches les uns<br />
des autres par leur anatomie et leur écologie. On connaissait jusqu'à présent<br />
quatre genres ;<br />
Prokoenenla Borner 1901 ;<br />
Eukoenenia Borner 1901 (pour Koenenia) ;<br />
Allokoenenia Silvestri 1913 ;<br />
Koeneniodes Silvestri 1913.<br />
Ces genres appartiennent à la même famille. Tous font partie de la faune<br />
du sol. On les rencontre le plus souvent sous les pierres, dans la terre ou<br />
encore dans les grottes. Ils ont des besoins hygrométriques précis. La faible<br />
diversité des Palpigracles est surprenante.<br />
Très récemment GERLACH a découvert un <strong>Palpigrade</strong> d'un nouveau genre :<br />
Leptokoenenia Condé 1965 qui habite les sables coralliens du littoral de la<br />
mer Rouge.<br />
Nous avons trouvé nous-même, dans les eaux souterraines littorales de<br />
Pointe Noire (Congo Brazzaville), une petite population de Microtéliphonides<br />
(ou <strong>Palpigrade</strong>s). Ces animaux ont été récoltés en filtrant sur soie à bluter<br />
l'eau saumâtre qui arrivait au fond d'un trou de CHAPPUIS. Ce trou avait<br />
1,50 m de profondeur environ. Il était creusé dans le sable de la plage à la<br />
(1) Remis le 15 novembre 1965.
42<br />
FRANÇOISE MONNIOT<br />
limite chi talus de déferlement, Au cours du prélèvement, nous avons vérifié<br />
qu'aucun anima! ne s'agitait sur le film de surface, cet examen ayant pour but<br />
de récolter d'éventuels Collemboles. Les <strong>Palpigrade</strong>s se trouvaient en compagnie<br />
d'Acariens marins, d'Oligochètes, de Polychètes, de Ciliés. L'eau était peu<br />
dessalée,<br />
Cet habitat <strong>interstitiel</strong>, nouveau pour les <strong>Palpigrade</strong>s, en dehors de la<br />
récolte de GDRLACH, a de quoi surprendre. En effet, ces animaux qui vivent toujours<br />
à proximité de l'eau ne peuvent pas, en principe, se « mouiller ». Il est<br />
peu vraisemblable que les <strong>Palpigrade</strong>s récoltés à Pointe-Noire proviennent du<br />
sable de la plage, sec et brûlant, et encore moins du littoral assez éloigné.<br />
D'autre part, les animaux remis dans l'eau, après le passage sur le filet, avaient<br />
un comportement normal ; ils s'agrippaient aux grains de sable, nageaient<br />
avec leurs pattes, sans mouvements désordonnés. II faut donc admettre un<br />
mode de vie <strong>interstitiel</strong>, CONIJÉ doute du mode de vie <strong>interstitiel</strong> de son e<strong>sp</strong>èce<br />
Leptokoenenia gerlachî. Mais sa restriction s'explique puisque aucun <strong>Palpigrade</strong><br />
<strong>interstitiel</strong> n'a encore été décrit. II ne possédait qu'un seul individu,<br />
immature. Malgré la diagnose forcément très sommaire du genre Leptokoe<br />
nenia par CONJJH, nous y incluerons pour l'instant l'e<strong>sp</strong>èce de Pointe Noire,<br />
jusqu'à ce que des <strong>Palpigrade</strong>s adultes soient récoltés à nouveau en Mer Rouge,<br />
II est intéressant de remarquer, une fois encore, que l'adaptation d'un<br />
groupe à la vie <strong>interstitiel</strong>le n'entraîne pas de modifications majeures dans<br />
l'anatomie des animaux. Si les e<strong>sp</strong>èces acquièrent une allure particulière, elle<br />
est due à l'accumulation de petites transformations qui, prises une à une,<br />
n'auraient que peu d'importance ; leur somme devient au contraire très<br />
caractéristique. Cette constatation, générale à tous les groupes, se vérifie<br />
encore pour les <strong>Palpigrade</strong>s comme nous allons le montrer.<br />
Dans une première partie, nous envisagerons les différences essentielles<br />
entre le genre Leptokoenenia, <strong>interstitiel</strong>, et les genres endogés, en ne parlant<br />
que des grands traits morphologiques ceux sur lesquels sont basées les grandes<br />
coupures systématiques. Nous ne pourrons malheureusement pas comparer<br />
les deux e<strong>sp</strong>èces de Leptokoenenia. du point de vue adaptatif, faute de renseignements.<br />
Puis nous expliquerons pourquoi nous nous sommes résolue à<br />
garder le genre Leptokoenenia pour notre e<strong>sp</strong>èce nouvelle. <strong>Un</strong>e discussion<br />
devra être engagée ultérieurement, quand les adultes de L. gerlachi auront<br />
été découverts.<br />
Les carnclères élu genre Leptokoenenia<br />
envisagés pin rapport à son mode de vie <strong>interstitiel</strong><br />
<strong>Un</strong>e différence apparaît immédiatement entre les individus <strong>interstitiel</strong>s<br />
et terrestres quand on les place côte à côte. La forme du corps des<br />
Leptokoenenia est amincie, les contours sont plus simples. Les protubérances<br />
comme les étranglements sont atténués. Le corps paraît long et filiforme.<br />
L'allongement apparent des Leptokoenenia ne représente pas une augmentation<br />
de taille par rapport aux autres <strong>Palpigrade</strong>s. L'opisthosome n'a pas une<br />
longueur anormale. Par contre il est très aminci ce qui l'amène à un diamètre<br />
à peu près égal à celui du prosome. Cet amincissement n'est pas tout à fait un
UN PALPIGKAlffi JNTURSÏlTIFsL : LGPTOKOBNIîNIA SCURUA, N, SP. 43<br />
caractère original puisqu'il existe déjà à un degré poussé chez une e<strong>sp</strong>èce<br />
asiatique Eukoenenia angusta Hansen. Il atteint cependant ici un stade qui<br />
n'est réalisé chez aucune e<strong>sp</strong>èce terrestre.<br />
Le flagelle qui contribue beaucoup a donner au Microléliphonicles un<br />
a<strong>sp</strong>ect niliforme ne se présente plus comme une sorte d'appendice très fin et<br />
mobile : il prolonge véritablement le corps. Il est plus fort que clans l'ensemble<br />
des autres e<strong>sp</strong>èces, plus court. II s'insère à l'extrémité postérieure de l'opisthosome,<br />
dorsaleraent à l'anus, par l'intermédiaire d'un article court mais<br />
bien individualisé (fig. 5). Il s'agit d'un article de diamètre égal a celui du<br />
flagelle, phis développé que ceux qui existent dans les autres e<strong>sp</strong>èces, Les<br />
mouvements de la partie postérieure du corps sont limités par les épines clé<br />
cette pièce basale, mais aussi par la présence d'un éperon chitineux dorsal<br />
situé sur le dernier segment opisthosomien. {fig, 5). A l'état vivant le flagelle<br />
n'est pas dressé comme chez les animaux terrestres, mais reste dans l'axe du<br />
corps dont il suit les mouvements. Il n'est pas souple, ses articles emboîtés<br />
les uns dans les autres l'en empêchent. D'autre part les articulations sont<br />
recouvertes aux articles 1, 2, 3, 5, 7 et 9 d'une couronne de soies épineuses<br />
raides implantées les unes contre les autres. Le renflement au niveau des<br />
verticilles de soies barbelées, net chez les e<strong>sp</strong>èces terrestres, est Ici très<br />
réduit (fig. 5). Les articles du flagelle prennenl un a<strong>sp</strong>ect cylindrique. Ils<br />
ressemblent en cela à ceux des Prokoenenia. Les soies barbelées sont plus<br />
courtes que dans les autres e<strong>sp</strong>èces, Elles semblent donc plus raides. Elles<br />
s'insèrent perpendiculairement au tégument, Bien qu'il possède 15 articles,<br />
le flagelle de Leptokoenenia scurra est plus fort et moins mobile que chez les<br />
e<strong>sp</strong>èces terricoles,<br />
L'un des caractères les plus employés pour différencier les genres de<br />
<strong>Palpigrade</strong>s est la taille re<strong>sp</strong>ective des 3 derniers segments opisthosomiens.<br />
— Chez Allokoenenia, le 9° segment n'est pas plus large que le 11 e . Tous<br />
deux sont très amincis par rapport au 8°,<br />
— Chez Koeneniodes et Eukoenenia le 9° segment a un diamètre bien<br />
inférieur au 8 e segment, mais plus grand que le 11 e ,<br />
— Chez Prokoenenia les derniers segments de l'opisthosome sont régulièrement<br />
rétrécis à partir du 8°.<br />
— Chez Leptokoenenia, le co:rps est fusiforme, progressivement plus<br />
étroit vers l'anus, sans rétrécissement brusque. Cela pourrait paraître équivalent<br />
au cas du genre Prokoenenia. En réalité, chez ce dernier, le rétrécissement<br />
se produit au niveau du 8 e segment et du 9 e , c'est-à-dire à partir des<br />
papilles qui portent les éléments sternaux différenciés de l'opisthosome.<br />
Parallèlement au rétrécissement postérieur du corps, il existe dans le cas<br />
général un étranglement médian situé au niveau où se rejoignent le prosome<br />
et l'opisthosome. Il forme une sorte de « taille » à la suite de laquelle le corps<br />
est brusquement renflé. Cet élargissement est maximal au niveau des volets<br />
génitaux. Cette « taille » n'existe pas dans le genre Leptokoenenia, le segment<br />
génital est moins large que le suivant et n'a pas une épaisseur plus grande.<br />
Chez les mâles seulement, les volets génitaux sont écartés du corps. Le seul<br />
amincissement que l'on puisse constater en vue dorsale se situe entre la<br />
deuxième et la troisième paire de pattes. Il corre<strong>sp</strong>ond simplement a l'arrêt<br />
du bouclier formé par le propeltidium et l'étendue du tégument mou entre le
44 FKANÇOISB MONNIOT<br />
tétra et le pentasterum, qui corre<strong>sp</strong>ond d'ailleurs à un e<strong>sp</strong>acement accentué<br />
entre l'insertion des pattes II et III,<br />
Nous devons signaler que chez l'e<strong>sp</strong>èce Eukoenenia angusta du Siam, la<br />
« taille » est beaucoup moins nette que dans l'ensemble des autres e<strong>sp</strong>èces,<br />
<strong>Un</strong> autre caractère générique important tient compte des papilles ster tuiles<br />
de l'opisthosome. Chez Prokoenenia il existe des vésicules exsertiles sur les 4 e ,<br />
5 e et 6 B segments, ce qui sépare nettement le genre. Chez Koenenlodes la partie<br />
sternale médiane des 4 e et 5° segments se soutève en une protubérance armée<br />
de fortes soies, tandis que des poils sécréteurs particuliers s'insèrent sur le<br />
7 e segment. Il s'agit ici encore d'un bon caractère générique. Chez Eukoenenia<br />
il existe des protubérances plus ou moins marquées sur le 4 e et le 6 e segment.<br />
Le 6' segment porte toujours un pinceau de soies raides, plus ou moins nombreuses<br />
selon les e<strong>sp</strong>èces. Les e<strong>sp</strong>èces cavernicoles se distinguent par une<br />
réduction de ces formations. Mais le 6 e segment opisthosomien porte tout de<br />
même un rang de soies ventrales particulières. Eukoenenia angusta (1) ne<br />
possède pas de différenciations ventrales marquées, mais le 6 e segment est<br />
tout de même singularisé par une paire de soies qui n'existe pas sur les<br />
segments voisins. Chez Leptokoenenia les segments 4, 5 et 6 ne possèdent<br />
aucun renflement, îls présentent seulement une paire de soies ventrales courtes<br />
et larges qui remplacent une paire de soies barbelées normales.<br />
Les pattes I de Leptokoenenia scnrra sont très allongées, dirigées vers<br />
l'avant ; mais a cet allongement ne corre<strong>sp</strong>ond pas la diminution de diamètre<br />
constatée chex les e<strong>sp</strong>èces cavernicoles. Les pattes II, III, IV sont beaucoup<br />
plus courtes ainsi que les palpes et ne possèdent pas d'articles très allongés.<br />
Les appendices clans leur ensemble sont moins grêles que dans les autres<br />
e<strong>sp</strong>èces. Au lieu d'être longs et fins, prolongés par des griffes peu recourbées<br />
et parallèles, les tarses sont ici courts et cylindriques, terminés par un posttarse<br />
important sur les côtés duquel s'insèrent des griffes à forte courbure et<br />
a pointe très chitînisée. Pectinées sur les palpes, les griffes deviennent simples<br />
sur les pattes I, Elles acquièrent des denticulations internes sur les pattes<br />
marcheuses en gardant leur courbure et leur pointe solide, Elles ne sont pas<br />
parallèles mais écartées les unes des autres ; cet écartement est d'ailleurs<br />
rendu obligatoire par l'insertion même des griffes et leur élargissement eu<br />
sole au-dessus du pseudonychium (lig. 3), II s'agit peut-être d'une adaptation<br />
à la locomotion dans les interstices.<br />
Si les caractères que nous venons de décrire nous montrent bien les différences<br />
génériques entre Allokoenenia, Prokoenenia, Koeneniodes, Eukoenenia<br />
et Leptokoenenia. nous allons voir que l'étude du prosome isole davantage<br />
le genre Leptokoenenia,<br />
Chez les animaux terrestres, la faca sternale du prosome est recouverte<br />
de 4 slernites chitinisés qui s'étendent sur toute la face ventrale laissant entre<br />
eux un e<strong>sp</strong>ace intersegmentaire souple. Ces sternites sont figurés en forme<br />
(1) II est curieux de constater que plusieurs caractéristiques du genre Laptokoencn'm sont cldji<br />
UN PALPIGRADB INTERSTITIEL ! LEPTOKOBNENIA SCURRA, N. SP. 'If)<br />
d'écussons rectangulaires chez Koenenia mirabilis pour les segments qui<br />
portent les pattes II, III et IV. Chez Leptokoenenia les segments sont bien<br />
individualisés aussi par des joints de chitine molle, mais les stérilités sont<br />
découpés en plusieurs éléments chitinisés séparés par des e<strong>sp</strong>aces tégumentaires<br />
souples.<br />
Le deutotritosternum de Leptokoenenia scurra ne présente pas de zones<br />
amincies et il est tout à fait comparable au deutotritosternum des autres<br />
genres. Il manque cependant les soies que l'on y trouve habituellement. Il<br />
porte de petites protubérances irrégulières à son bord antérieur dont l'emplacement<br />
et le nombre varient avec les individus. Le metasternum ne possède<br />
pas non plus de caractères particuliers. Par contre le tetra et le pentasternum<br />
où s'insèrent les pattes II et III ne possèdent plus une chitine ventrale en<br />
revêtement continu, mais découpée en plaques. Ces épaississemeiits ont un<br />
a<strong>sp</strong>ect semblable et portent une pubescence analogue à celle qui couvre le<br />
reste du tégument, mais pas de soies. Les parties dures sont séparées les unes<br />
des autres par des bandes de tégument souple et mince susceptible de se<br />
plisser mais pourtant un peu plus épais que le tégument intersegmenlaire.<br />
Sur le pentasternum, en dehors des plaques coxales, il existe une plaque<br />
médiane antérieure triangulaire (ou deux plaques très proches) et une petite<br />
pièce postérieure et médiane située en relief. Ces formations qui n'ont jamais<br />
été décrites chez les autres genres de <strong>Palpigrade</strong>s n'existent pas chez les<br />
Koenenia mirabilis que j'ai pu observer. Par contre RUCKER signale pour<br />
Eukoenenia florenciae du Texas, un épaississement en forme de langue sur le<br />
pentasternum.<br />
Après avoir décrit la forme générale du corps comparativement avec ce<br />
que l'on trouve pour les e<strong>sp</strong>èces terrestres, nous pouvons faire plusieurs<br />
remarques :<br />
Les <strong>Palpigrade</strong>s sont déjà des animaux allongés en général, susceptibles<br />
de s'introduire dans les microcavités du sol. Ils ont une vie endogée. Les<br />
<strong>Palpigrade</strong>s terrestres présentent plusieurs point fragiles : en premier lieu<br />
le flagelle, dressé au-dessus du sol et formant un angle avec le corps, très<br />
souvent cassé ; la « taille » très fine suivie d'un élargissement marqué par<br />
rapport au diamètre du thorax ; les pattes aUongées, amincies dans leurs<br />
derniers articles,<br />
A tous ces caractères s'oppose la forme du genre Leptokoenenia, L'animal<br />
est allongé, le diamètre du corps n'augmente pas au niveau du premier segment<br />
opisthosomien et les protubérances ventrales n'existent plus. Il s'agit<br />
peut-être d'une évolution acquise avec le mode de vie <strong>interstitiel</strong>. La « taille »<br />
n'est plus aussi rétrécie et ne permet plus de blocage du corps à ce niveau au<br />
cours de la progression. Le flagelle plus court et droit prolonge le corps. Les<br />
e<strong>sp</strong>aces souples réunis entre les plaques sternales du prosome permettent,<br />
non seulement des mouvements dorso-ventraux, mais aussi des mouvements<br />
latéraux et une torsion relative du corps. Ces mouvements sont visibles sur<br />
l'animal vivant quand il s'agrippe aux grains de sable. Les griffes petites,<br />
écartées, et fortement courbées insérées sur des tarses fort, doivent permettre<br />
un accrochage sur le support beaucoup plus efficace que les griffes effilées,<br />
paraHèles,<br />
Tous ces caractères, s'ils sont pris un, à un, ne sont pas suffisants pour<br />
parler d'une véritable adaptation à la vie <strong>interstitiel</strong>le, mais, réunis, us entrât"
FRANÇOISE MONNIOT<br />
nent un changement important dans l'allure de l'animal. Ce phénomène est<br />
semblable à ceux que subissent d'autres groupes <strong>interstitiel</strong>s.<br />
D'autres caractères méritent d'être décrits chez les <strong>Palpigrade</strong>s et plus<br />
particulièrement les organes sensoriels du propeltiduim, la structure des<br />
chélicères des organes génitaux, etc... Ces critères seront envisages successivement<br />
dans le chapitre suivant de façon à donner une étude morpho!ogique<br />
complète de Leptokoenenia saura. Leur rôle dans 1 écologie de l'animal<br />
reste beaucoup moins important.<br />
Diagnose de Leptokoenenîa scurra, 11. <strong>sp</strong>. (1)<br />
Le corps est allongé, sans étrangement entre le prosome et l'opisthosome<br />
(fig. 1). Il est incolore. L'animai mesure 1,1 mm à 1,2 mm. Il n'existe pas de<br />
différences morphologiques entre les mâles et les femelles en dehors des<br />
valves génitales.<br />
— Le propeltidium.<br />
Le prosome se compose, sur la face dorsale, d'un bouclier peu chitinisé<br />
qui porte 10 paires de soies. Toutes les soies du propeltidium sont barbelées ;<br />
deux seulement, antérieures, sont longues, toutes les autres ont une taille<br />
réduite par rapport aux soies du reste du corps. Ce premier tergite est tout à<br />
fait comparable à ce qui existe chez les autres e<strong>sp</strong>èces de <strong>Palpigrade</strong>s.<br />
— Les organes sensoriels.<br />
L'organe frontal (s.m.) diffère sensiblement de tous ceux qui ont été<br />
décrits jusqu'à présent. La pièce basa!e, triangulaire, est armée à sa base d'une<br />
pièce chitineuse très bien individualisée, en forme de V ouvert vers le haut<br />
(flg. 5). Sur cette embase s'insèrent deux <strong>sp</strong>hérules échinulées, bien séparées<br />
l'une de l'autre à leur base, qui portent une épine longue et fine à leur pôle<br />
antérieur.<br />
(1) J'adopte pour l'Instant, mais avec réserves, le genre Leptokocnetna Comté 1965, Ce genre,<br />
créé pour lin seul Individu, incomplet, et immature n'a pas fait l'objet d'une cliagnose précise. Les<br />
caractères qui lu justifient n'ont pas été séparés des caractères <strong>sp</strong>écifiques As l'animal. Or chez les<br />
<strong>Palpigrade</strong>s, les jeunes sont parfois très différents des adultes de la même e<strong>sp</strong>èce. Je suppose donc un<br />
employant le genre L<strong>sp</strong>tokoenenia que les adultes As L, gerlaclii ressemblent aux jeunes et aux individus<br />
adultes que j'ai récoltés au Congo.<br />
Jo garde comme diagnose du genre :<br />
— La forme allongée de l'opisthosome.<br />
— L'absence de « taille ».<br />
— La robustesse das appendices.<br />
— La forme de l'oi'ganc sensoriel médian.<br />
— La présence d'une paire de soies courtes ventrales, sur les 4°, 5° et û segments opisthosomiens.<br />
Les 3 premiers points existent déjà chez. Eukvcneititi angusla, les 2 derniers seuls me paraissent<br />
originaux.<br />
Jo considère comme caractères <strong>sp</strong>écifiques de . gerlaclii :<br />
— Le nombre de soies dorsales du dernier segment du prosome.<br />
— Le nombre de soies de l'avant-dernier segment
UN PALPIGRADE INTERSTITIEL ! LEPTOKOENRNIA SCURRA, N, SP. 47<br />
/_LL<br />
-V M/<br />
n<br />
FIG. 1. — Laptokociteiila scurra n. <strong>sp</strong>. :<br />
habitus en vue clorsiilc.<br />
L'organe sensoriel latéral (s. 1.) comprend<br />
deux fuseaux échinulés (fig. 5), insérés sur une<br />
même embase à. la façon des soies, Leur extrémité<br />
distale est également prolongée par une<br />
fine épine.<br />
L'organe frontal médian est implanté sous<br />
le propeltidium bien en retrait de son bord<br />
antérieur (fig, 1), dans une cavité située au<br />
niveau où s'insèrent les chéliceres. Les organes<br />
latéraux ne sont pas visibles en vue dorsale, Ils<br />
sont implantés sous le bord replié du propeltidium,<br />
au niveau de la base des coxae des<br />
pattes I.<br />
— Les chéliceres,<br />
Elles comprennent 3 articles (fig. 5), L'article<br />
basai est dirigé dans l'axe du corps. Il comporte<br />
une rangée de 4 soies courbes sur sa face<br />
interne, dirigées ventralement, rebroussées vers<br />
l'arrière : 2 soies plus courtes raides barbelées,<br />
sur le bord interne mais plus dorsalement.<br />
Plus antérieurement, toujours sur le bord<br />
interne s'insèrent 2 soies barbelées raides perpendiculaires<br />
à l'axe de l'article. Enfin une 9°<br />
soie arquée barbelée est implantée à l'extrémité<br />
distale et externe de ce premier article<br />
des chéliceres et se dresse sur la face tergale audessus<br />
de l'articulation. Le deuxième article,<br />
renflé est rabattu ventralement sur le premier,<br />
II porte dorsalement 4 soies barbelées assez<br />
courtes, une soie plumeuse plus longue sur sa<br />
face interne. Il existe de plus, 1 soie barbelée<br />
d'un seul côté sous l'insertion du doigt mobile<br />
de la pince. Sur le mors fixe et sur une protubérance<br />
dorsale, prend naissance 1 poil long<br />
en forme de S, caractéristique, barbelé d'un seul<br />
côté. IL existe 9 dents, barbelées elLes aussi sur<br />
le mors fixe, 10 sur le doigt mobile qui constitue<br />
le 3 e article. L'extrémité de ce dernier est<br />
recourbée en crochet (d'autres individus portent<br />
8 et 9 dents).<br />
— Les lèvres.<br />
Leur structure corre<strong>sp</strong>ond exactement h ce<br />
qui a été décrit chez Koenenia mirabilis. Sur<br />
la face interne de la lèvre infériexire sont implantées<br />
des rangées de petites épines, remplacées<br />
par vme courte pubescence sur la lèvre<br />
supérieure.<br />
4
I<br />
48 FRANÇOISE MOMNKXT<br />
— La face sternale. du prosotne,<br />
Elle est nettement individualisée en 4 parties : le deutotritosternum,<br />
tétrasternum, pentasternum, métasternum (iig. 4). Le deutotritosternum<br />
forme une sorte de bouclier qui recouvre toute la partie antérieure de la face<br />
ventrale, II est entièrement recouvert d'une pubescence analogue à celle que<br />
l'on rencontre sur l'ensemble du corps : les chélicères, le propeltidium, etc...<br />
Il n'y a aucune pièce chitineuse. On distingue seulement, au bord de i'échancrure<br />
antérieure 3 à 5 petites épines variables selon les individus quant à leur<br />
nombre et leur emplacement. Elles ne sont que de petites épines équivalentes<br />
à celles qui couvrent le corps, mais seulement un peu plus fortes à leur base.<br />
Elles ne possèdent pas d'embase. Ceci constitue l'un des caractères originaux<br />
de Leptokoenenia scurra. En effet la sétation du deutotritosternum constitue<br />
chez les autres e<strong>sp</strong>èces un caractère de systématique important.<br />
Le tétrasternum qui porte la deuxième paire de pattes, ne possède pas<br />
un revêtement chitineux complet. La partie médiane se différencie en un<br />
triangte très légèrement saillant sur une pièce étirée en pointes sur les côtés<br />
et arrondie en deux lobes dans la portion postérieure. Latéralement, de chaque<br />
côté, on trouve les coxae des pattes II, En avant de celles-ci on distingue<br />
très aisément une plaque en croissant (fig. 4), Ces différentes parties sont équiva!entes<br />
au tégument des tergites. Elles sont séparées par une membrane<br />
plus souple, non pubescente.<br />
Le pentasternum, où s'insère la troisième paire de pattes, comprend aussi<br />
plusieurs éléments, Dans la partie médiane se situent deux pièces soudées qui<br />
forment un triangle dont la base suit la limite antérieure de l'article. Dans<br />
la partie postérieure est isolée une formation plus petite en lunule. De chaque<br />
côté il existe encore une plaque, mais cette fois en continuité avec la coxa des<br />
pattes III.<br />
Le mélasternum est uniformément chltmisé, et directement lié au tergitc<br />
corre<strong>sp</strong>ondant. Il porte les coxae des pattes IV.<br />
Cette di<strong>sp</strong>osition des plaques sternales est tout à fait originale pour des<br />
<strong>Palpigrade</strong>s. Il existe des ecussons ventraux chez Eukoenenia mirabilis, décrits<br />
par MILLOT ; mais ils sont quadrangulaires, réguliers, sur les trois derniers<br />
segments du prosome. Nous les avons observés sur des exemplaires provenant<br />
du Muséum d'Histoire Naturelle, ils sont en réalité très peu nets, variables<br />
selon les individus, puis semblables à des épaississements qu'à de véritables<br />
plaques.<br />
L'avant dernier article du prosome est partiellement recouvert du côté<br />
dorsal par Je propeltidium. Il est renflé sur les côtés, aminci sur la ligne médiodorsale.<br />
Cet amincissement est encore accentué par le chevauchement du<br />
dernier article prosomien qui est gonflé et élargi sur sa face dorsale. II porte<br />
6 fortes soies barbelées,<br />
— Les appendices.<br />
Les appendices n'ont pas un a<strong>sp</strong>ect grêle : les articles qui les composent<br />
sont relativement courts et épais, même au niveau des articulations. Les soies
iim,<br />
iutn<br />
: a«<br />
qi*<br />
le.<br />
m CÜJ<br />
ItCi<br />
l*.<br />
IM<br />
lue<br />
\<br />
tii<br />
«K<br />
lui-<br />
1110<br />
»l<br />
im uc<br />
les<br />
itc<br />
les<br />
hs<br />
TS<br />
nt<br />
es<br />
•I*<br />
iolu<br />
k<br />
lit<br />
:s<br />
RI<br />
FM. 2. — Leptokoenenia scurra n. <strong>sp</strong>. : P.I, P.II, P.III, pattes ; r : « soie raide » ou « soie dcnsblc » ;<br />
tr, : trichobolhrle,
50 FRANÇOISE MONNIOT<br />
barbelées varient d'un individu à l'autre, sans que le sexe intervienne. Nous<br />
avons figuré les appendices d'un mâle adulte. Le nombre et la longueur des<br />
soies sont les mêmes à droite et à gauche pour un même individu.<br />
Les palpes (fig. 3).<br />
La coxa triangulaire possède ici 14 soies et 2 épines, Le trochanter, mince<br />
dans sa partie basale, s'élargit rapidement pour devenir cylindrique ; il porte<br />
8 soies dont 1, raide et longue, à la base de son bord interne. Le fémur possède<br />
également 1 soie longue interne et 6 autres plus courtes. Le tibia, renflé en son<br />
milieu, mesure environ 50 . Comme sur les articles précédents il existe une<br />
soie raide sur le bord interne, mais cette fois plus courte ; on compte aussi<br />
3 soies sur le bord externe et 4 à l'extrémité distale de l'article. Le basitarse I<br />
(.15 |i) n'a qu'une soie méclio-ddrsale. Le basitarse II est moins long que large<br />
(23 n/26 1-0 I il porte 7 soies courtes. Le tarse I (15 u-) n'a qu'une soie courte<br />
externe, Le tarse II (26 u.) comprend 2 soies externes, 2 internes, 1 antérieure<br />
et 1 postérieure, Le tarse III conique (28 u.) possède trois sortes de phanères :<br />
18 soies barbelées banales, 2 soies bifides très courtes de chaque côté de la<br />
gouttière unguéale, 2 soies courtes barbelées d'un seul côté (flg. 3). Sur le<br />
pseudonychium terminé en griffe bien chitinisée, barbelée, s'insèrent latéralement<br />
2 griffes peu recourbées terminées en pointe effilée qui portent sur<br />
leur face interne de longues barbules (flg. 3).<br />
Les pattes I (fig. 2).<br />
Beaucoup plus longue que les autres, la première paire de pattes se diiïérencie<br />
surtout des autres appendices par la présence de longues trichobothrics<br />
et de soies doubles dont nous verrons plus loin la structure. La coxa allongée<br />
porte 11 soies, le trochanter 5 seulement, le fémur 8. Sur la patelle et sur la<br />
face dorsale, au milieu de l'article, prend naissance une trichobothrie longue,<br />
très fine et barbelée. Au-dessus de celle-ci s'insère une longue soie barbelée ;<br />
on compte aussi 3 soies plus courtes. Le tibia (63 |ji) donne naissance à 6 soies.<br />
Le basitarse I (25 u.) comprend 3 soies et 2 trichobothries longues, Le basitarse<br />
II (25 u.) possède également 2 trichobothries ; il s'y ajoute 5 soies barbelées<br />
de type normal. Le basitarse III (40 n) porte 1 soie barbelée courte sur le<br />
bord tergal et 2 soies doubles, longues, dont l'une, tergale, prend naissance<br />
à la base de l'article contre le basitarse II, l'autre au 1/3 proximal sur le bord<br />
sternal. Cette dernière est plus courte que l'article et que son homologue<br />
tergale, Elle corre<strong>sp</strong>ond à ce que l'on a l'habitude de nommer « soie raiclc »<br />
chez les autres <strong>Palpigrade</strong>s. Nous discuterons plus loin cette question. Le<br />
basitarse IV (21 u.) a une trichobotrie, 1 soie barbelée longue, 5 soies banales,<br />
Le tarse I (15 u,) porte 2 soies banales et 3 soies doubles (1 dorsal et 1 de<br />
chaque côté). Le tarse II (21 u.) présente 4 soies barbelées et 1 trichobothrie.<br />
Le tarse III (60 n) possède encore 1 soie de chaque côté ; on y compte<br />
aussi 18 soies barbelées banales, 5 soies barbelées d'un seul côté très courtes<br />
analogues à celles du dernier article des palpes, et 2 soies bifides très courtes.<br />
Les griffes sont longues, étroites, effilées. Nous n'y avons pas vu de barbules.<br />
La griffe médiane s'insère entre deux expansions lamellaires du pseudonychium.<br />
Elle est très marquée, un peu plus courte que les griffes latérales.<br />
Les pattes II (fig. 2).<br />
La deuxième paire de pattes,, la plus courte, ne présente pas de caractères<br />
particuliers. Elle ne possède que des soies barbelées coniques assez courtes
UN PALPIÜUADE JNTCRSTITIEL ! LEPTOKOBNGNIA SCUIiUA, N. SI'. 51<br />
^> -'^ ^ :?^--!?_^%^ 1 r palpe<br />
'V>-f >-'''' S ' ' ' ^' - - >A-'v.*»-f'<br />
FIG. 3. — Lcptokociieina stitrra n. <strong>sp</strong>. : en linut et à droite, pallo IV et détail des griiïcs ; en bas<br />
à gauche, palpe avec les détails des griffes cl des soies du iarse ; r : tldlail d'une « soie doubla ».<br />
R IV
52 FRANÇOISE MONNIOT<br />
et 1 longue sur le bord externe de la coxa. La protubérance interne de la<br />
coxa est allongée, simpLe. La sétation peut se résumer ainsi : coxa 8 soies ; trochanter<br />
3 ; fémur 4 ; patelle 5 ; tibia 5 (29 u.) ; basitarse 4 (23 (A) ; tarse 9<br />
(31 u.) ; la griffe médiane, insérée entre deux lamelles du post-tarse a une<br />
longueur égale à celle des griffes latérales et une forme semblable. Celles-ci,<br />
fortement courbées, ont une extrémité effilée. Sur leur bord ventral et interne,<br />
on distingue avec difficulté de fins denticules, tandis que le bord externe est<br />
élargi en lame. Il existe une gouttière unguéale,<br />
Les pattes III (fig. 2).<br />
Elles sont un peu plus longues que les pattes II, de même type : coxa 5<br />
soies et une protubérance épineuse interne ; trochanter 1 soie ; fémur 3 ;<br />
patelle 6 ; tibia 5 (21 u.) ; basitarse 3 (25 u.) ; tarse 10 (29 p,} ; les grifTes sont<br />
semblables à celles des pattes II.<br />
Les pattes IV (fig. 3).<br />
Nettement plus longues que les pattes II et III, les pattes de la 4 e paire<br />
restent pourtant beaucoup plus courtes que les pattes I. La coxa ovale porte<br />
7 soies mais pas de protubérance épineuse, le trochanter 2 soies et 1 épine,<br />
le fémur 3 soies. La patelle, comme le fémur, montre 1 soie longue barbelée<br />
sur son bord interne ; il s'y ajoute 4 soies plus courtes, Le tibia ; long (59 )<br />
possède 5 soies. Le basitarse (29 (j,) avec 3 soies barbelées coniques porte 1 soie<br />
double analogue à celles ds pattes L Cette soie double est l'équivalent de In<br />
« soie raide ». Elle s'insère ici à l'extrémité du bord tergal de l'article (1/8<br />
distal) (fig, 3). Le tarse I (16 n) compte 4 soies ; le tarse II (20 n), 5 soies cl<br />
2 soies doubles, courbées, qui prennent naissance au milieu du bord tergal<br />
de ce dernier article et se terminent entre les griffes. Les griffes, fortement<br />
courbées possèdent des dents internes (fig, 3), Le post-tarse forme ici encore,<br />
deux lamelles étendues entre lesquelles s'articule la grille médiane, dentée<br />
aussi. Celle-ci possède dorsalement une sorte de talon, plus marqué qu'aux<br />
pattes II et III. La gouttière unguéale est présente comme à toutes les pattes,<br />
Les griffes de Leptokoenenici scumi semblent bien avoir la même valeur,<br />
la griffe médiane est nettement articulée sur une pièce squelettique ; le<br />
post-tarse ou pseudonychium. Cette griffe de grande taille, surtout aux pattes<br />
II, III, IV, est insérée au môme niveau que les griffes latérales ou un peu en<br />
arrière. Aux palpes, la griffe médiane est dentelée comme les griffes latérales.<br />
Il serait intéressant d'étudier en détail les griffes de différentes e<strong>sp</strong>èces de<br />
<strong>Palpigrade</strong>s et de tous leurs appendices de façon a pouvoir les comparer. I<br />
Chez l'exemplaire de Koenenia mirabilis que nous avons disséqué, les griffes !<br />
sont lisses, les deux lamelles du post-tarse sont absentes. La structure des . J<br />
tarses est peut-être liée à l'habitat de l'e<strong>sp</strong>èce. •;<br />
Remarque : Plusieurs caractères de sétation méritent une attention parti- :<br />
culière. Les « soies raides » des basitarses des pattes I et IV constituent dans f<br />
les descriptions de <strong>Palpigrade</strong>s un caractère de systématique important. Elles i<br />
avaient été déjà signalées par RUCKER chez Prokoenenîa wheeleri en 1901 et en -,<br />
1901 également par HANSEN qui les différencie en leur attribuant un rôle senso- \<br />
riel. Ce dernier auteur les décrit comme des soies larges, aplaties et creuses, f<br />
portant de fines barbules. Il signale lui-même que son microscope ne lui per- j<br />
met pas d'aller plus loin dans l'interprétation. ROEWBR en 1934 souligne la j<br />
difficulté, Ces soies n'ont plus été décrites depuis, ni figurées malgré le rôle
UN PAL1MGKADE INTERSTITIEL ! LEl'TOKOENENIA SCURRA, N. SI'.<br />
10<br />
. 4. -- Leplokuetteitia .tcnrra a. <strong>sp</strong>. : i>r',, fwcc scernnlc du prosuinc ; f $ , ilngeile d'un<br />
mâlu (en rcgcruinUion ?) ; f $, Dagcltc d'une femelle ; op, imm-, oplislliosome d'un<br />
immalui'c.<br />
systématique qui leur était donné. Les moyens optiques actuels permettent<br />
pourtant, avec un simple contraste de phases, une interprétation nouvelle.<br />
Chez Koenenia mirabilis, comme chez Le p to ko en enta scurra, ces soies sont<br />
en réalité composées chacune de deux soies longues, isodiamétrïques, barbe-<br />
£?<br />
53
SI-: MIINNHIT<br />
lées insérées sur une base commune. Parallèles, elles déterminent entre elles<br />
un e<strong>sp</strong>ace qui s'élargit quand l'ensemble des deux^soies est accidentellement<br />
courbé. Ces soies sont beaucoup plus grosses ehe/ Kvoicnîu mirabilis que chez<br />
Leptokoenenia saura, leur embase plus forte prend une l'orme de 8, Les deux<br />
soies parallèles sont de mêmu longueur et probablement maintenues l'une<br />
contre l'autre au moyen de leurs barbules enchevêtrées. Ces soies doubles que<br />
nous continuerons à désigner par (r) sur les ligures, ne sont pas « raides »,<br />
mais seulement flexibles dans un plan perpendiculaire à celui de leur aplatissement.<br />
Ce type de soie n'existe que sur les inities I et IV ehe/. Lcplokvenenia<br />
scuri'a.<br />
Les trichobothiïes sont tout à l'ail conformes à ce qui a été décrit par<br />
HANSEN en 1901. Elles sont finement barbelées et insérées au fond de cupules<br />
membraneuses hautes.<br />
Les soies bifides que l'on trouve sur différents articles des pattes de<br />
Koenema mirabilis sont totalement absentes ehe/. Lcplokocnenia set t r m. Celles<br />
qui sont placées à l'extrémité des tarses des pattes I et des palpes sont beaucoup<br />
plus courtes eL d'un autre type.<br />
Les soies coniques barbdées, épaisses ehe/, noire e<strong>sp</strong>èce <strong>interstitiel</strong>le, ont<br />
une structure <strong>sp</strong>iralée : chaque barbule, de même mille que les petites épines<br />
de la pubescence des pattes, s'insère sur une ligne régulière.<br />
Les soies dentelées d'un seul côté des tarses des palpes et des pattes I<br />
n'ont aucun rapport avec la structure des soies coniques de l'ensemble du<br />
corps. Elles présentent, en plus petit, la l'orme des soies du premier article<br />
des chélicères. Elles n'existent pas sur les trois dernières paires de pattes.<br />
— L'opisthosomc.<br />
Il comprend 11 segments nettement individualisés. Le premier article ne<br />
porte pas de soies sur sa face dorsale, il y a seulement 2 paires de soies ventrales<br />
chex le mâle, l ehe/, la Femelle. Le deuxième article possède 3 paires de<br />
soies sur la face tergale. Sur le troisième segment opisthosomien naissent<br />
2 paires de soies tergalcs et 1 paire cte soies latérales, di<strong>sp</strong>osition qui se retrouvera<br />
sur tous les articles suivants jusqu'au 8" Sur lu face ventrale il existe<br />
2 paires de soies, plus proches de la ligue médiane ehe/, la femelle que chez le<br />
mâle où elles sont séparées par les valves génitales plus longues, Toutes les<br />
soies dont nous venons de parler sont coniques et barbelées, équivalentes aux<br />
soies des appendices. Sur les 4", 5 et 6 e articles et sur la face stermile, se<br />
trouve 1 paire de soies de même épaisseur que les précédentes et dans une<br />
position plus médiane et plus antérieure 1 paire de soies plus courtes et plus<br />
épaisses, arrondies à leur extrémité (lig, S). El les sont remplacées au 7 e segment<br />
par des soies identiques aux autres et di<strong>sp</strong>osées sur le même cercle. Les<br />
8 e , 9", 10« et 11 5 segments ont une sétation identique, c'est-à-dire 1 paire de soies<br />
tergaies, 1 paire de soies latéro-tergales et 2 paires de soies ventrales, soit un<br />
cercle de 8 soies par segment.<br />
— Le flagelle.<br />
Il n'était présent que chez deux femelles et un mâle.<br />
Le flagelle s'insère sur le dernier article de l'opi.sthosome par l'intermédiaire<br />
d'une pièce chilincusc conique. Cette pièce s'attache sous un éperon
v.?<br />
UN PALPlültADB IKTERSTITIEL : LEPTOKOENBNIA SCUKKA, N. SP.<br />
/ V<br />
Fio. 5. — Leptokoetienia scurra n. <strong>sp</strong>. : A et B, exU'émhé poslirïcnne de l'opistllosomc de<br />
profil et en vue dorsale ; eh., chéltctro h la même dcliolte ; s.l,, organo sensoriel lalcra! ;<br />
s.m,, organe sensoriel médian ; s.o.4, A' segment opisllio&amicn en vue slcrnalc ;<br />
v. $, volets génitaux tlo la fcraolle.
5ß FRANÇOISE MONNIOT<br />
dorsal du 11° segment opisthosomien, mais n'atteint pas le bord ventral tic<br />
l'article. L'e<strong>sp</strong>ace laissé libre est occupé par l'anus. Le bord du dernier segment<br />
de l'opisthosome se prolonge au-dessus de l'anus et de chaque côté de<br />
l'article basai du flagelle par une fine membrane découpée en crénaux (fig, 5,<br />
A et B). Cet article basai porte dorsalement une petite épine médiane, puis<br />
1 paire de soies barbelées fines ; sur la face ventrale il y a 1 paire de soies<br />
barbelées plus fortes. Le tégument de cet article est pubescent, comme le reste<br />
du corps. Le premier article du flagelle (ou le 2 e suivant les auteurs) est le seul<br />
qui soit nettement renflé en son centre, tous les suivants restent approximativement<br />
cylindriques, II porte 8 soies longues, coniques, barbelées et raicles.<br />
Sur son bord distal il est prolongé par un rang d'épines assez longues, serrées,<br />
di<strong>sp</strong>osées en cercle continu (fig. 4). Les deux articles suivants portent également<br />
un cercle de soies longues (7 seulement) et un rang d'épines. Le 4 e article<br />
n'a pas d'épines mais 7 soies barbelées. Les 5 e , 7°, 9 e articles portent des épines<br />
et un cercle de 6 soies longues. Les 6 e , 8 e , 10 e , 11 e , 12 e , 13 e articles, plus allonges<br />
possèdent seulement un rang de 7 soies barbelées, Le 14 e et dernier article (ou<br />
15 e si l'on compte l'article basai) comprend un cercle postérieur de 6 soies<br />
barbelées et une papille terminale elle-même prolongée par une soie semblable.<br />
<strong>Un</strong> individu mâle portait une flagelle de 6 articles seulement (fig. 4), Le<br />
dernier article portait la papille et la soie terminales, ce qui exclut l'hypothèse<br />
d'une cassure. Peut-être y a-t-il eu régénération, à moins que nous soyons en<br />
présence d'un caractère sexuel secondaire, II n'existe aucun renseignement à<br />
ce sujet clans la littérature.<br />
— Les valves génitales.<br />
Elles occupent un volume important chez le mâle, dû à leur position<br />
écartée du corps. Elles restent plus petites chez la femelle.<br />
Le mâle.<br />
Les 3 volets génitaux superposés sont symétriques par rapport à la ligne<br />
médiane du corps. Le premier volet génital se compose d'abord, de chaque<br />
côté, d'un groupe de 3 soies barbelées, à embase large, dans la partie la plus<br />
antérieure. Puis, de l'extérieur vers l'intérieur, on trouve 1 soie courte, 1 soie<br />
longue et 1 courte sur un lobe, ensuite 1 soie assez courte sur un deuxième<br />
lobe. (Nous avons observé sur un autre mâle 2 soies au lieu d'une sur le lobe<br />
le plus interne du premier volet génital). Dans un plan un peu plus profond,<br />
partant des deux lobes de chaque côté du premier volet génital, on observe<br />
des formations coniques allongées, prolongées par un poil enroulé en tirebouchon,<br />
Cette très longue soie possède de fins <strong>sp</strong>inules en continuité avec la<br />
pubescence du tégument, plus courts que les barbules des soies. Dans ces poils<br />
on distingue un canal que l'on peut suivre clans le premier volet génital et<br />
jusque dans le premier segment opisthosomien (fig. 6). Ces poils sécréteurs<br />
corre<strong>sp</strong>ondent à ce qui a déjà été décrit dans différentes e<strong>sp</strong>èces de <strong>Palpigrade</strong>s,<br />
mais cette fois leur longueur et leur forme sont très différentes, On<br />
ignore encore le rôle de ces formations.<br />
Le deuxième volet génital se décompose aussi de chaque côté en deux<br />
parties : un lobe interne terminé par une pointe aiguë' qui porte 3 soies, et un<br />
lobe externe, dans un plan plus profond, également terminé en aiguille avec<br />
3 soies aussi. Enfin, sous ces formations, se situe le 3° volet génital arrondi et
UN PAU'IGRAUE INTERSTITIEL ! LEPTOKOENENIA SCURKA, N. SI", 57<br />
Fiu. 6. — teptokaotieuiii sctirra a. <strong>sp</strong>. : volets génitaux du mâle ; c., canaux ;<br />
p,s., poil sécréteur.<br />
plus simple qui ne porte qu'une soie longue de chaque côté du corps. Toutes<br />
les soies des volets génitaux sont coniques et barbelées, de structure semblable<br />
à celle que nous avons décrite jusqu'à présent.<br />
La femelle.<br />
L'appareil génital femelle ne comprend que 2 volets génitaux. Le premier<br />
médian, porte 7 paires de soies di<strong>sp</strong>osées selon la figure 5. Le deuxième volet<br />
est divisé en deux lobes symétriques, arrondis, terminés chacun vers l'arrière
BäffiSSl<br />
r-jfl FHANÇOISlî MONN10T<br />
par 2 soies barbelées raicles. Entre ces deux lobes, et sous le premier, s'ouvre<br />
l'orifice génital femelle. On distingue par tran<strong>sp</strong>arence 1'« utérus » dont la<br />
paroi semble chitinisée sur une certaine longueur.<br />
Les organes génitaux externes sont donc semblables à ce que l'on trouve<br />
dans l'ensemble des <strong>Palpigrade</strong>s, Les testicules pairs s'étendent sur presque<br />
toute la longueur de l'opisthosome et contiennent des <strong>sp</strong>ermatophores, peu<br />
visibles après éclaircissement, mais qui se rapprochent de ceux vus par<br />
RÉMY (1950) chez Eukoenenia delphini. Nous n'avons pu observer l'ovaire.<br />
Comparaison de Leplohoenenia scurra n. <strong>sp</strong>. avec L, gerlachi Conclu (1)<br />
Nous ne pourrons donner ici que quelques traits morphologiques essentiels<br />
parmi ceux qui permettent de différencier notre e<strong>sp</strong>èce de celle de Mer<br />
Rouge. Les caractères génériques communs, d'après la diagnose de CONIXÉ,<br />
dont nous devons tenir compte, sont les suivants ;<br />
— la forme de l'opisthosome ;<br />
— (l'absence de soies sur la face sternale du prosome) (coro, pers,) ;<br />
— la faible longueur des pattes ;<br />
— la forme de l'organe sensoriel frontal.<br />
Par contre quelques caractères sont franchement différents dans les deux<br />
e<strong>sp</strong>èces et justifient une coupure systématique. (Nous avons un immature en<br />
très mauvais état, mais il permet une comparaison bien qu'il ne puisse donner<br />
lieu à une description précise). L'un des caractères les plus importants est à<br />
notre avis le nombre de soies dorsales de l'avant dernier segment de<br />
l'opisthosome : 3 chez L. gerlachi et 2 paire chez L. scurra. On peut considérer<br />
ensuite le nombre de dents des chélicères : 7 au lieu de 9 au moins, la<br />
sétation de l'avant dernier article de l'opisthosome, la sétation et les proportions<br />
des articles des pattes. Tous ces caractères sont ceux sur lesquels sont<br />
basées les divisions <strong>sp</strong>écifiques dans les autres genres.<br />
CONCLUSION<br />
Dans cette étude morphologique nous avons été très gênée par la caractère<br />
sommaire des descriptions précédentes des autres <strong>Palpigrade</strong>s. En effet,<br />
en dehors de la synthèse de ROEWER en 1934 sur ce groupe, il n'existe pas de<br />
description totale d'un animal depuis 1901. Les comparaisons sont donc<br />
réduites. Il est vrai que les auteurs modernes signalent la ressemblance<br />
extrême des différentes e<strong>sp</strong>èces malgré leur éloignement géographique.<br />
Paris<br />
Pnlpigri " les dans lc milicu >nl c litie' littoral, C. R. Acail. Se/..
UN l'ALPIGUADE INTERSTITIEL : LEPTOKOBXBNIA SCURKA, N. SI 1 . 59<br />
II faut signaler aussi que la systématique des Microtéliphonides reste<br />
basée sur quelques détails de sétation, et les proportions des articles des<br />
pattes ; si leur intérêt est certain, les figures manquent. Il n'y a donc aucune<br />
possibilité de connaître la forme des différentes parties des appendices, ni leur<br />
épaisseur ni leur mode d'articulation.<br />
Beaucoup de détails d'un intérêt plus général sont également passés sous<br />
silence. Je pense particulièrement aux griffes, aux trichobothries, aux soies<br />
doubles, à l'insertion du flagelle, la direction générale des appendices. Ces<br />
renseignements permettraient peut-être de relier les Paipigrades à d'autres<br />
groupes d'Arachnides, même éloignés,<br />
II n'existait pas jusqu'à présent d'Arachnides marins en dehors des Acariens<br />
(Halacariens, Hydracariens). On connaît des Araignées marines, mais<br />
elles ne sont pas véritablement aquatiques puisque elles emportent sous l'eau<br />
avec elles des bulles d'air dont elles vivent. Beaucoup d'Arachnides de divers<br />
groupes sont littoraux, Ceci n'implique pas une vie marine, Ils supportent les<br />
embruns en menant une vie totalement aérienne.<br />
L'origine marine des Arachnides a donné lieu à de nombreuses discussions.<br />
Les <strong>Palpigrade</strong>s, incontestablement primitifs dans ce groupe, vont, avec des<br />
représentants marins, donner lieu à de nouvelles discussions. DBLAMARE et<br />
PAULIAN avaient déjà trouvé à Madagascar des <strong>Palpigrade</strong>s dans la faune<br />
<strong>interstitiel</strong>le, mais ils ont été déterminés comme des e<strong>sp</strong>èces communes, sans<br />
grand intérêt, La récolte en Mer Rouge d'un individu de L. gerlachi, même<br />
immature, dont l'a<strong>sp</strong>ect général se rapproche de notre nouvelle e<strong>sp</strong>èce, p!aide<br />
en faveur d'un biotope aquatique possible. Cette trouvaille dans le sable de<br />
plage à la limite de la zone de déferlement, représente pour nous un argument<br />
important pour prouver que les <strong>Palpigrade</strong>s peuvent avoir des représentants<br />
<strong>interstitiel</strong>s plus nombreux. Leur découverte accidentelle devra donner lieu à<br />
des recherches sélectives.<br />
Les caractères adaptés de ces animaux (ceux des pattes surtout) seraient<br />
primitifs, ainsi que le petit nombre des soies. On pourrait envisager un<br />
passage de la mer vers la terre. Pour les e<strong>sp</strong>èces terrestres, les récoltes les<br />
plus abondantes sont toujours effectuées à proximité des cours d'eau, On pourrait<br />
imaginer une étape évolutive en eau douce, A cette hypothèse s'opposent<br />
d'autres arguments par exemple la présence d'un tégument pubescent, caractéristique<br />
des animaux aériens.<br />
La découverte d'une e<strong>sp</strong>èce <strong>interstitiel</strong>le aura apporté plusieurs sujets<br />
d'étude et à cette occasion redonne au groupe des <strong>Palpigrade</strong>s un intérêt nouveau.<br />
En dehors des questions évolutives, encore insolubles, l'étude morphologique<br />
de notre nouvelle e<strong>sp</strong>èce montre la nécessité de réétudier en détail les<br />
soies, les griffes, de tous les genres. La biologie nécessiterait des élevages et<br />
apporterait certainement des renseignements précieux. La répartition verticale<br />
dans les sédiments devrait fournir le sujet d\me étude écologique d'un grand<br />
intérêt,<br />
LADORATOIRE D'ÉCOLOGIE GÉNÉRALE<br />
DU MUSÉUM. BRUNOY.
FRANÇOISE MONNIOT<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
BORLAND (L ) 1914. — <strong>Un</strong> palpigrade nouveau trouvé clans les serres du Muséum<br />
National d'Histoire Naturelle. Bull. Soc. Ent. France (375-377), 8 fig.<br />
BERLAND (L ) 1932, — Les Arachnides (Scorpions, araignées, etc...), Biologie - Systématique,<br />
Encyd. entom. 16, Paris, Lechevallier (1-485), 636 fig.<br />
BORNER (C.), 1901, — Zur äusseren Morphologie von Koenenia mirabilis Grassi.<br />
Zool. ànz. B. 24 (537-556), 12 fig.<br />
BORNER (C.) 1902, — Koenenia mirabilis und andere peclipalpen. Verh. Detistch. zoot<br />
Ges., J2 (214-215).<br />
BORNRR (C.), 1904. — Beiträge zur Morphologie der Arthropoden. I. Ein Beitrag zur<br />
Kenntnis der Pectipalpen. Zoologica, n° 42 (1-174), pl, 1-7,<br />
BUXTÛN (D.H.), 1913. — Coxal glands of the Arachnids. Zool. Jahr. Suppl. 15,<br />
(231-282), pl. 143.<br />
BUXTON (B. H.), 1917. — Note on the anatomy of Arachnida. The coxal glands of the<br />
arachnids. The ganglia of the Arachnids. Journ. morph. Philadelphia, 29<br />
(1-25).<br />
CONDÖ (B.), 1948. — Sur le mâle de Koenenia mirabilis Grassi (Arachnides <strong>Palpigrade</strong>s).<br />
Bull Mus. Flist. Nat. Paris (2), 20, 3 (252-253).<br />
CQNDÉ (B.), 1951. — <strong>Un</strong>e Koenenia cavernicole du Montserrat (Catalogue). (Arachnides,<br />
<strong>Palpigrade</strong>s). Rev. Franc. Entom., Paris, 18 (42-45).<br />
CÛNDIÎ (B.), 1951. — Campodéidés et <strong>Palpigrade</strong>s de Basse-Egypte. Bull. Mus. Hist.<br />
N al. Paris, 2" sér., 23 (211-216).<br />
CONDÉ (B.), 1951. — Le <strong>Palpigrade</strong> Koenenia berlesei Sllv. en France Continentale.<br />
Soc. Linn. Lyon 20' année, n° 3 (184-185),<br />
CONDÉ (B.), 1954. — Sur la faune endogée de Majorque (Penicillates, Protoures,<br />
Diploures, Campodeides, <strong>Palpigrade</strong>s), Bull. Mus. Hist, Nat. Paris, 2° sér.,<br />
(24), 6 (674-677).<br />
CONDÖ (B.), 1955. — <strong>Un</strong>e Koenenia cavernicole de Roumanie. Notes bio<strong>sp</strong>, 9<br />
(145-148).<br />
CONDB (B.), 1956, — Microteliphonides cavernicoles des Alpes de Provence et du<br />
Vercors. Bull. Mus. Hist. Nat, Paris, 2' sér, (28), 2 (199-204).<br />
CONDÖ (B,X 1956. — MicroteJiphonides cavernicoles des Alpes de Provence et du<br />
Vercors (Suite et fin). Bull Mus. Hist. Nat. Paris, 2" sér. (28), 6 (512-518).<br />
CONDÊ (B.), 1956. — <strong>Un</strong>e Koenenia cavernicole de Sardaigne (Arachnides microteliphonides).<br />
Notes bio<strong>sp</strong>., 11 (13-16).<br />
COKDÉ (B.), 1965. — Présence de <strong>Palpigrade</strong>s clans le milieu <strong>interstitiel</strong> littoral.<br />
C. R. Acad. Sei. Paris, 261, gr. 12 (1898-1900).<br />
GINET (R.), 1956. — Faune cavernicole du Vercors et du Diois IL Stations pro<strong>sp</strong>ectées<br />
en 1954 et 1955. Bull. Soc. Linn. Lyon, 25 (86-88),<br />
GINBT (R,) et GENEST (L. C.), 1954, - Faune cavernicole du Vercors I. Stations pro<strong>sp</strong>ectées<br />
pendant la campagne 1953. Bull. Soc. Linn. Lyon, 23 (73-80),<br />
GRASSI (B.), 1886. Progenitori dei Miriapodi e degli Inselti rnem. V. Intorno ad un<br />
nuovo Aracnide artrogastro (Koenenia mirabilis) rappresentante di un nuovo<br />
ordlne (Microteliphonida). Bail. soc. ent. Ital. Firenze, 18 (153-172), pl. IX-X.
UN PALPIGRADB INTERSTITIEL : LEPTOKOENENIA. SCURRA, N. SP. Gl<br />
GRASSI (B.) et CALANDRUCCIO (S,), 1885. — Intorno ad un nuovo Aracnide Artrogastro<br />
(Koenenia mirabilis) ehe crediamo rappresentante d'un nuovo ordine (Microtheliphonida).<br />
Naturaliste, siciliano, 4 (127-133) et (162-168).<br />
HAASE (E.), 1890, — Eine neue Artlu'ogastren-Familie aus dem weissen Jura. Zeit sehr,<br />
d, deutsch. Geolog. Ges., 42 ( ), pl. 31.<br />
HANSEN (H.J.), 1901. — On six <strong>sp</strong>ecies of Koencnia, wich remarks on thé order<br />
Palpigracli, Ent. Tidskr., 22 (193-240).<br />
HANSEN (H.J.), 1926. — Bio<strong>sp</strong>eologica 53 — Palpigradi (2° série). Arch. Zool. Exp.<br />
Gen., 65 (167-180), pl. 2, 3,<br />
HANSEN (H. J.), 1930. — Studios in Arthropoda. 3. Teil. Kopenhagen.<br />
HANSEN (H,J.) et SORENSEN (W.), 1897. — The order Palpigradi Thorell (Koenenia<br />
mirabilis Grassi) and its relationships to other Arachnida, Ent. Tidskr,, 18<br />
(223-240), pl. 4 .<br />
JANBTSCHEK (H.), 1952. — Beitrag zur Kenntnis der Höhlentierwelt der nördlichen<br />
Kalkalpen, Ver. Z. Schütze der Alpenpfl, lt. Tiere München, e, 5, (3-27).<br />
JANUTSCHEK (H.), 1957. — Das Seltsamste Tier Tirols. Festschr. 50 jähr. Best. Kirfsteiner<br />
Mittdsch 1907-1957. Kufsteiner Buch 3, Schlcrn-Schr. 158, Insbruck,<br />
Wagner (192-214).<br />
JEANNEL (R.), 1926. — Faune cavernicole de la France, etc. Encycl. eniom., 8, Paris,<br />
Lechevallier éd. (334), 74 flg.<br />
JCANNEL (R.) et RACOVITZA (E. G.), 1912. — Bio<strong>sp</strong>eologica XXIV. Enumeratlon. des<br />
grottes visitées (4 e série). Arch. Zool. Exp. Gén., 5, 9 (501-667).<br />
KÄSTNBR (A.), 1932. — Palpigradi Thorell in ; Kukenlhal-Krumbach, Handbuch der<br />
Zoologie, 3 (2 e part.) (77-98).<br />
KRAGPELTN (K.), 1901. — Palpigradi und Solifugae. Das Tierreich, 12 (1-3),<br />
LAWRENCE (R. F.), 1947, — A collection ou Arachnida made by D. I, Trägarolh in Natal<br />
and Zululand (1904-1905). Göteborgs Kimgl Vetensk. ach Vitterh. Sombrai<br />
Handl. Sjätle Följd, B. 5, n° 9 (41 p.).<br />
MELLÛ-LEITAO (C, de), 1940. — Notes sur la systématique des <strong>Palpigrade</strong>s, 6° congr.<br />
Int. Ent. 1935 Madrid, l (143-144),<br />
MELLO-LEITAO (C. de) et ARLÉ (R.), 1935, — Consideraçoes sobre a ordern Pedipalpi<br />
coma descriçao de una nova c<strong>sp</strong>ecies, Ann. Acad. Bras. Soi. Rio. (7), 4 (339-<br />
343), 1 pl., 6 fig.<br />
MILLOT (J.), 1926. — Contribution h l'histophysiologie des Aranéides. Bull. biol.<br />
France Belgique, suppl. 8 (1-238), pl. 1-5.<br />
MILLOT (J.), 1936. — Métamérisation et musculature abdominale chez les Aranéornorphes.<br />
Bull. Soc. Zool. France, 61, n" 3 (181-204).<br />
MILLOT (J.), 1942. — Sur l'anatomie et l'histophysiologie de Koenenia mirabilis Grassi<br />
(Arachnida, Palpigradi). Rev. Fr. Ent, Paris, 9, 2 (33-51).<br />
MILLOT (J.), 1943, — Notes complémentaires sur l'anatomie, l'histologie et la répartition<br />
géographique en France de Koenenia mirabilis. Rev. F : Ent., 9,<br />
fasc. 1 et 2 (127-135).<br />
MILLOT (J.), 1949. — Ordre des <strong>Palpigrade</strong>s, In , P. Grasse • Traité de zoologie, 6,<br />
Paris, Masson et C" ed, (520-532).<br />
PETRUNKBVITCII (A,), 1949. — A study oi ; Palaeozoic Arachnida. A study oD thé structure,<br />
classification and relationships of thé Palaeoxoic Arachnida based on thé<br />
collections of thé British Museum. Trans. Conn. Acad, Arts. Sei., 37 (69-315),<br />
pl. 1-83.
FRANÇOIS!! .MÛNNIOT<br />
PETRUNKEVITCH (A.), 1953. - Paleozoic and Meso/oic Arachnida of Europe. Man.<br />
Geol. Soc. Amer,, 53 (1-128), pi. 1-58.<br />
ppvmjTMHOFF (P de) 1902. — Découverte en France du genre Koenenia. (Aracli.<br />
i I 1 lil\lttlilUl L V.* • - / * . \ / _, TTT<br />
Palpigradi). Bull. Soc. Ent. France (280-283), iig. MI.<br />
PBYERIMHOPF (P de), 1905. — Recherches sur la faune cavernicole des Basses-A!pes.<br />
Ann. Soc'Ent. France, 75 (203-222).<br />
PHYERIMHOFF (P, de), 1906. — Sur l'existence à Majorque du genre Koenenia Bnll.<br />
Soc. Ent. France (300-302), 4 ug.<br />
PEYERIMHOFF (P. de), 1908. — Bio<strong>sp</strong>eologica VIII. Palpigradi. Arch. Zoo/, Exp. fît Gen.,<br />
sei: 4, 9, n« 3 (189-193).<br />
POCOCK (R.J.), 1893. — Morphology of thé Arachnida. Ann. Mag. Mat. l-Iisi., ,<br />
6 (1-19),<br />
RHHY (P.), 1942. — Quelques Arthropodes intéressants des serres du Parc clé la<br />
Tête d'Or. Bull. Soc. Linn. Lyon, 11 (140-142).<br />
RBMY (P.), 1948. — Sur la répartition du Palplgrade Koenenia mirabilis Grnssi en<br />
France et en Algérie. Bull. Mus, Mal. Hist. Nat. Pans, 2° sér., 27 (115-152).<br />
RE.UY (P.), 1948. — <strong>Palpigrade</strong>s du Mexique et de Cuba. Mexico Ciencia. Rav. fli<strong>sp</strong>.<br />
Amer, dette, pura y aplic., 9 (33-36).<br />
REMY (P.), 1949. — Sur la Biologie Sexuelle des Palpigradcs. Bull. Soc. Sei. Nancy,<br />
n. s., 8 (41-42).<br />
REMY (P.), 1949. — <strong>Palpigrade</strong>s de Corse. Bull. Mus, Nat. Hist. Nat. Paris, 2 e s«îr.r 21<br />
(218-223).<br />
REMY (P.), 1950. — Description d'un palpigracle nouveau, récolté par le D r A. de<br />
Barros Machado en Angola. Put. Cuil. Coin. Dianiantas Angola., 7 (123-128).<br />
REMY (P.), 1950. — <strong>Palpigrade</strong>s de Madagascar, Mein. Inst. Scient. Madagascar, A,<br />
4 (135-164).<br />
REMY (P.), 1951, — Nouvelles stations du Palpigraclc Koenenïa mirabilis Grassi.<br />
Bull. Soc. Ent. Fr., 56 (106-108).<br />
REMY (P.), 1952, — <strong>Palpigrade</strong>s du Maroc et d'Algérie occidentale. Bull, Soc. Set. mit.<br />
Maroc, 30 (159-163).<br />
REMY (P.), 1952. — <strong>Palpigrade</strong>s de l'Ile de la Réunion, Main, Inst. Scient. Madagascar<br />
A, 7 (69-79),<br />
REMY (P.), 1953. — Description d'un nouveau palpigracle d'Afrique occidentale française.<br />
Bull Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 2' sér., 25 (86-89).<br />
REMY (P.), 1956. — Contribution à l'étude de la microfaune enclogée de l'Afrique tropicale<br />
: <strong>Palpigrade</strong>s et Pauropodes. Rev. Zool But. Afr., 53 (327-335).<br />
ÏMY (P,), 1956, — Sur la microfaune endogée des jardins de Tanger (Sympliyles,<br />
Pauropodes, Penicillates, Protoures, <strong>Palpigrade</strong>s). Bull. Soc. Set. nat. ot pfiys.<br />
Maroc, 35 (103-108).<br />
REMY (P.), 1957. — NouvelLes stations marocaines du palpigracle Eukoenenta mirabilis<br />
Grassi. Bull. Soc. Sei. nat. et phys. Maroc, 36 (335-339).<br />
REMY (P.), 1957. — <strong>Palpigrade</strong>s et Pauropodes du Natal (récoltes du D' R. F. LAW-<br />
RENCE). Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 1' sér., 29 (221-225).<br />
REMY (P.), 1958. — <strong>Palpigrade</strong>s de l'Ile Maurice. Bull. Mauritius Inst., 5 (94-1O2).<br />
REMY (P.), 1959. — <strong>Palpigrade</strong>s et Pauropodes du Natal (nouvelles récoltes du<br />
D r R, F. LAWRENCE). Bull. Mus. Nat, Hist. Nat. Paris, 2' sér., 31 (256-26O).<br />
RRMY (P.), 1959. — <strong>Palpigrade</strong>s de Madagascar II. Mem. Inst. Sei, Madagascar, 13<br />
(33-66).<br />
REMY (P.), I960. — <strong>Palpigrade</strong>s de la région de Pondichery (Inde). Bull. Mtts, Mal.<br />
Hist. Nat. Paris, 2' sér., 32 (230-234).
UN PALPIGRADE INTERSTITIEL : LÏSI'TOKOENENIA SCUURA, N. SP. 03<br />
REMY (P, A.), 1961. — On thé soil microfauna of thé Hawaian Islands. Proc. Haw.<br />
Enlom. Soc,<br />
RBMY (P.A.), 1962. — <strong>Palpigrade</strong>s de la région de Tucuman (Argentine). Biologie de<br />
l'Amérique Australe Mission Cl. Delamare Deboutteville, 1, (281-285).<br />
ROEWER (C. Fr.), 1934. — Palpigradi in : Bronn's Klassen und Ordnungen das Tierreichs,<br />
5 (640-723).<br />
RoEwmi (C. Fr.), 1953, — Cavernicole Arachniden aus Sardinien. Notes Bio<strong>sp</strong>,, 8<br />
(39-49).<br />
RUCKER (A.), 1901, — The Texan Koenenia. Amei: Nalural, Boston, 35 ( 1 -630).<br />
RUCKER (A.), 1903. — A new Koenenia from Texas. Quart, Joitrn. Micr. Sei,, 47<br />
(215-231), pl. 18.<br />
RUCKER (A.), 1903. — Further observations on Koenenia. Zool. Jahrb. Syst., IS (401-<br />
434), pl. 21-23.<br />
SILVESTRI (F.), 1896. — <strong>Un</strong>e escursione in Tunisia ; Symphyle, Chilopoda, Diplopoda.<br />
Natural Sidliano, n. s., l (143).<br />
SILVESTRI (F.), 1899. — Distribuzionc geographica di Koenenia mirabilis Grassi ed<br />
altri piccoli Arthopodi. Zool. Am., 22 (369-371).<br />
SILVESTRI (F.), 1903, — Fauna Napolitana. Descrizione preliminare di due nuove<br />
<strong>sp</strong>ecie di Koenenia trovate in Italia, Ann, Mus. Zool. <strong>Un</strong>iv. Napoli, n. s., l,<br />
n° 11 (1-2).<br />
SILVESTRI (F.), 1905. — Note arachnologiche I-III. Redia, 2 (239-261), pl. XXI-XXIV.<br />
SILVESTRI (F.), 1913. — Novi generi e <strong>sp</strong>ecie de Koeneniidae, Boll. Lab. Zool. Gen.<br />
Agrar., l (211-217).<br />
ST0RMRR (L,), PETRUNKEVITCH (A.) et HEDGPBTH (J, W.), 1955. — part. P Arthropoda 2<br />
Chelicerata with sections on Pycnogonida and Palaeoisopus, Treatise on<br />
invertebrate Paleontology RC Moore Kunsas, I-XVII, (1-181), fig. l-1.22.<br />
STROUHAL (H.), 1936, — Die Entotrophi (Ins. Apteryg.) von Warmbad Villarch.<br />
Festsch. E. Strand, l (519-529).<br />
STROUHAL (H,), 1936, — Eine Kärntner Höhlen Koenenia (Araclmoidea Palpigradi).<br />
Zool. Anz„ 115 (161-168), 12 fig.<br />
STROUHAL (H.), 1939. — Die in den Höhlen von Waimbad Villach, Ka'rnten festgestellfen<br />
Tiere. Folia Zool. hydrobiol Riga, 9 (247-290).<br />
STROUHAL (H.), 1952. — Scorpionidea : Palpigradi. Catalogus Faunae. Austnae Wien,<br />
9a (1-2).<br />
STROUHAL (H.), 1956, — Scorpionidae, Palpigradi I Nachtrag. Catalogus Faunae<br />
Austrine, 9a (7-8).<br />
SZALAY (L.), 1956, — Der erste Fund von <strong>Palpigrade</strong>n in <strong>Un</strong>garn. Ann. Hist. Nat. Mas.<br />
Nat. Hungarici (s, nova), 7 (439-442).<br />
THORELL (T.), 1888, — Pedipalpi e Scarpioni dell Aräpelago Malg. Ann. nuis. civ.<br />
stör. nat. Genova ser, 2, 26 (358),<br />
VERSLUYS (J.) et DEMOLL (R.), 1921, — Die Verwandschaft der Merostomata mit den<br />
Arachnida und anderen Abteilungen der Arthropoda. Proc. Roy, Acad, Sei.<br />
Amsterdam, math, phys. Sect., 23 (739-765).<br />
VERSLUYS (J.) et DDMOLL (R.), 1923. — Das Limulus-Problera. Ergeh, u. Forscht: Zool.<br />
Jena, 5 (67-388).<br />
VORNATSCHER (J.), 1946. — Koenenia austriaca (Palpigradi) in den nördlichen Ostalpen.<br />
Speläologische Mitt., l (7-10).
FRANÇOISB MONNIOT<br />
64<br />
(U 1950. D- erste Fund eines echten Höhlentlerc» nördlich der<br />
Dräu. Die Höhle, l (161-168).<br />
WALF (B.), 1934-1938. Animalium cavernamm catalogus, 3 (535).<br />
WHBBLBR (W.), 1900. - A singer Arachnid (Ä*««,fa nnralnUs Gras») occunng ,n<br />
Texas. 4»w. N attirai, 34 (837-850).<br />
, 1Q2, _ <strong>Un</strong>tersuchungen über die Fauna der Hohlen II. EclUe<br />
WICH<br />
Sn NoÏÏoLlpen. loot Am., 67 (250-252).