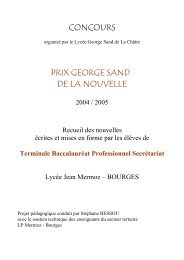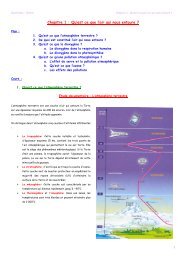Jean Fautrier, Les Otages, série, vers 1943
Jean Fautrier, Les Otages, série, vers 1943
Jean Fautrier, Les Otages, série, vers 1943
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Jean</strong> <strong>Fautrier</strong>, <strong>Les</strong> <strong>Otages</strong>, <strong>série</strong>, <strong>vers</strong> <strong>1943</strong><br />
1)Présentation<br />
Tête d'otage 1945 est une peinture à l'huile sur<br />
papier marouflé (collé) sur toile de 35 x 27cm.<br />
Elle appartient à une <strong>série</strong> d’une cinquantaine<br />
de peintures et sculptures exposées pour la<br />
première fois en 1945<br />
Grande tête<br />
tragique, bronze,<br />
1942« L’Otage qui<br />
donne la clef des<br />
autres, c’est le grand<br />
otage sculpté. Plutôt<br />
que des tableaux de<br />
<strong>Fautrier</strong>, ces figures<br />
viennent de la<br />
sculpture. » A. Malraux.<br />
<strong>Jean</strong> <strong>Fautrier</strong> est un artiste français né en 1898 à Paris et mort à Châtenay-Malabry en<br />
1964. A la mort de son père, au début des années 1910, il s'installe avec sa mère à<br />
Londres et est admis à la Royal Academy (école d’art) dès l'âge de quatorze ans. En<br />
1917, il s'engage dans l'armée (1ere guerre) puis s'installe à Paris où il expose pour la<br />
première fois en 1921. Dès 1927, il réalise des portraits, des natures mortes (objets),<br />
des paysages, animaux écorchés, nus soit une peinture figurative, souvent sombre par<br />
les couleurs employées (la couleur noire domine). Forcé par la crise économique, il<br />
abandonne la peinture et devient moniteur de ski et gérant d’hôtel dans les Alpes<br />
Il revient à Paris et se remet à la peinture lorsque la guerre éclate. À partir de 1940,<br />
<strong>Fautrier</strong> explore les possibilités de la matière. Il est avec <strong>Jean</strong> Dubuffet, le plus<br />
important représentant du courant de l'art informel. Il est aussi un pionnier de la<br />
technique de haute pâte. Il se partage entre sculpture et peinture. En <strong>1943</strong>, arrêté par la<br />
Gestapo, puis relâché, il se réfugie dans une clinique d’aliénés de la banlieue de Paris.<br />
Dans les bois environnants, les Allemands torturent des prisonniers et se livrent à des<br />
exécutions sommaires. Il tire de ces atrocités une <strong>série</strong> de petits panneaux qu’il appelle<br />
<strong>Otages</strong>. Il réalise aussi des sculptures, la grande Tête d'otage sera la dernière. Ces<br />
peintures seront exposées en 1945 à la galerie Drouin.<br />
Contexte historique : la deuxième guerre mondiale en France.<br />
Lors de la défaite de l'armée française en 1940, le gouvernement de Vichy,<br />
représenté par le maréchal Philippe Pétain, signe l'accord de l'armistice avec<br />
l'Allemagne, le 24 juin 1940. À ce moment-là, la France est profondément divisée<br />
entre la collaboration avec les Allemands ou la poursuite de la guerre. La Résistance<br />
s’organise. C’est le temps des dénonciations, des arrestations par la Gestapo (la<br />
police nazie).<br />
Le nord du pays et Paris sont sous la domination de l’armée allemande.
3) Techniques (comment c’est fait ?)<br />
La matière faite de ciment, plâtre et peinture est appliquée est appliquée avec un outil qui ressemble plus à<br />
une truelle qu’à un pinceau (couteau à peindre).<br />
4) Significations/usages<br />
2) Formes (ce que je vois, l’apparence<br />
extérieure)<br />
Une forme arrondie plus claire se détache sur le fond sombre. Quelques<br />
lignes, des traces d’outils. Des couleurs dans des tonalités rosées ou<br />
beiges, une matière épaisse. Le support n’est pas très grand (35 X 27<br />
cm). Au premier regard, on n’identifie aucune représentation : ce n’est pas<br />
de la peinture figurative.<br />
Ce qui retient l’attention, c’est la matière colorée. On est fasciné et<br />
repoussé par son aspect.<br />
« Une étrange pâte, et fort déplaisante à regarder. Ce qui forme tant de vapeurs et de poudroiements, les<br />
plus subtils peut-être mais les plus violents qu’on ait jamais vus dans un tableau, ce sont d’épais<br />
grumeaux aplatis, un badigeon de fard, tout un sabrage de craie grasse. L’on découvre que <strong>Fautrier</strong> s’est<br />
fabriqué une matière à lui, qui tient de l’aquarelle et de la fresque, de la détrempe et de la gouache, où le pastel<br />
broyé se mêle à l’huile, à l’encre et à l’essence. Le tout s’applique à la hâte sur un papier gras, qu’un enduit colle<br />
à la toile. L’ambiguïté en quelque sorte y quitte le sujet. Elle se fait peinture » <strong>Jean</strong> Paulhan, écrivain<br />
C’est seulement si l’on fait le lien avec le titre « Tête d’otage », que l’on se dit<br />
qu’effectivement on est peut-être face à une tête. Matière et gros empâtements donnent à<br />
sentir l’épaisseur de la substance mais n’imitent pas la réalité. Francis Ponge, écrivain et<br />
admirateur dit de <strong>Fautrier</strong> : « il est le peintre le plus révolutionnaire du monde à ma<br />
connaissance depuis Picasso ...Chacun de ses tableaux s’ajoute à la réalité avec vivacité,<br />
résolution, naturel. S’ajoute : ne la reproduit pas. »<br />
L’œuvre évoque, fait ressentir les plaies, les blessures, les chairs torturées, la souffrance<br />
des otages.<br />
C’est par l’intermédiaire de cette matière épaisse malaxée, triturée, que l’artiste<br />
exprime ce qu’il a pu ressentir lorsqu’il entendait les cris des victimes exécutées et<br />
torturées par les nazis.<br />
C’est par les sensations que nous éprouvons au regard de cette matière subtilement<br />
colorée que le peintre nous fait partager ses émotions et transmet la mémoire des<br />
horreurs subies par les otages.<br />
C’est leur souffrance qui est au centre de l’œuvre.<br />
« On ne fait jamais que réinventer ce qui est, restituer en nuances d'émotion la réalité qui<br />
s'est incorporée à la matière, à la forme, à la couleur, produits de l'instant, changé en ce<br />
qui ne change plus ». J. <strong>Fautrier</strong><br />
En 1954, <strong>Fautrier</strong> poursuit l'exploration de la matière à<br />
tra<strong>vers</strong> des <strong>série</strong>s de tableaux dont celle intitulée<br />
Têtes de partisans (ci-contre) qu'il réalise en 1956<br />
après l'invasion de la Hongrie par les troupes<br />
soviétiques.<br />
En réaction à l'invasion de Budapest par les russes en<br />
1956, il reprend le motif des <strong>Otages</strong> pour la suite des<br />
Têtes de partisans, variations sur le <strong>vers</strong><br />
"Liberté,j'écris ton nom" de Paul Éluard . Enfin jusqu'à<br />
sa mort qui survient en 1964, <strong>Fautrier</strong> brosse des<br />
tableaux d'inspiration plus structurée où se<br />
superposent stries, lignes colorées et grilles à<br />
plusieurs côtés.<br />
Art informel :<br />
Terme inventé en<br />
1951 par le<br />
critique d'art<br />
Michel Tapié<br />
pour nommer les<br />
œuvres non<br />
figuratives qui<br />
privilégient<br />
matières, traces<br />
et tâches de<br />
couleurs au<br />
détriment de la<br />
forme.<br />
L’art informel<br />
apparaît après la<br />
seconde guerre<br />
mondiale. Selon<br />
certains<br />
philosophes, les<br />
horreurs liées à<br />
cette guerre sont<br />
telles qu’il n’est<br />
plus possible de<br />
représenter la<br />
figure humaine.<br />
Quelques<br />
peintres de l’art<br />
informel : <strong>Jean</strong><br />
Dubuffet, <strong>Jean</strong><br />
<strong>Fautrier</strong>, ou<br />
encore d'Antoni<br />
Tàpies<br />
Hautes Pâtes :<br />
Titre ironique<br />
donné aux<br />
œuvres de<br />
Dubuffet<br />
évoquant à la fois<br />
la gastronomie et<br />
la « mélasse »<br />
qui les composait