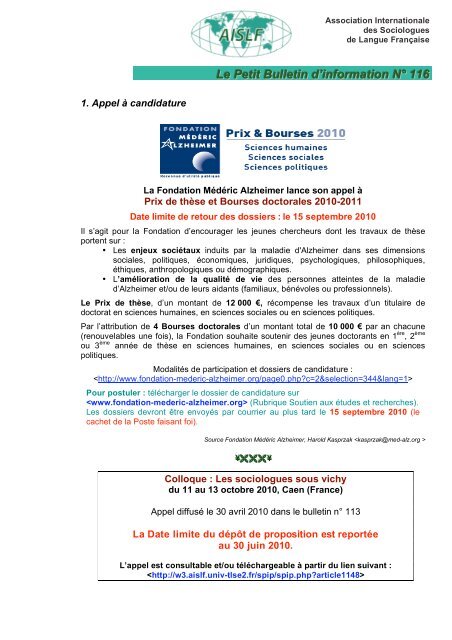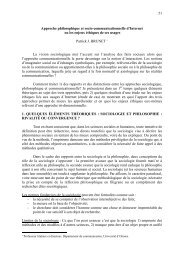Téléchargez le Petit Bulletin n°116 au format PDF - Association ...
Téléchargez le Petit Bulletin n°116 au format PDF - Association ...
Téléchargez le Petit Bulletin n°116 au format PDF - Association ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1. Appel à candidature<br />
Le Pettiitt Bulll<strong>le</strong>ttiin d’’iinf<strong>format</strong>tiion N° 116<br />
La Fondation Médéric Alzheimer lance son appel à<br />
Prix de thèse et Bourses doctora<strong>le</strong>s 2010-2011<br />
Date limite de retour des dossiers : <strong>le</strong> 15 septembre 2010<br />
Il s’agit pour la Fondation d’encourager <strong>le</strong>s jeunes chercheurs dont <strong>le</strong>s trav<strong>au</strong>x de thèse<br />
portent sur :<br />
• Les enjeux sociét<strong>au</strong>x induits par la maladie d'Alzheimer dans ses dimensions<br />
socia<strong>le</strong>s, politiques, économiques, juridiques, psychologiques, philosophiques,<br />
éthiques, anthropologiques ou démographiques.<br />
• L’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie<br />
d’Alzheimer et/ou de <strong>le</strong>urs aidants (famili<strong>au</strong>x, bénévo<strong>le</strong>s ou professionnels).<br />
Le Prix de thèse, d’un montant de 12 000 €, récompense <strong>le</strong>s trav<strong>au</strong>x d’un titulaire de<br />
doctorat en sciences humaines, en sciences socia<strong>le</strong>s ou en sciences politiques.<br />
Par l’attribution de 4 Bourses doctora<strong>le</strong>s d’un montant total de 10 000 € par an chacune<br />
(renouvelab<strong>le</strong>s une fois), la Fondation souhaite soutenir des jeunes doctorants en 1 ère , 2 ème<br />
ou 3 ème année de thèse en sciences humaines, en sciences socia<strong>le</strong>s ou en sciences<br />
politiques.<br />
Modalités de participation et dossiers de candidature :<br />
<br />
Pour postu<strong>le</strong>r : télécharger <strong>le</strong> dossier de candidature sur<br />
(Rubrique Soutien <strong>au</strong>x études et recherches).<br />
Les dossiers devront être envoyés par courrier <strong>au</strong> plus tard <strong>le</strong> 15 septembre 2010 (<strong>le</strong><br />
cachet de la Poste faisant foi).<br />
Source Fondation Médéric Alzheimer, Harold Kasprzak <br />
¥¥ ¥¥<br />
Colloque : Les sociologues sous vichy<br />
du 11 <strong>au</strong> 13 octobre 2010, Caen (France)<br />
Appel diffusé <strong>le</strong> 30 avril 2010 dans <strong>le</strong> bul<strong>le</strong>tin n° 113<br />
<strong>Association</strong> Internationa<strong>le</strong><br />
des Sociologues<br />
de Langue Française<br />
La Date limite du dépôt de proposition est reportée<br />
<strong>au</strong> 30 juin 2010.<br />
L’appel est consultab<strong>le</strong> et/ou téléchargeab<strong>le</strong> à partir du lien suivant :<br />
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
2. Appels à communication<br />
2.1<br />
Colloque international : Genre et parcours de vie<br />
Enfance, ado<strong>le</strong>scence, vieil<strong>le</strong>sse<br />
Les 21 et 22 octobre 2010, Nancy (France)<br />
Université de Nancy 2<br />
Date limite des propositions de communication : 15 juil<strong>le</strong>t 2010<br />
ppaaggee 22<br />
Le colloque a <strong>le</strong> soutien de la MSH Lorraine, de l’AISLF (CR n°06), de deux équipes de<br />
recherche (2L2S-Lasures-Érase des Universités de Nancy et de Metz ; Cultures et Sociétés<br />
en Europe de l’Université de Strasbourg) et du programme de recherche international<br />
« CEVI ».<br />
Problématique<br />
Depuis plusieurs années, <strong>le</strong>s trav<strong>au</strong>x conduits sur <strong>le</strong> genre ont mis <strong>au</strong> jour <strong>le</strong>s processus de sexuation<br />
mais <strong>au</strong>ssi <strong>le</strong>s critères mobilisés pour définir et hiérarchiser <strong>le</strong>s conduites masculines et féminines<br />
dans des domaines divers de l’existence socia<strong>le</strong> (la famil<strong>le</strong>, l’éco<strong>le</strong>, l’emploi, la retraite, etc.). Ceci<br />
étant, <strong>le</strong>s recherches articulant <strong>le</strong>s problématiques liées <strong>au</strong> genre et cel<strong>le</strong>s liées à la codification des<br />
âges soci<strong>au</strong>x sont encore assez peu nombreuses. On sait, par exemp<strong>le</strong>, peu de choses des<br />
stéréotypes sexués et des normes encadrant <strong>le</strong>s rapports de genre <strong>au</strong>x deux extrémités des parcours<br />
de vie : la période de l’enfance dont <strong>le</strong>s bornes se redéfinissent avec l’apparition de catégories tel<strong>le</strong>s<br />
que la préado<strong>le</strong>scence et cel<strong>le</strong> de la vieil<strong>le</strong>sse <strong>au</strong>jourd’hui désignée par des termes hétérogènes<br />
(troisième âge, grand âge, dépendance, etc.). Dans quel<strong>le</strong> mesure ces désignations sont-el<strong>le</strong>s<br />
genrées ? Quels en sont <strong>le</strong>s effets sur <strong>le</strong>s positions et <strong>le</strong>s trajectoires des hommes et des femmes ?<br />
Autant de questions qui se posent <strong>au</strong>jourd’hui avec une acuité particulière.<br />
Au plan théorique, rappelons en effet que, si <strong>le</strong>s désignations du masculin et du féminin ne sont pas<br />
anhistoriques, el<strong>le</strong>s ne sont non plus a-biographiques. En effet, <strong>le</strong>s critères définissant la féminité et la<br />
masculinité, durant l’enfance, ne sont pas nécessairement ceux qualifiant la féminité et la masculinité<br />
<strong>au</strong> grand âge. Des attributs imputés <strong>au</strong>x femmes sont même inversés à certains moments de <strong>le</strong>urs<br />
parcours de vie. Par exemp<strong>le</strong>, pendant longtemps jugés fragi<strong>le</strong>s, <strong>au</strong> grand âge, <strong>le</strong>s corps féminins<br />
semb<strong>le</strong>nt perçus comme plus « robustes » tant par <strong>le</strong>s professionnels organisant l’accès à l’aide<br />
publique que par l’entourage des personnes âgées. Jugées plus résistantes, <strong>le</strong>s femmes âgées<br />
seraient plus à même de réorganiser <strong>le</strong>ur quotidien en dépit d’une motricité amoindrie (repasser<br />
assise pour soulager <strong>le</strong>s dou<strong>le</strong>urs articulaires, etc.). On mesure ici combien <strong>le</strong>s dimensions mobilisées<br />
pour qualifier et hiérarchiser <strong>le</strong>s aptitudes féminines et masculines gagnent à être étudiées en tenant<br />
compte des systèmes normatifs encadrant <strong>le</strong>s âges soci<strong>au</strong>x 1 .<br />
Or ces derniers sont <strong>au</strong>jourd’hui profondément recomposés par des trans<strong>format</strong>ions démographiques,<br />
économiques et culturel<strong>le</strong>s conduisant à redessiner <strong>le</strong>s modes de désignation et <strong>le</strong>s vécus de<br />
l’avancée en âge. En l’occurrence, <strong>le</strong>s recherches sociologiques mettent <strong>au</strong> jour une trans<strong>format</strong>ion<br />
des deux dimensions constitutives du parcours de vie : l’institution du parcours de vie (la manière dont<br />
une société définit des âges de la vie, des séquences ordonnées de positions, des étapes, des<br />
discontinuités) mais <strong>au</strong>ssi <strong>le</strong>s parcours de vie individuels (l’ensemb<strong>le</strong> des trajectoires suivies dans <strong>le</strong>s<br />
différentes sphères de l’existence, la manière dont <strong>le</strong>s individus composent avec un modè<strong>le</strong> de<br />
dérou<strong>le</strong>ment de la vie que la société <strong>le</strong>ur impose) 2 . En substance, après une période d’unification et<br />
d’institutionnalisation de ces parcours via la codification d’âges soci<strong>au</strong>x spécifiques (enfance,<br />
jeunesse, adulte, vieil<strong>le</strong>sse), plusieurs trav<strong>au</strong>x soulignent un renversement partiel de la tendance. La<br />
multiplication des configurations familia<strong>le</strong>s, des trajectoires scolaires, professionnel<strong>le</strong>s et de santé<br />
brouil<strong>le</strong>raient la nature des étapes socia<strong>le</strong>ment reconnues comme faisant grandir/vieillir, comme<br />
1 Löwy I., L’emprise du genre. Masculinité, féminité, inégalité, Paris, La dispute, 2007.<br />
2 Cavalli S., « Le parcours de vie. Entre institutionnalisation et individualisation », in S. Cavalli, J.-P. Fragnière (dir.) L'avenir.<br />
Attentes, projets, (dés)illusions, ouvertures, L<strong>au</strong>sanne, Éditions Réalités socia<strong>le</strong>s, 2003, p. 2. Cf. éga<strong>le</strong>ment Lalive d'Épinay<br />
C., Bickel J.-F., Cavalli S., Spini D., « Le parcours de vie: émergence d'un paradigme interdisciplinaire », in J.-F. Guill<strong>au</strong>me,<br />
avec la collaboration de C. Lalive d'Épinay et L. Thomsin (dir.), Parcours de vie. Regards croisés sur la construction des<br />
biographies contemporaines, Liège, Les éditions de l'Université de Liège, 2005, pp. 187-210.<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 33<br />
faisant passer d’un âge à un <strong>au</strong>tre. Et <strong>le</strong>s parcours de vie de la deuxième moitié du XX ème sièc<strong>le</strong> s’en<br />
verraient, sinon plus f<strong>le</strong>xib<strong>le</strong>s, plus hétérogènes 3 . Dans quel<strong>le</strong> mesure assiste-t-on à une<br />
« déstandardisation » des parcours de vie ? Comment <strong>le</strong>s cadrages institutionnels et normatifs<br />
codifiant <strong>le</strong> genre et l’âge se recomposent-ils 4 ? Et qu’en est-il des incidences sur <strong>le</strong>s rapports de<br />
genre et <strong>le</strong>s situations socioéconomiques différentiel<strong>le</strong>s des hommes et des femmes 5 ?<br />
Pour éclairer ces trans<strong>format</strong>ions, <strong>le</strong>s propositions de communications pourront s’inscrire dans l’une<br />
ou l’<strong>au</strong>tre de ces thématiques et interrogations :<br />
2- Les modes de constitution des désignations politiques et institutionnel<strong>le</strong>s de l’avancée en âge et<br />
<strong>le</strong>urs effets<br />
Il s’agit ici de tracer la généalogie et <strong>le</strong>s modalités d’institutionnalisation des nouvel<strong>le</strong>s catégorisations<br />
des âges soci<strong>au</strong>x (prime enfance, enfance, préado<strong>le</strong>scence, ado<strong>le</strong>scence, jeunesse, maturité,<br />
maturescence, vieil<strong>le</strong>sse, grand âge, dépendance…) : ces passages sont-ils présentés comme des<br />
ruptures, des continuités ? Quels sont <strong>le</strong>s critères utilisés pour définir ces âges et pour scander <strong>le</strong><br />
passage d’un âge à un <strong>au</strong>tre ? Dans quel<strong>le</strong> mesure sont-ils genrés (qu’il s’agisse de critères<br />
spécifiquement utilisés pour <strong>le</strong>s hommes et pour <strong>le</strong>s femmes ou bien de critères qui, bien que<br />
viricentrés, sont présentés comme génér<strong>au</strong>x et asexués) ? L’étude des acteurs participant de la<br />
définition de ces critères est évidemment centra<strong>le</strong> : quels sont <strong>le</strong>s discours experts participant de la<br />
formalisation de ces périodes et de la désignation des bornes temporel<strong>le</strong>s 6 ? Sur quels systèmes<br />
normatifs ces discours experts s’appuient-ils ? Et enfin quels liens ces discours entretiennent-ils avec<br />
<strong>le</strong>s politiques publiques prenant directement ou indirectement ces âges soci<strong>au</strong>x pour cib<strong>le</strong>s (politiques<br />
scolaires, de santé, de dépendance, etc.) ?<br />
Il s’agit éga<strong>le</strong>ment de comprendre la manière dont <strong>le</strong>s élus, <strong>le</strong>s acteurs institutionnels et <strong>le</strong>s<br />
professionnels mobilisent ces catégories : dans quel<strong>le</strong>s acceptions ? Quels types de pratiques<br />
professionnel<strong>le</strong>s cela suscite-t-il ? Ces pratiques sont-el<strong>le</strong>s genrées ? Et quels en sont <strong>le</strong>s effets ?<br />
Par exemp<strong>le</strong>, on s’interrogera ici sur l’importance que prend la norme d’<strong>au</strong>tonomie dans des politiques<br />
publiques qui tendent à organiser l’accès <strong>au</strong>x aides à l’<strong>au</strong>ne d’un modè<strong>le</strong> du « gouvernement de soi »<br />
misant sur la responsabilité des sujets et <strong>le</strong>urs capacités individuel<strong>le</strong>s à dessiner <strong>le</strong>ur propre parcours.<br />
Dans cette perspective, <strong>le</strong>s formes du grandir et du vieillir dépendraient, par exemp<strong>le</strong>, de la capacité<br />
de chacun à gérer son avancée en âge et <strong>le</strong>s institutions viseraient alors à maintenir – sinon à<br />
développer – <strong>le</strong>s degrés d’<strong>au</strong>tonomie individuel<strong>le</strong>. C’est <strong>le</strong> cas de l’Allocation Personnalisée<br />
d’Autonomie qui fait de cette notion un des critères d’accès à l’aide publique mais c’est <strong>au</strong>ssi <strong>le</strong> cas<br />
d’un grand nombre de dispositifs scolaires enjoignant <strong>le</strong>s professionnels de l’éducation à concentrer<br />
<strong>le</strong>urs efforts sur <strong>le</strong>s élèves jugés <strong>le</strong>s moins « <strong>au</strong>tonomes ». Bien que cette tendance à déplacer <strong>le</strong>s<br />
contradictions du système sur un plan biographique s’observe dans des terrains divers, on sait encore<br />
peu de choses de la manière dont ces normes institutionnel<strong>le</strong>s se déploient selon <strong>le</strong> sexe des<br />
individus ciblés, des tensions normatives spécifiques qu’el<strong>le</strong>s génèrent et des nouvel<strong>le</strong>s formes de<br />
justification des différentiels d’aptitudes entre hommes et femmes qu’el<strong>le</strong>s peuvent alimenter. Dès<br />
lors, comment l’<strong>au</strong>tonomie des hommes et des femmes est-el<strong>le</strong> appréciée ? Dans quel<strong>le</strong> mesure <strong>le</strong>s<br />
critères utilisés par <strong>le</strong>s institutions pour mesurer l’<strong>au</strong>tonomie de la personne âgée génèrent-ils des<br />
différentiels d’aide proposée <strong>au</strong>x hommes et <strong>au</strong>x femmes ? Comment cette <strong>au</strong>tonomie est-el<strong>le</strong><br />
appréciée par <strong>le</strong>s professionnels de l’éducation ? Et quel<strong>le</strong>s en sont <strong>le</strong>s conséquences sur <strong>le</strong> soutien<br />
dont <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s garçons peuvent bénéficier ?<br />
Ceci étant, <strong>le</strong>s individus ne sont pas seu<strong>le</strong>ment destinataires de ces catégorisations. Ils sont <strong>au</strong>ssi<br />
acteurs de <strong>le</strong>ur propre avancée en âge.<br />
2- Les modes de désignation socia<strong>le</strong> de cette avancée en âge et <strong>le</strong>urs effets<br />
Il s’agit ici de comprendre la manière dont <strong>le</strong>s hommes et <strong>le</strong>s femmes, mais <strong>au</strong>ssi <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s<br />
garçons, s’approprient <strong>le</strong>s catégories médiatiques et institutionnel<strong>le</strong>s qui <strong>le</strong>s cib<strong>le</strong>nt. Par exemp<strong>le</strong>, se<br />
saisissent-ils ou non de la catégorie de « préado<strong>le</strong>scents » véhiculée par <strong>le</strong>s médias, <strong>le</strong> marketing et<br />
3<br />
Cavalli S., « Modè<strong>le</strong> de parcours de vie et individualisation : un état du débat », Gérontologie et société, n° 123/4, 2007, pp.<br />
55-69.<br />
4<br />
Par exemp<strong>le</strong>, sur la persistance de l’imposition du sexe biologique, voir Wiels J. « La différence des sexes : une chimère<br />
résistante », in C. Vidal (dir.), Féminin, Masculin, Mythes et idéologies, Paris, Belin, 2006, pp. 71-81.<br />
5<br />
Sur la question du croisement genre et milieu social, cf. pour l’enfance/ado<strong>le</strong>scence (Mardon A., « Sociabilités et travail de<br />
l’apparence <strong>au</strong> collège », Ethnologie française, XL/1, 2010, pp. 39-48) ; pour <strong>le</strong> passage à la retraite (Guil<strong>le</strong>mard A.M, « L'âge<br />
de l'emploi, <strong>le</strong>s sociétés à l'épreuve du vieillissement », Paris, A. Colin, 2003).<br />
6<br />
Citons par exemp<strong>le</strong> ici <strong>le</strong>s discours médic<strong>au</strong>x. Sur la corrélation des âges à des moyennes physiques, cf Turmel A., A<br />
historical sociology of Childhood, Cambridge University Press, 2008. À propos de la définition médica<strong>le</strong> de la maternité, cf<br />
Löwy I.., « L’âge limite de la maternité : corps, biomédecine, et politique », Mouvements 2009/3, n° 59, p. 102-112.<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 44<br />
<strong>le</strong>s institutions (éco<strong>le</strong>) 7 ? Qu’en est-il de la notion de « dépendance » 8 ? Le regard devra <strong>au</strong>ssi être<br />
porté sur <strong>le</strong>s désignations socia<strong>le</strong>s, élaborées par <strong>le</strong>s individus et <strong>le</strong>ur entourage, parfois à distance<br />
des catégorisations institutionnel<strong>le</strong>s et expertes. Cette activité d’élaboration de critères propres est<br />
d’<strong>au</strong>tant plus importante que plusieurs trav<strong>au</strong>x font état d’une tendance à la « biographisation » des<br />
parcours de vie 9 . Ce qui était <strong>le</strong> produit d’un <strong>format</strong>age social est <strong>au</strong>jourd’hui présenté comme la<br />
résultante d’un projet, d’une réf<strong>le</strong>xivité. Tel est <strong>le</strong> cas des événements censés scander <strong>le</strong><br />
vieillissement. Christian Lalive d’Épinay et Stefano Cavalli ont montré que, contrairement <strong>au</strong>x discours<br />
politiques et médiatiques, la retraite n’est pas l’évènement <strong>le</strong> plus mobilisé par <strong>le</strong>s individus pour<br />
décrire <strong>le</strong>s tournants marquant la deuxième moitié de <strong>le</strong>ur vie. La perte de proches et l’expérience du<br />
veuvage sont plus souvent convoquées 10 . Le même décalage se retrouve d’ail<strong>le</strong>urs pour la<br />
ménop<strong>au</strong>se : si <strong>le</strong> discours médical en fait un tournant essentiel, <strong>le</strong>s femmes l’articu<strong>le</strong>nt à d’<strong>au</strong>tres<br />
événements soci<strong>au</strong>x 11 . Comment <strong>le</strong>s hommes et <strong>le</strong>s femmes se saisissent-ils/el<strong>le</strong>s de ces catégories<br />
d’âge ? Quels sont <strong>le</strong>s critères utilisés par <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s et l’entourage pour définir ces âges soci<strong>au</strong>x ?<br />
Quels sont <strong>le</strong>s marqueurs convoqués (évènement familial, changement corporel, des formes de<br />
sociabilité). Quel<strong>le</strong>s stratégies individuel<strong>le</strong>s ou col<strong>le</strong>ctives <strong>le</strong>s individus mettent-ils en place pour<br />
préserver/<strong>au</strong>gmenter <strong>le</strong>ur <strong>au</strong>tonomie, s’approprier <strong>le</strong>urs trans<strong>format</strong>ions corporel<strong>le</strong>s ? Autant<br />
d’interrogations permettant d’explorer <strong>le</strong>s al<strong>le</strong>rs-retours entre <strong>le</strong>s constructions institutionnel<strong>le</strong>s ou<br />
normatives, et la façon dont el<strong>le</strong>s sont investies.<br />
Enfin, <strong>le</strong>s communications pourront éga<strong>le</strong>ment interroger <strong>le</strong>s effets symboliques, identitaires mais<br />
<strong>au</strong>ssi matériels de cette recomposition des modes de scansion et de désignation de l’avancée en âge.<br />
La légitimation socia<strong>le</strong> de ces catégories conduit-el<strong>le</strong> l’entourage à reconnaître la spécificité de<br />
l’expérience du ou de la préado<strong>le</strong>scente, de la personne âgée classée « dépendante » ? Leur<br />
capacité à être acteur/actrice s’en trouvent-el<strong>le</strong>s <strong>au</strong>gmentées ? Qu’est-ce que ces désignations<br />
produisent sur <strong>le</strong>s solidarités familia<strong>le</strong>s dont <strong>le</strong>s hommes et <strong>le</strong>s femmes bénéficient ? De manière plus<br />
structurel<strong>le</strong>, peut-on considérer que l’individualisation des vécus du grandir et du vieillir conduit à un<br />
rapprochement des trajectoires masculines et féminines ? Ou voit-on, <strong>au</strong> contraire, apparaître de<br />
nouve<strong>au</strong>x processus maintenant ou renforçant <strong>le</strong>s différentiels sexués de position socia<strong>le</strong> et<br />
économique à mesure de l’avancée en âge ? Par exemp<strong>le</strong>, pour Leisering 12 , la déstandardisation des<br />
parcours <strong>au</strong>gmenterait <strong>le</strong> sentiment d’insécurité et conduirait à de nouvel<strong>le</strong>s demandes<br />
d’« institutionnalisation de la f<strong>le</strong>xibilité » (cf. par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong>s demandes concernant <strong>le</strong>s dispositifs<br />
d’orientation scolaire, de réorientation professionnel<strong>le</strong>, de soutien de la dépendance). Sont<br />
bienvenues ici des propositions interrogeant ces sentiments d’insécurité et <strong>le</strong>urs manifestations<br />
sexuées.<br />
Plus largement, ce colloque entend rassemb<strong>le</strong>r des recherches en sciences humaines et<br />
socia<strong>le</strong>s prenant pour objet l’étude des différenciations sexuées, observées dans différents<br />
espaces et à divers moments des parcours biographiques individuels : l’expérience de<br />
l’enfance, de l’ado<strong>le</strong>scence, <strong>le</strong>s épreuves codifiant la vie adulte, l’expérience postprofessionnel<strong>le</strong><br />
et cel<strong>le</strong> du vieillissement. Des données comparatives internationa<strong>le</strong>s<br />
pourront contribuer à faire émerger <strong>le</strong>s différences de perception du genre, voire <strong>le</strong>s<br />
différences de parcours de vie selon <strong>le</strong>s pays ou <strong>le</strong>s aires culturel<strong>le</strong>s.<br />
Il est largement ouvert <strong>au</strong>x doctorants et <strong>au</strong>x jeunes chercheurs mais <strong>au</strong>ssi <strong>au</strong>x chercheurs<br />
plus expérimentés souhaitant partager <strong>le</strong>s réf<strong>le</strong>xions engagées <strong>au</strong>tour de nouve<strong>au</strong>x projets<br />
de recherche en lien avec <strong>le</strong> thème du colloque (réf<strong>le</strong>xions théoriques, méthodologiques,<br />
présentation de problématiques de recherches en cours, etc.).<br />
Ce colloque est <strong>le</strong> premier temps fort d'un cyc<strong>le</strong> de manifestations scientifiques associant la<br />
MSH Lorraine et <strong>le</strong>s laboratoires 2L2S/Cultures et Sociétés en Europe. Il accorde une large<br />
7<br />
Dès <strong>le</strong>s années 1980, la catégorie des tweens (pré-ado<strong>le</strong>scents) a acquis une importance croissante. Aux États-Unis, <strong>le</strong> terme<br />
tweens <strong>au</strong>rait même remplacé celui de sub-teens employé dans <strong>le</strong>s années 1950 et <strong>le</strong> pre-teens des années 1960 et 1970.<br />
Cf. ici Cook D.T., Kaiser S. B., « Betwixt and Be Tween: Age Ambiguity and the Sexualization of the Fema<strong>le</strong> Consuming<br />
Subject », Journal of Consumer Culture, n°4, 2004, pp. 203-227.<br />
8<br />
Ennuyer B., Les Ma<strong>le</strong>ntendus de la dépendance. De l'incapacité <strong>au</strong> lien social, Paris, Dunod, 2002.<br />
9<br />
Levy R., « Regard sociologique sur <strong>le</strong>s parcours de vie », Cahiers de la Section des Sciences de l'Éducation, Université de<br />
Genève, n°95, 2001, pp. 1-20.<br />
10<br />
Lalive d’Épinay C., Cavalli S., « Changements et tournants dans la seconde moitié de la vie », Gérontologie et société,<br />
n°121/2, 2007.<br />
11<br />
Vinel 2004, « La ménop<strong>au</strong>se : instabilité des affects et des pratiques en France » in Héritier F., Xanthakou M., Corps et<br />
affects, Paris, Odi<strong>le</strong> Jacob, pp. 221-233.<br />
12<br />
Leisering L., « Government and the Life Course », in J. T. Mortimer and M. J. Shanahan (Eds.), The Handbook of Life<br />
Course, New-York, Kluwer Academic/P<strong>le</strong>num, 2003, pp. 205-225.<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 55<br />
place <strong>au</strong>x approches sociologiques s'intéressant <strong>au</strong>x tournants d'âge et <strong>au</strong> vieillissement<br />
dans une perspective genrée. Le second versant, prévu en novembre 2011, se centrera<br />
davantage sur <strong>le</strong>s approches anthropologiques des transitions de l'enfance à l'ado<strong>le</strong>scence.<br />
Propositions de communications :<br />
Les personnes désirant soumettre une communication doivent envoyer un résumé de 20 à<br />
30 lignes, pour <strong>le</strong> 2 juil<strong>le</strong>t 2010 ( <strong>au</strong> plus tard pour <strong>le</strong> 15 juil<strong>le</strong>t) simultanément à :<br />
Sahlia Traore (coordinatrice du comité d’organisation) : <br />
Monique Legrand : <br />
Le texte comp<strong>le</strong>t des communications sera ensuite adressé <strong>au</strong>x organisateurs sous une<br />
forme définitive (<strong>le</strong>s normes de publications seront envoyées plus tard) pour fin octobre<br />
2010. Les communications <strong>le</strong>s plus significatives feront l’objet d’une série de publications.<br />
- Un dossier spécial « Genre et vieillissement » de la revue de SociologieS de l’AISLF est<br />
prévu<br />
- Des actes en lignes sont éga<strong>le</strong>ment envisagés.<br />
Comité scientifique (pressenti)<br />
Didier Vrancken (CRIS - Univ. de Liège), Christian Lalive d’Épinay (Centre Interfacultaire de<br />
Gérontologie, Genève,), Monique Membrado (LISST-CIEU, Univ. de Toulouse 2), Virginie<br />
Vinel (2L2S-Erase, Univ. de Metz), Nico<strong>le</strong>tta Diasio (Cultures et sociétés en Europe, Univ.<br />
de Strasbourg), Monique Legrand et Ingrid Voléry (2L2S-Lasures, Univ. de Nancy 2), Liliana<br />
Gastrón (Univ. Nacional de Luján, Argentine), Jean-François Guill<strong>au</strong>me (Univ. de Liège),<br />
Nicky Le Feuvre (Univ. de L<strong>au</strong>sanne), Cornélia Hummel (Univ. de Genève).<br />
Comité d’organisation<br />
Monique Legrand, Ingrid Voléry, Sahlia Traore,<br />
Julien Bi<strong>au</strong>det, Sylvie Laguerre, Frédérique Bey.<br />
Centre de recherche sur <strong>le</strong>s médiations<br />
(CREM - EA 3476)<br />
(Université P<strong>au</strong>l Verlaine-Metz, Université<br />
Nancy 2, Université de H<strong>au</strong>te-Alsace)<br />
2.2<br />
Source Monique Legrand <br />
Laboratoire interuniversitaire des sciences de<br />
l’éducation et de la communication (LISEC –<br />
EA 2310)<br />
(Université de Strasbourg, Université Nancy<br />
2, Université de H<strong>au</strong>te-Alsace)<br />
Colloque international<br />
Les cultures des sciences en europe<br />
Vo<strong>le</strong>t 1 : Dispositifs en pratique<br />
Les 9 et 10 décembre 2010, Nancy (France)<br />
Date limite des propositions : 30 juil<strong>le</strong>t 2010<br />
En novembre 2000, la Commission européenne rédigeait un document intitulé Science,<br />
société et citoyens en Europe qui constituait la première pierre d’un vaste programme de<br />
réf<strong>le</strong>xions et d’actions <strong>au</strong>tour des questions sciences-technologies-société. L’Europe affirme<br />
ainsi son rô<strong>le</strong> dans la médiation des sciences et des techniques par <strong>le</strong> Plan d’action qu’el<strong>le</strong><br />
élabore en 2002 et l’inscription forte des préoccupations relatives à l’interface<br />
sciences/société dans <strong>le</strong>s 6 e et 7 e programmes cadres, <strong>au</strong>tour des thèmes Science et société<br />
puis Science dans la société.<br />
Dix ans après ces premiers pas, il semb<strong>le</strong> opportun de dresser un état des lieux<br />
problématisé des actions, des « philosophies » et des agendas politiques présidant à cette<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 66<br />
préoccupation européenne. Le colloque Les cultures des sciences en Europe : dispositifs en<br />
pratique représente <strong>le</strong> premier vo<strong>le</strong>t d’une manifestation qui se tiendra à Nancy, puis à<br />
Strasbourg (printemps 2011). Il vient poursuivre la réf<strong>le</strong>xion engagée dans <strong>le</strong> dossier publié<br />
dans <strong>le</strong> n°17 de la revue Questions de communication. Ce premier vo<strong>le</strong>t, <strong>au</strong>-delà du simp<strong>le</strong><br />
état des lieux des pratiques de médiation en matière de cultures scientifiques en Europe,<br />
vise à examiner <strong>le</strong>s différents dispositifs de médiation dans <strong>le</strong> domaine des sciences et des<br />
techniques. Existe-t-il des « traditions nationa<strong>le</strong>s » ? Sont-el<strong>le</strong>s transférab<strong>le</strong>s d’un contexte à<br />
l’<strong>au</strong>tre, et comment ? Quels sont <strong>le</strong>s modè<strong>le</strong>s favorisés voire imposés <strong>au</strong>x nive<strong>au</strong>x local et<br />
européen ? Sur quels présupposés s’appuient-ils ?<br />
Une attention particulière sera ainsi accordée <strong>au</strong>x rô<strong>le</strong>s que ces dispositifs attribuent <strong>au</strong>x<br />
publics et <strong>au</strong>x positionnements effectifs de ces derniers. Par ail<strong>le</strong>urs, parce qu’un dispositif<br />
de médiation n’est jamais neutre, il importe d’ouvrir <strong>le</strong> débat sur <strong>le</strong>s fonctions d’organisation,<br />
de crédibilisation et de hiérarchisation des va<strong>le</strong>urs sociéta<strong>le</strong>s/culturel<strong>le</strong>s que <strong>le</strong>s politiques de<br />
médiation attribuent <strong>au</strong>x sciences et <strong>au</strong>x techniques. Il s’agira <strong>au</strong>ssi d’apprécier <strong>le</strong>s<br />
interrogations ouvertes par la « standardisation » européenne des dispositifs, la comp<strong>le</strong>xité<br />
de <strong>le</strong>ur adaptation <strong>au</strong>x cultures loca<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s possibilités ou impossibilités de transférabilité…<br />
Sont attendues des contributions re<strong>le</strong>vant des Sciences de l’in<strong>format</strong>ion et de la<br />
communication, et de façon plus large des différents domaines des Sciences humaines et<br />
socia<strong>le</strong>s. Les présentations théoriques ouvrant sur des questionnements nouve<strong>au</strong>x, <strong>le</strong>s<br />
recherches empiriques origina<strong>le</strong>s ainsi que <strong>le</strong>s études de cas seront particulièrement<br />
appréciées, ainsi que <strong>le</strong>s réf<strong>le</strong>xions critiques et retours d’expériences provenant des acteurs<br />
de la médiation. Aussi <strong>le</strong> colloque permettra-t-il de participer à l’émergence de<br />
problématiques nouvel<strong>le</strong>s et de faire dialoguer <strong>le</strong>s approches. Les contributions seront de<br />
préférence nourries par une mise en perspective via une approche comparative concernant<br />
<strong>le</strong>s pratiques ou <strong>le</strong>s politiques de la médiation scientifique et technique dans différents pays<br />
européens.<br />
Les communications se distribueront <strong>au</strong>tour de 3 axes :<br />
1/ Espaces et dispositifs de médiation<br />
Des installations <strong>au</strong>x forums hybrides via <strong>le</strong>s fêtes de la science, <strong>le</strong>s dispositifs actuel<strong>le</strong>ment dédiés à<br />
la médiation des sciences et des techniques sont de plus en plus diversifiés, se voient chargés de<br />
missions nouvel<strong>le</strong>s et charrient des enjeux traditionnels (vulgarisation) et/ou plus contextuels (dans <strong>le</strong><br />
cadre de la communication <strong>au</strong>tour des controverses publiques, par exemp<strong>le</strong>). Cependant, cette<br />
diversité ne doit pas masquer que <strong>le</strong>s dispositifs mettent en jeu des négociations comp<strong>le</strong>xes entre<br />
différentes catégories d’acteurs (bail<strong>le</strong>urs de fonds, responsab<strong>le</strong>s d’institutions, chargés de<br />
communication, architectes ou scénaristes, médiateurs, chercheurs…) conduisant à une confrontation<br />
de visions du monde parfois très différentes. Ces négociations ne sont pas sans incidences sur la<br />
forme fina<strong>le</strong> des dispositifs. Quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>urs incidences sur <strong>le</strong> choix des médias utilisés (images,<br />
textes, sons, vidéo ou outils interactifs, architecture spatia<strong>le</strong>) et sur <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> qu’ils devraient jouer dans<br />
la médiation ? Comment forment-el<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s contours des narrations relatives <strong>au</strong>x sciences, <strong>au</strong>x<br />
techniques et à <strong>le</strong>urs développements ? Sur quels principes tacites se fondent <strong>le</strong>s dispositifs mis en<br />
pratique?<br />
2/ Les publics : acteurs de la médiation ?<br />
Les mutations récentes de la rhétorique européenne plaidant pour un engagement plus large des<br />
publics vis-à-vis de la science et de la technologie conduit à interroger la façon dont <strong>le</strong>s dispositifs<br />
configurent <strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s et interactions des acteurs de la médiation. Comment ces dispositifs sont-ils<br />
censés agir – et agissent-ils concrètement – sur l’engagement ou l’implication des publics dans <strong>le</strong>s<br />
actions concernant à la fois <strong>le</strong>s sciences, <strong>le</strong>s technologies et la société ? Comment sont-ils conçus<br />
dans <strong>le</strong>s politiques de communication scientifique et technique ? Ce questionnement concerne<br />
notamment <strong>le</strong>s dispositifs dirigés vers <strong>le</strong>s jeunes publics – futures forces vives de la société de la<br />
connaissance. Il s’adresse éga<strong>le</strong>ment <strong>au</strong>x publics des espaces de médiations classiques (médias,<br />
musées, science centers…) et à ceux des formes plus récentes de médiation (débats publics, forums<br />
hybrides…). S’il existe des « publics particuliers », comment ceux-ci sont-ils définis ? Et comment se<br />
manifestent-ils effectivement ? Dans ce cadre, on pourra s’interroger sur <strong>le</strong>s pré-requis <strong>au</strong>xquels est<br />
soumis l’engagement des publics : l’éducation et la sensibilisation accrues <strong>au</strong>x sciences et<br />
technologies constituent-el<strong>le</strong>s des préalab<strong>le</strong>s nécessaires ? Dans quels domaines ? Qu’en est-il<br />
attendu ? Et quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s représentations des publics qui motivent ces préalab<strong>le</strong>s ?<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 77<br />
3/ Confrontations des savoirs « savants » et des savoirs « citoyens »<br />
Les dispositifs mobilisés dans <strong>le</strong>s espaces de médiation scientifique et technique proposent des récits,<br />
des scénarisations, des agencements, hiérarchisent <strong>le</strong>s représentations, <strong>le</strong>s questionnements et <strong>le</strong>s<br />
acteurs qui apparaîtront plus ou moins légitimes, et participent ainsi à une cartographie des savoirs, à<br />
l’élaboration de promesses et à une organisation, un classement des va<strong>le</strong>urs qui y sont associées.<br />
Dans ce cadre, il importe d’analyser la façon dont est organisée et s’organise la confrontation entre<br />
savoirs savants et <strong>au</strong>tres savoirs (informels, culturels,..). Quel rô<strong>le</strong> sociétal est implicitement dévolu<br />
<strong>au</strong>x représentations de la science et des technologies ? Quel<strong>le</strong> place est laissée <strong>au</strong>x savoirs<br />
« profanes » ?<br />
Le vo<strong>le</strong>t 2 de ce colloque se dérou<strong>le</strong>ra à l’Université de Strasbourg <strong>au</strong> printemps 2011. Il<br />
s’intitu<strong>le</strong>ra Les cultures des sciences en Europe. Dispositifs, discours et institutions. L’appel<br />
à communication sera diffusé en temps voulu.<br />
Proposition de communication<br />
Les communications pourront être prononcées en français ou en anglais. El<strong>le</strong>s feront l’objet<br />
d’une présentation de 30 minutes.<br />
Les propositions doivent impérativement comporter <strong>le</strong>s éléments suivants :<br />
- nom et prénom, adresse é<strong>le</strong>ctronique, cordonnées téléphoniques et posta<strong>le</strong>s<br />
- statut professionnel, institution de rattachement de l’<strong>au</strong>teur/des <strong>au</strong>teurs<br />
- 500 mots maximum (3000 signes), en langue française ou en langue anglaise<br />
(précisant la problématique, <strong>le</strong>s données utilisées et la méthode).<br />
Les propositions doivent être déposées <strong>au</strong>près de Philippe Chavot ou Anne Masseran, à<br />
l’adresse suivante : <strong>au</strong> plus tard <strong>le</strong> 30 juil<strong>le</strong>t 2010.<br />
Les <strong>au</strong>teurs seront informés par courriel de la réponse faite à <strong>le</strong>ur proposition de<br />
communication.<br />
Après validation par <strong>le</strong> comité scientifique, <strong>le</strong>s textes des communications seront publiés en<br />
un volume d’actes.<br />
Comité scientifique<br />
Patrick Amey (Dpt de Sociologie, Univ. de Genève) ; Christian Dournon (Rése<strong>au</strong> Hubert<br />
Curien de Lorraine) ; Ulrike Felt (VIRUSSS, Univ. de Vienne) ; Béatrice F<strong>le</strong>ury (CREM, Univ.<br />
Nancy 2) ; Philippe Hert (Univ. de Provence / C2SO, ENS Lyon) ; Elsa Poupardin (LISEC,<br />
Univ. de Strasbourg) ; Jacques Walter (CREM, Univ. P<strong>au</strong>l Verlaine, Metz)<br />
Organisation<br />
Philippe Chavot (LISEC), Univ. de Strasbourg et Anne Masseran (CREM - Univ. Nancy 2) &<br />
Univ. de Strasbourg <br />
2.3<br />
Source Philippe Chavot < philippe.chavot@unistra.fr><br />
Colloque international<br />
Repenser l’itinérance. Défis théorique et méthodologiques<br />
Du 27 <strong>au</strong> 29 octobre 2010, Montréal (Canada)<br />
Date limite des propositions : <strong>au</strong> plus tard <strong>le</strong> 31 juil<strong>le</strong>t 2010<br />
La recherche à propos de l’itinérance a connu un essor important <strong>au</strong> cours des trente<br />
dernières années. SDF, Home<strong>le</strong>ss, itinérance, sans-abri, la pluralité des dénominations du<br />
phénomène selon <strong>le</strong>s sociétés témoigne de la nécessité de comprendre ces situations et <strong>le</strong>s<br />
contextes sociopolitiques qui <strong>le</strong>s définissent. Les chercheurs anglophones, francophones,<br />
américains, européens, ont ainsi développé des savoirs qui se croisent et se recroisent<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 88<br />
<strong>au</strong>tour de la question de l’itinérance. Quel bilan de ces compréhensions théoriques et<br />
empiriques du phénomène peut-on faire ? Quels portraits en font <strong>le</strong>s chercheurs ? Les<br />
savoirs produits sont-ils toujours d’actualité ? De quel<strong>le</strong>s manières la recherche a-t-el<strong>le</strong> eu un<br />
impact sur la compréhension et l’intervention (clinique, socia<strong>le</strong>, politique, économique, etc.) ?<br />
Quel<strong>le</strong>s orientations sont dominantes ? Quel<strong>le</strong>s directions la recherche est-el<strong>le</strong> susceptib<strong>le</strong><br />
de prendre dans <strong>le</strong>s années qui viennent ?<br />
Ce colloque propose de réunir des chercheurs d’horizons différents (disciplines, approches,<br />
méthodologies et contextes sociopolitiques) pour rendre compte de la diversité théorique,<br />
conceptuel<strong>le</strong> et méthodologique qui caractérise la recherche sur l’itinérance. Que dire de<br />
cette diversité ? Peut-on par<strong>le</strong>r de complémentarité, de similarité qui permettrait de soutenir<br />
un cumul de savoirs et de méthodologies expérimentées ?<br />
Organisé par <strong>le</strong> Col<strong>le</strong>ctif de recherche sur l’itinérance, la p<strong>au</strong>vreté et l’exclusion socia<strong>le</strong>,<br />
(CRI) ce colloque a pour but de faire un bilan des acquis de la recherche et des nouvel<strong>le</strong>s<br />
questions qui se posent <strong>au</strong>jourd’hui. Au cours des dernières années <strong>le</strong> projet du CRI a été<br />
de développer et soutenir un rése<strong>au</strong> de praticiens et de chercheurs pour favoriser<br />
l’émergence de pratiques de recherche sur la question de l’itinérance (Laberge, 2000; Roy et<br />
Hurtubise 2007). Au cœur de ce projet on retrouve quatre idées centra<strong>le</strong>s : 1) l’itinérance est<br />
un phénomène comp<strong>le</strong>xe qui nécessite <strong>le</strong> développement d’une approche scientifique qui<br />
favorise l’interdisciplinarité et la considération des multip<strong>le</strong>s facettes du phénomène ; 2) <strong>le</strong>s<br />
méthodes, <strong>le</strong>s concepts et <strong>le</strong>s théories héritées des disciplines respectives ne peuvent<br />
s’appliquer directement, il y a un nécessaire travail d’adaptation, de traduction voire<br />
d’innovation; 3) <strong>le</strong> partenariat entre chercheurs et intervenants des milieux de pratique<br />
repose sur un dialogue constant entre acteurs du milieu de la pratique et des milieux<br />
universitaires; 4) <strong>au</strong> cœur de la production scientifique, il est nécessaire d’introduire <strong>le</strong><br />
transfert des connaissances comme un processus cumulatif et continu.<br />
Les recherches menées ici comme ail<strong>le</strong>urs permettent de cerner trois composantes<br />
importantes qui ont marqué <strong>le</strong> phénomène de l’itinérance Premièrement, l’accroissement du<br />
phénomène se traduit à la fois par l’<strong>au</strong>gmentation du nombre de personnes touchées dans<br />
<strong>le</strong>s grandes vil<strong>le</strong>s, considérées comme <strong>le</strong>s princip<strong>au</strong>x foyers de l’itinérance, et par son<br />
extension dans des vil<strong>le</strong>s plus petites qui n’étaient pas concernées jusqu’à maintenant, par<br />
cette réalité. Deuxièmement, <strong>le</strong> phénomène se transforme <strong>au</strong>ssi sur la base d’une<br />
diversification des groupes touchés. La population itinérante n’est pas homogène. On y<br />
retrouve une diversité de profils dont de nouvel<strong>le</strong>s figures (apparition de famil<strong>le</strong>s itinérantes)<br />
ou de nouvel<strong>le</strong>s configurations. Troisièmement, on constate une détérioration des conditions<br />
de vie des personnes affectées par des problèmes multip<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>ur combinaison aggrave <strong>le</strong>s<br />
difficultés <strong>au</strong>xquel<strong>le</strong>s ils doivent faire face et ce, sur plusieurs plans. Quel<strong>le</strong>s composantes<br />
sont cernées par <strong>le</strong>s <strong>au</strong>tres chercheurs, <strong>le</strong>s <strong>au</strong>tres pays ? Quel<strong>le</strong>s définitions avons-nous<br />
maintenant du phénomène ? Comment conjuguer dans l’analyse <strong>le</strong>s dimensions<br />
structurel<strong>le</strong>s, institutionnel<strong>le</strong>s et individuel<strong>le</strong>s?<br />
Au cours des grandes conférences, des experts internation<strong>au</strong>x se pencheront sur <strong>le</strong>s<br />
thématiques centra<strong>le</strong>s du colloque. Des communications libres seront éga<strong>le</strong>ment données<br />
sous la forme d’ateliers thématiques. Le comité scientifique vous invite à soumettre des<br />
propositions de communication <strong>au</strong>tour des thèmes suivants :<br />
• Comprendre l’itinérance. Quel<strong>le</strong>s connaissances, quels acquis ?<br />
• Une réalité à décrire. Un portrait pourquoi ? Pour qui ?<br />
• Des connaissances scientifiques à mobiliser dans la compréhension et l’action. Paro<strong>le</strong>s<br />
scientifiques et paro<strong>le</strong>s publiques.<br />
• Un champ d’étude qui permet d’enrichir <strong>le</strong> développement des sciences humaines et<br />
socia<strong>le</strong>s<br />
Plus d’in<strong>format</strong>ion sur <strong>le</strong>s thèmes<br />
< http://pages.usherbrooke.ca/colloquecri2010/index.php/cri2010/cri2010/schedConf/cfp><br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 99<br />
Le comité organisateur serait ouvert à recevoir des propositions sur des thèmes <strong>au</strong>tres que<br />
ceux indiqués, mais en lien avec <strong>le</strong> thème du colloque.<br />
Les propositions de communications peuvent être soumises en français et anglais <strong>au</strong> plus<br />
tard <strong>le</strong> 31 juil<strong>le</strong>t 2010. Pour soumettre une proposition en ligne et avoir plus d’in<strong>format</strong>ion sur<br />
<strong>le</strong> colloque consultez notre site web : < www.cri.uqam.ca.><br />
2.4<br />
Source Roch Hurtubise <br />
Colloque international pluridisciplinaire<br />
Vieillissement de la population dans <strong>le</strong>s pays du Sud :<br />
Famil<strong>le</strong>, Conditions de vie, Solidarités publiques et privées…<br />
État des lieux et perspectives.<br />
Du 17 <strong>au</strong> 19 mars 2011, Meknès (Maroc)<br />
Date limite des propositions de communication : 30 septembre 2010<br />
Organisé par<br />
La Faculté des Sciences juridiques, Economiques et Socia<strong>le</strong>s de<br />
l’Université Moulay Ismaïl de Meknès<br />
en collaboration avec<br />
l’Université de Tours et l’UMR CITERES (Equipes COST et EMAM)<br />
La langue de travail du colloque est <strong>le</strong> Français.<br />
Les axes de réf<strong>le</strong>xion proposés sont <strong>le</strong>s suivants :<br />
1. Statut et représentation des personnes âgées dans <strong>le</strong>s pays du Sud<br />
2. Famil<strong>le</strong>s et solidarités<br />
3. Conditions de vie des personnes âgées<br />
4. Solidarités publiques et privées<br />
5. Vieil<strong>le</strong>sse et habitat<br />
L’un des objectifs du colloque est de mettre en relation des chercheurs issus des pays du<br />
Sud et du Nord qui travail<strong>le</strong>nt sur cette thématique émergente.<br />
Toutes <strong>le</strong>s in<strong>format</strong>ions sur <strong>le</strong> colloque seront progressivement mises en ligne à cette<br />
adresse <br />
Pour toute question à propos de ce colloque,<br />
Merci d’adresser votre message à : <br />
Source C. d'organisation <br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
2.5<br />
Colloque international<br />
Créativité socia<strong>le</strong> et culturel<strong>le</strong> émergente<br />
Les visages pluriels de l’individu incertain<br />
Du 12 <strong>au</strong>14 avril 2011, Mexico (Mexique)<br />
Date limite des propositions de communication : 31 septembre 2010<br />
Instituto de Investigaciones Socia<strong>le</strong>s (IIS)<br />
de la Univ. Nacional Autónoma de Mexico (UNAM)<br />
Laboratorio Internacional de Investigación Social y Cultural *<br />
CesNova, Centro de Estudos em Sociologia<br />
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa (Portugal)<br />
Chaire de Sociologie, Travail Social et Politiques Socia<strong>le</strong>s de l’Univ. de Fribourg (Suisse)<br />
Lieu<br />
Dans <strong>le</strong> cadre du Comité de Recherche<br />
CR30 "Inégalités, Identités et Liens Soci<strong>au</strong>x" de l’AISLF<br />
ppaaggee 1100<br />
Ce colloque <strong>au</strong>ra lieu du mardi 12 <strong>au</strong> jeudi 14 avril 2011, dans la sal<strong>le</strong> de conférences de<br />
l’Insituto de Investigaciones Socia<strong>le</strong>s de l’Universidad Nacional Autonoma de Mexico<br />
(Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Campus de l’UNAM, Mexico DF).<br />
Comité scientifique<br />
Guy Bajoit, Univ. Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique ; <br />
Casimiro Balsa, Univ. Nova, Lisboa, Portugal ; <br />
Pablo S. Garcia, Univ. de Buenos Aires, Argentina ; <br />
Mario Sandoval, Univ.Católica Silva Henriquez, Santiago, Chi<strong>le</strong> ; <br />
Marc-Henry Sou<strong>le</strong>t, Univ. de Fribourg, Suisse ; <br />
Hugo José Suarez, Univ. Nacional Autónoma de Mexico ; <br />
Veronica Zubillaga, Univ. S. Bolivar, Caracas, Venezuela ; <br />
Comité d’organisation<br />
Antécédents<br />
Pour toute in<strong>format</strong>ion, s’adresser à :<br />
Hugo José Suarez, Univ. Nacional Autónoma de Mexico.<br />
Guy Bajoit, Univ. Catholique de Louvain-la-Neuve.<br />
Cette rencontre scientifique s’inscrit dans une ligne de réf<strong>le</strong>xion ouverte par plusieurs<br />
colloques antérieurs, organisés soit par l’Instituto de Investigaciones Socia<strong>le</strong>s (IIS) de<br />
l’UNAM, soit par <strong>le</strong> Comité de Recherche 30 de l’AISLF.<br />
* Les membres de ce Laboratoire sont, actuel<strong>le</strong>ment, Hugo José Suarez, de la Univ. Nacional Autónoma de Mexico, Mexique ;<br />
Veronica Zubillaga, de la Univ. Simon Bolivar, Venezuela ; Pablo S. García, de la Univ. de Buenos Aires, Argentina ; Mario<br />
Sandoval, de la Univ. Católica Silva Henriquez, Chi<strong>le</strong> et Guy Bajoit, de l’Univ. Catholique de Louvain, Belgique. Bien<br />
entendu, ce groupe est ouvert à d’<strong>au</strong>tres collaborations.<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 1111<br />
Ainsi, en mars 2009, Hugo Jose Suarez et Veronica Zubillaga ont organisé, à l’IIS de<br />
l’UNAM, une rencontre sur <strong>le</strong> thème Malaise social et angoisse d’exister 1 . Le but de ce<br />
premier échange était de mettre en évidence, chez be<strong>au</strong>coup de groupes soci<strong>au</strong>x, <strong>le</strong>s<br />
formes du malaise existentiel qui résultent des changements soci<strong>au</strong>x, économiques,<br />
technologiques, politiques et culturels en cours dans nos sociétés et plus particulièrement en<br />
Amérique Latine. En mars 2010, ils ont organisé, dans <strong>le</strong> même cadre institutionnel, une<br />
seconde rencontre, qui devait prolonger la première, et qui a eu pour thème L’incertitude et<br />
<strong>le</strong>s stratégies de sens 2 . Encouragés par <strong>le</strong> succès de ces deux rencontres, <strong>le</strong>s organisateurs<br />
souhaitent maintenant, non seu<strong>le</strong>ment élargir la participation en organisant, en avril 2011, un<br />
troisième colloque avec la collaboration de l’AISLF, mais <strong>au</strong>ssi en faisant un pas de plus<br />
pour approfondir la problématique, cel<strong>le</strong> de la créativité socia<strong>le</strong> et culturel<strong>le</strong> de l’individu face<br />
à l’incertitude.<br />
De son côté, et depuis de nombreuses années, <strong>le</strong> Comité de Recherche 30 de l’AISLF a<br />
organisé plusieurs colloques sur ces mêmes questions. Citons seu<strong>le</strong>ment ceux qui se<br />
rapportent <strong>le</strong> plus directement <strong>au</strong> thème proposé ici : à l’Université de Fribourg (Suisse), en<br />
2002 : « Faire face et s'en sortir. Agir en situation de vulnérabilité » ; à l’Université de Tours<br />
(France), en 2004 : « Retour à l'individu et détours de l'individu : individuation et société<br />
d’inégalités » ; à l’Université de Concepción (Chili) en 2008 : « Le contrat social dans un<br />
monde en voie de globalisation » ; à l’Université de Montes-Claros (Brésil), en 2010 : « Les<br />
Ressources de la lutte contre la p<strong>au</strong>vreté : entre contrô<strong>le</strong> sociétal et reconnaissance<br />
socia<strong>le</strong> ». 3<br />
Problématique<br />
Dans des sociétés régies par un modè<strong>le</strong> culturel de l’ « individu-sujet-acteur », chacun se sent appelé<br />
par la culture qui l’environne à se réaliser comme personne singulière, à choisir sa vie, à la vivre avec<br />
passion et bonheur, à être <strong>au</strong>tonome et responsab<strong>le</strong> de lui-même, à ne tomber dans <strong>au</strong>cun des<br />
pièges qui se dressent sur son chemin. Or, il lui est diffici<strong>le</strong> de se conformer à de tel<strong>le</strong>s injonctions :<br />
souvent, <strong>le</strong>s ressources lui manquent ou la société ne <strong>le</strong>s donne pas ; souvent <strong>au</strong>ssi, même quand il<br />
en dispose, il ne sait pas comment s’y prendre pour se conformer à des attentes <strong>au</strong>ssi exigeantes.<br />
Son avenir est donc incertain, et <strong>le</strong> malaise – <strong>le</strong> mal être – qui résulte de cette incertitude peut toucher<br />
tout <strong>le</strong> monde. S’il est vrai que <strong>le</strong>s précaires et <strong>le</strong>s exclus sont plus vulnérab<strong>le</strong>s que <strong>le</strong>s <strong>au</strong>tres, il n’est<br />
pas moins vrai que l’incertitude peut atteindre n’importe qui. En effet, cette hydre moderne porte,<br />
sinon sept, <strong>au</strong> moins cinq têtes :<br />
1. L'appel à la compétition engendre la montée de la précarité, des inégalités, du chômage et,<br />
d'une manière généra<strong>le</strong>, de l'exclusion socia<strong>le</strong>. Or, dans <strong>le</strong> même temps, l'appel insistant à la<br />
consommation fait désirer <strong>au</strong>x individus des dizaines de biens et de services qu'ils <strong>au</strong>ront bien du<br />
mal à se procurer. Certains y parviendront pourtant, mais en travaillant be<strong>au</strong>coup (stress), en<br />
devenant des « loups parmi <strong>le</strong>s loups » (hyper-individualisme) et en s'endettant souvent à l'excès<br />
(consumérisme) ; d'<strong>au</strong>tres n'y parviendront jamais…, et ils <strong>le</strong> savent !<br />
2. L'appel à une nouvel<strong>le</strong> citoyenneté (plus pragmatique, plus proche des gens, plus participative,<br />
plus décentralisée) entre en contradiction flagrante avec <strong>le</strong> monde politique « traditionnel », qui<br />
résiste <strong>au</strong> changement, et qui s'enfonce peu à peu dans la démagogie, <strong>le</strong>s marchandages, <strong>le</strong>s<br />
promesses non tenues, <strong>le</strong> clientélisme, <strong>le</strong>s scanda<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> corruption, <strong>le</strong>s « affaires » et, plus<br />
généra<strong>le</strong>ment, l'absence de projet politique alternatif <strong>au</strong> modè<strong>le</strong> néolibéral.<br />
__________________________<br />
1 Les actes de ce colloque sont actuel<strong>le</strong>ment sous presse à l’Instituto de Investigación Social de l’UNAM, sous <strong>le</strong> titre : El<br />
nuevo ma<strong>le</strong>star en la cultura (Coordinateurs : Hugo Jose Suarez, Veronica Zubillaga et Guy Bajoit).<br />
2 Les actes sont actuel<strong>le</strong>ment en préparation et seront publiés par <strong>le</strong> même éditeur que <strong>le</strong> précédent.<br />
3 Les actes de ces colloques ont été publiés, soit par l’Université de Fribourg (Academic Press Friboug, Col. Res Publica), soit<br />
par l’Université Nova de Lisboa (par <strong>le</strong> CesNova, en collaboration avec d’<strong>au</strong>tres presses universitaires).<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 1122<br />
3. L'appel à l'<strong>au</strong>tonomie, à la responsabilisation des individus, à l'activation, sur <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s élites<br />
politiques prétendent fonder <strong>le</strong> nouve<strong>au</strong> contrat social est contredit dans la pratique <strong>au</strong> moins<br />
pour deux raisons. D'une part, par l'insuffisance des moyens mis à la disposition des politiques<br />
socia<strong>le</strong>s et des services publics, alors que <strong>le</strong>s besoins ne cessent d’<strong>au</strong>gmenter. D'<strong>au</strong>tre part,<br />
cette politique socia<strong>le</strong> et publique — qui prétend, dans son discours, rest<strong>au</strong>rer la citoyenneté,<br />
l'<strong>au</strong>tonomie et la responsabilité des sujets individuels —, débouche en réalité sur une « chasse<br />
<strong>au</strong>x profiteurs » et à ceux qui mettent en péril la sécurité publique.<br />
4. L'appel à l'<strong>au</strong>toréalisation individuel<strong>le</strong> et à un rapport réf<strong>le</strong>xif à la norme et <strong>au</strong>x va<strong>le</strong>urs entre en<br />
contradiction avec la crise de l’<strong>au</strong>torité dans <strong>le</strong>s instances de socialisation (la famil<strong>le</strong>, l’éco<strong>le</strong>…).<br />
Cette crise engendre, <strong>au</strong>ssi bien chez ceux qui doivent exercer l’<strong>au</strong>torité que chez ceux à qui el<strong>le</strong><br />
s’applique, des troub<strong>le</strong>s psychiques plus ou moins graves : troub<strong>le</strong>s de l'identité, de la relation<br />
socia<strong>le</strong> et de l'agir.<br />
5. L'appel <strong>au</strong> pluralisme, à la tolérance envers <strong>le</strong>s différences, à l'interculturel, à l'inscription des<br />
individus dans des rése<strong>au</strong>x, entre en contradiction avec deux traits importants des sociétés<br />
d'<strong>au</strong>jourd'hui. D'une part, la mondialisation – avec la généralisation de l'American way of life –,<br />
est en train de broyer, partout dans <strong>le</strong> monde, <strong>le</strong>s cultures loca<strong>le</strong>s avec toute la puissance de<br />
conviction des mass media et des industries culturel<strong>le</strong>s, provoquant partout des replis sur <strong>le</strong>s<br />
identités ethniques et nationa<strong>le</strong>s. D'<strong>au</strong>tre part, ces replis culturels ont souvent des re<strong>le</strong>nts<br />
racistes, et <strong>le</strong> racisme, comme l'extrême droite, est une des formes de réponse à l'incertitude<br />
dans laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s gens sont amenés à vivre <strong>au</strong>jourd'hui.<br />
Comment <strong>le</strong>s individus « se débrouil<strong>le</strong>nt-ils » avec ces formes d’incertitude ? La question que<br />
soulève <strong>le</strong> colloque <strong>au</strong>quel nous vous convions est cel<strong>le</strong> des formes de créativité socia<strong>le</strong> et<br />
culturel<strong>le</strong>, qui émergent de tous <strong>le</strong>s individus affectés par <strong>le</strong> malaise et l’inquiétude. L’accent est<br />
mis, cette fois, sur l’innovation, sur la capacité des individus incertains d’inventer eux-mêmes des<br />
solutions à <strong>le</strong>urs problèmes, et de se conduire ainsi, dans <strong>le</strong>s limites de <strong>le</strong>urs ressources, comme<br />
sujets et acteurs de <strong>le</strong>ur existence.<br />
Sans prétendre ici à l’exh<strong>au</strong>stivité, et dans <strong>le</strong> seul but d’illustrer quelque peu une problématique<br />
que <strong>le</strong>s participants ne manqueront pas d’enrichir par <strong>le</strong>urs apports, on peut observer que la<br />
créativité dont il s’agit s’exprime chez toutes <strong>le</strong>s catégories d’individus où l’incertitude fait des<br />
ravages. En voici quelques exemp<strong>le</strong>s.<br />
Les visages du jeune face à l’incertitude<br />
Face à <strong>le</strong>ur avenir, plus ou moins inquiétant selon <strong>le</strong>s ressources dont ils disposent, <strong>le</strong>s jeunes<br />
adoptent de multip<strong>le</strong>s formes créatives d’adaptation : ils entrent dans « <strong>le</strong> système » et deviennent<br />
des travail<strong>le</strong>urs précaires mais f<strong>le</strong>xib<strong>le</strong>s, des consommateurs compétitifs et connectés sur <strong>le</strong> web ; ils<br />
participent à des groupes de pairs (<strong>le</strong>s bandes, <strong>le</strong>s tribus urbaines, <strong>le</strong>s supporters…) ; ils font partie de<br />
mouvements politiques (l’altermondialisme, l’anarchisme, l’extrême droite...), de courants artistiques<br />
(<strong>le</strong> hip-hop, <strong>le</strong> rap, <strong>le</strong> tag…) ou religieux (chrétiens, musulmans, bouddhistes…) ; et, pourquoi pas ? ils<br />
se marient et font des enfants !<br />
Les visages de la femme, de l’homme et du coup<strong>le</strong> face à l’incertitude<br />
Malgré des progrès indéniab<strong>le</strong>s, devant <strong>le</strong>s discriminations dont el<strong>le</strong>s continuent d’être victimes, <strong>le</strong>s<br />
femmes exigent toujours l’égalité chère <strong>au</strong>x féministes. Mais, en même temps – modè<strong>le</strong> culturel<br />
oblige –, el<strong>le</strong>s revendiquent <strong>au</strong>ssi <strong>le</strong>ur droit à une identité singulière, <strong>au</strong> libre choix de la vie qu’el<strong>le</strong>s<br />
entendent mener : vivre seu<strong>le</strong>s ou en coup<strong>le</strong>, être hétéro ou homosexuel<strong>le</strong>s, avoir ou non des enfants,<br />
devenir des professionnel<strong>le</strong>s ou des mères <strong>au</strong> foyer, être frivo<strong>le</strong>s et séduisantes ou porter <strong>le</strong> voi<strong>le</strong>,<br />
comme bon <strong>le</strong>ur plaît, et sans que ce soit forcément incompatib<strong>le</strong>.<br />
Mais si <strong>le</strong> genre féminin « n’est plus ce qu’il était », <strong>le</strong> genre masculin n’est pas davantage « sûr de<br />
son affaire » : quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s normes de la masculinité d’<strong>au</strong>jourd’hui ? Alors que la plupart des<br />
femmes occupent des emplois, l’homme est-il encore celui qui gagne l’argent du ménage ? Quel<strong>le</strong> est<br />
sa position devant <strong>le</strong> partage des tâches dites « domestiques » ? Comment se comporte-t-il dans sa<br />
sexualité ? Comment exerce-t-il sa paternité ?<br />
Et, bien entendu, des femmes et des hommes en train de créer des identités nouvel<strong>le</strong>s, cela donne<br />
des coup<strong>le</strong>s plus incertains que jamais, et donc <strong>au</strong>ssi des enfants, des famil<strong>le</strong>s dont l’avenir n’est plus<br />
prévisib<strong>le</strong>, structuré par des normes claires et rassurantes.<br />
Les visages du travail<strong>le</strong>ur face à l’incertitude<br />
Partout, <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> économique et technologique néolibéral a posé ses conditions : restructuration et<br />
délocalisation d’entreprises, robotisation de la production, individualisation des contrats de travail,<br />
démobilisation du syndicalisme, mise en place d’une nouvel<strong>le</strong> culture d’entreprise. Les groupes<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 1133<br />
financiers et commerci<strong>au</strong>x <strong>le</strong>s plus forts imposent la libre compétition <strong>au</strong>x plus faib<strong>le</strong>s, alors qu’ils ne<br />
la respectent pas eux-mêmes. Il en a résulté une précarisation du travail et une régression de la<br />
sécurité socia<strong>le</strong>. Dans <strong>le</strong> secteur formel, <strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>urs doivent cultiver la performance s’ils veu<strong>le</strong>nt<br />
garder <strong>le</strong>ur emploi ; dans <strong>le</strong> secteur informel, ils doivent brico<strong>le</strong>r des solutions : des entreprises<br />
récupérées <strong>au</strong>togérées, du troc, de la monnaie loca<strong>le</strong>, de l’économie socia<strong>le</strong> solidaire…<br />
Les visages du citoyen et du militant face à l’incertitude<br />
Hier, <strong>le</strong> citoyen était sûr de son affaire. Il était « de g<strong>au</strong>che » (anticapitaliste, anti-impérialiste,<br />
socialiste révolutionnaire ou social-démocrate) ou il était « de droite » (<strong>le</strong> contraire). Aujourd’hui, il ne<br />
sait plus par où passe cette ligne de partage : <strong>le</strong>s révolutionnaires ne sont plus crédib<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s soci<strong>au</strong>xdémocrates<br />
sont presque <strong>au</strong>ssi libér<strong>au</strong>x que la droite et, depuis la dernière crise, <strong>le</strong>s néolibér<strong>au</strong>x<br />
par<strong>le</strong>nt de la nécessité d’en revenir à une régulation du marché par l’État. Comment être citoyen<br />
<strong>au</strong>jourd’hui dans des pays où l’État est incapab<strong>le</strong> d’assurer ses fonctions essentiel<strong>le</strong>s : garantir la<br />
sécurité des citoyens, exercer la vio<strong>le</strong>nce légitime, garantir <strong>le</strong> contrat social par une solidarité<br />
instituée, légiférer et gouverner, rester souverain dans un ordre mondialisé ?<br />
Et comment être militant politique ou social, lorsque <strong>le</strong>s enjeux se sont diversifiés ? Il y a toujours <strong>le</strong><br />
syndicalisme (ouvrier ou paysan), bien sûr, mais <strong>au</strong>ssi la défense de l’environnement, des<br />
consommateurs, de la démocratie, des services publics, des peup<strong>le</strong>s originaires, des femmes, des<br />
jeunes, des exclus, des immigrés, des homosexuels, etc., etc.<br />
Les visages du croyant face à l’incertitude<br />
Hier, l’Occident était catholique ou protestant ; à moins d’être laïc (ce qui n’est qu’une <strong>au</strong>tre<br />
croyance) ! Aujourd’hui, <strong>le</strong> croyant a <strong>le</strong> choix, mais il ne sait plus en quoi croire : sectes et églises se<br />
livrent à un prosélytisme acharné, et ce n’est pas toujours la conviction religieuse qui entraîne<br />
l’adhésion. Il peut réaffirmer sa foi ancienne ou construire ses croyances « à la carte », en y mêlant un<br />
peu de bouddhisme, un peu d’islam, un peu d’animisme et pas mal de superstition.<br />
Structure du colloque<br />
Le colloque comportera cinq ou six demi-journées du travail (selon <strong>le</strong>s propositions de<br />
communication retenues) : deux <strong>le</strong> mardi 12, deux <strong>le</strong> mercredi 13 et une ou deux <strong>le</strong> jeudi 14<br />
avril. Chacune serait introduite par deux conférences plénières, l’une par un conférencier<br />
latino-américain, l’<strong>au</strong>tre par un conférencier proposé par l’AISLF. Si <strong>le</strong> nombre et <strong>le</strong>s thèmes<br />
abordés par <strong>le</strong>s participants l’<strong>au</strong>torisent, <strong>le</strong>s cinq champs d’innovation énoncés ci-dessus<br />
devraient permettre de distribuer <strong>le</strong>s communications entre <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>s rondes, parallè<strong>le</strong>s ou<br />
simultanées.<br />
Comment participer ?<br />
Les chercheurs intéressés à prendre part à ce colloque devront s’adresser à l’un ou à l’<strong>au</strong>tre<br />
des deux membres du Comité d’organisation : Hugo José Suarez et/ou Guy Bajoit. Ils <strong>le</strong>ur<br />
enverront un résumé détaillé de la communication qu’ils comptent présenter (en français ou<br />
en espagnol). Nous <strong>le</strong>ur demandons de faire cette démarche avant <strong>le</strong> 31 septembre 2010,<br />
afin de pouvoir <strong>le</strong>ur donner une réponse dans un délai suffisant, afin que ceux qui ont besoin<br />
d’introduire des demandes de financement aient <strong>le</strong> temps de <strong>le</strong> faire. Le Comité scientifique<br />
examinera <strong>le</strong>ur proposition et <strong>le</strong>ur communiquera sa décision avant <strong>le</strong> 31 octobre 2010.<br />
Des In<strong>format</strong>ions pratiques seront communiquées plus tard.<br />
¥¥ ¥¥<br />
Source Guy Bajoit <br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
3. Manifestations<br />
Programme<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
3.1<br />
Colloque international<br />
Développement durab<strong>le</strong>, Commun<strong>au</strong>tés et Sociétés<br />
Du 16 <strong>au</strong> 18 juin 2010, Mulhouse (France)<br />
<br />
Université de H<strong>au</strong>te-Alsace, Campus Fonderie<br />
Faculté des Sciences Economiques, Socia<strong>le</strong>s et Juridiques<br />
AISLF - CR 21 "Transaction socia<strong>le</strong>"<br />
Groupe de Sociologie Politique Européenne (GSPE-PRISME)<br />
Centre de Recherches en Sciences Socia<strong>le</strong>s (CRESS)<br />
Le mercredi 16 juin 2010 à consulter sur <strong>le</strong> lien suivant :<br />
<br />
Le jeudi 17 juin 2010 à consulter sur <strong>le</strong> lien suivant :<br />
<br />
Le jeudi 17 juin 2010 à consulter sur <strong>le</strong> lien suivant :<br />
<br />
3.2<br />
ppaaggee 1144<br />
Source Josiane Stoessel-Ritz <br />
Journée d'étude<br />
Développement durab<strong>le</strong> des territoires. Quel<strong>le</strong> place pour <strong>le</strong> patrimoine<br />
et <strong>le</strong> paysage dans la <strong>format</strong>ion du lien social ?<br />
Vendredi 18 juin 2010, Val de Reuil (France)<br />
Ce séminaire s’inscrit dans <strong>le</strong> cadre d’un contrat de collaboration entre la Commun<strong>au</strong>té<br />
d’Agglomération Seine-Eure et <strong>le</strong> laboratoire « Groupe de Recherche Innovations et<br />
Sociétés » de l’université de Rouen. Il offre l’opportunité d’une rencontre entre universitaires<br />
et acteurs du territoire <strong>au</strong>tour de questions sur <strong>le</strong> patrimoine (bâti et naturel) et son<br />
inscription dans <strong>le</strong> processus du développement durab<strong>le</strong>. Cette rencontre est une occasion<br />
pour <strong>le</strong>s participants (chercheurs, services de l’Etat, professionnels, col<strong>le</strong>ctivités publiques,<br />
associations…) de prendre connaissance des résultats de trav<strong>au</strong>x empiriques et d’échanger<br />
sur des questions diverses du territoire tel<strong>le</strong>s que la place et <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> du paysage dans la<br />
valorisation des lieux, <strong>le</strong> patrimoine bâti et l’identité des territoires, l’insertion socia<strong>le</strong> par <strong>le</strong><br />
patrimoine, l’importance du social dans <strong>le</strong> rapport à l’environnement et <strong>au</strong>tres questions sur<br />
<strong>le</strong> vaste champ du développement durab<strong>le</strong>.<br />
Programme consultab<strong>le</strong> sur <strong>le</strong> lien suivant :<br />
<br />
¥¥ ¥¥<br />
Source Nassima Dris < nassima.dris@wanadoo.fr><br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
4. Les publications de membres<br />
ppaaggee 1155<br />
Thierry Blin, Requiem pour une phénoménologie : sur Alfred Schütz, Mer<strong>le</strong><strong>au</strong>-Ponty et<br />
quelques <strong>au</strong>tres, Paris, Eds du Félin, Coll. Le Félin Poche, 2010, 192 p.<br />
Pour c<strong>au</strong>se d’hégémonie durkheimienne, que n’amoindrira pas la vague structuraliste, la tradition<br />
sociologique al<strong>le</strong>mande, de Max Weber à Georg Simmel, est longtemps restée cantonnée dans<br />
d’obscurs baraquements, où ne rodaient que quelques rares chercheurs têtus. Ce temps passé n’est<br />
plus <strong>le</strong> nôtre. Il s’est en effet trouvé que <strong>le</strong>s sciences socia<strong>le</strong>s, revues et corrigées à l’encre naissante<br />
des années 1980, vécurent un «changement de paradigme» marquant la sortie de l’âge structuraliste,<br />
<strong>au</strong> profit d’une attention portée à la part réfléchie de l’action humaine. D’où cette conséquence qu’il n’y<br />
avait plus à dire «structure», «déterminisme caché», avec pour corrélat <strong>le</strong> (be<strong>au</strong>) rô<strong>le</strong> démystificateur<br />
du sociologue, mais «action». La sociologie pourrait alors s’offrir corps et âmes, ici à la tradition<br />
compréhensive, là à l’herméneutique, ail<strong>le</strong>urs à l’anthropologie du quotidien, à la phénoménologie<br />
socia<strong>le</strong>… Décorticage des arcanes de la phénoménologie socia<strong>le</strong> à l’appui, de Husserl à Aron<br />
Gurwitsch, en passant par Mer<strong>le</strong><strong>au</strong>-Ponty et Alfred Schütz, Thierry Blin nous livre un essai ardent et<br />
polémique sur une pente récente du débat sociologique qui intéressera éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> philosophe.<br />
Anni Borzeix, Gwenaël<strong>le</strong> Rot, Genèse d'une discipline, naissance d'une revue, Sociologie<br />
du travail, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2010<br />
Le projet de ce livre est né en 2002 d’une rencontre entre deux sociologues du travail qu’une<br />
génération sépare. Comment et pourquoi devenait-on sociologue du travail il y a cinquante ans et en<br />
quoi consistait alors ce métier ? La création d’une revue consacrée à ce domaine allait nous servir de<br />
bousso<strong>le</strong> pour remonter <strong>le</strong> temps. Comment et pourquoi la revue Sociologie du travail avait-el<strong>le</strong> vu <strong>le</strong><br />
jour en 1959 ? Cette publication offrait <strong>au</strong>ssi un <strong>au</strong>tre atout. El<strong>le</strong> réunissait en qualité de fondateurs<br />
quatre éminents sociologues, Michel Crozier, Jean-Daniel Reyn<strong>au</strong>d, Alain Touraine et Jean-René<br />
Tréanton. Nous tenions là, sans <strong>au</strong>cun doute, de quoi raconter une « bel<strong>le</strong> histoire » dont <strong>le</strong> sens –<br />
pour ceux qui l’avaient vécue, mais peut-être surtout pour <strong>le</strong>s générations suivantes – restait<br />
accessib<strong>le</strong> ; de quoi offrir <strong>au</strong>x futurs praticiens de la discipline une histoire sensib<strong>le</strong> sur la fabrique d’un<br />
objet de papier simp<strong>le</strong> et robuste, un périodique de référence qui paraît toujours cinquante ans plus<br />
tard.<br />
Roland J. Campiche, La religion visib<strong>le</strong>. Pratiques et croyances en Suisse, L<strong>au</strong>sanne,<br />
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Série: Société, 2010, 144 p.<br />
La religion en Europe ne s’est pas effondrée dans <strong>le</strong>s ardeurs consommatrices des Trente glorieuses.<br />
El<strong>le</strong> a profondément changé. Son pô<strong>le</strong> institutionnel, représenté par <strong>le</strong>s Eglises catholique romaine et<br />
réformée, a été marginalisé mais n’a pas laissé la place vide. Mort de Dieu ? Nul<strong>le</strong>ment, selon <strong>le</strong>s<br />
enquêtes qui, de 1962 à nos jours, révè<strong>le</strong>nt l’évolution des pratiques et croyances. En Suisse une<br />
forte majorité des personnes interrogées continue à se référer à une tradition religieuse. Ce chiffre se<br />
réduit de moitié si l’on considère la tradition chrétienne. C’est un rejet du «prêt-à-croire». Seul un quart<br />
de la population affirme une certitude religieuse absolue, mais rares sont ceux qui disent: je ne crois<br />
pas en Dieu. Le doute, la recherche ou la gestion des différences sont entrés dans <strong>le</strong> «logiciel<br />
religieux» des famil<strong>le</strong>s, souvent recomposées ou mixtes, mais qui continuent d’assurer la<br />
transmission. De quel<strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs ? De quel<strong>le</strong> foi ? L’<strong>au</strong>teur, l’un des pionniers de la sociologie des<br />
religions, répond avec références, nuances et réf<strong>le</strong>xions à une question abrupte: que croient <strong>le</strong>s<br />
Suisses ?<br />
Bérengère Marques-Pereira, Petra Meier et David Paternotte (eds), Au-delà et en deçà de<br />
l'État : Le genre entre dynamiques transnationa<strong>le</strong>s et multi-nive<strong>au</strong>x, Louvain-la-Neuve,<br />
Belgique, Academia Bruylant, Coll. Science politique, 2010, 204 p<br />
In<strong>format</strong>ions complémentaires, couverture et tab<strong>le</strong> des matières :<br />
http://www.academia-bruylant.be/index2.php?addr=fr2/fiche_3.php?id=2970<br />
Présentation du livre et bon de commande: http://www.academia-bruylant.be/doc/BDC_ScPol10.pdf<br />
Cet ouvrage étudie la problématique « genre et politique » <strong>au</strong>-delà, en-deçà, voire à côté de l’État. À<br />
l’heure de la globalisation, il s’intéresse <strong>au</strong>x relations entre mouvements de femmes, politiques<br />
publiques destinées à promouvoir l’égalité des sexes et dynamiques transnationa<strong>le</strong>s et multi-nive<strong>au</strong>x.<br />
Il déplace <strong>le</strong> regard de l’enceinte étatique, espace d’analyse privilégié des recherches sur genre et<br />
politique, vers un monde comp<strong>le</strong>xe, dans <strong>le</strong>quel <strong>le</strong>s arènes de pouvoir se multiplient, s’enchevêtrent et<br />
interagissent. Il examine <strong>le</strong>s défis posés par cet environnement et la manière dont acteurs politiques<br />
et soci<strong>au</strong>x s’en saisissent. Il s’interroge sur <strong>le</strong>s « voyages » du concept de genre et sur sa<br />
trans<strong>format</strong>ion. Ce livre, un des premiers en français sur cette thématique, réunit des politologues, des<br />
historiennes et des sociologues de Belgique, du Chili, de France, du Québec et de Suisse..<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
ppaaggee 1166<br />
Ivan Sains<strong>au</strong>lieu, Monika Salzbrunn et L<strong>au</strong>rent Amiotte-Suchet (dir.), Faire commun<strong>au</strong>té<br />
en société. Dynamique des appartenances col<strong>le</strong>ctives, Rennes, Presses Universitaires de<br />
Rennes, Coll. Le Sens social, 2010, 250 p.<br />
Tension fondamenta<strong>le</strong> de la sociologie, la relation entre commun<strong>au</strong>té et société demeure <strong>au</strong> centre de<br />
la réf<strong>le</strong>xion théorique contemporaine. La synthèse des débats francophones (marqués par<br />
l’historicisme), germanophones (<strong>le</strong>s notions de «Gemeinschaft »/« Gesellschaft » de Tönnies, Weber,<br />
Luhmann), anglophones (<strong>le</strong>s « community studies ») et italophones (Roberto Esposito) constitue l’un<br />
des points forts du présent ouvrage. Celui-ci donne éga<strong>le</strong>ment une place importante <strong>au</strong>x études<br />
empiriques qui, à partir de terrains variés, permettent d’illustrer la diversité des formes socia<strong>le</strong>s<br />
commun<strong>au</strong>taires.<br />
Françoise Lorcerie (sous la dir. de), Pratiquer <strong>le</strong>s frontières. Jeunes migrants et<br />
descendants de migrants dans l’espace franco-maghrébin, CNRS éditions,<br />
, 2010<br />
Gril<strong>le</strong>s, caméras, miradors. Les obstac<strong>le</strong>s entre l’Europe et <strong>le</strong> Maghreb se dressent chaque jour un<br />
peu plus h<strong>au</strong>ts pour empêcher <strong>le</strong>s migrants clandestins d’al<strong>le</strong>r vers <strong>le</strong> Nord. Instituées par des États<br />
qui sont à la peine avec <strong>le</strong>urs politiques d’intégration, ces frontières barrent <strong>le</strong> passage, refou<strong>le</strong>nt des<br />
individus en quête d’un ail<strong>le</strong>urs fantasmé qui fut celui de plusieurs générations. Au nord, en France,<br />
<strong>le</strong>urs cousins, descendants d’immigrés, font face à d’<strong>au</strong>tres frontières, d’une nature certes différente.<br />
Ici, ce sont <strong>le</strong>s ségrégations socia<strong>le</strong>s et ethno-racia<strong>le</strong>s, véritab<strong>le</strong>s plafonds de verre, qui séparent et<br />
rejettent. Autant de trajets, de connexions, de parcours et d’expériences que ce livre interroge et<br />
partage entre <strong>le</strong> Maghreb et <strong>le</strong>s quartiers. Enquête sociologique, cet ouvrage apporte un recadrage<br />
théorique sur la gestion des frontières par <strong>le</strong>s migrants et un éclairage multip<strong>le</strong> de douze<br />
témoignages, douze coups de projecteur analytiques, qui permettent de renouve<strong>le</strong>r l’in<strong>format</strong>ion<br />
disponib<strong>le</strong>.<br />
L<strong>au</strong>rence Roul<strong>le</strong><strong>au</strong>-Berger, Migrer <strong>au</strong> féminin, Paris, PUF, Coll. "La nature humaine", 2010,<br />
192 p.<br />
La migration internationa<strong>le</strong> de ces dernières années a un visage de plus en plus féminin. Les<br />
situations économiques des femmes en migration ne cessent de se diversifier et de se comp<strong>le</strong>xifier.<br />
Tout en contribuant à la reconfiguration des économies loca<strong>le</strong>s et globa<strong>le</strong>s, cel<strong>le</strong>s-ci sont souvent<br />
confrontées à l’épreuve de la disqualification socia<strong>le</strong>. Certaines deviennent objet de déni de<br />
reconnaissance et de vio<strong>le</strong>nces symboliques. En analysant <strong>le</strong>s parcours biographiques et <strong>le</strong>s<br />
expériences migratoires de ces femmes, L<strong>au</strong>rence Roul<strong>le</strong><strong>au</strong>-Berger montre comment el<strong>le</strong>s<br />
redéfinissent <strong>le</strong>ur identité à partir d’une multiplicité de rô<strong>le</strong>s et d’appartenances dans un contexte<br />
globalisé et multistratifié.<br />
Philippe Cabin et Jean-François Dortier (coordonné par), La communication. État des<br />
savoirs, Paris, éds. Sciences humaines . Les <strong>au</strong>teurs ayant<br />
participé à cet ouvrage : Daniel Bougnoux, Jacques Cosnier, Daniel Dayan, Wil<strong>le</strong>m Doise,<br />
Gustave-Nicolas Fischer, Patrice Flichy, Jacques Goldberg, Catherine Kerbrat-Orecchioni,<br />
Pascal Lardellier, Edmond Marc Lipiansky, Philippe Meirieu, Bernard Miège, Edgar Morin,<br />
A<strong>le</strong>x Mucchielli, Dominique Picard, Alain Ral<strong>le</strong>t, Emmanuel Sander, Yves Winkin,<br />
Dominique Wolton.<br />
De la conversation ordinaire <strong>au</strong>x grands médias de masse, des échanges privés à la communication<br />
dans l’entreprise, du téléphone portab<strong>le</strong> à Internet, des panne<strong>au</strong>x routiers <strong>au</strong>x satellites, la<br />
communication est partout et a envahi nos vies. Voilà pourquoi on n’hésite pas à par<strong>le</strong>r <strong>au</strong>jourd’hui de<br />
« société de l’in<strong>format</strong>ion et de la communication ». Les sciences de l’in<strong>format</strong>ion et de la<br />
communication se sont même constituées pour tenter de penser <strong>le</strong> phénomène. Cet ouvrage propose<br />
<strong>le</strong> bilan de cinquante ans de recherches sur la communication et fait <strong>le</strong> point sur <strong>le</strong>s grands enjeux liés<br />
<strong>au</strong>x révolutions des nouvel<strong>le</strong>s technologies.<br />
¥¥ ¥¥<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
LLee PPeet ti iit t<br />
BBuul lll<strong>le</strong>et l ti iinn<br />
DD iif ifff<br />
ffuuss éé lll ee 1100 jjuui j ii nn 2200 1100<br />
dd’ ’’i iinn foor f<br />
rmmaat ti iioonn<br />
NN° ° 111166<br />
¥¥ ¥¥<br />
ppaaggee 1177<br />
Les in<strong>format</strong>ions contenues dans ce Bul<strong>le</strong>tin<br />
n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.