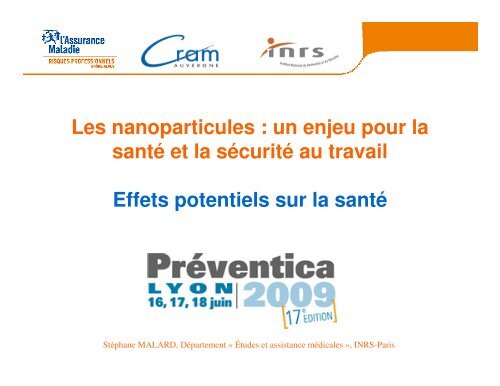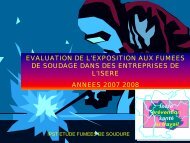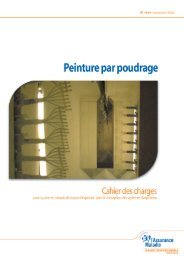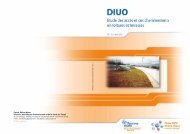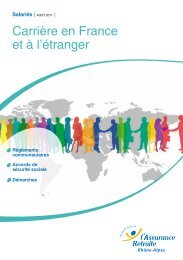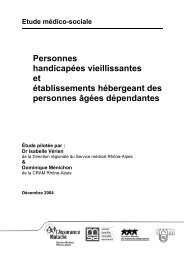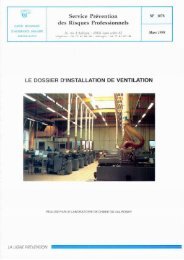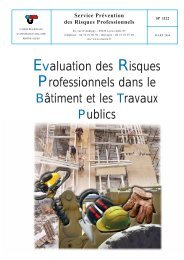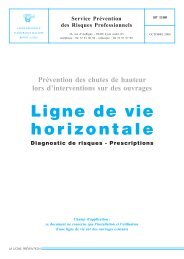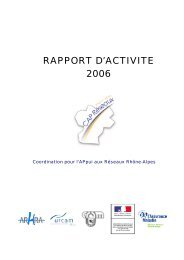Les nanoparticules - Carsat
Les nanoparticules - Carsat
Les nanoparticules - Carsat
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Les</strong> <strong>nanoparticules</strong> : un enjeu pour la<br />
santé et la sécurité au travail<br />
Effets potentiels sur la santé<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Questionnements<br />
Pourquoi s’intéresser aux effets toxiques potentiels des <strong>nanoparticules</strong><br />
manufacturées ?<br />
Passent-elles les barrières biologiques et quel est leur devenir dans<br />
l’organisme ?<br />
Quels sont les déterminants de leur toxicité ?<br />
Quelle est la portée du bilan des connaissances ?<br />
2
Quels sont les résultats des études sur les effets des<br />
particules ultra-fines de l’environnement ?<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
3
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Études épidémiologiques<br />
Données issues des études épidémiologiques sur les effets sur la santé des particules<br />
ultra-fines d’origine environnementale (PM10 ; PM2,5 et PM0,1)<br />
• Augmentation de la morbidité et de la mortalité respiratoire et cardio-vasculaire<br />
• Population étudiée : sujets atteints de maladies respiratoires chroniques (asthme, BPCO) ou<br />
cardiaques (coronariens)<br />
• Effets observés: diminution du DEP, augmentation de la symptomatologie respiratoire et des<br />
médications, sous décalage ST à l’épreuve d’effort, diminution de l’activité physique<br />
4
Données expérimentales chez l’homme<br />
Données en conditions d’exposition contrôlée à des particules ultra-fines chez des sujets<br />
sains, asthmatiques ou BPCO<br />
• Augmentation de la fraction déposée en fonction inverse de la taille de la particule, à l’effort, chez<br />
l’asthmatique et les BPCO<br />
• Dépôt préférentiel au niveau des bronchioles et des alvéoles pulmonaires<br />
• Obstruction réversible des petites voies aériennes chez des sujets sains (carbone)<br />
• Perturbation des paramètres de la coagulation sanguine (concentrats de particules ambiantes,<br />
particules diesel)<br />
• Augmentation dose dépendante des cytokines pro-inflammatoires (fumées d’oxyde de zinc)<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
5
Données expérimentales chez l’animal<br />
Données issues des études expérimentales sur la toxicité de la pollution atmosphérique<br />
particulaire globale (PM 10 et PM 2,5)<br />
• Inflammation pulmonaire<br />
• Effets extra-pulmonaires (variabilité du rythme cardiaque, ischémie cardiaque, diminution de la<br />
résistance pulmonaire aux infections)<br />
Études portant sur la fraction ultra-fine de la pollution particulaire environnementale<br />
• Chez le rongeur, inflammation pulmonaire significative<br />
• Effets immuno-allergiques (effet adjuvant)<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
6
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Études in vitro<br />
<strong>Les</strong> tests in vitro des PM10 et PM2,5 sur différentes lignées cellulaires ont confirmé le<br />
caractère inflammatoire et oxydant des particules ambiantes<br />
• Génération d’espèces réactives de l’oxygène<br />
• Induction de médiateurs pro-inflammatoires (TNF , IL-6…)<br />
• Activation de facteurs de transcription régulant l’expression de gènes impliqués dans la réponse<br />
cellulaire au stress<br />
Études portant sur la fraction ultra-fine de la Pollution particulaire environnementale<br />
• Toxicité in vitro plus grande de la fraction ultra-fine des particules environnementales liée au<br />
contenu en composés organiques oxydo-réducteurs et à la capacité à léser les mitochondries<br />
7
Quelles sont les voies de pénétration et le devenir des<br />
<strong>nanoparticules</strong> dans l’organisme ?<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
8
Extrait de Witschger et Fabries. HST. 2005.<br />
Dépôt dans les voies respiratoires<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Dépôt total le plus faible pour les particules de<br />
300 nm d’après le modèle de la CIPR (1994)<br />
<strong>Les</strong> capacités d’agrégation ou d’agglomération<br />
modifient les paramètres de pénétration et de<br />
déposition<br />
Déposition des <strong>nanoparticules</strong> supérieure aux particules<br />
plus grosses du fait du mouvement brownien<br />
9
Extrait de Oberdörster et coll. EHP. 2005.<br />
Dépôt régional dans les voies respiratoires<br />
en fonction de la taille des particules<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Dépôt important des <strong>nanoparticules</strong><br />
dans le poumon profond<br />
Distribution plus uniforme pour les<br />
<strong>nanoparticules</strong> que pour les particules de taille<br />
micrométrique<br />
<strong>Les</strong> particules > 10 nm se déposent<br />
préférentiellement au niveau alvéolaire<br />
<strong>Les</strong> particules < 10 nm se déposent<br />
préférentiellement au niveau extra-thoracique<br />
10
Extrait de Oberdörster et coll. EHP. 2005.<br />
<strong>Les</strong> mécanismes de clairance pulmonaire<br />
Augmentation de la Bio-persistance<br />
et de la probabilité d’effets<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Fonction du site de déposition<br />
Niveau alvéolaire : macrophages<br />
• mécanisme saturable<br />
• Phagocytose contrariée pour les<br />
particules < 20 nm (endocytose par les<br />
cellules épithéliales puis interstitialisation)<br />
Niveau trachéo-bronchique : ascenseur<br />
mucociliaire<br />
• Moins efficace si tabagisme, BPCO,<br />
asthme, mucoviscidose ou exposition à<br />
des irritants respiratoires<br />
11
Translocation vers le système circulatoire<br />
Extrait de Nemmar et coll. Circ. 2002<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Étude chez l’homme : translocation<br />
rapide de particules de carbone
Translocation cérébrale des particules inhalées<br />
Extrait de Oberdörster et coll. EHP. 2005.<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Via les nerfs olfactif et trijumeau<br />
Nombre de particules / unité de surface<br />
élevée<br />
Plusieurs mécanismes de pénétration<br />
(diffusion passive ou transport actif)<br />
Influencée par la nature de la particule, sa<br />
taille, ses revêtements de surface, sa<br />
solubilité…)<br />
Translocation mise en évidence dans plusieurs espèces<br />
animales après instillation intra-nasale (Mn, Au, C, Ir)<br />
13
Extrait de Oberdörster et coll. EHP. 2005.<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Exposition par voie percutanée<br />
Ryman-Rasmussen et coll. 2006 : QD<br />
6nm - peau de porc<br />
Influence de la taille, les caractéristiques<br />
physico-chimiques, les propriétés de<br />
surface, l’élasticité, l’état de la peau, la<br />
flexion, la sueur…<br />
Limites des études :<br />
• protocoles variés<br />
Pénétration de certaines <strong>nanoparticules</strong><br />
dans certaines conditions<br />
• données +/- extrapolables<br />
14
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Exposition par voie digestive<br />
Concerne les particules déposées au niveau de l’arbre trachéo-bronchique et<br />
secondairement dégluties<br />
Très peu d’études disponibles<br />
Mise en évidence d’un transfert systémique de NTC mono-feuillet chez la souris<br />
Translocation systémique probable mais hypothèse<br />
nécessitant d’être étayée par plus d’études<br />
15
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Quels sont les déterminants<br />
de la toxicité des <strong>nanoparticules</strong> ?<br />
16
Extrait de Oberdörster G. EHP. 2005<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Rôle de la surface spécifique<br />
La réduction de la taille entraîne une<br />
augmentation de la surface spécifique et du<br />
nombre de groupes réactifs, avec<br />
accroissement des effets à dose<br />
équivalente<br />
Réaction inflammatoire plus importante (à<br />
masse et structure équivalentes) pour les<br />
<strong>nanoparticules</strong><br />
Relation dose - réponse inflammatoire<br />
quand la dose est exprimée en fonction de<br />
la surface spécifique<br />
La surface est un meilleur indicateur de dose pour comparer les effets<br />
inflammatoires pulmonaires des particules fines et ultra-fines<br />
17
La taille des particules conditionne :<br />
• le site de déposition pulmonaire<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Rôle de la taille<br />
• l’efficacité de la phagocytose et de la clairance pulmonaire : bio-persistance<br />
• les processus de translocation<br />
• les interactions avec les protéines du milieu biologique : phénomènes de dénaturation<br />
Exemple du dioxyde de titane ultra-fin<br />
• Initialement témoin négatif dans les études expérimentales<br />
• Mise en évidence d’excès de cancers pulmonaires chez le rat<br />
• Réévaluation du CIRC en 2006 : Cat. 3 => Cat. 2B<br />
18
Propriétés de surface : charge,<br />
groupements fonctionnels, recouvrement,<br />
substances adsorbées…<br />
Composition chimique : présence de<br />
métaux de transition (génération d’espèces<br />
réactives de l’oxygène)<br />
Forme : effet fibre (cytotoxicité,<br />
fibrogénèse)<br />
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Autres déterminants<br />
Structure cristalline : plus grande<br />
réactivité de surface<br />
Rôle des agrégats et agglomérats :<br />
influence le dépôt, la dénaturation des<br />
protéines, l’adsorption des phospholipides<br />
Nombre de particules : biodisponibilité<br />
Solubilité…<br />
Nécessité d’une bonne caractérisation pour évaluer la toxicité<br />
19
Stéphane MALARD, Département « Études et assistance médicales », INRS-Paris<br />
Conclusions<br />
Données humaines sur les effets des <strong>nanoparticules</strong> manufacturées inexistantes<br />
Données expérimentales : grande réactivité et effets locaux et systémiques variés<br />
Beaucoup de limites à l’extrapolation des données expérimentales :<br />
• Nombre de particules étudiées par rapport à la diversité des <strong>nanoparticules</strong><br />
• Phénomènes de surcharge pulmonaire chez le rat liés à la dose<br />
• Inconnues concernant les effets des agrégats et des agglomérats<br />
• Caractérisation insuffisante des particules étudiées / paramètres influençant la toxicité<br />
• Hétérogénéité des protocoles expérimentaux<br />
Conséquences en terme de prévention :<br />
• Principe de précaution : mise en place de mesures préventives effectives et proportionnées<br />
• Surveillance médicale et traçabilité<br />
20