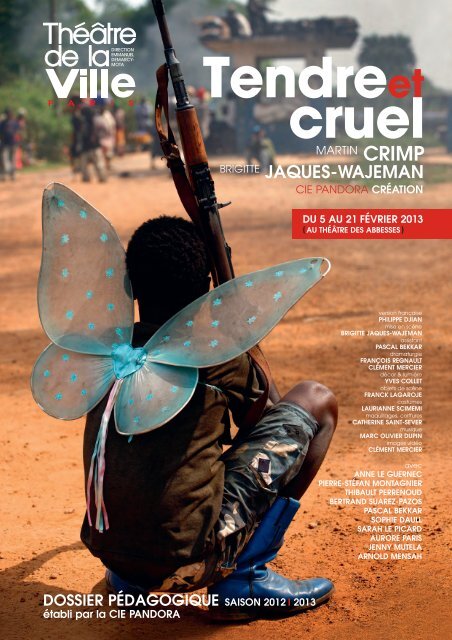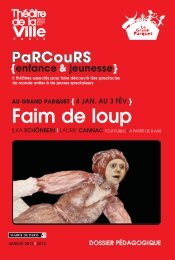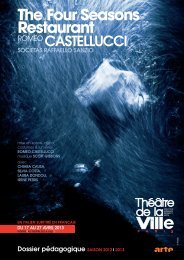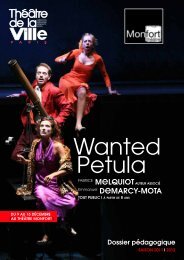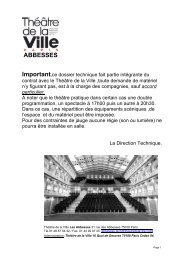Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
T<strong>en</strong>dreet<br />
cruel<br />
MARTIN CRIMP<br />
BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN<br />
CIE PANDORA CRÉATION<br />
DOSSIER PÉDAGOGIQUE SAISON 2012 I 2013<br />
établi par <strong>la</strong> CIE PANDORA<br />
DU 5 AU 21 FÉVRIER 2013<br />
{ AU THÉÂTRE DES ABBESSES }<br />
version française<br />
PHILIPPE DJIAN<br />
mise <strong>en</strong> scène<br />
BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN<br />
assistant<br />
PASCAL BEKKAR<br />
dramaturgie<br />
FRANÇOIS REGNAULT<br />
CLÉMENT MERCIER<br />
décor & lumière<br />
YVES COLLET<br />
objets <strong>de</strong> scène<br />
FRANCK LAGAROJE<br />
costumes<br />
LAURIANNE SCIMEMI<br />
maquil<strong>la</strong>ges, coiffures<br />
CATHERINE SAINT-SEVER<br />
musique<br />
MARC OLIVIER DUPIN<br />
images vidéo<br />
CLÉMENT MERCIER<br />
avec<br />
ANNE LE GUERNEC<br />
PIERRE-STÉFAN MONTAGNIER<br />
THIBAULT PERRENOUD<br />
BERTRAND SUAREZ-PAZOS<br />
PASCAL BEKKAR<br />
SOPHIE DAULL<br />
SARAH LE PICARD<br />
AURORE PARIS<br />
JENNY MUTELA<br />
ARNOLD MENSAH
© X. DR<br />
MARTIN CRIMP I BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN<br />
CIE PANDORA<br />
T<strong>en</strong>dre et cruel CRÉATION<br />
2<br />
VERSION FRANÇAISE Philippe Djian (ÉDITIONS DE L’ARCHE)<br />
MISE EN SCÈNE Brigitte Jaques-Wajeman<br />
ASSISTANT Pascal Bekkar<br />
DRAMATURGIE François Regnault, Clém<strong>en</strong>t Mercier<br />
DÉCOR & LUMIÈRE Yves Collet<br />
COLLABORATION LUMIÈRE Nico<strong>la</strong>s Faucheux<br />
OBJETS DE SCÈNES Franck Lagaroje<br />
COSTUMES Laurianne Scimemi<br />
MAQUILLAGES, COIFFURES Catherine Saint-Sever<br />
MUSIQUE ORIGINALE Marc Olivier Dupin<br />
ÉDITEUR Frédéric Leibovitz I Cézame Music Ag<strong>en</strong>cy<br />
SAXOPHONE TÉNOR Davy Basquin I PIANO Maréva Bécu I<br />
PERCUSSIONS Hervé Trovel<br />
IMAGES VIDÉO Clém<strong>en</strong>t Mercier<br />
SON Stéphanie Gibert<br />
AVEC<br />
Anne Le Guernec AMELIA<br />
Pierre-Stéfan Montagnier LE GÉNÉRAL, SON MARI<br />
Thibault Perr<strong>en</strong>oud JAMES, LEUR FILS<br />
Bertrand Suarez-Pazos RICHARD, JOURNALISTE<br />
Pascal Bekkar JONATHAN, MINISTRE<br />
Sophie Daull LA GOUVERNANTE, RACHEL<br />
Sarah Le Picard LA PHYSIOTHÉRAPEUTE, CATHY<br />
Aurore Paris L’ESTHÉTICIENNE, NICOLE<br />
J<strong>en</strong>ny Mute<strong>la</strong> LAELA, 18 ANS, JEUNE AFRICAINE<br />
Arnold M<strong>en</strong>sah EDU, SON FRÈRE<br />
Arnold M<strong>en</strong>sah IOLAOS, UN AMI DU GÉNÉRAL<br />
COPRODUCTION <strong>Théâtre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Ville</strong>-Paris – L’On<strong>de</strong>, Vélizy –<br />
Comédie <strong>de</strong> l’Est, Colmar – Compagnie Pandora<br />
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE <strong>la</strong> DRAC Île-<strong>de</strong>-France.<br />
ADMINISTRATION CIE PANDORA Dorothée Cabrol<br />
créé à L’ONDE – <strong>Théâtre</strong> et C<strong>en</strong>tre d’art <strong>de</strong> Vélizy-<br />
Vil<strong>la</strong>coub<strong>la</strong>y le 31 janvier 2013.<br />
SOMMAIRE<br />
photos répétitions<br />
Joanna Levas<br />
La Tragédie portée au prés<strong>en</strong>t I B. Jaques-Wajeman …….. p. 4<br />
Prés<strong>en</strong>tation I Clém<strong>en</strong>t Mercier ……………………………. p. 5<br />
Sophocle à l’aéroport I Martin Crimp …………………………… p. 6<br />
Sophocle I Clém<strong>en</strong>t Mercier ………………………….……. p. 7<br />
La lég<strong>en</strong><strong>de</strong> I Paul Mazon ……………………………………………… p. 8<br />
Les Trachini<strong>en</strong>nes I François Regnault ……………………………. p. 9<br />
Une tragédie contemporaine ? I Clém<strong>en</strong>t Mercier ……...… p.12<br />
Vieilles outres & vin nouveau ………………………………….... p.13<br />
T<strong>en</strong>dre et cruel… une adaptaion <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes ... p.14<br />
Ouverture I Prologue<br />
La Machine I premier cœur<br />
L’Héritage<br />
Le Messager I le Jounaliste<br />
Le Ministre<br />
Lae<strong>la</strong><br />
Le C<strong>en</strong>taure I Le militant gauchiste<br />
Le Philtre d’amour<br />
Une nouvelle histoire <strong>de</strong> chœur<br />
Une robe bi<strong>en</strong> mou<strong>la</strong>nte<br />
Un mois plus tard…<br />
Martin Crimp ……………………………………………...………………. p.21<br />
Brigitte Jaques-Wajeman ……………….………………………….. p.22<br />
les comédi<strong>en</strong>s ……………….…………………………………………... p.23<br />
R<strong>en</strong>contre I Tournée ……………………………………....…………... p.25<br />
3
LA TRAGÉDIE PORTÉE AU PRÉSENT<br />
Les dramaturges grecs fur<strong>en</strong>t les maîtres <strong>de</strong>s fables. Un fabuleux trésor<br />
qu’auteurs contemporains, metteurs <strong>en</strong> scène et acteurs continu<strong>en</strong>t d’explorer.<br />
D’une pièce <strong>de</strong> Sophocle réécrite par Martin Crimp, Brigitte Jaques-Wajeman tire<br />
<strong>de</strong>s fils où politique et intimité se nou<strong>en</strong>t et s’oppos<strong>en</strong>t.<br />
Avec T<strong>en</strong>dre et cruel, Martin Crimp réécrit avec une<br />
extrême fidélité une très belle tragédie <strong>de</strong> Sophocle, Les<br />
Trachini<strong>en</strong>nes, et <strong>la</strong> porte <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t au prés<strong>en</strong>t. Il<br />
retrouve <strong>la</strong> longue tradition <strong>de</strong>s auteurs qui s’empar<strong>en</strong>t<br />
au fil <strong>de</strong>s siècles <strong>de</strong> thèmes et <strong>de</strong> mythes antiques et les<br />
trait<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus proche actualité ! Les<br />
dramaturges grecs sont les maîtres <strong>de</strong>s fables. Ils nous<br />
offr<strong>en</strong>t un fabuleux trésor d’histoires où politique et<br />
intimité se nou<strong>en</strong>t et s’oppos<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> façon <strong>la</strong> plus mystérieuse.<br />
Nous n’avons pas fini <strong>de</strong> les explorer. Crimp le<br />
fait d’une façon magistrale.<br />
La guerre et l’amour sont au cœur <strong>de</strong> cette pièce éminemm<strong>en</strong>t<br />
politique : <strong>la</strong> guerre <strong>en</strong>tre les sexes et les nouvelles<br />
formes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre contemporaine aux masques<br />
multiples. Tout le génie <strong>de</strong> cette adaptation ti<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> ma -<br />
nière dont le militaire et le civil, le bourreau et <strong>la</strong> victime,<br />
l’amour et <strong>la</strong> mort vont se confondre ici si bi<strong>en</strong> qu’aucune<br />
zone n’est finalem<strong>en</strong>t t<strong>en</strong>ue à l’écart <strong>de</strong> l’horreur.<br />
L’éc<strong>la</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s frontières <strong>de</strong> <strong>la</strong> brutalité est <strong>en</strong> effet ce<br />
qui affleure dans T<strong>en</strong>dre et cruel, bi<strong>en</strong> qu’aucun acte <strong>de</strong><br />
viol<strong>en</strong>ce n’y soit commis.<br />
La tragédie <strong>de</strong> Sophocle met <strong>en</strong> scène l’histoire douloureuse<br />
<strong>de</strong> Déjanire, exilée à Trachis avec ses <strong>en</strong>fants, dont<br />
son fils ainé Hyllos. Épouse dé<strong>la</strong>issée d’Héraclès, Déjanire<br />
se p<strong>la</strong>int au chœur <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes : On l’oblige à ac -<br />
cueillir dans son pa<strong>la</strong>is une jeune femme qu’elle pr<strong>en</strong>d<br />
<strong>en</strong> pitié d’abord, mais dont elle appr<strong>en</strong>d qu’elle est <strong>la</strong><br />
nouvelle épouse du héros. Pour <strong>la</strong> conquérir, Héraclès a<br />
tué ses par<strong>en</strong>ts et massacré une ville <strong>en</strong>tière. Déjanire<br />
<strong>en</strong>voie alors à son mari une tunique trempée dans le sang<br />
du c<strong>en</strong>taure Nessos. Elle espère retrouver son amour<br />
grâce à ce qu’elle croit être un philtre d’amour. Mais le<br />
philtre s’avère fatal. Héraclès se meurt. La tunique dé -<br />
verse du poison dans ses <strong>en</strong>trailles. Déjanire se tue et le<br />
<strong>de</strong>rnier acte nous montre Héraclès, hur<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> douleur.<br />
Martin Crimp suit <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie et trouve<br />
une équival<strong>en</strong>ce contemporaine à chacun <strong>de</strong> ses person -<br />
nages : il se saisit du redoutable guerrier antique, pour<br />
<strong>en</strong> faire, dans T<strong>en</strong>dre et cruel, Le Général, au service d’une<br />
puissance occid<strong>en</strong>tale, poursuivi pour crimes contre<br />
l’humanité. Bourreau san guinaire et victime sacrificielle,<br />
il arrive sur <strong>la</strong> scène à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce dans un<br />
état pi toy able.<br />
4<br />
Déjanire <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t Amelia, l’épouse du Général ; autrefois<br />
belle et désirée, elle est aujourd’hui une femme seule,<br />
vieillissante. Réfugiée dans un appartem<strong>en</strong>t, près d’un<br />
aéroport – saisissante transposition <strong>de</strong> l’exil <strong>de</strong> Sophocle<br />
– mis à disposition par le gouvernem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>puis que son<br />
mari est accusé <strong>de</strong> crimes <strong>de</strong> guerre, elle ne sait ri<strong>en</strong> ou ne<br />
veut ri<strong>en</strong> savoir <strong>de</strong>s activités brutales du Général. Elle<br />
l’aime. Elle se p<strong>la</strong>int à un chœur <strong>de</strong> jeunes femmes<br />
formé d’une gouvernante, d’une physiothérapeute et d’une<br />
esthétici<strong>en</strong>ne. Bi<strong>en</strong>veil<strong>la</strong>ntes, mais peu concernées.<br />
La mise <strong>en</strong> scène s’ordonnera autour <strong>de</strong> cette femme bles -<br />
sée, <strong>de</strong> ce qu’elle vit, <strong>de</strong> son abandon, <strong>de</strong> son angoisse,<br />
dans une suite d’hôtel sans âme, aménagée pour un<br />
séjour indéfini. Elle se croit à l’abri, mais <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>ce du<br />
mon<strong>de</strong> <strong>la</strong> rejoint, inexorable, et <strong>la</strong> pousse au meurtre et<br />
au suici<strong>de</strong>. Son mari est le soldat qu’on <strong>en</strong>voie sur une<br />
opération après l’autre, nous dit-elle avec une étrange<br />
lucidité, « dans le but – le but déc<strong>la</strong>ré – d’éradiquer le terrorisme<br />
: sans compr<strong>en</strong>dre que plus il combat le terrorisme<br />
plus il <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre le terrorisme – et même invite le terrorisme<br />
– qui n’a pas <strong>de</strong> paupières – dans son propre lit. »<br />
Le lit d’Amelia sera le théâtre dans lequel va se jouer <strong>la</strong><br />
tragédie <strong>de</strong> Martin Crimp.<br />
Brigitte Jaques-Wajeman<br />
* Je remercie Alice Z<strong>en</strong>iter et Arielle Meyer, très admiratives<br />
<strong>de</strong> Martin Crimp, qui m’ont inspiré quelques-unes <strong>de</strong> leurs belles<br />
analyses.<br />
PRÉSENTATION<br />
Écrite par Sophocle autour <strong>de</strong> 445 av. JC, Les Tra chi -<br />
ni<strong>en</strong>nes raconte <strong>la</strong> mort d’Héraclès, tué involontairem<strong>en</strong>t<br />
par sa femme Déjanire. Celle-ci vou<strong>la</strong>nt récupérer l’amour<br />
<strong>de</strong> son mari, dont l’infidélité va jusqu’à abriter chez lui<br />
sa femme et son amante. Elle lui offre un philtre d’amour<br />
qui s’avère être un terrible poison. Ca<strong>de</strong>au empoisonné<br />
d’un c<strong>en</strong>taure v<strong>en</strong>geur qui fut au trefois tué par<br />
Héraclès.<br />
T<strong>en</strong>dre et Cruel est une adaptation contemporaine <strong>de</strong><br />
cette histoire. Déjanire s’appelle maint<strong>en</strong>ant Amelia, le<br />
héros mythique Héraclès est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u un sanguinaire<br />
général d’armée et le philtre du c<strong>en</strong>taure est maint<strong>en</strong>ant<br />
une molécule chimique. À quelques exceptions près, l’auteur<br />
britannique respecte <strong>la</strong> trame narrative et <strong>la</strong> structure<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce d’origine. Il y ajoute, comme Racine à<br />
son époque, les r<strong>en</strong>contres <strong>en</strong>tre personnages que <strong>la</strong><br />
dramaturgie grecque omettait : ainsi Amelia parlera à<br />
l’amante <strong>de</strong> son mari comme Phèdre a pu r<strong>en</strong>contrer<br />
Hippolyte dans l’adaptation racini<strong>en</strong>ne.<br />
Si T<strong>en</strong>dre et Cruel est un brûlot contre le colonialisme<br />
américain et ses missions d’ingér<strong>en</strong>ces, il dénonce aussi<br />
les guerres civiles africaines et le mon<strong>de</strong> politique corrompu.<br />
Martin Crimp a p<strong>en</strong>sé le lieu unique <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragé-<br />
5<br />
die pour <strong>en</strong> faire une pièce d’intérieur aux allures très<br />
britanniques. Mais <strong>la</strong> puissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce ne s’arrête<br />
pas au g<strong>en</strong>re, ni à ces adaptations plus ou moins réussies.<br />
La véritable inv<strong>en</strong>tion que T<strong>en</strong>dre et Cruel déploie<br />
est le personnage d’Amelia, bi<strong>en</strong> plus complexe que celui<br />
<strong>de</strong> Déjanire. Femme terriblem<strong>en</strong>t seule, elle nous est<br />
montrée comme une princesse naïve d’un autre temps<br />
mais cond<strong>en</strong>se <strong>en</strong> elle-même toutes les problématiques<br />
complexes du féminisme comme celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> solitu<strong>de</strong> et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>ce humaine.<br />
Si T<strong>en</strong>dre et Cruel est une tragédie contemporaine, c’est<br />
bi<strong>en</strong> par <strong>la</strong> grâce <strong>de</strong> ce personnage qui, <strong>en</strong> l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong><br />
toute dim<strong>en</strong>sion divine, dévoile une véritable id<strong>en</strong>tité<br />
tragique. Crimp démontre que le pas qui existe <strong>en</strong>tre <strong>la</strong><br />
tragédie et le drame est analogue à celui qui transforme<br />
<strong>la</strong> métaphysique <strong>en</strong> psychologie. Son actualisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
tragédie fait peut-être passer T<strong>en</strong>dre et Cruel du côté du<br />
drame psychologique, mais Amelia transc<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t<br />
les limitations du g<strong>en</strong>re et donne à cette pièce sa véritable<br />
vocation tragique, qui r<strong>en</strong>voie à l’idée d’un ma<strong>la</strong>ise<br />
universel et intemporel.<br />
Clém<strong>en</strong>t Mercier
©X.DR<br />
SOPHOCLE À L'AÉROPORT SOPHOCLE<br />
Héraclès – ou Hercule – fut l’archétype du héros <strong>de</strong> guerre,<br />
et le premier <strong>de</strong>structeur <strong>de</strong> terreur. Qu’est ce que l’Hydre<br />
– ce serp<strong>en</strong>t à plusieurs têtes qui, pour chaque tête qu’Hé -<br />
raclès tranchait, <strong>en</strong> avait <strong>de</strong>ux qui repoussai<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
– si ce n’est une préfiguration étrange du terrorisme ?<br />
[…] Dans Les Trachini<strong>en</strong>nes <strong>de</strong> Sophocle, le héros <strong>de</strong><br />
guerre, incapable <strong>de</strong> s’arrêter <strong>de</strong> tuer, rase une ville <strong>en</strong> tière<br />
pour s’emparer <strong>de</strong> <strong>la</strong> fille, qui l’obsè<strong>de</strong>, puis l’<strong>en</strong>voie chez<br />
lui auprès <strong>de</strong> sa propre épouse, dont l’effort pour regagner<br />
son amour a pour seule issue <strong>la</strong> mort viol<strong>en</strong>te <strong>de</strong>s<br />
protagonistes. C’est là <strong>la</strong> pièce que j’ai réécrite sous le<br />
titre <strong>de</strong> T<strong>en</strong>dre et cruel.<br />
[…] Deux mille cinq c<strong>en</strong>ts ans avant l’inv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
psychologie, Sophocle eut l’idée <strong>de</strong> génie d’écrire une<br />
pièce dans <strong>la</strong>quelle ce fossé <strong>en</strong>tre les sexes est explicite :<br />
non seulem<strong>en</strong>t les hommes et les femmes viv<strong>en</strong>t dans<br />
<strong>de</strong>s mon<strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts, mais le mari et <strong>la</strong> femme, dans<br />
ce drame particulier, ne se r<strong>en</strong>contr<strong>en</strong>t même pas. Il ne<br />
nous montre l’homme que dans les toutes <strong>de</strong>rnières<br />
<strong>page</strong>s du texte, brisé et <strong>en</strong> colère (le <strong>de</strong>stin <strong>de</strong> tant <strong>de</strong><br />
soldats traumatisés) pourrissant comme le cafard <strong>de</strong><br />
Kafka abandonné <strong>de</strong> tous, alors qu’il consacre <strong>la</strong> plus<br />
gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce (et <strong>en</strong> ce<strong>la</strong> il semble tellem<strong>en</strong>t<br />
mo<strong>de</strong>rne) à une femme qui se bat pour composer avec<br />
l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’homme, sa viol<strong>en</strong>ce et son infidélité.<br />
6<br />
Le portrait d’Amelia, comme je l’ai rebaptisé, est extraordinaire.<br />
[…] Un acte <strong>de</strong> viol<strong>en</strong>ce aveugle <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong><br />
son mari – ce qu’aujourd’hui on appellerait un crime <strong>de</strong><br />
guerre – et voilà qu’elle a été <strong>en</strong>voyée <strong>en</strong> « exil », c’està-dire<br />
forcée à établir sa maison temporairem<strong>en</strong>t dans<br />
une autre cité-État ou polis. Son fils <strong>la</strong> traite avec un<br />
mépris adolesc<strong>en</strong>t. Les « messagers » qui install<strong>en</strong>t dans<br />
sa maison <strong>la</strong> petite amie d’Héraclès lui m<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t par<br />
g<strong>en</strong>tillesse, ou lui dis<strong>en</strong>t <strong>la</strong> vérité par méchanceté. Mais<br />
à mesure que tomb<strong>en</strong>t les unes après les autres ses illusions<br />
sur son mari, loin <strong>de</strong> s’effondrer, elle fait face à <strong>la</strong><br />
nouvelle situation et s’ingénie à trouver <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong><br />
regagner son amour. On a un s<strong>en</strong>s aigu <strong>de</strong> son <strong>en</strong>fermem<strong>en</strong>t<br />
domestique, <strong>de</strong> son extrême difficulté à agir sur le<br />
mon<strong>de</strong> extérieur, lorsque ce mon<strong>de</strong>, et même ce qu’on<br />
parvi<strong>en</strong>t à <strong>en</strong> savoir, est contrôlé par les hommes. Amelia<br />
résiste au contrôle, refuse l’étiquette <strong>de</strong> « victime ».<br />
[…] Donc dans T<strong>en</strong>dre et Cruel, l’« exil » <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t le nonlieu<br />
c<strong>la</strong>ssique du mon<strong>de</strong> développé : le no-man’s <strong>la</strong>nd<br />
<strong>de</strong>s abris où l’on prépare <strong>la</strong> nourriture, <strong>de</strong>s parkings<br />
longue durée et <strong>de</strong>s chaînes d’hôtel qui fleuriss<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
grappe autour d’un aéroport international perpétuellem<strong>en</strong>t<br />
éc<strong>la</strong>iré. Près <strong>de</strong> l’aéroport, on est près <strong>de</strong>s sites sacrés<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> v<strong>en</strong>te au détail, aussi bi<strong>en</strong> que <strong>de</strong>s détecteurs à<br />
rayons X qui nous permett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> lire dans les <strong>en</strong>trailles<br />
<strong>de</strong> nos bagages <strong>de</strong>s signes <strong>de</strong> bon ou mauvais augure.<br />
Le « chœur » <strong>de</strong> femmes peut dégivrer le frigo d’Amelia<br />
ou passer l’aspirateur sur <strong>la</strong> moquette pleine <strong>de</strong> miettes<br />
– mais égalem<strong>en</strong>t étant donné que les chœurs originaux<br />
chantai<strong>en</strong>t et dansai<strong>en</strong>t, s’incarner dans <strong>la</strong> voix délici eu -<br />
sem<strong>en</strong>t dépourvue d’inflexion <strong>de</strong> Billie Holiday chantant:<br />
I can’t give you anything but love.<br />
Martin Crimp<br />
Sophocle est né <strong>en</strong> 496 av. J.C., il est mort <strong>en</strong> 406. Une<br />
vie <strong>de</strong> quatre-vingt-dix ans, contemporaine du V e siècle,<br />
le siècle <strong>de</strong> l’histoire glorieuse d’Athènes. Il passe pour<br />
avoir eu une vie heureuse, à <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> ses héros.<br />
Il avait sans doute écrit une c<strong>en</strong>taine <strong>de</strong> pièces (123 !),<br />
il n’<strong>en</strong> reste que sept. Il fut couronné 18 fois aux Gran<strong>de</strong>s<br />
Dionysies d’Athènes, soit 72 pièces couronnées, quelques<br />
autres ailleurs (aux Léné<strong>en</strong>nes). Il fut donc couronné à<br />
peu près <strong>de</strong>ux fois sur trois. (Eschyle seulem<strong>en</strong>t 13 fois,<br />
Euripi<strong>de</strong> 5 fois).<br />
Enfance aisée, beau, physiquem<strong>en</strong>t doué, il dansait et<br />
jouait <strong>de</strong> <strong>la</strong> cithare <strong>en</strong> public. Son fils légitime Iophon, fut<br />
égalem<strong>en</strong>t un poète tragique, ainsi qu’un petit-fils illégitime,<br />
Sophocle le Jeune. Ami d’Hérodote et <strong>de</strong> Périclès,<br />
il participe à <strong>la</strong> vie politique d’Athènes (élu stratège <strong>en</strong> 441,<br />
et élu commissaire du peuple après le désastre <strong>de</strong> Sicile,<br />
à 83 ans).<br />
Il appartint à une confrérie religieuse, dont le héros fut<br />
Asclépios (l’Escu<strong>la</strong>pe <strong>de</strong>s Latins), et il accueillit <strong>la</strong> statue<br />
du dieu à Epidaure : il fut surnommé à ce propos<br />
« l’Accueil<strong>la</strong>nt ».<br />
Il voulut <strong>de</strong>meurer « un homme <strong>de</strong> <strong>la</strong> rue ». Sa carrière<br />
est difficile à suivre, comme il est difficile <strong>de</strong> dater ses<br />
pièces. Celles qui rest<strong>en</strong>t dat<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière partie <strong>de</strong><br />
sa carrière (on n’a ri<strong>en</strong> <strong>de</strong> lui <strong>en</strong>tre ses 25 et ses 55 ans !)<br />
On suppose que Les Trachini<strong>en</strong>nes est <strong>la</strong> première <strong>de</strong><br />
celles qui rest<strong>en</strong>t, suivie par Antigone (442), puis, sans<br />
doute dans l’ordre : Ajax, Œdipe Roi, Electre, Philoctète<br />
(409), Œdipe à Colone (<strong>en</strong> 401, après sa mort).<br />
Une s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce qui revi<strong>en</strong>t chez lui est celle qu’il met<br />
dans <strong>la</strong> bouche <strong>de</strong> Déjanire au début <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes :<br />
« C’est une vérité admise <strong>de</strong>puis bi<strong>en</strong> longtemps chez les<br />
hom mes qu’on ne peut savoir, pour aucun mortel, avant<br />
qu’il soit mort, si <strong>la</strong> vie lui fit ou douce ou cruelle. » (<strong>en</strong><br />
grec : ei chrèstos ei kakos : « Ou bon, heureux, ou mauvais,<br />
malheureux »).<br />
C’est sans doute <strong>de</strong> cette s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce que Martin Crimp a<br />
tiré le titre <strong>de</strong> sa pièce, T<strong>en</strong>dre and cruel. (D’après Paul<br />
Mazon dans sa traduction <strong>de</strong> Sophocle, Les Belles Lettres,<br />
1950) Aristote déc<strong>la</strong>re dans sa Poétique, au chapitre 4 :<br />
« Le premier, Eschyle porta à <strong>de</strong>ux le nombre <strong>de</strong>s acteurs ;<br />
il diminua <strong>la</strong> partie du chœur et donna le premier rôle au<br />
dialogue. Sophocle utilisa trois acteurs et introduisit les<br />
décors peints. »<br />
François Regnault<br />
7<br />
© mou<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> satue <strong>de</strong> Sophocle du museé du Latran
© www.histoire-fr.com, Hercule, Déjanire et le c<strong>en</strong>taure Nessus, 1699,<br />
château <strong>de</strong> Versailles, Versailles.<br />
LA LÉGENDE<br />
Deux lég<strong>en</strong><strong>de</strong>s, l’une étoli<strong>en</strong>ne, l’autre thessali<strong>en</strong>ne, fondues<br />
<strong>de</strong> bonne heure <strong>en</strong>semble dans <strong>la</strong> geste d’Héraclès,<br />
ont fourni à Sophocle le sujet <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes.<br />
La version <strong>la</strong> plus courante <strong>de</strong> l’histoire à son époque<br />
semble avoir été celle-ci : Déjanire, fille d’Œnée, roi <strong>de</strong><br />
Pleuron, est, à son grand effroi, l’objet <strong>de</strong>s sollicitations<br />
d’Achélôos, le grand fleuve d’Étolie. Heureusem<strong>en</strong>t<br />
Héraclès, qui vi<strong>en</strong>t d’achever ses travaux, se prés<strong>en</strong>te<br />
aussi un jour comme prét<strong>en</strong>dant à sa main et dans un dur<br />
combat triomphe <strong>de</strong> son rival. Mais, alors qu’il emmène<br />
<strong>la</strong> nouvelle épousée chez lui, il se trouve arrêté par le<br />
cours torr<strong>en</strong>tueux <strong>de</strong> l’Événos.<br />
Le C<strong>en</strong>taure Nessos, qui fait là fonction <strong>de</strong> passeur, s’offre<br />
à charger Déjanire sur sa croupe. Il <strong>la</strong> transporte donc<br />
sur <strong>la</strong> rive adverse, mais c’est pour t<strong>en</strong>ter aussitôt <strong>de</strong> lui<br />
faire viol<strong>en</strong>ce. La jeune femme pousse un cri <strong>de</strong> détresse.<br />
Héraclès, resté sur l’autre bord, saisit son arc et d’une<br />
flèche abat le monstre. Nessos mourant déc<strong>la</strong>re alors à<br />
Déjanire qu’il lui indiquera un philtre capable <strong>de</strong> lui<br />
conserver à jamais l’affection <strong>de</strong> son mari.<br />
Qu’elle recueille seulem<strong>en</strong>t le sperme qu’il vi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong>isser<br />
échapper et qu’après l’avoir mé<strong>la</strong>ngé à <strong>de</strong> l’huile et<br />
au sang qui dégoutte <strong>en</strong>core <strong>de</strong> <strong>la</strong> flèche meurtrière elle<br />
8<br />
<strong>en</strong> frotte <strong>la</strong> tunique d’Héraclès. Déjanire écoute <strong>la</strong> leçon.<br />
Elle ramasse et rapporte chez elle le sperme et le sang<br />
du C<strong>en</strong>taure.<br />
Plus tard, alors qu’Héraclès à <strong>la</strong> suite d’un meurtre a dû<br />
s’exiler <strong>de</strong> Tyrinthe, transp<strong>la</strong>nter tous les si<strong>en</strong>s <strong>en</strong> pays<br />
maliaque, à Trachis chez son cousin Céyx, et subir luimême<br />
un an <strong>de</strong> servage chez Omphale <strong>en</strong> Lydie, il<br />
s’épr<strong>en</strong>d, <strong>en</strong> traversant l’Eubée, d’Iole, fille d’Eurytos, le<br />
roi d’Œchalie, et pour <strong>la</strong> conquérir il détruit sa cité,<br />
massacre sa famille et l’<strong>en</strong>voie elle-même à Trachis avec<br />
son butin. Déjanire s<strong>en</strong>t alors son foyer m<strong>en</strong>acé et elle<br />
use aussitôt du philtre <strong>de</strong> Nessos. Elle <strong>en</strong> <strong>en</strong>duit une<br />
tunique neuve qu’elle expédie à Héraclès <strong>en</strong> Eubée, où<br />
il s’occupe justem<strong>en</strong>t à célébrer son triomphe par un<br />
sacrifice à Zeus. À peine Héraclès l’a-t-il revêtue, que le<br />
poison se met à dévorer ses chairs au milieu <strong>de</strong> telles<br />
souffrances qu’il ne souhaite plus qu’une prompte mort.<br />
Il supplie les si<strong>en</strong>s <strong>de</strong> le porter au sommet <strong>de</strong> l’Œta et<br />
<strong>de</strong> l’y brûler vif. Mais il est fils <strong>de</strong> Zeus, et ce suici<strong>de</strong> se<br />
transforme <strong>en</strong> apothéose : dans <strong>la</strong> vapeur du bûcher,<br />
Héraclès monte jusqu’aux dieux.<br />
Paul Mazon, Notice <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes, édition <strong>de</strong>s « Belles-Lettres »<br />
LES TRACHINIENNES<br />
Déjanire, le femme d’Héraclès (l’Hercule <strong>de</strong>s Latins), seule<br />
dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Trachis (<strong>en</strong> Thessalie, près du Mont<br />
Œta), se rappelle comm<strong>en</strong>t, promise <strong>en</strong> mariage à un<br />
mons tre (un fleuve), elle a vu arriver Héraclès, fils <strong>de</strong> Zeus<br />
et d’Alcmène (<strong>la</strong> femme d’Amphitryon, visitée une nuit<br />
par Zeus sous les traits <strong>de</strong> son époux), et comm<strong>en</strong>t, vainqueur<br />
<strong>de</strong> son rival, il l’a conquise. Malheureusem<strong>en</strong>t, il<br />
est reparti très vite accomplir ses travaux.<br />
Prés<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t, elle ne sait où il est, et elle craint le pire.<br />
Elle sait seulem<strong>en</strong>t que le temps est arrivé où l’oracle a<br />
déc<strong>la</strong>ré ou bi<strong>en</strong> qu’il trouverait <strong>la</strong> mort, ou qu’il passerait<br />
tranquillem<strong>en</strong>t le reste <strong>de</strong> ses jours. Elle confie son<br />
angoisse à son fils Hyllos, qui déci<strong>de</strong> d’aller à <strong>la</strong> re -<br />
cherche <strong>de</strong> son père.<br />
Entrée du Chœur, formé <strong>de</strong> jeunes filles <strong>de</strong> Trachis (les<br />
Trachini<strong>en</strong>nes), qui compatit à ses douleurs.<br />
Déjanire s’inquiète d’autant plus qu’elle a découvert le<br />
testam<strong>en</strong>t d’Héraclès, lui appr<strong>en</strong>ant le dé<strong>la</strong>i d’un an et<br />
trois mois au terme duquel l’oracle (celui <strong>de</strong>s chênes <strong>de</strong><br />
Dodone) s’accomplirait. Ce jour est arrivé. Mais un Mes -<br />
sager vi<strong>en</strong>t annoncer le retour d’Héraclès. Il ti<strong>en</strong>t <strong>la</strong> nou -<br />
velle du héraut Lichas. Joie <strong>de</strong> Déjanire. Le Chœur exulte.<br />
Lichas, accompagné <strong>de</strong> captives, vi<strong>en</strong>t alors donner <strong>de</strong>s<br />
nouvelles d’Héraclès: son honteux séjour comme esc<strong>la</strong>ve<br />
aux pieds <strong>de</strong> <strong>la</strong> reine Omphale, son départ pour <strong>la</strong> ville<br />
d’Eurytos, qu’il accuse du sort subi, le meurtre brutal<br />
d’Iphitos, fils d’Eurytos, v<strong>en</strong>u le voir à Tirynthe, et précipité<br />
par lui dans le vi<strong>de</strong>, <strong>la</strong> ville réduite <strong>en</strong> esc<strong>la</strong>vage,<br />
ses femmes, que voici, <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ues captives, et, parmi elle,<br />
cette jeune Iole, sur qui Déjanire s’apitoie. Lichas sort<br />
avec elles.<br />
Le Messager revi<strong>en</strong>t alors et révèle à Déjanire le m<strong>en</strong>songe<br />
<strong>de</strong> Lichas : <strong>en</strong> vérité, Héraclès n’a conquis <strong>la</strong> ville<br />
que pour ravir <strong>la</strong> fille d’Iphitos, qui n’est autre que Iole.<br />
Désarroi <strong>de</strong> Déjanire, qui force <strong>en</strong>suite Lichas à avouer<br />
ce qu’il avait caché. Elle convi<strong>en</strong>t qu’Amour comman<strong>de</strong><br />
aux dieux mêmes, et se souvi<strong>en</strong>t qu’après tout, Héraclès<br />
a connu bi<strong>en</strong> d’autres femmes. Elle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> seulem<strong>en</strong>t<br />
qu’on cesse <strong>de</strong> lui m<strong>en</strong>tir. Lichas reconnaît les faits. Le<br />
Chœur atteste <strong>la</strong> puissance terrible <strong>de</strong> l’Amour.<br />
9<br />
Déjanire revi<strong>en</strong>t alors : « Nous voici donc <strong>de</strong>ux désormais<br />
sous <strong>la</strong> même couverture, dit-elle, à att<strong>en</strong>dre qu’un homme<br />
nous pr<strong>en</strong>ne dans ses bras ». Elle porte un prés<strong>en</strong>t que<br />
Nessos lui avait confié, caché dans un coffret <strong>de</strong> bronze ;<br />
elle avait, jeune épousée traversé un fleuve sur le dos du<br />
C<strong>en</strong>taure, qui avait au milieu du fleuve, voulu <strong>la</strong> violer.<br />
Héraclès, resté sur <strong>la</strong> rive, avait tué le C<strong>en</strong>taure d’une<br />
flèche. Le C<strong>en</strong>taure <strong>en</strong> mourant lui avait recommandé<br />
<strong>de</strong> recueillir le sang <strong>de</strong> sa blessure, <strong>en</strong> un <strong>en</strong>droit <strong>de</strong> son<br />
corps jadis teint <strong>en</strong> noir par l’Hydre <strong>de</strong> Lerne (le monstre<br />
à plusieurs têtes), et d’<strong>en</strong> <strong>en</strong>duire une tunique <strong>de</strong>stinée<br />
à Héraclès, si elle vou<strong>la</strong>it récupérer un jour l’amour <strong>de</strong><br />
son mari [Sophocle a éliminé le sperme du C<strong>en</strong>taure, attesté<br />
dans <strong>la</strong> lég<strong>en</strong><strong>de</strong>]. Le Coryphée l’<strong>en</strong>courage dans cette voie.<br />
Elle confie donc le coffret à Lichas, et lui recomman<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> retour proche d’Héraclès et s’<strong>en</strong> réjouit.<br />
Héracles tuant le c<strong>en</strong>taure_Loggia <strong>de</strong>i Lanzi Flor<strong>en</strong>ce, Italie
Mais Déjanire revi<strong>en</strong>t, craignant d’être allée trop loin: un flocon <strong>de</strong> <strong>la</strong>ine, <strong>en</strong> effet, avec lequel elle a oint <strong>la</strong> tunique,<br />
exposé au jour, s’est dissous <strong>en</strong> poudre. Elle craint le même effet sur Héraclès. Si jamais il <strong>en</strong> meurt, elle mourra avec<br />
lui. Le Coryphée t<strong>en</strong>te <strong>de</strong> <strong>la</strong> rassurer.<br />
Retour d’Hyllos : « Ton mari, tu vi<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’assassiner ! » Et il raconte comm<strong>en</strong>t Héraclès s’est revêtu <strong>de</strong> <strong>la</strong> tunique<br />
pour sacrifier à Zeus son père, et comm<strong>en</strong>t « un prurit spasmodique » s’est soudain emparé <strong>de</strong> lui. Pris <strong>de</strong> fureur, il a<br />
précipité Lichas contre un rocher. Puis il a <strong>de</strong>mandé à Hyllos, son fils <strong>de</strong> l’emm<strong>en</strong>er au plus vite loin <strong>de</strong> ce lieu. Sans<br />
un mot, Déjanire r<strong>en</strong>tre dans <strong>la</strong> pa<strong>la</strong>is. Le Chœur vérifie le dire <strong>de</strong> l’oracle, et se <strong>la</strong>m<strong>en</strong>te sur le sort d’Héraclès.<br />
La servante <strong>de</strong> Déjanire vi<strong>en</strong>t alors annoncer le suici<strong>de</strong> <strong>de</strong> sa maîtresse : r<strong>en</strong>trée chez elle, elle a touché tous les<br />
objets <strong>de</strong> sa chambre, puis elle s’est poignardée. La servante et son fils Hyllos l’ont découverte <strong>en</strong>semble; Hyllos, qui<br />
sera bi<strong>en</strong>tôt orphelin ! Le Choeur ne sait plus <strong>de</strong> quel malheur se <strong>la</strong>m<strong>en</strong>ter. Il voit arriver Héraclès porté sur une<br />
civière.<br />
Hyllos gémit sur le sort <strong>de</strong> son père, un Vieil<strong>la</strong>rd le prie <strong>de</strong> se calmer, mais Héraclès s’éveille ; <strong>en</strong> proie à d’atroces<br />
douleurs, il ne supporte pas qu’on le touche. Il supplie son fils <strong>de</strong> le tuer. (Il alterne <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>mation et le chant).<br />
Puis il décrit ses souffrances, et, s’<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>ant à Déjanire, il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à son fils <strong>de</strong> l’am<strong>en</strong>er ici, afin qu’il <strong>la</strong> punisse.<br />
Et pourtant, il a tué le lion <strong>de</strong> Némée (il énumère alors ses travaux, ici au nombre <strong>de</strong> six). Hyllos annonce <strong>en</strong> tremb<strong>la</strong>nt<br />
le suici<strong>de</strong> <strong>de</strong> sa mère, et qu’elle avait cru bi<strong>en</strong> faire <strong>en</strong> <strong>en</strong>voyant à son époux <strong>la</strong> tunique <strong>de</strong> Nessos. Hé raclès<br />
compr<strong>en</strong>d alors qu’il est perdu, et voudrait rassem bler tous ses <strong>en</strong>fants, et sa mère Alcmène, pour leur dire que l’oracle<br />
<strong>de</strong>s chênes <strong>de</strong> Dodone lui avait prédit qu’il mourrait, non d’un vivant, mais d’un mort. Or Nessos est mort. Il<br />
ne lui reste plus qu’à supplier son fils <strong>de</strong> le conduire au sommet <strong>de</strong> l’Œta, et <strong>de</strong> le brûler sur un bûcher ; il le prie<br />
<strong>en</strong> outre <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre soin d’Iole, et <strong>de</strong> l’épouser, ce à quoi Hyllos se résout avec <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> difficulté.<br />
Hyllos conclut qu’il va <strong>de</strong>voir accomplir un acte que les dieux verront d’un mauvais œil. On emporte alors Héraclès.<br />
Le Coryphée conclut qu’aucun <strong>de</strong> tous ces malheurs n’est étranger à Zeus !<br />
La lég<strong>en</strong><strong>de</strong> d’Héraclès nous conte qu’à peine sur le bûcher, le héros est transporté dans les cieux et <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t un dieu,<br />
mais cette donnée reste <strong>en</strong> <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie, et <strong>de</strong>meure sans doute étrangère à <strong>la</strong> vision sophoclé<strong>en</strong>ne <strong>de</strong>s<br />
malheurs <strong>de</strong>s héros et <strong>de</strong>s hommes.<br />
Redisons-nous donc, nous, avec Victor Hugo, ces <strong>de</strong>ux vers que Malraux avait mis <strong>en</strong> épigraphe à ses Chênes qu’on<br />
abat, dialogue <strong>en</strong>tre De Gaulle et lui-même :<br />
« Oh ! quel farouche bruit font dans le crépuscule<br />
Les chênes qu’on abat pour le bûcher d’Héraclès ! »<br />
François Regnault<br />
10<br />
11
UNE TRAGÉDIE CONTEMPORAINE ?<br />
Hérodote nous raconte que, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> représ<strong>en</strong>tation <strong>de</strong><br />
La Prise <strong>de</strong> Milet, une tragédie historique <strong>de</strong> Phrynichos,<br />
le théâtre tout <strong>en</strong>tier fondit <strong>en</strong> <strong>la</strong>rmes. Le poète fut<br />
condamné à une am<strong>en</strong><strong>de</strong> très sévère <strong>de</strong> mille drachmes<br />
« parce qu’il leur avait rappelé <strong>la</strong> mémoire <strong>de</strong> leurs malheurs<br />
domestiques ». Aussi, cette pièce fut-elle interdite<br />
à <strong>la</strong> représ<strong>en</strong>tation et <strong>la</strong> tragédie ne <strong>de</strong>vra plus jamais<br />
s’intéresser à l’histoire réelle. Ce g<strong>en</strong>re théâtral ne doit plus<br />
traiter que <strong>de</strong>s mythes et mettre <strong>en</strong> scène <strong>de</strong>s interactions<br />
tragiques <strong>en</strong>tre notre mon<strong>de</strong> et les Dieux. Résu mer simplem<strong>en</strong>t,<br />
il ne doit être question que <strong>de</strong> <strong>la</strong> démesure <strong>de</strong>s<br />
hommes dans <strong>la</strong> juste mesure <strong>de</strong>s vers.<br />
Le théâtre antique est un lieu popu<strong>la</strong>ire et citoy<strong>en</strong>, les<br />
plus pauvres étant aussi invités et conviés à cette gran<strong>de</strong><br />
fête dionysiaque. Trois jours <strong>de</strong> tragédies, conclus, cha -<br />
que fois, par une comédie. La valeur cathartique <strong>de</strong>s<br />
représ<strong>en</strong>tations pr<strong>en</strong>d alors tout son s<strong>en</strong>s. Le happy<strong>en</strong>ding<br />
hollywoodi<strong>en</strong> s’inspire <strong>de</strong> ce principe : une fin<br />
heureuse vi<strong>en</strong>t s’ajouter à une première fin triste et réaliste<br />
pour permettre au spectateur <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>ir doucem<strong>en</strong>t<br />
à <strong>la</strong> réalité, sans être déstabiliser par <strong>la</strong> force <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fiction.<br />
En adaptant une tragédie, Martin Crimp pose alors <strong>de</strong>s<br />
questions sur le <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s stimu<strong>la</strong>tions imaginaires et<br />
<strong>de</strong>s croyances merveilleuses dans notre société, comme<br />
dans le théâtre et ses spectateurs contemporains.<br />
12<br />
Pourquoi? Parce que, justem<strong>en</strong>t, il considère et interprète<br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s données métaphysiques dans <strong>la</strong> tragédie pour<br />
les adapter, aujourd’hui, à notre mon<strong>de</strong>. Il revi<strong>en</strong>t aussi<br />
à l’histoire, bravant l’antique interdit. L’auteur ang<strong>la</strong>is<br />
construit une passerelle <strong>en</strong>tre l’antiquité et <strong>la</strong> contemporanéité<br />
<strong>en</strong> p<strong>en</strong>sant <strong>la</strong> tragédie comme une représ<strong>en</strong>tation<br />
du mon<strong>de</strong>. Elle emprunte alors un nouveau chemin<br />
<strong>en</strong> se dérou<strong>la</strong>nt à notre époque : celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> multiplication<br />
<strong>de</strong>s possibilités narratives et surtout, celle du<br />
hasard et du susp<strong>en</strong>se. Un spectateur tragique, sait, avant<br />
même d’<strong>en</strong>trer au théâtre, que Héraclès va mourir, il<br />
n’est là que pour assister à sa mort et à compr<strong>en</strong>dre l’interv<strong>en</strong>tion<br />
<strong>de</strong>s Dieux, tout <strong>en</strong> les louant. Les personnages<br />
crimpi<strong>en</strong>s n’ont, quant à eux, plus aucune visibilité<br />
vers le futur, ils march<strong>en</strong>t vers l’inconnu et s’occup<strong>en</strong>t<br />
futilem<strong>en</strong>t. La tragédie <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t alors un drame bourgeois,<br />
g<strong>en</strong>re très anglo-saxon d’ailleurs, mais si T<strong>en</strong>dre et Cruel<br />
réussit à le dépasser, c’est sûrem<strong>en</strong>t grâce à sa source<br />
tragique. S’il vole à Sophocle les thèmes, les personnages<br />
et l’histoire, Crimp ne se cont<strong>en</strong>te pas <strong>de</strong> donner<br />
à voir une adaptation mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes. En<br />
effet, il l’intègre pleinem<strong>en</strong>t dans son œuvre d’écrivain<br />
et y développe son propre style et ses problématiques, à<br />
partir du matériel dramaturgique grec.<br />
Clém<strong>en</strong>t Mercier<br />
VIEILLES OUTRES<br />
& VIN NOUVEAU<br />
Sans avoir étudié forcém<strong>en</strong>t <strong>la</strong> mythologie grecque ni<br />
les lég<strong>en</strong><strong>de</strong>s anci<strong>en</strong>nes, nous avons tous vaguem<strong>en</strong>t ou<br />
précisém<strong>en</strong>t <strong>en</strong> mémoire certains épiso<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerre<br />
<strong>de</strong> Troie, supposée v<strong>en</strong>ger l’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t d’Hélène par<br />
Pâris, l’histoire d’Œdipe, qui tua son père et épousa sa<br />
mère, Médée, qui tua ses <strong>en</strong>fants pour punir Jason <strong>de</strong><br />
l’avoir trompée, ou les Travaux d’Héraclès.<br />
Nous pr<strong>en</strong>ons donc un grand p<strong>la</strong>isir à voir un dramaturge<br />
mo<strong>de</strong>rne repr<strong>en</strong>dre une fable antique, nous <strong>la</strong> raconter<br />
à sa façon, <strong>la</strong> « mo<strong>de</strong>rniser », <strong>en</strong> tirer <strong>de</strong> nouvelles signi -<br />
fications ou <strong>de</strong>s leçons inédites. Mettre du vin nouveau<br />
dans <strong>de</strong> vieilles outres, comme on dit parfois (mais on<br />
lit dans saint Luc, V, 37 que « Le vin nouveau fera éc<strong>la</strong>ter<br />
les outres » !). Ce fut un peu <strong>la</strong> formule utilisée par<br />
plusieurs écrivains français du XX e siècle : Jean Cocteau<br />
repr<strong>en</strong>ant l’histoire d’Œdipe dans sa Machine infernale,<br />
Giraudoux s’amusant à opérer <strong>de</strong>s variations sur <strong>de</strong>s thè -<br />
mes antiques dans son Electre et dans La Guerre <strong>de</strong> Troie<br />
n’aura pas lieu, Jean Anouilh essayant d’interroger <strong>la</strong> po -<br />
litique <strong>de</strong> son époque dans son Antigone. Ou Sartre<br />
retraduisant à sa façon Les Troy<strong>en</strong>nes d’Euripi<strong>de</strong> pour<br />
parler <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerre d’Algérie et du colonialisme.<br />
Bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du, on n’a pas att<strong>en</strong>du le XX e siècle pour se<br />
livrer à ce g<strong>en</strong>re <strong>de</strong> transposition, ou simplem<strong>en</strong>t d’adap -<br />
tation : même lorsque Corneille et Racine repr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t<br />
une tragédie anci<strong>en</strong>ne, ou un épiso<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’histoire an ci<strong>en</strong> -<br />
ne, ils se livr<strong>en</strong>t à <strong>de</strong>s transpositions plus ou moins importantes<br />
(Racine refusant <strong>de</strong> substituer une biche à Iphigénie<br />
dans le sacrifice <strong>de</strong> <strong>la</strong> fille d’Agamemnon, et inv<strong>en</strong>tant à <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>ce une captive Eriphile, procè<strong>de</strong> un peu comme Crimp!)<br />
sans parler <strong>de</strong> Molière tirant son Amphitryon di recte m<strong>en</strong>t<br />
d’une comédie <strong>de</strong> P<strong>la</strong>ute, ou son Avare, <strong>de</strong> façon très trans -<br />
posée, <strong>de</strong> l’Aulu<strong>la</strong>ire (La Marmite) <strong>de</strong> ce même P<strong>la</strong>ute.<br />
Dans T<strong>en</strong>dre et Cruel, Martin Crimp, répondant à une<br />
comman<strong>de</strong>, produit un équival<strong>en</strong>t mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>s Tra -<br />
chini<strong>en</strong>nes <strong>de</strong> Sophocle. Cette tragédie est peu connue,<br />
bi<strong>en</strong> qu’elle raconte le retour d’Héraclès (l’Hercule grec)<br />
<strong>de</strong> ses campagnes héroïques et <strong>la</strong> v<strong>en</strong>geance involontaire<br />
(ou inconsci<strong>en</strong>te) <strong>de</strong> sa femme Déjanire lui faisant<br />
prés<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> tunique du C<strong>en</strong>taure Nessus, grâce à <strong>la</strong> -<br />
quelle elle espère regagner l’amour perdu <strong>de</strong> son mari,<br />
lorsqu’elle appr<strong>en</strong>d qu’il a <strong>en</strong>trepris une guerre pour<br />
conquérir une jeune étrangère. (On a conservé d’ailleurs<br />
d’autres tragédies sur Héraclès, La Folie d’Héraclès, d’Eu -<br />
ripi<strong>de</strong>, reprise dans son Héraclès furieux par Sénèque,<br />
qui a écrit aussi un Héraclès sur l’Œta, <strong>la</strong> montagne où,<br />
13<br />
terrassé par les souffrances que lui cause <strong>la</strong> tunique em -<br />
poisonnée, il se fait brûler sur un bûcher).<br />
L’originalité <strong>de</strong> Martin Crimp par rapport aux “reprises”<br />
françaises d’œuvres antiques citées plus haut, ti<strong>en</strong>t à ce<br />
que sa mo<strong>de</strong>rnisation est complète. Personne, <strong>en</strong> principe,<br />
n’est c<strong>en</strong>sé, <strong>en</strong> lisant <strong>la</strong> pièce ou <strong>en</strong> y assistant, <strong>de</strong>viner<br />
qu’il s’agit d’Héraclès, aucun nom antique n’est conser -<br />
vé, sauf lorsque le héros, à <strong>la</strong> fin, délire et déc<strong>la</strong>re : « J’ai<br />
tué le Lion <strong>de</strong> Némée ».<br />
Crimp procè<strong>de</strong> plutôt comme Pasolini racontant dans son<br />
film Œdipe d’abord l’histoire mo<strong>de</strong>rne d’un couple du XX e<br />
siècle avec un <strong>en</strong>fant, jaloux du retour <strong>de</strong> son père militaire,<br />
qu’il <strong>en</strong>chaîne avec l’histoire supposée d’Œdipe <strong>en</strong><br />
costumes antiques et dans <strong>de</strong>s lieux grecs. Crimp transpose<br />
seulem<strong>en</strong>t.<br />
Dans T<strong>en</strong>dre et cruel, Héraclès est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u un Général parti<br />
<strong>en</strong> mission militaire <strong>en</strong> Afrique pour « éradiquer le terrorisme<br />
», <strong>en</strong>treprise on ne peut plus actuelle, et s’il revi<strong>en</strong>t<br />
avec une jeune fille et un petit garçon orphelins <strong>de</strong> leurs<br />
par<strong>en</strong>ts massacrés par lui, on ne <strong>de</strong>vine pas tout <strong>de</strong> suite<br />
que cette jeune fille est sa maîtresse, ni qu’il aurait écrasé<br />
une ville <strong>en</strong>tière pour <strong>la</strong> conquérir.<br />
Martin Crimp suit pourtant assez exactem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> très belle<br />
tragédie <strong>de</strong> Sophocle, dont Déjanire, <strong>la</strong> femme d’Héraclès,<br />
est incontestablem<strong>en</strong>t l’héroïne, le personnage principal<br />
constamm<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>t, tandis qu’Héraclès n’apparaît qu’à<br />
<strong>la</strong> toute fin, déjà contaminé par <strong>la</strong> tunique v<strong>en</strong>imeuse,<br />
prés<strong>en</strong>t imprud<strong>en</strong>t <strong>de</strong> son épouse, lorsque celle-ci s’est sui -<br />
cidée <strong>en</strong> appr<strong>en</strong>ant qu’elle a été à son insu (mais <strong>la</strong> ques -<br />
tion se pose !) <strong>la</strong> victime du m<strong>en</strong>songe <strong>de</strong> Nessus.<br />
Les messagers antiques sont transposés par Crimp <strong>en</strong> <strong>de</strong>s<br />
personnages ayant <strong>de</strong>s fonctions, sinon équival<strong>en</strong>tes, du<br />
moins ayant quelques rapports: un journaliste, un ministre.<br />
Quant au Chœur, il est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s trois em -<br />
ployées au service d’Amelia, le femme du Général (tout<br />
comme <strong>la</strong> tragédie française se vante d’avoir réduit <strong>la</strong><br />
fonction <strong>de</strong>s Chœurs à celles <strong>de</strong>s confid<strong>en</strong>ts).<br />
On a donc affaire à une sorte <strong>de</strong> pièce symphonique dont<br />
le thème <strong>la</strong>t<strong>en</strong>t peut être reconnu par le connaisseur, mais<br />
dont <strong>la</strong> fable racontée est résolum<strong>en</strong>t contemporaine.<br />
Qu’il reconnaisse ou non <strong>la</strong> forme du f<strong>la</strong>con ou son goût,<br />
le spectateur d’aujourd’hui goûtera, lui, le vin nouveau ;<br />
il sera s<strong>en</strong>sible à <strong>la</strong> figure noble et tragique <strong>de</strong> cette fem -<br />
me à l’amour contrarié (elle ressemble <strong>en</strong> ce<strong>la</strong> à l’héroïne<br />
<strong>de</strong> Sophocle), sur fond <strong>de</strong> guerre et <strong>de</strong> massacres.<br />
François Regnault
TENDRE ET CRUEL<br />
UNE ADAPTATION … … DES TRACHINIENNES<br />
En vue <strong>de</strong> ce petit dossier dramaturgique, il nous est ap -<br />
paru plus rigoureux <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ser les réflexions autour <strong>de</strong>s<br />
thèmes et <strong>de</strong>s personnages par rapport à l’ordre chronologique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce et, surtout, <strong>en</strong> <strong>la</strong> comparant sans<br />
cesse à <strong>la</strong> pièce d’origine. Les diverg<strong>en</strong>ces et les ressemb<strong>la</strong>nces,<br />
les images oubliées, celles utilisées, les ajouts<br />
et les adaptations sont autant <strong>de</strong> procédés d’écriture qui<br />
ne pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t leurs s<strong>en</strong>s que lorsqu’ils sont contextualisés<br />
dans une comparaison. Celle-ci ne cherche aucunem<strong>en</strong>t<br />
ni raison ni valeur au travail <strong>de</strong> Crimp, mais elle essaie<br />
<strong>de</strong> compr<strong>en</strong>dre son cheminem<strong>en</strong>t et son s<strong>en</strong>s.<br />
Les <strong>page</strong>s pour Les Trachini<strong>en</strong>nes (référ<strong>en</strong>ces chiffrées<br />
sans <strong>la</strong> m<strong>en</strong>tion p.) r<strong>en</strong>voi<strong>en</strong>t au Folio-C<strong>la</strong>ssique dans<br />
<strong>la</strong> traduction <strong>de</strong> Paul Mazon. Celles <strong>de</strong> T<strong>en</strong>dre et Cruel<br />
(référ<strong>en</strong>ces chiffrées précédées <strong>de</strong> <strong>la</strong> m<strong>en</strong>tion p.) r<strong>en</strong>voi<strong>en</strong>t<br />
à l’Arche dans <strong>la</strong> traduction <strong>de</strong> Philippe Djian.<br />
L’OUVERTURE I PROLOGUE<br />
Martin Crimp choisit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r <strong>la</strong> ligne générale et les<br />
grands traits du monologue <strong>de</strong> Déjanire ; on a alors : <strong>de</strong>s<br />
considérations <strong>de</strong> vérité générale sur le sexe, <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>ce<br />
et les hommes, une biographie amoureuse <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme qui<br />
parle (son père, son prét<strong>en</strong>dant) et une explication c<strong>la</strong>ire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> situation. Les occurr<strong>en</strong>ces vont <strong>en</strong>core plus loin, jus -<br />
qu’au niveau du champ lexical :<br />
→ « douce et cruelle » inspiration <strong>de</strong> Crimp pour le titre,<br />
dire explicite chez Sophocle ;<br />
→ « ne me valût que <strong>de</strong>s souffrances » Déjanire, comme<br />
Amelia, se définit d’abord par le fait qu’elles sont femmes<br />
et souffrantes.<br />
Ensuite, cette définition s’approfondit, ces femmes souffr<strong>en</strong>t<br />
d’abord <strong>de</strong> l’abs<strong>en</strong>ce d’un mari : « Ainsi le vou<strong>la</strong>it<br />
l’exist<strong>en</strong>ce qui, sans répit, quand il r<strong>en</strong>trait chez lui, l’<strong>en</strong><br />
éloignait bi<strong>en</strong> vite »<br />
Vi<strong>en</strong>t alors une nouvelle problématique commune aux<br />
<strong>de</strong>ux œuvres : l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> résid<strong>en</strong>ce qui affecte Déjanire<br />
comme Amelia : « nous y habitons (à Trachis) chez un<br />
hôte », transposé à l’aéroport pour Crimp.<br />
Enfin, <strong>la</strong> question primordiale qui ouvre l’action et qui<br />
termine le prologue : où est Héraclès ? Où est le général<br />
? Pour repr<strong>en</strong>dre Déjanire : « où est-il ? ».<br />
À propos <strong>de</strong>s <strong>en</strong>fants d’Héraclès: « comme un paysan qui<br />
a pris <strong>la</strong> charge d’un domaine au loin, ne les a jamais vus<br />
qu’une fois ou l’autre, aux seules époques <strong>de</strong>s semailles ».<br />
14<br />
L’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’homme dans <strong>la</strong> structure familiale est<br />
confirmée. Crimp repr<strong>en</strong>d avec exactitu<strong>de</strong> cette comparai -<br />
son: son adaptation oscille <strong>en</strong>tre <strong>de</strong> telles ressemb<strong>la</strong>nces,<br />
<strong>de</strong>s discordances f<strong>la</strong>grantes et <strong>de</strong>s nouvelles propositions<br />
ou approfondissem<strong>en</strong>ts.<br />
Dans les <strong>de</strong>ux cas, c’est bi<strong>en</strong> l’histoire d’une femme souf -<br />
frante, privée <strong>de</strong> son mari, abandonnée à elle-même dans<br />
un lieu inconnu et qui, surtout, manque d’information,<br />
ou plutôt croit <strong>en</strong> manquer. Dans les <strong>de</strong>ux cas, le fils est au<br />
courant <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> son père alors qu’elle l’ignore.<br />
La première diverg<strong>en</strong>ce prononcée dans <strong>la</strong> dramaturgie<br />
intervi<strong>en</strong>t par l’intermédiaire du fils Hyllos/James. En<br />
effet, le fils d’Héraclès part volontairem<strong>en</strong>t chercher son<br />
père alors que celui d’Amelia traîne les pieds à cette pro po -<br />
sition. D’un côté, le fils mythique <strong>en</strong>dosse <strong>la</strong> responsabi -<br />
lité d’une quête absur<strong>de</strong>, celle <strong>de</strong> « chercher son père »,<br />
alors que le fils contemporain est plutôt consci<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cette<br />
absurdité. Absurdité qui existe dès lors que l’on démystifie<br />
<strong>la</strong> situation, ce que Crimp fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce <strong>en</strong> excluant<br />
les Dieux. Ainsi, on voit bi<strong>en</strong> qu’<strong>en</strong>voyer chercher son<br />
père dans une ville africaine <strong>en</strong> plein milieu d’une zone <strong>de</strong><br />
guerre sans aucune information n’a, à proprem<strong>en</strong>t parler,<br />
aucun s<strong>en</strong>s, soulignant ainsi l’illusion et l’aveuglem<strong>en</strong>t<br />
qui définit le personnage féminin. (pp. 16-41)<br />
« LA MACHINE » I PREMIER CHŒUR<br />
Si Crimp conserve quelque chose <strong>de</strong>s personnages du<br />
chœur, c’est leur sexe: c’est un chœur <strong>de</strong> femmes. En effet,<br />
les <strong>de</strong>ux servantes (2 et 3) sont explicitem<strong>en</strong>t les remp<strong>la</strong>çantes<br />
du chœur grec si l’on <strong>en</strong> croit leurs interv<strong>en</strong>tions<br />
par rapport à <strong>la</strong> structure générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce <strong>de</strong><br />
Sophocle. En remp<strong>la</strong>çant le chœur par <strong>de</strong>ux personnages<br />
qui intervi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t directem<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> fiction, Crimp continue<br />
<strong>de</strong> s’éloigner <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie antique. Ce<br />
choix s’éc<strong>la</strong>ircit d’autant mieux à <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> première<br />
scène <strong>en</strong>tre les domestiques et Amelia : quand le<br />
chœur antique invoquait Zeus pour ne pas qu’il <strong>la</strong>isse<br />
souf frir <strong>de</strong> <strong>la</strong> sorte une pauvre femme, les domestiques<br />
invoqu<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s problèmes cosmétiques et sportifs. Dans<br />
un certain s<strong>en</strong>s, chez les Grecs, si Déjanire va mal, c’est<br />
<strong>la</strong> faute <strong>de</strong>s Dieux ; chez nous, contemporains, si l’on va<br />
mal c’est <strong>la</strong> faute <strong>de</strong> <strong>la</strong> machine <strong>de</strong> sport que nous n’utilisons<br />
pas. Crimp pr<strong>en</strong>d, bi<strong>en</strong> sûr, cette proposition avec<br />
du recul et un second <strong>de</strong>gré qui apparti<strong>en</strong>t à son style<br />
et non plus à celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie. On peut facilem<strong>en</strong>t voir<br />
ici, par le procédé <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t du chœur, une critique<br />
<strong>de</strong>s problématiques actuelles et <strong>de</strong>s politiques in -<br />
s<strong>en</strong>sées du bonheur personnel néo-libéral, mais ce n’est<br />
pas si simple. Si l’auteur ang<strong>la</strong>is fait bi<strong>en</strong> changer le chœur<br />
<strong>de</strong> registre, il gar<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>en</strong>sée principale <strong>de</strong> <strong>la</strong> scène :<br />
Déjanire/Amelia souffre. (pp. 16-17 ; 42-43)<br />
Dans ces thématiques divines, que Crimp supprime,<br />
Déjanire, par <strong>la</strong> voie <strong>de</strong> l’Oracle, est convaincue d’une<br />
chose : cette mission sera pour Héraclès <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière. Ou<br />
bi<strong>en</strong> il <strong>en</strong> mourra, ou bi<strong>en</strong> il revi<strong>en</strong>dra, libre jusqu’à <strong>la</strong><br />
fin <strong>de</strong> ses jours. Cette annonce <strong>de</strong> Déjanire, Crimp<br />
l’écrase <strong>en</strong> supprimant radicalem<strong>en</strong>t toute religiosité.<br />
La tragédie emprunte alors un nouveau chemin: celui <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> multiplication <strong>de</strong>s possibilités narratives et surtout,<br />
celui du hasard et du susp<strong>en</strong>se. Un spectateur tragique,<br />
sait, avant même d’<strong>en</strong>trer au théâtre, qu’Héraclès va mou -<br />
rir, il n’est là que pour assister à sa mort et compr<strong>en</strong>dre<br />
l’interv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s Dieux, tout <strong>en</strong> les louant. Les personnages<br />
crimpi<strong>en</strong>s n’ont, quant à eux, aucune projection<br />
vers le futur, ils march<strong>en</strong>t vers l’inconnu, err<strong>en</strong>t et s’occup<strong>en</strong>t<br />
futilem<strong>en</strong>t.<br />
L’HÉRITAGE<br />
Comme chez Sophocle, Crimp, par l’intermédiaire d’Ame -<br />
lia, évoque <strong>la</strong> question d’une sorte <strong>de</strong> testam<strong>en</strong>t <strong>de</strong> son<br />
mari qui délègue à son seul fils « <strong>la</strong> gérance et l’usage <strong>de</strong> ses<br />
15<br />
bi<strong>en</strong>s », comme si « elle n’existait pas » (p. 21), ce qui <strong>la</strong> bou -<br />
leverse. Déjanire, elle, dans <strong>la</strong> pièce <strong>de</strong> Sophocle, est seu -<br />
lem<strong>en</strong>t troublée <strong>de</strong> découvrir un testam<strong>en</strong>t d’Héraclès,<br />
et donc qu’il avait pu <strong>en</strong>visager sa mort possible.<br />
LE MESSAGER I LE JOURNALISTE<br />
En poursuivant son adaptation <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s religieux inhé -<br />
r<strong>en</strong>ts à <strong>la</strong> tragédie, Crimp ajuste habilem<strong>en</strong>t les transpo -<br />
sitions: après le chœur transformé <strong>en</strong> domestiques conso m -<br />
matrices, le messager (aggelos, <strong>en</strong> grec, qui est notre<br />
mot “ange”) <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t un journaliste. La constatation que<br />
pose cette mutation est c<strong>la</strong>ire, sans pour autant porter<br />
<strong>de</strong> jugem<strong>en</strong>t : à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce du messager antique, toujours<br />
un peu v<strong>en</strong>u d’ailleurs, s’impose aujourd’hui le journaliste,<br />
inévitable. En adaptant <strong>de</strong> cette manière <strong>la</strong> tragédie<br />
mythique, Crimp pose <strong>de</strong>s questions sur le <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir<br />
<strong>de</strong>s croyances anci<strong>en</strong>nes dans notre société comme dans<br />
le théâtre contemporain.<br />
Si Amelia et Déjanire partag<strong>en</strong>t <strong>en</strong>suite un s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t et<br />
un questionnem<strong>en</strong>t communs, ils s’exprim<strong>en</strong>t simplem<strong>en</strong>t<br />
: où est le mari ? Pourquoi n’est-il pas là ? Cette<br />
inquiétu<strong>de</strong> paraît plus réelle chez Déjanire, qui est vraim<strong>en</strong>t<br />
heureuse <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle puisqu’elle <strong>en</strong> félicite les<br />
Dieux. Amelia, elle, ne <strong>la</strong>nce qu’un très forcé « Je suis<br />
très très heureuse » (pp. 23-44). Amelia s’empresse <strong>en</strong> suite<br />
<strong>de</strong> se jeter dans les bras <strong>de</strong> Richard pour danser, manifestem<strong>en</strong>t<br />
par désespoir. En tant que femme, elle a besoin<br />
<strong>de</strong> se s<strong>en</strong>tir désirée, accompagnée. Son désarroi subit le<br />
r<strong>en</strong> voie aux questionnem<strong>en</strong>ts fondam<strong>en</strong>taux <strong>de</strong> son exis -<br />
t<strong>en</strong>ce, du même coup se révèle aussi pour nous <strong>la</strong> portée<br />
tragique <strong>de</strong> son personnage.<br />
Pour conclure cette séqu<strong>en</strong>ce, Crimp propose une nouvelle<br />
adaptation du chœur, plus fidèle à l’esprit antique.<br />
L’im portance qu’il donne à <strong>la</strong> musique, et précisém<strong>en</strong>t<br />
là aux chansons <strong>de</strong> Billie Holliday, est fondam<strong>en</strong>tale.<br />
Ainsi, par ce geste, nous montre-t-il <strong>la</strong> puissance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mu sique et du chant, qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t décrire l’état d’esprit<br />
d’Amelia. Comme dans le chœur antique <strong>de</strong>s femmes <strong>de</strong><br />
Trachis, certaines considérations générales sont sublimées<br />
par <strong>la</strong> voix et les p<strong>en</strong>sées intérieures <strong>de</strong> l’héroïne.<br />
Dans un certain s<strong>en</strong>s, il p<strong>en</strong>se <strong>la</strong> musique comme une
véritable re<strong>la</strong>tion au mon<strong>de</strong> extérieur qui pourrait se<br />
substituer à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion que les Grecs <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t avec<br />
les Dieux. En tout cas, <strong>la</strong> musique est un mom<strong>en</strong>t privilégié<br />
qui élèverait l’âme.<br />
LE MINISTRE (P. 32…)<br />
Le discours <strong>de</strong> Jonathan est très semb<strong>la</strong>ble à celui <strong>de</strong><br />
Lichas à quelques petites exceptions près : Lichas était<br />
un ami proche d’Héraclès quand Jonathan <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t un<br />
ministre manipu<strong>la</strong>teur, qui récite un discours pré-fabriqué<br />
dans <strong>la</strong> longue tradition <strong>de</strong>s <strong>la</strong>ngues <strong>de</strong> bois.<br />
Dans <strong>la</strong> série ce que les Dieux <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t, on peut aussi<br />
noter que le général est abs<strong>en</strong>t parce qu’il lui faut <strong>en</strong> -<br />
core « sécuriser <strong>la</strong> ville » tandis que le ministre doit don -<br />
ner à son sujet une « confér<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> presse »: alors qu’Hé -<br />
raclès « revi<strong>en</strong>dra, aussitôt achevé le pieux sacrifice qu’il<br />
doit pour sa conquête à son père Zeus » (48), le rite religieux<br />
se voit <strong>en</strong> somme substituer <strong>la</strong> toute puissance du<br />
journaliste mo<strong>de</strong>rne.<br />
Si on a l’impression que Lichas m<strong>en</strong>t beaucoup moins<br />
que Jonathan, il ne faut pas se mépr<strong>en</strong>dre. En effet, dans<br />
le discours <strong>de</strong> Jonathan, celui-ci m<strong>en</strong>t à propos <strong>de</strong> l’origine<br />
<strong>de</strong>s <strong>en</strong>fants alors que Lichas annonce tout <strong>de</strong> suite<br />
qu’elles sont <strong>de</strong>s prisonnières <strong>de</strong> guerre. Cette diverg<strong>en</strong>ce<br />
ne peut être analysée <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière que<br />
toutes les autres puisqu’il était courant, dans <strong>la</strong> Grèce<br />
antique, <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre <strong>de</strong>s captifs et <strong>de</strong>s captives pour les<br />
am<strong>en</strong>er chez soi après une guerre. Ce qui paraîtrait to ta -<br />
lem<strong>en</strong>t invraisemb<strong>la</strong>ble dans une guerre mo<strong>de</strong>rne. Cette<br />
diverg<strong>en</strong>ce forcée permet, par contre, d’ajouter un m<strong>en</strong>songe<br />
au discours <strong>de</strong> Jonathan. Et à Crimp d’attaquer<br />
ainsi le comportem<strong>en</strong>t d’Amelia, et du mon<strong>de</strong> occid<strong>en</strong>tal,<br />
par <strong>la</strong> même occasion. Pour justifier cette captivité,<br />
Jonathan veut invoquer notre bonne consci<strong>en</strong>ce chréti<strong>en</strong>ne.<br />
Ainsi, ce sont <strong>de</strong>s « rescapés » dont il faut s’occuper<br />
et Amelia s’<strong>en</strong> donne à cœur joie. Il faut leur donner<br />
« <strong>de</strong>s jouets ». Il existe <strong>en</strong> elle une beauté et une naï -<br />
veté primaire qui flirte avec une fausse mondanité et <strong>de</strong>s<br />
comportem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> princesse. Son côté Marie-Antoinette<br />
l’empêche souv<strong>en</strong>t <strong>de</strong> voir <strong>la</strong> réalité <strong>en</strong> face : à propos du<br />
discours <strong>de</strong> Jonathan, elle p<strong>en</strong>se que ce n’est pas vraisemb<strong>la</strong>ble.<br />
La manière dont il décrit, <strong>de</strong> manière très<br />
réaliste, <strong>la</strong> guerre, n’est pour Amelia qu’une exagération.<br />
Le dialogue Jonathan/Amelia t<strong>en</strong>te <strong>de</strong> souligner cette<br />
fausse bonne consci<strong>en</strong>ce occid<strong>en</strong>talo-écologique qui ne<br />
sert qu’à cacher les horreurs <strong>de</strong> l’impérialisme. Quand<br />
on parle <strong>de</strong> « l’inimitable manière du général » (p.28), il<br />
faut <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dre crime contre l’humanité.<br />
16<br />
C’est <strong>de</strong> cette manière-là que Crimp utilise <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s<br />
« captives » qui ne peuv<strong>en</strong>t être chez Sophocle à l’origine<br />
d’un tel discours puisque <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> guerre à l’époque<br />
n’était pas <strong>la</strong> même qu’aujourd’hui. En transformant Li -<br />
chas <strong>en</strong> Jonathan, Crimp utilise ce rôle pour t<strong>en</strong>ir un dis -<br />
cours politique. Le rôle <strong>de</strong>s prisonniers varie énormém<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux pièces puisque, dans cette même scène,<br />
Amelia va vouloir s’<strong>en</strong> occuper, pour qu’ils soi<strong>en</strong>t mieux<br />
traités que chez eux et qu’ils oubli<strong>en</strong>t leurs malheurs.<br />
Chez Sophocle, Lichas reconnaît que les captives vont<br />
« échanger leur opul<strong>en</strong>ce contre un sort moins <strong>en</strong>viable ».<br />
Cette transposition souligne bi<strong>en</strong> que <strong>la</strong> barbarie <strong>de</strong>s<br />
guerres, si elle était explicite dans <strong>la</strong> pièce grecque, est<br />
aujourd’hui dissimulée par une <strong>en</strong>treprise téléologique<br />
<strong>de</strong> justification.<br />
Aujourd’hui, on nous fait croire à <strong>de</strong>s croisa<strong>de</strong>s du bi<strong>en</strong>.<br />
Amelia est dans <strong>la</strong> comp<strong>la</strong>isance et l’illusion quand elle<br />
approuve ce geste alors que Déjanire s’opposait à l’idée<br />
d’<strong>en</strong>fermer ces captives : « une étrange pitié me pénètre »<br />
(48). Adapter une tragédie aujourd’hui, c’est aussi se<br />
r<strong>en</strong>dre compte que ri<strong>en</strong> n’a changé, et qu’on veut juste<br />
nous <strong>en</strong> faire accroire.<br />
Autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> même problématique, une <strong>de</strong>s questions<br />
que pose l’adaptation <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes est celle <strong>de</strong>s mo -<br />
tivations <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre. Est-ce que ce<strong>la</strong> est concevable, <strong>de</strong><br />
nos jours, <strong>de</strong> faire une guerre pour une femme ? Crimp<br />
a eu l’audace <strong>de</strong> conserver cette idée dramaturgique<br />
propre aux récits grecs (se souv<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong><br />
Troie pour Hélène). C’est une intrigue invraisemb<strong>la</strong>ble<br />
mais ce<strong>la</strong> soulève <strong>la</strong> question <strong>de</strong> l’invraisemb<strong>la</strong>nce qu’il<br />
peut y avoir à écrire une tragédie aujourd’hui. Les ob -<br />
jectifs <strong>de</strong> l’écriture sont bi<strong>en</strong> différ<strong>en</strong>ts : si l’on considère<br />
les objectifs généraux <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie grecque, il y a, <strong>de</strong> ma -<br />
nière prioritaire, le culte <strong>de</strong> Dionysos et <strong>la</strong> catharsis du<br />
public. Le public v<strong>en</strong>ait voir les conséqu<strong>en</strong>ces du combat<br />
contre les Dieux, le pouvoir <strong>de</strong>s oracles, l’idéal héroïque<br />
et l’absolu résultat mortuaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> démesure <strong>de</strong> l’homme,<br />
le tout dans <strong>la</strong> juste mesure <strong>de</strong>s vers. Dans un certain<br />
s<strong>en</strong>s, <strong>la</strong> tragédie était une leçon <strong>de</strong> vie. En s’adressant<br />
aux contemporains, Crimp sait bi<strong>en</strong> que le public n’a plus<br />
du tout les mêmes att<strong>en</strong>tes et que le théâtre n’a plus du<br />
tout <strong>la</strong> même vocation.<br />
Aussi, Crimp s’intéresse-t-il aujourd’hui aux m<strong>en</strong>songes<br />
politiques, au terrorisme, à l’impérialisme, bref à un<br />
théâtre <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénonciation qui n’a aucune vocation<br />
cathartique. Mais grâce à <strong>la</strong> trame tragique habilem<strong>en</strong>t<br />
adaptée (notons que les proportions, les images, les<br />
scènes, les ruptures et les intrigues sont conservées) et<br />
surtout grâce au personnage d’Amelia, l’auteur donne<br />
une tout autre dim<strong>en</strong>sion à sa pièce et ne tombe pas<br />
dans l’archétype d’un théâtre politique.<br />
Schématiquem<strong>en</strong>t, le général a combattu le « terrorisme »<br />
quand Héraclès s’est v<strong>en</strong>gé d’une humiliation qu’il a<br />
subie <strong>en</strong> <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ant esc<strong>la</strong>ve d’Omphale, les <strong>de</strong>ux <strong>en</strong>fants<br />
sont <strong>de</strong>s rescapés <strong>de</strong> guerre quand les Trachini<strong>en</strong>nes<br />
sont <strong>de</strong>s captives. Amelia ne peut croire au geste <strong>de</strong> son<br />
mari quand Déjanire accepte <strong>la</strong> vérité tout <strong>de</strong> suite. Dans<br />
les <strong>de</strong>ux cas, Jonathan et Lichas ne veul<strong>en</strong>t pas « bouleverser<br />
» l’épouse, mais <strong>la</strong> protéger. De même, Amelia<br />
et Déjanire ne vont pas reprocher au mari sa tromperie<br />
mais son m<strong>en</strong>songe.<br />
LAELA (PP. 48-49)<br />
La gran<strong>de</strong> possibilité qu’offre une adaptation tragique<br />
aujourd’hui rési<strong>de</strong> dans l’écriture <strong>de</strong> nouvelles scènes<br />
dont les conv<strong>en</strong>tions du théâtre grec ôtai<strong>en</strong>t les possibilités,<br />
même si ce manque était aussi ce qui faisait <strong>la</strong> force<br />
<strong>de</strong> ces tragédies. Ainsi, Amelia r<strong>en</strong>contre Lae<strong>la</strong> tandis<br />
que Déjanire ne s’adresse jamais à <strong>la</strong> captive.<br />
C<strong>la</strong>u<strong>de</strong>l, à propos <strong>de</strong>s Choéphores d’Eschyle, disait :<br />
« On y retrouve <strong>de</strong>ux situations dont nos grands poètes […]<br />
aurai<strong>en</strong>t tiré le meilleur parti : <strong>la</strong> r<strong>en</strong>contre du frère et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> sœur […] on voit d’avance tout ce qu'(ils) aurai<strong>en</strong>t su filer<br />
sur ces thèmes. Eschyle, au contraire, expédie tout ce qui est<br />
drame […] c’est sur l’incantation c<strong>en</strong>trale que le drame<br />
<strong>en</strong>tier trouve son équilibre. »<br />
Ainsi Crimp vi<strong>en</strong>t-il ajouter du drame à <strong>la</strong> pièce d’origine,<br />
ce drame est créé par les r<strong>en</strong>contres <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> femme<br />
et l’amante. Il p<strong>en</strong>se alors <strong>la</strong> réécriture tragique comme<br />
une possibilité créative d’imaginer <strong>la</strong> psychologie drama -<br />
tique <strong>de</strong> certaines situations occultées chez Sophocle. Il<br />
n’y avait aucun réalisme psychologique chez Sophocle :<br />
p<strong>en</strong>ser une tragédie aujourd’hui consisterait alors à in -<br />
v<strong>en</strong>ter et créer <strong>de</strong>s r<strong>en</strong>contres qui n’existai<strong>en</strong>t pas. En<br />
écrivant <strong>la</strong> r<strong>en</strong>contre <strong>en</strong>tre Hippolyte et Phèdre, <strong>en</strong>tre<br />
Hermione et Andromaque, Racine l’a bi<strong>en</strong> compris :<br />
notre mo<strong>de</strong>rnité rêve <strong>de</strong> ces r<strong>en</strong>contres. Combler le désir<br />
d’un public contemporain <strong>en</strong> réécrivant une tragédie se<br />
manifeste aussi dans <strong>la</strong> transformation, par le biais <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
psychologie, du tragique <strong>en</strong> dramatique, <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie<br />
<strong>en</strong> drame.<br />
Cette déviation psychologique rejoint évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t <strong>la</strong> di -<br />
minution <strong>de</strong> <strong>la</strong> portée métaphysique. De <strong>la</strong> tragédie au<br />
drame : c’est le pas qu’il y a <strong>de</strong> <strong>la</strong> métaphysique à <strong>la</strong> psychologie.<br />
Encore une fois, très explicitem<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong><br />
structure <strong>de</strong> T<strong>en</strong>dre et Cruel, les chœurs aux propos mé -<br />
taphysiques se transform<strong>en</strong>t symboliquem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> un quotidi<strong>en</strong><br />
critique : les témoignages pornographiques d’un<br />
quelconque magazine féminin remp<strong>la</strong>c<strong>en</strong>t les nouveaux<br />
é<strong>la</strong>ns lyriques du culte dionysiaque.<br />
17<br />
LE CENTAURE I LE MILITANT GAUCHISTE<br />
Avec l’histoire <strong>de</strong> Robert, Amelia confirme d’abord son<br />
statut <strong>de</strong> bourgeoise tiersmondiste pleine <strong>de</strong> bons s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts,<br />
son jugem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s causes soixante-huitar<strong>de</strong>s<br />
amène un ton plutôt méprisant quand elle décrit le mi -<br />
litantisme <strong>de</strong> Robert qui marche « pour <strong>la</strong> paix » (p. 51).<br />
L’adaptation du mythe du c<strong>en</strong>taure et <strong>de</strong> son philtre<br />
d’amour n’a d’équival<strong>en</strong>ce, pour Crimp, que <strong>la</strong> sci<strong>en</strong>ce<br />
mo<strong>de</strong>rne. Faire d’un produit magique et mystérieux le<br />
résultat purem<strong>en</strong>t sci<strong>en</strong>tifique d’une formule chimique<br />
correspond au <strong>de</strong>ssein <strong>de</strong> substituer aux élém<strong>en</strong>ts my -<br />
thiques <strong>de</strong> l’Antiquité nos démons mo<strong>de</strong>rnes. Écrire une<br />
tragédie avec les croyances d’aujourd’hui, c’est compr<strong>en</strong>dre<br />
pourquoi l’homme avait tant besoin <strong>de</strong>s Dieux et ce<br />
par quoi on les remp<strong>la</strong>ce aujourd’hui. S’il est probable<br />
que <strong>la</strong> disparition du vol Rio-Paris aurait été sûrem<strong>en</strong>t<br />
perçue par les Grecs comme un châtim<strong>en</strong>t divin, il n’apparaît<br />
aujourd’hui, par l’accumu<strong>la</strong>tion du système judiciaire,<br />
que comme une conséqu<strong>en</strong>ce matérielle d’un défaut<br />
<strong>de</strong> fabrication. Un quelconque fabricant <strong>de</strong> tournevis <strong>de</strong><br />
Roubaix qui aurait mal fait son travail à un <strong>en</strong>droit clé <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> chaîne <strong>de</strong> production peut nous permettre <strong>de</strong> canaliser<br />
nos émotions <strong>en</strong> dénonçant un fautif. Si <strong>la</strong> tragédie<br />
n’est plus possible aujourd’hui, c’est que les Dieux se rem -<br />
p<strong>la</strong>c<strong>en</strong>t si facilem<strong>en</strong>t dans un quotidi<strong>en</strong> dépourvu d’ima -<br />
gination. Si l’homme sci<strong>en</strong>tifique est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u le Dieu<br />
unique, il ne nous reste que le drame psychologique.<br />
L’adaptation crimpi<strong>en</strong>ne est alors fondam<strong>en</strong>talem<strong>en</strong>t<br />
nécessaire. P<strong>en</strong>ser <strong>la</strong> tragédie aujourd’hui, c’est compr<strong>en</strong>dre<br />
ce que l’organisation du mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s hommes et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>en</strong>sée est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ue. Et ce que le théâtre, aussi, est<br />
<strong>de</strong>v<strong>en</strong>u. « Nous avons beau trouver admirables les statues<br />
<strong>de</strong>s dieux grecs, nous ne plions plus les g<strong>en</strong>oux », disait<br />
déjà Hegel.
Dans le écit qu’elle fait <strong>de</strong> sa r<strong>en</strong>contre avec Robert,<br />
Amelia souligne le rapport <strong>de</strong> soumission du corps <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> femme qu’elle projette dans sa vision sexuelle. « Ces<br />
choses » que Robert att<strong>en</strong>dait, elle les a faites. Comme si<br />
c’était naturel… Notons qu’elle a déjà évoqué une sexualité<br />
avec Jonathan et que son histoire avec Richard est<br />
aussi ambiguë. Ce rapport qu’Amelia a avec <strong>la</strong> sexualité<br />
est annoncé dès <strong>la</strong> tira<strong>de</strong> d’ouverture et son refus <strong>de</strong><br />
l’appel<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> « victime ». Aussi perçoit-elle sa sexualité<br />
affirmée non pas comme une soumission mais pa -<br />
radoxalem<strong>en</strong>t comme une acceptation <strong>de</strong> sa nature. Les<br />
femmes refusant cette position <strong>de</strong> soumission <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>drai<strong>en</strong>t<br />
alors <strong>de</strong>s « victimes ».<br />
Ensuite, ce que nous appr<strong>en</strong>d et confirme ce passage<br />
est simple : Amelia n’est pas une femme fidèle. Juste -<br />
m<strong>en</strong>t parce que ce n’est pas une victime. Nous savons<br />
déjà qu’elle p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> « vérité » au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> tout. Chez<br />
Sophocle, c’est l’infidélité <strong>de</strong>s hommes qui était soulignée.<br />
Si Amelia se rapprochait <strong>de</strong> Marie-Antoinette, elle<br />
ti<strong>en</strong>t aussi <strong>de</strong> Déjanire quelques rel<strong>en</strong>ts d’Anne Sinc<strong>la</strong>ir.<br />
L’héroïne tragique par<strong>la</strong>nt ainsi <strong>de</strong> l’infidélité <strong>de</strong> son<br />
mari : « si souv<strong>en</strong>t repris <strong>de</strong> ce mal ». Crimp ajoute donc<br />
l’infidélité <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme à <strong>la</strong> trame dramaturgique <strong>de</strong> sa<br />
pièce : ce qui rec<strong>en</strong>tre <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> sexualité et <strong>de</strong><br />
l’amour autour du personnage d’Amelia pour lui faire<br />
gagner <strong>en</strong> richesse et <strong>en</strong> ambiguïté. Dans tous les cas,<br />
pour ces femmes, l’infidélité ne compte pas. C’est <strong>la</strong> victimisation<br />
et le m<strong>en</strong>songe qui les perturb<strong>en</strong>t.<br />
LE PHILTRE D’AMOUR<br />
Dans Les Trachini<strong>en</strong>nes, Déjanire parle d’abord au chœur<br />
<strong>de</strong> ce philtre d’amour. De <strong>la</strong> même manière, par transpo -<br />
sition, c’est aux domestiques qu’Amelia l’évoque d’abord.<br />
La différ<strong>en</strong>ce fondam<strong>en</strong>tale dans l’évocation du mystérieux<br />
remè<strong>de</strong> est résumée dans cette phrase <strong>de</strong> Déjanire:<br />
« J’espère pour ma part que ce projet n’est pas déraison -<br />
nable ». D’un côté, nous avons une Déjanire doutant <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> nature même <strong>de</strong> ce qu’elle a <strong>en</strong>tre les mains alors que<br />
le chœur lui propose d’essayer, <strong>la</strong> convainquant grossièrem<strong>en</strong>t<br />
que c’est un véritable philtre. De l’autre côté,<br />
Amelia ne se pose aucun doute, elle est persuadée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
nature du cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiole alors que les gouvernantes<br />
n’y croi<strong>en</strong>t pas : « ce n’est probablem<strong>en</strong>t que <strong>de</strong> l’eau ». La<br />
question qui <strong>de</strong>meure évi<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t, et que l’échange<br />
<strong>de</strong>s doutes souligne, tourne autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance<br />
d’Amelia à propos <strong>de</strong> ce poison. Croit-elle vraim<strong>en</strong>t au<br />
philtre d’amour ? Ou, peut-être, est-ce une v<strong>en</strong>geance<br />
inconsci<strong>en</strong>te ?<br />
L’échange <strong>de</strong>s rôles qu’opère Crimp dans T<strong>en</strong>dre et Cruel<br />
par rapport aux Trachini<strong>en</strong>nes ne s’arrête pas à ce doute<br />
concernant le philtre, il s’ét<strong>en</strong>d sur toute <strong>la</strong> pièce pour<br />
rec<strong>en</strong>trer les <strong>en</strong>jeux contemporains mis <strong>en</strong> valeur. Ainsi,<br />
18<br />
Robert, le militant gauchiste propose à Amelia un philtre<br />
qui ôte « à un soldat l’<strong>en</strong>vie <strong>de</strong> se battre <strong>en</strong> faisant <strong>la</strong>nguir<br />
ce soldat après un <strong>en</strong>droit sûr […] un besoin d’amour<br />
et <strong>de</strong> réconfort » (p. 52). Ce m<strong>en</strong>songe sert Robert dans<br />
sa mission politique puisque, sachant qu’elle va l’utiliser<br />
pour son mari, l’activiste tuera le colon impérialiste.<br />
Si le c<strong>en</strong>taure propose à Déjanire une potion qui fera<br />
qu’Héraclès ne « pourra (lui) préférer aucune autre<br />
femme » (59), c’est pour une v<strong>en</strong>geance personnelle :<br />
Héraclès l’a tué, il le tue à son tour. Chez Crimp, <strong>la</strong> v<strong>en</strong>geance<br />
personnelle et mythique (les oracles l’avai<strong>en</strong>t pré -<br />
dite) <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie se transforme <strong>en</strong> acte politique. On<br />
retrouve cette adaptation <strong>de</strong> <strong>la</strong> v<strong>en</strong>geance personnelle<br />
vers le politique dans le précéd<strong>en</strong>t discours <strong>de</strong> Lichas/<br />
Jonathan : Héraclès attaque <strong>la</strong> cité pour se v<strong>en</strong>ger personnellem<strong>en</strong>t<br />
d’une humiliation subie (voir l’histoire<br />
d’Héraclès travesti <strong>en</strong> femme et gardé aux pieds d’Om -<br />
phale). Le général, quant à lui, n’attaque pas <strong>la</strong> cité pour<br />
une inclination <strong>de</strong> v<strong>en</strong>geance personnelle, mais dans le<br />
but, officiellem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> sûr, d’éradiquer le terrorisme, geste<br />
a priori <strong>de</strong> nature politique. Les complots et les intri gues<br />
que noue une tragédie antique autour d’une v<strong>en</strong>geance<br />
personnelle serai<strong>en</strong>t alors, transposés dans notre mon<strong>de</strong>,<br />
le véritable visage <strong>de</strong> <strong>la</strong> machine politique.<br />
UNE NOUVELLE HISTOIRE DE CHŒUR<br />
La <strong>de</strong>rnière utilisation <strong>de</strong> Billie Holyday par Crimp, <strong>en</strong><br />
rem p<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t du chœur, nous invite à une <strong>de</strong>rnière<br />
constatation. Chez Sophocle, le chœur alterne <strong>en</strong>tre naïveté<br />
(du type « vive le philtre d’amour ! ») avec <strong>de</strong>s mo -<br />
m<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> lucidité. Si Crimp transpose quelques<br />
idées cohér<strong>en</strong>tes du chœur dans <strong>la</strong> bouche <strong>de</strong>s trois<br />
domes tiques, il transfère le kitsch, <strong>la</strong> grandiloqu<strong>en</strong>ce et<br />
<strong>la</strong> naïveté <strong>de</strong>s interv<strong>en</strong>tions chantées à Billie Holyday,<br />
dont les chansons d’amour sont déjà écrites et veul<strong>en</strong>t<br />
décrire un état amoureux et sa puissance <strong>la</strong>ngoureuse.<br />
En utilisant <strong>la</strong> musique, Crimp t<strong>en</strong>te <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ser <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
du chœur, ou <strong>de</strong> ce qu’il représ<strong>en</strong>tait, aujourd’hui. On<br />
retrouve à travers <strong>la</strong> chanson et <strong>la</strong> mélodie quelque<br />
chose du quotidi<strong>en</strong> : comme ces tubes qu’on chantonne,<br />
qu’on connaît par cœur, naïfs, et qui nous donn<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
l’es pérance. Écrire une tragédie aujourd’hui nous permet<br />
<strong>de</strong> compr<strong>en</strong>dre l’idée du chœur et ce qu’il est c<strong>en</strong>sé<br />
vé hiculer dans le quotidi<strong>en</strong> <strong>de</strong>s hommes, et dans <strong>la</strong><br />
représ<strong>en</strong>tation qu’on <strong>en</strong> fait au théâtre. Le chœur transforme<br />
<strong>la</strong> vie humaine <strong>en</strong> chants pour l’aiguiller, comme<br />
les chansons nous accompagn<strong>en</strong>t aussi pour ori<strong>en</strong>ter<br />
nos vies.<br />
UNE ROBE BIEN MOULANTE<br />
Dans Les Trachini<strong>en</strong>nes comme dans T<strong>en</strong>dre et Cruel,<br />
Amelia/Déjanire a <strong>de</strong>s doutes sur <strong>la</strong> nature du ca<strong>de</strong>au<br />
avant même d’<strong>en</strong> savoir les conséqu<strong>en</strong>ces sur son mari.<br />
Chez Sophocle, un bout <strong>de</strong> <strong>la</strong>ine brûle au contact du<br />
poison, chez Crimp, un <strong>de</strong>s <strong>en</strong>fants cesse <strong>de</strong> respirer au<br />
contact du tiroir le cont<strong>en</strong>ant. En tout cas, <strong>la</strong> sincérité<br />
du ca<strong>de</strong>au est remise <strong>en</strong> question, Robert utilise Amelia<br />
pour sa cause politique et considère le Général, à son tour,<br />
comme un singe <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire. De <strong>la</strong> même manière, le<br />
C<strong>en</strong>taure se v<strong>en</strong>ge.<br />
La <strong>de</strong>scription que fait Sophocle <strong>de</strong> <strong>la</strong> tunique empoison -<br />
née (64) trouve un étrange écho dans T<strong>en</strong>dre et Cruel.<br />
En effet, dans le texte grec il est question <strong>de</strong> « <strong>la</strong> tunique<br />
alors qui colle à ses f<strong>la</strong>ncs et s’ajuste ». Par un dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t,<br />
au s<strong>en</strong>s presque freudi<strong>en</strong> du terme, Crimp s’attar<strong>de</strong> beaucoup<br />
sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> <strong>la</strong> robe très « mou<strong>la</strong>nte »<br />
d’Amelia (p. 64). Par <strong>la</strong> symbolique <strong>de</strong> cette robe se trans -<br />
fère, grâce à notre imaginaire, tout un pan <strong>de</strong> <strong>la</strong> matérialisation<br />
du supplice du général : d’où l’importance <strong>de</strong><br />
ce costume.<br />
Comme chez Sophocle, c’est par l’intermédiaire <strong>de</strong> James<br />
que nous appr<strong>en</strong>ons que le ca<strong>de</strong>au était bi<strong>en</strong> empoisonné.<br />
Dans un style et une scène purem<strong>en</strong>t crimpi<strong>en</strong>s,<br />
James accuse sa mère (p. 66). Mais si Déjanire pleure tout<br />
<strong>de</strong> suite le sort <strong>de</strong> son mari, Amelia reste un temps dans<br />
le déni. Déni que Crimp souligne par les interruptions<br />
répétées d’Amelia et <strong>de</strong> vagues sujets <strong>de</strong> discussions<br />
touristiques. L’auteur ang<strong>la</strong>is redistribue aussi les rôles<br />
et divise le grand discours <strong>de</strong> <strong>la</strong> nourrice chez Sophocle<br />
19<br />
<strong>en</strong>tre les domestiques, Lae<strong>la</strong> et Amelia elle-même.<br />
Encore une fois, il ajoute à Sophocle ces r<strong>en</strong>contres que<br />
<strong>la</strong> tragédie omettait volontairem<strong>en</strong>t. Il termine même <strong>la</strong><br />
vie d’Amelia sur un dialogue avec Lae<strong>la</strong>. Sa tira<strong>de</strong> sur<br />
l’aéroport, <strong>la</strong> pointe et les rayons X intègre et dép<strong>la</strong>ce<br />
métaphoriquem<strong>en</strong>t, comme souv<strong>en</strong>t dans l’adaptation,<br />
<strong>de</strong>s images <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes. Par exemple, <strong>la</strong> nourrice<br />
avait révélé chez Sophocle, dans <strong>la</strong> narration du suici<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Déjanire : ce « f<strong>la</strong>nc transpercé » par une pointe, et<br />
que les Dieux voi<strong>en</strong>t. Nos rayons X mo<strong>de</strong>rnes nous permett<strong>en</strong>t,<br />
à l’image <strong>de</strong>s Dieux ou du chœur, <strong>de</strong> savoir ce<br />
qu’il y a vraim<strong>en</strong>t dans le cœur <strong>de</strong>s g<strong>en</strong>s… C’est-à-dire<br />
une pointe pour Amelia…<br />
Dans son cœur trône <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> ne jamais être une vic -<br />
time. Elle m<strong>en</strong>tirait aux douaniers <strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s : oui, elle a<br />
« volontairem<strong>en</strong>t » dissimulé cette pointe. Amelia a natu -<br />
rellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> elle cette alliance <strong>en</strong>tre viol<strong>en</strong>ce et amour, ce<br />
poignard près du cœur. En faisant son ca<strong>de</strong>au d’amour,<br />
elle offre <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>ce. La tira<strong>de</strong> sur l’aéroport fait d’elle<br />
une terroriste <strong>de</strong> l’amour, c’est un soldat : plein d’amour<br />
<strong>de</strong>structeur malgré elle. Est-elle prête à accepter le rôle<br />
<strong>de</strong> meurtrière <strong>de</strong> son mari pour ne pas être considérée<br />
comme <strong>la</strong> victime <strong>de</strong> Robert ? Peut-être irait-elle jusqu’à<br />
avouer avoir consciemm<strong>en</strong>t tué son mari, si ce<strong>la</strong> lui évite<br />
l’appel<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> victime. Se suici<strong>de</strong>-t-elle par tristesse ?<br />
Ou, justem<strong>en</strong>t, parce qu’elle a été, malgré elle, victime <strong>de</strong><br />
cette machination qui a tué le général ?
UN MOIS PLUS TARD…<br />
Quand <strong>la</strong> gouvernante résume <strong>en</strong> une liste les objets<br />
tâchés <strong>de</strong> sang par Amelia, le récit n’a ri<strong>en</strong> d’empathique<br />
contrairem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> tira<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> nourrice chez Sophocle.<br />
Dans <strong>la</strong> pièce <strong>de</strong> Crimp, globalem<strong>en</strong>t, les personnages<br />
sont beaucoup moins touchés par les événem<strong>en</strong>ts. Dans<br />
T<strong>en</strong>dre et Cruel, il y a bi<strong>en</strong> un recul et un détachem<strong>en</strong>t,<br />
pour ne pas dire un second <strong>de</strong>gré.<br />
La v<strong>en</strong>ue du Général est, chez Sophocle, annoncée par le<br />
chœur. Dans une parfaite cohér<strong>en</strong>ce analogique Crimp<br />
donne au Général une première réplique qui repr<strong>en</strong>d un<br />
texte <strong>de</strong> Billie Hollyday. La gran<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnité qu’apporte<br />
T<strong>en</strong>dre et Cruel à <strong>la</strong> souffrance du Général est à propos <strong>de</strong><br />
sa santé m<strong>en</strong>tale. Si <strong>la</strong> souffrance d’Héraclès était physique,<br />
celle du Général est c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t, et principalem<strong>en</strong>t,<br />
psychique. Chez Sophocle, Héraclès <strong>de</strong>man<strong>de</strong> où est<br />
Déjanire, alors qu’elle est morte. Mais il n’est pas au<br />
courant <strong>de</strong> son suici<strong>de</strong> alors que, chez Crimp, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière<br />
partie se passe un mois plus tard. Ainsi, par cette transposition<br />
temporelle, le Général ne peut qu’être fou <strong>en</strong><br />
<strong>de</strong>mandant Amelia alors qu’il a assisté à son <strong>en</strong>terrem<strong>en</strong>t.<br />
Pour souligner cette torture m<strong>en</strong>tale que subit le Général,<br />
Crimp y ajoute un versant politique. Le Général est<br />
condamné pour ses actes quand personne ne remet les<br />
massacres d’Héraclès <strong>en</strong> question. C’est l’époque qui<br />
veut ça.<br />
Si l’opinion publique dénonce c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t les exactions du<br />
général, celui-ci, comme Héraclès, ne regrette absolum<strong>en</strong>t<br />
pas ses actes. Déjà, chez Sophocle, le guerrier se vante<br />
d’avoir « purgé les mers et les forêts » (72). On retrouve<br />
cette caractéristique <strong>de</strong> purge chez le général qui a « éra -<br />
diqué le terrorisme ». La question qu’on peut alors se poser<br />
tourne autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> position d’Héraclès : était-il un personnage<br />
aussi négatif pour les Grecs? Était-ce cette brute<br />
sanguinaire que représ<strong>en</strong>te le général ? Et quelle idée<br />
Crimp a-t-il <strong>de</strong> ce héros mythique pour le transformer<br />
<strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s ? Peut-être veut-il nous montrer que les idoles<br />
20<br />
et les héros ne sont que <strong>de</strong>s meurtriers… En tout cas, les<br />
héros mythiques sont bel et bi<strong>en</strong> remp<strong>la</strong>cés par <strong>de</strong>s<br />
militaires sanguinaires. On peut aussi p<strong>en</strong>ser à l’affirmation<br />
<strong>de</strong> Brecht dans La Vie <strong>de</strong> Galilée : « Malheureux<br />
le pays qui a besoin <strong>de</strong> héros ». La nouvelle question que<br />
pose alors cette adaptation est <strong>la</strong> suivante : qui sont<br />
vraim<strong>en</strong>t nos héros ?<br />
En disant avoir « vaincu le lion <strong>de</strong> Némée », le général<br />
(et Crimp) repr<strong>en</strong>d un <strong>de</strong>s travaux d’Héraclès. Cette citation<br />
pure ne se cont<strong>en</strong>te pas d’offrir un lyrisme aux propos<br />
du général, elle souligne <strong>en</strong>core plus sa folie, folie du<br />
guerrier mo<strong>de</strong>rne qui se pr<strong>en</strong>d pour un héros grec. La<br />
gran<strong>de</strong> tira<strong>de</strong> d’Héraclès à propos <strong>de</strong> sa douleur physique<br />
ne conti<strong>en</strong>t, quant à elle, aucune allusion à un quelconque<br />
dé lire. Le héros pardonne même à Déjanire, il <strong>la</strong> compr<strong>en</strong>d,<br />
ce qui n’existe pas du tout chez Crimp. De même,<br />
James ne déf<strong>en</strong>d pas vraim<strong>en</strong>t sa mère à <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce<br />
d’Hyllos. Écrire une tragédie mo<strong>de</strong>rne nécessite, comme<br />
le remarque Racine dans sa préface <strong>de</strong> Phèdre, <strong>de</strong>s personnages<br />
ni tout à fait coupables, ni tout à fait innoc<strong>en</strong>ts.<br />
La tragédie mo<strong>de</strong>rne peut apporter une nuance<br />
importante à <strong>la</strong> radicalité <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie antique. De <strong>la</strong><br />
même manière que Crimp évacue les Dieux <strong>de</strong> l’histoire<br />
<strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes, il sort les personnages du temps du<br />
<strong>de</strong>stin. Pour repr<strong>en</strong>dre Lacan, à notre époque, « nous<br />
sommes chargés d’un malheur plus grand <strong>en</strong>core <strong>de</strong> ce que<br />
ce <strong>de</strong>stin ne soit plus ri<strong>en</strong> ». Seule règne <strong>la</strong> conting<strong>en</strong>ce.<br />
Héraclès <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à son fils <strong>de</strong> le sacrifier sur le mont<br />
Œta, « sacrifice » qui résonne dans les <strong>de</strong>rniers mots du<br />
général. Mais, pour lui, ce sera <strong>de</strong>vant le tribunal qu’il<br />
oservira <strong>de</strong> « victime ». Contrairem<strong>en</strong>t à Sophocle, James<br />
refuse <strong>de</strong> faire mourir son père, il refuse sa <strong>de</strong>rnière vo -<br />
lonté au nom d’un concept, qu’il croit plus universel, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> justice. De <strong>la</strong> même manière, James refuse <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre<br />
Lae<strong>la</strong> comme femme alors qu’Hyllos, malgré certaines<br />
rétic<strong>en</strong>ces, accepte d’épouser <strong>la</strong> captive. En effet, <strong>la</strong> peur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> v<strong>en</strong>geance <strong>de</strong>s Dieux est trop forte pour que le fils<br />
ne cè<strong>de</strong> pas aux <strong>de</strong>rnières volontés <strong>de</strong> son père. Jusquelà,<br />
<strong>la</strong> prophétie avait raison : Héraclès cè<strong>de</strong> bi<strong>en</strong> à une<br />
mort vivante offerte <strong>de</strong> <strong>la</strong> main d’un mort. Si les oracles<br />
et les Dieux changeai<strong>en</strong>t le cours <strong>de</strong>s choses, sans ces <strong>de</strong>r -<br />
niers, James peut refuser et agir selon ses inclinations et ses<br />
valeurs. T<strong>en</strong>dre et Cruel est une tragédie sans les Dieux,<br />
c’est-à-dire une tragédie où les hommes et les fem mes<br />
sont livrés à eux-mêmes. Peut-on voir alors, dans l’exercice<br />
<strong>de</strong> l’adaptation et <strong>de</strong> <strong>la</strong> réécriture, une t<strong>en</strong> tative <strong>de</strong><br />
dévoiler au grand jour <strong>la</strong> vérité, ce qui s’est réel lem<strong>en</strong>t<br />
passé ? Sauf si <strong>la</strong> liberté prise par rapport au <strong>de</strong>stin n’est<br />
qu’une nouvelle illusion qui ronge les personnages…<br />
par François Regnault et Clém<strong>en</strong>t Mercier<br />
MARTIN CRIMP<br />
Martin Crimp est né <strong>en</strong> 1956 dans le K<strong>en</strong>t. Il comm<strong>en</strong>ce à<br />
s’intéresser au théâtre p<strong>en</strong>dant ses étu<strong>de</strong>s à Cambridge et<br />
écrit C<strong>la</strong>ng, une pièce sur <strong>la</strong> manière dont les désordres psychologiques<br />
influ<strong>en</strong>t sur le <strong>la</strong>ngage.<br />
P<strong>en</strong>dant les premières an nées qui suiv<strong>en</strong>t l’obt<strong>en</strong>tion <strong>de</strong><br />
son diplôme, il se consacre à une carrière d’écrivain peu<br />
couronnée <strong>de</strong> succès (il écrit <strong>de</strong>ux romans qui ne trouv<strong>en</strong>t<br />
pas d’éditeur) et pour réussir à vivre accumule les petits<br />
boulots que l’on retrouvera <strong>en</strong>suite au fil <strong>de</strong> ses pièces<br />
(sondages marketing dans <strong>la</strong> rue, travailleur <strong>en</strong> usine…).<br />
Il est égalem<strong>en</strong>t musici<strong>en</strong> professionnel (piano, c<strong>la</strong>vecin) ce<br />
qui influ<strong>en</strong>ce considérablem<strong>en</strong>t sa vision du texte comme<br />
d’une partition où les pauses et les rythmes doiv<strong>en</strong>t être scru -<br />
puleusem<strong>en</strong>t respectés.<br />
Ses premières pièces sont produites et montées par l’Orange<br />
Tree Theatre à Richmond, dans <strong>la</strong> banlieue londoni<strong>en</strong>ne<br />
où il habite, et comport<strong>en</strong>t : Living Remains (1982), Four<br />
Attempted Acts (1984), Definitely the Bahamas (1987),<br />
Dealing With C<strong>la</strong>ir (1998), P<strong>la</strong>y With Repeats (1989). Bi<strong>en</strong><br />
que se prés<strong>en</strong>tant sous <strong>de</strong>s formes différ<strong>en</strong>tes, très influ<strong>en</strong>cées<br />
par Beckett pour les premières puis davantage par Pinter<br />
ou Carol Churchill, ses pièces trait<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s thèmes récurr<strong>en</strong>ts<br />
parmi lesquels les rapports conjugaux, l’ambival<strong>en</strong>ce du<br />
statut <strong>de</strong> bourreau ou <strong>de</strong> victime, et l’exploitation <strong>de</strong> l’être<br />
humain par ses pairs ou par son époque dominée par <strong>la</strong><br />
technique, occup<strong>en</strong>t une <strong>la</strong>rge p<strong>la</strong>ce.<br />
21<br />
Pourtant Crimp n’est pas, comme ont pu le croire au départ<br />
les critiques, un a<strong>de</strong>pte du réalisme trash britannique (Kitch<strong>en</strong><br />
sink drama), ni <strong>de</strong> l’ultra viol<strong>en</strong>ce poético-politique <strong>de</strong> l’In-<br />
Yer-Face Theatre. Il constitue un auteur à part sur <strong>la</strong> scène<br />
ang<strong>la</strong>ise, au s<strong>en</strong>s où ses intérêts et ses référ<strong>en</strong>ces sont ce que<br />
ses compatriotes appellerai<strong>en</strong>t « contin<strong>en</strong>taux » ou « europé<strong>en</strong>s<br />
». Il avoue une passion pour Marguerite Duras, traduit<br />
Koltès, Molière, G<strong>en</strong>et. Depuis Cambridge, il lit le <strong>la</strong>tin<br />
et le grec, ce qui veut dire qu’il dévore les tragédies an -<br />
tiques. De ces lectures, naîtra T<strong>en</strong>dre et Cruel, sa réécriture<br />
<strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes <strong>de</strong> Sophocle.<br />
Dans les années 90, ses pièces comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à être connues<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s frontières britanniques.<br />
En 1991, il effectue une résid<strong>en</strong>ce à New York durant <strong>la</strong> -<br />
quelle il écrit Le Traitem<strong>en</strong>t, qui est c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t un hommage<br />
à l’esthétique du cinéma américain <strong>en</strong> même temps qu’une<br />
viol<strong>en</strong>te critique <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière dont celui-ci utilise les g<strong>en</strong>s<br />
et falsifie leurs histoires personnelles.<br />
Il <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t par <strong>la</strong> suite artiste associé au Royal Court, à<br />
Londres, et écrit notamm<strong>en</strong>t Personne ne voit <strong>la</strong> vidéo,<br />
(1990), Getting Att<strong>en</strong>tion (1991), Atteintes à sa vie (1997), La<br />
campagne (2000), Face au mur (mars 2002), T<strong>en</strong>dre et Cruel<br />
(2004). Malgré <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong>s productions <strong>de</strong> celles-ci, il<br />
continue à être un quasi-inconnu <strong>en</strong> Angleterre. En<br />
revanche, le reste <strong>de</strong> l’Europe s’intéresse beaucoup à ses<br />
pièces. Elles reti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t notamm<strong>en</strong>t l’att<strong>en</strong>tion à Mi<strong>la</strong>n, où<br />
elles sont inscrites au répertoire du Piccolo Teatro, à<br />
Lisbonne, à Bruxelles, à Berlin et à Paris sous <strong>la</strong> direction<br />
<strong>de</strong> Luc Bondy, Stanis<strong>la</strong>s Nor<strong>de</strong>y ou Joël Jouanneau.
BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN LES COMÉDIENS<br />
Brigitte Jaques-Wajeman<br />
crée L’Éveil du printemps<br />
<strong>de</strong> We<strong>de</strong>kind au Festival<br />
d’Au tomne 1974.<br />
Elle fon<strong>de</strong><br />
avec François Regnault<br />
<strong>la</strong> Compagnie Pandora<br />
et dirige avec lui<br />
le <strong>Théâtre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Commune/Pandora<br />
à Aubervilliers<br />
<strong>de</strong> 1991 à 1997.<br />
C’est au début <strong>de</strong>s années 80 que Brigitte Jaques-Wajeman a inauguré son cycle cornéli<strong>en</strong>, notamm<strong>en</strong>t grâce à Jacqueline<br />
Licht<strong>en</strong>stein, professeur <strong>de</strong> Philosophie à <strong>la</strong> Sorbonne.<br />
Cycle <strong>de</strong> « Corneille colonial » : 1983 La Mort <strong>de</strong> Pompée (1983, puis <strong>en</strong> 1993-4). Sopho nisbe (1988). Suréna (1994-5)<br />
Sertorius (1996-7). Nicomè<strong>de</strong> (2008-9). Nicomè<strong>de</strong> et Suréna au <strong>Théâtre</strong> <strong>de</strong>s Abbesses ( 2011).<br />
Outre ce cycle « Corneille colonial », elle aura aussi mis <strong>en</strong> scène, <strong>de</strong> Corneille : Horace (Chaillot, 1989), La P<strong>la</strong>ce royale<br />
(<strong>Théâtre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commune/Pandora 1992, reprise <strong>en</strong> 1993), L’Illusion comique (Comédie <strong>de</strong> G<strong>en</strong>ève, <strong>Théâtre</strong> <strong>de</strong> G<strong>en</strong> -<br />
nevilliers, 2004), Le Cid (Comédie-Française, 2005, reprise 2006). Au <strong>Théâtre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commune Pandora d’Aubervillers,<br />
qu’elle dirigeait, elle avait mis <strong>en</strong> scène <strong>en</strong> 1992 (repris <strong>en</strong> 1995) <strong>de</strong>s Entreti<strong>en</strong>s avec Pierre Cor neille, composés par elle<br />
et Jacqueline Licht<strong>en</strong>stein à partir <strong>de</strong>s Discours, avertissem<strong>en</strong>ts et Préfaces <strong>de</strong> Corneille, et interprétés par François Regnault<br />
(Corneille) et Emmanuel Demarcy-Mota (un jeune visiteur).<br />
Tournée mondiale d’Elvire Jouvet 40 (Leçons <strong>de</strong> Jouvet sur l’Elvire du Dom Juan, 1986). L’Imposture, d’après Bernanos<br />
(<strong>Théâtre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Ville</strong>, 1989), Partage <strong>de</strong> midi <strong>de</strong> C<strong>la</strong>u<strong>de</strong>l (1990).<br />
À LA COMÉDIE-FRANÇAISE, ELLE A MONTÉ : La Nuit <strong>de</strong> l’iguane <strong>de</strong> T<strong>en</strong>nessee Williams, Ruy B<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Victor Hugo,<br />
Britannicus <strong>de</strong> Racine, Le Cid <strong>de</strong> Corneille (2005-6).<br />
ET AILLEURS : Mme Klein <strong>de</strong> Nicho<strong>la</strong>s Wright, Angels in America <strong>de</strong> Tony Kushner. Dom Juan (1998), Tartuffe (2009) <strong>de</strong><br />
Molière.<br />
OPÉRAS : Don Giovanni <strong>de</strong> Mozart (Toulouse).<br />
OPÉRAS CONTEMPORAINS (Ligeti, Georges Aperghis, M.-O. Dupin).<br />
22<br />
Pascal BEKKAR<br />
Formé auprès <strong>de</strong> Jacques Fontaine, Pierre Debauche, il travaille<br />
sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> JL Thamin dans Les Nègres et les<br />
Bonnes <strong>de</strong> J. G<strong>en</strong>et, <strong>de</strong> V. Colin dans une adaptation <strong>de</strong> Can -<br />
di<strong>de</strong> <strong>de</strong> Voltaire et <strong>de</strong>s Mariés <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tour Eiffel <strong>de</strong> J. Cocteau.<br />
Il r<strong>en</strong>contre Brigitte Jaques-Wajeman sur <strong>la</strong> création du Don<br />
Juan <strong>de</strong> Molière et <strong>de</strong>puis participe et col<strong>la</strong>bore à <strong>de</strong> nombreuses<br />
créations <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cie Pandora: La Marmite et Pseudolus<br />
<strong>de</strong> P<strong>la</strong>ute, L’Illusion Comique, Le Cid, Nicomè<strong>de</strong>, Suréna, <strong>de</strong><br />
Corneille.<br />
Sophie DAULL,<br />
Elle a travaillé <strong>en</strong>tre autres avec Hubert Co<strong>la</strong>s, Stéphane<br />
Braun schweig, A<strong>la</strong>in Ollivier, Jacques Lassalle, Odile Duboc,<br />
Jean Gaudin…. Elle col<strong>la</strong>bore à toutes les créations <strong>de</strong> l’auteure-<br />
metteuse <strong>en</strong> scène Carole Thibaut, et <strong>en</strong>registre régulièrem<strong>en</strong>t<br />
pour France-Culture. T<strong>en</strong>dre et Cruel est sa 5 e col -<br />
<strong>la</strong>boration avec Brigitte Jaques-Wajeman<br />
Anne LE GUERNEC<br />
Élève <strong>de</strong> Ma<strong>de</strong>leine Marion, elle comm<strong>en</strong>ce sa carrière <strong>de</strong><br />
comédi<strong>en</strong>ne au théâtre avec Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Buchard, Stéphanie<br />
Loïk, Jeanne Moreau, Margarita M<strong>la</strong>d<strong>en</strong>ova et Ivan Dob -<br />
tchev, A-L Liégeois… Elle joue plusieurs spectacles mis <strong>en</strong><br />
scène par Guy Pierre Couleau. Au cinéma, elle tourne avec<br />
S. Gainsbourg, Peter Werner, Jean Becker. Récemm<strong>en</strong>t, elle<br />
interprète Eléna dans Oncle Vania mis <strong>en</strong> scène par le letton,<br />
Edmunds Freibergs. Elle retrouve aujourd’hui Brigitte<br />
Jaques-Wajeman après Tartuffe <strong>de</strong> Molière <strong>en</strong> 2009.<br />
Sarah LE PICARD<br />
Formée au conservatoire du V e arrondissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> Paris, elle<br />
travaille <strong>en</strong>suite au théâtre avec Matthieu Roy (Histoire<br />
d’amour <strong>de</strong> JL Lagarce, L’amour conjugal <strong>de</strong> A. Moravia) et<br />
Brigitte Jaques-Wajeman dans Tartuffe. Elle participe à <strong>la</strong><br />
création du collectif « <strong>la</strong> vie brève », m<strong>en</strong>ée par Jeanne Can<strong>de</strong>l<br />
et à son premier spectacle Robert P<strong>la</strong>nkett. Elle joue aussi<br />
au cinéma ou à <strong>la</strong> télévision notamm<strong>en</strong>t dans G<strong>en</strong>tille <strong>de</strong><br />
Sophie Fillières, dans Le Hérisson <strong>de</strong> Mona Achache ou plus<br />
récemm<strong>en</strong>t dans Alyah d’Elie Wajeman.<br />
Arnold MENSAH,<br />
Sa formation <strong>de</strong> comédi<strong>en</strong> comm<strong>en</strong>ce réellem<strong>en</strong>t à l’âge <strong>de</strong><br />
15 ans au conservatoire <strong>de</strong> P<strong>la</strong>isir. Il fait alors une apparition<br />
dans le film Carré B<strong>la</strong>nc <strong>de</strong> Jean-Baptiste Leonetti <strong>en</strong><br />
2010. Il passe sa première audition <strong>en</strong> mai 2012 pour le<br />
double rôle d’Edu et <strong>de</strong> Io<strong>la</strong>os dans le projet <strong>de</strong> Brigitte<br />
Jaques-Wajeman. Aujourd’hui il suit <strong>de</strong>s cours au<br />
Conservatoire du XVI e arrondissem<strong>en</strong>t avec Nathalie<br />
Bécue, et achève une lic<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> Lettres Mo<strong>de</strong>rnes Parcours<br />
Étu<strong>de</strong>s Théâtrales.<br />
23<br />
Pierre-Stéfan MONTAGNIER,<br />
Il r<strong>en</strong>contre Brigitte Jaques-Wajeman lors <strong>de</strong> sa formation<br />
à l’ENSATT. T<strong>en</strong>dre et Cruel marque leur septième col<strong>la</strong>boration<br />
artistique dominée par Corneille, P<strong>la</strong>ute et Molière. Au<br />
théâtre, il a notamm<strong>en</strong>t croisé les univers d’I. Starkier, G.<br />
Bour<strong>de</strong>t, GP Couleau, C. Rauck, C. Yersin, S. Purcarete, C.<br />
Colin, B. Kud<strong>la</strong>ck, S. Tcheumlekdjian… Il est lecteur <strong>de</strong> longue<br />
date <strong>de</strong> <strong>la</strong> compagnie « La Liseuse » dirigée par Caroline<br />
Girard : un spectacle commun à partir d’une œuvre littéraire<br />
est actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> préparation<br />
J<strong>en</strong>ny MUTELA<br />
Après une formation <strong>de</strong> danseuse c<strong>la</strong>ssique au Conser va -<br />
toire national <strong>de</strong> région <strong>de</strong> Rueil-Malmaison, elle intègre<br />
différ<strong>en</strong>tes compagnies <strong>de</strong> danse contemporaine avant <strong>de</strong><br />
s’inscrire aux cours Flor<strong>en</strong>t pour suivre une formation thé -<br />
âtrale. Elle intègre <strong>en</strong>suite le conservatoire d’art dramatique<br />
<strong>de</strong> Paris. Depuis sa sortie, elle a travaillé avec J-P. W<strong>en</strong>zel,<br />
I. M<strong>en</strong>jinski, P. Piard et C. Perton. En parallèle, elle joue<br />
dans <strong>de</strong>s fictions pour <strong>la</strong> télé et le cinéma.<br />
Aurore PARIS<br />
Sortie du conservatoire national <strong>en</strong> 2008, elle travaille au<br />
théâtre sous <strong>la</strong> direction d’E. Lacasca<strong>de</strong>, L.Pogrebnitchko,<br />
B.Sobel, P.Bureau, M.Kerzanet et <strong>en</strong>fin B. Jaques-Wajeman.<br />
Elle tourne dans <strong>de</strong>s téléfilms, notamm<strong>en</strong>t L’amour dans le<br />
sang, dans lequel elle interprète le rôle <strong>de</strong> Charlotte Va<strong>la</strong>ndrey.<br />
Parallèlem<strong>en</strong>t, Aurore écrit roman, poésie, pièces <strong>de</strong> thé âtre,<br />
scénarii et réalise son premier court-métrage <strong>en</strong> 2012 : Ad<br />
Nauseam.<br />
Thibault PERRENOUD<br />
Diplômé du conservatoire national supérieur d’Art Dra -<br />
matique <strong>de</strong> Paris (2004- 2007), il a travaillé notamm<strong>en</strong>t<br />
avec D. Mesguich, B.Sobel, J.Lassalle, B.Moreau, S.Llorca,<br />
M.Boisliveau… Avec eux, il explore <strong>de</strong>s auteurs c<strong>la</strong>ssiques<br />
et contemporains comme Corneille, Molière, Kleist, Gabily,<br />
Schimmelpf<strong>en</strong>nig, Lescot… Parallèlem<strong>en</strong>t à son parcours<br />
d’acteur, il crée <strong>la</strong> Compagnie Kobal’t.<br />
T<strong>en</strong>dre et Cruel est sa 4 e col<strong>la</strong>boration avec Brigitte Jaques-<br />
Wajeman<br />
Bertrand SUAREZ-PAZOS<br />
Il a travaillé avec Coline Serreau, Nino d’Introna, Jean La cor -<br />
nerie, Richard Brunel, Stéphanie Loïk, Elisabeth Chailloux,<br />
Jean-Pierre Berthomier, Michel Belletante… Voix familière<br />
<strong>de</strong>s dramatiques <strong>de</strong> France Culture et France Inter. Il a écrit<br />
et mis <strong>en</strong> scène Derrière les murs.<br />
Prix Arthur Rimbaud pour Vers <strong>de</strong>s espoirs publié à La<br />
Maison <strong>de</strong> Poésie <strong>en</strong> 1999. Il travaille <strong>de</strong>puis <strong>de</strong> nombreuses<br />
années avec Brigitte Jaques-Wajeman.
TOURNÉE 2013<br />
31 JANVIER & 1 ER FÉVRIER<br />
L'On<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Vélizy-Vil<strong>la</strong>coub<strong>la</strong>y<br />
26 & 27 MARS<br />
Comédie <strong>de</strong> l’Est à Colmar<br />
24 MAI<br />
L’Apostrophe –<br />
<strong>Théâtre</strong> <strong>de</strong>s Louvrais –<br />
Scène nationale Cergy-Pontoise et val d’Oise<br />
RENCONTRES<br />
DIMANCHE 10 FÉVRIER 17H<br />
AU THÉÂTRE DES ABBESSES<br />
<strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce<br />
<strong>de</strong> Brigitte JAQUES-WAJEMAN<br />
& <strong>de</strong>s comédi<strong>en</strong>s<br />
SAMEDI 16 FEVRIER À 15 H<br />
À LA BIBLIOTHEQUE OSCAR WILDE<br />
12 rue du Télégraphe, Paris 20<br />
AUTOUR DE T<strong>en</strong>dre et cruel<br />
avec Brigitte JAQUES-WAJEMAN<br />
ENTRÉE LIBRE<br />
MAIS RÉSERVATION SUR INTERNET<br />
www.theatre<strong>de</strong><strong>la</strong>ville-paris.com //<br />
rubrique r<strong>en</strong>contre //<br />
cal<strong>en</strong>drier et inscriptions