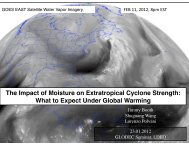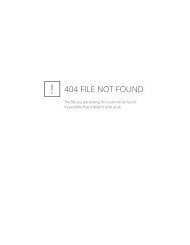Haut Atlas occidental - Columbia University
Haut Atlas occidental - Columbia University
Haut Atlas occidental - Columbia University
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
♦ 2 à 3 m d’alternances de calcaires fins, de dolomies et de marnes gypsifères<br />
♦ 1 à 1,5 m de dolomies évaporitiques et de marnes gypsifères en alternance<br />
;<br />
♦ 4 à 6 m de calcaires bioclastiques et de calcaires dolomitiques ;<br />
♦ 3 à 3,5 m de marnes et de calcaires bioclastiques ;<br />
♦ 3 m de dolomies calcaires et de marnes affectées par une dolomitisation<br />
secondaire ;<br />
♦ 3 m de calcaires bioclastiques, de dolomies calcaires et de marnes ;<br />
♦ 3-4 m de calcaires dolomitiques à bioclastes et à laminites algaires ;<br />
♦ 8-10 m de dolomies massives roses, de dolomies sableuses bioclastiques<br />
qui forment un niveau repère au sommet de la formation. Le<br />
microfaciès est celui d’une dolosparite à une dolomicrosparite bioclastique<br />
;<br />
♦ 1-2,5 m de calcaires bioclastiques riches en oursins, couronnés par une<br />
surface ferrugineuse ;<br />
♦ 3-5 m de marnes rouges et de marnes jaunes ;<br />
♦ 1,5 -2 m de calcaires dolomitiques bioturbés ;<br />
♦ 1,5-2 m d’argiles et de marnes vertes.<br />
Faciès : Dolomies sableuses (littoral proche des plages),<br />
calcaires coquilliers (infralittoral ouvert), dolomies calcaires<br />
bioclastiques (barre bioclastique infralittorale à<br />
proche du littoral), marnes vertes : infralittoral distal. Les<br />
autres faciès sont semblables à ceux rencontrés dans la formation<br />
d’Id Ou Moulid.<br />
Ces faciès suggèrent une sédimentation sur une rampe carbonatée,<br />
dans un climat chaud des zones infra- à médio- et<br />
supra-littorales et supra littorales avec la présence de rares<br />
environnements de type sebkha.<br />
Biostratigraphie : De la base au sommet, cinq biozones<br />
différentes ont été définies (fig. 1.13 ; cf. détail in<br />
Bouaouda, 2007) :<br />
0Biozone à Pseudocyclammina maynci, fin du Bajocien – milieu du Bathonien<br />
;<br />
0Biozone à Praekurnubia crusei, fini-bathonienne ;<br />
0Biozone à Megaporella boulangeri, début du Callovien ;<br />
0Biozone à Kurnubia variabilis, milieu du Callovien p.p ;<br />
0Biozone à Valvulina lugeoni / Nautiloculina sp., qui peut être attribuée<br />
à l’intervalle Callovien moyen p.p. – fin du Callovien.<br />
Remarque : Le reste de la coupe est généralement dolomitisé<br />
et ne permet pas d’identifier les deux autres biozones<br />
: Cylindroporella sp. arabica (Oxfordien inférieur)<br />
et Alveosepta jaccardi (milieu – fin de l’Oxfordien), bien<br />
définies dans le Jurassique de Mouissat (voir J3). Sur les<br />
bordures du bassin atlantique, le sommet de la Formation<br />
d’Oumssissene ne livre pas de fossiles d’affinité Kimméridgien<br />
inférieur, dont les espèces-marqueurs ont été identifiées<br />
dans les régions d’Essaouira et d’Agadir.<br />
Route : Après l’arrêt 4, nous entrons dans le couloir d’Argana<br />
(fig. 1.10). La route traverse le Membre d’Aït Hssaine<br />
(Hasseine Member des auteurs anglophones) du Norien supérieur<br />
(voir 2ème partie). A gauche apparaissent les cuestas<br />
de grès de Tadrart Ouadou (Carnien-Norien inférieur) à pendage<br />
WNW, alors qu’à droite, la corniche correspond aux<br />
CIRCUIT C11 : HAUT ATLAS OCCIDENTAL<br />
calcaires et dolomies jurassiques d’Id Ou Moulid, recouvrant<br />
quelques affleurements verdâtres de basaltes altérés.<br />
A Tazidra, on observe un bel exemple de tectonique extensive,<br />
avec la répétition des grès de Tadrart Ouadou dans une<br />
série de demi-grabens délimités par des failles à pendage est.<br />
On traverse ensuite une série épaisse de grès puis la faille<br />
WNW-ESE d’Amzri (fig. 1.10), avant de longer le contact<br />
entre la Fm d’Aït Hssaine et les formations sous-jacentes.<br />
On remarque la disparition des niveaux de grès épais et la<br />
différentiation progressive des formations du Jurassique.<br />
La région d’Aït Khattab montre le passage des faciès de bordure<br />
vers les faciès de bassin, par le biais d’une faille dirigée<br />
N120. La plupart des formations s’épaississent en<br />
direction du SW, se différenciant en 3 barres bien distinctes<br />
(cf. J2) ; de même, les coulées de basalte s’épaississent<br />
considérablement (Tixeront, 1974 ; Aït Chayeb et al., 1998).<br />
J1, deuxième partie : Le Trias du couloir<br />
d’Argana<br />
(M. Et-TOUHAMI & P.E. OLSEN)<br />
III. Le bassin triasique d’Argana<br />
De vastes bassins remplis de couches rouges silicoclastiques<br />
continentales se sont ouverts au cours du rifting de<br />
la Pangée, pendant l’intervalle Permien supérieur-Trias<br />
supérieur (fig. 1.14). Une partie seulement de ces bassins<br />
est visible en surface, le couloir d’Argana est une de ces<br />
zones d’affleurement, avec des strates particulièrement<br />
bien exposées et peu déformées, relativement riches en<br />
restes de Vertébrés (Dutuit & Heyler, 1983 ; Jalil, 1996).<br />
Les couches rouges, principalement continentales, du bassin<br />
d’Argana, sont subdivisées en quatre séquences tectono-stratigraphiques<br />
TS I à TS IV (fig. 1.15), limitées par<br />
des contacts au moins en partie discordants. Elles sont<br />
pourvues chacune d’un ensemble caractéristique de faciès<br />
et d’un style propre de cyclicité lacustre à évaporitique.<br />
La séquence tectonostratigraphique la plus ancienne (TS I)<br />
est constituée par la Formation Ikakern d’âge permien<br />
dans sa totalité suite à la découverte de restes de Paraeiosaurus<br />
(Jalil & Janvier, 2005) et à faciès à dominance fluviatile.<br />
Elle est subdivisée en deux membres (T1 et T2 de<br />
Tixeront, 1973) : Assif Aït Driss et Tourbiain (= Tourbihine).<br />
La séquence tectonostratigraphique TSII, séparée de la<br />
Formation Ikakern sous-jacente par une forte discordance<br />
locale, est constituée par la Formation de Timezgadiwine<br />
à faciès lacustres, detaïques et fluviatiles. Elle est subdivisée<br />
à son tour en trois membres : Tanameurt , Aglegal et<br />
Irohalene (T3, T4 et T5 de Tixeront, 1973). La partie médiane<br />
de la formation (base de T5), pour le moins, est franchement<br />
cyclique, montrant un motif fortement hiérarchisé<br />
avec des cycles lacustres bien développés de 20, 100, 400<br />
25