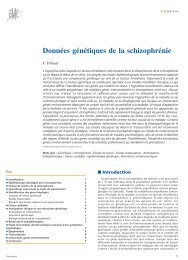Complications neurologiques liées à l'alcool - Psychologie - M ...
Complications neurologiques liées à l'alcool - Psychologie - M ...
Complications neurologiques liées à l'alcool - Psychologie - M ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Neurologie COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES LIÉES À L’ALCOOL<br />
17-161-B-10<br />
d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Elle peut avoir un aspect<br />
oppositionnel ou pseudoparkinsonien, surtout <strong>à</strong> prédominance axiale.<br />
L’hypotonie est aussi possible, mais très rare.<br />
Le réflexe cutané plantaire peut parfois être en extension, avec ou sans<br />
hyperréflexie. Des signes frontaux sont également rapportés : libération de<br />
réflexes archaïques, persévérations, stéréotypies, comportement d’utilisation.<br />
Les troubles végétatifs sont très fréquents et méritent d’être surveillés<br />
attentivement, surtout dans la phase aiguë. Ils se manifestent avant tout par<br />
une tachycardie, une hypotension et des troubles de la régulation de la<br />
température corporelle et de la sudation.<br />
En raison du caractère fluctuant de ces signes et symptômes, le diagnostic<br />
d’une encéphalopathie de Wernicke peut être difficile, surtout lorsque le<br />
tableau clinique est pauvre et monosymptomatique. Cependant, dans le doute,<br />
il ne faut <strong>à</strong> aucun prix retarder l’introduction d’un traitement vitaminé.<br />
Étiologie<br />
La cause de cette encéphalopathie est un déficit en vitamine B 1, la<br />
thiamine [19]. En effet, les cerveaux autopsiés de patients avec une<br />
encéphalopathie de Gayet-Wernicke révèlent un sévère déficit en enzymes<br />
dépendant de la thiamine [19]. De même chez l’animal, une déficience en<br />
thiamine provoque les symptômes de l’encéphalopathie de<br />
Gayet-Wernicke [81].<br />
Le déficit en thiamine est dû avant tout <strong>à</strong> son apport alimentaire insuffisant<br />
chez l’alcoolique chronique dénutri, bien que son métabolisme puisse être<br />
modifié en raison de prédispositions génétiques [14, 77]. L’éthanol interfère<br />
directement ou indirectement avec l’absorption, le stockage et l’utilisation de<br />
la thiamine. On pense que cette vitamine intervient dans le métabolisme de<br />
l’alcool au niveau de la carboxylation des corps cétoniques et de l’acide<br />
cétoglutarique, et que cette déficience causerait une augmentation de l’activité<br />
de l’alcool déshydrogénase, accélérant le métabolisme de l’alcool. Cette<br />
vitamine joue également un rôle essentiel dans le métabolisme du glucose<br />
comme cofacteur dans l’activité du shunt des pentoses. Il faut au moins un<br />
déficit de 70 % pour déclencher une encéphalopathie.<br />
Traitement<br />
Le traitement consiste en l’administration par voie veineuse de thiamine, le<br />
plus rapidement possible et avant toute injection de glucose, ce dernier<br />
pouvant précipiter l’utilisation des dernières réserves de vitamine B 1. Les<br />
besoins quotidiens recommandés sont de1<strong>à</strong>5mg/j pour un adulte avec des<br />
réserves de thiamine normales. Cela représente une protection pour une<br />
période de 18 <strong>à</strong> 35 jours environ. Chez l’alcoolique, différents régimes de<br />
supplémentation sont proposés dans la littérature, généralement entre 50 et<br />
500 mg/j, mais sans qu’il y ait de réel consensus sur la durée du traitement [24].<br />
Neuropathologie<br />
Les anomalies pathologiques sont de localisations précises et bilatérales au<br />
niveau du tronc cérébral et de l’hypothalamus [120]. La lésion caractéristique<br />
est une nécrose affectant les neurones, les axones et la myéline <strong>à</strong> des degrés<br />
divers, qui s’étend dans la substance grise autour du IIIe ventricule, l’aqueduc<br />
de Sylvius et le IVe ventricule. Les corps mamillaires sont toujours lésés et<br />
d’autres structures peuvent également être atteintes comme le thalamus,<br />
l’hypothalamus, la région périaqueducale mésencéphalique, le plancher du<br />
IVe ventricule et le vermis.<br />
Bien que les corps mamillaires, l’hypothalamus et la partie médiane du<br />
thalamus soient touchés dans l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke, la<br />
controverse subsiste concernant la lésion responsable de l’amnésie. Se basant<br />
sur les résultats d’autopsies de 43 cerveaux, Victor et al estiment que l’atteinte<br />
du noyau dorsomédian du thalamus est essentielle pour déclencher les<br />
troubles mnésiques [120]. Cependant, il n’a jamais était rapporté de syndrome<br />
de Korsakoff lié <strong>à</strong> une lésion isolée de ce noyau thalamique. C’est pourquoi il<br />
est généralement admis que les troubles mnésiques sont produits par l’atteinte<br />
combinée des corps mamillaires et du thalamus [75, 79]. Selon d’autres études<br />
neuropathologiques, les troubles mnésiques pourraient être provoqués par<br />
l’atteinte du diencéphale et de l’hippocampe [4, 79, 120]. Mais les lésions <strong>à</strong> ce<br />
niveau ne sont pas constantes ; elles pourraient aussi expliquer les troubles du<br />
comportement.<br />
Les études neuroradiologiques ont confirmé la présence de lésions du<br />
diencéphale dans le syndrome de Wernicke-Korsakoff et ont permis de révéler<br />
aussi une atteinte corticale au niveau des lobes frontaux et pariétaux, sous la<br />
forme d’une atrophie [23, 58, 105, 108].<br />
Syndrome de Korsakoff<br />
C’est la forme chronique de l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Elle se<br />
caractérise par un syndrome amnésique avec préservation relative des<br />
fonctions cognitives [57, 107]. Les patients sont totalement incapables<br />
d’enregistrer une information verbale ou non verbale, d’apprendre les noms<br />
des personnes, les nouveaux faits, même après répétition et oublient les<br />
informations fournies quelques minutes auparavant. Mais, en fait, il ne s’agit<br />
pas d’une perturbation de l’enregistrement immédiat des informations,<br />
puisque les patients sont capables de répéter les informations immédiatement.<br />
En revanche, si une tâche distrayante est effectuée pendant quelques<br />
secondes, les performances vont nettement diminuer. Ainsi, cette sensibilité<br />
accrue aux interférences est considérée comme la caractéristique de l’amnésie<br />
antérograde du syndrome de Korsakoff. Cela suggère que les interférences<br />
surviennent parce que le patient est incapable d’inhiber les informations<br />
distrayantes au moment de la récupération d’une information précise.<br />
Certains auteurs pensent que ce syndrome amnésique est dû <strong>à</strong> des difficultés<br />
<strong>à</strong> coder les attributs d’un stimulus. Les patients analyseraient les signes<br />
phonémiques et associatifs, mais négligeraient les signes sémantiques.<br />
Malgré les sévères déficits dans l’apprentissage, certaines zones de la<br />
mémoire sont préservées et notamment celle pour l’acquisition de nouvelles<br />
tâches motrices.<br />
Les patients souffrant d’un syndrome de Korsakoff ont également une atteinte<br />
de la mémoire rétrograde, avec une altération de la capacité <strong>à</strong> retrouver les<br />
faits autobiographiques ou publics, surtout du passé récent.<br />
Maladie de Marchiafava-Bignami<br />
Décrite pour la première fois en 1903 chez des buveurs de vin italiens, cette<br />
maladie est actuellement connue chez des gens de toutes nationalités<br />
consommant n’importe quelle boisson alcoolisée. Son mécanisme demeure<br />
encore inconnu, mais il entraîne une démyélinisation progressive avec<br />
nécrose de la partie médiane du corps calleux et de la commissure<br />
antérieure [3, 119]. Parfois les lésions peuvent s’étendre latéralement dans le<br />
centre semi-ovale, tout en respectant la capsule interne et le pied de la corona<br />
radiata, et également les fibres en U. L’aspect histologique est similaire <strong>à</strong> celui<br />
de la myélinolyse centropontine et comme ces deux maladies peuvent<br />
survenir chez le même patient, on suspecte un même mécanisme<br />
étiopathogénique [48].<br />
La plupart des patients souffrant de cette maladie sont alcooliques, dénutris<br />
ou souffrant d’une atteinte hépatique. Toutefois, elle peut survenir également<br />
lors d’intoxication aux cyanures et même en l’absence d’alcoolisme [63].<br />
Le début de la maladie peut être aigu, sous la forme d’un coma avec des crises<br />
d’épilepsie. Généralement, on remarque une sévère hypertonie avec un<br />
mutisme akinétique. Les formes lentement progressives arrivent au même<br />
tableau clinique entrecoupé d’épisodes évolutifs avec confusion, crise<br />
d’épilepsie et l’installation d’une hypertonie de plus en plus marquée<br />
conduisant <strong>à</strong> un état grabataire. Selon Boudin et al, le tableau clinique<br />
caractéristique comporterait une démence, une hypertonie, une astasie-abasie<br />
et une dysarthrie [16]. L’examen neuropsychologique permet de mettre en<br />
évidence des signes de dysconnexion calleuse : apraxie unilatérale, anosmie,<br />
dysconnexion auditive et visuelle. La résonance magnétique permet de<br />
confirmer le diagnostic par la mise en évidence de la démyélinisation du corps<br />
calleux. L’évolution se fait sur3<strong>à</strong>4ansenviron, mais des améliorations, tant<br />
cliniques que radiologiques, sont également rapportées [27, 82, 85, 131].<br />
Myélinolyse centropontine<br />
C’est une complication neurologique rare mais grave, principalement liée aux<br />
désordres électrolytiques (hyponatrémie) et <strong>à</strong> leur correction trop rapide [65].<br />
D’abord décrite chez l’alcoolique dénutri, elle peut se manifester en cas de<br />
cancer, d’hémopathie maligne, d’insuffisance rénale ou hépatique.<br />
Il s’agit d’une démyélinisation pure affectant principalement la protubérance,<br />
mais qui peut s’étendre <strong>à</strong> la substance blanche sous-corticale [17]. Beaucoup<br />
de formes sont asymptomatiques et sont découvertes lors d’une autopsie.<br />
Dans les formes symptomatiques, les patients présentent un syndrome<br />
pseudobulbaire caractérisé par des rires et des pleurs spasmodiques, une<br />
dysarthrie, une dysphagie, parfois un mutisme. Une atteinte tétrapyramidale<br />
s’y associe, pouvant aboutir <strong>à</strong> une tétraplégie. Il n’est pas rare que l’évolution<br />
se fasse vers un mutisme akinétique et se complique du décès du patient en<br />
2 <strong>à</strong> 4 semaines.<br />
Démence alcoolique<br />
Une démence alcoolique non liée aux causes décrites ci-dessus fait toujours<br />
l’objet d’une certaine controverse dans la littérature médicale. De nombreuses<br />
études neuropsychologiques ont montré que les patients alcooliques<br />
chroniques développaient des troubles cognitifs, surtout frontaux,<br />
principalement caractérisés par une apathie et un bradypsychisme et qui<br />
s’associeraient <strong>à</strong> une atrophie frontale [70, 87]. Ces troubles seraient<br />
proportionnels <strong>à</strong> la quantité d’alcool absorbée [89, 90].<br />
page 3