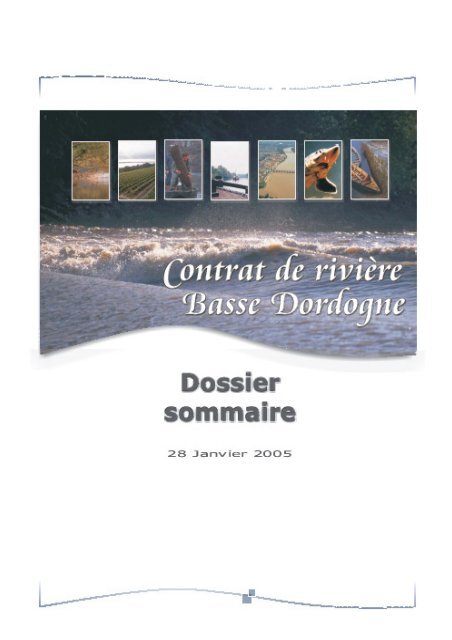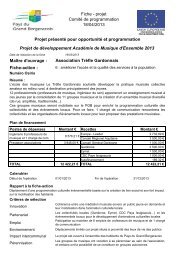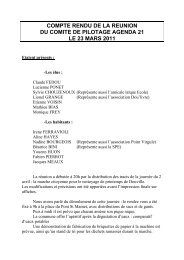Téléchargez le dossier sommaire - Pays de Bergerac
Téléchargez le dossier sommaire - Pays de Bergerac
Téléchargez le dossier sommaire - Pays de Bergerac
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Sommaire<br />
SOMMAIRE............................................................................................................. 1<br />
PREAMBULE ........................................................................................................... 3<br />
INTRODUCTION....................................................................................................... 7<br />
1 LE CONTEXTE DU PROJET ................................................................................. 9<br />
1.1 Le bassin <strong>de</strong> la Dordogne ......................................................................... 9<br />
1.2 L’émergence <strong>de</strong> l’entité basse Dordogne................................................... 10<br />
1.3 Vallée ou bassin ? ................................................................................. 11<br />
2 DIAGNOSTIC : L’EAU, LES MILIEUX ET LES ACTIVITES SUR LA BASSE DORDOGNE ........ 13<br />
2.1 Hydrographie........................................................................................ 13<br />
2.2 Géomorphologie.................................................................................... 13<br />
2.3 Hydrologie ........................................................................................... 13<br />
2.4 La qualité <strong>de</strong>s eaux ............................................................................... 14<br />
2.5 Les milieux........................................................................................... 15<br />
2.6 La faune et la flore ................................................................................ 16<br />
2.7 Les paysages........................................................................................ 17<br />
2.8 Le patrimoine ....................................................................................... 18<br />
2.9 La démographie .................................................................................... 18<br />
2.10 L’agriculture ......................................................................................... 18<br />
2.11 L’industrie............................................................................................ 19<br />
2.12 Le tourisme et <strong>le</strong> patrimoine fluvial .......................................................... 19<br />
2.13 Les loisirs nautiques .............................................................................. 20<br />
2.14 La pêche.............................................................................................. 20<br />
2.15 La chasse............................................................................................. 21<br />
2.16 Les rejets et l’assainissement.................................................................. 21<br />
2.17 Les prélèvements d’eau ......................................................................... 22<br />
2.18 Les inondations..................................................................................... 23<br />
2.19 La Directive Cadre sur l’Eau .................................................................... 23<br />
3 LE PROJET DE CONTRAT BASSE DORDOGNE ....................................................... 25<br />
3.1 L'objectif général .................................................................................. 25<br />
3.2 La place <strong>de</strong> l’outil « contrat <strong>de</strong> rivière » dans un projet plus global <strong>de</strong><br />
développement durab<strong>le</strong> <strong>de</strong> la basse Dordogne..................................................... 25<br />
3.3 Le périmètre......................................................................................... 26<br />
3.4 Le contenu du contrat............................................................................ 26<br />
4 L’ORGANISATION TERRITORIALE..................................................................... 51<br />
4.1 L'organisation territoria<strong>le</strong> ....................................................................... 51<br />
4.2 Le contexte <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la basse Dordogne ............................................ 51<br />
5 RECAPITULATIF DES ETUDES PREALABLES ENVISAGEES......................................... 53<br />
6 LES PARTENAIRES DU CONTRAT ...................................................................... 61<br />
7 LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU CONTRAT ........................................... 63<br />
1
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
2
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Préambu<strong>le</strong><br />
Dans <strong>le</strong>s <strong>Pays</strong> du Libournais et du Grand <strong>Bergerac</strong>ois, <strong>le</strong>s paysages <strong>de</strong> rivière, ponctués<br />
<strong>de</strong> vil<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> villages, témoignent d’une longue histoire et abon<strong>de</strong>nt d'héritages<br />
économiques et culturels particulièrement <strong>de</strong>nses, toujours vivants mais fragi<strong>le</strong>s, qui<br />
offrent <strong>de</strong>s potentiels <strong>de</strong> développement durab<strong>le</strong> insuffisamment utilisés.<br />
De la rive gauche à la rive droite, <strong>le</strong>s différents sites du <strong>Pays</strong> du Libournais et du <strong>Pays</strong> du<br />
Grand <strong>Bergerac</strong>ois, sont l’expression du travail <strong>de</strong>s hommes. Gérer <strong>de</strong> façon durab<strong>le</strong> ce<br />
patrimoine et ce potentiel naturel et humain, c’est travail<strong>le</strong>r sur la mémoire et l’i<strong>de</strong>ntité<br />
<strong>de</strong>s territoires traversés, et répondre à l’impérieuse nécessité <strong>de</strong> préserver et mettre en<br />
va<strong>le</strong>ur cet élément vivant que constitue la rivière. C'est surtout préparer <strong>le</strong>ur avenir pour<br />
<strong>le</strong> long terme et plus largement celui <strong>de</strong>s départements <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong>, <strong>de</strong> la Dordogne et<br />
<strong>de</strong> la région Aquitaine.<br />
A la suite <strong>de</strong> la proposition <strong>de</strong> création d’un syndicat mixte par M. D. Garrigue, Députémaire<br />
<strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong> et <strong>de</strong>s élus du <strong>Pays</strong> Foyen, R. Provain, Maire <strong>de</strong> Sainte-Foy-la-Gran<strong>de</strong><br />
et JP. Chalard, Conseil<strong>le</strong>r général, <strong>le</strong>s élus <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>Pays</strong> se sont réunis pour abor<strong>de</strong>r<br />
ensemb<strong>le</strong> <strong>le</strong>s problèmes <strong>de</strong> la rivière.<br />
Il n’est pas neutre d’y consacrer un temps <strong>de</strong> réf<strong>le</strong>xion qui tienne compte <strong>de</strong>s caractères<br />
intrinsèques <strong>de</strong> chaque territoire comme autant d’éléments constituant <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>Pays</strong>.<br />
C’est à condition <strong>de</strong> conserver <strong>le</strong>ur charme, <strong>le</strong>ur originalité, mais d'abord <strong>le</strong>urs<br />
dynamiques propres, que ces lieux pourront continuer à être <strong>de</strong>s atouts pour <strong>le</strong><br />
développement local, l'accueil <strong>de</strong>s populations, <strong>le</strong> tourisme et l’image <strong>de</strong> marque <strong>de</strong>s<br />
<strong>Pays</strong> du Libournais et du Grand <strong>Bergerac</strong>ois.<br />
L’histoire fluvia<strong>le</strong> <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux territoires et la richesse <strong>de</strong> la navigation jusqu’au XIX ème<br />
sièc<strong>le</strong>, permettent aux <strong>de</strong>ux <strong>Pays</strong> <strong>de</strong> disposer d’un patrimoine <strong>de</strong> ca<strong>le</strong>s, <strong>de</strong> quais, <strong>de</strong><br />
cités, et <strong>de</strong> bourgs et villages varié et important. Ce patrimoine propice offre <strong>de</strong>s<br />
occurrences aux loisirs nautiques, à la navigation et la mise à l’eau d’engins légers, et<br />
permet <strong>le</strong> développement d'une navigation <strong>de</strong> plaisance, dans sa partie aval, dynamique<br />
que renforce l’implantation <strong>de</strong> société <strong>de</strong> croisières ... Les potentiels du tourisme fluvial<br />
reposent sur <strong>le</strong> développement <strong>de</strong>s loisirs nautiques, <strong>de</strong> la baigna<strong>de</strong>, du canoë, du kayak,<br />
du transport <strong>de</strong> passagers et <strong>de</strong> la plaisance.<br />
Malgré cette richesse et ces potentialités, force est <strong>de</strong> constater que, <strong>de</strong> nos jours, faute<br />
<strong>de</strong> stratégie d’accueil, <strong>le</strong>s usagers, quel que soit <strong>le</strong>ur type <strong>de</strong> loisirs, vont pratiquer<br />
ail<strong>le</strong>urs qu'en rivière Dordogne, sur <strong>de</strong>s zones équipées et mises en sécurité.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, si la rivière doit re<strong>de</strong>venir un élément fondamental et structurant du<br />
développement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>Pays</strong>, il convient d’y associer organiquement <strong>le</strong>s nécessités <strong>de</strong><br />
gestion d’un milieu fragilisé par <strong>de</strong>s années <strong>de</strong> désintérêt, voire d'abandon, et <strong>le</strong>s<br />
occurrences d'aménagement socio-économiques. La réappropriation <strong>de</strong> l’espace rivière et<br />
son développement vont <strong>de</strong> pair, et passent par <strong>le</strong> maintien d’usages touristiques,<br />
agrico<strong>le</strong>s et piscico<strong>le</strong>s, … <strong>de</strong> la Dordogne, et reposent sur la forte volonté exprimée par<br />
<strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, et sur <strong>le</strong>ur engagement énergique à réhabiliter la rivière, tant<br />
dans ses aspects environnementaux, qu'économiques, sociaux et culturels.<br />
La qualité <strong>de</strong> l’eau, l’entretien et la gestion du lit, <strong>de</strong>s berges, <strong>de</strong>s paysages et du<br />
patrimoine culturel, <strong>le</strong> maintien d’une faune et d’une flore spécifiques, sont autant <strong>de</strong><br />
préalab<strong>le</strong>s majeurs à une bonne gestion durab<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’espace valléen <strong>de</strong> la Dordogne, et à<br />
sa mise en va<strong>le</strong>ur raisonnée au bénéfice <strong>de</strong>s générations futures.<br />
Le contrat <strong>de</strong> rivière dans <strong>le</strong>quel s'engagent <strong>le</strong>s <strong>Pays</strong> du Libournais et du Grand<br />
<strong>Bergerac</strong>ois se veut ainsi une action qui ouvre sur une gestion intégrée <strong>de</strong>s hommes et<br />
<strong>de</strong>s milieux <strong>de</strong> la rivière, dans une perspective ouverte d'avenir et <strong>de</strong> développement<br />
harmonieux et soutenab<strong>le</strong>. Il participe ainsi à l'émergence <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> territoires<br />
propres à chacun <strong>de</strong> ces <strong>Pays</strong>.<br />
3
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Les démarches <strong>de</strong> création <strong>de</strong>s <strong>Pays</strong>, initiées à partir <strong>de</strong> 1999, ont permis <strong>de</strong> fédérer <strong>le</strong>s<br />
acteurs locaux du développement, mais aussi <strong>le</strong>s populations el<strong>le</strong>s-mêmes autour <strong>de</strong> la<br />
volonté commune <strong>de</strong> faire émerger un projet col<strong>le</strong>ctif, qu'il faudra exprimer dans la<br />
durée.<br />
A ce titre, la réalisation <strong>de</strong> la Charte du <strong>Pays</strong> du Libournais a permis que s'exprime<br />
notamment un engagement fort <strong>de</strong> tous en direction <strong>de</strong>s espaces naturels qui<br />
caractérisent ce territoire, et au premier rang <strong>de</strong>squels la rivière Dordogne joue un rô<strong>le</strong><br />
prépondérant. La gestion <strong>de</strong> ces espaces, dans <strong>le</strong>ur diversité, constitue une <strong>de</strong>s clés <strong>de</strong> la<br />
stratégie d'aménagement élaborée.<br />
Plus spécifiquement, la rivière Dordogne et l'ensemb<strong>le</strong> du bassin versant qu'el<strong>le</strong> draine<br />
constituent <strong>de</strong>s facteurs d'attractivité forts pour un espace proche d'une agglomération<br />
importante constituée autour d'une capita<strong>le</strong> régiona<strong>le</strong>. C'est ainsi, que la qualité<br />
écologique et la va<strong>le</strong>ur esthétique que représente la basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne sont<br />
non seu<strong>le</strong>ment bénéfiques pour <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s populations libournaises, mais<br />
constituent aussi <strong>de</strong>s atouts <strong>de</strong> développement économique, touristique et d'i<strong>de</strong>ntité<br />
culturel<strong>le</strong>. Leur protection et <strong>le</strong>ur mise en va<strong>le</strong>ur sont donc <strong>de</strong>venues une impérieuse<br />
nécessité, tant pour ses enjeux d'attractivité que pour garantir à chacun <strong>de</strong>s libournais<br />
son droit à vivre dans un environnement <strong>de</strong> qualité.<br />
La préoccupation <strong>de</strong> développement durab<strong>le</strong> doit alors conduire <strong>le</strong>s déci<strong>de</strong>urs locaux à<br />
favoriser l'émergence d'un "aménagement <strong>de</strong> l'environnement". La prise en compte <strong>de</strong><br />
l'environnement, et ici plus spécifiquement la reconsidération <strong>de</strong> l'espace rivière, n'est<br />
pas subie mais intégrée au processus <strong>de</strong> développement local. De contrainte,<br />
l'environnement <strong>de</strong>vient un capital, <strong>le</strong> support d'un développement durab<strong>le</strong> effectivement<br />
maîtrisé. Mal i<strong>de</strong>ntifié, un territoire banal n'est pas un espace moteur. Il ne suscite pas<br />
l'adhésion, ni <strong>le</strong> désir <strong>de</strong> <strong>le</strong> respecter, d'y vivre ou d'y entreprendre. Préserver et<br />
développer ce capital répond ainsi à trois enjeux majeurs pour <strong>le</strong> <strong>Pays</strong> du Libournais :<br />
- la préservation <strong>de</strong> l'écosystème qu'induit la rivière Dordogne, dans un but <strong>de</strong><br />
conservation et <strong>de</strong> transmission aux générations futures,<br />
- la valorisation <strong>de</strong> l'atout que représente la rivière Dordogne, dans un but<br />
offensif et promotionnel,<br />
- l'organisation spatia<strong>le</strong> dans un but <strong>de</strong> qualifier <strong>le</strong>s espaces, <strong>de</strong> <strong>le</strong>s gérer dans<br />
<strong>le</strong>ur diversité et d'affirmer nos volontés,<br />
- la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.<br />
La Charte <strong>de</strong> Développement du <strong>Pays</strong> du Grand <strong>Bergerac</strong>ois, quant à el<strong>le</strong>, a abouti à la<br />
définition <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Dordogne comme l’axe fédérateur du territoire, par<br />
l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s acteurs locaux, élus et socioprofessionnels du Conseil <strong>de</strong> Développement,<br />
sur <strong>le</strong> plan humain, par la concentration <strong>de</strong> la population dans sa vallée, sur <strong>le</strong> plan<br />
économique et plus largement sur <strong>le</strong> plan i<strong>de</strong>ntitaire.<br />
La rivière est cependant restée sous-exploitée <strong>de</strong>puis qu’el<strong>le</strong> ne joue plus par el<strong>le</strong>-même<br />
un rô<strong>le</strong> économique. L’ambition du <strong>Pays</strong> du Grand <strong>Bergerac</strong>ois est <strong>de</strong> redonner un sens<br />
concret à cette rivière qui est liée étroitement à l’histoire du territoire.<br />
La Charte insiste pour cela sur la nécessité <strong>de</strong> favoriser une gestion concertée et durab<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> cet espace, afin d’en concilier la préservation et la valorisation.<br />
La rivière et sa vallée forment un espace multifonctionnel. Les acteurs du <strong>Bergerac</strong>ois<br />
s’attachent donc à sa valorisation en poursuivant <strong>de</strong>s objectifs indissociab<strong>le</strong>s :<br />
- la connaissance et, par conséquent, la protection du milieu,<br />
- la pérennité <strong>de</strong>s activités économiques attenantes,<br />
- <strong>le</strong> développement <strong>de</strong> filières économiques durab<strong>le</strong>s, notamment <strong>le</strong> tourisme,<br />
- la redécouverte et la réappropriation par la population rési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> son<br />
patrimoine,<br />
4
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
- <strong>le</strong> respect d’un cadre paysager remarquab<strong>le</strong>, au centre <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> qualité<br />
<strong>de</strong> vie, sur laquel<strong>le</strong> s’appuie en gran<strong>de</strong> partie l’attractivité du territoire.<br />
- la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.<br />
A l’échel<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’ensemb<strong>le</strong> du bassin, la Basse Dordogne représente alors un enjeu<br />
important, d'autant qu'il s’agit <strong>de</strong> la partie la plus peuplée et la plus urbanisée. El<strong>le</strong> est<br />
aussi <strong>le</strong> réceptac<strong>le</strong> <strong>de</strong>s eaux circulant sur un territoire <strong>de</strong> 25 000 km². El<strong>le</strong> est <strong>le</strong> passage<br />
obligé pour <strong>le</strong>s poissons migrateurs qui remontent vers <strong>le</strong>urs frayères. El<strong>le</strong> est enfin<br />
l’emblème d’une rivière navigab<strong>le</strong> riche d’un patrimoine et d’une culture <strong>de</strong> la vie fluvia<strong>le</strong><br />
porteuse d'un développement potentiel pour <strong>le</strong>s hommes, qu'il convient d'écrire<br />
maintenant au travers d'un contrat <strong>de</strong> rivière <strong>de</strong> la basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne.<br />
C’est pour cela que <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>Pays</strong> ont décidé <strong>de</strong> s’associer à l’établissement public<br />
EPIDOR, qui <strong>de</strong>puis sa création en 1991 s’est donné pour mission d’élaborer <strong>de</strong>s<br />
stratégies <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s cours d’eau dans <strong>le</strong> bassin <strong>de</strong> la<br />
Dordogne. Il vise aussi à favoriser la coordination interrégiona<strong>le</strong> et interdépartementa<strong>le</strong><br />
sur ce territoire. Par ail<strong>le</strong>urs, ce choix <strong>de</strong>s <strong>Pays</strong> respecte p<strong>le</strong>inement <strong>le</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’environnement qui i<strong>de</strong>ntifie <strong>le</strong>s Etablissements Publics Territoriaux <strong>de</strong> Bassin comme <strong>le</strong>s<br />
organisations privilégiées pour servir une gestion coordonnée, harmonieuse et durab<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong>s rivières.<br />
Afin que cette chaîne <strong>de</strong> co-responsabilités soit complète, <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>Pays</strong> et EPIDOR<br />
rappel<strong>le</strong>nt et confirment la mission <strong>de</strong>s acteurs locaux : col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, EPCI et<br />
associations, à qui il reviendra in fine, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur participation aux instances<br />
délibératives, <strong>le</strong> soin <strong>de</strong> mettre en œuvre <strong>le</strong>s politiques <strong>de</strong> terrain, <strong>de</strong> définir <strong>le</strong>s<br />
modalités <strong>de</strong> la gestion et du développement durab<strong>le</strong> <strong>de</strong>s territoires sur <strong>le</strong>squels ils<br />
fon<strong>de</strong>nt <strong>le</strong>urs projets, dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong>s chartes <strong>de</strong> territoire respectives à chaque <strong>Pays</strong>.<br />
Au regard <strong>de</strong> ces dispositions dont l'aboutissement est la mise en commun <strong>de</strong> toutes<br />
compétences au service <strong>de</strong> la rivière, EPIDOR assurera l'animation et la mise en œuvre<br />
du contrat <strong>de</strong> rivière basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne, fort <strong>de</strong> son expérience <strong>de</strong> trois<br />
contrats <strong>de</strong> rivière déjà menés sur la Haute Dordogne, la Cère et <strong>le</strong> Céou, et <strong>de</strong> plus <strong>de</strong><br />
dix années d’étu<strong>de</strong>s et d’observations réalisées sur la basse Dordogne.<br />
L’implication commune <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>Pays</strong> et d’EPIDOR est une nécessité et une garantie <strong>de</strong><br />
réussite pour mener à bien ce contrat <strong>de</strong> rivière, dont l’une <strong>de</strong>s originalités rési<strong>de</strong> dans la<br />
dimension du territoire et dans l’importance <strong>de</strong> l’axe fluvial.<br />
Serge FOURCAUD<br />
Prési<strong>de</strong>nt du <strong>Pays</strong> du Grand <strong>Bergerac</strong>ois<br />
Bernard CAZEAU<br />
Prési<strong>de</strong>nt d'EPIDOR<br />
5<br />
Serge MORIN<br />
Prési<strong>de</strong>nt du <strong>Pays</strong> du Libournais
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
6
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Introduction<br />
De nombreux projets <strong>de</strong> mise en va<strong>le</strong>ur économique et touristique émergent <strong>de</strong>puis<br />
quelques années <strong>le</strong> long <strong>de</strong> la basse vallée <strong>de</strong> la rivière Dordogne. En effet, <strong>le</strong>s<br />
col<strong>le</strong>ctivités riveraines souhaitent renforcer <strong>le</strong> potentiel <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> la rivière et<br />
<strong>de</strong> sa vallée, notamment à travers <strong>le</strong>s activités nautiques, la mise en va<strong>le</strong>ur paysagère et<br />
touristique <strong>de</strong>s berges et <strong>de</strong>s milieux naturels. Mais la mise en œuvre <strong>de</strong> ces projets<br />
rencontre un certain nombre <strong>de</strong> difficultés, tant sur <strong>le</strong> plan technique, avec la nécessité<br />
parfois <strong>de</strong> <strong>de</strong>voir coordonner <strong>le</strong>s opérations sur un territoire qui concerne plusieurs<br />
maîtres d’ouvrages, que sur <strong>le</strong> plan financier. Leur conduite nécessite par ail<strong>le</strong>urs une<br />
articulation étroite avec <strong>le</strong>s politiques <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la ressource et <strong>de</strong>s milieux<br />
aquatiques. En effet, d’une part, tout <strong>le</strong> potentiel <strong>de</strong> développement envisagé autour du<br />
f<strong>le</strong>uve Dordogne dépend avant tout <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement fluvial. D’autre part,<br />
il apparaît essentiel <strong>de</strong> prévoir et <strong>de</strong> maîtriser l’impact <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> développement afin<br />
que ceux-ci restent compatib<strong>le</strong>s avec <strong>le</strong>s objectifs <strong>de</strong> préservation et <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong><br />
la rivière.<br />
Face à ces constats, <strong>le</strong>s <strong>Pays</strong> du Libournais et du Grand <strong>Bergerac</strong>ois se sont rapprochés<br />
pour réfléchir à la manière <strong>de</strong> conduire un projet coordonné <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la rivière<br />
souhaité par <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités riveraines. Ce projet serait mené en concertation et en<br />
synergie et intégrerait aux projets <strong>de</strong> mise en va<strong>le</strong>ur, <strong>le</strong>s aspects environnementaux<br />
indispensab<strong>le</strong>s <strong>de</strong> tout projet <strong>de</strong> développement durab<strong>le</strong>. Aucun outil <strong>de</strong> gestion classique<br />
n’étant à l’heure actuel<strong>le</strong> capab<strong>le</strong> <strong>de</strong> supporter ces <strong>de</strong>ux vo<strong>le</strong>ts, une solution origina<strong>le</strong> a<br />
été imaginée en ajoutant à l’outil « contrat <strong>de</strong> rivière », principa<strong>le</strong>ment ciblé sur <strong>le</strong>s<br />
actions <strong>de</strong> restauration du bon état écologique <strong>de</strong>s cours d’eau, un programme <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong>s activités nautiques et touristiques liées à la rivière. Pour procé<strong>de</strong>r à<br />
l’élaboration du projet <strong>de</strong> « Contrat Basse Dordogne », <strong>le</strong>s <strong>Pays</strong> se sont appuyés sur<br />
l’expérience <strong>de</strong> l’établissement public EPIDOR, qui possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s compétences reconnues<br />
en matière <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s milieux fluviaux et <strong>de</strong>s activités aquatiques, et qui assure la<br />
gestion <strong>de</strong> trois contrats <strong>de</strong> rivière sur la Haute Dordogne, sur la Cère et sur <strong>le</strong> Céou. Un<br />
élément important <strong>de</strong> ce partenariat se situe dans <strong>le</strong> lien étroit qui s’établit ainsi entre <strong>le</strong>s<br />
projets <strong>de</strong> développement local <strong>de</strong> la basse Dordogne et <strong>le</strong>s politiques <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> l’eau<br />
du bassin versant.<br />
Le présent document constitue <strong>le</strong> <strong>dossier</strong> <strong>sommaire</strong> du Contrat Basse Dordogne. Il<br />
présente <strong>le</strong> contexte géographique, socio économique, politique et l’état <strong>de</strong> motivation<br />
dans <strong>le</strong>quel s’inscrit <strong>le</strong> projet <strong>de</strong> contrat. A partir <strong>de</strong> celui-ci, il justifie une approche<br />
centrée sur l’axe fluvial, <strong>de</strong> Limeuil, confluence avec la Vézère, au Bec d’Ambès,<br />
confluence avec la Garonne. A l’appui d’un livret cartographique présenté en annexe, il<br />
propose ensuite sur ce territoire un diagnostic <strong>de</strong>s problématiques et <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong><br />
gestion en place, en liaison notamment avec <strong>le</strong>s préconisations du SDAGE Adour<br />
Garonne. Puis il expose <strong>le</strong> contenu précis d’un projet <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> développement en<br />
i<strong>de</strong>ntifiant, pour chaque thème, <strong>le</strong>s documents <strong>de</strong> référence (étu<strong>de</strong>s, schémas,<br />
stratégies…), <strong>le</strong>s étu<strong>de</strong>s complémentaires qui seront à réaliser dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
préalab<strong>le</strong>s au contrat, ainsi que <strong>le</strong>s actions qui sont d’ores et déjà prêtes à être engagées<br />
au sein <strong>de</strong>s cadres <strong>de</strong> gestion existants. Il distingue clairement <strong>le</strong>s actions re<strong>le</strong>vant <strong>de</strong> la<br />
politique classique <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> rivière et <strong>le</strong>s actions d’une politique <strong>de</strong> développement<br />
touristique local. Le <strong>dossier</strong> analyse enfin l’organisation territoria<strong>le</strong> et administrative du<br />
territoire retenu et propose un cadre <strong>de</strong> partenariat pour l’élaboration et <strong>le</strong> suivi du<br />
Contrat Basse Dordogne.<br />
7
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
8
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
1 Le contexte du projet<br />
1.1 Le bassin <strong>de</strong> la Dordogne<br />
Le bassin <strong>de</strong> la Dordogne est une entité hydrographique qui sert <strong>de</strong> référence à nombre<br />
<strong>de</strong> procédures <strong>de</strong> gestion. Le Comité <strong>de</strong> bassin Adour Garonne possè<strong>de</strong> d’ail<strong>le</strong>urs une<br />
commission géographique Dordogne et il existe un établissement public territorial <strong>de</strong><br />
bassin à l’échel<strong>le</strong> <strong>de</strong> ce territoire : EPIDOR.<br />
D’une superficie tota<strong>le</strong> <strong>de</strong> 25 000 km², <strong>le</strong> bassin <strong>de</strong> la Dordogne s’étend <strong>de</strong>puis <strong>le</strong> massif<br />
du Sancy jusqu’à l’Estuaire <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong>, en traversant <strong>le</strong>s contreforts cristallins et<br />
métamorphiques du Limousin, <strong>le</strong>s plateaux karstiques du Quercy et du Périgord puis <strong>le</strong>s<br />
plaines d’Aquitaine. Il recoupe ainsi <strong>de</strong>s problématiques assez variées. L’axe Dordogne<br />
lui-même représente un linéaire <strong>de</strong> 475 km (cf. livret carto. p 1).<br />
Les principa<strong>le</strong>s procédures qui structurent actuel<strong>le</strong>ment la gestion <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong>s milieux<br />
sur <strong>le</strong> bassin sont :<br />
- la mise en œuvre <strong>de</strong> la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (cf. livret carto.<br />
p 2 & 3), qui s’inscrit à l’échel<strong>le</strong> du district hydrographique Adour Garonne, dont<br />
l’état <strong>de</strong>s lieux a été réalisé à partir d’un pilotage local, au niveau du bassin <strong>de</strong> la<br />
Dordogne ;<br />
- <strong>le</strong>s plans <strong>de</strong> gestion d'étiage (PGE) (cf. livret carto. p 4) sur <strong>le</strong> bassin Is<strong>le</strong>–Dronne<br />
(en cours <strong>de</strong> signature) et sur <strong>le</strong> bassin Dordogne – Vézère (en cours <strong>de</strong><br />
lancement) ;<br />
- la lutte contre <strong>le</strong>s inondations (cf. livret carto. p 5) comprenant notamment <strong>de</strong>s<br />
actions <strong>de</strong> prévision, pilotées par <strong>le</strong> service <strong>de</strong> prévision <strong>de</strong>s crues du bassin <strong>de</strong> la<br />
Dordogne, et un plan <strong>de</strong> prévention élaboré à l’échel<strong>le</strong> du bassin versant ;<br />
- <strong>le</strong> plan <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s éclusées (cf. livret carto. p 6), qui s’inscrit dans <strong>le</strong> cadre<br />
d’un défi territorial porté au niveau du bassin <strong>de</strong> la Dordogne ;<br />
- <strong>le</strong> plan <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s poissons migrateurs (cf. livret carto. p 7), élaboré par <strong>le</strong><br />
comité <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s poissons migrateurs, qui prévoit une mise en œuvre à<br />
l’échel<strong>le</strong> du bassin <strong>de</strong> la Dordogne ;<br />
9
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
- la procédure Natura 2000 qui concerne l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’axe fluvial Dordogne, visà-vis<br />
notamment <strong>de</strong> la conservation <strong>de</strong>s populations exceptionnel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> poissons<br />
migrateurs présentes sur <strong>le</strong> bassin ;<br />
- l’élaboration d’une stratégie <strong>de</strong> développement touristique (cf. livret carto. p 8) à<br />
l’échel<strong>le</strong> du bassin <strong>de</strong> la Dordogne, initiée notamment par une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> marketing<br />
touristique ;<br />
- <strong>le</strong>s chartes <strong>de</strong> <strong>Pays</strong> et <strong>le</strong>s procédures qui <strong>le</strong>s accompagnent.<br />
Ces procédures disposent chacune <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur propre dynamique qu’il est souhaitab<strong>le</strong> <strong>de</strong> ne<br />
pas perturber en essayant <strong>de</strong> <strong>le</strong>s traiter à une autre échel<strong>le</strong>. Ce ne sont donc pas sur ces<br />
thèmes que se fon<strong>de</strong> l’idée d’un contrat <strong>de</strong> rivière sur la basse Dordogne. Il est<br />
néanmoins essentiel d’intégrer <strong>le</strong>ur existence en amont <strong>de</strong> la réf<strong>le</strong>xion, <strong>de</strong> façon à<br />
trouver la meil<strong>le</strong>ure façon, pour un contrat <strong>de</strong> rivière, <strong>de</strong> <strong>le</strong>s accompagner, <strong>de</strong> <strong>le</strong>s relayer<br />
et <strong>de</strong> <strong>le</strong>s compléter.<br />
1.2 L’émergence <strong>de</strong> l’entité basse Dordogne<br />
Il existe <strong>de</strong>s problématiques plus loca<strong>le</strong>s mises en avant par <strong>le</strong>s acteurs riverains, qui<br />
s’expriment d’une façon assez similaire sur toute <strong>de</strong> la basse Dordogne. Ces questions,<br />
qui pourraient trouver <strong>de</strong>s solutions communes sur un ensemb<strong>le</strong> homogène, sont à la<br />
base d’une dynamique cohérente aujourd’hui prête à s’engager.<br />
L’émergence <strong>de</strong> l’entité basse Dordogne s’explique en gran<strong>de</strong> partie par la cohérence<br />
géographique <strong>de</strong> ce territoire.<br />
La basse Dordogne offre une homogénéité certaine sur <strong>le</strong> plan physique. La Dordogne en<br />
aval <strong>de</strong> Limeuil se distingue en effet <strong>de</strong> la partie moyenne et haute du f<strong>le</strong>uve par ses<br />
caractéristiques <strong>de</strong> rivière <strong>de</strong> plaine, avec un lit à chenal unique évoluant dans une large<br />
vallée et aux reliefs peu marqués. Les î<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s bras morts très développés sur la<br />
moyenne Dordogne sont ici rares.<br />
Sur <strong>le</strong> plan hydrographique, la basse Dordogne est aussi un ensemb<strong>le</strong> cohérent (cf. livret<br />
carto. p 9). A l’amont, <strong>de</strong>ux grands sous bassins confluent : la Vézère (3 700 km²) et la<br />
Dordogne amont (9 600 km²). Tout à l’aval, dans la partie soumise à l’influence <strong>de</strong>s<br />
marées, se déverse <strong>le</strong> sous bassin <strong>de</strong> l’Is<strong>le</strong> (7 500 km²). En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> ces grands<br />
ensemb<strong>le</strong>s, la Dordogne ne reçoit que <strong>de</strong>s petits affluents, dont <strong>le</strong> plus grand <strong>de</strong>s bassins<br />
versants n’excè<strong>de</strong> pas 320 km² <strong>de</strong> superficie.<br />
La basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne s’individualise éga<strong>le</strong>ment par sa socio économie.<br />
L’urbanisation et l’industrialisation y sont plus importantes que dans <strong>le</strong> reste du bassin.<br />
Les principaux foyers se concentrent autour <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>, <strong>de</strong> Libourne, ainsi que d’un<br />
ensemb<strong>le</strong> s’étendant entre Saint Loubès et Saint-André-<strong>de</strong>-Cubzac, marquant la<br />
périphérie <strong>de</strong> l’agglomération bor<strong>de</strong>laise. L’activité agrico<strong>le</strong> dominante, principa<strong>le</strong>ment la<br />
viticulture et l’arboriculture, est éga<strong>le</strong>ment particulière à cette partie du bassin.<br />
Mais l’un <strong>de</strong>s principaux atouts d’une dynamique coordonnée à l’échel<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’entité basse<br />
Dordogne est certainement la volonté politique et la motivation <strong>de</strong>s acteurs qui s’est<br />
exprimée pour engager une action commune. Cette intention se manifeste par <strong>le</strong><br />
rapprochement <strong>de</strong>s pays du Libournais et du Grand <strong>Bergerac</strong>ois. Tous <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux sont<br />
fortement concernés par la vallée <strong>de</strong> la Dordogne, qui occupe une partie importante <strong>de</strong><br />
<strong>le</strong>ur territoire. Cet aspect ressort clairement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux chartes <strong>de</strong> développement<br />
rédigées par chacun <strong>de</strong>s pays. Ils comptent maintenant s’associer pour traiter ensemb<strong>le</strong><br />
<strong>le</strong>s problématiques liées à ce territoire. Pour <strong>le</strong> faire ils souhaitent s’appuyer sur EPIDOR<br />
qui par ail<strong>le</strong>urs est certainement l’organisation la plus à même <strong>de</strong> garantir <strong>le</strong>s liens avec<br />
<strong>le</strong>s stratégies <strong>de</strong> gestion plus globa<strong>le</strong>s du bassin versant.<br />
10
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
1.3 Les Chartes <strong>de</strong> <strong>Pays</strong> et <strong>le</strong> projet <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s<br />
rivières<br />
Dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong>s chartes <strong>de</strong>s pays du Libournais et du Grand <strong>Bergerac</strong>ois, <strong>le</strong>s rivières<br />
sont i<strong>de</strong>ntifiées comme <strong>de</strong>s espaces majeurs <strong>de</strong> culture, d’économie, d’environnement et<br />
<strong>de</strong> cadre <strong>de</strong> vie. Après plusieurs années d’oubli voir d’abandon, ces espaces retrouvent<br />
<strong>le</strong>ur intérêt propre relativement au développement <strong>de</strong>s territoires et à l’enrichissement<br />
tant économique que culturel <strong>de</strong>s populations.<br />
Le projet <strong>de</strong> développement durab<strong>le</strong> prôné par <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux pays est conçu selon <strong>le</strong>s axes<br />
suivants. Un tourisme s’appuyant sur <strong>le</strong>s richesses environnementa<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la rivière et<br />
selon une logique <strong>de</strong> pérégrination tant sur la rivière qu’autour <strong>de</strong> la rivière. En ce sens,<br />
la Dordogne constitue à la fois <strong>le</strong> support du tourisme, l’environnement du tourisme et<br />
l’image <strong>de</strong> marque du tourisme ainsi promu.<br />
Les chartes <strong>de</strong> pays établies à partir <strong>de</strong> la synthèse <strong>de</strong> nombreux débats avec l’ensemb<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong>s forces vives <strong>de</strong>s territoires ont mis en exergue l’objectif stratégique à long terme<br />
ainsi défini. Les rivières et <strong>le</strong>urs environnements représentent aussi bien <strong>de</strong>s atouts que<br />
<strong>de</strong>s risques. Ils doivent êtres considérés comme un bien commun et partagés entre <strong>le</strong>s<br />
différents usagers ce qui induit la notion <strong>de</strong> coresponsabilité.<br />
1.4 Vallée ou bassin ?<br />
Les principes <strong>de</strong> gestion par bassin versant mis en avant par la loi sur l’eau inciteraient,<br />
pour traiter la problématique <strong>de</strong> la basse Dordogne, à travail<strong>le</strong>r sur un territoire <strong>de</strong><br />
25 000 km², ce qui est très au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> la va<strong>le</strong>ur moyenne d’environ 1 000 km²<br />
habituel<strong>le</strong>ment rencontrée pour la mise en œuvre <strong>de</strong> contrats <strong>de</strong> rivière. La définition<br />
d’un périmètre pertinent doit donc reposer sur un compromis, qui concilie <strong>le</strong>s impératifs<br />
d’une analyse technique <strong>de</strong> qualité et d’une bonne opérationnalité.<br />
Les arguments exposés précé<strong>de</strong>mment individualisent clairement l’entité vallée basse<br />
Dordogne comme un ensemb<strong>le</strong> cohérent.<br />
Les petits affluents, qui constituent <strong>le</strong> bassin versant « latéral » <strong>de</strong> la basse Dordogne,<br />
ont une longueur qui varie entre 10 et 50 km, et une largeur qui n’excè<strong>de</strong> généra<strong>le</strong>ment<br />
pas quelques mètres. Leur gestion se pose <strong>de</strong> façon assez différente <strong>de</strong> cel<strong>le</strong> du f<strong>le</strong>uve,<br />
qui mesure plus <strong>de</strong> 100 mètres <strong>de</strong> large et dont <strong>le</strong> débit moyen s’élève à plusieurs<br />
centaines <strong>de</strong> mètres cubes par secon<strong>de</strong>. De plus, <strong>le</strong>s nombreux affluents (Couze, Conne,<br />
Cau<strong>de</strong>au, Eyraud, Gardonnette, Seignal, Estrop, Soulège, Durèze, Lidoire, Engranne,<br />
Vayres, Laurence, Virvée, Moron) offrent <strong>de</strong>s contextes très différents <strong>le</strong>s uns <strong>de</strong>s autres<br />
(situation <strong>de</strong> plateaux vs. situation <strong>de</strong> marais ; géologie karstique vs. géologie<br />
alluvionnaire ; contexte rural vs. contexte urbanisé…). Les motivations loca<strong>le</strong>s pour y<br />
engager <strong>de</strong>s actions sont éga<strong>le</strong>ment très hétérogènes : forte volonté sur certains,<br />
inexistante sur d’autres.<br />
En intégrant d’emblée au projet <strong>le</strong>s questions liées aux affluents, il existe un risque <strong>de</strong> se<br />
disperser, en multipliant <strong>le</strong>s problématiques traitées, et <strong>de</strong> diluer la motivation exprimée<br />
par <strong>le</strong>s partenaires. L’extension du périmètre « vallée » au périmètre « bassin » fait par<br />
ail<strong>le</strong>urs passer la superficie du territoire <strong>de</strong> 700 à plus <strong>de</strong> 3 000 km², <strong>le</strong> nombre <strong>de</strong><br />
communes concernées <strong>de</strong> 102 à 340, <strong>le</strong> nombre <strong>de</strong> communautés <strong>de</strong> communes <strong>de</strong> 17 à<br />
34 et <strong>le</strong> nombre d’habitants <strong>de</strong> 178 000 à 284 000. Ces chiffres, qui dans <strong>le</strong> cas <strong>de</strong> la<br />
seu<strong>le</strong> vallée sont déjà important par rapport aux moyennes <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> rivière,<br />
<strong>de</strong>viennent démesurés dans <strong>le</strong> cas d’un périmètre étendu au bassin latéral.<br />
Pour se doter <strong>de</strong>s meil<strong>le</strong>ures conditions d’entretenir une démarche dynamique, il est donc<br />
proposé <strong>de</strong> concentrer <strong>le</strong> projet sur l’axe fluvial qui constituera l’épine dorsa<strong>le</strong> du projet.<br />
Pour traiter <strong>le</strong>s problématiques qui s’y rapportent, il sera certainement nécessaire<br />
d’intervenir sur <strong>le</strong>s confluences, sur la vallée, voire <strong>de</strong> remonter sur certains affluents, en<br />
11
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
partenariat avec <strong>le</strong>s structures actives dans ce domaine. Certaines priorités, i<strong>de</strong>ntifiées<br />
sur certains affluents pour la mise en œuvre <strong>de</strong> la Directive Cadre européenne sur l’Eau<br />
pourront éga<strong>le</strong>ment être prises en compte par <strong>le</strong> contrat, sur <strong>le</strong> thème principa<strong>le</strong>ment <strong>de</strong><br />
la restauration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s principes <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> concertation mis en place autour du contrat <strong>de</strong><br />
vallée pourront jouer un rô<strong>le</strong> <strong>de</strong> locomotive et servir d’appui aux dynamiques connexes<br />
qui pourront s’engager sur <strong>le</strong>s affluents.<br />
12
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
2 Diagnostic : l’eau, <strong>le</strong>s milieux et <strong>le</strong>s<br />
activités sur la basse Dordogne<br />
2.1 Hydrographie<br />
(cf. livret carto. p 10)<br />
La Dordogne entre Limeuil et <strong>le</strong> Bec d’Ambès représente un linéaire <strong>de</strong> 180 km. La<br />
superficie <strong>de</strong> la vallée représente environ 730 km², avec une largeur variant entre 2 km<br />
et 11 km.<br />
La basse Dordogne naît <strong>de</strong> la confluence <strong>de</strong> la Vézère (bassin versant <strong>de</strong> 3 700 km²) et<br />
<strong>de</strong> la Dordogne amont (bassin versant <strong>de</strong> 9 600 km²).<br />
El<strong>le</strong> est régulièrement alimentée par <strong>de</strong> petits affluents qui drainent <strong>le</strong>s plateaux bordant<br />
la vallée. Les principaux sont d’amont en aval :<br />
- en rive gauche la Couze (long. 30 km), la Conne (long. 23 km), la Gardonnette<br />
(long. 24 km), <strong>le</strong> Seignal (long. 22 km), la Durèze (long. 16 km), l’Engranne<br />
(long. 22 km), <strong>le</strong> Vayres (long. 22 km), la Laurence (long. 15 km),<br />
- en rive droite, <strong>le</strong> Cau<strong>de</strong>au (long. 38 km), l’Eyraud (long. 21 km), l’Estrop (long.<br />
18 km), la Lidoire (long. 49 km), la Virvée (long. 17 km), <strong>le</strong> Moron (long. 24 km).<br />
L’Is<strong>le</strong> (bassin versant <strong>de</strong> 7 500 km²) se déverse dans la Dordogne à Libourne, dans la<br />
partie aval, en zone d’influence <strong>de</strong>s marées, à environ 40 km <strong>de</strong> l’estuaire <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong>.<br />
2.2 Géomorphologie<br />
(cf. livret carto. p 11)<br />
Dans la partie amont <strong>de</strong> la basse vallée, la rivière forme <strong>le</strong>s méandres <strong>de</strong> Limeuil et <strong>de</strong><br />
Trémolat, encaissés dans <strong>le</strong>s calcaires du Crétacé. Ces formations occupent la bordure<br />
occi<strong>de</strong>nta<strong>le</strong> du vaste massif karstique <strong>de</strong>s causses du Périgord et du Quercy. Au niveau<br />
<strong>de</strong> Lalin<strong>de</strong>, la vallée se réduit en un étroit sillon. Un peu à l’amont <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>, la vallée<br />
s’élargit dans <strong>le</strong>s formations détritiques continenta<strong>le</strong>s du tertiaire et du quaternaire. Les<br />
terrasses anciennes, <strong>le</strong>s plus é<strong>le</strong>vées, sont très étendues et bor<strong>de</strong>nt la vallée. La plaine<br />
alluvia<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s basses terrasses, qui bor<strong>de</strong>nt <strong>le</strong> cours d’eau, sont en général séparées du<br />
lit <strong>de</strong> la rivière par un bourre<strong>le</strong>t alluvial. Dans la partie la plus aval, celui-ci a souvent été<br />
renforcé pour former <strong>de</strong> véritab<strong>le</strong>s digues. Peu après Castillon-la-Batail<strong>le</strong>, la Dordogne<br />
s’épanouit dans une vallée <strong>de</strong> plus en plus large. L’altitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la basse vallée varie <strong>de</strong> la<br />
cote zéro dans <strong>le</strong>s zones basses jusqu’à 100 à 150 mètres aux sommets <strong>de</strong>s versants.<br />
2.3 Hydrologie<br />
(cf. livret carto. p 12)<br />
Le climat <strong>de</strong> la basse vallée est soumis aux influences océaniques. Le régime<br />
hydrologique est <strong>de</strong> type pluvial avec <strong>de</strong> hautes eaux hiverna<strong>le</strong>s et printanières et un<br />
étiage estival souvent sévère. Le débit moyen annuel à <strong>Bergerac</strong> est <strong>de</strong> 280 m 3 /s. La<br />
crue maxima<strong>le</strong> enregistrée est cel<strong>le</strong> du 15 janvier 1962 avec 2600 m 3 /s.<br />
Le régime subit d’importantes fluctuations artificiel<strong>le</strong>s, conséquence <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong>s<br />
barrages hydroé<strong>le</strong>ctriques du Massif Central. Les lâchés d’eau importants, appelés<br />
13
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
éclusées, peuvent se traduire par <strong>de</strong>s variations importantes et rapi<strong>de</strong>s du débit, surtout<br />
en hiver et au printemps, pério<strong>de</strong> stratégique pour la production hydroé<strong>le</strong>ctrique. En<br />
pério<strong>de</strong> estiva<strong>le</strong>, <strong>de</strong> forte fréquentation touristique, une consigne <strong>de</strong> sécurité est imposée<br />
aux exploitants <strong>de</strong>s barrages pour limiter ce phénomène. Les barrages hydroé<strong>le</strong>ctriques<br />
<strong>de</strong> Mauzac, Tuilières et <strong>Bergerac</strong> quant à eux fonctionnent « au fil <strong>de</strong> l’eau » et n’ont<br />
qu’une très faib<strong>le</strong> influence sur <strong>le</strong> régime hydrologique.<br />
A Pessac-sur-Dordogne (33), <strong>le</strong> début <strong>de</strong> l’influence <strong>de</strong> la marée se fait sentir, mais <strong>le</strong><br />
phénomène d’inversement <strong>de</strong>s écou<strong>le</strong>ments n’intervient vraiment qu’à l’aval <strong>de</strong> Castillonla-Batail<strong>le</strong>,<br />
plus précisément en aval du site <strong>de</strong>s « graviers <strong>de</strong> Vignonet ».<br />
Cette limite correspond éga<strong>le</strong>ment à cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’extension amont du bouchon vaseux. Ce<br />
<strong>de</strong>rnier semb<strong>le</strong> se <strong>de</strong>nsifier <strong>de</strong>puis quelques années. Plusieurs causes sont évoquées<br />
(extraction <strong>de</strong> granulats, modification <strong>de</strong>s débits…) mais à ce jour aucune étu<strong>de</strong> n’a<br />
expliqué <strong>le</strong> constat. Le mascaret remonte jusqu’à l’amont <strong>de</strong> Libourne, ce phénomène<br />
spectaculaire se produit lors <strong>de</strong> la conjonction d’une forte marée montante et d’un faib<strong>le</strong><br />
débit <strong>de</strong> la Dordogne.<br />
Les enjeux en matière <strong>de</strong> gestion quantitative concernent <strong>de</strong>ux aspects :<br />
- <strong>le</strong>s débits d'étiage : <strong>le</strong>s débits <strong>de</strong> la Dordogne sont naturel<strong>le</strong>ment faib<strong>le</strong>s en été. Le<br />
SDAGE Adour-Garonne fixe <strong>de</strong>s va<strong>le</strong>urs minima<strong>le</strong>s à respecter. Sur <strong>le</strong> point <strong>de</strong><br />
contrô<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>, <strong>le</strong> Débit Objectif d'Etiage (débit minimum à respecter 4 années<br />
sur 5) est <strong>de</strong> 33 m3/s et <strong>le</strong> Débit <strong>de</strong> Crise (débit à tenir en toute circonstance) est <strong>de</strong><br />
16 m3/s. Les objectifs et <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s <strong>de</strong> gestion dans ce domaine seront traités dans <strong>le</strong><br />
cadre du Plan <strong>de</strong> Gestion d'Etiage Dordogne – Vézère, qui sera engagé en 2004. Le<br />
PGE Is<strong>le</strong>-Dronne est en cours <strong>de</strong> validation. Il prend en compte <strong>le</strong>s enjeux <strong>de</strong> la<br />
Dordogne fluvio-estuarienne.<br />
- Les éclusées : <strong>le</strong>s variations artificiel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> débit et <strong>de</strong> hauteur d'eau induites par <strong>le</strong><br />
fonctionnement <strong>de</strong>s barrages hydroé<strong>le</strong>ctriques <strong>de</strong> la haute Dordogne se font sentir<br />
jusqu'à la zone d'influence <strong>de</strong>s marées. La perturbation <strong>de</strong>s régimes hydrologiques au<br />
pas <strong>de</strong> temps journalier, hebdomadaire et saisonnier a <strong>de</strong>s impacts sur <strong>le</strong>s milieux et<br />
<strong>le</strong>s usages. Après l'étu<strong>de</strong> réalisée en 2001, un programme expérimental <strong>de</strong> réduction<br />
<strong>de</strong>s éclusées et <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs impacts est en cours d'élaboration. Il sera mis en œuvre<br />
dans <strong>le</strong> cadre d'un Défi Territorial <strong>de</strong> l'Agence <strong>de</strong> l'Eau en 2005 et 2006.<br />
2.4 La qualité <strong>de</strong>s eaux<br />
(cf. livret carto. p 13)<br />
La qualité <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> la basse Dordogne est pour partie héritée du reste du bassin<br />
versant. El<strong>le</strong> est éga<strong>le</strong>ment liée aux caractéristiques d’une rivière <strong>de</strong> plaine, large et<br />
<strong>le</strong>nte. Les eaux <strong>de</strong> la Dordogne sont donc naturel<strong>le</strong>ment chargées en sels dissous. Les<br />
va<strong>le</strong>urs moyennes restent toutefois assez peu é<strong>le</strong>vées pour une rivière <strong>de</strong> cette<br />
importance qui draine un bassin <strong>de</strong> 25 000 km². La teneur en nitrates est par exemp<strong>le</strong><br />
souvent inférieure à 10 mg/l, la norme <strong>de</strong> potabilité étant <strong>de</strong> 50. En ce qui concerne <strong>le</strong><br />
taux <strong>de</strong> matières en suspension, très bas en certaines pério<strong>de</strong>s, il peut rapi<strong>de</strong>ment<br />
monter en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> hautes eaux. La température varie selon <strong>le</strong>s cyc<strong>le</strong>s saisonniers. El<strong>le</strong><br />
dépasse fréquemment la va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong> 25°C en été.<br />
Cinq points <strong>de</strong> suivi appartenant aux réseaux classiques d’observation permettent <strong>de</strong><br />
disposer d’information sur la qualité <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> ce secteur.<br />
14
Co<strong>de</strong><br />
station<br />
05046000<br />
05045000<br />
05047000<br />
05047600<br />
05048210<br />
05026000<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Nom Dépt Localisation Réseau<br />
La Dordogne à<br />
Pessac<br />
La Dordogne à<br />
Branne<br />
La Dordogne en<br />
aval <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong><br />
La Dordogne à<br />
Cours <strong>de</strong> Pi<strong>le</strong><br />
La Dordogne à<br />
Trémolat<br />
La Dordogne au<br />
Port <strong>de</strong> St Pardon<br />
15<br />
Mise en<br />
service<br />
24 Pont <strong>de</strong> Pessac R.N.B. 1971<br />
Mise hors<br />
service<br />
33 Pont <strong>de</strong> la N136 à Branne I.N.P. 1971 1971<br />
24 Pont <strong>de</strong> la D4 à Gardonne R.N.B. 1971<br />
24<br />
Pont reliant la N660 à la<br />
D37 à Cours <strong>de</strong> Pi<strong>le</strong><br />
R.C.A.<br />
(A.G.)<br />
1975<br />
24 Pont <strong>de</strong> la D31 à Trémolat R.N.B. 1975<br />
33<br />
Port <strong>de</strong> St-Pardon, aval du<br />
confluent avec <strong>le</strong> Gestas<br />
R.N.B. 1971<br />
Objectif<br />
qualité<br />
Sur la basse Dordogne, il faut distinguer trois secteurs sur <strong>le</strong>squels la qualité <strong>de</strong> l’eau<br />
n’évolue pas <strong>de</strong> la même façon.<br />
La partie amont située entre Limeuil et <strong>Bergerac</strong> est essentiel<strong>le</strong>ment constituée <strong>de</strong>s<br />
retenues <strong>de</strong> barrages <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>, Tuilières et Mauzac. Les écou<strong>le</strong>ments sont très <strong>le</strong>nts<br />
et <strong>le</strong>s profon<strong>de</strong>urs importantes. Les phénomènes <strong>de</strong> décantation et <strong>de</strong> stratification<br />
dominent, pouvant favoriser à certaines pério<strong>de</strong>s <strong>le</strong> développement d’algues et <strong>de</strong><br />
plancton.<br />
Sur la partie médiane, entre <strong>Bergerac</strong> et Castillon-la-Batail<strong>le</strong>, la rivière est plus courante,<br />
<strong>le</strong>s zones <strong>de</strong> radiers alternent avec <strong>de</strong>s biefs plus profonds. Cette zone est propice à<br />
l’autoépuration, <strong>le</strong>s bancs <strong>de</strong> graviers jouent <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> <strong>de</strong> filtres et la faib<strong>le</strong> épaisseur d’eau<br />
favorisent l’action <strong>de</strong>s ultravio<strong>le</strong>ts.<br />
En aval <strong>de</strong> Castillon-la-Batail<strong>le</strong>, l’action <strong>de</strong> la marée permet <strong>le</strong> développement d’un<br />
bouchon vaseux où <strong>le</strong>s phénomènes d’adsorption modifient complètement <strong>le</strong>s échanges<br />
et <strong>le</strong>s équilibres chimiques. Un réseau <strong>de</strong> mesure est actuel<strong>le</strong>ment en cours d’installation<br />
à l’échel<strong>le</strong> du système Giron<strong>de</strong>-Garonne-Dordogne pour tenter <strong>de</strong> mieux comprendre <strong>le</strong><br />
fonctionnement et l’évolution <strong>de</strong> ce bouchon vaseux.<br />
Du point <strong>de</strong> vue bactériologique, <strong>le</strong>s étu<strong>de</strong>s menées en 1994 par EPIDOR montrent que la<br />
bonne qualité généra<strong>le</strong> <strong>de</strong> la basse Dordogne peut rapi<strong>de</strong>ment se dégra<strong>de</strong>r lors<br />
d’épiso<strong>de</strong>s particuliers, après <strong>de</strong>s orages notamment. Les données <strong>de</strong> suivi régulier sont<br />
actuel<strong>le</strong>ment trop rares pour bien apprécier cet aspect <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux.<br />
On observe, sur la basse Dordogne, une abondance d’objets flottants, principa<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>s<br />
débris végétaux issus <strong>de</strong> l’ensemb<strong>le</strong> du système Dordogne. Ils contribuent avec ceux <strong>de</strong><br />
la Garonne à la pollution <strong>de</strong>s plages <strong>de</strong> l’Atlantique et représentent une contrainte et<br />
parfois un danger pour l’exercice <strong>de</strong>s activités sur la basse Dordogne (pêche,<br />
navigation…). Une politique d’entretien menée sur l’ensemb<strong>le</strong> du bassin est <strong>de</strong> nature à<br />
réduire <strong>le</strong> volume <strong>de</strong> ces corps flottants. Mais ceux-ci représenteront toujours un volume<br />
suffisamment important pour causer <strong>de</strong>s nuisances. Un point <strong>de</strong> col<strong>le</strong>cte, placé<br />
suffisamment en aval, permettrait d’envisager <strong>le</strong> retrait et <strong>le</strong> traitement <strong>de</strong> la plupart <strong>de</strong>s<br />
apports et résoudrait en gran<strong>de</strong> partie <strong>le</strong>s problèmes causés sur la basse Dordogne, sur<br />
l’estuaire et sur <strong>le</strong> littoral.<br />
2.5 Les milieux<br />
(cf. livret carto. p 14, 15 & 16)<br />
Dans <strong>le</strong> contexte d'une vallée marquée par <strong>le</strong> développement d’un tissu urbain et<br />
industriel et par <strong>le</strong>s infrastructures routières et ferroviaires, certes assez lâche mais bien<br />
présent, <strong>le</strong>s milieux d’intérêt écologique sont en gran<strong>de</strong> partie situés sur ou à proximité<br />
immédiate <strong>de</strong> la Dordogne : îlots, bras morts, forêts alluvia<strong>le</strong>s, prairies. Certaines parties<br />
<strong>de</strong>s coteaux présentent <strong>de</strong>s boisements intéressants. Certains <strong>de</strong> ces milieux sont classés<br />
1B<br />
3<br />
1B<br />
1B<br />
1B
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
en zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou bien en Zone<br />
d’Intérêt pour la Conservation <strong>de</strong>s Oiseaux (ZICO).<br />
Les terres riveraines <strong>de</strong> la Dordogne en aval <strong>de</strong> Branne (33) forment <strong>de</strong>s zones<br />
faci<strong>le</strong>ment inondab<strong>le</strong>s (<strong>le</strong>s zones <strong>de</strong> palus), protégées par <strong>de</strong>s digues. Les palus sont <strong>de</strong>s<br />
dépressions situées au sein <strong>de</strong>s méandres en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong>s plus hautes eaux <strong>de</strong> la<br />
Dordogne. Ils sont drainés par un réseau comp<strong>le</strong>xe <strong>de</strong> canaux, <strong>de</strong> fossés réguliers<br />
appelés ja<strong>le</strong>s ou esteys. Des vannes et <strong>de</strong>s pel<strong>le</strong>s assurent <strong>le</strong> drainage à marée basse <strong>de</strong>s<br />
terres détrempées par l’aff<strong>le</strong>urement <strong>de</strong> la nappe phréatique et évitent la remontée <strong>de</strong>s<br />
eaux salées à marée haute. Les palus, caractéristiques du système fluvio-estuarien, sont<br />
délimités par <strong>de</strong>s bourre<strong>le</strong>ts fluviaux composés <strong>de</strong> sab<strong>le</strong> et <strong>de</strong> vase. Ce sont <strong>de</strong>s zones<br />
d’intérêt patrimonial au niveau végétal et animal. Nombreuses espèces d’oiseaux<br />
migrateurs y trouvent refuge. Certains sites ont été classés par <strong>le</strong>s départements en<br />
Espace Naturel Sensib<strong>le</strong> et font l'objet <strong>de</strong> plans <strong>de</strong> gestion particuliers. Par ail<strong>le</strong>urs <strong>le</strong>s<br />
orientations fixées en matière d’urbanisme par <strong>le</strong>s Plans <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques<br />
d’Inondation posent <strong>de</strong>s règ<strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s pour l’utilisation <strong>de</strong> ces zones, avec <strong>de</strong>s<br />
conséquences possib<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong>ur future évolution.<br />
Les berges <strong>de</strong> la Dordogne constituent <strong>de</strong>s zones sensib<strong>le</strong>s tant du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s<br />
milieux que <strong>de</strong>s usages : protection contre l'érosion par la rivière, fréquentation<br />
touristique. Les étu<strong>de</strong>s réalisées ou en cours sur l'ensemb<strong>le</strong> du linéaire <strong>de</strong> la basse<br />
Dordogne montrent que <strong>le</strong>s zones d'érosions sont peu nombreuses et menacent rarement<br />
<strong>le</strong>s infrastructures et <strong>le</strong>s activités. Par contre, el<strong>le</strong>s mettent en évi<strong>de</strong>nce un besoin<br />
d'entretien régulier et adapté. La mise en œuvre <strong>de</strong> ces interventions s’avère parfois<br />
problématique lorsqu’il s’agit d’intervenir à la fois sur <strong>le</strong> Domaine Public Fluvial (talus <strong>de</strong><br />
berges) et chez <strong>de</strong>s propriétaires privés (sommet <strong>de</strong> berge). Chacun répond en effet à un<br />
régime juridique et à <strong>de</strong>s règ<strong>le</strong>s propres qui comp<strong>le</strong>xifient fortement <strong>le</strong>s interventions.<br />
On trouve éga<strong>le</strong>ment, dans <strong>le</strong> lit majeur, d’anciens sites d’extractions <strong>de</strong> granulats qui<br />
forment aujourd’hui <strong>de</strong>s milieux humi<strong>de</strong>s nouveaux, remarquab<strong>le</strong>s pour bon nombre<br />
d’espèces. Leur gestion peut éga<strong>le</strong>ment constituer un enjeu environnemental important.<br />
2.6 La faune et la flore<br />
La basse Dordogne offre une gran<strong>de</strong> richesse piscico<strong>le</strong>. On y retrouve la majorité <strong>de</strong>s<br />
espèces <strong>de</strong> la zone à brême : gardons, ab<strong>le</strong>ttes, brèmes, carpes, sandre, silure. Sur la<br />
partie aval, la dynamique fluvio-estuarienne permet la présence du f<strong>le</strong>t et du bar.<br />
La basse Dordogne est surtout réputée pour ses poissons migrateurs : esturgeon,<br />
saumon, truite <strong>de</strong> mer, lamproie marine, lamproie fluviati<strong>le</strong>, anguil<strong>le</strong>, gran<strong>de</strong> alose, alose<br />
feinte. Selon <strong>le</strong>ur cyc<strong>le</strong> biologique ils exploitent différemment <strong>le</strong> milieu :<br />
- Le saumon et la truite vivent et se reproduisent sur la Dordogne amont et ne font que<br />
transiter sur la basse rivière.<br />
- Pour la gran<strong>de</strong> alose, la lamproie marine, la lamproie fluviati<strong>le</strong> et l’anguil<strong>le</strong>, la basse<br />
Dordogne constitue la limite aval <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur aire fluvia<strong>le</strong> <strong>de</strong> développement.<br />
- Pour l’alose feinte, <strong>le</strong> mu<strong>le</strong>t, <strong>le</strong> f<strong>le</strong>t et l’esturgeon la basse vallée comprend la totalité<br />
<strong>de</strong> <strong>le</strong>ur habitat fluvial et permet <strong>le</strong> développement <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur population.<br />
L'équipement <strong>de</strong>s barrages <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>, Tuilières et Mauzac en ouvrages <strong>de</strong><br />
franchissement a permis la reconquête <strong>de</strong> la moyenne et haute Dordogne par <strong>le</strong> saumon,<br />
l'alose et la lamproie. Des améliorations restent néanmoins à apporter sur ces obstac<strong>le</strong>s,<br />
vis-à-vis notamment <strong>de</strong> la dévalaison. Des démarches ont été entreprises en ce sens<br />
dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong>s poissons migrateurs.<br />
Une réf<strong>le</strong>xion concerne par ail<strong>le</strong>urs l’amélioration <strong>de</strong> la connexion <strong>de</strong> l’axe Dordogne avec<br />
son réseau d’affluents, en vue <strong>de</strong> faciliter l’accès <strong>de</strong>s anguil<strong>le</strong>s à <strong>le</strong>urs habitats sur <strong>le</strong><br />
16
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
réseau secondaire. Cette réf<strong>le</strong>xion s’intègre dans <strong>le</strong> cadre plus large d’un programme<br />
européen Interreg III, baptisé Indicang.<br />
La présence <strong>de</strong>s espèces migratrices a motivé l'inscription du lit <strong>de</strong> la Dordogne à<br />
l'inventaire <strong>de</strong>s sites Natura 2000.<br />
Les palus <strong>de</strong> la basse vallée, abritent <strong>de</strong>ux mammifères aquatiques classés espèces<br />
d’intérêt communautaire : la loutre commune (Lutra lutra) et <strong>le</strong> vison d’Europe (Mustela<br />
lutreola). Ces zones humi<strong>de</strong>s représentent aussi un site <strong>de</strong> grand intérêt pour <strong>le</strong>s oiseaux<br />
d’eau.<br />
Sur ces mêmes secteurs, on rencontre <strong>de</strong>s espèces végéta<strong>le</strong>s d’intérêt patrimonial tel<strong>le</strong>s<br />
que l’Angélique à fruits variab<strong>le</strong>s (Angelica heterocarpa), la nivéo<strong>le</strong> d’été (Leucojum<br />
aestivum), la Gratio<strong>le</strong> officina<strong>le</strong> (Gratiola officinalis) et la pulicaire vulgaire (Pulcaria<br />
vulgaris). Ces espèces sont protégées à l’échel<strong>le</strong> nationa<strong>le</strong> ou communautaire.<br />
Certaines espèces introduites perturbent <strong>le</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s milieux. Des végétaux<br />
tels que la renouée du japon empêchent <strong>le</strong> développement <strong>de</strong> la strate arbustive <strong>de</strong>s<br />
berges, qui est essentiel<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>ur stabilité. Des espèces végéta<strong>le</strong>s comme la jussie<br />
posent <strong>le</strong> risque <strong>de</strong> fermeture <strong>de</strong>s milieux et d’asphyxie <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> bras mort. Parmi<br />
<strong>le</strong>s espèces anima<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> ragondin et <strong>le</strong> rat musqué font l'objet <strong>de</strong>puis plusieurs années <strong>de</strong><br />
campagnes d'éradication en raison <strong>de</strong>s dégâts qu'ils occasionnent aux cultures et aux<br />
berges. D'autres espèces moins connues ou d'introduction plus récente représentent une<br />
menace pour <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>ments autochtones : silure glane, écrevisse <strong>de</strong> Louisiane, crabe<br />
chinois, grenouil<strong>le</strong> taureau.<br />
2.7 Les paysages<br />
(cf. livret carto. p 17)<br />
Le Plan <strong>Pays</strong>ages <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Dordogne réalisé en 1994 i<strong>de</strong>ntifie six entités<br />
paysagères sur la basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne.<br />
- "De Limeuil à Mauzac, ou la <strong>le</strong>çon <strong>de</strong> géographie" : ce sont <strong>le</strong>s paysages <strong>de</strong>s grands<br />
cing<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Limeuil et <strong>de</strong> Trémolat.<br />
- "De Mauzac à Cours-<strong>de</strong>-Pi<strong>le</strong>, <strong>de</strong>s terrasses sur la Dordogne" : c’est un secteur en<br />
p<strong>le</strong>ine mutation. La route en rive droite parallè<strong>le</strong> au coteau structure l’urbanisation et<br />
l’étire <strong>le</strong> long <strong>de</strong> son axe. Les établissements industriels sont plus ou moins vétustes.<br />
L’activité agrico<strong>le</strong> est principa<strong>le</strong>ment présente en rive gauche. Le canal <strong>de</strong> dérivation<br />
<strong>de</strong> Lalin<strong>de</strong> longe la rivière en rive droite.<br />
- "De Cours-<strong>de</strong>-Pi<strong>le</strong> au F<strong>le</strong>ix, l’essor <strong>de</strong> la vigne" : la Dordogne forme <strong>de</strong>s méandres<br />
dans une vallée élargie, où se développent <strong>le</strong>s vergers, <strong>le</strong> maïs et <strong>le</strong>s prairies. La<br />
vigne occupe <strong>le</strong>s coteaux. L’urbanisation reste diffuse et <strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s constructions<br />
ont tendances à noyer <strong>le</strong> patrimoine architectural.<br />
- Du F<strong>le</strong>ix à Castillon-la-Batail<strong>le</strong>, entre vergers et vignob<strong>le</strong>s : La vallée s’inscrit entre<br />
<strong>de</strong>ux coteaux s’évasant peu à peu vers l’aval. Les points é<strong>le</strong>vés constituent <strong>de</strong>s<br />
belvédères. Le paysage est animé et diversifié du point <strong>de</strong> vue agrico<strong>le</strong>. On retrouve<br />
un patrimoine rural vernaculaire abondant constitué <strong>de</strong> nombreux ports et petits<br />
aménagements en bordure <strong>de</strong> rivière.<br />
- "De Castillon-la-Batail<strong>le</strong> au pont <strong>de</strong> Cubzac entre vignob<strong>le</strong>s et marais" : <strong>le</strong> fond <strong>de</strong> la<br />
vallée se caractérise par <strong>le</strong> paysage <strong>de</strong>s palus où subsistent <strong>le</strong>s traces d’un bocage <strong>de</strong><br />
chênes et <strong>de</strong> frênes. Les bords <strong>de</strong> la Dordogne sont occupés par <strong>de</strong> nombreux petits<br />
ports attenants aux villages. Sur ce linéaire, la Dordogne a contribué à façonner <strong>le</strong><br />
terroir exceptionnel constituant l'ancienne Juridiction <strong>de</strong> Saint-Emilion, inscrit en 1999<br />
au Patrimoine Mondial <strong>de</strong> l'UNESCO au titre <strong>de</strong>s paysages culturels.<br />
17
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
- "De Cubzac-<strong>le</strong>s-Ponts au Bec d’Ambés la Dordogne <strong>de</strong> l’estuaire" : c’est un paysage<br />
marqué par l’ambiance marine et la dissymétrie <strong>de</strong> la vallée avec <strong>le</strong>s coteaux vitico<strong>le</strong>s<br />
au nord et la plaine <strong>de</strong> l'Entre-Deux-Mers au sud, marquée par <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
installations industriel<strong>le</strong>s.<br />
2.8 Le patrimoine<br />
La basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne est marquée d’une histoire forte qui se traduit aujourd’hui<br />
par la présence <strong>de</strong> nombreux sites qui retracent <strong>le</strong>s différentes époques.<br />
Ainsi, <strong>de</strong>s villas gallo-romaines aux basti<strong>de</strong>s (Montcaret, Libourne, Sainte-Foy-La-Gran<strong>de</strong>,<br />
Lalin<strong>de</strong>), la basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne dispose d’un vaste patrimoine architectural.<br />
Ces éléments sont complétés d’un vaste réseau <strong>de</strong> quais (<strong>Bergerac</strong>, Tuilières, Castillon-<br />
La-batail<strong>le</strong>, Flaujagues, Branne, Génissac…), témoins <strong>de</strong> l’activité marchan<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
Dordogne.<br />
De nombreux châteaux fortifiés ou non selon qu’ils sont issus <strong>de</strong>s guerres ou <strong>de</strong> la<br />
culture <strong>de</strong> la vigne (Limeuil, Château <strong>de</strong> Barrail, <strong>de</strong> Cadillac-en-Fronsadais, <strong>de</strong> Vayres, <strong>de</strong><br />
La Rivière, <strong>de</strong> Baneuil ou <strong>de</strong> Ba<strong>de</strong>fols), surplombent la rivière.<br />
Enfin, il faut y ajouter l’impressionnant patrimoine issu <strong>de</strong>s traditions, <strong>de</strong>s métiers liés à<br />
la rivière ou du développement <strong>de</strong>s populations riveraines (<strong>de</strong>meures, chais, hangar à<br />
tabac, papeterie…).<br />
2.9 La démographie<br />
(cf. livret carto. p 18)<br />
La basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne compte environ 180 000 habitants, soit une <strong>de</strong>nsité<br />
comprise entre 70 hab./km² dans la zone amont et 100 hab./km² en aval. L’urbanisation<br />
est plutôt diffuse. Mais el<strong>le</strong> prend une place croissante dans la vallée au fur et à mesure<br />
que l'on s'approche <strong>de</strong> Libourne et <strong>de</strong> l'aire d'influence <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux. Les <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong>s<br />
communes ont moins <strong>de</strong> 1 000 habitants. On trouve <strong>de</strong>ux vil<strong>le</strong>s <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 20 000<br />
habitants (<strong>Bergerac</strong> et Libourne) quelques gros bourgs (Lalin<strong>de</strong>, Sainte-Foy-la-Gran<strong>de</strong>,<br />
Castillon-la-Batail<strong>le</strong>) et <strong>de</strong> nombreux villages. La plupart <strong>de</strong>s villages sont construits sur<br />
<strong>le</strong>s anciennes terrasses, à l’abri <strong>de</strong>s crues <strong>de</strong> la rivière, laissant place aux cultures dans la<br />
plaine. La plaine alluvia<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s basses terrasses connaissent un habitat plus diffus.<br />
2.10 L’agriculture<br />
L’activité agrico<strong>le</strong> occupe une place prépondérante dans l’économie <strong>de</strong> la vallée. El<strong>le</strong> est<br />
fondée à l’amont sur la polyculture et l’é<strong>le</strong>vage. Vers l’aval, à partir <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>, la vigne<br />
prend une place prédominante aux côtés du maraîchage et <strong>de</strong> l’arboriculture. La<br />
maïsiculture se développe et vient souvent remplacer <strong>le</strong>s prairies humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s palus.<br />
Sur la basse Dordogne, l’agriculture est aussi une activité majeure pour la gestion <strong>de</strong>s<br />
espaces et <strong>de</strong>s paysages. Les terrains qui bor<strong>de</strong>nt la rivière sont en effet principa<strong>le</strong>ment<br />
agrico<strong>le</strong>s. Une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s enjeux <strong>de</strong> mise en va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong> l’espace fluvial est donc en<br />
lien avec l’activité agrico<strong>le</strong>.<br />
Si l’impact du développement <strong>de</strong>s cultures irriguées reste modéré sur l’axe Dordogne, il<br />
est parfois déterminant sur <strong>de</strong>s petits affluents qui peuvent subir <strong>de</strong>s prélèvements<br />
supérieurs à <strong>le</strong>ur capacité en été. Ces problèmes <strong>de</strong> déficit estival <strong>de</strong> ressource en étiage<br />
trouveront <strong>de</strong>s solutions dans la mise en œuvre <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> gestion d’étiage (PGE)<br />
engagés sur <strong>le</strong>s sous-bassins Is<strong>le</strong> Dronne et Dordogne Vézère. Dans ces procédures<br />
néanmoins, <strong>le</strong>s plus gran<strong>de</strong>s difficultés consistent à établir <strong>le</strong>s objectifs d’étiage réalistes<br />
18
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
et suffisamment précis, par sous bassins. Etant donnée la faib<strong>le</strong> couverture <strong>de</strong>s affluents<br />
par <strong>le</strong> réseau <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong>s débits, <strong>le</strong>s connaissances sont certainement aujourd’hui<br />
insuffisantes pour alimenter correctement <strong>le</strong>s réf<strong>le</strong>xions du futur PGE.<br />
2.11 L’industrie<br />
On rencontre dans la basse vallée une industrie basée sur l’agroalimentaire (conserverie,<br />
vinification), la chimie et la papeterie. Le développement <strong>de</strong> ces activités suit celui <strong>de</strong><br />
l’urbanisation <strong>le</strong> long <strong>de</strong> l’axe <strong>Bergerac</strong> – Libourne et en périphérie <strong>de</strong> l’agglomération<br />
Bor<strong>de</strong>laise. L’industrie reste assez dispersée et <strong>le</strong>s entreprises sont souvent <strong>de</strong> petite<br />
tail<strong>le</strong> (conserverie agroalimentaire, coopératives agrico<strong>le</strong>s…). Il existe toutefois <strong>de</strong>s<br />
foyers industriels plus importants au pourtour <strong>de</strong>s agglomérations <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>, <strong>de</strong><br />
Libourne et d’Ambès.<br />
Il existe, sur la basse Dordogne, une exploitation hydroé<strong>le</strong>ctrique alimentée par trois<br />
barrages au fil <strong>de</strong> l’eau (usines EDF <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>, Tuilières et Mauzac). Ces barrages<br />
peuvent provoquer <strong>de</strong>s nuisances en concentrant <strong>le</strong>s objets flottants qui dérivent du<br />
bassin amont et qui sont régulièrement relargués à l’occasion <strong>de</strong> chasses périodiques.<br />
Barrage Volume <strong>de</strong> la retenue en<br />
m3<br />
Puissance en KW Production Annuel<strong>le</strong> en<br />
MW/h<br />
Mauzac 1 250 000 18 500 63 000<br />
Tuilière 150 000 37 400 37 400<br />
<strong>Bergerac</strong> 10 000 1 500 9 200<br />
L’exploitation industriel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s granulats est éga<strong>le</strong>ment assez développée dans <strong>le</strong> lit<br />
majeur <strong>de</strong> la Dordogne. Les sites sont exploités pendant une durée limitée. Leur<br />
réhabilitation après exploitation constitue un enjeu important pour <strong>le</strong>s milieux, <strong>le</strong>s<br />
paysages et la mise en va<strong>le</strong>ur touristique <strong>de</strong> la basse vallée.<br />
2.12 Le tourisme et <strong>le</strong> patrimoine fluvial<br />
(cf. livret carto. p 19)<br />
La basse vallée possè<strong>de</strong> un potentiel touristique important. Les paysages <strong>de</strong> la basse<br />
vallée sont riches et diversifiés. Le long passé <strong>de</strong> la navigation marchan<strong>de</strong> a laissé un<br />
important patrimoine architectural (quais, ports, embarcadères, basti<strong>de</strong>s, bourgs, canal<br />
<strong>de</strong> Lalin<strong>de</strong>). Ce patrimoine constitue un point d’attrait pour <strong>le</strong> tourisme lié au f<strong>le</strong>uve.<br />
Cependant, il nécessite souvent <strong>de</strong>s investissements importants pour sa conservation et<br />
sa remise en état.<br />
Sa mise en va<strong>le</strong>ur, associée au développement <strong>de</strong> la navigation, est perçue par <strong>le</strong>s<br />
acteurs locaux comme un élément déterminant pour la navigation <strong>de</strong> plaisance sur la<br />
basse Dordogne.<br />
Le <strong>Pays</strong> du Libournais a engagé dès 2003, une étu<strong>de</strong> visant à réaliser un audit <strong>de</strong>s sites<br />
et établir un programme <strong>de</strong> réhabilitation dans un doub<strong>le</strong> objectif <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s<br />
activités fluvia<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> conservation du patrimoine.<br />
La promotion touristique <strong>de</strong> la basse Dordogne s'inscrit dans cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> l'ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong> la<br />
vallée. Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> marketing touristique <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Dordogne a été réalisée par<br />
EPIDOR en 2004. Les réf<strong>le</strong>xions, qui ont associé <strong>le</strong>s services <strong>de</strong>s départements et <strong>de</strong>s<br />
régions concernés, donneront lieu à <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> communication et <strong>de</strong> mise en marché<br />
à différentes échel<strong>le</strong>s.<br />
19
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
2.13 Les loisirs nautiques<br />
(cf. livret carto. p 20)<br />
De par la nature du cours <strong>de</strong> la Dordogne, <strong>le</strong>s usages nautiques prennent différentes<br />
facettes selon <strong>le</strong>s secteurs :<br />
- Sur la Dordogne <strong>de</strong> Limeuil à <strong>Bergerac</strong>, <strong>le</strong>s retenues <strong>de</strong>s barrages <strong>de</strong> Mauzac et <strong>de</strong><br />
<strong>Bergerac</strong> sont utilisées par <strong>de</strong>s gabares, pour <strong>le</strong> motonautisme, la voi<strong>le</strong> et l’aviron.<br />
Les biefs offrent aussi <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> navigation col<strong>le</strong>ctive. En outre, la présence<br />
du canal <strong>de</strong> Lalin<strong>de</strong> constitue un élément fort qu'il reste à valoriser.<br />
- Sur <strong>le</strong> secteur médian, <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong> à Castillon-la-Batail<strong>le</strong>, la Dordogne offre <strong>de</strong>s<br />
possibilités <strong>de</strong> navigation légère à partir d’embarcations individuel<strong>le</strong>s ou <strong>de</strong> petites<br />
tail<strong>le</strong>s (canoë-kayak, aviron). On retrouve la navigation col<strong>le</strong>ctive sur <strong>le</strong>s biefs.<br />
- La portion estuarienne (en aval <strong>de</strong> Castillon-la-Batail<strong>le</strong>) est adaptée à l’activité <strong>de</strong><br />
plaisance. Un développement <strong>de</strong>s programmations <strong>de</strong> Tour Opérateur sur <strong>de</strong>s<br />
péniches hôtels est envisagé. La navigation <strong>de</strong> ce secteur est effectuée avec la<br />
marée, el<strong>le</strong> est tributaire du mascaret. Le phénomène du mascaret attire <strong>de</strong>puis<br />
quelques années <strong>le</strong>s surfeurs et canoéistes, en particulier sur <strong>le</strong> site <strong>de</strong> Saint-Pardon<strong>de</strong>-Vayres.<br />
L’activité <strong>de</strong> baigna<strong>de</strong>, la plupart du temps spontanée, concerne différents sites répartis<br />
sur l’ensemb<strong>le</strong> du linéaire. Un schéma interdépartemental <strong>de</strong>s loisirs nautiques sur la<br />
Dordogne a été réalisé par EPIDOR en 1998. Il sert <strong>de</strong> cadre <strong>de</strong> cohérence à l'élaboration<br />
<strong>de</strong>s plans départementaux <strong>de</strong> randonnée nautiques. Le PDRN <strong>de</strong> la Dordogne a ainsi été<br />
élaboré en 2000.<br />
L’implantation d’un sta<strong>de</strong> d’eaux vives pour la pratique familia<strong>le</strong> et sportive du canoë et<br />
du kayak est à l’étu<strong>de</strong> sur <strong>le</strong> barrage <strong>de</strong> Mauzac.<br />
2.14 La pêche<br />
(cf. livret carto. p 21)<br />
Il existe une activité <strong>de</strong> pêche professionnel<strong>le</strong> sur la basse Dordogne. Si cette activité<br />
marque un certain déclin sur l’ensemb<strong>le</strong> du territoire français, la Dordogne apparaît<br />
comme une zone relativement dynamique qui concentre encore un assez grand nombre<br />
d’entreprises <strong>de</strong> pêche. Cel<strong>le</strong>s-ci sont réparties en <strong>de</strong>ux organisations :<br />
- l’association agréée départementa<strong>le</strong> <strong>de</strong>s pêcheurs professionnels en eau douce <strong>de</strong><br />
la Giron<strong>de</strong> (AADPPEDG), qui regroupe environ 80 entreprises.<br />
- L’association agréée interdépartementa<strong>le</strong> <strong>de</strong>s pêcheurs professionnels du bassin<br />
<strong>de</strong> la Garonne (AAIPPBG), qui compte environ 30 entreprises.<br />
La production piscico<strong>le</strong> globa<strong>le</strong> représente un chiffre d’affaire <strong>de</strong> 5 à 10 millions d’euros<br />
sur l’ensemb<strong>le</strong> Giron<strong>de</strong>-Garonne-Dordogne. Le métier <strong>de</strong> pêcheur s’inscrit parfois dans <strong>le</strong><br />
cadre d’une pluriactivité, surtout dans <strong>le</strong> secteur amont, en complément d’activités<br />
agrico<strong>le</strong>, touristique, d’é<strong>le</strong>vage piscico<strong>le</strong>… La pêche professionnel<strong>le</strong> fait partie du<br />
patrimoine culturel <strong>de</strong> la région au travers <strong>de</strong>s techniques et <strong>de</strong> la gastronomie.<br />
L’exploitation porte principa<strong>le</strong>ment sur <strong>le</strong>s poissons migrateurs dans la partie aval, et sur<br />
<strong>le</strong>s espèces sé<strong>de</strong>ntaires à l’amont. Cette activité souffre <strong>de</strong> différents problèmes parmi<br />
<strong>le</strong>squels la dégradation du milieu naturel, <strong>le</strong> déclin et <strong>le</strong>s aléas <strong>de</strong> certains stocks et <strong>le</strong><br />
manque <strong>de</strong> valorisation <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> la pêche.<br />
La pêche <strong>de</strong> loisir est pratiquée sur l’ensemb<strong>le</strong> du linéaire. Seize associations agréées <strong>de</strong><br />
pêche et <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s milieux aquatiques (AAPPMA) sont concernées par la basse<br />
Dordogne. Leur action est coordonnée par <strong>le</strong>s fédérations départementa<strong>le</strong>s <strong>de</strong> pêche <strong>de</strong><br />
la Dordogne et <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong>. Deux associations <strong>de</strong> pêcheurs amateurs aux engins et<br />
20
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
fi<strong>le</strong>ts rassemb<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s pratiquant <strong>de</strong> cette activité qui prend <strong>de</strong>s formes très diverses<br />
selon <strong>le</strong>s secteurs <strong>de</strong> la rivière (carre<strong>le</strong>ts, nasses, fi<strong>le</strong>ts,…). Des plans départementaux <strong>de</strong><br />
gestion piscico<strong>le</strong> (PDGP) sont en cours <strong>de</strong> réalisation sur <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux départements.<br />
La pêche <strong>de</strong> loisir intéresse essentiel<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s locaux. Néanmoins, <strong>le</strong> développement du<br />
tourisme vert induit la présence en été d'une clientè<strong>le</strong> potentiel<strong>le</strong> pour <strong>de</strong>s produits pêche<br />
que <strong>le</strong>s fédérations tentent actuel<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> développer, autour notamment d’espèces<br />
phares comme l’alose ou <strong>le</strong> mu<strong>le</strong>t.<br />
2.15 La chasse<br />
L’activité chasse <strong>le</strong> long <strong>de</strong> la rivière Dordogne concerne, dans <strong>le</strong> département <strong>de</strong> la<br />
Giron<strong>de</strong>, 39 associations <strong>de</strong> chasse, qui regroupent plus <strong>de</strong> 3 000 chasseurs. 24 sont <strong>de</strong>s<br />
Associations Communa<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Chasse Agréées (ACCA) et 15 <strong>de</strong> Associations <strong>de</strong> Chasse<br />
Sociétés <strong>de</strong> Chasse type 1901.<br />
La chasse du gibier d’eau, qui dépend <strong>de</strong>s milieux aquatiques et humi<strong>de</strong>s et qui est <strong>de</strong> ce<br />
fait concernée par la problématique du Contrat <strong>de</strong> Basse Vallée, se pratique différemment<br />
selon <strong>le</strong>s espèces recherchées :<br />
• Les anatidés et la Foulque macrou<strong>le</strong> sont chassés principa<strong>le</strong>ment à la tonne<br />
(hutte fixe avec appelants disposés sur une mare naturel<strong>le</strong> ou artificiel<strong>le</strong>) et à la<br />
passée du matin et du soir. 157 tonnes (déclaration préfectora<strong>le</strong> obligatoire)<br />
sont recensées <strong>le</strong> long <strong>de</strong> la Dordogne, <strong>de</strong> l’Is<strong>le</strong> aval et du Moron.<br />
• Les limico<strong>le</strong>s, Vanneau huppé et Pluvier doré sont chassés <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s affûts ou<br />
éga<strong>le</strong>ment à la passée dans <strong>le</strong>s secteurs <strong>de</strong> prairies humi<strong>de</strong>s.<br />
• La Bécasse <strong>de</strong>s bois et <strong>le</strong> Râ<strong>le</strong> d’eau sont chassés au chien d’arrêt dans <strong>le</strong>s<br />
boisements humi<strong>de</strong>s et <strong>le</strong>s roselières, alors que la Bécassine <strong>de</strong>s marais est<br />
chassée « <strong>de</strong>vant soi » avec ou sans chien d’arrêt dans <strong>le</strong>s marais et prairies<br />
humi<strong>de</strong>s.<br />
Des actions <strong>de</strong> conservation ont été réalisées par <strong>le</strong>s acteurs cynégétiques (ACCA, FDC<br />
33 et Fondation Nationa<strong>le</strong> pour la Protection <strong>de</strong>s Habitats Français <strong>de</strong> la Faune Sauvage)<br />
sur <strong>le</strong>s communes <strong>de</strong> Prignac et Marcamps, et <strong>de</strong> Cézac dans la vallée du Moron : 3<br />
territoires ont été acquis, pour une superficie d’une trentaine d’hectares.<br />
De plus, en 2004, 102 hectares <strong>de</strong> marais ont été entretenus <strong>le</strong> long <strong>de</strong> la Dordogne et<br />
du Moron, par <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> fauche réalisés par plusieurs associations <strong>de</strong> chasse que la<br />
Fédération subventionne au titre <strong>de</strong> l’entretien <strong>de</strong> zones humi<strong>de</strong>s abandonnées. En effet,<br />
<strong>le</strong> phénomène <strong>de</strong> déprise agrico<strong>le</strong> due à l’abandon <strong>de</strong>s activités d’é<strong>le</strong>vage, comme la<br />
fauche et <strong>le</strong> pâturage, conduit à un vieillissement <strong>de</strong>s milieux humi<strong>de</strong>s et à une perte <strong>de</strong><br />
diversité floristique et faunistique.<br />
2.16 Les rejets et l’assainissement<br />
(cf. livret carto. p 22)<br />
2.16.1 Les rejets domestiques<br />
Environ 60% <strong>de</strong>s communes possè<strong>de</strong>nt un équipement <strong>de</strong> col<strong>le</strong>cte et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s<br />
eaux usées. Cette va<strong>le</strong>ur est dans la moyenne <strong>de</strong> l’équipement du bassin <strong>de</strong> la Dordogne.<br />
Parmi ces communes, l’assainissement n’est pas toujours achevé et certains équipements<br />
peuvent parfois présenter <strong>de</strong>s dysfonctionnements, notamment par temps <strong>de</strong> pluie (eaux<br />
parasites).<br />
De gros investissements restent donc à réaliser pour l’atteinte <strong>de</strong>s objectifs prescrits par<br />
la directive cadre européenne sur <strong>le</strong>s eaux résiduaires urbaines qui prévoit<br />
21
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
l’assainissement comp<strong>le</strong>t <strong>de</strong> toutes <strong>le</strong>s agglomérations <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 2 000 habitants à<br />
l’horizon 2005. Des aménagements complémentaires restent éga<strong>le</strong>ment à faire pour<br />
limiter <strong>le</strong>s concentrations en éléments bactériologiques <strong>de</strong>s rejets <strong>de</strong> stations d’épuration<br />
en particulier dans <strong>le</strong>s secteurs où <strong>de</strong>s activités aquatiques ont lieu (baigna<strong>de</strong>, nautisme).<br />
Des services publics d’assainissement non col<strong>le</strong>ctif (SPANC) doivent être mis en place<br />
avant <strong>le</strong> 31 décembre 2005. On constate un important retard général dans ce domaine.<br />
2.16.2 Les rejets agrico<strong>le</strong>s<br />
En matière d’impact agrico<strong>le</strong> sur la qualité <strong>de</strong>s eaux, l’élément principal et <strong>le</strong> mieux<br />
connu est certainement la pollution organique provoquée par l’activité vitico<strong>le</strong>, très<br />
développée dans toute la basse vallée. Ces pollutions interviennent à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s<br />
précises et <strong>le</strong>ur impact est très variab<strong>le</strong> selon <strong>le</strong>s milieux qui <strong>le</strong>s reçoivent. El<strong>le</strong>s peuvent<br />
être assez rapi<strong>de</strong>ment assimilées par la Dordogne mais peuvent très lour<strong>de</strong>ment affecter<br />
<strong>le</strong>s plus petits cours d’eau. Des solutions sont en train <strong>de</strong> se mettre en place sur ce<br />
thème.<br />
Le second point concerne l’usage <strong>de</strong>s produits phytosanitaires, qui n’est d’ail<strong>le</strong>urs pas<br />
uniquement lié à l’agriculture. Les différentes activités agrico<strong>le</strong>s engendrent l’usage d’une<br />
gran<strong>de</strong> variété <strong>de</strong> produits phytosanitaires. Ces pollutions sont aujourd’hui très mal<br />
cernées, du fait notamment <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> variété <strong>de</strong>s substances qui rend diffici<strong>le</strong> <strong>le</strong>ur<br />
détection et du fait du faib<strong>le</strong> nombre <strong>de</strong> mesures effectuées sur ce thème.<br />
Enfin, l’apport diffus <strong>de</strong> substances nutritives pour <strong>le</strong>s cultures ne semb<strong>le</strong> pas affecter<br />
fortement la rivière Dordogne sur cette zone. Des analyses complémentaires seraient<br />
toutefois nécessaires pour <strong>le</strong> confirmer.<br />
2.16.3 Les rejets industriels<br />
L’équipement <strong>de</strong>s installations industriel<strong>le</strong>s en système d’épuration <strong>de</strong>s eaux a fortement<br />
progressé au cours <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières années sur la basse Dordogne. Le niveau<br />
d’assainissement <strong>de</strong>s industries a progressé <strong>de</strong> façon importante au cours <strong>de</strong> ces<br />
<strong>de</strong>rnières années mais il n’est pas homogène dans toutes <strong>le</strong>s entreprises. Des<br />
investissements importants restent à engager sur certains sites pour améliorer <strong>le</strong><br />
traitement <strong>de</strong>s effluents.<br />
2.17 Les prélèvements d’eau<br />
(cf. livret carto. p 23)<br />
En Mm 3 AEP Industrie Irrigation Total<br />
Nappe captive 3.963 0.059 0.107 4.129<br />
Nappes phréatiques et sources 0.601 0.107 1.763 2.471<br />
Nappes superficiel<strong>le</strong>s 0.014 1.373 5.575 6.962<br />
Total 4.5781 1.539 7.445 13.562<br />
Les débits <strong>de</strong> la Dordogne sont soutenus, en été, par <strong>le</strong> débit réservé induit par <strong>le</strong>s<br />
barrages amont sur la Dordogne et la Vézère. Ils ne semb<strong>le</strong>nt pas fortement affectés par<br />
<strong>le</strong>s prélèvements en rivière et nappes d’accompagnement.<br />
Sur l’axe Dordogne, l’alimentation en eau pour <strong>le</strong>s différents usages ne connaît pas <strong>de</strong><br />
difficulté d’ordre quantitatif, ce qui n’est pas <strong>le</strong> cas sur certains affluents. On constate<br />
néanmoins une baisse régulière du niveau <strong>de</strong> la nappe éocène dans plusieurs secteurs <strong>de</strong><br />
la basse vallée. Cette évolution s’inscrit dans <strong>le</strong> contexte <strong>de</strong> l’abaissement très fort <strong>de</strong><br />
22
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
cette nappe constaté autour <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux et qui a motivé la mise en œuvre du SAGE<br />
Nappes Profon<strong>de</strong>s en Giron<strong>de</strong>.<br />
Sans qu’un lien soit établi entre <strong>le</strong>s prélèvements effectués en Giron<strong>de</strong> et la baisse <strong>de</strong> la<br />
nappe sur la basse vallée, il est nécessaire d’assurer une gestion cohérente à l’échel<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
cet aquifère (cf. groupe <strong>de</strong> liaison interdépartemental du SAGE Nappes Profon<strong>de</strong>s).<br />
Du point <strong>de</strong> vue qualitatif, <strong>le</strong>s enjeux concernent principa<strong>le</strong>ment la nappe alluvia<strong>le</strong> <strong>de</strong> la<br />
Dordogne. Mais cet aquifère est actuel<strong>le</strong>ment peu sollicité pour l’eau potab<strong>le</strong>. Plusieurs<br />
captages ont en effet été transférés vers l’éocène au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières années en<br />
raison <strong>de</strong> la dégradation <strong>de</strong> la qualité. Les nitrates et <strong>le</strong>s produits phytosanitaires<br />
d’origine agrico<strong>le</strong> sont à l’origine <strong>de</strong> cette dégradation. Des actions sont en cours<br />
(périmètres <strong>de</strong> protection) pour sécuriser <strong>le</strong>s <strong>de</strong>rniers captages existant sur source et en<br />
nappe.<br />
2.18 Les inondations<br />
La partie aval du territoire <strong>de</strong> la basse vallée, qui est soumise à la fois aux inondations<br />
d’origine fluvia<strong>le</strong> et aux crues d’origine maritime, est <strong>le</strong> secteur <strong>le</strong> plus sensib<strong>le</strong> aux<br />
inondations. En aval <strong>de</strong> Branne (33), <strong>le</strong>s zones <strong>de</strong> palus, faci<strong>le</strong>ment inondab<strong>le</strong>s, sont<br />
protégées par <strong>de</strong>s digues dont la gestion est partagée par <strong>le</strong>s propriétaires, privés<br />
(agriculteurs et riverains) ou col<strong>le</strong>ctivités, parfois regroupés en Associations Syndica<strong>le</strong>s<br />
Autorisées (ASA) ou en Syndicats comme sur la presqu’î<strong>le</strong> d’Ambès (SPIPA). Le contexte<br />
<strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> ces digues et <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> canaux et <strong>de</strong> fossés réguliers qui assurent <strong>le</strong><br />
ressuyage <strong>de</strong>s terres est assez comp<strong>le</strong>xe. En pratique, cette gestion est souvent<br />
déficiente, par manque <strong>de</strong> coordination et par manque <strong>de</strong> moyens. El<strong>le</strong> est source <strong>de</strong><br />
risques et <strong>de</strong> conflit lorsque surviennent <strong>de</strong>s évènements hydrologiques importants.<br />
En matière d’urbanisme, <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s sont fixées par <strong>le</strong>s Plans <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s Risques<br />
d’Inondation. La mise en œuvre <strong>de</strong>s PPRI est largement engagée sur la basse vallée <strong>de</strong> la<br />
Dordogne. De nombreuses communes sont fortement concernées par <strong>le</strong> risque<br />
d’inondation. Le renforcement <strong>de</strong>s contraintes liées aux PPRI change <strong>le</strong> potentiel <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong>s zones <strong>le</strong>s plus exposées. De nouvel<strong>le</strong>s réf<strong>le</strong>xions restent à mener sur<br />
l’aménagement, la gestion et la valorisation <strong>de</strong> ces territoires.<br />
Pour cadrer et orienter <strong>le</strong>s stratégies <strong>de</strong> lutte contre <strong>le</strong>s inondations, une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
définition d’un plan d’aménagement et <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s inondations a été engagée par<br />
EPIDOR à l’échel<strong>le</strong> du bassin <strong>de</strong> la Dordogne. Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre <strong>de</strong><br />
la circulaire dite « Bachelot » du 1 er octobre 2002.<br />
2.19 La Directive Cadre sur l’Eau<br />
La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) constitue désormais la référence en<br />
matière <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong>s milieux aquatiques et constituera la base <strong>de</strong>s<br />
programmes d’action <strong>de</strong> la plupart <strong>de</strong>s partenaires. L’état <strong>de</strong>s lieux réalisé dans ce cadre<br />
découpe la basse Dordogne en trois masses d’eau :<br />
• la Dordogne du confluent <strong>de</strong> la Vézère au confluent du Couzeau (entre Lalin<strong>de</strong> et<br />
Tuilières) ;<br />
• la Dordogne du confluent du Couzeau au confluent <strong>de</strong> la Lidoire (à Castillon-la-<br />
Batail<strong>le</strong>) ;<br />
• la Dordogne en aval du confluent <strong>de</strong> la Lidoire.<br />
Cet état <strong>de</strong>s lieux individualise 8 <strong>de</strong>s 14 principaux affluents <strong>de</strong> la basse Dordogne (dont<br />
la longueur est supérieure à 15 km). Il décrit éga<strong>le</strong>ment trois petits affluents<br />
supplémentaires.<br />
23
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Les principaux problèmes re<strong>le</strong>vés concernent surtout <strong>le</strong>s affluents, en relation notamment<br />
avec l’activité agrico<strong>le</strong> et vitico<strong>le</strong>, mais aussi dans certains cas, à cause d’insuffisances en<br />
matière d’assainissement domestique. La pression <strong>de</strong> prélèvement, pour l’irrigation ou<br />
pour l’eau potab<strong>le</strong> apparaît aussi problématique sur certains affluents.<br />
Néanmoins, à l’heure actuel<strong>le</strong>, l’état <strong>de</strong>s lieux DCE ne définit clairement aucune priorité<br />
d’action. Seu<strong>le</strong>s sont proposées <strong>de</strong>s « questions importantes » auxquel<strong>le</strong>s il faudra<br />
répondre à l’échel<strong>le</strong> du bassin Adour Garonne pour atteindre <strong>le</strong>s objectifs <strong>de</strong> la DCE.<br />
24
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
3 Le projet <strong>de</strong> Contrat Basse Dordogne<br />
3.1 L'objectif général<br />
Il s’agit <strong>de</strong> traiter <strong>le</strong>s problématiques et <strong>de</strong> mettre en va<strong>le</strong>ur l’axe fluvial Dordogne, en<br />
cohérence avec la DCE et <strong>le</strong> SDAGE Adour Garonne, dans un esprit <strong>de</strong> développement<br />
durab<strong>le</strong>. Pour cela, <strong>le</strong> projet prévoit d’accompagner et si besoin <strong>de</strong> décliner <strong>le</strong>s stratégies<br />
déjà existantes, en même temps que d'élaborer <strong>le</strong>s siennes propres.<br />
En effet, <strong>le</strong>s schémas <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> développement définis à l’échel<strong>le</strong> du bassin<br />
versant <strong>de</strong> la Dordogne ou à l’échel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s départements apportent d’ores et déjà, sur<br />
certains thèmes, <strong>de</strong>s stratégies, <strong>de</strong>s préconisations et <strong>de</strong>s propositions qui ont appuyés<br />
cette réf<strong>le</strong>xion. C’est <strong>le</strong> cas dans <strong>le</strong> domaine <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux, <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s<br />
débits, <strong>de</strong> la restauration <strong>de</strong>s poissons migrateurs, <strong>de</strong> la mise en va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong>s paysages, <strong>de</strong><br />
la conservation <strong>de</strong>s milieux naturels et du développement touristique.<br />
Le contrat envisage éga<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> soutenir <strong>de</strong>s initiatives loca<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s<br />
stratégies spécifiques à la basse vallée. Pour ce qui concerne <strong>le</strong>s projets <strong>de</strong> mise en<br />
va<strong>le</strong>ur, ils <strong>de</strong>vront afficher clairement <strong>le</strong> respect <strong>de</strong> l'espace <strong>de</strong> la basse vallée dans <strong>le</strong>s<br />
dispositifs d’aménagement. Ainsi, <strong>le</strong> développement <strong>de</strong>s loisirs nautiques doit être pensé<br />
et conçu selon un même mo<strong>de</strong> opératoire favorisant l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> la basse vallée et réalisé<br />
dans <strong>le</strong> respect <strong>de</strong>s caractéristiques environnementa<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la Dordogne. Le contrat doit<br />
permettre un développement économique harmonieux et soucieux <strong>de</strong> la Dordogne et <strong>le</strong>s<br />
stratégies <strong>de</strong> mise en va<strong>le</strong>ur touristique reposent sur la nécessaire complémentarité à<br />
établir entre terroir et rivière. Il s’agit éga<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> favoriser l’instauration <strong>de</strong> bonnes<br />
pratiques, chaque usage <strong>de</strong>vant être respectueux <strong>de</strong>s autres. Le contrat est susceptib<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> répondre à ces besoins en permettant la réalisation <strong>de</strong>s aménagements nécessaires<br />
au développement <strong>de</strong> nouvel<strong>le</strong>s pratiques touristiques. Il doit éga<strong>le</strong>ment permettre <strong>de</strong><br />
soutenir <strong>le</strong>s filières économiques qui participent à la gestion <strong>de</strong> la rivière tel<strong>le</strong>s que la<br />
pêche professionnel<strong>le</strong>.<br />
Enfin et <strong>de</strong> manière transversa<strong>le</strong>, l’éducation à l’environnement doit être appréciée<br />
comme un processus dans <strong>le</strong>quel <strong>le</strong>s individus et <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités prennent conscience <strong>de</strong><br />
<strong>le</strong>ur environnement. Il s’agit notamment <strong>de</strong> contribuer à :<br />
• ai<strong>de</strong>r à faire clairement comprendre l’existence te l’importance <strong>de</strong>s éléments relatifs<br />
aux différents milieux (économique, social, politique et écologique) ;<br />
• donner à chaque individu la possibilité d’acquérir <strong>le</strong>s connaissances nécessaires, <strong>le</strong> sens<br />
<strong>de</strong>s va<strong>le</strong>urs environnementa<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s attitu<strong>de</strong>s respectueuses <strong>de</strong> l’environnement,<br />
l’intérêt actif pour protéger et améliorer l’environnement ;<br />
• inculquer <strong>de</strong> nouveaux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comportement.<br />
• développer un ou <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> ressources afin <strong>de</strong> diffuser, échanger et débattre <strong>de</strong><br />
l’environnement.<br />
3.2 La place <strong>de</strong> l’outil « contrat <strong>de</strong> rivière » dans un projet plus<br />
global <strong>de</strong> développement durab<strong>le</strong> <strong>de</strong> la basse Dordogne<br />
Les <strong>Pays</strong> du Libournais et du Grand <strong>Bergerac</strong>ois ont souhaité développer un projet global<br />
et cohérent qui allie <strong>de</strong>s actions à caractère environnemental et <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong><br />
développement touristiques liées à la rivière. La démarche et la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong><br />
rivière sont apparues tout à fait adaptées pour élaborer et conduire un tel projet. Le label<br />
« contrat <strong>de</strong> rivière » dresse un cadre global, lisib<strong>le</strong> et reconnu par <strong>le</strong>s partenaires. Mais<br />
<strong>le</strong> texte <strong>de</strong> la circulaire du 20 janvier 2004, relative aux contrats <strong>de</strong> rivière et <strong>de</strong> baie, ne<br />
25
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
fait référence explicite qu’aux actions <strong>de</strong> restauration du bon état écologique <strong>de</strong>s cours<br />
d’eau. Les actions <strong>de</strong> mise en va<strong>le</strong>ur sont seu<strong>le</strong>ment considérées comme <strong>de</strong>s actions<br />
d’accompagnement.<br />
Le contrat basse Dordogne est un projet qui dépasse l’ambition d’un contrat <strong>de</strong> rivière<br />
classique. Il est constitué <strong>de</strong>s actions habituel<strong>le</strong>s aux caractéristiques environnementa<strong>le</strong>s<br />
affirmées auxquel<strong>le</strong>s s’ajoute un vo<strong>le</strong>t particulier qui concerne <strong>de</strong>s actions tournées vers<br />
<strong>le</strong> développement d’activités touristiques durab<strong>le</strong>s.<br />
3.3 Le périmètre<br />
Le contrat vise prioritairement l’axe fluvial entre Limeuil (24) et <strong>le</strong> Bec d’Ambès (33) qui<br />
est <strong>le</strong> territoire <strong>de</strong> référence. Les actions se développeront dans cette zone, sur<br />
l’ensemb<strong>le</strong> du lit majeur <strong>de</strong> la basse Dordogne, mais seront aussi amenées à s’étendre, à<br />
partir <strong>de</strong>s confluences, dans certains bassins versants jugés stratégiques pour l’atteinte<br />
<strong>de</strong>s objectifs environnementaux du contrat. Cette extension se justifiera pour certains<br />
thèmes comme celui <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux, et sera précisée par <strong>le</strong>s étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s.<br />
En ce qui concerne <strong>le</strong>s aspects quantitatifs, ils seront pris en compte dans <strong>le</strong> cadre d’une<br />
autre procédure déjà engagée par l’Etat, EPIDOR et l’Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne : <strong>le</strong><br />
PGE Dordogne-Vézère. Cette procédure aboutira à la formulation <strong>de</strong> recommandations<br />
avec <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> contrat <strong>de</strong>vra rester compatib<strong>le</strong> et cohérent.<br />
3.4 Le contenu du contrat<br />
Chaque thème qu’il est proposé <strong>de</strong> développer dans <strong>le</strong> contrat fait l’objet d’une fiche<br />
action présentée ci-après. Chaque fiche présente <strong>le</strong> contexte, l’objectif recherché par <strong>le</strong><br />
contrat, <strong>le</strong>s documents et étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> référence, la nature <strong>de</strong>s actions qui pourront se<br />
développer dans <strong>le</strong> contrat, <strong>le</strong>s partenaires à impliquer sur ce thème et <strong>le</strong>s étu<strong>de</strong>s qui<br />
seront à engager dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s au contrat.<br />
Chaque fiche sera référencée selon la nomenclature <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> rivière prévue dans<br />
la circulaire du 30 janvier 2004 1 relative aux contrats <strong>de</strong> rivière et <strong>de</strong> baie. Le vo<strong>le</strong>t D<br />
constitue un vo<strong>le</strong>t particulier du Contrat Basse Dordogne, qui regroupe <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong><br />
développement touristiques liées à la rivière et qui s’ajoute aux actions du contrat <strong>de</strong><br />
rivière proprement dit.<br />
Vo<strong>le</strong>t A :<br />
Vo<strong>le</strong>t B1 :<br />
Vo<strong>le</strong>t B2 :<br />
- Lutte contre la pollution<br />
- Objets flottants<br />
- Lit mineur et berges<br />
- Zones humi<strong>de</strong>s<br />
- <strong>Pays</strong>ages<br />
- Pêche<br />
- Poissons migrateurs<br />
- Faune exotique<br />
- Inondations<br />
Vo<strong>le</strong>t B3 :<br />
Vo<strong>le</strong>t C :<br />
Vo<strong>le</strong>t D<br />
(hors<br />
nomenclature<br />
contrat <strong>de</strong><br />
rivière) :<br />
26<br />
- Etiage<br />
- Eau potab<strong>le</strong><br />
- Animation<br />
- Patrimoine fluvial<br />
- Voies vertes et voies b<strong>le</strong>ues :<br />
loisirs nautiques, itinérance et <strong>le</strong><br />
tourisme fluvial<br />
- Sta<strong>de</strong> d’eaux vives <strong>de</strong> Mauzac<br />
1 Vo<strong>le</strong>t A : <strong>le</strong>s travaux <strong>de</strong> lutte contre la pollution en vue <strong>de</strong> la restauration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux (superficiel<strong>le</strong>s, souterraines et, <strong>le</strong> cas<br />
échéant, <strong>de</strong> la mer) avec <strong>le</strong>s programmes d’assainissement <strong>de</strong>s eaux résiduaires et <strong>de</strong>s eaux pluvia<strong>le</strong>s urbaines, <strong>le</strong>s programmes <strong>de</strong><br />
dépollution <strong>de</strong>s industries et, <strong>le</strong> cas échéant, <strong>de</strong>s zones portuaires, <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s pollutions diffuses d’origine agrico<strong>le</strong>,<br />
Vo<strong>le</strong>t B 1 : <strong>le</strong>s travaux <strong>de</strong> restauration, <strong>de</strong> renaturation, d’entretien et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s berges, du lit, du littoral et <strong>de</strong>s zones inondab<strong>le</strong>s, <strong>de</strong><br />
mise en va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong>s milieux aquatiques, marins et <strong>de</strong>s paysages, <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s espèces piscico<strong>le</strong>s, nécessaires pour la restauration du bon<br />
état écologique <strong>de</strong>s cours d’eau,<br />
Vo<strong>le</strong>t B 2 : <strong>le</strong>s actions <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s inondations et <strong>de</strong> protection contre <strong>le</strong>s risques concernant <strong>le</strong>s zones urbanisées (travaux et mesures<br />
rég<strong>le</strong>mentaires) et <strong>le</strong> cas échéant <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s submersions marines,<br />
Vo<strong>le</strong>t B 3 : <strong>le</strong>s travaux d’amélioration <strong>de</strong> la gestion quantitative <strong>de</strong> la ressource (optimisation <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s prélèvements, soutien <strong>de</strong>s<br />
étiages, débits réservés) ainsi que la protection <strong>de</strong>s ressources en eau potab<strong>le</strong>,<br />
Vo<strong>le</strong>t C : la coordination, l’animation, <strong>le</strong> suivi et la réalisation du bilan du contrat.
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Vo<strong>le</strong>t A<br />
Lutte contre la pollution et<br />
restauration <strong>de</strong> la qualité<br />
<strong>de</strong>s eaux<br />
Lutte contre la pollution<br />
Objets flottants<br />
27
A<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET RESTAURATION DE LA QUALITE DES EAUX<br />
LUTTE CONTRE LA POLLUTION<br />
Contexte :<br />
La qualité <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> la Dordogne est globa<strong>le</strong>ment bonne. On observe néanmoins <strong>de</strong>s dégradations<br />
sur certains points, notamment sur <strong>de</strong>s affluents directs <strong>de</strong> la Dordogne, qui peuvent perturber ou<br />
menacer certains usages et notamment <strong>le</strong>s activités aquaphi<strong>le</strong>s (baigna<strong>de</strong>, nautisme).<br />
A l’échel<strong>le</strong> du bassin et du district hydrographique Adour Garonne l’état <strong>de</strong>s lieux réalisé dans <strong>le</strong> cadre<br />
<strong>de</strong> la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) i<strong>de</strong>ntifie <strong>le</strong>s principaux problèmes sur l’axe<br />
Dordogne et sur une partie <strong>de</strong> ses affluents, sans toutefois définir <strong>de</strong> priorités d’intervention. Une<br />
stratégie est par ail<strong>le</strong>urs en cours d’élaboration pour la restauration d’une qualité d’eau baigna<strong>de</strong> à<br />
l’échel<strong>le</strong> du bassin <strong>de</strong> la Dordogne.<br />
Objectif :<br />
• Participer à la mise en œuvre <strong>de</strong> la DCE et du SDAGE sur la<br />
Dordogne et sur <strong>le</strong>s affluents prioritaires.<br />
• Mettre en place un traitement <strong>de</strong>s effluents adapté aux usages<br />
actuels et aux objectifs <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s activités<br />
aquaphi<strong>le</strong>s sur la basse Dordogne.<br />
• Se doter d’instruments d’évaluation <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux plus<br />
précis.<br />
Type d’actions :<br />
• Elaboration <strong>de</strong>s Schémas Communaux d’Assainissement (SCA)<br />
non réalisés.<br />
• Amélioration <strong>de</strong>s réseaux d’assainissement (réduction <strong>de</strong>s eaux<br />
claires parasites).<br />
• Construction ou amélioration <strong>de</strong> stations d’épuration.<br />
• Mise en place <strong>de</strong> traitements tertiaires <strong>de</strong>stinés à améliorer la<br />
qualité bactériologique <strong>de</strong>s rejets <strong>de</strong>s stations existantes.<br />
• Mise en place <strong>de</strong> réseaux complémentaires d’observation <strong>de</strong> la<br />
qualité <strong>de</strong>s eaux (baigna<strong>de</strong>, phytosanitaires…).<br />
• Actions d’animation concernant la mise en œuvre <strong>de</strong>s SCA, la<br />
mise en place <strong>de</strong>s SPANC, la connaissance, la sensibilisation et<br />
l’accompagnement <strong>de</strong>s filières professionnel<strong>le</strong>s (industriel<strong>le</strong>s,<br />
agrico<strong>le</strong>s, hôtel<strong>le</strong>rie <strong>de</strong> p<strong>le</strong>in air…).<br />
• Actions <strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s populations (événementiels,<br />
expositions, …)<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, MISE, DDASS, DRIRE, AEAG, CG, SATESE,<br />
Région, EPCI, chambres consulaires (CCI, CA, CM), campings,…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
• Bilan <strong>de</strong>s données disponib<strong>le</strong>s sur l’état <strong>de</strong> la<br />
qualité <strong>de</strong>s eaux et sur son évolution.<br />
• Besoin <strong>de</strong> données complémentaires sur la<br />
qualité <strong>de</strong>s eaux au niveau <strong>de</strong>s confluences<br />
(Libourne…).<br />
• Bilan <strong>de</strong>s installations d’assainissement <strong>de</strong>s<br />
col<strong>le</strong>ctivités, industriel<strong>le</strong>s et agrico<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur<br />
fonctionnement.<br />
• Elaboration d’une stratégie <strong>de</strong> lutte contre<br />
toutes <strong>le</strong>s formes <strong>de</strong> pollution <strong>de</strong>s eaux<br />
(domestique, industriel<strong>le</strong> et agrico<strong>le</strong>) sur la<br />
basse Dordogne et ses affluents prioritaires.<br />
28<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Etat <strong>de</strong>s lieux DCE (Agence<br />
<strong>de</strong> l’Eau / Etat – en cours).<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la qualité<br />
bactériologique <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong><br />
la Dordogne (EPIDOR).<br />
• Bilans <strong>de</strong>s suivis<br />
départementaux <strong>de</strong> la qualité<br />
<strong>de</strong>s eaux (SATESE).<br />
• Bilans <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong><br />
mesure et <strong>de</strong>s équipements<br />
(Agence <strong>de</strong> l’Eau).
A<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET RESTAURATION DE LA QUALITE DES EAUX<br />
OBJETS FLOTTANTS<br />
Contexte :<br />
La basse Dordogne col<strong>le</strong>cte <strong>le</strong>s débris végétaux issus <strong>de</strong> l’ensemb<strong>le</strong> du bassin amont. Ils sont la<br />
cause <strong>de</strong> plusieurs problèmes : dépôts sur <strong>le</strong>s plages atlantiques, embâc<strong>le</strong>s, dégradations <strong>de</strong>s<br />
installations fluvia<strong>le</strong>s, risques pour la navigation. Le SDAGE encourage la mise en œuvre d’une action<br />
col<strong>le</strong>ctive pour récupérer et éliminer <strong>le</strong>s objets flottants.<br />
Objectif :<br />
• Réduire <strong>le</strong>s quantités <strong>de</strong> matériaux flottants sur la basse vallée.<br />
Type d’actions :<br />
• Conception et mise en place d‘un système <strong>de</strong> récupération sur <strong>le</strong><br />
barrage <strong>de</strong> Tuilières.<br />
• Mise en place et mise en œuvre d’un plan <strong>de</strong> col<strong>le</strong>cte et<br />
d’élimination (déchets col<strong>le</strong>ctés à Tuilières et retour <strong>de</strong> la barge<br />
Le Coulobre sur la Dordogne).<br />
• Actions d’information et <strong>de</strong> sensibilisation (en liaison avec <strong>le</strong>s<br />
actions berges).<br />
Partenaires :<br />
EDF, Etat, CG, Région, AEAG, EPCI, Syndicats <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s<br />
déchets (SMBGD / SMD3), Réseau Ferré <strong>de</strong> France, VNF, DDE…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Evaluation <strong>de</strong>s quantités et <strong>de</strong>s rythmes <strong>de</strong><br />
col<strong>le</strong>cte <strong>de</strong>s déchets.<br />
• Elaboration d’un plan <strong>de</strong> col<strong>le</strong>cte et<br />
d’élimination.<br />
29<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Etu<strong>de</strong> sur <strong>le</strong> statut juridique<br />
<strong>de</strong>s objets flottants (étu<strong>de</strong><br />
EPIDOR).
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
30
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
VOLET B1<br />
Gestion <strong>de</strong>s berges, du lit et<br />
<strong>de</strong>s zones inondab<strong>le</strong>s<br />
Lit mineur et berges<br />
Zones humi<strong>de</strong>s<br />
Mise en va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong>s milieux et<br />
<strong>de</strong>s paysages<br />
<strong>Pays</strong>ages<br />
Pêche<br />
Protection <strong>de</strong>s espèces<br />
Poissons migrateurs<br />
Faune exotique<br />
31
B1<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
GESTION DES BERGES, DU LIT ET DES ZONES INONDABLES<br />
LIT MINEUR ET BERGES<br />
Contexte :<br />
La Dordogne a fait l’objet <strong>de</strong> nombreuses extractions <strong>de</strong> granulats qui ont profondément déstabilisé <strong>le</strong><br />
lit. El<strong>le</strong>s ont notamment provoqué une incision qui renforce à certains endroits l’instabilité <strong>de</strong>s berges.<br />
El<strong>le</strong>s ont éga<strong>le</strong>ment détruit <strong>de</strong> nombreux habitats vitaux pour <strong>le</strong>s poissons et notamment <strong>le</strong>s poissons<br />
migrateurs.<br />
Mais globa<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> lit <strong>de</strong> la basse Dordogne reste stab<strong>le</strong> et évolue peu, même s’il existe <strong>de</strong>s<br />
problèmes sur certains secteurs, qui engendrent ponctuel<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> véritab<strong>le</strong>s reculs <strong>de</strong>s berges.<br />
Suite à l’arrêt <strong>de</strong>s extractions, <strong>le</strong>s habitats <strong>de</strong>s poissons migrateurs se sont restaurés et la partie<br />
périgordine du lit est protégée par un arrêté <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> biotope. L’ensemb<strong>le</strong> du lit mineur est par<br />
ail<strong>le</strong>urs désigné au titre <strong>de</strong> Natura 2000. Pour toute intervention dans <strong>le</strong> lit, une étu<strong>de</strong> d’inci<strong>de</strong>nce<br />
particulière sur ces points doit donc s’ajouter aux procédures classiques d’autorisation <strong>de</strong> travaux en<br />
rivière.<br />
Les problèmes <strong>de</strong> berges sont parfois provoqués ou aggravés par <strong>de</strong> mauvaises pratiques<br />
(plantations, protections sauvages par déversement <strong>de</strong> remblais…) et par <strong>le</strong> développement<br />
d’espèces exotiques : renouée du Japon et canne <strong>de</strong> Provence (fragilisation <strong>de</strong>s berges, altération<br />
<strong>de</strong>s paysages). La végétalisation <strong>de</strong>s îlots peut éga<strong>le</strong>ment être à l’origine <strong>de</strong> désordres constatés sur<br />
<strong>le</strong>s berges. Le développement d’espèces aquatiques exotiques (jussie, élodée, égéria) peut provoquer<br />
la fermeture <strong>de</strong>s milieux et constituer une gêne à la navigation.<br />
Objectif :<br />
• Mettre en œuvre une gestion <strong>de</strong>s berges et du lit conciliant la<br />
protection <strong>de</strong>s zones riveraines et <strong>le</strong>s enjeux économiques,<br />
écologiques et paysagers.<br />
• Améliorer l’organisation et la coordination entre <strong>le</strong>s maîtres<br />
d’ouvrage.<br />
• Contribuer à la lutte contre l’installation <strong>de</strong>s espèces végéta<strong>le</strong>s<br />
invasives aquatiques et <strong>de</strong>s berges.<br />
Type d’actions :<br />
• Travaux <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong>s berges sur <strong>de</strong>s sites prioritaires.<br />
• Opérations <strong>de</strong> faucardage et d’arrachage visant à contenir<br />
l’expansion <strong>de</strong> la jussie, <strong>de</strong> l’élodée et l’égéria et acquisition <strong>de</strong><br />
matériel adapté.<br />
• Opérations d’arrachage <strong>de</strong>s foyers <strong>de</strong> renouée du Japon et <strong>de</strong> la<br />
canne <strong>de</strong> Provence (voir actions berges).<br />
• Travaux <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s îlots et <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> dynamique<br />
fluvia<strong>le</strong>.<br />
• Campagnes d’information et <strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s riverains sur<br />
<strong>le</strong>s bonnes pratiques d’entretien <strong>de</strong>s berges (fiches techniques,<br />
réunions publiques, démonstrations…).<br />
• Animation auprès <strong>de</strong>s maîtres d’ouvrage pour promouvoir une<br />
organisation et une mobilisation col<strong>le</strong>ctive <strong>de</strong> moyens (équipes,<br />
matériel…).<br />
• Actions <strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s populations (événementiels,<br />
expositions, …)<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, CG 24 et 33, ASA, riverains, VNF, DDE, EDF,<br />
SEPANSO, CDT 24 et 33…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Définir une stratégie et <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lutte<br />
contre <strong>le</strong>s espèces végéta<strong>le</strong>s invasives.<br />
32<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Schéma <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />
berges <strong>de</strong> la Dordogne entre<br />
Mauzac et <strong>Bergerac</strong><br />
(EPIDOR).<br />
• Schéma <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />
berges <strong>de</strong> la Dordogne entre<br />
<strong>Bergerac</strong> et Ste Terre<br />
(EPIDOR, en cours).<br />
• Schéma <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />
berges <strong>de</strong> la Dordogne<br />
soumises à la marée<br />
(EPIDOR).<br />
• Etu<strong>de</strong> bathymétrique du lit <strong>de</strong><br />
la Dordogne et <strong>de</strong> l’Is<strong>le</strong> aval<br />
(EPIDOR).<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
• Aménagements expérimentaux prévus par <strong>le</strong>s<br />
schémas <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s berges.<br />
• Initier <strong>de</strong>s campagnes d’arrachage <strong>de</strong>s foyers<br />
<strong>de</strong> jussie et d’élodée.<br />
• Initier <strong>de</strong>s campagnes d’arrachage d’égéria sur<br />
la retenue <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>.
B1<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
GESTION DES BERGES, DU LIT ET DES ZONES INONDABLES<br />
ZONES HUMIDES<br />
Contexte :<br />
Il existe <strong>de</strong>s milieux qui constituent un patrimoine naturel sur la basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne : la<br />
rivière, <strong>le</strong>s bras morts ou couasnes, <strong>le</strong>s boisements alluviaux, <strong>le</strong>s marais ou palus et <strong>le</strong>s prairies<br />
humi<strong>de</strong>s. Ils abritent <strong>de</strong>s espèces emblématiques comme la loutre, <strong>le</strong> vison d’Europe, l’esturgeon,<br />
l’anguil<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s autres poissons migrateurs ainsi que <strong>de</strong>s végétaux d’intérêt communautaire (angélique<br />
à fruits variab<strong>le</strong>s) ou encore une faune aviaire migratrice (bécasse). Par ail<strong>le</strong>urs, certains espaces<br />
comme <strong>le</strong>s gravières méritent d’être restaurés et mis en va<strong>le</strong>ur.<br />
Plusieurs procédures et outils <strong>de</strong> gestion sont susceptib<strong>le</strong>s d’intervenir ou d’interférer dans ce<br />
domaine : Natura 2000, zones vertes du SDAGE, Espaces Naturels Sensib<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s départements…<br />
Objectif :<br />
• Mettre en œuvre une gestion <strong>de</strong>s espaces conciliant <strong>le</strong>s<br />
fonctions écologiques (habitats, espèces remarquab<strong>le</strong>s), <strong>le</strong> rô<strong>le</strong><br />
hydrodynamique et hydrologique (expansion <strong>de</strong>s crues,<br />
dissipation d’énergie), <strong>le</strong> maintien d’activités et <strong>le</strong> développement<br />
urbain.<br />
• Restaurer <strong>le</strong>s milieux dégradés et en particulier <strong>le</strong>s anciennes<br />
gravières.<br />
Type d’actions :<br />
• Inventaire complémentaires, i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s habitats et <strong>de</strong>s<br />
espèces d’intérêt, notamment <strong>le</strong>s espèces protégées.<br />
• Conventions <strong>de</strong> gestion (palus, boisements).<br />
• Contrat d’entretien multipartenaires.<br />
• Acquisition <strong>de</strong> terrains (palus, boisements).<br />
• Travaux d’entretien et d’aménagement (esteys, palus, couasnes,<br />
gravières).<br />
• Actions d’information et <strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s riverains et<br />
col<strong>le</strong>ctivités sur <strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s intérêts <strong>de</strong>s zones humi<strong>de</strong>s ainsi<br />
que sur <strong>le</strong>s utilisations qui peuvent en être faites.<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, CATER, ASA, CREN Aquitaine, FDP, FDC,<br />
CSP, ONC, ONF, CRPF, MISE, VNF, SEPANSO, CREN, CDT 24<br />
et 33…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Synthétiser <strong>le</strong>s données concernant <strong>le</strong>s zones<br />
humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la basse Dordogne.<br />
• Définir une stratégie <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s zones<br />
humi<strong>de</strong>s en adéquation avec <strong>le</strong>s autres enjeux<br />
concernant <strong>le</strong>s berges et <strong>le</strong> lit mineur, <strong>le</strong>s<br />
inondations, la lutte contre <strong>le</strong>s espèces<br />
invasives, <strong>le</strong>s activités riveraines…<br />
33<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s milieux naturels<br />
remarquab<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong><br />
la Dordogne (EPIDOR).<br />
• Inventaires ZNIEFF (DIREN /<br />
Museum d’Histoire Naturel<strong>le</strong>)<br />
• Politiques et plans <strong>de</strong> gestion<br />
<strong>de</strong>s Espaces Naturels<br />
Sensib<strong>le</strong>s (CG 24 et 33).<br />
• Plan <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s marais<br />
du Moron (GEREA).<br />
• Inventaire <strong>de</strong>s zones<br />
humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong> (ONC<br />
et FDC 33).<br />
• Plan d’aménagement<br />
paysager <strong>de</strong> l’autoroute A89<br />
(ASF).
B1<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
MISE EN VALEUR DES MILIEUX ET DES PAYSAGES<br />
PAYSAGES<br />
Contexte :<br />
La basse vallée est un large couloir alluvial qui tend à rejoindre à Garonne et former l’Estuaire <strong>de</strong> la<br />
Giron<strong>de</strong>. Large <strong>de</strong> 150 à 200 mètres, <strong>le</strong> f<strong>le</strong>uve cou<strong>le</strong> dans une amp<strong>le</strong> vallée <strong>de</strong> 4 à 8 km. La Dordogne<br />
y <strong>de</strong>ssine <strong>de</strong>s sinuosités très douces ou <strong>de</strong>s parcours plus rectilignes. El<strong>le</strong> est bordée <strong>de</strong> part et<br />
d’autre, <strong>de</strong> vil<strong>le</strong>s, <strong>de</strong> bourgs et <strong>de</strong> hameaux s’inscrivant dans un paysage typiquement rural. Parmi<br />
ceux-ci, <strong>le</strong>s paysages <strong>de</strong> l'ancienne Juridiction <strong>de</strong> Saint-Emilion, inscrits au Patrimoine Mondial <strong>de</strong><br />
l'UNESCO, s'imposent à tous, à la fois comme paysage relique (conservant <strong>de</strong>s témoignages<br />
remarquab<strong>le</strong>s et uniques <strong>de</strong> l'Histoire) et comme paysage vivant (issu du terroir et <strong>de</strong>s efforts<br />
séculaires <strong>de</strong>s habitants). Ces paysages pluriels sont partie prenante <strong>de</strong> la valorisation <strong>de</strong> la rivière<br />
Dordogne, mais ils font l’objet <strong>de</strong> nombreuses dégradations. Les décharges sauvages ou l’utilisation<br />
d’essences étrangères au milieu contribuent à une perte <strong>de</strong> la qualité paysagère <strong>de</strong> la rivière. Par<br />
ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong> paysage doit permettre <strong>de</strong>s « fenêtres » sur la rivière et sur <strong>le</strong>s terres selon qu’el<strong>le</strong>s ont<br />
pour ang<strong>le</strong> <strong>de</strong> vue la berge ou l’eau. El<strong>le</strong>s doivent favoriser <strong>le</strong> spectac<strong>le</strong> <strong>de</strong> la nature et inviter à la<br />
découverte <strong>de</strong>s sites terrestres.<br />
Objectif :<br />
• Mettre en va<strong>le</strong>ur <strong>le</strong>s sites paysagers remarquab<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la vallée<br />
<strong>de</strong> la Dordogne en cohérence avec <strong>le</strong>s actions développées en<br />
matière d’itinérance touristique.<br />
• Veil<strong>le</strong>r au maintien en état du paysage et à son entretien régulier.<br />
Type d’actions :<br />
• Sensibilisation <strong>de</strong>s propriétaires riverains (publics /privés).<br />
• Conduire un partenariat avec la chambre <strong>de</strong>s métiers dans la<br />
gestion <strong>de</strong>s déchets : problématique <strong>de</strong>s déchets en berges.<br />
• Réalisation d’aménagements paysagers favorisant <strong>le</strong>s<br />
ouvertures entre <strong>le</strong> f<strong>le</strong>uve et <strong>le</strong>s rives.<br />
• Actions <strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s populations (événementiels,<br />
expositions, …)<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, VNF, CDT 33 et 24, SMNG, CAUE, DIREN,…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Recensement <strong>de</strong>s sites et i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s<br />
projets d’aménagement paysager.<br />
34<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Plan paysage vallée <strong>de</strong> la<br />
Dordogne (EPIDOR).<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s paysages du<br />
département <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong>.<br />
• Vignob<strong>le</strong> et villages <strong>de</strong><br />
l'Ancienne Juridiction <strong>de</strong><br />
Saint-Emilion – Dossier <strong>de</strong><br />
présentation en vue <strong>de</strong><br />
l'inscription sur la liste du<br />
patrimoine mondial <strong>de</strong><br />
l'UNESCO au titre <strong>de</strong><br />
paysage culturel (SIVOM <strong>de</strong><br />
l'ancienne Juridiction <strong>de</strong><br />
Saint-Emilion).<br />
• Projet <strong>de</strong> territoire<br />
(Communauté <strong>de</strong><br />
Communes <strong>de</strong> la Juridiction<br />
<strong>de</strong> Saint-Emilion).<br />
• Plan d’aménagement<br />
paysager <strong>de</strong> l’autoroute A89<br />
(ASF).
B1<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
MISE EN VALEUR DES MILIEUX ET DES PAYSAGES<br />
PECHE<br />
Contexte :<br />
La rivière Dordogne bénéficie <strong>de</strong> ressources piscico<strong>le</strong>s qui sont <strong>le</strong> support <strong>de</strong> multip<strong>le</strong>s activités<br />
halieutiques. Cel<strong>le</strong>s-ci sont tournées vers <strong>le</strong>s poissons migrateurs sur la partie aval et vers <strong>le</strong>s<br />
espèces <strong>de</strong> poissons d’eau douce sur la partie amont. La pêche professionnel<strong>le</strong> alimente <strong>le</strong> marché<br />
local et la restauration. La pêche <strong>de</strong> loisirs revêt un caractère traditionnel et culturel important.<br />
Certaines formes <strong>de</strong> pêche sportive sont susceptib<strong>le</strong>s d’attirer une clientè<strong>le</strong> touristique.<br />
Objectif :<br />
• Valoriser <strong>le</strong>s différentes filières <strong>de</strong> la pêche présentes sur la<br />
basse Dordogne.<br />
• Mettre en va<strong>le</strong>ur et promouvoir <strong>le</strong>s produits <strong>de</strong> la pêche fluvia<strong>le</strong>.<br />
Type d’actions :<br />
• Actions <strong>de</strong> promotion (vente, dégustation, …) <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> la<br />
pêche professionnel<strong>le</strong>.<br />
• Actions <strong>de</strong> développement du tourisme pêche.<br />
Partenaires :<br />
FDP 24 et 33, AAIPPBG, AADPPEDG, CSP, CDT 33 et 24…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Stratégie <strong>de</strong> mise en va<strong>le</strong>ur touristique <strong>de</strong>s<br />
filières et <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> pêche sur la<br />
Dordogne.<br />
35<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Plans Départementaux <strong>de</strong><br />
Gestion Piscico<strong>le</strong> <strong>de</strong> 24 et 33<br />
(en cours <strong>de</strong> réalisation).<br />
• Bilan <strong>de</strong> la pêche<br />
professionnel<strong>le</strong> en Dordogne<br />
et perspective <strong>de</strong><br />
développement (AAIPPBG).<br />
• Bilan <strong>de</strong>s sessions rivière<br />
partage <strong>de</strong> l’eau organisées<br />
sur l’Is<strong>le</strong> aval (AADPPPEDG)<br />
• Schéma départemental <strong>de</strong> la<br />
pêche <strong>de</strong> loisir (FDAPP 33).
B1<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
PROTECTION DES ESPECES<br />
POISSONS MIGRATEURS<br />
Contexte :<br />
Huit espèces <strong>de</strong> poissons migrateurs fréquentent <strong>le</strong> bassin <strong>de</strong> la Dordogne. Certaines d’entre el<strong>le</strong>s ne<br />
font que traverser la basse Dordogne pour accé<strong>de</strong>r à <strong>le</strong>urs zones <strong>de</strong> reproduction situées en amont<br />
(salmonidés), d’autres y effectuent toute la partie dulcico<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur cyc<strong>le</strong> biologique (esturgeon,<br />
lamproies marine et fluviati<strong>le</strong>, aloses vraie et feinte, anguil<strong>le</strong>).<br />
Les habitats <strong>de</strong>s poissons migrateurs présents dans <strong>le</strong> lit périgourdin <strong>de</strong> la Dordogne sont jugés<br />
d’assez bonne qualité. Ils sont protégés par un arrêté <strong>de</strong> biotope. La Dordogne est éga<strong>le</strong>ment<br />
concernée par la procédure Natura 2000 en gran<strong>de</strong> partie pour <strong>le</strong>s populations <strong>de</strong> migrateurs qu’el<strong>le</strong><br />
abrite.<br />
Les barrages présents sur <strong>le</strong> cours <strong>de</strong> la Dordogne ont été équipés <strong>de</strong> passes et d’ascenseur à<br />
poissons pour rétablir <strong>de</strong>s conditions satisfaisantes <strong>de</strong> libre circulation. Toutefois, certains <strong>de</strong> ces<br />
ouvrages restent à améliorer, notamment pour la dévalaison <strong>de</strong>s poissons. Des aménagements<br />
complémentaires seront éga<strong>le</strong>ment nécessaires pour la montaison sur <strong>le</strong> barrage <strong>de</strong> Mauzac, si un<br />
débit réservé est rétabli au droit du barrage. Un projet est pour l’instant engagé pour la réalisation d’un<br />
ouvrage mixte, <strong>de</strong> type rivière artificiel<strong>le</strong>, dans <strong>le</strong> cadre d’un sta<strong>de</strong> d’eaux vives. Le rétablissement <strong>de</strong><br />
la connexion entre l’axe fluvial et certains affluents apparaît par ail<strong>le</strong>urs comme un élément important,<br />
en particulier pour l’espèce anguil<strong>le</strong>.<br />
Objectif :<br />
• Développer la culture liée aux poissons migrateurs.<br />
• Garantir la prise en compte <strong>de</strong>s poissons migrateurs dans tout<br />
projets concernant la gestion du f<strong>le</strong>uve.<br />
• Trouver <strong>de</strong>s relais opérationnels pour la mise en œuvre <strong>de</strong>s<br />
stratégies <strong>de</strong> gestion élaborées à l’échel<strong>le</strong> du bassin versant.<br />
Type d’actions :<br />
• Mise en place et amélioration <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> franchissement<br />
<strong>de</strong>s obstac<strong>le</strong>s (montaison et dévalaison), incluant <strong>le</strong>s besoins<br />
particuliers <strong>de</strong> l’anguil<strong>le</strong>.<br />
• Actions d’animation auprès <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> l’aménagement et du<br />
développement local pour une meil<strong>le</strong>ure connaissance et une<br />
meil<strong>le</strong>ure prise en compte <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>s poissons migrateurs.<br />
• Actions <strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s populations (événementiels,<br />
expositions, …)<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, DDAF 24 et 33, CSP, FDP 24 et 33,<br />
AAIPPBG, AADPPEDG, EDF…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
Aucune étu<strong>de</strong> prévue.<br />
36<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Plan <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s poissons<br />
migrateurs du COGEPOMI<br />
Garonne Dordogne Charente<br />
Seudre Leyre.<br />
• Objectif Retour aux Sources<br />
(EPIDOR).<br />
• Atlas <strong>de</strong>s poissons<br />
migrateurs <strong>de</strong> la Dordogne<br />
(EPIDOR).<br />
• Suivis <strong>de</strong>s migrations à<br />
Tuilières (MIGADO).<br />
• Suivis <strong>de</strong> la reproduction <strong>de</strong>s<br />
aloses et <strong>de</strong>s lamproies sur<br />
la basse Dordogne<br />
(MIGADO).<br />
• Plans Départementaux <strong>de</strong><br />
Gestion Piscico<strong>le</strong> <strong>de</strong> 24 et 33<br />
(en cours <strong>de</strong> réalisation).<br />
• Programme <strong>de</strong> suivi<br />
d’abondance <strong>de</strong>s anguil<strong>le</strong>s<br />
Indicang (IFREMER).
B1<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
PROTECTION DES ESPECES<br />
FAUNE EXOTIQUE<br />
(flore exotique : cf. fiche lit et berges)<br />
Contexte :<br />
Plusieurs espèces anima<strong>le</strong>s et végéta<strong>le</strong>s perturbent <strong>le</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s écosystèmes aquatiques et<br />
sont à l’origine <strong>de</strong> nuisances. Le cas <strong>de</strong>s espèces végéta<strong>le</strong>s est traité dans la fiche « berges et lit<br />
mineur ». De nombreuses espèces anima<strong>le</strong>s sont éga<strong>le</strong>ment source <strong>de</strong> difficultés : ragondin et rat<br />
musqué (dégâts aux cultures et aux digues), écrevisse <strong>de</strong> Louisiane (dégâts sur <strong>le</strong>s esteys), grenouil<strong>le</strong><br />
taureau (perte biodiversité), vison d’Amérique (menace sur vison d’Europe), silure (équilibre<br />
piscico<strong>le</strong>s). Certaines seu<strong>le</strong>ment sont classées nuisib<strong>le</strong>s (ragondin et rat musqué, vison d’Amérique).<br />
Des actions sont parfois engagées en vue <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur régulation (inventaires, campagnes <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>struction,…). El<strong>le</strong>s concernent <strong>de</strong>s échel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> territoires variées et ne sont pas toujours<br />
coordonnées. La régulation <strong>de</strong>s ragondins et <strong>de</strong>s rats musqués revêt un enjeu sanitaire car ils sont<br />
vecteurs <strong>de</strong> la <strong>le</strong>ptospirose.<br />
Objectif :<br />
• Mettre en place <strong>de</strong>s actions coordonnées <strong>de</strong> lutte contre<br />
l’expansion <strong>de</strong>s espèces invasives à l’échel<strong>le</strong> <strong>de</strong> la basse vallée.<br />
Type d’actions :<br />
• Mise en place <strong>de</strong> campagnes <strong>de</strong> piégeage coordonnées <strong>de</strong>s<br />
ragondins et rats musqués à proximité <strong>de</strong>s embarcadères.<br />
• Réaliser <strong>de</strong>s campagnes <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> la grenouil<strong>le</strong> taureau<br />
et <strong>de</strong> l’écrevisse <strong>de</strong> Louisiane.<br />
• Réaliser <strong>de</strong>s campagnes <strong>de</strong> pêche ciblées pour appréhen<strong>de</strong>r <strong>le</strong>s<br />
effets <strong>de</strong> la présence du silure.<br />
Partenaires :<br />
ragondins et rats musqués : EPCI, FDGDON, FDC, ONC, ASA,<br />
DDAF, CG… / grenouil<strong>le</strong> taureau : Cistu<strong>de</strong> Nature, CSP,<br />
SEPANSO, ASA… / silure : FDP, Pêcheurs professionnels, CSP,<br />
DDAF…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Synthèse <strong>de</strong>s informations et <strong>de</strong>s données<br />
disponib<strong>le</strong>s sur la présence du silure et sur ses<br />
impacts possib<strong>le</strong>s.<br />
37<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Stratégie <strong>de</strong> lutte contre <strong>le</strong>s<br />
ragondins et <strong>le</strong>s rats<br />
musqués du bassin versant<br />
<strong>de</strong> la Dordogne (étu<strong>de</strong><br />
EPIDOR).<br />
• Cartographies <strong>de</strong>s espèces<br />
végéta<strong>le</strong>s invasives (étu<strong>de</strong>s<br />
Cemagref / EPIDOR).<br />
• Schéma <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />
berges <strong>de</strong> la Dordogne<br />
(étu<strong>de</strong>s EPIDOR).<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la répartition <strong>de</strong>s<br />
grenouil<strong>le</strong>s taureau et<br />
stratégie d’action (étu<strong>de</strong><br />
Cistu<strong>de</strong> Nature).<br />
• Plan <strong>de</strong> gestion du Vison<br />
d’Europe (mission vison<br />
DIREN Aquitaine).<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
• Installation d’un réseau opérationnel pour<br />
mener la lutte contre <strong>le</strong> ragondin et <strong>le</strong> rat<br />
musqué.<br />
• Développer <strong>le</strong>s campagnes <strong>de</strong> lutte contre la<br />
grenouil<strong>le</strong> taureau.
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
38
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
VOLET B2<br />
PREVENTION ET PROTECTION<br />
CONTRE LES INONDATIONS<br />
Digues<br />
39
B2<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
PREVENTION ET PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS<br />
INONDATIONS<br />
Contexte :<br />
La sensibilité <strong>de</strong> la basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne aux inondations varie d’un secteur à l’autre. Entre<br />
Limeuil et Le F<strong>le</strong>ix, <strong>le</strong>s inondations restent limitées aux bordures du lit mineur. En aval, <strong>le</strong>s<br />
débor<strong>de</strong>ments s’éten<strong>de</strong>nt sur <strong>le</strong>s anciens méandres <strong>de</strong> la plaine alluvia<strong>le</strong>. A partir d’Eynesse, el<strong>le</strong>s<br />
peuvent toucher la majeure partie <strong>de</strong> la plaine alluvia<strong>le</strong>. En aval <strong>de</strong> Branne, la Dordogne est endiguée<br />
sur la quasi totalité <strong>de</strong> son cours. A proximité <strong>de</strong> l’estuaire, <strong>le</strong>s inondations peuvent avoir une origine<br />
fluvia<strong>le</strong> mais aussi marine. Certaines digues vétustes manquent d’entretien et risquent <strong>de</strong> se romprent<br />
en cas <strong>de</strong> forte crue, augmentant ainsi la gravité <strong>de</strong>s inondations. Leur gestion, fractionnée en<br />
fonction <strong>de</strong>s syndicats <strong>de</strong> propriétaires, manque <strong>de</strong> coordination et nuit à l’efficacité globa<strong>le</strong> du<br />
système <strong>de</strong> protection contre <strong>le</strong>s inondations.<br />
Les communes <strong>le</strong>s plus exposées <strong>de</strong> la basse Dordogne disposent d’un Plan <strong>de</strong> Prévention <strong>de</strong>s<br />
Risques d’Inondation. Par ail<strong>le</strong>urs une étu<strong>de</strong> sur la prévention <strong>de</strong>s inondations est engagée à l’échel<strong>le</strong><br />
du bassin dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> la circulaire Bachelot du 1 er octobre 2002.<br />
Objectif :<br />
• Favoriser l’épanchement <strong>de</strong>s crues en maintenant quand cela<br />
est possib<strong>le</strong> une gestion <strong>de</strong> terrains inondab<strong>le</strong>s.<br />
• Disposer d’un diagnostic fiab<strong>le</strong> sur l’état du dispositif <strong>de</strong><br />
protection contre <strong>le</strong>s inondations (digues, vannes, esteys…).<br />
• Restaurer <strong>le</strong> dispositif <strong>de</strong> protection contre <strong>le</strong>s inondations et<br />
améliorer son fonctionnement (suppression <strong>de</strong>s points faib<strong>le</strong>s sur<br />
<strong>le</strong>s digues, efficacité <strong>de</strong>s vannages et esteys pour <strong>le</strong> ressuyage<br />
<strong>de</strong>s terrains).<br />
• Valoriser <strong>le</strong>s espaces inondab<strong>le</strong>s.<br />
Type d’actions :<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’état et du fonctionnement hydraulique <strong>de</strong>s systèmes<br />
<strong>de</strong> protection contre <strong>le</strong>s inondations (digues, vannages, esteys).<br />
• Travaux <strong>de</strong> restauration et d’entretien <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong><br />
protection contre <strong>le</strong>s inondations (digues, vannages, esteys).<br />
• Mise en œuvre <strong>de</strong> pratiques <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> valorisation <strong>de</strong>s<br />
zones inondab<strong>le</strong>s et engagement <strong>de</strong> réf<strong>le</strong>xions sur<br />
l’emplacement <strong>de</strong>s digues et sur la reconquête d’espaces pour<br />
l’expansion <strong>de</strong>s crues.<br />
• Animation auprès <strong>de</strong>s maîtres d’ouvrage pour promouvoir une<br />
organisation et une mobilisation col<strong>le</strong>ctive <strong>de</strong> moyens en vue <strong>de</strong><br />
la gestion et <strong>de</strong> l’entretien <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> protection contre <strong>le</strong>s<br />
inondations et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s zones inondab<strong>le</strong>s.<br />
• Actions <strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s populations (événementiels,<br />
réalisation d’expositions, …)<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, Conseil Général 33, DDE, SMN, ASA,<br />
CATER, SPIPA, FDC 33, CDT 24 et 33…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Inventaire <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> protection contre<br />
<strong>le</strong>s inondations.<br />
• Description <strong>sommaire</strong> du fonctionnement <strong>de</strong>s<br />
systèmes <strong>de</strong> protection contre <strong>le</strong>s inondations<br />
(analyse <strong>de</strong>s réseaux d’esteys).<br />
• Analyse <strong>de</strong> l’organisation et <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
gestion en place.<br />
• Etu<strong>de</strong> sur <strong>le</strong>s perspectives d’aménagement et<br />
<strong>de</strong> développement dans <strong>le</strong>s zones inondab<strong>le</strong>s<br />
<strong>de</strong> la basse Dordogne.<br />
40<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Cartographies informatives<br />
<strong>de</strong>s zones inondab<strong>le</strong>s (DDE).<br />
• PPRI <strong>de</strong>s communes.<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition du plan<br />
<strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s<br />
inondations du bassin <strong>de</strong> la<br />
Dordogne (EPIDOR).
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
VOLET B3<br />
GESTION QUANTITATIVE<br />
Etiage<br />
Eau potab<strong>le</strong><br />
41
B3<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
GESTION QUANTITATIVE<br />
ETIAGE<br />
Contexte :<br />
Les débits <strong>de</strong> la Dordogne sont naturel<strong>le</strong>ment faib<strong>le</strong>s en été. L’impact <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> la basse<br />
Dordogne sur <strong>le</strong>s débits du f<strong>le</strong>uve reste modéré au regard <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong> ce territoire par rapport à<br />
l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s bassins amont (Is<strong>le</strong>, Vézère, Dordogne amont). Sur <strong>le</strong>s petits affluents en revanche,<br />
certaines difficultés peuvent être directement reliées aux activités présentes sur <strong>le</strong>s bassins versants.<br />
Un Plan <strong>de</strong> Gestion d’Etiage (PGE) vient d’être adopté sur <strong>le</strong> bassin Is<strong>le</strong>-Dronne. Un second PGE doit<br />
prochainement être engagé sur <strong>le</strong> bassin Dordogne-Vézère, couvrant <strong>le</strong> territoire <strong>de</strong> la basse vallée et<br />
<strong>de</strong> ses affluents.<br />
Objectif :<br />
• Alimenter <strong>le</strong>s réf<strong>le</strong>xions du PGE Dordogne-Vézère pour la<br />
définition <strong>de</strong>s objectifs d’étiage.<br />
• Appuyer la mise en œuvre du PGE Dordogne-Vézère lorsque<br />
celui-ci sera adopté.<br />
Type d’actions :<br />
• Etu<strong>de</strong> du fonctionnement hydrologique <strong>de</strong>s principaux systèmes<br />
affluents et mise en place <strong>de</strong> systèmes <strong>de</strong> mesure<br />
hydrométriques (échel<strong>le</strong>s).<br />
• Actions d’animation <strong>de</strong>stinées à favoriser la participation du<br />
comité <strong>de</strong> rivière aux débats du PGE Dordogne-Vézère.<br />
• Mise en œuvre <strong>de</strong>s prescriptions du PGE sur <strong>le</strong>s zones<br />
prioritaires i<strong>de</strong>ntifiées par celui-ci.<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, Conseil Général 24 et 33, DDAF, Chambres<br />
d’Agriculture…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Premier bilan <strong>de</strong> l’hydrologie <strong>de</strong>s bassins<br />
affluents à l’étiage.<br />
42<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Protoco<strong>le</strong> du PGE Is<strong>le</strong>-<br />
Dronne (EPIDOR).<br />
• Etu<strong>de</strong> PGE Dordogne-<br />
Vézère (EPIDOR, en cours).<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
• Réaliser <strong>de</strong> campagnes <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> débits<br />
aux principa<strong>le</strong>s confluences <strong>de</strong> la Dordogne.
B3<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
GESTION QUANTITATIVE<br />
EAU POTABLE<br />
Contexte : Sur la basse Dordogne, l’enjeu <strong>de</strong> l’AEP se situe principa<strong>le</strong>ment au niveau <strong>de</strong> la nappe<br />
profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’éocène. La gestion <strong>de</strong> cette nappe, qui dépasse très largement <strong>le</strong> périmètre du contrat<br />
<strong>de</strong> rivière est actuel<strong>le</strong>ment envisagée dans <strong>le</strong> cadre du groupe <strong>de</strong> liaison <strong>de</strong>s nappes profon<strong>de</strong>s mis<br />
en place par <strong>le</strong> SDAGE en lien avec <strong>le</strong> SAGE nappes profon<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Giron<strong>de</strong>. Il n’existe pas <strong>de</strong><br />
captage en rivière. De rares captages existent toutefois sur <strong>de</strong>s sources ou en nappe alluvia<strong>le</strong> <strong>de</strong> la<br />
Dordogne pour <strong>le</strong>squels une protection durab<strong>le</strong> reste parfois à mettre en place.<br />
Le schéma départemental d’AEP <strong>de</strong> la Dordogne est en cours d’approbation (début 2005), celui <strong>de</strong> la<br />
Giron<strong>de</strong> a été actualisé récemment, à l’occasion <strong>de</strong> l’élaboration du SAGE nappes profon<strong>de</strong>s.<br />
Objectif :<br />
• Protéger <strong>le</strong>s captages AEP situés sur <strong>le</strong>s sources ou sur la<br />
nappe alluvia<strong>le</strong> en cohérence avec <strong>le</strong>s Schémas<br />
Départementaux d’AEP <strong>de</strong> la Dordogne et <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong>.<br />
• Développer <strong>le</strong>s économies d’eau potab<strong>le</strong>.<br />
Type d’actions :<br />
• Mise en œuvre <strong>de</strong>s prescriptions <strong>de</strong>s SDAEP et notamment <strong>de</strong>s<br />
périmètres <strong>de</strong> protection rég<strong>le</strong>mentaire sur <strong>le</strong>s captages, <strong>de</strong>s<br />
diagnostics <strong>de</strong>s réseaux…<br />
• Actions d’animation et <strong>de</strong> sensibilisation sur l’eau potab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s<br />
économies d’eau…<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, CG 24 et 33, SIAEP…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
Aucune étu<strong>de</strong> prévue.<br />
43<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• SDAEP 24 et 33.<br />
• SAGE nappes profon<strong>de</strong>s.<br />
Projets prêts à démarrer :
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
44
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
VOLET C<br />
COORDINATION ET SUIVI<br />
Animation<br />
45
C<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
COORDINATION ET SUIVI<br />
ANIMATION<br />
Contexte :<br />
Le contexte territorial interdépartemental, <strong>le</strong>s enjeux fluviaux et la présence d’un Etablissement Public<br />
Territorial <strong>de</strong> Bassin (EPIDOR) désignent naturel<strong>le</strong>ment ce <strong>de</strong>rnier pour assurer l’animation du Contrat<br />
<strong>de</strong> Rivière Basse Vallée <strong>de</strong> la Dordogne. EPIDOR dispose éga<strong>le</strong>ment d’une gran<strong>de</strong> expérience <strong>de</strong><br />
l’animation <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> procédure puisque cette structure assure déjà l’animation <strong>de</strong> trois contrats<br />
<strong>de</strong> rivière.<br />
Objectif :<br />
• Assurer un relais entre <strong>le</strong>s partenaires du contrat <strong>de</strong> rivière.<br />
• Faciliter l’élaboration <strong>de</strong>s projets et favoriser <strong>le</strong>ur mise en œuvre<br />
dans <strong>le</strong> cadre du programme d’action.<br />
• Favoriser l’implication <strong>de</strong> la population loca<strong>le</strong> et en préparant <strong>le</strong>s<br />
acteurs du bassin à la gestion <strong>de</strong> l'eau <strong>de</strong> façon col<strong>le</strong>ctive.<br />
Type d’actions :<br />
• Coordination <strong>de</strong>s actions : assurer <strong>le</strong> suivi <strong>de</strong>s travaux, la<br />
cohérence <strong>de</strong>s actions.<br />
• Animation du Comité <strong>de</strong> rivière.<br />
• Suivi technique, financier et administratif du Contrat <strong>de</strong> rivière<br />
(tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong> bord).<br />
• Accompagnement et sensibilisation <strong>de</strong>s maîtres d’ouvrages.<br />
• Actions <strong>de</strong> communication et sensibilisation du grand public.<br />
• Actions d’éducation à l’environnement.<br />
• Participation aux consultations sur la DCE et sur la révision du<br />
SDAGE.<br />
Partenaires :<br />
Partenaires du comité <strong>de</strong> rivière.<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
Aucune étu<strong>de</strong> préalab<strong>le</strong>.<br />
46<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’animation réalisée<br />
par l’ARPE Midi Pyrénées.<br />
• Bilan <strong>de</strong>s sessions rivière<br />
partage <strong>de</strong> l’eau organisées<br />
sur l’Is<strong>le</strong> aval<br />
(AADPPPEDG).<br />
• Bilan <strong>de</strong>s sessions rivière<br />
partage <strong>de</strong> l’eau organisées<br />
sur la Dordogne entre<br />
Limeuil et Libourne<br />
(Conservatoire <strong>de</strong>s rives <strong>de</strong><br />
la Dordogne).
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
VOLET D<br />
(hors nomenclature contrat <strong>de</strong> rivière)<br />
Développement touristique<br />
Patrimoine fluvial<br />
Voies vertes et Voies b<strong>le</strong>ues : loisirs nautiques, itinérance et tourisme fluvial<br />
Sta<strong>de</strong> d’eaux vives <strong>de</strong> Mauzac<br />
47
D<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE<br />
PATRIMOINE FLUVIAL<br />
Contexte :<br />
La Dordogne a joué un rô<strong>le</strong> économique et culturel majeur dans la civilisation et l’animation <strong>de</strong> toute la<br />
vallée. El<strong>le</strong> a été une voie <strong>de</strong> communication privilégiée entre <strong>le</strong> Haut <strong>Pays</strong> et Bor<strong>de</strong>aux. Le bateau<br />
facilitait <strong>le</strong>s déplacements et dès l’époque gallo-romaine, il permettait <strong>le</strong>s contacts <strong>de</strong> toute nature. Les<br />
négociant <strong>de</strong> Burdigala expédiaient <strong>de</strong>s vins venus <strong>de</strong>s pays méditerranéens vers <strong>le</strong>s cités installées<br />
<strong>le</strong> long du f<strong>le</strong>uve : la villa gallo-romaine du Canet près <strong>de</strong> Sainte-Foy-La-Gran<strong>de</strong> s’étendait <strong>le</strong> long <strong>de</strong><br />
la Dordogne. Ses propriétaires étaient en contact avec diverses parties du mon<strong>de</strong>. On festoyait aux<br />
huîtres fraîches et au vin importé. En l’an 848, <strong>le</strong>s normands remontèrent la Dordogne sur <strong>le</strong>urs<br />
drakkars. Ils furent anéantis en 889 par <strong>le</strong>s troupes du Vicomte <strong>de</strong> Turenne et <strong>de</strong>s abbés <strong>de</strong> Beaulieu.<br />
Dès <strong>le</strong> XIIIe sièc<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s basti<strong>de</strong>s furent édifiées <strong>le</strong> long du f<strong>le</strong>uve, profitant ainsi <strong>de</strong> la pêche et du<br />
commerce qui se faisait par bateau, car la voie fluvia<strong>le</strong> était bien plus sûre et régulière que <strong>le</strong>s<br />
chemins. Des ports rég<strong>le</strong>mentés par <strong>de</strong>s chartes furent aménagés à cet effet. Les paroisses riveraines<br />
aménagèrent <strong>de</strong>s peyrats pour faciliter l’accostage et <strong>le</strong> chargement <strong>de</strong>s bateaux à fond plat. Ce n’est<br />
là qu’un bout <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la basse vallée qui composait un mon<strong>de</strong> original à part entière. C’est<br />
l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong> ces éléments historiques comprenant à la fois <strong>de</strong>s édifices, <strong>de</strong>s lieux et <strong>de</strong>s pratiques<br />
agrico<strong>le</strong>s mais éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s traditions et cultures loca<strong>le</strong>s que <strong>le</strong>s territoires souhaitent redécouvrir et<br />
mettre en va<strong>le</strong>ur.<br />
Objectif :<br />
• Favoriser la découverte du patrimoine <strong>de</strong> la basse vallée.<br />
• Affirmer <strong>le</strong>s caractères i<strong>de</strong>ntitaires liés aux pratiques, à l’histoire<br />
et aux usages <strong>de</strong> la rivière.<br />
• Sauvegar<strong>de</strong>r, protéger et mettre en va<strong>le</strong>ur <strong>le</strong> patrimoine lié à la<br />
Dordogne.<br />
Type d’actions :<br />
• Recueil <strong>de</strong>s mémoires col<strong>le</strong>ctives sur <strong>le</strong> f<strong>le</strong>uve.<br />
• I<strong>de</strong>ntification d’un concept <strong>de</strong> transmission <strong>de</strong> ces mémoires.<br />
• Réhabilitation restauration, entretien et développement <strong>de</strong>s<br />
ouvrages bâtis et notamment <strong>de</strong>s infrastructures portuaires.<br />
• Mise en œuvre <strong>de</strong>s panneaux Giron<strong>de</strong> à F<strong>le</strong>ur <strong>de</strong> Pierre.<br />
• Manifestations populaires centrées sur <strong>le</strong> f<strong>le</strong>uve.<br />
• Evaluation du patrimoine archéologique et naturel<br />
• Actions <strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s populations (événementiels,<br />
expositions, …)<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, VNF, CDT 33 et 24, CRTA, CAUE, DRAC,<br />
Université <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, Musée d’Aquitaine, Conservatoire <strong>de</strong>s<br />
rives <strong>de</strong> la Dordogne, Maison du F<strong>le</strong>uve PSF, Musée <strong>de</strong> la<br />
Batel<strong>le</strong>rie <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>, CIVRB, Bâtiments <strong>de</strong> France…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Recensement <strong>de</strong>s patrimoines et i<strong>de</strong>ntification<br />
<strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> restauration.<br />
48<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> marketing<br />
touristique <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la<br />
Dordogne (EPIDOR).<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> « Valorisation <strong>de</strong>s<br />
thématiques liées à l’espace<br />
fluviomaritime » (ADDTF33).<br />
• Programme Giron<strong>de</strong> à f<strong>le</strong>ur<br />
<strong>de</strong> pierre (Conseil Général<br />
33).<br />
• Etu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’Association pour<br />
<strong>le</strong> Développement du<br />
Tourisme Fluvial et transfert<br />
d’expérience sur <strong>le</strong><br />
département <strong>de</strong> la Dordogne.<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
• Restauration et mise en va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong>s quais et<br />
ca<strong>le</strong>s.<br />
• Jardin <strong>de</strong> la lamproie (Ste Terre)
D<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE<br />
VOIES VERTES ET VOIES BLEUES :<br />
LOISIRS NAUTIQUES, ITINERANCE ET TOURISME FLUVIAL<br />
Contexte :<br />
La rivière Dordogne est un patrimoine auquel <strong>le</strong>s communautés riveraines vouent un fort attachement. Ceci<br />
s’explique par <strong>le</strong> poids historique <strong>de</strong>s activités liées au f<strong>le</strong>uve et par <strong>le</strong>ur importance dans <strong>le</strong> développement <strong>de</strong> la<br />
vallée. Autrefois classée navigab<strong>le</strong> sur tout son cours, la Dordogne a conservé ce statut à l’aval <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>. La<br />
gestion du Domaine Public Fluvial incombe sur ce parcours à l’établissement public Voies Navigab<strong>le</strong>s <strong>de</strong> France.<br />
Le tourisme fluvial est perçu par <strong>le</strong>s acteurs locaux comme un atout déterminant <strong>de</strong> la basse vallée.<br />
La pratique <strong>de</strong>s loisirs nautiques est généra<strong>le</strong>ment faci<strong>le</strong> et accessib<strong>le</strong> au plus grand nombre sur la basse vallée<br />
<strong>de</strong> la Dordogne. Cel<strong>le</strong>-ci dispose <strong>de</strong> nombreux sites <strong>de</strong> baigna<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> location d’embarcations légères, activités<br />
qui se pratiquent <strong>de</strong> façon plus ou moins organisée voire complètement spontanées. Dans <strong>le</strong>s logiques <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong>s territoires et <strong>de</strong> respect <strong>de</strong>s milieux et <strong>de</strong>s usages, il est possib<strong>le</strong> d’organiser ces pratiques<br />
pour mieux en contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s impacts et <strong>de</strong> <strong>le</strong>s développer pour diversifier l’offre touristique <strong>de</strong> la basse vallée.<br />
L’attraction <strong>de</strong> la Dordogne dans <strong>le</strong> développement <strong>de</strong>s pratiques <strong>de</strong> loisirs n’est plus à démontrer. Toutefois, la<br />
mise en œuvre d’itinéraires <strong>le</strong> long <strong>de</strong>s voies d’eau est rendue diffici<strong>le</strong> par <strong>le</strong>s contextes physiques et<br />
rég<strong>le</strong>mentaires <strong>de</strong>s rivières. Par ail<strong>le</strong>urs, il est impératif pour la basse vallée <strong>de</strong> constituer <strong>de</strong>s liens physiques<br />
entre la rivière et <strong>le</strong> reste du territoire. En effet, <strong>le</strong>s populations touristiques ne sont pas toutes concentrées <strong>le</strong> long<br />
<strong>de</strong> la voie d’eau mais sur l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s territoires. Il convient alors <strong>de</strong> créer <strong>le</strong>s conditions permettant<br />
l’interactivité <strong>de</strong>s milieux facilitant ainsi <strong>le</strong>ur accessibilité.<br />
Objectif :<br />
• Favoriser l’accès et la découverte du f<strong>le</strong>uve et <strong>de</strong> la vallée, ainsi que<br />
l’itinérance nautique et terrestre <strong>le</strong> long <strong>de</strong> l’axe fluvial.<br />
• Développer <strong>le</strong>s liens entre la rivière et <strong>le</strong> reste du territoire.<br />
• Favoriser l’implantation d’activités liées au tourisme fluvial.<br />
• Organiser, développer, qualifier et aménager <strong>le</strong>s lieux d’accueil et<br />
d’activité <strong>le</strong> long <strong>de</strong> la rivière (baigna<strong>de</strong>, navigation col<strong>le</strong>ctive, canoë,<br />
voi<strong>le</strong>, aviron, pêche, découverte, sensibilisation…) notamment au<br />
regard <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> préservation <strong>de</strong><br />
l’environnement.<br />
• Accompagner et développer <strong>le</strong>s clubs nautiques dans <strong>le</strong><br />
développement <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs pratiques et <strong>le</strong>ur implication touristique.<br />
• Valoriser <strong>le</strong>s pratiques <strong>de</strong> glisse sportive sur <strong>le</strong> mascaret.<br />
Type d’actions :<br />
• Création d’itinéraires <strong>de</strong> randonnée nautique et aménagement <strong>de</strong>s<br />
parcours <strong>de</strong> navigation par balisage et signalisation <strong>de</strong> secteurs<br />
diffici<strong>le</strong>s.<br />
• Création d’itinéraires terrestres et aménagement <strong>de</strong>s liaisons.<br />
• Aménagement <strong>de</strong> lieux d’accueil (haltes nautiques, quais<br />
d’accostage, ca<strong>le</strong>s, haltes pique-nique, belvédères, sentiers<br />
d’interprétation, maisons <strong>de</strong> la rivière…) au regard <strong>de</strong>s impératifs du<br />
paysage et <strong>de</strong> l’environnement fluvial.<br />
• Entretien régulier <strong>de</strong>s lieux d’accueil.<br />
• Développement <strong>de</strong>s dispositifs d’animation, promotion, formation et<br />
d’accueil touristiques (communication -SIG, Site Internet,<br />
multimédia-, sites <strong>de</strong> formation, promotion, mise en réseau…).<br />
• Mise en œuvre d’une programmation festive, populaire et culturel<strong>le</strong><br />
favorisant la découverte et l’appropriation <strong>de</strong> la rivière.<br />
Partenaires :<br />
Col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, OTSI, EPCI, VNF, CDT 33 et 24, CRTA, SMNG,<br />
CAUE, CDCK, FDP…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Définition d’un concept et <strong>de</strong> circuits d’itinérance douce.<br />
• Etablissement <strong>de</strong> prescriptions techniques, paysagères<br />
et environnementa<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s aménagements fluviaux, <strong>de</strong>s<br />
aménagements d’accueil et <strong>de</strong>s itinéraires.<br />
• Définition d’une stratégie et d’outils <strong>de</strong> promotion et <strong>de</strong><br />
communication.<br />
• Etablissement d’un plan <strong>de</strong> formation à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s<br />
acteurs du tourisme.<br />
49<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• Plan paysage vallée <strong>de</strong> la Dordogne<br />
(EPIDOR).<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> marketing touristique <strong>de</strong> la<br />
vallée <strong>de</strong> la Dordogne (EPIDOR).<br />
• Schéma départemental <strong>de</strong><br />
développement du tourisme fluvial<br />
(Conseil Général 33).<br />
• Chartes <strong>Pays</strong> du Libournais et du<br />
Grand <strong>Bergerac</strong>ois.<br />
• Plans départementaux <strong>de</strong> randonnée<br />
pé<strong>de</strong>stre (CG33 et 24).<br />
• Plan départemental <strong>de</strong>s pistes et<br />
itinéraires cyclab<strong>le</strong>s (CG33).<br />
• Schéma régional <strong>de</strong>s vélo routes et<br />
voies vertes.<br />
• Plan interdépartemental <strong>de</strong>s loisirs<br />
nautiques du bassin <strong>de</strong> la Dordogne<br />
(EPIDOR).<br />
• Schéma départemental <strong>de</strong> la pêche<br />
<strong>de</strong> loisir (FDAPP 33).<br />
• Etu<strong>de</strong> bathymétrique du lit <strong>de</strong> la<br />
Dordogne et <strong>de</strong> l’Is<strong>le</strong> aval (EPIDOR)<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Nœuds <strong>de</strong> Réseaux<br />
(ADDTF33).<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> stratégie touristique<br />
territoria<strong>le</strong> Limeuil Trémolat Mauzac<br />
Lalin<strong>de</strong> (CG24).<br />
• Schéma directeur convention<br />
interrégiona<strong>le</strong> Dordogne (EPIDOR).<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
• Balisage du chenal <strong>de</strong> la navigation.<br />
• Restauration et mise en va<strong>le</strong>ur quais et ca<strong>le</strong>s.<br />
• Jardin <strong>de</strong> la lamproie (Sainte-Terre)<br />
• Passerel<strong>le</strong> <strong>de</strong> Saillans<br />
• Base <strong>de</strong> loisirs nautiques <strong>de</strong> Dagueys<br />
• Pô<strong>le</strong> Environnement <strong>Pays</strong> du Libournais<br />
• Voie verte et d’un site d’accueil CdC 3 vallées<br />
• Programme d’animation château <strong>de</strong> Limeuil
D<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE<br />
STADE D’EAUX VIVES DE MAUZAC<br />
Contexte :<br />
Dans <strong>le</strong> cadre du renouvel<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> la concession du barrage <strong>de</strong> Mauzac, EDF a l'obligation <strong>de</strong><br />
régulariser <strong>le</strong> débit réservé <strong>de</strong> l'ouvrage au titre du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’environnement. Il est aussi tenu, en vertu<br />
<strong>de</strong> l'artic<strong>le</strong> L.432-6 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'Environnement, d'équiper celui-ci pour améliorer <strong>le</strong> franchissement<br />
<strong>de</strong>s poissons migrateurs, aujourd'hui considéré comme déficient.<br />
Compte tenu <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> débit et <strong>de</strong> dénivelé particulièrement intéressantes pour<br />
développer une activité nautique sur <strong>le</strong> site, <strong>le</strong> Conseil Général <strong>de</strong> la Dordogne a envisagé la<br />
possibilité d'implanter un sta<strong>de</strong> d'eaux vives sur <strong>le</strong> barrage <strong>de</strong> Mauzac.<br />
EPIDOR a assuré la conduite d'une étu<strong>de</strong> d'avant projet <strong>sommaire</strong> et l'animation d'un groupe<br />
technique comprenant <strong>de</strong>s experts en matière d'hydraulique, d'hydrologie et <strong>de</strong> poissons migrateurs et<br />
<strong>le</strong>s principaux partenaires du projet.<br />
Objectif :<br />
• Offrir au public un site sécurisé afin <strong>de</strong> pratiquer <strong>le</strong>s sports d’eau<br />
vive.<br />
• Améliorer <strong>le</strong> franchissement du barrage <strong>de</strong> Mauzac par <strong>le</strong>s<br />
poissons migrateurs.<br />
• Aménager un site <strong>de</strong> niveau international aux pratiquants <strong>de</strong>s<br />
sports d’eau vive.<br />
Type d’actions :<br />
• Conception et réalisation du sta<strong>de</strong> d’eau vive.<br />
Partenaires :<br />
Conseil Général 24, CDT 24, Conseil Régional Aquitaine, CRT,<br />
FFCK, DDJS, DRJS, EPIDOR, Agence <strong>de</strong> l’Eau, CSP, MIGADO,<br />
Commune <strong>de</strong> Mauzac, CC Entre Dordogne et Louyre…<br />
Besoins en étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s :<br />
• Etu<strong>de</strong> juridique, sécurité, économique et<br />
environnementa<strong>le</strong>.<br />
50<br />
Doc. <strong>de</strong> référence :<br />
• EDF/SIRA Ingéniérie, 1997.<br />
Sta<strong>de</strong> d'Eau Vive <strong>de</strong> Mauzac<br />
(Dordogne), Avant Projet<br />
Sommaire.<br />
• Agence Technique<br />
Départementa<strong>le</strong> Dordogne,<br />
1999. Site <strong>de</strong> Mauzac :<br />
création d'un parc olympique<br />
d'eau vive.<br />
Projets prêts à démarrer :<br />
(projet déjà inscrit au CPER 2000-2006).
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
4 L’organisation territoria<strong>le</strong><br />
4.1 L'organisation territoria<strong>le</strong><br />
(cf. livret carto. p 24 & 25)<br />
La basse vallée <strong>de</strong> la Dordogne (Limeuil –<strong>le</strong> Bec d’Ambès) est située dans la région<br />
Aquitaine, à cheval sur <strong>de</strong>ux départements : la Dordogne et la Giron<strong>de</strong>. Sur environ<br />
40 km <strong>de</strong> long, c’est la rivière qui sert <strong>de</strong> frontière aux <strong>de</strong>ux départements.<br />
Deux pays couvrent environ 80% du territoire : <strong>le</strong> Grand <strong>Bergerac</strong>ois, et <strong>le</strong> Libournais.<br />
Trois autres pays sont concernés : la Haute Giron<strong>de</strong>, <strong>le</strong> Cœur Entre-Deux-Mers et<br />
l’Agglomération Bor<strong>de</strong>laise.<br />
Seize communautés <strong>de</strong> communes sont concernées par <strong>le</strong> territoire : Cadouin, Territoire<br />
<strong>de</strong> la truffe, Entre Dordogne et Louyre, Bassin Lindois, Trois Vallées du <strong>Bergerac</strong>ois,<br />
<strong>Bergerac</strong> Pourpre, Dordogne – Eyraud – Lidoire, <strong>Pays</strong> Foyen, Castillon – Pujols,<br />
Juridiction <strong>de</strong> St-Emilion, Libournais, canton <strong>de</strong> Fronsac, sud Libournais, Secteur <strong>de</strong> St-<br />
Loubès, Cubzacais, Canton <strong>de</strong> Bourg. Deux secteurs ne sont pas regroupés en<br />
communautés : <strong>le</strong> Brannais et <strong>le</strong> Vélinois.<br />
Cent <strong>de</strong>ux communes sont concernées par <strong>le</strong> territoire.<br />
4.2 Le contexte <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la basse Dordogne<br />
Sur tout <strong>le</strong> territoire, la Dordogne appartient au Domaine Public Fluvial.<br />
El<strong>le</strong> a été rayée <strong>de</strong> la nomenclature <strong>de</strong>s voies navigab<strong>le</strong>s en amont <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong>. La<br />
gestion <strong>de</strong> ce secteur est assurée par la DDE <strong>de</strong> la Dordogne pour <strong>le</strong> compte du Ministère<br />
<strong>de</strong> l’Ecologie et du Développement Durab<strong>le</strong>.<br />
Toujours classée navigab<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong> au Bec d’Ambés, sa gestion incombe à<br />
l'établissement public Voies Navigab<strong>le</strong>s <strong>de</strong> France. Dans la pratique, <strong>le</strong>s services <strong>de</strong> l’Etat<br />
ont un rô<strong>le</strong> d’opérateurs locaux pour VNF :<br />
- la DDE <strong>de</strong> la Dordogne pour la partie allant <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong> à Saint-Pierre d’Eyraud ;<br />
- <strong>le</strong> Service Maritime <strong>de</strong> Navigation <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong> basé à Libourne pour la partie allant<br />
<strong>de</strong> Saint-Pierre d’Eyraud au Bec d’Ambès.<br />
51
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
52
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
5 Récapitulatif <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s<br />
envisagées<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’un programme <strong>de</strong><br />
restauration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
53<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
A<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
65 000 €<br />
Il s’agira <strong>de</strong> réaliser un bilan <strong>de</strong>s données disponib<strong>le</strong>s sur l’état <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux et sur son<br />
évolution (état <strong>de</strong>s lieux DCE, étu<strong>de</strong>s EPIDOR, données RNB, DDASS), <strong>de</strong> recueillir et d’analyser<br />
<strong>le</strong>s bilans <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s installations d’assainissement domestiques industriel<strong>le</strong>s et<br />
agrico<strong>le</strong>s (données AEAG, SATESE, Chambres <strong>de</strong> Commerce et d’Industrie, Chambres<br />
d’Agriculture). Ce bilan sera complété par une campagne complémentaire <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> la qualité<br />
<strong>de</strong>s eaux (physico-chimique et bactériologique) menée sur l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’axe <strong>de</strong> la basse<br />
Dordogne, et sur <strong>le</strong>s confluences du f<strong>le</strong>uve et <strong>de</strong>s principaux affluents. Ce travail sera réalisé sur<br />
l’ensemb<strong>le</strong> du bassin <strong>de</strong> la Dordogne aval en vue d’établir une stratégie <strong>de</strong> lutte contre la pollution<br />
domestique, industriel<strong>le</strong> et agrico<strong>le</strong> sur l’axe Dordogne et sur <strong>de</strong>s affluents prioritaires. Cette<br />
stratégie <strong>de</strong>vra tenir compte <strong>de</strong> la cartographie <strong>de</strong>s activités présentes sur <strong>le</strong> territoire. L’étu<strong>de</strong><br />
comprendra éga<strong>le</strong>ment la proposition d’un programme d’investissement sur <strong>le</strong>s cinq ans du contrat<br />
<strong>de</strong> rivière. El<strong>le</strong> permettra <strong>de</strong> dresser <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> la complémentarité entre <strong>le</strong>s actions spécifiques<br />
du contrat <strong>de</strong> rivière et <strong>le</strong>s actions sortant du périmètre mais pouvant contribuer au respect <strong>de</strong> la<br />
DCE ou à l’amélioration généra<strong>le</strong> <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s eaux.<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne<br />
Conseil Généraux 24 et 33<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’un système <strong>de</strong><br />
récupération <strong>de</strong>s objets flottants et<br />
élaboration d’un plan d’élimination<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong>, MISE 24 et 33, DDASS 24 et 33, DRIRE<br />
Aquitaine, Chambres consulaires, SATESE,<br />
syndicats vitico<strong>le</strong>s…<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
A<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
30 000 €<br />
Il s’agira d’estimer <strong>le</strong>s informations sur la quantité et la nature <strong>de</strong>s déchets susceptib<strong>le</strong>s d’être<br />
col<strong>le</strong>ctés et traités à partir d’une plateforme <strong>de</strong> col<strong>le</strong>cte <strong>de</strong>s objets flottants à Tuilières, site<br />
pressenti comme <strong>le</strong> plus adapté à ce projet. L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>vra ensuite envisager <strong>le</strong>s solutions<br />
techniques à mettre en œuvre sur <strong>le</strong> site <strong>de</strong> récupération et structurer toute la filière <strong>de</strong> transport,<br />
<strong>de</strong> traitement et d’éventuel<strong>le</strong> valorisation <strong>de</strong>s déchets, qui sont essentiel<strong>le</strong>ment composés <strong>de</strong><br />
végétaux.<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne<br />
Agence <strong>de</strong> l’Environnement et <strong>de</strong> la Maîtrise <strong>de</strong><br />
l’Energie<br />
Conseil Général 24<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
EDF<br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong> Grand <strong>Bergerac</strong>ois, MISE 24, DRIRE<br />
Aquitaine, SMBGD/SMD3…
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’une stratégie <strong>de</strong><br />
lutte contre <strong>le</strong>s espèces végéta<strong>le</strong>s<br />
envahissantes<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
54<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
B1<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
10 000 €<br />
A partir <strong>de</strong>s inventaires existants et <strong>de</strong>s observations <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> terrain et <strong>de</strong>s chantiers déjà<br />
mis en œuvre sur la basse Dordogne, il s’agira <strong>de</strong> définir <strong>le</strong>s mo<strong>de</strong>s d’intervention (techniques,<br />
pério<strong>de</strong>s, opérateurs, territoires…) pour la régulation <strong>de</strong>s plantes aquatiques exotiques<br />
envahissantes à l’échel<strong>le</strong> <strong>de</strong> la basse Dordogne. L’étu<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntifiera <strong>le</strong>s sites à traiter et proposera<br />
<strong>de</strong>s schémas interventions adaptés. El<strong>le</strong> envisagera une stratégie <strong>de</strong> sensibilisation et d’animation<br />
auprès <strong>de</strong>s acteurs locaux.<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne<br />
Conseil Général 24 et 33<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
Etu<strong>de</strong> bilan <strong>de</strong>s informations disponib<strong>le</strong>s<br />
sur la présence du silure et sur <strong>le</strong>s<br />
conséquences <strong>de</strong> son expansion<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong> Libournais et Grand <strong>Bergerac</strong>ois,<br />
Cemagref, CC <strong>Bergerac</strong> Pourpre…<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
B1<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
2 000 €<br />
Il s’agira d’effectuer la col<strong>le</strong>cte <strong>de</strong>s informations disponib<strong>le</strong>s sur la colonisation du silure dans la<br />
Dordogne (données pêche professionnel<strong>le</strong>, enquête pêcheurs aux lignes, statistiques MIGADO). A<br />
partir <strong>de</strong> l’expérience acquise sur d’autres bassins versants, l’étu<strong>de</strong> tentera d’appréhen<strong>de</strong>r <strong>le</strong>s<br />
conséquences possib<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la présence du silure sur la basse Dordogne. El<strong>le</strong> définira <strong>le</strong>s voies<br />
d’action possib<strong>le</strong>s pour limiter, si nécessaire, l’expansion <strong>de</strong> l’espèce ou diminuer ses impacts sur<br />
<strong>le</strong>s écosystèmes locaux et dressera <strong>le</strong>s pistes d’investigations complémentaires à mener pour<br />
mieux connaître la situation.<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne<br />
Conseil Général 24 et 33<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’un programme <strong>de</strong><br />
gestion <strong>de</strong>s zones humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la basse<br />
Dordogne<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong> Libournais et Grand <strong>Bergerac</strong>ois,<br />
Fédération <strong>de</strong> pêche, pêche professionnel<strong>le</strong>,<br />
CSP…<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
B1 / B2<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
40 000 €<br />
Il s’agira <strong>de</strong> col<strong>le</strong>cter et <strong>de</strong> synthétiser <strong>le</strong>s données disponib<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong>s zones humi<strong>de</strong>s présentant<br />
un intérêt écologique (forêts alluvia<strong>le</strong>s, couasnes, prairies humi<strong>de</strong>s, habitats d’espèces rares,…) ou<br />
hydraulique (champs d’expansion <strong>de</strong>s crues, palus), ainsi que <strong>le</strong>s anciens et actuels sites<br />
d’extractions en lit majeur. A partir d’une analyse <strong>de</strong> l’évolution récente <strong>de</strong> ces milieux et <strong>de</strong>s<br />
pressions qui s’exercent sur eux, il s’agira <strong>de</strong> définir <strong>de</strong>s stratégies et <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion<br />
adaptées à chacun <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> milieux rencontrés. Ces stratégies <strong>de</strong>vront être cohérentes avec<br />
<strong>le</strong>s politiques engagées sur la gestion <strong>de</strong>s berges et du lit mineur, la lutte <strong>le</strong>s inondations, la lutte<br />
contre <strong>le</strong>s espèces invasives, la mise en va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong>s paysages. El<strong>le</strong>s <strong>de</strong>vront intégrer, autant que<br />
possib<strong>le</strong>, <strong>le</strong> maintien, voire <strong>le</strong> développement d’activités dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>de</strong>s tel<strong>le</strong>s que par<br />
exemp<strong>le</strong> l’itinérance touristique, la pêche professionnel<strong>le</strong> (grossissement <strong>de</strong>s anguil<strong>le</strong>s,<br />
reproduction piscico<strong>le</strong>), la chasse au gibier d’eau, la recherche scientifique et <strong>le</strong>s activités<br />
naturalistes et culturel<strong>le</strong>s, l’é<strong>le</strong>vage extensif <strong>de</strong> bétail. L’étu<strong>de</strong> comprendra la proposition <strong>de</strong> projets<br />
d’aménagement ou <strong>de</strong> gestion sur <strong>le</strong>s sites <strong>le</strong>s plus propices.<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Europe<br />
Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne<br />
Conseil Général 24 et 33<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong>, CREN Aquitaine, ONC, ONF, CRPF,<br />
Fédération <strong>de</strong> pêche, CSP, VNF, SEPANSO,<br />
Chambres d’Agriculture, CDT 24 et 33…
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’état et du<br />
fonctionnement <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong><br />
protection contre <strong>le</strong>s inondations <strong>de</strong> la<br />
basse Dordogne<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
55<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
B2<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
40 000 €<br />
Il s’agira <strong>de</strong> col<strong>le</strong>cter et <strong>de</strong> compléter <strong>le</strong>s inventaires et <strong>le</strong>s <strong>de</strong>scriptifs existant <strong>de</strong> l’état<br />
<strong>de</strong>s digues <strong>de</strong> la basse Dordogne. L’étu<strong>de</strong> analysera <strong>de</strong> façon <strong>sommaire</strong> <strong>le</strong><br />
fonctionnement et l’état d’entretien <strong>de</strong>s réseaux d’esteys. L’organisation en place pour la<br />
gestion <strong>de</strong> ces systèmes ainsi que <strong>le</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestion pratiqués seront analysés. A<br />
partir <strong>de</strong> cet état <strong>de</strong>s lieux, l’étu<strong>de</strong> définira <strong>de</strong>s stratégies d’intervention, si nécessaires<br />
adaptées aux particularités <strong>de</strong>s différentes zones du bassin. Des voies d’action seront<br />
définies : rénovation d’ouvrages prioritaires clairement défectueux, restauration <strong>de</strong> zones<br />
d’épanchement <strong>de</strong>s crues, étu<strong>de</strong>s hydrauliques complémentaires sur <strong>le</strong>s réseaux <strong>le</strong>s plus<br />
comp<strong>le</strong>xes, meil<strong>le</strong>ure organisation <strong>de</strong>s gestionnaires d’ouvrages, formation et conseil<br />
technique auprès <strong>de</strong>s gestionnaires d’ouvrage…<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne<br />
Conseil Général 24 et 33<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
Etu<strong>de</strong> bilan <strong>de</strong> l’hydrologie estiva<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />
bassins affluents <strong>de</strong> la basse Dordogne<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong>, DDE 33, VNF, Chambres d’Agriculture,<br />
SPIPA, ASA…<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
B3<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
3 000 €<br />
Il s’agira <strong>de</strong> réaliser une première série <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong>s débits <strong>de</strong>s principaux affluents<br />
<strong>de</strong> la basse Dordogne au niveau <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur confluence, en pério<strong>de</strong> d’étiage estival. Ces<br />
mesures auront pour but <strong>de</strong> fournir <strong>le</strong>s informations nécessaires aux analyses menées<br />
dans <strong>le</strong> cadre du PGE du bassin Dordogne-Vézère. El<strong>le</strong>s permettront au comité <strong>de</strong> rivière<br />
<strong>de</strong> participer efficacement aux débats dans <strong>le</strong> cadre du PGE Dordogn- Vézère.<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne<br />
Conseil Général 24 et 33<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
Etu<strong>de</strong> préalab<strong>le</strong> à l’aménagement<br />
paysager et à la mise en va<strong>le</strong>ur du<br />
patrimoine fluvial <strong>de</strong> la basse Dordogne<br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong>, MISE 24 et 33, Chambres d’Agriculture…<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
B1 / D<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
50 000 €<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
Il s’agira d’effectuer un inventaire précis <strong>de</strong>s sites pouvant s’intégrer dans un projet <strong>de</strong><br />
mise en va<strong>le</strong>ur du f<strong>le</strong>uve. Ces sites seront d’une part <strong>le</strong>s patrimoines architecturaux,<br />
archéologiques ou paysagers <strong>de</strong> la vallée, et d’autre part <strong>le</strong>s points noirs paysagers qu’il<br />
faudra résorber. Pour chaque site et en référence qu plan paysage <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la<br />
Dordogne, seront proposés <strong>de</strong>s principes et <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> préservation, d’éventuel<strong>le</strong><br />
restauration et d’aménagement. L’étu<strong>de</strong> envisagera éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s principes<br />
d’aménagement paysagers qui <strong>de</strong>vront être suivis dans <strong>le</strong>s éventuels aménagements<br />
touristiques <strong>de</strong>s autres vo<strong>le</strong>ts du contrat.<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Europe, Etat, Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne,<br />
Conseil Général 24 et 33, Conseil Régional<br />
d’Aquitaine<br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong>, CAUE, CDT, CRT, VNF…
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Etu<strong>de</strong> juridique, sécurité, économique et<br />
environnement préalab<strong>le</strong> à la réalisation<br />
d’un sta<strong>de</strong> d’eaux vives à Mauzac<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
56<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
Conseil<br />
Général 24<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
D<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
80 000 €<br />
Il s’agira d’analyser <strong>le</strong>s vo<strong>le</strong>ts économique, sécurité, juridique et environnemental du projet qui<br />
permettront <strong>de</strong> déboucher sur <strong>de</strong>s propositions et <strong>de</strong>s scénarios chiffrés pour la gestion et <strong>le</strong><br />
fonctionnement du site, prenant en compte <strong>le</strong>s différentes contraintes d’utilisation (sécurité,<br />
juridique, environnement).<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Conseil Général 24<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’un projet <strong>de</strong><br />
développement du tourisme fluvial sur<br />
la basse Dordogne<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong> du Grand <strong>Bergerac</strong>ois, CRT, CDT 24,<br />
FFCK, DRJS, DDJS 24, EDF, AEAG, CSP,<br />
MIGADO, Commune <strong>de</strong> Mauzac, CC entre<br />
Dordogne et Louyre…<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
D<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
90 000 €<br />
L’étu<strong>de</strong> vise à concevoir et à organiser <strong>le</strong> développement du tourisme lié à la rivière Dordogne, en<br />
privilégiant <strong>le</strong>s activités <strong>de</strong> loisirs aquatiques, <strong>de</strong> découverte et d’itinérance douce sur et autour du<br />
f<strong>le</strong>uve.<br />
Il s’agira pour l’essentiel d’effectuer la synthèse partagée <strong>de</strong>s programmes et projets en cours ainsi<br />
que <strong>de</strong>s schémas en vigueur afin d’atteindre <strong>le</strong>s objectifs <strong>de</strong> cohérence, <strong>de</strong> lisibilité économique et<br />
d’assurer un développement soucieux <strong>de</strong> la préservation du milieu. A partir <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s existantes<br />
sur <strong>le</strong>s paysages, sur <strong>le</strong> patrimoine fluvial, <strong>le</strong>s loisirs nautiques et du tourisme fluvial, réalisées à<br />
l’échel<strong>le</strong> du bassin ou <strong>de</strong> la basse vallée, l’étu<strong>de</strong> proposera <strong>de</strong>s interventions coordonnées avec <strong>le</strong>s<br />
projets <strong>de</strong> mise en va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong>s <strong>Pays</strong>. El<strong>le</strong> prendra en compte <strong>le</strong>s actions i<strong>de</strong>ntifiées par <strong>le</strong>s chartes<br />
<strong>de</strong>s <strong>Pays</strong> et <strong>le</strong>s programmes soutenus par <strong>le</strong>s départements <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong> et <strong>de</strong> la Dordogne et la<br />
Région Aquitaine.<br />
L’étu<strong>de</strong> réalisera une synthèse <strong>de</strong>s ressources (patrimoine, paysages, sites, faune et notamment<br />
poissons, gastronomie, batel<strong>le</strong>rie, pêche professionnel<strong>le</strong>…) et <strong>de</strong>s possibilités offertes par <strong>le</strong><br />
territoire (baigna<strong>de</strong>, navigation, découverte, pêche…). El<strong>le</strong> étudiera une stratégie <strong>de</strong> mise en<br />
va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong> ces éléments.<br />
L’étu<strong>de</strong> analysera <strong>le</strong>s réseaux d’itinérance existant (i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> jonction, déficit <strong>de</strong><br />
liaison…) et proposera un projet global d’itinérance douce propre à la thématique fluvia<strong>le</strong>, sur tout<br />
<strong>le</strong> territoire <strong>de</strong> la basse vallée. El<strong>le</strong> prospectera <strong>le</strong>s parcours potentiels nautiques et terrestres<br />
(voies b<strong>le</strong>ues et voies vertes) en fonction <strong>de</strong>s contraintes naturel<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> l’attrait <strong>de</strong> la rivière. El<strong>le</strong><br />
étudiera <strong>le</strong>s questions techniques et juridiques pour la réalisation du projet : maîtrise d’ouvrage<br />
<strong>de</strong>s travaux, gestion foncière (ex. réf<strong>le</strong>xion sur la requalification du chemin <strong>de</strong> halage), coût<br />
estimatif d’investissement et d’entretien… Le projet ne <strong>de</strong>vra pas se focaliser sur une itinérance en<br />
site propre mais privilégier une réf<strong>le</strong>xion sur l’inter modalité entre <strong>le</strong>s mo<strong>de</strong>s d’itinérance. L’étu<strong>de</strong><br />
veil<strong>le</strong>ra à définir <strong>de</strong>s tronçons en bouc<strong>le</strong> à partir <strong>de</strong>s voies d’eau, à établir <strong>de</strong>s liaisons avec <strong>le</strong>s<br />
autres parcours existants sur d’autres thématiques (vignob<strong>le</strong>, histoire…) ainsi qu’à associer un<br />
réseau d’hébergements aux itinéraires.<br />
L’étu<strong>de</strong> établira <strong>de</strong>s prescriptions techniques, paysagères et environnementa<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong>s<br />
aménagements fluviaux, <strong>de</strong>s aménagements d’accueil et <strong>de</strong>s itinéraires susceptib<strong>le</strong>s d’être<br />
développés (haltes nautiques, quais d’accostage, ca<strong>le</strong>s, haltes pique-nique, belvédères, sentiers<br />
d’interprétation, maisons <strong>de</strong> la rivière…). On cherchera à favoriser l’utilisation <strong>de</strong>s infrastructures<br />
existantes et <strong>le</strong>ur intégration paysagère. On veil<strong>le</strong>ra à la prise en compte systématique <strong>de</strong> la<br />
récupération <strong>de</strong>s déchets <strong>de</strong>s bateaux.<br />
El<strong>le</strong> proposera un plan <strong>de</strong> formation à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s acteurs du tourisme. El<strong>le</strong> analysera <strong>le</strong>s outils<br />
<strong>de</strong> communication et <strong>de</strong> promotion harmonieuses à développer à partir <strong>de</strong>s outils déjà mis en<br />
place par <strong>le</strong>s partenaires.<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Europe, Etat, Conseil Général 24 et 33, Conseil<br />
Régional d’Aquitaine, VNF<br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
<strong>Pays</strong>, CDT, CRT, UDOTSI, DDE…
Intitulé<br />
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Animation du contrat basse Dordogne<br />
Description <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
57<br />
Maître<br />
d’ouvrage<br />
EPIDOR<br />
Vo<strong>le</strong>ts<br />
concernés<br />
C<br />
Coût<br />
prévisionnel<br />
10 000 € +<br />
70 000 €/an<br />
Il s’agira <strong>de</strong> mettre en œuvre <strong>de</strong>s moyens d’animation pour accompagner <strong>le</strong> comité <strong>de</strong><br />
rivière dans la coordination et <strong>le</strong> suivi <strong>de</strong> la phase préalab<strong>le</strong> du contrat basse Dordogne.<br />
Partenaires financiers pressentis<br />
Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne<br />
Conseil Général 24 et 33<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
<strong>Pays</strong><br />
Autres partenaires à associer au pilotage<br />
Comité <strong>de</strong> rivière.
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s : actions classiques contrat <strong>de</strong> rivière<br />
Intitulé <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’un programme <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong> la<br />
qualité <strong>de</strong>s eaux<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’un système <strong>de</strong> récupération <strong>de</strong>s objets<br />
flottants et élaboration d’un plan d’élimination<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’une stratégie <strong>de</strong> lutte contre <strong>le</strong>s espèces<br />
végéta<strong>le</strong>s envahissantes<br />
Bilan <strong>de</strong>s informations disponib<strong>le</strong>s sur la présence du silure et<br />
sur <strong>le</strong>s conséquences <strong>de</strong> son expansion<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’un programme <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s zones<br />
humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la basse Dordogne<br />
Analyse <strong>sommaire</strong> <strong>de</strong> l’état et du fonctionnement <strong>de</strong>s<br />
systèmes <strong>de</strong> protection contre <strong>le</strong>s inondations <strong>de</strong> la basse<br />
Dordogne<br />
Bilan <strong>de</strong> l’hydrologie estiva<strong>le</strong> <strong>de</strong>s bassins affluents <strong>de</strong> la<br />
basse Dordogne<br />
Etu<strong>de</strong> préalab<strong>le</strong> à l’aménagement paysager et à la mise en<br />
va<strong>le</strong>ur du patrimoine fluvial <strong>de</strong> la basse Dordogne<br />
Vo<strong>le</strong>t<br />
58<br />
Partenaires financiers<br />
Montant<br />
prévu<br />
(en K€) Europe Etat CG 24 CG 33<br />
CR<br />
Aquit.<br />
A 65 X X X X<br />
AEAG Autre<br />
A 30 X X X X ADEME<br />
B1 10 X X X X<br />
B1 2 X X X X<br />
B1/B2 40 X X X X X<br />
B2 40 X X X X X<br />
B3 3 X X X X<br />
B1/D 50 X X X X X X<br />
Animation du contrat basse Dordogne C 10+70/an X X X X <strong>Pays</strong><br />
TOTAL A/B/C 250+70/an
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
Tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s : vo<strong>le</strong>t touristique<br />
Intitulé <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> définition d’un projet <strong>de</strong> développement du tourisme<br />
fluvial sur la basse Dordogne<br />
Etu<strong>de</strong> juridique, sécurité, économique et environnement<br />
préalab<strong>le</strong> à la réalisation d’un sta<strong>de</strong> d’eaux vives à Mauzac<br />
Vo<strong>le</strong>t<br />
TOTAL D 170<br />
59<br />
Partenaires financiers<br />
Montant<br />
prévu<br />
(en K€) Europe Etat CG 24 CG 33<br />
CR<br />
Aquit.<br />
Autre<br />
D 90 X X X X X VNF<br />
D 80 X X
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
60
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
6 Les partenaires du contrat<br />
Les membres <strong>de</strong> droit du comité <strong>de</strong><br />
rivière<br />
DIREN Aquitaine<br />
Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour Garonne<br />
Conseil Supérieur <strong>de</strong> la Pêche<br />
Les services et <strong>le</strong>s établissements<br />
publics <strong>de</strong> l’Etat<br />
Préfecture <strong>de</strong> la Dordogne<br />
Préfecture <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong><br />
Service Maritime et <strong>de</strong> Navigation<br />
DDE 24<br />
DDE 33<br />
Voies Navigab<strong>le</strong>s <strong>de</strong> France<br />
DDAF 24<br />
DDAF 33<br />
DRT Aquitaine<br />
DRIRE Aquitaine<br />
DRAC Aquitaine<br />
DRASS<br />
GRAPP<br />
ONC<br />
DDASS 33<br />
DDASS 24<br />
Bâtiments <strong>de</strong> France<br />
Les usagers et acteurs socio<br />
professionnels<br />
Syndicat du canal <strong>de</strong> Lalin<strong>de</strong><br />
Syndicat <strong>de</strong> Protection contre <strong>le</strong>s Inondations<br />
<strong>de</strong> la Presqu’î<strong>le</strong> d’Ambès (SPIPA)<br />
ASA et autres syndicats<br />
CCI Libourne<br />
CCI Dordogne<br />
Chambres <strong>de</strong>s Métiers 24, 33<br />
Chambres d’Agriculture 24, 33<br />
Syndicats vitico<strong>le</strong>s<br />
Pô<strong>le</strong> <strong>de</strong> développement touristique <strong>de</strong>s<br />
vignob<strong>le</strong>s <strong>de</strong> <strong>Bergerac</strong><br />
Pô<strong>le</strong> <strong>de</strong> développement touristique <strong>de</strong>s<br />
Basti<strong>de</strong>s<br />
UDOTSI 24, 33<br />
EDF<br />
Fédération <strong>de</strong> Pêche (FDP) 24, 33<br />
Fédération <strong>de</strong> Chasse (FDC) 24, 33<br />
Pêche professionnel<strong>le</strong> 24, 33<br />
Comités Départementaux <strong>de</strong> Canoë Kayak<br />
(CDCK) 24, 33<br />
Conservatoire <strong>de</strong>s rives <strong>de</strong> la Dordogne<br />
SEPANSO<br />
Association Navidor<br />
Association Le Mascaret<br />
61<br />
Les porteurs du contrat<br />
<strong>Pays</strong> du Grand <strong>Bergerac</strong>ois<br />
<strong>Pays</strong> du Libournais<br />
EPIDOR<br />
Les col<strong>le</strong>ctivités<br />
Conseil Régional d’Aquitaine<br />
Conseil Général <strong>de</strong> la Dordogne<br />
Conseil Général <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong><br />
<strong>Pays</strong> <strong>de</strong> la Haute Giron<strong>de</strong><br />
<strong>Pays</strong> Cœur Entre Deux Mers<br />
<strong>Pays</strong> Agglomération Bor<strong>de</strong>laise<br />
CdC <strong>de</strong> Cadouin<br />
CdC du Terroir <strong>de</strong> la truffe<br />
CdC Entre Dordogne et Louyre<br />
CdC du Bassin Lindois<br />
CdC <strong>de</strong>s Trois Vallées du <strong>Bergerac</strong>ois<br />
CdC du <strong>Bergerac</strong> Pourpre<br />
CdC Dordogne – Eyraud – Lidoire<br />
CdC du <strong>Pays</strong> Foyen<br />
CdC <strong>de</strong> Castillon – Pujols<br />
CdC Juridiction <strong>de</strong> St-Emilion<br />
CdC du Libournais<br />
CdC du canton <strong>de</strong> Fronsac<br />
CdC du sud Libournais<br />
CdC du Secteur <strong>de</strong> St-Loubès<br />
CdC du Cubzacais<br />
CdC du Canton <strong>de</strong> Bourg<br />
Communes riveraines non regroupées<br />
Comité Régional du Tourisme (CRT) Aquitaine<br />
Comités Départementaux du Tourisme (CDT)<br />
24, 33
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
62
Contrat <strong>de</strong> rivière Basse Dordogne – Dossier <strong>sommaire</strong> – 28 Janvier 2005<br />
7 Les perspectives <strong>de</strong> développement<br />
du contrat<br />
Dans l’hypothèse <strong>de</strong> son agrément, susceptib<strong>le</strong> d’être délivré par la commission <strong>de</strong><br />
planification du comité <strong>de</strong> bassin Adour Garonne, <strong>le</strong> 28 janvier 2005, <strong>le</strong> contrat <strong>de</strong> rivière<br />
pourrait se développer suivant <strong>le</strong>s étapes et <strong>le</strong>s échéances suivantes :<br />
• L’un <strong>de</strong>s Préfets concernés par <strong>le</strong> territoire se verra mandaté par <strong>le</strong> Préfet <strong>de</strong> Bassin<br />
Adour Garonne pour suivre et coordonner la procédure du contrat <strong>de</strong> rivière. L’une <strong>de</strong><br />
ses premières missions consistera à constituer <strong>le</strong> comité <strong>de</strong> rivière, assemblée <strong>de</strong><br />
débat, <strong>de</strong> coordination et <strong>de</strong> pilotage <strong>de</strong>s actions du contrat. Une fois constitué, <strong>le</strong><br />
comité élira son Prési<strong>de</strong>nt.<br />
• Une cellu<strong>le</strong> d’animation sera mise en place pour assister <strong>le</strong> comité <strong>de</strong> rivière et pour<br />
accompagner l’ensemb<strong>le</strong> du projet jusqu’à son terme.<br />
• Les étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s prévues dans <strong>le</strong> présent <strong>dossier</strong> seront ensuite engagées, sous <strong>le</strong><br />
contrô<strong>le</strong> du comité <strong>de</strong> rivière. Autour <strong>de</strong> chaque étu<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s comités techniques pourront<br />
être instaurés pour assister <strong>le</strong> maître d’ouvrage et pour coordonner <strong>le</strong>s contributions<br />
techniques <strong>de</strong>s différents partenaires. Toutes <strong>le</strong>s étu<strong>de</strong>s sont prévues d’être achevées<br />
en juin 2006.<br />
• Le <strong>dossier</strong> définitif sera constitué au fur et à mesure <strong>de</strong> la validation, par <strong>le</strong> comité <strong>de</strong><br />
rivière, <strong>de</strong>s conclusions et <strong>de</strong>s propositions formulées par <strong>le</strong>s étu<strong>de</strong>s. Le <strong>dossier</strong> définitif<br />
comprendra trois grands vo<strong>le</strong>ts :<br />
1- la présentation du territoire,<br />
2- une synthèse <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s préalab<strong>le</strong>s,<br />
3- un programme d’actions, sur 5 ans, détaillé année par année, sous forme <strong>de</strong> fichesactions,<br />
précisant <strong>le</strong>s opérations retenues, <strong>le</strong> montant <strong>de</strong>s investissements, <strong>le</strong>s maîtres<br />
d’ouvrage ainsi que <strong>le</strong>s partenariats techniques et financiers prévus pour chaque action<br />
(nature du financement, taux et modalités d’intervention prévisionnels,…). Il est<br />
important qu’une forte mobilisation <strong>de</strong>s porteurs <strong>de</strong> projets ait lieu pendant<br />
l’élaboration <strong>de</strong> ce programme. Le <strong>dossier</strong> définitif <strong>de</strong>vrait être présenté <strong>de</strong>vant la<br />
commission <strong>de</strong> planification à la fin <strong>de</strong> l’année 2006.<br />
Dès lors, la signature du contrat <strong>de</strong> rivière par <strong>le</strong>s partenaires (<strong>Pays</strong> du Libournais et du<br />
Grand <strong>Bergerac</strong>ois, EPIDOR, Etat, à travers l’Agence <strong>de</strong> l’Eau Adour-Garonne, Conseil<br />
Régional, Conseils Généraux) vaudra engagement pour un soutien à la réalisation <strong>de</strong>s<br />
opérations et sur un principe <strong>de</strong> participation à <strong>le</strong>ur financement.<br />
• Le contrat entrera dans sa phase <strong>de</strong> réalisation sur la pério<strong>de</strong> 2007-2011. Les maîtres<br />
d’ouvrage pourront alors réaliser <strong>le</strong>urs actions en bénéficiant <strong>de</strong> la programmation<br />
établie par <strong>le</strong> contrat, <strong>de</strong> l’engagement <strong>de</strong>s partenaires financiers et du conseil <strong>de</strong><br />
l’animateur du contrat. Tout au long du contrat, <strong>le</strong> comité <strong>de</strong> rivière pourra déci<strong>de</strong>r<br />
d’ajuster ou <strong>de</strong> modifier <strong>le</strong> ca<strong>le</strong>ndrier et <strong>le</strong> contenu <strong>de</strong>s actions ou d’i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong><br />
nouvel<strong>le</strong>s priorités. Chaque année, une évaluation <strong>de</strong> l’avancement du contrat sera<br />
réalisée par <strong>le</strong> comité <strong>de</strong> rivière.<br />
• Pendant toute la durée d’élaboration du <strong>dossier</strong> définitif, <strong>le</strong>s actions urgentes ou déjà<br />
prêtes à être engagées pourront voir <strong>le</strong> jour au titre <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> financement<br />
existants (Vision 2000, par exemp<strong>le</strong>), sou sréserve qu’el<strong>le</strong>s s’intègrent tota<strong>le</strong>ment dans<br />
<strong>le</strong> projet global. El<strong>le</strong>s bénéficieront <strong>de</strong> la dynamique du contrat <strong>de</strong> rivière et pourront<br />
être appuyées par <strong>le</strong> comité <strong>de</strong> rivière qui, reconnaissant <strong>le</strong>ur cohérence avec <strong>le</strong> projet<br />
<strong>de</strong> contrat, pourra favoriser <strong>le</strong>ur mise en oeuvre.<br />
63
<strong>Pays</strong> du Grand <strong>Bergerac</strong>ois<br />
EPIDOR<br />
Etablissement Public Territorial du Bassin <strong>de</strong> la Dordogne<br />
BP 13, 24250 Castelnaud-la-Chapel<strong>le</strong><br />
Tél : 05.53.29.17.65<br />
Fax : 05.53.28.29.60<br />
Mél : epidor@eptb-dordogne.fr<br />
www.eptb-dordogne.fr<br />
EPIDOR<br />
la rivière solidaire