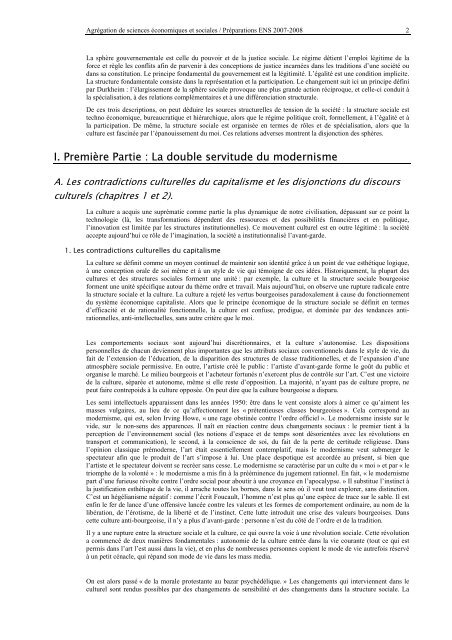Les contradictions culturelles du capitalisme
Les contradictions culturelles du capitalisme
Les contradictions culturelles du capitalisme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Agrégation de sciences économiques et sociales / Préparations ENS 2007-2008 2<br />
La sphère gouvernementale est celle <strong>du</strong> pouvoir et de la justice sociale. Le régime détient l’emploi légitime de la<br />
force et règle les conflits afin de parvenir à des conceptions de justice incarnées dans les traditions d’une société ou<br />
dans sa constitution. Le principe fondamental <strong>du</strong> gouvernement est la légitimité. L’égalité est une condition implicite.<br />
La structure fondamentale consiste dans la représentation et la participation. Le changement suit ici un principe défini<br />
par Durkheim : l’élargissement de la sphère sociale provoque une plus grande action réciproque, et celle-ci con<strong>du</strong>it à<br />
la spécialisation, à des relations complémentaires et à une différenciation structurale.<br />
De ces trois descriptions, on peut dé<strong>du</strong>ire les sources structurelles de tension de la société : la structure sociale est<br />
techno économique, bureaucratique et hiérarchique, alors que le régime politique croît, formellement, à l’égalité et à<br />
la participation. De même, la structure sociale est organisée en termes de rôles et de spécialisation, alors que la<br />
culture est fascinée par l’épanouissement <strong>du</strong> moi. Ces relations adverses montrent la disjonction des sphères.<br />
I. Première Partie : La double servitude <strong>du</strong> modernisme<br />
A. <strong>Les</strong> <strong>contradictions</strong> <strong>culturelles</strong> <strong>du</strong> <strong>capitalisme</strong> et les disjonctions <strong>du</strong> discours<br />
culturels (chapitres 1 et 2).<br />
La culture a acquis une suprématie comme partie la plus dynamique de notre civilisation, dépassant sur ce point la<br />
technologie (là, les transformations dépendent des ressources et des possibilités financières et en politique,<br />
l’innovation est limitée par les structures institutionnelles). Ce mouvement culturel est en outre légitimé : la société<br />
accepte aujourd’hui ce rôle de l’imagination, la société a institutionnalisé l’avant-garde.<br />
1. <strong>Les</strong> <strong>contradictions</strong> <strong>culturelles</strong> <strong>du</strong> <strong>capitalisme</strong><br />
La culture se définit comme un moyen continuel de maintenir son identité grâce à un point de vue esthétique logique,<br />
à une conception orale de soi même et à un style de vie qui témoigne de ces idées. Historiquement, la plupart des<br />
cultures et des structures sociales forment une unité : par exemple, la culture et la structure sociale bourgeoise<br />
forment une unité spécifique autour <strong>du</strong> thème ordre et travail. Mais aujourd’hui, on observe une rupture radicale entre<br />
la structure sociale et la culture. La culture a rejeté les vertus bourgeoises paradoxalement à cause <strong>du</strong> fonctionnement<br />
<strong>du</strong> système économique capitaliste. Alors que le principe économique de la structure sociale se définit en termes<br />
d’efficacité et de rationalité fonctionnelle, la culture est confuse, prodigue, et dominée par des tendances antirationnelles,<br />
anti-intellectuelles, sans autre critère que le moi.<br />
<strong>Les</strong> comportements sociaux sont aujourd’hui discrétionnaires, et la culture s’autonomise. <strong>Les</strong> dispositions<br />
personnelles de chacun deviennent plus importantes que les attributs sociaux conventionnels dans le style de vie, <strong>du</strong><br />
fait de l’extension de l’é<strong>du</strong>cation, de la disparition des structures de classe traditionnelles, et de l’expansion d’une<br />
atmosphère sociale permissive. En outre, l’artiste créé le public : l’artiste d’avant-garde forme le goût <strong>du</strong> public et<br />
organise le marché. Le milieu bourgeois et l’acheteur fortunés n’exercent plus de contrôle sur l’art. C’est une victoire<br />
de la culture, séparée et autonome, même si elle reste d’opposition. La majorité, n’ayant pas de culture propre, ne<br />
peut faire contrepoids à la culture opposée. On peut dire que la culture bourgeoise a disparu.<br />
<strong>Les</strong> semi intellectuels apparaissent dans les années 1950: être dans le vent consiste alors à aimer ce qu’aiment les<br />
masses vulgaires, au lieu de ce qu’affectionnent les « prétentieuses classes bourgeoises ». Cela correspond au<br />
modernisme, qui est, selon Irving Howe, « une rage obstinée contre l’ordre officiel ». Le modernisme insiste sur le<br />
vide, sur le non-sens des apparences. Il naît en réaction contre deux changements sociaux : le premier tient à la<br />
perception de l’environnement social (les notions d’espace et de temps sont désorientées avec les révolutions en<br />
transport et communication), le second, à la conscience de soi, <strong>du</strong> fait de la perte de certitude religieuse. Dans<br />
l’opinion classique prémoderne, l’art était essentiellement contemplatif, mais le modernisme veut submerger le<br />
spectateur afin que le pro<strong>du</strong>it de l’art s’impose à lui. Une place despotique est accordée au présent, si bien que<br />
l’artiste et le spectateur doivent se recréer sans cesse. Le modernisme se caractérise par un culte <strong>du</strong> « moi » et par « le<br />
triomphe de la volonté » : le modernisme a mis fin à la prééminence <strong>du</strong> jugement rationnel. En fait, « le modernisme<br />
part d’une furieuse révolte contre l’ordre social pour aboutir à une croyance en l’apocalypse. » Il substitue l’instinct à<br />
la justification esthétique de la vie, il arrache toutes les bornes, dans le sens où il veut tout explorer, sans distinction.<br />
C’est un hégélianisme négatif : comme l’écrit Foucault, l’homme n’est plus qu’une espèce de trace sur le sable. Il est<br />
enfin le fer de lance d’une offensive lancée contre les valeurs et les formes de comportement ordinaire, au nom de la<br />
libération, de l’érotisme, de la liberté et de l’instinct. Cette lutte intro<strong>du</strong>it une crise des valeurs bourgeoises. Dans<br />
cette culture anti-bourgeoise, il n’y a plus d’avant-garde : personne n’est <strong>du</strong> côté de l’ordre et de la tradition.<br />
Il y a une rupture entre la structure sociale et la culture, ce qui ouvre la voie à une révolution sociale. Cette révolution<br />
a commencé de deux manières fondamentales : autonomie de la culture entrée dans la vie courante (tout ce qui est<br />
permis dans l’art l’est aussi dans la vie), et en plus de nombreuses personnes copient le mode de vie autrefois réservé<br />
à un petit cénacle, qui répand son mode de vie dans les mass media.<br />
On est alors passé « de la morale protestante au bazar psychédélique. » <strong>Les</strong> changements qui interviennent dans le<br />
culturel sont ren<strong>du</strong>s possibles par des changements de sensibilité et des changements dans la structure sociale. La