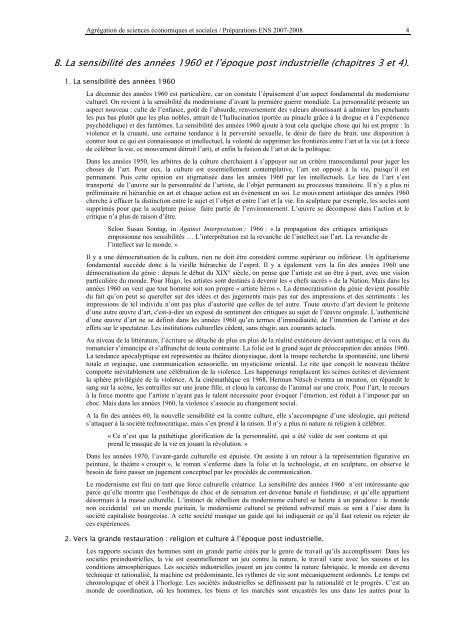Les contradictions culturelles du capitalisme
Les contradictions culturelles du capitalisme
Les contradictions culturelles du capitalisme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Agrégation de sciences économiques et sociales / Préparations ENS 2007-2008 4<br />
B. La sensibilité des années 1960 et l’époque post in<strong>du</strong>strielle (chapitres 3 et 4).<br />
1. La sensibilité des années 1960<br />
La décennie des années 1960 est particulière, car on constate l’épuisement d’un aspect fondamental <strong>du</strong> modernisme<br />
culturel. On revient à la sensibilité <strong>du</strong> modernisme d’avant la première guerre mondiale. La personnalité présente un<br />
aspect nouveau : culte de l’enfance, goût de l’absurde, renversement des valeurs aboutissant à admirer les penchants<br />
les pus bas plutôt que les plus nobles, attrait de l’hallucination (portée au pinacle grâce à la drogue et à l’expérience<br />
psychédélique) et des fantômes. La sensibilité des années 1960 ajoute à tout cela quelque chose qui lui est propre : la<br />
violence et la cruauté, une certaine tendance à la perversité sexuelle, le désir de faire <strong>du</strong> bruit, une disposition à<br />
contrer tout ce qui est connaissance et intellectuel, la volonté de supprimer les frontières entre l’art et la vie (et à force<br />
de célébrer la vie, ce mouvement détruit l’art), et enfin la fusion de l’art et de la politique.<br />
Dans les années 1950, les arbitres de la culture cherchaient à s’appuyer sur un critère transcendantal pour juger les<br />
choses de l’art. Pour eux, la culture est essentiellement contemplative, l’art est opposé à la vie, puisqu’il est<br />
permanent. Puis cette opinion est stigmatisée dans les années 1960 par les intellectuels. Le lieu de l’art s’est<br />
transporté de l’œuvre sur la personnalité de l’artiste, de l’objet permanent au processus transitoire. Il n’y a plus ni<br />
préliminaire ni hiérarchie en art et chaque action est un évènement en soi. Le mouvement artistique des années 1960<br />
cherche à effacer la distinction entre le sujet et l’objet et entre l’art et la vie. En sculpture par exemple, les socles sont<br />
supprimés pour que la sculpture puisse faire partie de l’environnement. L’œuvre se décompose dans l’action et le<br />
critique n’a plus de raison d’être.<br />
Selon Susan Sontag, in Against Interpretation : 1966 : « la propagation des critiques artistiques<br />
empoisonne nos sensibilités … L’interprétation est la revanche de l’intellect sur l’art. La revanche de<br />
l’intellect sur le monde. »<br />
Il y a une démocratisation de la culture, rien ne doit être considéré comme supérieur ou inférieur. Un égalitarisme<br />
fondamental succède donc à la vieille hiérarchie de l’esprit. Il y a également vers la fin des années 1960 une<br />
démocratisation <strong>du</strong> génie : depuis le début <strong>du</strong> XIX° siècle, on pense que l’artiste est un être à part, avec une vision<br />
particulière <strong>du</strong> monde. Pour Hugo, les artistes sont destinés à devenir les « chefs sacrés » de la Nation. Mais dans les<br />
années 1960 on veut que tout homme soit son propre « artiste héros ». La démocratisation <strong>du</strong> génie devient possible<br />
<strong>du</strong> fait qu’on peut se quereller sur des idées et des jugements mais pas sur des impressions et des sentiments : les<br />
impressions de tel indivi<strong>du</strong> n’ont pas plus d’autorité que celles de tel autre. Toute œuvre d’art devient le prétexte<br />
d’une autre œuvre d’art, c'est-à-dire un exposé <strong>du</strong> sentiment des critiques au sujet de l’œuvre originale. L’authenticité<br />
d’une œuvre d’art ne se définit dans les années 1960 qu’en termes d’immédiateté, de l’intention de l’artiste et des<br />
effets sur le spectateur. <strong>Les</strong> institutions <strong>culturelles</strong> cèdent, sans réagir, aux courants actuels.<br />
Au niveau de la littérature, l’écriture se détache de plus en plus de la réalité extérieure devient autistique, et la voix <strong>du</strong><br />
romancier s’émancipe et s’affranchit de toute contrainte. La folie est le grand sujet de préoccupation des années 1960.<br />
La tendance apocalyptique est représentée au théâtre dionysiaque, dont la troupe recherche la spontanéité, une liberté<br />
totale et orgiaque, une communication sensorielle, un mysticisme oriental. Le rite que conçoit le nouveau théâtre<br />
comporte inévitablement une célébration de la violence. <strong>Les</strong> happenings remplacent les scènes écrites et deviennent<br />
la sphère privilégiée de la violence. A la cinémathèque en 1968, Herman Nitsch éventra un mouton, en répandit le<br />
sang sur la scène, les entrailles sur une jeune fille, et cloua la carcasse de l’animal sur une croix. Pour l’art, le recours<br />
à la force montre que l’artiste n’ayant pas le talent nécessaire pour évoquer l’émotion, est ré<strong>du</strong>it à l’imposer par un<br />
choc. Mais dans les années 1960, la violence s’associe au changement social.<br />
A la fin des années 60, la nouvelle sensibilité est la contre culture, elle s’accompagne d’une idéologie, qui prétend<br />
s’attaquer à la société technocratique, mais s’en prend à la raison. Il n’y a plus ni nature ni religion à célébrer.<br />
« Ce n’est que la pathétique glorification de la personnalité, qui a été vidée de son contenu et qui<br />
prend le masque de la vie en jouant la révolution. »<br />
Dans les années 1970, l’avant-garde culturelle est épuisée. On assiste à un retour à la représentation figurative en<br />
peinture, le théâtre « croupit », le roman s’enferme dans la folie et la technologie, et en sculpture, on observe le<br />
besoin de faire passer un jugement conceptuel par les procédés de communication.<br />
Le modernisme est fini en tant que force culturelle créatrice. La sensibilité des années 1960 n’est intéressante que<br />
parce qu’elle montre que l’esthétique de choc et de sensation est devenue banale et fastidieuse, et qu’elle appartient<br />
désormais à la masse culturelle. L’instinct de rébellion <strong>du</strong> modernisme culturel se heurte à un paradoxe : le monde<br />
non occidental est un monde puritain, le modernisme culturel se prétend subversif mais se sent à l’aise dans la<br />
société capitaliste bourgeoise. A cette société manque un guide qui lui indiquerait ce qu’il faut retenir ou rejeter de<br />
ces expériences.<br />
2. Vers la grande restauration : religion et culture à l’époque post in<strong>du</strong>strielle.<br />
<strong>Les</strong> rapports sociaux des hommes sont en grande partie créés par le genre de travail qu’ils accomplissent. Dans les<br />
sociétés préin<strong>du</strong>strielles, la vie est essentiellement un jeu contre la nature, le travail varie avec les saisons et les<br />
conditions atmosphériques. <strong>Les</strong> sociétés in<strong>du</strong>strielles jouent un jeu contre la nature fabriquée, le monde est devenu<br />
technique et rationalisé, la machine est prédominante, les rythmes de vie sont mécaniquement ordonnés. Le temps est<br />
chronologique et obéit à l’horloge. <strong>Les</strong> sociétés in<strong>du</strong>strielles se définissent par la rationalité et le progrès. C’est un<br />
monde de coordination, où les hommes, les biens et les marchés sont encastrés les uns dans les autres pour la