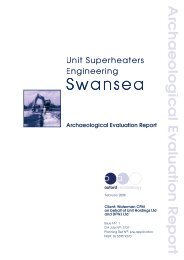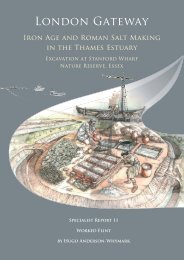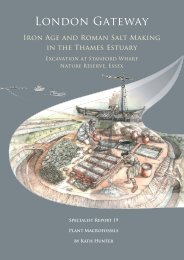AGDE - the OA Library - Oxford Archaeology
AGDE - the OA Library - Oxford Archaeology
AGDE - the OA Library - Oxford Archaeology
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Oxford</strong> Archéologie Méditerranée, 115 rue Merlot, ZAC la Louvade, 34130 Mauguio<br />
Au sud, au pied du versant opposé du Mont Saint-<br />
Loup, au site de Saint Loup I (34-003-016H), un<br />
petit ensemble de céramique (amphore, sigillée,<br />
dolia, tegulae, imbrices), associé à des éléments<br />
de sol en tuileau et d’enduit blanc, suggère la<br />
présence d’un établissement rural du Ier av. au Ier<br />
ap. J.-C. L’abbé J. Giry a également identifié un<br />
habitat gallo-romain à Saint-Martin des Vignes<br />
(34-003-19H), sur la base de briquettes d’opus<br />
spicatum, morceaux de dolia, tegulae, imbrices,<br />
amphores et autres céramiques.<br />
Et cela pour ne citer que les sites les plus<br />
proches.<br />
2.2.5 Quelques problématiques autour d’Agde<br />
De ce contexte général, nous pouvons tirer<br />
quelques remarques.<br />
La ville d’Agde est mal connue, ainsi que<br />
l’étendue de son territoire et sa caractérisation.<br />
Si l’existence de la Chôra est retenue par tous<br />
les auteurs consultés, sa caractérisation, son<br />
étendue et son évolution ne sont pas établies de<br />
façon incontestée. La connaissance pratique du<br />
territoire du bassin de Thau repose surtout sur les<br />
prospections pédestres et il semble que la Chôra<br />
agathoise échappe au chercheur avant le IIème<br />
siècle avant J.-C.<br />
Les petits établissements, types fermes, sont<br />
attestés, même si souvent mal définis. La part<br />
d’élément indigène et d’élement italique, grec,<br />
voir ibérique reste aussi un point à définir.<br />
Par contre, il semble clair maintenant que dès le<br />
IIème siècle (avant même la fin de ce siècle) cette<br />
campagne sert en partie à la production à grande<br />
échelle de vin, certainement pour l’exportation.<br />
La présence de nombreux épandages de<br />
matériaux, principalement des amphores, souvent<br />
italiques, est le signe d’une anthropisation des<br />
zones rurales. L’origine de ces concentrations<br />
est souvent inconnue : colluvionnement (mais<br />
la densité des concentrations laisse peu de place<br />
aux phénomènes naturels), amendement des<br />
sols, restes d’habitat ou structures en matériaux<br />
périssables (Dellong dans document internet<br />
http://lemo.irht.cnrs.fr/44/narbonne-antique.<br />
htm).<br />
La fouille du Capiscol s’inscrit dans ce cadre<br />
général et bien que modeste en elle-même, s’est<br />
efforcée de considérer ces problématiques au<br />
travers des méthodes mises en oeuvre par la<br />
fouille.<br />
2.3 Méthodes de fouilles et enregistrement de<br />
terrain<br />
2.3.1 Les terrassements<br />
Le décapage mécanique fut réalisé, pendant<br />
14 jours, à l’aide d’une pelle à chenille (20<br />
tonnes), équipée d’un godet lisse de curage et<br />
sous direction archéologique. La terre arable fut<br />
décapée par passes d’environ 0,20 m jusqu’à<br />
ce que les niveaux archéologiques ou bien le<br />
sommet du substrat géologique soient atteints.<br />
Des camions bennes (19 tonnes) furent utilisés<br />
afin d’emporter la terre dans des aires de<br />
stockage appropriées, adjacentes au site. Tous les<br />
terrassements ont été réalisés par la société CMP.<br />
La terre arable a été enlevée sur une profondeur<br />
variant entre 0,30 m et 1,50 m.<br />
Un problème survint avant l’intervention de<br />
l’équipe archéologique et le décapage de la<br />
zone B, au nord du site. Une mauvaise lecture<br />
des piquets de délimitation de la zone touchée par<br />
la prescription a induit les terrassiers préparant<br />
les voies d’accès pour le compte de l’aménageur<br />
à installer un bassin de rétention temporaire<br />
au milieu de la zone B. Par comparaison avec<br />
les résultats obtenus par le diagnostic de<br />
l’I.N.R.A.P., il apparaît qu’environ 10% de<br />
la surface projetée comme étant occupée par<br />
l’éventuel habitat a été détruite.<br />
2.3.2 Stratégie de fouille<br />
Les trois zones furent ouvertes consécutivement.<br />
La zone A fut fouillée en premier puis les deux<br />
autres zones simultanément.<br />
Après le décapage et un plan des faits observés,<br />
établi au préalable de la fouille à l’aide d’une<br />
Station Totale TPS1200, des interventions d’un<br />
mètre minimum ont été effectuées manuellement<br />
à intervalles réguliers au travers des linéaires, les<br />
fosses ont été sectionnées à moitié. Les sections<br />
ont été dessinées à la main au 1/20e ou 1/10e<br />
au besoin. Les intersections entre fossés ont été<br />
étudiées spécifiquement pour établir précisément<br />
la chronologie relative du site.<br />
La couche riche en matériel de la zone B a été<br />
nettoyée à la main et dessinée au 1/20e.<br />
33