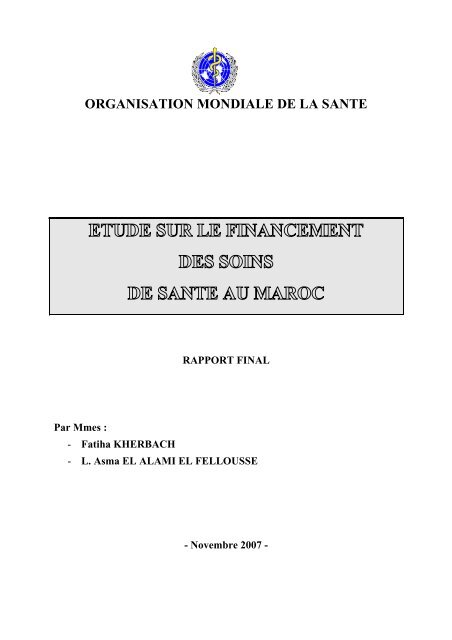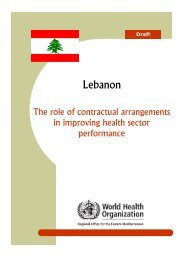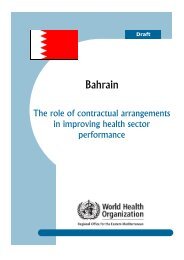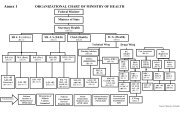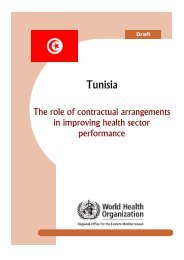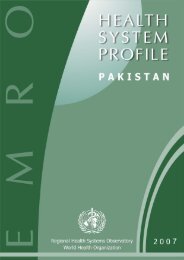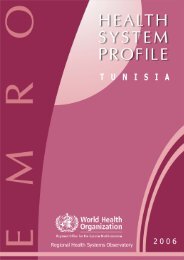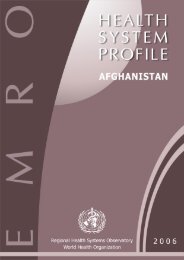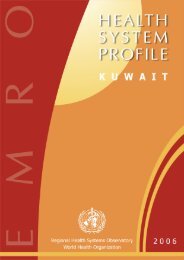Mapping Health care Financing Morocco.pdf - What is GIS
Mapping Health care Financing Morocco.pdf - What is GIS
Mapping Health care Financing Morocco.pdf - What is GIS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Par Mmes :<br />
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE<br />
- Fatiha KHERBACH<br />
RAPPORT FINAL<br />
- L. Asma EL ALAMI EL FELLOUSSE<br />
- Novembre 2007 -
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Avert<strong>is</strong>sement<br />
Les auteurs sont des cadres du Min<strong>is</strong>tère des<br />
Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation et du Min<strong>is</strong>tère de<br />
la Santé marocains. Les données et les opinions<br />
relatées dans ce document n’engagent ni le<br />
département ni le pays auxquels ils appartiennent.<br />
2
Financement des soins de santé au Maroc<br />
TABLE DES MATIERES<br />
AVERTISSEMENT................................................................................................................... 2<br />
TABLE DES MATIERES ......................................................................................................... 3<br />
LISTES DES TABLEAUX........................................................................................................ 7<br />
LISTES DES GRAPHIQUES.................................................................................................... 8<br />
ACRONYMES........................................................................................................................... 9<br />
RESUME ANALYTIQUE....................................................................................................... 10<br />
INTRODUCTION.................................................................................................................... 16<br />
CHAPITRE PRELIMINAIRE : MATRICE DONNANT UNE VUE D'ENSEMBLE DE<br />
CHAQUE REGIME DE PREPAIEMENT (Y COMPRIS CEUX DE L'ETAT) .................... 21<br />
I/ ETAT .................................................................................................................................. 21<br />
II/ REGIME D’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE (AMO) ..................................... 22<br />
III/ SECTEUR MUTUALISTE ET SECTEUR DES ASSURANCES (ASSURANCE FACULTATIVE : DE<br />
BASE ET COMPLEMENTAIRE).................................................................................................. 24<br />
PREMIERE PARTIE : ANALYSE DES SOUS-FONCTIONS DU FINANCEMENT DU<br />
SYSTEME DE SANTE ........................................................................................................... 26<br />
CHAPITRE 1 : COLLECTE DES FONDS ..................................................................................... 26<br />
I/ de l'Etat,........................................................................................................................ 26<br />
II/ des employeurs, ........................................................................................................... 27<br />
III/ des ménages, .............................................................................................................. 27<br />
IV/ de la coopération internationale/donateurs............................................................... 28<br />
CHAPITRE 2 : MISE EN COMMUN DES FONDS ET MUTUALISATION DES RESSOURCES .............. 29<br />
I/ M<strong>is</strong>e en commun des fonds et mutual<strong>is</strong>ation des ressources par les mécan<strong>is</strong>mes liés à<br />
l'Etat ................................................................................................................................. 29<br />
II/ M<strong>is</strong>e en commun des fonds et mutual<strong>is</strong>ation des ressources par les régimes de<br />
couverture de soins de santé ............................................................................................ 30<br />
CHAPITRE 3 : ACHAT DE BIENS ET SERVICES DE SOINS .......................................................... 30<br />
I/ Achat de services de soins ............................................................................................ 30<br />
I.1. Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé ........................................................................................ 30<br />
I.1.1. Le réseau des établ<strong>is</strong>sements de soins de santé de base................................. 31<br />
I.1.2. Le réseau des hôpitaux.................................................................................... 31<br />
I.2. Les organ<strong>is</strong>mes gérant la couverture médicale ...................................................... 34<br />
3
Financement des soins de santé au Maroc<br />
I.2.1. Description des arrangements liés à la politique d'achat des services de santé<br />
par les systèmes de prépaiement .............................................................................. 34<br />
I.2.2. Mécan<strong>is</strong>mes de contractual<strong>is</strong>ation relatifs au système du tiers payant.......... 36<br />
I.3. Les ménages........................................................................................................... 36<br />
II/ Achat de biens : Le médicament.................................................................................. 36<br />
DEUXIEME PARTIE : FINANCEMENT PAR LES REGIMES ET MECANISMES DE<br />
COUVERTURE DES SOINS DE SANTE.............................................................................. 40<br />
CHAPITRE 1 : BUDGET DE L’ETAT ......................................................................................... 40<br />
Section I : Financement du Min<strong>is</strong>tère de la Santé ........................................................... 40<br />
I.1. Budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé (Niveau, Evolution et Exécution des crédits) .... 40<br />
I.2. Structure des dépenses du Min<strong>is</strong>tère de la Santé ................................................... 41<br />
Section II : La participation des autres Min<strong>is</strong>tères au financement de la santé.............. 42<br />
II.1. Sources de financement des autres départements min<strong>is</strong>tériels ............................. 42<br />
II.2. Classification économique des dépenses des autres Min<strong>is</strong>tères ........................... 42<br />
II.3. Classification fonctionnelle des dépenses des autres Min<strong>is</strong>tères.......................... 43<br />
Section III : Le financement de la santé par les Collectivités Locales ............................ 44<br />
III.1. Flux financiers entre les CL et les autres institutions.......................................... 45<br />
III.2. Classification économique des dépenses des CL ................................................ 46<br />
III.3. Classification fonctionnelle des dépenses des CL............................................... 46<br />
Section IV : Financement des programmes de santé publique et des services de ........... 47<br />
soins : L’immun<strong>is</strong>ation, la promotion de la santé, … ...................................................... 47<br />
Section V : Les formations médicales et paramédicales.................................................. 49<br />
V.I. Formation des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dent<strong>is</strong>tes............... 49<br />
V.II. Formation du personnel paramédical................................................................... 49<br />
V.3. Formation continue............................................................................................... 50<br />
CHAPITRE 2 : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DEMUNIES ................................................. 51<br />
I/ Par l’Etat ...................................................................................................................... 51<br />
II/ A travers des mutuelles communautaires.................................................................... 53<br />
CHAPITRE 3 : REGIMES DE COUVERTURE MEDICALE ............................................................. 55<br />
Section I : H<strong>is</strong>torique ....................................................................................................... 55<br />
Section II : Etat des lieux ................................................................................................. 57<br />
II.1. L’assurance maladie obligatoire de base (AMO)................................................. 57<br />
II.1.1. Le régime d'assurance maladie obligatoire de base géré par la CNOPS..... 58<br />
II.1.2. Le régime d'assurance maladie obligatoire de base géré par la CNSS ........ 61<br />
II.2. Couverture facultative .......................................................................................... 63<br />
4
Financement des soins de santé au Maroc<br />
II.2.1. La couverture de base.................................................................................... 63<br />
II.2.2. La couverture complémentaire...................................................................... 64<br />
Section III : Système de régulation des régimes de couverture médicale........................ 64<br />
III.1. L’Agence Nationale d’Assurance Maladie (ANAM) pour l’AMO .................. 64<br />
III.2. Le Conseil supérieur de la mutualité (CSM) pour le secteur de la mutualité. 67<br />
III.3. Le Conseil consultatif des assurances (CCA) pour le secteur des assurances68<br />
Section IV : Analyse des situations financières des régimes de couverture et leur<br />
évolution........................................................................................................................... 69<br />
IV.1. La CNOPS ....................................................................................................... 69<br />
IV.2. La CNSS........................................................................................................... 71<br />
IV.3. Les sociétés mutual<strong>is</strong>tes................................................................................... 72<br />
IV.4. Les entrepr<strong>is</strong>es d’assurances........................................................................... 73<br />
CHAPITRE 4 : FORCES ET FAIBLESSE DES SYSTEMES DE PREPAIEMENT .................................. 75<br />
I/ En termes de populations couvertes et de cons<strong>is</strong>tance des services assurés............. 75<br />
II/ En termes d'équité, de qualité et de d<strong>is</strong>ponibilité des services de soins.................. 77<br />
TROISIEME PARTIE : REFORME DES REGIMES ET MECANISMES DE<br />
PREPAIEMENT ...................................................................................................................... 78<br />
CHAPITRE 1 : REFORME DE LA DEPENSE PUBLIQUE ............................................................... 79<br />
CHAPITRE 2 : EXTENSION DE LA COUVERTURE MEDICALE..................................................... 79<br />
I/ Régime d’ass<strong>is</strong>tance médicale (RAMED)..................................................................... 80<br />
II/ L’assurance maladie obligatoire au profit des travailleurs indépendants, les<br />
personnes exerçant une profession libérale et les aides art<strong>is</strong>ans .................................... 86<br />
II.1. Le secteur des assurances ..................................................................................... 87<br />
II.2. Le secteur mutual<strong>is</strong>te............................................................................................ 88<br />
II.2.1. Les pharmaciens et professionnels de la santé.............................................. 88<br />
II.2.2. Les art<strong>is</strong>tes..................................................................................................... 88<br />
II.2.3. Les avocats .................................................................................................... 88<br />
III/ L’assurance maladie au profit d’autres catégories ................................................... 89<br />
III.1. Les auxiliaires de l'autorité (Moqqaddems et Chioukhs).................................... 89<br />
III.2. Les Imams ........................................................................................................... 89<br />
III.3. Les Anciens rés<strong>is</strong>tants et anciens membres de l’Armée de libération ................ 90<br />
III.4. Les victimes de violation des droits de l’Homme ............................................... 90<br />
IV/ Population restant à couvrir....................................................................................... 91<br />
IV.1. Les étudiants ....................................................................................................... 91<br />
5
Financement des soins de santé au Maroc<br />
IV.2. Les professionnels du transport (propriétaires de véhicules de transport, titulaires<br />
d’agréments de transport, les chauffeurs, …) .............................................................. 91<br />
IV.3. Les personnes n’exerçant aucune activité et d<strong>is</strong>posant d’un revenu (rentiers,…)<br />
...................................................................................................................................... 91<br />
CONCLUSION ........................................................................................................................ 92<br />
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................. 96<br />
ANNEXES ............................................................................................................................... 98<br />
6
Financement des soins de santé au Maroc<br />
LISTES DES TABLEAUX<br />
Tableau 1 : Sources de financement des autres Min<strong>is</strong>tères (hors paiements des salaires des<br />
médecins enseignants), 2001.................................................................................................... 42<br />
Tableau 2 : Classification économique des dépenses des autres Min<strong>is</strong>tères (hors paiements des<br />
salaires des médecins enseignants), 2001 ................................................................................ 43<br />
Tableau 3 : Classification fonctionnelle des dépenses des autres Min<strong>is</strong>tères (hors paiements<br />
des salaires des médecins enseignants), 2001 .......................................................................... 44<br />
Tableau 4 : Flux financiers entre les CL et les autres institutions, 2001, ................................ 45<br />
Tableau 5 : Contribution des mutuelles communautaires marocaines aux objectifs de la grille<br />
d’analyse d’Alain Letourmy et Aude Pavy-Letourmy............................................................. 54<br />
Tableau 6 : Population couverte par la CNOPS....................................................................... 59<br />
Tableau 7 : Population couverte par la CNSS.......................................................................... 62<br />
Tableau 8 : Dépenses prév<strong>is</strong>ionnelles de la CNOPS en 2007 ................................................. 70<br />
Tableau 9 : Dépenses de la CNSS en 2006 ............................................................................. 71<br />
Tableau 10 : Evolution de la situation des sociétés mutual<strong>is</strong>tes ............................................. 72<br />
Tableau 11 : Evolution des primes ém<strong>is</strong>es par les entrepr<strong>is</strong>es d’assurance ............................ 73<br />
Tableau 12 : Evolution des prestations et fra<strong>is</strong> payés ............................................................. 74<br />
Tableau 13 : Evolution de la situation des entrepr<strong>is</strong>es d’assurances ....................................... 74<br />
7
Financement des soins de santé au Maroc<br />
LISTES DES GRAPHIQUES<br />
Figure 1 : Evolution des indices des différents chapitres du budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé,<br />
1997/97-2007 ........................................................................................................................... 41<br />
Figure 2 : Classification économique des dépenses de santé des autres Min<strong>is</strong>tères, 2001 ...... 43<br />
Figure 3 : Classification fonctionnelle des dépenses de santé des autres Min<strong>is</strong>tères, 2001.... 44<br />
Figure 4 : Classification économique des dépenses de santé des Collectivités Locales, 2001 46<br />
Figure 5 : Classification fonctionnelle des dépenses de santé des Collectivités Locales, 2001<br />
.................................................................................................................................................. 47<br />
Figure 6 : Evolution de la situation des sociétés mutual<strong>is</strong>tes................................................... 73<br />
Figure 7 : Evolution de la situation des entrepr<strong>is</strong>es d’assurances............................................ 75<br />
8
Financement des soins de santé au Maroc<br />
ACRONYMES<br />
AFD : Agence França<strong>is</strong>e de Développement<br />
AIEA : Agence Internationale d’Energie Atomique<br />
ALC : Affections lourdes et coûteuses<br />
ALD : Affections de longue durée<br />
AMO : Assurance Maladie Obligatoire<br />
ANAM : Agence Nationale d’Assurance Maladie<br />
AO : Appels d’Offres<br />
BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement<br />
CMB : Couverture médicale de Base<br />
CHU : Centre Hospitalier Universitaire<br />
C L : Collectivités Locales<br />
CMIM : Ca<strong>is</strong>se Marocaine Interprofessionnelle des Mutuelles<br />
CNOPS : Ca<strong>is</strong>se Nationale d'Organ<strong>is</strong>mes de Prévoyance Sociale<br />
CNSS : Ca<strong>is</strong>se Nationale de Sécurité Sociale<br />
DAPS : Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale<br />
E E P : Entrepr<strong>is</strong>es et Etabl<strong>is</strong>sements Publics<br />
FMSAR : Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurance et de Réassurance<br />
FMI : Fonds Mondial International<br />
FNUAP : Fond des Nations Unies pour le Population<br />
IFCS : Instituts de Formation aux Carrières de Santé<br />
MFP : Min<strong>is</strong>tère des Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation<br />
NABM : Nomenclature des Actes de Biologie Médicale<br />
NGAP : Nomenclature Générale des Actes Professionnels<br />
OMS : Organ<strong>is</strong>ation Mondiale de la Santé<br />
ONG : Organ<strong>is</strong>ations Non Gouvernementales<br />
PIB : Produit Intérieur Brut<br />
PPM : Prix Public Maroc<br />
RAMED : Régime d'Ass<strong>is</strong>tance Médicale<br />
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat<br />
RSSB : Réseau de Soins de Santé de Base<br />
SEGMA : Service de l'Etat Géré de Manière Autonome<br />
TNR : Tarification Nationale de Référence<br />
9
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Résumé analytique<br />
Le Maroc est un pays où coex<strong>is</strong>tent une offre de soins publique et une offre privée. De même,<br />
en matière de financement, c’est un système multiple qui comporte un régime d'assurance<br />
maladie obligatoire de base et des mutuelles et entrepr<strong>is</strong>es d’assurances privées qui assurent<br />
une couverture médicale de base et/ou complémentaire.<br />
Mutations démographiques, socio-économiques, sanitaires, …<br />
Le système de santé marocain connaît de profondes mutations sur le plan épidémiologique,<br />
démographique et socioéconomique.<br />
L’espérance de vie à la na<strong>is</strong>sance est passé de 48 ans en 1967 à 69,5 ans en 1999 et 70,8 ans<br />
en 2004, avec un écart entre le milieu urbain et le milieu rural.<br />
L’éspérance de vie en bonne santé (ou espérance de vie corrigée de l’état de santé, EVCS) est<br />
à 54,9 ans. Ceci veut dire qu’actuellement un nouveau-né marocain peut espérer vivre près de<br />
55 ans en pleine santé.<br />
Le niveau de mortalité infantile et infanto-juvénile reste relativement élevé, avec des taux<br />
respectifs de 40‰ et 47‰ en 2000 et 2004.<br />
Le taux de mortalité maternelle de 359 à 227 décès maternels pour 100 000 na<strong>is</strong>sances<br />
vivantes entre 1981 et 2003.<br />
D’importantes inégalités sont encore observées au niveau de la répartition des taux de<br />
mortalité maternelle et de mortalité des enfants par milieu de résidence, par niveau de vie et<br />
par région.<br />
En terme de morbidité, les affections transm<strong>is</strong>sibles, périnatales et maternelles continuent à<br />
représenter un poids relativement important dans la charge de morbidité globale avec 46,4%<br />
des Années de Vie Perdues en ra<strong>is</strong>on d’un Décès Prématuré (AVDP) et 33,4% des Années de<br />
Vie Corrigées du facteur Invalidité (AVCI). Elle touche davantage les groupes de population<br />
défavor<strong>is</strong>ée.<br />
Les affections non transm<strong>is</strong>sibles dominent la structure de la charge globale de morbidité avec<br />
55,8% des AVCI et 41,2% des AVDP (hypertension artérielle est dominante, maladies<br />
respiratoires et cancers).<br />
Quant aux accidents, les traumat<strong>is</strong>mes et les intoxications, ils constituent le phénomène<br />
émergeant de la morbidité globale avec 10,8% des AVCI et 9,6% des AVDP. Ils représentent<br />
entre 17% et 50% des motifs de consultation au niveau des urgences hospitalières.<br />
Système de santé : offres de soins limitées et besoins en soins insat<strong>is</strong>faits<br />
Au Maroc, l’offre de soins est organ<strong>is</strong>é de façon pyramidale, autour de deux secteurs :<br />
le secteur public : il comprend les ressources sanitaires du Min<strong>is</strong>tère de la Santé, des<br />
Forces Armées Royales, des Collectivités Locales et d’autres départements min<strong>is</strong>tériels.<br />
le secteur privé : il est composé de deux sous-ensembles, dont un à but non lucratif qui<br />
regroupe les ressources sanitaires de la Ca<strong>is</strong>se Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), des<br />
mutuelles, du Cro<strong>is</strong>sant Rouge Marocain (CRM), des ONG, etc. ; et le second à but<br />
lucratif, constitué par les ressources sanitaires du secteur libéral, organ<strong>is</strong>ées et dirigées à<br />
titre individuel ou en groupement, par des professionnels de santé<br />
Depu<strong>is</strong> l’indépendance, un important effort a été consenti par l’Etat pour étendre la couverture<br />
sanitaire à l’ensemble du territoire et en même temps réhabiliter ou reconstruire un certain<br />
nombre d’établ<strong>is</strong>sements de soins ex<strong>is</strong>tants. Le même effort a été entrepr<strong>is</strong> pour améliorer<br />
10
Financement des soins de santé au Maroc<br />
l’encadrement du système par les professionnels de la santé nécessaire aux soins et aux<br />
activités de promotion, de prévention et de lutte contre les maladies.<br />
Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé constitue le premier prestataire de soins, pu<strong>is</strong>qu’il d<strong>is</strong>pose de 80% de<br />
la capacité litière du pays. Seulement, les services de santé essentiels sont soit inaccessibles à<br />
ceux qui en ont besoin soit sous-util<strong>is</strong>és par ceux qui en ont besoin, en ra<strong>is</strong>on des obstacles<br />
financiers, sociaux, physiques et géographiques. Alors que la plupart des besoins en soins de<br />
santé non sat<strong>is</strong>faits se trouvent dans les zones rurales et parmi les plus pauvres, la majorité des<br />
services de santé bien dotées, par des médecins et autres professionnels de la santé se trouvent<br />
dans les grandes villes. Ainsi, les fonds publics ne suivent pas le patient, ma<strong>is</strong> ils vont là où se<br />
trouvent les services de santé et les médecins.<br />
Insuff<strong>is</strong>ance du financement des soins de santé collectif et solidaire<br />
La dépense globale de santé est faible : 59 US$ par habitant et par an et 5% par rapport au<br />
PIB . Sachant que les coûts des biens et services médicaux sont élevés, c’est le recours aux<br />
soins qui reste faible.<br />
La source principale de financement de la santé reste le paiement directs des ménages : 52%,<br />
contre 44% pour le financement collectif de la santé (f<strong>is</strong>calité nationale et locale 28% et<br />
assurance maladie 16%) .<br />
Avec 80% de la capacité litière du pays, le Min<strong>is</strong>tère de la Santé ne bénéficie que d’environ<br />
31,4% du financement du système national de santé. De l’ensemble des crédits budgétaires<br />
dépensés par le Min<strong>is</strong>tère de la Santé en 2001, 49% profitent aux hôpitaux (17% aux CHU et<br />
32% au reste des hôpitaux), 37% au réseau de soins de santé de base (RSSB) et 10% à<br />
l’Admin<strong>is</strong>tration Centrale et Locale.<br />
De l’ensemble des paiements directs des organ<strong>is</strong>mes gestionnaires des divers régimes<br />
d’assurance maladie, les hôpitaux publics bénéficient à peine de 6%. La part des cabinets<br />
privés est assez importante (34%) ainsi que celle des cliniques privées (32%).<br />
Parallèlement aux actions de diagnostic et de traitement des maladies et de réhabilitation des<br />
incapacités, des actions de promotion de la santé et de prévention sont généralement menés<br />
par le système de soins.<br />
Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé, à travers son budget, suit une politique de santé publique qui<br />
s’appuie énormément sur les programmes de santé publique (une trentaine) dont les plus<br />
importants sont :<br />
- Les Programmes de Santé Maternelle et Infantile :<br />
- Les Programmes de Prévention Sanitaire Collective :<br />
- Le Programme des IST-SIDA<br />
- Autres programmes (diabète, tuberculose, hygiène bucco-dentaire, santé scolaire et<br />
universitaire,…)<br />
Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé, à travers son budget, assure également la pr<strong>is</strong>e en charge des<br />
personnes démunies. En principe, tous les malades se présentant comme indigents, quel que<br />
soit leur lieu de résidence et quel que soit le type d’hôpital qui les reçoit (autonome ou en<br />
régie), doivent bénéficier de l’ass<strong>is</strong>tance médicale gratuite sur présentation d’un certificat<br />
d’indigence délivré par l’autorité locale.<br />
Les organ<strong>is</strong>mes de coopératon internationale financent aussi certains de ces programmes.<br />
L’ONU, a m<strong>is</strong> en place un Fonds multilatéral consacré à la lutte contre les IST-SIDA .<br />
11
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Des ONG (notamment des associations) participent à des actions de prévention, de<br />
sensibil<strong>is</strong>ation et même de financement de certains programmes de santé de manière générale<br />
(Exemple : lutte contre le SIDA, le cancer…) ou ciblés au profit de populations ou régions<br />
spécifiques.<br />
Les autres min<strong>is</strong>tères participent au financement de la santé, à travers leur Budget pour une<br />
part négligeable (environ 53 millions de DHS en 2001).<br />
Les activités sanitaires des Collectivités Locales sont de l’ordre de 1% de la dépense globale<br />
de santé, sous forme de participation en nature (personnel, immobil<strong>is</strong>ations, aide log<strong>is</strong>tique…)<br />
pour le Min<strong>is</strong>tère de la Santé et d’aides financières directes aux ONG. Cette part est appelée à<br />
connaître une augmentation substantielle car les Collectivités Locales seront également<br />
amenées à jouer un rôle très important dans le financement du RAMED.<br />
Transition d’une couverture facultative vers une Couverture médicale obligatoire de<br />
base qui se réal<strong>is</strong>e progressivement<br />
Jusqu’au 18 août 2005, date d’entrée en vigueur de la loi n° 65-00 portant code de la<br />
couverture médicale de base, le Maroc ne conna<strong>is</strong>sait pas de régime d'assurance maladie<br />
obligatoire.<br />
Il a fait le choix de la général<strong>is</strong>ation de la couverture médicale de base en util<strong>is</strong>ant les<br />
structures ex<strong>is</strong>tantes. Le premier acte qui est l'Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO)<br />
au profit des salariés actifs et pensionnés des secteurs public et privé avec deux organ<strong>is</strong>mes<br />
gestionnaires : la CNOPS et la CNSS ainsi que les autres couvertures médicales ont porté la<br />
population des salariés couverte de 16% à 34%.<br />
L’assurance maladie de base de certains salariés reste aussi du ressort d’autres entités<br />
(mutuelles et entrepr<strong>is</strong>es d’assurance), du moins pendant la période transitoire de 5 ans.<br />
A partir de l’année 2006, les sociétés mutual<strong>is</strong>tes sont chargées de deux volets :<br />
- Les sociétés mutual<strong>is</strong>tes composant la CNOPS qui continuent à assurer la gestion de la<br />
couverture médicale complémentaire à l’AMO. Dans ce cadre les sociétés mutual<strong>is</strong>tes sont en<br />
phase d’entreprendre des études actuarielles pour apprécier le niveau de cot<strong>is</strong>ation qui leur<br />
permettrait d’assurer leur équilibre. En parallèle, elles sont chargées de la gestion de certaines<br />
m<strong>is</strong>sions de la CNOPS au titre de l’AMO ;<br />
- Les autres sociétés mutual<strong>is</strong>tes continuent à gérer la couverture médicale de base en plus de<br />
la couverture médicale complémentaire. Certaines de ces sociétés mutual<strong>is</strong>tes ont entamé la<br />
réal<strong>is</strong>ation d’études actuarielles pour l’appréciation de leur équilibre, notamment dans le cas<br />
où leurs adhérents basculeraient dans le régime AMO (CNOPS ou CNSS), après la période de<br />
transition prévue par la loi 65-00.<br />
Les entrepr<strong>is</strong>es d’assurances dans le cadre des contrats individuels ou de groupe offrent des<br />
couvertures complémentaires du r<strong>is</strong>que maladie, souscrits par des particuliers ou par des<br />
employeurs, en complément des prestations garanties par des couvertures de base (régimes<br />
obligatoires ou contrats d’assurances).<br />
Les niveaux de couverture et les taux de primes varient selon les besoins exprimés par les<br />
assurés. Les contrats en couverture complémentaire prévoient des franch<strong>is</strong>es de pr<strong>is</strong>e en<br />
charge, égales aux plafonds prévus par les couvertures de base, ainsi que des plafonds<br />
pouvant atteindre un million de dirhams.<br />
Forces et faiblesse des systèmes de prépaiement<br />
La couverture médicale en vigueur et en cours de m<strong>is</strong>e en œuvre présente un certain nombre<br />
de points forts ma<strong>is</strong> elle souffre également de faiblesses en termes de populations couvertes,<br />
12
Financement des soins de santé au Maroc<br />
de cons<strong>is</strong>tance des paniers de soins et en termes d'équité, de qualité et de d<strong>is</strong>ponibilité de<br />
l’offre de soins.<br />
- l’instauration de systèmes spécifiques de couverture médicale pour chaque catégorie de<br />
personnes qui prennent en considération ses caractér<strong>is</strong>tiques et notamment sa capacité<br />
contributive, ce qui facilite l’extension de la couverture ma<strong>is</strong> favor<strong>is</strong>e une fragmentation de la<br />
population couverte et l’ex<strong>is</strong>tence d’une diversité des régimes de couverture avec différents<br />
niveaux de couverture (taux de couverture et panier de soins) ce qui a abouti à un système à<br />
plusieurs vitesses et à l’absence de toute solidarité entre les catégories d’assurés ;<br />
- l’intervention d’opérateurs publics et privés dans le cadre de la couverture médicale crée<br />
une émulation et des synergies entre les intervenants. De même, la création d’un partenariat<br />
entre des régimes de couverture de statut privé avec des prestataires de soins relevant du<br />
secteur public, pourrait contribuer à la m<strong>is</strong>e à niveau de ces structures publiques et la maîtr<strong>is</strong>e<br />
des dépenses de ces régimes ;<br />
- l’absence de toute coordination entre les différents régimes en matière d'affiliation et<br />
d'immatriculation, du système d'information, de communication, etc. ce qui favor<strong>is</strong>e<br />
l’ex<strong>is</strong>tence d’une fraude des régimes difficilement contrôlable, sachant qu’une partie de la<br />
population marocaine ne bénéficie pas encore d’une couverture médicale actuellement.<br />
- les écarts importants entre les tarifs qui servent de base pour les remboursements des<br />
dossiers maladie et les prix effectivement pratiqués par les prestataires de soins, la<strong>is</strong>se une<br />
part importance des coûts des prestations à la charge des ménages ;<br />
- La grande <strong>care</strong>nce en termes de d<strong>is</strong>ponibilité des services de soins réside dans la<br />
configuration de la carte sanitaire. La m<strong>is</strong>e en place de cette carte, avec une meilleure<br />
répartition des prestataires privés, conjointement à l’amélioration des prestations hospitalières<br />
publiques, va non seulement corriger progressivement ces d<strong>is</strong>parités ou du moins les plus<br />
flagrantes, ma<strong>is</strong> aussi permettre d’irriguer entièrement le territoire national par les ressources<br />
mobil<strong>is</strong>ées par les régimes et mécan<strong>is</strong>mes de prépaiement (AMO, RAMED, Inaya…).<br />
- les dysfonctionnements dont souffrent les établ<strong>is</strong>sements de soins publics rendent<br />
problématique la m<strong>is</strong>e en œuvre d’une tarification des actes et d’un financement basé sur la<br />
performance. Ils compliquent également l’élaboration et l’application du contrôle médical par<br />
les régimes d’assurances. Il s’agit de :<br />
• L’image des établ<strong>is</strong>sements de soins publics et même certains de ceux du privé<br />
intervenant dans le secteur de la santé est entachée par les <strong>care</strong>nces de gestion, la<br />
pers<strong>is</strong>tance de mécan<strong>is</strong>mes de financements parallèles et de formes clandestines de<br />
corruption, d’insuff<strong>is</strong>ance des ressources humaines et de pratiques ne respectant pas<br />
les règles déontologiques ;<br />
• L’absence de mécan<strong>is</strong>mes rigoureux de contrôle et de régulation ;<br />
• L’ex<strong>is</strong>tence de comportements individuels non compatibles avec les exigences<br />
minimales du service public ;<br />
• L’absence de v<strong>is</strong>ion à moyen et long terme et d’une planification stratégique en<br />
matière de ressources humaines (formation et carrière).<br />
- L’iniquité d’affectation des ressources financières se manifeste à plusieurs niveaux et<br />
touche principalement le recours (et l’util<strong>is</strong>ation) aux services de soins publics ainsi que la<br />
répartition des ressources.<br />
13
Financement des soins de santé au Maroc<br />
• Le recours aux soins :<br />
- La gratuité des soins dans les établ<strong>is</strong>sements de soins de santé de base (D<strong>is</strong>pensaires,<br />
Centres de Santé, Centres spécial<strong>is</strong>és -Tuberculose-) est acqu<strong>is</strong>e à toute la population ;<br />
- Le cadre de pr<strong>is</strong>e en charge des personnes démunies souffre de la bureaucratie, de la<br />
non standard<strong>is</strong>ation et de la subjectivité des critères d’éligibilité ;<br />
• La répartition des ressources financières :<br />
- L’absence de critères pertinents et objectifs pour la répartition des crédits entre les<br />
différentes provinces et les divers établ<strong>is</strong>sements et services publics ;<br />
- L’absence de programmation unique du budget et de maîtr<strong>is</strong>e des ressources extra<br />
budgétaires ce qui rend difficile de mettre en place des critères standards de répartition<br />
de ces ressources.<br />
Réforme des régimes et mécan<strong>is</strong>mes de prépaiement est en marche<br />
La réforme qui a débuté depu<strong>is</strong> 2002, jouera un rôle restructurant dans le système de<br />
financement du secteur de santé marocain.<br />
Réforme de la dépense publique<br />
Depu<strong>is</strong> le lancement par le Gouvernement du chantier de la réforme de la dépense publique,<br />
en vertu de la circulaire 12/2001 du 25 décembre 2001 de Monsieur le Premier Min<strong>is</strong>tre<br />
relative à « l'adaptation de la programmation et de l'exécution du budget de l’Etat dans le<br />
cadre de la déconcentration », le Min<strong>is</strong>tère de la Santé s’est approprié l’ensemble des outils<br />
développés dans le cadre des axes de cette réforme (Global<strong>is</strong>ation des crédits, Partenariat,<br />
contractual<strong>is</strong>ation et CDMT) et a contribué activement à l’enrich<strong>is</strong>sement des débats et<br />
réflexions y afférents, tout en procédant en interne à une adaptation de certains outils aux<br />
spécificités sectorielles du Min<strong>is</strong>tère.<br />
Extension de la couverture médicale<br />
La réforme du système marocain de la couverture médicale, permettra à tous les citoyens<br />
l'accès aux soins dans des conditions financières favorables et assurera des recettes sûres et<br />
durables aux producteurs des soins publics et privés, en accro<strong>is</strong>sant la part des mécan<strong>is</strong>mes<br />
collectifs dans le financement du système de santé.<br />
L’AMO qui est entrée en vigueur depu<strong>is</strong> le 18 août 2005 et a commencé à servir les<br />
prestations à partir du début du mo<strong>is</strong> de mars 2007 concerne environ le tiers de la population<br />
marocaine.<br />
Le reste du paysage de la couverture maladie au Maroc s’articule autour de 2 composantes :<br />
• Le régime d’ass<strong>is</strong>tance médicale (RAMED), institué par la loi n° 65-00 précitée, qui<br />
s’adresse aux personnes démunies ou à faible revenu ;<br />
• Le système de couverture médicale au profit du reste de la population<br />
(principalement les indépendants).<br />
- Le régime d’ass<strong>is</strong>tance médicale (RAMED) :<br />
Dans la réforme projetée au Maroc, le RAMED représente le changement institutionnel<br />
majeur dans le financement du système de santé. Le RAMED est donc appelé à participer très<br />
fortement à la restructuration du système national de santé.<br />
14
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Le RAMED, constitue le volet ass<strong>is</strong>tance ou aide sociale financé par la f<strong>is</strong>calité. Il jouera un<br />
rôle appréciable pour éviter l'exclusion des soins d'une partie de la population et le<br />
renforcement de la protection sociale au Maroc.<br />
Il s'agit donc d'un filet social pour des personnes démunies dont la vulnérabilité économique<br />
les maintient hors du système contributif.<br />
Le RAMED dont la m<strong>is</strong>e en place est en cours d’expérimentation dans certaines régions du<br />
Maroc s’adresse à environ 8,5 millions de marocains.<br />
Outre ses principales m<strong>is</strong>sions d'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de<br />
base et de la m<strong>is</strong>e en place des outils de régulation du système, le lég<strong>is</strong>lateur a confié à<br />
l'Agence Nationale d’Assurance Maladie (ANAM) la gestion des ressources financières<br />
affectées au RAMED.<br />
La logique de progressivité dans la m<strong>is</strong>e en œuvre du RAMED devra se faire avec le maintien<br />
de la gratuité des programmes sanitaires et le renforcement des prestations offertes par les<br />
structures de soins de premier niveau.<br />
Compte tenu d'une part, des déla<strong>is</strong> nécessaires pour la m<strong>is</strong>e en place du RAMED (constitution<br />
des comm<strong>is</strong>sions d'identification des populations éligibles, délivrance des cartes d'indigence,<br />
m<strong>is</strong>e en place d’un système d’information etc.) et des possibilités budgétaires offertes d’autre<br />
part, on peut ra<strong>is</strong>onnablement admettre que ce régime atteindra sa vitesse de cro<strong>is</strong>ière dans 2 à<br />
3 ans et permettra à terme à toute la population éligible au RAMED (indigents absolus et<br />
relatifs) d'être pr<strong>is</strong>e en charge dans les hôpitaux publics.<br />
- L’assurance maladie obligatoire au profit des travailleurs<br />
indépendants, les personnes exerçant une profession libérale<br />
et les aides art<strong>is</strong>ans (Inaya)<br />
L’assurance maladie obligatoire (Inaya) pour les travailleurs indépendants, qui exercent, pour<br />
leur propre compte, une activité génératrice de revenus, quelle que soit la nature de l'activité<br />
ou de revenus, les personnes exerçant une profession libérale et les aides art<strong>is</strong>ans exerçant une<br />
activité dans le secteur de l’art<strong>is</strong>anat et les membres de leurs familles, concerne une<br />
population estimée à près de 10 millions de personnes.<br />
La loi n° 03-07 qui a instauré l’obligation de d<strong>is</strong>poser d’une couverture médicale auprès de<br />
sociétés d’assurances ou dans le cadre de mutuelles, a également fixé un panier de soins<br />
minimum que toute couverture doit comporter, à savoir :<br />
- les soins liés à l'hospital<strong>is</strong>ation et aux interventions chirurgicales ;<br />
- les soins liés au suivi des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de<br />
longue durée ;<br />
- les soins relatifs à l'accouchement.<br />
Malgré que la loi n’entrerait en vigueur qu’en 2008, la couverture est en cours de m<strong>is</strong>e en<br />
œuvre par les deux secteurs concernés en partenariat avec les prestataires de soins du secteur<br />
public dans le cadre de conventions de tiers payant selon le système par capitation.<br />
La réflexion actuellement engagée au sujet de cette couverture concerne les modalités de<br />
contrôle du respect de l’obligation et l’organ<strong>is</strong>me qui serait chargé de ce contrôle.<br />
15
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Introduction<br />
Le choix du mode d'organ<strong>is</strong>ation d'un système de santé, quel que soit le pays, est souvent<br />
ramené à l'alternative Etat/marché concurrentiel.<br />
En réalité les systèmes de santé présentent une double originalité, une diversité considérable<br />
et une autonomie relative par rapport aux systèmes économiques des pays concernés.<br />
Diversité par la part faite au marché, par la central<strong>is</strong>ation plus ou moins importante du<br />
système, par les caractér<strong>is</strong>tiques de l'offre (publique, privée, mixte), par les modes de<br />
financement et par les modes de recours aux soins (libre ou réglementé).<br />
Autonomie par rapport à l'économie globale pu<strong>is</strong>que les pays occidentaux offrent une palette<br />
complète depu<strong>is</strong> le système américain libéral et décentral<strong>is</strong>é jusqu'au système angla<strong>is</strong><br />
(scandinave, et des pays de l'Europe du Sud) où l'accès à l'offre est réglementé, le marché<br />
réduit et le financement central<strong>is</strong>é.<br />
C'est le degré de central<strong>is</strong>ation, le choix entre régulation centrale et dynamique<br />
concurrentielle qui fait la différence entre les systèmes de santé effectifs.<br />
L'organ<strong>is</strong>ation la plus fréquente cons<strong>is</strong>te en un système hybride ou coex<strong>is</strong>tent une offre<br />
publique et une offre privée et où les systèmes de financement sont mixtes.<br />
C'est le cas de pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays Bas, la Corée, le<br />
Japon, l'Algérie, la Tun<strong>is</strong>ie, etc.<br />
Les pays qui adoptent ce système organ<strong>is</strong>ent une médecine libérale, une hospital<strong>is</strong>ation mixte<br />
(publique avec le réseau hospitalier, privée avec les cliniques privées) et un système de<br />
financement mixte également où le régime d'assurance maladie obligatoire est complété par<br />
des assurances mutuelles ou privées. Le Maroc s’insère dans cette catégorie de pays.<br />
a. Système de santé au Maroc en bref :<br />
Le système de santé se définit comme l’ensemble des infrastructures, des ressources<br />
(humaines et matérielles) et des actions mobil<strong>is</strong>ées pour assurer la production de soins<br />
préventifs, curatifs, promotionnels et de réhabilitation de la santé de la population.<br />
Ce système est actuellement organ<strong>is</strong>é autour de deux secteurs :<br />
le secteur public : il comprend les ressources sanitaires du Min<strong>is</strong>tère de la Santé, des<br />
Forces Armées Royales, des Collectivités Locales et d’autres départements min<strong>is</strong>tériels.<br />
le secteur privé : il est composé de deux sous-ensembles, dont un à but non lucratif qui<br />
regroupe les ressources sanitaires de la Ca<strong>is</strong>se Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), des<br />
mutuelles, du Cro<strong>is</strong>sant Rouge Marocain (CRM), des ONG, etc. ; et le second à but<br />
lucratif, constitué par les ressources sanitaires du secteur libéral, organ<strong>is</strong>ées et dirigées à<br />
titre individuel ou en groupement, par des médecins, des chirurgiens dent<strong>is</strong>tes, des<br />
pharmaciens ou par d’autres professionnels de santé (cabinets de consultations, d’imagerie<br />
médicale, de biologie, de soins et de réhabilitation, de chirurgie dentaire, cliniques<br />
d’hospital<strong>is</strong>ation, pharmacies et dépôts de médicaments, etc.)<br />
Au Maroc, l’offre de soins est organ<strong>is</strong>ée de façon pyramidale selon quatre niveaux de<br />
recours :<br />
- Un niveau de premier recours (ou de première ligne) qui correspond à l’offre de proximité<br />
et qui est représenté par les établ<strong>is</strong>sements de soins de santé de base (ESSB) et les cabinets<br />
privés. Dans ce niveau de recours, l’offre publique de soins est organ<strong>is</strong>ée selon deux<br />
stratégies : une stratégie fixe où les prestations sont assurées par les ESSB (d<strong>is</strong>pensaire<br />
rural, centre de santé communal avec ou sans module d’accouchement et les hôpitaux<br />
16
Financement des soins de santé au Maroc<br />
locaux) et une stratégie mobile où les prestations sont assurées par des infirmiers itinérants<br />
et des équipes mobiles.<br />
- Un niveau de deuxième recours (ou de deuxième ligne) qui est représenté par les hôpitaux<br />
locaux, les hôpitaux provinciaux ou préfectoraux et les cliniques privées.<br />
- Un niveau de tro<strong>is</strong>ième recours qui comprend les hôpitaux régionaux qu’ils soient<br />
généraux ou spécial<strong>is</strong>és. Certaines cliniques privées spécial<strong>is</strong>ées relèvent également de ce<br />
niveau de recours.<br />
- Un niveau de quatrième recours qui est représenté par les centres hospitaliers universitaires<br />
(CHU).<br />
Depu<strong>is</strong> l’indépendance, un important effort a été consenti par l’Etat pour étendre la couverture<br />
sanitaire à l’ensemble du territoire et en même temps réhabiliter ou reconstruire un certain<br />
nombre d’établ<strong>is</strong>sements de soins ex<strong>is</strong>tants. Le même effort a été entrepr<strong>is</strong> pour améliorer<br />
l’encadrement du système par les professionnels de la santé nécessaire aux soins et aux<br />
activités de promotion, de prévention et de lutte contre les maladies.<br />
Cependant, en dépit des efforts déployés par le secteur public et le développement rapide du<br />
secteur privé, la couverture sanitaire de la population connaît toujours les insuff<strong>is</strong>ances<br />
suivantes :<br />
• Couverture sanitaire quantitativement modeste. A titre illustratif, la capacité litière<br />
nationale est de près de 37 000 lits 1 (81% dans le secteur public et 19% dans le privé) 2 .<br />
Pour le réseau hospitalier, le ratio est de 9 lits pour 10 000 habitants. Ce ration reste<br />
faible comparativement à des pays à développement équivalent qui ont des ratios<br />
proches ou supérieurs à 20 lits pour 10 000 habitants.<br />
• Grandes d<strong>is</strong>parités entre les milieux urbain et rural, entre les régions ma<strong>is</strong> aussi à<br />
l’intérieur de celles-ci.<br />
• Dans les villes, les quartiers périurbains sur lesquels ont été appliqués les critères de<br />
programmation de l’urbain, malgré leur contexte socio-économique défavorable et<br />
leur développement rapide et non contrôlé, sont défavor<strong>is</strong>és en terme de couverture<br />
par les établ<strong>is</strong>sements de soins de santé de base (ESSB) 3 . Ces déséquilibres se sont<br />
accentués avec le ciblage fait par des projets financés en faveur des provinces les plus<br />
démunies. Malheureusement, les ESSB construits dans ce cadre restent souvent fermés<br />
par défaut de ressources humaines 4 .<br />
• La répartition de l’offre de soins privée (cliniques, cabinets de consultation et de<br />
diagnostic, pharmaciens, chirurgiens dent<strong>is</strong>tes et soins paramédicaux) sur l’ensemble<br />
du territoire accuse un important déséquilibre entre milieu urbain et rural et entres les<br />
régions. En 2005, on observe un ratio de 1 cabinet médical pour 3 047 habitants en<br />
milieu urbain contre un cabinet pour 59 561 habitants en milieu rural. De plus, cette<br />
offre se trouve concentrée dans les grandes agglomérations urbaines. En effet, 52%<br />
des cliniques se trouvent dans les grandes villes avec plus de 48% de la capacité litière<br />
totale des cliniques.<br />
• Les faiblesses du Plan d’Extension de la Couverture Sanitaire (PECS, outil de<br />
1<br />
Ce chiffre comprend aussi les lits ex<strong>is</strong>tants dans les établ<strong>is</strong>sements de soins de santé de base.<br />
2<br />
DPRF, Offre de soins, mars 2006.<br />
3<br />
Le milieu rural a été particulièrement favor<strong>is</strong>é pu<strong>is</strong>que, la desserte habitants par ESSB a été réduite de quatre<br />
fo<strong>is</strong> en passant de 1 ESSB pour 27 000 habitants en 1960 à 1 ESSB pour 7 164 en 2005, tand<strong>is</strong> qu’en milieu<br />
urbain, la desserte est passée de 1 pour 36 900 en 1960 à 1 pour 25 319 en 2005.<br />
4<br />
Du fait d’un déséquilibre entre la programmation des constructions et l’affectation des ressources humaines.<br />
17
Financement des soins de santé au Maroc<br />
planification temporelle et spatiale de l’offre publique de soins) et l’absence d’un<br />
cadre légal de régulation (Carte Sanitaire) expliquent, en partie, la pers<strong>is</strong>tance de ces<br />
problèmes.<br />
• Le système de soins connaît des clo<strong>is</strong>onnements d’ordre fonctionnel et technique entre<br />
les niveaux ambulatoire et hospitalier. A titre illustratif, l’hôpital local ne joue pas son<br />
rôle en tant que structure intermédiaire entre l’hôpital provincial et les ESSB en ra<strong>is</strong>on<br />
de la non fonctionnalité des plateaux techniques et l’absence d’équipes médicales et<br />
paramédicales conséquentes.<br />
Par ailleurs, parmi les ressources nécessaires pour la santé, les ressources humaines occupent<br />
une place de choix.<br />
La problématique liée aux ressources humaines est marquée par :<br />
L’insuff<strong>is</strong>ance notoire en personnel de santé particulièrement les médecins, les sagesfemmes<br />
et les infirmiers ;<br />
L’insuff<strong>is</strong>ance en terme de capacité de formation et de recrutement par rapport aux<br />
besoins ; capacité de formation ; Médecins ; 800/an et 1 000 infirmiers dont 150 pour<br />
les services de santé des Forces Armées Royales et 50 dans le cadre de la coopération<br />
internationale ; faible possibilité de recrutement (nombre de postes ouverts par an<br />
insuff<strong>is</strong>ant aggravé par la suppression des postes vacants en ra<strong>is</strong>on des départs à la<br />
retraite) ;<br />
Les besoins pressants dans certaines spécialités médicales telles que l’anesthésie, la<br />
gynécologie obstétrique, la chirurgie générale, la pédiatrie et la psychiatrie ainsi que<br />
l’apparition de nouveaux besoins tels que la gériatrie, la cancérologie et la<br />
néphrologie.<br />
La mauva<strong>is</strong>e répartition spatiale de la plupart des spécialités dont la concentration est<br />
évidente dans les grands centres urbains notamment à Casablanca, Rabat, Kénitra,<br />
Marrakech, Agadir et Tanger, (environ 51% des spécial<strong>is</strong>tes exercent dans ces<br />
provinces).<br />
b. Description des principaux indicateurs et leur tendance : socio-économiques,<br />
sanitaires, démographiques, dépenses de santé, …<br />
Le système de santé marocain connaît de profondes mutations. En effet, les multiples<br />
bouleversements observés - épidémiologiques, démographiques, socioéconomiques, …-<br />
nécessitent des adaptations permanentes.<br />
Depu<strong>is</strong> plusieurs décennies, les plans de développement sanitaire ont focal<strong>is</strong>é leurs<br />
interventions, principalement sur la réduction du niveau de mortalité. Les programmes de<br />
santé maternelle et infantile (planification familiale, vaccinations, surveillance de la grossesse<br />
et de l’accouchement, etc.), de lutte et de prévention contre les maladies transm<strong>is</strong>sibles<br />
attestent des efforts entrepr<strong>is</strong>. Ma<strong>is</strong> globalement, il faut imputer l’amélioration des indicateurs<br />
sanitaires nationaux à l’extension de la couverture sanitaire par les secteurs public et privé<br />
(hôpitaux publics, centres de santé, cliniques et cabinets privés, officines, etc.) à l'ensemble du<br />
territoire.<br />
Parmi les indicateurs servant à mesurer l’état de santé, l’espérance de vie à la na<strong>is</strong>sance<br />
(EVN), la mortalité des enfants et maternelle ont été les plus util<strong>is</strong>és jusqu’à maintenant.<br />
L’espérance de vie à la na<strong>is</strong>sance :<br />
Durant les trente dernières années, le citoyen marocain a gagné plus de 20 années d’EVN. En<br />
18
Financement des soins de santé au Maroc<br />
effet, cet indicateur est passé de 48 ans en 1967 à 69,5 ans en 1999 et 70,8 ans en 2004 5 .<br />
Cependant, l’analyse de l’EVN par milieu de résidence (ensemble des sexes) montre un<br />
élarg<strong>is</strong>sement de l’écart entre le milieu urbain et le milieu rural qui est passé de 2,9 ans en<br />
1967 à 9,3 ans en 1987. Ce phénomène s’explique par la forte réduction de la mortalité<br />
infantile qu’a connue le milieu urbain, d’une part, et par l’accélération de l’urban<strong>is</strong>ation,<br />
d’autre part. L’écart s’est ensuite amenu<strong>is</strong>é pour s’établir à 6 ans en 1999.<br />
En termes d’espérance de vie en bonne santé (ou espérance de vie corrigée de l’état de santé,<br />
EVCS), le Maroc est à 54,9 ans. Ceci veut dire qu’actuellement un nouveau-né marocain peut<br />
espérer vivre près de 55 ans en pleine santé contre 58,5 ans en Jordanie, 69,4 ans en Belgique<br />
et 70 ans au Canada.<br />
La mortalité :<br />
Le niveau de mortalité infantile et infanto-juvénile, quoiqu’en amélioration, reste relativement<br />
élevé, avec des taux respectifs de 40‰ et 47‰ en 2000 et 2004. A titre de compara<strong>is</strong>on, des<br />
pays vo<strong>is</strong>ins ont des taux de mortalité infantile plus faibles : la Tun<strong>is</strong>ie (26,2‰), la Jordanie<br />
(31,3‰), l’Egypte (29,1‰) et la Syrie (24‰). Dans les pays de l’OCDE, ce taux est environ<br />
dix fo<strong>is</strong> moins important avec des valeurs de l’ordre de 4,9‰ en Espagne, 4,3‰ en France,<br />
3,4‰ en Suède…<br />
En dépit d’un recul du taux de mortalité maternelle de 359 à 227 décès maternels pour<br />
100 000 na<strong>is</strong>sances vivantes entre 1981 et 2003, ce dernier reste alarmant. Comparé à d’autres<br />
pays similaires, ce taux paraît très élevé. Il est de 180 en Syrie, de 170 en Tun<strong>is</strong>ie et de 150 en<br />
Jordanie.<br />
D’importantes inégalités sont encore observées au niveau de la répartition des taux de<br />
mortalité maternelle et de mortalité des enfants par milieu de résidence, par niveau de vie et<br />
par région.<br />
L’évolution de la morbidité :<br />
La morbidité liée aux affections transm<strong>is</strong>sibles, périnatales et maternelles continue à<br />
représenter un poids relativement important dans la charge de morbidité globale avec 46,4%<br />
des Années de Vie Perdues en ra<strong>is</strong>on d’un Décès Prématuré (AVDP) et 33,4% des Années de<br />
Vie Corrigées du facteur Invalidité (AVCI). Elle touche davantage les groupes de population<br />
défavor<strong>is</strong>ée.<br />
Si quelques maladies cibles du programme d’immun<strong>is</strong>ation (poliomyélite, diphtérie, rougeole,<br />
etc.) et d’autres programmes sanitaires (palud<strong>is</strong>me, bilharziose, …) sont éliminés ou en voie<br />
d’éradication, il n’en est pas de même pour d’autres qui continuent à constituer une menace. Il<br />
s’agit particulièrement des infections respiratoires aiguës, de la Tuberculose et surtout du<br />
VIH-SIDA.<br />
Les affections non transm<strong>is</strong>sibles dominent la structure de la charge globale de morbidité avec<br />
55,8% des AVCI et 41,2% des AVDP. Il s’agit particulièrement des maladies cardiovasculaires<br />
(où l’hypertension artérielle est dominante), des maladies respiratoires et des<br />
cancers.<br />
Les accidents, traumat<strong>is</strong>mes et intoxications constituent le phénomène émergeant de la<br />
morbidité globale avec 10,8% des AVCI et 9,6% des AVDP. Ils représentent entre 17% et<br />
50% des motifs de consultation au niveau des urgences hospitalières.<br />
5 Les tendances de l’espérance de vie à la na<strong>is</strong>sance sont contenues dans le document « Tendances futures ENV<br />
TU 2004-2025 ». Elles sont <strong>is</strong>sues du RGPH de 2004.<br />
19
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Ces éléments confirment la transition épidémiologique et les nombreux déf<strong>is</strong> à relever. En<br />
effet, si certains problèmes sont en voie de résolution, d’autres plus récents, appellent des<br />
mesures devant être intégrés dans une vaste réforme.<br />
Les principaux déterminants :<br />
L’amélioration de l’état de santé des populations est un objectif de société qui repose sur une<br />
forte collaboration intersectorielle et une grande mobil<strong>is</strong>ation sociale. Le Min<strong>is</strong>tère de la<br />
Santé intervient à travers l’organ<strong>is</strong>ation du système de soins qui n’est qu’un des déterminants<br />
de la santé. Des secteurs comme l’eau potable, l’assain<strong>is</strong>sement, l’habitat, l’éducation, le<br />
développement économique … ont un impact considérable sur la santé. Si ces questions, en<br />
amont, ne sont pas résolues, les difficultés resteront grandes pour réussir l’amélioration du<br />
niveau de santé de la population.<br />
Le retard pr<strong>is</strong> dans la m<strong>is</strong>e en place des infrastructures de base (eau potable, assain<strong>is</strong>sement,<br />
routes, électricité), dans la scolar<strong>is</strong>ation et la lutte contre l’analphabét<strong>is</strong>me, dans la politique<br />
environnementale et dans la lutte contre le logement insalubre a eu fatalement des<br />
répercussions négatives sur l’état de santé de la population marocaine. Cette situation est<br />
exacerbée par l’évolution défavorable de quelques indicateurs macroéconomiques (taux de<br />
chômage, taux de pauvreté et de vulnérabilité économique) et le maintien au même niveau<br />
d’autres indicateurs tels que le PIB per capita et le pouvoir d’achat des ménages.<br />
Cependant, quel que soit l’effort déployé par le système de soins, l’amélioration du niveau de<br />
santé et la réponse aux attentes de la population passe essentiellement par une amélioration<br />
des principaux déterminants tels que l’assain<strong>is</strong>sement de base, la général<strong>is</strong>ation de l’accès à<br />
l’eau potable, la résorption de l’habitat insalubre, le désenclavement des zones éloignées et<br />
marginal<strong>is</strong>ées, la lutte contre l’analphabét<strong>is</strong>me …<br />
La dépense de santé :<br />
La dépense globale de santé est faible : 59 US$ par habitant et par an (contre plus de 100 US$<br />
pour les pays économiquement similaires) et 5% par rapport au PIB (contre 6,4% à 12,2%<br />
dans ces pays). Sachant que les coûts des biens et services médicaux sont élevés, ceci veut<br />
dire que ce ne sont pas les prix qui sont faibles, ma<strong>is</strong> plutôt le recours aux soins<br />
La source principale de financement de la santé reste le paiement directs des ménages : 52%,<br />
contre 44% pour le financement collectif de la santé (f<strong>is</strong>calité nationale et locale 28% et<br />
assurance maladie 16%) 6 .<br />
Les ressources mobil<strong>is</strong>ées par le système national de santé sont consacrées, pour une bonne<br />
part, aux médicaments. En effet, le système national de santé consacre plus de 36% à l’achat<br />
de médicaments et biens médicaux en tant que bien de consommation finale par le patient.<br />
Le poids, assez faible, des soins ambulatoires, qui représente 33% des dépenses du système<br />
national de santé est exacerbé par la modicité de celui de la prévention sanitaire collective<br />
(Contrôle de la qualité de l’eau potable, Information, éducation et communication, …). Les<br />
dépenses de cette dernière atteignent à peine 2,0% de la dépense globale de santé.<br />
Par ailleurs, le Min<strong>is</strong>tère de la Santé, qui constitue le premier prestataire de soins, pu<strong>is</strong>qu’il<br />
d<strong>is</strong>pose de 80% de la capacité litière du pays, ne bénéficie que d’environ 31,4% du<br />
financement du système national de santé. 49% profitent aux hôpitaux contre 37% au réseau<br />
de soins de santé de base (RSSB). Les Instituts et Laboratoires Nationaux, qui représentent<br />
essentiellement des activités de soutien au réseau de soins de santé de base et à la formation,<br />
6 Min<strong>is</strong>tère de la Santé / Direction de la Planification et des Ressources Financières, Les Comptes Nationaux de<br />
la Santé 2001, 2005.<br />
20
Financement des soins de santé au Maroc<br />
ne bénéficient que de 4% de ces allocations, beaucoup moins que l’Admin<strong>is</strong>tration Centrale et<br />
Locale (10%).<br />
Cependant, les hôpitaux publics bénéficient à peine de 6% de l’ensemble des paiements<br />
directs des organ<strong>is</strong>mes gestionnaires des divers régimes d’assurance maladie. La part des<br />
cabinets privés est assez importante (34%) ainsi que celle des cliniques privées (32%).<br />
Par ailleurs, la part des paiements directs des ménages (net de remboursements des assurances<br />
et mutuelles), a connu une diminution en passant de 54% en 1997/98 à 52% en 2001. Alors<br />
que le financement collectif (f<strong>is</strong>cal et contributif) est passé de 41% à 44% sur la même<br />
période ; ceci étant dû essentiellement à l’augmentation du budget alloué au Min<strong>is</strong>tère de la<br />
Santé.<br />
La couverture médicale de base est parmi les réponses apportées par le Maroc pour améliorer<br />
les indicateurs sociaux dans le domaine de la santé.<br />
Chapitre préliminaire : Matrice donnant une vue d'ensemble de chaque<br />
régime de prépaiement (y compr<strong>is</strong> ceux de l'Etat)<br />
I/ Etat<br />
Population couverte • La population en<br />
général.<br />
• Les groupes<br />
vulnérables qui<br />
s'exposent à des<br />
facteurs de r<strong>is</strong>que<br />
particuliers.<br />
• Les patients adm<strong>is</strong> dans<br />
les établ<strong>is</strong>sements de<br />
Min<strong>is</strong>tère de la Santé Autres Min<strong>is</strong>tères Collectivités locales<br />
soins.<br />
Prestations couvertes • Une trentaine de<br />
programmes de santé<br />
publique ;<br />
• Hospital<strong>is</strong>ation ;<br />
• Consultations<br />
médicales et<br />
paramédicales ;<br />
• Analyses médicaux et<br />
examens radiologiques,<br />
• Soins dentaires ;<br />
• Formation / Recherche<br />
/ Enseignement<br />
Lieu des soins • RSSB<br />
• Hôpitaux<br />
Tarification • Gratuite au niveau du<br />
RSSB<br />
• Tarification fixée par<br />
arrêté pour les hôpitaux<br />
• Etudiants<br />
• Universitaires<br />
• Pr<strong>is</strong>onniers<br />
• Médecine<br />
scolaire<br />
• Médecine<br />
universitaire<br />
• Médecine<br />
pénitentiaire<br />
• Ecoles<br />
• Universités<br />
• Pr<strong>is</strong>ons<br />
• La population en<br />
général.<br />
• Les groupes vulnérables<br />
qui s'exposent à des<br />
facteurs de r<strong>is</strong>que<br />
particuliers.<br />
Prévention sanitaire<br />
collective en termes<br />
d’hygiène et de salubrité<br />
publique :<br />
• La pr<strong>is</strong>e en charge d’une<br />
bonne partie de la<br />
population (promotion<br />
de la santé<br />
essentiellement) ;<br />
• La réal<strong>is</strong>ation et<br />
l’entretien des hôpitaux<br />
et des établ<strong>is</strong>sements<br />
universitaires ;<br />
• L’hygiène ;<br />
• etc.<br />
Gratuite Gratuite<br />
Bureau Municipaux<br />
d’Hygiène<br />
21
Financement des soins de santé au Maroc<br />
II/ Régime d’assurance maladie obligatoire de base (AMO)<br />
Population couverte<br />
Prestations<br />
couvertes<br />
AMO (SECTEUR PUBLIC)<br />
Géré par la CNOPS<br />
- Les fonctionnaires, les agents<br />
temporaires, occasionnels, journaliers et<br />
contractuels de l’Etat, les mag<strong>is</strong>trats, les<br />
personnels d’encadrement et de rang des<br />
Forces Auxiliaires, le corps des<br />
admin<strong>is</strong>trateurs du min<strong>is</strong>tère de<br />
l’intérieur, ainsi que le personnel des<br />
collectivités locales, des établ<strong>is</strong>sements<br />
publics et des personnes morales de droit<br />
public et leurs ayants droit.<br />
- les personnes titulaires de pensions de<br />
retraite, de vieillesse, d’invalidité ou<br />
d’ayants cause et leurs ayants droit.<br />
REMBOURSEMENT OU PRISE EN CHARGE<br />
EN TIERS PAYANT DES FRAIS DE SOINS<br />
CURATIFS, PREVENTIFS ET DE<br />
REHABILITATION RELATIFS AUX<br />
PRESTATIONS SUIVANTES :<br />
- soins préventifs et curatifs liés aux<br />
programmes prioritaires entrant dans le<br />
cadre de la politique sanitaire de l’Etat ;<br />
- actes de médecine générale et de<br />
spécialités médicales et chirurgicales ;<br />
- soins relatifs au suivi de la grossesse,<br />
à l’accouchement et ses suites ;<br />
- soins liés à l’hospital<strong>is</strong>ation et aux<br />
interventions chirurgicales y compr<strong>is</strong> les<br />
actes de chirurgie réparatrice ;<br />
- analyses de biologie médicale ;<br />
- radiologie et imagerie médicale ;<br />
- explorations fonctionnelles ;<br />
- médicaments adm<strong>is</strong> au<br />
remboursement ;<br />
- poches de sang humain et dérivés<br />
sanguins ;<br />
- d<strong>is</strong>positifs médicaux et implants<br />
nécessaires aux différents actes médicaux<br />
et chirurgicaux ;<br />
- appareils de prothèse et d’orthèse<br />
médicales adm<strong>is</strong> au remboursement ;<br />
- lunetterie médicale ;<br />
- soins bucco-dentaires ;<br />
- orthodontie pour les enfants ;<br />
- actes de rééducation fonctionnelle et<br />
de kinésithérapie ;<br />
- actes paramédicaux.<br />
AMO (SECTEUR PRIVE)<br />
Géré par la CNSS<br />
- Les personnes assujetties au régime de<br />
sécurité sociale et leurs ayants droit.<br />
- Les personnes titulaires de pensions de<br />
retraite, de vieillesse, d’invalidité ou<br />
d’ayants cause et leurs ayants droit.<br />
REMBOURSEMENT OU PRISE EN<br />
CHARGE EN TIERS PAYANT DES FRAIS<br />
RELATIFS :<br />
1. en ce qui concerne les ALD et<br />
ALC, aux prestations suivantes<br />
qu’elles soient d<strong>is</strong>pensées à titre<br />
ambulatoire ou dans le cadre<br />
d’une hospital<strong>is</strong>ation :<br />
- actes de médecine générale et de<br />
spécialités médicales et<br />
chirurgicales ;<br />
- analyses de biologie médicale ;<br />
- radiologie et imagerie médicale ;<br />
- explorations fonctionnelles ;<br />
- hospital<strong>is</strong>ation ;<br />
- médicaments adm<strong>is</strong> au<br />
remboursement ;<br />
- sang et ses dérivés labiles ;<br />
- soins bucco-dentaires ;<br />
- d<strong>is</strong>positifs médicaux et implants<br />
nécessaires aux différents actes<br />
médicaux et chirurgicaux ;<br />
- actes de rééducation fonctionnelle<br />
et de kinésithérapie ;<br />
- actes paramédicaux.<br />
- appareils de prothèse et d’orthèse<br />
médicales adm<strong>is</strong> au remboursement ;<br />
- lunetterie médicale.<br />
2. En ce qui concerne l’enfant<br />
dont l’âge est inférieur à 12 ans,<br />
à l’ensemble des prestations<br />
définies à l’article 7 de la loi n°<br />
65-00 (cf. prestations<br />
AMO/CNOPS) ;<br />
3. En ce qui concerne le suivi de<br />
la grossesse, à l’accouchement<br />
et ses suites, aux actes<br />
22
Financement des soins de santé au Maroc<br />
AMO (SECTEUR PUBLIC)<br />
Géré par la CNOPS<br />
Lieux des soins Libre choix Libre choix<br />
Taux de pr<strong>is</strong>e en<br />
charge ou de<br />
remboursement<br />
Ticket modérateur<br />
- 80% de la TNR pour les actes de<br />
médecine générale et de spécialités<br />
médicales et chirurgicales, actes<br />
médicaux, de rééducation fonctionnelle et<br />
de kinésithérapie délivrés à titre<br />
ambulatoire ainsi que pour les soins<br />
bucco-dentaires ;<br />
- 90% de la TNR pour les soins liés à<br />
l’hospital<strong>is</strong>ation et aux interventions<br />
chirurgicales y compr<strong>is</strong> les actes de<br />
chirurgie réparatrice et le sang et ses<br />
dérivés labiles. Ce taux est porté à 100%<br />
lorsque les prestations sont rendues dans<br />
les hôpitaux publics et les services<br />
sanitaires relevant de l’Etat ;<br />
- 70% du PPM pour les médicaments ;<br />
Au forfait pour la lunetterie médicale, les<br />
d<strong>is</strong>positifs médicaux et implants nécessaires<br />
aux actes médicaux et chirurgicaux, appareils<br />
de prothèse et d’orthèse médicales,<br />
orthodontie pour les enfants.<br />
- Pour les ALD, la part restant à la charge<br />
de l’assuré ne peut être supérieure 10%de<br />
la TNR.<br />
- Pour les ALC, l’exonération est totale<br />
AMO (SECTEUR PRIVE)<br />
Géré par la CNSS<br />
médicaux et chirurgicaux tels<br />
qu’ils sont défin<strong>is</strong> à la NGAP et<br />
la NABM ainsi qu’aux<br />
médicaments adm<strong>is</strong> au<br />
remboursement, au sang et ses<br />
dérivés labiles, aux actes<br />
paramédicaux et, le cas échéant,<br />
aux actes de rééducation<br />
fonctionnelle et de<br />
kinésithérapie ;<br />
4. En ce qui concerne<br />
l’hospital<strong>is</strong>ation, à l’ensemble<br />
des prestations et soins rendus<br />
dans ce cadre y compr<strong>is</strong> les<br />
actes de chirurgie réparatrice.<br />
- 70% de la TNR pour toutes les<br />
prestations pr<strong>is</strong>es en charge. Ce taux<br />
est porté à 90% pour les ALD et<br />
ALC, lorsque les prestations y<br />
afférentes sont d<strong>is</strong>pensées dans les<br />
hôpitaux publics, les établ<strong>is</strong>sements<br />
publics de santé et les services<br />
sanitaires relevant de l’Etat.<br />
- 30%<br />
Plafonds Pas de plafonds Pas de plafonds<br />
Primes - Salariés : 5% de l’ensemble des<br />
rémunérations v<strong>is</strong>ées à l’article 106 de la<br />
loi n° 65-00 (dont 50% à la charge de<br />
l’employeur) ;<br />
- Pensionnés : 2,5% du montant global<br />
des pensions de base.<br />
- 10% pour les ALD et ALC, lorsque les<br />
prestations y afférentes sont d<strong>is</strong>pensées<br />
dans les hôpitaux publics, les<br />
établ<strong>is</strong>sements publics de santé et les<br />
services sanitaires de l’Etat<br />
- Salariés : 4% de l’ensemble des<br />
rémunérations v<strong>is</strong>ées à l’article 19 du<br />
dahir relatif au régime de la sécurité<br />
sociale (dont 50% à la charge de<br />
l’employeur) + 1,5% de la<br />
rémunération brute mensuelle à la<br />
charge exclusive de l’employeur ;<br />
23
Financement des soins de santé au Maroc<br />
AMO (SECTEUR PUBLIC)<br />
Géré par la CNOPS<br />
Min : 70 DHS - Max : 400 DHS<br />
- Assurance volontaire : 5% du dernier<br />
salaire ayant servi de base du calcul des<br />
dernières cot<strong>is</strong>ations et contributions au<br />
RCAR.<br />
Périodicité Paiement mensuel Paiement mensuel<br />
Exclusions - Interventions de chirurgie<br />
esthétique, cures thermales, acupuncture,<br />
mésothérapie, thalassothérapie,<br />
homéopathie et prestations d<strong>is</strong>pensées<br />
dans le cadre de la médecine dite douce ;<br />
- Soins inhérents aux accidents du travail<br />
et meladies professionnelles .<br />
AMO (SECTEUR PRIVE)<br />
Géré par la CNSS<br />
- Marins pêcheurs :<br />
o 1,2% du produit brut de la vente<br />
du po<strong>is</strong>son pêché sur les chalutiers ;<br />
o 1,5% du produit brut de la vente<br />
du po<strong>is</strong>son pêché sur les sardiniers<br />
et les palangriers ;<br />
- Pensionnés : 4% du montant global<br />
des pensions de base ;<br />
- Assurance volontaire : 4% de la<br />
rémunération ayant servi de base au<br />
calcul de la dernière cot<strong>is</strong>ation<br />
obligatoire au titre de ladite<br />
assurance.<br />
Interventions de chirurgie esthétique,<br />
cures thermales, acupuncture,<br />
mésothérapie, thalassothérapie,<br />
homéopathie et prestations d<strong>is</strong>pensées<br />
dans le cadre de la médecine dite douce ;<br />
- Soins inhérents aux accidents du travail<br />
et meladies professionnelles .<br />
Période de stage Maximum six (6) mo<strong>is</strong> Maximum six (6) mo<strong>is</strong><br />
Délai de<br />
remboursement des<br />
dossiers<br />
Délai de paiement<br />
des prestataires de<br />
soins<br />
Conventions<br />
Maximum tro<strong>is</strong> (3) mo<strong>is</strong> Maximum tro<strong>is</strong> (3) mo<strong>is</strong><br />
Maximum six (6) mo<strong>is</strong> Maximum six (6) mo<strong>is</strong><br />
- TNR<br />
- Tiers payant<br />
- TNR<br />
- Tiers payant<br />
III/ Secteur mutual<strong>is</strong>te et secteur des assurances (Assurance facultative : de base<br />
et complémentaire)<br />
Population couverte<br />
SECTEUR MUTUALISTE SECTEUR DES ASSURANCES<br />
- Les fonctionnaires, les agents<br />
temporaires, occasionnels, journaliers et<br />
contractuels de l’Etat, les mag<strong>is</strong>trats, les<br />
personnels d’encadrement et de rang des<br />
Forces Auxiliaires, le corps des<br />
admin<strong>is</strong>trateurs du min<strong>is</strong>tère de<br />
l’intérieur, ainsi que le personnel des<br />
collectivités locales, des établ<strong>is</strong>sements<br />
publics et des personnes morales de droit<br />
public et leurs ayants droit ;<br />
- certains salariés d’entrepr<strong>is</strong>es privées ;<br />
- les personnes titulaires de pensions de<br />
- les salariés du secteur privé, les agents<br />
de certains établ<strong>is</strong>sements publics, les<br />
personnes exerçant une profession<br />
libérale.<br />
24
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Prestations<br />
couvertes<br />
SECTEUR MUTUALISTE SECTEUR DES ASSURANCES<br />
retraite, de vieillesse, d’invalidité ou<br />
d’ayants cause et leurs ayants droit.<br />
REMBOURSEMENT OU PRISE EN CHARGE<br />
EN TIERS PAYANT DES FRAIS DES :<br />
- actes de médecine générale et de<br />
spécialités médicales et chirurgicales ;<br />
- soins relatifs au suivi de la grossesse,<br />
à l’accouchement et ses suites ;<br />
- soins liés à l’hospital<strong>is</strong>ation et aux<br />
interventions chirurgicales y compr<strong>is</strong> les<br />
actes de chirurgie réparatrice ;<br />
- analyses de biologie médicale ;<br />
- radiologie et imagerie médicale ;<br />
- explorations fonctionnelles ;<br />
- médicaments et biens médicaux ;<br />
- appareils de prothèse et d’orthèse<br />
médicales ;<br />
- lunetterie médicale ;<br />
- soins bucco-dentaires ;<br />
- actes de rééducation fonctionnelle et<br />
de kinésithérapie ;<br />
- actes paramédicaux.<br />
Lieux des soins Libre choix Libre choix<br />
Taux de pr<strong>is</strong>e en<br />
charge ou de<br />
remboursement<br />
Plafonds Pas de plafonds<br />
Primes<br />
- 90% d’un tarif de responsabilité fixé par<br />
la société mutual<strong>is</strong>te ou par l’union pour<br />
celle qui en d<strong>is</strong>pose<br />
- En fonction des salaires : en général<br />
autour de 5% pour la couverture de base<br />
et 1% pour la complémentaire<br />
REMBOURSEMENT OU PRISE EN<br />
CHARGE EN TIERS PAYANT DES FRAIS<br />
DES :<br />
- actes de médecine générale et de<br />
spécialités médicales et<br />
chirurgicales ;<br />
- soins relatifs au suivi de la<br />
grossesse, à l’accouchement et ses<br />
suites ;<br />
- soins liés à l’hospital<strong>is</strong>ation et<br />
aux interventions chirurgicales y<br />
compr<strong>is</strong> les actes de chirurgie<br />
réparatrice ;<br />
- analyses de biologie médicale ;<br />
- radiologie et imagerie médicale ;<br />
- explorations fonctionnelles ;<br />
- médicaments et biens médicaux ;<br />
- appareils de prothèse et d’orthèse<br />
médicales ;<br />
- lunetterie médicale ;<br />
- soins bucco-dentaires ;<br />
- actes de rééducation fonctionnelle<br />
et de kinésithérapie ;<br />
- actes paramédicaux.<br />
- varie de 70 à 90 % des fra<strong>is</strong> engagés<br />
par les assurés, selon les contrats sur<br />
la base du choix du souscripteur.<br />
- plafond général annuel pouvant<br />
atteindre un million de DHS<br />
- des sous plafonds pour certaines<br />
prestations (lunettes, dentition,<br />
rééducation, …).<br />
- en fonction des salaires ou montant<br />
forfaitaire sui dépend du niveau de<br />
couverture souhaitée par les<br />
souscripteurs de contrats.<br />
Périodicité Paiement mensuel Paiement trimestriel ou mensuel<br />
Exclusions - Interventions de chirurgie<br />
esthétique, cures thermales, acupuncture,<br />
mésothérapie, thalassothérapie,<br />
homéopathie et prestations d<strong>is</strong>pensées<br />
dans le cadre de la médecine dite douce.<br />
- Interventions de chirurgie<br />
esthétique, cures thermales,<br />
acupuncture, mésothérapie,<br />
thalassothérapie, homéopathie et<br />
prestations d<strong>is</strong>pensées dans le cadre<br />
de la médecine dite douce ;<br />
- Soins afférents aux accidents de la<br />
circulation et aux accidents du<br />
travail ;<br />
- Les maladies antérieures à la<br />
souscription ;<br />
25
Financement des soins de santé au Maroc<br />
SECTEUR MUTUALISTE SECTEUR DES ASSURANCES<br />
Période de stage Maximum six (6) mo<strong>is</strong> et un ans pour certains<br />
soins<br />
Délai de<br />
remboursement des<br />
dossiers<br />
Conventions<br />
Variable selon la société et en moyenne 6<br />
mo<strong>is</strong><br />
- Tarif de responsabilité<br />
- Tiers payant<br />
- Les personnes dépassant un certains<br />
âge, généralement 60 ans.<br />
Maximum six (6) mo<strong>is</strong><br />
- Maximum tro<strong>is</strong> (3) mo<strong>is</strong><br />
- Fra<strong>is</strong> engagés<br />
- Tiers payant<br />
Première partie : Analyse des sous-fonctions du financement du système de<br />
santé<br />
Le financement du système de santé comporte tro<strong>is</strong> fonctions essentielles et<br />
interdépendantes : la collecte des fonds, la m<strong>is</strong>e en commun des ressources et l’achat ou la<br />
prestation des services.<br />
Chapitre 1 : Collecte des fonds<br />
Au Maroc, le système de santé fait intervenir le secteur public et le secteur privé au niveau<br />
des sources de financement. Les sources publiques des soins et des services de santé<br />
proviennent généralement d’allocations budgétaires au titre des recettes générales tand<strong>is</strong> que<br />
le financement privé comprend les paiement des ménages, les employeurs (entrepr<strong>is</strong>es<br />
privées, CL, Etat et Offices), …<br />
I/ de l'Etat,<br />
Le rôle de l’Etat dans le secteur de la santé se justifie par les échecs du marché à financer,<br />
consommer et assurer les services de soins de santé.<br />
En effet, lorsque les avantages sociaux dérivés d’une activité donnée sont plus importantes<br />
que les avantages individuels, les populations auront tendance à sous-investir dans ces<br />
services ou à les sous-consommer et l’Etat a, dès lors, un rôle à jouer pour en garantir des<br />
niveaux socialement souhaitables. La vaccination et le traitement des maladies transm<strong>is</strong>sibles<br />
sont deux activités sanitaires de ce type.<br />
Par ailleurs, le rôle de l’Etat est aussi d’assurer des Biens Publics. C’est-à-dire des biens ou<br />
services que le marché ne peut offrir. Ceci veut dire également qu’il n’est pas opportun (car<br />
coûteux et périlleux) d’empêcher la consommation de ce bien et service. L’ex<strong>is</strong>tence de biens<br />
publics tels que l’air pur et l’eau salubre, l’assain<strong>is</strong>sement, la recherche médicale, l’hygiène<br />
de l’environnement et les activités de promotion sanitaire justifient un financement public.<br />
La principale source de financement public est l’imposition (les impôts directs et les impôts<br />
indirects). Dans ce cadre, la loi de finances est l’instrument essentiel qui détermine le montant<br />
et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ; le bloc des recettes et celui des<br />
dépenses sont séparés, il est impossible d’affecter telles recettes a telles dépenses (Règle de<br />
non affectation). Par exemple, il est impossible d’affecter des recettes des droits de<br />
consommation d’alcool et de tabac aux dépenses sanitaires 7 .<br />
7 Cette règle connaît des exceptions :<br />
26
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Le budget de l’Etat n’est autre que la loi de finances annuelle et la part du budget du<br />
Min<strong>is</strong>tère de la Santé dans ce budget est dictée par la politique du Gouvernement et les<br />
contraintes macroéconomiques qui s’imposent à l’economie nationale.<br />
Le budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé a connu son apogée durant les années1960-1964 8 suite à la<br />
conférence d’Avril 1959 sous la présidence de feu SM le roi MOHAMED V qui a m<strong>is</strong> en<br />
évidence la responsabilité de l’Etat en matière de santé publique.<br />
A partir de 1968, les principales priorités du Gouvernement étaient la rentabilité économique<br />
et financière à travers le développement agricole, industriel et tour<strong>is</strong>tique au dépens des<br />
secteurs sociaux. Le budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé a connu le niveau le plus bas en 1975.<br />
Ces restrictions budgétaires dans le secteur social ont été maintenu jusqu’en 1993 dans le<br />
cadre du plan d’ajustement structurel en concertation avec les bailleurs de fonds<br />
internationaux qui a pour objetif le redressement des finances publiques et le retour aux<br />
équilibres fondamentaux.<br />
Dès la sortie de la période d’ajustement, l’Etat s’est engagé dans plusieurs chantiers de<br />
modern<strong>is</strong>ation et de réformes. La pr<strong>is</strong>e en compte de la problèmatique sociale s’est traduite<br />
par l’augmentation de l’invest<strong>is</strong>sement dans le secteur social. La politique sanitaire durant<br />
cette période a renoué définitivement avec les grands principes de la conférence nationale sur<br />
la santé.<br />
II/ des employeurs,<br />
Ag<strong>is</strong>sant comme source de financement, les employeurs font plusieurs sortes de paiements<br />
pour le compte de leurs employés. Il s’agit de dépenses de l’employeur pour acheter une<br />
couverture d’assurance maladie à ses employés et aux personnes à leur charge. Ces paiements<br />
sont de deux types :<br />
- des cot<strong>is</strong>ations patronales qui sont versées par les employeurs directement aux<br />
organ<strong>is</strong>mes assurant la couverture maladie (ca<strong>is</strong>ses internes, mutuelles et entrepr<strong>is</strong>es<br />
d’assurances) ;<br />
- des subventions octroyées par certains employeurs (y compr<strong>is</strong> l’Etat employeur) et<br />
versées directement aux organ<strong>is</strong>mes assurant la couverture maladie concernés ;<br />
- des participations des employeurs à la résorption des déficits dégagés par les<br />
polycliniques appartenant à la Ca<strong>is</strong>se Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) par<br />
l’affectation d’une partie des excédents dégagés par le régime des Allocations<br />
Familiales géré par cette ca<strong>is</strong>se et dont le financement est à la charge exclusive des<br />
entrepr<strong>is</strong>es privées.<br />
III/ des ménages,<br />
Les cot<strong>is</strong>ations des employés aux régimes de couverture médicale et d’assurance maladie<br />
constituent une source de financement des soins de santé à la charge des ménages.<br />
• Les fonds de concours : ces fonds qui sont versés par des personnes morales ou physiques pour concourir<br />
(participer) avec ceux de l’Etat pour réal<strong>is</strong>er des projets d’intérêt général, sont bien affectés c’est-à-dire qu’il<br />
faut respecter la volonté des parties versantes pour la réal<strong>is</strong>ation du projet.<br />
• Les budgets annexes : car ces budgets annexes comportent des recettes bien affectées à des dépenses bien<br />
préc<strong>is</strong>es. « les recettes de la R.T.M doivent être affectées pour le développement de l’espace audio-v<strong>is</strong>uel<br />
Marocain ».<br />
8 Au début de cette période, l’environnement économique était favorable à l’invest<strong>is</strong>sement suite à<br />
l’augmentation du prix du Phosphate. L’économie marocaine a connu une période de forte cro<strong>is</strong>sance (5,7%).<br />
27
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Les cot<strong>is</strong>ations salariales sont souvent précomptées à la source par les employeurs et versées<br />
directement aux organ<strong>is</strong>mes assurant la couverture maladie en même temps que les cot<strong>is</strong>ations<br />
patronales.<br />
Le montant des cot<strong>is</strong>ations et la clé de partage entre employeurs et salariés sont fixés par voie<br />
réglementaire, statutairement ou contractuellement.<br />
La participation des ménages au financement sont aussi les paiements directs pour des soins et<br />
services de santé soit pour la totalité des coûts des soins soit sous forme de ticket modérateur<br />
(tout ce qui n’est pas pr<strong>is</strong> en charge par les régimes de couverture médicale), ce qui contribue<br />
au recouvrement d’une partie des coûts financiers des prestations publiques et privées.<br />
IV/ de la coopération internationale/donateurs.<br />
Les ressources de financement à travers la coopération internationale sont généralement<br />
orientées vers le Gouvernement et les ONG. Elles servent à financer les invest<strong>is</strong>sements et les<br />
charges récurrentes du secteur de santé public.<br />
Parallèlement aux autres sources de financement, le financement externe peut être<br />
extrêmement variable d’une année à l’autre, parce qu’ilest souvent lié à des projets<br />
spécifiques. Il constitue un mécan<strong>is</strong>me à court terme v<strong>is</strong>ant à sat<strong>is</strong>faire les besoins médicaux<br />
essentiels et pressants et à développer les infrastructures essentielles au maintien du système<br />
de santé à long terme. Il ne constiue pas une solution à long terme pour la création de revenus<br />
et ne peut garantir la pérennité financière à terme du système de santé.<br />
Les sources externes sont sous deux formes : les emprunts et les dons internationaux,<br />
bilatéraux et multilatéraux.<br />
Les emprunts :<br />
Il s’agit principalement des emprunts consent<strong>is</strong> par la Banque Mondiale 9 et la Banque<br />
Européenne d’Invest<strong>is</strong>sement.<br />
Les besoins de financement du programme d’invest<strong>is</strong>sement du Maroc excèdent ses<br />
ressources. Ces ressources provenant principalement des impôts ne couvrent que 77% des<br />
besoins de financement du programme total d’invest<strong>is</strong>sement. Le reste (23%) du programme<br />
d’invest<strong>is</strong>sement sont couverts par des bailleurs de fonds, dont les emprunts de la Banque<br />
Mondiale avec 11%, et quelques emprunts nationaux.<br />
Comme source complémentaire de financement, la BEI prend généralement en charge environ<br />
1/3 du coût d’un projet et au maximum 50% de ce coût.<br />
Ces fonds sont entièrement intégrés dans le budget général de l’Etat ou dans celui d’un<br />
secteur partculier.<br />
Cependant, malgré l’importance que revêt ce type de financement, ils imposent un fardeau de<br />
poids aux générations futures et alourd<strong>is</strong>sent la conditionalité macro-économique et<br />
sectorielle, étant donné que les emprunts doivent être remboursés,. Ils s’inscrivent dans une<br />
logique de conditionnalité sur les instruments qui servent à appuyer techniquement la<br />
réal<strong>is</strong>ation des objectifs du Gouvernement.<br />
9 La Banque Internationale pour la reconstruction et le Développement (BIRD), communément appelée Banque<br />
Mondiale, est, avec le FMI, le second pilier des institutions financières internationales.<br />
28
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Les dons :<br />
Plusieurs pays donateurs et organ<strong>is</strong>ations internationales participent activement au<br />
financement des activités sanitaires et des travaux connexes dont essentiellement l’OMS, le<br />
FNUAP et l’UNICEF.<br />
Le financement de la coopération bilatérale et multilatérale au profit de la santé a connu une<br />
ba<strong>is</strong>se remarquable, due essentiellement au retrait de l’USAID des activités dans le domaine<br />
sanitaire et son orientation vers d’autres secteurs tels que l’éducation et la promotion de la<br />
petite et moyenne entrepr<strong>is</strong>e.<br />
Afin de diversifier les activités de coopération, le Min<strong>is</strong>tère de la Santé a développé des<br />
relations de coopération avec d’autres organ<strong>is</strong>mes tels que l’AFD, l’AIEA, le Fonds Mondial,<br />
etc.<br />
Cette nouvelle forme de coopération permet de responsabil<strong>is</strong>er le Min<strong>is</strong>tère de la Santé à<br />
travers sa contribution (en coûts partagés) au financement des programmes de coopération. A<br />
titre d’exemple, dans le programme de coopération Min<strong>is</strong>tère de la Santé - FNUAP pour la<br />
période 2002-2006, le montant de la contribution du Min<strong>is</strong>tère de la Santé s’élève à<br />
1 000 000$US dont 150 000 $US pour la première année. L’AIEA, pour sa part, a exigé, en<br />
2005, que le Min<strong>is</strong>tère de la Santé contribue à ra<strong>is</strong>on de 5% du montant global du projet.<br />
Pour l’OMS, les allocations budgétaires affectées au Maroc, comme aux autres pays,<br />
comprennent deux parties : le budget régulier, fondé sur le barème des quotes-parts des<br />
contributions des membres et membres associés de l’Organ<strong>is</strong>ation des Nations Unies, et les<br />
fonds des contributions volontaires 10 provenant de divers partenaires 11 et orientés vers des<br />
programmes prioritaires (Surveillance, prévention et pr<strong>is</strong>e en charge des maladies<br />
chroniques ; Santé mentale et toxicomanie ; Tabag<strong>is</strong>me ; Grossesse sans r<strong>is</strong>ques ;<br />
VIH/SID…).<br />
Chapitre 2 : M<strong>is</strong>e en commun des fonds et mutual<strong>is</strong>ation des ressources<br />
I/ M<strong>is</strong>e en commun des fonds et mutual<strong>is</strong>ation des ressources par les mécan<strong>is</strong>mes<br />
liés à l'Etat<br />
La m<strong>is</strong>e en commun des ressources cons<strong>is</strong>te à accumuler et à gérer les revenus obtenus du<br />
prépaiement de manière que le r<strong>is</strong>que de paiement des soins de santé soit réparti entre tous les<br />
membres du groupe et non pas assumé par chacun des cot<strong>is</strong>ants. La m<strong>is</strong>e en commun des<br />
ressources est généralement appelée « fonction d’assurance », que les gens soient affiliés à<br />
une ca<strong>is</strong>se (volontairement ou d’office) ou que le financement se fasse par l’impôt.<br />
La gestion des ressources mobil<strong>is</strong>ées est l’affaire de plusieurs entités ou institution<br />
intermédiaire de m<strong>is</strong>e en commun des fonds : Min<strong>is</strong>tère de la Santé, les assureurs, les<br />
mutuelles, …<br />
Au Maroc, en 2001, le financement collectif de la santé à travers des mécan<strong>is</strong>mes solidaires<br />
(au sens large) ne concerne que 44% de la dépense globale de santé ; les ressources f<strong>is</strong>cales<br />
nationales et locales ne sont à l’origine que de 28% des dépenses globales de santé, alors que<br />
l'assurance maladie représente à peine 16% de ces mêmes dépenses.<br />
10 Eu égard à l’incertitude pers<strong>is</strong>tante quant au versement des contributions dues par les États membres, une<br />
importante proportion des ressources financières de l’OMS provient des contributions volontaires. En effet, les<br />
deux tiers du budget programme de l’OMS sont financés par des contributions volontaires des Etats Membres et<br />
d’autres partenaires.<br />
11 Les Gouvernements, les autres institutions des Nations Unies, les organ<strong>is</strong>ations non gouvernementales (ONG)<br />
et le secteur privé.<br />
29
Financement des soins de santé au Maroc<br />
La part la plus importante demeure celle des paiements directs des ménages (52%).<br />
Dans le cas de la contribution financière des ménages, où le patient paie directement et<br />
intégralement ou partiellement ses soins aux prestataires de services, il n’y a aucune m<strong>is</strong>e en<br />
commun des ressources ni aucun partage du r<strong>is</strong>que entre les usagers.<br />
Donc la mutual<strong>is</strong>ation des ressources est assurée par les différents régimes de couverture<br />
médicale et les départements min<strong>is</strong>tériels et les collectvités locales.<br />
Par ailleurs, de nombreux départements min<strong>is</strong>tériels sont des prestataires de soins et des<br />
agents actifs de la prévention sanitaire collective. Il s’agit notamment du :<br />
- Min<strong>is</strong>tère de l’Education Nationale : santé dans le milieu scolaire ;<br />
- Min<strong>is</strong>tère de l’Enseignement Supérieur : santé dans le milieu universitaire et paiement des<br />
salaires des médecins enseignants travaillant pour le compte du Min<strong>is</strong>tère de la Santé ;<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Justice : Médecine pénitentiaire ;<br />
D’autres départements interviennent dans le domaine sanitaire, notamment les Forces Armées<br />
Royales et la Protection Civile, ma<strong>is</strong>, comme indiqué précédemment, il n’a pas été possible de<br />
d<strong>is</strong>poser des données de ces dernières afin d’appréhender, même grossièrement, leurs<br />
dépenses de santé.<br />
II/ M<strong>is</strong>e en commun des fonds et mutual<strong>is</strong>ation des ressources par les régimes de<br />
couverture de soins de santé<br />
Compte tenu de l’éclatement de la couverture médicale, assurée par une diversité<br />
d’organ<strong>is</strong>mes, la m<strong>is</strong>e en commun et la mutual<strong>is</strong>ation s’opère au sein de chaque entité.<br />
Les primes ou cot<strong>is</strong>ations collectées par les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires de l’AMO, les mutuelles<br />
et les entrepr<strong>is</strong>es d’assurances sont gérées par ces entités selon les techniques de l’assurance<br />
par répartition, à travers la mutual<strong>is</strong>ation des r<strong>is</strong>ques. En fait, la totalité des cot<strong>is</strong>ations ou<br />
primes reçues par un régime, une mutuelle ou une entrepr<strong>is</strong>e d’assurances servent au paiement<br />
par chaque régime, mutuelle ou entrepr<strong>is</strong>e de l’ensemble des prestations servies à ses assurés<br />
et de ses fra<strong>is</strong> de gestion.<br />
Chapitre 3 : Achat de biens et services de soins<br />
Une fo<strong>is</strong> les ressources m<strong>is</strong>es en commun, des services de santé sont ensuite achetés auprès<br />
des divers producteurs de soins (publics et privés), pour faire face aux besoins de santé de la<br />
population, soit directement par les ménages, soit par les organ<strong>is</strong>mes chargés de la m<strong>is</strong>e en<br />
commun des ressources.<br />
La composante « achat de prestations de soins » fait partie intégrante du financement de la<br />
santé pu<strong>is</strong>que le mode de paiement va agir sur le comportement du producteur de soins et du<br />
malade et donc sur les coûts des soins, leur quantité, leur qualité, l'équité,… et donc in fine<br />
sur le financement.<br />
I/ Achat de services de soins<br />
I.1. Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé<br />
Celui-ci est à la tête d’un vaste réseau de prestataires publics organ<strong>is</strong>é en service national de<br />
santé et qui dessert l’ensemble de la population. Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé assure alors l'achat<br />
« passif » des prestations pu<strong>is</strong>que celui-ci se fait au sein du même organ<strong>is</strong>me donc sans m<strong>is</strong>e<br />
en concurrence des producteurs de soins. En effet, la majorité de ses ressources budgétaires<br />
du Min<strong>is</strong>tère de la Santé est util<strong>is</strong>ée pour l’achat et la d<strong>is</strong>tribution de fournitures aux structures<br />
30
Financement des soins de santé au Maroc<br />
périphériques dans toutes les provinces du pays, ma<strong>is</strong> certaines sont aussi util<strong>is</strong>ées pour<br />
l’approv<strong>is</strong>ionnement des services au niveau central.<br />
I.1.1. Le réseau des établ<strong>is</strong>sements de soins de santé de base<br />
Les prestations d<strong>is</strong>pensées dans les établ<strong>is</strong>sements de soins de base (soins préventifs, la<br />
consultation de médecine générale, le suivi de la maternité et de l’enfant, …) sont assurées<br />
gratuitement.<br />
D’une manière générale, les centres de santé ne gèrent pas directement le budget. Ils sont<br />
informés des montants qui leurs sont accordés en matière d’achat de fournitures de bureau et<br />
font leur commande à concurrence du montant alloué et ce à partir d’une l<strong>is</strong>te standard. Les<br />
achats sont effectués à partir de la province et reçoivent une dotation non valor<strong>is</strong>ée.<br />
Ces formations ne conna<strong>is</strong>sent pas les montants alloués pour la consommation de l’eau, de<br />
l’électricité et du téléphone. Il en est de même pour les rubriques qui concernent le chauffage,<br />
le gaz, …<br />
I.1.2. Le réseau des hôpitaux<br />
Les structures hôspitalières du Min<strong>is</strong>tère de la Santé sont destinés à d<strong>is</strong>penser les prestations<br />
de diagnostic et de soins (consultations, analyses, hospital<strong>is</strong>ations, …) aux malades.<br />
Les modalités de rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux et services<br />
relevant du Min<strong>is</strong>tère de la Santé sont fixées par le Décret n° 2-99-80 du 12 hijja 1419 (30<br />
mars 1999) 12 relatif à la fixation des prix de remboursement de la journée d'hospital<strong>is</strong>ation et<br />
des honoraires médicaux et chirurgicaux dans les formations de l'Etat.<br />
Selon ce décret, pour les malades soignés dans les services de médecine et de chirurgie, la<br />
tarification à l'acte se traduit par la sommation :<br />
- des honoraires médicaux et chirurgicaux calculés en fonction des actes médicaux, de<br />
chirurgie, de radiologie, d'imagerie médicale et d'exploration fonctionnelle ou de biologie<br />
qui leur ont été d<strong>is</strong>pensés au cours de leur séjour à l'hôpital ;<br />
- du montant total du prix des journées d'hospital<strong>is</strong>ation calculé sur la base de la durée de<br />
séjour selon la catégorie de la chambre ;<br />
- du prix des médicaments coûteux admin<strong>is</strong>trés au malade durant son séjour lorsque le<br />
montant global dépasse le seuil fixé par arrêté conjoint des min<strong>is</strong>tres chargés de la santé et<br />
des finances ;<br />
- du prix des séances de rééducation.<br />
Toutefo<strong>is</strong>, sont exonérées totalement ou partiellement du paiement des tarifs :<br />
1. Les personnes dont les capacités contributives ne leur permettent pas de supporter la<br />
totalité ou une partie des fra<strong>is</strong> des prestations, sur fourniture d’un certificat<br />
d’indigence ;<br />
Les critères et les procédures d'identification de ces personnes seront fixés par arrêté<br />
conjoint du min<strong>is</strong>tre chargé de la santé, du min<strong>is</strong>tre chargé de l'intérieur et du Min<strong>is</strong>tre<br />
Chargé des Finances dans le cadre du RAMED ;<br />
2. Les personnes bénéficiant de la gratuité des soins et de l'hospital<strong>is</strong>ation en vertu d'une<br />
d<strong>is</strong>position légale.<br />
12 Bulletin officiel n° 4682 du 28 hija 1419 (15 avril 1999).<br />
31
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Les maladies fa<strong>is</strong>ant l'objet de programmes sanitaires et figurant sur une l<strong>is</strong>te établie par<br />
arrêté 13 du min<strong>is</strong>tre chargé de la santé peuvent donner également lieu à exonération.<br />
La détermination des fra<strong>is</strong> dus par les malades hospital<strong>is</strong>és s'effectue soit au forfait journalier<br />
seul, soit au forfait journalier majoré, soit à l'acte.<br />
Les honoraires médicaux et chirurgicaux couvrent les actes de médecine, de chirurgie, de<br />
biologie médicale, de radiologie, d'imagerie médicale, d'exploration fonctionnelle et de<br />
rééducation fonctionnelle, calculés sur la base de la nomenclature des actes professionnels des<br />
médecins, chirurgiens dent<strong>is</strong>tes, sages femmes et auxiliaires médicaux et de la nomenclature<br />
des actes de biologie médicale fixées par arrêtés du Min<strong>is</strong>tre de la Santé.<br />
Le calcul des honoraires s'effectue au moyen des lettres clés K (actes de chirurgie et de<br />
spécialité), Z (actes de radiologie), B (actes de biologie médicale), D (actes dentaires) et<br />
AMM (actes de kinésithérapie), AMO (actes d'orthophonie), AMY (actes d'orthoptie).<br />
Chaque lettre clé est dotée d'un coefficient tel que prévu dans les nomenclatures des actes. Les<br />
honoraires sont le produit du coefficient de l'acte indiqué à la nomenclature par le montant de<br />
la valeur attribuée à la lettre clé.<br />
Toutefo<strong>is</strong>, lorsque les actes médicaux effectués ne dépassent pas B 120 et Z 50, leurs tarifs<br />
sont inclus dans le forfait de la journée d'hospital<strong>is</strong>ation et le forfait chirurgical.<br />
Les tarifs des actes, services et prestations rendus par des hôpitaux et services relevant du<br />
Min<strong>is</strong>tère de la Santé pourront être rév<strong>is</strong>és par arrêté conjoint des min<strong>is</strong>tres chargés de la<br />
santé et des finances.<br />
Si, dans le secteur privé, la tarification des actes et des services, fixée par un arrêté du<br />
Min<strong>is</strong>tère de la Santé de 1984, est dépassée, non respectée et ne constitue plus une référence,<br />
celle du secteur public a été revue, en 2004 14 , pour les hôpitaux publics, suite notamment à la<br />
détermination des coûts de production (étude 2001) et, en 1998, pour les Centre<br />
Hospitaliers 15 . En effet, la réforme hospitalière prévoyait, en matière de recouvrement et de<br />
financement, notamment une nouvelle tarification et une amélioration de la facturation, des<br />
moyens de recouvrement efficaces et surtout un bon rapport qualité/prix.<br />
Il est à noter que dans le cadre de cette réforme hospitalière, le modèle de gestion financière et<br />
comptable a décrit au niveau des fonctions de la gestion des ressources financière, les<br />
processus qui permettent d’assurer la gestion des revenus 16 . Ces processus doivent, entre<br />
autres :<br />
- assurer la facturation et la comptabil<strong>is</strong>ation de l’intégralité de ces revenus quel que soit<br />
leurs sources ou leurs formes (numéraire ou nature).<br />
- uniform<strong>is</strong>er la tarification des prestations de services pour tous les clients (individus,<br />
mutuelles, compagnies d’assurance, etc.).<br />
13 Arrêté du min<strong>is</strong>tre de la santé n° 2284-05 du 4 chaoual 1426 (7 novembre 2005) fixant la l<strong>is</strong>te des maladies<br />
donnant lieu à exonération de la rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux et services<br />
relevant du min<strong>is</strong>tère de la santé.<br />
14 Arrêté conjoint du Min<strong>is</strong>tre de la Santé et du Min<strong>is</strong>tre des Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation n° 10-04 du 3 Safar<br />
1425 (25/03/2004) fixant les tarifs des services et prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du<br />
Min<strong>is</strong>tère de la Santé.<br />
15 Arrêté du Min<strong>is</strong>tre des Affaires Sociales n° 221-98 du 30 ramadan 1418 (29 janvier 1998) fixant les tarifs des<br />
actes et prestations rendus par les Centres hospitaliers.<br />
16 Min<strong>is</strong>tère de la Santé, Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoire, « Réforme hospitalière :<br />
Restructuration de la gestion financière et comptable dans les hôpitaux publics marocains », décembre 2004,<br />
Rabat.<br />
32
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification, le montant des recettes des SEGMA a<br />
dépassé 184 MDH en 2004 contre 71 MDH réal<strong>is</strong>és en 1999/2000.<br />
De plus, en 2006 des conventions ont été signées sous l’égide de l’ANAM, entre les<br />
organ<strong>is</strong>mes gestionnaires de l’AMO et les établ<strong>is</strong>sements de soins publics, afin de définir les<br />
tarifications et les autres mesures de régulation.<br />
En mars 2007, et suite à la signature de la convention avec les Centres Hospitaliers<br />
Universitaires, il s’est avéré nécessaire de rév<strong>is</strong>er la lettre clé B servant de calcul des examens<br />
de biologie à travers la publication d’un arrêté n° 630-07 du 18 safar 1428 modifiant et<br />
complétant l’arrêté n°10-04 du 3safar 1428 (25 mars 2004) fixant les tarifs des services et<br />
prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du Min<strong>is</strong>tère de la Santé. (BO n° 5536<br />
du 21 juin 2007).<br />
En effet, la plupart des actes courants de biologie figurant dans la nomenclature de biologie<br />
médicale de 2005 ont connu une augmentation pouvant atteindre le double ou le triple de la<br />
cotation de 1977.<br />
Cette augmentation a nécessité par conséquent une rév<strong>is</strong>ion de la lettre clé B contenue dans<br />
l’arrêté du Min<strong>is</strong>tère des Affaires Sociales n° 221-98 du 30 Ramadan 1418 (29 Janvier 1998)<br />
fixant les tarifs des actes et prestations rendus par les Centres Hospitaliers, et ce afin de<br />
drainer plus de patients vers les hôpitaux publics qui r<strong>is</strong>quent, en maintenant l’ancien tarif, de<br />
privilégier le recours au secteur privé.<br />
Par ailleurs, conformément à l’article 19 de loi 65-00, les tarifs conventionnels ne peuvent<br />
être inférieurs à ceux fixés par voie réglementaire.<br />
I.1.3 External<strong>is</strong>ation<br />
Au Maroc, l'external<strong>is</strong>ation est devenue une démarche managériale souvent pratiquée par les<br />
hôpitaux. La sous-traitance, comme premier degré de l'external<strong>is</strong>ation, touche des fonctions<br />
log<strong>is</strong>tiques et de soutien, permettant aux institutions de se concentrer sur leurs fonctions de<br />
base à savoir assurer aux malades une bonne qualité de soins.<br />
Les premières activités sous-traitées n’ont véritablement commencé que dans les années 90.<br />
Cela, bien que des services aient été external<strong>is</strong>és bien avant (exemple de la centrale thermique<br />
du CHU Avicenne de Rabat). Ces activités ont d’abord concerné les fonctions hôtelières des<br />
hôpitaux. Les activités de nettoyage ont été external<strong>is</strong>ées au niveau du Centre hospitalier<br />
provincial (CHP) de Tanger en 1993, suivies tro<strong>is</strong> ans après par la sous-traitance du buandage<br />
au CHP d’Agadir en 1996. En 2004, 63% des activités de gardiennage des 52 CHP gérés de<br />
manière autonome (CHP SEGMA) que compte le Maroc étaient cédées au privé. Ceci, au<br />
même titre que 50% des opérations de nettoyage, 41% en matière de restauration et 19% des<br />
activités de buandage. Le tout, pour des dépenses totales avo<strong>is</strong>inant 51 millions de DH. Ce<br />
montant représente 16% du budget global (hors salaires du personnel), de l’ordre de 305<br />
millions de DH, accordé en 2006 aux CHP SEGMA.<br />
Ceci a été rendu possible notamment à travers l’introduction, en 2002, d’une circulaire du<br />
Min<strong>is</strong>tre de la Santé incitant les hôpitaux à external<strong>is</strong>er certaines activités. Les premiers<br />
exemples de contrats de prescriptions spéciales (CPS-types) pour la sous-traitance dans ces<br />
domaines ont été élaborés à cette date. Il s’agit de contrats rég<strong>is</strong>sant les rapports entre<br />
établ<strong>is</strong>sements hospitaliers et prestataires de services. Les volets concernant la formation, les<br />
adm<strong>is</strong>sions aux hôpitaux ou encore la gestion des ressources humaines ne sont cependant pas<br />
encore concernés par cette tendance.<br />
Les résultats n’ont néanmoins pas tardé à suivre. Une enquête menée par le min<strong>is</strong>tère de la<br />
Santé au niveau de 46 CHP SEGMA en 2004 a fait ressortir une amélioration notable de la<br />
33
Financement des soins de santé au Maroc<br />
qualité et de l’efficacité des prestations. Le déficit en personnel a été corrigé. Les coûts liés<br />
aux activités sous-traitées ont été maîtr<strong>is</strong>és.<br />
Cela étant, ce procédé pose plus d’une contrainte. A commencer par l’absence de normes et<br />
de procédures pour le contrôle de qualité et l’évaluation des prestations sous-traitées. Le<br />
manque de professionnal<strong>is</strong>me chez certains prestataires grève la qualité des services rendus.<br />
Certains personnels chargés d’exécuter ces activités restent peu ou pas formés (nettoyage,<br />
restauration…). Les dépenses, comme celle de la restauration, sont difficilement supportables<br />
par les hôpitaux marocains. Cela s’est traduit les deux dernières années par une ba<strong>is</strong>se du<br />
recours à l’external<strong>is</strong>ation.<br />
A partir de 2005, une nouvelle expérience a été entamée. Celle-ci concerne les déchets 17<br />
hospitaliers au niveau de 4 établ<strong>is</strong>sements (CHU de Casa et Fès, le CHP de Kénitra et le<br />
Centre national de transfusion sanguine).<br />
En 2005, le Min<strong>is</strong>tère de la Santé avait fait l’acqu<strong>is</strong>ition de 21 broyeurs - stéril<strong>is</strong>ateurs pour le<br />
traitement des déchets médicaux au sein des principaux hôpitaux provinciaux du Maroc,<br />
notamment à Casablanca, Safi, Agadir, Kenitra, Settat, Tanger, Fès, El Jadida…).<br />
De plus, le min<strong>is</strong>tère de la santé s’est engagé dans ce processus en d<strong>is</strong>tribuant de nouveaux<br />
stéril<strong>is</strong>ateurs et en créant un budget pour certains hôpitaux. Quant aux décrets d’application de<br />
la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par dahir n° 1-<br />
06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), ils sont en cours de final<strong>is</strong>ation.<br />
La création de sociétés de traitement de déchet s’avère importante de nos jours, ces dernières<br />
peuvent se doter d’usines ou de stations de collecte, de stéril<strong>is</strong>ation et de destruction. En<br />
attendant, les services médicaux doivent continuer à sensibil<strong>is</strong>er et à former du personnel pour<br />
trier et collecter les déchets.<br />
Par ailleurs et en attendant l’application de la loi 28-00, qui devrait prendre effet en 2012, la<br />
DHSA continue le traitement des déchets en fa<strong>is</strong>ant impliquer des sociétés privées afin que la<br />
sous-traitance des «ordures» se poursuive toujours dans les principales villes. Des guides de<br />
sensibil<strong>is</strong>ation sont toujours d<strong>is</strong>tribués dans le corps médical spécial<strong>is</strong>é.<br />
I.2. Les organ<strong>is</strong>mes gérant la couverture médicale<br />
Il s’agit des organ<strong>is</strong>mes gestionnaires de l’AMO, des mutuelles et des entrepr<strong>is</strong>es<br />
d’assurances. Certains de ces organ<strong>is</strong>mes, notamment les mutuelles possédent leur propre<br />
réseau de prestataires de soins (cabinets dentaires, centre de diagnostic, cliniques, maternité,<br />
etc.) et la CNSS (13 polycliniques). De plus, ces organ<strong>is</strong>mes font appel à des prestataires<br />
extérieurs pour fournir les services de santé à leurs assurés. Ils assurent donc la fonction de<br />
m<strong>is</strong>e en commun des ressources et d'achat des services de soins de façon « passive » lorsqu'ils<br />
possèdent leur propre réseau de structures de soins et de façon « stratégique » lorsqu'il font<br />
appel à des prestataires de soins extérieurs. La concurrence entre acheteurs et producteurs est<br />
introduite, de sorte que les acheteurs recherchent les meilleurs services au moindre prix et que<br />
les producteurs sont incités à répondre à cette demande.<br />
I.2.1. Description des arrangements liés à la politique d'achat des services de santé par les<br />
systèmes de prépaiement<br />
Conformément aux d<strong>is</strong>positions de la loi n° 65-00, l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie<br />
(ANAM) a conduit dans un premier temps les travaux relatifs à l'établ<strong>is</strong>sement le cadre<br />
17 Les hôpitaux marocains produ<strong>is</strong>ent chaque année plus de 45 000 tonnes de déchets de toutes sortes :<br />
Seringues, lames de b<strong>is</strong>tour<strong>is</strong>, plâtres, pansements, scalpels, gants, sondes, fœtus, placentas, fragments<br />
d’organes, …<br />
34
Financement des soins de santé au Maroc<br />
conventionnel type 18 ayant servi de base aux conventionsconclues entre les organ<strong>is</strong>mes<br />
gestionnaires de l’AMO et les représentants des professionnels de santé publics et privés.<br />
Dès l'entrée en vigueur de l'AMO, les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires (CNOPS et CNSS), sous<br />
l'égide de l'ANAM, se sont engagés dans un cycle de négociations des conventions nationales<br />
fixant la tarification nationale de référence (TNR) avec les prestataires de soins du secteur<br />
privé. A l'<strong>is</strong>sue de ces négociations, des accords tarifaires ont été conclus sur la base d'une<br />
approche de forfait<strong>is</strong>ation.<br />
De même, les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires de l’AMO, sous l'égide de l'ANAM, ont signé une<br />
convention avec les établ<strong>is</strong>sements de soins et d'hospital<strong>is</strong>ation relevant de l’Etat et les CHU<br />
et établ<strong>is</strong>sements assimilés.<br />
Ces conventions rég<strong>is</strong>sent les relations entres les parties signataires et fixent la tarification<br />
nationale de référence. Elles déterminent plus particulièrement :<br />
• Les obligations légales et réglementaires à la charge des deux parties<br />
conformément aux textes, ainsi que leurs engagements réciproques ;<br />
• Les modalités opérationnelles de la m<strong>is</strong>e en œuvre au quotidien des services aux<br />
assurés ;<br />
• La tarification nationale de référence.<br />
Ces conventions conclues pour une durée de 3 ans et sont renouvelables par tacite<br />
reconduction, peuvent faire l'objet, de modifications par avenant, pour entériner tout accord<br />
intervenu sous l'égide de l'ANAM entre les parties signataires. Ces avenants peuvent porter<br />
aussi bien sur les modalités opérationnelles, que sur le volet tarifaire des actes et prestations.<br />
Les conventions signées sont les suivantes :<br />
• Convention nationale entre les Organ<strong>is</strong>mes Gestionnaires et les biolog<strong>is</strong>tes<br />
représentés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, le Conseil National<br />
de l'Ordre des Pharmaciens et le Conseil National de l'Ordre National des<br />
vétérinaires, avec le concours du Conseil des Pharmaciens Biolog<strong>is</strong>tes et de la<br />
Chambre Syndicale des Biolog<strong>is</strong>tes, signée le 13 Avril 2006 ;<br />
• Convention nationale entre les Organ<strong>is</strong>mes Gestionnaires et les médecins et<br />
établ<strong>is</strong>sements de soins du secteur privé représentés par le Conseil National de<br />
l'Ordre des Médecins le concours de l'Association Nationale des Cliniques Privées<br />
et le Syndicat National des Médecins du Secteur Libéral, signée le 28 Juillet 2006 ;<br />
• Convention nationale entre les Organ<strong>is</strong>mes Gestionnaires et les chirurgiens<br />
dent<strong>is</strong>tes représentés par l'Ordre National des Chirurgiens Dent<strong>is</strong>tes représenté par<br />
le Président de la Délégation Spéciale des Chirurgiens Dent<strong>is</strong>tes, signée le 28<br />
Juillet 2006 ;<br />
• Convention nationale entre les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires et les établ<strong>is</strong>sements de<br />
soins relevant de l'Etat signée le 22 décembre 2006 ;<br />
• Convention nationale entre les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires et les Cardiologues<br />
privés ;<br />
18 Arrêté du min<strong>is</strong>tre de la santé n° 830-06 du 21 rabii I 1427 fixant le cadre conventionnel type pour les<br />
conventions nationales à conclure entre les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires de l’Assurance maladie obligatoire de base<br />
et les conseils nationaux des ordres professionnels des médecins, des chirurgiens dent<strong>is</strong>tes et des biolog<strong>is</strong>tes de<br />
secteur privé.<br />
35
Financement des soins de santé au Maroc<br />
• Convention nationale entre les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires et les centres hospitaliers<br />
universitaires et établ<strong>is</strong>sements de soins assimilés :<br />
• Les 4 Centres Hospitaliers Universitaires (CHU)<br />
• L’Hôpital Cheikh Zaid<br />
• La Ligue des Maladies Cardio-Vasculaires<br />
I.2.2. Mécan<strong>is</strong>mes de contractual<strong>is</strong>ation relatifs au système du tiers payant<br />
En général, les régimes de couverture médicale (organ<strong>is</strong>mes gestionnaires de l’AMO,<br />
mutuelles et entrepr<strong>is</strong>es d’assurance) adoptent le principe de l’avance des fra<strong>is</strong> par les assurés<br />
et le remboursement de ses fra<strong>is</strong> sur la base de taux de couverture et d’un tarif de<br />
remboursement.<br />
Cependant, ces régimes concluent des conventions de tiers payant avec les prestataires de<br />
soins, notamment en ce qui concerne les hôspital<strong>is</strong>ations et les soins lourds, afin d’éviter<br />
l’avance des fra<strong>is</strong> par leurs assurés.<br />
Outre les opérateurs publics et privés dans le domaine des prestations de soins, les 13<br />
polycliniques de la CNSS assurent une offre de soins aussi bien au profit des adhérents de<br />
cette ca<strong>is</strong>se qu’au profit des assurés d’autres organ<strong>is</strong>mes, à savoir les sociétés mutual<strong>is</strong>tes et<br />
des entrepr<strong>is</strong>es d’assurance à travers les conventions de tiers payant conclues avec ces<br />
derniers.<br />
I.3. Les ménages<br />
Les ménages fourn<strong>is</strong>sent, en plus des fonds aux régimes d’assurance à travers leur paiement<br />
de primes (en tant que source de financement du système de santé), des fonds pour leur propre<br />
achat de soins de santé (en tant qu’agent de financement du système de santé).<br />
L’achat direct des soins par les ménages concerne soit la totalité des soins nécessaires à leur<br />
état de santé soit d’une partie de ses soins.<br />
La pr<strong>is</strong>e en charge du coût des soins est total pour les ménages qui ne d<strong>is</strong>posent pas d’une<br />
couverture médicale et ne sont pas pr<strong>is</strong> en charge dans le cadre du système de soins des<br />
indigents. Il est partiel pour ceux qui bénéficient d’un système de couverture médicale y<br />
compr<strong>is</strong> ceux qui bénéficient de soins fourn<strong>is</strong> aux indigents.<br />
L’achat des soins par les ménages auprès des divers prestataires de soins et fourn<strong>is</strong>seurs de<br />
biens médicaux publics et privés qui opèrent dans le domaine( structures de soins publiques et<br />
privées, polycliniques de la CNSS, œuvres sociales relevant des mutuelles, pharmacies …).<br />
II/ Achat de biens : Le médicament<br />
II.1. Par appels d’offres<br />
Avant 2001, l’achat des biens médicaux par le Min<strong>is</strong>tère de la Santé est effectué par une<br />
multitude de structures : Chaque Direction technique (Population 19 et Epidémiologie 20 ) s’est<br />
chargée de l’achat des produits nécessaires aux Programmes de Santé Publique qu’elle gère ;<br />
les Instituts et les Laboratoires Nationaux ont leur système propre ainsi que les CHU ; les<br />
hôpitaux SEGMA effectuaient eux-mêmes leurs achats ; enfin, la Div<strong>is</strong>ion de<br />
l’Approv<strong>is</strong>ionnement s’est chargée de l’achat groupé des biens médicaux pour les hôpitaux<br />
gérés en Régie et les établ<strong>is</strong>sements de soins de santé de base. Suite aux dysfonctionnements<br />
constatés et reconnus qui ont entaché l’application de la politique d’achat des biens médicaux<br />
complètement déconcentrés par les hôpitaux SEGMA, le Min<strong>is</strong>tère de la Santé a adopté<br />
19 Exemple : les vaccins et contraceptifs.<br />
20 Exemple : les produits contre la tuberculose, le sida et les vaccins.<br />
36
Financement des soins de santé au Maroc<br />
durant ces dernières années une politique de central<strong>is</strong>ation des achats des médicaments et des<br />
d<strong>is</strong>positifs médicaux.<br />
Le min<strong>is</strong>tère approv<strong>is</strong>ionne les délégations provinciales de la santé (qui elles mêmes<br />
approv<strong>is</strong>ionnent les hôpitaux en régie et centres de santé) et les hôpitaux SEGMA. Ces<br />
hôpitaux, comme tous les services publics, peuvent acheter directement par bon de commande<br />
jusqu’à un plafond de 100 000 DHS 21 par ordonnateur et par rubrique (ce qui représente<br />
environ 2,5% de leur budget) et ils le font auprès des gross<strong>is</strong>teries et des officines. Il s'agit en<br />
principe de produits spécifiques non fourn<strong>is</strong> pas le min<strong>is</strong>tère.<br />
Le min<strong>is</strong>tère envoie aux délégations et hôpitaux les bons de commande en blanc comprenant<br />
la nomenclature 22 et les prix indicatifs. Cette nomenclature est modifiée légèrement tous les<br />
ans ou tous les deux ans.<br />
Les prix indicatifs sont les prix antérieurs payés, sauf pour les produits nouveaux pour<br />
lesquels on retient le prix de vente aux gross<strong>is</strong>tes privés. Cette méthode se révèle la meilleure<br />
prév<strong>is</strong>ion possible du prix du marché bien que dans certains cas, les prix du marché peuvent<br />
être sensiblement différents.<br />
Après réception des commandes des délégations et des hôpitaux, la Div<strong>is</strong>ion de<br />
l'Approv<strong>is</strong>ionnement les collationne, les vérifie (conformité de la l<strong>is</strong>te, des prix,<br />
vra<strong>is</strong>emblance des quantités et non dépassement du crédit) et lance les appels d'offres (AO).<br />
La déc<strong>is</strong>ion finale de l’AO est en fonction du prix et des autres variables. Jusqu'à maintenant,<br />
une proposition pouvait être rejetée pour prix excessif (supérieur de 30 % au prix indicatif),<br />
ma<strong>is</strong> une circulaire vient d'interdire cette pratique qui n'avait pas de base réglementaire<br />
préc<strong>is</strong>e 23 . Ceci peut rendre l'AO infructueux lorsqu'il y a une seule soum<strong>is</strong>sion. Lorsque le<br />
prix d'un fourn<strong>is</strong>seur est très inférieur à celui des concurrents, il est d'abord demandé au<br />
fourn<strong>is</strong>seur de confirmer ce prix. Il est ensuite demandé au fourn<strong>is</strong>seur de justifier ce prix à<br />
travers une facture pro forma du fourn<strong>is</strong>seur étranger du produit ou de la substance active.<br />
Dans le cas où l’AO est infructueux, une relance est effectuée (nouvel appel d'offres). Lorsque<br />
cette relance est infructueuse, le service passe un marché par négociation directe avec un<br />
fourn<strong>is</strong>seur. Il négocie un raba<strong>is</strong> sur le prix indicatif. La négociation se fait au cours d’une<br />
réunion avec les fourn<strong>is</strong>seurs à laquelle participent plusieurs cadres de la Div<strong>is</strong>ion de<br />
l'Approv<strong>is</strong>ionnement.<br />
La central<strong>is</strong>ation des achats en 2001 a perm<strong>is</strong> une ba<strong>is</strong>se des prix d’achats de 33,41 % par<br />
rapport au système antérieur, ce qui a perm<strong>is</strong> d’accroître de 50% les quantités achetées.<br />
Depu<strong>is</strong>, les prix sont relativement stables. L’analyse détaillée de deux appels d’offres de 2004<br />
montre que le système de m<strong>is</strong>e en concurrence est limité par l’importance des cas où il y a un<br />
seul soum<strong>is</strong>sionnaire : le prix augmente en moyenne pondérée d’un AO à l’autre de 5,81% s’il<br />
y a un seul soum<strong>is</strong>sionnaire, alors qu’ils ba<strong>is</strong>sent de 6,37% s’il y en a plusieurs. Cette ba<strong>is</strong>se<br />
est largement liée aux changements de fourn<strong>is</strong>seurs.<br />
La compara<strong>is</strong>on des prix d’achat avec les prix indicatifs (prix de l’année antérieure ou vente<br />
au secteur privé) montre que les prix d’achat sont inférieurs de 3 à 5% en moyenne, quelque<br />
21 Arrêté du Min<strong>is</strong>tre de la Santé du 25 juin 2001 complétant l’arrêté n°563-01 du 19 Al Kaâda 1421 (13 Février<br />
2001) relatif à la nomination des sous ordonnateurs et de leurs suppléants.<br />
22 La nomenclature comprend 230 médicaments et 200 à 250 d<strong>is</strong>positifs médicaux. La nomenclature des<br />
médicaments comprend 70% de génériques (médicaments bénéficiant d'au moins deux fourn<strong>is</strong>seurs sur le<br />
marché marocain).<br />
23 L'ex<strong>is</strong>tence de ces prix excessif parait par ailleurs parfo<strong>is</strong> illégale, car il est interdit de vendre à l'Etat à un prix<br />
supérieur de 5% au prix réglementé (arrêté de septembre 1969 fixant le prix des médicaments). Ces deux critères<br />
peuvent être présents ensemble, mai pas forcément.<br />
37
Financement des soins de santé au Maroc<br />
soit le nombre de soum<strong>is</strong>sionnaire du lot. Il semble que dans la très grande majorité des cas, le<br />
prix de vente au secteur privé (réglementé) serve de référence aux soum<strong>is</strong>sionnaires. Il y a peu<br />
de cas de « guerre des prix » avec des raba<strong>is</strong> importants.<br />
L’organ<strong>is</strong>ation du marché pharmaceutique marocain est tel que le nombre de<br />
soum<strong>is</strong>sionnaires est limité aux fabricants locaux (producteurs ou importateurs) qui sont en<br />
nombre limité (26), et évidement beaucoup moins en moyenne pour chaque produit.<br />
Le nombre de soum<strong>is</strong>sionnaires croit avec la taille des lots (moyenne et médiane): plus un<br />
marché est important, plus il y a de concurrence. Ma<strong>is</strong> le système d’appel d’offres semble peu<br />
efficace pour faire ba<strong>is</strong>ser les prix, pu<strong>is</strong>que la ba<strong>is</strong>se de prix obtenue est indépendante du<br />
nombre de soum<strong>is</strong>sionnaires (1, ou au moins 2). Tout se passe, dans la plupart des cas, comme<br />
si le montant proposé est basé sur le prix public des médicaments au Maroc.<br />
II.2. Auprès des officines<br />
La réglementation des prix des médicaments date de la fin des années 60. Cette<br />
réglementation a introduit une d<strong>is</strong>tinction dans les modes de fixation des prix des<br />
médicaments fabriqués localement et ceux importés.<br />
Médicaments fabriqués localement :<br />
a) Fixation des prix<br />
C’est l’arrêté n° 465-69 du 19/09/1969 qui détermine les modalités de fixation des prix des<br />
médicaments fabriqués localement. Cet arrêté n’a jama<strong>is</strong> été rév<strong>is</strong>é, il est basé sur le principe<br />
du cadre de prix. Le système tient compte des différentes composantes qui interviennent dans<br />
le prix de revient industriel. A ce dernier sont ajoutées les taxes et marges pour aboutir au Prix<br />
Public Maroc.<br />
Ce système n’est en fait pas appliqué car les paramètres qui interviennent dans le calcul du<br />
prix de revient industriel sont difficiles à appréhender. De plus le prix étant directement<br />
proportionnel au prix de revient, l’industriel aurait tout intérêt à gonfler celui-ci, par une<br />
augmentation du prix des matières premières ou du coût de la main d’œuvre au détriment<br />
d’une meilleure productivité.<br />
Le prix est en fait fixé par compara<strong>is</strong>on avec celui des médicaments similaires de formule<br />
quant ils ex<strong>is</strong>tent et en tenant compte des améliorations galéniques éventuelles et du prix dans<br />
le pays d’origine quand celui-ci est contrôlé.<br />
Une procédure a été récemment m<strong>is</strong>e en place en ce qui concerne les médicaments<br />
génériques. Ainsi, le prix du premier générique qui arrive sur le marché est inférieur de 20 à<br />
30% au prix du médicament princeps. Le prix des génériques suivants est à chaque fo<strong>is</strong><br />
inférieur de 5% à celui du similaire le moins cher.<br />
b) Rév<strong>is</strong>ion des prix<br />
La réglementation ne prévoit pas de système de rév<strong>is</strong>ion des prix des médicaments fabriqués<br />
localement. Différentes rév<strong>is</strong>ions ont cependant eu lieu, après av<strong>is</strong> de la Comm<strong>is</strong>sion<br />
Intermin<strong>is</strong>térielle des Prix (CIP), à des taux variables et sans périodicité déterminée.<br />
Des rév<strong>is</strong>ions ponctuelles ont eu lieu également au profit de certains médicaments dont les<br />
prix étaient jugés déficitaires, et ce après présentation de dossiers par les laboratoires et après<br />
av<strong>is</strong> de la CIP.<br />
Une procédure de rév<strong>is</strong>ion automatique a été d<strong>is</strong>cutée dans le cadre de la CIP. Cette procédure<br />
devait accorder une rév<strong>is</strong>ion annuelle aux prix des médicaments fabriqués localement. Le taux<br />
38
Financement des soins de santé au Maroc<br />
de cette rév<strong>is</strong>ion, égale au taux d’inflation diminué d’un facteur correspondant au gain de<br />
productivité devait être accordé en deux tranches.<br />
Médicaments importés :<br />
a) Fixation des prix<br />
L’arrêté du min<strong>is</strong>tre de la santé n° 107-69 du 18/09/1969 relatif à la fixation des prix des<br />
médicaments importés permet de calculer le prix des médicaments importés à partir du prix<br />
FOB (Free On Board) dans le pays d’origine, convert<strong>is</strong> en dirhams, par l’application d’une<br />
formule mathématique qui tient compte des fra<strong>is</strong> de transport de façon forfaitaire ainsi que des<br />
droits de douanes, des taxes et des marges gross<strong>is</strong>tes et pharmacien d’officine. La marge de<br />
l’importateur est incluse dans le prix FOB. Elle est de 20%.<br />
Cet arrêté a été rév<strong>is</strong>é à 5 repr<strong>is</strong>es par l’introduction notamment de nouveaux coefficients de<br />
calcul pour tenir compte des différentes quotités de droits de douane et de taxes appliquées.<br />
En 1998, le principe de l’alignement des prix des spécialités importées sur celui de leurs<br />
similaires fabriqués localement, quand ils ex<strong>is</strong>tent, a été introduit. Cette d<strong>is</strong>position a été<br />
jusque la très peu appliquée.<br />
b) Rév<strong>is</strong>ion des prix<br />
Le système de rév<strong>is</strong>ion des prix des spécialités importées est plus simple que celui des<br />
spécialités fabriquées localement pu<strong>is</strong>que la procédure est quasi automatique. La rév<strong>is</strong>ion<br />
intervient à chaque variation d’un des paramètres entrant dans le calcul : prix FOB, taux de<br />
change, droits et taxes.<br />
Conséquences de la réglementation actuelle :<br />
Par rapport à la France pr<strong>is</strong>e comme référence (la majorité des médicaments du marché<br />
marocain sont fabriqués sous licence de laboratoires frança<strong>is</strong> ou importés directement de<br />
France), les prix des médicaments sont plus bas en ce qui concerne les produits fabriqués ma<strong>is</strong><br />
plus élevés pour les produits importés.<br />
Sur 10 ans, les hausses autor<strong>is</strong>ées des prix des médicaments fabriqués au Maroc ont été<br />
inférieures à la moitié du taux d'inflation, alors que les médicaments importés ont vu leurs<br />
prix doubler.<br />
En 2000, la moyenne des prix des médicaments importés était de 48,40 dirhams (en PPM),<br />
supérieure de 35% à celle des produits fabriqués localement.<br />
La part des produits fabriqués qui était d’environ 80% au début des années 90 ne représentait<br />
plus que 72% en 2000 (en valeur).<br />
Force est de constater que :<br />
• Le système du cadre de prix est dépassé. D’ailleurs celui afférent aux produits<br />
fabriqués localement n’est plus appliqué par l’admin<strong>is</strong>tration ;<br />
• Le prix des produits importés est établ<strong>is</strong> à partir du prix dans le pays d’origine, de ce<br />
fait le prix sera dépendant du choix de ce pays la<strong>is</strong>sé aux bons soins de l’importateur<br />
(un prix de cession Su<strong>is</strong>se sera différent du prix de cession France) ;<br />
• Le système de rév<strong>is</strong>ion des prix, souple pour les médicaments importés est plus<br />
complexe et aléatoire pour les médicaments fabriqués ;<br />
• Le système de fixation des prix des produits fabriqués maintient une grande différence<br />
entre les médicaments anciens et les médicaments récents, dont les prix sont plus<br />
importants. Ceci conduit à l’abandon des premiers au profit des seconds ;<br />
39
Financement des soins de santé au Maroc<br />
• La réglementation entraîne une d<strong>is</strong>parité entre produits importés et produits fabriqués<br />
au profit des premiers. Depu<strong>is</strong> le milieu des années 90, on ass<strong>is</strong>te à une augmentation<br />
du pourcentage des produits importés qui ont représenté, en 2000, 28% du chiffre<br />
d’affaires réal<strong>is</strong>é par l’industrie pharmaceutique.<br />
Deuxième partie : Financement par les régimes et mécan<strong>is</strong>mes de<br />
couverture des soins de santé<br />
Analyse détaillée de l’organ<strong>is</strong>ation actuelle des systèmes de prépaiement dans le domaine de<br />
la santé : Description de tous les mécan<strong>is</strong>mes et régimes ex<strong>is</strong>tants relatifs au financement des<br />
services de santé.<br />
Chapitre 1 : Budget de l’Etat<br />
Section I : Financement du Min<strong>is</strong>tère de la Santé<br />
L’analyse du financement du Min<strong>is</strong>tère de la Santé revêt une grande importance en ra<strong>is</strong>on de<br />
son poids dans le système national de santé. Outre son rôle de garant de la santé au Maroc, ce<br />
département est le plus important fourn<strong>is</strong>seur de soins.<br />
Cette section s’intéressera à l’analyse des sources de financement de ses dépenses, à la<br />
classification économique et fonctionnelle de ces mêmes dépenses ainsi qu’à la répartition des<br />
ressources entre les régions.<br />
I.1. Budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé (Niveau, Evolution et Exécution des crédits)<br />
La source principale de financement des activités du Min<strong>is</strong>tère de la Santé est le budget de<br />
l’Etat. Plus des tro<strong>is</strong>-quarts des dépenses du département proviennent du budget général de<br />
l’Etat. Toutefo<strong>is</strong>, cette part a connu une chute assez importante, en passant de 81,3% en<br />
1997/98 à 77,6% en 2001, en ra<strong>is</strong>on notamment de l’augmentation de la participation des<br />
ménages au financement des activités des structures de soins du secteur public. Leur part est<br />
passée de 7,4% en 1997/98 à 10,3% en 2001 24 .<br />
Par ailleurs, en dépit des ressources supplémentaires injectées dans le secteur, le budget du<br />
Min<strong>is</strong>tère de la Santé demeure insuff<strong>is</strong>ant : il atteint près de 6 milliards de DHS en 2006 ; soit<br />
moins de 200 DHS par habitant, 5% du budget général de l’Etat et 1,3% du PIB.<br />
Si on doit considérer un département bénéficiant de dotations budgétaires dont l’évolution est<br />
plus rapide que celle du budget de l’Etat et celle du PIB comme un secteur prioritaire, on<br />
pourra sans hésiter qualifier la Santé en tant que véritable priorité de l’Etat. En effet, entre<br />
1997 et 2007, l’évolution de l’indice du budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé fut supérieure à ceux<br />
du budget de l’Etat et du PIB.<br />
Toutefo<strong>is</strong>, l’essentiel de ces augmentations est absorbé par la masse salariale qui constitue<br />
63% des crédits alloués au Min<strong>is</strong>tère de la Santé.<br />
En outre, la structure du budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé reste à optim<strong>is</strong>er car l’évolution de<br />
l’invest<strong>is</strong>sement est plus rapide que celle des dépenses récurrentes nécessaires au maintien de<br />
celui-ci. En plus, il faut noter que les crédits nécessaires à la maintenance et à la réparation ne<br />
constituent que 4% des invest<strong>is</strong>sements effectifs (bâtiments, équipements, véhicules…) pour<br />
un même exercice 25 .<br />
24 Les autres sources de financement des activités du Min<strong>is</strong>tère de la Santé demeurent négligeables et<br />
pratiquement inchangées durant cette période : autres min<strong>is</strong>tères (5%), assurances et mutuelles (3%),<br />
collectivités locales (1,5%) et coopération internationale (1,1%)<br />
25 Si ce taux est très valable pour l’invest<strong>is</strong>sement d’une seule année, il demeure très insuff<strong>is</strong>ant pour couvrir les<br />
besoins d’entretien et de maintenance des invest<strong>is</strong>sements cumulés durant plusieurs années. Ceci explique, entre<br />
40
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Figure 1 : Evolution des indices des différents chapitres du budget du Min<strong>is</strong>tère de la<br />
Santé, 1997/98-2007<br />
En dépit des progrès réal<strong>is</strong>és à ce niveau, les performances en terme d’exécution des crédits<br />
alloués au Min<strong>is</strong>tère de la Santé demeurent modestes : le taux d’ém<strong>is</strong>sion des crédits du<br />
« Fonds Spécial de la Pharmacie Centrale » n’a pas dépassé 64% en 2005. Plus encore, le<br />
même taux pour les crédits d’invest<strong>is</strong>sement (neufs et reports) a été inférieur à 42%.<br />
Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé ne doit pas se contenter d’essayer de régler le problème des marchés<br />
reportés depu<strong>is</strong> plusieurs années (pour causes diverses) et de pousser les responsables, à<br />
différents niveaux (en n’omettant pas les Centres Hospitaliers Universitaires), à consommer<br />
mieux leurs crédits, ma<strong>is</strong> doit revoir également son approche de programmation.<br />
I.2. Structure des dépenses du Min<strong>is</strong>tère de la Santé<br />
De l’ensemble des crédits budgétaires dépensés par le Min<strong>is</strong>tère de la Santé en 2001, 49%<br />
profitent aux hôpitaux (17% aux CHU et 32% au reste des hôpitaux) contre 37% au réseau de<br />
soins de santé de base (RSSB). Les Instituts et Laboratoires Nationaux (ILN), qui représentent<br />
essentiellement des activités de soutien aux programmes et à la formation, bénéficient de 4%<br />
de ces allocations, soit 3 fo<strong>is</strong> moins que l’Admin<strong>is</strong>tration Centrale et Locale (10%) 26 .<br />
Cette répartition a connu un petit changement, entre 1997/98 et 2001, qui a profité<br />
essentiellement aux hôpitaux (CHU et début des projets PFGSS et MEDA) et aux ILN au<br />
détriment des soins de santé de base et de l’admin<strong>is</strong>tration centrale et provinciale.<br />
A travers l’analyse fonctionnelle des dépenses du Min<strong>is</strong>tère de la Santé, on peut constater<br />
que :<br />
autres (problèmes de gestion, …), la sévérité et la chronicité des pannes et la dégradation rapide du patrimoine<br />
du Min<strong>is</strong>tère de la Santé.<br />
26 Il est vrai que ce pourcentage est assez élevé. Toutefo<strong>is</strong>, il faut préc<strong>is</strong>er que, dans le cadre des programmes<br />
sanitaires et du suivi des activités de soins et de prévention sanitaire, l’encadrement aussi bien au niveau central<br />
que local (admin<strong>is</strong>tration des programmes sanitaires, Services d’Infrastructures et d’Actions Ambulatoires<br />
Provinciaux, …) demeure important.<br />
41
Financement des soins de santé au Maroc<br />
• L’Admin<strong>is</strong>tration bénéficie d’une part très élevée (16,8%) en ra<strong>is</strong>on de l’intégration des<br />
admin<strong>is</strong>trations des prestataires tels que les hôpitaux et les Instituts et Laboratoires<br />
Nationaux.<br />
• Les soins ambulatoires (au sens large) ont un poids estimé à 38% contre 37% pour les<br />
soins hospitaliers. Ces pourcentages seraient de 31,7% pour les premiers et 43,3% pour les<br />
seconds si on considérait toutes les prestations externes de l’hôpital comme des soins<br />
hospitaliers.<br />
• La part des soins ambulatoires, quelle qu’en soit la définition, peut être considérée comme<br />
insuff<strong>is</strong>ante en ra<strong>is</strong>on, d’une part, de la grande faiblesse quantitative des activités<br />
complémentaires telle que la prévention sanitaire collective dont le poids ne dépasse pas<br />
4%, et d’autre part, des besoins actuels de la société marocaine en termes de prestations<br />
liées à l’hygiène du milieu, à la santé maternelle et infantile et au traitement des maladies<br />
transm<strong>is</strong>sibles.<br />
• Les activités relatives à la formation, recherche et enseignement bénéficient de 6% des<br />
ressources mobil<strong>is</strong>ées par le Min<strong>is</strong>tère de la Santé. Il s’agit surtout des salaires des<br />
enseignants et formateurs dans les IFCS et dans les CHU.<br />
Section II : La participation des autres Min<strong>is</strong>tères au financement de la santé<br />
En dehors du paiement des salaires des médecins enseignants par le budget général de l’Etat<br />
via le MES (près de 298 millions de Dirhams), les départements min<strong>is</strong>tériels (hors Min<strong>is</strong>tère<br />
de la Santé) ont dépensé environ 53 millions de Dirhams.<br />
II.1. Sources de financement des autres départements min<strong>is</strong>tériels<br />
Le budget de l’Etat finance les activités sanitaires des départements min<strong>is</strong>tériels à hauteur de<br />
99,95%. Le reste, très dér<strong>is</strong>oire, est financé par les participations des entrepr<strong>is</strong>es privées<br />
(0,05% des ressources).<br />
Tableau 1 : Sources de financement des autres Min<strong>is</strong>tères (hors paiements des salaires<br />
des médecins enseignants), 2001<br />
Sources Montants en DHS Part en %<br />
Budget du Min<strong>is</strong>tère 52 756 504 99,73<br />
Autres Min<strong>is</strong>tères 115 879 0,22<br />
Entrepr<strong>is</strong>es privées 24 482 0,05<br />
Total 52 896 865 100,00<br />
Source : MS/DPRF/SES « Comptes Nationaux de la Santé, 2001 ».<br />
II.2. Classification économique des dépenses des autres Min<strong>is</strong>tères<br />
L’analyse des dépenses sanitaires des autres départements min<strong>is</strong>tériels, montre une nette<br />
hégémonie de la masse salariale avec environ 59,4% de l’ensemble de ces dépenses. La part<br />
des biens de consommation, hors biens médicaux, est assez importante pu<strong>is</strong>qu’elle atteint<br />
26% des dépenses. Par contre, les immobil<strong>is</strong>ations, quant à elles, ont un poids très faible<br />
pu<strong>is</strong>qu’il n’atteint pas 1% des dépenses des autres min<strong>is</strong>tères.<br />
42
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Tableau 2 : Classification économique des dépenses des autres Min<strong>is</strong>tères (hors<br />
paiements des salaires des médecins enseignants), 2001<br />
Types de dépenses Montants en Dirhams Parts en %<br />
Médicaments et biens médicaux 13 770 109 26,00<br />
Autres biens de consommation 7 130 570 13,50<br />
Services 140 361 0,30<br />
Immobil<strong>is</strong>ation 437 634 0,80<br />
Masse salariale 31 418 191 59,40<br />
Total 52 896 865 100,00<br />
Source : MS/DPRF/SES « Comptes Nationaux de la Santé, 2001 ».<br />
Si on admettait les paiements des salaires des médecins enseignants par le MES, la masse<br />
salariale représenterait plus de 90% des dépenses des autres Min<strong>is</strong>tères.<br />
Figure 2 : Classification économique des dépenses de santé des autres Min<strong>is</strong>tères, 2001<br />
Masse salariale<br />
59,40%<br />
Médicaments et<br />
biens médicaux<br />
26,03%<br />
Autres biens de<br />
consommation<br />
13,48%<br />
Services<br />
Immobil<strong>is</strong>ation0,27%<br />
0,83%<br />
II.3. Classification fonctionnelle des dépenses des autres Min<strong>is</strong>tères<br />
Les dépenses sanitaires des départements min<strong>is</strong>tériels (hors Min<strong>is</strong>tère de la Santé) s’orientent<br />
toujours davantage vers la prévention sanitaire collective que vers les soins prodigués dans les<br />
milieux pénitenciers, scolaires et universitaires.<br />
43
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Tableau 3 : Classification fonctionnelle des dépenses des autres Min<strong>is</strong>tères (hors<br />
paiements des salaires des médecins enseignants), 2001<br />
Niveaux Montants en DHS Part en %<br />
Prévention sanitaire collective 140 361 0,27<br />
Médecine pénitentiaire 37 163 801 70,26<br />
Admin<strong>is</strong>tration 10 868 197 20,55<br />
Santé dans le milieu scolaire 1 232 690 2,33<br />
Santé dans le milieu universitaire 3 491 815 6,60<br />
Total 52 896 865 100,00<br />
Source : MS/DPRF/SES « Comptes Nationaux de la Santé, 2001 ».<br />
En terme de poids de chaque type d’activités dans les dépenses sanitaires de ces Min<strong>is</strong>tères, la<br />
médecine pénitentiaire est dominante avec un pourcentage atteignant pratiquement 70%<br />
contre seulement 9% pour la santé dans les milieux scolaires et universitaires. Alors que<br />
l’Admin<strong>is</strong>tration bénéficie d’environ du quart des ressources mobil<strong>is</strong>ées et dépensées par ces<br />
départements.<br />
Figure 3 : Classification fonctionnelle des dépenses de santé des autres Min<strong>is</strong>tères, 2001<br />
Admin<strong>is</strong>tration<br />
20,5%<br />
Santé scolaire<br />
2,3%<br />
Santé universitaire<br />
6,6%<br />
Prévention sanitaire<br />
collective<br />
0,3%<br />
Section III : Le financement de la santé par les Collectivités Locales<br />
Médecine<br />
pénitentiaire<br />
70,3%<br />
Les m<strong>is</strong>sions sanitaires des Collectivités Locales (CL), au travers des activités des Bureaux<br />
d’Hygiène et de la police admin<strong>is</strong>trative d’hygiène et de salubrité publique, ont trait<br />
essentiellement à la prévention sanitaire collective en termes d’hygiène et de salubrité<br />
publique.<br />
44
Financement des soins de santé au Maroc<br />
En effet, étant donné leur proximité par rapport à la population et leurs attributions générales<br />
et spécifiques au domaine de la santé 27 , les CL constituent un acteur stratégique<br />
incontournable dans les déc<strong>is</strong>ions concernant le système national de santé. Les CL participent<br />
directement par leur appui aux différentes fonctions, à savoir la pr<strong>is</strong>e en charge d’une bonne<br />
partie de la production (promotion de la santé essentiellement), la réal<strong>is</strong>ation et l’entretien des<br />
hôpitaux et des établ<strong>is</strong>sements universitaires, des équipements d’intérêt régional, la possibilité<br />
de recours à des conventions pour entreprendre des actions de coopération nécessaire au<br />
développement régional, l’acqu<strong>is</strong>ition d’équipements, l’hygiène, etc.<br />
Les ressources propres des CL sont essentiellement f<strong>is</strong>cales dont une bonne partie est<br />
constituée par les 30% des montants globaux de la TVA collectée au niveau national. Les CL<br />
ont alloué à leurs activités sanitaires un peu plus de 232 millions de Dirhams en 2001, soit une<br />
augmentation annuelle d’un peu plus de 10% durant la période 1997/98 - 2001.<br />
La part des dépenses des CL dans la dépense globale de santé n’a pratiquement pas évolué<br />
durant cette même période ; elle est estimée à 1%.<br />
III.1. Flux financiers entre les CL et les autres institutions<br />
Le montant de 232 millions de Dirhams dépensé par les CL au profit des activités sanitaires<br />
ne bénéficie pas uniquement aux BMH.<br />
L’intérêt accordé par les CL au secteur de la santé se manifeste à travers les flux financiers<br />
transféré aux autres institutions, en nature (personnel, immobil<strong>is</strong>ations, aide log<strong>is</strong>tique…)<br />
pour le Min<strong>is</strong>tère de la Santé et sous forme d’aides financières directes aux ONG versées<br />
principalement dans la pr<strong>is</strong>e en charge des personnes atteintes de diabète et celles souffrant<br />
d’insuff<strong>is</strong>ance rénale.<br />
Un peu plus de 100 millions de Dirhams a été transféré aux autres institutions en 2001 contre<br />
environ 30 millions de Dirhams en 1997/98. Ce qui équivaut à une augmentation annuelle de<br />
38% durant cette période. Cette augmentation bénéficie particulièrement aux structures de<br />
soins de santé de base et ONG dont la part a évolué respectivement de 75% et 47% par an<br />
entre 1997/98 et 2001.<br />
Tableau 4 : Flux financiers entre les CL et les autres institutions, 2001, en Dirhams<br />
Institutions Flux vers Flux de<br />
Hôpitaux Publics (MS) 14 266 023 -<br />
Réseau de Soins de Santé de Base (MS) 74 969 879 -<br />
Admin<strong>is</strong>tration locale du MS 2 287 541 -<br />
Min<strong>is</strong>tère de la Santé (MS) - 13 684 396<br />
ONG 15 397 801 -<br />
Coopération internationale - 4 564 759<br />
Total 106 921 244 18 249 155<br />
Source : MS/DPRF/SES « Comptes Nationaux de la Santé, 2001 ».<br />
En parallèle, les CL bénéficient, à leur tour, des flux financiers des autres institutions qui se<br />
sont élevés à près de 18 millions de Dirhams en 2001. Il s’agit surtout du personnel payé par<br />
le Min<strong>is</strong>tère de la Santé ma<strong>is</strong> travaillant pour le compte des CL ainsi que des aides reçues de<br />
la coopération internationale. Le flux du Min<strong>is</strong>tère de la Santé aux CL a connu une<br />
27 La charte communale 2002 (Loi 78-00) et la régional<strong>is</strong>ation étaient une occasion pour responsabil<strong>is</strong>er les CL<br />
sur ces aspects de santé et mobil<strong>is</strong>er leur participation dans la planification et le financement des soins et un<br />
moyen de red<strong>is</strong>tribution des ressources humaines et financières.<br />
45
Financement des soins de santé au Maroc<br />
augmentation annuelle de 8,7% durant la période 1997/98 - 2001 contre 33,6% pour ceux<br />
provenant de la coopération internationale.<br />
III.2. Classification économique des dépenses des Collectivités Locales<br />
A l’instar de tout le secteur public, les Collectivités Locales consacrent une grande partie de<br />
leurs ressources au paiement de la masse salariale. Pourtant, cette part a connu une<br />
diminution, en passant de 61% en 1997/98 à 58% en 2001 ; soit une diminution annuelle de<br />
1,5%.<br />
Figure 4 : Classification économique des dépenses de santé des Collectivités Locales, 2001<br />
Immobil<strong>is</strong>ation<br />
19,4%<br />
Salaires<br />
58,1%<br />
Médicaments<br />
17,1%<br />
Biens médicaux<br />
1,7%<br />
Autres biens de<br />
consommation<br />
3,2%<br />
Services<br />
0,6%<br />
A l’exception des dépenses en médicaments et en immobil<strong>is</strong>ations, tous les autres postes de<br />
dépenses ont connu une diminution. Seulement, pour ces derniers, la diminution est plus<br />
importante ; elle varie annuellement de 25 à un peu plus de 31%.<br />
Pour les médicaments et les immobil<strong>is</strong>ations, l’évolution des dépenses des Collectivités<br />
Locales a connu un accro<strong>is</strong>sement annuel très important évalué respectivement à 11 et 42%.<br />
III.3. Classification fonctionnelle des dépenses des Collectivités Locales<br />
A l’instar des CNS 1997/98, la structure fonctionnelle des dépenses sanitaires des<br />
Collectivités Locales reflète la vocation première des BMH à savoir, l’hygiène, la prévention<br />
et la salubrité publique. Ceci se traduit par la part importante de la prévention sanitaire<br />
collective qui atteint 39% des dépenses sanitaires des Collectivités Locales en 2001.<br />
Néanmoins, ce poste de dépense a connu une diminution de l’intérêt pu<strong>is</strong>que la part des<br />
dépenses des Collectivités Locales en matière de prévention sanitaire collective était évaluée à<br />
58% en 1997/98.<br />
46
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Figure 5 : Classification fonctionnelle des dépenses de santé des Collectivités Locales, 2001<br />
Admin<strong>is</strong>tration<br />
34,04%<br />
Form/Ens/Rech<br />
0,01%<br />
Prév Sanit<br />
Collective<br />
39,02%<br />
Soins ambulatoires<br />
21,54%<br />
Soins hospitaliers<br />
5,39%<br />
Les dépenses en soins ambulatoires, qui restent essentiellement préventifs, n’ont presque pas<br />
évolué ; ils représentent environ 22% de cette même dépense alors que la part de<br />
l’admin<strong>is</strong>tration est exorbitante dépassant de loin celle réservé à l’admin<strong>is</strong>tration au niveau<br />
globale.<br />
Il est à noter que l’implication des Collectivités Locales dans les activités sanitaires est<br />
amenée à évoluer. En effet, le rôle des Collectivités Locales est très important dans<br />
l'accompagnement de la m<strong>is</strong>e en place de l'Initiative Nationale pour le Développement<br />
Humain (INDH) vu la nature de leur niveau le plus proche de la représentation de la<br />
population et la politique de proximité. Ce qui est d'ailleurs l’une des principales nouveautés<br />
de l'esprit de la Charte Communale introduite en 2003.<br />
Dans le même sens, les Collectivités Locales sont appelées à jouer un rôle majeur notamment<br />
en matière de financement, pu<strong>is</strong>qu'elles doivent participer à hauteur de 20% du coût de<br />
l'opération INDH.<br />
Les Collectivités Locales seront également amenées à jouer un rôle très important dans la<br />
m<strong>is</strong>e en œuvre du RAMED. En plus de leur implication dans la procédure admin<strong>is</strong>trative<br />
d’identification de la population éligible au régime, la loi 65-00 prévoit le financement dudit<br />
régime principalement par l’Etat et les Collectivités Locales (article 125).<br />
Section IV : Financement des programmes de santé publique et des services de<br />
soins : L’immun<strong>is</strong>ation, la promotion de la santé, …<br />
Parallèlement aux actions de diagnostic et de traitement des maladies, à des actions de<br />
réduction des souffrances et de réhabilitation des incapacités, des actions de promotion de la<br />
santé et de prévention sont généralement menés par le système de soins. Ces actions sont<br />
ciblées et orientées vers :<br />
47
Financement des soins de santé au Maroc<br />
• la population en général au sein de laquelle, les améliorations de santé les plus<br />
significatives s’obtiennent par des actions de santé publique, spécialement celles<br />
induites par l’amélioration de l’accès à l'eau potable, de la nutrition, des conditions<br />
d’habitat et du niveau d’instruction ;<br />
• les groupes vulnérables qui s'exposent à des facteurs de r<strong>is</strong>que particuliers. Ces<br />
groupes doivent être identifiés de manière à cibler à leur intention des programmes<br />
spéciaux de promotion, de prévention, de traitement et de rééducation. Les maladies<br />
pour lesquelles les externalités sont importantes ou dont la prévention dépend des<br />
services publics sont dans une large mesure celles qui touchent les groupes<br />
vulnérables en général et les pauvres en particulier ;<br />
• les patients adm<strong>is</strong> dans les établ<strong>is</strong>sements de soins.<br />
Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé, à travers son budget, suit une politique de santé publique qui<br />
s’appuie énormément sur les programmes de santé publique (une trentaine) dont les plus<br />
importants sont :<br />
- Les Programmes de Santé Maternelle et Infantile :<br />
o Planification familiale<br />
o Surveillance de la grossesse et de l’accouchement<br />
o Lutte contre les maladies de <strong>care</strong>nce<br />
o Immun<strong>is</strong>ation<br />
o Lutte contre les maladies diarrhéiques<br />
o Lutte contre les Infections respiratoires aiguës<br />
- Les Programmes de Prévention Sanitaire Collective :<br />
o Programmes d’hygiène du milieu<br />
o Information Education Communication<br />
- Le Programme de Santé Mentale et de Lutte contre la Toxicomanie<br />
- Le Programme des IST-SIDA<br />
- Autres programmes (diabète, tuberculose, hygiène bucco-dentaire, santé scolaire et<br />
universitaire, …)<br />
Les organ<strong>is</strong>mes de coopératon internationale financent aussi certains de ces programmes. En<br />
effet, depu<strong>is</strong> plus de cinquante ans, les grandes priorités des organ<strong>is</strong>mes de coopération<br />
internationale étaient la vaccination, les maladies infectieuses et parasitaires, la malnutrition,<br />
l'hygiène et l'assain<strong>is</strong>sement, les infrastructures sanitaires de base, et le développement ou la<br />
reconstruction des services de santé.<br />
Devant l’ampleur des tro<strong>is</strong> principales pandémies (Sida, tuberculose, palud<strong>is</strong>me), l’ONU,<br />
conscient que les conséquences du VIH/Sida étaient sans précédent, nécessitant des mesures<br />
de financement exceptionnelles, a m<strong>is</strong> en place un Fonds multilatéral unique consacré à la<br />
lutte contre ces pandémies.<br />
Par ailleurs, plusieurs ONG (notamment des associations) s’intéressent au système de santé,<br />
en organ<strong>is</strong>ant ou en participant à des actions de prévention, de sensibil<strong>is</strong>ation et même de<br />
financement de certains programmes de santé de manière générale (Exemple : lutte contre le<br />
SIDA, le cancer…)ou ciblés au profit de populations ou régions spécifiques.<br />
48
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Ces actions sont financés, notamment par :<br />
- les adhérents à ces associations ;<br />
- certains organ<strong>is</strong>mes nationaux publics et privés ;<br />
- des ONG internationaux ;<br />
- des transferts de certains min<strong>is</strong>tères.<br />
Section V : Les formations médicales et paramédicales<br />
V.1. Formation des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dent<strong>is</strong>tes<br />
Via ses facultés de médecine et de pharmacie, crées respectivement en 1962 (Rabat), 1976<br />
(Casablanca) et 1998 (Fès et Marrakech), l’Etat finance la formation de base des médecins,<br />
des pharmaciens et des chirurgiens dent<strong>is</strong>tes.<br />
Ces facultés de médecine et de pharmacie sont encore régies par des textes obsolètes ayant<br />
une incidence négative sensible sur la formation, la recherche et la gestion admin<strong>is</strong>trative.<br />
Le nombre d’étudiants en médecine inscrits annuellement dans ces quatre facultés reste fixé à<br />
environ 800 auxquels s’ajoutent 200 médecins par an pour la formation en spécialités.<br />
Par ailleurs, un nombre important d’étudiants marocains en médecine et en pharmacie se<br />
forment actuellement à l’étranger (environ 300 médecins et 700 pharmaciens formés à<br />
l’étranger arriveront annuellement comme offre supplémentaire).<br />
Les études en pharmacie ont démarré en 1986 à la faculté de Rabat. Chaque année 80 à 90<br />
nouveaux pharmaciens sont formés, auxquels s’ajoutent les lauréats formés à l’étranger et<br />
dont le nombre est en augmentation constante (environ 700).<br />
Les facultés de médecine dentaire de Rabat et de Casablanca ont été créées en 1981. Elles<br />
forment environ 80 à 100 chirurgiens-dent<strong>is</strong>tes par an. L’effectif global formé jusqu’à présent<br />
au sein des deux facultés est de 2 106. Les deux Facultés assurent actuellement la formation<br />
des spécial<strong>is</strong>tes et enseignants en médecine dentaire.<br />
Les problèmes qui se posent à la formation de base des médecins, des pharmaciens et des<br />
chirurgiens dent<strong>is</strong>tes se situent essentiellement au niveau du cursus ainsi que des méthodes<br />
d’enseignement, en plus du problème de l’équivalence des diplômes et de la qualité de la<br />
formation dans certaines facultés étrangères.<br />
Quant à la formation des médecins spécial<strong>is</strong>tes, elle souffre également d’un certain nombre de<br />
problèmes liés aux effectifs formés, aux spécialités prioritaires, à la durée de formation, etc.<br />
V.2. Formation du personnel paramédical<br />
Deux types d’établ<strong>is</strong>sements, relevant du Min<strong>is</strong>tère de la Santé, composent le d<strong>is</strong>positif de<br />
formation de base du personnel paramédical : les Instituts de Formation aux Carrières de<br />
Santé (IFCS) au nombre de 9 (Agadir, Casablanca, Fès, Laâyoune, Marrakech, Oujda,<br />
Meknès, Rabat et Tétouan) et qui total<strong>is</strong>ent une capacité d’accueil de 3 110 stagiaires et les<br />
Instituts de Formation des Techniciens de Santé (IFTS) au nombre de 6 (Béni Mellal, Settat,<br />
Essaouira, Tiznit, Errachidia et Nador) avec une capacité de 120 places chacun.<br />
Au niveau des IFCS, les études sont organ<strong>is</strong>ées en 2 cycles :<br />
- Le 1 er cycle est destiné à la formation des Infirmiers Polyvalents, Infirmiers en<br />
Anesthésie-Réanimation, Infirmiers en Psychiatrie, Sages Femmes, Techniciens de<br />
laboratoire, Techniciens de Radiologie, Techniciens d’Hygiène du Milieu,<br />
Kinésithérapeutes, Orthoprothés<strong>is</strong>tes, Orthophon<strong>is</strong>tes, Orthopt<strong>is</strong>tes, Ass<strong>is</strong>tantes Sociales,<br />
49
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Diététiciens, Préparateurs en Pharmacie ;<br />
- Le 2 ème cycle ouvert dans les IFCS réun<strong>is</strong>sant certains critères en rapport notamment avec<br />
les possibilités d’encadrement offre deux sections de formation : Surveillants des Services<br />
de Santé et Enseignement Paramédical.<br />
Au niveau des IFTS, une seule filière de formation est instituée : infirmier auxiliaire.<br />
Pour le secteur privé, les établ<strong>is</strong>sements de formation paramédicale doivent avoir<br />
l’autor<strong>is</strong>ation du Min<strong>is</strong>tère de l’Enseignement Supérieur ou de la Formation Professionnelle<br />
pour leur création. Un av<strong>is</strong> préalable est demandé au Min<strong>is</strong>tère de la Santé. Ce dernier d<strong>is</strong>pose<br />
aussi d’un droit de regard sur le cursus au cours de la formation.<br />
Par ailleurs, le Min<strong>is</strong>tère de la Santé a signé avec certains établ<strong>is</strong>sements de formation<br />
paramédicale privés des conventions de stage pratique dans les structures dudit Min<strong>is</strong>tère au<br />
profit de leurs étudiants. Depu<strong>is</strong> 1999 à ce jour, 103 conventions ont été signées avec<br />
principalement des établ<strong>is</strong>sements spécial<strong>is</strong>és dans la formation notamment des infirmiers<br />
auxiliaires, des infirmiers polyvalents, des sages-femmes et des kinésithérapeutes.<br />
Cependant, si les établ<strong>is</strong>sements publics de formation paramédicale sont financés par le<br />
budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé, le secteur de l’enseignement paramédical privé est<br />
exclusivement financé par les paiements des personnes formées. Cependant, l’absence de<br />
mécan<strong>is</strong>mes de coordination avec ce secteur ne permet pas d’avoir plus d’information sur ce<br />
dernier.<br />
V.3. Formation continue<br />
La formation continue est une composante de la gestion stratégique des ressources humaines.<br />
Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé l’a toujours considérée comme une composante essentielle dans la<br />
réflexion pour l’amélioration des performances des ressources humaines.<br />
Dans cette perspective, le Min<strong>is</strong>tère de la Santé a m<strong>is</strong> en place dès 1990 28 , une stratégie de<br />
décentral<strong>is</strong>ation de la formation continue et a créé un service de formation continue. Il ressort<br />
du constat de la situation actuelle que les principaux dysfonctionnements et contraintes<br />
peuvent se résumer comme suit :<br />
- Absence d’outils réglementaires, la formation continue n’est pas encore institutionnal<strong>is</strong>ée ;<br />
- Faiblesse des structures chargées de la formation continue ;<br />
- Insuff<strong>is</strong>ance des ressources humaines et financières allouées à la formation continue ;<br />
- Inadaptation des approches, méthodes de formation ;<br />
- Insuff<strong>is</strong>ance de la documentation et des revues spécial<strong>is</strong>ées ;<br />
- Limitation de l’accès aux technologies de l’information ;<br />
- Absence de motivation ;<br />
- Absence d’organ<strong>is</strong>ation de formation diplômante.<br />
28 La stratégie nationale de formation continue a été rév<strong>is</strong>ée en 1999 compte tenu de l’émergence de nouvelles<br />
structures et intervenants en matière de formation continue (création de l’INAS en temps que structure de<br />
formation continue, processus de régional<strong>is</strong>ation et réforme du d<strong>is</strong>positif de formation de base avec l’apparition<br />
des IFCS leur conférant la m<strong>is</strong>sion de formation continue en sus des m<strong>is</strong>sions classiques).<br />
50
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Chapitre 2 : Pr<strong>is</strong>e en charge des personnes démunies<br />
I/ Par l’Etat<br />
L’ass<strong>is</strong>tance médicale gratuite a pendant longtemps été édifiée par des textes. Ainsi, un Dahir<br />
du 19 avril 1913 réglemente et organ<strong>is</strong>e l’activité sanitaire sur la base des principes qui<br />
prévalaient à l’époque.<br />
Le principe que « toutes les hospital<strong>is</strong>ations des civils donnent lieu au remboursement » a<br />
découlé tout naturellement du classement des malades en deux catégories : les civils solvables<br />
et les civils indigents. A cet effet, une procédure défin<strong>is</strong>sait les modalités d’adm<strong>is</strong>sion au titre<br />
de l’une ou l’autre catégorie. Les indigents étaient pr<strong>is</strong> en charge par le budget du protectorat<br />
ou par la municipalité concernée.<br />
Par la suite, une circulaire du 16 octobre 1923, m<strong>is</strong>e à jour en 1950, réglemente dans le détail<br />
l’ass<strong>is</strong>tance médicale gratuite (AMG). Elle pose comme principe que l’indigent est une<br />
personne qui ne d<strong>is</strong>pose pas de ressources suff<strong>is</strong>antes pour faire face à la maladie (et non<br />
totalement de ressources). Dans chaque ville une comm<strong>is</strong>sion d’ass<strong>is</strong>tance était instituée pour<br />
dresser la l<strong>is</strong>te des personnes résidant depu<strong>is</strong> au moins une année et pouvant prétendre à<br />
l’A.M.G. Cette comm<strong>is</strong>sion établ<strong>is</strong>sait une l<strong>is</strong>te au mo<strong>is</strong> de janvier rév<strong>is</strong>able chaque trimestre.<br />
Elle était composée du médecin directeur du bureau municipal d’hygiène, du receveur<br />
municipal, du membre de la comm<strong>is</strong>sion municipale, d’un fonctionnaire municipal secrétaire<br />
et d’une ass<strong>is</strong>tante sociale.<br />
Le Dahir du 23 juin 1960 relatif à l’organ<strong>is</strong>ation communale réaffirme la responsabilité des<br />
municipalités dans la pr<strong>is</strong>e en charge des fra<strong>is</strong> d’hospital<strong>is</strong>ation des indigents.<br />
En 1976, la charte communale marque un tournant dans l’évolution du système. A partir de<br />
cette date, tous les malades se présentant comme indigents, quel que soit leur lieu de résidence<br />
et quel que soit le type d’hôpital qui les reçoit (autonome ou en régie), bénéficient de<br />
l’ass<strong>is</strong>tance médicale gratuite et sont soignés gratuitement sur présentation d’un certificat<br />
d’indigence délivré par l’autorité locale.<br />
Dès 1995, des travaux ont eu lieu en vue de l’identification des économiquement faibles. A<br />
cet effet, des comm<strong>is</strong>sions de déc<strong>is</strong>ion au niveau des municipalités ou des cercles ont été<br />
constituées. Elles étaient chargées de statuer sur la délivrance du certificat d’indigence à partir<br />
d’un dossier comprenant les éléments suivants :<br />
• Une fiche de renseignement délivrée par l’autorité locale,<br />
• Un certificat d’imposition,<br />
• Un certificat de vie collective,<br />
• Une attestation de travail ou de salaire,<br />
• Une photocopie de la carte nationale d’identité et une quittance de loyer.<br />
Le décret n°2-99-80 du 12 hijja 1419 (30 mars 1999) a exonéré du paiement des services et<br />
prestations d<strong>is</strong>pensés ou rendus à titre externe par les hôpitaux et services relevant du<br />
Min<strong>is</strong>tère de la santé les personnes dont les capacités contributives ne leur permettent pas de<br />
supporter la totalité ou une partie des fra<strong>is</strong> des prestations.<br />
Le 21 octobre 1999, la circulaire n° 106 du 24 août 1999 du Min<strong>is</strong>tre de l’Intérieur a lancé des<br />
tests d’identification des indigents au niveau national. Elle prévoyait la délivrance<br />
d’attestations d’indigence pour six mo<strong>is</strong>. Cette tentative a perm<strong>is</strong> de confirmer le rôle<br />
51
Financement des soins de santé au Maroc<br />
important des ass<strong>is</strong>tantes sociales et leurs positions d’intermédiaires entre la population et les<br />
admin<strong>is</strong>trations.<br />
C’est donc le système de certificat d’indigence qui est la base de la pr<strong>is</strong>e en charge médicale<br />
des pauvres dans les hôpitaux publics. Le véritable problème n’est donc pas l’absence totale<br />
d’un d<strong>is</strong>positif de pr<strong>is</strong>e en charge des économiquement faibles, ma<strong>is</strong> surtout l’inadaptation<br />
devenue structurelle de ce dernier. En effet, ce mécan<strong>is</strong>me d’identification des personnes<br />
démunies, basée actuellement sur le certificat d’indigence, comporte de multiples<br />
dysfonctionnements et inadaptations, ce qui a affecte la pertinence et l’efficacité sociale de ce<br />
système. Selon le rapport d’étape de l’une des comm<strong>is</strong>sions chargé de la m<strong>is</strong>e en œuvre du<br />
RAMED :<br />
• la conception actuelle de la gratuité des soins est désuète et inefficace comme le<br />
témoigne l’Enquête Nationale sur le Niveau de Vie des Ménages (ENNVM) effectuée<br />
par la Direction de la Stat<strong>is</strong>tique (1991) qui a démontré que :<br />
o 59% des ménages à revenu élevé ne paient pas les fra<strong>is</strong> d’hospital<strong>is</strong>ation ;<br />
o 24% des ménages à revenu faible paient quand même les fra<strong>is</strong> de soins.<br />
• Les 30% les plus riches de la population bénéficient de presque 56% de l’argent public<br />
qui finance les hôpitaux, alors que les 30% les plus pauvres n’en reçoivent que moins<br />
de 13,5%. La situation est encore plus grave pour les pauvres du milieu rural qui<br />
représentent 24,1% de la population totale du pays et qui ne reçoivent que 7,4% de ce<br />
financement, (selon l’étude sur les dépenses publiques menée par la Banque mondiale<br />
en septembre 1994).<br />
• En ne prenant en considération que les ménages non couverts par une assurance<br />
maladie, on constate que 67% des services d<strong>is</strong>pensés gratuitement par les hôpitaux<br />
publics bénéficient aux 20% de la population la plus a<strong>is</strong>ée contre 5% seulement aux<br />
20% les moins nant<strong>is</strong>.<br />
• Les critères d’éligibilité ne sont pas standard<strong>is</strong>és et demeurent subjectifs : l’attribution<br />
du certificat dépend d’une ou deux responsables locaux. Le mécan<strong>is</strong>me d’octroi dudit<br />
certificat ouvre la voie à des pratiques parfo<strong>is</strong> malsaines privant quelques fo<strong>is</strong> les<br />
véritables économiquement faibles de ce droit qui est attribué injustement dans<br />
certains cas à des personnes nanties.<br />
• La lourde bureaucratie empêche les pauvres d’avoir très rapidement le certificat<br />
d’indigence : une fo<strong>is</strong> ce certificat obtenu, il ne peut servir qu’une seule fo<strong>is</strong>. Si le<br />
bénéficiaire a besoin de deux services différents dans deux structures séparées, il doit<br />
faire prévaloir à chaque fo<strong>is</strong> son éligibilité à la pr<strong>is</strong>e en charge gratuite par un certificat<br />
original.<br />
• L’accès difficile aux soins : les personnes bénéficiaires du certificat d’indigence<br />
sub<strong>is</strong>sent les longs déla<strong>is</strong> de rendez-vous et quelques fo<strong>is</strong> la d<strong>is</strong>crimination au sein des<br />
hôpitaux publics, particulièrement pour des services rares et/ou très demandés.<br />
• La non séparation entre le budget des hôpitaux et l’enveloppe consacrée à la pr<strong>is</strong>e en<br />
charge médicale des indigents : cette situation engendre un manque à gagner pour<br />
l’hôpital et crée un certain flou autour de son budget qui ne peut être négocié dans de<br />
bonnes conditions avec le Min<strong>is</strong>tère Chargé des Finances. Par conséquent, l’hôpital<br />
devant garantir des prestations de soins fait office également d’institution d’ass<strong>is</strong>tance<br />
sans les moyens adéquats pour le faire et sans qu’on ne lui reconna<strong>is</strong>se cette fonction.<br />
52
Financement des soins de santé au Maroc<br />
• L’admin<strong>is</strong>tration qui délivre les certificats, qui sont des autor<strong>is</strong>ations de soins, n’est<br />
pas responsable du financement de ces soins pour lesquelles elle fait office<br />
d’ordonnateur de les dépenses à la charge d’un autre département.<br />
II/ A travers des mutuelles communautaires<br />
Les mutuelles communautaires sont définies par la Banque Mondiale comme des « régimes<br />
de prépaiement des soins de santé à but non lucratif, à adhésion volontaire, et sur lesquels<br />
s’exerce le contrôle de la communauté » 29 .<br />
En effet, dans certaines régions, comme en Afrique de l’Ouest, ou encore en Asie du Sud, cet<br />
instrument est un mécan<strong>is</strong>me courant de prépaiement des fra<strong>is</strong> de santé.<br />
Au Maroc, les mutuelles communautaires ont été créée à partir de 2002, après sensibil<strong>is</strong>ation<br />
et évaluation des besoins par les autorités. Il ne s’agit pas d’une initiative des populations. A<br />
titre d’exemple, la mutuelle de Tabant (à la province d’Azilal) a été créée dans le cadre du<br />
programme des Besoins Essentiels de Développement (BED) mené par le Min<strong>is</strong>tère de la<br />
Santé. Celles de Bâb Taza, Bni Darkoul et Bni Salah (Chefchaouen) s’inscrivent dans la<br />
continuité d’une expérience soutenue par l’UNICEF.<br />
A l’exception de la mutuelle de Tabant où environ un quart des ménages de la commune y<br />
adhère, le taux d’adhésion des ménages des autres communes est très faibles ; il ne dépasse<br />
pas les 15% voir même 1%.<br />
Les mutuelles communautaires de santé sont un mécan<strong>is</strong>me de solidarité au niveau local,<br />
ciblant les populations vulnérables. Concrètement, les populations s’organ<strong>is</strong>ent pour fixer des<br />
cot<strong>is</strong>ations ainsi qu’un panier de soins auquel elles donnent droit, pour collecter ces<br />
cot<strong>is</strong>ations et pour payer les prestataires.<br />
Le panier de soins pr<strong>is</strong> en charge est composé des médicaments prescrits par le médecin du<br />
centre de santé et du transfert vers un hôpital de référence. La mutuelle de Bâb Taza, Bni<br />
Darkoul et Bni Salah prend en charge également les médicaments pour le traitement de deux<br />
maladies chroniques (Diabète et Hypertension artérielle).<br />
Les sources de financement des mutuelles sont composées essentiellement des cot<strong>is</strong>ations des<br />
adhérents. Celles-ci varient de 150 à 200 DHS par famille et par an. Certaines mutuelles<br />
bénéficient aussi d’une aide des communes. Il est à noter que toutes les mutuelles ont un solde<br />
positif allant jusqu’à 150 000 DHS. Ces ressources sont allouées au remboursement des<br />
médicaments à ra<strong>is</strong>on de 70%.<br />
Au Maroc, les mutuelles communautaires sont actuellement expérimentées sur 10 sites,<br />
regroupant 25 communes dans 8 provinces dont Bâb Taza, Bni Salah, Bni Darkoul et Zoumi<br />
dans la province de Chefchaouen, Tabant, Aït M’hammed et Aït Abbas dans la province<br />
d’Azilal, Ourika dans la province d’El Haouz, Souk Sabt Jahjouh dans la province d’El<br />
Hajeb. Seulement, ces expériences sont encore bien trop peu développées pour permettre de<br />
d<strong>is</strong>poser de suff<strong>is</strong>amment de recul pour une évaluation.<br />
Seulement, ces expériences ne sont pas initiées dans un cadre unifié et ne sont pas menées<br />
dans une démarche stratégique de réponse aux besoins des populations en matière de<br />
financement de la santé. Il s’agit de tentatives ponctuelles pour répondre localement à un<br />
besoin qui a principalement trait au médicament.<br />
Ces premières expériences, menées par le Min<strong>is</strong>tère de la Santé avec, entre autre, le soutien de<br />
l’OMS, de l’UNICEF et du FNUAP présentent plusieurs points forts :<br />
29 Gotteret P, Schieber G, <strong>Health</strong> <strong>Financing</strong> Rev<strong>is</strong>ited, World Bank/The International Bank for Reconstruction<br />
and Development, 2006.<br />
53
Financement des soins de santé au Maroc<br />
• La fa<strong>is</strong>abilité démontrée ;<br />
• L’accessibilité des soins améliorée ;<br />
• La simplicité de la m<strong>is</strong>e en œuvre ;<br />
• La mobil<strong>is</strong>ation communautaire autour des projets ;<br />
• Les taux d’adhésion encourageants ;<br />
• L’implication de multiples partenaires.<br />
Cependant, elles présentent aussi des points faibles, parmi lesquels :<br />
• Le manque de coordination entre les acteurs ;<br />
• Le manque de documentation de l’expérience ;<br />
• L’unicité du modèle ;<br />
• Le panier de soin peu attractif.<br />
Ces premières expérimentations ont perm<strong>is</strong> de situer les mutuelles communautaires<br />
marocaines dans une grille, comme le montre le tableau ci-dessous.<br />
Tableau 5 : Contribution des mutuelles communautaires marocaines aux objectifs de la<br />
grille d’analyse d’Alain Letourmy et Aude Pavy-Letourmy<br />
Volet<br />
techn<br />
ique<br />
Volet<br />
straté<br />
gique<br />
Dimension<br />
concernée<br />
Population v<strong>is</strong>ée<br />
Garanties<br />
proposées<br />
Mode<br />
d’organ<strong>is</strong>ation<br />
Fonctionnement<br />
du secteur des<br />
soins de santé<br />
Contribution à<br />
l’extension de la<br />
protection sociale<br />
Participation à la<br />
lutte contre la<br />
pauvreté<br />
Promotion de la<br />
démocratie<br />
Contribution des mutuelles communautaires marocaines<br />
Les mutuelles communautaires marocaines v<strong>is</strong>ent une population<br />
vulnérable, non couverte, ou partiellement couverte, par la CMB.<br />
Les mutuelles communautaires marocaines couvrent actuellement<br />
le petit r<strong>is</strong>que (médicaments, transferts sanitaires). Cette<br />
couverture est pour certains sites en cours d’extension à d’autres<br />
prestations (analyses, consultations spécial<strong>is</strong>ées…), ma<strong>is</strong> ne<br />
concerne pas le gros r<strong>is</strong>que.<br />
Les mutuelles communautaires marocaines sont organ<strong>is</strong>ées en<br />
association selon le dahir de 1953. Elles sont donc gérées par un<br />
bureau élu lors de l’Assemblée Générale.<br />
Cet objectif est indirectement v<strong>is</strong>é par les mutuelles<br />
communautaires marocaines, car les prestations couvertes sont<br />
fournies par le secteur public, et les mutuelles ne d<strong>is</strong>posent pas<br />
d’une masse critique pour influer sur ces prestataires.<br />
Les mutuelles communautaires marocaines v<strong>is</strong>ent à compléter la<br />
CMB, et l’extension de la protection sociale est donc leur<br />
principal objectif.<br />
Les mutuelles communautaires marocaines v<strong>is</strong>ent à réduire la<br />
vulnérabilité, et par là même elles v<strong>is</strong>ent à réduire la pauvreté,<br />
dans le cadre de l’INDH.<br />
Objectif non v<strong>is</strong>é par les mutuelles communautaires marocaines.<br />
Extension du<br />
marché de Objectif non v<strong>is</strong>é par les mutuelles communautaires marocaines.<br />
l’assurance<br />
Source : Grille d’analyse d’Alain Letourmy et Aude Pavy-Letourmy<br />
La poursuite de l’expérimentation de mutuelles communautaires de santé au Maroc nécessite<br />
donc la définition d’un référentiel auquel pourront se rapporter les différents acteurs. C’est<br />
pourquoi, avec l’appui de l’OMS, le Min<strong>is</strong>tère de la Santé, expérimente actuellement cet outil<br />
54
Financement des soins de santé au Maroc<br />
de manière plus structurée, afin de déterminer exactement quelle pourrait être sa contribution<br />
à la couverture médicale de base.<br />
Parmi les quatre sites où l’OMS intervient, celui de Tabant, qui a démarré en 2005, est le plus<br />
ancien. Le panier de soins couvert comprend les médicaments essentiels prescrits par le<br />
médecin du centre de santé, ainsi que les évacuations sanitaires vers l’hôpital provincial de<br />
référence, et ce pour une cot<strong>is</strong>ation de 200 DH par famille et par an. Aujourd’hui, le Min<strong>is</strong>tère<br />
de la Santé, l’OMS et le FNUAP travaillent à l’élarg<strong>is</strong>sement de ce panier de soins, de<br />
manière à mieux répondre aux attentes de la population de Tabant. Sur le site de Souk Sabt<br />
Jahjouh, dans la province d’El Hajeb, les activités de la mutuelle viennent à peine de<br />
commencer. Dans les provinces d’El Jadida, où une mutuelle couvrira tro<strong>is</strong> communes, et de<br />
Taounate, où une autre en couvrira deux, la phase préliminaire est en cours, et l’accent est m<strong>is</strong><br />
sur la participation communautaire.<br />
D’autre part, l’OMS a en juin 2006 effectué une étude financière pour évaluer la fa<strong>is</strong>abilité de<br />
l’extension du panier de soins à 4 types de prestations délivrées à l’hôpital provincial<br />
d’Azilal, à savoir :<br />
• Les accouchements avec complication qui ne peuvent pas être pratiqués à la ma<strong>is</strong>on<br />
d’accouchement du centre de santé ;<br />
• Les consultations spécial<strong>is</strong>ées ;<br />
• Les consultations d’urgence ;<br />
• Les analyses biologiques.<br />
Compte tenu des réserves dont d<strong>is</strong>pose l’association, des taux d’util<strong>is</strong>ation par la population<br />
de Tabant des prestations identifiées, et du prix actuel de la cot<strong>is</strong>ation, l’étude financière a<br />
conclu à la fa<strong>is</strong>abilité de l’intégration des 4 prestations dans le panier de soins.<br />
Chapitre 3 : Régimes de couverture médicale<br />
Section I : H<strong>is</strong>torique<br />
Le Maroc ne conna<strong>is</strong>sait pas, jusqu’au 18 août 2005, de régime d'assurance maladie<br />
obligatoire ma<strong>is</strong> un certain nombre d'organ<strong>is</strong>mes (sociétés mutual<strong>is</strong>tes, ca<strong>is</strong>ses internes et<br />
entrepr<strong>is</strong>es d'assurances) offraient une assurance facultative, sous forme de remboursement de<br />
dépenses de santé.<br />
I.1. Le secteur mutual<strong>is</strong>te<br />
Les sociétés mutual<strong>is</strong>tes ont pour objet de mener, en faveur de leurs adhérents et de leurs<br />
familles, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide tendant à la couverture des<br />
r<strong>is</strong>ques pouvant atteindre la personne humaine. Cet objet très large a été ramené dans la<br />
pratique au r<strong>is</strong>que maladie et aux charges de maternité encourues pour les assurés et leurs<br />
familles.<br />
Elles sont des groupements de droit privé à but non lucratif, régies par le Dahir n° 1.57.187 du<br />
12 Novembre 1963 portant statut de la mutualité, qui a institué le cadre juridique de la<br />
mutualité marocaine.<br />
Elles assuraient la couverture médicale de base et complémentaire à environ 2,5 millions de<br />
bénéficiaires et regroupent environ 1 000 000 d'adhérents. Les mutuelles créées par les<br />
personnels du secteur public sont regroupées dans une union dénommée « Ca<strong>is</strong>se Nationale<br />
des Organ<strong>is</strong>mes de Prévoyance Sociale (C.N.O.P.S) », créée le 14 janvier 1950, dont le rôle<br />
est la gestion des activités communes à l’ensemble des sociétés mutual<strong>is</strong>tes qui la composent.<br />
L'avènement de la mutualité au Maroc est ancien. En effet, sous le protectorat, tro<strong>is</strong> mutuelles<br />
de service ont vu le jour (la Mutuelle de Police en 1919, la Mutuelle des Douanes en 1928, la<br />
55
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Mutuelle des Poste, Téléphone et Télécommunication en 1946). Deux autres mutuelles à<br />
caractère général (Œuvres de Mutualité des Fonctionnaires et Agents Assimilés du Maroc -<br />
OMFAM en 1929 et la Mutuelles Générale des Personnels des Admin<strong>is</strong>trations Publiques -<br />
MGPAP en 1946) ont également été fondées.<br />
Après l'Indépendance, le mouvement mutual<strong>is</strong>te dans le secteur public a été renforcé par la<br />
création d'autres sociétés mutual<strong>is</strong>tes (Exemple : la mutuelle des Forces Armées Royales -<br />
MFAR en 1958 qui s'est retirée de la CNOPS en 1999, la Mutuelle Générale de l'Education<br />
Nationale -MGEN en 1963, la mutuelle des Forces auxiliaires -MFA en 1976, la Mutuelle du<br />
Personnel de l'Office d'Exploitation des Ports - MODEP en 1996).<br />
Les sociétés mutual<strong>is</strong>tes et la CNOPS ont joué un rôle moteur dans le domaine de l'économie<br />
sociale et ce, pendant plusieurs décennies.<br />
En effet, la population qui bénéficiait d'une assurance maladie est estimée à 16% de la<br />
population marocaine, dont 75% des bénéficiaires appartiennent aux mutuelles couvrant des<br />
agents de l'Etat, des collectivités locales et des établ<strong>is</strong>sements publics ainsi que leurs familles.<br />
Ces mutuelles remboursent convenablement l'hospital<strong>is</strong>ation dans les structures de soins du<br />
secteur privé et du secteur mutual<strong>is</strong>te, fort bien les produits pharmaceutiques et très mal la<br />
médecine de ville.<br />
Le secteur de la mutualité est constitué de tro<strong>is</strong> types d'institutions mutual<strong>is</strong>tes :<br />
I.1.1 Les sociétés mutual<strong>is</strong>tes des personnels du secteur public et leur union la CNOPS :<br />
La CNOPS gérait, pour le compte des sociétés mutual<strong>is</strong>tes, une assurance de base dite<br />
« secteur commun » et chaque société offre une assurance complémentaire.<br />
Le secteur commun effectuait le remboursement des dépenses de soins (maladie et maternité),<br />
avec un ticket modérateur sur la base des prix officiels des produits pharmaceutiques (PPM)<br />
et sur la base de tarifs de responsabilité pour les soins.<br />
Le secteur commun était financé par une cot<strong>is</strong>ation salariale de 2,5% du traitement de base<br />
(hors primes) plafonnée à 1.000 Dirhams par an et par une cot<strong>is</strong>ation patronale de 3,5% (dont<br />
1% en tant que participation aux fra<strong>is</strong> de gestion).<br />
Depu<strong>is</strong> l'entrée en vigueur de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base,<br />
la CNOPS gère l'Assurance Maladie Obligatoire au profit des agents actifs et retraités du<br />
secteur public. Les mutuelles, quant à elles, gèrent à la fo<strong>is</strong> les soins ambulatoires de<br />
l'Assurance Maladie Obligatoire de Base pour le compte de la CNOPS et elles continuent de<br />
prendre en charge la couverture médicale complémentaire.<br />
I.1.2. Les mutuelles d’entrepr<strong>is</strong>es du secteur privé dont la plus importante est la Ca<strong>is</strong>se<br />
Mutual<strong>is</strong>te Interprofessionnelle Marocaine (C.M.I.M). Ces mutuelles versent des prestations<br />
d'assurance maladie-maternité en contrepartie d'une cot<strong>is</strong>ation pr<strong>is</strong>e en charge par les salariés<br />
et les employeurs.<br />
I.1.3. Les mutuelles et les ca<strong>is</strong>ses internes créées par certains établ<strong>is</strong>sements publics :<br />
Il s'agit de mutuelles et ca<strong>is</strong>ses internes propres aux personnels de grandes entrepr<strong>is</strong>es<br />
publiques qui remboursent les dépenses de soins en cas de maladie - maternité. Certaines<br />
mutuelles gèrent même des structures de soins (d<strong>is</strong>pensaires et cliniques).<br />
Leur financement est assuré par une cot<strong>is</strong>ation salariale et une contribution patronale, variable<br />
suivant les mutuelles ma<strong>is</strong> le financement par l'employeur est important car souvent les<br />
employeurs octroient des subventions d’équilibre à ces mutuelles.<br />
I.2. Le secteur des assurances<br />
56
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Les entrepr<strong>is</strong>es d'assurances et de réassurance dont quelques unes sont à forme mutuelle,<br />
proposent des contrats individuels ou de groupe destinés à fournir des prestations en cas de<br />
maladie -maternité de base et/ou complémentaire. Ces contrats sont à configuration variable et<br />
les cot<strong>is</strong>ations dépendent du niveau de la couverture retenue par les souscripteurs de contrats.<br />
Ces entrepr<strong>is</strong>es qui s'efforcent de prendre en charge les dépenses exposées par leurs assurés<br />
sur la base des factures réelles, négocient leurs contrats avec les souscripteurs, parallèlement à<br />
d’autres contrats d'assurances dommages ainsi qu'aux contrats d'accidents de travail et<br />
maladies professionnelles. Ainsi, le r<strong>is</strong>que maladie constitue en fait un produit d’appel dont le<br />
déficit fréquent est résorbé par les bénéfices des autres assurances.<br />
Section II : Etat des lieux<br />
Dans le domaine de la santé, le Maroc s’est lancé dans une réforme de son système de soins<br />
de santé qui v<strong>is</strong>e à renforcer la qualité des soins et à garantir l’accès à l’ensemble de la<br />
population.<br />
L’assurance maladie est le résultat d'une longue évolution qui présente à ce jour des<br />
caractér<strong>is</strong>tiques d<strong>is</strong>tinctes importantes quant au mandat des organ<strong>is</strong>mes gestionnaires, aux<br />
particularités institutionnelles, aux caractér<strong>is</strong>tiques de la couverture et, enfin quant à son<br />
financement.<br />
II.1. L’assurance maladie obligatoire de base (AMO)<br />
Le Maroc a fait le choix de la général<strong>is</strong>ation de la couverture médicale de base dont le premier<br />
acte est l'Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO) au profit des salariés actifs et<br />
pensionnés des secteurs public et privé avec deux organ<strong>is</strong>mes gestionnaires : la Ca<strong>is</strong>se<br />
Nationale des Organ<strong>is</strong>mes de Prévoyance Sociale (CNOPS) pour le régime des fonctionnaires<br />
et agents du secteur public et la Ca<strong>is</strong>se nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour les salariés<br />
du secteur privé et un organ<strong>is</strong>me de régulation : l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie<br />
(ANAM).<br />
L'entrée en vigueur de l'Assurance Maladie Obligatoire de base, le 18 août 2005, a eu perm<strong>is</strong><br />
à une large frange de la population, qui n'avait accès à aucun régime d'assurance maladie, de<br />
bénéficier d'une couverture médicale.<br />
De ce fait, il est attendu qu’à court terme, l'Assurance Maladie Obligatoire de base gérée par<br />
la CNOPS (secteur public) et la CNSS (secteur privé), ainsi que les autres couvertures<br />
médicales ex<strong>is</strong>tantes portent la population des salariés couverte de 16% à 34%.<br />
La loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par dahir n° 1-02-<br />
296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) constitue un d<strong>is</strong>positif juridique cadre du secteur de<br />
l'assurance sociale en matière de santé.<br />
Le préambule de cette loi exprime bien les intentions du lég<strong>is</strong>lateur quant à l'assurance<br />
maladie et à la situation de la population marocaine à cet égard, que ce soit à court terme ou à<br />
long terme.<br />
Outre la reconna<strong>is</strong>sance du droit à la santé, la loi v<strong>is</strong>e à assurer à la population un accès égal<br />
et équitable aux soins, consolide les droits acqu<strong>is</strong> par les personnes bénéficiant d'une<br />
assurance maladie avant l’entrée en vigueur de cette loi.<br />
Les principes de la loi sont préc<strong>is</strong>és par les articles 1 à 4 qui déterminent les populations<br />
couvertes par l'AMO et le RAMED ainsi que les autres catégories de personnes qui seront<br />
ultérieurement couvertes par des régimes encadrés par des lég<strong>is</strong>lations particulières.<br />
57
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Toute d<strong>is</strong>crimination du r<strong>is</strong>que maladie fondée sur l'âge, le sexe, le revenu, la zone de<br />
résidence ou les antécédents médicaux est interdite formellement (article 1-dernier alinéa et<br />
les articles 41 et 42).<br />
L’obligation d’affiliation incombe aux employeurs en ce qui concerne les salariés en activité<br />
et aux régimes de retraite en ce qui concerne les titulaires de pensions.<br />
Les employeurs désirant maintenir la couverture facultative qu’ils assuraient à leurs salariés<br />
avant l’entrée en vigueur de l’AMO, doivent fournir annuellement à l’organ<strong>is</strong>me gestionnaire<br />
dont ils relèvent l’attestation justifiant cette couverture. Cependant, les entrepr<strong>is</strong>es<br />
nouvellement créées après le 17 août 2005, sont assujetties de plein droit au régime<br />
d’assurance maladie obligatoire de base.<br />
La loi 65-00 précitée permet le maintien des prestations, au profit de la famille pendant six (6)<br />
mo<strong>is</strong> en cas de cessation d’activité de l’assuré, au profit du conjoint pendant douze (12) mo<strong>is</strong><br />
en cas de d<strong>is</strong>solution du lien de mariage et pendant vingt quatre (24) mo<strong>is</strong> pour le conjoint<br />
survivant et les enfants en cas de décès de l’assuré.<br />
En cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou<br />
particulièrement coûteux, la part restant à la charge de l'assuré ne peut être supérieure à 10%<br />
de la tarification nationale de référence (TNR) pour ces maladies et l'exonération de la part<br />
restant à la charge de l'assuré est totale pour les soins coûteux.<br />
Les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires appliquent comme base de remboursement, les tarifs des<br />
prestations déterminés aux conventions qu'ils ont signées avec les différents producteurs de<br />
soins, selon la nature des soins et selon le type de producteurs de soins. Les principaux<br />
producteurs de soins conventionnés avec ces organ<strong>is</strong>mes d<strong>is</strong>posent ainsi de grilles tarifaires<br />
propres à chaque catégorie de prestations. Les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires d<strong>is</strong>posent d’un délai<br />
de tro<strong>is</strong> mo<strong>is</strong> pour rembourser les assurés et six mo<strong>is</strong> pour payer les prestataires de soins.<br />
Pour assurer la pérennité et la viabilité financière du régime dans sa globalité, des mesures<br />
d’accompagnement portant sur l'optim<strong>is</strong>ation, la régulation et la maîtr<strong>is</strong>e des dépenses de<br />
santé ont été pr<strong>is</strong>es, notamment :<br />
- l’adoption d’une l<strong>is</strong>te des médicaments adm<strong>is</strong> au remboursement fixée par l’arrêté du<br />
min<strong>is</strong>tre de la Santé n° 2517-05 du 5 septembre 2005, sur la base du critère du service<br />
médical rendu avec leur adossement aux médicaments dits "génériques" lorsqu’ils<br />
ex<strong>is</strong>tent. Au démarrage, 1001 médicaments étaient adm<strong>is</strong> au remboursement. Cette<br />
l<strong>is</strong>te est passée à 1103 médicaments dans un deuxième temps pu<strong>is</strong> à 1650<br />
médicaments adm<strong>is</strong> au remboursement ;<br />
- l’adoption d’une l<strong>is</strong>te des ALD et ALC fixée par arrêté du min<strong>is</strong>tre de la santé n°<br />
2518-05 du 5 septembre 2005 ;<br />
- l’organ<strong>is</strong>ation par les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires de l’AMO de services chargé du<br />
contrôle médical ;<br />
- la conclusion de conventions de tarification avec les prestataires de soins publics et<br />
privés.<br />
II.1.1. Le régime d'assurance maladie obligatoire de base géré par la CNOPS<br />
Depu<strong>is</strong> l’entrée en vigueur de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base<br />
le 18 août 2005, la CNOPS gère l’assurance maladie obligatoire au profit des agents actifs et<br />
pensionnés du secteur public. Les mutuelles la composant, quant à elles, continuent de gérer<br />
le régime complémentaire qui n’a subi aucun changement.<br />
58
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Le statut de la CNOPS :<br />
La CNOPS, instituée en qualité d'union de sociétés mutual<strong>is</strong>tes du secteur public, est un<br />
organ<strong>is</strong>me de droit privé qui trouve son ex<strong>is</strong>tence légale dans le Dahir n° 1-57-187 du 12<br />
novembre 1963 portant statut de la mutualité.<br />
Elle reste régie par les d<strong>is</strong>positions dudit dahir, pour les d<strong>is</strong>positions qui ne sont pas en<br />
contradiction avec celles de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base.<br />
La population couverte :<br />
Le régime d'assurance maladie obligatoire de base (AMO) que gère la CNOPS concerne une<br />
population d'adhérents constitués des fonctionnaires de l'Admin<strong>is</strong>tration et des agents des<br />
établ<strong>is</strong>sements publics et des collectivités locales, qu’ils soient actifs ou pensionnés.<br />
Il couvre l’assuré et les membres de sa famille à sa charge (à condition qu'ils ne soient pas<br />
bénéficiaires à titre personnel d'une assurance de même nature), à savoir :<br />
• Le (les) conjoint (s) de l’assuré ;<br />
• Leurs enfants à charge âgés de 21 ans au plus ;<br />
• Leurs enfants à charge non mariés âgés de 26 ans au plus et poursuivant des études<br />
supérieures ;<br />
• Leurs enfants handicapés à charge, sans limite d’âge.<br />
Cette population est estimée à 3,372 millions de personnes bénéficiaires des prestations du<br />
régime, répartie comme suit :<br />
Tableau 6 : Population couverte par la CNOPS en 2006<br />
Actifs Pensionnés Total<br />
Assurés 942 414 215 385 1 158 799<br />
Ayants droit 1 790 937 423 593 2 214 530<br />
Total bénéficiaires 2 733 351 638 978 3 372 329<br />
Source : CNOPS<br />
Les cot<strong>is</strong>ations :<br />
Les cot<strong>is</strong>ations sont basées sur une assiette et un taux :<br />
Assiette de cot<strong>is</strong>ation :<br />
Pour un assuré en activité, l’assiette est le salaire brut déduction faite des allocations<br />
familiales.<br />
Pour un titulaire de pension (s), l’assiette est déterminée sur le montant global des pensions de<br />
base dont il bénéficie.<br />
Le taux de cot<strong>is</strong>ation :<br />
Pour un assuré en activité, le taux de cot<strong>is</strong>ation global est de 5% de l’assiette selon un partage<br />
à parts égales entre l’employeur (Etat, collectivité locale et établ<strong>is</strong>sement public) et les<br />
fonctionnaires ou agents.<br />
Le bénéficiaire de pension (s) supporte un prélèvement de 2,50 % de l’ensemble des pensions<br />
de base. Les ca<strong>is</strong>ses gérant les régimes servant ces pensions sont responsables du précompte à<br />
la source de ces prélèvements et de leurs versements à la CNOPS.<br />
59
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Le seuil minimal des cot<strong>is</strong>ations est de 70 DHS. Le seuil maximal est de 400 DHS. Si après<br />
déduction des allocations familiales et application du taux de cot<strong>is</strong>ation (2,5%), le montant dû<br />
à la CNOPS est inférieur à 70 DHS, il est ramené à ce seuil. Si le montant dû dépasse 400<br />
DHS, il est aligné sur ce plafond.<br />
En cas d’occupation de deux ou plusieurs fonctions ou perception de deux ou plusieurs<br />
pensions de base, chaque employeur ou régime de pensions doit verser la cot<strong>is</strong>ation<br />
correspondant à la rémunération ou la pension qu’il sert.<br />
L’employeur est responsable du paiement de la cot<strong>is</strong>ation globale. S’il cesse de payer pendant<br />
six mo<strong>is</strong>, l’assuré perd le bénéfice de la couverture médicale.<br />
Les biens et services assurés (le panier de soins) :<br />
Le panier de soins couvert par l’AMO est fixé par l'article 7 de la loi n° 65-00 portant code de<br />
la couverture médicale de base. Il comprend l'ensemble des services et des biens dits curatifs<br />
et de réadaptation et des soins préventifs, que les prestations soient servies en ambulatoire ou<br />
en hospital<strong>is</strong>ation. Les soins à l'étranger adm<strong>is</strong>sibles sont ceux qui ne sont pas d<strong>is</strong>ponibles au<br />
Maroc.<br />
Le panier de soins pr<strong>is</strong> en charge par la CNOPS comprend l’ensemble des prestations prévues<br />
par la loi n° 65-00, à savoir :<br />
• Les soins préventifs et curatifs, liés aux programmes prioritaires entrant dans le<br />
cadre de la politique sanitaire de l’Etat ;<br />
• Les actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;<br />
• Les soins relatifs au suivi de la grossesse, à l’accouchement et ses suites ;<br />
• Les soins liés à l’hospital<strong>is</strong>ation et aux interventions chirurgicales, y compr<strong>is</strong><br />
les actes de chirurgie réparatrice ;<br />
• Les analyses de biologie médicale ;<br />
• La radiologie et imagerie médicale ;<br />
• Les explorations fonctionnelles ;<br />
• Les médicaments adm<strong>is</strong> au remboursement ;<br />
• Les poches de sang humains et dérivés sanguins ;<br />
• Les d<strong>is</strong>positifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux<br />
et chirurgicaux, compte tenu de la nature de la maladie ou de l’accident et du<br />
type de d<strong>is</strong>positif ou d’implants ;<br />
• Les appareils de prothèse ou d’orthèse médicale adm<strong>is</strong> au remboursement ;<br />
• La lunetterie médicale ;<br />
• Les soins bucco-dentaires ;<br />
• L’orthodontie pour les enfants ;<br />
• Les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;<br />
• Les actes paramédicaux.<br />
Le panier de soins ne comprend pas : Les interventions de chirurgie esthétique, les cures<br />
thermales, l'acupuncture, la mésothérapie, la thalassothérapie, l'homéopathie et les prestations<br />
d<strong>is</strong>pensées dans le cadre de la médecine dite douce.<br />
L’AMO n'assure pas les soins esthétiques, les soins aux accidentés de la route, ni les soins<br />
reliés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.<br />
Tous les soins couverts donnent droit au remboursement ou éventuellement à une pr<strong>is</strong>e en<br />
charge directe par la CNOPS.<br />
60
Financement des soins de santé au Maroc<br />
La couverture est répartie entre :<br />
• le tiers - payant : pr<strong>is</strong>e en charge des fra<strong>is</strong> directement par la CNOPS et paiement des<br />
prestataires de soins dans le cadre de conventions de tiers payant, selon les taux et<br />
forfaits qui y sont fixés ;<br />
• les soins ambulatoires : remboursement aux assurés d’un pourcentage des fra<strong>is</strong><br />
engagés, sur la base d’une tarification nationale de référence.<br />
Le taux de couverture :<br />
Les taux de couverture des prestations sont fixés par groupes de prestations comme suit :<br />
• Actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales, actes<br />
paramédicaux, de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie délivrés à titre<br />
ambulatoire hors médicaments : 80% de la tarification nationale de référence ;<br />
• Soins liés à l'hospital<strong>is</strong>ation et aux interventions chirurgicales y compr<strong>is</strong> les actes de<br />
chirurgie réparatrice et le sang et ses dérivés labiles : 90% de la tarification<br />
nationale de référence. Ce taux est porté à 100% lorsque les prestations sont rendues<br />
dans les hôpitaux publics, les établ<strong>is</strong>sements publics de santé et les services<br />
sanitaires relevant de l'Etat ;<br />
• Médicaments adm<strong>is</strong> au remboursement : 70 % du prix public Maroc sur la base du<br />
prix du générique lorsqu’il ex<strong>is</strong>te ;<br />
• Lunetterie médicale, d<strong>is</strong>positifs médicaux et implants nécessaires aux actes<br />
médicaux et chirurgicaux : forfaits fixés dans la tarification nationale de référence ;<br />
• Appareils de prothèse et d'orthèse médicales adm<strong>is</strong> au remboursement : forfaits fixés<br />
dans la tarification nationale de référence ;<br />
• Soins bucco-dentaires : 80% de la tarification nationale de référence ;<br />
• Orthodontie médicalement requ<strong>is</strong>e pour les enfants : forfait fixé dans la tarification<br />
nationale de référence.<br />
L'entrée en vigueur de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base a constitué<br />
une opportunité pour les mutuelles adhérentes à la CNOPS de capital<strong>is</strong>er davantage leurs<br />
acqu<strong>is</strong> et leurs expériences, sachant que la CNOPS leur a délégué la gestion des soins<br />
ambulatoires couverts dans le cadre de l’AMO, dans le respect de critères prédéfin<strong>is</strong> par la<br />
convention conclue entre elles.<br />
Ces mutuelles adhérentes à la CNOPS continuent à assurer une couverture complémentaire.<br />
II.1.2. Le régime d'assurance maladie obligatoire de base géré par la CNSS<br />
Depu<strong>is</strong> l’entrée en vigueur de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base<br />
le 18 août 2005, la CNSS gère l’assurance maladie obligatoire au profit des salariés actifs et<br />
pensionnés du secteur privé.<br />
Statut de la CNSS :<br />
La CNSS créée en 1959, en tant qu’établ<strong>is</strong>sement public sous la tutelle du Min<strong>is</strong>tère chargé de<br />
l’Emploi, est une ca<strong>is</strong>se qui gère le régime de sécurité sociale couvrant les salariés des<br />
entrepr<strong>is</strong>es du secteur privé.<br />
Dans ce cadre, elle assure les prestations suivantes :<br />
- Prestations à long terme<br />
- Prestations à court terme<br />
- Allocations familiales<br />
61
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Et depu<strong>is</strong> le 18 août 2005, la CNSS s’est vue son rôle se renforcer dans la protection sociale<br />
des travailleurs du secteur privé, par la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base<br />
(AMO) au profit de ces travailleurs.<br />
La population couverte :<br />
L’assurance maladie obligatoire de base gérée par la CNSS concerne :<br />
• Les salariés assujett<strong>is</strong> au régime de sécurité sociale ;<br />
• Les titulaires de pensions dont le montant est supérieur ou égal à 500 DHS par mo<strong>is</strong> ;<br />
• Les assurés volontaires ;<br />
• Les marins pêcheurs à la part.<br />
Elle couvre l’assuré et les membres de sa famille à sa charge (à condition qu'ils ne soient pas<br />
bénéficiaires à titre personnel d'une assurance de même nature), à savoir :<br />
• Le (les) conjoint (s) de l’assuré ;<br />
• Leurs enfants à charge âgés de 21 ans au plus ;<br />
• Leurs enfants à charge non mariés âgés de 26 ans au plus et poursuivant des études<br />
supérieures ;<br />
• Leurs enfants handicapés à charge, sans limite d’âge.<br />
Elle assure ainsi la couverture médicale pour la première fo<strong>is</strong> d’une population estimée à<br />
2,290 millions de personnes, réparties comme suit :<br />
Tableau 7 : Population couverte par la CNSS en 2006<br />
Actifs Pensionnés Total<br />
Assurés 626 593 237 122 863 715<br />
Ayants droit 985 948 441 375 1 427 323<br />
Total bénéficiaires 1 612 541 678 497 2 290 038<br />
Source : CNSS<br />
Les cot<strong>is</strong>ations :<br />
Les cot<strong>is</strong>ations sont basées sur une assiette et un taux :<br />
Assiette de cot<strong>is</strong>ation :<br />
Pour un assuré en activité, l’assiette est le salaire brut déduction faite des allocations<br />
familiales.<br />
Pour un titulaire de pension (s), l’assiette est déterminée sur la base du montant global des<br />
pensions de base.<br />
Le taux de cot<strong>is</strong>ation :<br />
Le taux de cot<strong>is</strong>ation global est fixé à 4% du salaire brut déduction faite des allocations<br />
familiales, réparti à part égale entre l’employeur et le salarié.<br />
Le bénéficiaire d’une pension supporte la cot<strong>is</strong>ation globale de 4% sur sa ou ses pension (s).<br />
Ce taux est complété par une participation complémentaire à la charge exclusive de<br />
l’ensemble des employeurs affiliés au régime de sécurité sociale, prélevée sur le taux de<br />
cot<strong>is</strong>ation afférent aux allocations familiales qui est égale à 1,5% de la masse salariale<br />
soum<strong>is</strong>e à cot<strong>is</strong>ation à la CNSS.<br />
62
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Les biens et services assurés (panier de soins) :<br />
Le panier de soins pr<strong>is</strong> en charge par la CNSS comprend une partie des prestations prévues<br />
par l’article 7 de la loi n° 65-00, à savoir :<br />
- En ce qui concerne les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue<br />
durée ou particulièrement coûteux, les prestations médicalement requ<strong>is</strong>es qu'elles<br />
soient d<strong>is</strong>pensées à titre ambulatoire ou dans le cadre de l'hospital<strong>is</strong>ation suivantes :<br />
• Les actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;<br />
• Les analyses de biologie médicale ;<br />
• La radiologie et l'imagerie médicale ;<br />
• Les explorations fonctionnelles ;<br />
• L'hospital<strong>is</strong>ation ;<br />
• Les médicaments adm<strong>is</strong> au remboursement ;<br />
• Le sang et ses dérivés labiles ;<br />
• Les soins bucco-dentaires ;<br />
• Les d<strong>is</strong>positifs médicaux et implants nécessaires aux actes médicaux et<br />
chirurgicaux adm<strong>is</strong> au remboursement ;<br />
• Les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;<br />
• Les actes paramédicaux ;<br />
• Les appareils de prothèse et d'orthèse médicales adm<strong>is</strong> au remboursement ;<br />
• La lunetterie médicale.<br />
- En ce qui concerne l'hospital<strong>is</strong>ation, l'ensemble des prestations et soins rendus dans ce<br />
cadre y compr<strong>is</strong> les actes de chirurgie réparatrice.<br />
En outre, la CNSS couvre également les actes médicaux et chirurgicaux tels qu'ils sont<br />
défin<strong>is</strong> à la nomenclature générale des actes professionnels et à la nomenclature des actes<br />
de biologie médicale ainsi que les médicaments adm<strong>is</strong> au remboursement, le sang et ses<br />
dérivés labiles, les actes paramédicaux et, le cas échéant, les actes de rééducation<br />
fonctionnelle et de kinésithérapie, en ce qui concerne l'enfant dont l'âge est inférieur ou<br />
égal à 12 ans et le suivi de la mère pendant la grossesse, l'accouchement et ses suites.<br />
Le taux de couverture :<br />
Le taux de couverture de ces groupes de prestations est fixé à 70% de la tarification nationale<br />
de référence.<br />
Ce taux est porté à 90% pour les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de<br />
longue durée ou particulièrement coûteux, lorsque les prestations y afférentes sont d<strong>is</strong>pensées<br />
dans les hôpitaux publics, les établ<strong>is</strong>sements publics de santé et les services sanitaires relevant<br />
de l'Etat.<br />
II.2. Couverture facultative<br />
II.2.1. La couverture de base<br />
Dans une phase transitoire prévue par la loi 65-00 (article 114), de cinq années renouvelable,<br />
la couverture médicale de base pour les personnes qui en bénéficiaient avant le 18 août 2005,<br />
continue à être assurée par :<br />
a) Les sociétés mutual<strong>is</strong>tes autres que celles qui composent la CNOPS et les ca<strong>is</strong>ses<br />
internes au sein des entrepr<strong>is</strong>es publiques. Les niveaux de couverture (taux de<br />
remboursement) et les niveaux des cot<strong>is</strong>ations sont fixés par les statuts et les<br />
63
Financement des soins de santé au Maroc<br />
règlements intérieurs de ces sociétés. Ils sont au moins similaires à ceux prévus par le<br />
régime d’AMO géré par la CNOPS ;<br />
b) Les entrepr<strong>is</strong>es d’assurances dans le cadre des contrats de groupe couvrant le r<strong>is</strong>que<br />
maladie et souscrits par des employeurs avant l’entrée en vigueur de l’AMO : Les<br />
niveaux de couverture (taux de remboursement, plafond ….) et les niveaux de primes<br />
varient selon les besoins exprimés par les assurés.<br />
II.2.2. La couverture complémentaire<br />
La couverture de base garantit le remboursement des prestations afférentes à un panier de<br />
soins selon des taux de référence et l'assuré couvre le reste, d'où l'intérêt de la couverture<br />
complémentaire.<br />
Cette couverture complémentaire est offerte par les sociétés mutual<strong>is</strong>tes et les entrepr<strong>is</strong>es<br />
d’assurances.<br />
Les sociétés mutual<strong>is</strong>tes<br />
Les sociétés mutual<strong>is</strong>tes assurent, pour leurs adhérents, le remboursement de 16% des fra<strong>is</strong><br />
médicaux et 20 % pour les prothèses, les analyses, les actes chirurgicaux et les lunettes sur la<br />
base d’un tarif de responsabilité. De plus, elles gèrent des oeuvres sociales au profit de leurs<br />
adhérents (cabinets dentaires, polycliniques, etc.).<br />
Le taux de cot<strong>is</strong>ation varie entre 1% et 1,80% du salaire de base sans que le montant dû ne<br />
dépasse 600 DH par année pour les adhérents en activité.<br />
Quant aux adhérents retraités, le taux de cot<strong>is</strong>ation ne dépasse pas 1% de la pension dans la<br />
limite d’un plafond de 500 DH par année.<br />
Les entrepr<strong>is</strong>es d’assurances<br />
Les entrepr<strong>is</strong>es d’assurances offrent, dans le cadre des contrats individuels ou de groupe, des<br />
couvertures complémentaires du r<strong>is</strong>que maladie, souscrits par des particuliers ou par des<br />
employeurs, en complément des prestations garanties par des couvertures de base (régimes<br />
obligatoires ou contrats d’assurances).<br />
Les niveaux de couverture et les taux de primes varient selon les besoins exprimés par les<br />
assurés. Les contrats en couverture complémentaire prévoient des franch<strong>is</strong>es de pr<strong>is</strong>e en<br />
charge, égales aux plafonds prévus par les couvertures de base, ainsi que des plafonds<br />
pouvant atteindre un million de dirhams.<br />
Section III : Système de régulation des régimes de couverture médicale<br />
III.1. L’Agence Nationale d’Assurance Maladie (ANAM) pour l’AMO<br />
L’Agence nationale de l’assurance maladie est un établ<strong>is</strong>sement public doté de la personnalité<br />
morale et de l’autonomie financière. Elle est soum<strong>is</strong>e à la tutelle du Min<strong>is</strong>tère de la Santé,<br />
lequel a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l’agence, les d<strong>is</strong>positions<br />
de la loi n° 65-00 précitée, en particulier celles relatives aux m<strong>is</strong>sions qui lui sont dévolues et,<br />
de manière générale, de veiller au bon fonctionnement du système de couverture médicale de<br />
base.<br />
L’agence est également soum<strong>is</strong>e au contrôle financier de l’Etat applicable aux établ<strong>is</strong>sements<br />
publics conformément à la lég<strong>is</strong>lation en vigueur.<br />
L’ANAM a pour m<strong>is</strong>sion d’assurer l’encadrement technique de l’assurance maladie<br />
obligatoire de base et de veiller à la m<strong>is</strong>e en place des outils de régulation du système.<br />
A ce titre, elle est chargée de :<br />
64
Financement des soins de santé au Maroc<br />
- s’assurer, de concert avec l’admin<strong>is</strong>tration, de l’adéquation entre le fonctionnement de<br />
l’assurance maladie obligatoire de base et les objectifs de l’Etat en matière de santé ;<br />
- conduire, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les négociations relatives à<br />
l’établ<strong>is</strong>sement des conventions nationales entre les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires d’une<br />
part, les prestataires de soins et les fourn<strong>is</strong>seurs de bien et de services médicaux<br />
d’autre part ;<br />
- proposer à l’admin<strong>is</strong>tration les mesures nécessaires à la régulation du système<br />
d’assurance maladie obligatoire de base et, en particulier, les mécan<strong>is</strong>mes appropriés<br />
de maîtr<strong>is</strong>e des coûts de l’assurance maladie obligatoire de base et veiller à leur<br />
respect ;<br />
- émettre son av<strong>is</strong> sur les projets de textes lég<strong>is</strong>latifs et réglementaires relatifs à<br />
l’assurance maladie obligatoire de base dont elle est sa<strong>is</strong>ie par l’admin<strong>is</strong>tration, ainsi<br />
que sur toutes autres questions relatives au même objet ;<br />
- veiller à l’équilibre global entre les ressources et les dépenses pour chaque régime<br />
d’assurance maladie obligatoire de base ;<br />
- apporter l’appui technique aux organ<strong>is</strong>mes gestionnaires pour la m<strong>is</strong>e en place d’un<br />
d<strong>is</strong>positif permanent d’évaluation des soins d<strong>is</strong>pensés aux bénéficiaires de l’assurance<br />
maladie obligatoire de base dans les conditions et selon les formes édictées par<br />
l’admin<strong>is</strong>tration ;<br />
- assurer l’arbitrage en cas de litiges entre les différents intervenants dans l’assurance<br />
maladie ;<br />
- assurer la normal<strong>is</strong>ation des outils de gestion et documents relatifs à l’assurance<br />
maladie obligatoire de base ;<br />
- tenir les informations stat<strong>is</strong>tiques consolidées de l’assurance maladie obligatoire de<br />
base sur la base des rapports annuels qui lui sont adressés par chacun des organ<strong>is</strong>mes<br />
gestionnaires ;<br />
- élaborer et diffuser annuellement un rapport global relatant les ressources, les<br />
dépenses et les données relatives à la consommation médicale des différents régimes<br />
d’assurance maladie obligatoire de base.<br />
L’ANAM est aussi chargée de la gestion des ressources affectées au régime d’ass<strong>is</strong>tance<br />
médicale (RAMED).<br />
Elle est admin<strong>is</strong>trée par un conseil présidé par le Premier Min<strong>is</strong>tre ou l’autorité<br />
gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Il comprend en outre :<br />
a) des représentants de l’admin<strong>is</strong>tration ;<br />
b) des représentants des employeurs (publics et privés) ;<br />
c) des représentants des assurés des secteurs publics et privé désignés par les centrales<br />
syndicales les plus représentatives ;<br />
d) des représentants des organ<strong>is</strong>mes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de<br />
base.<br />
Siègent également au conseil d’admin<strong>is</strong>tration de l’agence, avec voix consultative, des<br />
représentants des prestataires de soins ainsi que des personnalités désignées pour leur<br />
compétence dans le domaine de l’assurance maladie.<br />
65
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Lorsque le conseil d’admin<strong>is</strong>tration de l’agence est appelé à se prononcer sur la gestion des<br />
ressources affectées au RAMED, il est composé uniquement des représentants de<br />
l’admin<strong>is</strong>tration et des directeurs des établ<strong>is</strong>sements publics de soins et d’hospital<strong>is</strong>ation.<br />
L’agence est gérée par un directeur qui détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la<br />
gestion de l’agence.<br />
Il exécute les déc<strong>is</strong>ions du conseil d’admin<strong>is</strong>tration.<br />
Il représente l’agence en justice et peut intenter toutes les actions judiciaires ayant pour objet<br />
la défense des intérêts de l’agence ; il doit, toutefo<strong>is</strong>, en av<strong>is</strong>er le président du conseil<br />
d’admin<strong>is</strong>tration.<br />
Il assure la gestion de l’ensemble des services de l’agence et nomme le personnel dans les<br />
conditions prévues par la réglementation en vigueur.<br />
Il est habilité à engager les dépenses par acte, contrat ou marché conformément à la<br />
lég<strong>is</strong>lation et à la réglementation en vigueur pour les établ<strong>is</strong>sements publics.<br />
Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les<br />
recettes de l’agence conformément à la lég<strong>is</strong>lation et à la réglementation en vigueur.<br />
Il délivre à l’agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.<br />
Il peut recevoir délégation du conseil d’admin<strong>is</strong>tration pour le règlement d’affaires<br />
déterminées.<br />
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs aux cadres placés sous son<br />
autorité.<br />
Il présente au conseil d’admin<strong>is</strong>tration, en fin de chaque année, un rapport sur les activités de<br />
l’agence, ainsi que le projet de programme d’action pour l’année suivante.<br />
Il ass<strong>is</strong>te aux réunions du conseil d’admin<strong>is</strong>tration et des comm<strong>is</strong>sions spécial<strong>is</strong>ées, avec voie<br />
consultative.<br />
Les ressources de l’agence comprennent :<br />
- un prélèvement uniforme des cot<strong>is</strong>ations et des contributions dues aux organ<strong>is</strong>mes<br />
gestionnaires des régimes d’assurance maladie obligatoire de base, dont le taux est<br />
fixé par voie réglementaire ;<br />
- une proportion des ressources du régime d’ass<strong>is</strong>tance maladie affectée à la gestion<br />
dudit régime ;<br />
- les subventions ;<br />
- les dons et legs acceptés par le conseil d’admin<strong>is</strong>tration ;<br />
- les avances remboursables du Trésor ou des organ<strong>is</strong>mes publics ou privés ;<br />
- les emprunts autor<strong>is</strong>és conformément à la réglementation en vigueur ;<br />
- toutes autres ressources en rapport avec son activité, notamment celles qui peuvent lui<br />
être affectées par les textes lég<strong>is</strong>latifs et réglementaires.<br />
Les dépenses de l’agence comprennent :<br />
- les dépenses de fonctionnement et d’équipement ;<br />
- le remboursement des avances et emprunts ;<br />
- toutes autres dépenses en rapport avec la couverture médicale.<br />
66
Financement des soins de santé au Maroc<br />
III.2. Le Conseil supérieur de la mutualité (CSM) pour le secteur de la mutualité<br />
II est créé, auprès du min<strong>is</strong>tre délégué au travail et aux affaires sociales, un conseil supérieur<br />
de la mutualité. La composition et les attributions de cet organ<strong>is</strong>me seront fixées par décret.<br />
Le conseil supérieur de la mutualité est présidé par le min<strong>is</strong>tre du travail et des affaires<br />
sociales ou son représentant et comprend :<br />
- Un mag<strong>is</strong>trat de la chambre admin<strong>is</strong>trative de la Cour suprême ;<br />
- Deux représentants du min<strong>is</strong>tère des affaires admin<strong>is</strong>tratives, secrétariat général du<br />
Gouvernement (fonction publique et admin<strong>is</strong>tration générale) ;<br />
- Un représentant de chacun des min<strong>is</strong>tères suivants : Travail et affaires sociales,<br />
Finances, Intérieur, Santé publique, Défense nationale ;<br />
- Dix représentants des organ<strong>is</strong>ations mutual<strong>is</strong>tes ;<br />
- Deux représentants des travailleurs ;<br />
- Deux représentants des employeurs ;<br />
- Un représentant de chacune des organ<strong>is</strong>ations professionnelles suivantes : Ordre des<br />
médecins, Ordre des chirurgiens dent<strong>is</strong>tes, Ordre des sages-femmes, Conseil national<br />
prov<strong>is</strong>oire de la pharmacie ou à défaut ;<br />
- Un représentant des groupements professionnels (syndicats ou associations) suivants :<br />
Médecins, Chirurgiens dent<strong>is</strong>tes, Sages-femmes, Pharmaciens.<br />
- Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes<br />
conditions que celui-ci.<br />
Le secrétariat du conseil supérieur de la mutualité est assuré par le min<strong>is</strong>tère du travail et des<br />
affaires sociales.<br />
Les membres du conseil supérieur de la mutualité sont nommés pour tro<strong>is</strong> ans renouvelables.<br />
Leurs fonctions sont gratuites.<br />
Le conseil supérieur de la mutualité se réunit au moins deux fo<strong>is</strong> par an, sur convocation de<br />
son président.<br />
Il est institué au sein du conseil supérieur de la mutualité une section permanente composée<br />
de sept membres désignés par le min<strong>is</strong>tre du travail et des affaires sociales.<br />
Le conseil supérieur de la mutualité donne son av<strong>is</strong> sur les questions intéressant la mutualité.<br />
L'av<strong>is</strong> conforme du conseil supérieur de la mutualité doit être requ<strong>is</strong> pour l'attribution du<br />
surplus de l'actif social d'une société mutual<strong>is</strong>te à une ou plusieurs sociétés mutual<strong>is</strong>tes, quand<br />
cette répartition n'a pas été effectuée dans le délai de six mo<strong>is</strong> suivant sa d<strong>is</strong>solution.<br />
L'av<strong>is</strong> du conseil supérieur de la mutualité doit être recueilli notamment pour :<br />
1. l'établ<strong>is</strong>sement du statut type des sociétés mutual<strong>is</strong>tes et la détermination des<br />
d<strong>is</strong>positions de ce statut qui ont un caractère obligatoire ;<br />
2. la reconna<strong>is</strong>sance d'utilité publique d'une société mutual<strong>is</strong>te ;<br />
3. l'abrogation du texte reconna<strong>is</strong>sant d'utilité publique une société mutual<strong>is</strong>te ;<br />
4. l'établ<strong>is</strong>sement des règles comptables auxquelles doivent se conformer les sociétés<br />
mutual<strong>is</strong>tes ;<br />
5. le retrait d'approbation des statuts d'une société mutual<strong>is</strong>te et d'une ca<strong>is</strong>se autonome<br />
mutual<strong>is</strong>te ;<br />
67
Financement des soins de santé au Maroc<br />
6. l'établ<strong>is</strong>sement de la convention type que les sociétés mutual<strong>is</strong>tes peuvent conclure<br />
avec les médecins et chirurgiens dent<strong>is</strong>tes ;<br />
7. le retrait d'approbation du règlement concernant les œuvres sociales d'une société<br />
mutual<strong>is</strong>te.<br />
Le conseil supérieur de la mutualité peut proposer la fusion de deux ou de plusieurs sociétés<br />
mutual<strong>is</strong>tes dans le cas où la réunion d'une assemblée générale des sociétés appelées à<br />
d<strong>is</strong>paraître est rendue impossible.<br />
Le conseil supérieur de la mutualité donne son av<strong>is</strong> sur les questions intéressant la mutualité<br />
dont il est sa<strong>is</strong>i par le min<strong>is</strong>tère du travail et des affaires sociales.<br />
Il est habilité, s'il le juge utile, à présenter toutes suggestions concernant les questions<br />
intéressant la mutualité.<br />
Il doit établir, chaque année, un rapport moral sur le fonctionnement de l'ensemble des<br />
organ<strong>is</strong>mes mutual<strong>is</strong>tes.<br />
Il doit prendre toutes mesures pour encourager l'action mutual<strong>is</strong>te et susciter ou favor<strong>is</strong>er la<br />
création de sociétés mutual<strong>is</strong>tes et d'œuvres sociales mutual<strong>is</strong>tes.<br />
Il peut entendre, s'il le juge utile, toute personne ayant une compétence spéciale sur les<br />
questions étudiées par lui et décider de confier l'étude de problèmes particuliers à des<br />
comm<strong>is</strong>sions constituées dans son sein.<br />
Le conseil supérieur de la mutualité peut régler à l'amiable les différents survenus entre les<br />
sociétés mutual<strong>is</strong>tes.<br />
La section permanente a pour fonction de donner son av<strong>is</strong> sur toutes les questions qui lui sont<br />
envoyées, soit par le conseil supérieur, soit par le min<strong>is</strong>tre du travail et des affaires sociales.<br />
III.3. Le Conseil consultatif des assurances (CCA) pour le secteur des assurances<br />
Le Comité consultatif des assurances chargé de donner son av<strong>is</strong> sur toutes les questions<br />
relatives aux opérations d'assurances et de réassurance. Il peut être sa<strong>is</strong>i à la demande soit de<br />
l'admin<strong>is</strong>tration soit de la majorité de ses membres.<br />
Il est également sa<strong>is</strong>i par l'admin<strong>is</strong>tration de tout projet de loi ou de textes réglementaires<br />
rég<strong>is</strong>sant les conditions d'exercice, de gestion et de commercial<strong>is</strong>ation des opérations<br />
d'assurances.<br />
Le Comité consultatif des assurances est présidé par le min<strong>is</strong>tre chargé des finances ou son<br />
représentant.<br />
Il est composé de cinq (5) représentants du min<strong>is</strong>tère chargé des finances, de douze (12) à<br />
seize (16) représentants des entrepr<strong>is</strong>es d'assurances et de réassurance et de quatre (4)<br />
représentants des intermédiaires d'assurances. Il comprend en outre le directeur de la Ca<strong>is</strong>se<br />
de dépôt et de gestion, un représentant du Comité national de la prévention contre les<br />
accidents de la route, un mag<strong>is</strong>trat ayant grade de conseiller versé dans le domaine<br />
économique et financier désigné par le premier président de la Cour suprême.<br />
Le comité, à la demande de son président, peut s'adjoindre sans voix délibérative, toute<br />
personne dont il estime l'av<strong>is</strong> utile.<br />
La l<strong>is</strong>te des membres représentant les entrepr<strong>is</strong>es d'assurances et de réassurance ainsi que les<br />
intermédiaires d'assurances, dont le mandat est de tro<strong>is</strong> (3) ans renouvelable, est fixée par<br />
l'admin<strong>is</strong>tration et publiée au Bulletin officiel.<br />
Cette l<strong>is</strong>te doit prévoir les membres titulaires et les membres suppléants.<br />
68
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Le Comité consultatif des assurances se réunit chaque fo<strong>is</strong> que nécessaire et au moins une fo<strong>is</strong><br />
par an.<br />
Il peut créer en son sein une ou plusieurs comm<strong>is</strong>sions auxquelles il délègue tout ou partie de<br />
ses attributions et notamment l'examen des textes réglementaires, l'étude des questions<br />
techniques et d'organ<strong>is</strong>ation du marché.<br />
Le comité élabore un règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du min<strong>is</strong>tre chargé des<br />
finances.<br />
Le Comité consultatif des assurances est sa<strong>is</strong>i par le min<strong>is</strong>tre chargé des finances, qui peut<br />
fixer audit Comité un délai pour émettre son av<strong>is</strong>.<br />
Section IV : Analyse des situations financières des régimes de couverture et leur<br />
évolution<br />
IV.1. La CNOPS<br />
Ressources :<br />
Les ressources financières de la CNOPS en 2006 qui est l’année de démarrage pour cette<br />
ca<strong>is</strong>se en tant qu’organ<strong>is</strong>me gestionnaire de l’AMO, sont de l’ordre de 3 milliards de DH.<br />
Elles sont constituées essentiellement par les cot<strong>is</strong>ations des assurés (actifs et pensionnés) et<br />
par les contributions des employeurs, principalement l’Etat qui doit payer au titre de sa<br />
cot<strong>is</strong>ation patronale plus d’un milliard de DH par an.<br />
Dépenses :<br />
Les dépenses de la CNOPS au titre de l’année 2006 s’élèvent à 2,944 milliards de DHS,<br />
répart<strong>is</strong> en remboursements des adhérents par le bia<strong>is</strong> des mutuelles délégataires de la gestion<br />
pour compte d’un montant de 1,008 milliard de DHS et en paiements des prestataires de soins<br />
dans le cadre du tiers payant effectués directement par la CNOPS de l’ordre de 1,936 milliard<br />
de DH.<br />
Pour maîtr<strong>is</strong>er ses dépenses et malgré la conclusion de conventions avec les prestataires de<br />
soins, fixant la tarification nationale de référence devant constituer la base de remboursement<br />
des dossiers maladie, la ca<strong>is</strong>se a adopte, pour certains postes réputés budgétivores, des tarifs<br />
de responsabilité inférieurs à ceux prévus par lesdites conventions.<br />
Elle a également privilégié la forfait<strong>is</strong>ation des actes dans le cadre des conventions de tiers<br />
payant.<br />
Projections 2007 (selon une estimation effectuée par l’ANAM) :<br />
Considérant certaines hypothèses d'évolution des dépenses de la CNOPS pour l'année 2007,<br />
notamment :<br />
1. L'augmentation de la population (+23% pour les actifs et +60% pour les retraités) ;<br />
2. L'augmentation de la consommation due à la réduction des déla<strong>is</strong> de remboursement<br />
(Hypothèse : +10%) ;<br />
3. La diminution du prix du médicament (Hypothèse : -15%). Tenant compte de la m<strong>is</strong>e<br />
en place des mesures d'accompagnement en particulier l'entrée en vigueur des l<strong>is</strong>tes<br />
des médicaments remboursables et des prix de base de remboursement tenant compte<br />
des prix des génériques ;<br />
4. La réduction des dépenses due à l'augmentation de la fréquentation des structures<br />
publiques pour les hospital<strong>is</strong>ations et les ALD (-50% de réduction en moyenne) ;<br />
69
Financement des soins de santé au Maroc<br />
5. L’Augmentation des dépenses due aux changements de nomenclature introduits en<br />
2006 (+40% pour la biologie et +12% pour la radiologie).<br />
Les simulations ont donné la répartition des dépenses prév<strong>is</strong>ionnelles relatée dans le tableau<br />
suivant :<br />
Tableau 8 : Dépenses prév<strong>is</strong>ionnelles de la CNOPS en 2007 (En milliers de DHS)<br />
Actifs Pensionnés Total %<br />
Pharmacie 572 505 296 905 869 410 37,50<br />
Chirurgie et hospital<strong>is</strong>ations 305 211 135 617 440 828 19,02<br />
Dialyse 173 490 173 909 347 399 14,99<br />
Soins et prothèses dentaires 137 212 47 172 184 384 7,95<br />
Biologie 94 955 47 359 142 314 6,14<br />
Consultations 64 651 22 431 87 082 3,76<br />
Radiologie 58 001 22 629 80 630 3,48<br />
Autres 109 087 57 066 166 153 7,17<br />
Total 1 515 112 803 087 2 318 200 100,00<br />
Source : ANAM<br />
Il est prévu que les postes de biologie et de radiologie seront doublés à cause de la rév<strong>is</strong>ion<br />
des nomenclatures des actes relatives à ces postes.<br />
Le poste chirurgie générale et cardiovasculaire sera lui aussi doublé, principalement à cause<br />
de l'augmentation significative de la population des pensionnés touchée à 30% par les<br />
maladies cardiovasculaires.<br />
Le poste consultations augmentera sensiblement malgré l’adoption par la CNOPS des tarifs de<br />
responsabilité inférieurs à la TNR. Ces mêmes tarifs de responsabilité permettront au poste de<br />
«Soins et prothèses dentaires» d'augmenter dans des proportions ra<strong>is</strong>onnables.<br />
Selon les prév<strong>is</strong>ions de l’ANAM, il est estimé que le recours par la CNOPS à un tarif de<br />
responsabilité comme base de remboursement inférieur à la tarification nationale de référence<br />
fixée par les conventions signées avec les prestataires de soins, représenterait une économie<br />
pour la CNOPS de 406 millions de DHS, et permettrait de limiter le déficit prév<strong>is</strong>ionnel à 158<br />
millions de DHS au lieu de 564 millions de DHS.<br />
D’autres mesures pourraient atténuer le déficit :<br />
1) Promouvoir la fréquentation des structures publiques et de l'util<strong>is</strong>ation des génériques.<br />
Une fréquentation accrue de 15% des structures publiques par les assurés de la<br />
CNOPS représenterait une économie de 174 millions de DHS ;<br />
2) Augmenter la cot<strong>is</strong>ation des pensionnés qui ne cot<strong>is</strong>ent qu'à hauteur de 2,5% au lieu<br />
de 5% ;<br />
3) Déplafonner la cot<strong>is</strong>ation actuellement plafonnée à 400 DHS par mo<strong>is</strong> ;<br />
4) Mettre en place un seuil minimum pour la délivrance des pr<strong>is</strong>es en charge pour alléger<br />
la gestion des demandes d'accord de pr<strong>is</strong>e en charge.<br />
Si ces estimations restent des indicateurs importants, il n’en demeure pas moins que<br />
l’appréciation des retombées de l'ensemble de ses mesures et de l'application de la tarification<br />
nationale de référence nécessite une étude détaillée et approfondie.<br />
70
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Néanmoins, en l'absence de protocoles thérapeutiques et si se maintiennent le plafonnement<br />
des cot<strong>is</strong>ations, les programmes de départ volontaires, la tendance constatée de la population<br />
couverte vers une aggravation du r<strong>is</strong>que maladie (le ratio actif - retraité passera de 4,6<br />
actuellement à 1,9 en 2024) et enfin une montée en charge des affections de longue durée et<br />
de la consommation des médicaments, l'équilibre du régime AMO géré par la CNOPS menacé<br />
à moyen terme, et même des augmentations de cot<strong>is</strong>ations ne seraient pas suff<strong>is</strong>antes pour le<br />
rétablir.<br />
IV.2. La CNSS<br />
Ressources :<br />
Depu<strong>is</strong> l’entrée en vigueur de l’AMO le 18 août 2005 jusqu’au 31 décembre 2006, la CNSS a<br />
enca<strong>is</strong>sé pour 1,541 milliard de DHS sur un montant de cot<strong>is</strong>ations m<strong>is</strong>es en recouvrement de<br />
plus de 2 milliards de DHS.<br />
Dépenses :<br />
Les dépenses engagées par la CNSS au titre des prestations couvertes par cette institution au<br />
cours de l’année 2006, ont atteint environ 270 millions de DHS, tel que détaillé dans le<br />
tableau ci-après :<br />
Tableau 9 : Dépenses de la CNSS en 2006 (En DHS)<br />
Type de flux Nombre de dossiers Montant<br />
Dossiers de remboursement 110 681 211 932 271,65<br />
Demande d'entente Préalable 344 _<br />
Demande de pr<strong>is</strong>e en charge 10 920 101 537 266,69<br />
Demande d'ouverture de Droit ALD 25 599 _<br />
Dossiers de remboursement aux les<br />
prestataires de soins<br />
5 109 27 580 942,81<br />
Source : CNSS<br />
TOTAL 152 653 341 050 481,15<br />
Projections 2007 (selon l’ANAM) :<br />
Pour faire des prév<strong>is</strong>ions sur la situation du régime de l’AMO géré par la CNSS, certaines<br />
hypothèses ont été ém<strong>is</strong>es, en se basant sur les données de la CNOPS :<br />
• Les bénéficiaires des prestations des deux ca<strong>is</strong>ses (CNOPS et CNSS) ont le même<br />
profil de consommation médicale ;<br />
• La part des soins ambulatoires, pr<strong>is</strong>e en charge par la CNSS estimée à 30% par rapport<br />
à la CNOPS (pr<strong>is</strong>e en charge des ALD, des enfants de moins de 12 ans et de la mère) ;<br />
• La fréquentation des structures publiques augmenterait pour atteindre 15% des<br />
prestations ;<br />
• Le taux moyen de remboursement des actes en tiers payant serait de 80% si on inclut<br />
les ALD et le taux de fréquentation des hôpitaux publics, sachant que la CNSS d<strong>is</strong>pose<br />
de 13 polycliniques à travers le territoire marocain.<br />
Les simulations effectuées ont abouti aux prév<strong>is</strong>ions de dépenses suivantes :<br />
Remboursement des dépenses en tiers payant :<br />
71
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Les dépenses de la CNOPS ont donné une moyenne de 760 DHS par assuré actif et de 1 940<br />
DHS par pensionné. Ces dépenses incluant la pr<strong>is</strong>e en charge des ayants droit.<br />
Les mêmes moyennes, corrigées par le différentiel des taux de remboursement, appliquées à<br />
la CNSS donnent 654 DHS pour un actif et 1 669 pour un pensionné.<br />
Cela représente un budget global en tiers payant de 707,8 Millions de DHS.<br />
Remboursement des dépenses avancées par les patients :<br />
Les dépenses de la CNOPS en soins ambulatoires ont été d'abord corrigées par la suppression<br />
de l’effet de l’application par la CNOPS des tarifs de responsabilité qui sont inférieurs à la<br />
TNR.<br />
Ces dépenses sont passées de 1 184 millions DHS à 1 336 millions DHS. La moyenne par<br />
assuré actif est de 970 DHS et de 1 961 DHS par pensionnés.<br />
L'application du différentiel de remboursement donne 917 DHS et 1 855 DHS<br />
respectivement.<br />
Le budget théorique global pour la pr<strong>is</strong>e en charge des soins ambulatoires s'élèverait à 949,9<br />
Millions de DHS.<br />
Le panier CNSS ne couvre en soins ambulatoires que l'enfant de moins de 12 ans, la mère et<br />
les ALD ce qui représente 285 millions de DHS.<br />
Le total des dépenses est estimé à 992,8 millions de DHS.<br />
L'intégration des 163 932 pensionnés et leurs ayants droit demanderait un budget<br />
supplémentaire de 364,8 millions de DHS hors fra<strong>is</strong> de gestion. Cette augmentation<br />
représenterait l’équivalent d’un prélèvement de l'ordre de 0,80% de la masse salariale globale<br />
déclarée à la CNSS.<br />
Les dépenses globales y compr<strong>is</strong> les fra<strong>is</strong> de gestion s'élèveraient à 1,394 milliard de DHS.<br />
IV.3. Les sociétés mutual<strong>is</strong>tes<br />
Les données d<strong>is</strong>ponibles relatives au secteur mutual<strong>is</strong>te concernent les années antérieures à<br />
l’entrée en vigueur de l’AMO. Une évolution de la situation des sociétés mutual<strong>is</strong>tes sur la<br />
période 2002 à 2005 est retracée dans le tableau ci-après :<br />
Tableau 10 : Evolutions de la situation des sociétés mutual<strong>is</strong>tes (En milliers de DHS)<br />
Adhérents Bénéficiaires Total<br />
produits<br />
Total<br />
charges<br />
Excédent ou<br />
insuff<strong>is</strong>ance de<br />
l'exercice<br />
2002 1 174 428 3 532 163 3 061 188 3 248 628 -187 441<br />
2003 1 214 315 3 674 906 3 281 080 2 601 603 679 476<br />
2004 1 251 183 3 750 365 3 536 341 2 814 911 721 431<br />
2005(*) 1 278 035 3 812 881 2 619 872 3 627 718 -995 577<br />
(*) Chiffres prov<strong>is</strong>oires<br />
Source : Rapports moraux et financiers des sociétés mutual<strong>is</strong>tes<br />
72
Financement des soins de santé au Maroc<br />
5 000 000<br />
4 000 000<br />
3 000 000<br />
2 000 000<br />
1 000 000<br />
0<br />
-1 000 000<br />
-2 000 000<br />
Figure 6 : Evolution de la situation des sociétés mutual<strong>is</strong>tes<br />
2002 2003 2004 2005<br />
Adhérents<br />
Bénéficiaires<br />
Total produits<br />
Total charges<br />
Excédent ou insuff<strong>is</strong>ance de<br />
l'exercice<br />
A partir de l’année 2006, l’analyse de la situation des sociétés mutual<strong>is</strong>tes est à appréhender<br />
sur deux volets :<br />
- La situation des sociétés mutual<strong>is</strong>tes composant la CNOPS qui ne comporterait que la<br />
gestion de la couverture médicale complémentaire à l’AMO. Dans ce cadre les sociétés<br />
mutual<strong>is</strong>tes sont en phase d’entreprendre des études actuarielles pour apprécier le niveau de<br />
cot<strong>is</strong>ation qui leur permettrait d’assurer leur équilibre ;<br />
- La situation des autres sociétés mutual<strong>is</strong>tes qui continuent à gérer la couverture médicale de<br />
base en plus de la couverture médicale complémentaire.<br />
Certaines de ces sociétés mutual<strong>is</strong>tes ont entamé la réal<strong>is</strong>ation d’études actuarielles pour<br />
l’appréciation de leur équilibre, notamment dans le cas où leurs adhérents basculeraient dans<br />
le régime AMO (CNOPS ou CNSS), après la période de transition prévue par la loi 65-00.<br />
IV.4. Les entrepr<strong>is</strong>es d’assurances<br />
Les entrepr<strong>is</strong>es d’assurances prenant en charge le r<strong>is</strong>que «Santé» qui sont au nombre de 11,<br />
ont un portefeuille de contrats pratiquement stable. Il est constitué d’environ 350 contrats<br />
couvrant une population de plus d’un million de bénéficiaires (assurés et ayants droit).<br />
Les montants des primes ém<strong>is</strong>es par ces entrepr<strong>is</strong>es au cours des 4 dernières années (2003-<br />
2006) ainsi que la part de l’assurance maladie-maternité dans le chiffre d’affaires de ces<br />
entrepr<strong>is</strong>es sont relatées dans le tableau suivant :<br />
Tableau 11 : Evolution des primes ém<strong>is</strong>es par les entrepr<strong>is</strong>es d’assurances (En milliers<br />
de DHS)<br />
Années Total des primes de Total des primes du r<strong>is</strong>que Santé<br />
tous les r<strong>is</strong>ques Montant Part en %<br />
2003 12 375 762 1 048 622 8,50<br />
73
Financement des soins de santé au Maroc<br />
2004 12 250 878 1 146 192 9,37<br />
2005 13 153 428 1 338 620 10,19<br />
2006 (*) 14 450 784 1 481 203 10,23<br />
Source : Rapports d’activité des entrepr<strong>is</strong>es d’assurances et de réassurance - DAPS<br />
La part de l’assurance maladie -maternité dans le chiffre d’affaire des entrepr<strong>is</strong>es d’assurance,<br />
malgré une évolution d’année en année, reste modeste ne dépassant pas les 10% du total des<br />
primes ém<strong>is</strong>es par ces sociétés.<br />
Tableau 12 : Evolution des prestations et fra<strong>is</strong> payés (En milliers de DHS)<br />
Années Total des prestations et fra<strong>is</strong><br />
payés de tous les r<strong>is</strong>ques<br />
Total des prestations et fra<strong>is</strong> payés au<br />
titre du r<strong>is</strong>que Santé<br />
Montant Part en %<br />
2003 7 971 533 1 076 514,00 13,27<br />
2004 8 028 893 1 143 441,00 13,90<br />
2005 8 212 443 1 162 489,00 14,16<br />
2006 (*) 9 424 305 1 197 559,00 12,72<br />
(*) Chiffres prov<strong>is</strong>oires<br />
Source : Rapports d’activité des entrepr<strong>is</strong>es d’assurances et de réassurance - DAPS<br />
A l’instar des primes, les prestations et fra<strong>is</strong> payés représentent en moyenne 13% des<br />
prestations et fra<strong>is</strong> serv<strong>is</strong> par année par le secteur des assurances.<br />
Tableau 13 : Evolution de la situation du r<strong>is</strong>que « Santé » (En milliers de DHS)<br />
Années Primes Prestations et fra<strong>is</strong> Prov<strong>is</strong>ions Résultat<br />
payés<br />
techniques<br />
2002 990 987 1 075 033 23 148 -107 194<br />
2003 1 048 622 1 076 514 17 198 - 45 090<br />
2004 1 146 192 1 143 441 29 458 - 26 707<br />
2005 1 338 620 1 162 489 -6 729 + 182 860<br />
2006 (*) 1 481 203 1 197 559 56 719 + 226 925<br />
(*) Chiffres prov<strong>is</strong>oires<br />
Source : Rapports d’activité des entrepr<strong>is</strong>es d’assurances et de réassurance - DAPS<br />
74
Financement des soins de santé au Maroc<br />
1600000,00<br />
1400000,00<br />
1200000,00<br />
1000000,00<br />
800000,00<br />
600000,00<br />
400000,00<br />
200000,00<br />
0,00<br />
-200000,00<br />
Figure 7 : Evolution de la situation des entrepr<strong>is</strong>es d’assurances<br />
2002 2003 2004 2005 2006<br />
Primes<br />
Prestations et fra<strong>is</strong><br />
Prov<strong>is</strong>ions techniques<br />
Résultat<br />
A travers ce tableau, fort est de constater l’amélioration des résultats dégagés par le secteur<br />
des assurances en matière d’assurance « maladie – maternité ». Les excédents, malgré leur<br />
modicité, ont commencé à apparaître à partir de l’exercice 2005.<br />
Concernant les perspectives d’avenir de cette catégorie et en l’absence de toute étude, il est<br />
très difficile d’avancer des prév<strong>is</strong>ions sur son évolution, vue les mutations que la couverture<br />
médicale est en train de connaître. Cette catégorie ne manquerait pas d’être impactée par :<br />
- l’application de l’AMO pour les salariés du secteur privé et notamment après la<br />
période de transition prévue par la loi 65-00, qui doivent rejoindre le régime AMO<br />
géré par la CNSS avant la fin de l’année 2010 ;<br />
- l’application de la loi relative à la couverture médicale obligatoire pour les<br />
indépendants et les aides art<strong>is</strong>ans, qui oblige ces personnes à d<strong>is</strong>poser d’une<br />
couverture maladie- maternité soit en souscrivant des contrats d’assurance auprès de<br />
ces entrepr<strong>is</strong>es soit en adhérant à des sociétés mutual<strong>is</strong>tes.<br />
Chapitre 4 : Forces et faiblesse des systèmes de prépaiement<br />
La couverture médicale en vigueur et en cours de m<strong>is</strong>e en œuvre présente un certain nombre<br />
de points forts ma<strong>is</strong> elle souffre également de faiblesses en termes de populations couvertes,<br />
de cons<strong>is</strong>tance des services assurés et en termes d'équité, de qualité et de d<strong>is</strong>ponibilité des<br />
services de soins.<br />
I/ En termes de populations couvertes et de cons<strong>is</strong>tance des services assurés<br />
L’adoption du principe de progressivité dans l’instauration de la couverture médicale<br />
obligatoire ainsi que la nécessité de sauvegarde des droits acqu<strong>is</strong> par les personnes bénéficiant<br />
de couverture avant l’entrée en vigueur de l’obligation ont généré une fragmentation de la<br />
population couverte et la multiplicité des régimes d’assurance avec différents niveaux de<br />
couverture (taux de couverture et panier de soins). Ainsi, si la création de systèmes<br />
spécifiques de couverture médicale pour chaque catégorie de personnes permet de prendre en<br />
considération leurs caractér<strong>is</strong>tiques et notamment leur capacité contributive et facilite<br />
75
Financement des soins de santé au Maroc<br />
l’extension de cette couverture, elle a aussi abouti à un système à plusieurs vitesses et a rendu<br />
difficile toute solidarité entre les catégories d’assurés.<br />
L’absence de toute coordination entre les différents régimes en matière d'affiliation et<br />
d'immatriculation, de système d'information, de communication, etc… favor<strong>is</strong>e l’ex<strong>is</strong>tence<br />
d’une fraude de ces régimes difficilement contrôlable, accentuée par l’absence de l’obligation<br />
d’assurance pour certaines catégories de population qui leur permet de rester en dehors du<br />
système de couverture médicale. Cet état de fait à des conséquences sur l’équilibre des<br />
régimes et sur les coûts à supporter par les parties qui les financent. Cette absence de<br />
coordination transparaît également entre la couverture de base et la couverture<br />
complémentaire.<br />
Les écarts importants entre les tarifs qui servent de base pour les remboursements des dossiers<br />
maladie et les prix effectivement pratiqués par les prestataires de soins, la<strong>is</strong>se une part<br />
importance des coûts des prestations à la charge des ménages.<br />
L’intervention d’opérateurs publics et privés dans le cadre de la couverture médicale crée une<br />
émulation et des synergies entre les différents intervenants. De même, la création d’un<br />
partenariat entre des régimes d’assurance de statut privé avec des prestataires de soins<br />
relevant du secteur public, va contribuer à la m<strong>is</strong>e à niveau de ces structures publiques et la<br />
maîtr<strong>is</strong>e des dépenses de ces régimes.<br />
II/ En termes de régulation et de gouvernance<br />
Avec l’avènement de l’AMO, les organ<strong>is</strong>mes opérant dans la couverture des soins de santé se<br />
sont trouvés devant une nouvelle d<strong>is</strong>tribution des rôles qui requiert des structures adéquates,<br />
une organ<strong>is</strong>ation prévoyante, des ressources humaines performantes et surtout une capacité<br />
d'écoute développée et un recentrage sur la qualité et sur la proximité.<br />
Ces déf<strong>is</strong> nécessitent que le secteur adopte une nouvelle démarche qui exige la modern<strong>is</strong>ation<br />
de ses structures, des règles de bonne gouvernance ainsi que la restructuration de toute la<br />
chaîne de traitement des prestations.<br />
A cet égard, les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires de l’AMO (CNOPS et CNSS) ont adopté une<br />
démarche qualité qui a amélioré les indicateurs du bon accueil, simplifié les procédures,<br />
raccourci les déla<strong>is</strong> de réponse et de remboursement et mobil<strong>is</strong>é les ressources humaines. De<br />
même, l’ouverture sur les nouvelles technologies d'information et de communication prôné<br />
par ces organ<strong>is</strong>mes commence à se répercuter sur la qualité de leur réactivité pour répondre<br />
aux attentes des assurés.<br />
L’adoption des règles de bonne gouvernance, commence à germer au niveau des différentes<br />
composantes du système de prépaiement des soins de santé. L’implication des différents<br />
intervenants dans la gouvernance des régimes d’assurance (CNOPS et CNSS) et de régulation<br />
(ANAM) est prévue par la réglementation rég<strong>is</strong>sant ses organ<strong>is</strong>mes. Actuellement, les<br />
syndicats et les prestataires de soins sont représentés dans les conseils d’admin<strong>is</strong>tration de<br />
l’ANAM et de la CNSS et indirectement dans celui de la CNOPS. Ma<strong>is</strong>, il n’ex<strong>is</strong>te pas encore<br />
de mécan<strong>is</strong>mes pour une participation publique à la gouvernance du système de santé en<br />
général.<br />
Le rôle des prestataires de soins dans la gouvernance du système de santé est très limité. Les<br />
associations de prestataires en tant que représentants de toute la profession n’ont pas une<br />
plate-forme formelle pour participer aux déc<strong>is</strong>ions stratégiques les concernant directement<br />
(formation des ressources humaines ; octroi des agréments ; gestion des réclamations des<br />
patients …..). Ils participent aux négociations concernant les barèmes tarifaires ma<strong>is</strong> avec un<br />
simple av<strong>is</strong> consultatif.<br />
76
Financement des soins de santé au Maroc<br />
La gouvernance du système de santé est segmentée en ra<strong>is</strong>on du cumul et de chevauchement<br />
des fonctions de régulation, de prestation de soins et de gestion de l’assurance maladie par le<br />
min<strong>is</strong>tère de la santé, l’ANAM et les organ<strong>is</strong>mes gestionnaires.<br />
La central<strong>is</strong>ation empêche une gouvernance efficace, en ce sens que le min<strong>is</strong>tère de la santé<br />
superv<strong>is</strong>e directement l’admin<strong>is</strong>tration et le financement de tous les établ<strong>is</strong>sements de soins relevant<br />
du secteur public. A présent, il y a un pouvoir de déc<strong>is</strong>ion limité à l’échelle régionale et locale en vue<br />
d’une planification plus intégrée et mult<strong>is</strong>ectorielle au niveau local ce qui constitue une entrave à la<br />
bonne gouvernance du système.<br />
III/ En termes d'équité, de qualité et d’offre de soins<br />
D<strong>is</strong>ponibilité :<br />
L’invest<strong>is</strong>sement constant dans les établ<strong>is</strong>sements de soins et la formation des professionnels<br />
de la santé par l’Etat se sont traduits par de meilleurs résultats de la santé. La couverture des<br />
services essentiels de santé et l’accès à ces services tels que l’immun<strong>is</strong>ation et les soins de<br />
santé primaires se sont également améliorés. En parallèle le réseau d’établ<strong>is</strong>sements et de<br />
praticiens privés s’est développé progressivement pour faire concurrence au niveau de la<br />
qualité, du moins pour les habitants urbains plus a<strong>is</strong>és et plus éduqués.<br />
Cependant, il subs<strong>is</strong>te toujours une <strong>care</strong>nce en termes de d<strong>is</strong>ponibilité des services de soins<br />
résidant dans la configuration de la carte sanitaire. La m<strong>is</strong>e en place de cette carte, avec une<br />
meilleure répartition des prestataires privés, conjointement à l’amélioration des prestations<br />
hospitalières publiques, va non seulement corriger progressivement ces d<strong>is</strong>parités ou du moins<br />
les plus flagrantes, ma<strong>is</strong> aussi permettre d’irriguer entièrement le territoire national par les<br />
ressources mobil<strong>is</strong>ées par les régimes et mécan<strong>is</strong>mes de prépaiement (AMO, RAMED,<br />
Inaya…) afin que les patients ne sub<strong>is</strong>sent pas, en plus des charges de soins, des coûts de<br />
déplacement et de pertes de revenus (longue absence du travail) trop élevés.<br />
De même, du fait de la non d<strong>is</strong>ponibilité des médicaments et autres produits et soins dans les<br />
structures de soins publiques, les patients, même les indigents, sub<strong>is</strong>sent des surcharges<br />
importantes, pour se procurer ces médicaments et soins.<br />
Qualité :<br />
Les établ<strong>is</strong>sements de soins publics conna<strong>is</strong>sent des dysfonctionnements. Il s’agit de :<br />
• L’image des établ<strong>is</strong>sements de soins publics et même certains de ceux du privé<br />
intervenant dans le secteur de la santé est entachée par les <strong>care</strong>nces de gestion, la<br />
pers<strong>is</strong>tance de mécan<strong>is</strong>mes de financements parallèles et de formes clandestines de<br />
corruption, d’insuff<strong>is</strong>ance des ressources humaines et de pratiques ne respectant pas<br />
les règles déontologiques ;<br />
• L’absence de mécan<strong>is</strong>mes rigoureux de contrôle et de régulation ;<br />
• L’ex<strong>is</strong>tence de comportements individuels non compatibles avec les exigences<br />
minimales du service au public ;<br />
• L’absence de v<strong>is</strong>ion à moyen et long terme et d’une planification stratégique en<br />
matière de ressources humaines (formation et carrière).<br />
Ces dysfonctionnements rendent problématique la m<strong>is</strong>e en œuvre d’une tarification des actes<br />
et d’un financement des établ<strong>is</strong>sements de soins du secteur public basé sur la performance. Ils<br />
compliquent également l’élaboration et l’application du contrôle médical par les régimes<br />
d’assurances.<br />
Iniquités et problèmes d’affectation des ressources financières :<br />
77
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Les analyses relatives à l’iniquité se manifestent à plusieurs niveaux et touchent<br />
principalement le recours (et l’util<strong>is</strong>ation) aux services de soins du Min<strong>is</strong>tère de la Santé, le<br />
financement de ces services par les ménages ainsi que la répartition des ressources du<br />
département .<br />
• Le recours aux soins :<br />
- Malgré que le Min<strong>is</strong>tère de la Santé assure des soins gratuitement dans ses établ<strong>is</strong>sements de<br />
soins de santé de base (D<strong>is</strong>pensaires, Centres de Santé, Centres spécial<strong>is</strong>és -Tuberculose-)<br />
pour toute la population et que les tarifs appliqués dans les hôpitaux sont les plus bas sur le<br />
marché, seuls 47,2% 30 de la population marocaine, qui a accès aux soins de santé, recourt aux<br />
services des structures de soins du secteur public (D<strong>is</strong>pensaires, Centres de Santé, Centres<br />
spécial<strong>is</strong>és - Tuberculose -, hôpitaux, instituts et laboratoires nationaux) ;<br />
- Le cadre de pr<strong>is</strong>e en charge des personnes démunies souffrant de la bureaucratie, de la non<br />
standard<strong>is</strong>ation et de la subjectivité des critères d’éligibilité et bien que le tarif des<br />
consultations dans les structures publiques soit le plus bas sur le marché, force est de<br />
constater que cela entrave l’accès des indigents aux soins<br />
• La répartition des ressources financières :<br />
L’analyse des dépenses globales du Min<strong>is</strong>tère de la Santé (hors CHU, Instituts et Laboratoires<br />
Nationaux et Admin<strong>is</strong>tration Centrale 31 ) par habitant et par région en 2001 a montré<br />
l’ex<strong>is</strong>tence de d<strong>is</strong>parités assez importantes :<br />
- L’absence de critères pertinents et objectifs pour la répartition des crédits entre les<br />
différentes provinces et les divers établ<strong>is</strong>sements et services du Min<strong>is</strong>tère de la Santé ;<br />
- L’absence de programmation unique du budget et de maîtr<strong>is</strong>e des ressources extra<br />
budgétaires ce qui rend difficile de mettre en place des critères standards de répartition de ces<br />
ressources 32 .<br />
Il n’en demeure pas moins que le budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé a connu une évolution<br />
importante et que le Min<strong>is</strong>tère de la Santé a procédé à quelques tentatives d’élaboration de<br />
critères de répartition de ses ressources financières. Celles-ci n’ont pas abouti eu égard à<br />
l’importance des iniquités, aux d<strong>is</strong>parités inter et intra régionales et à la non fiabilité des<br />
données stat<strong>is</strong>tiques relatives au coûts des soins d<strong>is</strong>pensés par les différentes structures.<br />
Aussi, la réforme des dépenses publiques, à savoir la global<strong>is</strong>ation des crédits, la<br />
contractual<strong>is</strong>ation et le partenariat, représente une opportunité pour l’amélioration des<br />
performances du département et sa préparation à la déconcentration. Enfin, la<br />
contractual<strong>is</strong>ation (ou budget programme) v<strong>is</strong>ant à responsabil<strong>is</strong>er les services déconcentrés<br />
permet de procéder à l’allocation optimale des ressources sur des bases plus tangibles.<br />
Tro<strong>is</strong>ième partie : Réforme des régimes et mécan<strong>is</strong>mes de prépaiement<br />
La réforme des régimes et des mécan<strong>is</strong>mes de prépaiement a pour objet un nouveau partage<br />
des responsabilités entre l'Etat, les entrepr<strong>is</strong>es et les ménages dans la pr<strong>is</strong>e en charge des<br />
dépenses de santé et entre le secteur public et le secteur privé dans l'offre de soins.<br />
30<br />
Données de l’« Enquête sur la Santé et la Réactivité du Système de Santé, 2004 », Min<strong>is</strong>tère de la Santé /<br />
DPRF / SEIS.<br />
31<br />
Ces structures sont local<strong>is</strong>ées dans quatre régions et sont destinées à la pr<strong>is</strong>e en charge médicale de toute la<br />
population marocaine. Leur pr<strong>is</strong>e en compte dans la répartition géographique des dépenses du Min<strong>is</strong>tère de la<br />
Santé tendrait vers la hausse les dépenses de ces régions et bia<strong>is</strong>erait toute tentative d’analyse.<br />
32<br />
Chaque direction (DP, DELM, DPRF, DEM, …) décide d’une méthode de répartition concernant un volet<br />
donné du budget du Min<strong>is</strong>tre de la Santé qu’elle gère.<br />
78
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Au Maroc, pays en voie de développement où la couverture sanitaire a toujours été considérée<br />
comme un privilège de certaines couches sociales qui ne dépassent guère 16% de la<br />
population, la réforme du système de santé a toutes les chances de participer au bien être des<br />
citoyens marocains en consolidant les acqu<strong>is</strong> des bénéficiaires actuels et en étendant leurs<br />
prestations à d'autres couches non encore couvertes.<br />
Ainsi, cette réforme qui a débuté depu<strong>is</strong> 2002, jouera un rôle restructurant dans le système de<br />
financement du secteur de santé marocain.<br />
Elle s’articule autour des deux principaux axes :<br />
• Réforme de la dépense publique<br />
• Extension de la couverture médicale<br />
Chapitre 1 : Réforme de la dépense publique<br />
Depu<strong>is</strong> le lancement par le Gouvernement du chantier de la réforme de la dépense publique,<br />
en vertu de la circulaire 12/2001 du 25 décembre 2001 de Monsieur le Premier Min<strong>is</strong>tre<br />
relative à « l'adaptation de la programmation et de l'exécution du budget de l’Etat dans le<br />
cadre de la déconcentration », le Min<strong>is</strong>tère de la Santé s’est approprié l’ensemble des outils<br />
développés dans le cadre des axes de la réforme (Global<strong>is</strong>ation des crédits, Partenariat,<br />
contractual<strong>is</strong>ation et CDMT) et a contribué activement à l’enrich<strong>is</strong>sement des débats et<br />
réflexions y afférents, tout en procédant en interne à une adaptation pointue de certains outils<br />
aux spécificités sectorielles du Min<strong>is</strong>tère.<br />
C’est ainsi qu’après avoir été le premier à mettre en œuvre la global<strong>is</strong>ation des crédits et la<br />
nouvelle procédure de partenariat avec les organ<strong>is</strong>mes non gouvernementaux (ONG), et après<br />
avoir réal<strong>is</strong>é un cycle d’expérimentation de la contractual<strong>is</strong>ation interne avec les régions<br />
sanitaires sur la base des premiers budgets programmes régionaux 2004-2006 ; le Min<strong>is</strong>tère<br />
de la santé a procédé à :<br />
• L’évaluation des premières expériences en matière de global<strong>is</strong>ation des crédits, de<br />
partenariat et de contractual<strong>is</strong>ation, ce qui a perm<strong>is</strong> de déceler les points forts à<br />
consolider et les lacunes à combler en vue de mener à bien le d<strong>is</strong>positif de la gestion<br />
axée sur les résultats m<strong>is</strong> en place par le Min<strong>is</strong>tère ;<br />
• L’élaboration avec l’appui de l’OMS d’une stratégie de contractual<strong>is</strong>ation interne dont<br />
le document a été validé dans un atelier de consensus ;<br />
• La conception avec l’Appui du FNUAP des outils méthodologiques et pédagogiques<br />
d’opérationnal<strong>is</strong>ation de la stratégie de contractual<strong>is</strong>ation interne et leur util<strong>is</strong>ation<br />
comme support à la préparation des nouveaux budgets programmes régionaux 2007-<br />
2009 ;<br />
• La préparation du CDMT-Santé en conformité avec l’approche méthodologique<br />
précon<strong>is</strong>ée et avec les choix stratégiques du département.<br />
Chapitre 2 : Extension de la couverture médicale<br />
Le Maroc s’est engagé dans la réforme du financement du système de la santé depu<strong>is</strong><br />
quelques années.<br />
La réforme du système marocain de la couverture médicale, permettrait à toute la population<br />
l'accès aux soins dans des conditions financières favorables et assurerait des revenus<br />
significatifs et durables aux producteurs des soins publics et privés, en accro<strong>is</strong>sant la part des<br />
mécan<strong>is</strong>mes collectifs dans le financement du système de santé.<br />
79
Financement des soins de santé au Maroc<br />
I/ Régime d’ass<strong>is</strong>tance médicale (RAMED)<br />
Dans la réforme projetée au Maroc, le RAMED représente le changement institutionnel<br />
majeur dans le financement du système de santé. Le RAMED est donc appelé à participer très<br />
fortement à la restructuration du système national de santé.<br />
Le RAMED, constitue le volet ass<strong>is</strong>tance ou aide sociale financé par la f<strong>is</strong>calité, dont l'objet<br />
est de prévenir l'exclusion des soins d'une partie de la population et renforcement de la<br />
protection sociale au Maroc.<br />
Il s'agit d'un filet social pour des personnes démunies dont la vulnérabilité économique les<br />
maintient hors du système contributif.<br />
Le RAMED constitue la seconde composante du système de couverture médicale de base<br />
prévu par la loi 65-00.<br />
Ce Régime, qui bénéficie aux personnes démunies non couvertes par un régime d'assurance<br />
maladie, est fondé sur les principes de l'ass<strong>is</strong>tance sociale et de la solidarité nationale. Son<br />
financement est assuré principalement par l'Etat et les collectivités locales et accessoirement<br />
par une contribution des bénéficiaires éligibles.<br />
Les d<strong>is</strong>positions de la loi 65-00 ainsi que les résultats saillants des études menées par des<br />
comm<strong>is</strong>sions instituées à cet effet, figurent ci-dessous :<br />
Population éligible :<br />
Aux termes des articles 116 à 119 de cette loi, la population des bénéficiaires des prestations du<br />
RAMED comprend :<br />
• les personnes économiquement faibles non assujetties à aucun régime d'assurance<br />
maladie obligatoire de base et ne d<strong>is</strong>posant pas de ressources suff<strong>is</strong>antes pour faire face<br />
aux dépenses inhérentes aux prestations médicales définies par le code de couverture<br />
médicale de base susmentionné. Le RAMED s'applique également aux membres de<br />
famille de ces personnes (conjoint, enfants légalement à charge et enfants handicapés) ;<br />
• les pensionnaires des établ<strong>is</strong>sements pénitentiaires, de bienfa<strong>is</strong>ance, orphelinats, hospices<br />
ou de rééducation, et de tout établ<strong>is</strong>sement public ou privé à but non lucratif hébergeant<br />
des enfants abandonnés ou adultes sans famille ;<br />
• les personnes sans domicile fixe ;<br />
• les personnes jou<strong>is</strong>santes, en vertu d'une lég<strong>is</strong>lation particulière, de la gratuité pour la<br />
pr<strong>is</strong>e en charge d'une ou plusieurs pathologies.<br />
La qualité de bénéficiaire de ce régime est prononcée, à la demande de l'intéressé, par<br />
l'Admin<strong>is</strong>tration dans les conditions et selon des modalités à fixer par voie réglementaire.<br />
Le bureau d’étude, qui a procédé à l’évaluation de la population totale éligible au RAMED, a<br />
estimé cette population, à partir des seuils officiels de pauvreté et de vulnérabilité de 2004, à<br />
8,5 millions de personnes. A ceux-ci s’ajoutent 100 000 qui sont des éligibles de droit.<br />
L’étude prévoit qu’en 2027 cette population ba<strong>is</strong>serait à 5 millions de personnes.<br />
Prestations garanties et conditions de pr<strong>is</strong>e en charge :<br />
Selon les d<strong>is</strong>positions de la loi 65-00, les personnes éligibles au RAMED bénéficient de la pr<strong>is</strong>e<br />
en charge totale ou partielle des fra<strong>is</strong> inhérents aux prestations médicalement requ<strong>is</strong>es suivantes :<br />
- les soins préventifs ;<br />
- les actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;<br />
- les soins relatifs au suivi de la grossesse, à l’accouchement et ses suites ;<br />
80
Financement des soins de santé au Maroc<br />
- les soins liés à l’hospital<strong>is</strong>ation et aux interventions chirurgicales y compr<strong>is</strong> les actes<br />
de chirurgie réparatrice ;<br />
- les analyses de biologie médicale ;<br />
- la radiologie et l’imagerie médicale ;<br />
- les explorations fonctionnelles ;<br />
- les médicaments et produits pharmaceutiques admin<strong>is</strong>trés pendant les soins ;<br />
- les poches de sang humain et ses dérivés ;<br />
- les d<strong>is</strong>positifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et<br />
chirurgicaux ;<br />
- les articles de prothèse et d’orthèse ;<br />
- la lunetterie médicale ;<br />
- les soins bucco-dentaires ;<br />
- les soins orthodontie pour les enfants ;<br />
- les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;<br />
- les actes paramédicaux ;<br />
- les évacuations sanitaires inter hospitalières.<br />
En outre, la pr<strong>is</strong>e en charge des fra<strong>is</strong> de santé, dans le cadre du RAMED ne peut intervenir que :<br />
dans les hôpitaux publics, établ<strong>is</strong>sements publics de santé et services sanitaires<br />
relevant de l'Etat ;<br />
si les prestations sont prescrites et admin<strong>is</strong>trées au Maroc.<br />
Sont exclus de la couverture garantie par le régime d'ass<strong>is</strong>tance médicale (RAMED) les<br />
interventions de chirurgie plastique et esthétique à l'exception des actes de chirurgie réparatrice<br />
et d'orthopédie maxillo-faciale médicalement requ<strong>is</strong>.<br />
A l’instar de l’AMO et dans le sens de la progressivité le panier de soins retenu pour le<br />
démarrage du RAMED est le panier de soins hospitalier. Il comprend toutes les prestations<br />
servies à l’hôpital public, à savoir :<br />
- Les hospital<strong>is</strong>ations<br />
- Les accouchements<br />
- Le passage aux urgences<br />
- Les consultations spécial<strong>is</strong>ées externes<br />
- Les analyses de biologie en externe<br />
- Les examens d'imagerie médicale en externe<br />
- et le suivi des ALD (Hémodialyse, Diabète, Tumeurs malignes, Insuff<strong>is</strong>ance<br />
cardiaque, etc.)<br />
Procédure admin<strong>is</strong>trative d’identification des indigents :<br />
La procédure d’identification de la population éligible au RAMED débute par le recueil des<br />
informations concernant le postulant à travers un formulaire.<br />
En effet, le postulant au bénéfice du RAMED doit déposer sa demande auprès de l’autorité<br />
admin<strong>is</strong>trative locale compétente du lieu de sa résidence, établie sur un formulaire défini par<br />
arrêté conjoint du Min<strong>is</strong>tre de l’Intérieur, du Min<strong>is</strong>tre Chargé des Finances et du Min<strong>is</strong>tre de<br />
la Santé. Ce formulaire comprend notamment les indications et les informations portant sur :<br />
- le milieu de résidence,<br />
- l’identification de la personne postulante,<br />
81
Financement des soins de santé au Maroc<br />
- les conditions socioéconomiques et les conditions de vie selon le milieu de résidence,<br />
- la déclaration de revenu,<br />
- la déclaration sur l’honneur attestant la véracité des informations fournies et le non<br />
bénéfice d’aucun régime d’assurance maladie obligatoire de base ou de toute autre<br />
couverture médicale de base, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit.<br />
D’autres questions sont ajoutées au formulaire pour faciliter la vérification de certaines<br />
informations déclarées par le postulant.<br />
Ce formulaire doit être accompagné des documents justificatifs dont la l<strong>is</strong>te est fixée par<br />
arrêté conjoint du Min<strong>is</strong>tre de l’Intérieur et du Min<strong>is</strong>tre de la Santé.<br />
Dès réception du formulaire de la demande et des documents l’accompagnant, l’autorité<br />
admin<strong>is</strong>trative locale procède à la vérification des documents et éléments d’information<br />
fourn<strong>is</strong> et délivre immédiatement au postulant un récép<strong>is</strong>sé. La vérification des documents et<br />
éléments d’information a pour objet de s’assurer de la complétude des informations fournies.<br />
Par la suite, l’autorité admin<strong>is</strong>trative locale compétente transmet le formulaire de la demande,<br />
accompagné des documents, à une comm<strong>is</strong>sion permanente locale, instituée dans le ressort<br />
territorial de chaque caïdat, arrond<strong>is</strong>sement ou pachalik d’une ville non découpée en annexes<br />
admin<strong>is</strong>tratives. Cette comm<strong>is</strong>sion permanente locale a pour m<strong>is</strong>sion :<br />
- Examiner les demandes du bénéfice du RAMED et vérifier les conditions et les<br />
critères d’éligibilité sur la base du revenu déclaré et des variables liées aux conditions<br />
de vie, des coefficients de pondération du revenu déclaré, des indices de calcul du<br />
score patrimonial ainsi que des indices de calcul des scores des conditions<br />
socioéconomiques.<br />
Elle peut, le cas échéant, inviter le postulant à fournir un complément d’informations<br />
ou diligenter une enquête sociale.<br />
- Statuer sur les demandes et transmettre la l<strong>is</strong>te des personnes reconnues éligibles au<br />
RAMED préc<strong>is</strong>ant le niveau de pr<strong>is</strong>e en charge, totale ou partielle selon le cas,<br />
accompagnée des procès verbaux, dûment signés par ses membres, à la comm<strong>is</strong>sion<br />
provinciale ou préfectorale.<br />
La comm<strong>is</strong>sion, en plus des représentants du Min<strong>is</strong>tère de l’Intérieur, s’étend aux autres<br />
départements notamment le Min<strong>is</strong>tère de la Santé, le Min<strong>is</strong>tère Chargé de l’Agriculture, le<br />
Min<strong>is</strong>tère Chargé des Finances et toute autre personne dont la contribution est jugée utile pour<br />
les travaux de la comm<strong>is</strong>sion.<br />
Quant à la comm<strong>is</strong>sion permanente provinciale ou préfectorale instituée dans chaque province<br />
ou préfecture, elle est chargée de :<br />
- Assurer la coordination, l’évaluation et le contrôle des comm<strong>is</strong>sions permanentes<br />
locales ;<br />
- Statuer sur les recours présentés contre les déc<strong>is</strong>ions des comm<strong>is</strong>sions permanentes<br />
locales et informer la comm<strong>is</strong>sion permanente locale de sa déc<strong>is</strong>ion ;<br />
- Arrêter la l<strong>is</strong>te globale des bénéficiaires du RAMED dans le ressort territorial de la<br />
province ou de la préfecture concernée y compr<strong>is</strong> les demandes retenues suite à un<br />
recours et assurer sa transm<strong>is</strong>sion aux services centraux des min<strong>is</strong>tères de l’Intérieur et<br />
de la Santé ;<br />
82
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Pour les personnes adm<strong>is</strong>es de droit au bénéfice de la pr<strong>is</strong>e totale des fra<strong>is</strong> des prestations de<br />
soins, en vertu de l’article 118 de la loi précitée n°65-00, les l<strong>is</strong>tes sont établies et dûment<br />
signées par le directeur de l’établ<strong>is</strong>sement dont relèvent ces personnes.<br />
Quant aux personnes sans domicile fixe, la l<strong>is</strong>te est établie par les soins de l’autorité<br />
admin<strong>is</strong>trative locale compétente dans le ressort de laquelle se trouve la personne concernée.<br />
Une carte d’ass<strong>is</strong>tance médicale serait attribuée aux personnes reconnues éligibles au<br />
RAMED qui doit indiquer le niveau de pr<strong>is</strong>e en charge dont bénéficient la personne concernée<br />
et ses ayants droit. Sa durée de validité serait de 3 ans.<br />
Modalités de pr<strong>is</strong>e en charge :<br />
La présentation de la carte d’ass<strong>is</strong>tance médicale est exigée lors de tout recours aux soins<br />
d<strong>is</strong>pensés par les hôpitaux publics civils et militaires, les établ<strong>is</strong>sements publics de santé et les<br />
services sanitaires relevant de l’Etat.<br />
Toutefo<strong>is</strong>, en cas d’hospital<strong>is</strong>ation en urgence, le patient est pr<strong>is</strong> en charge immédiatement à<br />
l’hôpital. Il lui incombe de fournir au cours ou à l’<strong>is</strong>sue de son séjour à l’hôpital, la carte<br />
d’ass<strong>is</strong>tance médicale ou, à défaut, le récép<strong>is</strong>sé de dépôt de la demande du bénéfice du<br />
RAMED auprès de l’autorité admin<strong>is</strong>trative locale du lieu de sa résidence.<br />
Sauf cas d’hospital<strong>is</strong>ation en urgence, tout patient titulaire de la carte d’ass<strong>is</strong>tance médicale<br />
est adm<strong>is</strong> à l’hôpital au vu de son carnet de santé et du document qui le réfère d’un service de<br />
santé relevant du réseau de soins de santé de base à l’hôpital dans le respect de la filière de<br />
soins hospitaliers et en fonction du médicalement requ<strong>is</strong> par son état de santé.<br />
Evaluation du coût de la pr<strong>is</strong>e en charge des économiquement démun<strong>is</strong> :<br />
L’estimation du coût du RAMED par une étude 33 selon le scénario optim<strong>is</strong>te 34 d’évolution de<br />
la population couverte, du recours aux soins et du coût réel ou du tarif officielle des<br />
prestations servies dans le cadre du panier de soins hospitalier, a abouti pour 2007, à un coût<br />
technique qui serait de 2,6 milliards de dirhams. A ce coût, il faut ajouter le coût admin<strong>is</strong>tratif<br />
qui découle des procédures d’affiliation des personnes éligibles et de paiement des<br />
prestataires, ainsi que du fonctionnement du système d’information associé. Selon l’étude, les<br />
fra<strong>is</strong> admin<strong>is</strong>tratifs du RAMED seraient de 10% du coût technique.<br />
Financement du RAMED :<br />
Comme prévu par la loi 65-00, le RAMED doit tirer ses ressources principalement du budget<br />
de l’Etat et des collectivités locales. A ces ressources s’ajouteraient :<br />
• la participation des bénéficiaires v<strong>is</strong>ée à l’article 120 de la loi 65-00 ;<br />
• les produits financiers, éventuellement ;<br />
• les dons et legs ;<br />
• toutes autres ressources affectées à ce régime en vertu de lég<strong>is</strong>lation ou de réglementation<br />
particulières.<br />
Selon les termes du code de couverture médicale de base, les contributions de l'Etat et des<br />
collectivités locales sont inscrites respectivement dans la loi de finances de chaque année et dans<br />
les budgets desdites collectivités. Pour ces dernières, la contribution au financement du RAMED<br />
constitue une dépense obligatoire.<br />
33 Actual<strong>is</strong>ation de la deuxième et de la quatrième étape de l’« l’Étude actuarielle relative au projet du Régime<br />
d'Ass<strong>is</strong>tance Médicale aux Économiquement Faibles » réal<strong>is</strong>ée, en 2001, par le Min<strong>is</strong>tère de la Santé.<br />
34 Scénario optim<strong>is</strong>te : évolution de la population potentiellement éligible au RAMED sur la base des objectifs de<br />
réduction arrêtés dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement.<br />
83
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Il est env<strong>is</strong>agé que la participation des bénéficiaires serait de deux ordres :<br />
• La contribution forfaitaire annuelle de l’ordre de 100 DHS par personne éligible avec<br />
un plafond de 500 DHS par ménage. Elle serait payée par les économiquement faibles<br />
relatifs alors que celle des économiquement faibles absolus sera supportée par les<br />
Collectivités Locales. Les simulations ont estimé les ressources découlant de cette<br />
contribution à :<br />
o Contribution des économiquement faibles relatifs : 420 millions de DHS.<br />
o Contribution des économiquement faibles absolus (supportée par les CL) :<br />
380 millions de DHS.<br />
• Le ticket modérateur de 10%, avec un plafond de 300 DHS à l’instar de ce qui est<br />
prévu par les conventions conclues entre les hôpitaux publics et les assureurs dans le<br />
cadre de la couverture des indépendants et aides art<strong>is</strong>ans « Inaya », sur toutes les<br />
prestations horm<strong>is</strong> les ALD et le passage aux urgences. Il est appliqué aussi bien pour<br />
les indigents absolus que pour les indigents relatifs. Les ressources de la contribution<br />
des économiquement faibles à travers le ticket modérateur seraient de 141 millions de<br />
DHS.<br />
Tableau 14 : Financement et montage financier du RAMED<br />
Montant en millions de<br />
DHS<br />
Budget du Min<strong>is</strong>tère de la Santé 1 048,00<br />
Économiquement faibles relatifs 421,00<br />
Collectivités Locales (Économiquement faibles absolus) 377,00<br />
Ticket modérateur 141,00<br />
Total 1 987,00<br />
Coût technique du RAMED 2 600,00<br />
GAP 613,00<br />
Source : Calcul de la comm<strong>is</strong>sion « Financement du RAEMD ».<br />
Il est proposé par le Min<strong>is</strong>tère des Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation de partager le gap entre<br />
l’Etat et les collectivités selon un rapport deux-tiers /un tiers, soit 409 millions de DHS pour<br />
l’Etat et 204 millions de DHS pour les Collectivités Locales.<br />
Le montage financier serait alors de :<br />
- Etat : 56%<br />
- Collectivités Locales : 22,4%<br />
- Bénéficiaires : 21,6%<br />
La gestion financière du RAMED :<br />
Outre ses principales m<strong>is</strong>sions d'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de<br />
base et de la m<strong>is</strong>e en place des outils de régulation du système, le lég<strong>is</strong>lateur a confié à l'Agence<br />
Nationale d’Assurance Maladie (ANAM) la gestion des ressources financières affectées au<br />
RAMED.<br />
Cette gestion doit être conforme aux conditions fixées par la loi 65-00 et par les textes pr<strong>is</strong> pour<br />
son application. A cet égard, il convient de préc<strong>is</strong>er que les opérations afférentes à la gestion<br />
84
Financement des soins de santé au Maroc<br />
financière du régime d'ass<strong>is</strong>tance médicale réal<strong>is</strong>ées par cette agence doivent faire l'objet d'une<br />
comptabilité d<strong>is</strong>tincte.<br />
Sachant que la gestion des ressources financières du RAMED est légalement de la<br />
compétence de l’ANAM, le RAMED en tant que régime ne débutera réellement qu’au début<br />
de l’année budgétaire. La m<strong>is</strong>e en œuvre du RAMED au titre de l’année 2008 cons<strong>is</strong>terait à<br />
tester l’application de la procédure d’identification et l’enreg<strong>is</strong>trement des bénéficiaires. Il<br />
reste par conséquent à :<br />
- Arrêter les modalités de recouvrement des contributions des bénéficiaires de la<br />
gratuité relative dont le paiement devra impérativement se faire avant l’octroi de la<br />
carte ;<br />
- Allouer à titre exceptionnel (comme cela a été le cas pour le démarrage de l’ANAM)<br />
une enveloppe budgétaire dédiée à financer les activités nécessaires à la préparation<br />
au démarrage du régime<br />
Opérationnalité du RAMED et test pilote :<br />
Afin de vérifier l’opérationnalité de la procédure d’identification et plus particulièrement des<br />
critères retenus par l’étude, le Min<strong>is</strong>tère de l’Intérieur a procédé au cours du 2 ème trimestre à la<br />
d<strong>is</strong>tribution et au rempl<strong>is</strong>sage de 54 formulaires dans 5 provinces.<br />
La sa<strong>is</strong>ie des informations contenues dans les formulaires a perm<strong>is</strong> de soulever des remarques<br />
quant à la qualité de rempl<strong>is</strong>sage des formulaires 35 . Après corrections des insuff<strong>is</strong>ances<br />
constatées, l’exploitation des données qui y figurent a perm<strong>is</strong> de déterminer la population<br />
éligible au RAMED parmi ces personnes.<br />
Par ailleurs, il est env<strong>is</strong>agé de poursuivre l’opérationnal<strong>is</strong>ation des critères d’éligibilité à<br />
travers des actions tests au niveau d’une autre région pilote avant de général<strong>is</strong>er l’opération à<br />
tout le pays.<br />
La m<strong>is</strong>e en œuvre du RAMED au niveau de cette dernière région devrait se faire, d’après les<br />
recommandations de la comm<strong>is</strong>sion intermin<strong>is</strong>térielle, selon les modalités suivantes :<br />
- La m<strong>is</strong>e en place de la comm<strong>is</strong>sion locale d’éligibilité<br />
- L’admin<strong>is</strong>tration des formulaires afin de :<br />
• Encadrer la procédure de d<strong>is</strong>pensation des certificats d’indigence<br />
• Identifier les deux catégories de bénéficiaires<br />
- La préparation des structures de soins à travers :<br />
• L’estimation des recours aux soins hospitaliers des indigents de cette<br />
région<br />
• L’estimation des dépenses du RAMED dans la même région<br />
Par ailleurs, des mesures d’accompagnement ont été identifiées afin de mener à bien cette<br />
opération. Il s’agit de :<br />
- L’appui budgétaire pour résorber le gap financier des hôpitaux dans cette région ;<br />
- La d<strong>is</strong>ponibilité des médicaments ;<br />
- Le renforcement en ressources humaines, principalement les postes clés (médecins et<br />
infirmiers dont les sages-femmes) ;<br />
35 Il s’est avéré, par exemple, nécessaire d’introduire des questions dans la partie réservée au milieu rural.<br />
85
Financement des soins de santé au Maroc<br />
- La d<strong>is</strong>ponibilité des générateurs de dialyse pour la pr<strong>is</strong>e en charge des malades sur l<strong>is</strong>te<br />
d’attente à travers le renforcement du centre de dialyse ex<strong>is</strong>tant dans cette région et la<br />
création d’un autre centre ;<br />
- La formation et la sensibil<strong>is</strong>ation des différents intervenants ;<br />
- La m<strong>is</strong>e en place d’une équipe de suivi et de superv<strong>is</strong>ion des opérations sous la<br />
présidence du Wali de cette région et avec la participation de représentants du Min<strong>is</strong>tère<br />
de la Santé, du Min<strong>is</strong>tère des Finances, du Min<strong>is</strong>tère de l’Intérieur et de l’ANAM.<br />
En parallèle, d’autres mesures sont en cours de m<strong>is</strong>e en place :<br />
- Élaboration des projets de textes d’application du code de la CMB relatifs au RAMED ;<br />
- M<strong>is</strong>e en place des comm<strong>is</strong>sions locales d’éligibilité (institution, désignation des<br />
membres et préc<strong>is</strong>ion du mandat desdites comm<strong>is</strong>sions) et final<strong>is</strong>ation des outils<br />
nécessaires à la m<strong>is</strong>e en œuvre du RAMED (formulaire, manuel de procédures, système<br />
d’information, etc.).<br />
La logique de progressivité adoptée dans la m<strong>is</strong>e en œuvre du RAMED se fera avec le<br />
maintien de la gratuité des programmes sanitaires et le renforcement des prestations offertes<br />
par les structures de soins de premier niveau.<br />
Compte tenu des déla<strong>is</strong> nécessaires pour la m<strong>is</strong>e en place du RAMED (constitution des<br />
comm<strong>is</strong>sions d'identification des populations éligibles, délivrance des cartes d'indigence, m<strong>is</strong>e<br />
en place d’un système d’information etc.) d'une part, et des possibilités budgétaires offertes<br />
d’autre part, on peut ra<strong>is</strong>onnablement admettre que ce régime atteindrait sa vitesse de<br />
cro<strong>is</strong>ière dans 2 à 3 ans et permettrait à terme à toute la population éligible au RAMED<br />
(indigents absolus et relatifs) d'être pr<strong>is</strong>e en charge dans les hôpitaux publics.<br />
II/ L’assurance maladie obligatoire au profit des travailleurs indépendants, les<br />
personnes exerçant une profession libérale et les aides art<strong>is</strong>ans<br />
Le paysage de la couverture maladie au Maroc s’articule autour de 3 composantes :<br />
- L’assurance maladie obligatoire (AMO) instituée par la loi n° 65-00 portant code de la<br />
couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3<br />
octobre 2002) qui couvre les personnels du secteur privé et du secteur public ainsi que<br />
leurs familles ;<br />
- Le régime d’ass<strong>is</strong>tance médicale (RAMED), institué par la loi n° 65-00 précitée, qui<br />
s’adresse aux personnes démunies ou à faible revenu ;<br />
- Le système de couverture médicale au profit du reste de la population (principalement les<br />
indépendants).<br />
L’AMO qui est entrée en vigueur depu<strong>is</strong> le 18 août 2005 et a commencé à servir les<br />
prestations à partir du début du mo<strong>is</strong> de mars 2007 concerne environ le tiers de la population<br />
marocaine.<br />
Le RAMED dont la m<strong>is</strong>e en place est en cours d’expérimentation dans certaines régions du<br />
Maroc s’adresse à environ 8,5 millions de marocains.<br />
Après, la final<strong>is</strong>ation de ces deux étapes, il a été entrepr<strong>is</strong> l’institution d’une couverture<br />
maladie obligatoire (Inaya) pour les travailleurs indépendants, qui exercent, pour leur propre<br />
compte, une activité génératrice de revenus, quelle que soit la nature de l'activité ou de<br />
revenus, les personnes exerçant une profession libérale et les aides art<strong>is</strong>ans exerçant une<br />
activité dans le secteur de l’art<strong>is</strong>anat et les membres de leurs familles, soit une population<br />
estimée à près de 10 millions de personnes.<br />
86
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Pour permettre de général<strong>is</strong>er à terme cette couverture à l’ensemble de la population ciblée,<br />
une loi instaurant l’obligation de d<strong>is</strong>poser d’une couverture médicale pour l’ensemble de ces<br />
personnes, à l’exception de ceux qui ne justifient pas d’un revenu supérieur à un seuil 36 qui<br />
sera fixé par voie réglementaire a été adoptée par le parlement avec ses deux chambres en<br />
juillet 2007. Les textes d’application de cette loi sont en cours de final<strong>is</strong>ation.<br />
Outre l’instauration de l’obligation de d<strong>is</strong>poser d’une couverture médicale auprès de sociétés<br />
d’assurances ou dans le cadre de mutuelles, cette loi n° 03-07 a fixé un panier de soins<br />
minimum que toute couverture doit comporter, à savoir :<br />
- les soins liés à l'hospital<strong>is</strong>ation et aux interventions chirurgicales ;<br />
- les soins liés au suivi des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de<br />
longue durée ;<br />
- les soins relatifs à l'accouchement.<br />
Malgré que la loi n’entrerait en vigueur qu’en 2008, la couverture est en cours de m<strong>is</strong>e en<br />
œuvre par les deux secteurs concernés.<br />
II.1. Le secteur des assurances<br />
Deux entrepr<strong>is</strong>es d’assurances ont présenté des offres de couverture à cette population qui<br />
cons<strong>is</strong>te en la m<strong>is</strong>e à la d<strong>is</strong>position de ces personnes des contrats d’assurances maladie<br />
individuels ou de groupes adaptés à leurs besoins.<br />
Les produits d’assurances constituant l’offre des deux entrepr<strong>is</strong>es assurent au moins le panier<br />
de soins prévu par la loi 03-07, couvrant les soins de santé relatifs aux maladies de longue<br />
durée, aux hospital<strong>is</strong>ations médicales et chirurgicales, à l’accouchement, aux hospital<strong>is</strong>ations<br />
de jour de type dialyse, etc.)<br />
Pour faciliter l’accès de ces personnes aux produits d’assurance ainsi qu’aux soins de santé et<br />
garantir le bon déroulement de la m<strong>is</strong>e en œuvre, le système implique des partenaires privés,<br />
des institutions publiques et le Min<strong>is</strong>tère de la Santé en tant que prestataire de soins.<br />
Des conventions entre les assureurs impliqués et les hôpitaux publics ont été conclues pour la<br />
pr<strong>is</strong>e en charge directe des soins à d<strong>is</strong>penser à ces personnes au niveau de ces hôpitaux.<br />
D’autres conventions ont été signées entre les partenaires pour préc<strong>is</strong>er les rôles de chacun<br />
dans le cadre de cette couverture, à savoir :<br />
- Les assureurs couvrent le r<strong>is</strong>que en garant<strong>is</strong>sant le remboursement ou la pr<strong>is</strong>e en charge<br />
en tiers payant des fra<strong>is</strong> engagés par les assurés ;<br />
- Barid Al Maghrib, agit, en tant qu’intermédiaire d’assurance ;<br />
- Les associations de micro-crédit interviennent comme souscripteurs de contrats au profit<br />
de leur clientèle assurant ainsi la proximité du service.<br />
Pour faciliter l’accessibilité financière des cot<strong>is</strong>ations pour ces personnes, deux mesures ont<br />
été prévues. La première cons<strong>is</strong>te en l’exonération des contrats d’assurances garant<strong>is</strong>sant le<br />
panier de soins obligatoire, de la taxe d’assurance (équivalente à 13,8% des primes) qui a été<br />
instituée par la loi de Finances pour l’année 2007. La deuxième mesure est apportée par le<br />
projet de loi modifiant et complétant la loi n° 18-97 relative au micro-crédit qui prévoit la<br />
possibilité pour les associations de micro-crédit d’octroyer à leurs clients des crédits dont<br />
l’objet est de financer les primes d’assurance. Ce projet de loi n° 04-07 a été adopté par le<br />
parlement au niveau de ses deux chambres en même temps que le projet de loi relative à<br />
l’obligation d’assurance.<br />
36 Ce seuil sera celui retenu pour l’éligibilité au RAMED.<br />
87
Financement des soins de santé au Maroc<br />
La population des bénéficiaires cible est estimée à 30 % de la population marocaine. Les tro<strong>is</strong><br />
premières années, il est attendu environ 500 000 assurés.<br />
Avec une cot<strong>is</strong>ation mensuelle moyenne de 50 DHS par assuré, cette couverture peut drainer<br />
des ressources annuelles d’environ 300 millions de DHS.<br />
II.2. Le secteur mutual<strong>is</strong>te<br />
Dans le cadre de ce projet (Inaya), des groupements professionnels ont présenté des projets de<br />
création de sociétés mutual<strong>is</strong>tes au profit de leurs membres.<br />
II.2.1. Les pharmaciens et professionnels de la santé<br />
La Mutuelle Générale des Pharmaciens et des Professionnels de la Santé v<strong>is</strong>e à couvrir les<br />
gros r<strong>is</strong>ques et les maladies graves et chroniques. Elle assure une couverture sans limite d’âge.<br />
Les bénéficiaires sont les pharmaciens, les professionnels de la santé et les membres de leur<br />
famille.<br />
Les statuts de cette société mutual<strong>is</strong>te ont été approuvés par arrêté conjoint du Min<strong>is</strong>tre chargé<br />
de l’Emploi et du Min<strong>is</strong>tre chargé des Finances. La m<strong>is</strong>e en place est en cours.<br />
Les cot<strong>is</strong>ations annuelles sont fixées forfaitairement à 2 000 DHS pour un adulte et 1 000<br />
DHS pour un enfant.<br />
La population des bénéficiaires potentiels est d’environ 4 000 adultes et 8 000 enfants.<br />
II.2.2. Les art<strong>is</strong>tes<br />
La Mutuelle Nationale des Art<strong>is</strong>tes qui est en projet, couvrirait les art<strong>is</strong>tes et leurs familles.<br />
Le panier de soins qui serait couvert par cette mutuelle comprend :<br />
- Honoraires médecins ;<br />
- Fra<strong>is</strong> pharmaceutiques ;<br />
- Fra<strong>is</strong> de laboratoire et de radiologie ;<br />
- Actes de spécialité et de pratique médicale ;<br />
- Traitements spéciaux ;<br />
- Hospital<strong>is</strong>ation chirurgicale ;<br />
- Hospital<strong>is</strong>ation médicale ;<br />
- Tuberculose, sanatorium, préventorium ;<br />
- Optique ;<br />
- soins dentaires et prothèse dentaire ;<br />
- Maternité et fra<strong>is</strong> prêt et post natal ;<br />
- Fra<strong>is</strong> du transport du malade à l’intérieur du Maroc.<br />
Pour l’année de démarrage, les prév<strong>is</strong>ions sont les suivantes :<br />
- La population à couvrir est estimée à environ 2 000 adhérents et 5 000<br />
bénéficiaires.<br />
- Le total des ressources s’élèverait à 5,5 millions de dirhams et le total des<br />
prestations est estimé à 5 ,2 millions de dirhams.<br />
II.2.3. Les avocats<br />
La Mutuelle Nationale des Avocats qui est en projet couvrirait les avocats (tous les barreaux)<br />
et leurs familles.<br />
Le panier de soins qui serait couvert par cette mutuelle comprend :<br />
- Médecine générale et spécialité médicale ;<br />
88
Financement des soins de santé au Maroc<br />
- Soins liés aux hospital<strong>is</strong>ations et aux interventions chirurgicales ;<br />
- Radiologie et imagerie médicale ;<br />
- Analyse de biologie médicale ;<br />
- Ass<strong>is</strong>tance médicale ;<br />
- Accouchements et ses suites ;<br />
- Pharmacie ;<br />
- Rééducation fonctionnelle et kinésithérapie ;<br />
- Optique.<br />
Pour l’année de démarrage, les prév<strong>is</strong>ions sont les suivantes :<br />
- La population à couvrir est estimée à environ 8790 adhérents et 16760<br />
bénéficiaires.<br />
- Le total des ressources s’élèverait à environ 20 millions de dirhams et le total<br />
des prestations est estimé à 16 millions de dirhams.<br />
III/ L’assurance maladie au profit d’autres catégories<br />
Pour des catégories de populations spécifiques, des couvertures ad-hoc sont en cours d’être<br />
m<strong>is</strong>es en place à leur profit.<br />
III.1. Les auxiliaires de l'autorité (Moqqaddems et Chioukhs)<br />
Un contrat d’assurance de groupe a été conclu au profit de cette population auprès d’une<br />
entrepr<strong>is</strong>e d’assurance qui est entré en vigueur au cours de 2007.<br />
La population concernée est estimée à 16 000 assurés et 40 000 bénéficiaires.<br />
Le panier de soins couvert concerne :<br />
• Remboursement ou pr<strong>is</strong>e en charge directe en mode de tiers payant d’une partie des<br />
fra<strong>is</strong> médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospital<strong>is</strong>ation conformément à la<br />
loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base (régime d’AMO géré par la<br />
CNOPS) ;<br />
• Pr<strong>is</strong>e en charge des fra<strong>is</strong> de transport médical et de garde ;<br />
• Pr<strong>is</strong>e en charge des ALD et ALC prévues par l’AMO.<br />
Sont exclues les maladies antérieures à la date d’adhésion.<br />
Les taux de pr<strong>is</strong>e en charge ou de remboursement sont identiques à ceux prévus par régime<br />
d’AMO géré par la CNOPS.<br />
Le bénéficiaire est totalement ou partiellement exonéré en cas d’ALD ou ALC de la part<br />
restant à sa charge selon le type de maladie, avec un maximum de 10% de la Tarification<br />
Nationale de Référence.<br />
L’exonération de la part restant à la charge du bénéficiaire est totale pour les soins onéreux.<br />
Le montant de la prime est de 1 680 DHS par an et par famille.<br />
III.2. Les Imams<br />
Une couverture médicale de base équivalente à celle qui est prévue par le régime d'assurance<br />
maladie obligatoire (AMO) géré par la CNOPS au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat,<br />
est offerte à cette population dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit et<br />
financé par le Min<strong>is</strong>tère des HABOUS.<br />
89
Financement des soins de santé au Maroc<br />
L'effectif de la population des Imams est de 41 755 personnes et les bénéficiaires avo<strong>is</strong>inent<br />
les 100 000 personnes.<br />
La prime s’élève à 1 680 DHS par an et par famille.<br />
III.3. Les Anciens rés<strong>is</strong>tants et anciens membres de l’Armée de libération<br />
Une couverture médicale de base équivalente à celle qui est prévue par le régime d'assurance<br />
maladie obligatoire (AMO) géré par la CNOPS au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat,<br />
est offerte à cette population dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit et<br />
financé par le Haut comm<strong>is</strong>sariat aux Anciens rés<strong>is</strong>tants et anciens membres de l’Armée de<br />
libération.<br />
La population concernée s’élève à 7 869 assurés et à plus de 30 500 bénéficiaires.<br />
La prime s’élève à 2 100 DHS par an et par famille.<br />
III.4. Les victimes de violation des droits de l’Homme<br />
La couverture médicale des personnes victimes de violation des droits de l’Homme et de leurs<br />
ayants droit, telles qu’elles sont recensées par le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme<br />
CCDH) dont la gestion est confiée à la CNOPS pour le compte de l’Etat, s’applique aux :<br />
- Victimes appelées « assurés » ayant subi des violations des droits de l’Homme durant les<br />
années 1956 et 1999, tel que recensées par le CCDH ;<br />
- Leur(s) conjoint (s) et les enfants à sa charge, âgés de 21 ans au plus. Cette limite d’âge<br />
est prorogée jusqu’à 26 ans pour les enfants non mariés poursuivant des études<br />
supérieures, à condition d’en apporter la justification.<br />
Sont considérées comme personnes à charge sans limite d’âge, les enfants de l’assuré atteints<br />
d’un handicap physique ou mental qui sont dans l’incapacité totale, permanente et définitive<br />
de se livrer à une activité rémunérée.<br />
- Le(s) conjoint(s) et les enfants d’une victime décédée, sous réserve des conditions d’âge<br />
et d’handicap énoncées aux paragraphes ci-dessus.<br />
Sont exclus du bénéfice de la « couverture médicale de base » objet de la présente<br />
convention :<br />
o Les victimes de violation des droits de l’Homme bénéficiant d’un régime<br />
d’assurance maladie obligatoire ou de tout autre couverture médicale de base<br />
en ra<strong>is</strong>on de leur état matrimonial ou de leur activité ;<br />
o Les victimes qui deviennent, postérieurement, bénéficiaires d’une couverture<br />
médicale de base ;<br />
o Les ascendants des personnes assurées.<br />
La couverture médicale de base garantit pour les assurés et leurs ayants droit, la couverture<br />
des r<strong>is</strong>ques et fra<strong>is</strong> de soins de santé inhérents à la maladie ou l’accident, à la maternité et à la<br />
réhabilitation physique et fonctionnelle.<br />
Cette couverture assure le remboursement et éventuellement la pr<strong>is</strong>e en charge directe des<br />
fra<strong>is</strong> des prestations de soins et de services qui leur sont d<strong>is</strong>pensées à titre ambulatoire ou en<br />
hospital<strong>is</strong>ation par les producteurs de soins publics et privés.<br />
Le contenu des prestations garanties, les niveaux de couverture ainsi que les conditions et<br />
modalités de remboursement ou de pr<strong>is</strong>e en charge des prestations par la CNOPS sont ceux<br />
appliqués aux assurés AMO auprès de cette ca<strong>is</strong>se.<br />
90
Financement des soins de santé au Maroc<br />
La CNOPS délivre une carte d’immatriculation à chacun des assurés dans un délai maximum<br />
de 30 jours à compter de la réception des dossiers complets.<br />
Le financement s’effectue au moyen d’une contribution à la charge exclusive de l’Etat.<br />
La contribution de l’Etat englobe la cot<strong>is</strong>ation à la prestation d’assurance maladie et les fra<strong>is</strong><br />
de gestion admin<strong>is</strong>trative de cette prestation.<br />
En cas de déficit technique, le niveau de cette contribution sera relevé.<br />
IV/ Population restant à couvrir<br />
IV.1. Les étudiants<br />
L’actual<strong>is</strong>ation de l’étude actuarielle élaborée en 2001 est en cours, pour estimer la population<br />
des étudiants qui seraient concernés par une couverture médicale dédiée à cette population, le<br />
panier de soins à garantir et le coût de la pr<strong>is</strong>e en charge de cette couverture.<br />
IV.2. Les professionnels du transport (propriétaires de véhicules de transport,<br />
titulaires d’agréments de transport, les chauffeurs, …)<br />
La couverture sociale de cette catégorie socio -professionnelle dont la couverture médicale<br />
fait l’objet d’une réflexion au sein d’une comm<strong>is</strong>sion auprès du Min<strong>is</strong>tère chargé du<br />
Transport.<br />
IV.3. Les personnes n’exerçant aucune activité et d<strong>is</strong>posant d’un revenu<br />
(rentiers,…)<br />
Aucun projet ni réflexion n’est initié concernant la couverture médicale de ces personnes.<br />
91
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Conclusion<br />
CONSTATS :<br />
Quelques indicateurs relatifs à l’année 2005 :<br />
Population générale : 30 millions de personnes avec 55% en milieu urbain<br />
% 20-60 ans : 52%<br />
% population > 60 ans : 8%<br />
Ratio de dépendance : 15%<br />
Population « actifs occupés » : 10,23 millions soit 34%<br />
Taux de chômage en milieu urbain : 18%<br />
Nombre de ménages : 5,7 millions<br />
Espérance de vie à la na<strong>is</strong>sance : 70 ans (en milieu urbain : 74 ans)<br />
PIB : 457 milliards DHS<br />
En dépit des efforts déployés par le secteur public et le développement rapide du<br />
secteur privé, la couverture sanitaire de la population, quantitativement modeste,<br />
connaît toujours les insuff<strong>is</strong>ances suivantes :<br />
Faible performance des établ<strong>is</strong>sements de soins publics, qui tient à plusieurs<br />
facteurs, notamment : les <strong>care</strong>nces en ressources humaines, une obsolescence<br />
des infrastructures et des équipements, la quasi-absence de maintenance des<br />
infrastructures et des équipements, l’insuff<strong>is</strong>ance et la mauva<strong>is</strong>e gestion des<br />
ressources financières, l’irrégularité dans l’approv<strong>is</strong>ionnement en médicaments<br />
et en consommables, et des comportements individuels peu compatibles avec<br />
les intérêts des usagers et le maintien d’un niveau minimal d’hygiène, ce<br />
qui,implique une certaine iniquité dans l’accès à des soins de qualité ;<br />
Absence de complémentarité entre l’offre publique et l’offre privée de soins.<br />
En effet, faute de carte sanitaire et de cadre réglementaire, l’offre de soins<br />
privée est de niveaux hétérogènes et ne correspond pas toujours aux besoins<br />
prioritaires des populations ;<br />
Faiblesses en matière de régulation, avec notamment l’absence de carte<br />
sanitaire ainsi que des déficiences en termes de gouvernance aussi bien dans le<br />
secteur public que privé, ce qui implique de grandes d<strong>is</strong>parités entre les<br />
milieux urbain et rural, entre les régions ma<strong>is</strong> aussi à l’intérieur de celles-ci ;<br />
Système de soins conna<strong>is</strong>sant des clo<strong>is</strong>onnements d’ordre fonctionnel et<br />
technique entre les niveaux ambulatoire et hospitalier et une insuff<strong>is</strong>ance<br />
notoire en personnel de santé particulièrement les médecins, les sages-femmes<br />
et les infirmiers insuff<strong>is</strong>ance en terme de capacité de formation et de<br />
recrutement par rapport aux besoins ;<br />
Besoins pressants dans certaines spécialités médicales et mauva<strong>is</strong>e répartition<br />
spatiale de la plupart d’entre elles.<br />
Le Min<strong>is</strong>tère de la Santé, dont les m<strong>is</strong>sions n'ont pas été redéfinies à l'occasion de la<br />
m<strong>is</strong>e en place de l’AMO, continue à jouer un rôle central en matière d’offre de soins,<br />
et en particulier pour les plus démun<strong>is</strong>. Par contre il s’est insuff<strong>is</strong>amment consacré à<br />
l’élaboration, l’adoption et la m<strong>is</strong>e en œuvre des outils de régulation nécessaires à<br />
92
Financement des soins de santé au Maroc<br />
l’util<strong>is</strong>ation optimale des ressources (carte sanitaire, régional<strong>is</strong>ation.). L’absence de<br />
régulation entrave la maîtr<strong>is</strong>e des dépenses de santé et l’adéquation de l’offre de soins<br />
aux besoins de santé de la population.<br />
La structure de financement des soins de santé globalement inéquitable, en particulier<br />
v<strong>is</strong>-à-v<strong>is</strong> des populations les plus démunies est aggravée par une insuff<strong>is</strong>ance des<br />
financements publics, ce qui contribue amplement à expliquer les difficultés d’accès<br />
aux soins en particulier pour ces populations : le paiement direct des ménages<br />
intervient pour 52% alors que les ressources f<strong>is</strong>cales (nationale ou locale) ne<br />
représentaient que 28% et l’assurance maladie 16%. De plus, la « social<strong>is</strong>ation » du<br />
financement des dépenses de santé concerne majoritairement les populations les plus<br />
favor<strong>is</strong>ées et celles vivant en zone urbaine.<br />
La m<strong>is</strong>e en œuvre de la CMB (AMO/INAYA/RAMED) constituerait une opportunité<br />
pour augmenter le financement collectif des soins de santé et en particulier dans le<br />
secteur public du fait des encouragements et obligations apportés par les<br />
réglementations rég<strong>is</strong>sant ces couvertures, d’un recours renforcé aux services publics<br />
hospitaliers.<br />
La couverture médicale de base est une démarche non intégrée due d’une part à<br />
l’application de la progressivité dans la m<strong>is</strong>e en œuvre de cette couverture au profit<br />
des différentes catégories de la population : L’assurance maladie obligatoire de base<br />
(AMO) instaurée au profit des salariés des secteurs public et privé (près de 34% de la<br />
population marocaine) est entrée en vigueur en 2006 ; Le régime d’ass<strong>is</strong>tance<br />
médicale (RAMED) conçu au profit des personnes démunies (près de 30% de la<br />
population marocaine) est en cours de final<strong>is</strong>ation ; et l’assurance maladie obligatoire<br />
de base au profit des travailleurs indépendants et des aides art<strong>is</strong>ans (Inaya) qui<br />
concerne près de 30% de la population marocaine et qui est en cours de m<strong>is</strong>e en place<br />
dans le cadre de contrats d’assurance ou de mutuelles. Et d’autre part au fait de la<br />
déc<strong>is</strong>ion que cette couverture util<strong>is</strong>e les structures ex<strong>is</strong>tantes, ce qui a engendré des<br />
contraintes quant à la sauvegarde des droits acqu<strong>is</strong> par les personnes bénéficiant d’une<br />
couverture dans le cadre de ces structures, avant l’avènement de la loi 65-00, ce qui a<br />
eu pour conséquences des couvertures de différents niveaux dont certaines<br />
n’englobent pas la totalité des soins de santé et portent essentiellement sur les gros<br />
r<strong>is</strong>ques (hospital<strong>is</strong>ations médicales et chirurgicales et suivi des affections longue durée<br />
(ALD) et des affections longues et coûteuses (ALC)). Ces contraintes ont généré la<br />
fragmentation de la population couverte et la multiplicité des régimes d’assurance<br />
avec différents niveaux de couverture (taux de couverture et panier de soins).<br />
Ainsi, si la création de systèmes spécifiques de couverture médicale pour chaque<br />
catégorie de personnes permet de prendre en considération leurs caractér<strong>is</strong>tiques et<br />
notamment leur capacité contributive et facilite l’extension de cette couverture, elle a<br />
aussi abouti à un système à plusieurs vitesses et a rendu difficile toute solidarité entre<br />
les catégories d’assurés.<br />
La pérennité du système est confrontée à différentes contraintes consécutives<br />
notamment :<br />
au vieill<strong>is</strong>sement de la population, impliquant l’augmentation des maladies<br />
liées à l’âge ;<br />
à la hausse de la demande de soins engendrée par l’amélioration de l’espérance<br />
de vie ;<br />
93
Financement des soins de santé au Maroc<br />
au renchér<strong>is</strong>sement du coût des soins de santé dû aux progrès techniques et à<br />
l’amélioration de l’accès aux soins de santé ;<br />
à la faible cro<strong>is</strong>sance des cot<strong>is</strong>ations qui dépend de l’évolution des revenus ;<br />
à la cro<strong>is</strong>sance du coût des prestations de soins toujours supérieure à celle des<br />
revenus ;<br />
à la limite de la rév<strong>is</strong>ion à la hausse des taux de contribution qui doivent rester<br />
compatibles avec la capacité contributive des opérateurs économiques tout en<br />
maintenant le niveau de couverture actuel, sachant que les bénéficiaires<br />
exerçeraient une pression pour améliorer le niveau de couverture.<br />
RECOMMANDATIONS :<br />
• Le Maroc se doit de d<strong>is</strong>poser d’un système de couverture médicale général<strong>is</strong>ée et<br />
cohérente, compatible avec la capacité contributive des opérateurs économiques.<br />
• Le système doit s’autofinancer et éviter d’interférer avec les finances publiques et en<br />
cas d’appel à des mécan<strong>is</strong>mes de solidarité, il est impératif de fixer des règles assurant<br />
la transparence et la pérennité de ces mécan<strong>is</strong>mes.<br />
• Le système doit util<strong>is</strong>er au mieux les ressources et les mécan<strong>is</strong>mes ex<strong>is</strong>tants et<br />
impliquer davantage le secteur privé (mutuelles et secteur des assurances).<br />
• La couverture complémentaire, offerte par les sociétés mutual<strong>is</strong>tes et les entrepr<strong>is</strong>es<br />
d’assurances doit être renforcée et mieux encadrée.<br />
• Il faut tendre vers un système de couverture unifiée ainsi que vers une couverture<br />
universelle. Si un système d’assurance maladie obligatoire de base a pour but de<br />
fournir la couverture universelle pour un panier essentiel de soins, une restructuration<br />
importante de l’architecture institutionnelle ex<strong>is</strong>tante et du cadre lég<strong>is</strong>latif et<br />
régulateur est nécessaire. Une fo<strong>is</strong> que le RAMED fonctionne et que l’AMI-Inaya<br />
devient pleinement fonctionnelle, l’harmon<strong>is</strong>ation des taux des primes, l’éligibilité, les<br />
paniers de soins et les taux de remboursement devraient progressivement être m<strong>is</strong> à<br />
exécution en vue d’une fusion « virtuelle » de tous les régimes d’assurance. Le<br />
processus d’harmon<strong>is</strong>ation comprendrait également la tarification nationale de<br />
référence négociée avec les prestataires de soins.<br />
• Des règles de bonnes gouvernance doivent aussi être instaurées aussi bien au niveau<br />
des prestataires de soins relevant du secteur public ou du secteur privé qu’au niveau<br />
des organ<strong>is</strong>mes chargés de la couverture médicale. La bonne gouvernance passe aussi<br />
par la nette séparation entre les m<strong>is</strong>sions de gestion du r<strong>is</strong>que, de gestion des<br />
prestations de soins et de régulation.<br />
• La réforme de la dépense publique, à savoir la global<strong>is</strong>ation des crédits, la<br />
contractual<strong>is</strong>ation et le partenariat, représente une opportunité pour l’amélioration des<br />
performances du département de la santé et sa préparation à la déconcentration. La<br />
contractual<strong>is</strong>ation (ou budget programme) en v<strong>is</strong>ant à responsabil<strong>is</strong>er les services<br />
déconcentrés permet de procéder à l’allocation optimale des ressources sur des bases<br />
plus tangibles.<br />
• Le défi majeur auquel sera confronté les structures de soins sera inévitablement la<br />
pression sur l’offre de soins par rapport à la demande induite par la m<strong>is</strong>e en œuvre de<br />
la CMB (AMO /RAMED/INAYA) sachant que la dotation actuelle en ressources<br />
94
Financement des soins de santé au Maroc<br />
log<strong>is</strong>tiques, technologiques et humaines fait difficilement face au faible niveau<br />
ex<strong>is</strong>tant de la demande pour les soins de santé.<br />
Pour la m<strong>is</strong>e en œuvre du RAMED :<br />
1. La réal<strong>is</strong>ation de la couverture universelle d’une manière équitable et financièrement<br />
équilibrée exige, en tout premier lieu, un consensus sur le contenu du panier de soins<br />
que le RAMED aura à couvrir, sur les critères d’éligibilité et sur le dosage optimal<br />
entre la capacité contributif du patient et viabilité budgétaire d’une part, et de l’autre,<br />
facilité d’admin<strong>is</strong>tration, possibilité d’application et commodité pour la clientèle en<br />
entrant et en sortant des deux catégories (i.e., les pauvres et les vulnérables)<br />
2. L’appui budgétaire pour résorber le gap financier des hôpitaux ;<br />
3. La d<strong>is</strong>ponibilité des médicaments au niveau des hôpitaux publics ;<br />
4. Le renforcement des hôpitaux en ressources humaines, principalement les postes clés<br />
(médecins et infirmiers dont les sages-femmes) ;<br />
5. La formation et la sensibil<strong>is</strong>ation des différents intervenants et final<strong>is</strong>ation aux<br />
différents outils nécessaires à la m<strong>is</strong>e en œuvre du RAMED (formulaire, manuel de<br />
procédures, système d’information, etc.) ;<br />
6. La m<strong>is</strong>e en place d’une équipe de suivi et de superv<strong>is</strong>ion des opérations<br />
d’identification des indigents.<br />
Par ailleurs, dans le cadre de la m<strong>is</strong>e en œuvre progressive du RAMED, il est nécessaire de<br />
donner la priorité, dans un 1 er temps, au panier hospitalier avec une amélioration du niveau<br />
des prestations offertes actuellement, à titre gratuit, par les structures de soins de première<br />
ligne (centres de santé). De plus, étant donné que le RAMED devrait être un régime résiduel,<br />
il est opportun de lancer au préalable les couvertures médicales à instaurer en faveur des<br />
personnes susceptibles de supporter une contribution tel le produit « Inaya ».<br />
95
Financement des soins de santé au Maroc<br />
Références bibliographiques<br />
- Ahmed AMAMOU, La mutualité au Maroc (CNOPS, mutuelles…..) : Problèmes et<br />
perspectives, juin 2001, Impression DAR AL QALAM.<br />
- Banque Mondiale, Aides Mémoire, 2000-2003.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé / Inspection Générale (2000), « Rapport sur l’appréciation du<br />
système d’approv<strong>is</strong>ionnement en médicament du Min<strong>is</strong>tère de la Santé », novembre,<br />
Rabat<br />
- MS/DPRF (2001), « Les Comptes Nationaux de la Santé », Rabat<br />
- MS/DPRF, Documents budgétaires<br />
- OMS / Min<strong>is</strong>tère de la Santé (2001), « Revue du Secteur Pharmaceutique au Maroc », J.<br />
Dumoulin et al., novembre, Rabat.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé, Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoire (2004),<br />
« Réforme hospitalière : Restructuration de la gestion financière et comptable dans les<br />
hôpitaux publics marocains », décembre, Rabat.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé / Direction de la Planification et des Ressources Financières,<br />
Documents budgétaires.<br />
- Les rapports d’activité des entrepr<strong>is</strong>es d’assurances et de réassurance 2002 -2006.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la santé / Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, « Fiche<br />
technique : Approv<strong>is</strong>ionnement des Centres Hospitaliers SEGMA en produits<br />
pharmaceutiques », non daté, Rabat.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé / Div<strong>is</strong>ion des Approv<strong>is</strong>ionnements, Documents divers, non daté,<br />
Rabat.<br />
- OMS, Les mutuelles communautaires de santé au Maroc : une expérience au service de la<br />
santé des populations, non daté.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé, Manuel des procédures de gestion admin<strong>is</strong>trative et économiques<br />
des hôpitaux, 1994.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé / Direction de la Réglementation et du Contentieux, Réglementation<br />
de la tarification applicable aux hôpitaux relevant du Min<strong>is</strong>tère de la Santé et aux centres<br />
hospitaliers, 1998.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé / Inspection Générale, « Rapport sur l’appréciation du système<br />
d’approv<strong>is</strong>ionnement en médicament du Min<strong>is</strong>tère de la Santé », novembre 2000, Rabat.<br />
- OMS / Min<strong>is</strong>tère de la Santé, « Revue du Secteur Pharmaceutique au Maroc », J.<br />
Dumoulin et al., novembre 2001, Rabat.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé, Santé : Etat actuel, tendances et orientations stratégiques, 2002.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé, Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoire , « Réforme<br />
hospitalière : Restructuration de la gestion financière et comptable dans les hôpitaux<br />
publics marocains », décembre 2004, Rabat.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la santé / Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, Guide de<br />
gestion des déchets des établ<strong>is</strong>sements de soins, Décembre 2004.<br />
96
Financement des soins de santé au Maroc<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé / Direction de la Planification et des Ressources Financières (2001),<br />
« Les Comptes Nationaux de la Santé », 2005, Rabat.<br />
- Min<strong>is</strong>tère des Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation, Guide de la réforme budgétaire : La nouvelle<br />
approche budgétaire axée sur les résultats et intégrant la dimension genre, 2005.<br />
- Min<strong>is</strong>tère des Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation, La Nouvelle Approche Budgétaire axée sur<br />
les résultats, Revue Trimestrielle Al Maliya n°39, Septembre 2006.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé / Direction de la Planification et des Ressources Financières, La<br />
Stratégie de contractual<strong>is</strong>ation interne avec les régions sanitaires basée sur l’approche<br />
« Budget-programme », Juin 2006.<br />
- Min<strong>is</strong>tère des Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation / Direction du Budget, Cadre de dépense à<br />
moyen terme-CDMT : Guide méthodologique, Juin 2006.<br />
- Min<strong>is</strong>tère des Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation, La Budgét<strong>is</strong>ation Sensible au Genre : Un<br />
outil d’amélioration de l'équité et de l’efficacité de la gouvernance économique, Revue<br />
Trimestrielle Al Maliya n°38, Juin 2006.<br />
- Min<strong>is</strong>tère des Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation, La nouvelle approche budgétaire : La gestion<br />
axée sur les résultats, Revue Trimestrielle Al Maliya n°33, Juin 2006.<br />
- OMS, Les mutuelles communautaires au Maroc : Principales leçons des expériences<br />
menées à ce jour, mars 2006<br />
- D. Tommasi, Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) : Eléments pour un manuel de<br />
procédure, 12 mars 2006.<br />
- OCDE, La gestion axée sur les résultats de développement – Des principes à l’action :<br />
Document de référence sur les bonnes pratiques émergentes, 2006<br />
www.mfdr.org/Sourcebook.html<br />
- Le bulletin de la CNOPS, Skhirat 26-27 mars 2007.<br />
- OMS, Guide de la Gestion basée sur les Résultats pour l’élaboration des plans Pays, 2006.<br />
- Min<strong>is</strong>tère des Finances et de la Privat<strong>is</strong>ation, La réforme du contrôle de la dépense<br />
publique, Revue Trimestrielle Al Maliya n°3, Février 2007.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la Santé / Direction de la Planification et des Ressources Financières,<br />
Situation sanitaire au Maroc à la veille de 2006, avril 2007.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la santé / Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, Projet pilote -<br />
Mutuelles communautaires - Rapport d’étape, Juin 2007.<br />
- Min<strong>is</strong>tère de la santé / Santé : V<strong>is</strong>ion 2020, Septembre 2007.<br />
97
Financement des soins de santé au Maroc<br />
ANNEXES<br />
98
Financement des soins de santé au Maroc<br />
ANNEXE I<br />
LES SOCIETES MUTUALISTES AU MAROC EN 2005<br />
Sociétés mutual<strong>is</strong>tes et leur union : Secteur public<br />
Société mutual<strong>is</strong>te Date de<br />
création<br />
Date<br />
d'approbation<br />
des statuts<br />
Adhérents Bénéficiaires<br />
MFAR 1958 1969 280 346 913 138<br />
MGPAP 1946 1970 306 920 844 696<br />
MGEN 1963 1968 4 385 15 285<br />
OMFAM 1929 1969 156 720 481 838<br />
FRATERNELLE DE POLICE 1919 1969 66 290 188 647<br />
MDII 1928 1968 6 908 32 668<br />
MODEP 1996 1996 10 565 29 373<br />
MFA 1976 1976 92 045 290 487<br />
MGPT 1946 1972 25 775 78 673<br />
1 216 664 3 642 401<br />
Union Date de<br />
création<br />
CNOPS (mutuelles du secteur<br />
public à l'exception de la<br />
MFAR) +MODEP<br />
1950<br />
Sociétés mutual<strong>is</strong>tes : Autres secteurs d'activités<br />
Société mutual<strong>is</strong>te Date<br />
de création<br />
Date<br />
d'approbation<br />
des statuts<br />
1970<br />
Date<br />
d'approbation<br />
des statuts<br />
Adhérents Bénéficiaires<br />
CMCAS 1968 1968 15 500 52 650<br />
MAMT 1969 1969 4 385 15 285<br />
MPBP 1985 1989 7 987 25 834<br />
MUPRAS 1973 1973 5 728 21 049<br />
MAS 1972 1972 12 521 50 000<br />
MPSC 1987 1987 19 470 30 847<br />
65 591 195 665<br />
Société mutual<strong>is</strong>te Date Date d'approbation Adhérents Bénéficiaires<br />
de création des statuts<br />
CMIM<br />
Ca<strong>is</strong>se de secours<br />
1977 1977 20 972 69 138<br />
IMINI<br />
1968<br />
1968<br />
227 1 577<br />
TUYAUTO 1984 1984 125 556<br />
LIMADET -Ferry 1985 1985 146 689<br />
21 470 71 960<br />
99
Financement des soins de santé au Maroc<br />
ANNEXE II<br />
LES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE<br />
EN ACTIVITE AU MAROC EN 2006 (*)<br />
(En millions de dirhams)<br />
Entrepr<strong>is</strong>es d'Assurances et Capital Primes Prestations Prov<strong>is</strong>ions Placements<br />
de réassurance social ém<strong>is</strong>es et fra<strong>is</strong> techniques<br />
(1) (2) payés (3) (4) (5)<br />
Atlanta (6) 116,00 844,09 501,15 3 144,07 3 198,21<br />
Axa Assurance Maroc (6) 900,00 2 393,02 1 529,15 13 143,55 12 513,92<br />
Axa-Ass<strong>is</strong>tance Maroc 50,00 17,74 2,44 0,00 49,80<br />
CNIA Assurance (6) 210,00 1 207,17 832,26 6 595,35 6 316,98<br />
Compagnie d’Assurances<br />
Transport<br />
162,66 588,69 379,46 4 515,47 3 628,09<br />
Essaada (6) 107,59 929,93 577,28 3 704,44 1 240,82<br />
Euler Hermes Acmar 50,00 29,22 8,42 38,01 50,37<br />
Issaf Mondial Ass<strong>is</strong>tance 50,00 167,20 53,88 56,74 56,03<br />
La Marocaine Vie (6) 183,75 556,05 232,94 2 891,24 2 442,98<br />
Maroc Ass<strong>is</strong>tance<br />
International<br />
50,00 202,65 132,62 78,96 89,62<br />
Mutuelle Agricole<br />
Marocaine d’Assurances (6)<br />
100,00 305,07 126,25 1 469,20 2 495,24<br />
Mutuelle Centrale<br />
Marocaine d’Assurances (6)<br />
100,00 430,88 238,66 2 541,73 3 977,87<br />
Mutuelle d'Assurances des<br />
Transporteurs Un<strong>is</strong><br />
51,62 206,95 189,85 1 365,01 1 389,19<br />
Royale Marocaine<br />
d’Assurances-Alwatanya (6)<br />
1 796,17 3 055,34 1 572,22 15 712,78 14 544,64<br />
Sanad (6) 125,00 956,54 540,90 3 102,66 2 995,95<br />
Wafa Assurance (6) 350,00 2 389,96 1 171,60 9 801,84 9 944,09<br />
Zurich Compagnie<br />
Marocaine d'Assurances (6)<br />
90,00 503,62 260,80 1 710,03 1 771,07<br />
TOTAL 4 492,79 14 784,12 8 349,88 69 871,09 66 704,87<br />
Société Centrale de<br />
Réassurance<br />
(*) Chiffres prov<strong>is</strong>oires<br />
1) Ou fonds d'établ<strong>is</strong>sement<br />
1 000,00 1 834,19 1 464,95 8 918,70 7 577,73<br />
2) Nettes d'annulations (y compr<strong>is</strong> les acceptations)<br />
3) Nets de recours<br />
4) Prov<strong>is</strong>ions de capital<strong>is</strong>ation compr<strong>is</strong>e<br />
5) Placements affectés aux opérations d'assurances (Compte 26 du bilan actif, colonne exercice brut)<br />
6) Entrepr<strong>is</strong>es pratiquant l'opération d'assurance "Maladie -Maternité"<br />
Source : Situation liminaire du secteur des assurances au Maroc en 2006- DAPS-MFP.<br />
100