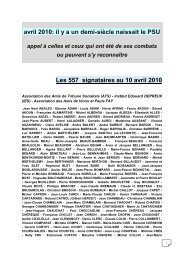Jacqueline Giraud - l'Express n° 874, 18-24 mars 1968. - esu-psu-unef
Jacqueline Giraud - l'Express n° 874, 18-24 mars 1968. - esu-psu-unef
Jacqueline Giraud - l'Express n° 874, 18-24 mars 1968. - esu-psu-unef
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
M. JACQUES BALLAND.<br />
Fini, les fils de bourgeois<br />
Les vieux interdits. MÖme si<br />
elles sont en retrait sur les<br />
revendications actuelles de<br />
l'U.N.E.F. et :de la F.R.U.F. : -— qui<br />
jugent Ä Å la toutepuissance<br />
de dÇcision laissÇe au<br />
directeur — ces concessions ont<br />
ramenÇ le calme É Antony. Sans<br />
pour autant en faire le lieu de<br />
dÇsordre et de perdition que<br />
prÇdisaient les esprits chagrins.<br />
Depuis deux ans, au mÇpris du<br />
rÑglement officiel, les Çtudiants<br />
peuvent vivre É Antony. Mais pas<br />
dans les autres rÇsidences<br />
franàaises.<br />
Ä Le problÑme des rÇsidences, dit<br />
M. Balland, c'est, au fond, celui de<br />
la dÇmocratisation de<br />
l'enseignement. Autrefois, les<br />
facultÇs n'accueillaient que les fils<br />
de bourgeois qui vivaient dans leur<br />
famille ou avaient les moyens de<br />
s'installer en ville. Aujourd'hui,<br />
l'accÑs aux facultÇs est plus ouvert,<br />
et l'on convient qu'il faut permettre<br />
aux Çtudiants sans fortune de se<br />
loger en citÇ. Mais si l'on maintient<br />
les vieux interdits de dÇfense de la<br />
bourgeoisie, cela veut dire qu'on<br />
refuse aux Çtudiants issus des<br />
milieux modestes la possibilitÇ<br />
d'une vÇritable initiation civique.<br />
Encore une fois il faut Ötre logique.<br />
Le problÑme des Çtudiants rappelle<br />
celui de la dÇcolonisation. Il faut<br />
dÇparternaliser. Å<br />
Sur ce mot d'ordre, les Çtudiants<br />
sont tous d'accord. Parce que le<br />
paternalisme des institutions<br />
universitaires est en flagrante<br />
contradiction avec une maturitÇ de<br />
plus en plus prÇcoce. On brime<br />
encore les Çtudiants quand, dÇjÉ, la<br />
rÇvolte gagne les lycÇes. Quand le<br />
cinÇma et, surtout, la tÇlÇvision<br />
mettent dÇsormais les jeunes face<br />
aux rÇalitÇs, É la guerre du Vietnam<br />
et aux Çmeutes noires, aux dÇbats<br />
politiques et aux exploits<br />
scientifiques. La sociÇtÇ de<br />
consommation a dÇcouvert en eux<br />
une clientÑle. Elle leur reconnaét le<br />
droit d'acheter. Elle voudrait leur<br />
dÇnier les autres.<br />
Le fer de lance. Conflit des<br />
gÇnÇrations, la lutte dans les<br />
rÇsidences est d'abord cela. Mais<br />
pour une fraction des Çtudiants, elle<br />
est plus que cela. Si le rÑglement<br />
des campus est en contradiction<br />
avec la dÇmocratisation de<br />
l'enseignement, ils jugent que ce<br />
n'est pas un hasard, mais l'une des<br />
multiples manifestations de la nondÇmocratisation<br />
rÇelle de<br />
l'enseignement.<br />
C'est ce qu'illustre bien l'histoire<br />
mouvementÇe de Nanterre. A sa<br />
crÇation, il y a quatre ans, cette<br />
facultÇ a soulevÇ de grands espoirs.<br />
Ce devait Ötre le lieu d'expÇrimentation<br />
d'un enseignement<br />
renouvelÇ, l'esquisse de l'UniversitÇ<br />
de demain. De cÇlÑbres professeurs<br />
ont volontairement quittÇ la<br />
Sorbonne pour participer É la<br />
Grande Aventure. Aujourd'hui, cette<br />
facultÇ neuve suinte dÇjÉ l'ennui et<br />
la vieillesse des H.L.M. immÇdiatement<br />
fanÇs. Des murs sales, un<br />
hall kafkaèen qui Çvoque<br />
irrÇsistiblement la froideur vÇtuste<br />
de la salle des pas perdus de la gare<br />
Saint-Lazare. Une architecture<br />
sarcellienne dressÇe dans un<br />
immense chantier boueux. Un<br />
horizon : les bidonvilles. Un bruit<br />
de fond : les grues, les camions et<br />
les marteaux-piqueurs sur le<br />
chantier du mÇtro express.<br />
Ä Il ne suffit pas d'utiliser du<br />
bÇton et du verre pour faire du<br />
moderne, nous dit un Çtudiant en<br />
sociologie. Dans sa conception —avec<br />
ses amphis de 900 places —<br />
Nanterre reprend ce qu'il y É de plus<br />
vieux dans l'enseignement franàais.<br />
Et quelle misÑre architecturale ! Å<br />
Ironique, il me montre le Ä club<br />
des professeurs Å : vaste salle vitrÇe,<br />
calme, pastel, fauteuils profonds et<br />
tables basses. Ä C'est ici que pensent<br />
les professeurs. Pour nous, c'est É<br />
cátÇ. Å A cátÇ : une piÑce aveugle,<br />
cernÇe de machines É distribuer<br />
boissons et nourritures, oÜ les<br />
Çtudiants s'entassent, debout, entre<br />
les cours.<br />
GrÄve sauvage. AprÑs quatre ans<br />
d'existence, Nanterre est dÇjÉ le<br />
tombeau des illusions perdues,<br />
noyÇes sous l'avalanche dÇmographique.<br />
En 1964, Nanterre<br />
accueillait 2 300 Çtudiants. Cette<br />
annÇe, elle a dê en absorber 12 000.<br />
Une rentrÇe difficile : faute de<br />
professeurs, des cours, des travaux<br />
pratiques ont dê Ötre supprimÇs.<br />
Le 17 novembre, les Çtudiants en<br />
sociologie lancent un mot d'ordre de<br />
grÑve, en accord avec leurs<br />
professeurs. Mais c'est une Ä grÑve<br />
sauvage Å, pas une occasion de<br />
prendre des vacances. Les Çtudiants<br />
sont lÉ, mais au lieu de suivre les<br />
cours, ils veulent discuter de leurs<br />
problÑmes avec les professeurs et<br />
les responsables universitaires. Le<br />
mouvement gagne l'ensemble de la<br />
facultÇ et se poursuit dix jours<br />
durant. Il se termine sur la<br />
constitution d'une commission<br />
mixte (Çtudiants, professeurs)<br />
chargÇe d'Çlaborer les propositions<br />
communes É soumettre au ministÑre.<br />
Ici comme en r Çsidence<br />
s'affirme cette volontÇ de ne plus<br />
simplement subir — un rÑglement<br />
de citÇ, une rÇforme de l'enseignement<br />
— mais de participer.<br />
Au-delÉ de ce dÇsir commun, les<br />
contradictions commencent. Pour la<br />
majoritÇ des Çtudiants de Nanterre,<br />
la grÑve ne remettait pas en cause le<br />
principe de la rÇforme Fouchet.<br />
Mais ses modalitÇs : travaux<br />
pratiques surchargÇs, manque de<br />
bibliothÑques, problÑme des<br />
Çquivalences entre l'ancien et le<br />
nouveau rÇgime, inquiÇtude sur les<br />
dÇbouchÇs. Maintenant que la<br />
commission mixte leur permet de<br />
discuter de ces problÑmes, ils sont<br />
satisfaits. Et ils condamnent les<br />
autres, les minoritÇs agissantes qui<br />
n'ont pas dÇsarmÇ.<br />
Cahots. Pour ceux-lÉ, en effet, le<br />
problÑme n'est pas d'adoucir les<br />
cahots qu'entraéne la mise en place<br />
du plan Fouchet. Il s'agit de refuser<br />
cette rÇforme Ä technocratique Å<br />
dans laquelle ils dÇnoncent<br />
l'asservissement de l'UniversitÇ aux<br />
besoins immÇdiats de l'industrie,<br />
Cette contestation-lÉ, c'est É peine<br />
si elle s'Çbauche, dans un monde<br />
Çtudiant dÇsorganisÇ, ces derniÑres<br />
annÇes, par la crise de I'U.N.E.F., la<br />
crise de l'U.E.C. (Union des<br />
Çtudiants communistes). Au<br />
lendemain de la guerre d'AlgÇrie,<br />
les Çtudiants franàais, comme les<br />
adultes, se sont endormis dans le<br />
LES ãTUDIANTS FRANëAIS DE 1945 í <strong>1968.</strong>