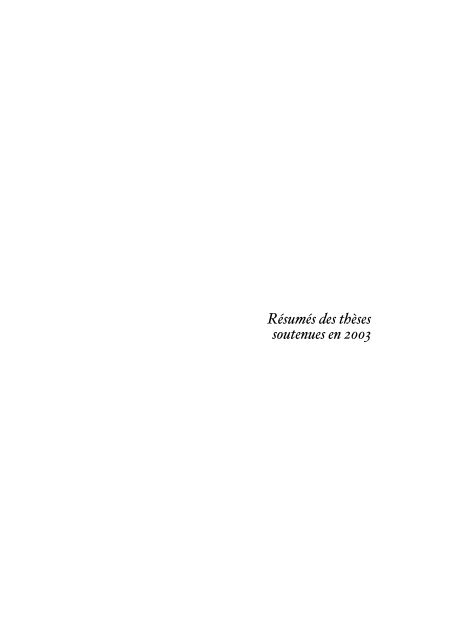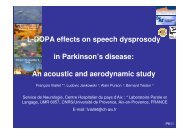Résumés des thèses soutenues en 2003 - Laboratoire Parole et ...
Résumés des thèses soutenues en 2003 - Laboratoire Parole et ...
Résumés des thèses soutenues en 2003 - Laboratoire Parole et ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Résumés</strong> <strong>des</strong> <strong>thèses</strong><br />
<strong>sout<strong>en</strong>ues</strong> <strong>en</strong> <strong>2003</strong>
LES CONSTRUCTIONS PREPOSITIONNELLES CHEZ LES APPRENANTS<br />
DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE AU GABON : ETUDE DIDACTIQUE<br />
Jean-Aimé PAMBOU<br />
Thèse dirigée par Jean-Pierre Cuq, sout<strong>en</strong>ue le 26 septembre <strong>2003</strong>.<br />
Les appr<strong>en</strong>ants du Gabon utilis<strong>en</strong>t de manière particulière les prépositions françaises. Il <strong>en</strong><br />
eff<strong>et</strong> remarquable que là où la préposition est att<strong>en</strong>due, les appr<strong>en</strong>ants ne la produis<strong>en</strong>t<br />
pas ; là où elle n’est pas att<strong>en</strong>due, elle apparaît ; là où une forme est att<strong>en</strong>due, une autre est<br />
plutôt r<strong>en</strong>due, <strong>et</strong>c. S’il est facile d’étiqu<strong>et</strong>er toutes les constructions qui n’<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t pas dans<br />
les modèles att<strong>en</strong>dus au moy<strong>en</strong> <strong>des</strong> vocables « fautes » ou « erreurs », nous avons choisi<br />
d’analyser ces constructions avant de formuler <strong>des</strong> propositions concrètes dans le cadre de<br />
l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> prépositions françaises <strong>en</strong> classe de français langue seconde au Gabon.<br />
Notre hypothèse c<strong>en</strong>trale est que, loin d’être de simples erreurs, ces constructions<br />
prépositionnelles particulières correspond<strong>en</strong>t à une variété de français que nous avons<br />
appelée « lecte <strong>des</strong> appr<strong>en</strong>ants ». Pour t<strong>en</strong>ter de vérifier c<strong>et</strong>te hypothèse, nous nous<br />
sommes r<strong>en</strong>du sur le terrain, afin de recueillir <strong>des</strong> productions linguistiques <strong>des</strong><br />
appr<strong>en</strong>ants, puis de décrire <strong>et</strong> d’expliquer l’usage <strong>des</strong> prépositions françaises r<strong>en</strong>contrées.<br />
Cela nous a conduit dans cinq <strong>des</strong> neuf provinces du Gabon : l’Estuaire, le Haut-Ogooué,<br />
le Moy<strong>en</strong>-Ogooué, la Nyanga <strong>et</strong> le Woleu-Ntem.<br />
Quatre parties principales ont ponctué notre étude : le cadre socio-didactique, la<br />
prés<strong>en</strong>tation de l’<strong>en</strong>quête <strong>et</strong> du corpus, l’analyse du corpus <strong>et</strong> les propositions <strong>et</strong> bilan du<br />
travail.<br />
La situation socio-didactique nous a permis de déterminer les cadres sociolinguistique <strong>et</strong><br />
didactique de notre recherche. S’agissant du cadre sociolinguistique, nous avons d’abord<br />
montré le caractère particulièrem<strong>en</strong>t privilégié du français. Nous avons <strong>en</strong>suite décrit le<br />
plurilinguisme <strong>en</strong>dogène, qui ne favorise pas l’émerg<strong>en</strong>ce d’une langue locale dominante.<br />
Le statut particulièrem<strong>en</strong>t privilégié du français est remarquable à triple point de vue :<br />
sur le plan officiel, c’est la seule langue clairem<strong>en</strong>t id<strong>en</strong>tifiée, pourvue d’un statut<br />
juridique ; sur le plan <strong>des</strong> échanges quotidi<strong>en</strong>s, c’est la langue véhiculaire à l’échelle<br />
nationale <strong>et</strong> sur le plan du développem<strong>en</strong>t cognitif <strong>et</strong> intellectuel, elle devi<strong>en</strong>t la langue de<br />
référ<strong>en</strong>ce d’un nombre non négligeable d’appr<strong>en</strong>ants vivant au Gabon. Le cadre<br />
sociolinguistique nous a égalem<strong>en</strong>t donné l’opportunité de r<strong>en</strong>dre compte de l’exist<strong>en</strong>ce
d’une soixantaine de variétés linguistiques réparties <strong>en</strong> douze grands groupes inégalem<strong>en</strong>t<br />
constitués. En travaillant avec les sources disponibles sur les prépositions dans les langues<br />
gabonaises, nous avons constaté le caractère très limité <strong>des</strong> morphèmes prépositionnels <strong>et</strong><br />
le fait que plusieurs prépositions françaises puiss<strong>en</strong>t être r<strong>en</strong>dues par un nombre très<br />
réduit de prépositions issues <strong>des</strong> langues gabonaises. Dans l’hypothèse <strong>des</strong> interfér<strong>en</strong>ces<br />
linguistiques, cela suppose qu’il y aurait suppression massive <strong>des</strong> prépositions françaises <strong>et</strong><br />
donc très peu, ou pas du tout, d’ajouts de prépositions ; de même qu’il y aurait<br />
substitution de plusieurs prépositions françaises att<strong>en</strong>dues par un nombre très réduit de<br />
morphèmes prépositionnels.<br />
Quant au cadre didactique, nous avons développé celui du français langue seconde, lui-même<br />
dép<strong>en</strong>dant de la didactique du français langue étrangère, qui est à son tour une branche de la<br />
didactique <strong>des</strong> langues <strong>et</strong> <strong>des</strong> sci<strong>en</strong>ces du langage. La didactique empruntant à d’autres<br />
disciplines, nous avons pu nous interroger sur l’influ<strong>en</strong>ce <strong>des</strong> faits sociolinguistiques, sur celle<br />
de la situation de communication <strong>et</strong> sur celle <strong>des</strong> représ<strong>en</strong>tations dans la production <strong>des</strong><br />
constructions prépositionnelles <strong>des</strong> appr<strong>en</strong>ants <strong>et</strong> dans le cadre général de la transposition<br />
didactique. Celle-ci apparaît, à nos yeux, comme l’espace indiqué pour traiter <strong>des</strong><br />
constructions prépositionnelles sans a priori de type normatif.<br />
Abordant la deuxième partie, nous avons successivem<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>té la manière dont nous<br />
avons m<strong>en</strong>é notre <strong>en</strong>quête <strong>et</strong> le corpus que nous avons pu constituer à ce suj<strong>et</strong>.<br />
L’<strong>en</strong>quête a été marquée par quatre temps principaux : la pré-<strong>en</strong>quête, l’<strong>en</strong>quête<br />
principale, l’<strong>en</strong>quête subsidiaire (1) <strong>et</strong> l’<strong>en</strong>quête subsidiaire (2). S’agissant <strong>des</strong> trois<br />
premières étapes, les informateurs devai<strong>en</strong>t interv<strong>en</strong>ir aussi bi<strong>en</strong> à l’oral qu’à l’écrit. À<br />
l’oral, ils étai<strong>en</strong>t invités à répondre à l’une ou l’autre de ces trois questions :<br />
1) Tu es un élève de CE2, de CM2, de Cinquième ou de Troisième. Raconte-nous une histoire que tu as<br />
vécue ou qui a été vécue par une personne que tu connais.<br />
2) Tu es un élève de CE2, CM2, Cinquième ou Troisième. Tu connais <strong>des</strong> stars dans plusieurs<br />
domaines de la vie : musique, culture, sport, cinéma, <strong>et</strong>c. Quel type de stars tu aimes <strong>et</strong> pourquoi ?<br />
3) Tu es un élève de CE2, CM2, Cinquième <strong>et</strong> Troisième. Si on te proposait d’aller passer <strong>des</strong> vacances<br />
loin de chez toi où irais-tu <strong>et</strong> pourquoi ?<br />
À l’écrit, la principale question était la suivante :<br />
Tu es un élève de CE2, CM2, Cinquième ou Troisième. Raconte-nous une histoire que tu as vécue ou<br />
qui a été vécue par une personne que tu connais.<br />
Toutefois, étant donné <strong>des</strong> circonstances particulières comme la « grève illimitée » <strong>des</strong><br />
<strong>en</strong>seignants dép<strong>en</strong>dant du ministère de l’Éducation nationale (premier <strong>et</strong> second degrés de<br />
215
l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t) ou le niveau réel <strong>des</strong> informateurs après seulem<strong>en</strong>t quelques mois de cours<br />
(la « grève illimitée » s’étant finalem<strong>en</strong>t ét<strong>en</strong>due sur quatre mois), nous avons accepté<br />
que les <strong>en</strong>seignants eux-mêmes, <strong>en</strong> tant que responsables de classe, propos<strong>en</strong>t <strong>des</strong> suj<strong>et</strong>s <strong>en</strong><br />
fonction du niveau réel de leurs propres appr<strong>en</strong>ants. L’ess<strong>en</strong>tiel était que les informateurs<br />
racont<strong>en</strong>t une histoire vécue ou vraisemblable <strong>et</strong> que nous ayons suffisamm<strong>en</strong>t d’exemples<br />
pour étudier l’utilisation particulière <strong>des</strong> prépositions françaises. Pour ce qui est<br />
spécifiquem<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>quête subsidiaire (1), elle consistait à nous forger une idée sur l’usage<br />
<strong>des</strong> prépositions françaises par <strong>des</strong> appr<strong>en</strong>ants à l’issue de quatorze années de scolarité<br />
<strong>en</strong>viron. Il s’agissait plus exactem<strong>en</strong>t de voir si les constructions prépositionnelles relevées<br />
dans les quatre premiers niveaux étai<strong>en</strong>t aussi observables <strong>en</strong> classe de Terminale. 768<br />
informateurs ont participé à l’<strong>en</strong>semble de ces trois étapes du recueil <strong>des</strong> données sur le<br />
terrain. Quant à l’<strong>en</strong>quête subsidiaire (2), l’objectif était de nous intéresser aux<br />
représ<strong>en</strong>tations <strong>des</strong> appr<strong>en</strong>ants sur leurs propres pratiques linguistiques. Étant donné que<br />
nous n’avions ni les moy<strong>en</strong>s financiers pour repartir dans les différ<strong>en</strong>ts lieux de notre<br />
<strong>en</strong>quête ni la possibilité de r<strong>et</strong>rouver forcém<strong>en</strong>t les mêmes informateurs d’une année à une<br />
autre, nous nous sommes cont<strong>en</strong>té d’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre c<strong>et</strong>te <strong>en</strong>quête dans la seule ville de<br />
Libreville. Nous avions cep<strong>en</strong>dant t<strong>en</strong>u à repartir dans les établissem<strong>en</strong>ts où nous avions<br />
m<strong>en</strong>é nos précéd<strong>en</strong>tes <strong>en</strong>quêtes. En fonction <strong>des</strong> faits relevés dans les trois premières<br />
étapes de l’<strong>en</strong>quête, nous proposions deux ou trois constructions prépositionnelles au<br />
choix avec au moins une construction non standard. Pour chaque question posée<br />
uniquem<strong>en</strong>t à l’écrit, il rev<strong>en</strong>ait aux informateurs de dire parmi les constructions<br />
proposées celle(s) qu’ils estimai<strong>en</strong>t la (les) plus « correcte(s) » par rapport au français<br />
standard puis de justifier leur point de vue. 388 informateurs de CE2, CM2, Cinquième <strong>et</strong><br />
Troisième ont été r<strong>et</strong><strong>en</strong>us pour c<strong>et</strong>te partie de l’<strong>en</strong>quête, conçue comme qualitative. En y<br />
ajoutant les 768 premiers informateurs, nous avons obt<strong>en</strong>u un total de 1156 informateurs.<br />
Dans la troisième partie, consacrée à l’analyse du corpus, la caractérisation nous a am<strong>en</strong>é à<br />
relever 708 constructions prépositionnelles particulières composées de 661 constructions<br />
non standard <strong>et</strong> de 47 unités lexicales particulières. Sur les 661 constructions non standard,<br />
270 occurr<strong>en</strong>ces (40,84%) sont marquées par <strong>des</strong> effacem<strong>en</strong>ts de prépositions ; 193<br />
occurr<strong>en</strong>ces (29,19%), par <strong>des</strong> ajouts de prépositions ; 187 occurr<strong>en</strong>ces (28,29%), par <strong>des</strong><br />
substitutions de prépositions <strong>et</strong> 11 occurr<strong>en</strong>ces (1,66%), par <strong>des</strong> supports de droite non<br />
att<strong>en</strong>dus. Les unités lexicales, dont nous n’avons pu établir <strong>des</strong> pourc<strong>en</strong>tages du fait de leur<br />
nombre réduit, compr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t, de leur côté, 27 néologismes prépositionnels <strong>et</strong> 20<br />
occurr<strong>en</strong>ces de realia. Concernant les mécanismes explicatifs, les formes étudiées nous ont<br />
216
ori<strong>en</strong>té, d’une part, vers les mécanismes intralinguistiques : surgénéralisations,<br />
hypercorrections, évolution diachronique du français, restructurations, dérivations<br />
lexicales, assimilations régressives <strong>et</strong> influ<strong>en</strong>ce de la situation sur la parole ; d’autre part,<br />
vers les mécanismes extralinguistiques : usage populaire du français (dans un pays où<br />
pour plusieurs raisons c<strong>et</strong>te langue s’impose parfois à tous les citoy<strong>en</strong>s), influ<strong>en</strong>ce de la<br />
parole sur la situation <strong>et</strong> représ<strong>en</strong>tations <strong>des</strong> appr<strong>en</strong>ants sur leurs propres pratiques.<br />
Par rapport à ces faits, quelle conception de la préposition déf<strong>en</strong>dons-nous dans le cadre<br />
du français langue seconde <strong>et</strong> quel bilan avons-nous tiré de notre propre travail ? C’est<br />
pour t<strong>en</strong>ter de répondre à ces deux questions que nous avons prévu une quatrième partie<br />
intitulée « <strong>en</strong> guise de propositions <strong>et</strong> de bilan ».<br />
Au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong> propositions, il nous a semblé nécessaire de revisiter la notion préposition à la<br />
lumière de la linguistique moderne <strong>et</strong> de son corollaire, la grammaire <strong>des</strong>criptive. Nous<br />
nous sommes appuyé pour cela sur quatre domaines d’analyse : étymologique,<br />
morphologique, sémantique <strong>et</strong> syntaxique. Sur le plan étymologique, on peut être t<strong>en</strong>té de<br />
considérer la préposition comme un morphème « pré-posé » ou une « unité linguistique<br />
placée avant une autre ». Dans notre étude, nous avons montré le caractère trompeur de<br />
c<strong>et</strong>te étymologie. La préposition peut certes être « pré-posée », mais il est aussi <strong>des</strong> cas<br />
où elle est « inter-posée », <strong>et</strong> même, paradoxalem<strong>en</strong>t, « post-posée ». Sur le plan<br />
morphologique, nous avons remis <strong>en</strong> cause le caractère figé de la notion de « locution »<br />
puis nous avons souligné la nécessité d’établir une distinction prépositions « simples » /<br />
prépositions « composées » plutôt que « prépositions simples » / « locutions<br />
prépositionnelles » ou « locutions prépositives ». Notre positionnem<strong>en</strong>t s’explique par<br />
le fait que les différ<strong>en</strong>ts morphèmes assum<strong>en</strong>t les mêmes rôles syntaxiques <strong>et</strong> qu’ils sont<br />
pourvus <strong>des</strong> valeurs sémantiques semblables. Par ailleurs, nous avons r<strong>en</strong>du compte d’une<br />
part, de la prés<strong>en</strong>ce implicite <strong>des</strong> prépositions « à » <strong>et</strong> « de » dans <strong>des</strong> formes comme<br />
« au(x) », « au(x)quel (le) (s) », « lui », « leur », « du », « dont », « duquel »,<br />
<strong>et</strong>c. ; d’autre part, de l’abs<strong>en</strong>ce implicite de ces mêmes prépositions dans <strong>des</strong> formes<br />
comme « le », « la », « les », « que », « qui », <strong>et</strong>c. Sur le plan sémantique, il est<br />
parfois posé une tripartition « prépositions vi<strong>des</strong> », « prépositions semi-pleines » <strong>et</strong><br />
« prépositions pleines ». À c<strong>et</strong>te tripartition fondée sur la nature <strong>des</strong> prépositions, nous<br />
avons préféré une autre pr<strong>en</strong>ant appui sur les occurr<strong>en</strong>ces <strong>des</strong> prépositions. Aucune<br />
préposition n’est <strong>en</strong> eff<strong>et</strong> intrinsèquem<strong>en</strong>t ni vide, ni semi-pleine, ni pleine. Seules les<br />
constructions dans lesquelles elles sont utilisées peuv<strong>en</strong>t conférer aux unités<br />
prépositionnelles ces différ<strong>en</strong>tes caractéristiques. Aussi avons-nous suggéré de parler de<br />
217
prépositions (sémantiquem<strong>en</strong>t) autonomes, de prépositions (sémantiquem<strong>en</strong>t) semiautonomes<br />
<strong>et</strong> de prépositions (sémantiquem<strong>en</strong>t) non autonomes. Sur le plan syntaxique<br />
<strong>en</strong>fin, après avoir rappelé que toute préposition est pourvue d’un support de gauche <strong>et</strong><br />
d’un support de droite, même implicitem<strong>en</strong>t marqué, nous avons montré que toutes les<br />
unités lexicales semblables à la préposition n’assum<strong>en</strong>t pas nécessairem<strong>en</strong>t de fonction<br />
prépositionnelle. Il <strong>en</strong> est ainsi <strong>des</strong> indices d’infinitif « à » <strong>et</strong> « de » puis de l’article<br />
« de ». Suivant ce principe, il nous a paru conv<strong>en</strong>able de parler de complém<strong>en</strong>t<br />
prépositionnel de verbe plutôt que de complém<strong>en</strong>t d’obj<strong>et</strong> indirect ou de complém<strong>en</strong>t<br />
d’attribution <strong>et</strong> de complém<strong>en</strong>t non prépositionnel de verbe plutôt que de complém<strong>en</strong>t<br />
d’obj<strong>et</strong> direct. La dénomination traditionnelle de ces complém<strong>en</strong>ts n’a <strong>en</strong> eff<strong>et</strong> de s<strong>en</strong>s que<br />
par rapport à la prés<strong>en</strong>ce ou non d’un morphème prépositionnel régi par le verbe.<br />
Nous <strong>en</strong>gageant dans le bilan, nous avons souligné que notre recherche ne nous a pas<br />
permis de répondre à toutes les hypo<strong>thèses</strong> émises ici <strong>et</strong> là dans le travail. Ainsi, compte<br />
t<strong>en</strong>u <strong>des</strong> difficultés r<strong>en</strong>contrées dans la collecte <strong>des</strong> données <strong>et</strong> <strong>des</strong> déséquilibres qui <strong>en</strong><br />
ont résulté, il ne nous pas été possible d’étudier les constructions prépositionnelles par<br />
rapport à certains variables comme l’âge, le sexe, la langue parlée, la langue que tel ou tel<br />
informateur souhaiterait ne pas parler, la langue <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts, la profession <strong>des</strong> par<strong>en</strong>ts, le<br />
lieu d’habitation <strong>et</strong>, pour Libreville, les établissem<strong>en</strong>ts de bonne r<strong>en</strong>ommée <strong>et</strong> les<br />
établissem<strong>en</strong>ts de moins bonne r<strong>en</strong>ommée. Nous avons toutefois pu établir certaines<br />
estimations par rapport aux provinces r<strong>et</strong><strong>en</strong>ues à l’« intérieur du pays », par rapport aux<br />
mo<strong>des</strong> de production de données <strong>et</strong> par rapport aux degrés d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t. Nous<br />
r<strong>et</strong>i<strong>en</strong>drons ainsi que les différ<strong>en</strong>ces ne sont pas réellem<strong>en</strong>t tranchées d’une province à une<br />
autre mais que les constructions prépositionnelles particulières vont decresc<strong>en</strong>do, de la<br />
province du Haut-Ogooué à celle du Woleu-Ntem (de 134 à 82 occurr<strong>en</strong>ces). S’il est<br />
possible de lire derrière ces chiffres une meilleure maîtrise <strong>des</strong> constructions dans la<br />
dernière province, nous n’occulterons pas le fait que c<strong>et</strong>te justification serait <strong>en</strong>core plus<br />
déf<strong>en</strong>dable si les données analysées étai<strong>en</strong>t équilibrées <strong>en</strong>tre les deux provinces. Nous<br />
r<strong>et</strong>i<strong>en</strong>drons égalem<strong>en</strong>t que les constructions prépositionnelles sont plus marquées à l’oral<br />
qu’à l’écrit (413 occurr<strong>en</strong>ces contre 295 occurr<strong>en</strong>ces). Cela semble lié au caractère spontané<br />
de l’oral par rapport à l’écrit <strong>et</strong> au fait que les productions orales sont numériquem<strong>en</strong>t<br />
beaucoup plus importantes que les productions écrites. Nous r<strong>et</strong>i<strong>en</strong>drons <strong>en</strong>fin qu’<strong>en</strong>tre<br />
les deux degrés d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t, l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t primaire est beaucoup plus marqué par les<br />
constructions prépositionnelles non standard que l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t secondaire (398<br />
occurr<strong>en</strong>ces contre 310 occurr<strong>en</strong>ces). Même si on peut invoquer le caractère plus abondant<br />
218
<strong>des</strong> constructions prépositionnelles relevées dans le « primaire », il est tout de même à<br />
signaler que plus on avance dans le niveau d’étu<strong>des</strong>, plus la maîtrise <strong>des</strong> constructions<br />
prépositionnelles est moins hasardeuse. Les productions <strong>des</strong> informateurs de Terminale<br />
sont par exemple beaucoup plus faciles à lire <strong>et</strong> à compr<strong>en</strong>dre que celles <strong>des</strong> informateurs<br />
de l’école primaire.<br />
Si les hypo<strong>thèses</strong> secondaires n’ont pas toujours été confirmées <strong>et</strong> si toutes les variables<br />
n’ont pas toujours été exploitées, l’hypothèse principale a <strong>en</strong> revanche pu être vérifiée.<br />
L’idée du « lecte <strong>des</strong> appr<strong>en</strong>ants » se vérifie par le fait qu’on r<strong>et</strong>rouve une diversité de<br />
constructions prépositionnelles semblables <strong>des</strong> informateurs de niveau CE2 aux<br />
informateurs de niveau Terminale. Elle est aussi confirmée par le fait que derrière un<br />
certain nombre de constructions prépositionnelles, les mêmes mécanismes<br />
intralinguistiques ou extralinguistiques sont souv<strong>en</strong>t avancées. Elle est <strong>en</strong>fin confirmée par<br />
le fait qu’une quantité non négligeable de constructions prépositionnelles étudiées<br />
correspond à l’usage géographique du français au Gabon, du moins dans sa caractéristique<br />
populaire. À ce suj<strong>et</strong>, il est bi<strong>en</strong> difficile de parler d’« erreurs » ou de « fautes »,<br />
auxquelles nous préférons l’expression « variations géographiques de la langue<br />
française », les habitu<strong>des</strong> ou l’usage fonctionnant comme <strong>des</strong> normes particulières.<br />
Nous avons émis, au terme de notre étude, l’idée de poursuivre l’exploitation de notre<br />
corpus dans <strong>des</strong> recherches ultérieures, les champs ouverts par ledit corpus étant assez<br />
vastes. Concernant plus spécialem<strong>en</strong>t le prés<strong>en</strong>t travail, nous sommes parv<strong>en</strong>u à l’idée<br />
qu’un bon <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t de prépositions au Gabon doit être sous-t<strong>en</strong>du par une<br />
conception « plurinormaliste » de la langue française. Celle-ci consiste non pas à<br />
<strong>en</strong>visager la langue comme un fait figé mais à la décrire sans parti pris normatif, de manière<br />
que les appr<strong>en</strong>ants puiss<strong>en</strong>t établir le li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre la variété qu’ils sont c<strong>en</strong>sés appr<strong>en</strong>dre à<br />
l’école <strong>et</strong> celles qu’ils <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t une fois sortis <strong>des</strong> salles de classe. C’est égalem<strong>en</strong>t,<br />
p<strong>en</strong>sons-nous, une façon d’aider à atténuer l’insécurité linguistique tant observée chez les<br />
appr<strong>en</strong>ants, ceux-ci étant alors mieux fixés sur les valeurs sociales accordées à telle ou telle<br />
construction prépositionnelle produite.<br />
219
ETUDE LONGITUDINALE DE LA DYSPROSODIE D’UN CAS D’APHASIE<br />
PROGRESSIVE PRIMAIRE : ANALYSE DES VARIABLES TEMPORELLES<br />
Marianne LOUIS<br />
Thèse sout<strong>en</strong>ue le 5 décembre <strong>2003</strong>, sous la direction d’Albert di Cristo.<br />
L’objectif de ce travail est d’étudier la prosodie dans un cas de parole pathologique <strong>et</strong> plus<br />
particulièrem<strong>en</strong>t dans les symptômes d’une maladie dégénérative telle que l’aphasie<br />
progressive primaire (A.P.P.), qui fournit un modèle privilégié de dégradation d’une ou de<br />
plusieurs sous-composantes du langage.<br />
Nous avons choisi d’étudier un cas unique pour deux raisons : la première afin d’éviter les<br />
eff<strong>et</strong>s de la variabilité inter-individuelle face à un syndrome rare <strong>et</strong> complexe ; la<br />
deuxième pour c<strong>en</strong>trer notre recherche sur la mise <strong>en</strong> valeur <strong>des</strong> variations liées d’une part<br />
à la tâche effectuée <strong>et</strong>, d’autre part, à la longueur <strong>des</strong> items proposés. L’hypothèse<br />
principale de ce travail est que la dégénéresc<strong>en</strong>ce s’accompagne d’eff<strong>et</strong>s prosodiques dont<br />
le suivi longitudinal de l’évolution chronologique de la pathologie devrait perm<strong>et</strong>tre de<br />
caractériser <strong>et</strong> de quantifier les variations.<br />
C<strong>et</strong>te étude, qui s’inscrit au sein de démarches d’évaluation <strong>et</strong> de rééducation, s’est voulue<br />
restrictive au regard de la prosodie <strong>et</strong> se limite par conséqu<strong>en</strong>t à l’analyse de quelques<br />
variables temporelles. Dans ce cadre, le corpus est constitué <strong>des</strong> réponses orales de la<br />
version française du bilan d’aphasie, le Boston Diagnostic Aphasia Examination<br />
(B.D.A.E.). Nous avons <strong>en</strong>registré la totalité de ce bilan de langage sept fois au cours <strong>des</strong><br />
deux premières années présumées de développem<strong>en</strong>t de l’aphasie progressive primaire.<br />
Notre travail se rapporte à deux axes de recherche : d’une part, une analyse de<br />
l’organisation temporelle dép<strong>en</strong>dante <strong>des</strong> phénomènes cognitifs nécessaires à la réalisation<br />
de la tâche (temps de lat<strong>en</strong>ce, conduites d’approches) ; d’autre part, une analyse de<br />
l’organisation temporelle c<strong>en</strong>trée sur les aspects phonétiques <strong>et</strong> phonologiques <strong>des</strong><br />
productions du pati<strong>en</strong>t (phrases, mots, syllabes).<br />
L’analyse <strong>des</strong> variables temporelles concerne l’évolution de phénomènes id<strong>en</strong>tiques :<br />
durée <strong>des</strong> syllabes de type consonne/voyelle (CV), dans <strong>des</strong> tâches différ<strong>en</strong>tes comme par<br />
exemple la répétition d’un même mot <strong>en</strong> lecture ou <strong>en</strong> dénomination. De plus, la longueur<br />
de l’item est prise <strong>en</strong> compte dans ces différ<strong>en</strong>tes épreuves.<br />
220
Le premier chapitre expose une revue de la littérature sur les perturbations prosodiques<br />
(dysprosodie ou aprosodie) <strong>en</strong>visagées du double point de vue de l’aphasiologie <strong>et</strong> de<br />
l’analyse linguistique. Nous y exposons les désordres prosodiques dans les étu<strong>des</strong> <strong>en</strong><br />
pathologie d’une part, <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>tant la notion de « latéralisation hémisphérique » <strong>et</strong><br />
d’autre part, <strong>en</strong> décrivant les troubles dysprosodiques <strong>en</strong> fonction de la localisation de la<br />
lésion hémisphérique (gauche/droite) dans <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> portant sur <strong>des</strong> tâches de production<br />
<strong>et</strong> de perception. D’une façon générale, les résultats qui émerg<strong>en</strong>t <strong>des</strong> analyses<br />
linguistiques <strong>et</strong> phonétiques qui ont cherché à établir <strong>des</strong> correspondances <strong>en</strong>tre <strong>des</strong><br />
aspects de la prosodie affective <strong>et</strong>/ou linguistique <strong>et</strong> <strong>des</strong> sites lésionnels confirm<strong>en</strong>t la<br />
complexité du fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> systèmes prosodiques <strong>et</strong> m<strong>et</strong>t<strong>en</strong>t <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce une<br />
désorganisation compliquée dont les rouages rest<strong>en</strong>t à définir.<br />
Le deuxième chapitre définit l’<strong>en</strong>semble <strong>des</strong> notions qui caractéris<strong>en</strong>t les maladies<br />
dégénératives <strong>et</strong> définit le syndrome de Mesulam (ou aphasie progressive primaire). Nous<br />
situons c<strong>et</strong>te pathologie parmi les divers types de dém<strong>en</strong>ces dont la plus connue est la<br />
maladie d’Alzheimer. Afin de déterminer les syndromes de l’aphasie progressive primaire<br />
nous rappelons les définitions <strong>des</strong> pathologies susceptibles d’interférer dans le diagnostic<br />
de c<strong>et</strong>te maladie rare.<br />
Le troisième chapitre prés<strong>en</strong>te le pati<strong>en</strong>t de notre étude, l’histoire de sa maladie <strong>et</strong> les<br />
résultats <strong>des</strong> divers exam<strong>en</strong>s réalisés au cours <strong>des</strong> quatre années d’observation de sa<br />
pathologie. Nous proposons de décrire l’évaluation <strong>des</strong> désordres du langage dans le cadre<br />
de l’aphasie <strong>en</strong> insistant sur l’explication <strong>des</strong> tâches <strong>et</strong> <strong>des</strong> items du bilan dont les épreuves<br />
orales constitu<strong>en</strong>t notre corpus de travail. Nous consacrons <strong>en</strong>fin une partie de ce chapitre<br />
à exposer <strong>des</strong> aspects méthodologiques de notre recherche liés au choix de la méthode de<br />
segm<strong>en</strong>tation du corpus <strong>et</strong> <strong>des</strong> niveaux de transcription du matériau analysé.<br />
Le chapitre quatre est consacré à l’analyse <strong>des</strong> durées syllabiques dans une tâche de<br />
répétition de mots <strong>et</strong> de phrases. Nous décrivons, par ordres d’unités décroissantes (de<br />
l’<strong>en</strong>semble du corpus à la syllabe) les eff<strong>et</strong>s d’allongem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> de détérioration de la<br />
réalisation de la tâche au cours <strong>des</strong> 8 trimestres d’évolution de la pathologie. Nous<br />
examinons les incid<strong>en</strong>ces de la nature de la syllabe (la longueur, la position, la structure)<br />
sur les variations temporelles <strong>des</strong> productions, <strong>en</strong> fonction de la progression de la maladie.<br />
Le chapitre cinq prés<strong>en</strong>te égalem<strong>en</strong>t l’analyse <strong>des</strong> durées syllabiques mais c<strong>et</strong>te fois-ci dans<br />
<strong>des</strong> tâches de dénomination qui inclu<strong>en</strong>t une épreuve de lecture à haute voix (mots <strong>et</strong><br />
phrases), une épreuve de dénomination d’images, une épreuve de dénomination par le<br />
221
contexte <strong>et</strong> une épreuve de dénomination <strong>des</strong> parties du corps. L’exploration <strong>des</strong><br />
variations temporelles se déroule de manière id<strong>en</strong>tique au développem<strong>en</strong>t du chapitre 4.<br />
Le sixième chapitre prés<strong>en</strong>te <strong>des</strong> images cérébrales construites à partir d’Images par<br />
Résonance Magnétique. Un traitem<strong>en</strong>t d’image a été effectué à l’aide d’un logiciel<br />
spécifique perm<strong>et</strong>tant alors l’accès aux reconstructions <strong>en</strong> trois dim<strong>en</strong>sions de l’<strong>en</strong>semble<br />
<strong>des</strong> sillons corticaux <strong>et</strong> du cerveau. Ce traitem<strong>en</strong>t a égalem<strong>en</strong>t permis d’effectuer une<br />
superposition <strong>des</strong> images du pati<strong>en</strong>t <strong>et</strong> <strong>des</strong> images du suj<strong>et</strong>-témoin apparié, afin<br />
d’id<strong>en</strong>tifier les zones cérébrales affectées par la dégénéresc<strong>en</strong>ce.<br />
Au terme du dernier chapitre, nous discutons l’<strong>en</strong>semble <strong>des</strong> résultats qui nous ont permis<br />
d’observer <strong>en</strong> détail la production dans un type d’aphasie progressive primaire. L’évolution<br />
de c<strong>et</strong>te maladie a révélé les étapes successives de la construction d’une pathologie<br />
aphasique. L’instabilité du système fait que le pati<strong>en</strong>t adapte son comportem<strong>en</strong>t<br />
linguistique au fur <strong>et</strong> à mesure de l’addition <strong>des</strong> symptômes, ce qui nous incite à la plus<br />
grande prud<strong>en</strong>ce dans l’interprétation de nos résultats.<br />
Les t<strong>en</strong>dances qui se détach<strong>en</strong>t de nos analyses nous apport<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>ts r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts<br />
sur les aspects perturbés de l’organisation temporelle <strong>des</strong> productions du pati<strong>en</strong>t.<br />
Les résultats obt<strong>en</strong>us dans c<strong>et</strong>te recherche nous amèn<strong>en</strong>t à poser certaines hypo<strong>thèses</strong> <strong>et</strong> à<br />
formuler plusieurs questions qui se rapport<strong>en</strong>t à différ<strong>en</strong>tes problématiques concernant la<br />
prosodie <strong>et</strong> la cognition ou à <strong>des</strong> considérations plus générales.<br />
222
L’APPROCHE CURRICULAIRE : UNE FORMATION INDISPENSABLE<br />
EN DIDACTIQUE DU FLE AUX SEYCHELLES<br />
Gervais SALABERT<br />
Thèse sout<strong>en</strong>ue le 6 décembre <strong>2003</strong>, sous la direction de Chantal Forestal.<br />
En 1994, aux Seychelles, la Section de français du C<strong>en</strong>tre Chargé du Curriculum lance un<br />
programme de révision / réactualisation du curriculum de français du primaire <strong>et</strong> du<br />
secondaire. Outre le personnel de c<strong>et</strong>te Section, les autres ag<strong>en</strong>ts impliqués dans c<strong>et</strong>te<br />
opération sont le Conseil d’Enseignem<strong>en</strong>t du français, qui regroupe <strong>des</strong> <strong>en</strong>seignants, <strong>des</strong><br />
formateurs <strong>et</strong> <strong>des</strong> technici<strong>en</strong>s du Ministère de l‘Education <strong>et</strong> de la Culture, <strong>et</strong> les chefs de<br />
file, <strong>en</strong>seignants expérim<strong>en</strong>tés <strong>et</strong> suffisamm<strong>en</strong>t motivés pour se lancer dans ce travail de<br />
longue haleine ; ces derniers sont les interfaces directes <strong>en</strong>tre les opérateurs du Ministère<br />
<strong>et</strong> le terrain.<br />
Mais est-ce que l’implication d’autant de personnes dans c<strong>et</strong>te révision / réactualisation du<br />
curriculum de français ne nuit pas au r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t général ? Est-ce que le personnel<br />
concerné est suffisamm<strong>en</strong>t formé pour garantir ce r<strong>en</strong>ouveau ? Quels sont les problèmes<br />
r<strong>en</strong>contrés <strong>en</strong> prônant c<strong>et</strong>te démarche qui touche, <strong>en</strong> principe, tous les <strong>en</strong>seignants de<br />
français du primaire <strong>et</strong> du secondaire ?<br />
Toutes ces questions m<strong>et</strong>t<strong>en</strong>t au premier plan la problématique du développem<strong>en</strong>t<br />
curriculaire <strong>en</strong> termes de modèles à élaborer, de métho<strong>des</strong> à finaliser <strong>et</strong> de ressources<br />
humaines à former. Cela justifie le recours à la recherche-action comme moy<strong>en</strong> pour<br />
construire <strong>et</strong> maint<strong>en</strong>ir les li<strong>en</strong>s nécessaires <strong>en</strong>tre les <strong>en</strong>seignants sur le terrain <strong>et</strong> les<br />
spécialistes du curriculum au Ministère ; de cela émerge une équipe de travail fondée sur la<br />
collaboration comme approche gratifiante <strong>et</strong> professionnelle à la conduite du r<strong>en</strong>ouveau<br />
curriculaire.<br />
Mots-clés : Curriculum, formation, <strong>en</strong>seignant, didactique, recherche-action,<br />
évaluation, objectif, finalité, communication, éducation.<br />
223