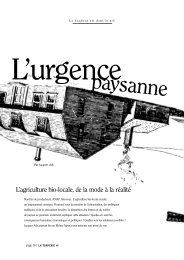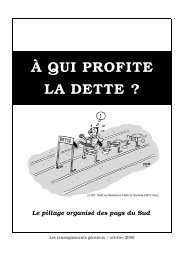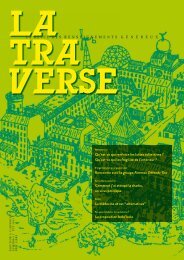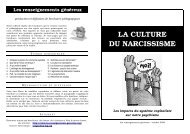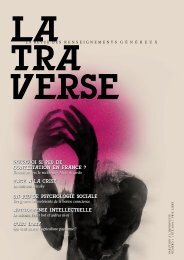Postillon-3.pdf PDF - Les renseignements généreux
Postillon-3.pdf PDF - Les renseignements généreux
Postillon-3.pdf PDF - Les renseignements généreux
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Villeneuve, l'utopie à l'agonie<br />
Portés par l’esprit de 68, les<br />
concepteurs du quartier de la<br />
Villeneuve entendaient « changer<br />
la ville pour changer la vie ».<br />
Près de quarante ans plus<br />
tard, un projet de rénovation se<br />
prépare pour changer l’image<br />
de ce quartier stigmatisé en<br />
cité.<br />
Cette « utopie des années 70 »<br />
était-elle une chimère ?<br />
Qu’en reste-t-il ?<br />
La Villeuneuve ?<br />
La nomination « La Villeneuve »<br />
regroupe des réalités très différentes.<br />
Deux quartiers : l’un sur la commune<br />
d’Echirolles, l’autre sur Grenoble.<br />
Ce dernier, regroupant 12 000 habitants,<br />
est constitué d’espaces bien<br />
différents, avec les grandes barres de<br />
l’Arlequin, les plus petits immeubles<br />
des Baladins et de la place des Géants,<br />
ou le quartier d’Helbronner.<br />
Ce papier se concentre sur la<br />
Villeneuve de Grenoble. Avec un<br />
nombre limité de rencontres et de<br />
lectures, cet article n’a pas la prétention<br />
d’être exhaustif. La Villeneuve<br />
mériterait un nouveau livre.<br />
Photo : sculpture de "l'indien" dans le parc Verlhac datant de 1977<br />
Vendredi, fin après midi. La barre d’immeubles<br />
de l’Arlequin toise les enfants<br />
à la sortie de l’école du Lac. Louise, la<br />
trentaine, sort tout juste de son boulot<br />
et attend son fils. Un grillage ceinture<br />
l’école depuis la rentrée. Signe d’un temps révolu<br />
du quartier utopique de la Villeneuve, où les écoles<br />
étaient ouvertes et proposaient un enseignement<br />
expérimental. « Ce n’est pas du tout pour « l’utopie<br />
des années 70 du quartier » que je me suis<br />
installée ici, d’ailleurs j’en avais jamais entendu<br />
parlé. J’habitais Fontaine et j’ai dû vendre l’appart<br />
dans lequel j’étais. J’ai cherché à Grenoble<br />
mais tout était trop cher. Et puis j’ai trouvé ici à<br />
Villeneuve. C’est d’abord parce que c’était moins<br />
cher et puis quand j’ai découvert le parc qui se<br />
cachait derrière la galerie de l’arlequin, je me<br />
suis dit que ça serait idéal pour une fille comme<br />
moi, seule avec un enfant. » Lydie, ivoirienne, la<br />
main serrée dans celle de son fils alpague Louise<br />
« je passe tout à l’heure chez toi, ok ? » Elle non<br />
plus ne connaissait pas le projet initial du quartier<br />
: « Ici, on est comme une famille. On se parle<br />
facilement. C’est clair que c’est une cité. Y a des<br />
jeunes qui crachent partout, qui font peur à nos<br />
gamins avec leurs motos mais ça reste un petit<br />
paradis la Villeneuve ! On a tout à côté, pas<br />
besoin de voiture ! »<br />
Sur la place du marché, tentatives de discussions<br />
impromptues avec des habitants de la Villeneuve<br />
: « Alors, que reste-t-il de l’utopie des années 1970 ? »<br />
demande-t-on naïvement. « Quelle utopie ? »,<br />
« De quoi ? », « qu’est-ce tu m’embrouilles ? »,<br />
« ... », « tu veux dire les motos ? », nous répondent-ils.<br />
Comme une impression de s’être trompés<br />
d’adresse. Ou d’être autant à côté de la plaque que<br />
le premier journaliste de TF1 venu.<br />
Et pourtant, on ne rêve pas. La Villeneuve cristallisa<br />
beaucoup d’espoirs au moment de sa<br />
réalisation, à tel point qu’on parla « d’utopie ».<br />
L’espoir de changer la vie en changeant la ville.<br />
Le Nouvel Observateur titre le 15 mai 1972 :<br />
« L’anti-Sarcelles : comment à la Villeneuve un<br />
groupe d’animateurs et d’urbanistes, la bande à<br />
Verlhac, a osé construire la ville où l’imagination<br />
aura enfin le pouvoir. » Un espoir allant jusqu’à<br />
susciter une curiosité et un engouement national :<br />
« Tout ce que la France a d’urbanistes, d’architectes,<br />
de sociologues, de pédagogues, d’élus, de<br />
journalistes en quête de renouvellement est venu<br />
voir la Villeneuve. Au début des années 70, elle<br />
fut le Mont-Saint-Michel de tous ceux qui aspirent<br />
à « changer la vie. »(1) Alors que s’est-il passé<br />
entre 1972 et 2009 ? Qu’est-il arrivé pour que le<br />
mot utopie, rattaché au projet de quartier au début<br />
des années 1970, suscite, quarante ans plus tard,<br />
incompréhension au cœur même de ce quartier ?<br />
« Transformer les rapports humains »<br />
Au commencement étaient d’un côté un grand<br />
terrain vierge, ancien aérodrome de Grenoble, et de<br />
l’autre une équipe municipale cherchant à apporter<br />
une réponse à la crise du logement des années<br />
1960 avec une volonté d’innovation sociale. La<br />
majorité municipale regroupe des membres de la<br />
SFIO (futur P.S.), du P.S.U. et du Groupe d’Action<br />
Municipale (GAM) fondé par Hubert Dubedout,<br />
élu maire de Grenoble en 1965. Autour de Jean<br />
Verlhac, adjoint à l’urbanisme, se monte un projet<br />
ambitieux surfant sur le « changer la vie » en<br />
vogue à la fin des années 1960. La commission<br />
de travail se dote d’une charte qui débute ainsi<br />
: « Le projet Villeneuve se caractérise par une<br />
volonté de transformer les rapports humains dans<br />
la cité. » Est donc mise en œuvre une série d’innovations<br />
sur l’architecture, la mixité, l’éducation<br />
et les initiatives autogestionnaires. <strong>Les</strong> voitures<br />
sont laissées à l’extérieur du quartier. Sous les<br />
immeubles serpente une rue couverte et piétonne<br />
afin de faciliter les rencontres. <strong>Les</strong> couloirs menant<br />
aux appartements sont des coursives communiquant<br />
entre plusieurs montées. Des passerelles<br />
piétonnes permettent de se rendre d’un côté au<br />
centre commercial, et de l’autre au Cargo, l’ancienne<br />
Maison de la Culture. <strong>Les</strong> locataires et les<br />
propriétaires cohabitent dans les mêmes montées<br />
et se partagent le quartier. Des logements pour<br />
handicapés, des résidences pour personnes âgées,<br />
un foyer pour jeunes en difficulté sont mis en place.<br />
Une Maison de quartier regroupe le collège, la<br />
bibliothèque, des salles de réunion, des ateliers et<br />
un restaurant libre-service. Une télévision de quartier<br />
et une maison médicale sont lancées. Beaucoup<br />
d’efforts sont concentrés sur les écoles, « recouvrant<br />
l’enjeu le plus important. » (1) Elles entendent<br />
mettre en œuvre une pédagogie différente,<br />
non autoritaire, expérimentale et s’intègrent à l’immense<br />
parc situé au milieu du quartier. « Pas mal<br />
de gens modifièrent leur vie en choisissant de venir<br />
à la Villeneuve. C’est un cadre de direction d’une<br />
entreprise de la région parisienne qui abandonne<br />
sa situation pour venir ici.(...) C’est un non-violent<br />
qui se sépare de Lanza del Vasto, des chèvres et<br />
des moutons, pour venir établir à la Villeneuve une<br />
petite communauté de l’Arche, ou bien un prêtre<br />
qui renonce au sacerdoce paroissial pour prendre<br />
un magasin, et qui s’établit comme marchand de<br />
journaux. » (1) L’Arlequin est peuplé à ses débuts<br />
de près de 50% de ménages de cadres moyens et<br />
supérieurs.<br />
Premières désillusions<br />
Dès les premières années, la réalité se révèle<br />
moins attrayante que l’utopie dépeinte à travers<br />
plaquettes et articles de presse. La télévision de<br />
quartier capote vite. Des cadres, volontaires au<br />
départ, le fuient. En 1979, soit 7 ans après l’arrivée<br />
des premiers habitants, « certains vivent encore à<br />
la Villeneuve, mais beaucoup n’ont pas pu tenir et<br />
sont partis. C’est qu’il n’est pas habituel, pour un<br />
cadre de vivre dans un grand ensemble, (...) c’est<br />
très bien sur le papier, c’est généreux, c’est très<br />
chrétien de gauche, mais c’est difficile à supporter<br />
| Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009<br />
Le <strong>Postillon</strong> | numéro 3 - décembre 2009 |