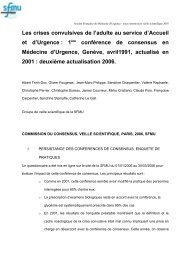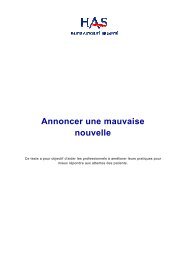L'utilisation de la morphine par l'urgentiste - SFMU
L'utilisation de la morphine par l'urgentiste - SFMU
L'utilisation de la morphine par l'urgentiste - SFMU
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
URGENCES<br />
2007<br />
co-fondateurs<br />
8. Décrire les modalités <strong>de</strong> re<strong>la</strong>is analgésique après titration morphinique lors<br />
d’une hospitalisation en aval <strong>de</strong>s urgences.<br />
9. Définir les modalités <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce d’un patient analgésié en urgence et les<br />
procédures en cas d’inci<strong>de</strong>nt acci<strong>de</strong>nt.<br />
1. Morphine, médicament ancien dont les propriétés<br />
sont bien connues<br />
La <strong>morphine</strong> est un alcaloï<strong>de</strong> extrait <strong>de</strong> l’opium du pavot asiatique. Après<br />
incisions superficielles dans les capsules <strong>de</strong>s pavots, s’écoule un suc <strong>la</strong>iteux qui<br />
se <strong>de</strong>ssèche, s’oxy<strong>de</strong> à l’air et prend alors une couleur brunâtre. Après ma<strong>la</strong>xage,<br />
cette substance <strong>de</strong>vient l’opium qui contient environ 10 % <strong>de</strong> <strong>morphine</strong>. Le<br />
principe actif <strong>de</strong> l’opium fut découvert en 1804 <strong>par</strong> Friedrich Sertürner, un<br />
pharmacien allemand âgé <strong>de</strong> 22 ans. Il en teste ensuite les effets sur lui-même<br />
et 3 personnes qui se portent volontaires. Comme ils ont pris environ 10 fois plus<br />
que <strong>la</strong> dose prescrite <strong>de</strong> nos jours, Sertürner baptise <strong>la</strong> nouvelle substance<br />
« principe somnifère » en raison <strong>de</strong> ses capacités puissantes à provoquer le<br />
sommeil. Ce nom est remp<strong>la</strong>cé plus tard <strong>par</strong> le mot <strong>morphine</strong> en l’honneur <strong>de</strong><br />
Morphée, le dieu grec <strong>de</strong>s rêves. Malgré une utilisation <strong>de</strong>puis <strong>de</strong> nombreux<br />
siècles, les mécanismes d’action <strong>de</strong> cette substance sur <strong>la</strong> modu<strong>la</strong>tion du<br />
message douloureux, au niveau cérébral, n’ont été découverts qu’au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième moitié du XX e siècle. À <strong>par</strong>tir <strong>de</strong> 1952, <strong>la</strong> synthèse chimique <strong>de</strong><br />
<strong>morphine</strong> et <strong>de</strong> dérivés morphiniques est possible.<br />
Les différents effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>morphine</strong> peuvent se résumer dans l’urgence à son<br />
effet analgésique et à <strong>de</strong>s effets annexes indésirables.<br />
L’analgésie est le principal effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>morphine</strong> qui calme <strong>la</strong> plu<strong>par</strong>t <strong>de</strong>s<br />
syndromes douloureux. La <strong>morphine</strong> est un antalgique à effet central. Ses<br />
propriétés antalgiques sont dues à son action d’activation (dite agoniste) <strong>de</strong>s<br />
récepteurs opioï<strong>de</strong>s, en <strong>par</strong>ticulier mu (µ), présents au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> moelle<br />
épinière et <strong>de</strong> différents centres nerveux supramédul<strong>la</strong>ires. Ces sites, qui<br />
expliquent que <strong>la</strong> <strong>morphine</strong> puisse être administrée <strong>par</strong> voie péridurale ou<br />
intrathécale, voire intra-cérébro-ventricu<strong>la</strong>ire, sont <strong>la</strong> cible <strong>de</strong> son effet inhibiteur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong> l’influx douloureux. C’est avant tout cette action<br />
pharmacologique qui explique l’activité antalgique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>morphine</strong>, même s’il est<br />
évoqué quelquefois une influence plus ou moins validée sur le vécu douloureux.<br />
La <strong>morphine</strong> augmente le seuil <strong>de</strong> perception <strong>de</strong> <strong>la</strong> douleur : <strong>la</strong> sensibilité aux<br />
stimuli nociceptifs (électriques, chimiques, mécaniques) est diminuée d’une<br />
manière spécifique ; sans modification <strong>de</strong>s autres perceptions : vision, audition,<br />
toucher. La <strong>morphine</strong> modifie également <strong>la</strong> perception douloureuse : <strong>la</strong> douleur<br />
est toujours présente, mais <strong>la</strong> <strong>morphine</strong> entraîne un certain détachement vis-àvis<br />
d’elle. L’action analgésique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>morphine</strong> après administration <strong>par</strong>entérale<br />
systémique dure <strong>de</strong> 4 à 6 heures et résulte <strong>de</strong> son action à plusieurs niveaux :<br />
cérébral, médul<strong>la</strong>ire, périphérique. Cette action périphérique est facile à mettre<br />
164<br />
■ ANALGÉSIE-SÉDATION EN URGENCE