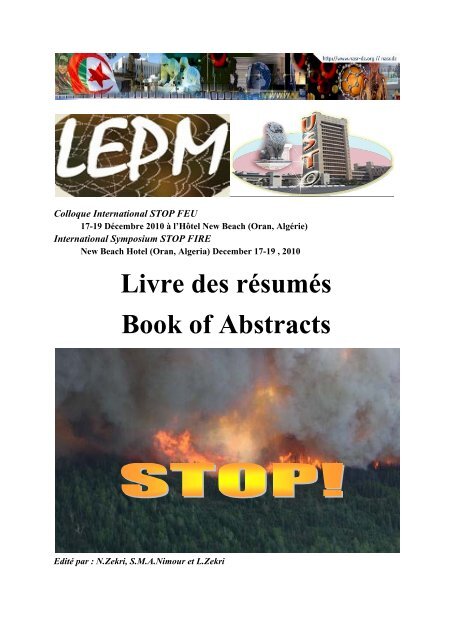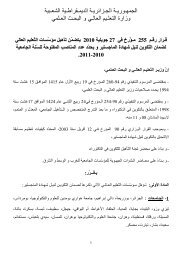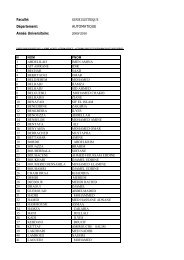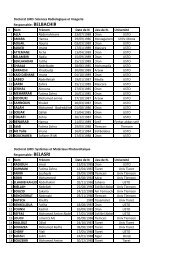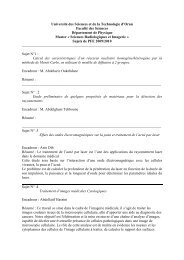Le livre des resumes - Université des Sciences et de la Technologie ...
Le livre des resumes - Université des Sciences et de la Technologie ...
Le livre des resumes - Université des Sciences et de la Technologie ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Colloque International STOP FEU<br />
17-19 Décembre 2010 à l’Hôtel New Beach (Oran, Algérie)<br />
International Symposium STOP FIRE<br />
New Beach Hotel (Oran, Algeria) December 17-19 , 2010<br />
Livre <strong><strong>de</strong>s</strong> résumés<br />
Book of Abstracts<br />
Edité par : N.Zekri, S.M.A.Nimour <strong>et</strong> L.Zekri
STOP FEU, Oran 2010<br />
Nous remercions nos sponsors / We thank our sponsors:<br />
Agence Nationale du<br />
Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Recherche Scientifique<br />
ANDRU<br />
Ambassa<strong>de</strong> <strong>de</strong> France en<br />
Algérie<br />
Service <strong>de</strong> Coopération <strong>et</strong><br />
d’Action Culturelle<br />
Centre Culturel Français<br />
d’Oran<br />
ENTEC<br />
Engineering Technics<br />
CCS Environnement<br />
Tel. : 40.237.430<br />
Agréé par le Ministère<br />
<strong>et</strong> l’Hôtel New Beach Oran<br />
2
STOP FEU, Oran 2010<br />
Ce colloque est organisé avec l’autorisation du Ministère <strong>de</strong><br />
l’Enseignement Supérieur <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche Scientifique<br />
La Direction Générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche Scientifique <strong>et</strong> du<br />
Développement Technologique<br />
Et<br />
L’Université <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Technologie</strong> d’Oran<br />
« Mohamed Boudiaf »<br />
A l’Initiative <strong>de</strong><br />
l’Equipe Feu du Laboratoire d’Etu<strong>de</strong> Physique <strong><strong>de</strong>s</strong> Matériaux<br />
3
STOP FEU, Oran 2010<br />
Comité d’honneur/ Honorary Committee<br />
Aourag Hafid : Directeur Général DGRSDT<br />
Bensafi Mohamed : Recteur <strong>de</strong> l’USTO<br />
Ab<strong>de</strong>louahab Mohamed : Doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong> (USTO)<br />
Prési<strong>de</strong>nt du Colloque/Conference Chair<br />
Zekri Nouredine<br />
Comité Scientifique<br />
Scientific Committee<br />
Comité d’Organisation<br />
Organization Committee<br />
Abidat Miloud USTO- Algérie Al<strong>la</strong> Hocine USTO-Algérie<br />
Azzi Abbes USTO- Algérie Be<strong>la</strong>sri Ahmed USTO-Algérie<br />
Be<strong>la</strong>sri Ahmed USTO- Algérie Belbachir A.Hafid USTO-Algérie<br />
Belbachir Ahmed Hafid USTO- Algérie Benslimane Med Karim USTO-Al<br />
Benharrats Nassira USTO- Algérie Brikci Sid AEK USTO-Algérie<br />
Boul<strong>et</strong> Pascal Nancy, France Djeraba Aicha USTO-Algérie<br />
Clerc Jean-Pierre Marseille, France Kaiss Ahmed Marseille, France<br />
Vantelon Jean-Pierre Poitiers, France Hamdaoui Sid Ahmed USTO-Al<br />
Hamdache Fatima USTO- Algérie Belhadj Lilia USTO-Algérie<br />
Thomas Rogaume Poitiers, France Belhadji Laidia USTO-Algérie<br />
Porterie Bernard Marseille-France El Chikh Mokhtar USTO-Algérie<br />
Rein Guillermo Edinburg, Ecosse Nimour Mohamed USTO-Algérie<br />
Nemdili Ali USTO-Algérie Ouasti Rachid USTO-Algérie<br />
Zekri Nouredine USTO-Algérie Hammou B.Amine USTO-Algérie<br />
Sabeur Amine USTO-Algérie<br />
Zekri Lotfi USTO-Algérie<br />
Ziani Nossair USTO-Algérie<br />
Zekri Nouredine USTO-Algérie<br />
OBJECTIFS<br />
La prévention <strong>et</strong> <strong>la</strong> lutte contre les incendies en milieux urbains, industriels <strong>et</strong> naturels, représente un enjeu<br />
sociétal <strong>de</strong> première importance <strong>de</strong> protection <strong><strong>de</strong>s</strong> vies, <strong><strong>de</strong>s</strong> biens <strong>et</strong> du patrimoine naturel. Il est aussi un<br />
véritable défi pour les chercheurs. Si d’énormes progrès ont été accomplis ces <strong>de</strong>rnières années, <strong>la</strong><br />
compréhension <strong>et</strong> <strong>la</strong> prédiction du comportement d’un incendie nécessitent encore <strong><strong>de</strong>s</strong> développements<br />
théoriques, numériques <strong>et</strong> expérimentaux.<br />
Ce colloque, organisé à l’initiative <strong>de</strong> l’Université <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Technologie</strong> d’Oran, <strong>et</strong> <strong>de</strong> son<br />
<strong>la</strong>boratoire d’Etu<strong>de</strong> Physique <strong><strong>de</strong>s</strong> Matériaux (équipe feu), souhaite répondre au besoin avéré d’échanges entre<br />
chercheurs d’une même communauté <strong>et</strong> faciliter le rapprochement entre opérateurs, industriels <strong>et</strong> scientifiques.<br />
Il perm<strong>et</strong>tra <strong>de</strong> faire le point sur l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche sur les incendies <strong>et</strong> <strong>de</strong> contribuer à renforcer<br />
l’efficacité <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te lutte à travers le mon<strong>de</strong>.<br />
OBJECTIVES<br />
Prevention and fight against urban, industrial and natural fires are a soci<strong>et</strong>al issue of primary importance to<br />
protect lives, property and natural heritage. It is also a challenge for researchers, and so much progress has<br />
been ma<strong>de</strong> in recent years, un<strong>de</strong>rstanding and predicting the behavior of a fire requires further theor<strong>et</strong>ical<br />
<strong>de</strong>velopments, numerical and experimental.<br />
This symposium, organized at the initiative of the University of Science and Technology of Oran, and it<br />
<strong>la</strong>boratory LEPM (fire team), wishes to respond to <strong>de</strong>monstrated need for exchanges b<strong>et</strong>ween researchers from<br />
a same community and facilitate reconciliation b<strong>et</strong>ween tra<strong>de</strong>rs, industrialists and scientists. It will take stock of<br />
<strong>de</strong>velopments in fire research and contribute to strengthening the effectiveness of this fight around the world.<br />
4
STOP FEU, Oran 2010<br />
Programme du colloque /Conference Program<br />
Vendredi/Friday 17 Décembre 2010<br />
13h30 : Acceuil <strong>et</strong> Inscriptions <strong><strong>de</strong>s</strong> participants / Registration<br />
15h00 : Ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> conférence Recteur <strong>de</strong> l’USTO, Coordinateur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Conférence / Opening the Conference<br />
16h00 : Pause café /Coffee break<br />
16h30 : Plénière (Plenary talk) J.-P.Vantelon<br />
17h15 : Plénière (Plenary talk) A.Coppalle<br />
18h00 : Expositions <strong>et</strong> Session Posters Thèmes I-V/ Exhibitions and poster session<br />
20h00: Diner / Dinner<br />
Samedi/Saturday 18 Décembre 2010<br />
Matin/Morning<br />
08h30 : Plénière (Plenary talk) P.Boul<strong>et</strong><br />
09h00 : Plénière (Plenary talk) E.<strong>Le</strong>oni<br />
09h30 : Plénière (Plenary talk) A.Kaiss<br />
10h00 : Pause café /Coffee break<br />
10h30 : Communications Orales : Thèmes I-IV (3 salles)/ Oral session (3 rooms)<br />
12h30 : Déjeuner / Lunch<br />
Après midi/Afternoon<br />
14h30 : Plénière (Plenary talk) J.P.Clerc<br />
15h00 : Plénière (Plenary talk) T.Rogaume<br />
15h30 : Plénière (Plenary talk) G.Rein<br />
16h00 : Pause café / Coffee break<br />
17h00 : Communications Orales : Thèmes I-IV (3 salles)/ Oral session (3 rooms)<br />
18h30 : Expositions <strong>et</strong> session Posters, thèmes I-V / Exhibition and Poster session<br />
20h00 : Diner / Dinner<br />
Dimanche/Sunday 19 Décembre 2010<br />
08h30 : Plénière (Plenary talk) C.Lallemand<br />
09h00 : Plénière (Plenary talk) L.Rigoll<strong>et</strong><br />
09h30 : Plénière (Plenary talk) B.Porterie<br />
10h00 : Pause Café /Coffee break<br />
10h30 : Table ron<strong>de</strong> / Round table<br />
12h30 : Clôture <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conférence / Closing the Conference<br />
13h00 : Déjeuner / Lunch<br />
Remarque/Remark :<br />
<strong>Le</strong> colloque portera sur les thèmes suivants /The conference topics are :<br />
I- <strong>Le</strong> feu en milieux naturel /<br />
Fire in natural environments<br />
II- <strong>Le</strong> feu en milieu urbain <strong>et</strong> industriel /<br />
Fire in urban and industrial environments<br />
III- Moyens <strong>de</strong> protection, <strong>de</strong> prévention <strong>et</strong> <strong>de</strong> lutte contre les incendies /<br />
The means of protection, prevention and fight against fire<br />
IV- Influence du feu sur l’environnement<br />
The influence of fire on the environment<br />
V- Propriétés physiques <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux<br />
Physical properties of materials<br />
5
STOP FEU, Oran 2010<br />
Sommaire / Table of contents<br />
Titre<br />
Page<br />
Résumés Plénières (Plenary talks)<br />
ETiC : un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> recherche commun sur <strong>la</strong> combustion <strong>et</strong> l’incendie<br />
en milieu confiné B.Porterie <strong>et</strong> L.Rigoll<strong>et</strong> 10<br />
Rôle du rayonnement dans <strong>la</strong> propagation du feu P. Boul<strong>et</strong> 11<br />
Propriétés fractales <strong>et</strong> dynamique du front J.P.Clerc 12<br />
Dégradation thermique <strong>de</strong> combustibles naturels E.<strong>Le</strong>oni 13<br />
<strong>Le</strong> feu à l'interface forêt-habitat A.Kaiss 14<br />
<strong>Le</strong> boilover d’hydrocarbures répandus en couche mince sur une surface<br />
aqueuse J.P.Garo, J.P.Vantelon <strong>et</strong> A.C.Fern<strong>de</strong>z Pello 15<br />
Outils <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tions du risque incendie à bord <strong><strong>de</strong>s</strong> navires C.Lallemand 16<br />
<strong>Le</strong>s besoins en recherche dans le domaine nucléaire L.Rigoll<strong>et</strong> 17<br />
<strong>Le</strong>s défis <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche pour améliorer <strong>la</strong> modélisation <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies dans les<br />
bâtiments <strong>et</strong> renforcer les applications à l’ingénierie <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité incendie<br />
A.Coppalle 18<br />
<strong>Le</strong>s additifs chimiques utilisés dans <strong>la</strong> lutte contre les feux <strong>de</strong> forêts C.Picard 19<br />
Smoul<strong>de</strong>ring fires, the slow, low-temperature, f<strong>la</strong>meless burning, represent<br />
the most persistent type of combustion G.Rein 20<br />
<strong>Le</strong>s moyens expérimentaux <strong>de</strong> caractérisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation thermique <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
matériaux soli<strong><strong>de</strong>s</strong> T.Rogaume 21<br />
Résumés Communications Orales (Oral talks)<br />
1.1 Risques <strong>de</strong> feux <strong>de</strong> for<strong>et</strong>s en Algérie A.Adja <strong>et</strong> al. 23<br />
1.2 Exploration <strong>de</strong> l'Apport <strong>de</strong> l'Imagerie Satellitaire dans <strong>la</strong> Détection Avancée<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> Feux <strong>de</strong> For<strong>et</strong> en Algérie A.Benbouzid 25<br />
1.3 <strong>Le</strong>s incendies <strong>de</strong> for<strong>et</strong>s dans l'Est algérien; cas <strong>de</strong> Bejaia, Jijel, Sétif<br />
<strong>et</strong> Bordj Bou-arreridj S.Merdas <strong>et</strong> al. 26<br />
1.4 Évaluation <strong>de</strong> La Télédétection Des Feux <strong>de</strong> Forêts par C<strong>la</strong>ssification<br />
M.Rebhi <strong>et</strong> al. 27<br />
1.5 Problematique <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêts en Algérie M.Abbas 29<br />
2.1 Application <strong><strong>de</strong>s</strong> métho<strong><strong>de</strong>s</strong> d’Ingénierie Incendie au Comportement <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Structures Métalliques sous <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions <strong>de</strong> Feu A.Kada <strong>et</strong> al. 31<br />
2.2 Apport <strong><strong>de</strong>s</strong> analyses statistiques dans <strong>la</strong> prévention du risque <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies<br />
<strong>de</strong> forêts en Algérie O.Sahar <strong>et</strong> al. 32<br />
2.3 Simu<strong>la</strong>tion Numérique De La Dégradation Des composites à matrice<br />
métallique (Ni) Protégé par <strong><strong>de</strong>s</strong> Barrières Chimiques Dans <strong>Le</strong>s<br />
Constructions Aéronautiques (Turbines) H.Khelifa <strong>et</strong> al. 33<br />
3.1 Control fire in the road tunnel by the optimization of the heat flux<br />
Un<strong>de</strong>r longitudinal venti<strong>la</strong>tion and water spray H.Miloua <strong>et</strong> al. 35<br />
3.2 Etu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> mousses liquids à base <strong>de</strong> PEO-SDS M.Lounis <strong>et</strong> K.Bekkour 36<br />
4.1 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’émission, <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmabilité <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés thermodynamiques<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> Composés Organiques Vo<strong>la</strong>tils impliqués dans les feux <strong>de</strong> forêts accélérés<br />
L.Courty, K.Ch<strong>et</strong>ehouna <strong>et</strong> al. 37<br />
6
STOP FEU, Oran 2010<br />
4.2 Simu<strong>la</strong>tion numérique <strong>de</strong> <strong>la</strong> dispersion <strong><strong>de</strong>s</strong> polluants dans milieu urbain<br />
(comparaison aves <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats numériques <strong>et</strong> expérimentaux) F.Bouzit <strong>et</strong> al. 39<br />
4.3 L’influence <strong><strong>de</strong>s</strong> variations <strong>de</strong> <strong>la</strong> température du gaz sur <strong>la</strong> production<br />
d’Ozone par décharge électrique haute pression dans le mé<strong>la</strong>nge N 2 -O 2<br />
M.Benyamina <strong>et</strong> al. 40<br />
4.4 Forest fires smoke monitoring from SeaWiFS sensor images A.Hassini <strong>et</strong> al. 42<br />
4.5 Quelles essences <strong>de</strong> reboisement peut –on r<strong>et</strong>enir pour le reboisement ?<br />
M.Kaid-Harche 43<br />
Résumés Communications par affiches (Posters)<br />
1.1 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> dimension fractale du front dans un système désordonné binaire.<br />
Application aux feux <strong>de</strong> forêt M. Ammari <strong>et</strong> N. Zekri 45<br />
1.2 Caractérisation Statistique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Structure d’un Réseau Aléatoire <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it<br />
Mon<strong>de</strong> <strong>et</strong> son Application aux Feux <strong>de</strong> Forêt F.Z.Benzahra <strong>et</strong> N.Zekri 47<br />
1.3 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> variation du vent sur <strong>la</strong> propagation d’un front <strong>de</strong> feu<br />
F-Z.Sabi <strong>et</strong> N.Zekri 50<br />
1.4 Une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> segmentation d’images pour <strong>la</strong> métrologie <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong><br />
forêts S.Rudz, K.Ch<strong>et</strong>ehouna <strong>et</strong> al. 52<br />
1.5 <strong>Le</strong>s feux <strong>de</strong> forêt dans <strong>la</strong> Parc National <strong>de</strong> Belezma: Stratégie <strong>de</strong> gestion<br />
H.Boukerker <strong>et</strong> al. 53<br />
1.6 Active Fire Monitoring with SEVIRI MSG Satellites A.Hassini <strong>et</strong><br />
A.H.Belbachir 55<br />
2.1 Comportement au feu d’un poteau mixte acier-béton <strong>et</strong> moyens <strong>de</strong><br />
prévention S.Sekkiou <strong>et</strong> al. 59<br />
5.1 Physical properties of polymeric materials N.Berrahou <strong>et</strong> al. 60<br />
5.2 La variation dimensionnelle <strong><strong>de</strong>s</strong> BAP soumis oumis au choc thermique<br />
B.Boukni <strong>et</strong> H.Hacène 61<br />
5.3 Renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure du coton par insersion <strong>de</strong> nanocharges <strong>de</strong><br />
montmorillonite Y.Koriche <strong>et</strong> S.Semsari 62<br />
5.4 Prediction of m<strong>et</strong>allic properties for the Heusler alloys Cu 2 MnX S-I.<br />
S.Messaoudi <strong>et</strong> al. 64<br />
5.5 <strong>Le</strong>s distributions du <strong>Le</strong>vy <strong><strong>de</strong>s</strong> intensités <strong><strong>de</strong>s</strong> courants dans <strong><strong>de</strong>s</strong> systèmes<br />
composites M. Mokhtari <strong>et</strong> L. Zekri 65<br />
5.6 Nouveaux systèmes vitreux à base d’oxy<strong>de</strong> d’Antimoine<br />
(0.7-x)Sb2O3 -30 ZnCl2 – x ZnBr2 F.Rahal <strong>et</strong> al. 67<br />
5.7 Etu<strong>de</strong> électrochimique sur le comportement corrosif <strong><strong>de</strong>s</strong> aciers <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
gazoducs <strong>de</strong> SONATRACH M. Hadjel <strong>et</strong> A.Benmoussat 68<br />
5.8 Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation en fréquence <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité d'un mé<strong>la</strong>nge<br />
métal/diélectrique au seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion pour <strong><strong>de</strong>s</strong> fréquences proches <strong>de</strong> DC<br />
F.Chari <strong>et</strong> N.Zekri 70<br />
5.9 Modélisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> spectroscopie d’impédance par un réseau électrique<br />
RC pour détecter <strong>la</strong> position d’un diélectrique dans une composite métaldiéléctrique<br />
G.Benab<strong>de</strong>l<strong>la</strong>h <strong>et</strong> N. Zekri 72<br />
7
STOP FEU, Oran 2010<br />
5.10 Modélisation <strong><strong>de</strong>s</strong> transferts <strong>de</strong> chaleur <strong>et</strong> <strong>de</strong> masse dans les poudres en<br />
projection thermique M.Ab<strong>de</strong>louahab, A,Nourreddine, A.Aissa 74<br />
5.11 Etu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> fluctuations du champ local d'un composite métal-diélectrique<br />
près du seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion B Bencherif <strong>et</strong> L Zekri 75<br />
Quelques articles <strong>de</strong> lectures invitées 77<br />
ETiC : un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> recherche commun sur <strong>la</strong> combustion <strong>et</strong> l’incendie<br />
en milieu confiné B.Porterie <strong>et</strong> L.Rigoll<strong>et</strong> 78<br />
Propriétés fractales <strong>et</strong> dynamique du front J.P.Clerc 82<br />
<strong>Le</strong> feu à l'interface forêt-habitat A.Kaiss 84<br />
<strong>Le</strong> boilover d’hydrocarbures répandus en couche mince sur une surface<br />
aqueuse J.P.Garo, J.P.Vantelon <strong>et</strong> A.C.Fern<strong>de</strong>z Pello 88<br />
<strong>Le</strong>s moyens expérimentaux <strong>de</strong> caractérisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation thermique <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
matériaux soli<strong><strong>de</strong>s</strong> T.Rogaume 94<br />
Liste <strong><strong>de</strong>s</strong> participants 98<br />
La Recherche en Algérie 99<br />
Remarque : Dans <strong>la</strong> numérotation X.Y <strong><strong>de</strong>s</strong> communications orales <strong>et</strong> posters, X<br />
signifie le numéro <strong>de</strong> thème (1 à 5) <strong>et</strong> Y l’ordre <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication.<br />
8
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
Plénières<br />
Plenary talks<br />
9
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
ETiC : un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> recherche commun sur <strong>la</strong> combustion <strong>et</strong> l’incendie en<br />
milieu confiné<br />
B.Porterie <strong>et</strong> L.Rigoll<strong>et</strong><br />
EPUM/ IUSTI Marseille IRSN, Cadarache<br />
Fruit <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borations établies <strong>de</strong> longue date entre l'IRSN, le CNRS <strong>et</strong> les<br />
Universités d'Aix-Marseille I & II, le <strong>la</strong>boratoire ETiC (l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'incendie en milieu<br />
confiné ) perm<strong>et</strong>tra <strong>de</strong> conduire les recherches nécessaires pour apprécier les risques<br />
liés aux activités nucléaires <strong>et</strong> industrielles. Il perm<strong>et</strong>tra également d'atteindre une<br />
taille critique <strong>de</strong> compétences pour abor<strong>de</strong>r <strong><strong>de</strong>s</strong> thématiques <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> complexité <strong>et</strong><br />
m<strong>et</strong>tre en œuvre les techniques les plus avancées <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> d'expérimentation<br />
pour faire progresser <strong>la</strong> sûr<strong>et</strong>é. Au-<strong>de</strong>là, c<strong>et</strong>te coopération exemp<strong>la</strong>ire <strong><strong>de</strong>s</strong> équipes<br />
contribue à resserrer les liens entre les organismes au bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
formation par <strong>la</strong> recherche. Associer <strong><strong>de</strong>s</strong> compétences complémentaires, bâtir <strong>et</strong> gérer<br />
en commun <strong><strong>de</strong>s</strong> outils <strong>de</strong> modélisation <strong>et</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion, diffuser <strong>la</strong> connaissance <strong>et</strong> le<br />
savoir-faire acquis pour un cas spécifique, établir un dialogue interdisciplinaire, sont<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> approches éprouvées pour appliquer <strong><strong>de</strong>s</strong> connaissances fondamentales à <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
problématiques appliquées.<br />
Au p<strong>la</strong>n scientifique, son objectif est <strong>de</strong> comprendre, modéliser <strong>et</strong> prédire le<br />
comportement d’un incendie en milieu confiné <strong>et</strong> ventilé, caractéristique <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
instal<strong>la</strong>tions nucléaires <strong>et</strong> industrielles. Dans <strong>la</strong> communauté scientifique, un élément<br />
qui fait consensus est <strong>la</strong> difficulté à modéliser <strong>et</strong> à évaluer <strong>la</strong> source combustible, en<br />
termes <strong>de</strong> puissance, <strong>de</strong> production <strong>de</strong> suies <strong>et</strong> <strong>de</strong> débit <strong>de</strong> pyrolyse. Une difficulté qui<br />
s’accentue lorsque le feu se développe en atmosphère sous-oxygénée. Ces problèmes<br />
sont abordés dans le cadre d’ETIC au travers <strong>de</strong> quatre thématiques scientifiques dans<br />
une démarche couplée d’analyse expérimentale m<strong>et</strong>tant en œuvre <strong><strong>de</strong>s</strong> techniques <strong>de</strong><br />
mesures avancées, <strong>de</strong> modélisation <strong>et</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion numérique : (1) étu<strong>de</strong> du<br />
mouvement <strong><strong>de</strong>s</strong> fumées, (2) combustion en conditions d’incendie, (3) développement<br />
d’instrumentation dédiée aux interactions incendie-paroi <strong>et</strong> (4) développement <strong>de</strong><br />
modèles à champs.<br />
De par leur caractère générique, les thèmes scientifiques abordés dans le cadre du<br />
<strong>la</strong>boratoire ETiC, <strong>et</strong> les outils qui leur sont associés, ouvrent <strong>la</strong> voie à <strong><strong>de</strong>s</strong> r<strong>et</strong>ombées<br />
dans <strong><strong>de</strong>s</strong> domaines du « hors-nucléaire », comme les feux en milieux urbains,<br />
industriels <strong>et</strong> naturels, <strong>la</strong> caractérisation <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux, ou le développement d’outils<br />
prédictifs <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion numérique.<br />
10
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
Rôle du rayonnement dans <strong>la</strong> propagation du feu<br />
P.Boul<strong>et</strong><br />
LEMTA, Nancy, France<br />
<strong>Le</strong> rayonnement est souvent i<strong>de</strong>ntifié comme un <strong><strong>de</strong>s</strong> moteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> propagation du feu.<br />
Pourtant son rôle exact est souvent mal connu ou mal quantifié. Nous avons <strong>la</strong>ncé<br />
<strong>de</strong>puis 5 ans un ensemble d’étu<strong><strong>de</strong>s</strong> expérimentales visant à caractériser l’émission <strong>de</strong><br />
rayonnement par une f<strong>la</strong>mme <strong>et</strong> les propriétés <strong>de</strong> réception <strong><strong>de</strong>s</strong> surfaces cibles. Ce<br />
travail a été mené essentiellement en vue d’applications aux feux naturels mais nous<br />
l’étendons actuellement aux feux compartimentés. Par l’utilisation <strong>de</strong> dispositifs<br />
dédiés dans l’infrarouge (caméra multispectrale, spectromètres à transformée <strong>de</strong><br />
Fourier) nous avons observé les propriétés <strong>de</strong> réception <strong>et</strong> d’émission dans l’infrarouge<br />
en étudiant <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> p<strong>et</strong>ite taille en bacs <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> f<strong>la</strong>mmes plus conséquentes en tunnel<br />
à feu. La quantification <strong>de</strong> l’émission <strong><strong>de</strong>s</strong> suies par rapport à ce qu’ém<strong>et</strong>tent les gaz<br />
produits par <strong>la</strong> combustion a montré <strong>la</strong> complexité du problème selon l’épaisseur<br />
optique <strong>de</strong> <strong>la</strong> f<strong>la</strong>mme, bien loin du concept d’une f<strong>la</strong>mme noire équivalente issue d’un<br />
panneau rayonnant. De même <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong> l’absorptivité spectrale <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation<br />
traduit un comportement non gris, évolutif en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> teneur en eau, qui n’est<br />
pas celui d’une surface absorbante noire ou même grise. La présentation proposera une<br />
synthèse <strong>de</strong> résultats sur une centaine d’essais d’émission <strong>de</strong> rayonnement pour <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
f<strong>la</strong>mmes <strong>de</strong> taille croissante. Elle montrera en parallèle les propriétés d’absorption<br />
pour un ensemble <strong>de</strong> végétaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> région méditerranéenne.<br />
Ces informations sont délivrées comme données d’entrée à <strong><strong>de</strong>s</strong>tination <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
modélisateurs. Elles doivent maintenant servir en vue d’efforts <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> gui<strong>de</strong>r<br />
vers <strong><strong>de</strong>s</strong> essais en gran<strong>de</strong>ur réelle, sur brû<strong>la</strong>ge dirigé par exemple.<br />
11
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
Propriétés fractales <strong>et</strong> dynamique du front.<br />
J-P.Clerc<br />
IUSTI, Marseille, France<br />
<strong>Le</strong>s grands incendies <strong>de</strong> forêts se propagent dans <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions météorologiques <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
végétation hétérogènes. <strong>Le</strong>s contours <strong>de</strong> feux sont irréguliers <strong>et</strong> souvent fractals,<br />
comme le montrent les images satellites <strong>de</strong> feux historiques. <strong>Le</strong> modèle <strong>de</strong> « réseau <strong>de</strong><br />
p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong>» est un modèle stochastique <strong>de</strong> réseau social qui prend en compte ces<br />
hétérogéneités locales <strong>et</strong> les connections à longue distance dues au rayonnement,<br />
responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> propagation. Il utilise <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres macroscopiques physiques <strong>et</strong><br />
a été validé sur <strong><strong>de</strong>s</strong> feux historiques (<strong>Le</strong>cture invitée d'Ahmed Kaiss). On montre que<br />
le modèle <strong>de</strong> p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong> reproduit <strong>de</strong> façon satisfaisante le comportement fractal du<br />
feu. L'étu<strong>de</strong> du comportement dynamique du front <strong>de</strong> feu en fonction <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres<br />
du modèle perm<strong>et</strong> d'i<strong>de</strong>ntifier plusieurs régimes <strong>de</strong> propagation.<br />
On s'intéresse également à <strong>la</strong> corré<strong>la</strong>tion qui semble exister entre <strong>la</strong> dimension fractale<br />
du support sur lequel se propage le feu, supposée connue, <strong>et</strong> celles du contour <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
surface brûlée. Ce que confirment les premiers résultats obtenus concernant <strong>la</strong><br />
propagation d’un feu sur un paysage dont <strong>la</strong> dimension fractale est connue a priori, en<br />
l’absence <strong>de</strong> vent <strong>et</strong> pour un couvert végétal homogène. La dimension fractale du<br />
paysage pourrait être un indicateur du comportement fractal du feu <strong>et</strong> donc ai<strong>de</strong>r au<br />
dimensionnement <strong><strong>de</strong>s</strong> moyens <strong>de</strong> lutte à engager.<br />
12
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
Dégradation thermique <strong>de</strong> combustibles naturels<br />
E.Léoni<br />
SPE, Corte, France)<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> propagation avec f<strong>la</strong>mme d'un feu <strong>de</strong> végétaux ou sans f<strong>la</strong>mme d'un feu <strong>de</strong><br />
tourbe, <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> l'étape <strong>de</strong> dégradation thermique du soli<strong>de</strong> est primordiale<br />
pour <strong>la</strong> modélisation du processus.<br />
<strong>Le</strong> travail présenté concerne l'utilisation <strong>de</strong> l'analyse thermique <strong>et</strong> chimique pour<br />
l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation thermique <strong>de</strong> végétaux méditerranéens <strong>et</strong> <strong>de</strong> tourbes<br />
Ecossaises <strong>et</strong> Russes. La métho<strong>de</strong> expérimentale <strong>et</strong> numérique développée est<br />
présentée <strong>et</strong> les resultats obtenus sur les différents combustibles sont commentés. <strong>Le</strong>s<br />
expériences menées perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong> remonter à <strong>la</strong> cinétique <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation thermique<br />
<strong>et</strong> à <strong>la</strong> composition <strong><strong>de</strong>s</strong> gaz émis durant c<strong>et</strong>te dégradation.<br />
13
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
<strong>Le</strong> feu à l'interface forêt-habitat<br />
A.Kaiss<br />
IUSTI, Marseille, France<br />
La problématique <strong><strong>de</strong>s</strong> grands incendies <strong>de</strong> forêts, responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> majeure partie <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
surfaces brûlées, est qu'ils se propagent dans <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions hétérogènes en termes <strong>de</strong><br />
vent, <strong>de</strong> végétation <strong>et</strong> <strong>de</strong> relief. <strong>Le</strong> modèle <strong>de</strong> « réseau <strong>de</strong> p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong>» est un modèle<br />
stochastique <strong>de</strong> réseau social qui prend en compte ces hétérogéneités locales <strong>et</strong> les<br />
connections à longue distance (rayonnement, sautes <strong>de</strong> feu) responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
propagation. Il utilise <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres macroscopiques physiques, comme le temps <strong>de</strong><br />
combustion, le temps <strong>de</strong> dégradation du végétal, ou <strong>la</strong> zone d’impact du rayonnement.<br />
La détermination <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres a nécessité le recours à l’expérience <strong>et</strong> à <strong>la</strong><br />
simu<strong>la</strong>tion numérique à l’ai<strong>de</strong> d’un modèle déterministe tri-dimensionnel <strong>de</strong><br />
combustion diphasique à l'échelle macroscopique (celle <strong><strong>de</strong>s</strong> f<strong>la</strong>mmes du front). Dans<br />
sa version <strong>la</strong> plus avancée, <strong>la</strong> végétation est répartie sur un réseau amorphe construit<br />
par algorithme génétique. La validation a été réalisée par comparaison avec <strong><strong>de</strong>s</strong> feux<br />
réels. <strong>Le</strong>s applications du modèle sont nombreuses, <strong>de</strong>puis l' é<strong>la</strong>boration d'un<br />
simu<strong>la</strong>teur jusqu'à l'établissement <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> prévention du risque incendie <strong>de</strong> forêts<br />
ou à l'ai<strong>de</strong> à l'aménagement du territoire.<br />
Un autre aspect <strong>de</strong> <strong>la</strong> problématique <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies <strong>de</strong> forêts concerne le risque subi à<br />
l'interface forêt-habitat en termes <strong>de</strong> rayonnement du front <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mmes sur les<br />
structures. Il est traité en combinant le modèle <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme soli<strong>de</strong> au calcul du<br />
rayonnement par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> Monte Carlo. Des exemples concr<strong>et</strong>s sont donnés<br />
perm<strong>et</strong>tant d'établir une cartographie précise <strong><strong>de</strong>s</strong> niveaux radiatifs.<br />
14
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
<strong>Le</strong> boilover d’hydrocarbures répandus en couche mince sur une surface aqueuse<br />
J.P.Garo <strong>et</strong> J.P.Vantelon<br />
Département, Flui<strong><strong>de</strong>s</strong>, Thermique <strong>et</strong> Combustion, Institut P’, UPR CNRS 3346<br />
ENSMA BP 40109, 86961 Futuroscope Chasseneuil France<br />
A.C.Fernan<strong>de</strong>z-Pello<br />
Department of Mechanical Engineering, University of California at Berkeley<br />
Berkeley, California 94720 USA<br />
L’inf<strong>la</strong>mmation d’un épandage acci<strong>de</strong>ntel d’hydrocarbure flottant à <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> l’eau<br />
peut conduire à un phénomène <strong>de</strong> caractère spectacu<strong>la</strong>ire <strong>et</strong> redoutable, souvent appelé<br />
boilover en couche mince. Dans certaines conditions, en eff<strong>et</strong>, le flux <strong>de</strong> chaleur<br />
traverse <strong>la</strong> nappe <strong>de</strong> combustible en feu, chauffe l’eau jusqu’à ébullition, <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te<br />
ébullition soulève le combustible <strong>et</strong> le disperse, provoquant une véritable explosion du<br />
foyer.<br />
Une étu<strong>de</strong> systématique <strong>de</strong> ce phénomène complexe est présentée à partir<br />
d’expérimentations menées à l’échelle <strong>la</strong>boratoire, sur différents types<br />
d’hydrocarbures représentant une <strong>la</strong>rge gamme <strong>de</strong> composition (purs ou <strong>de</strong> coupes <strong>de</strong><br />
distil<strong>la</strong>tion variables).<br />
L’influence <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres majeurs jouant sur le processus, épaisseur initiale <strong>et</strong> point<br />
d’ébullition du combustible, surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> nappe, <strong>et</strong> leur impact sur l’échauffement <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
phases, tant combustible qu’aqueuse, <strong>et</strong> sur le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> déclenchement <strong>de</strong> l’ébullition,<br />
sont examinés. <strong>Le</strong>s résultats obtenus m<strong>et</strong>tent bien en évi<strong>de</strong>nce le rôle <strong><strong>de</strong>s</strong> transferts<br />
thermiques en profon<strong>de</strong>ur <strong>et</strong> montre que le boilover est dû à une ébullition <strong>de</strong> type<br />
nucléation hétérogène prenant naissance à l’interface combustible-eau, l’eau étant<br />
surchauffée.<br />
Une modélisation <strong><strong>de</strong>s</strong> transferts <strong>de</strong> chaleur perm<strong>et</strong> enfin <strong>de</strong> bien appréhen<strong>de</strong>r les<br />
mécanismes contrô<strong>la</strong>nt le phénomène <strong>et</strong> <strong>de</strong> prédire les risques d’apparition <strong>de</strong> celui-ci.<br />
15
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
Outils <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tions du risque incendie à bord <strong><strong>de</strong>s</strong> navires<br />
C.Lallemand<br />
DGA, Toulon, France<br />
La sécurité incendie à bord <strong><strong>de</strong>s</strong> navires <strong>de</strong> combat regroupent les <strong>de</strong>ux risques<br />
suivants : le risque incendie c<strong>la</strong>ssique (combustion aérobie) <strong>et</strong> le risque pyrotechnique<br />
(munitions).<br />
Bien que <strong><strong>de</strong>s</strong> réglementations « marine » (RT, IG, …) <strong>et</strong> « civiles » (SOLAS, APSAD,<br />
…) existent sur ces suj<strong>et</strong>s, l’expertise <strong><strong>de</strong>s</strong> proj<strong>et</strong>s <strong>de</strong> navire ou l’analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> acci<strong>de</strong>nts<br />
<strong>et</strong> inci<strong>de</strong>nts à bord ne peuvent pas être effectuées que sur le seul angle « respect <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
réglementation ».<br />
Ainsi, une prestation globale d’analyse <strong>de</strong> sécurité c<strong>la</strong>ssique à bord <strong><strong>de</strong>s</strong> navires fait<br />
appel à trois domaines <strong>de</strong> compétence qui se complètent : <strong>la</strong> « phénoménologie <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
sinistres » qui comprend : <strong>la</strong> modélisation physique <strong><strong>de</strong>s</strong> phénomènes <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> moyens <strong>de</strong><br />
prévention <strong>et</strong> <strong>de</strong> lutte ainsi que <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion numérique <strong>de</strong> scénarios acci<strong>de</strong>ntels, l’«<br />
organisation sécurité à bord » qui comprend les aspects préventifs <strong>et</strong> les moyens <strong>de</strong><br />
lutte <strong>et</strong> enfin, les « instal<strong>la</strong>tions à bord » qui recoupent les matériels <strong>et</strong> leur sûr<strong>et</strong>é <strong>de</strong><br />
fonctionnement.<br />
Pour couvrir le <strong>de</strong>uxième domaine, DGA Techniques navales dispose d’outils <strong>de</strong><br />
simu<strong>la</strong>tion du risque incendie, développés en interne (logiciel macroscopique, co<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
0D ou 1D) ou en externe (co<strong><strong>de</strong>s</strong> 3D) pour couvrir l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> aspects <strong>et</strong> sur<br />
plusieurs échelles : au niveau système (propagation d’un incendie dans le navire pris<br />
dans sa globalité), au niveau expertise (analyse globale) mais aussi phénoménologique<br />
(co<strong>de</strong> 3D) pour le local sinistré <strong>et</strong> ses voisins immédiats.<br />
L’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te présentation est <strong>de</strong> vous donner un aperçu <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> ces outils<br />
<strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion.<br />
16
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
<strong>Le</strong>s besoins en recherche dans le domaine nucléaire<br />
L.Rigoll<strong>et</strong><br />
IRSN, Cadarache, France<br />
<strong>Le</strong> confinement <strong><strong>de</strong>s</strong> feux dans les locaux <strong><strong>de</strong>s</strong> instal<strong>la</strong>tions nucléaires impacte fortement<br />
<strong>la</strong> combustion <strong><strong>de</strong>s</strong> foyers qui peuvent être liqui<strong><strong>de</strong>s</strong> (feux <strong>de</strong> solvants dans les<br />
instal<strong>la</strong>tions du cycle du combustible) ou soli<strong><strong>de</strong>s</strong> (matériels électriques, en particulier,<br />
dans toutes les instal<strong>la</strong>tions). La venti<strong>la</strong>tion éventuelle <strong><strong>de</strong>s</strong> locaux <strong>et</strong> sa conduite en cas<br />
<strong>de</strong> feu (arrêt, passage en <strong>de</strong>mi régime, ferm<strong>et</strong>ure <strong>de</strong> c<strong>la</strong>p<strong>et</strong>s coupe-feux) joue un rôle<br />
crucial sur <strong>la</strong> puissance thermique du foyer <strong>et</strong> donc sur <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> feu. Pour les<br />
instal<strong>la</strong>tions du cycle du combustible, le risque est <strong>la</strong> dissémination d’aérosols<br />
radioactifs dans l’environnement consécutive à une perte <strong>de</strong> confinement <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
dispositifs contenant ces matériaux (percement d’une boite à gants, fuite du solvant<br />
servant au r<strong>et</strong>raitement du combustible). Pour les réacteurs <strong>de</strong> puissance, le risque est<br />
<strong>la</strong> perte du contrôle du réacteur pouvant conduire à un acci<strong>de</strong>nt endommageant son<br />
cœur. Dans le premier cas, il est nécessaire <strong>de</strong> caractériser les phénomènes physiques,<br />
conséquences du feu, qui peuvent endommager le confinement <strong><strong>de</strong>s</strong> matières<br />
radioactives, favoriser leur transport <strong>et</strong> dégra<strong>de</strong>r les dispositifs ultimes <strong>de</strong> filtration.<br />
Pour les réacteurs, il est nécessaire <strong>de</strong> caractériser les chargements thermiques <strong>et</strong><br />
chimiques engendrées par le feu qui peuvent endommager les équipements importants<br />
pour <strong>la</strong> sûr<strong>et</strong>é (composants d’armoires électriques <strong>et</strong> électroniques, câbles électriques<br />
<strong>de</strong> puissance <strong>et</strong> <strong>de</strong> contrôle) <strong>et</strong> nuire à l’intervention (propagation du feu <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
fumées).<br />
La recherche menée par l’IRSN, Institut <strong>de</strong> Radioprotection <strong>et</strong> <strong>de</strong> Sûr<strong>et</strong>é Nucléaire<br />
(France), a pour obj<strong>et</strong> le développement <strong><strong>de</strong>s</strong> connaissances <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> outils nécessaire à<br />
l’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> conséquence d’un incendie <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> pertinence <strong><strong>de</strong>s</strong> mesures proposées<br />
par les exploitants pour limiter voire arrêter son développement <strong>et</strong> en limiter les<br />
conséquences. La démarche générale est re<strong>la</strong>tivement c<strong>la</strong>ssique, elle s’appuie sur les<br />
vol<strong>et</strong>s expérimentation, modélisation <strong>et</strong> implémentation dans les logiciels <strong>de</strong> calcul<br />
simu<strong>la</strong>nt les scénarios <strong>et</strong> configurations d’intérêt, enfin validation <strong><strong>de</strong>s</strong> modèles<br />
physique sur <strong><strong>de</strong>s</strong> essais en gran<strong>de</strong>ur réelle <strong>et</strong> représentatifs <strong><strong>de</strong>s</strong> acci<strong>de</strong>nts étudiés.<br />
17
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
<strong>Le</strong>s défis <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche pour améliorer <strong>la</strong> modélisation <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies dans les<br />
bâtiments <strong>et</strong> renforcer les applications à l’ingénierie <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité incendie<br />
A.Coppalle<br />
CORIA, Rouen, France<br />
Un incendie est un processus complexe qui fait intervenir <strong>de</strong> nombreux phénomènes<br />
physiques <strong>et</strong> chimiques. Son analyse <strong>et</strong> sa modélisation font appel à <strong><strong>de</strong>s</strong> compétences<br />
variées dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> thermique <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> combustion, <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux mais aussi<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mécanique du soli<strong>de</strong> <strong>et</strong> du comportement <strong><strong>de</strong>s</strong> structures. Chaque spécialiste <strong>de</strong><br />
ces disciplines peut donc apporter ses compétences afin d’améliorer <strong>la</strong> compréhension<br />
globale <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies <strong>et</strong> <strong>la</strong> prédiction <strong>de</strong> leurs conséquences.<br />
Dans c<strong>et</strong> exposé, il sera rappelé quelques points essentiels qui perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong><br />
comprendre le départ <strong>et</strong> l’évolution d’un sinistre dans un milieu confiné, ainsi que les<br />
phénomènes <strong>de</strong> base qui s’enchaînent. En particulier, l’influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> puissance<br />
libérée sera examinée sous l’angle <strong><strong>de</strong>s</strong> différents transferts <strong>de</strong> masse <strong>et</strong> <strong>de</strong> chaleur qui<br />
contrôlent l’intensité <strong>et</strong> <strong>la</strong> croissance d’un incendie. L'état actuel <strong><strong>de</strong>s</strong> connaissances sur<br />
c<strong>et</strong>te puissance libérée <strong>et</strong> sa modélisation sera exposé. Des exemples serviront à<br />
illustrer l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> modélisation à l'Ingénierie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sécurité Incendie, dont le<br />
principe <strong>et</strong> les métho<strong><strong>de</strong>s</strong> seront brièvement rappelés.<br />
18
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
<strong>Le</strong>s additifs chimiques utilisés dans <strong>la</strong> lutte contre les feux <strong>de</strong> forêts<br />
C.Picard<br />
CEREN, Va<strong>la</strong>bre, France<br />
Quelque soit le moyen <strong>de</strong> lutte, sa rentabilité est subordonnée à l’agent extincteur qu’il<br />
utilise. <strong>Le</strong> dopage <strong>de</strong> l’eau pour en améliorer ses qualités extinctrices ou r<strong>et</strong>ardatrices<br />
face à l’élément feu n’est pas novateur. En 1821, Gay Lussac m<strong>et</strong> en évi<strong>de</strong>nce les<br />
propriétés ignifugeantes <strong>de</strong> quelques sels minéraux (phosphates,chlorure<br />
d’ammonium).<br />
Il faut attendre l’année 1954 pour que les équipes <strong>de</strong> l’United States Forest Service aux<br />
USA s’intéressent aux propriétés ignifugeantes <strong>de</strong> ces agents chimiques. De nombreux<br />
essais sont réalisés par l’équipe <strong>de</strong> C.Georges, tant sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> l’efficacité que <strong>de</strong><br />
l’épandage du produit. r<strong>et</strong>ardants. En eff<strong>et</strong>, <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> comportement se<br />
distinguent: les r<strong>et</strong>ardants à court terme <strong>et</strong> les r<strong>et</strong>ardants à long terme.<br />
Très synthétiquement nous allons examiner leur mo<strong>de</strong> d’action, les différents tests<br />
perm<strong>et</strong>tant : <strong>de</strong> connaître leurs propriétés physico chimiques, leur innocuité face à <strong>la</strong><br />
faune <strong>et</strong> <strong>la</strong> flore <strong>et</strong> enfin comment les hiérarchiser en fonction <strong>de</strong> leur efficacité. <strong>Le</strong><br />
second vol<strong>et</strong> <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te présentation sera dédié à leur emploi opérationnel tant dans le<br />
domaine aérien que terrestre. Enfin différentes situations réelles opérationnelles seront<br />
présentées en corré<strong>la</strong>nt l’arrêt d’un front <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme avec l’utilisation d’additifs<br />
chimiques.<br />
19
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
Smoul<strong>de</strong>ring fires, the slow, low-temperature, f<strong>la</strong>meless burning, represent the<br />
most persistent type of combustion<br />
G.Rein<br />
Ei<strong>de</strong>mburg University, Scot<strong>la</strong>nd<br />
Phenomena and the longest continuously fires on Earth system. Although interactions<br />
b<strong>et</strong>ween f<strong>la</strong>ming fires and the Earth system have been a central focus, smoul<strong>de</strong>ring<br />
fires could be as important in terms of ecosystem damage, atmospheric emissions and<br />
socio-economic threats but have received little attention.<br />
Biomass capable of sustaining smoul<strong>de</strong>ring are logs, litter, duff, humus, peat, coal<br />
seams and soils of high organic fraction, which global total carbon pool exceeds that<br />
of the Earth’s forests or atmosphere. After the study of the 1997 extreme haze event in<br />
South-East Asia, the scientific community recognised the environmental and economic<br />
threats. The haze was caused by the spread of vast smoul<strong>de</strong>ring peat fires in Indonesia,<br />
burning below the surface for months during the El Niño climate event. It has been<br />
calcu<strong>la</strong>ted that the 1997 fires released b<strong>et</strong>ween 0.81 and 2.57 Gton of carbon gases<br />
(13–40% of global emissions).<br />
Smoul<strong>de</strong>ring fires propagate slowly through organic <strong>la</strong>yers of the forest ground and<br />
can reach <strong>de</strong>eper horizons if <strong>la</strong>rge cracks, natural piping or channel systems exist.<br />
Once ignited, they are particu<strong>la</strong>rly difficult to extinguish <strong><strong>de</strong>s</strong>pite extensive rains,<br />
weather changes or fire-fighting attempts, and can persist for long periods of time<br />
(months, years) spreading <strong>de</strong>ep and over extensive areas. Differences with f<strong>la</strong>ming<br />
fires are important.<br />
These wildfires burn fossil fuels and thus are about the only carbon-positive natural<br />
fire phenomena. This creates feedbacks in the climate system because soil moisture<br />
<strong>de</strong>ficit and self-heating are enchanted un<strong>de</strong>r warmer climate scenarios and lead to<br />
more frequent fires. Warmer temperatures at high <strong>la</strong>titu<strong><strong>de</strong>s</strong> are resulting in more<br />
frequent Artic fires. Unprece<strong>de</strong>nted permafrost thaw is leaving <strong>la</strong>rge soil carbon pools<br />
exposed to smoul<strong>de</strong>ring fires for the fist time since millennia. This presentation<br />
reviews the current knowledge on smoul<strong>de</strong>ring fires in the Earth system regarding<br />
combustion dynamics, damage to the soil, emissions and feedbacks in the climate<br />
system.<br />
20
STOP FEU, Oran 2010<br />
Plénières/Plenary talks<br />
<strong>Le</strong>s moyens expérimentaux <strong>de</strong> caractérisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation thermique <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
matériaux soli<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
T.Rogaume<br />
Poitiers, France<br />
Face aux coûts <strong>et</strong> impacts <strong><strong>de</strong>s</strong> feux, il est primordial <strong>de</strong> développer <strong><strong>de</strong>s</strong> moyens <strong>de</strong><br />
prévention <strong>et</strong> <strong>de</strong> protection. Toutefois, chaque feu étant <strong>de</strong> part ses caractéristiques <strong>et</strong><br />
son environnement un cas particulier, son étu<strong>de</strong> requiert <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>et</strong><br />
l’utilisation <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tions numériques. En ce sens divers co<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong><strong>de</strong>s</strong> feux<br />
ont été développés, mais tous reposent sur une hypothèse limitante, le modèle <strong>de</strong><br />
pyrolyse. Ainsi <strong>de</strong> nombreuses étu<strong><strong>de</strong>s</strong> actuelles consistent à développer <strong>de</strong> nouveaux<br />
modèles <strong>de</strong> pyrolyse, plus pertinents <strong>et</strong> performants. Toutefois, se pose toujours pour<br />
le modélisateur <strong>la</strong> question suivante : quel modèle <strong>de</strong> pyrolyse prendre, est il vali<strong>de</strong><br />
pour mes conditions ? Chaque modèle <strong>de</strong> pyrolyse est développé <strong>et</strong> mis en p<strong>la</strong>ce à<br />
partir <strong>de</strong> résultats expérimentaux.<br />
C’est dans ce sens qu’est réalisée c<strong>et</strong>te conférence, dont l’enjeu est <strong>de</strong> présenter les<br />
différents dispositifs expérimentaux utilisés afin d’étudier <strong>la</strong> dégradation thermique<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux soli<strong><strong>de</strong>s</strong> dans le but <strong>de</strong> développer <strong><strong>de</strong>s</strong> modèles <strong>de</strong> pyrolyse. Pour chaque<br />
dispositif expérimental, un bi<strong>la</strong>n du principe <strong>de</strong> fonctionnement, <strong><strong>de</strong>s</strong> avantages <strong>et</strong><br />
inconvénients est réalisé<br />
21
STOP FEU, Oran 2010<br />
Communications Orales<br />
Communications<br />
orales<br />
Oral Sessions<br />
22
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème I<br />
O.1.1<br />
Risques <strong>de</strong> feux <strong>de</strong> for<strong>et</strong>s en Algérie. Analyse du risque <strong>et</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> l’année 2007<br />
A.Adja, C. Mansour, A .Bounif<br />
Laboratoire <strong><strong>de</strong>s</strong> Carburants Gazeux <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’Environnement USTO<br />
A l’instar <strong><strong>de</strong>s</strong> pays méditerranéens, le patrimoine forestier Algérien est exposé aux<br />
risques du feu, en égard à sa composition floristique en espèces très combustibles <strong>et</strong> au<br />
climat chaud <strong>et</strong> sec en été qui favorise <strong>la</strong> propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’activité<br />
anthropique, sans cesse croissante, <strong><strong>de</strong>s</strong> popu<strong>la</strong>tions riveraines. Ce patrimoine, couvrant<br />
une superficie <strong>de</strong> 4,7 millions d’hectares <strong>de</strong> forêts, <strong>de</strong> maquis <strong>et</strong> <strong>de</strong> broussailles, a été<br />
touché en moyenne, sur 28.000 ha/an par les feux <strong>de</strong> forêts durant <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière<br />
décennie.<br />
Par ses eff<strong>et</strong>s, le feu est un agent <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong>truction aussi bien pour les hommes <strong>et</strong> leurs<br />
activités, que pour l'environnement.<br />
Évaluer un risque, c’est m<strong>et</strong>tre en regard le niveau estimé du risque <strong>et</strong> un certain<br />
nombre <strong>de</strong> critères préa<strong>la</strong>blement défini <strong>de</strong> manière à hiérarchiser les risques, sans se<br />
préoccuper du moment <strong>de</strong> son apparition. Donc Évaluer un risque, c’est chercher à le<br />
connaître, sans savoir quand le phénomène se produira<br />
Il existe <strong>de</strong>ux types d’évaluation: Une estimation dans le temps <strong>et</strong> dans l’espace<br />
<strong>Le</strong> risque temporel n’est pas forcément uniforme sur l’ensemble d’un territoire,<br />
l’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> zones à risque : Pour avoir une action ciblée <strong>et</strong> adaptée, il est donc<br />
important <strong>de</strong> connaître les zones présentant un risque élevé.<br />
L'évaluation du niveau <strong>de</strong> risque peut être réalisée selon <strong>de</strong>ux approches :<br />
- A dires d'experts.<br />
- Recours à <strong><strong>de</strong>s</strong> modèles mathématiques.<br />
La simu<strong>la</strong>tion <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêt, c’est-à-dire <strong>la</strong> prévision au cours du temps du<br />
développement du front <strong>de</strong> feu <strong>et</strong> du contour <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone incendiée, ainsi que <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
caractéristiques du feu (puissance, longueur <strong><strong>de</strong>s</strong> f<strong>la</strong>mmes), a pour objectif d’améliorer<br />
les actions <strong>de</strong> prévision <strong>et</strong> <strong>de</strong> lutte.<br />
L'évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface à l'attaque <strong>et</strong> <strong>la</strong> prédiction <strong>de</strong> l'évolution du front <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme<br />
sont <strong><strong>de</strong>s</strong> données importantes pour le déploiement <strong><strong>de</strong>s</strong> forces <strong>de</strong> lutte.<br />
La simu<strong>la</strong>tion est un outil d’ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> décision. En aucun cas elle ne peut<br />
remp<strong>la</strong>cer celle-ci l’homme. Il faut distinguer plusieurs types <strong>de</strong> modèle dont:<br />
23
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème I<br />
- <strong>Le</strong>s modèles locaux <strong>de</strong> propagation.<br />
- <strong>Le</strong>s modèles locaux <strong>de</strong> comportement du feu.<br />
On peut distinguer les facteurs <strong>de</strong> déclenchement <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies, qui sont généralement<br />
d'origine anthropique <strong>et</strong> les facteurs du milieu naturel qui déterminent <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions<br />
favorables à l'éclosion <strong>et</strong> à <strong>la</strong> propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies. La contribution <strong>de</strong> ces<br />
facteurs au risque peut être estimée à partir <strong>de</strong> l'observation <strong><strong>de</strong>s</strong> phénomènes<br />
historiques <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'expérience <strong><strong>de</strong>s</strong> personnels <strong>de</strong> terrain, ou encore <strong>de</strong> données<br />
expérimentales.<br />
<strong>Le</strong>s feux représente sans aucun doute le facteur <strong>de</strong> dégradation le plus ravageur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
forêt en Algérie, malgré les efforts engagé par l’état, le feu continu a détruire notre<br />
patrimoine naturel <strong>et</strong> ce<strong>la</strong> suite a l’étendu du for<strong>et</strong> algérienne, cependant il faut<br />
intensifier les moyens humaines <strong>et</strong> matériel <strong>et</strong> surtout les rationalisé dans un<br />
programme établi sur <strong>la</strong> base <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong> d’analyse <strong>de</strong> risque établi en col<strong>la</strong>boration par<br />
les différents acteurs ; du terrains, <strong><strong>de</strong>s</strong> chercheurs d’université <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> société.<br />
24
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème I<br />
O.1.2<br />
Exploration <strong>de</strong> l'Apport <strong>de</strong> l'Imagerie Satellitaire dans <strong>la</strong> Détection Avancée <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Feux <strong>de</strong> For<strong>et</strong> en Algérie.<br />
A.Benbouzid<br />
Centre National <strong><strong>de</strong>s</strong> Techniques Spatiales<br />
<strong>Le</strong>s feux <strong>de</strong> forêt ont un impact social, économique <strong>et</strong> environnemental majeur. <strong>Le</strong>s<br />
pouvoirs publics consentent <strong><strong>de</strong>s</strong> efforts <strong>de</strong> plus en plus importants pour protéger les<br />
forêts. Des facteurs économiques <strong>et</strong> sociaux sont à l’origine <strong>de</strong> l’extension du risque :<br />
essor <strong><strong>de</strong>s</strong> activités <strong>de</strong> loisir <strong>et</strong> <strong>de</strong> récréation, pénétration <strong><strong>de</strong>s</strong> forêts périurbaines par un<br />
habitat dispersé. La doctrine contemporaine adoptée face au risque d’incendie repose<br />
sur le principe <strong>de</strong> réduction maximum <strong><strong>de</strong>s</strong> dé<strong>la</strong>is d’intervention sur p<strong>la</strong>ce. Il est<br />
impératif <strong>de</strong> détecter rapi<strong>de</strong>ment les départs d’incendies. Etant donné que <strong>la</strong><br />
surveil<strong>la</strong>nce <strong><strong>de</strong>s</strong> feux au sol par mail<strong>la</strong>ge du territoire par <strong><strong>de</strong>s</strong> tours <strong>de</strong> gu<strong>et</strong> ou par<br />
avion est coûteuse, l'outil spatial s'est imposé comme alternative <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce vu son<br />
coût re<strong>la</strong>tivement bas, sa haute fréquence <strong>de</strong> revisite <strong>et</strong> <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> région.<br />
A travers ce travail, nous souhaitons en utilisant autant que faire se peut <strong><strong>de</strong>s</strong> moyens<br />
ouvert <strong>et</strong> à accès public (sites internent spécialisé, base <strong>de</strong> données image) apporter <strong>la</strong><br />
démonstration <strong>de</strong> l'apport <strong>de</strong> l'imagerie satellitaire dans <strong>la</strong> détection précoce <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
départs <strong>de</strong> feux <strong>de</strong> forêt en Algérie.<br />
Ce travail à pour obj<strong>et</strong> principale <strong>la</strong> sélection <strong>et</strong> le test d'un algorithme adéquat pour <strong>la</strong><br />
détection active <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>et</strong> irruptions avec prise en compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface <strong>et</strong><br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> conditions atmosphériques re<strong>la</strong>tive à l’Algérie sur les images NOAA (canaux 2,<br />
3,4) MODIS ou ASTER. <strong>Le</strong> principe est <strong>de</strong> détecter les pixels affectés par le feu avec<br />
suppression <strong><strong>de</strong>s</strong> fausses alertes dues à <strong>la</strong> réflexion spécu<strong>la</strong>ire sur les p<strong>la</strong>ns d’eau <strong>et</strong> les<br />
nuages. En parcourant l'état <strong>de</strong> l'art <strong><strong>de</strong>s</strong> métho<strong><strong>de</strong>s</strong> utilisées nous avons sélectionné un<br />
algorithme simple en vue d'e l'implémenter rapi<strong>de</strong>ment dans Mat<strong>la</strong>b. La métho<strong>de</strong> est<br />
ensuite validée sur une image MODIS. La validation quant à elle se faisant sur <strong>la</strong><br />
comparaison du taux <strong>de</strong> détection <strong><strong>de</strong>s</strong> départs <strong>de</strong> feu avec les départs réellement établis<br />
en exploitant les moyens disponibles comme <strong><strong>de</strong>s</strong> bases <strong>de</strong> données gratuites Intern<strong>et</strong><br />
(Modis Rapid Response, <strong>et</strong>c). <strong>Le</strong> taux <strong>de</strong> réussite contribuera à l'exploration rapi<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
possibilités offertes <strong>et</strong> à <strong>la</strong> maîtrise <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions éventuelles <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> limites qui<br />
contraignent un usage <strong>de</strong> l'imagerie satellite dans <strong>la</strong> détection <strong><strong>de</strong>s</strong> départs <strong>de</strong> feux en<br />
Algérie.<br />
Keywords: hot spot, détection, précoce, satellite, MODIS, Infra-rouge<br />
25
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème I<br />
O.1.3<br />
<strong>Le</strong>s incendies <strong>de</strong> for<strong>et</strong>s dans l'Est algérien; cas <strong>de</strong> Bejaia, Jijel, Sétif <strong>et</strong> Bordj Bou-<br />
Arreridj<br />
S.Merdas 1 , H.Boukerer 2 , L.Bouatia 1 , M.R.Boumedjane 2<br />
1 Département <strong>de</strong> Biologie <strong>et</strong> Ecologie, Université Mentouri <strong>de</strong> Constantine.<br />
2 Université El Hadj Lakhdar Batna ; E-mail : merdas_saifi20022000@yahoo.fr<br />
<strong>Le</strong> rôle <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies <strong>de</strong> forêts pour les écosystèmes est importants ; ils influencent<br />
certaines fonctions écosystémiques dont le recyc<strong>la</strong>ge <strong><strong>de</strong>s</strong> nutriments, <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> succession végétale <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’habitat faunique; ils maintiennent <strong>la</strong> diversité biologique,<br />
réduisent <strong>la</strong> biomasse <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong> contrôler les popu<strong>la</strong>tions d’insectes <strong>et</strong> les<br />
phytopathologies, <strong>la</strong> forêt algérienne représente un écosystème fragile contres les<br />
incendies, vue <strong>la</strong> fréquence importante <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies <strong>et</strong> les conditions favorables pour<br />
le déc<strong>la</strong>nchement <strong><strong>de</strong>s</strong> feux, ce phénomène représente un facteur<br />
<strong>de</strong> dégradation remarquable, qui a <strong><strong>de</strong>s</strong> conséquences néfastes sur l’écosystème.<br />
L’objectif <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te présente étu<strong>de</strong> consiste dans un premier temps à faire un<br />
état <strong><strong>de</strong>s</strong> lieux concernant les feux <strong>de</strong> forêts dans quatre wi<strong>la</strong>yas <strong>de</strong> l’Est algérien<br />
(Bejaia, Jijel, Sétif <strong>et</strong> Bordj Bou Arréridj), <strong>et</strong> dans un second, faire un bi<strong>la</strong>n <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
incendies sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> vingt ans al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> 1985 à 2004, les résultats obtenus<br />
seront utilisés pour une stratégie d’aménagement <strong><strong>de</strong>s</strong> forêts.<br />
<strong>Le</strong>s incendies <strong>de</strong> forêts ont ravagé 126260.63 ha durant 20 ans pour l’ensemble<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zone d’étu<strong>de</strong>. La wi<strong>la</strong>ya <strong>de</strong> Bejaia <strong>de</strong>meure <strong>la</strong> plus incendiée 62% <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie<br />
brûlée soit (78.916.32 ha). <strong>Le</strong> nombre <strong>de</strong> foyers par compagnie, pério<strong>de</strong> (1985- 2000)<br />
indique que le mois d’Août est le mois qui totalise le plus grand nombre <strong>de</strong> foyers. <strong>Le</strong>s<br />
formations les plus touchées par les incendies c’est les forêts. L’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> variance<br />
indique que les superficies brûlées diffèrent significativement d’une wi<strong>la</strong>ya à une<br />
autre, <strong>et</strong> varie proportionnellement en fonction <strong><strong>de</strong>s</strong> nombres <strong>de</strong> foyers importants (+<br />
50ha). <strong>Le</strong>s paramètres climatiques ne sont pas corrélés aux incendies <strong>de</strong> forêts, sauf le<br />
cas <strong><strong>de</strong>s</strong> précipitations qui sont corrélées négativement aux incendies <strong>de</strong> forêts pour<br />
Bejaia (r= -0.48).<br />
C<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> nous a permis d’apprécier le menace <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêts dans <strong>la</strong> zone<br />
concernée, ce qui nécessite <strong><strong>de</strong>s</strong> stratégies d’aménagement bien étudiées, à savoir <strong>la</strong><br />
maitrise d’utilisation <strong><strong>de</strong>s</strong> brû<strong>la</strong>ges dirigés, sylviculture adaptée <strong>et</strong> les traitements <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
combustibles, <strong>de</strong>nsité suffisante <strong><strong>de</strong>s</strong> TPF, réseau <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce avec postes VG<br />
équipés <strong>et</strong> fonctionnels <strong>et</strong> enfin surtout les points d’eaux mobiles, <strong>et</strong> qui donnent <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
résultats bénéfiques, <strong>et</strong> maintiennent <strong>la</strong> durabilité <strong><strong>de</strong>s</strong> écosystème.<br />
Mots clés : Incendies <strong><strong>de</strong>s</strong> forêts, Superficies brûlées, Bi<strong>la</strong>n <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies <strong>de</strong> forêt,<br />
Traitement du combustible, Brû<strong>la</strong>ge dirigé.<br />
26
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème I<br />
O.1.4<br />
Évaluation <strong>de</strong> La Télédétection Des Feux <strong>de</strong> Forêts par C<strong>la</strong>ssification<br />
M.Rebhi, A.Belghoraf <strong>et</strong> J.Zerubia<br />
Laboratoire Signaux <strong>et</strong> système- Université Ab<strong>de</strong>lhamid Ibn Badis-27000<br />
Mostaganem, Algérie Email : rebhi@univ-mosta.dz<br />
Département d’électronique, Université <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Technologie</strong> d’Oran –<br />
Mohamed Boudiaf, 31000 Oran, Algérie<br />
INRIA Sophia Antipolis Méditerranée - 2004, route <strong><strong>de</strong>s</strong> Lucioles - BP 93 - 06902<br />
Sophia Antipolis Ce<strong>de</strong>x, France<br />
<strong>Le</strong>s feux <strong>de</strong> forêt durant les mois <strong>de</strong> faible pluviométrie sont un problème majeur en<br />
Algérie. La direction Générale <strong><strong>de</strong>s</strong> Forêts a publié pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> s’étendant<br />
seulement du 01/06/2009 au 31/07/2009 le lourd bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> 1477 foyers <strong>de</strong> feu avec une<br />
moyenne <strong>de</strong> 24 nids <strong>de</strong> feu par jour causant <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> 17076 ha <strong>de</strong> végétation dont<br />
11946 ha <strong>de</strong> forêts <strong>et</strong> maquis soit avec un taux <strong>de</strong> 70 %.<br />
Dans c<strong>et</strong> article, il s’agira <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification supervisée <strong>de</strong> feux <strong>de</strong> forêts. Parmi les<br />
métho<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification les plus utilisées, on peut citer celle <strong><strong>de</strong>s</strong> machines à vecteurs<br />
<strong>de</strong> support ou séparateurs à vaste marge (Support Vector Machine, SVM). C<strong>et</strong>te<br />
technique nécessite une base d’apprentissage à ensembles d’entraînement positif <strong>et</strong><br />
négatif. En absence <strong>de</strong> données <strong>de</strong> satellites dédiés à <strong>la</strong> détection <strong>de</strong> feux <strong>de</strong> forêts,<br />
l’algorithme appliqué sur une image Alsat-1 à trois ban<strong><strong>de</strong>s</strong> spectrales donne <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
résultats très appréciables comparés à <strong><strong>de</strong>s</strong> relevés <strong>de</strong> terrain.<br />
La figure 1 représente une image <strong>de</strong> <strong>la</strong> (Region Of Interest) ROI dans <strong>la</strong> Wi<strong>la</strong>ya <strong>de</strong><br />
Jijel acquise dans les trois ban<strong><strong>de</strong>s</strong> spectrales par Alsat-1 après un feu <strong>de</strong> forêt ravageur<br />
qui s’est déclenché pendant l’été 2007.<br />
Figure 1: Image Alsat-1 <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone d’intérêt.<br />
La première étape était <strong>de</strong> sélectionner aussi convenablement que possible<br />
l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> pixels d’entraînement. Ceci entraîne <strong>la</strong> répétition <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te étape autant<br />
<strong>de</strong> fois pour converger vers <strong><strong>de</strong>s</strong> détections les plus proches <strong><strong>de</strong>s</strong> vérités <strong>de</strong> terrains (VT)<br />
obtenues auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction Générale <strong><strong>de</strong>s</strong> Forêts. Une fois <strong>la</strong> phase d’apprentissage<br />
terminée, les résultats seront exploités pour déterminer à partir <strong><strong>de</strong>s</strong> histogrammes <strong>la</strong><br />
radiométrie <strong><strong>de</strong>s</strong> pixels indiquant <strong><strong>de</strong>s</strong> zones ravagées par le feu, c'est-à-dire <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse<br />
positive selon <strong>la</strong> SVM.<br />
La figure 1 est <strong>de</strong> 1297 x 1029 pixels. <strong>Le</strong>s relevés <strong>de</strong> terrain constituant <strong><strong>de</strong>s</strong> VT<br />
effectuées par les agents relevant <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction Générale <strong><strong>de</strong>s</strong> Forêts nous ont permis<br />
d’é<strong>la</strong>borer une image référence. C<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière servira à vérifier les résultats obtenus<br />
par notre algorithme <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification (cf. figure 2).<br />
27
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème I<br />
Figure 2 : Images c<strong>la</strong>ssifiées avec :a- 3 pixels <strong>de</strong> voisinage (Résultats appréciables) ; b-<br />
15 pixels <strong>de</strong> voisinages (Résultats grossiers)<br />
L’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> télédétection par c<strong>la</strong>ssification s’intéresse à déterminer, pour<br />
chaque base d’apprentissage commune, le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> pertinence <strong>de</strong> l’algorithme <strong>de</strong><br />
c<strong>la</strong>ssification.<br />
L’aspect <strong>de</strong> comparaison entre les résultats a été mis en exergue par le recours à <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
base d’apprentissage <strong>de</strong> plus en plus é<strong>la</strong>rgies, en prenant pour <strong>la</strong> même base, les pixels<br />
<strong>de</strong> connexité (son voisinage) avec un ordre croissant donnant différents résultats mais<br />
pénalisant en terme <strong>de</strong> temps <strong>de</strong> calcul.<br />
28
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème I<br />
O.1.5<br />
Problématique <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêt en Algérie<br />
M.Abbas (*)<br />
Direction Générale <strong><strong>de</strong>s</strong> Forêts mohamedabbas13@yahoo.fr<br />
En Algérie, à l'instar <strong><strong>de</strong>s</strong> pays méditerranéens, le patrimoine forestier continue à subir<br />
les eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation, notamment par les incendies, eu égard à sa composition<br />
floristique en espèces très combustibles, au climat chaud <strong>et</strong> sec en été, accentué parfois<br />
par <strong><strong>de</strong>s</strong> vents secs <strong>et</strong> violents (sirocco) qui favorisent l'éclosion <strong>et</strong> <strong>la</strong> propagation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
foyers <strong>de</strong> feu <strong>et</strong> à l'activité anthropique, sans cesse croissante, <strong><strong>de</strong>s</strong> popu<strong>la</strong>tions<br />
riveraines <strong>et</strong> autres estivants occasionnels.<br />
Pour ce<strong>la</strong>, l'administration <strong><strong>de</strong>s</strong> forêts, représentée par <strong>la</strong> direction générale <strong><strong>de</strong>s</strong> Forêts<br />
entame <strong>la</strong> campagne <strong>de</strong> prévention <strong>et</strong> <strong>de</strong> lutte contre les feux <strong>de</strong> forêts en début <strong>de</strong><br />
chaque année, notamment en ce qui concerne les vol<strong>et</strong>s <strong>de</strong> sensibilisation <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
prévention. En eff<strong>et</strong>, un <strong>la</strong>rge programme <strong>de</strong> sensibilisation est <strong>la</strong>ncé annuellement en<br />
direction <strong>de</strong> toutes les tranches <strong>de</strong> <strong>la</strong> société (écoliers, lycéens, étudiants, estivants,<br />
riverains <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt <strong>et</strong> autres) par l'implication <strong>et</strong> l'utilisation <strong>de</strong> différents canaux <strong>de</strong><br />
communication (Télévision, radios, presse écrite, conférences débats, prêches du<br />
vendredi). Ce vol<strong>et</strong> s'avère être très important compte tenu du lien étroit <strong>et</strong> avéré qui<br />
existe entre le déclenchement d'un feu <strong>et</strong> son auteur qui est principalement l'homme.<br />
En matière <strong>de</strong> prévention, <strong><strong>de</strong>s</strong> travaux <strong>de</strong> préventifs (ouverture <strong>de</strong> pistes, <strong>de</strong> tranchées<br />
pare feu, postes <strong>de</strong> vigie, points d'eau, débroussaillement <strong>et</strong> n<strong>et</strong>toiement <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
accotements <strong>de</strong> routes sont menées aux niveaux <strong>de</strong> tous les massifs forestiers sensibles<br />
<strong>et</strong> à proximité.<br />
En matière d'intervention, l'administration <strong><strong>de</strong>s</strong> forêts est chargée notamment en chaque<br />
début <strong>de</strong> campagne <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre en p<strong>la</strong>ce <strong><strong>de</strong>s</strong> briga<strong><strong>de</strong>s</strong> mobiles d'intervention, <strong><strong>de</strong>s</strong> postes<br />
<strong>de</strong> vigie pour <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>et</strong> l'alerte rapi<strong>de</strong>, <strong><strong>de</strong>s</strong> camions d'interventions, ainsi que<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> chantiers d'interventions.<br />
Ces moyens mis en p<strong>la</strong>ce par le secteur <strong><strong>de</strong>s</strong> forêts sont appuyés par d’importants<br />
renforts en moyens humains <strong>et</strong> matériels <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection civile (notamment les<br />
colonnes mobiles) <strong>et</strong> ceux <strong><strong>de</strong>s</strong> collectivités locales.<br />
Comme il y a lieu <strong>de</strong> signaler <strong>la</strong> contribution indéniable <strong><strong>de</strong>s</strong> popu<strong>la</strong>tions riveraines <strong>et</strong><br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> citoyens dans <strong>la</strong> prévention <strong>et</strong> <strong>la</strong> première intervention sur les feux.<br />
Un autre moyen non moins important utilisé ces <strong>de</strong>rnières années c'est l’utilisation<br />
d’outils mo<strong>de</strong>rnes (images satellitales) dans <strong>la</strong> prévention <strong>et</strong> <strong>la</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong><br />
forêts dans le cadre d'une coopération avec l'Agence Spatiale Algérienne, (ASAL)<br />
29
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème I<br />
notamment dans l'estimation <strong><strong>de</strong>s</strong> superficies parcourues par le feu <strong>et</strong> le taux <strong>de</strong> reprise<br />
végétale.<br />
Tout ce dispositif est mis en p<strong>la</strong>ce pour faire face au danger éminemment important<br />
constitué par les feux <strong>de</strong> forêts, puisque il faut savoir qu'en moyenne nous enregistrons<br />
en Algérie, une superficie <strong>de</strong> 28.000 ha/an parcourue par le feu (moyenne sur dix ans).<br />
Beaucoup d'efforts restent à consentir à l'eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> diminuer un tant soit peu l'inci<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong> ce fléau sur le patrimoine forestier, en concentrant nos moyens sur <strong>la</strong> prévention <strong>et</strong><br />
<strong>la</strong> prise <strong>de</strong> conscience <strong><strong>de</strong>s</strong> popu<strong>la</strong>tions pour une meilleure prise en charge <strong>de</strong> ce<br />
phénomène.<br />
(*) Sous Directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection du patrimoine forestier<br />
30
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème II<br />
O.2.1<br />
Application <strong><strong>de</strong>s</strong> métho<strong><strong>de</strong>s</strong> d’Ingénierie Incendie au Comportement <strong><strong>de</strong>s</strong> Structures<br />
Métalliques sous <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions <strong>de</strong> Feu<br />
A. Kada*, N. Ben<strong>la</strong>kehal*, B. Lamri *, B. Achour **, H. Bouchair***<br />
* Université H.B.Bouali <strong>de</strong> Chlef, Dépt. G.C., kada_ab<strong>de</strong>l@yahoo.com,<br />
**Université <strong>de</strong> Mostaganem , Département <strong>de</strong> Génie Civil,<br />
*** Polytech'Clermont-Ferrand, Département Génie Civil (LaMI)<br />
<strong>Le</strong> feu est l’une <strong><strong>de</strong>s</strong> actions acci<strong>de</strong>ntelles <strong>de</strong> très courte durée auxquelles les structures<br />
peuvent être exposées pendant leur durée <strong>de</strong> service ; <strong>et</strong> dans le contexte d’un<br />
incendie, l’acier à une mauvaise réputation. Bien qu’il soit incombustible, on lui<br />
reproche une faible résistance aux températures élevées en plus <strong>de</strong> faciliter <strong>la</strong><br />
propagation <strong>de</strong> chaleur par conduction. Dans le cas d’un incendie majeur, les éléments<br />
métalliques sans protection sont endommagés ou ruinées. Ceci est principalement dû à<br />
une réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> résistance <strong><strong>de</strong>s</strong> éléments métalliques:<br />
Ce travail présente une métho<strong>de</strong> d’analyse par l’ingénierie d’incendie appliquée au<br />
calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> résistance au feu <strong><strong>de</strong>s</strong> éléments métalliques poutres <strong>et</strong> <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> réduction <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés mécaniques <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux <strong>et</strong> les recommandations <strong>de</strong><br />
l’EC3 dans l’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> caractéristiques thermiques <strong>de</strong> l’acier.<br />
<strong>Le</strong> comportement <strong>de</strong> poutres à une seule travée selon le teste <strong>de</strong> Cardington est<br />
comparé au test standard ISO 834<br />
Mots clés :Charpente métallique, Acier, Feu, Protection incendie, Résistance au feu,<br />
Ingénierie incendie<br />
Fire is one of acci<strong>de</strong>ntal actions that a building structure is bound to be subjected to<br />
during its life time. In fire scenario, steel material bears the bad reputation of having<br />
weak resistance to high temperatures besi<strong><strong>de</strong>s</strong> allowing heat propagation by conduction.<br />
This work done as part of the research project, presents the mo<strong>de</strong>lling of steel beams<br />
and the analysis of their behaviour with regard to the reduction of material properties<br />
and the EC3 recommendations<br />
The research work presents fire engineering m<strong>et</strong>hod applied to fire resistance <strong><strong>de</strong>s</strong>ign of<br />
single steel beams with the effect of thermal and mechanical properties.<br />
TheNumerical non-linear behaviour of single span beams has bean compared with<br />
Cardington test.<br />
Keywords: Fire, Steel beam, fire resistance, fire engineering, Euroco<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
31
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème II<br />
O.2.2<br />
Apport <strong><strong>de</strong>s</strong> analyses statistiques dans <strong>la</strong> prévention du risque <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies<br />
<strong>de</strong> forêts en Algérie<br />
O.Meddour-Sahar 1 , R.Meddour 1 , A.Derridj 1 <strong>et</strong> C.Bouiss<strong>et</strong> 2<br />
1 Faculté <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong> Biologiques <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong> Agronomiques Universté Mouloud<br />
Mammeri Tizi Ouzou, Algérie. o.sahar@yahoo.fr<br />
2 Laboratoire SET-UMR 5603 CNRS Université <strong>de</strong> Pau <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> Pays <strong>de</strong> l'Adour, France<br />
L’incendie, surtout à l’apogée <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> estivale, constitue une menace permanente<br />
pour les forêts <strong>de</strong> <strong>la</strong> région méditerranéenne <strong>et</strong> représente <strong>la</strong> cause principale <strong>de</strong><br />
<strong><strong>de</strong>s</strong>truction <strong><strong>de</strong>s</strong> forêts.<br />
En Algérie, <strong>la</strong> moyenne du nombre <strong>de</strong> feux est <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 1 300 par an (soit 2,34 % <strong>de</strong><br />
part re<strong>la</strong>tive du total méditerranéen), <strong>et</strong> <strong>la</strong> moyenne <strong><strong>de</strong>s</strong> surfaces incendiées est<br />
d’environ 39 000 ha par an pour les <strong>de</strong>rnières décennies (soit 6,5 % <strong>de</strong> part re<strong>la</strong>tive).<br />
Incontestablement, dans le contexte du bassin méditerranéen, l’Algérie est l’un <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
pays où le problème <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêts se pose avec acuité <strong>et</strong> dont l’impact exige une<br />
prise en compte. Il mérite <strong>de</strong> ce fait qu’on s’attar<strong>de</strong> sur le bi<strong>la</strong>n historique <strong>et</strong> l’analyse<br />
statistique <strong>de</strong> ses feux <strong>de</strong> forêts, d’autant que c’est l’un <strong><strong>de</strong>s</strong> pays méditerranéens qui<br />
possè<strong>de</strong> une <strong><strong>de</strong>s</strong> plus longues séries chronologiques sur les incendies <strong>de</strong> forêts (plus<br />
d’un siècle).<br />
L’analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> informations re<strong>la</strong>tives aux incendies <strong>de</strong> forêts sur une longue pério<strong>de</strong>,<br />
plusieurs années ou décennies, perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> déterminer les caractéristiques spatiales <strong>et</strong><br />
temporelles du risque d’incendie. L’un <strong><strong>de</strong>s</strong> objectifs <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> feux passés<br />
est <strong>de</strong> montrer comment l'analyse <strong>et</strong> l’interprétation <strong><strong>de</strong>s</strong> statistiques re<strong>la</strong>tives à un<br />
grand nombre d'incendies peuvent servir à l’é<strong>la</strong>boration <strong><strong>de</strong>s</strong> stratégies <strong>de</strong> prévention <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêts.<br />
Aussi L’évaluation <strong>de</strong> l’aléa incendie, basée sur les statistiques <strong><strong>de</strong>s</strong> « feux historiques<br />
ou du passé » <strong>et</strong> <strong>la</strong> restitution <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats obtenus sous forme cartographique peut<br />
s’avérer d’un apport remarquable aux gestionnaires <strong><strong>de</strong>s</strong> forêts dans l’ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong> décision,<br />
qui peuvent ainsi asseoir sur <strong><strong>de</strong>s</strong> bases logiques toute politique <strong>de</strong> prévention. En eff<strong>et</strong>,<br />
ces documents cartographiques <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> risque m<strong>et</strong>tent en évi<strong>de</strong>nce <strong><strong>de</strong>s</strong> secteurs<br />
sensibles à haut risque d’incendie (zones rouges), dans lesquels une concentration <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
efforts <strong>et</strong> surtout <strong><strong>de</strong>s</strong> équipements <strong>de</strong> PFCI sont à prévoir en toute objectivité. Au final,<br />
n'oublions pas que le but fondamental <strong>de</strong> l'évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> risques d'incendies est <strong>de</strong><br />
réduire leur fréquence <strong>et</strong> <strong>la</strong> superficie <strong><strong>de</strong>s</strong> zones brûlées, au moyen <strong>de</strong> mesures<br />
préventives <strong>et</strong> d'assurer l'utilisation optimale <strong><strong>de</strong>s</strong> ressources limitées, dont on dispose<br />
pour lutter contre les feux.<br />
Mots clés : Analyse statistique exploratoire, feux <strong>de</strong> forêts, risque d’incendie, Algérie.<br />
32
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème II<br />
O.2.3<br />
Simu<strong>la</strong>tion Numérique De La Dégradation Des composites à matrice métallique<br />
(Ni) Protégé par <strong><strong>de</strong>s</strong> Barrières Chimiques Dans <strong>Le</strong>s Constructions<br />
Aéronautiques (Turbines).<br />
H.Khelifa, M.Rahmani, A.Yousfi<br />
Université <strong>de</strong> Amar-Thligi-Laghouat 03000. h.khelifa@mail.<strong>la</strong>gh-univ.dz<br />
L’industrie aéronautique, durant <strong>de</strong> nombreuses années, a été le véritable<br />
moteur du développement <strong><strong>de</strong>s</strong> techniques <strong>de</strong> revêtement thermique, notamment grâce à<br />
<strong>la</strong> révolution technologique. L’augmentation <strong><strong>de</strong>s</strong> ren<strong>de</strong>ments <strong><strong>de</strong>s</strong> turbines<br />
aéronautiques a toujours été un but poursuivi par les industriels du domaine. C<strong>et</strong>te<br />
augmentation <strong><strong>de</strong>s</strong> performances passe notamment par une augmentation <strong><strong>de</strong>s</strong> taux <strong>de</strong><br />
compression <strong>de</strong> l’air dans les différents étages <strong><strong>de</strong>s</strong> compresseurs (donc par une<br />
réduction importante <strong><strong>de</strong>s</strong> fuites possibles) <strong>et</strong> par une augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> température<br />
en entrée <strong>de</strong> <strong>la</strong> turbine. En parallèle, <strong>la</strong> diminution <strong><strong>de</strong>s</strong> masses, notamment celles en<br />
mouvement, a entraîné une augmentation <strong><strong>de</strong>s</strong> niveaux <strong>de</strong> sollicitation <strong><strong>de</strong>s</strong> constituants<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> turbine.<br />
<strong>Le</strong> concept <strong>de</strong> barrière thermique<br />
est donc <strong>de</strong>venu un objectif majeur dans <strong>la</strong><br />
conception <strong><strong>de</strong>s</strong> aubes <strong>de</strong> turbines, <strong>et</strong> se<br />
traduit généralement par l’apposition<br />
d’un système composé <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux couches :<br />
une sous-couche dite ‘d’accrochage’<br />
déposée directement sur le substrat <strong>et</strong><br />
une couche <strong>de</strong> céramique <strong><strong>de</strong>s</strong>tinée à<br />
diminuer <strong>la</strong> température du superalliage.<br />
Notre système est composé du superalliage<br />
monocristallin à base Nickel, sur lequel on<br />
vient déposer, , un aluminure <strong>de</strong> Nickel Figure 2<br />
allié avec du P<strong>la</strong>tine (Ni,Pt)Al, qui constitue<br />
<strong>la</strong> sous-couche métallique. La céramique, composé d’oxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> Zirconium (ZrO 2 )(cf<br />
fig.2),<br />
<strong>Le</strong> but <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication est <strong>de</strong> bâtir dans <strong>la</strong> théorie <strong>de</strong> ces nouveaux<br />
matériaux, un modèle numérique capable <strong>de</strong> simuler les mécanismes physiques qui<br />
conduisent à l’écail<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> barrière thermique en utilisant <strong>la</strong> mécanique <strong>de</strong><br />
l’endommagement <strong>et</strong> en coup<strong>la</strong>nt ces calculs à un calcul numérique fondé sur<br />
l’utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> éléments finis, c’est le co<strong>de</strong> CASTEME 2005<br />
(développé à l’Ecole <strong><strong>de</strong>s</strong> Mines <strong>de</strong> Paris <strong>et</strong> à l’Onera), <strong>la</strong> modélisation perm<strong>et</strong><br />
d’estimer les contraintes <strong>de</strong> croissance dûes au changement <strong>de</strong> volume métal/oxy<strong>de</strong>.<br />
Finalement, l’utilisation <strong><strong>de</strong>s</strong> essais mécaniques insérés dans <strong>la</strong> communication simule<br />
33
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème II<br />
l’endommagement dans <strong>la</strong> couche d’oxy<strong>de</strong> induisant <strong>la</strong> création <strong>de</strong> fissures, sans<br />
chemin pré-établi, conduisant à l’écail<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> barrière thermique.<br />
Mots Clés : Barrières thermique, endommagement, superalliages, oxy<strong>de</strong>, céramique,<br />
loi <strong>de</strong> comportement.<br />
Bibliographies :<br />
[1] A.M.Huntz, G.Sattonnay , K.Loudjani « E<strong>la</strong>boration <strong>et</strong> caractéristiques <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
couches minces d’oxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> zirconium pour <strong><strong>de</strong>s</strong> applications <strong>de</strong> revêtements<br />
protecteurs <strong>de</strong> matériaux <strong>de</strong> structure » Rapport <strong>de</strong> stage février – 2004- .<br />
[2] Z.Suo , Mechanical and aerospace engineering <strong>de</strong>partment and materials institute<br />
of Princ<strong>et</strong>on university « Fracture in thin films » . Encyclopedia of materials, second<br />
Edition 2001.<br />
34
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème III<br />
O.3.1<br />
Control fire in the road tunnel by the optimization of the heat flux<br />
Un<strong>de</strong>r longitudinal venti<strong>la</strong>tion and water spray<br />
H.Miloua*, A.Azzi** and W.H.Xing***<br />
* Laboratoire <strong>de</strong> mécanique appliquée, USTO Fac. G-Mécanique Oran, Algérie<br />
miloua_hadj@yahoo.fr<br />
* * Laboratoire <strong>de</strong> mécanique appliquée, USTO Fac. G-Mécanique Oran, Algérie<br />
*** LCD <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> combustion <strong>et</strong> détonique ENSMA Poitiers France<br />
This paper present a numerical simu<strong>la</strong>tion by CFD program named the fire dynamics<br />
simu<strong>la</strong>tor (FDS) based on <strong>la</strong>rge eddy simu<strong>la</strong>tions (LES) .This study focused to the<br />
<strong>la</strong>rge scale fire tests of a passenger car in a road tunnel. Many tunnels are equipped<br />
with longitudinal venti<strong>la</strong>tion systems to control smoke in the event of a fire, a smoke<br />
and hot combustion products can form a <strong>la</strong>yer near the ceiling and flow in the opposite<br />
direction to the venti<strong>la</strong>tion stream. This reverse stratified flow has an important<br />
influence on fire characters, plume spread in the tunnel and comportment of tunnel<br />
structure and all object existed behind the fire.<br />
The results obtained which are (1) the heat release rate of a fire in a tunnel (HRR), (2)<br />
all heat transfer mo<strong><strong>de</strong>s</strong>, (3) the functions which re<strong>la</strong>ted to the dispersion of smoke<br />
resembling to the visibility, level of CO and soot <strong>de</strong>nsity it’s consi<strong>de</strong>r a data to control<br />
fire in road tunnel and (4) shape of plume after the interaction with water spray from<br />
sprinkler.<br />
Keywords: LES; fire; tunnel; longitudinal venti<strong>la</strong>tion; sprinkler spray.<br />
35
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème III<br />
O.3.2<br />
Etu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> mousses liqui<strong><strong>de</strong>s</strong> à base <strong>de</strong> PEO-SDS<br />
M.Lounis 1 & K.Bekkour 2<br />
1 Département <strong>de</strong> Physique – Faculté <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong>USTO-MB, BP 1505 El M’Naouer<br />
31000 Oran, Algérie. E-mail : loumou2000@yahoo.fr<br />
2<br />
Institut <strong>de</strong> Mécanique <strong><strong>de</strong>s</strong> Flui<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> Soli<strong><strong>de</strong>s</strong> - UMR 7507 ULP-CNRS Université<br />
Louis Pasteur, 2 rue Boussingault, 67000 Strasbourg, France<br />
Dans le domaine <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>et</strong> incendies les mousses sont <strong>de</strong> plus en plus utilisées pour<br />
leurs propriétés physiques particulières qui les ren<strong>de</strong>nt très efficaces pour stopper <strong>et</strong><br />
lutter contre leurs propagations. <strong>Le</strong>s étu<strong><strong>de</strong>s</strong> réalisées sur les mousses sont à bases <strong>de</strong><br />
polymères le SDS (Sodium Dodécyl Sulfate) comme agent moussant <strong>et</strong> un surfactant<br />
le PEO (Poly Ethylène Oxy<strong>de</strong>) comme agent stabilisant. Une série <strong>de</strong> mesures<br />
rhéologiques sur les mousses sont réalisées révèle une réelle possibilité <strong>de</strong> contrôle du<br />
volume <strong>de</strong> mousse à produire ainsi que leur durée <strong>de</strong> vie. Ces <strong>de</strong>ux paramètres peuvent<br />
être optimisés grâce au contrôle <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations <strong>de</strong> SDS <strong>et</strong> du PEO. <strong>Le</strong>s résultats<br />
obtenus nous perm<strong>et</strong>tent également une reproductibilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> mousse<br />
désirée. Ces résultats varient d’un processus industriel à un autre, c’est pour c<strong>et</strong>te<br />
raison que les résultats expérimentaux obtenus dans <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions expérimentales <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>boratoire.<br />
Mots-clés : mousses, rhéologie, drainage, incendie, polymère, surfactant.<br />
36
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème IV<br />
O.4.1<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’émission, <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmabilité <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés thermodynamiques <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Composés Organiques Vo<strong>la</strong>tils impliqués dans les feux <strong>de</strong> forêts accélérés<br />
L.Courty 1,2 , K.Ch<strong>et</strong>ehouna 2 , J.Goulier 3 , L.Catore 4 , J.P.Garo 1 <strong>et</strong> N.Chaumeix 3<br />
1 Institut P’, UPR 3346 CNRS, ENSMA, Université <strong>de</strong> Poitiers, 1 Avenue Clément<br />
A<strong>de</strong>r, Téléport 2, BP 40109, 86961 Futuroscope Chasseneuil, France<br />
2 ENSI <strong>de</strong> Bourges, Institut PRISME UPRES EA 4229, 88 Boulevard Lahitolle,<br />
18020 Bourges, France, E-mail: khaled.ch<strong>et</strong>ehouna@ensi-bourges.fr<br />
3 Institut <strong>de</strong> Combustion, Aérothermique, Réactivité <strong>et</strong> Environnement, CNRS Orléans,<br />
1c Avenue <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche Scientifique, 45071 Orléans, France<br />
4 ENSTA ParisTech, 32 Boulevard Victor, 75015 Paris, France<br />
Plusieurs travaux <strong>de</strong> recherches ont montré que dans certaines occasions les feux <strong>de</strong><br />
forêts se comportent <strong>de</strong> manière surprenante, changeant soudainement d’un<br />
comportement modéré caractérisé par une vitesse <strong>de</strong> propagation re<strong>la</strong>tivement basse à<br />
une propagation explosive caractérisée par une vitesse <strong>et</strong> une énergie libérée beaucoup<br />
plus importantes. Ce phénomène est connu sous le nom d’ « explosion du feu », <strong>de</strong><br />
« feu éruptif » ou <strong>de</strong> « feu <strong>de</strong> forêt accéléré ». Il se produit généralement dans <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
canyons <strong>et</strong> est responsable <strong>de</strong> nombreux décès au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décennie. En<br />
eff<strong>et</strong>, l’acci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Pa<strong>la</strong>sca en France en 2000 a tué <strong>de</strong>ux pompiers. L’acci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />
Kornati - Croatie, 2007 - a fait douze victimes <strong>et</strong> celui d’Artemida en Grèce en 2007 a<br />
également tué 24 personnes.<br />
Il existe actuellement <strong>de</strong>ux approches hydrodynamiques pour expliquer ce phénomène.<br />
Une approche thermochimique, basée sur l’inf<strong>la</strong>mmation d’un nuage <strong>de</strong> Composés<br />
Organiques Vo<strong>la</strong>tils (COVs), a été développé dans <strong><strong>de</strong>s</strong> travaux antérieurs.<br />
L’accélération brutale d’un feu <strong>de</strong> forêt peut être <strong>la</strong> conséquence <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
COVs émis par <strong>la</strong> végétation préchauffée par les f<strong>la</strong>mmes <strong>et</strong> accumulés dans les<br />
canyons. En eff<strong>et</strong>, certaines p<strong>la</strong>ntes méditerranéennes (Rosmarinus officinalis, Pinus<br />
halepensis, Cistus albidus ...) lorsqu’elles sont chauffés produisent <strong>et</strong> ém<strong>et</strong>tent <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
substances vo<strong>la</strong>tiles. La validation <strong>de</strong> l’hypothèse thermochimique repose sur <strong>la</strong><br />
détermination <strong><strong>de</strong>s</strong> limites d’inf<strong>la</strong>mmabilités inférieures <strong>de</strong> ces COVs. Il n’existe<br />
aucunes données expérimentales dans <strong>la</strong> littérature sur les limites d’inf<strong>la</strong>mmabilité<br />
inférieures <strong>de</strong> ces composés émis en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> température <strong>et</strong> leur mesure<br />
perm<strong>et</strong>tra d’améliorer c<strong>et</strong>te approche. <strong>Le</strong>s étu<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> combustion d’un mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong><br />
COVs nécessitent <strong><strong>de</strong>s</strong> données thermodynamiques pour perm<strong>et</strong>tre <strong><strong>de</strong>s</strong> calculs<br />
d’équilibre chimique <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong> cinétiques. Pour <strong>la</strong> plupart <strong><strong>de</strong>s</strong> composés émis, il<br />
n’y a pas <strong>de</strong> données thermodynamiques dans <strong>la</strong> littérature <strong>et</strong> ces données sont<br />
estimées dans ce travail en utilisant plusieurs métho<strong><strong>de</strong>s</strong>.<br />
L’objectif principal <strong>de</strong> c<strong>et</strong> article est d’étudier les émissions, les limites<br />
d’inf<strong>la</strong>mmabilité inférieures <strong>et</strong> <strong>de</strong> déterminer les propriétés thermodynamiques <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
37
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème IV<br />
COVs impliqués dans les feux <strong>de</strong> forêts accélérés en utilisant une espèce végétale<br />
représentative du bassin méditerranéen : Rosmarinus officinalis. <strong>Le</strong>s résultats <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
émissions montrent que ce type <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nte ém<strong>et</strong> quatorze COVs, principalement l’αpinène<br />
<strong>et</strong> le limonène. <strong>Le</strong>s limites d’inf<strong>la</strong>mmabilité inférieures <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux composés<br />
sont mesurées dans une bombe sphérique <strong>et</strong> <strong>de</strong>ux re<strong>la</strong>tions linéaires expérimentales<br />
sont obtenues <strong>et</strong> comparées avec <strong><strong>de</strong>s</strong> corré<strong>la</strong>tions empiriques <strong>de</strong> <strong>la</strong> littérature.<br />
L’enthalpie standard <strong>de</strong> formation <strong><strong>de</strong>s</strong> quatorze composés est estimée par <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
métho<strong><strong>de</strong>s</strong> empiriques <strong>et</strong> théoriques adaptées.<br />
38
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème IV<br />
O.4.2<br />
Simu<strong>la</strong>tion numérique <strong>de</strong> <strong>la</strong> dispersion <strong><strong>de</strong>s</strong> polluants dans milieu urbain<br />
(comparaison aves <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats numériques <strong>et</strong> expérimentaux)<br />
F. Bouzit , M. Bouzit, H. Ameur<br />
Faculté <strong>de</strong> Génie Mécanique, USTO-MB<br />
La pollution générée par <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion automobile au cœur <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville ainsi que par<br />
les activités industrielles à sa périphérie est un problème aigu <strong><strong>de</strong>s</strong> gran<strong><strong>de</strong>s</strong> cités. Une<br />
fois émis dans l’atmosphère, les polluants subissent <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> contraintes : d’une<br />
part ils réagissent chimiquement entre eux donnant naissance à <strong>de</strong> nouveaux polluants<br />
tels que l’ozone, <strong>et</strong> d’autre part ils sont transportés par les vents. Nous avons choisi <strong>de</strong><br />
travailler à l’échelle locale autour d’un groupe <strong>de</strong> bâtiments.<br />
La simu<strong>la</strong>tion numérique <strong>et</strong> <strong>la</strong> modélisation <strong><strong>de</strong>s</strong> comportements <strong>de</strong> flui<strong><strong>de</strong>s</strong> dans<br />
divers écoulements <strong>et</strong> différentes géométries ont toujours été d’une importance<br />
capitale pour les chercheurs, poussés dans c<strong>et</strong> objectif par <strong><strong>de</strong>s</strong> industriels soucieux <strong>de</strong><br />
trouver <strong><strong>de</strong>s</strong> outils <strong>de</strong> prédictions <strong>et</strong> d’analyses plus rapi<strong>de</strong> <strong>et</strong> moins onéreux.<br />
<strong>Le</strong> présent travail traite <strong>de</strong> <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion numérique <strong>de</strong> <strong>la</strong> dispersion <strong><strong>de</strong>s</strong> polluants<br />
dans un milieu urbain qui est une géométrie c<strong>la</strong>ssique pour <strong>la</strong>quelle beaucoup <strong>de</strong><br />
travaux expérimentaux ont été réalisés <strong>et</strong> qui concerne surtout <strong><strong>de</strong>s</strong> visualisations<br />
d’écoulements <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> mesures <strong>de</strong> composantes <strong>de</strong> champs <strong>de</strong> vitesse, <strong>de</strong> pression <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
contrainte.<br />
L’objectif <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> donner d’abord une définition bien détaillée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pollution <strong>et</strong> les différents polluants puis c’est aperçus généraux sur <strong>la</strong> couche limite<br />
atmosphérique, les modèles <strong>de</strong> turbulence <strong>et</strong> les métho<strong><strong>de</strong>s</strong> numériques. La première<br />
partie qui est donc bibliographique est consacrée aux aperçus précé<strong>de</strong>mment cités.<br />
La <strong>de</strong>uxième partie <strong>et</strong> qui est <strong>la</strong> plus importante dans ce travail est consacré à <strong>la</strong><br />
simu<strong>la</strong>tion elle même. On commence d’abord par définir le problème abordé, ensuite<br />
on donne une présentation globale du logiciel utilisé qui est le CFX, vient ensuite <strong>la</strong><br />
démarche proposée pour le traitement numérique <strong>de</strong> notre configuration qui passe par<br />
<strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> géométrie, le mail<strong>la</strong>ge, les calculs, les résultats, les analyses <strong>et</strong> enfin<br />
l’étu<strong>de</strong> comparative.<br />
Mots-clés : pollution, ville, ozone, modélisation, simu<strong>la</strong>tion numérique, couche limite<br />
atmosphère, turbulence.<br />
39
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème IV<br />
O.4.3<br />
L’influence <strong><strong>de</strong>s</strong> variations <strong>de</strong> <strong>la</strong> température du gaz sur <strong>la</strong> production d’Ozone<br />
par décharge électrique haute pression dans le mé<strong>la</strong>nge N 2 -O 2<br />
M Benyamina, N.Ait hamouda, Ahmed Be<strong>la</strong>sri<br />
Laboratoire <strong>de</strong> Physique <strong><strong>de</strong>s</strong> P<strong>la</strong>smas, Matériaux Conducteurs <strong>et</strong> leurs Application<br />
Université <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Technologie</strong> d’Oran EL M’NAOUER B.P. 1505,<br />
31000 Oran, Algérie. Benyamina_amina@hotmail.com<br />
L’ozone se produit naturellement dans l’atmosphère <strong>et</strong> présente un filtre <strong>de</strong><br />
protection a absorbant les rayonnements <strong><strong>de</strong>s</strong> longueurs d’on<strong>de</strong> inférieur à 310 nm. Vu<br />
les différentes applications en technologie <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te molécule, les chercheurs<br />
s’intéressent d’avantages à ses propriétés physico-chimique. La génération industrielle<br />
<strong>de</strong> l'ozone est l'application c<strong>la</strong>ssique <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>la</strong>smas d'air hors équilibre à <strong>la</strong> pression<br />
atmosphérique. Une basse température est obligatoire par ce que les molécules <strong>de</strong><br />
l'ozone se dé<strong>la</strong>brent rapi<strong>de</strong>ment à <strong>la</strong> température élevée. L’étu<strong>de</strong> est basée sur un<br />
modèle cinétique temporelle pour <strong>la</strong> production d’ozone. La cinétique chimique<br />
implique 64 réactions avec 18 espèces atomiques <strong>et</strong> molécu<strong>la</strong>ires crées dans <strong>la</strong><br />
décharge.<br />
Ce travail perm<strong>et</strong> d’effectuer le calcul <strong>de</strong> l’évolution temporelle <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
concentrations <strong><strong>de</strong>s</strong> espèces neutres, ionisés <strong>et</strong> excitées dans le p<strong>la</strong>sma. <strong>Le</strong>s résultats<br />
montrent l’influence da <strong>la</strong> cinétique sur le ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> production d’ozone <strong>et</strong><br />
l’influence du chauffage du gaz par eff<strong>et</strong> Joule.<br />
Mots-Clés : Ozone ; p<strong>la</strong>sma froid ; mo<strong>de</strong>l cinétique temporelle : N 2 -O 2 ; eff<strong>et</strong> du<br />
chauffage.<br />
10 13<br />
(a)<br />
(b)<br />
<strong>de</strong>nsité électronique(cm -3 )<br />
10 12<br />
10 11<br />
10 10<br />
10 9<br />
10 -8 10 -7 10 -6<br />
Temps (s)<br />
avec eff<strong>et</strong> joule<br />
sans eff<strong>et</strong> joule<br />
[O<br />
3<br />
](cm -3 )<br />
10 16<br />
10 15<br />
10 14<br />
10 13<br />
10 12<br />
10 11<br />
sans eff<strong>et</strong> joule<br />
10 10<br />
10 9<br />
10 8<br />
10 7<br />
avec eff<strong>et</strong> joule<br />
10 6<br />
10 -8 10 -7 10 -6 10 -5<br />
Tem ps(s)<br />
Références:<br />
[1] K. Yanal<strong>la</strong>h, S. Hadj Ziane, A. Be<strong>la</strong>sri and Y. Meslem”Numérical mo<strong>de</strong>ling of<br />
ozone production in direct current corona discharge” journal of molecu<strong>la</strong>r structure<br />
THEOCHEM, V°777, Issues13, p125, August(2006)<br />
40
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème IV<br />
[2] A Kossyi, A Yu Kostinsky, Aa Mateveyev And Vp Si<strong>la</strong>kov, "Kin<strong>et</strong>ic scheme of<br />
the non-equilibrium discharge in nitrogen-oxygen mixtures", p<strong>la</strong>sma sources<br />
sci.technol. 1 207-220 (1992)<br />
41
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème IV<br />
O.4.4<br />
Forest fires smoke monitoring from SeaWiFS sensor images<br />
A.Hassini ac , S.Deajean b , A.H.Belbachir a<br />
a Laboratory of Application and Analysis of Radiations, Department of Physics<br />
USTOMB. El M’nouer B.P.1505 Oran, Algeria. Tel: +213 74374379, Fax: +213 41560350<br />
b Institute of Mathematics of Toulouse, UMR CNRS 5219, University Paul Sabatier,<br />
31062, Toulouse ce<strong>de</strong>x 9, France.<br />
c Institute of Maintenance and Industrial Security, University of Oran, Algeria.<br />
Correspon<strong>de</strong>nce to: A. Hassini (hassini.ab<strong>de</strong><strong>la</strong>tif@univ-oran.dz)<br />
Monitoring of active fires allows the prediction of spread of fire fronts to areas with<br />
values at risk. The forest fires smoke can be used to assist in fire fighting prevention<br />
measures by indicating wind patterns, veg<strong>et</strong>ation changes and other cumu<strong>la</strong>tive<br />
factors. A m<strong>et</strong>hod for d<strong>et</strong>ecting forest fires smoke using SeaWiFS (Sea-viewing Wi<strong>de</strong>-<br />
Field-of View Sensor) images is <strong>de</strong>veloped in this paper.<br />
Because the long field of view in the visible spectrum compared with NOAA –<br />
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiom<strong>et</strong>er) sensor , multiregional<br />
coverage (po<strong>la</strong>r orbit satellite) compared with GOES and MSG satellites<br />
(geostationary satellites), and, <strong>la</strong>rge spectral window of each channel compared with<br />
MODIS satellite, SeaWiFS sensor is selected b<strong>et</strong>ter for the extraction of Forest Fires<br />
Smoke Plumes product.<br />
The colour masking technique is proposed to extract the maximum fires smoke pixels<br />
from the SeaStar/SeaWiFS images by using Fusion by Arithm<strong>et</strong>ic Combination (FAC)<br />
of spectral bands m<strong>et</strong>hod. Each image used is converted from RGB (Red, Green,<br />
Blue) to HIS (Hue, Saturation, Intensity) system, The results smoke plumes pixels are<br />
obtained visually on the images Intensity and Saturation, then one looks at the values<br />
taken by intensity and saturation for potentially applying them to other images in<br />
routine.<br />
In this research, we applied our d<strong>et</strong>ecting forest fires smoke algorithm in seven<br />
different scenes, for a vari<strong>et</strong>y of conditions, including different regions of the p<strong>la</strong>n<strong>et</strong>,<br />
and, different times, Smoke Pixel Reference Ratio SPRR is used to test the proposed<br />
m<strong>et</strong>hod. The <strong>la</strong>rgest values of this in<strong>de</strong>x are observed because of a small area of smoke<br />
plumes in scene of image used (1.031% from Saturation image and 0.0950% from<br />
Intensity image).<br />
We found that the m<strong>et</strong>hod can d<strong>et</strong>ect maximum pixels of smoke plumes in spite of<br />
some limitations.<br />
Key words: Remote sensing, Forest fires, SeaWiFS Images, Smoke, FAC m<strong>et</strong>hod.<br />
42
STOP FEU, Oran 2010 Orales Thème IV<br />
O.4.5<br />
Quelles essences <strong>de</strong> reboisement peut –on r<strong>et</strong>enir pour le reboisement ?<br />
M.Kaid-Harche<br />
Département <strong>de</strong> biotechnologie ,faculté <strong><strong>de</strong>s</strong> sciences ,U.S.T.O. Mohamed Boudiaf.<br />
e.m : armoise200@yahoo.fr<br />
La forêt fournit à l’être humain l’oxygène, <strong>de</strong> multiples bienfaits (, bois liège, produits<br />
pharmaceutique <strong>et</strong>c.) <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> lieux <strong>de</strong> détente <strong>et</strong> <strong>de</strong> loisir.<br />
En Algérie, les forêts <strong>et</strong> maquis couvrent 4,1 millions d’hectares soit un taux <strong>de</strong><br />
boisement <strong>de</strong> 16,4% pour le nord <strong>de</strong> l’Algérie <strong>et</strong> <strong>de</strong> 1,7 % pour les régions du sud. <strong>Le</strong>s<br />
essences prédominantes sont représentées par <strong><strong>de</strong>s</strong> Gymnospermes (conifères ou<br />
résineux) principalement le pin d’Alep, le thuya, le cèdre, le genévrier <strong>et</strong> par <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Angiospermes, nous pouvons citer : le chêne liège, l’ eucalyptus, le chêne vert.<br />
<strong>Le</strong> réchauffement climatique nous incite à diversifier le choix <strong><strong>de</strong>s</strong> essences forestières.<br />
Des ligneux peu connus en Algérie, constituent au p<strong>la</strong>n morphologique <strong>et</strong> structurale<br />
<strong>de</strong> bons modèles à introduire dans les programmes <strong>de</strong> reboisement .Nous donnerons<br />
quelques exemples d’arbres susceptibles d’intéresser le forestier.<br />
43
STOP FEU, Oran 2010<br />
Posters<br />
Communications<br />
en affiches<br />
(Posters)<br />
44
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
P.1.1<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> dimension fractale du front dans un système désordonné binaire.<br />
Application aux feux <strong>de</strong> forêt<br />
M. Ammari <strong>et</strong> N. Zekri<br />
USTO, Département <strong>de</strong> Physique, LEPM, BP 1505 El M’naouer Oran, Algérie<br />
Dans ce travail nous tentons d'étudier <strong>la</strong> dimension fractale du front <strong>de</strong> feu D p <strong>et</strong> <strong>la</strong><br />
dimension fractale du front <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface brûlé D s sur un système <strong>de</strong> type perco<strong>la</strong>tion<br />
avec une <strong>de</strong>nsité p <strong>de</strong> cellules actives (contenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation). La dimension<br />
fractale du front est utilisée par les pompiers pour optimiser les moyens <strong>de</strong> combat du<br />
feu. Lorsque c<strong>et</strong>te dimension est inférieure à 1, c’est que le front présente <strong><strong>de</strong>s</strong> coupures<br />
non combustibles <strong>et</strong> le feu se présente sous forme <strong>de</strong> segments qui peuvent être<br />
combattus facilement. Si c<strong>et</strong>te dimension est supérieure à 1D le front <strong>de</strong>vient linéaire<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> moyens pour être éteint.<br />
Pour c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong>, un programme réalisé par le LEPM sera utilisé pour modéliser <strong>la</strong><br />
vitesse <strong>de</strong> propagation, <strong>la</strong> masse brulée <strong>et</strong> le front du feu. La dimension fractale du feu<br />
sera investiguée pour différentes <strong>de</strong>nsités <strong>de</strong> végétation au <strong><strong>de</strong>s</strong>sus du seuil <strong>de</strong><br />
perco<strong>la</strong>tion.<br />
Dans une secon<strong>de</strong> étape, on étudiera l’eff<strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> reliefs (pentes <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong>centes du sol) sur<br />
<strong>la</strong> dimension fractale du front. <strong>Le</strong> sol présentant <strong><strong>de</strong>s</strong> reliefs a une structure rugueuse<br />
ayant une dimension fractale caractéristique appelée rugosité σ. Nous observons<br />
ensuite l'influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> rugosité du terrain sur <strong>la</strong> dimension fractale du front.<br />
Figure. 1- Mesures <strong>de</strong> <strong>la</strong> dimension d’une courbe par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> boîtes.<br />
45
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
Figure. 3- nombre <strong>de</strong> sites en feu en fonction du temps pour p=0.5<strong>et</strong> p=1 <strong>et</strong> différentes sigma<br />
Figure. 4- D p <strong>et</strong> D s en fonction <strong>de</strong> σ pour p =1 avec l x =2 <strong>et</strong> l y =6.<br />
Mots clés : feux <strong>de</strong> for<strong>et</strong>, modèle <strong>de</strong> Réseau <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong>, perco<strong>la</strong>tion,<br />
caractérisation <strong><strong>de</strong>s</strong> réseaux, dimension fractale.<br />
46
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
P.1.2<br />
Caractérisation Statistique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Structure d’un Réseau Aléatoire <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong><br />
<strong>et</strong> son Application aux Feux <strong>de</strong> Forêt<br />
F.Z.Benzahra <strong>et</strong> N.Zekri<br />
USTO, Département <strong>de</strong> Physique, LEPM, BP 1505 El Mnaouer Oran, Algérie<br />
<strong>Le</strong>s propriétés <strong>de</strong> propagation d’un front (appliqué à <strong>la</strong> propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong><br />
for<strong>et</strong>) sous l’influence <strong><strong>de</strong>s</strong> brandons <strong>et</strong> <strong>la</strong> zone d’interaction (lx, ly) due au<br />
rayonnement sont examinées en utilisant le modèle du Réseau P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong>. Nous<br />
avons analysé <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong> connexions dans un réseau <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong> <strong>et</strong> le<br />
coefficient d’amas qui représentent les propriétés mathématiques du réseau.<br />
<strong>Le</strong> modèle utilisé est un modèle stochastique qui perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> prédire le comportement<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêt. Il est une variante du modèle Réseau <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong> social<br />
initialement proposé par Watts <strong>et</strong> Strogatz qui perm<strong>et</strong> en plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong><strong>de</strong>s</strong> amas,<br />
celle <strong><strong>de</strong>s</strong> connexions à longue distance. Ce modèle a été appliqué avec succès à <strong>la</strong><br />
propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> ma<strong>la</strong>dies, il est caractérisé par un par un fort comportement en amas <strong>et</strong><br />
une distribution <strong><strong>de</strong>s</strong> connexions en loi <strong>de</strong> Poisson.<br />
<strong>Le</strong> modèle du Réseau <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong> a été aussi adapté à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> propagation<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> for<strong>et</strong>, il inclue <strong><strong>de</strong>s</strong> connexions au-<strong>de</strong>là <strong><strong>de</strong>s</strong> proches voisins dues au<br />
rayonnement <strong><strong>de</strong>s</strong> f<strong>la</strong>mmes ou les sautes <strong>de</strong> feux induites par les brandons que les<br />
autres modèles <strong>de</strong> propagation ne peuvent inclure. Il a été validé par différents<br />
résultats expérimentaux sur <strong><strong>de</strong>s</strong> feux réels.<br />
Nous avons étudié <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong> connexions <strong>et</strong> le coefficient d’amas <strong>et</strong> d’autres<br />
caractéristiques <strong>de</strong> c<strong>et</strong> amas comme <strong>la</strong> taille <strong>et</strong> le nombre d’amas pour ce nouveau<br />
réseau dans un système homogène <strong>et</strong> hétérogène (près du seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion). D’autre<br />
part, nous avons r<strong>et</strong>rouvé une distribution en loi <strong>de</strong> Poisson ainsi qu’un grand<br />
coefficient d’amas pour ce type <strong>de</strong> réseau que nous avons comparé aux autres réseaux.<br />
Tous ces paramètres changent significativement lorsque le nombre <strong>de</strong> connexions<br />
par site augmente. Nous avons aussi trouvé que le nombre moyen <strong>de</strong> connexions<br />
augmente en puissance avec <strong>la</strong> concentration <strong>de</strong> sites actifs suivant une loi universelle<br />
près du seuil <strong>de</strong> <strong>la</strong> transition.<br />
C<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> nous a permis d‘analyser statistiquement l’eff<strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> connexions à longue<br />
distance qui sont les brandons. Nous avons trouvé que plus le nombre <strong>de</strong> brandons<br />
émis par site est élevé plus le coefficient d’amas <strong>et</strong> <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong> connexion sont<br />
modifiés.<br />
47
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
Fig.1. L'évolution du réseau <strong>de</strong> Watts- Strogatz : A partir d'un anneau régulier avec k=6(a), à <strong>la</strong> suite<br />
du processus <strong>de</strong> reliage (b), en arrivant à une structure <strong>de</strong> graphe aléatoire (c). Une définition<br />
alternative (d), lorsque seulement les courts circuits sont ajoutés à l’anneau originale <strong>de</strong> début.<br />
Fig.2.La distribution <strong>de</strong> connexions dans un modèle <strong>de</strong> Watts-Strogatz P(k) ~Poisson(k).<br />
Fig.4. réseau carré <strong>de</strong> p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong> (à2D) appliqué au for<strong>et</strong> mise en feux ,montre les connexion entre<br />
les arbres ,que se soit <strong><strong>de</strong>s</strong> connexions entre proche voisins(celle en vert),ou bien les connexions à<br />
longue distance(nommé aussi court-circuit)qui sont les brandons dans notre cas <strong>de</strong> feux <strong>de</strong> for<strong>et</strong> (celle<br />
en b<strong>la</strong>nc) ,ici lx
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
D onnées <strong>de</strong> <strong>la</strong> sim u<strong>la</strong>tion<br />
Ajustement en p 2<br />
Nombre moyen <strong>de</strong> connexions λ<br />
10<br />
1<br />
Seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion p c<br />
0,1 1<br />
proportion <strong><strong>de</strong>s</strong> sites actifs P<br />
Fig.8. le nombre moyen <strong>de</strong> connexion en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> proportion <strong><strong>de</strong>s</strong> sites actifs.<br />
D’autre parts, le coefficient d’amas C qui mesure <strong>la</strong> cohésion du réseau est grand lorsque le réseau<br />
obéit à une certaine hétérogénéité (avec connexions à longue distance) où <strong>la</strong> topologie aléatoire<br />
(RPM), <strong>et</strong> diminue lorsque le réseau est homogène c'est-à-dire il existe certaine régu<strong>la</strong>rité (sans<br />
connexions à longue distance).<br />
Mots clés : feux <strong>de</strong> for<strong>et</strong>, systèmes complexes, modèle <strong>de</strong> Réseau <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong>,<br />
perco<strong>la</strong>tion, caractérisation <strong><strong>de</strong>s</strong> réseaux.<br />
49
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
P.1.3<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> variation du vent sur <strong>la</strong> propagation d’un front <strong>de</strong> feu<br />
F-Z.Sabi <strong>et</strong> N.Zekri<br />
USTO, LEPM, Département <strong>de</strong> Physique, BP 1505 El Mnaouer Oran, Algeri<br />
<strong>Le</strong>s propriétés <strong>de</strong> propagation d’un front (appliqué à <strong>la</strong> propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong><br />
for<strong>et</strong>) sous l’influence d’un champ variable correspondant aux rafales <strong>de</strong> vent sont<br />
examinées en utilisant le modèle du Réseau <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong>.<br />
<strong>Le</strong> modèle utilisé est un modèle stochastique qui perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> prédire le<br />
comportement <strong>de</strong> <strong>la</strong> propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> for<strong>et</strong>. Il est une variante du modèle<br />
Réseau <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong> social initialement proposé par Watts <strong>et</strong> Strogatz qui perm<strong>et</strong><br />
en plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong><strong>de</strong>s</strong> amas, celle <strong><strong>de</strong>s</strong> connexions à longue distance. Ce modèle a<br />
été appliqué avec succès à <strong>la</strong> propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> ma<strong>la</strong>dies.<br />
<strong>Le</strong> modèle du Réseau <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong> est le mieux approprié pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
propagation <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> for<strong>et</strong>, il inclue <strong><strong>de</strong>s</strong> connexions au-<strong>de</strong>là <strong><strong>de</strong>s</strong> proches voisins<br />
dues au rayonnement <strong><strong>de</strong>s</strong> f<strong>la</strong>mmes ou les sautes <strong>de</strong> feux induites par les brandons que<br />
les autres modèles ne peuvent inclure, il utilise une double pondération basée sur le<br />
temps <strong>de</strong> combustion, temps nécessaire au combustible <strong>de</strong> se consumer, <strong>et</strong> l’énergie<br />
requise par <strong>la</strong> végétation pour s’allumer. Il a été validé par différents résultats<br />
expérimentaux <strong>et</strong> par <strong><strong>de</strong>s</strong> feux réels.<br />
Tout d’abord l’étu<strong>de</strong> est faite analytiquement <strong>et</strong> numériquement avec le modèle à<br />
1D dans un milieu homogène. Ensuite <strong>la</strong> propagation est examinée à 2D aussi bien<br />
dans un milieu homogène que hétérogène où le feu se propage dans <strong>la</strong> phase vent<br />
maximal <strong>et</strong> ne se propage pas dans <strong>la</strong> phase vent minimal.<br />
Pour les milieux homogènes <strong>la</strong> propagation est stationnaire dans le cas <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>et</strong>ites<br />
pério<strong><strong>de</strong>s</strong>, <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> propagation tend vers une vitesse moyenne entre <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
phase vent minimal <strong>et</strong> celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase vent maximal. Par contre, elle fluctue autour<br />
<strong>de</strong> c<strong>et</strong>te vitesse pour <strong><strong>de</strong>s</strong> pério<strong><strong>de</strong>s</strong> intermédiaire (comme indiqué sur fig.1). Un<br />
phénomène bistable est observé pour <strong>de</strong> gran<strong><strong>de</strong>s</strong> pério<strong><strong>de</strong>s</strong>. <strong>Le</strong>s systèmes hétérogènes<br />
sont caractérisés par une propagation stationnaire pour les p<strong>et</strong>ites pério<strong><strong>de</strong>s</strong> seulement,<br />
avec une vitesse plus lente due à l’hétérogénéité du système. La vitesse <strong>de</strong> propagation<br />
diminue pour les gran<strong><strong>de</strong>s</strong> pério<strong><strong>de</strong>s</strong> où une compétition entre le temps <strong>de</strong> combustion <strong>et</strong><br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du champ apparaît.<br />
50
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
Fig.1 définition <strong><strong>de</strong>s</strong> variables<br />
utilisées dans <strong>la</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong>cription du<br />
domaine d’interaction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cellule en feu i, δl=a est le<br />
paramètre du réseau.<br />
Vitesse <strong>de</strong> propagation<br />
0,60<br />
0,55<br />
0,50<br />
1 10 100<br />
Pé r i o d e (T)<br />
Fig.1 <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> propagation en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> T. <strong>Le</strong>s courbes en pointillé <strong>et</strong> triangle<br />
correspon<strong>de</strong>nt au calcul analytique, <strong>la</strong> courbe en étoile<br />
au calcul numérique.<br />
Mots clés : Réseau <strong>de</strong> P<strong>et</strong>it Mon<strong>de</strong>, propagation <strong>de</strong> feu, champ périodique.<br />
51
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
P.1.4<br />
Une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> segmentation d’images pour <strong>la</strong> métrologie <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêts<br />
S.Rudz 1,2 , K.Ch<strong>et</strong>ehouna 2 , A.Hafiane 2 , H.Laurent 2 and O.Sero-Guil<strong>la</strong>ume 1<br />
1<br />
LEMTA (UMR 7563 CNRS/INPL/UHP), 2 avenue <strong>de</strong> <strong>la</strong> Forêt <strong>de</strong> Haye – 54504<br />
Vandoeuvre les Nancy ce<strong>de</strong>x, France<br />
2 ENSI <strong>de</strong> Bourges, Institut PRISME UPRES EA 4229, 88 boulevard Lahitolle,<br />
18020 Bourges Ce<strong>de</strong>x, France, E-mail: khaled.ch<strong>et</strong>ehouna@ensi-bourges.fr<br />
<strong>Le</strong>s feux <strong>de</strong> forêts <strong>de</strong>viennent, années après années, <strong>de</strong> plus en plus fréquents <strong>et</strong><br />
dangereux. C<strong>et</strong>te tendance ira en s’amplifiant dans les prochaines années à cause du<br />
réchauffement climatique. Bien sûr les combattants <strong><strong>de</strong>s</strong> feux améliorent sans cesse<br />
leurs outils, mais ils ne disposent malheureusement que <strong>de</strong> trop peu d’informations sur<br />
<strong>la</strong> position du feu dans <strong>la</strong> plupart <strong><strong>de</strong>s</strong> cas. Pour remédier à ce problème <strong>la</strong> piste du<br />
traitement d’image est explorée <strong>de</strong>puis une dizaine d’années. La localisation du feu se<br />
fait alors en <strong>de</strong>ux étapes consécutives : segmentation du feu puis calcul <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
coordonnées. Bien que <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième étape soit maîtrisée, elle est directement<br />
conditionnée par <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> <strong>la</strong> segmentation du feu dans l’image.<br />
L’objectif <strong>de</strong> c<strong>et</strong> article est <strong>de</strong> proposer une nouvelle métho<strong>de</strong> perm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> segmenter<br />
le feu dans une image en utilisant une caméra travail<strong>la</strong>nt dans le domaine du visible en<br />
raison <strong>de</strong> son faible coût. Ce travail s’appuie sur une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution <strong><strong>de</strong>s</strong> pixels<br />
<strong>de</strong> feux sur chaque composante <strong><strong>de</strong>s</strong> espaces couleurs RGB, HSV, YUV <strong>et</strong> Lab. <strong>Le</strong>s<br />
résultats obtenus ont permis <strong>de</strong> proposer une nouvelle métho<strong>de</strong> combinant une<br />
c<strong>la</strong>ssification par k-means sur <strong>la</strong> composante « b » <strong>de</strong> l’espace couleur Lab <strong>et</strong><br />
l’utilisation <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution du feu dans l’espace couleur RGB. La<br />
composante « b » <strong>de</strong> l’espace couleur Lab discrimine en eff<strong>et</strong> particulièrement bien le<br />
feu du reste <strong>de</strong> l’image tandis que <strong>la</strong> distribution dans l’espace RGB perm<strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
construire <strong><strong>de</strong>s</strong> modèles <strong>de</strong> références. <strong>Le</strong>s performances <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te technique <strong>de</strong><br />
segmentation sont ensuite quantifiées à l’ai<strong>de</strong> d’un critère d’évaluation supervisé qui<br />
repose sur <strong><strong>de</strong>s</strong> images <strong>de</strong> feux annotées par un expert. Finalement une comparaison<br />
avec d’autres algorithmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> littérature est présentée afin <strong>de</strong> démontrer l’intérêt <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> métho<strong>de</strong> proposée. La suite <strong>de</strong> ce travail sera consacrée à l’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
robustesse <strong>de</strong> l’algorithme en é<strong>la</strong>rgissant <strong>la</strong> base <strong>de</strong> données <strong>et</strong> en optimisant ses<br />
paramètres.<br />
52
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
P.1.5<br />
<strong>Le</strong>s feux <strong>de</strong> forêt dans <strong>la</strong> Parc National <strong>de</strong> Belezma: Stratégie <strong>de</strong> gestion.<br />
H.Boukerker 1 , S.Merdas 2 , M.R.Boumedjane 1 , L.Bouatia 2<br />
1 Université El Hadj Lakhdar Batna,<br />
2 Université Mantouri Constantine<br />
Email : hboukerker@yahoo.fr<br />
<strong>Le</strong> Parc National <strong>de</strong> Belezma est une aire protégée se situe dans <strong>la</strong> partie orientale <strong>de</strong><br />
l’Algérie du Nord, dans le massif montagneux du Belezma qui se trouve à l’extrémité<br />
Ouest du Mont Aurès dans l’Est Algérien. Il se localise à environ 7 km au nord-ouest<br />
du chef-lieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> wi<strong>la</strong>ya <strong>de</strong> Batna.<br />
Il correspond à un chaînon montagneux très acci<strong>de</strong>nté marquant le début du massif <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Aurès, avec un relief très tourmenté, <strong><strong>de</strong>s</strong> vallées très étroites <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> pics culminants<br />
jusqu’à 2136m d’altitu<strong>de</strong> (Djebel Tichaou) <strong>et</strong> 2178 (Djebel Refaâ).<br />
C<strong>et</strong>te aire protégée préservent une vaste gamme <strong>de</strong> ressources patrimoniales <strong>de</strong><br />
nature culturelle <strong>et</strong> naturelle dans les Aurès à s’avoir <strong>la</strong> cédraie du Belezma joyaux<br />
monuments naturels <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong><strong>de</strong>s</strong> Aurès, il s’agit d’un patrimoine national <strong>et</strong><br />
mondial, unique écotype situé aux portes du désert qui abrite <strong><strong>de</strong>s</strong> espèces<br />
faunistiques<br />
<strong>et</strong> floristiques endémiques rares <strong>et</strong> rassîmes. La flore du Belezma représente 16,87%<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> flore algérienne qui en compte 3129 espèces <strong>et</strong> 398 espèces <strong>de</strong> faunes sont<br />
ainsi recensées. Ces zones fournissent <strong><strong>de</strong>s</strong> possibilités éducatives <strong>et</strong> récréatives<br />
importantes pour l’Algérie ainsi que pour <strong><strong>de</strong>s</strong> milliers <strong>de</strong> visiteurs algériens <strong>et</strong><br />
internationaux.<br />
A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> il est plus que recommandé d’entreprendre toutes les actions possibles <strong>et</strong><br />
réalisables pour <strong>la</strong> protection, <strong>la</strong> valorisation <strong>et</strong> <strong>la</strong> réhabilitation <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te aire protégée<br />
contre toutes perturbations ; ma<strong>la</strong>dies, sécheresse <strong>et</strong> surtout les incendies <strong>de</strong> forêts.<br />
De ce point <strong>de</strong> vue, <strong>la</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêt dans le Parc National <strong>de</strong> Belezma -<br />
Batna- a <strong>de</strong>ux objectifs, d’une part <strong>de</strong> prévenir les blessures personnelles, <strong>la</strong> perte <strong>de</strong><br />
ressources <strong>et</strong> les perturbations sociales <strong>et</strong> d’autre part à travers les actions <strong>de</strong><br />
sensibilisation <strong>de</strong> mieux faire comprendre aux gens le rôle écologique du feu<br />
<strong>et</strong> utiliser ses eff<strong>et</strong>s bénéfiques dans <strong>la</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> ressources.<br />
Atteindre ces objectifs à l’échelle d’une aire protégée exige une p<strong>la</strong>nification<br />
judicieuse orientée par <strong><strong>de</strong>s</strong> recherches scientifiques, l’expérience <strong>de</strong> terrain <strong><strong>de</strong>s</strong> agents<br />
forestiers <strong>et</strong> écologistes <strong>et</strong> une gestion <strong>de</strong> proximité efficace.<br />
53
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
Dans les aires protégées en générale <strong>et</strong> le Parc National <strong>de</strong> Belezma spécialement; le<br />
feu assure dans certains cas <strong>la</strong> régénération naturelle <strong><strong>de</strong>s</strong> peuplements surtout pour les<br />
pinè<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>et</strong> <strong>la</strong> santé écologique <strong>de</strong> l’écosystème Cédraie qu’est en état <strong>de</strong> dégradation<br />
très avancée (Etat <strong>de</strong> dépérissement donc beaucoup <strong>de</strong> bois morts sur pied).<br />
Ces incendies sont dans <strong>la</strong> plupart <strong><strong>de</strong>s</strong> cas les responsables du riche patrimoine<br />
naturel que l’on r<strong>et</strong>rouve actuellement dans le Parc National <strong>de</strong> Belezma. <strong>Le</strong>s<br />
gestionnaires <strong><strong>de</strong>s</strong> zones protégées <strong>et</strong> du feu s’aperçoivent <strong>de</strong> plus en plus que les<br />
écosystèmes dans plusieurs zones dépen<strong>de</strong>nt du feu <strong>et</strong> d’autres perturbations, comme<br />
le vent, pour leur renouvellement <strong>et</strong> leur santé. Lorsqu’il y a absence <strong>de</strong> feu, ces<br />
écosystèmes changent, l’habitat se détériore <strong>et</strong> les zones protégées per<strong>de</strong>nt le<br />
patrimoine naturel qui avait causé leur création.<br />
<strong>Le</strong> feu est essentiel du point <strong>de</strong> vue écologique mais il peut également menacer <strong>la</strong><br />
santé <strong>et</strong> <strong>la</strong> sécurité du public ainsi que autres valeurs. Pour réaliser ces objectifs<br />
efficacement, un p<strong>la</strong>n d’action à été établit par les gestionnaires <strong>et</strong> les scientifiques sur<br />
<strong>la</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> feux <strong>de</strong> forêt dans le Parc National <strong>de</strong> Belezma qui pris en<br />
considération l’équilibre entre le besoin <strong>de</strong> protéger les valeurs <strong>et</strong> le besoin d’utiliser le<br />
feu pour rétablir <strong>et</strong> maintenir <strong>la</strong> santé <strong>et</strong> l’équilibre <strong><strong>de</strong>s</strong> écosystèmes représentés dans<br />
notre aire protégée..<br />
Mots clés : Parc National Belezma, Feux, Forêts, P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Gestion, P<strong>la</strong>n d’action,<br />
Régénération<br />
54
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
P.1.6<br />
Active Fire Monitoring with SEVIRI MSG Satellites<br />
A.Hassini ab , A.H.Belbachir a<br />
a Laboratory of Application and Analysis of Radiations LAAR,<br />
Department of Physics USTOMB. El M’nouer B.P.1505 Oran, Algeria.<br />
Tel: +213 74374379; Fax: +213 41560350 Email: ab<strong>de</strong><strong>la</strong>tif_hassini@yahoo.com<br />
The first of the new generation of M<strong>et</strong>eosat satellites, known as M<strong>et</strong>eosat Second<br />
Generation (MSG-1), was <strong>la</strong>unched in August 2002. As with the current M<strong>et</strong>eosat<br />
series, MSG is spin-stabilized, and capable of greatly enhanced Earth observations.<br />
The satellite’s 12-channel imager, known formally as the Spinning Enhanced Visible<br />
and Infrared Imager (SEVIRI), observes the full disk of the Earth with an<br />
unprece<strong>de</strong>nted repeat cycle of 15 minutes in 12 spectral wavelength regions or<br />
channels.<br />
Our goal is to collect maximum MSG images data with our real time acquisition<br />
system, to trust the continuous observation of the Earth’s full disk with a multi-spectral<br />
imager.<br />
This paper gives an overview of the MSG SEVIRI instrument, the general approach<br />
for the active fire monitoring, and the <strong><strong>de</strong>s</strong>cription of the algorithm tog<strong>et</strong>her with the<br />
practical application of the tests and the algorithm.<br />
The AFMA algorithm (Active Fire Monitoring Algorithm) <strong>de</strong>veloped in this work is<br />
able to d<strong>et</strong>ect most of the existing active fires with a minimum of false a<strong>la</strong>rms.<br />
The AFMA algorithm distinguishes b<strong>et</strong>ween Diurnal and Nocturnal periods of day.<br />
The algorithm itself is based on a simple threshold algorithm. A few results are<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong>cribed and discussed.<br />
Keywords: Satellite images, SEVIRI, MSG, Fires, AFMA algorithm.<br />
Somme results:<br />
Receivi<br />
KU<br />
EUMETSA<br />
TUSBK<br />
PCI-<br />
Co<br />
Figure 1. Global synoptic of MSG acquisition system.<br />
Figure 2. AFMA algorithm: Pixel to be c<strong>la</strong>ssified<br />
as a diurnal fire pixel.<br />
T4 > threshold1<br />
SDev4 > threshold2<br />
T4-T9 > threshold3<br />
SDev9< threshold4<br />
Diurnal fire<br />
55
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
T4 > threshold5<br />
SDev4 > threshold6<br />
T4-T9 > threshold7<br />
SDev9< threshold8<br />
Nocturnal fire pixel<br />
Figure 3. AFMA algorithm : Pixel to be c<strong>la</strong>ssified as a Nocturnal fire pixel.<br />
Satellites MSG-1<br />
and MSG 2<br />
Raw data Ch4,Ch8<br />
and Ch9<br />
<strong>Le</strong>vel 1.5 data Ch4, Ch8 and<br />
Ch9<br />
Input data<br />
Figure 4. The flowchart of the fire-d<strong>et</strong>ection<br />
algorithm for use with MSG SEVIRI data.<br />
Calibration, radiom<strong>et</strong>ric<br />
AFMA algorithm applied to<br />
Output<br />
Single date fire mask<br />
56
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
N<br />
0 250<br />
Figure 5-a. A part of Channel Ch 4 (IR3.9) as acquired (<strong>Le</strong>vel 1.5 data) on 1st August 2006 at<br />
13h15min UTC. Cities and over<strong>la</strong>y mask is processed after saving the raw image.<br />
N<br />
0<br />
Figure 5-b. Apart of Channel (CH 4) IR3.9 brightness temperature acquired on 1st August 2006 at<br />
13h15min UTC. Dark means low temperatures, bright means high temperatures due to the so<strong>la</strong>r<br />
reflection in channel IR3.9, low clouds appear warmer than the clear At<strong>la</strong>ntic Ocean and<br />
Mediterranean Sea.<br />
57
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème I<br />
Congo-<br />
Congo-Kinshasa<br />
N<br />
0 250<br />
Figure 6: Channel (CH 4) IR3.9 brightness temperatures on 1st August 2006 at 13h15min UTC. Forest<br />
fire pixels in Congo-Brazzaville and Congo-Kinshasa processed with the AFMA algorithm in diurnal<br />
period.<br />
58
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème II<br />
P.2.1<br />
Comportement au feu d’un poteau mixte acier-béton <strong>et</strong> moyens <strong>de</strong> prévention<br />
S.Sekkiou, M.Mimoune, R.Belounis<br />
Département <strong>de</strong> Génie civil, Université <strong>de</strong> Constantine, Algérie. E-mail :<br />
s.savoir@yahoo.fr<br />
Dans c<strong>et</strong> article, le comportement <strong><strong>de</strong>s</strong> poteaux mixtes en profils d’acier partiellement<br />
enrobés <strong>de</strong> béton sans protection au feu <strong>et</strong> sous chargement axial, a été étudié en<br />
employant le modèle <strong>de</strong> calcul simplifié <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'Euroco<strong>de</strong>4 (EC4). <strong>Le</strong>s<br />
objectifs principaux <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> sont: évaluer d'abord <strong>la</strong> température <strong><strong>de</strong>s</strong> différents<br />
composants <strong>de</strong> <strong>la</strong> section du poteau ainsi que <strong>la</strong> variation <strong><strong>de</strong>s</strong> caractéristiques <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
matériaux les constituant; <strong>et</strong> analyser ensuite l'influence <strong>de</strong> plusieurs paramètres, tels<br />
que <strong>la</strong> dimension <strong>de</strong> <strong>la</strong> section, le taux d’acier d’armature, <strong>la</strong> longueur <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mbement<br />
<strong>et</strong> les résistances mécaniques <strong>de</strong> l'acier <strong>de</strong> construction <strong>et</strong> du béton sur <strong>la</strong> résistance<br />
ultime au feu ; <strong>et</strong> tirer <strong>de</strong> ce fait différents moyens <strong>de</strong> prévention <strong>Le</strong>s résultats<br />
montrent que les dimensions <strong>de</strong> <strong>la</strong> section, le taux d’armatures <strong>et</strong> <strong>la</strong> longueur <strong>de</strong><br />
f<strong>la</strong>mbement ont une influence significative sur <strong>la</strong> résistance au feu. Par contre, les<br />
résistances caractéristiques <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux ont une influence modérée.<br />
Mots clés : Résistance au feu; Incendie ; Section mixte acier-béton; Poteaux mixtes.<br />
59
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.1<br />
Physical properties of polymeric matérials<br />
N.Berrahou, M.O.Bensaid, S.Hiadsi<br />
Laboratory of the Electronic Microscopy and Materials Science<br />
Physics Department-faculty of Science USTO. BP .1505 El M’Naouar, 31100 Oran,<br />
Algéria :E-mail: berrahounoria@yahoo.fr<br />
The structures and properties of polymer melts at various interfaces have been the<br />
subject of numerous studies in recent years due to the critical role p<strong>la</strong>y in such<br />
important polymer applications.Computer simu<strong>la</strong>tion has become a major tool in<br />
polymer science in the same way as analytical theory and experiment. Consequently,<br />
the <strong>de</strong>velopment of appropriate m<strong>et</strong>hod of simu<strong>la</strong>tions for the polymers is a field of<br />
active research. These m<strong>et</strong>hods allow to investigate the propertiesof the polymer un<strong>de</strong>r<br />
different conditions such as in solution, in a polymer melt or in the crystalline state. In<br />
our work we have simu<strong>la</strong>ted by molecu<strong>la</strong>r dynamics m<strong>et</strong>hod, two polymer chains in<br />
their amorphous state , (poly m<strong>et</strong>hyl m<strong>et</strong>hacry<strong>la</strong>te) PMMA and (poly m<strong>et</strong>hyl acry<strong>la</strong>te)<br />
PMA using different force fields PCFF, COMPASS, AMBER, to view their g<strong>la</strong>ss<br />
transition. Given a simu<strong>la</strong>ted difference in Tg b<strong>et</strong>ween the two chains in agreement<br />
with experimental data. Energy studies have been un<strong>de</strong>rtaken to un<strong>de</strong>rstand the<br />
reasons for this discrepancy. The first study showed an energy difference mainly<br />
attributable to differences in intermolecu<strong>la</strong>r interactions and opening angle intra-dyad.<br />
These observations may exp<strong>la</strong>in the observed difference in Tg b<strong>et</strong>ween the two<br />
polymers. Thus the difference in results b<strong>et</strong>ween the force fields used.<br />
Keywords: polym<strong>et</strong>hylm<strong>et</strong>hacry<strong>la</strong>te; polym<strong>et</strong>hyacry<strong>la</strong>te; molecu<strong>la</strong>r dynamics; g<strong>la</strong>ss<br />
transition; force fields<br />
References:<br />
[1] Kuter Bin<strong>de</strong>r, Monte Carlo and Molecu<strong>la</strong>r Dynamics simu<strong>la</strong>tion in<br />
Polymer Scienc, Oxford University Press 1995<br />
[2] Mesfin Tsige ,P.L.Taylor ,Physical rewiew E,Vol 65 , 2002 , p- p 021805<br />
[3] Ash BJ, Siegel RW, Schadler LS. Macromolecules .Vol 37, p-p.1358, 2004<br />
[4] E. Rudrik, J. Thermal Analysis, Vol 49 , p. 465-469, 1997<br />
[5] A.Sol<strong>de</strong>ra, N.M<strong>et</strong>at<strong>la</strong>, j .Molecu<strong>la</strong>r Design, Vol 4, p.721-736 2005<br />
[6] E Osawa,KB.Lipkowitz, Reviewsin computational chemistry,Vol 6,p 6,1995<br />
[7] A.Sol<strong>de</strong>ra, N.M<strong>et</strong>at<strong>la</strong>, j .Composites.PartA, Vol 36, p 521-530, 2005<br />
[8] A.Sol<strong>de</strong>ra, Polymer, Vol 43, p-p 4269-4275, 2002<br />
60
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.2<br />
La variation dimensionnelle <strong><strong>de</strong>s</strong> BAP soumis au choc thermique<br />
B.Boukni, H.Houari<br />
Laboratoire Matériaux <strong>et</strong> Durabilité <strong><strong>de</strong>s</strong> Constructions Université Mentouri<br />
Constantine bokni_soria@yahoo.fr<br />
La recherche sur les matériaux cimentaires ne cesse <strong>de</strong> progresser afin <strong>de</strong> répondre aux<br />
besoins <strong><strong>de</strong>s</strong> industries <strong>de</strong> génie civil. La <strong>de</strong>rnière innovation est le béton autop<strong>la</strong>çant<br />
(BAP)<br />
La spécificité <strong><strong>de</strong>s</strong> BAP par rapport aux bétons traditionnels rési<strong>de</strong> dans le fait qu’ils<br />
sont extrêmement flui<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>et</strong> qu’ils ne nécessitent pas <strong>de</strong> vibration pour être mis en<br />
œuvre. Se compactant sous l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> leur propre poids, ils peuvent être coulés dans<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> zones très ferraillées ou dans <strong><strong>de</strong>s</strong> zones d’architecture complexe <strong>et</strong> difficilement<br />
accessibles.<br />
Diverses étu<strong><strong>de</strong>s</strong> suggèrent que l'addition <strong><strong>de</strong>s</strong> fillers, pouzzo<strong>la</strong>niques ou non<br />
pouzzo<strong>la</strong>niques, au ciment <strong>de</strong> Port<strong>la</strong>nd affecte les propriétés du béton frais <strong>et</strong> durci<br />
spécialement le r<strong>et</strong>rait.<br />
Ces exigences causent aussi une faible perméabilité, ceci à son tour affecte le<br />
comportement du béton autop<strong>la</strong>çant à haute température en particulier <strong>la</strong> migration<br />
d’eau, qui influe sur les propriétés <strong><strong>de</strong>s</strong> bétons <strong>et</strong> leur déformation.<br />
C'est dans ce cadre que s'inscrit c<strong>et</strong>te recherche. L'objectif est <strong>de</strong> montrer l’évolution<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> déformations dimensionnelles <strong>et</strong> pondérales <strong><strong>de</strong>s</strong> bétons autop<strong>la</strong>çants (BAP) <strong>et</strong> que<br />
présente l’ajout <strong><strong>de</strong>s</strong> additions sur les performances <strong><strong>de</strong>s</strong> BAP<br />
L’étu<strong>de</strong> est menée sur <strong>de</strong>ux bétons autop<strong>la</strong>çants avec <strong>de</strong>ux formu<strong>la</strong>tions différentes<br />
contenant un volume i<strong>de</strong>ntique <strong>de</strong> granu<strong>la</strong>t <strong>et</strong> présentant un rapport fillers/liant<br />
variable qui prend les valeurs <strong>de</strong> 0.16 <strong>et</strong> 0.33 respectivement.<br />
Des pertes <strong>de</strong> poids, les variations dimensionnelles avant <strong>et</strong> après le chauffage sont<br />
analysées<br />
Il en ressort <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> que l’augmentation du dosage <strong>de</strong> fillers affecte le r<strong>et</strong>rait <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
BAP, on observe une augmentation <strong>de</strong> r<strong>et</strong>rait en fonction du dosage <strong>de</strong> fillers.<br />
L’élévation <strong>de</strong> <strong>la</strong> température cause un fort raccourcissement puis une stabilité<br />
remarquée pour les <strong>de</strong>ux BAP.<br />
Mots clés : BAP, haute température, r<strong>et</strong>rait, variation dimensionnelle.<br />
61
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.3<br />
Renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure du coton par insersion <strong>de</strong> nanocharges <strong>de</strong><br />
montmorillonite<br />
Y.Koriche a,b , S.Semsari a<br />
a Laboratoire <strong>de</strong> Génie Chimique, Département <strong>de</strong> Chimie Industrielle, Université<br />
Saâd Dah<strong>la</strong>b, Route <strong>de</strong> Soumaâ, B.P. 270, Blida, Algérie<br />
b Institut <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Technologie</strong>, Centre Universitaire <strong>de</strong> Khemis Miliana,<br />
Route Theni<strong>et</strong> El Had, Khemis Miliana, Algérie E-mail : chahira_6@yahoo.fr<br />
La résistance du coton au feu peut être obtenue par <strong><strong>de</strong>s</strong> procédés conventionnels<br />
comme l’ajout <strong>de</strong> revêtements r<strong>et</strong>ard au feu, dérivés halogénés, hydroxy<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
métalliques…<strong>et</strong>c. Néanmoins ces techniques causent <strong><strong>de</strong>s</strong> problèmes à<br />
l’environnement, donc il y a un besoin d’utiliser d’autres technologies pour une<br />
meilleure utilisation industrielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellulose présente en abondance dans <strong>la</strong> nature.<br />
L’objectif <strong>de</strong> ce travail est l’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> stabilité thermique <strong>de</strong><br />
bionanocomposites à matrice cellulose combinée avec <strong>de</strong> faibles quantités <strong>de</strong><br />
montmorillonite comme renfort <strong>et</strong> ce<strong>la</strong> sans avoir recours à un traitement préa<strong>la</strong>ble du<br />
coton.<br />
La cellulose est fonctionnalisée par une réaction d’acéty<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong> montmorillonite est<br />
préparé par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> d’échange d’ions <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> bionanocomposites acétates <strong>de</strong><br />
cellulose/montmorillonites on étés préparés dans le solvant acétone.<br />
L’analyse FTIR a confirmée <strong>la</strong> présence d’argile dans les composites par l’apparition<br />
<strong>de</strong> ses ban<strong><strong>de</strong>s</strong> caractéristiques, l’analyse DRX n’a révélée aucun pic <strong>de</strong> diffraction<br />
propre à <strong>la</strong> montmrillonite, ce qui <strong>la</strong>isse à supposer que <strong>la</strong> structure est <strong>de</strong> type<br />
exfoliée.<br />
L’analyse morphologique SEM quant à elle, a permis <strong>de</strong> montrer l’homogénéité <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
matériaux préparés <strong>et</strong> nous pouvons dire qu’il y a eu une bonne interaction entre<br />
l’acétate <strong>de</strong> cellulose dissoute <strong>et</strong> l’argile, l’analyse thermogravimétrique nous a permis<br />
<strong>de</strong> tirer <strong><strong>de</strong>s</strong> conclusions quant à <strong>la</strong> dégradation <strong><strong>de</strong>s</strong> échantillons, nous pouvons dire que<br />
le processus <strong>de</strong> dégradation est ralenti par l’ajout d’argile <strong>et</strong> les résidus sont n<strong>et</strong>tement<br />
plus élevés.<br />
Figure 1 : Image SEM du bionanocomposite<br />
62
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
40<br />
35<br />
30<br />
Intensité<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
5 10 15 20 25 30<br />
2 Th<strong>et</strong>a<br />
Figure2 : Spectre DRX du bionanocomposite<br />
Mots clés : Bionanocomposites, montmorillonite, coton, acétate <strong>de</strong> cellulose<br />
63
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.4<br />
Prediction of m<strong>et</strong>allic properties for the Heusler alloys Cu 2 MnX<br />
S-I. Messaoudi, Z.Mameri, M. Ferhat<br />
Faculté <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong>, Laboratoire LEPM, Université Des <strong>Sciences</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Technologie</strong> Mohamed Boudiaf d’Oran, Ilhem_phy@hotmail.com<br />
Magn<strong>et</strong>ically driven actuator materials, such as the ternary and interm<strong>et</strong>allic<br />
Heusler alloys with composition X 2 YM, are studied within the <strong>de</strong>nsity-functional<br />
theory (DFT) with the generalized gradient approximation (GGA) for the electronic<br />
exchange and corre<strong>la</strong>tion. The geom<strong>et</strong>rical and electronic structures for the magn<strong>et</strong>ic<br />
L21 structure are calcu<strong>la</strong>ted. The structures and magn<strong>et</strong>ic moments at equilibrium are<br />
calcu<strong>la</strong>ted.<br />
Keywords: Heusler alloy; Half-m<strong>et</strong>allic; Band structure<br />
64
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.5<br />
<strong>Le</strong>s distributions du <strong>Le</strong>vy <strong><strong>de</strong>s</strong> intensités <strong><strong>de</strong>s</strong> courants dans <strong><strong>de</strong>s</strong> systèmes<br />
composites<br />
M. Mokhtari , L. Zekri<br />
USTO, Département <strong>de</strong> Physique, LEPM, BP 1505 El M’Naouar, Oran, Algérie<br />
La théorie <strong>de</strong> <strong>la</strong> perco<strong>la</strong>tion est un ancien modèle pour les systèmes désordonnés <strong>et</strong> ses<br />
transitions <strong>de</strong> phases [21], elle est étudiée par différentes métho<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>et</strong> techniques, les<br />
unes analytiques (théorie <strong>de</strong> milieu effectif, théorie <strong>de</strong> champ, <strong>et</strong>c...) <strong>et</strong> autre<br />
numériques (réseau <strong>de</strong> résistance aléatoire, simu<strong>la</strong>tion Monte Carlo…).<br />
<strong>Le</strong>s distributions du <strong>Le</strong>vy sont impliquées dans beaucoup <strong>de</strong> phénomènes physiques.<br />
<strong>Le</strong>urs caractéristiques principales sont une propagation très <strong>la</strong>rge <strong>et</strong> une longue queue.<br />
<strong>Le</strong> but <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong> est d'employer ces distributions du <strong>Le</strong>vy pour comprendre <strong>la</strong><br />
transition métal-iso<strong>la</strong>nt dans les systèmes composites. En utilisant <strong>la</strong> métho<strong>de</strong><br />
exacte(ME) basée sur <strong>la</strong> résolution <strong><strong>de</strong>s</strong> équations <strong>de</strong> Kirchhoff, nous calculons les<br />
intensités <strong><strong>de</strong>s</strong> courants à chaque point <strong>de</strong> réseau. Nous étudions les distributions<br />
d'intensités <strong><strong>de</strong>s</strong> courants pour différentes épaisseurs du système. Nous interprétons ces<br />
distributions en termes <strong>de</strong> loi du <strong>Le</strong>vy. Pour le premier <strong>et</strong> le <strong>de</strong>uxième moment<br />
diverge ceux qui nous mènent à dire qu’il existe une zone <strong>de</strong> . Après <strong>la</strong> détermination<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> nous traçons l’allure <strong>de</strong> en fonction <strong>de</strong> l’épaisseur <strong>de</strong> système.<br />
140000<br />
120000<br />
t100 f 15<br />
p=0.25<br />
100000<br />
Distribution<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
0<br />
-20000<br />
-10 -8 -6 -4 -2 0<br />
log I<br />
Figure 1 : distribution du logarithme du courant pour <strong>la</strong> taille 100 <strong>et</strong> épaisseur 15<br />
65
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
3,5<br />
3,0<br />
100x100x8<br />
100x100x15<br />
100x100x20<br />
2,5<br />
Exposant μ<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
0,24 0,26 0,28 0,30<br />
P<br />
Figure 2: Exposant µ en en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> concentration pour <strong>la</strong> taille 100 <strong>et</strong> pour<br />
différentes épaisseurs.<br />
Mots clés : perco<strong>la</strong>tion, composites, courant local, distribution <strong>de</strong> <strong>Le</strong>vy.<br />
66
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.6<br />
Nouveaux Systèmes Vitreux à Base D’oxy<strong>de</strong> D’Antimoine<br />
(0.7-x)Sb 2 O 3 -30 ZnCl 2 – x ZnBr 2<br />
F.Rahal 1 , S.Saidi 1 , R.Lakhdari 2 , M.<strong>Le</strong>gouera 2<br />
1<br />
Département <strong>de</strong> Chimie BP N°145, Université Mohamed Khi<strong>de</strong>r – Biskra, Algérie,<br />
email : fe<strong>la</strong>_78@yahoo.fr.<br />
2 Département <strong>de</strong> Génie Mécanique, Université <strong>de</strong> skikda, Algérie<br />
<strong>Le</strong> développement rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie photonique nécessite <strong>de</strong> plus en plus <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
matériaux efficaces, adaptés aux appareils photoniques tels que les matériaux pour<br />
amplificateurs <strong>et</strong> <strong>la</strong>sers <strong>de</strong> forte puissance. L’amplification optique basée sur le<br />
principe <strong>de</strong> l’eff<strong>et</strong> <strong>la</strong>ser peut être obtenue dans <strong><strong>de</strong>s</strong> matrices cristallisées ou vitreuses<br />
grâce aux émissions radiatives <strong><strong>de</strong>s</strong> ions <strong>de</strong> terres rares. <strong>Le</strong>s verres sont parmi les<br />
matrices intéressantes pour leur transparence dans une <strong>la</strong>rge région optique <strong>et</strong> pour leur<br />
aptitu<strong>de</strong> à recevoir <strong>de</strong> gran<strong><strong>de</strong>s</strong> quantités d’ions <strong>de</strong> terres rares. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, Une<br />
nouvelle famille <strong>de</strong> verres stables d’oxy<strong>de</strong> <strong>et</strong> d’halogénures dans les systèmes ternaires<br />
Sb 2 O 3 -ZnCl 2 -ZnBr 2 a été mise au point. Plusieurs caractérisations ont été faites sur<br />
<strong>de</strong>ux systèmes ternaires. L’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés évolue presque linéairement avec<br />
<strong>la</strong> variation <strong>de</strong> <strong>la</strong> composition. <strong>Le</strong>s résultats obtenus sont simi<strong>la</strong>ires à ceux <strong><strong>de</strong>s</strong> autres<br />
travaux. Il apparaît que <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> ces verres est plus ouverte d’où les faibles<br />
valeurs <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés mécaniques. L’analyse calorimétrique différentielle a montré<br />
que certaines compositions ne présentent pas <strong>de</strong> pics <strong>de</strong> cristallisation d’où leur gran<strong>de</strong><br />
stabilité thermique.<br />
Mots clés : Verres, L’amplification optique, La transparence, terres rares, L’analyse<br />
calorimétrique différentielle.<br />
67
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.7<br />
Etu<strong>de</strong> électrochimique sur le comportement corrosif <strong><strong>de</strong>s</strong> aciers <strong><strong>de</strong>s</strong> gazoducs <strong>de</strong><br />
SONATRACH.<br />
M. Hadjel*, A.Benmoussat**<br />
*University of Science and Technology of ORAN - Mohamed Boudiaf. Faculty of<br />
Science. Department of Chemistry. LSTGP, B.P. 1505 ORAN 31000-Algeria E mail:<br />
hadjel@univ-usto.dz<br />
**Faculté <strong><strong>de</strong>s</strong> sciences <strong>de</strong> l’ingénieur Université Abou Bekr Belkaïd, Tlemcen<br />
<strong>Le</strong>s réseaux <strong>de</strong> transport <strong><strong>de</strong>s</strong> hydrocarbures particulièrement <strong>de</strong> gaz naturel, sont <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
ouvrages perm<strong>et</strong>tant l’alimentation en continu. Par conséquent, <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> vie <strong>et</strong> <strong>la</strong><br />
sécurité <strong>de</strong> ces ouvrages sont <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres importants pour assurer <strong>la</strong> continuité <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
opérations <strong>de</strong> distributions.<br />
<strong>Le</strong>s défail<strong>la</strong>nces <strong>de</strong> l’acier qui peuvent se développer en surface sont principalement<br />
les pics <strong>de</strong> corrosion ou les fissures suivant un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> dégradation complexe<br />
caractérisée par une dégradation <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> surface <strong>de</strong> l’acier <strong>et</strong> l’apparition <strong>de</strong> pics<br />
<strong>de</strong> corrosion à <strong><strong>de</strong>s</strong> profon<strong>de</strong>urs différentes ou réparties en surface.<br />
Ces phénomènes sont préoccupants dans le transport par canalisation particulièrement<br />
dans les industries pétrolières <strong>et</strong> dans les <strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> recherche. <strong>Le</strong><br />
développement <strong><strong>de</strong>s</strong> métho<strong><strong>de</strong>s</strong> d'évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> défail<strong>la</strong>nces par corrosion par une<br />
estimation du taux <strong>de</strong> corrosion <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> vie utilitaire restante perm<strong>et</strong>tra<br />
également <strong>de</strong> définir les critères <strong>de</strong> réhabilitation <strong><strong>de</strong>s</strong> tubes corrodés <strong>et</strong> principalement<br />
par <strong><strong>de</strong>s</strong> nouveaux matériaux ignifuges.<br />
L’étu<strong>de</strong> portera non seulement sur les interactions électrochimiques <strong>de</strong> corrosion <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
aciers dans les milieux corrosifs par analyse électrochimiques stationnaires (courbes<br />
<strong>de</strong> po<strong>la</strong>risation) <strong>et</strong> transitoires (spectroscopie d’impédance électrochimique), mais<br />
également sur l’évaluation du taux <strong>de</strong> corrosion en utilisant l'outil statistique, les<br />
modèles <strong>de</strong> calculs <strong>et</strong> <strong>la</strong> tendance <strong>de</strong> l’approche probabiliste.<br />
L'objectif recherché <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te évaluation est <strong>la</strong> réhabilitation <strong>de</strong> l'acier <strong>de</strong> pipelines<br />
en vue <strong>de</strong> sa réutilisation aux mêmes conditions d'exploitation, c'est à dire à <strong>la</strong> même<br />
PMS (Pression maximale <strong>de</strong> service), afin <strong>de</strong> réduire les coûts <strong>de</strong> maintenance <strong>et</strong><br />
d'exploitation.<br />
Dans ce travail <strong><strong>de</strong>s</strong> investigations ont été menés par <strong><strong>de</strong>s</strong> enquêtes sur les pipelines<br />
corrodés au près <strong>de</strong> STT - SONATRACH (DRC) à B<strong>et</strong>hioua (ORAN), par <strong><strong>de</strong>s</strong> essais<br />
aux différents <strong>la</strong>boratoires LPCMCE- Oran ' Algérie <strong>et</strong> (PERF) - ENSCL <strong>de</strong> Lille<br />
(France).Ce travail a fait l'obj<strong>et</strong> d'un proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> recherche CNEPRU E 01920060041 <strong>et</strong><br />
d'une thèse <strong>de</strong> doctorat en cours. L'étu<strong>de</strong> n’étant pas encore finalisé, d'autres travaux<br />
sont en cours. Ils vont perm<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> mieux comprendre ces phénomènes<br />
d’endommagement par corrosion <strong>et</strong> d’évaluer le taux <strong>de</strong> corrosion <strong><strong>de</strong>s</strong> pipes corrodés<br />
par simu<strong>la</strong>tion par une étu<strong>de</strong> en fiabilité <strong>et</strong> <strong>la</strong> proposition d'une meilleure protection<br />
68
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> gazoducs contre <strong>la</strong> corrosion <strong>et</strong> le feu par <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> nouveaux matériaux ignifuges<br />
respectant <strong>la</strong> réglementation <strong>et</strong> l’environnement.<br />
Mots clés : corrosion – gazoducs – électrochimie - aciers API -5L- X60 -<br />
environnement. Matériaux ignifuges.<br />
69
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.8<br />
Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation en fréquence <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité d'un mé<strong>la</strong>nge<br />
métal/diélectrique au seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion pour <strong><strong>de</strong>s</strong> fréquences proches <strong>de</strong> DC<br />
F.Chari <strong>et</strong> N.Zekri<br />
Laboratoire d’étu<strong>de</strong> Physique <strong><strong>de</strong>s</strong> Matériaux, Département <strong>de</strong> physique, USTO-MB,<br />
BP1505 EL M’naouar, Oran, Algérie. fai.chari@gmail.com<br />
La transition <strong>de</strong> phase non conducteur/conducteur d'un composite métal-iso<strong>la</strong>nt<br />
représentée par un réseau RC soumis à un courant continu, a bien été caractérisée aussi<br />
bien pour <strong><strong>de</strong>s</strong> systèmes 2D que pour <strong><strong>de</strong>s</strong> dimensions supérieures. Ainsi, le seuil <strong>de</strong><br />
perco<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> les exposants critiques ont été estimés [1].<br />
Lorsque le système est soumis à un courant variable, l'iso<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>vient conducteur <strong>et</strong> le<br />
mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong>vient aussi conducteur. L'objectif <strong>de</strong> ce travail est d'étudier le<br />
comportement <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité du système pour <strong><strong>de</strong>s</strong> fréquences proches <strong>de</strong> DC afin<br />
d'examiner <strong>la</strong> transition non conducteur/conducteur lorsque <strong>la</strong> fréquence <strong>de</strong>vient non<br />
nulle. Une attention particulière sera portée à <strong>la</strong> disparition <strong><strong>de</strong>s</strong> liens critiques dans ce<br />
cas [2]. C<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong> sera ensuite étendue à <strong><strong>de</strong>s</strong> mé<strong>la</strong>nges non conducteurs (en <strong><strong>de</strong>s</strong>sous<br />
du seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion). Ces calculs <strong><strong>de</strong>s</strong>tinés à déterminer les propriétés diélectriques<br />
d’un composite pour <strong>de</strong> faibles fréquences, sera appliqué aux végétations qui sont<br />
aussi <strong><strong>de</strong>s</strong> composites diélectriques (eau)-conducteur (<strong>la</strong> partie non liqui<strong>de</strong>). <strong>Le</strong> calcul<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés diélectriques dans ce cas revient à extraire les compositions du végétal,<br />
très importants dans le cas <strong>de</strong> pyrolyse en présence d’un feu.<br />
1E-4<br />
log σ ∋ (Ω −1 )<br />
1E-5<br />
1000<br />
700<br />
500<br />
100<br />
46<br />
312<br />
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0<br />
log fréq w (Hz)<br />
Figure (1) ; <strong>la</strong> partie réelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité en fonction <strong>de</strong> fréquence pour différente taille <strong>de</strong><br />
réseau.<br />
70
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
0,0007<br />
0,0006<br />
0,0005<br />
1000<br />
700<br />
500<br />
312<br />
100<br />
46<br />
0,0004<br />
-σ ∋∋ (Ω −1 )<br />
0,0003<br />
0,0002<br />
0,0001<br />
0,0000<br />
0,0000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007<br />
σ ∋ ( Ω -1 )<br />
Figure (2) : Diagramme <strong>de</strong> Cole&Cole <strong>la</strong> variation <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie imaginaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité en<br />
fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie réelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> conductivité.<br />
Mots clés : perco<strong>la</strong>tion, composites, réseau RC.<br />
References<br />
[1] D. Stauffer ET A. Aharoni, Introduction to perco<strong>la</strong>tion theory, Taylor and Francis,<br />
London, 1991.<br />
[2] J.P.Clerc, L.Zekri, N.Zekri, Statistical and the finite size scaling behavior of the red<br />
bonds near the perco<strong>la</strong>tion threshold, Physics <strong>Le</strong>tters A Vol 338 (2005) 169-174.<br />
71
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.9<br />
Modélisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> spectroscopie d’impédance par un réseau électrique RC pour<br />
détecter <strong>la</strong> position d’un diélectrique dans une composite métal-diéléctrique<br />
G. Benab<strong>de</strong>l<strong>la</strong>h ET N. Zekri<br />
Laboratoire aboratoire d'Etu<strong>de</strong> Physique <strong><strong>de</strong>s</strong> Matériaux, USTO MB, département <strong>de</strong><br />
Physique, LEPM, BP 1505 El M’Naouar, Oran, Algerie .* e-mail :<br />
abedgh20@yahoo.fr<br />
Dans notre modélisation, Nous avons utilisé <strong>la</strong> technique <strong>de</strong> <strong>la</strong> spectroscopie<br />
d’impédance pour détecter <strong>la</strong> taille <strong>et</strong> <strong>la</strong> position d’un diélectrique dans une couche<br />
mince métal-diélectrique. L’analyse est faite à partir <strong><strong>de</strong>s</strong> fréquences <strong>de</strong> re<strong>la</strong>xation du<br />
système, <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie imaginaire <strong>et</strong> réelle <strong>de</strong> l’impédance complexe <strong>de</strong> ce matériau.<br />
Ces systèmes sont modélisés par un réseau carré <strong><strong>de</strong>s</strong> impédances RC. L’impédance<br />
totale équivalente du système est calculée par une métho<strong>de</strong> exacte basée sur les lois <strong>de</strong><br />
Kirchhoff. Nous avons montré que <strong>la</strong> fréquence <strong>de</strong> re<strong>la</strong>xation <strong>et</strong> <strong>la</strong> partie imaginaire<br />
sont dépen<strong>de</strong>nt à <strong>la</strong> taille <strong>et</strong> à <strong>la</strong> position <strong>de</strong> diélectrique.<br />
Fig. 1. Impédance effective en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fréquence pour plusieurs tailles <strong>de</strong> l'amas iso<strong>la</strong>nt au<br />
centre <strong>de</strong> système.<br />
72
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
Fig. 2. La partie imaginaire <strong>de</strong> l'impédance effective en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fréquence pour plusieurs tailles <strong>de</strong> l'amas iso<strong>la</strong>nt au centre <strong>de</strong> système.<br />
Fig. 4. <strong>la</strong> variation <strong>de</strong> <strong>la</strong> fréquence <strong>de</strong><br />
re<strong>la</strong>xation en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> position <strong>de</strong><br />
diélectrique<br />
Mots clés : spectroscopie d’impédance, fréquence <strong>de</strong> re<strong>la</strong>xation, diélectrique<br />
73
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
P.5.10<br />
Modélisation <strong><strong>de</strong>s</strong> transferts <strong>de</strong> chaleur <strong>et</strong> <strong>de</strong> masse dans les poudres en projection<br />
thermique<br />
M.Ab<strong>de</strong>louahab, A.Nourreddin, A.Aissa<br />
Laboratoire <strong>de</strong> physique énergétique <strong>et</strong> environnement, Département <strong>de</strong> physique<br />
Université <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Sciences</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Technologie</strong> d’Oran Email: aissa86@gmail0com<br />
Ce travail concerne l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> matériaux par dépôts <strong>de</strong> gouttes métalliques On<br />
s’intéresse aux échanges entre le gaz p<strong>la</strong>smagène <strong>et</strong> <strong>la</strong> particule. En eff<strong>et</strong> en projection<br />
p<strong>la</strong>sma, <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux métalliques sont proj<strong>et</strong>és à grand vitesse, dans un état fondu ou<br />
semi fondu sur substrats préa<strong>la</strong>blement préparés. <strong>Le</strong> p<strong>la</strong>sma perm<strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> températures<br />
élevées (6000 à 12000 °K) qui assurent <strong>la</strong> fusion <strong><strong>de</strong>s</strong> particules <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux les plus<br />
réfractaires.<br />
La vitesse d’impact <strong><strong>de</strong>s</strong> gouttes est élevée <strong>et</strong> il est difficile <strong>de</strong> décrire leur<br />
comportement à l’impact sur le substrat. De façon certaine le comportement à<br />
l’impact est directement influencé par l’histoire thermique <strong>et</strong> dynamique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
particule. Ce comportement dynamique est décrit par <strong><strong>de</strong>s</strong> simu<strong>la</strong>tions pour évaluer<br />
indépendamment l’écoulement axisymétrique statique du j<strong>et</strong> <strong>de</strong> p<strong>la</strong>sma <strong>et</strong> le<br />
comportement <strong>de</strong> <strong>la</strong> particule injectée au sein <strong>de</strong> celle-ci.<br />
Figure I-1: Principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> projection p<strong>la</strong>sma d’arc <strong>et</strong> ses principaux sous-systèmes Fonctionnels.<br />
74
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
O.5.11<br />
Etu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> fluctuations du champ local d'un composite métal-diélectrique près du<br />
seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion.<br />
B.Bencherif <strong>et</strong> L.Zekri<br />
Laboratoire d’Etu<strong>de</strong> Physique <strong><strong>de</strong>s</strong> Matériaux, U S TOran, Département <strong>de</strong> Physique,<br />
BP 1505 El M’naouar<br />
Nous présentons un travail sur l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> seuils critiques dans les systèmes<br />
binaires entre <strong>de</strong>ux <strong>et</strong> trois dimensions représentant <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux composites <strong>de</strong><br />
différentes épaisseurs en nombre <strong>de</strong> couches (systèmes réelles). Ce travail a été très<br />
peu étudié théoriquement car les données sont concentrées soit à <strong>de</strong>ux dimensions<br />
représentant <strong><strong>de</strong>s</strong> couches minces ou trois dimensions correspondant à <strong><strong>de</strong>s</strong> corps épais.<br />
En outre, les seuils <strong>et</strong> exposants critiques sont connus à <strong>la</strong> limite thermodynamique, or<br />
les expériences sont réalisées sur <strong><strong>de</strong>s</strong> systèmes <strong>de</strong> taille finie, ce qui ne perm<strong>et</strong>tait pas<br />
d’observer le seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion jusqu’à présent.<br />
Après une étu<strong>de</strong> statistique réalisée sur plusieurs centaines d’échantillons, Nous<br />
montrons principalement <strong>et</strong> en utilisant trois différentes métho<strong><strong>de</strong>s</strong> que le seuil <strong>de</strong><br />
perco<strong>la</strong>tion décroît fortement dès que l’épaisseur du système commence à augmenter<br />
(un nombre <strong>de</strong> couches faibles), <strong>et</strong> se stabilise à <strong>la</strong> valeur 3d bien avant que le système<br />
atteigne sa forme cubique.<br />
D’autres résultats concernant les fluctuations du champ local <strong>et</strong> l’analogie avec les<br />
liens critiques sont discutés.<br />
0,36<br />
0,34<br />
0,32<br />
Pc<br />
0,30<br />
0,28<br />
0,26<br />
0 5 10 15 20<br />
nbrf<br />
Figure 3 : le seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion en fonction du nombre <strong>de</strong> couche pour les tailles 60 (cercle),70<br />
(carré) , 80(triangle), 100(losange).<br />
75
STOP FEU, Oran 2010 Posters Thème V<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
PP<br />
0,4<br />
0,2<br />
taille 60x60x3<br />
taille 60x60x5<br />
taille 60x60x8<br />
0,0<br />
0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38<br />
concentration p<br />
Figure 4 : La probabilité <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion PP en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> concentration p<br />
Mots clés : perco<strong>la</strong>tion, composites, champ local, réseau RC<br />
76
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
Quelques<br />
lectures invitées<br />
77
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
ETiC : un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> recherche commun sur <strong>la</strong> combustion <strong>et</strong> l’incendie en<br />
milieu confiné<br />
Bernard Porterie <strong>et</strong> Laurence Rigoll<strong>et</strong><br />
EPUM/ IUSTI Marseille IRSN, Cadarache<br />
Fruit <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borations établies <strong>de</strong> longue date entre l'IRSN, le CNRS <strong>et</strong> les Universités d'Aix-<br />
Marseille I & II, le <strong>la</strong>boratoire ETiC (l’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'incendie en milieu confiné ) perm<strong>et</strong>tra <strong>de</strong><br />
conduire les recherches nécessaires pour apprécier les risques liés aux activités nucléaires <strong>et</strong><br />
industrielles. Il perm<strong>et</strong>tra également d'atteindre une taille critique <strong>de</strong> compétences pour abor<strong>de</strong>r<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> thématiques <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> complexité <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre en œuvre les techniques les plus avancées <strong>de</strong><br />
simu<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> d'expérimentation pour faire progresser <strong>la</strong> sûr<strong>et</strong>é. Au-<strong>de</strong>là, c<strong>et</strong>te coopération<br />
exemp<strong>la</strong>ire <strong><strong>de</strong>s</strong> équipes contribue à resserrer les liens entre les organismes au bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
recherche <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation par <strong>la</strong> recherche. Associer <strong><strong>de</strong>s</strong> compétences complémentaires,<br />
bâtir <strong>et</strong> gérer en commun <strong><strong>de</strong>s</strong> outils <strong>de</strong> modélisation <strong>et</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion, diffuser <strong>la</strong> connaissance<br />
<strong>et</strong> le savoir-faire acquis pour un cas spécifique, établir un dialogue interdisciplinaire, sont <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
approches éprouvées pour appliquer <strong><strong>de</strong>s</strong> connaissances fondamentales à <strong><strong>de</strong>s</strong> problématiques<br />
appliquées.<br />
Au p<strong>la</strong>n scientifique, son objectif est <strong>de</strong> comprendre, modéliser <strong>et</strong> prédire le comportement<br />
d’un incendie en milieu confiné <strong>et</strong> ventilé, caractéristique <strong><strong>de</strong>s</strong> instal<strong>la</strong>tions nucléaires <strong>et</strong><br />
industrielles. Dans <strong>la</strong> communauté scientifique, un élément qui fait consensus est <strong>la</strong> difficulté à<br />
modéliser <strong>et</strong> à évaluer <strong>la</strong> source combustible, en termes <strong>de</strong> puissance, <strong>de</strong> production <strong>de</strong> suies <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> débit <strong>de</strong> pyrolyse. Une difficulté qui s’accentue lorsque le feu se développe en atmosphère<br />
sous-oxygénée. Ces problèmes sont abordés dans le cadre d’ETIC au travers <strong>de</strong> quatre<br />
thématiques scientifiques dans une démarche couplée d’analyse expérimentale m<strong>et</strong>tant en<br />
œuvre <strong><strong>de</strong>s</strong> techniques <strong>de</strong> mesures avancées, <strong>de</strong> modélisation <strong>et</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion numérique : (1)<br />
étu<strong>de</strong> du mouvement <strong><strong>de</strong>s</strong> fumées, (2) combustion en conditions d’incendie, (3) développement<br />
d’instrumentation dédiée aux interactions incendie-paroi <strong>et</strong> (4) développement <strong>de</strong> modèles à<br />
champs.<br />
De par leur caractère générique, les thèmes scientifiques abordés dans le cadre du <strong>la</strong>boratoire<br />
ETiC, <strong>et</strong> les outils qui leur sont associés, ouvrent <strong>la</strong> voie à <strong><strong>de</strong>s</strong> r<strong>et</strong>ombées dans <strong><strong>de</strong>s</strong> domaines du<br />
« hors-nucléaire », comme les feux en milieux urbains, industriels <strong>et</strong> naturels, <strong>la</strong> caractérisation<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux, ou le développement d’outils prédictifs <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion numérique.<br />
Thèmes scientifiques du <strong>la</strong>boratoire ETiC<br />
L’analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> compétences existantes <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> développements nécessaires à <strong>la</strong> conduite <strong>de</strong> ce<br />
proj<strong>et</strong> perm<strong>et</strong> d’i<strong>de</strong>ntifier quatre gran<strong><strong>de</strong>s</strong> thématiques scientifiques.<br />
1. Mouvement <strong><strong>de</strong>s</strong> fumées d’incendie<br />
Ce thème concerne les écoulements <strong>de</strong> fumées d’incendie dans une instal<strong>la</strong>tion caractéristique<br />
<strong>de</strong> l’industrie nucléaire comportant plusieurs locaux connectés par <strong><strong>de</strong>s</strong> ouvertures <strong>et</strong> ventilés<br />
mécaniquement. Dans le cadre <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>et</strong> recherches sur l’incendie, <strong>la</strong> propagation <strong>et</strong> le<br />
contrôle <strong><strong>de</strong>s</strong> fumées constitue une thématique à part entière. C<strong>et</strong>te thématique s’inscrit<br />
pleinement dans <strong>la</strong> démarche ISI (Ingénierie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sécurité Incendie) entreprise actuellement en<br />
France, démarche qui vise à améliorer <strong>la</strong> sécurité <strong><strong>de</strong>s</strong> biens <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes en proposant <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
solutions (notamment sur le désenfumage <strong>et</strong> le pilotage <strong>de</strong> <strong>la</strong> venti<strong>la</strong>tion) al<strong>la</strong>nt bien au-<strong>de</strong>là<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> préconisations issues <strong><strong>de</strong>s</strong> référentiels réglementaires. Si l’approche ingénierie se base<br />
essentiellement sur l’utilisation d’outils <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion (co<strong><strong>de</strong>s</strong> à champs voire co<strong><strong>de</strong>s</strong> à zones),<br />
les expérimentations (sur site <strong>et</strong> en <strong>la</strong>boratoire) associées à une approche théorique restent<br />
indispensables pour améliorer l’état <strong><strong>de</strong>s</strong> connaissances, tant sur le p<strong>la</strong>n qualitatif<br />
(compréhension <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong>cription <strong><strong>de</strong>s</strong> phénomènes) que sur le p<strong>la</strong>n quantitatif (collecte <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
78
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
données pour l’amélioration <strong><strong>de</strong>s</strong> modèles utilisés dans co<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> calculs). C’est dans c<strong>et</strong>te<br />
optique que sont définis, suivant trois axes, les objectifs <strong>et</strong> les enjeux <strong>de</strong> ce thème <strong>de</strong> recherche.<br />
<strong>Le</strong> premier axe concerne l’approche théorique <strong>et</strong> <strong>la</strong> modélisation expérimentale <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
écoulements <strong>de</strong> fumées sur <strong><strong>de</strong>s</strong> dispositifs à p<strong>et</strong>ite échelle en <strong>la</strong>boratoire. L’approche r<strong>et</strong>enue<br />
consistera à utiliser un mé<strong>la</strong>nge gazeux léger (air/hélium ou azote /hélium) pour simuler les<br />
fumées. Une réflexion sera d’abord menée pour définir c<strong>la</strong>irement les lois <strong>de</strong> similitu<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
perm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> transposer les résultats vers <strong>la</strong> pleine échelle. Des tests seront ensuite entrepris<br />
pour étudier le remplissage d’un local par un panache (c’est-à-dire le développement d’un<br />
panache dans un environnement stratifié) puis les écoulements entre locaux via <strong><strong>de</strong>s</strong> ouvertures<br />
type porte, gaine ou trappe. <strong>Le</strong>s résultats obtenus perm<strong>et</strong>tront d’affiner les modèles utilisés<br />
dans les co<strong><strong>de</strong>s</strong> à zones.<br />
<strong>Le</strong> <strong>de</strong>uxième axe concerne l’application <strong>de</strong> métho<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> mesures non-intrusives perm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong><br />
mesurer <strong><strong>de</strong>s</strong> champs <strong>de</strong> vitesse <strong>et</strong> <strong>de</strong> turbulence (LDV <strong>et</strong> PIV) <strong>et</strong> les concentrations (PLIF) dans<br />
les écoulements à masse volumique variable ainsi qu’au sein <strong>de</strong> fumées d’incendie en<br />
écoulement. Ce travail sera mené dans un premier temps à p<strong>et</strong>ite échelle (en <strong>la</strong>boratoire) dans<br />
une optique <strong>de</strong> mise au point avant d’être appliqué à <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> échelle notamment dans les<br />
instal<strong>la</strong>tions du LEF. Il fournira une base <strong>de</strong> données pour <strong>la</strong> qualification <strong><strong>de</strong>s</strong> co<strong><strong>de</strong>s</strong> à champ.<br />
Enfin, le troisième axe vise à utiliser les expérimentations, à p<strong>et</strong>ite <strong>et</strong> gran<strong>de</strong> échelles, pour<br />
collecter <strong><strong>de</strong>s</strong> données utiles à l’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> sous-modèles <strong>de</strong> turbulence dans les co<strong><strong>de</strong>s</strong> à<br />
champ. En eff<strong>et</strong>, pour <strong><strong>de</strong>s</strong> écoulements turbulents principalement gouvernés par les forces <strong>de</strong><br />
flottabilité, <strong>la</strong> pertinence <strong>de</strong> certains sous-modèles reste un problème ouvert.<br />
2. Combustion en conditions d’incendie<br />
Un incendie qui se déc<strong>la</strong>re dans une instal<strong>la</strong>tion nucléaire, dont une <strong><strong>de</strong>s</strong> caractéristiques est<br />
d’être étanche, peut conduire à <strong><strong>de</strong>s</strong> feux sous-ventilés. Il s’en suit généralement un<br />
accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> production globale <strong>de</strong> suie du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> viciation du milieu ambiant. Ceci<br />
modifie en r<strong>et</strong>our <strong>la</strong> rétroaction du rayonnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> f<strong>la</strong>mme vers le matériau combustible <strong>et</strong><br />
donc influence le processus <strong>de</strong> pyrolyse.<br />
Ce problème constitue à l’heure actuelle un défi <strong>de</strong> recherche majeur pour <strong>la</strong> prédiction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
puissance du feu <strong>et</strong> donc <strong>de</strong> son développement. Par ailleurs, les propriétés radiatives <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
f<strong>la</strong>mme, <strong>et</strong> donc son potentiel à agresser thermiquement les éléments <strong>de</strong> sûr<strong>et</strong>é voisins, sont<br />
directement reliés à <strong>la</strong> teneur en suie <strong>et</strong> à ses propriétés radiatives.<br />
L’objectif <strong>de</strong> ce thème est d’étudier les eff<strong>et</strong>s d’une atmosphère contrôlée sur <strong>la</strong> production <strong>de</strong><br />
suie pour <strong><strong>de</strong>s</strong> f<strong>la</strong>mmes d’incendie <strong>et</strong> sur <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> pyrolyse du combustible. <strong>Le</strong>s enjeux<br />
scientifiques <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te thématique, sur lesquels <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration IRSN-IUSTI apporte une forte<br />
valeur ajoutée, sont <strong>de</strong>:<br />
- mieux appréhen<strong>de</strong>r les eff<strong>et</strong>s du niveau d’oxygène ambiant sur <strong>la</strong> production <strong>de</strong> suie <strong>et</strong><br />
le débit <strong>de</strong> pyrolyse, tout d’abord à p<strong>et</strong>ite échelle à l’IUSTI (Fire Propagation<br />
Apparatus) <strong>et</strong> ensuite à échelle intermédiaire au LEF ;<br />
- é<strong>la</strong>borer <strong>et</strong>/ou vali<strong>de</strong>r <strong><strong>de</strong>s</strong> modèles <strong>de</strong> production <strong>de</strong> suies à partir <strong>de</strong> ces données<br />
expérimentales.<br />
79
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
3. Développement d’instrumentation dédiée à l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> interactions incendie paroi<br />
Lors d’un incendie dans une enceinte fermée, plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaleur dégagée par le feu<br />
est transférée aux parois. <strong>Le</strong> transfert <strong>de</strong> chaleur par conduction aux parois est une thématique<br />
<strong>de</strong> recherche importante pour <strong>la</strong> compréhension du déroulement <strong>de</strong> l’incendie. La mesure <strong>de</strong><br />
flux <strong>de</strong> chaleur est en particulier utilisée pour évaluer les bi<strong>la</strong>ns énergétiques au sein d’un local,<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong> ce fait pour estimer <strong>la</strong> puissance du feu. L’interaction entre l’incendie <strong>et</strong> <strong>la</strong> paroi<br />
provoque une modification <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés thermo-physiques <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux : calcination,<br />
fissures, modification du contact fer-béton. Dans le cadre <strong><strong>de</strong>s</strong> recherches expérimentales sur<br />
l’incendie, les difficultés soulevées par l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> transferts <strong>de</strong> chaleur sont notamment :<br />
- le caractère agressif <strong>de</strong> <strong>la</strong> source <strong>de</strong> chaleur (f<strong>la</strong>mme, combustion, rayonnement, suies),<br />
- le caractère instationnaire <strong>et</strong> transitoire <strong><strong>de</strong>s</strong> mécanismes <strong>de</strong> transfert,<br />
- les limites <strong><strong>de</strong>s</strong> capteurs actuels (niveau <strong>de</strong> température, eff<strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> fumées),<br />
- <strong>la</strong> nature inhomogène <strong><strong>de</strong>s</strong> parois <strong>et</strong> <strong>la</strong> variation <strong>de</strong> ses propriétés physico-chimiques<br />
dans le temps.<br />
L’objectif <strong><strong>de</strong>s</strong> travaux menés dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration dans ce thème est <strong>de</strong> développer<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> métho<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> traitement <strong><strong>de</strong>s</strong> mesures obtenues lors <strong><strong>de</strong>s</strong> essais incendies. Ces travaux basés<br />
sur l’instrumentation mise en œuvre lors <strong><strong>de</strong>s</strong> expérimentations « feux » perm<strong>et</strong>tent d’améliorer<br />
le traitement <strong>de</strong> l’information <strong>et</strong> <strong>de</strong> diminuer l’incertitu<strong>de</strong> liée à l’estimation <strong><strong>de</strong>s</strong> gran<strong>de</strong>urs<br />
recherchées. Il est ainsi possible <strong>de</strong> dégager <strong><strong>de</strong>s</strong> synergies entre les <strong>la</strong>boratoires DPAM <strong>et</strong><br />
l’IUSTI en ce qui concerne notamment l’étalonnage <strong>de</strong> capteurs <strong>et</strong> le développement <strong>de</strong><br />
métrologie dédiée à l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> l’incendie sur les parois. Un exemple <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te<br />
synergie se traduit par <strong>la</strong> mise au point d’un nouveau concept <strong>de</strong> fluxmètre basé sur <strong>la</strong><br />
résolution d’un problème inverse <strong>de</strong> conduction <strong>de</strong> chaleur qui, à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong><br />
températures, perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> déterminer les flux <strong>de</strong> chaleur entrant dans une paroi. L’originalité du<br />
concept est <strong>de</strong> perm<strong>et</strong>tre à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’instrument <strong>de</strong> suivre l’évolution périodique <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés<br />
thermo-physiques <strong><strong>de</strong>s</strong> composants face incendie. L’enjeu <strong>de</strong> ce thème est d’é<strong>la</strong>borer un<br />
prototype <strong>de</strong> capteur semi industrialisable qui sera testé lors d’essais <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire puis<br />
d’essais dans <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions réelles dans l’instal<strong>la</strong>tion DIVA <strong>de</strong> <strong>la</strong> DPAM.<br />
4. Développement <strong>de</strong> modèles à champ<br />
<strong>Le</strong>s modèles à champ <strong><strong>de</strong>s</strong>tinés à étudier le comportement <strong><strong>de</strong>s</strong> feux sont apparus aux milieux<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> années 80. La difficulté <strong>de</strong> telles modélisations rési<strong>de</strong> dans les coup<strong>la</strong>ges complexes<br />
existant entre l’écoulement turbulent contrôlé par les forces <strong>de</strong> flottabilité, <strong>la</strong> pyrolyse <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
matériaux combustibles, <strong>la</strong> combustion en phase gazeuse, <strong>la</strong> formation <strong><strong>de</strong>s</strong> fumées, le<br />
rayonnement, <strong>et</strong> les interactions entre le foyer principal <strong>et</strong> le milieu environnant (parois,<br />
venti<strong>la</strong>tion forcée ou naturelle, cible, <strong>et</strong>c.). Malgré les avancées notables effectuées durant les<br />
vingt <strong>de</strong>rnières années, <strong><strong>de</strong>s</strong> problèmes fondamentaux subsistent.<br />
80
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
L’IUSTI <strong>et</strong> <strong>la</strong> DPAM développent <strong><strong>de</strong>s</strong> co<strong><strong>de</strong>s</strong> CFD complémentaires :<br />
- le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> recherche SAFIR <strong>de</strong> l’IUSTI,<br />
- le co<strong>de</strong> ISISS <strong>de</strong> <strong>la</strong> DPAM, qui est<br />
en open source, a pour vocation d’être utilisé par <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
organismes <strong>de</strong> recherche <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> industriels. Il contientt les modélisations développées<br />
par les universitaires <strong>et</strong><br />
chercheurs.<br />
Une connaissance<br />
précise <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitesse à <strong>la</strong>quelle les matériaux se dégra<strong>de</strong>nt <strong>et</strong> libèrent les<br />
produits<br />
combustibles gazeux<br />
qui vont<br />
générer <strong>la</strong> f<strong>la</strong>mme est nécessaire pour prédire le<br />
développement d’un feu. La<br />
pyrolyse reste difficile à prédire dans <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions réelles<br />
d’incendie. Pour <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux <strong>de</strong> type thermop<strong>la</strong>stiques, qui en première approche<br />
peuvent<br />
être assimilés à <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
liqui<strong><strong>de</strong>s</strong>, une col<strong>la</strong>boration entree l’IRSN <strong>et</strong> l’IUSTI menée dans le<br />
cadre <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> thèse <strong>de</strong> Yannick<br />
Pizzo, a permis d’apporter une solution re<strong>la</strong>tivement simple dans<br />
le cas <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> propagation <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme assistée par <strong>la</strong> gravité, <strong>la</strong> pyrolyse étant relié à un<br />
nombre <strong>de</strong><br />
transfert<br />
<strong>de</strong> masse déterminé expérimentalement.<br />
L’extension <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te approche à <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux plus<br />
complexes (matériaux composites, cellulosiquess ou formant une couche <strong>de</strong><br />
résidus<br />
charbonneux) semble difficile. La pyrolyse dépend alors non seulement <strong><strong>de</strong>s</strong> sollicitations<br />
thermiques du milieu environnant sur le combustible soli<strong>de</strong>, mais également <strong><strong>de</strong>s</strong> processus<br />
physico-chimiques<br />
complexes<br />
liés à sa dégradation. Des modèles <strong>de</strong> dégradation<br />
é<strong>la</strong>borés<br />
existentt déjà, prenant en compte une cinétique à une ou plusieurs étapes ainsii que les<br />
écoulements à travers <strong>la</strong> matrice soli<strong>de</strong>. <strong>Le</strong>s paramètres d’entrée <strong>de</strong> ces<br />
sous-modèles sont<br />
souvent<br />
difficiles à estimer. Une détermination précise <strong>de</strong> ces paramètres<br />
peut être obtenue à<br />
l’ai<strong>de</strong> d’algorithme<br />
d’optimisation (algorithme génétique par exemple) <strong>et</strong> <strong>de</strong> tests standards<br />
adaptés (FPA). La procédure d’optimisation consiste à introduire le modèle <strong>de</strong> pyrolyse dans<br />
un co<strong>de</strong><br />
à champ (ISIS ou SAFIR) <strong>et</strong> à extraire l’ensemble<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres du modèle qui<br />
minimise l’écart avec l’expérience. La validation à plus gran<strong>de</strong><br />
échelle se<br />
fera dans les locaux<br />
<strong>de</strong> l’IRSN (futur dispositif du LEF) <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’IUSTI (futur tunnel <strong>de</strong> feu).<br />
La rétroaction du rayonnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> f<strong>la</strong>mme vers le matériau combustible est aussi un<br />
problème fondamental. <strong>Le</strong>s produits <strong>de</strong> pyrolyse libérés à <strong>la</strong> surface du combustible<br />
génèrent<br />
une f<strong>la</strong>mme dont une partie du<br />
rayonnement revient sur c<strong>et</strong>te surface. C’est ce flux radiatif qui<br />
pilote principalement <strong>la</strong> pyrolyse. Une<br />
bonne prédiction du rayonnement nécessite non<br />
seulement <strong>de</strong> connaître les concentrations en produits <strong>de</strong> combustion<br />
<strong>et</strong> en suies, mais<br />
également <strong>de</strong> résoudre précisément l’équation <strong>de</strong> transfert radiatif (ETR). Des métho<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong><br />
résolution <strong>de</strong> l’ETR robustess <strong>et</strong> précises ont été incorporées<br />
dans les modèles CFD. Deux<br />
difficultés majeures subsistent : prendre en compte, d’une part, <strong>la</strong> nature spectrale du<br />
rayonnement <strong>et</strong>, d’autre part, le coup<strong>la</strong>ge rayonnement/turbulence. <strong>Le</strong> premierr objectif<br />
nécessite <strong>de</strong> recourir à <strong><strong>de</strong>s</strong> métho<strong><strong>de</strong>s</strong> très<br />
pénalisantes en termes <strong>de</strong> ressources informatiques.<br />
La parallélisation <strong><strong>de</strong>s</strong> co<strong><strong>de</strong>s</strong> ISIS <strong>et</strong> SAFIR comble en partie ce handicap. L’é<strong>la</strong>boration d’un<br />
modèle spectral <strong>de</strong><br />
rayonnement <strong>et</strong> <strong>la</strong> prise en compte du coup<strong>la</strong>ge rayonnement/turbulence se<br />
fera dans le cadre du <strong>la</strong>boratoire commun.<br />
81
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
Propriétés fractales <strong>et</strong> dynamique du front.<br />
Jean-Pierre Clerc<br />
IUSTI, Marseille, France<br />
<strong>Le</strong>s grands incendies <strong>de</strong> forêts se propagent dans <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions météorologiques,<br />
topographiques <strong>et</strong> botaniques hétérogènes. <strong>Le</strong>s contours <strong>de</strong> feux sont irréguliers, souvent<br />
fractals, comme le montrent les images satellites <strong>de</strong> feux historiques. <strong>Le</strong> modèle <strong>de</strong> réseau <strong>de</strong><br />
p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong> est un modèle stochastique <strong>de</strong> réseau social qui prend en compte ces<br />
hétérogénéités locales <strong>et</strong> les connections à courte <strong>et</strong> longue distances, responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
propagation, comme le rayonnement ou les sautes <strong>de</strong> feu. Il utilise <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres<br />
macroscopiques physiques <strong>et</strong> a été validé par comparaison à <strong><strong>de</strong>s</strong> données issues <strong>de</strong> feux<br />
historiques (<strong>Le</strong>cture invitée d'Ahmed Kaiss). On montre que le modèle <strong>de</strong> p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong><br />
reproduit <strong>de</strong> façon satisfaisante le comportement fractal du feu. L'étu<strong>de</strong> du comportement<br />
dynamique du front <strong>de</strong> feu en fonction <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres du modèle perm<strong>et</strong> d'i<strong>de</strong>ntifier plusieurs<br />
régimes <strong>de</strong> propagation. <strong>Le</strong>s résultats montrent qu’il semble exister une corré<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong><br />
dimension fractale du support sur lequel se propage le feu (D f ) <strong>et</strong> celle du front <strong>de</strong> feu ou <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
surface brûlée (d f ). La première est purement géométrique <strong>et</strong> liée au relief, alors que <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième résulte <strong><strong>de</strong>s</strong> contraintes appliquées au contour <strong>de</strong> feu. Ces contraintes sont liées aux<br />
hétérogénéités locales <strong>et</strong> peuvent être à courte portée (réaction-diffusion) ou à longue portée,<br />
bien au-<strong>de</strong>là <strong><strong>de</strong>s</strong> plus proches voisins.<br />
La première étape consiste à caractériser le support <strong>de</strong> <strong>la</strong> propagation. Pour ce<strong>la</strong>, on peut<br />
utiliser soit un paysage réel dont on détermine <strong>la</strong> dimension fractale en utilisant <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Box Counting 3D sur un modèle numérique <strong>de</strong> terrain (MNT) (Figure 1), soit construire<br />
mathématiquement un paysage <strong>de</strong> dimension fractale donnée (fonctions brownienne, <strong>de</strong><br />
Weierstrass, <strong>et</strong>c.).<br />
Figure 1<br />
82
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
On simule ensuite <strong>la</strong> propagation du front <strong>de</strong> feu sur ce support pour un couvert végétal<br />
homogène <strong>et</strong> en absence <strong>de</strong> vent. La taille du domaine d’interaction <strong>de</strong> chaque site en feu est<br />
affectée par <strong>la</strong> topographie du lieu. Sur terrain p<strong>la</strong>t, le domaine d’interaction est circu<strong>la</strong>ire <strong>et</strong><br />
limité aux plus proches voisins, alors que sur un terrain en pente ascendante, ce domaine est<br />
elliptique <strong>et</strong> porte au-<strong>de</strong>là <strong><strong>de</strong>s</strong> plus proches voisins. Pour un allumage ponctuel, <strong>la</strong> dimension<br />
fractale varie au cours du temps, d’une valeur faible (voisine <strong>de</strong> zéro) en début <strong>de</strong> propagation<br />
à une valeur proche <strong>de</strong> celle du support à <strong>la</strong> saturation pour <strong><strong>de</strong>s</strong> temps très grands où <strong>la</strong><br />
contribution collective <strong><strong>de</strong>s</strong> sites en feu est effective (Fig. 2).<br />
La dimension fractale du paysage constitue un bon indicateur du comportement fractal du feu<br />
<strong>et</strong> donc ai<strong>de</strong>r au dimensionnement <strong><strong>de</strong>s</strong> moyens <strong>de</strong> lutte à engager. <strong>Le</strong>s travaux en cours visent<br />
à m<strong>et</strong>tre en évi<strong>de</strong>nce l’existence d’un temps caractéristique lié à <strong>la</strong> transition <strong>de</strong> régimes <strong>de</strong><br />
propagation.<br />
Figure 2 : A gauche : évolution au cours du temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> dimension fractale du front <strong>de</strong> feu<br />
pour différentes dimensions fractales du support <strong>et</strong> différents taux <strong>de</strong> couverture végétale.<br />
L’encart correspond aux temps faibles. A droite : comportement près du seuil <strong>de</strong> perco<strong>la</strong>tion.<br />
83
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
<strong>Le</strong> feu à l'interface forêt-habitat<br />
Ahmed Kaiss<br />
IUSTI, Technopôle <strong>de</strong> Château-Gombert, 5 rue Enrico Fermi, 13453 Marseille ce<strong>de</strong>x 13<br />
La problématique <strong><strong>de</strong>s</strong> grands incendies <strong>de</strong> forêts, responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> majeure partie <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
surfaces brûlées, est qu'ils se propagent dans <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions hétérogènes en termes <strong>de</strong> vent,<br />
<strong>de</strong> végétation <strong>et</strong> <strong>de</strong> relief. <strong>Le</strong> modèle <strong>de</strong> « p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong>» est un modèle hybri<strong>de</strong> basé sur le<br />
réseau stochastique <strong>de</strong> réseau social qui prend en compte ces hétérogénéités locales <strong>et</strong> les<br />
connections à longue distance (rayonnement, sautes <strong>de</strong> feu), responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> propagation.<br />
L’existence <strong>de</strong> réseaux <strong>de</strong> "p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong>" a été révélée par l’expérience bien connue du<br />
sociologue Milgram en 1967 dans <strong>la</strong>quelle il a constaté qu’il ne faut pas plus <strong>de</strong> six<br />
intermédiaires, en moyenne, pour que <strong>de</strong>ux personnes quelconques d’une même communauté<br />
dans le mon<strong>de</strong> soient mises en contact. Trente ans après, Watts <strong>et</strong> Strogatz (Nature 393 (1998)<br />
440) en donnent une représentation sous <strong>la</strong> forme d’un réseau social ayant <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés<br />
d’amas <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tant une connexion entre <strong>de</strong>ux individus en un nombre fini d’étapes. Ce<br />
réseau <strong>de</strong> p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong> utilise donc <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> connexions, les unes impliquant les plus<br />
proches voisins, les autres à longue distance (court circuits). La notion <strong>de</strong> connexions entre<br />
proches voisins du modèle original est ici remp<strong>la</strong>cée par celle <strong>de</strong> domaine d’interaction d’un<br />
site en feu. Ce domaine est déterminé par un modèle macroscopique <strong>de</strong> rayonnement <strong>et</strong><br />
dépend <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions météorologiques, <strong>de</strong> <strong>la</strong> topographie du terrain <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation. <strong>Le</strong>s<br />
connexions à longue distance, au-<strong>de</strong>là du domaine d’interaction, comme celles générées par<br />
l’action <strong><strong>de</strong>s</strong> brandons ne sont pas considérées ici.<br />
<strong>Le</strong> modèle utilise également une pondération <strong><strong>de</strong>s</strong> sites basée sur <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
paramètres que sont le temps <strong>de</strong> combustion d’un site (i.e. le temps <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme)<br />
<strong>et</strong> l’énergie critique d’inf<strong>la</strong>mmation d’un site.<br />
Figure 1 : Réseau régulier <strong>de</strong> p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong> <strong>et</strong> domaine d’interaction d’un site en feu. La forme<br />
elliptique du domaine est liée à l’action du vent <strong>et</strong>/ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> pente. <strong>Le</strong> domaine d’interaction est<br />
constitué <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>mi-ellipses, l’une dans <strong>la</strong> direction principale <strong>de</strong> propagation, l’autre dans <strong>la</strong><br />
direction opposée. <strong>Le</strong> site en feu est au centre. Un site en feu brûle pendant le temps t c , qui correspond<br />
au temps <strong>de</strong> combustion <strong><strong>de</strong>s</strong> éléments fins combustibles, ceux-là même qui propagent le feu.<br />
84
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
La prise en compte <strong>de</strong> paramètres liés, par exemple, au type <strong>de</strong> végétation, à sa teneur en eau,<br />
ou à sa charge ne modifie pas <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong> pondération mais affecte directement le<br />
domaine d’interaction d’un site en feu.<br />
<strong>Le</strong> présent modèle peut être construit soit à partir d’un réseau bidimensionnel <strong>de</strong> sites <strong>de</strong> taille<br />
égale (grille régulière homogène, invariante par rotation <strong>et</strong> trans<strong>la</strong>tion), soit à partir d’un<br />
réseau totalement amorphe polydisperse. Il est constitué <strong>de</strong> sites actifs <strong>de</strong> concentration p <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> 1-p sites non actifs. Un site est dit actif lorsqu’il contient du combustible végétal. La<br />
distribution <strong><strong>de</strong>s</strong> sites actifs peut se faire <strong>de</strong> façon aléatoire, ou <strong>de</strong> façon déterministe par<br />
l’utilisation d’une carte <strong>de</strong> végétation du terrain étudié. Lors <strong>de</strong> l’évolution du système, un site<br />
actif peut se trouver dans l’un <strong><strong>de</strong>s</strong> quatre états suivants : sain, dégradé, en feu ou brûlé. <strong>Le</strong> site<br />
est sain lorsqu’il n’a subi aucune dégradation thermique. Il commence à se dégra<strong>de</strong>r dès lors<br />
qu’il se trouve dans le domaine d’interaction d’un ou plusieurs sites en feu. Lorsque l’énergie<br />
qu’il a reçue est supérieure ou égale à l’énergie d’allumage E ign , il s’enf<strong>la</strong>mme <strong>et</strong> brûle<br />
pendant un temps t c , appelé temps <strong>de</strong> combustion ou temps <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme. Durant t c ,<br />
ce site transfère alors son énergie par rayonnement aux sites situés dans son domaine<br />
d’interaction.<br />
L’énergie reçue par le site j localisé dans le domaine d’interaction <strong>de</strong> n sites en feu est donnée<br />
par:<br />
, <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
où H est <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong> Heavisi<strong>de</strong> <strong>et</strong> P ij <strong>la</strong> puissance reçue par le site j du site en feu i. La<br />
contribution du site en feu i n’est plus prise en compte quand un autre site en feu se trouve<br />
p<strong>la</strong>cé entre le site i <strong>et</strong> le site j (eff<strong>et</strong> d’écran). Lorsque l’énergie reçue par le site j atteint<br />
l’énergie d’allumage E ign , le site j se m<strong>et</strong> à brûler. La puissance P ij <strong>et</strong> le domaine d’interaction<br />
sont obtenus en utilisant le modèle <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme soli<strong>de</strong> <strong>et</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> Monte Carlo (Fig. 2).<br />
Figure 2 : Simu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Monte Carlo du transfert radiatif d’une f<strong>la</strong>mme générée par <strong>la</strong> combustion<br />
d’un site combustible vers les sites voisins. La f<strong>la</strong>mme est ici représentée par un cylindre <strong>de</strong> 2 m <strong>de</strong><br />
diamètre <strong>et</strong> <strong>de</strong> 5 m <strong>de</strong> hauteur, inclinée d’un angle <strong>de</strong> 30° par rapport à <strong>la</strong> verticale du lieu. Son<br />
pouvoir émissif est <strong>de</strong> 118 kW/m².<br />
85
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
Simu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> feux réels<br />
Dans sa version <strong>la</strong> plus avancée, <strong>la</strong> végétation est répartie sur un réseau amorphe construit par<br />
algorithme génétique (0.55
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
300<br />
(a)<br />
2.1<br />
(b)<br />
250<br />
4.7<br />
4.7<br />
y(m)<br />
200<br />
12.6<br />
37.5<br />
12.6<br />
37.5<br />
150<br />
2.1<br />
4.7<br />
100<br />
(c)<br />
(d)<br />
300<br />
250<br />
37.5<br />
4.7<br />
12.6<br />
37.5<br />
37.5<br />
37.5<br />
12.6<br />
y(m)<br />
200<br />
4.7<br />
4.7<br />
2.1<br />
150<br />
1.4<br />
1.4<br />
100<br />
100 150 200 250 300<br />
x(m)<br />
Figure 5<br />
100 150 200 250 300<br />
x(m)<br />
La figure 5 montre les niveaux radiatifs reçus par une zone débroussaillée <strong>de</strong> 50 m <strong>de</strong> rayon autour<br />
d’une habitation.<br />
Comme nous l’avons montré à travers quelques exemples, les applications du modèle <strong>de</strong><br />
réseau <strong>de</strong> p<strong>et</strong>it mon<strong>de</strong> sont nombreuses, <strong>de</strong>puis l'é<strong>la</strong>boration d'un simu<strong>la</strong>teur jusqu'à<br />
l'établissement <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> prévention du risque incendie <strong>de</strong> forêts ou à l'ai<strong>de</strong> à<br />
l'aménagement du territoire. Son extension à d’autres types d’écosystèmes (savanes, forêts<br />
tropicales, <strong>et</strong>c.) nécessite <strong>de</strong> réaliser <strong><strong>de</strong>s</strong> expériences <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire pour caractériser les<br />
propriétés thermo-physiques <strong><strong>de</strong>s</strong> espèces végétales impliquées. Des travaux en cours visent<br />
également à quantifier les émissions <strong>de</strong> gaz <strong>et</strong> <strong>de</strong> particules induites par un feu <strong>de</strong> forêt <strong>et</strong><br />
libérées dans l’atmosphère.<br />
87
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
<strong>Le</strong> boilover d’hydrocarbures répandus en couche mince sur une surface aqueuse<br />
J.P.Garo <strong>et</strong> J.P.Vantelon<br />
Département, Flui<strong><strong>de</strong>s</strong>, Thermique <strong>et</strong> Combustion, Institut P’, UPR CNRS 3346<br />
ENSMA BP 40109, 86961 Futuroscope Chasseneuil France<br />
A.C.Fernan<strong>de</strong>z-Pello<br />
Department of Mechanical Engineering, University of California at Berkeley<br />
Berkeley, California 94720 USA<br />
Résumé<br />
L’inf<strong>la</strong>mmation d’un épandage acci<strong>de</strong>ntel d’hydrocarbure flottant à <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> l’eau peut<br />
conduire à un phénomène <strong>de</strong> caractère spectacu<strong>la</strong>ire <strong>et</strong> redoutable, souvent appelé boilover en<br />
couche mince. Dans certaines conditions, en eff<strong>et</strong>, le flux <strong>de</strong> chaleur traverse <strong>la</strong> nappe <strong>de</strong><br />
combustible en feu, chauffe l’eau jusqu’à ébullition, <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te ébullition soulève le combustible<br />
<strong>et</strong> le disperse, provoquant une véritable explosion du foyer.<br />
Une étu<strong>de</strong> systématique <strong>de</strong> ce phénomène complexe est présentée à partir d’expérimentations<br />
menées à l’échelle <strong>la</strong>boratoire, sur différents types d’hydrocarbures représentant une <strong>la</strong>rge<br />
gamme <strong>de</strong> composition (purs ou <strong>de</strong> coupes <strong>de</strong> distil<strong>la</strong>tion variables).<br />
L’influence <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres majeurs jouant sur le processus, épaisseur initiale <strong>et</strong> point<br />
d’ébullition du combustible, surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> nappe, <strong>et</strong> leur impact sur l’échauffement <strong><strong>de</strong>s</strong> phases,<br />
tant combustible qu’aqueuse, <strong>et</strong> sur le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> déclenchement <strong>de</strong> l’ébullition, sont examinés.<br />
<strong>Le</strong>s résultats obtenus m<strong>et</strong>tent bien en évi<strong>de</strong>nce le rôle <strong><strong>de</strong>s</strong> transferts thermiques en profon<strong>de</strong>ur<br />
<strong>et</strong> montrent que le boilover est dû à une ébullition <strong>de</strong> type nucléation hétérogène prenant<br />
naissance à l’interface combustible-eau, l’eau étant surchauffée.<br />
Une modélisation <strong><strong>de</strong>s</strong> transferts <strong>de</strong> chaleur perm<strong>et</strong> enfin <strong>de</strong> bien appréhen<strong>de</strong>r les mécanismes<br />
contrô<strong>la</strong>nt le phénomène <strong>et</strong> <strong>de</strong> prédire les risques d’apparition <strong>de</strong> celui-ci.<br />
Introduction<br />
<strong>Le</strong> phénomène <strong>de</strong> boilover est le plus souvent associé aux grands stockages d’hydrocarbures à<br />
<strong>la</strong>rges coupes <strong>de</strong> distil<strong>la</strong>tion. En cas d’incendie en eff<strong>et</strong>, <strong>la</strong> combustion préférentielle <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
fractions les plus légères entraîne l’établissement <strong>de</strong> courants convectifs conduisant à <strong>la</strong><br />
formation d’une couche chau<strong>de</strong>, <strong>de</strong> température sensiblement uniforme, dont l’épaisseur croît<br />
plus vite que <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> régression <strong>de</strong> surface. Lorsque c<strong>et</strong>te couche chau<strong>de</strong>, toujours<br />
supérieure à 100°C, atteint l’eau souvent présente en fond <strong>de</strong> cuve, se produit une<br />
vaporisation explosive aux conséquences dramatiques.<br />
<strong>Le</strong> même type <strong>de</strong> phénomène peut toutefois se produire avec <strong><strong>de</strong>s</strong> épandages <strong>de</strong> couches<br />
minces, <strong>et</strong> même pour <strong><strong>de</strong>s</strong> hydrocarbures purs, les transferts <strong>de</strong> chaleur <strong>de</strong> type conductifs<br />
vers <strong>la</strong> phase aqueuse <strong>de</strong>venant prépondérants.<br />
Une étu<strong>de</strong> systématique <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te situation bien spécifique est présentée ici.<br />
Protocole expérimental<br />
L’étu<strong>de</strong> est menée à l’échelle <strong>la</strong>boratoire, ce qui assure un environnement calme, une f<strong>la</strong>mme<br />
stable, <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions <strong>de</strong> transferts thermiques en profon<strong>de</strong>ur dans les phases liqui<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
pratiquement uniformes. L’analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats s’en trouve ainsi gran<strong>de</strong>ment facilitée.<br />
Des cuves métalliques, <strong>de</strong> forme circu<strong>la</strong>ire, <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur 6 cm <strong>et</strong> <strong>de</strong> différents diamètres, 15,<br />
23, 30 <strong>et</strong> 50 cm, sont utilisées. Pour chaque diamètre <strong>de</strong> cuve, différentes épaisseurs <strong>de</strong><br />
combustible sont testées, comprises entre 2 <strong>et</strong> 15 mm. En cours <strong>de</strong> combustion, le niveau <strong>de</strong><br />
l’interface combustible/eau reste fixe. <strong>Le</strong> profil <strong>de</strong> température dans les <strong>de</strong>ux phases liqui<strong><strong>de</strong>s</strong>,<br />
combustible <strong>et</strong> eau, est déterminé à l’ai<strong>de</strong> d’un peigne <strong>de</strong> thermocouples chromel-alumel, <strong>de</strong><br />
diamètre 0,5 mm, disposés horizontalement <strong>et</strong> dont les têtes se trouvent positionnées selon<br />
88
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
l’axe <strong><strong>de</strong>s</strong> cuves. Ces cuves sont posées sur un peson qui perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> suivre l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
perte <strong>de</strong> masse <strong>de</strong> combustible en fonction du temps.<br />
Après une courte pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise en régime, <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> combustion atteint un état<br />
pratiquement stationnaire. Lorsque le boilover se produit, <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> combustion s’emballe<br />
avec <strong><strong>de</strong>s</strong> projections aléatoires d’eau <strong>et</strong> <strong>de</strong> combustible pulvérisé. On passe d’une combustion<br />
<strong>de</strong> surface « calme », à une combustion <strong>de</strong> type « explosif ».<br />
<strong>Le</strong>s combustibles utilisés sont : <strong>de</strong>ux hydrocarbures à coupes <strong>de</strong> distil<strong>la</strong>tion (fuel domestique<br />
(heating oil) (coupe <strong>de</strong> distil<strong>la</strong>tion restreinte) <strong>et</strong> fuel lourd (cru<strong>de</strong> oil) : Kittiway 63%, Arabian<br />
light 33%, Oural 4% (<strong>la</strong>rge coupe <strong>de</strong> distil<strong>la</strong>tion)) <strong>et</strong> cinq hydrocarbures purs : toluène, n-<br />
octane, xylène, n-décane <strong>et</strong> hexadécane.<br />
Résultats<br />
-Vitesse <strong>de</strong> combustion <strong>et</strong> dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> déclenchement du boilover<br />
La vitesse <strong>de</strong> combustion établie augmente avec le diamètre <strong>de</strong> cuve comme ce<strong>la</strong> est<br />
couramment observé dans c<strong>et</strong>te gamme <strong>de</strong> dimension <strong>de</strong> nappe. La figure 1 montre<br />
l’évolution du dé<strong>la</strong>i du déclenchement du boilover en fonction <strong>de</strong> l’épaisseur initiale <strong>de</strong><br />
combustible, pour les différents diamètres <strong>de</strong> cuve. Nous constatons que c<strong>et</strong>te évolution est<br />
pratiquement linéaire. Dans <strong>la</strong> mesure où le boilover se produit lorsque <strong>la</strong> température à<br />
l’interface combustible/eau atteint <strong>la</strong> température <strong>de</strong> nucléation <strong>de</strong> l’eau, ces droites peuvent<br />
être considérées comme représentatives d’une vitesse <strong>de</strong> pénétration thermique « apparente ».<br />
Plus le diamètre <strong>de</strong> cuve est grand, plus c<strong>et</strong>te vitesse apparente est élevée, ce qui est cohérent<br />
avec l’accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> combustion avec <strong>la</strong> taille <strong>de</strong> <strong>la</strong> nappe. Comme <strong>la</strong> vitesse<br />
<strong>de</strong> régression <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface combustible est connue, il est alors possible <strong>de</strong> déduire, par<br />
différence avec <strong>la</strong> pente <strong><strong>de</strong>s</strong> droites, <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> pénétration thermique « effective »<br />
responsable du boilover.<br />
Figure 1 : Temps avant boilover<br />
en fonction <strong>de</strong> l’épaisseur<br />
initiale <strong>de</strong> combustible pour<br />
différentes tailles <strong>de</strong> cuves<br />
(combustible : cru<strong>de</strong> oil).<br />
C<strong>et</strong>te vitesse <strong>de</strong> pénétration thermique « effective » augmente avec le point d’ébullition du<br />
combustible. En fait, <strong>la</strong> vitesse <strong>et</strong> le flux <strong>de</strong> chaleur à <strong>la</strong> surface diminuent lorsque le point<br />
d’ébullition augmente. La vitesse <strong>de</strong> pénétration thermique apparente est en conséquence<br />
réduite mais moins que <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> régression, ce qui se traduit par une augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
vitesse <strong>de</strong> pénétration thermique effective [1].<br />
Aussi, même si <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> chauffage <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase liqui<strong>de</strong> est accrue, <strong>la</strong> différence entre <strong>la</strong><br />
température <strong>de</strong> surface <strong>et</strong> <strong>la</strong> température <strong>de</strong> nucléation <strong>de</strong> l’eau est augmentée, <strong>et</strong> le temps<br />
pour atteindre c<strong>et</strong>te température à l’interface combustible/eau <strong>de</strong>vient re<strong>la</strong>tivement plus<br />
important. C’est ce que l’on peut constater si l’on considère l’évolution du dé<strong>la</strong>i avant<br />
boilover en fonction du point d’ébullition [1].<br />
-Proportion <strong>de</strong> combustible brûlé avant boilover<br />
Nous venons <strong>de</strong> voir que <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> pénétration thermique responsable du boilover était<br />
plus gran<strong>de</strong> lorsque le combustible présentait un point d’ébullition plus élevé. En<br />
89
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
conséquence, <strong>la</strong> proportion <strong>de</strong> combustible brûlé avant boilover décroît lorsque le point<br />
d’ébullition du combustible augmente. La figure 2 montre c<strong>et</strong>te évolution. <strong>Le</strong>s valeurs<br />
présentées sont indépendantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> dimension <strong>de</strong> <strong>la</strong> nappe <strong>et</strong> en accord avec les valeurs <strong>de</strong><br />
vitesse <strong>de</strong> pénétration thermique qui sont responsables du boilover, ainsi qu’avec les vitesses<br />
<strong>de</strong> régression limites. L’épaisseur <strong>de</strong> combustible encore présent au moment du boilover<br />
augmente avec le point d’ébullition <strong>et</strong>, en conséquence, l’intensité <strong>de</strong> boilover augmente,<br />
comme ce<strong>la</strong> est bien observé.<br />
Figure 2 : Proportion <strong>de</strong> combustible<br />
brûlé avant boilover en fonction du<br />
point d’ébul-lition (épaisseur initiale<br />
13 mm; cuve:15 cm).<br />
-Evolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> température <strong>et</strong> caractéristiques du boilover<br />
Un résultat intéressant est que le boilover se déclenche, dans tous les cas, lorsque <strong>la</strong><br />
température à l’interface combustible/eau atteint une valeur <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 120°C. La figure 3<br />
montre par exemple l’évolution <strong><strong>de</strong>s</strong> profils <strong>de</strong> température, <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> surface du combustible,<br />
à différents temps après l’inf<strong>la</strong>mmation, dans le cas <strong>de</strong> fuel domestique brû<strong>la</strong>nt dans une cuve<br />
<strong>de</strong> diamètre 15 cm <strong>et</strong> pour une épaisseur initiale <strong>de</strong> combustible <strong>de</strong> 11 mm (le boilover se<br />
produit au bout <strong>de</strong> 630 s).<br />
Figure 3 : Développement d’un profil<br />
<strong>de</strong> tem-pérature verticale<br />
(combustible : heating oil ; épaisseur<br />
initiale : 11 mm ; cuve : 15 cm).<br />
Il est bien connu qu’un liqui<strong>de</strong> qui n’est pas au contact d’une phase gazeuse peut être<br />
surchauffé, à pression constante, à <strong><strong>de</strong>s</strong> températures bien supérieures à sa température <strong>de</strong><br />
saturation. <strong>Le</strong> niveau <strong>de</strong> surchauffe observé ici, <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 20°C <strong>et</strong> déjà mentionné par<br />
d’autres auteurs [2, 3], est inférieur à ce qui pourrait être attendu. Il est p<strong>la</strong>usible d’attribuer ce<br />
bas niveau à <strong>la</strong> présence d’impur<strong>et</strong>és à l’interface. Ces impur<strong>et</strong>és ten<strong>de</strong>nt à favoriser une<br />
nucléation <strong>de</strong> type hétérogène au détriment d’une nucléation homogène. La formation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
bulles <strong>de</strong> vapeur, leur croissance <strong>et</strong> leur ascension vers <strong>la</strong> surface combustible en feu, ont été<br />
analysées dans un travail antérieur [4]. Une information intéressante est que les bulles<br />
naissent à l’interface combustible/eau mais croissent coté combustible. Ceci correspond au<br />
régime <strong>de</strong> type « bubble blowing » ; en d’autres termes <strong>la</strong> tension superficielle <strong>de</strong> l’eau est<br />
bien supérieure à <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> <strong>la</strong> tension superficielle du combustible <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> tension<br />
interfaciale.<br />
La vaporisation violente (le boilover) se produit lorsque <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> nucléation <strong><strong>de</strong>s</strong> bulles <strong>de</strong><br />
vapeur <strong>de</strong>vient si élevée que celles-ci ne peuvent plus cheminer régulièrement jusqu’à <strong>la</strong><br />
90
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
surface. L’important volume <strong>de</strong> vapeur d’eau générée soulève <strong>la</strong> couche <strong>de</strong> combustible <strong>et</strong> <strong>la</strong><br />
disperse dans <strong>la</strong> f<strong>la</strong>mme. Du combustible sous forme très divisée se trouve ainsi injecté dans<br />
celle-ci. <strong>Le</strong> résultat est toujours très spectacu<strong>la</strong>ire avec <strong>la</strong> formation d’une boule <strong>de</strong> feu très<br />
intense, <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> dimension par rapport au foyer initial.<br />
-Intensité du boilover<br />
Nous définissons l’intensité du boilover comme le rapport entre le débit massique <strong>de</strong><br />
combustible au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> brève pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> vaporisation explosive <strong>et</strong> le débit massique <strong>de</strong><br />
combustible au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> combustion avant boilover. En fait, <strong>la</strong> durée <strong>de</strong><br />
boilover, courte, est difficile à déterminer du fait du caractère violent du phénomène. De plus,<br />
il y a éjection assez aléatoire tant <strong>de</strong> combustible que d’eau hors du foyer. Aussi, l’intensité <strong>de</strong><br />
boilover n’est-elle qu’assez approximative <strong>et</strong> ne doit être considérée que comme une<br />
estimation qualitative.<br />
Il apparaît que l’intensité <strong>de</strong> boilover, ainsi évaluée augmente avec l’épaisseur initiale <strong>de</strong><br />
combustible mais décroît avec <strong>la</strong> dimension du foyer. L’influence du type <strong>de</strong> combustible sur<br />
l’intensité <strong>de</strong> boilover est montrée sur <strong>la</strong> figure 4. Il est possible <strong>de</strong> constater que l’intensité<br />
augmente avec <strong>la</strong> différence entre les points d’ébullition du combustible <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’eau. Ce<br />
résultat est en accord avec les résultats re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> fraction <strong>de</strong> combustible brûlé avant<br />
boilover (figure 2). En eff<strong>et</strong>, <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> combustible encore non brûlé avant boilover<br />
augmente avec le point d’ébullition <strong>et</strong> <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> combustible injecté dans les f<strong>la</strong>mmes est<br />
plus importante. La figure 4 montre également que l’épaisseur d’eau surchauffée augmente<br />
avec le point d’ébullition du combustible. On a ainsi plus d’eau vaporisée au moment du<br />
déclenchement du phénomène <strong>et</strong> ce<strong>la</strong> va aussi dans le sens <strong>de</strong> l’intensification <strong>de</strong> celui-ci.<br />
Figure 4 : Intensité <strong>de</strong><br />
boilover <strong>et</strong> épaisseur d’eau<br />
surchauffée en fonction du<br />
point d’ébullition<br />
(épaiSalemsseur initiale <strong>de</strong><br />
combustible : 13 mm ; cuve :<br />
15 cm).<br />
-Modélisation <strong>de</strong> l’échauffement du combustible <strong>et</strong> <strong>de</strong> son support aqueux<br />
<strong>Le</strong>s différentes caractéristiques du boilover, mises en évi<strong>de</strong>nce précé<strong>de</strong>mment, s’interprètent<br />
parfaitement à partir <strong>de</strong> l’analyse du transfert <strong>de</strong> chaleur monodirectionnel vers les <strong>de</strong>ux<br />
phases liqui<strong><strong>de</strong>s</strong>.<br />
En faisant l’hypothèse que le transfert est limité par <strong>la</strong> conduction, <strong>et</strong> en prenant en compte<br />
l’influence du rayonnement en profon<strong>de</strong>ur, une modélisation non-stationnaire a été<br />
développée, en utilisant un schéma <strong>de</strong> différences finies implicite <strong>et</strong> en appliquant <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
conditions limites appropriées [5]. C<strong>et</strong>te modélisation perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> prédire, avec un accord très<br />
satisfaisant, l’évolution <strong><strong>de</strong>s</strong> profils <strong>de</strong> température <strong>et</strong> le temps <strong>de</strong> déclenchement <strong>de</strong> boilover ;<br />
mais aussi <strong>de</strong> rendre compte <strong>de</strong> l’influence <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres fondamentaux que sont le point<br />
d’ébullition du combustible, l’épaisseur initiale <strong>de</strong> celui-ci <strong>et</strong> <strong>la</strong> taille du foyer.<br />
Toutefois, sur un p<strong>la</strong>n plus pratique, il apparaît très utile d’être en mesure <strong>de</strong> prédire <strong>de</strong> façon<br />
simple le déclenchement du phénomène. Dans c<strong>et</strong>te perspective, il est possible <strong>de</strong> considérer<br />
<strong>la</strong> phase liqui<strong>de</strong> comme un milieu semi-infini, soumis à un flux <strong>de</strong> chaleur uniforme.<br />
Sur <strong>la</strong> base <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats expérimentaux précé<strong>de</strong>nts, si y 0 est l’épaisseur initiale du<br />
combustible, t b le temps pour le déclenchement du boilover, r <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> régression du<br />
91
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
combustible <strong>et</strong> r p <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> pénétration <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> thermique responsable du boilover, on<br />
peut écrire :<br />
T b =y 0 /r+r p (1)<br />
La re<strong>la</strong>tion entre le temps d’échauffement <strong>et</strong> l’épaisseur <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> thermique y peut être<br />
obtenue en résolvant l’équation <strong>de</strong> conduction monodirectionnelle, avec les conditions limites<br />
appropriées, lorsque <strong>la</strong> température <strong>de</strong> surface du combustible, initialement à l’ambiante T ∞ ,<br />
est soudainement portée au point d’ébullition T b<br />
La distribution <strong>de</strong> température au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase liqui<strong>de</strong> est alors donnée par <strong>la</strong> solution<br />
c<strong>la</strong>ssique :<br />
T b -T/ T b -T ∞ =erf(y/2(αt) 1/2 )<br />
avec α <strong>la</strong> diffusivité thermique <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase liqui<strong>de</strong>.<br />
La fonction erf étant donnée par tous les ouvrages <strong>de</strong> référence en transfert <strong>de</strong> chaleur, une<br />
valeur X <strong>de</strong> <strong>la</strong> quantité y/2(αt b ) 1/2 peut être déduite, pour chaque combustible, en prenant T<br />
égal à 120°C, température <strong>de</strong> surchauffe <strong>de</strong> l’eau à l’initiation du boilover.<br />
Mais r p =y/t b <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te vitesse <strong>de</strong> pénétration <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> thermique peut s’écrire :<br />
r p =2X(α/t b ) 1/2<br />
En substituant c<strong>et</strong>te valeur dans l’équation (1), il vient :<br />
rt b + 2X(α/t b ) 1/2 =y 0 (2)<br />
<strong>Le</strong>s temps <strong>de</strong> déclenchement du boilover obtenus expérimentalement pour les différents<br />
combustibles, avec différentes conditions d’épaisseur initiale <strong>de</strong> ceux-ci <strong>et</strong> <strong>de</strong> taille <strong>de</strong> foyer,<br />
sont comparés avec les temps calculés à partir <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te re<strong>la</strong>tion (2), sur <strong>la</strong> figure 5. Il est<br />
possible <strong>de</strong> constater que l’accord est assez satisfaisant (
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
Références :<br />
[1] J.P. Garo, J.P. Vantelon and A.C. Fernan<strong>de</strong>z Pello, « Boilover burning of oil spilled on<br />
water », Twenty-Fifth Symposium (International) on Combustion. The Combustion Institute<br />
Pittsburgh, pp.1481-1488, 1994.<br />
[2] M.Arai, K.Saito and R.Altenkirch, « A study of boilover in liquid pool fires supported on<br />
water. Part I: Effects of water sub<strong>la</strong>yer on pool fires”, Combustion Science and Technology,<br />
71, pp.25-90,1990<br />
[3] H.Koseki, M.Kokka<strong>la</strong> and G.W.Mlhol<strong>la</strong>nd, “Experimental study of boilover in cru<strong>de</strong> oil<br />
fires”, Fire Saf<strong>et</strong>y Science, Proceedings of the Third International Symposium, Elsevier,<br />
London and New-York, pp.865-874, 1991.<br />
[4] J.P. Garo, J.P. Vantelon and A.C. Fernan<strong>de</strong>z Pello, « Effect of the fuel boiling point on the<br />
boilover burning of liquid fuels spilled on water », Twenty-Fifth Symposium (International)<br />
on Combustion. The Combustion Institute Pittsburgh, pp.1461-1467, 1996.<br />
[5] J.P. Garo, Ph. Gil<strong>la</strong>rd , J.P. Vantelon and A.C. Fernan<strong>de</strong>z-Pello, « Combustion of liquid<br />
fuels spilled on water. Prediction of time to start of boilover », Combustion Science and<br />
Technology, 147, 1-6, pp.39-59,1999.<br />
93
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
<strong>Le</strong>s moyens expérimentaux <strong>de</strong> caractérisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation thermique <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
matériaux soli<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Thomas Rogaume<br />
Institut Pprime, UPR 3346 CNRS, département Flui<strong><strong>de</strong>s</strong>, Thermique, Combustion, ENSMA, BP<br />
40109, 86961 Futuroscope ce<strong>de</strong>x. thomas.rogaume@lcd.ensma.fr<br />
Face aux coûts <strong>et</strong> impacts <strong><strong>de</strong>s</strong> feux, il est primordial <strong>de</strong> développer <strong><strong>de</strong>s</strong> moyens <strong>de</strong> prévention<br />
<strong>et</strong> <strong>de</strong> protection. Toutefois, chaque feu étant <strong>de</strong> part ses caractéristiques <strong>et</strong> son environnement<br />
un cas particulier, son étu<strong>de</strong> requiert <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>et</strong> l’utilisation <strong>de</strong> co<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tions<br />
numériques. En ce sens, divers co<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> simu<strong>la</strong>tion <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies ont été développés, mais<br />
tous reposent sur une hypothèse limitante, le modèle <strong>de</strong> pyrolyse. Ainsi <strong>de</strong> nombreuses étu<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
actuelles consistent à développer <strong>de</strong> nouveaux modèles <strong>de</strong> pyrolyse, plus pertinents <strong>et</strong><br />
performants. Toutefois, se pose toujours pour le modélisateur <strong>la</strong> question suivante : quel<br />
modèle <strong>de</strong> pyrolyse prendre, est il vali<strong>de</strong> pour mes conditions ? Chaque modèle <strong>de</strong> pyrolyse<br />
est développé <strong>et</strong> mis en p<strong>la</strong>ce à partir <strong>de</strong> résultats expérimentaux.<br />
C’est dans ce sens qu’est réalisé ce travail. L’enjeu est <strong>de</strong> présenter les différents dispositifs<br />
expérimentaux utilisés afin d’étudier <strong>la</strong> décomposition thermique <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux soli<strong><strong>de</strong>s</strong> pour<br />
le développement <strong><strong>de</strong>s</strong> modèles <strong>de</strong> pyrolyse. Pour chaque dispositif expérimental, un bi<strong>la</strong>n du<br />
principe <strong>de</strong> fonctionnement, <strong><strong>de</strong>s</strong> avantages <strong>et</strong> inconvénients est réalisé.<br />
<strong>Le</strong> modèle <strong>de</strong> pyrolyse répond à un double enjeu : décrire <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> masse du<br />
combustible <strong>et</strong> <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> gaz vo<strong>la</strong>tils formés. Il est alors d’une gran<strong>de</strong> importance car il<br />
décrire le terme source (1ere étape <strong>de</strong> <strong>la</strong> combustion) <strong>et</strong> en ce sens il va avoir un impact sur :<br />
‐ <strong>Le</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmation (température, dé<strong>la</strong>is… )<br />
‐ <strong>Le</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> combustion (phase gazeuse)<br />
Rappel <strong>de</strong> <strong>la</strong> problématique<br />
<strong>Le</strong>s modèles <strong>de</strong> pyrolyse ont pour enjeu <strong>de</strong> décrire <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> masse <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
combustibles soli<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>et</strong> <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> gaz vo<strong>la</strong>tils générés en fonction <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions aux<br />
limites, notamment du bi<strong>la</strong>n thermique.<br />
Lorsqu’un soli<strong>de</strong>, initialement à température ambiante, est soumis à un flux <strong>de</strong> chaleur q ° i , sa<br />
température en surface augmente, m<strong>et</strong>tant en jeu un certain nombre <strong>de</strong> processus physiques <strong>et</strong><br />
chimiques, présentés sur <strong>la</strong> figure 1.<br />
Figure 1. Processus simplifié <strong>de</strong> dégradation d’un combustible soli<strong>de</strong> [1].<br />
94
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
<strong>Le</strong> processus est considéré ici monodimensionnel selon l’axe x <strong>et</strong> l’échantillon a une épaisseur<br />
L. La surface supérieure du combustible qui reçoit <strong>la</strong> chaleur se situe à x=0 <strong>et</strong> l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
paramètres évoluent au cours du temps t. Il est important <strong>de</strong> noter que <strong>la</strong> position <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te<br />
surface (qui reçoit le flux <strong>de</strong> chaleur) va évoluer (régresser) en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> perte<br />
<strong>de</strong> masse. La chaleur (ainsi que <strong>la</strong> température T) va se répartir au sein du combustible par<br />
conduction q ° c, tandis qu’une autre partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaleur est rerayonnée à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface du<br />
combustible, q ° r.<br />
La phase soli<strong>de</strong> va produire une quantité <strong>de</strong> gaz à <strong>la</strong> vitesse m ° p. En fonction <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te vitesse,<br />
l’oxygène peut diffuser en surface <strong>et</strong> à l’intérieur du combustible en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
perméabilité χ, suivant un gradient <strong>de</strong> fraction massique Y O2 . La dégradation thermique va<br />
générer une fraction massique <strong>de</strong> combustible gazeux Y s <strong>et</strong> <strong>de</strong> combustible soli<strong>de</strong> résiduel<br />
Y F,s . L’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres évoluent en fonction <strong>de</strong> l’épaisseur x <strong>et</strong> du temps t : (x,t).<br />
La <strong><strong>de</strong>s</strong>cription <strong>de</strong> <strong>la</strong> dégradation thermique nécessite <strong>la</strong> résolution <strong>de</strong> l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> équations<br />
<strong>de</strong> conservation : masse, énergie, espèces <strong>et</strong> parfois quantité <strong>de</strong> mouvement. Toutefois, face à<br />
<strong>la</strong> complexité <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te résolution, aux temps <strong>de</strong> calculs générés <strong>et</strong> aux dimensions <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
domaines à modéliser, <strong>de</strong> nombreuses hypothèses <strong>et</strong> simplifications sont réalisées.<br />
La dégradation thermique va ainsi dépendre :<br />
- De <strong>la</strong> température, T(x,t).<br />
- De <strong>la</strong> fraction massique locale <strong>de</strong> combustible, Y s (x,t).<br />
- De <strong>la</strong> fraction massique locale d’oxygène, Y O2 (x,t).<br />
- De <strong>la</strong> fraction massique <strong>de</strong> combustible soli<strong>de</strong> résiduel, Y F,s (x,t).<br />
- De <strong>la</strong> perméabilité, χ(x,t).<br />
- De l’épaisseur <strong>de</strong> pénétration <strong>de</strong> l’oxygène, δ O2 (t).<br />
- De l’épaisseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone réactive, δ F (t).<br />
- De <strong>la</strong> valeur <strong><strong>de</strong>s</strong> constantes cinétiques, A i , n i , m i , E i.<br />
<strong>Le</strong>s investigations expérimentales<br />
<strong>Le</strong>s modèles <strong>de</strong> pyrolyse sont développés à partir d’investigations expérimentales. <strong>Le</strong>s<br />
paramètres qu’il est nécessaire <strong>de</strong> déterminer sont :<br />
• Caractéristiques chimiques : composition élémentaire, masse molécu<strong>la</strong>ire, <strong>de</strong>gré <strong>de</strong><br />
polymérisation…<br />
• Propriétés physiques <strong>et</strong> thermiques : k, ρ, Cp, , ∆H…<br />
• Caractéristiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> décomposition thermique : vitesse <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> masse (MLR),<br />
dé<strong>la</strong>is <strong>et</strong> température d’inf<strong>la</strong>mmation, quantité <strong>de</strong> gaz, composition <strong><strong>de</strong>s</strong> produits<br />
vo<strong>la</strong>tils<br />
C’est ce <strong>de</strong>rnier point qui est traité ici. La problématique <strong><strong>de</strong>s</strong> essais expérimentaux est alors :<br />
- De connaitre <strong>et</strong> <strong>de</strong> maitriser les paramètres influençant <strong>la</strong> dégradation (conditions<br />
initiales <strong>et</strong> conditions aux limites).<br />
- D’être représentatif <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions réelles d’incendie.<br />
Se pose alors <strong>la</strong> problématique <strong><strong>de</strong>s</strong> échelles <strong>de</strong> travail. Plus les essais sont conduits à p<strong>et</strong>ite<br />
échelle <strong>et</strong> plus les paramètres <strong>de</strong> <strong>la</strong> décomposition sont maîtrisés <strong>et</strong> connus, mais moins l’on<br />
est représentatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité d’un feu, <strong>et</strong> inversement en fonction <strong>de</strong> l’augmentation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
échelles <strong>de</strong> tests.<br />
De manière courante, 4 échelles sont considérées :<br />
95
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
Echelle <strong>de</strong> travail Taille <strong><strong>de</strong>s</strong> échantillons Dispositifs expérimentaux<br />
Echelle matière<br />
P<strong>et</strong>ite échelle (ou échelle<br />
matériau)<br />
Echelle produit<br />
Essais taille réelle<br />
Quelques mm<br />
1 à 15 cm<br />
10 aines <strong>de</strong> cm au m<br />
m à 10 aines <strong>de</strong> m<br />
• Analyse Thermogravimétrique (ATG)<br />
• Analyse Thermo différentielle (ATD)<br />
• Calorimétrie différentielle à ba<strong>la</strong>yage (DSC)<br />
• Four tubu<strong>la</strong>ire<br />
• Cône calorimètre<br />
• Fire Propagation Apparatus (FPA)<br />
• Vitesse <strong>de</strong> propagation <strong>la</strong>térale <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme,<br />
IMO-LIFT<br />
• Medium Burner<br />
• Single Burning Item<br />
• Room corner test<br />
• Caisson<br />
• P<strong>la</strong>te-forme<br />
• Tunnel<br />
Etu<strong><strong>de</strong>s</strong> à l’échelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> matière<br />
Ces dispositifs perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong> définir <strong>et</strong> <strong>de</strong> mesurer :<br />
- La perte <strong>de</strong> masse <strong>et</strong> <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> masse au cours du temps <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
température, ATG<br />
- <strong>Le</strong>s températures <strong>de</strong> décomposition, ATD<br />
- <strong>Le</strong>s températures <strong>de</strong> transition <strong>de</strong> phase <strong>et</strong> <strong>de</strong> décomposition, <strong>la</strong> capacité<br />
thermique spécifique, les enthalpies <strong>de</strong> réaction, DSC<br />
- <strong>Le</strong>s espèces vo<strong>la</strong>tiles émises, Four tubu<strong>la</strong>ire.<br />
<strong>Le</strong> principe <strong><strong>de</strong>s</strong> expériences est assez proche, quels que soient les dispositifs expérimentaux :<br />
un échantillon <strong>de</strong> quelques milligrammes est positionné dans un four ba<strong>la</strong>yé par un gaz<br />
vecteur connu : atmosphère inerte, sous air, concentration réduite en oxygène (0≤O 2 ≤21%).<br />
<strong>Le</strong> four peut alors subir une rampe <strong>de</strong> montée en température à une vitesse <strong>de</strong> chauffage<br />
connue (souvent comprise entre 5 <strong>et</strong> 50°C/min) jusqu’à une température maximale connue<br />
(souvent jusque 1100°C). Il peut également être possible <strong>de</strong> faire <strong><strong>de</strong>s</strong> montées en températures<br />
avec <strong><strong>de</strong>s</strong> rampes <strong>et</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>la</strong>teaux.<br />
<strong>Le</strong>s avantages <strong>de</strong> ces techniques sont <strong>la</strong> parfaite connaissance <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions <strong>de</strong><br />
décomposition thermique :<br />
• Température connue, pas <strong>de</strong> gradient <strong>de</strong> température dans <strong>la</strong> particule<br />
• Vitesse <strong>de</strong> Chauffage connue<br />
• Fraction massique locale <strong>de</strong> combustible homogène, pas <strong>de</strong> diffusion d’espèces<br />
• Concentration locale d’oxygène connue, pas <strong>de</strong> gradient <strong>et</strong> <strong>de</strong> diffusion d’oxygène<br />
• Perméabilité nulle<br />
• Epaisseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone réactive infiniment mince<br />
<strong>Le</strong>s inconvénients sont inversement <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> conditions <strong>de</strong> décomposition qui ne<br />
sont pas représentatives <strong><strong>de</strong>s</strong> scénarios réels <strong>de</strong> feux : faibles vitesses <strong>de</strong> chauffage, pas <strong>de</strong><br />
gradient <strong>de</strong> température <strong>et</strong> d’oxygène, soli<strong>de</strong> infiniment mince.<br />
96
STOP FEU, Oran 2010<br />
<strong>Le</strong>ctures invitées<br />
Etu<strong><strong>de</strong>s</strong> à l’échelle du matériau<br />
<strong>Le</strong>s <strong>de</strong>ux dispositifs principalement utilisés sont le cône calorimètre <strong>et</strong> le fire propagation<br />
apparatus. Un échantillon <strong>de</strong> plusieurs grammes (<strong>et</strong> <strong>de</strong> 100*100*épaisseur mm 3 ) est<br />
positionné dans un porte échantillon sur une ba<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> précision. Il subit alors une agression<br />
thermique à un flux <strong>de</strong> chaleur connu (entre 0 <strong>et</strong> 100 kW/m 2 ). En fonction <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong>, un<br />
système d’allumage piloté est également mis en p<strong>la</strong>ce. Ces dispositifs perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong><br />
déterminer <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> masse <strong>et</strong> <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> masse au cours du temps, le dé<strong>la</strong>i<br />
d’inf<strong>la</strong>mmation, le flux d’énergie libéré par <strong>la</strong> combustion (HRR) <strong>et</strong> si un coup<strong>la</strong>ge avec <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
analyseurs <strong>de</strong> gaz est utilisé, <strong>la</strong> composition <strong><strong>de</strong>s</strong> produits vo<strong>la</strong>tils <strong>et</strong> <strong>de</strong> combustion.<br />
<strong>Le</strong>s avantages <strong>de</strong> ces dispositifs sont qu’ils représentent assez bien les conditions réelles <strong>de</strong><br />
combustion. Inversement, seul le flux <strong>de</strong> chaleur radiant est connu. Ainsi, les paramètres<br />
suivants ne sont pas connus : <strong>la</strong> température <strong>de</strong> surface (<strong>de</strong> l’échantillon) <strong>et</strong> sont transfert, <strong>la</strong><br />
concentration en oxygène en surface <strong>et</strong> dans l’échantillon, <strong>la</strong> perméabilité du combustible, <strong>la</strong><br />
vitesse <strong>de</strong> chauffage, l’épaisseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone réactive.<br />
Ainsi il est impossible d’initialiser les modèles (au sein <strong><strong>de</strong>s</strong>quels <strong>la</strong> température <strong>et</strong> l’oxygène<br />
doivent être renseignés <strong>et</strong> le suivi <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> masse ne peut pas se faire en<br />
fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> température.<br />
Etu<strong><strong>de</strong>s</strong> à l’échelle produit :<br />
<strong>Le</strong> single burning item <strong>et</strong> le medium burner perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong> suivre l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong><br />
perte <strong>de</strong> masse <strong>et</strong> <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> propagation du front <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme au cours du temps. Un<br />
échantillon <strong>de</strong> plusieurs centaines voir milliers <strong>de</strong> grammes subit alors une agression<br />
thermique par une f<strong>la</strong>mme (brûleur) <strong>de</strong> puissance parfaitement connue. Dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
LIFT, le combustible en position verticale, est léché par une f<strong>la</strong>mme pilote tandis qu’il reçoit<br />
dans un même temps un flux <strong>de</strong> chaleur connu émis par un panneau radiant. Ce dispositif<br />
perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> déterminer l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> propagation <strong>la</strong>térale <strong>de</strong> f<strong>la</strong>mme en fonction<br />
du flux <strong>de</strong> chaleur.<br />
Ces essais sont réalisés dans l’air ambiant <strong>et</strong> les dispositifs peuvent être couplés à un dispositif<br />
<strong>de</strong> calorimétrie pour déterminer HRR ou <strong><strong>de</strong>s</strong> analyseurs <strong>de</strong> gaz pour déterminer l’évolution <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> composition <strong><strong>de</strong>s</strong> gaz <strong>de</strong> combustion.<br />
Toutefois, tous comme pour <strong>la</strong> précé<strong>de</strong>nte échelle, si ces dispositifs m<strong>et</strong>tent en jeu une<br />
combustion représentative <strong><strong>de</strong>s</strong> incendies, très peu <strong>de</strong> données sont connues <strong>et</strong> maîtrisées. Ils<br />
ne peuvent donc être utilisés pour le développement <strong>de</strong> modèles <strong>de</strong> pyrolyse.<br />
Etu<strong><strong>de</strong>s</strong> à échelle réelle<br />
La <strong>de</strong>rnière échelle qui peut être utilisée est celle dite réelle. <strong>Le</strong>s étu<strong><strong>de</strong>s</strong> reposent sur l’emploi<br />
<strong>de</strong> caissons, <strong>de</strong> bâtiments, <strong>de</strong> tunnels à feux. <strong>Le</strong>s informations collectées sont très riches pour<br />
le modélisateur mais ces dispositifs se révèlent complètement inadéquats pour mener <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
investigations fondamentales telles que le développement <strong>de</strong> modèles <strong>de</strong> pyrolyse.<br />
97
STOP FEU, Oran 2010<br />
Liste <strong><strong>de</strong>s</strong> Participants<br />
Liste <strong><strong>de</strong>s</strong> Participants au Colloque International STOP FEU<br />
Hôtel New Beach, Oran, 17-19 Décembre 2010<br />
Nom <strong>et</strong> Prénoms Etablissement Ville/Pays<br />
ABBES Mohamed DG For<strong>et</strong>s Alger/Algérie<br />
ADJA Ab<strong>de</strong>lka<strong>de</strong>r U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
AISSA Ab<strong>de</strong>lhamid U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
AMMARI Mokhtar U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
BENABDALLAH Ghamal<strong>la</strong>h U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
BENBOUZID Ayhane C.N.T.S. Arzew/Algérie<br />
BENCHERIF Brahim U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
BENYAMINA Mokhtaria U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
BENZAHRA BELKACEM Fatima Zahra U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
BERRAHOU Noria U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
BOUKERKER Hassene U Batna Batna/Algérie<br />
BOUKNI Bariza U. Jijel Constantine/Algérie<br />
BOULET Pascal LEMTA Nancy/France<br />
BOUZIT Fayçal IGCMO Oran/Algérie<br />
CHARI Fairouz U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
CHETEHOUNA Khaled ENSI <strong>de</strong> Bourges Bourges/France<br />
CLERC Jean Pierre IUSTI Marseille/France<br />
COPPALLE Alexis CORIA Rouen/France<br />
HADJEL Mohamed U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
HASSINI Ab<strong>de</strong>l<strong>la</strong>tif U.Oran Es Sénia Oran/Algérie<br />
KADA Ab<strong>de</strong>lhak U. Hassiba Benbouali Chlef/Algérie<br />
KAID-HARCHE Meriem U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
KAISS Ahmed IUSTI Marseille/France<br />
KHELIFA Hocine U.Laghouat Laghouat /Algérie<br />
KORICHE Yamina C.U. Khemis Miliana Khemis Miliana/Algérie<br />
LALLEMAND Christine DGA Toulon/France<br />
LEONI Eric SPE Corte/France<br />
LOUNIS Mourad U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
MERDAS Saifi U. Mentouri Constantine/Algérie<br />
MESSAOUDI Souad Ilhem USTO Oran/Algérie<br />
MILOUA Hadj U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
MOKHTARI Mohamed U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
PICARD C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> CEREN Va<strong>la</strong>bre/France<br />
PORTERIE Bernard IUSTI Marseille/France<br />
RAHAL Faya<strong>la</strong> U. Mohamed Khi<strong>de</strong>r Biskra/Algérie<br />
REBHI Mustapha U. Ab<strong>de</strong>lhamid Ibn Badis Mostaganem/Algérie<br />
REIN Guillermo E<strong>de</strong>nburg E<strong>de</strong>nburg/Scott<strong>la</strong>nd<br />
RIGOLLET Laurence IRSN Cadarache/France<br />
ROGAUME Thomas Institut Pprime Poitiers/France<br />
SABI Fatima Zohra U.S.T.O. Oran/Algérie<br />
SAHAR-MEDDOUR Ouahiba U. Mouloud Mammeri Tizi Ouzou/Algérie<br />
SEKKIOU Soumia U. Mentouri Khenche<strong>la</strong>/Algérie<br />
VANTELON Jean Pierre Institut Pprime Poitiers/France<br />
Entreprises participant à ce colloque :<br />
Direction Générale <strong><strong>de</strong>s</strong> Forêt (Algérie)<br />
ENTEC (Algérie)<br />
CCS Environnement (Algérie)<br />
98
STOP FEU, Oran 2010<br />
La Recherche en Algérie<br />
Enseignement Supérieur <strong>et</strong> Recherche Scientifique en Algérie<br />
L’enseignement supérieur <strong>et</strong> <strong>la</strong> Recherche Scientifique est sous <strong>la</strong> tutelle du Ministère <strong>de</strong><br />
l’Enseignement Supérieur <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche Scientifique MESRS (www.mesrs.dz).<br />
Enseignement supérieur :<br />
Il existe en Algérie 36 Universités, 15 Centres Universitaires, 16 Ecoles Nationales<br />
Supérieures <strong>et</strong> 5 Ecoles Normales Supérieures.<br />
Liste <strong><strong>de</strong>s</strong> Universités algériennes <strong>et</strong> leur adresse électronique<br />
Nom <strong>de</strong> l’établissement<br />
Université Ziane Achour <strong>de</strong> Djelfa<br />
Université Yahia Farès <strong>de</strong> Médéa<br />
Université Benyoucef Benkhedda d'Alger<br />
Université Ab<strong>de</strong>rrahmane Mira <strong>de</strong> Béjaia<br />
Université Hassiba Ben Bouali <strong>de</strong> Chlef<br />
Université M'hamed Bougara <strong>de</strong> Boumerdès<br />
Université Mouloud Maameri <strong>de</strong> Tizi Ouzou<br />
Université Omar Telidji <strong>de</strong> Laghouat<br />
Université Saad Dah<strong>la</strong>b <strong>de</strong> Blida<br />
Université <strong><strong>de</strong>s</strong> sciences <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie Houari Boumediène<br />
(USTHB)<br />
Université <strong>de</strong> <strong>la</strong> Formation Continue<br />
Université d'Alger 2<br />
Université d'Alger 3<br />
Université Ab<strong>de</strong>lhak Benhamouda <strong>de</strong> Jijel<br />
Université Larbi Tebessi <strong>de</strong> Tébessa<br />
Université Larbi Ben Mhidi <strong>de</strong> Oum El Bouaghi<br />
Université Badji Moktar <strong>de</strong> Annaba<br />
Université Ferhat Abbas <strong>de</strong> Sétif<br />
Université 8 mai 1945 <strong>de</strong> Guelma<br />
Université El Hadj Lakhdar <strong>de</strong> Batna<br />
Université Mentouri <strong>de</strong> Constantine<br />
Université Mohamed Khi<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Biskra<br />
Université <strong>de</strong> M'si<strong>la</strong><br />
Université Kasdi Merbah <strong>de</strong> Ouarg<strong>la</strong><br />
Université <strong><strong>de</strong>s</strong> sciences is<strong>la</strong>miques Emir Ab<strong>de</strong>lka<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Constantine<br />
Université 20 Août 1955 <strong>de</strong> Skikda<br />
Université <strong>de</strong> Béchar<br />
Université Mascara<br />
Université Tahar Mou<strong>la</strong>y <strong>de</strong> Saida<br />
Université Aboubeker Belkaid <strong>de</strong> Tlemcen<br />
Université Ahmed Draya d'Adrar<br />
Université Ibn Khaldoun <strong>de</strong> Tiar<strong>et</strong><br />
Université El Dji<strong>la</strong>li Liabès <strong>de</strong> Sidi Bel Abbès<br />
Université Ab<strong>de</strong>lhamid Ibn Badis <strong>de</strong> Mostaganem<br />
Université d'Oran - Sénia<br />
Université <strong><strong>de</strong>s</strong> sciences <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie Mohamed Boudiaf<br />
d'Oran<br />
Site web<br />
www.univ-djelfa.dz<br />
www.univ-me<strong>de</strong>a.dz<br />
www.univ-alger.dz<br />
www.univ-bejaia.dz<br />
www.univ-chlef.dz<br />
www.umbb.dz<br />
www.ummto.dz<br />
www.web-<strong>la</strong>gh.dz/web<br />
www.univ-blida.dz<br />
www.usthb.dz<br />
www.ufc.dz<br />
www.univ-alger2.dz/<br />
www.univ-alger3.dz/<br />
www.univ-jijel.dz<br />
www.univ-tebessa.dz<br />
www.univ-oeb.dz<br />
www.univ-annaba.dz<br />
www.univ-s<strong>et</strong>if.dz<br />
www.univ-guelma.dz<br />
www.univ-batna.dz<br />
www.umc.edu.dz<br />
www.univ-biskra.dz<br />
www.univ-msi<strong>la</strong>.dz<br />
www.ouarg<strong>la</strong>-univ.dz<br />
www.univ-emir.dz<br />
www.univ-skikda.dz<br />
www.univ-bechar.dz<br />
www.univ-mascara.dz<br />
www.univ-saida.dz<br />
www.univ-tlemcen.dz<br />
www.univ-adrar.dz<br />
www.univ-tiar<strong>et</strong>.dz<br />
www.univ-sba.dz<br />
www.univ-mosta.dz<br />
www.univ-oran.dz<br />
www.univ-usto.dz<br />
99
STOP FEU, Oran 2010<br />
La Recherche en Algérie<br />
Recherche Scientifique :<br />
<strong>Le</strong>s structures <strong>de</strong> recherche sont gérées par <strong>la</strong> Direction Générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche Scientifique<br />
<strong>et</strong> du Développement Technologique GDRSDT (www.nasr-dz.org)<br />
Il existe actuellement 10 centres <strong>de</strong> recherche, 5 Unités <strong>de</strong> Recherche <strong>et</strong> plus <strong>de</strong> 800<br />
Laboratoires <strong>de</strong> recherche agréés. Il y a aussi 3 Agences Nationales <strong>de</strong> recherche :<br />
- L’Agence Nationale du Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche Universitaire (ANDRU)<br />
www.andru.gov.dz<br />
- L’agence Nationale du Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche en Santé (ANDRS)<br />
www.andrs.gov.dz<br />
- L’Agence Nationale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Valorisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Recherche <strong>et</strong> du Développement<br />
Technologique (ANVREDET) www.anvred<strong>et</strong>.gov.dz<br />
Liste <strong><strong>de</strong>s</strong> Centres <strong>et</strong> Unités <strong>de</strong> Recherche<br />
Nom <strong>de</strong> l’établissement<br />
Site web<br />
Centres <strong>de</strong> Recherche<br />
Centre <strong>de</strong> Développement <strong><strong>de</strong>s</strong> énergies renouve<strong>la</strong>bles (CDER)<br />
www.c<strong>de</strong>r.dz<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche sur l'Information Scientifique <strong>et</strong> Technique<br />
(CERIST) (CERIST)<br />
www.cerist.dz<br />
Centre <strong>de</strong> Développement <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Technologie</strong>s Avancées (CDTA) www.cdta.dz<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche Scientifique <strong>et</strong> Technique en Soudage <strong>et</strong><br />
Contrôle (CSC)<br />
www.csc.dz<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche Scientifique <strong>et</strong> Technique en Analyses Physico<br />
– Chimiques (CRAPC) www.crapc.dz<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche Scientifique <strong>et</strong> Technique sur le<br />
Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Langue Arabe (CRSTDLA)<br />
www.crstd<strong>la</strong>.dz<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche en Economie Appliquée pour le développement<br />
(CREAD)<br />
www.cread.edu.dz<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche en Anthropologie Sociale <strong>et</strong> Culturelle<br />
(CRASC)<br />
www.crasc.dz<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche Scientifique <strong>et</strong> Technique sur les Régions<br />
Ari<strong><strong>de</strong>s</strong> (CRSTRA)<br />
www.crstra.dz<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche en Biotechnologie (Constantine) (CRB) www.cerist.dz<br />
Unités <strong>de</strong> Recherche<br />
Unité <strong>de</strong> Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Technologie</strong> du Silicium (UDTS)<br />
www.udts.dz<br />
Unité <strong>de</strong> Développement <strong><strong>de</strong>s</strong> Equipements So<strong>la</strong>ires (UDES) Membres.lycos.fr/u<strong><strong>de</strong>s</strong>1988<br />
Unité <strong>de</strong> recherche en Energies Renouve<strong>la</strong>bles en Milieu Saharien<br />
adrar (URERMS)<br />
Unité <strong>de</strong> Recherche Appliquée en Energies Renouve<strong>la</strong>bles (URAER) www.uraer.dz<br />
Unité <strong>de</strong> Recherche Appliquée en Sidérurgie <strong>et</strong> Métallurgie<br />
(URASM)<br />
La nouvelle politique <strong>de</strong> Recherche en Algérie vise à renforcer les structures <strong>de</strong> recherche par<br />
<strong>la</strong> création <strong>de</strong> nouveaux Laboratoires <strong>de</strong> Recherche pour atteindre plus <strong>de</strong> 1000 pour ce<br />
quinquennat. D’autre part, un appel d’offres pour 34 Programmes Nationaux <strong>de</strong> Recherche<br />
(PNR) à été <strong>la</strong>ncé c<strong>et</strong> automne <strong>et</strong> se trouve actuellement en cours d’évaluation (voir<br />
www.nasr-dz.org).<br />
100