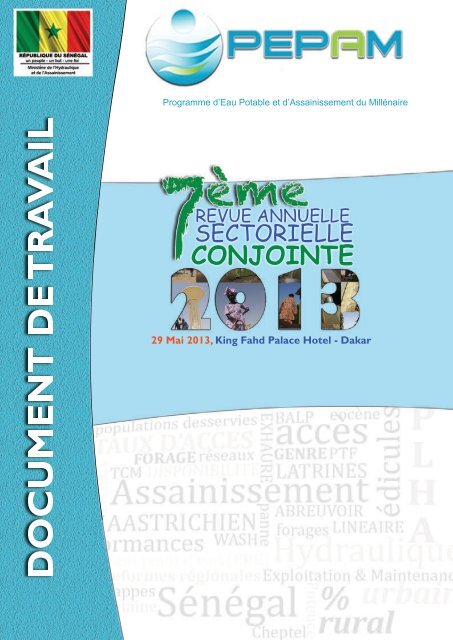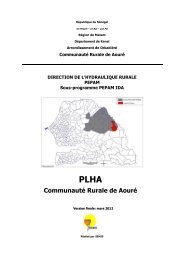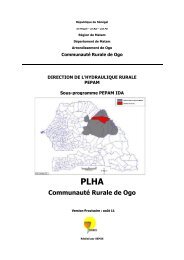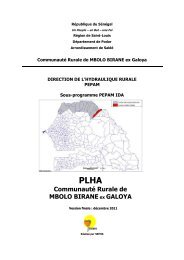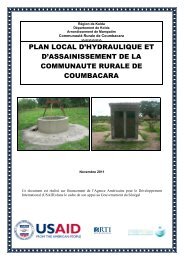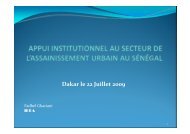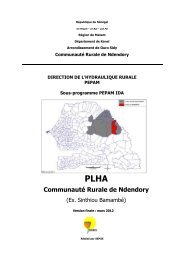Rapport de la Revue Annuelle Conjointe 2013 - pepam ...
Rapport de la Revue Annuelle Conjointe 2013 - pepam ...
Rapport de la Revue Annuelle Conjointe 2013 - pepam ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DOCUMENTDETRAVAIL<br />
Programmed’EauPotableetd’AssainissementduMilénaire<br />
REVUEANNUELLE<br />
SECTORIELLE<br />
CONJOINTE<br />
29Mai<strong>2013</strong>,KingFahdPa<strong>la</strong>ceHotel-Dakar
SOMMAIRE<br />
1 Résumé <strong>de</strong>s performances 1.1 - 1.5<br />
2 Hydraulique Rurale 2.1 - 2.7<br />
3 Assainissement Rural 3.1 - 3.6<br />
4 Hydraulique Urbaine 4.1 - 4.9<br />
5 Assainissement Urbain 5.1 - 5.5<br />
6 Cadre Unifié <strong>de</strong>s Interventions 6.1 - 6.5<br />
7 Gestion Intégrée <strong>de</strong>s Ressources en Eau 7.1 - 7.2
REVUEANNUELLE<br />
SECTORIELLE<br />
CONJOINTE<br />
1.0<br />
Résumé
1.1<br />
1. Mobilisation <strong>de</strong>s financements<br />
1.1 Situation du portefeuille <strong>de</strong>s opérations<br />
Pour l’année <strong>2013</strong>, le volume global <strong>de</strong>s financements mobilisés ou prévisibles dans le cadre du PEPAM<br />
porte sur une enveloppe totale <strong>de</strong> 537,145 milliards FCFA mobilisés sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2005-2012 ; ce<br />
correspond à une moyenne globale <strong>de</strong> 67,14 milliards FCFA par an. Cette bonne performance se<br />
rapproche beaucoup <strong>de</strong> <strong>la</strong> moyenne théorique attendue étant <strong>de</strong> 67,7 milliards FCFA sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s<br />
677 milliards FCFA constituant le coût total du programme sur les dix (10) ans. On a relevé une assez<br />
bonne tendance en effet net même si par ailleurs on relève un ralentissement sur les capacités réelles<br />
mobilisation <strong>de</strong> nouveaux financements qui étaient <strong>de</strong> 75 milliards FCFA en moyenne par an en 2011<br />
et 71 milliards CFA en 2012. Ce portefeuille est constitué en majorité <strong>de</strong> Prêts (53,6%) ; suit ensuite <strong>la</strong><br />
catégorie <strong>de</strong>s Subventions (31,7%) alors que les ressources mobilisées par l’Etat directement dans le<br />
cadre du BCI représentent 12,2% <strong>de</strong>s financements globaux. Les collectivités locales apparaissent<br />
comme <strong>de</strong>s contributeurs importantes dans le financement du secteur avec une mobilisation <strong>de</strong> 1,9%<br />
sur bases d’inscriptions dans leur budget propre ou en y intégrant <strong>de</strong>s appuis souvent issus <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
coopération décentralisée. Les contributions directes <strong>de</strong>s ONG intégrées dans le lot <strong>de</strong>s subventions<br />
représentent spécifiquement 3,3% <strong>de</strong>s financements mobilisés ; ce qui démontre tout l’intérêt <strong>de</strong> bien<br />
col<strong>la</strong>borer avec cette importante catégorie d’acteurs pour faire bénéficier au secteur <strong>de</strong> leurs capacités<br />
<strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> fonds mais aussi <strong>de</strong> leur flexibilité dans <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s opérations.<br />
Figure 1 = Mobilisation <strong>de</strong>s financements du PEPAM - <strong>2013</strong><br />
Sous-secteurs Sources Montant % sous-secteurs<br />
Assainissement Rural Etat 3 510 5,8%<br />
Prêt 29 450 48,5%<br />
Subvention 27 780 45,7%<br />
Total Assainissement Rural 60 740 100,0%<br />
Assainissement Urbain Collectivités 244 0,1%<br />
Etat 34 358 20,0%<br />
Prêt 103 177 60,0%<br />
Subvention 34 121 19,8%<br />
Total Assainissement Urbain 171 901 100,0%<br />
Hydraulique Rurale Collectivités 9 700 4,7%<br />
Etat 27 729 13,5%<br />
Prêt 72 361 35,2%<br />
Subvention 95 796 46,6%<br />
Total Hydraulique Rurale 205 586 100,0%<br />
Hydraulique Urbaine Prêt 82 934 83,8%<br />
SONES 3 300 3,3%<br />
Subvention 12 684 12,8%<br />
Total Hydraulique Urbaine 98 918 18,4%<br />
Total général 537 145 100,0%<br />
0,6%<br />
Répartition <strong>de</strong>s financements mobilisés et prévisibles du secteur<br />
PEPAM 2015. Décembre 2012<br />
31,7%<br />
1,9%<br />
12,2%<br />
53,6%<br />
Collectivités Etat Prêt SONES Subvention<br />
Sous-secteurs Prévus Réajustés Mobilisés Taux<br />
Hydraulique Rurale 165 716 225 716 205 586 91,1%<br />
Hydraulique Urbaine 139 426 139 426 98 918 70,9%<br />
TOTAL 1 305 142 365 142 304 504 83,4%<br />
Assainissement Rural 91 580 91 580 60 740 66,3%<br />
Assainissement Urbain 220 600 220 600 171 901 77,9%<br />
TOTAL 2 312 180 312 180 232 641 74,5%<br />
TOTAL 617 322 677 322 537 145 79,3%<br />
On relève ainsi que le niveau global <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong>s financements du PEPAM s’établit à 79,3% <strong>de</strong>s<br />
prévisions (contre 63,1% en 2012) à moins <strong>de</strong> trois (03) années <strong>de</strong> l’échéance pour l’atteinte <strong>de</strong>s OMD.<br />
Cependant on relève <strong>de</strong>s différences <strong>de</strong> performances entre les différents sous-secteurs avec toujours<br />
en tête le sous-secteur <strong>de</strong> l’hydraulique rurale qui affiche un taux <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> 91,1%, suivi par<br />
l’assainissement urbain et l’hydraulique urbaine avec respectivement <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s<br />
objectifs <strong>de</strong> 77,9% et 77,9%. Il ressort que tous les sous-secteurs ont affiché <strong>de</strong>s progrès sensibles ;<br />
mais il conviendra aussi relever que pour l’assainissement urbain il y a un retard <strong>de</strong> plus en plus net<br />
dans le renouvellement du portefeuille <strong>de</strong> manière générale et <strong>de</strong>s financements orientés vers le<br />
développement <strong>de</strong> l’accès à l’assainissement <strong>de</strong>s eaux usées domestiques, en particulier.
1.2<br />
Le sous-secteur <strong>de</strong> l’assainissement rural est cette fois c<strong>la</strong>ssé en <strong>de</strong>rnière position avec 66,3% <strong>de</strong>s<br />
besoins couverts par les ressources mobilisées. Le resserrement <strong>de</strong> l’écart entre les sous-secteurs <strong>de</strong><br />
l’hydraulique et <strong>de</strong> l’assainissement qui a été enregistré en 2012 (avec seulement 0,7 points) n’est plus<br />
cette fois-ci d’actualité car <strong>la</strong> différence entre les performances <strong>de</strong> mobilisation s’est très <strong>la</strong>rgement<br />
creusée avec 8,9 points (83,5% pour l’hydraulique et 74,5% pour l’assainissement).<br />
Il ressort aussi une évolution très nette entre les milieux urbain et rural avec une ba<strong>la</strong>nce équilibrée<br />
entre les <strong>de</strong>ux : 49,6% pour le rural et 50,4% pour l’urbain. En valeur absolue le profil s’établit comme<br />
suit : 266,326 milliards FCFA pour le milieu rural et 270,819 milliards FCFA pour le milieu urbain.<br />
A <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong>s analyses ci-<strong>de</strong>ssus sur le financement du secteur, on note un recul <strong>de</strong>s subventions au profit <strong>de</strong><br />
l’en<strong>de</strong>ttement avec parallèlement une baisse, même si elle est minime, <strong>de</strong> <strong>la</strong> part d l’Etat. Les crises économique<br />
et financière au p<strong>la</strong>n international vont avoir comme impact direct une réduction <strong>de</strong>s volumes <strong>de</strong> l’Ai<strong>de</strong> Publique<br />
au Développement (APD) et partant <strong>de</strong>s ressources concessionnelles mobilisables pour appuyer les stratégies <strong>de</strong><br />
réduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté dans les pays sous développés, notamment dans <strong>la</strong> promotion <strong>de</strong> l’accès aux services<br />
sociaux <strong>de</strong> base en général et à l’eau potable et l’assainissement, en particulier.<br />
L’APD nette à l’Afrique est<br />
restée stable en 2010, à<br />
48 milliards USD (OCDE).<br />
Elle a reculé <strong>de</strong> 4 % en<br />
valeur réelle en 2012,<br />
après avoir baissé <strong>de</strong> 2 %<br />
en 2011. Dans plusieurs<br />
pays, <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
crise financière et <strong>de</strong>s<br />
turbulences dans <strong>la</strong> zone<br />
euro a conduit les<br />
pouvoirs publics à donner<br />
un tour <strong>de</strong> vis budgétaire,<br />
décision qui a eu un<br />
impact direct sur l'ai<strong>de</strong><br />
versée aux pays pauvres..<br />
Il est donc à craindre à moyen et long termes <strong>de</strong>s répercussions négatives liées à <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong><br />
transfert à titre concessionnel pour le financement <strong>de</strong>s investissements du secteur <strong>de</strong> l’eau potable et <strong>de</strong><br />
l’assainissement. Il en est <strong>de</strong> même <strong>de</strong>s appréciations modérées à fortes sur le prix <strong>de</strong> l’eau qui pourraient être<br />
subséquentes à <strong>la</strong> hausse continue du coût <strong>de</strong> l’énergie qui est un poste stratégique dans <strong>la</strong> structure <strong>de</strong>s coûts<br />
<strong>de</strong> production. Plusieurs mesures sociales ont été prises en 2012 et se poursuivent pour améliorer les conditions<br />
<strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s ménages au Sénégal. Il s’agit notamment : i) <strong>de</strong> <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiscalité sur les sa<strong>la</strong>ires dans le cadre <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> révision du Co<strong>de</strong> Général <strong>de</strong>s Impôts, (ii) le relèvement <strong>de</strong>s allocations <strong>de</strong> retraite et <strong>la</strong> Caisse Autonome pour<br />
<strong>la</strong> Couverture Ma<strong>la</strong>die Universelle (CACMU) ou encore (iii) le relèvement du prix d’achat <strong>de</strong> l’arachi<strong>de</strong> qui <strong>la</strong><br />
principale spécu<strong>la</strong>tion agricole <strong>de</strong>s ménages ruraux.<br />
Cependant même si <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> restriction <strong>de</strong>s dépenses à caractère social n’ont pas été <strong>la</strong>rgement notées,<br />
les effets cumu<strong>la</strong>tifs <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>tion, même si c’est à faible amplitu<strong>de</strong>, sur les prix <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées <strong>de</strong> première<br />
nécessité, l’énergie et les autres dépenses <strong>de</strong> consommation courante risquent d’entraîner <strong>la</strong> compression du<br />
pouvoir d’achat <strong>de</strong>s ménages.<br />
Dès lors les capacités <strong>de</strong>s ménages à payer les services d’eau potable et d’assainissement se détériorent<br />
beaucoup plus à cause <strong>de</strong> l’augmentation <strong>de</strong> l’indice <strong>de</strong>s prix à <strong>la</strong> consommation que <strong>de</strong> politiques <strong>de</strong>s pouvoirs<br />
publics. Les ajustements tarifaires sur le prix <strong>de</strong> l’eau ont été par exemple gelés en milieu urbain <strong>de</strong>puis l’année<br />
2003 tout en conservant une tarification prévoyant une tranche sociale (0,3 euro pour une consommation <strong>de</strong> 0 à<br />
20 m 3 ).
1.3<br />
Analyse <strong>de</strong>s mobilisations <strong>de</strong> financement par sources - 2012<br />
Financement du sous-secteur <strong>de</strong> l'Hydraulique en milieu<br />
rural par source - 2005-2012<br />
Financement du sous-secteur <strong>de</strong> l'Assainissement en<br />
milieu rural par source - 2005-2012<br />
BAD<br />
Etat<br />
UEMOA<br />
Luxembourg<br />
ONG<br />
IDA<br />
JICA<br />
UE<br />
Collectivités locales<br />
Belgique<br />
USAID<br />
BIDC<br />
BID<br />
BADEA<br />
Corée<br />
FSD<br />
Turquie<br />
Espagne<br />
Chine<br />
JICA<br />
BOAD<br />
AFD<br />
BEI<br />
UEMOA<br />
UE<br />
IDA<br />
SONES<br />
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000<br />
Financement du sous-secteur <strong>de</strong> l'Hydraulique en milieu<br />
urbain par source - 2005-2012<br />
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000<br />
BAD<br />
Etat<br />
IDA<br />
UE<br />
Luxembourg<br />
UEMOA<br />
ONG<br />
Belgique<br />
USAID<br />
JICA<br />
Collectivités locales<br />
BIDC<br />
BID<br />
BADEA<br />
Corée<br />
FSD<br />
UNICEF<br />
Turquie<br />
WSSCC-UNOPS<br />
Espagne<br />
EAA<br />
Chine<br />
UN HABITAT<br />
Financement du sous-secteur rural par source - 2005-2012<br />
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000<br />
BAD<br />
IDA<br />
UE<br />
Belgique<br />
USAID<br />
Etat<br />
Luxembourg<br />
ONG<br />
UNICEF<br />
WSSCC-UNOPS<br />
JICA<br />
EAA<br />
UN HABITAT<br />
BADEA<br />
Belgique<br />
USAID<br />
UN HABITAT<br />
Collectivités locales<br />
0 5000 10000 15000 20000 25000<br />
Etat<br />
IDA<br />
UE<br />
BAD<br />
AFD<br />
BEI<br />
NDF<br />
BID<br />
ONG<br />
FAE<br />
IDA<br />
Etat<br />
UE<br />
AFD<br />
JICA<br />
BOAD<br />
BEI<br />
BAD<br />
NDF<br />
BADEA<br />
UEMOA<br />
SONES<br />
BID<br />
Belgique<br />
ONG<br />
FAE<br />
USAID<br />
UN HABITAT<br />
Collectivités locales<br />
Financement du sous-secteur <strong>de</strong> l'Assainissement en<br />
milieu urbain par source - 2005-2012<br />
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000<br />
Financement du sous-secteur urbain par source - 2005-2012<br />
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000<br />
1.2 Situation <strong>de</strong>s financements sur ressources internes <strong>de</strong> l’Etat<br />
i. Sous-secteur <strong>de</strong> l’Hydraulique rurale<br />
Depuis le démarrage du Programme d’Eau Potable et d’Assainissement (PEPAM) en 2005, les<br />
contributions <strong>de</strong> l’Etat sur ressources propres, en termes <strong>de</strong> programmations budgétaires, se chiffrent<br />
à un montant <strong>de</strong> 44.670 millions FCFA, soit une moyenne par an 6.381,48 millions FCFA. De 3.674<br />
millions FCFA en 2006, les ressources programmées ont atteint un montant <strong>de</strong> 9.555 F CFA millions en<br />
2011 et 6.609 FCFA millions en 2012. Cette tendance globale haussière (on note tout <strong>de</strong> même une<br />
nette baisse re<strong>la</strong>tive sur les crédits ouverts <strong>de</strong> 31% en 2012) reflète plutôt bien <strong>la</strong> ferme volonté du<br />
Gouvernement d’accroître <strong>de</strong> manière sensible ses efforts financiers en direction du secteur en vue<br />
d’améliorer le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural.<br />
Toutefois, cette volonté du Gouvernement a été fortement ébranlée par <strong>la</strong> crise mondiale économique<br />
et financière intervenue en 2008. Par ailleurs, malgré les difficultés structurelles du Trésor Public, les<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> paiement introduites par le ministère chargé <strong>de</strong> l’hydraulique rurale ont connu un bon<br />
niveau <strong>de</strong> satisfaction si l’on compare les montants effectivement engagés aux montants payés. En<br />
effet, le taux d’exécution financière sur cette base est passé <strong>de</strong> 53,12 % en 2006 à 83,73 % en 2010.
1.4<br />
Pour 2012, les montants programmés dans le Budget Consolidé d’Investissement (BCI) se sont élevés à<br />
6.609 millions FCFA. Sur ce montant, 2.809 millions FCFA ont fait l’objet d’engagement soit un taux<br />
d’engagement <strong>de</strong>s crédits ouverts <strong>de</strong> 43% ; le taux <strong>de</strong> règlement sur ces montants engagés est <strong>de</strong><br />
98,7%. En d’autres termes 57% <strong>de</strong>s crédits alloués au secteur, soit 3.800 FCFA millions, n’ont pas été<br />
engagés et sont par conséquent <strong>de</strong> ressources perdues par le secteur puisque non reportables sur le<br />
principe à une autre gestion.<br />
L’analyse <strong>de</strong> l’indicateur (crédits ouverts vs crédits<br />
engagés) sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2006-2012 révèle que le<br />
secteur <strong>de</strong> l’hydraulique rurale a ainsi perdu <strong>de</strong>s<br />
ressources d’un montant <strong>de</strong> 14.043 millions FCFA.<br />
Cette perte pour le secteur peut être due par <strong>de</strong>s<br />
procédures <strong>de</strong> dépenses publiques très longues<br />
mais surtout par une faible capacité <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>nification et <strong>de</strong> gestion au niveau <strong>de</strong>s<br />
différentes agences d’exécution.<br />
Sur les 2.809 millions FCFA engagés, un montant <strong>de</strong><br />
2.275 millions FCFA a fait l’objet <strong>de</strong> paiement à <strong>la</strong><br />
date du 31 décembre 2012, soit un taux<br />
d’exécution financière <strong>de</strong> 98,7%.<br />
Monatants (Millions FCFA)<br />
Exécution <strong>de</strong>s ressources internes du BCI - Hydraulique Rurale - 2005-2012<br />
9000,00<br />
8000,00<br />
7000,00<br />
6000,00<br />
5000,00<br />
4000,00<br />
3000,00<br />
2000,00<br />
1000,00<br />
0,00<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Crédits ouverts 3054,00 3816,17 8030,94 3391,51 5070,88 5988,81 8324,55 6609,00<br />
Montants engagés 2665,19 3111,75 3662,13 2711,22 3082,53 5866,74 5945,75 2809<br />
Montants payés 3574,00 2027,19 3252,78 2921,58 2952,91 5051,13 5174,54 2775<br />
ii. Sous-secteur <strong>de</strong> l’Assainissement rural<br />
Jusqu’à une pério<strong>de</strong> très récente, l’assainissement rural constitue un peu le maillon le plus faible dans<br />
le secteur. En effet, il n’était pas jusque là considéré, à un niveau assez satisfaisant, comme un secteur<br />
prioritaire comme l’attestent les statistiques financières. Les investissements dits publics dans le soussecteur<br />
<strong>de</strong> l’assainissement rural n’ont démarré qu’en 2005. Aucun flux public n’a été enregistré sur <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> antérieure. De 2006 à 2012, les montants programmés après ajustements budgétaires pour le<br />
sous secteur se sont élevés à 3.169,60 millions FCFA ; soit une moyenne annuelle 396,20 millions FCFA.<br />
Cependant, à partir <strong>de</strong> l’année 2012 on note une augmentation très sensible <strong>de</strong>s inscriptions pour le<br />
sous-secteur <strong>de</strong> l’assainissement rural faisant suite aux engagements du Ministère <strong>de</strong>s Finances du<br />
Sénégal au Sommet 2010 <strong>de</strong> l’Initiative Assainissement et Eau pour Tous tenu à Washington. C’est ainsi<br />
que <strong>de</strong> 126 millions FCFA en 2005, les crédits ouverts sont passés à 660 millions FCFA en 2012 et 1<br />
milliards FCFA en <strong>2013</strong>.<br />
Cependant les performances en termes d’engagement et <strong>de</strong> règlement ont été plutôt médiocres. En<br />
effet, le taux d’engagement moyen sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2006-2012 est <strong>de</strong> 68% alors que le taux d’exécution<br />
moyen sur <strong>la</strong> même pério<strong>de</strong> est <strong>de</strong> 62%.<br />
Monatants (Millions FCFA)<br />
Exécution <strong>de</strong>s ressources internes du BCI - Assainissement Rural -<br />
2005-2012<br />
700,00<br />
600,00<br />
500,00<br />
400,00<br />
300,00<br />
200,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Crédits ouverts 126,00 343,20 413,20 349,86 477,40 400,00 399,94 660<br />
Montants engagés 125,28 299,94 206,63 206,63 237,71 399,93 203,23 300<br />
Montants payés 106,62 41,97 124,90 206,63 94,65 50,71 182,00 288<br />
Comme pour l’hydraulique rurale et malgré <strong>la</strong><br />
modicité <strong>de</strong>s ressources budgétaires<br />
programmées, le sous secteur <strong>de</strong><br />
l’assainissement rural a perdu <strong>de</strong>s ressources<br />
d’un montant <strong>de</strong> 1.190,25 millions FCFA sur un<br />
total <strong>de</strong> 3.169,60 millions FCFA programmés<br />
durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2006-2012.
1.5<br />
iii. Sous-‐secteur <strong>de</strong> l’Assainissement urbain <br />
Il convient <strong>de</strong> faire remarquer sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2000-‐2004, les prévisions d’investissement n’ont jamais <br />
dépassé 400 millions par an. C’est en 2005 que pour <strong>la</strong> première fois un montant <strong>de</strong> 6.467 millions a <br />
été enregistré. Et <strong>de</strong>puis cette date, l’Etat budgétise en moyenne sur ressources internes par an <br />
environ 5.340,56 millions FCFA donnant ainsi un cumul d’investissements programmés <strong>de</strong> 2006 à 2012 <br />
<strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 42.724,28 millions FCFA. Par ailleurs, le sous secteur <strong>de</strong> l’assainissement urbain <br />
contrairement à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural n’a pas tellement souffert <strong>de</strong>s effets <br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> crise mondiale <strong>de</strong> 2008. Les taux d’exécution sur le p<strong>la</strong>n financier peuvent être qualifiés <br />
d’exceptionnels. En effet, les taux d’exécution atteignent généralement 100% par an. <br />
Ainsi, si avant 2011, <strong>de</strong>s structures telles que <br />
l’ONAS pouvait en début d’année mobiliser leurs <br />
crédits budgétaires quelque fut <strong>la</strong> maturité <strong>de</strong>s <br />
dépenses y afférentes, tel n’est plus le cas <br />
aujourd’hui. <br />
Monatants (Millions FCFA) <br />
Exécution <strong>de</strong>s ressources internes du BCI -‐ Assainissement Urbain -‐<br />
2005-‐2012<br />
En 2012, les crédits disponibles après prélèvements <br />
s’élèvent à un montant 5.806 millions FCFA dont <strong>la</strong> <br />
totalité a fait l’objet <strong>de</strong> paiement comme ressorti <br />
3000,00<br />
2000,00<br />
1000,00<br />
par le Système Intégré <strong>de</strong> Gestion <strong>de</strong>s Finances <br />
Publiques (SIGFIP) <br />
0,00<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Crédits ouverts 3010,40 6556,38 5757,12 4261,83 4668,75 7108,00 5556,00 5806,00<br />
8000,00<br />
7000,00<br />
6000,00<br />
5000,00<br />
4000,00<br />
Montants engagés 2721,54 6180,56 5869,00 4243,25 4611,80 7108,00 5556,00 5806<br />
Montants payés 2721,54 5937,50 5569,58 4257,43 4609,27 7050,00 5556,00 5806<br />
2. Evolution <strong>de</strong>s indicateurs majeurs pour l’atteinte <strong>de</strong>s OMD <br />
En fin décembre 2012, les indicateurs d’accès ont connu <strong>de</strong>s progressions positives plutôt moyens à <br />
élevés en fonction <strong>de</strong>s sous-‐secteurs ; ces résultats traduisent globalement <strong>de</strong> nets progrès par rapport <br />
à <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> décembre 2011. Toutefois si pour l’hydraulique les valeurs atteintes en 2011 sont en <br />
ligne ou dépassent les cibles retenues dans <strong>la</strong> liste dominante <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice <strong>de</strong>s indicateurs <strong>de</strong> suivi du <br />
DPES (mais en <strong>de</strong>çà <strong>de</strong>s prévisions sectorielles établies en 2010 cib<strong>la</strong>nt l’atteinte <strong>de</strong>s OMD dès 2012), <br />
les écarts négatifs se creusent <strong>de</strong> plus en plus pour le sous-‐secteur <strong>de</strong> l’assainissement. <br />
Le taux global (urbain et rural) d’accès à l’eau potable est égal à 89,5% alors que celui concernant <br />
l’assainissement (urbain et rural) se situe à 47,7%. <br />
Des résultats satisfaisants pour le secteur <strong>de</strong> l’eau potable et <br />
à renforcer rapi<strong>de</strong>ment pour l’assainissement ; même si <br />
pour cette <strong>de</strong>rnière les chances d’atteindre les OMD sont <br />
quasi-‐compromises. Il faudra désormais travailler à <br />
maximiser les performances et s’inscrire dans un horizon <br />
post 2015. <br />
Sous-‐secteurs Milieu # démographique Taux d'accès<br />
Rural 55% 81,2%<br />
Hydraulique<br />
Urbain 45% 99,6%<br />
Total Eau Potable 100% 89,5%<br />
Rural 55% 35,6%<br />
Assainissement<br />
Urbain 45% 62,4%<br />
Total Assainissement 100% 47,7%
REVUEANNUELLE<br />
SECTORIELLE<br />
CONJOINTE<br />
2.0<br />
Hydraulique<br />
Rurale
2.1<br />
2. Développement <strong>de</strong> l'accès à l'eau potable<br />
2.1 Mobilisation <strong>de</strong>s financements<br />
Les ressources mobilisées et pour le développement <strong>de</strong> l'accès à l'eau potable et le cadre unifié <strong>de</strong>s<br />
interventions sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2005-2012 s'élèvent au total à 205,586 milliards FCFA pour <strong>de</strong>s besoins<br />
estimés à 225,716 milliards FCFA, soit un taux <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> 91,1% contre 78,2% en fin 2011. Ces<br />
ressources comprennent (i) les financements <strong>de</strong>s partenaires au développement du secteur, mis en<br />
œuvre par les agences d'exécution du PEPAM (ii) le budget national et (iii) les financements mobilisés<br />
par l'ensemble <strong>de</strong>s autres acteurs. Cette donnée traduit une évolution positive <strong>de</strong> 29,1 milliards FCFA<br />
en valeur absolue et 13% en valeur re<strong>la</strong>tive par rapport à décembre 2011.<br />
Sous-secteurs Sources Montant % sous-secteurs<br />
Hydraulique Rurale Collectivités 9 700 4,7%<br />
Etat 27 729 13,5%<br />
Prêt 72 361 35,2%<br />
Subvention 95 796 46,6%<br />
Total Hydraulique Rurale 205 586 100,0%<br />
Luxembourg<br />
ONG<br />
Collectivités locales<br />
Belgique<br />
USAID<br />
Financement du sous-secteur <strong>de</strong> l'Hydraulique en milieu<br />
rural par source - 2005-2012<br />
BAD<br />
Etat<br />
UEMOA<br />
IDA<br />
JICA<br />
UE<br />
BIDC<br />
BID<br />
BADEA<br />
Corée<br />
FSD<br />
Turquie<br />
Espagne<br />
Chine<br />
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000<br />
Les financements <strong>de</strong>s bailleurs <strong>de</strong> fonds mis en œuvre par les agences d'exécution du PEPAM s'élèvent<br />
à 154,957 milliards FCFA dont 82,596 milliards FCFA en prêts (47%) et 72,361 milliards FCFA sous<br />
forme <strong>de</strong> subventions non remboursables (53%). On relève <strong>la</strong> dimension sociale <strong>de</strong> ce portefeuille<br />
majoritairement constituée <strong>de</strong> subventions ; ce portefeuille connaît du reste un renouvellement avec<br />
<strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s opérations dont certaines ont duré plus <strong>de</strong> 5 ans et <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong> nouvelles<br />
autres. Le financement <strong>de</strong> l'Etat, pour <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> précision, porte sur les montants effectivement<br />
payés par le Trésor Public en lieu et p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s inscriptions budgétaires au regard <strong>de</strong>s écarts parfois très<br />
importants entre ces <strong>de</strong>rniers avec les engagements et les règlements effectifs. Les ressources<br />
mobilisées par l’Etat sont ainsi établies à 27,729 milliards FCFA en fin 2012.<br />
Les financements hors agences d'exécution sont constitués pour l’essentiel par les ressources<br />
mobilisées sur ressources propres <strong>de</strong>s collectivités locales, à travers <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> concours spéciaux ou<br />
dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération décentralisée et qui vont principalement à l’eau. En ce qui concerne<br />
cette catégorie, les ressources sont estimées à 9,7 milliards FCFA en 2012 sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s informations<br />
disponibles. Le reste du financement est constitué par les subventions directes à <strong>de</strong>s ONG du Nord ou<br />
du Sud par certains partenaires techniques et financiers ou encore par <strong>de</strong>s agences <strong>de</strong> l’eau du Nord<br />
ou encore les ressources mobilisées dans le cadre <strong>de</strong>s initiatives <strong>de</strong> co-développement. Pour cette<br />
<strong>de</strong>rnière catégorie, le niveau <strong>de</strong> mobilisation atteint en 2011 s’élève à 13,2 milliards FCFA.<br />
Répartition <strong>de</strong>s financements mobilisés et prévisibles du sous-secteur <strong>de</strong><br />
l'hydraulique rurale - PEPAM 2015. Décembre 2012<br />
46,6%<br />
4,7%<br />
13,5%<br />
35,2%<br />
Des résultats importants ont été enregistrés au<br />
niveau du sous-secteur <strong>de</strong> l’Hydraulique Rurale<br />
avec un taux <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> 78,2%. La structure<br />
du portefeuille permet <strong>de</strong> saisir <strong>la</strong> dimension<br />
sociale du sous-secteur avec un maximum <strong>de</strong><br />
subvention dans le cadre du budget <strong>de</strong> l’Etat, <strong>de</strong>s<br />
collectivités locales ou <strong>de</strong>s concours directs <strong>de</strong>s<br />
bailleurs <strong>de</strong> fonds et <strong>de</strong>s acteurs non étatiques.<br />
Collectivités Etat Prêt Subvention
2.2<br />
2.2 Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural<br />
L’analyse <strong>de</strong> l’indicateur d’accès à l’eau potable est basée sur <strong>la</strong> méthodologie d’inventaire <strong>de</strong>s points<br />
d’eau fonctionnels à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> référence considérée ; cette approche révèle alors à cette pério<strong>de</strong><br />
retenue un bi<strong>la</strong>n ponctuel permettant <strong>de</strong> mesurer <strong>la</strong> quantité réelle d’offre <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte en tenant<br />
compte <strong>de</strong>s différents points <strong>de</strong> distribution <strong>de</strong> type amélioré. Ainsi sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s résultats du <strong>de</strong>rnier<br />
inventaire national <strong>de</strong>s points d’accès à l’eau potable au premier trimestre <strong>de</strong> 2012 sur 15.496<br />
localités (avec l’appui <strong>de</strong>s services régionaux, départements, locaux et <strong>de</strong>s collectivités locales), le taux<br />
national d'accès à l'eau potable en milieu rural est estimé à fin décembre 2012 à 81,2% contre 80,1%<br />
en décembre 2011, soit une légère amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>sserte en eau potable en milieu rural avec une<br />
hausse <strong>de</strong> +1,1 points.<br />
Le taux national d’accès par adduction d’eau potable (personnes <strong>de</strong>sservies par le biais <strong>de</strong>s bornes<br />
fontaines et branchements particuliers à partir <strong>de</strong> forages ou <strong>de</strong> stations <strong>de</strong> traitement d’eau) s’établit<br />
à 66,6% contre 64,0% en 2012 ; ce qui démontre une nette augmentation du taux d’accès par<br />
adduction d’eau sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2005-2012 alors que dans le sens opposé l’accès par puits protégés<br />
diminue progressivement et s’établit à 14,6% en fin 2012 traduisant ainsi une amélioration continue<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité et <strong>de</strong> l’échelle <strong>de</strong> l’accès.<br />
Les performances enregistrées en 2012 n’ont pas été à <strong>la</strong> hauteur <strong>de</strong>s prévisions initiales qui fixaient<br />
une cible <strong>de</strong> 315.000 personnes à <strong>de</strong>sservir à travers les différentes opérations du PEPAM. Cependant<br />
<strong>de</strong>s retards plus ou moins importants ont empêché <strong>la</strong> mise en service <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions mises en p<strong>la</strong>ce<br />
avant <strong>la</strong> fin du mois <strong>de</strong> décembre 2012.<br />
Le taux d’accès <strong>de</strong> 2012 est formé à hauteur <strong>de</strong> 66,6% par adduction d’eau (bornes fontaines et<br />
branchements domiciliaires) et 14,6% à partir <strong>de</strong>s puits mo<strong>de</strong>rnes protégés et <strong>de</strong>s forages équipés <strong>de</strong><br />
pompes à motricité humaine. Ces chiffres démontrent qu’il y a <strong>de</strong> plus en plus un recul <strong>de</strong> l’accès par<br />
puits qui était <strong>de</strong> 20% en fin 2009, 17% en fin 2010 et 16,1% en fin 2011 ; ce<strong>la</strong> se justifie bien du reste<br />
au regard <strong>de</strong> <strong>la</strong> consistance <strong>de</strong>s nouvelles opérations qui privilégient <strong>la</strong> réalisation d’adductions d’eau<br />
pour améliorer <strong>la</strong> qualité et <strong>la</strong> durabilité <strong>de</strong> l’accès et surtout l’objectivité <strong>de</strong> plus en plus grandissante<br />
dans le cib<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s zones d’intervention basé sur le choix prioritaires <strong>de</strong>s zones où les taux d’accès par<br />
puits mo<strong>de</strong>rnes sont élevés.<br />
Evolution du taux d'accès à l'eau potable en milieu rural. 2005-2011<br />
Une progression constante dans<br />
l’amélioration <strong>de</strong> l’accès à l’eau<br />
potable en milieu rural. Les<br />
tendances vont se confirmer en<br />
<strong>2013</strong> avec <strong>la</strong> mise en service <strong>de</strong>s<br />
ouvrages réalisés dans le cadre<br />
<strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s opérations<br />
actuellement en cours en <strong>2013</strong>.<br />
Taux d'accès (%)<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Taux d'accès 64% 69,50% 72,40% 75,50% 73,60% 77,50% 80,10%<br />
Les retards notés dans <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s opérations sont occasionnés par <strong>de</strong>s contraintes liées<br />
essentiellement au niveau <strong>de</strong> performance <strong>de</strong>s entreprises mais également à <strong>de</strong>s lenteurs notées sur <strong>la</strong><br />
passation <strong>de</strong>s marchés. Ce constats militent dès lors pour un renforcement <strong>de</strong>s capacités du secteur<br />
privé local afin d’optimiser leur compétitivité en matière d’offre <strong>de</strong> service surtout en matière <strong>de</strong><br />
travaux <strong>de</strong> forages ; au cas contraire les entreprises nationales risquent <strong>de</strong> passer à côté <strong>de</strong>s multiples<br />
effets bénéfiques liés à l’option d’é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong>s opportunités pour le secteur privé.
2.3<br />
2.3 L’analyse <strong>de</strong>s disparités zonales<br />
Les disparités entre les régions en matière d’accès sont une donnée constante qui résulte <strong>de</strong>s<br />
différences <strong>de</strong> niveau d’investissement (avant le démarrage du PEPAM) entre les différentes parties du<br />
pays et qui peut aussi être aggravé par d’autres réalités qui peuvent être d’ordre hydrogéologique<br />
(zone <strong>de</strong> socle) voire sociologique (préférence pour les puits dans <strong>la</strong> zone <strong>de</strong> Casamance) poussant les<br />
popu<strong>la</strong>tions vers un mo<strong>de</strong> d’approvisionnement spécifique.<br />
L’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>sserte montre qu’il n’ya pas eu beaucoup <strong>de</strong> changements par<br />
rapport à 2012 et que les disparités existent toujours entre les différentes zones du pays avec <strong>de</strong> plus<br />
en plus <strong>de</strong>s améliorations en termes <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s écarts inter-régionaux. Sept (07) régions sur<br />
treize (hors Dakar) présentent un taux d’accès global supérieur à <strong>la</strong> moyenne nationale ; <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième<br />
catégorie <strong>de</strong> régions présente <strong>de</strong>s taux moyens inférieurs seulement <strong>de</strong> maximum 2 points par rapport<br />
à <strong>la</strong> moyenne nationale.<br />
100,0%<br />
90,0%<br />
80,0%<br />
70,0%<br />
Distribution du taux d'accès par région - Décembre 2012<br />
Taux d'accès (%)<br />
60,0%<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
KEDOU DIOUR SLOUIS KAOLA THIES FATICK KAFFR MATAM ZIGUIN TAMBA LOUGA SEDHI KOLDA<br />
Accès Global 94,4% 92,1% 91,5% 89,3% 89,1% 83,6% 82,9% 79,7% 79,2% 79,0% 78,1% 65,6% 48,8%<br />
Accès par AEP 12,2% 90,9% 83,3% 77,8% 87,5% 74,5% 79,1% 69,5% 42,1% 46,3% 75,3% 23,7% 19,5%<br />
Moyenne Nationale 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20% 81,20%<br />
Comme <strong>de</strong> par les années précé<strong>de</strong>ntes, <strong>la</strong> zone Sud continue d’afficher les plus faibles performances<br />
<strong>de</strong>puis le <strong>la</strong>ncement du PEPAM avec surtout une gran<strong>de</strong> vo<strong>la</strong>tilité <strong>de</strong> l’accès qui est essentiellement<br />
porté par les puits mo<strong>de</strong>rnes, qui même s’ils sont <strong>de</strong>s systèmes améliorés, constituent tout <strong>de</strong> même<br />
un recours plus ou moins précaire. Ce<strong>la</strong> <strong>de</strong>vrait inciter le sous-secteur <strong>de</strong> l’hydraulique rurale à penser<br />
<strong>de</strong> plus en plus à <strong>de</strong>s systèmes d’approvisionnement en eau potable très innovants basés dans les<br />
opérations <strong>de</strong> transfert d’eaux <strong>de</strong> surface pour garantir un approvisionnement durable <strong>de</strong> ces zones.<br />
Par ailleurs le cib<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> Zone Sud par les nouvelles opérations du PEPAM-UE et du PSEA avec <strong>de</strong>s<br />
réalisations très consistantes permettra <strong>de</strong> modifier le profil <strong>de</strong> l’accès dans cette partie du pays dans<br />
les prochaines années.<br />
La région <strong>de</strong> Kédougou a fortement ressenti l’effet <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux phases du PEPAM-UEMOA qui ont permis<br />
<strong>de</strong> couvrir presque tous les vil<strong>la</strong>ges avec <strong>de</strong>s forages équipés <strong>de</strong> pompes à motricité humaine ; ce qui a<br />
permis <strong>de</strong> booster <strong>de</strong> manière très sensible les taux d’accès. Par contre <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Louga continue<br />
d’afficher un taux inférieur à 80% (78%) par le seul fait <strong>de</strong> l’effet dépréciatif du département <strong>de</strong><br />
Linguère.<br />
En effet, les <strong>de</strong>ux départements <strong>de</strong> Kébémer et <strong>de</strong> Louga affichent <strong>de</strong>s taux respectifs <strong>de</strong> 83,7% et<br />
86,3% grâce aux résultats imputables aux sous-programmes PEPAM-BAD1 et PEPAM-SEN026, Vil<strong>la</strong>ges<br />
du Millénaires ou encore le PNDL ; alors que le département <strong>de</strong> Linguère n’est crédité que d’un accès<br />
global <strong>de</strong> 59,8% pour un poids démographique <strong>de</strong> 28% <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion régionale. Ceci est du reste le<br />
motif principal qui a justifié le cib<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> ce département par le Luxembourg pour orienter son<br />
financement délégué à <strong>la</strong> Coopération Technique Belge dans le cadre du PIC III.
2.4<br />
L’analyse du phénomène <strong>de</strong> <strong>la</strong> disparité est encore plus précise quand on se concentre sur l’accès par<br />
adduction d’eau ; le resserrement est plus visible mais concerne <strong>de</strong>s blocs plus ou moins homogènes<br />
qui affichent <strong>de</strong>s profils très proches dans une approche <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification catégorielle. Le profil noté en<br />
2011 reste encore tout à fait va<strong>la</strong>ble pour l’année 2012.<br />
On relève toujours <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> cinq (05)<br />
grands blocs plus ou<br />
moins homogènes :<br />
100,0%<br />
90,0%<br />
80,0%<br />
70,0%<br />
Distribution du taux d'accès par AEP par région - Décembre 2012<br />
Diourbel<br />
B1 Thiès<br />
Saint-Louis<br />
Kaffrine<br />
B2 Louga<br />
Kao<strong>la</strong>ck<br />
B3 Matam<br />
Fatick<br />
B4 Ziguinchor<br />
Tamba<br />
Sédhiou<br />
B5 Kolda<br />
Kédougou<br />
Taux d'accès (%)<br />
60,0%<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
DIOUR THIES SLOUIS KAFFR KAOLA LOUGA FATICK MATAM TAMBA ZIGUIN SEDHI KOLDA KEDOU<br />
Accès par AEP 90,9% 87,5% 83,3% 79,1% 77,8% 75,3% 74,5% 69,5% 46,3% 42,1% 23,7% 19,5% 12,2%<br />
Moyenne Nationale AEP 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6%<br />
La cartographie <strong>de</strong> l’accès par<br />
adduction d’eau en eau potable<br />
suggère <strong>la</strong> nécessité d’accélérer<br />
les opérations <strong>de</strong> correction <strong>de</strong>s<br />
disparités entre les zones. Il<br />
ressort bien d’après <strong>la</strong> carte que<br />
<strong>la</strong> zone sylvo-pastorale (Linguère,<br />
Ranérou, Koumpentoum, une<br />
partie <strong>de</strong> Tamba) constitue un<br />
espace prioritaire pour <strong>de</strong><br />
nouvelles interventions. Il en est<br />
<strong>de</strong> même pour <strong>la</strong> région Sud <strong>de</strong><br />
manière générale.<br />
2.4 Analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> disponibilité du service en milieu rural<br />
La continuité du service d’eau potable est un indicateur majeur, en plus du taux d’accès, pour mieux<br />
restituer <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> service aux popu<strong>la</strong>tions ; ce<strong>la</strong> se fait en mesurant le taux <strong>de</strong> panne <strong>de</strong>s<br />
forages motorisés afin d’estimer le nombre total <strong>de</strong> jours dans l’année pendant lesquels le service<br />
d’eau potable a été continu. Sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s statistiques hebdomadaires <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> l’exploitation <strong>de</strong>s<br />
forages ruraux motorisés établies par <strong>la</strong> DEM à travers les Briga<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Puits et Forages réparties sur<br />
toute l’étendue du territoire, le taux moyen <strong>de</strong> disponibilité s’établit en décembre 2012 à 97% au<br />
niveau national contre 90,13% en décembre 2011 ; soit un gain très important <strong>de</strong> 7 points. Cette<br />
performance traduit une nette reprise en termes d’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’accès après une<br />
pério<strong>de</strong> d’instabilité mais surtout <strong>de</strong> tendance globalement baissière.
2.5<br />
Les opérations majeures <strong>de</strong><br />
renouvellement <strong>de</strong>s équipements<br />
d’exhaure financées dans le cadre <strong>de</strong>s<br />
sous-programmes PEPAM-IDA, PEPAM-<br />
BAD phase 2, Japon 13,5 et Programme<br />
d’urgence <strong>de</strong> <strong>la</strong> JICA ont permis<br />
d’améliorer <strong>de</strong> manière très sensible <strong>la</strong><br />
situation <strong>de</strong> <strong>la</strong> disponibilité <strong>de</strong>s forages<br />
ruraux motorisés. Ce<strong>la</strong> permet <strong>de</strong> réduire<br />
les pannes liées aux équipements mais<br />
ne met pas le parc à l’abri <strong>de</strong>s pannes<br />
liées aux ouvrages <strong>de</strong> captage au regard<br />
du caractère très vieillissant <strong>de</strong>s forages<br />
Taux <strong>de</strong> disponibilité<br />
Evolution du taux disponibilité <strong>de</strong>s forages ruraux motorisés -<br />
2006-2012<br />
98%<br />
96%<br />
94%<br />
92%<br />
90%<br />
88%<br />
86%<br />
84%<br />
82%<br />
80%<br />
<strong>de</strong> manière générale.<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Taux disponibilité 93% 88% 90,03% 89,40% 86,40% 90,10% 97%<br />
Ces performances pourront désormais être inscrites dans <strong>la</strong> durabilité dans <strong>la</strong> mesure où le processus<br />
<strong>de</strong> transfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> maintenance et <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s forages ruraux motorisés et <strong>de</strong> délégation ainsi<br />
<strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> délégations <strong>de</strong> service public au niveau <strong>de</strong> certaines grosses adductions d’eau ont<br />
été enclenchés par <strong>la</strong> DEM et <strong>la</strong> DH avec l’appui du WSP et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale. Ces opérations<br />
vont du reste se poursuivre dans les autres zones du pays avec les nouvelles interventions financées<br />
par <strong>la</strong> BAD, le Luxembourg, l’Union Européenne ou encore le Royaume <strong>de</strong> Belgique.<br />
2.5 Analyse <strong>de</strong>s tendances vers <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>s OMD en 2015<br />
D’après les prévisions établies dès 2011, <strong>la</strong> cible <strong>de</strong> 82% <strong>de</strong> taux d’accès global prévue pour 2015<br />
<strong>de</strong>vrait être atteinte avant l’échéance <strong>de</strong> 2015. Ces <strong>de</strong>rnières se confirment bien au regard <strong>de</strong>s<br />
résultats affichées pour décembre 2012. En effet, les opérations <strong>de</strong> mise en service <strong>de</strong>s réalisations du<br />
PEPAM-BAD2, du PEPAM-IDA, d’une partie du PEPAM-UEMOA 2, du PEPAM-BA sans compter celles<br />
concernant les projets mis en œuvre par les ONG telles ADOS se feront en majorité durant l’année<br />
<strong>2013</strong> et impacteront <strong>de</strong> manière très sensible <strong>la</strong> <strong>de</strong>sserte. Dès lors les chances pour le Sénégal<br />
d’atteindre les OMD sont intactes et seront effectives au courant <strong>de</strong> l’année <strong>2013</strong>.<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Evolution du taux d'accès à l'eau potable en milieu rural prévisons -<br />
réalisations et tendances - décembre 2011<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />
La terminaison <strong>de</strong>s opérations en<br />
cours et <strong>la</strong> mise en œuvre diligente<br />
<strong>de</strong>s nouvelles interventions<br />
permettraient <strong>de</strong> dépasser <strong>la</strong> cible<br />
<strong>de</strong> 82% en 2015. Dans <strong>la</strong> pério<strong>de</strong>, il<br />
faudra quand même surveiller les<br />
dégradations <strong>de</strong> l’accès imputables<br />
aux pannes <strong>de</strong>s ouvrages.<br />
Prévisions<br />
Réalisations/Tendances<br />
2.6 Problématique <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’eau au Sénégal<br />
La problématique <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s eaux du Sénégal est une réalité dans les régions centres du pays<br />
pour <strong>la</strong> principale nappe du bassin sénégalo-mauritanien, les zones <strong>de</strong>ltaïques pour les cours d’eau et<br />
les zones à fortes activités agroindustriel (vallée fleuve Sénégal et <strong>la</strong> cuvette <strong>de</strong> l’Anambé). Les taux <strong>de</strong><br />
chlorures et/ou <strong>de</strong> fluorures <strong>de</strong>s eaux du Maastrichtien, <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> réserve d’eau souterraine du<br />
Sénégal, constituent un facteur limitant pour son utilisation par les popu<strong>la</strong>tions. Il en est <strong>de</strong> même<br />
pour les nappes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Dakar où <strong>la</strong> teneur en nitrate dépasse les normes admissibles.
2.6<br />
La qualité <strong>de</strong> l’eau brute fournie par ces ouvrages <strong>de</strong> captage qui exploitent cette nappe ne répond pas<br />
aux normes. Les réponses apportées jusqu’ici à <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s eaux ne sont pas<br />
encore satisfaisantes du fait <strong>de</strong> leur caractère expérimental, <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments faibles et <strong>de</strong>s coûts<br />
d’exploitation re<strong>la</strong>tivement élevés.<br />
Dans une optique <strong>de</strong> prendre en charge <strong>de</strong> manière durable <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’eau, l’Etat du<br />
Sénégal compte mettre en œuvre <strong>de</strong>s solutions stratégiques et concertées, notamment : l’érection <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’eau en priorité avec <strong>la</strong> fixation d’objectifs dans le cadre <strong>de</strong> l’agenda post-OMD, <strong>la</strong> mise<br />
en p<strong>la</strong>ce d’un Comité Technique National avec une configuration intersectorielle, <strong>la</strong> réalisation d’une<br />
étu<strong>de</strong> globale pour <strong>la</strong> définition d’une stratégie nationale d’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’eau. Les<br />
résultats attendus <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> sont essentiellement :<br />
- Résultat 1 : Un état <strong>de</strong>s lieux détaillé <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> qualité physico-chimique <strong>de</strong> l’eau utilisée<br />
pour <strong>la</strong> consommation domestique par les ménages ruraux et urbains au Sénégal, incluant (i) un<br />
zonage géographique et hydrogéologique, (ii) l’estimation quantitative et <strong>la</strong> cartographie <strong>de</strong>s<br />
popu<strong>la</strong>tions touchées par un problème <strong>de</strong> qualité d’eau avec ses impacts sanitaires et socioéconomiques,<br />
(iii) l’estimation <strong>de</strong>s conséquences épidémiologiques sur les impacts sanitaires, (iv)<br />
un bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s opérations menées pour remédier à ce problème <strong>de</strong> qualité d’eau au Sénégal et<br />
éventuellement à l’étranger dans <strong>de</strong>s contextes simi<strong>la</strong>ires (v) un diagnostic du système actuel <strong>de</strong><br />
suivi <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’eau.<br />
- Résultat 2 : Une proposition <strong>de</strong> stratégie opérationnelle et <strong>de</strong> p<strong>la</strong>n d’investissement pour<br />
l’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité physico-chimique <strong>de</strong> l’eau, basée sur l’état <strong>de</strong>s lieux et incluant (i) un<br />
catalogue <strong>de</strong> solutions techniques couvrant les différents contextes physiques, locaux et socioéconomiques<br />
rencontrés, (ii) un dispositif opérationnel pour le suivi pérenne <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’eau en<br />
milieu rural et (iii) une ébauche <strong>de</strong> p<strong>la</strong>n d’investissement pour l’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’eau<br />
livrée à <strong>la</strong> consommation.<br />
- Résultat 3 : Un état <strong>de</strong>s lieux détaillé <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> qualité bactériologique <strong>de</strong> l’eau utilisée<br />
pour <strong>la</strong> consommation domestique par les ménages ruraux au Sénégal utilisant les résultats <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s déjà réalisées par le Service National <strong>de</strong> l’Hygiène.<br />
- Résultat 4 : Une proposition <strong>de</strong> stratégie opérationnelle et <strong>de</strong> p<strong>la</strong>n d’investissement pour<br />
l’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité bactériologique <strong>de</strong> l’eau en milieu rural, basée sur l’état <strong>de</strong>s lieux et<br />
incluant (i) un catalogue <strong>de</strong> solutions techniques couvrant les différents contextes physiques,<br />
locaux et socio-économiques rencontrés, (ii) un dispositif opérationnel pour le suivi pérenne <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
qualité bactériologique <strong>de</strong> l’eau en milieu rural et (iii) une ébauche <strong>de</strong> p<strong>la</strong>n d’investissement pour<br />
l’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’eau livrée à <strong>la</strong> consommation.<br />
- Résultat 5 : Un catalogue <strong>de</strong> mesures d’accompagnement portant sur <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s ressources<br />
en eau, le suivi <strong>de</strong>s ressources, <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s acteurs et les mesures légis<strong>la</strong>tives et<br />
réglementaires.
2.7<br />
Données <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>sserte à l’eau potable en milieu rural – décembre 2012<br />
Régions<br />
Départements<br />
Popu<strong>la</strong>tion<br />
2012<br />
Bornes<br />
fontaines<br />
Branchements<br />
privés<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
PM/H<br />
Vil<strong>la</strong>ges<br />
+1000 hbts<br />
sans AEP<br />
Taux <strong>de</strong><br />
Couverture<br />
Géographique<br />
global<br />
Taux <strong>de</strong><br />
Couverture Taux d'accès<br />
Géographique global<br />
par AEP<br />
Taux d'accès<br />
par AEP<br />
DIOURBEL BAMBEY 298 728 669 10 405 285 3 88,1% 85,4% 93,7% 91,9%<br />
DIOURBEL 160 275 731 2 274 91 2 87,7% 87,7% 92,4% 92,4%<br />
MBACKE 116 085 530 3 343 45 2 83,7% 82,7% 87,7% 86,3%<br />
Total DIOURBEL 575 088 1 930 16 022 421 7 86,7% 85,3% 92,1% 90,9%<br />
FATICK FATICK 292 058 1 234 4 779 480 6 96,7% 96,3% 95,9% 95,5%<br />
FOUNDIOUGNE 317 840 502 2 320 363 22 66,1% 47,4% 71,0% 53,0%<br />
GOSSAS 44 445 202 964 36 1 94,9% 93,6% 93,0% 90,8%<br />
Total FATICK 654 343 1 938 8 063 879 29 78,6% 67,4% 83,6% 74,5%<br />
KAFFRINE BIRKELANE 112 509 507 3 225 24 0 93,3% 93,3% 95,5% 95,5%<br />
KAFFRINE 177 311 539 4 414 20 5 82,0% 82,0% 85,4% 85,4%<br />
KOUNGHEUL 148 899 420 871 177 2 58,0% 44,3% 73,3% 62,3%<br />
MALEM HODDAR 99 107 326 1 517 23 4 69,1% 63,4% 78,5% 74,7%<br />
Total KAFFRINE 537 826 1 792 10 027 244 11 73,2% 67,1% 82,9% 79,1%<br />
KAOLACK GUINGUINEO 95 041 343 1 611 98 4 69,3% 67,5% 69,7% 68,3%<br />
KAOLACK 216 556 819 4 728 809 3 96,9% 84,2% 97,7% 88,6%<br />
NIORO 292 068 940 6 586 661 9 86,7% 62,2% 89,5% 72,8%<br />
Total KAOLACK 603 665 2 102 12 925 1 568 16 86,8% 71,5% 89,3% 77,8%<br />
KEDOUGOU KEDOUGOU 55 520 29 11 257 5 88,3% 9,0% 94,2% 21,4%<br />
SALEMATA 20 250 0 0 123 1 86,3% 0,0% 90,7% 0,0%<br />
SARAYA 38 876 13 64 186 5 93,4% 5,5% 96,7% 5,5%<br />
Total KEDOUGOU 114 646 42 75 566 11 89,3% 5,8% 94,4% 12,2%<br />
KOLDA KOLDA 170 868 135 102 406 6 47,4% 9,0% 62,2% 25,3%<br />
MEDINA YORO FOULA 114 861 43 232 130 13 22,8% 7,2% 31,7% 14,1%<br />
VELINGARA 237 676 159 1 776 215 13 34,8% 11,6% 47,6% 17,9%<br />
Total KOLDA 523 405 337 2 110 751 32 36,1% 9,3% 48,8% 19,5%<br />
LOUGA KEBEMER 250 619 1 085 5 923 122 3 85,8% 81,6% 83,7% 80,7%<br />
LINGUERE 202 023 519 4 375 132 0 42,8% 38,6% 59,8% 56,6%<br />
LOUGA 281 183 702 10 613 375 5 77,2% 71,1% 86,3% 84,0%<br />
Total LOUGA 733 825 2 306 20 911 629 8 67,8% 63,1% 78,1% 75,3%<br />
MATAM Kanel 249 671 364 6 382 148 12 64,1% 33,2% 87,0% 73,7%<br />
Matam 284 135 342 11 320 61 18 66,0% 55,7% 83,1% 75,8%<br />
Ranerou 57 471 36 100 12 1 20,6% 11,9% 31,2% 20,2%<br />
Total MATAM 591 277 742 17 802 221 31 52,8% 35,2% 79,7% 69,5%<br />
SAINT LOUIS DAGANA 161 436 371 2 803 30 16 67,4% 51,3% 76,0% 66,8%<br />
PODOR 355 553 443 7 812 53 13 95,9% 81,3% 98,8% 89,7%<br />
SAINT LOUIS 66 534 173 693 72 0 83,3% 79,8% 90,8% 88,4%<br />
Total SAINT LOUIS 583 523 987 11 308 155 29 80,0% 67,7% 91,5% 83,3%<br />
SEDHIOU BOUNKILING 108 014 70 200 234 17 40,0% 4,3% 52,8% 18,8%<br />
GOUDOMP 134 083 58 370 192 14 50,4% 8,3% 67,8% 26,2%<br />
SEDHIOU 142 854 80 174 176 28 54,9% 12,9% 73,4% 25,1%<br />
Total SEDHIOU 384 951 208 744 602 59 47,2% 7,8% 65,6% 23,7%<br />
TAMBACOUNDA BAKEL 138 800 190 1 241 243 8 84,5% 23,3% 89,0% 53,8%<br />
GOUDIRY 101 568 174 990 489 13 66,9% 11,2% 77,7% 29,0%<br />
KOUMPENTOUM 148 610 345 842 235 3 73,1% 34,6% 86,1% 55,9%<br />
TAMBACOUNDA 193 320 283 507 279 8 55,2% 23,9% 67,1% 42,7%<br />
Total TAMBACOUNDA 582 298 992 3 580 1 246 32 66,2% 22,5% 79,0% 46,3%<br />
THIES MBOUR 287 369 684 4 417 51 18 80,4% 77,7% 86,5% 84,4%<br />
THIES 248 872 694 4 853 132 12 89,3% 87,9% 87,8% 87,0%<br />
TIVAOUANE 325 066 1 030 14 161 173 7 92,1% 90,0% 92,3% 90,7%<br />
Total THIES 861 307 2 408 23 431 356 37 89,7% 87,7% 89,1% 87,5%<br />
ZIGUINCHOR BIGNONA 277 969 86 3 339 695 26 75,8% 16,0% 78,7% 41,9%<br />
OUSSOUYE 57 668 22 1 132 155 4 79,2% 35,1% 86,6% 48,2%<br />
ZIGUINCHOR 54 275 69 320 276 11 70,3% 28,6% 74,1% 36,5%<br />
Total ZIGUINCHOR 389 912 177 4 791 1 126 41 75,3% 21,4% 79,2% 42,1%<br />
Total général 7 136 066 15 961 131 789 8 764 343 69,7% 50,9% 81,2% 66,6%
REVUEANNUELLE<br />
SECTORIELLE<br />
CONJOINTE<br />
3.0<br />
Assainissement<br />
rural
3.1<br />
3. Mobilisation <strong>de</strong>s financements<br />
A <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’année 2012, les ressources mobilisées et les financements acquis pour le développement<br />
d’infrastructures d’assainissement en milieu rural s’élèvent à 60,47 milliards FCFA, soit 66,3% <strong>de</strong>s<br />
besoins qui étaient initialement évalués à 91,58 milliards <strong>de</strong> FCFA. On relève une progression <strong>de</strong> 20%<br />
par rapport à 2011 ; effet <strong>de</strong> l’intégration <strong>de</strong>s parts <strong>de</strong> financement prévus dans le cadre <strong>de</strong>s nouveaux<br />
sous-programmes financés, entre autres, par <strong>la</strong> BAD et l’Union Européenne. Dès l’année 2011, au<br />
sortir <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> Washington organisé en 2010 par l’Initiative Assainissement et Eau pour Tous,<br />
l’Etat du Sénégal a sensiblement relevé le niveau <strong>de</strong>s inscriptions budgétaires sur ressources internes<br />
consacrées au financement du sous-secteur <strong>de</strong> l’assainissement rural avec 660 millions FCFA. L’année<br />
2012 a été marquée par un engagement encore plus marqué fort <strong>de</strong> l’Etat avec l’inscription initiale<br />
d’un montant <strong>de</strong> 2,2 milliards FCFA à <strong>la</strong> LFI qui a été finalement réajusté à <strong>la</strong> baisse pour atteindre un<br />
budget d’un milliard suite aux ponctions impliquées par <strong>la</strong> mobilisation <strong>de</strong> ressources financières pour<br />
<strong>la</strong> phase d’urgence du programme décennal <strong>de</strong> lutte contre les inondations. Ces niveaux d’inscription<br />
budgétaire <strong>de</strong>vraient être maintenus jusqu’en 2015.<br />
Répartition <strong>de</strong>s financements mobilisés et prévisibles du sous-secteur <strong>de</strong><br />
l'assainissement rural - PEPAM 2015. Décembre 2012<br />
45,7%<br />
5,8%<br />
48,5%<br />
Etat Prêt Subvention<br />
Contrairement à l’année 2011, l’année 2012 est marquée<br />
par une majorité <strong>de</strong> prêts (48,5%) On remarque une<br />
prédominance <strong>de</strong>s subventions qui représentent 50,4%<br />
mais une présence nette <strong>de</strong>s prêts à hauteur <strong>de</strong> 42,6%.<br />
La part <strong>de</strong> l’Etat dans le financement du sous-secteur<br />
connaît une baisse par rapport à 2011 en passant <strong>de</strong><br />
6,9% à 5,8% en 2012. Ces performances pourraient être<br />
améliorées avec les engagements <strong>de</strong> l’Etat à financer le<br />
programme "Mécanisme Communautaire <strong>de</strong><br />
Développement <strong>de</strong> l’Assainissement Rural" à hauteur <strong>de</strong><br />
7 milliards sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2012-2015.<br />
Sous-secteurs Sources Montant % sous-secteurs<br />
Assainissement Rural Etat 3 510 5,8%<br />
Prêt 29 450 48,5%<br />
Subvention 27 780 45,7%<br />
Total Assainissement Rural 60 740 100,0%<br />
3. Développement <strong>de</strong> l'accès à l'assainissement<br />
Rappel <strong>de</strong>s objectifs du PEPAM<br />
L’objectif 7c <strong>de</strong>s OMD vise à «réduire <strong>de</strong> moitié, d’ici 2015, <strong>la</strong> proportion <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion qui n’a pas<br />
accès <strong>de</strong> façon durable à l’eau potable et à l’assainissement <strong>de</strong> base» . Pour le Sénégal, l’atteinte <strong>de</strong><br />
ces objectifs consistera à faire passer le taux d’accès à l’assainissement rural <strong>de</strong> 26,2 % en 2005 à 63%<br />
en 2015. En termes <strong>de</strong> réalisations il s’agira d’équiper 315.000 ménages en ouvrages d’assainissement<br />
individuel et réaliser 3.360 édicules publics dans les lieux publics communautaires. Notons, <strong>la</strong><br />
définition fournie par le JMP « une instal<strong>la</strong>tion sanitaire améliorée se définit comme une instal<strong>la</strong>tion<br />
hygiénique qui permet d’éviter que l’utilisateur et son milieu immédiat n’entrent en contact avec les<br />
excréta ».<br />
Evolution <strong>de</strong>s indicateurs d’accès<br />
En 2011, les résultats <strong>de</strong> l’enquête ménages nationale EDS-MICS 2011 ont permis d’établir le taux<br />
d’accès <strong>de</strong>s ménages ruraux à l’assainissement à 34,3%.
3.2<br />
L’intérêt <strong>de</strong> ce résultat se trouve surtout dans le fait qu’il permet <strong>de</strong> corriger le léger biais qui rési<strong>de</strong><br />
dans <strong>la</strong> non estimation <strong>de</strong>s autoréalisations <strong>de</strong>s ménages avec <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’inventaire <strong>de</strong>s ouvrages<br />
mis en p<strong>la</strong>ce dans le seul cadre <strong>de</strong>s opérations d’assainissement. Cette précision dans l’évaluation du<br />
taux d’accès à l’assainissement en milieu rural à travers <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s enquêtes <strong>de</strong> type ménage sera<br />
poursuivie du reste au moins pour les cinq (05) années suivantes dans le cadre du projet EDS Continue<br />
actuellement en cours d’exécution au sein <strong>de</strong> l’ANSD avec l’appui <strong>de</strong>s partenaires au développement.<br />
Cependant pour 2012, les résultats d’enquête ne seraient disponibles qu’au mois d’août <strong>2013</strong> ; ce qui<br />
justifie le recours aux estimations suivant <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> sectorielle basée sur les réalisations connues à<br />
travers les opérations en cours mais cette fois-ci corrigée par une marge d’autoréalisation (0,6 point)<br />
estimée sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> comparaison <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> l’enquête EDS-MICS 2011 et ceux du suivi <strong>de</strong><br />
routine.<br />
Le bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s opérations d’assainissement rural en 2012 établi en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> Direction nationale <strong>de</strong><br />
l’Assainissement, <strong>de</strong>s services déconcentrés, <strong>de</strong>s ONG et autres acteurs a permis <strong>de</strong> comptabiliser au<br />
total 6.491 ouvrages individuels <strong>de</strong> type amélioré. Le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural<br />
en décembre 2012 est ainsi estimé à 35,6% traduisant une progression <strong>de</strong> 1,3 points par rapport à<br />
l’an 2011 concernant le niveau d’accès <strong>de</strong>s ménages à <strong>de</strong>s systèmes améliorés d’assainissement.<br />
Ainsi le cumul <strong>de</strong>s réalisations <strong>de</strong>s opérations mises en œuvre dans le sous-secteur <strong>de</strong>puis l’année<br />
2005 s’élève à 40.227 unités soit 13% <strong>de</strong> l’objectif <strong>de</strong> 315.000 ouvrages individuels prévus pour<br />
atteindre les OMD. Les réalisations enregistrées en 2012 traduisent une bonne progression par<br />
rapport à 2011 avec un taux d’accroissement <strong>de</strong> 25% porté essentiellement par quatre opérations<br />
majeures du sous-secteur que sont : le PEPAM-BAD2, le PEPAM-IDA, l’USAID-PEPAM et le PEPAM-BA<br />
et une intervention très importante <strong>de</strong>s ONG et autres catégories d’acteurs non étatiques à hauteur<br />
dont <strong>la</strong> contribution aux réalisations est établi à 12% du cumul <strong>de</strong> 2012. Avec 205 édicules publics<br />
réalisées et réceptionnés en 2012, les résultats obtenus en 2012 sont moins satisfaisants que ceux <strong>de</strong><br />
l’année 2011 durant <strong>la</strong>quelle 429 unités avaient été comptabilisées pour les différentes opérations<br />
enregistrées.<br />
La contribution du sous-programme USAID-PEPAM a été très substantielle dans <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s performances <strong>de</strong> 2012 avec<br />
un ratio <strong>de</strong> 32% résultant <strong>de</strong>s réalisations dans les régions <strong>de</strong> Ziguinchor et <strong>de</strong> Sédhiou. Les prévisions <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s<br />
sous-programmes PEPAM-BAD2, PEPAM-IDA et PEPAM-BA n’ont pas été atteintes du fait d’une lenteur dans les dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong><br />
réalisation. Alors que pour ces différents sous-programmes, les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s confirmées enregistrées dans les zones<br />
d’intervention sont supérieures à 21.000 unités ; dès lors on relève que moins <strong>de</strong> 20% <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> exprimée a pu être<br />
satisfaite. Cette situation traduit le caractère sous capacitaire du sous secteur <strong>de</strong> l’assainissement rural où l’offre reste<br />
<strong>la</strong>rgement inférieure à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ; une situation <strong>la</strong>rgement imputable au statut <strong>de</strong> micro-entreprises pour l’essentiel <strong>de</strong>s<br />
prestataires intervenant dans <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>s ouvrages avec <strong>de</strong>s capacités techniques et financières limitées. La séparation<br />
<strong>de</strong>s acquisitions pour les matériaux et les travaux a certes permis d’améliorer un peu les conditions <strong>de</strong> réalisations mais pas<br />
encore à <strong>la</strong> hauteur <strong>de</strong>s attentes en termes <strong>de</strong> performances. Toutefois, même si les opérations majeures du PEPAM ont<br />
connu <strong>de</strong>s lenteurs dans leur mise en œuvre, les réalisations <strong>de</strong> l’année 2012, restent supérieures à <strong>la</strong> moyenne <strong>de</strong>s<br />
réalisations enregistrées <strong>de</strong>puis 2005 et pourraient s’amplifier et être clôturées en <strong>2013</strong> voire début 2014.<br />
40,00%<br />
Evolution du taux d'accès à l'assainissement en milieu rural - 2005-2012<br />
Les progressions positives sont enregistrées<br />
<strong>de</strong>puis le démarrage du PEPAM mais toujours<br />
très insuffisantes pour correspondre aux<br />
performances attendues en direction <strong>de</strong><br />
l’atteinte <strong>de</strong>s OMD en 2015.<br />
Taux d'accès (%)<br />
35,00%<br />
30,00%<br />
25,00%<br />
20,00%<br />
15,00%<br />
10,00%<br />
5,00%<br />
0,00%<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Taux d'accès 26,20% 26,70% 26,90% 27,50% 28,90% 29,60% 34,30% 35,60%
3.3<br />
Edicule réalisé par l’ONG ADOS - 2012<br />
Ouvrages réalisés dans le cadre du PEPAM-IDA - 2012<br />
Des efforts sensibles ont été notés dans <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s ouvrages mis en p<strong>la</strong>ce, notamment les édicules publics<br />
pour les rendre fonctionnels et durables. Même si dans une logique d’amoindrissement <strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong><br />
subvention et <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong>s <strong>la</strong>trines familiales, les superstructures sont désormais à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s ménages, <strong>de</strong>s<br />
réflexions sont en cours pour <strong>la</strong> proposition <strong>de</strong> mécanismes opérationnels et efficaces pour mettre à <strong>la</strong><br />
disposition <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions rurales <strong>de</strong>s modèles simples mais durables <strong>de</strong> superstructures à moindre coût<br />
susceptibles <strong>de</strong> garantir une meilleure utilisation <strong>de</strong>s ouvrages réalisés.<br />
4. Tendances vers <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>s OMD en 2015<br />
En 2010 déjà, même si le Sénégal était c<strong>la</strong>ssé parmi les pays « faisant mieux que <strong>la</strong> moyenne régionale<br />
en Afrique subsaharienne à <strong>la</strong> fois pour l’eau et l’assainissement », il était c<strong>la</strong>ir, qu’il n’était pas en<br />
bonne voie pour l’atteinte <strong>de</strong>s OMD. Cependant les performances augmentent chaque année, <strong>de</strong><br />
nouveaux partenaires au développement tels que <strong>la</strong> JICA et l’Union Européenne s’intéressent à<br />
l’assainissement rural. De plus, l’Etat s’est engagé à financer substantiellement le sous secteur <strong>de</strong><br />
l’assainissement à partir <strong>de</strong> l’année 2012.<br />
La réflexion est quasi permanente dans <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s projets d’assainissement rural. Depuis les<br />
premiers projets réalisés dans le cadre du PEPAM, <strong>de</strong> nombreuses améliorations ont été apportées. Le<br />
Sénégal reste encore selon les données du joint monitoring programme (JMP) <strong>de</strong> 2012, le pays qui<br />
aura une couverture en assainissement approprié le plus élevé en Afrique <strong>de</strong> l’ouest et centrale. Sans<br />
compter que les réalisations <strong>de</strong>vront être importantes pour l’année <strong>2013</strong> avec les contributions qui<br />
sont attendues <strong>de</strong>s sous-programmes PEPAM-IDA et PEPAM-BAD 2, PEPAM-BA et autres.<br />
Si rien n’est fait dans ce sens, les prévisions <strong>de</strong><br />
réalisations établies en tenant compte <strong>de</strong>s opérations<br />
en cours, en préparation ou en instruction, <strong>de</strong>s<br />
capacités réelles <strong>de</strong> réalisation physique (sur <strong>la</strong> base<br />
<strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> mise en œuvre et performances <strong>de</strong>s<br />
entreprises) font apparaître un cumul <strong>de</strong> seulement<br />
123.000 systèmes d’assainissement individuel (soit<br />
juste 39% <strong>de</strong> <strong>la</strong> cible <strong>de</strong> 2015) .<br />
70,0<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
Evolution du taux d'accès à l'assainissement en milieu rural<br />
Projections et tendances - décembre 2012<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015<br />
Réalisations<br />
Prévisions
3.4<br />
5. Etat <strong>de</strong> <strong>la</strong> défécation à l’air libre<br />
En 2004 et 2005 lors <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration du document <strong>de</strong> stratégie <strong>de</strong>s OMD au Sénégal, le concept <strong>de</strong><br />
défécation à l’air libre n’avait pas été pris en compte dans <strong>la</strong> définition les objectifs et dans <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>nification du sous secteur <strong>de</strong> l’assainissement rural. Il est apparu plus tard, dans les années 2008-<br />
2009 que <strong>la</strong> fraction <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ne disposant d’aucun ouvrage d’assainissement constitue près <strong>de</strong><br />
33% <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale du Sénégal. Dès lors les réflexions à l’échelle internationale développées<br />
par les déci<strong>de</strong>urs, chercheurs et p<strong>la</strong>nificateurs se sont alors intéressés à plusieurs autres approches<br />
innovantes dont le concept <strong>de</strong> l’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC).<br />
En effet le taux <strong>de</strong> défécation à l’air libre est très élevé au Sénégal, cette situation <strong>de</strong>meure critique<br />
avec un écart <strong>de</strong> 8 points par rapport à <strong>la</strong> moyenne <strong>de</strong> l’Afrique subsaharienne pour <strong>la</strong>quelle le taux <strong>de</strong><br />
défécation à l’air libre est évalué à 25%. Ainsi, selon le rapport du JMP (2012), le Sénégal présente un<br />
taux <strong>de</strong> défécation à l’air libre assez réduit par rapport à <strong>la</strong> Mauritanie, au Burkina Faso, Niger, au<br />
Bénin et au Togo. En revanche le Mali, présenterait un taux inférieur à celui du Sénégal.<br />
Cas d'évacuation <strong>de</strong>s excrétas<br />
100%<br />
80%<br />
33%<br />
53%<br />
25%<br />
60%<br />
26%<br />
33%<br />
40%<br />
20%<br />
34%<br />
47,4% 49%<br />
0%<br />
Milieu rural Niveau national Afrique<br />
Subsaharienne<br />
Défécation à l'air libre Latrines traditionnelles Assainissement amélioré<br />
Assainissement non amélioré<br />
Situation <strong>de</strong>s pays d’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest dans <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> défécation à l’air libre (source: JMP Report 2012)<br />
L’ATPC, à donc démarré en 2009 au Sénégal avec une phase<br />
test financée par l’UNICEF dans <strong>la</strong> communauté rurale <strong>de</strong><br />
Bani Israël dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Tambacounda. Depuis 2011, un<br />
passage à l’échelle a été enclenché avec l’appui <strong>de</strong> l’UNICEF.<br />
En l’état actuel, plusieurs partenaires au développement<br />
s’intéressent à cette approche.<br />
La situation <strong>de</strong> l’année 2012 est présentée dans le tableau<br />
suivant :<br />
Opérations Région Département Vil<strong>la</strong>ges cibles Vil<strong>la</strong>ges FDAL<br />
GSF Kédougou Kédougou 37 7<br />
Total Kédougou 37 7<br />
Total GSF 37 7<br />
UNICEF-DA Tambacounda Goudiry 10 10<br />
Tambacounda 12 12<br />
Total Tambacounda 22 22<br />
Total UNICEF-DA 22 22<br />
UNICEF-SNH Kaffrine Kaffrine 30 11<br />
Total Kaffrine 30 11<br />
Total UNICEF-SNH 30 11<br />
USAID-WADA Kolda Kolda 12 12<br />
Total Kolda 12 12<br />
Sedhiou Bounkiling 12 12<br />
Total Sedhiou 12 12<br />
Ziguinchor Bignona 6 6<br />
Total Ziguinchor 6 6<br />
Total USAID-WADA 30 30<br />
Total général 119 70<br />
6. Nouvelles orientations stratégiques du sous secteur<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> l’assainissement rural au Sénégal, financée par <strong>la</strong> Banque Africaine <strong>de</strong><br />
Développement a démarré en 2012. Rappelons que cette étu<strong>de</strong> avait pour objet <strong>de</strong> définir une<br />
politique et une stratégie <strong>de</strong> l’assainissement rural <strong>de</strong> même que <strong>de</strong>s objectifs raisonnables pour<br />
l’horizon 2025.
3.5<br />
A <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission 1, <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, concernant <strong>la</strong> réalisation du diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation du sous<br />
secteur, les orientations stratégiques se <strong>de</strong>ssinant pour les horizons 2015 et 2025 <strong>de</strong>vront :<br />
- Intégrer dans <strong>la</strong> politique sous sectorielle les nouvelles cibles constituées par <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
déféquant à l’air libre ;<br />
- Intégrer dans le concept <strong>de</strong> l’assainissement amélioré, les ouvrages traditionnels réhabilités ;<br />
- Définir <strong>de</strong>s options technologiques répondant à <strong>la</strong> norme sanitaire technique permettant <strong>de</strong><br />
garantir les conditions d’hygiène, favorisant <strong>la</strong> préservation <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>la</strong><br />
préservation <strong>de</strong> l’environnement.<br />
7. Mécanisme Communautaire <strong>de</strong> Développement <strong>de</strong> l’Assainissement Rural (MCDAR)<br />
Les lenteurs dans <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s opérations financées sur les ressources internes du budget <strong>de</strong><br />
l’Etat et portant sur le développement <strong>de</strong> l’accès à l’assainissement rural à travers <strong>la</strong> réalisation<br />
d’ouvrages individuels sont liées :<br />
1. Aux difficultés rencontrées dans <strong>la</strong> prise en charge les exigences <strong>de</strong> l’Approche Par <strong>la</strong> Deman<strong>de</strong><br />
et le principe d’annualité du budget ;<br />
2. aux mécanismes <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s ouvrages individuels impliquant <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is plus ou<br />
moins longs et les «lenteurs habituelles» dans les procédures d’exécution budgétaires <strong>de</strong> l’Etat<br />
3. aux exigences du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Marchés Publics en matière d’acquisitions et <strong>la</strong> spécificité <strong>de</strong>s<br />
programmes d’assainissement rural.<br />
Le schéma suivant permet <strong>de</strong> matérialiser ces différentes contraintes.<br />
Au regard <strong>de</strong>s faibles performances enregistrées <strong>de</strong>puis 2005, pour améliorer les chances du Sénégal<br />
dans <strong>la</strong> feuille <strong>de</strong> route pour l’atteinte <strong>de</strong>s OMD en 2015 il faudra nécessairement passer, entre autres,<br />
par : (i) l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise <strong>de</strong> l’Etat dans le financement du programme d’investissement du<br />
sous-secteur et (ii) l’accroissement <strong>de</strong>s capacités d’absorption <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong> l’Assainissement à<br />
travers <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un efficace mécanisme <strong>de</strong> mise en œuvre assis sur <strong>la</strong> mobilisation<br />
convergente <strong>de</strong>s efforts <strong>de</strong> plusieurs acteurs, particulièrement les communautés rurales, les structures<br />
financières décentralisées, les ASUFOR et les services techniques.<br />
C’est ainsi que <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong> l’Assainissement avec l’appui <strong>de</strong> l’Unité <strong>de</strong> Coordination du PEPAM et <strong>de</strong><br />
l’agence EAA, a mis en p<strong>la</strong>ce le MCDAR. Le principe <strong>de</strong> base du mécanisme restera cependant <strong>la</strong><br />
déconcentration, <strong>la</strong> décentralisation et le renforcement du cadre <strong>de</strong> faire-faire à travers le recours à<br />
<strong>la</strong> maîtrise d’ouvrage déléguée ; cette option permettra ainsi d’optimiser <strong>la</strong> chaîne <strong>de</strong> passation <strong>de</strong>s<br />
marchés, <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s activités p<strong>la</strong>nifiées et <strong>de</strong> leur supervision mais aussi et surtout<br />
d’améliorer les performances en matière <strong>de</strong> décaissement <strong>de</strong>s ressources budgétaires internes.
3.6
REVUEANNUELLE<br />
SECTORIELLE<br />
CONJOINTE<br />
4.0<br />
Hydraulique<br />
urbaine
4.1<br />
4. Développement <strong>de</strong> l’accès à l’eau potable en milieu urbain<br />
4.1 Mobilisation <strong>de</strong> financement<br />
Les financements mobilisés et prévisibles pour le financement du sous-secteur <strong>de</strong> l’hydraulique urbaine<br />
s'élèvent à 98,918 milliards FCFA; soit une nette progression positive liée à <strong>la</strong> mobilisation <strong>de</strong>s nouveaux<br />
financements avec <strong>la</strong> JICA, <strong>la</strong> BOAD, l’UEMOA et le financement sur ressources propres <strong>de</strong> <strong>la</strong> SONES <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
phase d’urgence du programme d’investissement à l’horizon 2025.<br />
JICA<br />
BOAD<br />
AFD<br />
BEI<br />
UEMOA<br />
UE<br />
Financement du sous-secteur <strong>de</strong> l'Hydraulique en milieu<br />
urbain par source - 2005-2012 Sous-secteurs Sources Montant % sous-secteurs<br />
Hydraulique Urbaine Prêt 82 934 83,8%<br />
SONES 3 300 3,3%<br />
Subvention 12 684 12,8%<br />
Total Hydraulique Urbaine 98 918 18,4%<br />
IDA<br />
SONES<br />
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000<br />
Les ressources financières mobilisées sont constituées<br />
majoritairement <strong>de</strong> prêts (83,8%) ; les subventions<br />
accordées représentent 12,8% du portefeuille global<br />
<strong>de</strong>s financements ; ce qui reflète bien le statut d’une<br />
société <strong>de</strong> patrimoine crédible et capable <strong>de</strong> mobiliser<br />
<strong>de</strong>s financements privés pour renforcer les<br />
infrastructures au titre du contrat <strong>de</strong> concession sur le<br />
périmètre. Toutefois il met aussi en relief le caractère<br />
stratégique <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> tarification et <strong>de</strong>s<br />
niveaux <strong>de</strong> performances en termes <strong>de</strong> recouvrement<br />
<strong>de</strong>s coûts pour garantir à <strong>la</strong> fois un équilibre financier<br />
durable du sous-secteur et rembourser correctement<br />
les crédits contractés.<br />
4.2 Résultats enregistrés en matière d’accès aux services<br />
Sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s statistiques stabilisées en décembre 2012 en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> SDE et <strong>la</strong> SONES et portant<br />
sur les prises d’eau effectivement facturées, l’accès par branchement privé, qui constitue l’option<br />
préférentielle du secteur en matière <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte se comporte <strong>de</strong> manière globalement très satisfaisante<br />
avec un taux <strong>de</strong> 90,1% pour l’ensemble du périmètre affermé. Ce ratio a atteint 100% pour Dakar urbain,<br />
81,5% pour <strong>la</strong> zone péri-urbaine et rurale <strong>de</strong> Dakar et 78,3% pour les autres centres urbains. Le taux<br />
d’accès par branchement a évolué <strong>de</strong> 1,4 points pour l’ensemble du périmètre et <strong>de</strong> 2,2 points pour ce<br />
qui concerne les autres centres urbains.<br />
Le taux d’accès global est proche <strong>de</strong> l’universel avec 99,6%, tiré par les performances très élevées dans <strong>la</strong><br />
majorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Dakar ; les autres centres urbains affichent un ratio <strong>de</strong> 91,6%. En termes <strong>de</strong><br />
points <strong>de</strong> distribution réalisés, il a été enregistré <strong>la</strong> réalisation en 2012 <strong>de</strong> 25.350 nouveaux branchements<br />
privés à l’eau potable dont 19.116 sociaux (soit 75%) et 6.231 ordinaires.
4.2<br />
Ces statistiques sont rapportées aux données démographiques du périmètre affermé actualisées dans le<br />
modèle <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> SONES et qui donnent en décembre 2012 une popu<strong>la</strong>tion globale <strong>de</strong> 5.719.179<br />
habitants répartis dans les soixante-six (66) centres du pays avec <strong>la</strong> répartition suivante : Dakar-Rufisque<br />
(53%) et les autres centres urbains qui regroupent les 47% restants.<br />
Le taux d’accès par bornes-fontaines s’établit à 9,5% globalement au niveau du périmètre avec 4,8% pour<br />
Dakar urbain, 13,4% pour <strong>la</strong> Dakar péri-urbain et les autres centres urbains. Les disparités continuent<br />
d’être perceptibles entres les centres du périmètre, mais pourraient être résorbées progressivement avec<br />
<strong>la</strong> terminaison du programme en cours <strong>de</strong>s 68.000 branchements sociaux.<br />
Titre <strong>de</strong> l'axe<br />
Situation <strong>de</strong> l'accès à l'eau dans le périmètre affermé - décembre 2012<br />
100,0%<br />
90,0%<br />
80,0%<br />
70,0%<br />
60,0%<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
DAK 2 DL LGA SL KL KAF DAK 1 FK TH TC KED ZIG MAT KDA<br />
Taux BP 100,0 91,3% 90,8% 85,9% 85,0% 81,7% 81,5% 78,8% 77,9% 61,7% 61,5% 60,5% 50,3% 44,9%<br />
Taux BF 5,6% 8,1% 22,9% 17,0% 4,4% 1,3% 31,0% 11,2% 10,9% 6,2% 15,0% 2,0% 13,4% 4,8%<br />
4.3 Qualité <strong>de</strong> l’eau et du service<br />
Malgré les perturbations connues en 2011 dans <strong>la</strong> fourniture du service au niveau <strong>de</strong> certains quartiers <strong>de</strong><br />
Dakar surtout en pério<strong>de</strong> pointe accentuées aussi par les coupures parfois longues sur <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong><br />
l’électricité, <strong>la</strong> qualité du service d’eau potable dans les centres gérés par <strong>la</strong> SDE est satisfaisante. Les<br />
travaux <strong>de</strong> renforcement dans le cadre du PEPAM-Urbain permettront à terme d’améliorer <strong>de</strong> manière<br />
encore plus satisfaisante <strong>la</strong> qualité du service à travers une continuité plus parfaite dans <strong>la</strong> fourniture<br />
d’eau aux ménages. Toutefois le phénomène du colmatage <strong>de</strong>s canalisations lié à <strong>la</strong> présence du calcaire<br />
dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Thiès occasionne <strong>la</strong> récurrence du manque d’eau avec <strong>de</strong>s désagréments enregistrés<br />
auprès <strong>de</strong>s usagers et qui justifie le taux d’accès moyen <strong>de</strong> 77,5%.<br />
La qualité <strong>de</strong> l’eau reste une forte préoccupation dans <strong>la</strong> fourniture du service d’eau potable dans le<br />
périmètre affermé ; le taux <strong>de</strong> conformité microbiologique <strong>de</strong> l’eau distribué est <strong>de</strong> 99,3% pour un<br />
objectif <strong>de</strong> 96% fixé dans le contrat <strong>de</strong> performances alors que le taux <strong>de</strong> conformité physico-chimique<br />
affiche 100% tenant compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> dérogation <strong>de</strong> <strong>la</strong> SONES ; pour un objectif <strong>de</strong> 95%. Les enquêtes auprès<br />
<strong>de</strong>s clients au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> banlieue ont permis <strong>de</strong> noter un taux <strong>de</strong> satisfaction global <strong>de</strong> 98% contre 45%<br />
en 2005 ; ce qui traduit que <strong>de</strong>s efforts importants sont en train d’être faits dans ce sens mais <strong>de</strong>vraient<br />
être nettement amplifiés pour régler définitivement <strong>la</strong> question du fer au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> banlieue en<br />
accélérant le <strong>la</strong>ncement <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> station <strong>de</strong> déferrisation <strong>de</strong> Thiaroye.<br />
Cependant il convient <strong>de</strong> noter que les solutions ponctuelles en matière d’amélioration satisfaisante <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
qualité physico-chimique <strong>de</strong> l’eau sont envisagées dans un avenir proche avec <strong>la</strong> SONES, en partenariat<br />
avec <strong>la</strong> BOAD, pour toucher les sites <strong>de</strong> Kao<strong>la</strong>ck, Fatick et Koungheul.<br />
4.4 Production et distribution<br />
La production totale d’eau au 31 décembre 2012 a été <strong>de</strong> 153,867 millions <strong>de</strong> m 3 pour une prévision <strong>de</strong><br />
153,5 millions <strong>de</strong> m 3 . Par rapport à l’année 2011 (148,6 millions <strong>de</strong> m 3 ), on note une nette évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
production avec +3,6%. Pour l’essentiel, les besoins moyens <strong>de</strong> <strong>la</strong> clientèle ont été couverts avec toutefois<br />
une tendance à <strong>la</strong> saturation <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong> production <strong>de</strong> Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Thiès.
4.3<br />
Même si <strong>la</strong> situation re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> crise <strong>de</strong> l’énergie s’est nettement améliorée par rapport à l’année 2011,<br />
<strong>de</strong>s perturbations sont encore notées au niveau <strong>de</strong>s principaux ouvrages <strong>de</strong> production, notamment KMS,<br />
les forages <strong>de</strong> Kelle /Kébémer et ceux <strong>de</strong> Pout nord.<br />
Une pointe <strong>de</strong> 324 527 m3/jour a été atteinte le 16 janvier 2012 pour une capacité installée <strong>de</strong> 331 835<br />
m3/jour, ce qui traduit <strong>la</strong> tendance à <strong>la</strong> limite <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> pointe par les ressources<br />
disponibles ; cette situation a conduit comme par le passé à un fonctionnement journalier <strong>de</strong> 23 heures<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> station <strong>de</strong> Mékhé qui reste l’ouvrage le plus critique du système <strong>de</strong> l’AEP <strong>de</strong> Dakar . Les projets<br />
d’amélioration <strong>de</strong> l’alimentation <strong>de</strong>s zones déficitaires initiés en 2011 par mail<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> réseau se<br />
poursuivent toujours. Ainsi, en plus <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> Liberté 5, Unité 26 Parcelles Assainies, quartiers CPI,<br />
Khandar, Grand Yoff, Comico-Sonatel, Keur Damel et Mamelles Aviation pour lesquelles <strong>la</strong> <strong>de</strong>sserte en<br />
eau avait été améliorée en 2011, <strong>de</strong> nouveaux quartiers ont bénéficié du programme <strong>de</strong> renforcement<br />
(Cambérène-Deggo, Unité 12, Air Afrique).<br />
Les seules zones qui connaissent <strong>de</strong>s baisses <strong>de</strong> pression pendant les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pointe sont celles <strong>de</strong><br />
Nord Foire et Ouest Foire et <strong>la</strong> mise en service <strong>de</strong> <strong>la</strong> station <strong>de</strong> Carmel apportera une solution à ce<br />
problème avec l’augmentation <strong>de</strong>s pressions <strong>de</strong> service. La mise en service <strong>de</strong> Carmel est prévue en juillet<br />
<strong>2013</strong> lorsque les aérateurs <strong>de</strong> Mékhé seront posés. Des perturbations sont encore notées sur les réseaux<br />
<strong>de</strong>s Maristes, Corniche-Médina et sur <strong>la</strong> Rue 6 en raison d’un remplissage moyen du réservoir du Point Y.<br />
Ainsi, le taux <strong>de</strong> continuité <strong>de</strong> service à Dakar est estimé à 90% et sera corrigé avec <strong>la</strong> mise en service <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> pleine capacité <strong>de</strong> Mékhé à fin 2014. Une cartographie <strong>de</strong>s zones déficitaires a été établie avec une<br />
étu<strong>de</strong> d’amélioration ; une requête <strong>de</strong> prise en charge a été adressée à <strong>la</strong> SONES en <strong>2013</strong>.<br />
L’eau non facturée constitue toujours une préoccupation forte du sous-secteur avec <strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong><br />
pertes d’eau supérieurs aux objectifs fixés dans le contrat <strong>de</strong> performances SONES-SDE. Au 31décembre<br />
2012, le ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> réseau à <strong>la</strong> fin du 6 ème bimestre est <strong>de</strong> 80,12 % contre 80,07 % en réel 2011 au<br />
même moment. Cette progression est le résultat <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns d’actions mis en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>ux ans.<br />
Figure 15 : Evolution annuelle <strong>de</strong>s fuites sur branchements et sur réseaux dans le périmètre affermé - 2012<br />
Evolution <strong>de</strong>s fuites d'eau sur réseau et branchements - 1996 à 2012<br />
35 000<br />
8 000<br />
Nombre <strong>de</strong> fuites détectés<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
7 000<br />
6 000<br />
5 000<br />
4 000<br />
3 000<br />
2 000<br />
1 000<br />
La problématique <strong>de</strong>s fuites constitue<br />
une préoccupation majeure surtout<br />
dans les zones inondées ; les pertes<br />
d’eau sont parfois très importantes et<br />
impactent aussi négativement le<br />
ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> réseau.<br />
0<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Années<br />
0<br />
Fuites sur branchements<br />
Fuites sur réseau<br />
4.5 Consommation d’eau <strong>de</strong> l’Administration<br />
Dans le cadre du p<strong>la</strong>n d’actions pour <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong>s consommations <strong>de</strong> l’Administration, (i) <strong>de</strong>s travaux<br />
<strong>de</strong> réhabilitation <strong>de</strong>s réseaux ont été réalisés par <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong> l'Hydraulique en 2011 au niveau <strong>de</strong><br />
l'UCAD, du COUD, du centre Aline Sitoe Jatta, du Lycée Limamou<strong>la</strong>ye, du Camp Michel le Grand <strong>de</strong> Thiès,<br />
du Camp Militaire <strong>de</strong> Bargny et <strong>de</strong> l'Ecole Polytechnique <strong>de</strong> Thiès, et (ii) <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce, <strong>de</strong><br />
contrôle et <strong>de</strong> réparations sont réalisées <strong>de</strong>puis le mois <strong>de</strong> juillet 2012 par <strong>la</strong> SDE sur les 100 plus gros<br />
consommateurs <strong>de</strong> l'Administration centrale. Dans <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong>s actions re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> rationalisation<br />
<strong>de</strong>s consommations d'eau <strong>de</strong> l'Administration, les actions suivantes ont été réalisées :
4.4<br />
1. mise en p<strong>la</strong>ce d’un Comité <strong>de</strong> suivi du processus <strong>de</strong> rationalisation <strong>de</strong>s consommations <strong>de</strong> l’Administration<br />
par arrêté n°007461 du 21 septembre 2012<br />
2. Marché <strong>de</strong> travaux pour prendre en charge les travaux <strong>de</strong> réparation sur les réseaux d'eau <strong>de</strong><br />
l'Administration à hauteur <strong>de</strong> 310 millions FCFA prévus dans le Budget Consolidé d'Investissement 2012 ;<br />
3. Réalisation d'une étu<strong>de</strong> pour <strong>la</strong> définition d'un mécanisme d'entretien et <strong>de</strong> maintenance durable <strong>de</strong>s<br />
instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> distribution interne d'eau.<br />
4. Mobilisation d’un budget <strong>de</strong> 100 millions <strong>de</strong> FCFA pour <strong>la</strong> pour <strong>la</strong> mise en conformité <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions<br />
intérieures et <strong>la</strong> réparation <strong>de</strong>s fuites et <strong>de</strong>s réseaux au niveau <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong>s 100 plus gros consommateurs<br />
<strong>de</strong> l'Administration centrale. A ce titre, <strong>de</strong>s visites sont organisées suivant une ca<strong>de</strong>nce hebdomadaire ;<br />
Le programme <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDE <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s 100 plus gros consommateurs <strong>de</strong> l’Administration initié <strong>de</strong><br />
juillet 2012 à décembre 2à12 se poursuit et s’appuie sur <strong>de</strong>s visites hebdomadaires <strong>de</strong>s compteurs, les<br />
réparations <strong>de</strong> fuites et <strong>la</strong> pose <strong>de</strong> 100 compteurs Watermind. Le taux d’avancement est <strong>de</strong> 65% au 31<br />
décembre 2012. Les résultats enregistrés en 2012 permettent <strong>de</strong> constater une réduction globale <strong>de</strong>s<br />
consommations <strong>de</strong>s 100 plus gros consommateurs qui se présentent comme suit :<br />
- Une baisse <strong>de</strong>s volumes <strong>de</strong> 521.939 M3 <strong>de</strong>s 100 plus gros consommateurs, soit 10% <strong>de</strong>s<br />
consommations facturées aux Bâtiments Administratifs en 2012 ;<br />
- Une économie réalisée <strong>de</strong> 1,2 milliard <strong>de</strong> FCFA sur les 100 plus gros consommateurs qui<br />
représentent 3,64% <strong>de</strong>s clients facturés au titre <strong>de</strong> l’Administration Centrale ;<br />
- Le poids <strong>de</strong>s consommations <strong>de</strong>s 100 plus gros sites administratifs passe <strong>de</strong> 59,29% en 2011 à<br />
55,15% <strong>de</strong>s volumes facturés à l’Etat en 2012 ;<br />
- Une baisse <strong>de</strong>s moyennes <strong>de</strong> consommations journalières qui passent <strong>de</strong> 15 671 M3 en 2011 à<br />
14 241 M3/jour en 2012, soit une réduction <strong>de</strong> 1.430 m3/j ;<br />
- Un suivi particulier du Camp Militaire <strong>de</strong> Dakar Bango qui est le plus gros consommateur <strong>de</strong><br />
l’Administration.<br />
Le programme <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDE, <strong>la</strong>ncé au mois <strong>de</strong> juillet 2012, a permis d’inverser <strong>la</strong> tendance haussière<br />
constatée sur les consommations d’eau <strong>de</strong> l’Etat sur les trois premiers bimestres 2012. En effet, les<br />
premières baisses ont été enregistrées à partir du 4 ème bimestre 2012 et se sont poursuivies jusqu’au<br />
<strong>de</strong>rnier bimestre 2012. Les réductions <strong>de</strong>s consommations d’eau <strong>de</strong> l’Administration sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du<br />
programme se présentent comme suit :<br />
Les consommations ont augmenté <strong>de</strong> 247 325 M3 au<br />
premier semestre 2011, alors qu’elles baissent <strong>de</strong><br />
415 176 M3 avec les actions menées à compter <strong>de</strong> juillet<br />
2012. Sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du programme, l’économie globale<br />
réalisée sur tous les clients <strong>de</strong> l’Administration se chiffre<br />
à 958,690 millions FCFA, obérée par <strong>la</strong> hausse <strong>de</strong> 608,609<br />
millions <strong>de</strong> FCFA (janvier 2012 à juin 2012) avant le<br />
démarrage <strong>de</strong>s actions.<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
0<br />
-50 000<br />
-100 000<br />
-150 000<br />
-200 000<br />
-250 000<br />
Evolution <strong>de</strong>s consommations <strong>de</strong>s sites <strong>de</strong> l'Administration<br />
Année 2012<br />
Bim1 Bim2 Bim3 Bim4 Bim5 Bim6<br />
2.1.1 Analyse globale <strong>de</strong>s consommations d’eau <strong>de</strong> l’Administration en 2012<br />
La facture globale <strong>de</strong> l’Etat passe <strong>de</strong> 23,746 milliards en 2011 à 23,396 milliards pour l’année 2012, soit<br />
une baisse <strong>de</strong> 1,47%, ce qui représente une économie <strong>de</strong> 350 millions <strong>de</strong> CFA pour le budget <strong>de</strong> l’Etat. La<br />
forte baisse engendrée par les actions menées au second semestre 2012 a été plombée par les hausses<br />
<strong>de</strong>s trois premiers bimestres 2012, avant le début <strong>de</strong>s interventions. Le poids <strong>de</strong> l’Administration sur les<br />
consommations globales est à son plus bas niveau <strong>de</strong>puis 2005. Le volume facturé à l’Administration<br />
représente 7,66% <strong>de</strong>s consommations facturées en 2012 contre 8,09 en 2011, étant entendu que le<br />
programme SDE n’a démarré qu’au mois <strong>de</strong> juillet 2012.
4.5<br />
Cette tendance à <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong>vrait se poursuivre sur toute l’année <strong>2013</strong> avec l’impulsion donnée par l’Etat<br />
dans sa volonté <strong>de</strong> lutter contre les gaspil<strong>la</strong>ges, à travers les programmes <strong>de</strong> rationalisation <strong>de</strong>s<br />
consommations <strong>de</strong> l’Administration menés par <strong>la</strong> SDE et <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong> l’Hydraulique,<br />
L’Etat a consommé 9.425.020 m3 en 2012 contre<br />
9.592.871 m3 en 2011, soit une baisse globale <strong>de</strong><br />
167.851 m3. Ce recul <strong>de</strong> -1,75% est le premier<br />
enregistré sur les quatre <strong>de</strong>rnières années qui<br />
présentent un taux <strong>de</strong> progression moyen annuel <strong>de</strong><br />
3,53%. Cette baisse globale a été obtenue grâce aux<br />
actions soutenues réalisées au 2 ème bimestre 2012 qui<br />
ont pu combler <strong>la</strong> progression <strong>de</strong>s consommations<br />
enregistrées au 1 er semestre 2012 comme l’indiquent<br />
les graphiques.<br />
Source : SDE<br />
Source : SDE<br />
L’objectif fixé reste toujours <strong>de</strong> réduire <strong>de</strong> 03 milliards <strong>de</strong> FCFA <strong>la</strong> facture d’eau <strong>2013</strong> <strong>de</strong> l’Etat en<br />
combinant les programmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDE et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong> l’Hydraulique. Dans ce cadre, il est impératif <strong>de</strong><br />
finaliser avant le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> facturation <strong>2013</strong> les visites <strong>de</strong>s sites, <strong>la</strong> réparation <strong>de</strong>s fuites et certain<br />
travaux <strong>de</strong> renouvellement <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions intérieures. La mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s compteurs Watermind<br />
interviendra au mois <strong>de</strong> mai <strong>2013</strong> et leur instal<strong>la</strong>tion conduira au déploiement dans chaque<br />
Administration concernée d’un logiciel <strong>de</strong> supervision <strong>de</strong>s consommations qui nécessitera <strong>la</strong> désignation<br />
d’un homme Eau. Cette personne sera chargée d’assurer l’analyse <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong> prendre les mesures<br />
correctives qui s’imposent en re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> SDE qui disposera du même logiciel centralisé à Hann.<br />
Le comité <strong>de</strong> suivi du processus <strong>de</strong> rationalisation <strong>de</strong>s consommations d’eau <strong>de</strong> l’administration a par<br />
ailleurs tenu sa <strong>de</strong>uxième réunion le 10 décembre 2012 au sortir <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle les décisions suivantes ont<br />
été prises :<br />
5. La SDE mobilisera en <strong>2013</strong> un budget <strong>de</strong> 80 millions <strong>de</strong> FCFA pour l'acquisition <strong>de</strong> 100 compteurs<br />
«intelligents» (<strong>de</strong> type WATERMIND) dont <strong>la</strong> pose est prévue avant <strong>la</strong> fin du premier trimestre <strong>de</strong> <strong>2013</strong> ;<br />
6. Une étu<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> procédure d’abonnement et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s polices d’eau <strong>de</strong> l’Administration sera réalisée<br />
par <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong> l’Hydraulique pour prendre en charge les difficultés rencontrées par <strong>la</strong> SDE dans <strong>la</strong><br />
maîtrise du fichier réel au titre <strong>de</strong> l’Administration re<strong>la</strong>tivement à l’absence <strong>de</strong> dispositions officielles dans<br />
les modalités d’autorisation ou <strong>de</strong> résiliation <strong>de</strong>s abonnements ;<br />
7. La Direction du Budget effectuera à partir <strong>de</strong> <strong>2013</strong> le test du mécanisme <strong>de</strong> suivi individualisé <strong>de</strong>s paiements<br />
d’eau au sein <strong>de</strong>s départements ministériels ; en effet chaque service aura sa dotation budgétaire et un suivi<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> certification <strong>de</strong>s factures sera assuré avec les DAGE et les SAGE.
4.6<br />
4.6 Réforme institutionnelle du secteur en milieu urbain<br />
Il existe un consensus parmi les acteurs du sous-secteur <strong>de</strong> l’hydraulique urbaine sur le fait que <strong>la</strong> réforme<br />
du secteur <strong>de</strong> 1995 a été un succès : le déficit <strong>de</strong> production a pu être résorbé et les investissements<br />
nécessaires ont été réalisés pour satisfaire <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> moyenne en eau jusqu’en 2015 et l'équilibre<br />
financier du secteur a été atteint en décembre 2003, conformément aux prévisions. Ainsi <strong>la</strong> production<br />
d’eau dans le périmètre affermé est passée <strong>de</strong> 96,3 millions <strong>de</strong> m 3 en 1997 à 148,6 millions <strong>de</strong> m 3 en<br />
2011. Plus <strong>de</strong> 300 milliards <strong>de</strong> FCFA ont été mobilisés sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1996-2011 dans le cadre <strong>de</strong>s grands<br />
programmes tels le PSE et le PELT et le taux d’accès à l’eau potable est l’un <strong>de</strong>s plus élevés en Afrique <strong>de</strong><br />
l’Ouest avec 98,7% en décembre 2011. Les performances enregistrées dans le cadre du contrat<br />
d’affermage sont très satisfaisantes et <strong>de</strong>vraient permettre au Sénégal d’entrer dans une nouvelle phase<br />
<strong>de</strong> consolidation <strong>de</strong>s acquis pour les prochaines années.<br />
Pour le sous-secteur <strong>de</strong> l’assainissement urbain, environ 200 milliards <strong>de</strong> FCFA ont été investis <strong>de</strong>puis<br />
1996 ; ce qui a permis <strong>de</strong> relever le taux d’accès <strong>de</strong> 53% à 63% en 2011 et le taux <strong>de</strong> dépollution, <strong>de</strong> 13% à<br />
23,5% sur <strong>la</strong> même pério<strong>de</strong>. Toutefois pour ce sous-secteur les résultats <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme sont plus ou moins<br />
mitigés. En effet ce sous-secteur reste confronté à un certain nombre <strong>de</strong> contraintes qui entravent son<br />
développement : (i) une insuffisance <strong>de</strong> financement soutenu pour faire face aux besoins<br />
d’investissement pour le développement <strong>de</strong> l’accès, et (ii) <strong>la</strong> faiblesse <strong>de</strong>s ressources issues <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
re<strong>de</strong>vance qui ne couvrent pas les charges d’exploitation ; ce qui entraîne une dégradation <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité<br />
du service offert aux popu<strong>la</strong>tions et un déséquilibre financier structurel.<br />
En matière <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s ressources en eau, <strong>de</strong>s évolutions très importantes ont également été<br />
enregistrées, notamment avec le renforcement du cadre institutionnel à travers <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gestion et <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification <strong>de</strong>s Ressources en Eau (DGPRE), <strong>la</strong> définition d’un P<strong>la</strong>n<br />
d’Actions pour <strong>la</strong> Gestion Intégrée <strong>de</strong>s Ressources en Eau (PAGIRE) et <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’Office du Lac <strong>de</strong><br />
Guiers (OLAG). Par ailleurs, les résultats enregistrés dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme ont permis au Sénégal <strong>de</strong><br />
construire une vision stratégique pour l’atteinte <strong>de</strong>s Objectifs du Millénaire pour le Développement<br />
(OMD) à travers <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce en 2005 du Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire<br />
(PEPAM). Toutefois malgré toutes les performances relevées ci-<strong>de</strong>ssus, le secteur <strong>de</strong> l’hydraulique urbaine<br />
et <strong>de</strong> l’assainissement continue <strong>de</strong> faire face à <strong>de</strong>s défis importants qu’il faudra surmonter dans les<br />
prochaines années pour consoli<strong>de</strong>r les acquis et corriger les insuffisances constatées.<br />
A ce titre le Gouvernement, sous l’impulsion <strong>de</strong> <strong>la</strong> Primature a élevé <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme du soussecteur<br />
<strong>de</strong> l’hydraulique et <strong>de</strong> l’assainissement au rang <strong>de</strong> priorité. Un Comité Technique Interministériel<br />
a ainsi été mis en p<strong>la</strong>ce qui, au sortir <strong>de</strong>s travaux du séminaire <strong>de</strong> Saly et <strong>de</strong>s concertations qui s’en sont<br />
suivies, a produit une Note d’Orientation validée par le Premier Ministre à travers <strong>la</strong> lettre n°3229<br />
PM/CAB/CS.MS/dkf du 27 août 2012. La feuille <strong>de</strong> route déclinée dans <strong>la</strong> note d’orientation est <strong>de</strong>puis<br />
lors en train d’être mise en œuvre ; les principales actions réalisées sont présentées ainsi qu’il suit.<br />
- E<strong>la</strong>boration du programme d’investissement <strong>de</strong> l’hydraulique urbaine à l’horizon 2025<br />
L’une <strong>de</strong>s préoccupations essentielles du Gouvernement et prise en charge par <strong>la</strong> Note d’Orientation du<br />
Comité Technique Interministériel concerne <strong>la</strong> problématique <strong>de</strong> l’approvisionnement en eau potable <strong>de</strong><br />
Dakar et <strong>la</strong> Petite Côte à l’horizon 2025. Le schéma d’investissement proposé par <strong>la</strong> SONES et qui prend<br />
en compte les directives <strong>de</strong>s plus hautes Autorités se caractérise par <strong>la</strong> mise en œuvre : (i) d’un<br />
programme à court terme (<strong>2013</strong>-2017), et (ii) d’un programme à moyen et long terme (2018-2025).<br />
Phase à court terme du programme d'investissement<br />
Suite à <strong>la</strong> saisine officielle du Ministre <strong>de</strong> l'Hydraulique et <strong>de</strong> l'Assainissement (lettre n°0784/MHA/DH du<br />
08 octobre 2012), <strong>la</strong> SONES a proposé un programme d’investissement pour <strong>la</strong> phase à court terme qui<br />
garantit une production <strong>la</strong>rgement suffisante pour couvrir les besoins en eau dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Dakar sur<br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>2013</strong>-2018. Il inclut :
4.7<br />
i. La réalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase d’urgence comprenant <strong>la</strong> réhabilitation <strong>de</strong> forages existants, <strong>la</strong><br />
réalisation <strong>de</strong> nouveaux forages et d’autres interventions d’optimisation qui permettront<br />
d'assurer une production <strong>de</strong> 34.540 m 3 /j. Cette production additionnelle permettrait d'éviter tout<br />
déficit à l’horizon 2014. Le financement <strong>de</strong> ce programme sera assuré sur fonds propres <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
SONES pour un montant prévisionnel <strong>de</strong> 2,410 milliards FCFA. La phase d’urgence comporte les<br />
travaux suivants :<br />
ii.<br />
iii.<br />
iv.<br />
- Equipement <strong>de</strong> 03 forages (PS2 bis, Kelle 2 et Kelle 4,<br />
- Réhabilitation du forage PK3 <strong>de</strong> POUT,<br />
- Renouvellement <strong>de</strong> 07 forages (PK2, PK4, PN 1, PN13, FLN 6, FLN 10 et FLN 13),<br />
- Travaux <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment du forage <strong>de</strong> Guéoul sur ALG,<br />
- Instal<strong>la</strong>tion d’aérateurs Amont réservoirs <strong>de</strong> Thiès.<br />
La réalisation du Programme d’Investissement Prioritaire du PEPAM à Dakar et dans les Régions<br />
pour un montant <strong>de</strong> 41 milliards FCFA avec l’appui <strong>de</strong> l’AFD, <strong>la</strong> BEI, l’UE, <strong>la</strong> BOAD et l’IDA,<br />
L’Amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’eau dans les villes <strong>de</strong> KAOLACK, FATICK (un excès <strong>de</strong> fluor et <strong>de</strong><br />
chlorures) et KOUNGHEUL (un excès <strong>de</strong> fer) pour un montant <strong>de</strong> 7,345 milliards FCFA sur<br />
financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> BOAD et <strong>de</strong> <strong>la</strong> SONES,<br />
L’Amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’eau dans <strong>la</strong> banlieue <strong>de</strong> Dakar par une nouvelle station <strong>de</strong><br />
déferrisation d’une capacité <strong>de</strong> 50.000 m 3 /j pour un montant <strong>de</strong> 4 milliards <strong>de</strong> FCFA toujours sur<br />
financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> BOAD et <strong>de</strong> <strong>la</strong> SONES,<br />
v. La Construction d’une station <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssalement d’eau <strong>de</strong> mer à Dakar d’une capacité <strong>de</strong> 25.000<br />
m 3 /j extensible à 50 000 m 3 /j pour un montant <strong>de</strong> 28 milliards FCFA avec un appui attendu <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
JICA,<br />
vi.<br />
vii.<br />
Le Renforcement du système <strong>de</strong> production d’eau potable <strong>de</strong> <strong>la</strong> Petite Côte,<br />
Et le Renforcement <strong>de</strong>s systèmes d’AEP <strong>de</strong>s villes régionales.<br />
Il convient <strong>de</strong> noter que ce programme d’investissement ne tient pas compte <strong>de</strong>s effets bénéfiques qui<br />
seraient liés du projet <strong>de</strong> réaffectation <strong>de</strong>s forages <strong>de</strong> Thiaroye et <strong>de</strong> <strong>la</strong> déconnexion subséquente <strong>de</strong><br />
maraichers dans <strong>la</strong> zone <strong>de</strong>s Niayes ; ce qui permettrait <strong>de</strong> récupérer une production d’au moins 16.000<br />
m 3 /jour. Ce projet porte sur les travaux <strong>de</strong> déconnexion <strong>de</strong>s forages <strong>de</strong> Thiaroye dont l’arrêt a été<br />
prononcé il y a quelques années du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> forte teneur en nitrates <strong>de</strong>s eaux produites. Cependant cet<br />
arrêt s’est traduit à <strong>la</strong> longue par un regorgement <strong>de</strong>s nappes <strong>de</strong> cette zone qui a un effet négatif sur les<br />
capacités d’infiltration du sol dans cette partie et partant une aggravation <strong>de</strong>s inondations dans <strong>la</strong><br />
banlieue. Les travaux prévus sont listés comme suit :<br />
- Réhabilitation <strong>de</strong> 6 forages et création <strong>de</strong><br />
4 forages<br />
- Canalisation <strong>de</strong> refoulement et<br />
d’adduction (27 km)<br />
- Equipement électromécanique <strong>de</strong> 10<br />
forages<br />
- Réservoir <strong>de</strong> 3 000 m3<br />
- Station <strong>de</strong> pompage <strong>de</strong> 800 m3/h<br />
- Déconnexion <strong>de</strong>s forages <strong>de</strong> Thiaroye du<br />
réseau d’eau potable et pompage <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
nappe pour son transfert pour l’usage<br />
agricole<br />
Phase à moyen et long terme du programme d'investissement<br />
1. Pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2018-2025, les travaux majeurs ciblés sont :<br />
- La Construction d’une station <strong>de</strong> traitement à Keur Momar Sarr d’une capacité <strong>de</strong> 50.000 m 3 /j,<br />
extensible à 75.000 m 3 /j (KMS3+ALG3) pour un montant <strong>de</strong> 112 milliards FCFA,
4.8<br />
- L’Extension <strong>de</strong> l’usine <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssalement <strong>de</strong> Dakar à 50.000 m 3 /j pour un montant <strong>de</strong> 16 milliards<br />
FCFA,<br />
- La Construction d’une station <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssalement d’eau <strong>de</strong> mer dans <strong>la</strong> zone <strong>de</strong> <strong>la</strong> Petite-Côte d’une<br />
capacité <strong>de</strong> 10.000 m 3 /j, extensible à 20.000 m 3 /j pour un montant <strong>de</strong> 15 milliards FCFA,<br />
- La mise en œuvre du Programme Post-OMD pour Dakar et Régions.<br />
- Prorogation du contrat d'affermage ETAT-SONES-SDE<br />
Tenant compte <strong>de</strong> l’échéance du 31 décembre 2012 coïncidant avec <strong>la</strong> date d’expiration <strong>de</strong> l’avenant n°5<br />
au contrat d’affermage entre l’Etat, <strong>la</strong> SONES et <strong>la</strong> SDE, du non démarrage <strong>de</strong>s négociations pour <strong>la</strong><br />
prorogation du contrat sur un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> cinq (05) ans et sur instruction du Premier Ministre, le Ministère <strong>de</strong><br />
l’Hydraulique et <strong>de</strong> l’Assainissement a engagé <strong>de</strong>s négociations avec <strong>la</strong> SDE pour <strong>la</strong> signature d’un avenant<br />
n°6 au contrat d'affermage sur une pério<strong>de</strong> d’une année al<strong>la</strong>nt du 1er janvier <strong>2013</strong> au 31 décembre <strong>2013</strong>.<br />
La SDE a accepté le principe et une entente a été trouvée par les parties prenantes sur un projet<br />
d’avenant qui a été signé le 31 décembre 2012. La partie publique (Etat, SONES) et <strong>la</strong> SDE ont aussi<br />
convenu <strong>de</strong> <strong>la</strong>ncer aussitôt les négociations pour aller dans le sens d’un nouvel avenant sur une durée <strong>de</strong><br />
cinq (05) ans si toutes les conditions sont réunies. Ces négociations seront terminées au plus tard le 30<br />
juin <strong>2013</strong> conformément aux c<strong>la</strong>uses <strong>de</strong> l’avenant n°6 signé par les parties contractantes.<br />
Simplification <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions contractuelles SONES-SDE<br />
Faisant suite au courrier officiel du Ministre <strong>de</strong> l’Hydraulique et <strong>de</strong> l’Assainissement (n°0822/MHA/DH du<br />
12 octobre 2012), <strong>la</strong> SONES et <strong>la</strong> SDE ont transmis les points <strong>de</strong> négociations dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
simplification <strong>de</strong> leurs re<strong>la</strong>tions contractuelles. Un comité <strong>de</strong> facilitation a été mis en p<strong>la</strong>ce présidé par le<br />
Secrétaire Général du Ministère <strong>de</strong> l’Hydraulique et <strong>de</strong> l’Assainissement et comprenant en outre <strong>la</strong><br />
Direction <strong>de</strong> l’Hydraulique et l’Unité <strong>de</strong> Coordination du PEPAM. Les travaux du Comité <strong>de</strong> facilitation ont<br />
démarré le 20 décembre 2012 au Centre <strong>de</strong> Métiers <strong>de</strong> l’Eau et ont permis, au sortir d’intenses échanges<br />
et discussions, <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s accords sur les points suivants :<br />
1. Audit <strong>de</strong> <strong>la</strong> comptabilité analytique <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDE : Après <strong>de</strong>s blocages nés d’une incompréhension entre<br />
les <strong>de</strong>ux structures, <strong>la</strong> SDE a accepté que <strong>la</strong> mission puisse démarrer au plus tard le 15 février <strong>2013</strong> ;<br />
<strong>la</strong> SONES a déjà recruté le Cabinet spécialisé Ernst & Young à cet effet aux fins <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’audit<br />
<strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDE pour les exercices al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> 2006 à 2012,<br />
2. Communication <strong>de</strong> documents par <strong>la</strong> SDE à <strong>la</strong> SONES : au sortir <strong>de</strong>s discussions, les <strong>de</strong>ux parties ont<br />
convenu d’arrêter <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s documents que <strong>la</strong> SDE transmettra désormais à <strong>la</strong> SONES selon <strong>de</strong>s<br />
pério<strong>de</strong>s qui seront définies en fonction <strong>de</strong>s échéances pertinentes pour les types d’informations<br />
considérés. En ce qui concerne plus spécifiquement <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong>s données cartographiques, <strong>la</strong><br />
SDE a marqué son accord pour <strong>la</strong> mise à disposition <strong>de</strong> fichiers numériques en lieu et p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s<br />
copies dures qui étaient jusque-là envoyées à <strong>la</strong> SONES,<br />
3. Mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong> l’acompte mensuel : les <strong>de</strong>ux parties se sont entendues sur le fait que le<br />
sol<strong>de</strong> lié aux pénalités <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> réseaux n’étant connu qu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’année, <strong>la</strong> SDE ne<br />
saurait procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s versements anticipés <strong>de</strong> montants qu’elle n’a pas encore encaissés comme le<br />
lui <strong>de</strong>mandait <strong>la</strong> SONES.<br />
Concernant <strong>la</strong> prévision <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : les <strong>de</strong>ux parties ne se sont pas entendues, notamment sur les<br />
exigences <strong>de</strong> <strong>la</strong> SONES en termes <strong>de</strong> ristourne en cas d’écart positif sur les prévisions <strong>de</strong> production ainsi<br />
que sur les modalités <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong> l’acompte mensuel que <strong>la</strong> SDE doit verser à <strong>la</strong> SONES. Face à<br />
une absence <strong>de</strong> consensus sur ce point, le comité <strong>de</strong> facilitation a retenu le principe <strong>de</strong> rediscuter <strong>la</strong><br />
question dans le cadre <strong>de</strong>s futures négociations à travers les travaux <strong>de</strong>s commissions spécialisées.
4.9<br />
4.7 Situation financière <strong>de</strong> <strong>la</strong> SONES<br />
L’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation financière <strong>de</strong> <strong>la</strong> SONES fait ressortir qu’au titre <strong>de</strong> l’année 2012, les<br />
comptes arrêtés au 31 Décembre affichent un bénéfice net <strong>de</strong> 1,850 Milliards FCFA contre 1,516<br />
Milliards en 2011 soit une progression <strong>de</strong> 22%<br />
En Millions <strong>de</strong> FCFA 2 010 2 011 2012 Evolution<br />
Chiffre d’affaires 17 920 18 146 17 249 - 5%<br />
Valeur ajoutée 16 496 16 623 14 378 -14%<br />
Excé<strong>de</strong>nt Brut Exploitation 15 220 15 188 12 744 -16%<br />
Résultat d’Exploitation 4 077 4 523 4 039 -11%<br />
Résultat Financier -2 753 - 2 431 1 999 +17%<br />
Résultat avant impôts 1 919 2 292 2 643 +15%<br />
Résultat Net ( Bénéfice) 1 480 1 516 1 850 +22%<br />
Capacité d’autofinancement 12 031 11 984 9 861 -18%<br />
Au titre <strong>de</strong> l’activité les principaux indicateurs significatifs sont les suivants :<br />
2011 2012 évolution commentaires<br />
Production (m3) 148 599 686 153 790 720 +3 ,5%<br />
réalisation /prévisions 2012 100,15% prévisions; 153 552 000 m3<br />
Prix Patrimoine (F/m3) 147,9 137,25<br />
Prix moyen eau (F/m3) 548,8 545,7<br />
Prix Exploitant (F/m3) 356,44 364<br />
La trésorerie globale au 31/12/2012 est <strong>de</strong> 9,12 Milliards FCFA (comprenant en partie les sol<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s<br />
versements <strong>de</strong>s bailleurs du PEPAM urbain 4 milliards et <strong>de</strong> l’Etat pour l’AIBD 1,4 milliards).<br />
La trésorerie propre est <strong>de</strong> 2,49 Milliards FCFA.<br />
Au titre du paiement <strong>de</strong>s factures d’eau <strong>de</strong> l’Etat, une <strong>de</strong>uxième convention <strong>de</strong> compensation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ttes<br />
croisées entre l’Etat, <strong>la</strong> SDE, l’ONAS et <strong>la</strong> SONES est en préparation. Le montant <strong>de</strong>s arriérés <strong>de</strong><br />
l’Administration centrale au 31/12/2011 incluant le 6 e bi 2011 s’élève globalement à 23,873 Mds FCFA<br />
TTC réparti comme suit : SONES : 11,534 Mds FCFA ; ONAS : 5,036 Mds FCFA ; SDE pour : 3,651 Mds .TVA<br />
et autres taxes 3,652 Mds.
REVUEANNUELLE<br />
SECTORIELLE<br />
CONJOINTE<br />
5.0<br />
Assainissement<br />
urbain
5.1<br />
5. Résultats enregistrés pour l’assainissement urbain<br />
5.1 Rappel <strong>de</strong>s objectifs du sous-secteur<br />
L’objectif global du PEPAM en milieu urbain pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2005-2015, est <strong>de</strong> permettre à 241.523<br />
ménages supplémentaires d'accé<strong>de</strong>r à un service d'assainissement approprié à travers le relèvement<br />
<strong>de</strong>s objectifs spécifiques ci-après :<br />
• le taux d'accès à l'assainissement <strong>de</strong> 56,7% en 2004 passera à 78% en 2015 ;<br />
• Le taux <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s eaux usées <strong>de</strong> 19% en 2004 passera à 61% en 2015 ;<br />
• Le taux <strong>de</strong> dépollution <strong>de</strong> 13% en 2004 passera à 44% en 2015.<br />
Pour l’atteinte <strong>de</strong> ces objectifs spécifiques, les réalisations prévues par le programme sont :<br />
• 92 400 branchements à l’égout ;<br />
• 801 km mètre linéaire d’extension <strong>de</strong> réseau ;<br />
• 135 300 d’ouvrages d’assainissement individuels ;<br />
• 160 édicules publics ;<br />
• 94.242 m3/jours seront épurées.<br />
Les besoins en financement nécessaires pour ces réalisations sont évalués à 220,6 Milliards suite au<br />
programme d’investissement établi en 2004 dans le cadre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie pour l’atteinte <strong>de</strong>s<br />
OMD en 2015.<br />
5.2 Portefeuille <strong>de</strong>s opérations du sous-secteur<br />
Sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2005-2012, ce sont trente (30) opérations majeures qui ont été mis en œuvre pour le<br />
développement <strong>de</strong>s infrastructures et <strong>de</strong> l'accès à l’assainissement en milieu urbain. Ces différentes<br />
opérations se chiffrent à 145 milliards FCFA et ont été clôturées pour l’essentiel ; les opérations qui<br />
sont actuellement en cours sont au nombre <strong>de</strong> quatre (04) et totalisent un financement global <strong>de</strong><br />
19,627 milliards FCFA.<br />
5.3 Mobilisation <strong>de</strong> financement pour l’assainissement urbain<br />
Les besoins en financement pour atteindre les OMD du sous-secteur <strong>de</strong> l’assainissement urbain<br />
s’élèvent à 220,6 Milliards <strong>de</strong> FCFA. La situation <strong>de</strong>s financements acquis en fin 2012 s’élèvent à<br />
171,901 milliards FCFA ; soit un taux <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> 77,9%.<br />
Le portefeuille global <strong>de</strong>s financements <strong>de</strong><br />
l’assainissement urbain est essentiellement constitué<br />
<strong>de</strong> prêts qui représentent 60% <strong>de</strong>s ressources<br />
mobilisées. Les subventions représentent 19,9% du<br />
portefeuille contre 21,7% <strong>de</strong>s financements en 2011 ;<br />
elles ont été acquises auprès d’institutions telles l’UE,<br />
le Royaume <strong>de</strong> Belgique et UN-Habitat. La contribution<br />
<strong>de</strong> l’Etat au financement <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> l’ONAS<br />
s’élève à 20% contre 15,5% en 2011.
5.2<br />
Le récapitu<strong>la</strong>tifs <strong>de</strong>s réalisations durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2005-2011 est présenté dans le tableau ci<strong>de</strong>ssous<br />
:<br />
Tableau 2 : Réalisations entre 2005-2012<br />
Rubrique<br />
Unité<br />
Quantité ciblée à<br />
l'horizon 2015<br />
Quantité réalisée<br />
entre 2005 et 2012<br />
% <strong>de</strong> réalisation # à<br />
l’objectif <strong>de</strong> 2012<br />
Assainissement Collectif<br />
Longueur réseau eaux usées Km 801 625 78%<br />
Capacité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s eaux m3/jour 94 242 7 865 8,30%<br />
Nombre <strong>de</strong> branchements U 92 400 44 678 48,40%<br />
Assainissement Autonome<br />
Nombre <strong>de</strong> systèmes autonomes U 135 300 45 399 33,60%<br />
Nombre d'édicules publics U 160 2 1,25%<br />
L’analyse <strong>de</strong>s réalisations présentées dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssus montre que :(i) le linéaire d’extension<br />
du réseau est bien avancé par rapport à l’objectif visé avec un taux <strong>de</strong> progression <strong>de</strong> 89.3 km/an qui<br />
est supérieur au taux objectif <strong>de</strong> 80.1 km/an. Toutefois le niveau <strong>de</strong> progression est re<strong>la</strong>tivement faible<br />
mais n’a pratiquement pas bougé entre 2009 et 2011 (527 km en 2009). Les autres paramètres que<br />
sont <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> traitement, le nombre <strong>de</strong> branchement et le nombre <strong>de</strong> système autonome sont en<br />
<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong>s 50% <strong>de</strong> réalisation ce qui est préoccupant si l’on sait que nous sommes dans le <strong>de</strong>rnier<br />
tiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> couverte par le PEPAM.<br />
5.4 Impact <strong>de</strong>s réalisations sur l’évolution <strong>de</strong>s indicateurs<br />
Trois indicateurs ont été i<strong>de</strong>ntifiés dans le cadre du PEPAM pour mesurer l’impact <strong>de</strong>s différentes<br />
réalisations ; il s’agit du taux d’accès à l’assainissement, du taux <strong>de</strong> dépollution et du taux <strong>de</strong><br />
traitement.<br />
5.4.1 Le taux d’accès à l’assainissement :<br />
En 2004, le nombre <strong>de</strong> ménages assainis en milieu urbain était <strong>de</strong> 303 247 sur un nombre total <strong>de</strong><br />
ménage <strong>de</strong> 535 014 soit un taux <strong>de</strong> 56,7%. Entre 2005 et 2011, les actions menées dans le cadre <strong>de</strong>s<br />
projets ont permis <strong>la</strong> réalisation :<br />
1. <strong>de</strong> 30 597 branchements au réseau collectif ;<br />
2. <strong>de</strong> 11 477 branchements au réseau semi-collectif ;<br />
3. et enfin <strong>de</strong> 45 047 systèmes autonomes.<br />
Le nombre <strong>de</strong> ménage correspondant à ces réalisations se calcule en faisant les équivalences<br />
suivantes : (i) 01 branchement au réseau collectif correspond à 1,3 ménage <strong>de</strong>sservi et (ii) 01<br />
raccor<strong>de</strong>ment à un réseau semi-collectif ou 01 système autonome correspond à 01 ménage <strong>de</strong>sservi.<br />
On en déduit que 100 169 ménages supplémentaires ont<br />
eu accès à l'assainissement en milieu urbain entre 2005 et<br />
2012, ce qui porte à 403 416, le nombre <strong>de</strong> ménages<br />
assaini sur un nombre total <strong>de</strong> 646 367 soit un taux d’accès<br />
<strong>de</strong> 62,4% en 2012. Une baisse <strong>de</strong> 0,9% est notée entre<br />
2011 et 2012, expliquée par <strong>la</strong> faiblesse <strong>de</strong>s<br />
investissements en termes d’accès à l’assainissement. Ce<br />
résultat ne tient toutefois pas compte <strong>de</strong>s réalisations non<br />
comptabilisées d’ouvrages individuels dans les nouveaux<br />
lotissements et habitations individuelles.<br />
Taux d'accès (%)<br />
Courbe d'évolution du taux d'accès à l'assainisement urbain - 2005-2012<br />
64,0%<br />
63,0%<br />
62,0%<br />
61,0%<br />
60,0%<br />
59,0%<br />
58,0%<br />
57,0%<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Taux 59,9% 61,9% 63,6% 63,7% 63,6% 63,1% 63,3% 62,40%
5.3<br />
5.4.2 Le taux <strong>de</strong> traitement<br />
Le taux <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s eaux usées est, dans un périmètre donné, le rapport entre le volume d’eaux<br />
usées traité par <strong>la</strong> station d’épuration <strong>de</strong> ce périmètre et le volume d’eaux usées collecté par le réseau<br />
public <strong>de</strong> ce même périmètre. Ce taux est passé <strong>de</strong> 19% en 2004 à 41,5% en 2012. Ce taux est<br />
inférieur à celui objectif intermédiaire <strong>de</strong> 49,5%. En considérant que d’ici 2015, il est improbable que<br />
<strong>de</strong>s travaux puissent être réalisés dans le sens d’améliorer les capacités <strong>de</strong> traitement même si <strong>de</strong>s<br />
financements seront mobilisés et disponibles, <strong>la</strong> cible OMD re<strong>la</strong>tif au taux <strong>de</strong> traitement ne sera pas<br />
atteint et pire sera dégradé, étant donné que les rejets vont s’accroitre <strong>de</strong> manière irréversible.<br />
.<br />
5.4.3 Le taux <strong>de</strong> dépollution :<br />
Le taux <strong>de</strong> dépollution est le ratio entre <strong>la</strong> pollution organique éliminée par les stations d’épuration<br />
<strong>de</strong>s eaux usées domestiques et <strong>la</strong> pollution totale produite par les habitants, et collectées par les<br />
réseaux publics d’assainissement. Il est aussi donné par le produit entre le ren<strong>de</strong>ment épuratoire et le<br />
taux <strong>de</strong> traitement. Ce taux est passé <strong>de</strong> 13% en 2004 à 30,3% en 2012 et est inférieur à l’objectif<br />
intermédiaire <strong>de</strong> 35,5%.<br />
.<br />
5.4.4 Analyse <strong>de</strong>s écarts<br />
5.4.4.1 Le taux d’accès<br />
Le taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain est passé <strong>de</strong> 56,7% en 2004 à 63,3% en 2011, ce qui<br />
donne une progression <strong>la</strong>rgement inférieure à l’objectif moyen OMD qui est <strong>de</strong> 72,1% en fin 2011.<br />
Cependant, ce résultat pourrait être certainement amélioré par <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong>s réalisations non<br />
comptabilisées d’ouvrages individuels dans les nouveaux lotissements et habitations individuelles. La<br />
tendance actuelle va cependant s’accentuer très rapi<strong>de</strong>ment si <strong>la</strong> mobilisation financière requise pour<br />
continuer <strong>de</strong> subventionner l’accès à l’assainissement n’est pas assurée. En l’absence <strong>de</strong> ressource à<br />
très court terme, le taux d’accès va s’écarter plus en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> l’objectif moyen après 2011, et s’en<br />
éloigner rapi<strong>de</strong>ment pour atteindre un déficit <strong>de</strong> 18 points en 2015.<br />
5.4.4.2 Le Traitement et <strong>la</strong> Dépollution <strong>de</strong>s eaux usées<br />
De 2004 à 2012, le taux <strong>de</strong> traitement est passé <strong>de</strong> 19% à 41,5% et a connu un avancement <strong>de</strong> 22,5<br />
points en 8 ans. Mais il est cependant très en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 8 points <strong>de</strong> l’objectif intermédiaire <strong>de</strong> 2012<br />
fixé à 49,5%. Le taux <strong>de</strong> dépollution <strong>de</strong>s eaux usées est passé <strong>de</strong> 13% en 2004 à 30,3 % en 2012 et a<br />
connu un avancement <strong>de</strong> 17,3 points en 8 ans. Cependant il est en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 5,2 points <strong>de</strong> l’objectif<br />
intermédiaire <strong>de</strong> 2012 fixé à 35,5%.<br />
De même que pour le taux d’accès, <strong>la</strong> tendance actuelle va s’accentuer très rapi<strong>de</strong>ment si <strong>la</strong><br />
mobilisation financière requise pour renforcer <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong>s stations d’épuration n’est pas assurée.<br />
Nous remarquons que les <strong>de</strong>ux taux s’écartent <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong>s objectifs intermédiaires pour<br />
atteindre un déficit <strong>de</strong> 9,5 points en 2015 pour le taux <strong>de</strong> traitement et <strong>de</strong> 7,4 points pour le taux <strong>de</strong><br />
dépollution.<br />
5.5 Perspectives du sous-secteur<br />
Le rythme <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong>s financements doit être augmenté si l’on veut engager les 220,6 Milliards<br />
<strong>de</strong> FCFA en dix (10) ans. Pour atteindre les objectifs <strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte, <strong>de</strong> traitement et <strong>de</strong> dépollution, il<br />
ressort qu’un gap <strong>de</strong> 97,12 Milliards <strong>de</strong> FCFA par rapport à l’estimation <strong>de</strong> 2004 sera nécessaire pour<br />
l’atteinte <strong>de</strong>s OMD.
5.4<br />
Les réévaluations opérées sur les projets<br />
ci-après ont permis <strong>de</strong> réactualiser les<br />
coûts et d’arriver à <strong>de</strong>s besoins<br />
supérieurs à ceux i<strong>de</strong>ntifiés en 2011 qui<br />
étaient à 76 milliards FCFA.<br />
Montant (en<br />
Projets en Recherche <strong>de</strong> financement<br />
Milliers <strong>de</strong> F<br />
CFA)<br />
Renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> station<br />
d'épuration <strong>de</strong> Cambérène<br />
35 000<br />
Finalisation travaux émissaire en mer 6 959<br />
Branchements Sociaux 9 800<br />
Assainissement Autonome 45 360<br />
TOTAL 97 119<br />
5.6 Mesures d’accompagnement<br />
5.6.1 Le renouvellement du réseau:<br />
Le renouvellement du réseau a été i<strong>de</strong>ntifié comme une stratégie importante à mettre en œuvre pour<br />
<strong>la</strong> viabilité <strong>de</strong>s actions entreprises dans le cadre du PEPAM. En effet le réseau <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s eaux<br />
usées <strong>de</strong> Dakar long <strong>de</strong> 1284 km environ compte 400 km <strong>de</strong> réseaux en amiante ciment dont une<br />
moitié a plus <strong>de</strong> 60 ans d’âge et l’autre moitié un âge compris entre 40 et 60 ans. De même 250 km <strong>de</strong><br />
réseaux majoritairement en PVC ont un peu moins <strong>de</strong> 40 ans.<br />
Ce<strong>la</strong> montre le besoin pressant d’un vaste programme <strong>de</strong> renouvellement en vue <strong>de</strong> réduire les<br />
charges d’exploitation du réseau mais aussi <strong>de</strong> réduire les désagréments dus au disfonctionnement du<br />
réseau. Afin <strong>de</strong> remettre en état le réseau, un linéaire <strong>de</strong> 300 km <strong>de</strong>vra être renouvelé en urgence. Le<br />
montant estimatif <strong>de</strong> ces travaux est d’environ 46 Milliards <strong>de</strong> francs CFA.<br />
5.6.2 La viabilité financière <strong>de</strong> l’ONAS<br />
La faiblesse <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance assainissement qui est <strong>la</strong> principale ressource pour financer l’exploitation<br />
<strong>de</strong>s eaux usées constitue l’une <strong>de</strong>s principales contraintes du sous-secteur <strong>de</strong> l’assainissement. Elle<br />
représente 10,37% du prix moyen du m3 d’eau vendue. En d’autres termes, conformément au Procèsverbal<br />
d’arrêté du prix moyen en date du 11 mai 2012, sur le prix moyen du m3 d’eau vendue à 548,89<br />
F CFA, l’ONAS perçoit au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance 56,94 F CFA/m3, tandis que le prix <strong>de</strong> l’exploitant (SDE)<br />
est fixé à 356,44 F CFA/m3 et le prix du gestionnaire du patrimoine (SONES) à 147,91 F CFA/m3.<br />
L’ONAS a perçu au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance assainissement à fin 2012, un montant moyen mensuel <strong>de</strong> 340<br />
millions <strong>de</strong> FCFA contre <strong>de</strong>s dépenses moyennes mensuelles d’exploitation qui s’élèvent à 550 millions<br />
F CFA. Ceci est dû au fait que l’évolution du niveau <strong>de</strong> cette re<strong>de</strong>vance n’a pas suivi celle <strong>de</strong>s charges<br />
d’exploitation qui ont sensiblement augmenté avec l’incorporation <strong>de</strong>s nouveaux ouvrages issus <strong>de</strong>s<br />
investissements réalisés à travers les différents projets et programmes. Le tableau ci-<strong>de</strong>ssous donne<br />
l’évolution du résultat du compte d’exploitation <strong>de</strong> l’ONAS et <strong>de</strong> <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s charges<br />
d’exploitation par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance assainissement:<br />
Libelle 2008 2009 2010 2011<br />
Re<strong>de</strong>vance assainissement 4 884 4 900 5150 5282<br />
Subventions d'exploitation 1 200 1 748 1 232 1336<br />
Autres Produits 421 264 321 692<br />
Total Produits 6 506 6 912 6 705 7311<br />
Total Charges 7 296 7 084 7 326 7583<br />
Résultat Net -790 -172 -620 -272<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s charges<br />
d'exploitation par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance<br />
66,95% 69,16% 70,29% 69,65%
5.5<br />
Il ressort ainsi <strong>de</strong> ce tableau que le taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s charges d’exploitation par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance<br />
assainissement tourne en moyenne autour <strong>de</strong> 70% sur les quatre <strong>de</strong>rnières années. Cette situation se<br />
justifie principalement par le blocage <strong>de</strong>s tarifs assainissement <strong>de</strong>puis 2008. La persistance <strong>de</strong> cette<br />
situation pose un problème <strong>de</strong> viabilité financière, voire <strong>de</strong> survie <strong>de</strong> l’ONAS à court terme, et a<br />
amené les bailleurs <strong>de</strong> fonds à se poser <strong>de</strong>s questions sur <strong>la</strong> pertinence même <strong>de</strong> continuer à financer<br />
le sous-secteur <strong>de</strong> l’assainissement étant donné que l’ONAS ne dispose même pas <strong>de</strong> ressources qui lui<br />
permettent d’assurer son fonctionnement et <strong>de</strong> renouveler les immobilisations <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 15 ans.<br />
C’est pourquoi, une augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance assainissement est <strong>de</strong>venue impérative pour<br />
garantir les revenus nécessaires à <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s charges d’exploitation, au risque <strong>de</strong> constater avec<br />
impuissance une dégradation continue <strong>de</strong>s indicateurs <strong>de</strong> performance (temps <strong>de</strong> réponse, taux <strong>de</strong><br />
curage, taux <strong>de</strong> disponibilité <strong>de</strong>s stations, etc.) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité du service offert aux popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> plus<br />
en plus exigeantes en matière d’assainissement. Ainsi, il a été proposé une augmentation du tarif<br />
assainissement moyen tenant compte <strong>de</strong>s hypothèses suivantes :<br />
Libellés 2009 2010 2011<br />
2012<br />
projeté<br />
Total charges d’exploitation hors amortissement 7 084 239 000 7 326 076 000 7 583 604 000 7 790 000 000<br />
Volume facturé (m3) 83 947 233 88 255 783 92 772 203 101 750 000<br />
Tarif moyen assainissement (F CFA / m3) 58,37 58,36 56,94 54,49<br />
Tarif moyen d’équilibre (100% taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s<br />
charges d’exploitation par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance)<br />
84,39 83,01 81,74 76,56<br />
GAP à couvrir 26,02 24,65 24,8 22,07<br />
Tarif moyen d’équilibre (couverture partielle <strong>de</strong>s charges<br />
d’exploitation par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance)<br />
70,09 69,41 68,81 64,77<br />
GAP à couvrir 11,72 11,05 11,87 10,28<br />
Hypothèse 1 : Tarif moyen d’équilibre avec couverture totale <strong>de</strong>s charges d’exploitation hors<br />
amortissement par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance.<br />
Pour assurer une couverture <strong>de</strong> 100% <strong>de</strong>s charges d’exploitation hors amortissement par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance<br />
assainissement, le tarif moyen d’équilibre <strong>de</strong>vrait passer à 76,56 F CFA/m3 en 2012, soit une<br />
augmentation <strong>de</strong> 22,07 F CFA/m3 en valeur absolue et 38,76 % en valeur re<strong>la</strong>tive équivalent à 2,042<br />
milliards <strong>de</strong> Francs CFA <strong>de</strong> revenus additionnels pour garantir l’équilibre financier <strong>de</strong> l’ONAS en 2012.<br />
Ce tarif ne comprend pas <strong>la</strong> prise en charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s eaux pluviales, qui doit être financée sur<br />
les ressources <strong>de</strong>s collectivités locales ou <strong>de</strong> l'Etat.<br />
Hypothèse 2 : Tarif moyen d’équilibre avec couverture partielle <strong>de</strong>s charges d’exploitation hors<br />
amortissement par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance.<br />
Dans le cas d'une augmentation partielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance, c'est-à-dire en ayant recours à <strong>la</strong> fois à <strong>la</strong><br />
re<strong>de</strong>vance et à <strong>la</strong> subvention d’exploitation pour couvrir les besoins <strong>de</strong> financement du service, le tarif<br />
moyen d’équilibre <strong>de</strong>vrait passer à 64,77 F CFA/m3 en 2012, soit une augmentation <strong>de</strong> 10,28 F CFA/m3<br />
en valeur absolue et 18,05 % en valeur re<strong>la</strong>tive, équivalent à 1,045 milliard <strong>de</strong> Francs CFA <strong>de</strong> revenus<br />
additionnels pour garantir l’équilibre financier <strong>de</strong> l’ONAS en 2012. Il faut également préciser qu’une<br />
augmentation du tarif assainissement ne peut être dissociée <strong>de</strong> celle, plus globale du tarif <strong>de</strong> l'eau. En<br />
effet, l’inci<strong>de</strong>nce financière d’une augmentation du tarif assainissement sur <strong>la</strong> facture d’eau serait<br />
d’environ 3,93 % avec une couverture totale <strong>de</strong>s charges d’exploitation par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance et d’environ<br />
1,83 % avec une couverture partielle <strong>de</strong>s charges d’exploitation par <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance.<br />
Une augmentation du tarif assainissement <strong>de</strong>vrait aboutir à une situation financière plus saine qui<br />
permettrait à l’ONAS <strong>de</strong> faire face à ses charges d’exploitation et <strong>de</strong> ne pas compromettre tous les<br />
efforts consentis afin d’offrir aux popu<strong>la</strong>tions un service <strong>de</strong> qualité.
REVUEANNUELLE<br />
SECTORIELLE<br />
CONJOINTE<br />
6.0<br />
Cadreunifié<br />
d‛intervention
7.1 Loi sur le Service Public <strong>de</strong> l’Eau Potable et <strong>de</strong> l’Assainissement (SPEPA)<br />
La loi SPEPA a été promulguée par le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République avant <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’année 2008,<br />
plus précisément le 24 septembre 2008 (référence : 2008-59 du 24/09/2008). Toutefois <strong>la</strong><br />
promulgation est intervenue plus <strong>de</strong> trois ans plus tard que l’échéance fixée par le p<strong>la</strong>n<br />
d’actions annexé à <strong>la</strong> lettre <strong>de</strong> politique sectorielle (15/06/2005).<br />
Cette loi organise le service public <strong>de</strong> l’eau potable et <strong>de</strong> l’assainissement collectif en milieu<br />
urbain et rural. Dans les centres concédés, elle prolonge, é<strong>la</strong>rgit et approfondit l’organisation<br />
<strong>de</strong> ce service initiée par <strong>la</strong> loi n° 95-10 du 7 avril 1995 organisant le service public <strong>de</strong><br />
l’hydraulique urbaine et autorisant <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Nationale <strong>de</strong>s Eaux du Sénégal.<br />
Dans les centres non concédés, elle permet d'institutionnaliser les principes <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong><br />
gestion et <strong>de</strong> contractualisation testés avec succès entre 1999 et 2004 dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
réforme <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s forages ruraux motorisés.<br />
Un comité technique a été mis en p<strong>la</strong>ce par arrêté du Ministre chargé <strong>de</strong> l’Hydraulique qui est<br />
actuellement en train d’é<strong>la</strong>borer les projets texte <strong>de</strong> décrets d’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi SPEPA. Un<br />
consultant a été recruté pour venir en appui à ce Comité Technique en réadaptant et en<br />
complétant les projets <strong>de</strong> décrets proposés en 2012. La validation du cadre réglementaire<br />
interviendra au terme <strong>de</strong>s prestations du consultant, sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s textes proposés et<br />
adoptés par les acteurs du secteur. L’application <strong>de</strong> cette loi dont une <strong>de</strong>s innovations<br />
majeures sera <strong>la</strong> possibilité offerte aux collectivités locales pour être délégataire <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion<br />
du service public <strong>de</strong> l’eau potable à travers <strong>de</strong>s contrats avec l’Etat, <strong>de</strong>vra être effective au<br />
plus tard en 2014.<br />
7.2 Le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’assainissement<br />
Le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’assainissement a été promulgué le 08 juillet 2009 par le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
République après que l’Assemblée Nationale et le Sénat l’ont adopté respectivement les 17 et<br />
19 juin 2009. Les décrets d’application ont été également signés en 2010.<br />
La mise en p<strong>la</strong>ce du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'assainissement fournit l'outil réglementaire spécifique<br />
nécessaire au pilotage sectoriel et permet l’introduction du principe pollueur-payeur dans le<br />
dispositif légis<strong>la</strong>tif pour une gestion satisfaisante <strong>de</strong>s ouvrages prévus dans le cadre du projet<br />
<strong>de</strong> dépollution <strong>de</strong> <strong>la</strong> baie <strong>de</strong> Hann. Le Co<strong>de</strong> permet <strong>de</strong> remédier, non à une vacuité juridique,<br />
mais plutôt <strong>de</strong> systématiser <strong>de</strong>s dispositions dispersées entre les différents co<strong>de</strong>s qui<br />
traitaient jusque-là <strong>de</strong> l’assainissement : co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’eau, co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’hygiène, co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’environnement, co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’urbanisme, co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction. Par ailleurs <strong>la</strong> mise en œuvre<br />
<strong>de</strong>s dispositions du co<strong>de</strong> permet également <strong>de</strong> faire respecter les normes re<strong>la</strong>tives aux<br />
déversements, écoulements, dépôts, jets, enfouissements et immersions directs ou indirects<br />
<strong>de</strong> déchets liqui<strong>de</strong>s, d’origines domestique, hospitalière et industrielle. Toutefois le co<strong>de</strong> doit<br />
faire l’objet d’une meilleure vulgarisation pour son appropriation par les acteurs<br />
particulièrement les collectivités locales dont les responsabilités en matière <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />
canaux d’eaux pluviales à ciel ouvert y sont c<strong>la</strong>irement affirmées et qu’elles sont en mesure <strong>de</strong><br />
confier ce travail à l’ONAS à travers <strong>la</strong> signature <strong>de</strong> conventions particulières.<br />
7.3 Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’eau
La proposition d’adoption <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi abrogeant et remp<strong>la</strong>çant <strong>la</strong> Loi 81-13 du 04 mars 1981<br />
portant Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’eau s’inscrit dans <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> l’État du Sénégal <strong>de</strong> respecter ses<br />
engagements internationaux à promouvoir <strong>la</strong> Gestion Intégrée <strong>de</strong>s Ressources en Eau (GIRE).<br />
La gestion intégrée <strong>de</strong>s ressources en eau (GIRE) est une philosophie qui offre un cadre<br />
conceptuel <strong>de</strong> gouvernance <strong>de</strong> l’eau dans le but d’améliorer sa gestion en vue d’une<br />
utilisation durable <strong>de</strong>s ressources en eau. Elle exige un changement <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> travail<br />
(concertation), d’avoir une vue holistique <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s actions à entreprendre, et <strong>de</strong><br />
comprendre les re<strong>la</strong>tions fonctionnelles qui les lient. Elle cherche également à introduire un<br />
élément <strong>de</strong> subsidiarité dans <strong>la</strong> façon dont l'eau est gérée, avec une insistance sur <strong>la</strong><br />
participation <strong>de</strong>s parties prenantes et <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> décision au niveau inférieur le plus<br />
approprié. Ainsi il est évi<strong>de</strong>nt que le cadre juridique et institutionnel en vigueur comporte<br />
encore beaucoup d’insuffisances par rapport aux principes <strong>de</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gestion intégrée <strong>de</strong>s<br />
ressources en eau (GIRE) que sont les principes d’équité, <strong>de</strong> subsidiarité, d’information et <strong>de</strong><br />
participation, <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification et <strong>de</strong> coopération, <strong>de</strong> gestion par bassin hydrographique, <strong>de</strong><br />
coopération, <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> précaution, <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s usagers et <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature,<br />
d’utilisateur-payeur, <strong>de</strong> pollueur- payeur.<br />
La légis<strong>la</strong>tion est revue pour intégrer les principes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gestion intégrée <strong>de</strong>s ressources en<br />
eau (GIRE) et harmoniser certaines dispositions du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’eau avec les instruments<br />
juridiques postérieurs sur l’eau (droit interne et droit international). Cette réforme offre<br />
l’opportunité d’une relecture du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’eau en re<strong>la</strong>tion avec les autres co<strong>de</strong>s sectoriels<br />
nationaux, le droit international <strong>de</strong> l’eau et le droit comparé notamment <strong>de</strong>s États <strong>de</strong> l’Union<br />
Économique et Monétaire Ouest Africaine (légis<strong>la</strong>tions du Mali, du Burkina Faso, du Togo<br />
etc.).<br />
La réforme du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Eau transpose en droit interne <strong>la</strong> résolution <strong>de</strong>s Nations Unies du 28<br />
juillet 2010 qui « déc<strong>la</strong>re que le droit à une eau potable salubre et propre est un droit<br />
fondamental, essentiel au plein exercice du droit à <strong>la</strong> vie et <strong>de</strong> tous les droits <strong>de</strong> l’homme ».<br />
L'objectif est d'accroître les efforts pour fournir « <strong>de</strong> l'eau potable, salubre, propre, accessible<br />
et abordable et l'assainissement pour tous ».<br />
En somme, le principal objectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle loi est <strong>de</strong> garantir une gestion rationnelle et<br />
durable <strong>de</strong>s ressources en eau du Sénégal. La nouvelle loi a pour objectifs spécifiques<br />
l’intégration <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> <strong>la</strong> GIRE, l’harmonisation et <strong>la</strong> redynamisation du dispositif<br />
légis<strong>la</strong>tif <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s ressources en eau à travers <strong>la</strong> responsabilisation et <strong>la</strong> participation<br />
accrue <strong>de</strong>s acteurs directs (collectivités locales, usagers, secteur privé) et une meilleure<br />
synergie intersectorielle (hydraulique, décentralisation, assainissement, énergie, santé, pêche<br />
continentale et aquaculture).<br />
En résumé les innovations majeures introduites portent sur les points suivants :<br />
− <strong>la</strong> définition <strong>de</strong>s termes clefs re<strong>la</strong>tifs au secteur <strong>de</strong> l’eau en tenant compte <strong>de</strong> celles déjà<br />
consacrées dans le droit positif et par <strong>la</strong> doctrine ;<br />
− <strong>la</strong> consécration <strong>de</strong>s objectifs et <strong>de</strong>s principes généraux <strong>de</strong> <strong>la</strong> GIRE dans le projet du co<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> l’eau ;<br />
− <strong>la</strong> c<strong>la</strong>rification du champ d’application du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’eau ;
− le financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’eau et du secteur <strong>de</strong> l’hydraulique;<br />
− <strong>la</strong> définition du domaine public hydraulique ;<br />
− l’i<strong>de</strong>ntification et <strong>la</strong> c<strong>la</strong>rification <strong>de</strong>s rôles et responsabilités <strong>de</strong>s acteurs dans <strong>la</strong> gestion du<br />
domaine public hydraulique (État, Collectivités locales, société civile et secteur privé) ;<br />
− <strong>la</strong> consécration légis<strong>la</strong>tive <strong>de</strong>s organes <strong>de</strong> coordination et d’arbitrage ainsi que <strong>de</strong>s cadres<br />
<strong>de</strong> concertation sur l’eau ;<br />
− le toilettage <strong>de</strong>s dispositions pénales pour un meilleur exercice par les agents <strong>de</strong> leurs<br />
pouvoirs <strong>de</strong> police judicaire en matière hydraulique.<br />
7.4 Le contrat <strong>de</strong> performances Etat-ONAS<br />
Après <strong>la</strong> validation <strong>de</strong>s différents sous-rapports juridique et financier, <strong>la</strong> finalisation du<br />
document portant contrat <strong>de</strong> performances a été effective <strong>de</strong>puis janvier 2008 sous <strong>la</strong><br />
conduite du Comité <strong>de</strong> Pilotage mis en p<strong>la</strong>ce à cet effet. Un partage du document avec les<br />
partenaires du secteur a été organisé dans le cadre d’une rencontre <strong>de</strong> concertation qui a<br />
permis d’intégrer l’essentiel <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>ments issus <strong>de</strong>s discussions dans <strong>la</strong> version finale du<br />
contrat éditée en mars 2008.<br />
La BEI a financé l’étu<strong>de</strong> tarifaire restreinte qui a permis <strong>de</strong> définir <strong>de</strong>s scénarii d’équilibre<br />
financier et <strong>de</strong> permettre ainsi <strong>la</strong> documentation <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> négociation avec l’Etat<br />
représenté par le Ministère <strong>de</strong> l’Economie et <strong>de</strong>s Finances pour <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s<br />
différentes modalités <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> l’équilibre financier <strong>de</strong> l’ONAS. Ces modalités portent sur<br />
<strong>la</strong> fixation du système <strong>de</strong> tarification, <strong>la</strong> mobilisation <strong>de</strong> subvention ou <strong>de</strong> financements<br />
permettant, à l’ONAS, <strong>de</strong> réaliser les investissements structurants et <strong>de</strong> faire face à <strong>la</strong> vétusté<br />
très avancée d’une partie du patrimoine par le renouvellement <strong>de</strong>s infrastructures d’une<br />
durée d’amortissement supérieure à quinze (15) ans.<br />
Le contrat <strong>de</strong> performances Etat-ONAS a été signé en juin 2008. Toutefois <strong>la</strong> question <strong>de</strong><br />
l’équilibre financier <strong>de</strong> l’ONAS continue <strong>de</strong> se poser encore dans <strong>la</strong> mesure où les<br />
engagements financiers <strong>de</strong> l’Etat ne sont toujours pas respectés. Par ailleurs ce contrat <strong>de</strong><br />
performances d’une durée <strong>de</strong> cinq (05) ans <strong>de</strong>vra expirer cette année. C’est dans ce cadre<br />
qu’un audit technique <strong>de</strong> ce contrat <strong>de</strong> performance a été conduit en avril <strong>2013</strong> sur un<br />
financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale dans le cadre du sous-programme PEPAM-IDA dans le<br />
but <strong>de</strong> passer en revue est L’évaluation <strong>de</strong> ce contrat <strong>de</strong> performances démarrée en 2012, est<br />
en phase <strong>de</strong> finalisation. Le rapport <strong>de</strong> cette mission fait ressortir globalement un non respect<br />
<strong>de</strong> plusieurs engagements par les <strong>de</strong>ux parties et suggère une amélioration <strong>de</strong> plusieurs<br />
dispositions re<strong>la</strong>tives au contrat, notamment les mécanismes et instruments <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong>s<br />
performances <strong>de</strong> l’ONAS, les dispositions pour le respect <strong>de</strong>s engagements <strong>de</strong> l’Etat et les<br />
mécanismes <strong>de</strong> suivi-contrôle du contrat <strong>de</strong> performances.<br />
7.5 Transfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> maintenance <strong>de</strong>s forages ruraux motorisés au secteur privé et<br />
création <strong>de</strong> l’OFOR<br />
Le Ministère <strong>de</strong> l’Hydraulique avait retenu le principe <strong>de</strong> sélectionner un unique opérateur<br />
privé par zone opérationnelle sur appel d’offres pour réaliser <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> maintenance
préventive et curative. Trois lots avaient été définis (zones centre, nord et sud) et un dossier<br />
d’appel d’offres avait été préparé pour <strong>la</strong> zone centre pour environ 600 forages, validé par <strong>la</strong><br />
DCMP. Par <strong>la</strong> suite, et pour <strong>de</strong>s raisons stratégiques, le Gouvernement du Sénégal n’a pas<br />
retenu cette option et en lieu et p<strong>la</strong>ce une nouvelle approche qui vise principalement <strong>de</strong>ux<br />
objectifs majeurs : 1) l’é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> l’offre en matière <strong>de</strong> services <strong>de</strong> maintenance dans<br />
une optique qui permette, en plus d’opérateurs privés <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> envergure, d’ouvrir le<br />
marché à <strong>de</strong> petits opérateurs locaux qui seront cependant préa<strong>la</strong>blement ; 2) <strong>la</strong> mise en<br />
p<strong>la</strong>ce d’une entité publique forte dénommée OFOR (Office <strong>de</strong> Gestion <strong>de</strong>s Forages Ruraux)<br />
mais avec une nature juridique appropriée qui lui permettra d’assurer une gestion autonome<br />
et efficace du service <strong>de</strong> l’eau potable en milieu rural.<br />
Suite à l’analyse <strong>de</strong> faisabilité re<strong>la</strong>tivement surtout à <strong>la</strong> question spécifique <strong>de</strong> <strong>la</strong> maintenance<br />
<strong>de</strong>s forages ruraux motorisés, le Gouvernement a décidé <strong>de</strong> maintenir l’option <strong>de</strong> délégation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> maintenance <strong>de</strong>s forages ruraux motorisés à travers le recrutement d’un seul opérateur<br />
privé pour chacune <strong>de</strong>s trois zones géographiques (Zone Centre, Zone Nord et Zone Sud) telle<br />
que préconisée dans les étu<strong>de</strong>s précé<strong>de</strong>ntes sur <strong>la</strong> maintenance. Les services compétents,<br />
notamment <strong>la</strong> DEM, seront ainsi chargés <strong>de</strong> diligenter le processus <strong>de</strong> réactualisation du<br />
dossier d’appel d’offres pour le recrutement <strong>de</strong> l’Opérateur Privé <strong>de</strong> Maintenance pour <strong>la</strong><br />
zone Centre aux fins <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à son <strong>la</strong>ncement avant <strong>la</strong> fin du mois <strong>de</strong> juin 2012.<br />
Cependant, les échanges entre <strong>la</strong> DEM, <strong>la</strong> DCMP et l’ARMP portant sur <strong>la</strong> validation du DAO,<br />
ont mis en évi<strong>de</strong>nces les limites <strong>de</strong>s dispositions actuelles en matière <strong>de</strong> passation <strong>de</strong> marchés<br />
<strong>de</strong> délégation <strong>de</strong> services qui excluent les prestations <strong>de</strong> maintenance du champ <strong>de</strong>s services<br />
finaux aux usagers. A cet effet, il a été décidé en novembre 2012, lors <strong>de</strong>s échanges tenus<br />
dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission <strong>de</strong> supervision du PEPAM IDA, d’intégrer <strong>la</strong> production parmi les<br />
services à déléguer aux opérateurs privés. Avec le soutien du PEA, un consultant a procédé à<br />
l’intégration <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong> production et à redéfinir les périmètres d’affermages constitués<br />
finalement <strong>de</strong> 5 lots correspondant aux régions <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone centre initialement définie.<br />
L’harmonisation avec les modèles <strong>de</strong> DAO <strong>de</strong> DSP disponibles, <strong>la</strong> finalisation et validation<br />
internes du DAO sont en cours. La transmission par <strong>la</strong> DEM à <strong>la</strong> DCMP est prévue en juin <strong>2013</strong>.<br />
Ainsi <strong>la</strong> maintenance <strong>de</strong>s ouvrages et <strong>la</strong> production seront confiées à <strong>de</strong>s opérateurs privés et<br />
l’actuel personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> DEM redéployé dans les nouvelles structures opérationnelles et/ou<br />
organisé en une nouvelle entité privée (avec une éventuelle mise disposition du matériel<br />
lourd <strong>de</strong> <strong>la</strong> DEM) qui pourrait s’occuper <strong>de</strong> <strong>la</strong> maintenance <strong>de</strong>s ouvrages hydrauliques d’une<br />
zone <strong>de</strong> maintenance. La réflexion sur le redéploiement du personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> DEM a été<br />
entamée notamment dans le cadre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> portant sur le transfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> maintenance en<br />
perspective <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l’OFOR dont le démarrage est intervenu en novembre 2012<br />
suivi d’un <strong>la</strong>ncement officiel en janvier <strong>2013</strong>.<br />
Le PEA-Afrique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Mondiale a accepté d’accompagner le Gouvernement dans <strong>la</strong><br />
mise en œuvre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l’OFOR, notamment (i) <strong>la</strong> définition<br />
du cadre organisationnel qui va intégrer le redéploiement du personnel exploitant <strong>de</strong> <strong>la</strong> DEM,<br />
(ii) l’é<strong>la</strong>boration du Manuel <strong>de</strong> Procédures Administratives et Financières <strong>de</strong> l’OFOR, (iii)<br />
l’inventaire <strong>de</strong>s immobilisations <strong>de</strong> l’OFOR, (iv) le système <strong>de</strong> suivi-évaluation et <strong>la</strong> définition<br />
du cadre <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion. Concomitamment, les textes portant sur <strong>la</strong> création, l’organisation et<br />
le fonctionnement <strong>de</strong> l’OFOR ont été finalisés et introduits dans le circuit d’approbation en<br />
vue <strong>de</strong> leur adoption pour permettre leur entrée en vigueur en <strong>2013</strong>.
7.6 Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie d’assainissement rural<br />
Depuis le <strong>la</strong>ncement du PEPAM en 2005, plusieurs initiatives ont été notées en termes d’une<br />
meilleure lecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie d’assainissement rural afin d’optimiser les réalisations mais<br />
aussi et surtout impliquer d’avantage les popu<strong>la</strong>tions dans une démarche d’érection <strong>de</strong> ce<br />
secteur au rang <strong>de</strong> priorité.<br />
Ainsi en termes d’options technologiques plusieurs initiatives ont été développées pour offrir<br />
<strong>de</strong>s paquets techniques diversifiés aux ménages en tenant compte <strong>de</strong> plusieurs facteurs dont<br />
le plus essentiel reste <strong>la</strong> prise en compte du pouvoir économique <strong>de</strong>s bénéficiaires. Mais pour<br />
donner une envergure plus officielle mais surtout mettre en p<strong>la</strong>ce un cadre normatif pour le<br />
sous-secteur une étu<strong>de</strong> est en cours sur financement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque Africaine <strong>de</strong><br />
Développement dont l’objet est <strong>la</strong> définition d’une stratégie efficace <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
composante assainissement rural du PEPAM autour <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle s’accor<strong>de</strong>ront les partenaires<br />
financiers et les autres acteurs du sous-secteur.<br />
Le bureau d’étu<strong>de</strong>s chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> a été sélectionné et les prestations<br />
ont démarré. Une première version du rapport provisoire est disponible et a été restituée.
REVUEANNUELLE<br />
SECTORIELLE<br />
CONJOINTE<br />
7.0<br />
Gestionintégrée<br />
<strong>de</strong>sressources<br />
eneau
7.1<br />
7. Gestion Intégrée <strong>de</strong>s Ressources en Eau<br />
7.1 P<strong>la</strong>n d’actions pour <strong>la</strong> Gestion Intégrée <strong>de</strong>s Ressources en Eau<br />
L’atteinte <strong>de</strong>s OMD dans le domaine l’approvisionnement en eau potable et <strong>de</strong> l’assainissement suppose<br />
tout d’abord une stratégie appropriée <strong>de</strong> gestion durable <strong>de</strong>s ressources en eau. C’est en ce<strong>la</strong> que se<br />
trouve <strong>la</strong> pertinence <strong>de</strong> <strong>la</strong> recommandation du Sommet <strong>de</strong> Johannesburg sur le développement durable<br />
re<strong>la</strong>tive à l’é<strong>la</strong>boration par tous les pays d’un P<strong>la</strong>n d’Action <strong>de</strong> Gestion Intégrée <strong>de</strong>s Ressources en Eau.<br />
En application <strong>de</strong> cette recommandation, le Sénégal a, <strong>de</strong><br />
2004 à 2007, initié un processus participatif d’é<strong>la</strong>boration<br />
d’un P<strong>la</strong>n d’Action <strong>de</strong> Gestion Intégrée <strong>de</strong>s Ressources en<br />
Eau articulé autour <strong>de</strong>s trois grands axes stratégiques que<br />
sont : (i) l’amélioration <strong>de</strong>s connaissances et <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong><br />
gestions <strong>de</strong>s ressources en eau, (ii) <strong>la</strong> création d’un<br />
environnement favorable à l’application <strong>de</strong> l’approche GIRE<br />
par <strong>de</strong>s réformes légales, organisationnelles et politiques,<br />
(iii) l’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication l’information,<br />
l’éducation et <strong>la</strong> sensibilisation sur l’eau.<br />
En vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en œuvre du PAGIRE, un Programme d’Actions Prioritaire (PAP) 2008-2015 a été défini<br />
pour un montant estimé à environ 19,02 millions d’euros. Le PAP comprend les projets suivants :<br />
– Projet <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s ressources en eau ;<br />
– Projet <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’outils <strong>de</strong> gestion et d’information ;<br />
– Projet <strong>de</strong> réforme institutionnelle, organisationnelle et juridique <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s ressources en eau ;<br />
– Projet <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un système <strong>de</strong> suivi-évaluation et gestion du PAGIRE ;<br />
– Projet d’éducation, <strong>de</strong> communication et <strong>de</strong> sensibilisation sur l’eau.<br />
7.2 Etat d’exécution du Programme d’Actions Prioritaires<br />
L’état d’exécution du PAP est caractérisé par <strong>la</strong> mobilisation d’un financement global <strong>de</strong> 3.503.299.003<br />
FCFA soit environ 5,34 millions d’euros à travers :<br />
(i) le projet <strong>de</strong> mise en œuvre du PAGIRE financé par <strong>la</strong> Facilité Africaine <strong>de</strong> l’Eau (FAE) pour un montant<br />
<strong>de</strong> 1,58 million d’euros ;<br />
(ii) le projet PAGIRE-BA d’un montant <strong>de</strong> 2 millions d’euros sur financement du Royaume <strong>de</strong> Belgique ;<br />
(iii) les volets « Gestion <strong>de</strong>s ressources en eau » <strong>de</strong>s différents sous-programmes du PEPAM (Projets<br />
PEPAM-SEN026, PEPAM-BAD2, PEPAM-BA, PEPAM-IDA) pour un montant cumulé <strong>de</strong> 1,6 millions<br />
d’euros.<br />
7.3 Besoins en financement<br />
Le faible niveau <strong>de</strong> mise en œuvre du PAP est imputable à <strong>la</strong> modicité <strong>de</strong>s financements obtenus. Pour le<br />
respect <strong>de</strong>s échéances <strong>de</strong> 2015, le gap <strong>de</strong> financement à combler se chiffre à <strong>de</strong> 13,68 millions d’euros<br />
soit 8,97 milliards FCFA. Les différents projets dont le financement est recherché sont présentés ci<strong>de</strong>ssous.<br />
Intitulés Projets<br />
Montants FCFA<br />
Projet <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> l’eau 1 574 189 805<br />
Projet <strong>de</strong> Mise en p<strong>la</strong>ce d’outils <strong>de</strong> gestion et d’Information sur l’eau 4 285 612 439<br />
Projet <strong>de</strong> réformes institutionnelles et juridiques 994 779 542<br />
Projet <strong>de</strong> Programme d’éducation, <strong>de</strong> communication et <strong>de</strong> sensibilisation sur l’eau 919 532 126<br />
Projet <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un système <strong>de</strong> suivi-évaluation et gestion du PAGIRE 1 204 587 085<br />
TOTAL 8 978 700 997
7.2<br />
7.4 Office du Lac <strong>de</strong> Guiers<br />
La ville <strong>de</strong> Dakar est alimenté eau pour prés 40% via le <strong>la</strong>c <strong>de</strong> Guiers dépendant du fleuve Sénégal ; ce qui<br />
démontre le caractère stratégique <strong>de</strong> cette énorme réservoir d’eau douce qu’il convient <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r au vue<br />
du rôle qu’il joue dans l’approvisionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mégalopole que constitue <strong>la</strong> capitale sans compter le service<br />
en route qui permet d’assurer <strong>la</strong> <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> localités importantes dans les régions <strong>de</strong> Louga et <strong>de</strong> Thiès. C’est<br />
ainsi que l’un <strong>de</strong>s résultats importants du Projet Sectoriel Eau Long Terme aura été <strong>de</strong> consacrer <strong>la</strong> création <strong>de</strong><br />
l’Office du Lac <strong>de</strong> Guiers (OLAG).<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> son Programme d’Investissement à Moyen Terme, <strong>de</strong>s projets<br />
structurants ont été i<strong>de</strong>ntifiés et qui vont permettre <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s activités<br />
efficaces pour : (i) améliorer <strong>la</strong> connaissance et assurer un suivi quantitatif et<br />
qualitatif <strong>de</strong>s usages, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et <strong>de</strong> <strong>la</strong> disponibilité en eau du <strong>la</strong>c, (ii)<br />
réaliser <strong>de</strong>s infrastructures visant à améliorer <strong>la</strong> gestion et <strong>la</strong> valorisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ressource.<br />
Au titre du PAGIRE, les financements mobilisés ont permis <strong>de</strong> mener plusieurs actions <strong>de</strong> renforcement du<br />
cadre <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s ressources en eau :<br />
• La révision du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’eau et <strong>la</strong> mise à jour <strong>de</strong>s textes d’application qui est dans le processus<br />
d’exame et <strong>de</strong> validation et <strong>la</strong> révision du cadre organisationnel <strong>de</strong>s ressources en eau avec une<br />
proposition <strong>de</strong> réorganisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> DGPRE et une proposition <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong><br />
gestion<br />
• La redynamisation du système <strong>de</strong> palnification <strong>de</strong>s ressources en eau à travers <strong>la</strong> définition<br />
d’Unités <strong>de</strong> Gestion et <strong>de</strong> P<strong>la</strong>nification (UGP) <strong>de</strong>s ressources en eau (outils et d’espaces <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong>s ressources en eau) et l’é<strong>la</strong>boration d’un p<strong>la</strong>n stratégique <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong>s<br />
ressources en eau et le programme d’investissement (l’horizon 2025)<br />
• Le renforcement du réseau <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s piézomètriques (environ 21 nouveau pièzomètres et<br />
l’équipement <strong>de</strong> 27 piézomètre en enregistreurs <strong>de</strong> niveau dans les différents sous programmes<br />
PEPAM)<br />
• Le suivi qualitatif et qualitatif du réseau dans les zones d’intervention <strong>de</strong>s sous programmes<br />
• Le renforcement <strong>de</strong>s moyens techniques (moyens logistiques, matériels technique et<br />
informatique) dans le cadre <strong>de</strong>s sous programmes PEPAM et du PADEN<br />
• L’amélioration <strong>de</strong>s connaissances <strong>de</strong>s ressources en eau dans le bassin arachidier à travers les<br />
étu<strong>de</strong>s(hydrologique, hydrogéolique et système d’information) du PAGIRE BA dont les étu<strong>de</strong>s<br />
sont toujors en cours<br />
• Le renforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong>s agents du secteur <strong>de</strong> l’hydraulique en collecte et traitement<br />
<strong>de</strong>s données dans le cadre du PADEN pour l’année 2012<br />
Afin <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r les actions réalisées et <strong>de</strong> résorber le gap <strong>de</strong> financement qui se chiffre à <strong>de</strong> 13,68<br />
millions d’euros soit 8.97 milliards FCFA du PAP/PAGIRE d’ici 2015, une table ron<strong>de</strong> <strong>de</strong>s bailleurs a été<br />
organisée en décembre 2012.<br />
Un document <strong>de</strong> programme conjoint intégrant les besoins en financement du programme d’urgence<br />
<strong>de</strong>s inondations, du PEPAM, du PDAZ et du PAGIRE a été présenté. Suite à cette table ron<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
bailleurs, le besoin <strong>de</strong> financement restait toujours une question à résoudre. La majorité <strong>de</strong>s bailleurs<br />
avait axé leurs annonces sur le programme d’urgence <strong>de</strong>s inondations. A cet effet, le financement du<br />
PAGIRE est à renforcer pour une gestion durable <strong>de</strong>s ressources en eau.<br />
Toutefois, les nouvelles interventions en phase <strong>de</strong> démarrage, notamment le SEN030, le PEPAM-UE, le<br />
PSEA financé par <strong>la</strong> BAD et le PASEPAR intègrent <strong>de</strong>s volets ou composantes spécifiques consacrés à <strong>la</strong><br />
promotion <strong>de</strong> <strong>la</strong> GIRE à une gran<strong>de</strong> échelle. Sans compter <strong>la</strong> phase 2 du PAGIRE-FAE actuellement en<br />
cours d’instruction au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAE pour un montant d’environ 2 millions d’euros.
Programmed’EauPotable<br />
etd’AssainissementduMilénaire