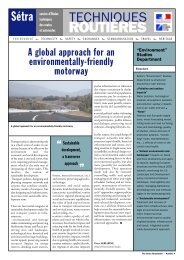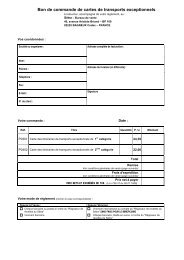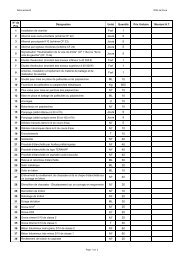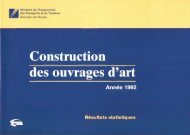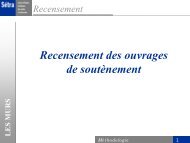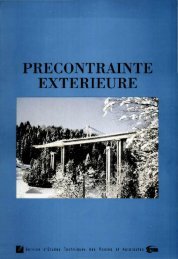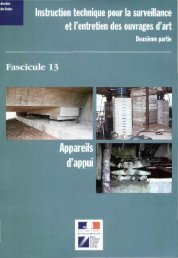Entretien préventif du réseau routier national GUIDE ... - DTRF
Entretien préventif du réseau routier national GUIDE ... - DTRF
Entretien préventif du réseau routier national GUIDE ... - DTRF
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MINISTERE DES TRANSPORTS<br />
DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS INTERIEURS<br />
<strong>Entretien</strong> préventif<br />
<strong>du</strong> réseau <strong>routier</strong> <strong>national</strong><br />
<strong>GUIDE</strong> TECHNIQUE<br />
DIRECTION DES ROUTES ET<br />
DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Page laissée blanche intentionnellement
MINISTERE DES TRANSPORTS<br />
DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS INTÉRIEURS<br />
Direction des Routes et de la Circulation Routière - 244, Bd Saint-Germain - 75775 PARIS CEDEX 16<br />
Sous-Direction de l'<strong>Entretien</strong>, de la Réglementation de la Voirie et <strong>du</strong> Contentieux (R/EG 2)<br />
<strong>Entretien</strong> préventif<br />
<strong>du</strong> réseau <strong>routier</strong> <strong>national</strong><br />
Document réalisé et diffusé par :<br />
Avril 1979<br />
le Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes<br />
46 avenue Aristide Briand - 92223 BAGNEUX<br />
le Laboratoire<br />
lMnfl<br />
Central des Ponts et Chaussées I | lil<br />
US. IIIH 58 bd Lefebvre 75732 PARIS CEDEX 15 LLlVi
MINISTERE DES TRANSPORTS<br />
DIRECTION GÉNÉRALE<br />
DES TRANSPORTS INTERIEURS<br />
DIRECTION DES ROUTES<br />
ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE<br />
SERVICE D'ETUDES TECHNIQUES<br />
DES ROUTES ET AUTOROUTES<br />
S.E.T.R.A.<br />
46, Avenue Arlstide-Briand • B.P. 100<br />
92223 BAGNEUX • Tél. : 664-14-77<br />
TELEX 260763 • SETRA BAGNX<br />
BAGNEUX, LE 19 AVRIL 1979<br />
J. BERTHIER<br />
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées<br />
DIRECTEUR<br />
Le Directeur <strong>du</strong> Service d'Etudes<br />
Techniques des Routes et Autoroutes<br />
Messieurs les Directeurs Départementaux<br />
de l'Equipement<br />
OBJET : ENTRETIEN PRÉVENTIF DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL<br />
Une politique de renforcement <strong>du</strong> réseau <strong>routier</strong> <strong>national</strong> a été entreprise en 1969 dont la suite logique a été<br />
la mise en place, à partir de 1972, d'une politique rationnelle d'entretien fondée sur des interventions à<br />
caractère essentiellement préventif.<br />
Le Guide technique 1979 pour l'entretien préventif <strong>du</strong> réseau <strong>routier</strong> <strong>national</strong> qui vous est proposé ci-après<br />
précise les éléments techniques à prendre en compte pour cette action, précise la marche à suivre pour apprécier<br />
l'urgence des travaux à effectuer et propose des solutions d'entretien dans les cas courants.<br />
Le Répertoire des dégradations SETRA-LCPC (avril 1979) associé à ce document doit, pour sa part, permettre<br />
une identification des désordres selon une terminologie commune à tous les services.<br />
La méthode proposée dans le document est fondée sur le principe d'interventions à caractère préventif ;<br />
cependant, pour pouvoir appliquer valablement ce principe, c'est-à-dire intervenir avant que n 'apparaissent<br />
les premières dégradations, il serait nécessaire, à partir des résultats des mesures d'auscultation à grand rendement,<br />
d'appréhender de façon précise l'évolution ultérieure de la chaussée en tenant compte des nombreux<br />
autres paramètres en cause (trafic, climat, etc.).<br />
En l'état actuel des moyens et des connaissances, cette évaluation est encore hors de portée. La méthode proposée<br />
consiste donc à programmer au mieux les interventions dès l'apparition des premières dégradations ou<br />
des premières évolutions significatives. Elle devrait ainsi, tout en assurant en permanence un niveau de service<br />
satisfaisant à l'usager, permettre d'éviter des opérations plus lourdes, <strong>du</strong> type renforcement par exemple.<br />
A l'occasion de cet envoi, je crois devoir attirer votre attention sur les points essentiels suivants :<br />
— ce Guide a été plus particulièrement conçu pour les sections en rase campagne ; les traverses d'agglomération<br />
font intervenir de nombreux autres facteurs et nécessitent une réflexion spécifique ;<br />
— // ne traite pas des chaussées en béton hydraulique. Leur auscultation fait en effet appel à une méthodologie<br />
bien spécifique et les solutions d'entretien, à l'exception des en<strong>du</strong>its superficiels, sont différentes de<br />
celles utilisées sur les autres types de chaussées ;
— les seuils d'entretien qui sont proposés dans le Guide sont provisoires et pourront être ultérieurement modifiés<br />
au fur et à mesure de l'expérience acquise ;<br />
— la connaissance de l'état initial de la structure immédiatement après construction (cas de chaussées neuves)<br />
ou renforcement est un facteur essentiel pour expliquer les observations ultérieures faites sur l'évolution<br />
de la chaussée.<br />
Il convient donc d'apporter toute l'attention nécessaire à l'établissement <strong>du</strong> dossier « point zéro ».<br />
— le classement des travaux souhaitables par ordre de priorité est défini dans le Guide en fonction de critères<br />
purement techniques. D'autres éléments doivent souvent être pris en considération ;<br />
— le cadre et les modalités de présentation des travaux ainsi définis sont chaque année précisés par les instructions<br />
<strong>du</strong> Directeur des Routes et de la Circulation Routière relatives aux propositions budgétaires ;<br />
— le Guide rappelle, dans quelques cas particuliers, l'opportunité de procéder à un balisage ou d'implanter<br />
éventuellement une signalisation de danger. La remarque a bien sûr une portée générale et il convient naturellement<br />
de mettre en place, dès que possible, une signalisation spécifique adaptée aux défectuosités constatées<br />
susceptibles de mettre en cause la sécurité des usagers (cf. Instruction interministérielle sur la signalisation<br />
routière <strong>du</strong> 7 juin 1977 - livre I - deuxième partie).<br />
Il faut enfin souligner que ce Guide constitue, au niveau mondial, une des premières tentatives de rationalisation<br />
de la stratégie de l'entretien des chaussées. Il est donc essentiel pour évaluer la valeur des principes proposés<br />
et pour progresser dans la mise au point de leur application, que nous ayons le concours actif de tous les<br />
services et à tous les niveaux. Nous les en remercions par avance.<br />
L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées<br />
Directeur <strong>du</strong> S.E.T.R.A.<br />
J. BERTHIER
PLAN DU DOCUMENT<br />
PREMIERE PARTIE<br />
ENTRETIEN DES CHAUSSEES<br />
1. Généralités 5<br />
1.1. Notion « d'indicateur d'état » 5<br />
1.2. Objectifs de l'entretien 6<br />
DEUXIÈME PARTIE<br />
ENTRETIEN DES DÉPENDANCES<br />
ET ÉQUIPEMENTS DIVERS<br />
1. <strong>Entretien</strong> des dépendances 21<br />
2. <strong>Entretien</strong> des plantations 25<br />
3. <strong>Entretien</strong> des équipements de la route ... 25<br />
4. <strong>Entretien</strong> des installations annexes 26<br />
2. Démarche de l'étude 6<br />
2.1. Etablissement <strong>du</strong> diagnostic 6<br />
2.2. Elaboration <strong>du</strong> programme opérationnel<br />
de travaux - Classement des opérations<br />
par ordre de priorité - Prévisions<br />
de travaux<br />
2.3. Notion de défaut localisé - défaut<br />
éten<strong>du</strong> 9<br />
3. Régies d'entretien des chaussées 11<br />
3.1. Présentation générale des tableaux . 11<br />
3.2. Tableaux concernant la conservation<br />
et l'adaptation de la structure .. 11<br />
3.3. Tableaux concernant la sécurité et le<br />
confort 12<br />
3.4. Tableaux concernant l'intégrité de la<br />
couche de surface 12<br />
3.5. Critères de choix entre en<strong>du</strong>its superficiels<br />
et enrobés classiques ou en<br />
couche mince<br />
g<br />
1 g<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
RECUEIL DES DONNÉES<br />
1. Surveillance systématique à l'aide d'appareils<br />
de mesure à grand rendement 27<br />
1.1. Dispositions générales 27<br />
1.2. Cas particulier <strong>du</strong> GERPHO 28<br />
2. Inspections visuelles détaillées 28<br />
2.1. Procé<strong>du</strong>res de réalisation des inspections<br />
détaillées 29<br />
2.2. Etablissement <strong>du</strong> compte ren<strong>du</strong> .... 30<br />
ANNEXE<br />
FICHES DE RENSEIGNEMENTS<br />
SUR LES APPAREILS DE MESURE<br />
A GRAND RENDEMENT<br />
1. Déflectographe .. 33<br />
2. Analyseur de profil en long 36<br />
3. Appareil SCRIM 38<br />
4. Appareil GERPHO 40
PREMIERE PARTIE<br />
ENTRETIEN DES CHAUSSEES<br />
1. GÉNÉRALITÉS<br />
1.1. NOTION « d'indicateur d'état »<br />
Les travaux d'entretien ne doivent être décidés qu'à partir des besoins réels découlant de l'état de la chaussée.<br />
Cet état est apprécié à l'aide d'un certain nombre de paramètres représentatifs, appelés « indicateurs<br />
d'état ».<br />
Les indicateurs d'état dont on dispose actuellement sont :<br />
— la déflexion<br />
— l'uni<br />
— l'adhérence<br />
— les dégradations.<br />
Pour les trois premiers, les valeurs sont fournies par les appareils de mesure à grand rendement.<br />
Les dégradations sont relevées soit par le GERPHO, soit plus généralement de façon manuelle au cours d'inspections<br />
détaillées (cf. troisième partie concernant le recueil des données). Elles doivent être classées, quantifiées<br />
et interprétées (nombre, longueur, surface).<br />
La comparaison des indicateurs d'état aux valeurs de référence données dans le présent document permet de<br />
cerner les « zones à problèmes » et pour celles-ci, d'apprécier le niveau des défauts ou dégradations.<br />
Des informations complémentaires sont nécessaires pour compléter et interpréter les données fournies par<br />
les indicateurs d'état ; elles concernent notamment :<br />
— les caractéristiques géométriques de la route (tracé, profil)<br />
— le trafic, les accidents<br />
— les structures des chaussées<br />
— l'historique des travaux<br />
— l'environnement.<br />
La plupart de ces renseignements seront fournis par la Banque de Données Routières sous forme d'un schéma<br />
itinéraire entretien ; mais d'autres documents devront également être consultés (listings détaillés des mesures,<br />
comptes ren<strong>du</strong>s de synthèse des contrôles de chantier, par exemple).
1.2. OBJECTIFS DE L'ENTRETIEN<br />
Les trois objectifs principaux de l'entretien préventif sont :<br />
— la conservation en bon état de la structure de chaussée et son adaptation à l'évolution <strong>du</strong> trafic (portance<br />
des assises),<br />
— le maintien de conditions de sécurité et de confort satisfaisantes,<br />
— la conservation de l'intégrité de la couche de surface (qualité de la couche de surface et rôle de protection<br />
des couches inférieures).<br />
Chacun des indicateurs d'état précédemment définis est relié à l'un de ces objectifs (considéré comme étant le<br />
principal mis en cause), de la manière indiquée par le tableau I ci-après. Une exception a cependant été faite<br />
pour l'uni ; la note d'uni constituant à elle seule un indicateur de confort et une diminution de la note entre<br />
deux passages successifs de l'analyseur de profil en long (A.P.L.) pouvant tra<strong>du</strong>ire une évolution de la structure.<br />
Dans la réalité, il est bien évident que la plupart des dégradations de la chaussée peuvent avoir une incidence<br />
à la fois sur la conservation de la structure, la sécurité et le confort des usagers ou l'intégrité de la couche de<br />
surface. De même, un défaut ne mettant en cause que le revêtement de surface peut, si on n'y remédie pas<br />
assez rapidement, entraîner une dégradation des couches inférieures.<br />
Cette distinction entre les différents objectifs de l'entretien est donc purement conventionnelle, mais elle permet<br />
une approche plus simple et plus rationnelle des problèmes, chaque défaut n'étant examiné qu'au titre<br />
d'un seul de ces objectifs et ne donnant lieu par conséquent qu'à une seule application de la démarche<br />
d'étude.<br />
Bien enten<strong>du</strong>, si une section de route présente différents défauts mettant en cause deux ou trois des objectifs<br />
de l'entretien, l'étude devra être menée pour chacun de ces objectifs et une synthèse des différentes solutions<br />
reconnues possibles à l'issue de ces études sera nécessaire pour déterminer le programme final de travaux.<br />
2. DÉMARCHE DE L'ÉTUDE<br />
La démarche proposée doit permettre, à partir des indicateurs d'état relevés sur la chaussée, de déterminer<br />
les travaux d'entretien souhaitables.<br />
L'étude sera en général faite par les responsables de l'entretien <strong>du</strong> réseau, dans le courant de l'été ou au début<br />
de l'automne, à partir des données recueillies antérieurement (mesures par les appareils à grand rendement,<br />
inspections visuelles).<br />
Elle aboutira à la définition :<br />
— d'un programme opérationnel de travaux à réaliser l'année suivante,<br />
— de prévisions de travaux pour les années ultérieures (regroupant les sections sur lesquelles l'analyse<br />
aura conclu à la nécessité d'une étude ou d'une surveillance particulière).<br />
Deux phases ont été distinguées dans la démarche :<br />
— Phase 1 : établissement <strong>du</strong> diagnostic<br />
— Phase 2 : définition <strong>du</strong> programme de travaux.<br />
2.1. ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC<br />
Le document de base nécessaire à l'établissement <strong>du</strong> diagnostic est le schéma itinéraire qui constituera une sortie<br />
systématique de la Banque de Données Routières (B.D.R.).<br />
Il contient, en plus <strong>du</strong> schéma général de la route et les données relatives à la structure, les valeurs de la<br />
déflexion, de l'adhérence (coefficient de frottement transversal mesuré au SCRIM) et de l'uni ; les dégradations<br />
pourront être reportées manuellement par l'utilisateur à partir des feuilles de compte ren<strong>du</strong> des inspections<br />
visuelles (cf. troisième partie concernant le recueil des données).<br />
La constitution de la Banque de Données Routières s'effectuant progressivement, ce document ne sera pas<br />
disponible immédiatement pour tous les itinéraires. En phase transitoire d'autres documents devront donc<br />
être utilisés (schéma-itinéraire établi manuellement, listings de sortie des appareils de mesures, etc.).<br />
Pour faciliter l'analyse, on peut distinguer les deux étapes suivantes qui, dans la pratique, ne seront pas<br />
nécessairement nettement séparées.
TABLEAU I<br />
Relations entre indicateurs d'état et objectifs de l'entretien.<br />
OBJECTIF ±<br />
INDICATEUR D'ETAT -^M. \.<br />
Conservation et adaptation de la structure<br />
Chaussée souple<br />
à assise<br />
non traitée<br />
Chaussée à<br />
couche de base<br />
traitée aux liants<br />
hydrocarbonés<br />
Chaussée à<br />
couche de base<br />
traitée aux liants<br />
hydrauliques<br />
Sécurité<br />
confort<br />
Intégrité<br />
de la couche<br />
de surface<br />
DEFLEXION<br />
•<br />
•<br />
•<br />
UNI<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ADHÉRENCE<br />
•<br />
Défauts de rive<br />
affaissements bourrelets<br />
•<br />
| DÉGRADATIONS ! REMONTÉES<br />
ARRACHEMENTS<br />
FISSURES<br />
DÉFORMATIONS<br />
Flaches<br />
Orniérage<br />
à grand rayon<br />
Orniérage<br />
à petit rayon<br />
Faïençage<br />
Fissures longitudinales<br />
dans les traces<br />
de roues<br />
Fissure longitudinale<br />
d'épaulement<br />
Raccordement défectueux<br />
de deux bandes<br />
d'enrobés<br />
Fissures transversales<br />
de retrait<br />
(suivant état) (1)<br />
Nids de poule<br />
(en formation<br />
ou rebouchés)<br />
Désenrobage<br />
Pelade<br />
Plumage<br />
Glaçage<br />
Ressuage<br />
Remontées de fines<br />
(laitance)<br />
Remontées d'eau<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
(1) Les fissures transversales de retrait seront rattachées soit à l'objectif « structure » soit à l'objectif « intégrité de la<br />
couche de surface » suivant leur état de dégradation :<br />
— Objectif « structure » : fissures transversales très dégradées : plus de 20 Vo <strong>du</strong> nombre total des fissures sont soit<br />
ramifiées, soit épaufrées avec des risques importants de départ de matériaux.<br />
— Objectif « Intégrité de la couche de surface » dans les autres cas.
2.1.1. Diagnostic sommaire<br />
L'analyse est faite à partir <strong>du</strong> schéma itinéraire défini ci-dessus. Elle consiste à effectuer un découpage de<br />
l'itinéraire en sections homogènes, déterminées à partir de la relative constance d'un certain nombre de données<br />
:<br />
— trafic (en nombre de poids lourds défini au sens <strong>du</strong> Catalogue 1977 des structures types de chaussées neuves),<br />
— structure de chaussée à la construction ou au renforcement (nature et épaisseur des couches, date de réalisation).<br />
Dans toute la mesure <strong>du</strong> possible, on tiendra compte <strong>du</strong> support, surtout pour les chaussées<br />
souples à base de matériaux non traités,<br />
— travaux d'entretien déjà réalisés depuis la construction ou le' renforcement (nature et épaisseur des couches,<br />
date de réalisation),<br />
— conditions de site (agglomération ou rase campagne, par exemple),<br />
— zone où il existe un risque particulier connu (incident de chantier, drainage défectueux, etc.).<br />
Il est ensuite possible :<br />
— d'éliminer les sections qui peuvent être considérées comme bonnes, c'est-à-dire celles où les valeurs des<br />
différents indicateurs d'état n'atteignent pas les seuils définis dans les tableaux <strong>du</strong> chapitre 3,<br />
— de déterminer pour chacune des sections retenues le ou les objectifs de l'entretien en cause. Ce ou ces<br />
objectifs peuvent être déterminés à partir de l'indicateur d'état, comme indiqué au tableau I.<br />
Si une section peut être considérée comme bonne à l'exception d'une zone très localisée, elle pourra être éliminée<br />
de la suite de l'étude, le point singulier étant cependant examiné à part avant d'arrêter le programme<br />
de travaux (cf. § 2.3).<br />
Les sections retenues à l'issue de cette première approche doivent faire l'objet d'une analyse plus fine : le<br />
diagnostic approfondi.<br />
2.1.2. Diagnostic approfondi<br />
II consiste à déterminer pour les sections retenues, les causes précises et le niveau des défauts constatés.<br />
A ce stade de l'étude, il sera nécessaire de consulter, outre le schéma itinéraire cité précédemment :<br />
— les résultats détaillés des mesures effectuées par les appareils à grand rendement,<br />
— les comptes ren<strong>du</strong>s de chantiers relatifs aux travaux antérieurs,<br />
— l'état <strong>du</strong> drainage,<br />
— éventuellement, d'autres informations (mesures complémentaires, études particulières, etc.).<br />
Le responsable de l'étude s'appuiera également sur l'expérience acquise et sur sa propre connaissance de la<br />
route (des visites sur place paraissent cependant indispensables lorsque la chaussée présente des dégradations<br />
apparentes).<br />
A partir de l'ensemble de ces éléments, il sera généralement con<strong>du</strong>it à effectuer un découpage plus fin des<br />
sections définies lors <strong>du</strong> diagnostic sommaire et définira ainsi des sous-sections homogènes qui correspondront<br />
à des niveaux identiques des indicateurs d'état.<br />
Toutefois, afin d'être significatives pour l'application des règles d'entretien et l'attribution des notes de<br />
priorité, ces sous-sections ne devront pas avoir une longueur inférieure à 200 m.<br />
2.2. ELABORATION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL DE TRAVAUX — CLASSEMENT DES<br />
OPÉRATIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉ — PRÉVISIONS DE TRAVAUX<br />
Le diagnostic approfondi ayant permis de déterminer des sous-sections bien délimitées nécessitant des interventions,<br />
il convient de définir le programme de travaux de l'année suivante, appelé « programme opérationnel<br />
», en classant les opérations par priorités.<br />
Au cours de cette étude seront également abordées les prévisions de travaux pour les années ultérieures.<br />
2.2.1. Définition <strong>du</strong> programme opérationnel et des prévisions de travaux<br />
Pour chaque sous-section précédemment définie, on recherchera, pour chacun des objectifs de l'entretien en<br />
cause, les solutions possibles en utilisant les règles <strong>du</strong> chapitre 3.
L'élaboration <strong>du</strong> programme opérationnel consistera ensuite à :<br />
— choisir entre les différentes solutions possibles. Le paragraphe 3.5 ci-après donne quelques indications<br />
qui pourront utilement guider ce choix,<br />
— définir la longueur des sections traitées. A cet égard, on recherchera si les défauts constatés sur une soussection<br />
sont susceptibles de s'étendre à brève échéance aux sous-sections voisines de mêmes caractéristiques<br />
au point de vue structure et trafic. Si tel est le cas, il sera nécessaire de réfléchir à l'opportunité<br />
d'une extension des travaux à l'ensemble des sous-sections considérées.<br />
En tout état de cause, il convient de rechercher des chantiers de longueur suffisante de manière à obtenir une<br />
bonne homogénéité de l'itinéraire, une qualité des travaux et des conditions économiques satisfaisantes. De<br />
façon plus générale, il convient également de prendre en compte les conditions d'exploitation sous circulation.<br />
Les règles d'entretien recommandent, dans certains cas, une surveillance de la section ; aucune intervention<br />
sur chaussée n'est alors à prévoir au titre <strong>du</strong> programme opérationnel. Cependant, des travaux seront généralement<br />
nécessaires à court terme et il conviendra de les inclure dans les prévisions de travaux des années ultérieures.<br />
2.2.2. Classement par priorités des opérations <strong>du</strong> programme opérationnel<br />
Les tableaux des règles d'entretien donnent une note de priorité pour les travaux possibles sur chaque soussection,<br />
de sorte que pour un tronçon déterminé regroupant plusieurs sous-sections, on peut se trouver en<br />
présence de plusieurs notes de priorité.<br />
It est donc nécessaire de déterminer la note de priorité à prévoir au programme opérationnel.<br />
On procédera pour cela comme suit :<br />
- la longueur <strong>du</strong> chantier correspond à une sous-section et un seul objectif de l'entretien est en cause : la<br />
note de priorité à attribuer aux travaux dans le programme opérationnel est celle donnée par le tableau<br />
des règles d'entretien,<br />
- la longueur <strong>du</strong> chantier correspond à plusieurs sous-sections et un seul objectif de l'entretien est en<br />
cause : la note de priorité à retenir est la plus faible (travaux prioritaires) parmi celles données pour les<br />
différentes sous-sections,<br />
- la longueur <strong>du</strong> chantier correspond à une ou plusieurs sous-sections et plusieurs objectifs de l'entretien<br />
sont en cause. On procédera comme précédemment, par objectif, et la note comportera un chiffre par<br />
objectif concerné.<br />
La note de priorité finale comportera donc de 1 à 3 chiffres.<br />
Les opérations prioritaires seront déterminées en considérant d'abord le chiffre le plus faible (travaux prioritaires),<br />
puis en prenant en compte de la même manière, les deuxième et troisième chiffres éventuels.<br />
Le cadre et les modalités de présentation des travaux ainsi définis seront précisés chaque année par les instructions<br />
relatives aux propositions budgétaires.<br />
2.3. NOTION DE DÉFAUT LOCALISÉ - DÉFAUT ÉTENDU<br />
11 n'a pas été tenu compte au cours de l'étude précédente des quelques défauts localisés qui ont pu apparaître<br />
sur de courtes sections, tels que pics de déflexion, adhérence localement faible, etc.<br />
De façon générale, on distinguera les points singuliers qui concernent la sécurité de ceux relatifs à la structure.<br />
Dans le premier cas, les travaux seront programmés en priorité 1 ; dans le second, l'option à retenir s'appuiera<br />
sur une réflexion complémentaire : il conviendra en particulier de rechercher si les anomalies rencontrées<br />
s'expliquent par des conditions locales particulières (passage d'un ouvrage d'assainissement, zone de<br />
raccordement où l'épaisseur de la structure est insuffisante, drainage défectueux, incident de chantier, etc.),<br />
ou si elles sont susceptibles de se généraliser.<br />
S"il s'agit d'un défaut réellement localisé, il y aura lieu de procéder dès que possible à l'exécution des réparations<br />
(remplacement de la couche de roulement, remise en état éventuelle des ouvrages d'assainissement,<br />
reconstruction après purge, etc.).<br />
S'il s'agit d'un défaut susceptible de se généraliser, il conviendra d'appliquer les règles d'entretien à la section<br />
homogène correspondante et de programmer les travaux nécessaires.<br />
Le tableau II ci-après résume les différentes phases de l'étude.
TABLEAU II -<br />
DEMARCHE DE L'ETUDE<br />
DONNEES<br />
ÉTUDES<br />
RÉSULTATS<br />
y<br />
O<br />
/<br />
O<br />
Schéma itinéraire<br />
entretien<br />
(B.D.R. si disponible)<br />
et<br />
comptes ren<strong>du</strong>s des<br />
inspections visuelles<br />
Découpage en sections<br />
de caractéristiques<br />
homogènes<br />
Identification des<br />
sections à problèmes<br />
Diagnostic sommaire<br />
Sections « bonnes »<br />
Sections<br />
« à problèmes »<br />
Q<br />
H<br />
tu<br />
•J:<br />
<<br />
Résultats détaillés des<br />
mesures<br />
Comptes ren<strong>du</strong>s de<br />
chantiers<br />
Connaissance de la<br />
route<br />
Analyse de chaque<br />
section retenue, indicateur<br />
par indicateur<br />
Détermination de soussections<br />
homogènes<br />
Recherche des causes<br />
Diagnostic approfondi<br />
Sous-sections homogènes<br />
où des travaux (ou<br />
études) sont à envisager<br />
\<br />
X<br />
D<br />
£<br />
oi<br />
h- 1<br />
tu<br />
Q<br />
tu<br />
tAMM<br />
a<br />
ooi<br />
Règles d'entretien <strong>du</strong><br />
Guide technique<br />
Techniquesdisponibles<br />
Données locales<br />
Application des règles à<br />
chaque sous-section par<br />
objectif de l'entretien et<br />
synthèse<br />
(Prise en compte des<br />
problèmes de qualité,<br />
de coût, d'exploitation,<br />
des contraintes particulières...)<br />
Sections de travaux<br />
Sections de travaux <strong>du</strong><br />
programme opérationnel<br />
Prévisions de travaux<br />
pour les années ultérieures<br />
D<br />
û<br />
Z<br />
O<br />
z<br />
Propositions pour programme<br />
opérationnel<br />
ztu<br />
Q<br />
fN<br />
tu<br />
C/5<br />
Notes de priorité<br />
<strong>du</strong> Guide technique<br />
Application <strong>du</strong> système<br />
de priorités à chaque<br />
section de travaux <strong>du</strong><br />
programme opérationnel<br />
Travaux affectés d'une<br />
note de priorité<br />
CL<br />
V<br />
10
3. RÈGLES D'ENTRETIEN DES CHAUSSÉES<br />
Le diagnostic d'état des chaussées étant établi, les règles d'entretien constituent la base <strong>du</strong> choix des travaux.<br />
Elles sont présentées successivement pour chacun des trois objectifs principaux de l'entretien :<br />
— conservation et adaptation de la structure,<br />
— sécurité - confort<br />
— intégrité de la couche de surface.<br />
Les solutions d'entretien proposées, bien que représentatives des cas les plus courants, ne doivent pas être<br />
considérées comme impératives, mais comme des références à partir desquelles l'esprit critique des responsables<br />
doit s'exercer afin d'adapter la solution à chaque cas particulier.<br />
3.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES TABLEAUX<br />
Pour chacun des trois objectifs précités, un tableau subdivisé en deux parties donne :<br />
— pour chaque indicateur d'état, le paramètre à considérer et les fourchettes de valeurs correspondant aux<br />
différents niveaux,<br />
— les règles d'entretien proprement dites. Celles-ci permettent, à partir des niveaux des indicateurs d'état et<br />
de certains paramètres auxiliaires, de déterminer les sections qui doivent faire l'objet soit de travaux, soit<br />
d'une surveillance particulière qui consistera notamment à suivre l'évolution des paramètres ayant donné<br />
l'alerte.<br />
Le Guide rappelle, dans quelques cas particuliers, l'opportunité de procéder à un balisage ou d'implanter<br />
éventuellement une signalisation de danger. La remarque a bien sûr une portée générale et il convient naturellement<br />
de mettre en place, dès que possible, une signalisation spécifique adaptée aux défectuosités constatées<br />
susceptibles de mettre en cause la sécurité des usagers (cf. Instruction interministérielle sur la signalisation<br />
routière <strong>du</strong> 7 juin 1977 - livre I - deuxième partie).<br />
Lorsque des travaux sont préconisés, il conviendra d'en définir la nature exacte. Quelques indications à ce<br />
sujet sont fournies au paragraphe 3.5, mais dans certains cas, et notamment lorsque la structure est en cause,<br />
le recours au laboratoire sera nécessaire.<br />
3.2. TABLEAU CONCERNANT LA CONSERVATION ET L'ADAPTATION DE LA STRUCTURE<br />
Pour la conservation de la structure et son adaptation à l'évolution <strong>du</strong> trafic, trois types de chaussées ont été<br />
distingués :<br />
— les chaussées à couche de base en matériaux non traités,<br />
— les chaussées à couche de base traitée aux liants hydrocarbonés (les chaussées ayant reçu plusieurs rechargements<br />
successifs portant l'épaisseur totale de l'enrobé en surface à une vingtaine de centimètres, seront<br />
assimilées à ce type de structure),<br />
— les chaussées à couche de base traitée aux liants hydrauliques.<br />
Les chaussées présentant des défauts de structure nécessiteront généralement des travaux d'entretien relativement<br />
lourds (rechargement de 8 à 10 cm de béton bitumineux, voire renforcement).<br />
De plus, dès constatation des premiers indices d'une dégradation, il est recommandé de faire procéder par le<br />
laboratoire à une étude <strong>du</strong> type renforcements coordonnés.<br />
11 convient également de s'assurer que l'évolution <strong>du</strong> trafic lourd ne con<strong>du</strong>it pas à un changement de classe<br />
de trafic.<br />
Rappelons à ce sujet que les classes de trafic (définies dans le Catalogue 1977 des structures types de chaussées<br />
neuves) sont déterminées à partir <strong>du</strong> trafic poids lourds MJA (moyenne journalière annuelle) de la voie la plus<br />
chargée de la chaussée pendant l'année de mise en service, soit :<br />
I T3 T2 I Tl I T0<br />
Trafic PL - MJA de la voie la plus chargée<br />
pendant l'année de la mise en service.<br />
50 150 M)0 750 2000<br />
11
Ces classes tra<strong>du</strong>isent en fait des trafics cumulés, calculés sur une période de 15 à 20 années, dans l'hypothèse<br />
d'un taux de croissance géométrique annuel égal 7 %.<br />
Si, pendant les années qui suivent la construction ou le renforcement de la chaussée, la croissance <strong>du</strong> trafic est<br />
supérieure à 7 %, il peut se pro<strong>du</strong>ire un changement de classe. Pour en effectuer la vérification, il faut comparer<br />
:<br />
— le nombre cumulé réel des poids lourds qui ont effectivement circulé sur la voie la plus chargée depuis la<br />
construction ou le renforcement de la chaussée,<br />
— le nombre cumulé fictif, calculé sur la même période, en prenant pour trafic initial la borne supérieure de<br />
la classe Ti retenue pour le dimensionnement de la chaussée, et en considérant un taux de croissance géométrique<br />
annuel égal à 7 %.<br />
Si le trafic cumulé réel est supérieur à ce nombre cumulé fictif, il y a effectivement changement de classe et il<br />
convient d'examiner s'il y a lieu de réajuster le dimensionnement de la structure de chaussée.<br />
L'abaque 1 de la page suivante permet une vérification facile des classes de trafic.<br />
3.3. TABLEAU CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT<br />
Divers points relatifs à l'adhérence et aux accidents sur chaussée mouillée méritent d'être rappelés ici.<br />
a) Le niveau de l'adhérence est apprécié par l'appareil SCRIM qui mesure (à une vitesse de 60 km/h) le<br />
Coefficient de Frottement Transversal (CFT). Cet appareil est équipé d'un pneumatique lisse, ce qui permet<br />
à la fois une bonne répétabilité des conditions de mesure et dilate l'échelle d'appréciation des revêtements.<br />
L'adhérence mesurée des chaussées est variable en fonction de la nature <strong>du</strong> revêtement et <strong>du</strong> trafic supporté<br />
mais dépend aussi :<br />
• de la vitesse de l'appareil de mesure,<br />
• de la période de l'année <strong>du</strong>rant laquelle la mesure est effectuée. Ce sont les variations saisonnières,<br />
variables d'un revêtement à l'autre, avec en moyenne, une adhérence plus élevée au printemps et plus<br />
faible à la fin de l'été. Ces variations semblent être liées aux précipitations précédant la mesure,<br />
• de la température extérieure au moment de la mesure, qui influe sur les propriétés des pneumatiques<br />
(valable pour tous les pneumatiques),<br />
• de la position de la mesure dans le profil en travers, car il existe une hétérogénéité de l'adhérence <strong>du</strong>e à<br />
la canalisation <strong>du</strong> trafic.<br />
• des souillures accidentelles (boues, hydrocarbures...).<br />
Toutes ces variations qui sont perceptibles à l'usager compliquent l'interprétation de la mesure. Il n'est donc<br />
pas défini de coefficient pondérateur, ni a fortiori, de valeur seuil. Les niveaux de CFT indiqués dans le<br />
tableau relatif au confort et à la sécurité ne constituent donc que des indicateurs donnant des ordres de grandeur<br />
<strong>du</strong> phénomène mesuré.<br />
b) Le suivi des accidents sur chaussée mouillée permet de situer le risque de dérapage par insuffisance<br />
d'adhérence sur la section considérée par rapport à une section de référence. On s'appuie pour cela sur la<br />
valeur <strong>du</strong> rapport M/T (rapport <strong>du</strong> nombre d'accidents sur chaussée mouillée au nombre total d'accidents).<br />
De nombreux facteurs peuvent influencer ce rapport (caractéristiques géométriques de la route, trafic,<br />
<strong>du</strong>rée des précipitations variables d'une région à l'autre...) et il n'est pas possible de fixer une valeur unique,<br />
valable pour tout le réseau <strong>national</strong>, au-delà de laquelle la proportion d'accidents sur chaussée<br />
mouillée pourrait être considérée comme anormale.<br />
On compare donc le rapport M/T des différentes sections d'une route à la moyenne m obtenue sur le<br />
tronçon homogène (caractéristiques géométriques, trafic et site) qui intègre ces sections. On peut ainsi<br />
dégager les sections où le rapport M/T s'écarte significativement de la moyenne.<br />
Seuls sont à prendre en compte les accidents survenus en rase campagne, hors carrefour. De plus, le rapport<br />
M/T ne doit porter que sur les accidents postérieurs à la mise en œuvre de la dernière couche de roulement<br />
sur la section considérée et le nombre total d'accidents pris en compte doit être suffisamment<br />
significatif.<br />
Pour chaque section ainsi détectée, on s'efforcera de rechercher la (ou les) cause(s) des accidents (signalisation<br />
verticale ou horizontale, caractéristiques géométriques, environnement, qualités superficielles de<br />
la chaussée, etc.). Seuls sont abordés dans ce document les travaux visant à restaurer les qualités superficielles<br />
de la chaussée.<br />
3.4.TABLEAU CONCERNANT L'INTÉGRITÉ DE LA COUCHE DE SURFACE<br />
Le tableau correspondant n'appelle pas de commentaire particulier.<br />
12
Abaque 1 : VERIFICATION DE LA CLASSE DE TRAFIC<br />
1/365» <strong>du</strong> trafic<br />
60 000-t-^PL cumulé sur la<br />
R voie la plus chargée<br />
T0<br />
T1<br />
T2<br />
T3<br />
300<br />
200<br />
150<br />
100-<br />
90-<br />
80-<br />
70-<br />
60-<br />
50-<br />
T2<br />
T3<br />
/<br />
/<br />
Exemple d'utilisation : une chaussée supportait 650 PL -MJA, sur<br />
la voie la plus chargée, l'année de renforcement (année 0). La<br />
structure a donc été dimensionnée pour un trafic Tl. Le taux de'<br />
croissance géométrique annuel <strong>du</strong> trafic PL a été de 20 % entre<br />
l'année 1 et l'année 5. Le trafic PL cumulé s'obtient en multipliant '<br />
, le trafic PL de l'année 0 par le coefficient correcteur calculé ci-1<br />
après :<br />
Années 1 2 3 4 5<br />
Trafic PL cumulé 1 2,2 3,64 5,37 7,44<br />
A une constante près (365), le trafic PL cumulé est égal à la<br />
somme des moyennes journalières annuelles, soit à 650 x 7,44 =<br />
4 836 PL (point A). On voit que le trafic est passé en classe T0.<br />
T<br />
Années<br />
10 15 20<br />
13
TABLEAU III<br />
CONSERVATION ET ADAPTATION DE LA STRUCTURE<br />
NIVEAU DES INDICATEURS D'ETAT<br />
M\I AI :<br />
NIVEAU 1<br />
INDICATEUR D'ETAT<br />
PARAMETRE CONSIDÈRE<br />
Chaussées<br />
simples<br />
à assise<br />
non traitée<br />
Chaussée à<br />
couche<br />
de base<br />
traitée aux<br />
liants<br />
hydrocarbonés<br />
Chaussée a<br />
couche<br />
de base<br />
traitée aux<br />
liants<br />
hydrauliques<br />
Toutes<br />
structures<br />
DÉFLEXION (1)<br />
Déflexion<br />
caractéristique<br />
(en 1/100 e ) en fonction<br />
de la classe de trafic<br />
35 à 50<br />
50 à 75<br />
75 à 100<br />
100 à 150<br />
30 à 40<br />
40 à 50<br />
50 à 70<br />
70 à 90<br />
20 à 30<br />
35 à 45<br />
40 à 50<br />
Défauts de rive<br />
(affaissements,<br />
bourrelets)<br />
Pourcentage de longueur<br />
de chaussée affectée<br />
5 à 10<br />
Valeurs<br />
supérieures<br />
aux valeurs<br />
maximales<br />
<strong>du</strong> niveau 2<br />
Flaches, nids de poule<br />
(en formation ou<br />
rebouchés)<br />
Nombre par section<br />
de 200 m<br />
2 à 4 à2<br />
Orniérage à grand rayon<br />
Profondeur moyenne<br />
de l'ornière<br />
Pourcentage de longueur<br />
orniérée<br />
15 à 20 mm<br />
sur plus de 30 % de la longueur<br />
20 mm<br />
sur plus de<br />
Fissures transversales<br />
de retrait<br />
très dégradées (2)<br />
NIVEAU 1<br />
dans tous les cas<br />
Faïençage<br />
Pourcentage de surface<br />
de chaussée faïencée<br />
2à5 1 à 3<br />
Fissures longitudinales<br />
dans les traces de roues<br />
Pourcentage de longueur<br />
de chaussée fissurée<br />
5 à 10 ! a S ",,<br />
Valeurs<br />
supérieures<br />
aux valeurs<br />
maximales<br />
<strong>du</strong> niveau 2<br />
Remontées de fines<br />
Nombre par section<br />
de 200 m<br />
a 2<br />
Variations de la note d'UNI<br />
Pour les chaussées souples à assise non traitée el les chaussées de base traitée aux liants hydrocarbonés, une<br />
diminution sensible de la note d'uni (au moins 2 classes) entre deux passages successifs de l'appareil peut<br />
être le signe d'une évolution de la structure.<br />
(1) Si l'on constate une évolution importante de la valeur initiale de la déflexion mesurée lors de l'établissement <strong>du</strong> point 0, on sera<br />
con<strong>du</strong>it à classer une chaussée dans le niveau 2 même si les valeurs <strong>du</strong> tableau ci-dessus ne sont pas atteintes. On rappelle que pour les<br />
chaussées à assises traitées aux liants hydrauliques, la déflexion n'est qu'un indicateur de mauvaise qualité; il serait souhaitable de lui<br />
associer le rayon de courbure, mais celui-ci n'est pas encore mesurable en continu.<br />
(2) Les fissures transversales de retrait seront considérées comme « très dégradées » si plus de 20% d'entre elles sont, soit ramifiées, soit<br />
épaufrées et présentant des risques importants de départs de matériaux. Dans le cas contraire, elles seront prises en compte au titre<br />
de « l'intégrité de la couche de surface ».<br />
NOTA : Pour les dégradations de structure, les divers pourcentages (longueur de chaussée fissurée, surface faïencée, etc.) ainsi que le<br />
nombre de défauts (flaches, nids de poule) sont à considérer pour la voie (3,5 m) la plus dégradée et à ramener à la longueur ou<br />
surface de cette voie.<br />
14
REGLES D'ENTRETIEN<br />
DEFLEXION<br />
NIVEAU 1<br />
NIVEAU 2<br />
Inférieure<br />
au niveau 2<br />
DÉGRADATIONS DE STRUCTURE<br />
NIVEAU 1<br />
NIVEAU 2<br />
Existence de dégradations<br />
de structure susceptibles<br />
de se généraliser<br />
Absence de dégradation<br />
de structure<br />
TRAVAUX<br />
priorité 1<br />
TRAVAUX<br />
priorité 2<br />
Elude<br />
complémentaire<br />
(2)<br />
TRAVAUX<br />
priorité 2<br />
SURVEIL-<br />
LANCE<br />
(1)<br />
TRAVAUX<br />
priorité 2<br />
SURVEILLANCE<br />
(1)<br />
(1) SURVEILLANCE :<br />
Surveillance particulière de la section : inspections détaillées et éventuellement mesures complémentaires.<br />
Réparations localisées éventuelles s'il y a présence de dégradations.<br />
(2) L'étude complémentaire définira la nature des travaux à prévoir et précisera leur urgence.<br />
NOTA important :<br />
De façon générale, il conviendra de vérifier et éventuellement de remettre en état les ouvrages d'assainissement<br />
de la chaussée. L'entretien de ces ouvrages doit d'ailleurs être une préoccupation essentielle des responsables<br />
<strong>du</strong> réseau <strong>routier</strong>.<br />
15
TABLEAU IV<br />
SECURITE - CONFORT<br />
NIVEAU DFS INDICATEURS D'ETAT<br />
INDICATEUR D'ÉTAT<br />
PARAMETRE CONSIDÉRÉ<br />
NIVEAU 1<br />
NIVEAU 2<br />
NIVEAU 3<br />
ADHERENCE<br />
Coefficient de Frottement<br />
Transversal (CF.T.)<br />
inférieur<br />
à 0,25<br />
de l'ordre de<br />
0,25 à 0,45<br />
de l'ordre de<br />
0,45 à 0,55<br />
UNI<br />
Classe d'uni (dans les courte et<br />
moyenne longueurs d'onde:<br />
1 à 3,3 m et 3,3 à 13 m)<br />
1-2 ou 3<br />
4 ou 5<br />
DÉGRADATIONS<br />
Orniérage<br />
à petit rayon<br />
Plumage -<br />
Ressuage - Glaçage<br />
• Profondeur moyenne de<br />
l'ornière<br />
• Pourcentage de longueur<br />
orniérée<br />
Pourcentage de longueur<br />
de chaussée affectée<br />
plus de 20 mm<br />
plus de 30%<br />
supérieur à 30%<br />
15 à 20 mm<br />
plus de 30%<br />
10 à 30%<br />
NOTA : 1) Pour les dégradations, les divers pourcentages (longueur de chaussée orniérée, etc.) sont à considérer pour la voie<br />
(3,50 m) la plus dégradée et à ramener à la longueur totale de cette voie.<br />
2) Si la note d'uni dans la gamme des grandes longueurs d'onde (13 à 40 m) est basse et que des travaux sont programmés<br />
pour d'autres raisons, il convient d'examiner dans quelle mesure une amélioration peut être obtenue dans le cadre des<br />
travaux d'entretien.<br />
16
REGLES D'ENTRETIEN<br />
L'adhérence est au plus <strong>du</strong> niveau 3 L'adhérence est supérieure au niveau 3<br />
\l)lll RI N< 1<br />
DÉGRADATIONS<br />
NIVEAU 1 NIVEAU 2<br />
NIVEAU 3<br />
NIVEAU 1<br />
NIVEAU 2<br />
Absence de paramètre<br />
auxiliaire<br />
Conditions<br />
géométriques<br />
défavorables (1)<br />
TRAVAUX<br />
priorité 1<br />
TRAVAUX<br />
priorité 2<br />
SURVEILLANCE<br />
(2)<br />
TRAVAUX<br />
priorité 2<br />
SURVEILLANCE<br />
(2)<br />
NIVEAU<br />
2<br />
TRAVAUX<br />
priorité 2<br />
TRAVAUX<br />
priorité 3<br />
UNI<br />
NIVEAU 1<br />
1<br />
TRAVAUX<br />
priorité 1<br />
TRAVAUX<br />
priorité 2<br />
! DÉGRADATIONS<br />
NIVEAU<br />
2<br />
NIVEAU<br />
1<br />
TRAVAUX<br />
priorité 1<br />
TRAVAUX<br />
priorité 3<br />
TRAVAUX<br />
priorité 2<br />
(1) DÉFINITION DES CONDITIONS<br />
GÉOMÉTRIQUES DÉFAVORABLES<br />
Tracé en plan :<br />
Autoroute : rayon en plan < 1000 m<br />
Route <strong>national</strong>e : rayon en plan < 425 m<br />
ou < 665 m si<br />
la courbe suit un grand alignement.<br />
Profil en long : toutes voies : pente ou rampe > 5 %<br />
Kcoulemenl des eaux :<br />
• pente longitudinale < 0,5 %<br />
• zone d'accumulation d'eau : les caractéristiques <strong>du</strong><br />
dévers et la pente longitudinale con<strong>du</strong>isent à une<br />
accumulation d'eau ou à un écoulement important ; ou<br />
bien les lignes d'écoulement traversent la chaussée.<br />
Visibilité :<br />
Autoroute<br />
: distance de visibilité A V des points<br />
d'accès < 1 000 m<br />
Route <strong>national</strong>e :<br />
à 2 chaussées ou à 4 voies : A V < 230 m<br />
à 2 ou 3 voies : A V < 400 m<br />
(2) SURVEILLANCE<br />
Surveillance particulière de la section, suivi des accidents<br />
et éventuellement mesures complémentaires<br />
d'adhérence.<br />
SECTIONS A ACCUMULATION D'ACCIDENTS<br />
SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE<br />
On considérera qu'une section présente une accumulation<br />
d'accidents sur chaussée mouillée si le rapport M/T<br />
(rapport <strong>du</strong> nombre d'accidents sur chaussée mouillée<br />
au nombre total d'accidents) y est nettement supérieur à<br />
la moyenne m de ce même rapport sur le tronçon homogène<br />
considéré.<br />
De telles sections doivent faire l'objet d'une étude<br />
approfondie, avec visites des lieux, pour rechercher les<br />
origines des accidents. Si les caractéristiques de surface<br />
de la chaussée sont en cause, il convient de prévoir au<br />
programme opérationnel, avec la priorité 1, le renouvellement<br />
de la couche de roulement.<br />
17
TABLEAU V<br />
INTEGRITE DE LA COUCHE DE SURFACE<br />
NIVEAU DES INDICATEURS D'ETAT<br />
INDICATEUR D'ETAT<br />
PARAMETRE CONSIDÈRE'<br />
NIVEAU 2<br />
NIVEAU 1<br />
Fissure longitudinale<br />
d'épaulement<br />
Raccordement<br />
défectueux de deux<br />
bandes d'enrobés<br />
Etat de la fissure<br />
Etat <strong>du</strong> joint<br />
Dès apparition <strong>du</strong> défaut<br />
Apparition de désordres<br />
secondaires : faïençage,<br />
nids de poule, arrachements<br />
avec risques importants de<br />
départs de matériaux<br />
DEGRADATIONS<br />
Fissures transversales<br />
de retrait<br />
Désenrobage<br />
Etat des fissures (1 )<br />
Pourcentage de longueur<br />
de chaussée dégradée<br />
Fissures peu dégradées<br />
10 à 30 %<br />
Fissures très dégradées<br />
(cf. tableau III)<br />
y 3o %<br />
Pelade<br />
Pourcentage de surface<br />
de chaussée dégradée<br />
0 à 2 "o<br />
> 2 »/o<br />
Remontées d'eau - Signes<br />
de perméabilité de<br />
l'enrobé<br />
Pourcentage de surface<br />
de chaussée dégradée<br />
0 à 10 "'()<br />
(1) Les fissures transversales considérées comme « très dégradées » (c'est-à-dire si plus de 20% d'entre elles sont soit ramifiées, soit<br />
épaufrées et présentant des risques importants de départs de matériaux) sont prises en compte au titre de la « conservation et<br />
adaptation de la structure ».<br />
NOTA: Pour les dégradations, les divers pourcentages (longueur ou surface de chaussée dégradée/ sont à considérer pour la voie<br />
(3,50 m) la plus dégradée, et à ramener à la longueur ou surface de cette voie.<br />
y<br />
m »/o<br />
REGLES D'ENTRETIEN<br />
Fissures transversales de retrait<br />
NIVEAU 2<br />
Scellement des fissures dès leur apparition (2)<br />
— Fissure longitudinale<br />
d'épaulement<br />
— Raccordement défectueux de<br />
deux bande d'enrobés<br />
NIVEAU 2<br />
NIVEAU 1<br />
Scellement des fissures ou <strong>du</strong> joint (2)<br />
Renouvellement de la couche de roulement (tapis d'enrobés)<br />
priorité 2<br />
Désenrobage<br />
NIVEAU 2<br />
NIVEAU 1<br />
Surveillance particulière de la section (inspections détaillées)<br />
Renouvellement de la couche de roulement<br />
(en<strong>du</strong>it ou tapis d'enrobés) priorité 3<br />
Pelade<br />
NIVEAU 2<br />
NIVEAU 1<br />
Réparations localisées (2) par emplois partiels ou enrobés<br />
Renouvellement de la couche de roulement (tapis d'enrobés)<br />
priorité 2<br />
— Remontées d'eau<br />
— Signes de perméabilité<br />
de l'enrobé<br />
NIVEAU 2<br />
NIVEAU 1<br />
Surveillance particulière de la section (inspections détaillées)<br />
Renouvellement de la couche de roulement (en<strong>du</strong>it ou<br />
tapis d'enrobés) après étude spécifique destinée à vérifier<br />
la perméabilité de l'enrobé — priorité 3<br />
(2) La note de priorité ne concerne que les tâches importantes programmables (en<strong>du</strong>its, tapis d'enrobés), les réparations localisées sont<br />
cependant à effectuer dans l'année.<br />
18
3.5. CRITÈRES DE CHOIX ENTRE ENDUITS SUPERFICIELS ET ENROBÉS CLASSIQUES OU EN<br />
COUCHE MINCE<br />
On a vu que les chaussées présentant des problèmes de structure nécessitent des travaux d'entretien relativement<br />
« lourds » qui excluent donc les en<strong>du</strong>its superficiels et les enrobés en couche mince.<br />
Par contre, si les caractéristiques de surface de la chaussée sont seules en cause, la question <strong>du</strong> choix entre<br />
en<strong>du</strong>it superficiel et enrobés peut se poser.<br />
L'en<strong>du</strong>it superficiel constitue la solution la plus intéressante au plan économique ; sa possibilité devra donc<br />
être examinée en premier lieu. Cette solution connaît cependant des limites techniques précisées dans l'intro<strong>du</strong>ction<br />
de la Directive SETRA-LCPC de novembre 1978 sur la réalisation des en<strong>du</strong>its superficiels, à laquelle il<br />
convient de se reporter.<br />
Si les en<strong>du</strong>its se révèlent techniquement inadaptés, les enrobés en couche mince à base de bitume pur, mis au<br />
point par les laboratoires des P. et C, peuvent constituer une solution économiquement intéressante. La Note<br />
technique correspondante est en cours d'élaboration.<br />
En revanche, si une chaussée comporte une couche de roulement dont l'épaisseur est inférieure à celle prévue<br />
au Catalogue 1977 des structures types de chaussées neuves, la mise aux normes à titre préventif, par un tapis<br />
d'enrobés classiques sera préférée aux solutions précédentes, même en l'absence de problème de structure.<br />
Enfin, il est également nécessaire de comparer sur le plan économique les différentes séquences d'entretien<br />
possibles, en particulier lorsque l'âge de la couche de surface est relativement élevé et que d'autre part la<br />
structure devra être réadaptée à brève échéance. Une question fréquemment posée est de savoir s'il convient<br />
d'exécuter un en<strong>du</strong>it à l'année n, puis un tapis d'enrobés classiques (rechargement) quelques années plus<br />
tard ou d'avancer la réalisation <strong>du</strong> tapis d'enrobés au lieu de l'en<strong>du</strong>it.<br />
En règle générale, et indépendamment des dispositions qui pourront être prises en fonction des problèmes<br />
d'exploitation, on pourra adopter le comportement suivant :<br />
— si un tapis est prévisible à court terme (de l'ordre de 3 ans) pour des raisons d'adaptation de la structure,<br />
on a intérêt économiquement à avancer le tapis d'enrobés plutôt que de faire un en<strong>du</strong>it d'attente,<br />
— dans le cas contraire, un en<strong>du</strong>it de bonne qualité à l'année n reste économiquement justifié.<br />
19
Page laissée blanche intentionnellement
DEUXIEME PARTIE<br />
ENTRETIEN DES DÉPENDANCES<br />
ET ÉQUIPEMENTS DIVERS<br />
Les règles d'entretien à appliquer sont définies dans les tableaux ci-après, successivement pour :<br />
— les dépendances,<br />
— les plantations<br />
— les équipements de la route<br />
— les installations annexes (points d'arrêt, aires de repos et de service).<br />
1. ENTRETIEN DES DÉPENDANCES<br />
Nature des ouvrages<br />
Bandes d'arrêt revêtues<br />
Bandes d'arrêt stabilisées<br />
Règles d'entretien<br />
1. Réparation des nids de poule et des affaissements (dénivellation<br />
supérieure à 4 ou 5 cm) dans un délai aussi ré<strong>du</strong>it que possible. Si les<br />
affaissements ne concernent que la partie de la bande d'arrêt située<br />
au-delà d'une distance de 1,00 m <strong>du</strong> bord théorique de la chaussée,<br />
on pourra intervenir dans un délai plus long. Une signalisation<br />
appropriée doit être mise en place dès que possible : balisage de la<br />
chaussée le long de la zone dégradée.<br />
2. Réparations localisées des zones fissurées et faïencées (scellements,<br />
purges et emplois partiels) dès que possible. Le délai de réparation<br />
est fonction de l'importance des pénétrations d'eau et de leur incidence<br />
sur la tenue de la chaussée (cas des sols sensibles à l'eau).<br />
1. Interventions dans une zone de 1,00 m de largeur, comptée à partir<br />
<strong>du</strong> bord théorique de la chaussée, dans les mêmes conditions que<br />
pour les bandes d'arrêt revêtues.<br />
2. Réparation des déformations et dégradations diverses constatées audelà<br />
de 1,00 m <strong>du</strong> bord théorique de la chaussée dans le cadre d'un<br />
programme annuel exécuté avant l'hiver. Des interventions plus fréquentes<br />
peuvent être nécessaires si les déformations sont très importantes<br />
(ornières ou flaches profonds de 10 cm ou plus) et favorisent<br />
l'infiltration des eaux (cas des sols de fondation sensibles à l'eau).<br />
21
Nature des ouvrages<br />
Berme en limite de chaussée<br />
ou de piste cyclable<br />
Règles d'entretien<br />
1. Interventions dans une zone de 1,00 m de largeur ou dans la zone<br />
située devant une glissière de sécurité dans les mêmes conditions que<br />
précédemment si les dégradations présentent un danger.<br />
2. Réparation des déformations et dégradations diverses constatées audelà<br />
de 1,00 m <strong>du</strong> bord théorique de la chaussée dans le cadre d'un<br />
programme annuel de travaux exécuté avant l'hiver lorsque les<br />
défauts gênent l'écoulement des eaux.<br />
Des interventions plus fréquentes peuvent être recommandées dans le<br />
cas de déformations très importantes facilitant la pénétration des<br />
eaux lorsque le sol de fondation de la chaussée est sensible à l'eau.<br />
3. Ouverture de saignées lorsque la surélévation de la berme con<strong>du</strong>it à<br />
la formation d'un écoulement longitudinal sur la chaussée ou à la<br />
stagnation des eaux à la suite d'une pluie d'intensité courante.<br />
4. Dérasement des bermes lorsque la surélévation dépasse une dizaine<br />
de centimètres.<br />
5. Remise à niveau des accotements lorsque la dénivellation à la limite<br />
de la chaussée est susceptible de mettre en cause la sécurité des usagers.<br />
6. Délignage des bermes : les travaux de délignage doivent être exécutés<br />
dès que la bande blanche de rive est atteinte par la végétation et avant<br />
rechargement de la chaussée.<br />
Berme en limite de bandes<br />
d'arrêt<br />
Berme : contrôle de la<br />
végétation<br />
1. Réparation des affaissements, orniérages, ravinements, suivant les<br />
indications définies au § 2 ci-dessus.<br />
2. Ouverture de saignées lorsque la surélévation de la berme con<strong>du</strong>it à<br />
la formation d'un écoulement longitudinal important sur la bande<br />
d'arrêt.<br />
3. Dérasement des bermes lorsque la surélévation atteint 15 à 20 cm<br />
environ.<br />
Les interventions de fauchage varieront généralement de 2 à 4 par an en<br />
fonction de la région et des conditions météorologiques de l'année.<br />
L'objectif souhaitable est de ne pas dépasser une vingtaine de cm de<br />
hauteur d'herbe sur les autoroutes et les routes <strong>national</strong>es importantes,<br />
cette hauteur pouvant aller jusqu'à une quarantaine de cm sur les routes<br />
à faible trafic. Des interventions localisées supplémentaires peuvent être<br />
nécessaires pour assurer la visibilité dans certaines zones (dégagement en<br />
courbes, panneaux, carrefours, etc.).<br />
Lorsqu'il n'y a pas de glissière de sécurité, le fauchage doit être fait sur<br />
la largeur totale de la berme.<br />
Lorsqu'il y a une glissière de sécurité, le fauchage doit être fait sur la<br />
largeur totale devant la glissière de sécurité aux périodicités indiquées cidessus,<br />
et une fois par an sous et derrière la glissière.<br />
Remarques :<br />
1. L'emploi de pro<strong>du</strong>its limitateurs de croissance peut diminuer les fréquences<br />
d'intervention, mais leur application nécessite le respect de<br />
conditions très strictes qui en font une technique peu souple à mettre<br />
en œuvre (assistance technique des fabricants nécessaire).<br />
2. Le désherbage chimique peut être utilisé en complément <strong>du</strong> fauchage<br />
mécanique dans les zones d'accès difficile et lorsque la couverture<br />
végétale n'est pas nécessaire à la stabilité <strong>du</strong> terrain (pieds de panneaux<br />
de signalisation, bornes, délinéateurs, supports de glissières).<br />
Des précautions particulières doivent être prises pour éviter la pollution<br />
et des destructions en dehors des zones traitées. Se référer à ce sujet à la<br />
Note d'information « Traitement chimique des abords de chaussée » —<br />
septembre 1977 — diffusée par le SETRA<br />
22
Nature des ouvrages<br />
Bande dérasée de gauche<br />
Terre-plein engazonné<br />
Accotements et terre-plein<br />
Règles d'entretien<br />
Mêmes interventions que sur les bandes d'arrêt.<br />
Mêmes interventions que sur les bermes avec possibilité de désherbage<br />
chimique total sous glissières (quand elles sont situées en bor<strong>du</strong>re de surfaces<br />
minéralisées) et d'utilisation de limitateurs de croissance (section à<br />
fort trafic notamment).<br />
Le nettoyage régulier des accotements et l'enlèvement des détritus sur<br />
toute la largeur est nécessaire pour l'esthétique générale de la route.<br />
L'accumulation des détritus incite à en ajouter.<br />
On pourra à ce sujet se référer au Guide « Propreté de la route » décembre<br />
1977, diffusé parle S.E.T.R.A.<br />
Fossés ou cunettes<br />
1. Dégagement des obstacles accidentels à l'écoulement des eaux<br />
(dépôts, glissements de talus) dès constatation <strong>du</strong> défaut.<br />
2. Curage périodique des fossés en terre tous les 3 ou 5 ans. La fréquence<br />
des interventions pourra être adaptée aux conditions locales.<br />
Des interventions de débroussaillage sont nécessaires dans l'intervalle<br />
suivant le développement observé et la nature de la végétation<br />
(débroussaillage mécanique de préférence, une fois par an).<br />
Le débroussaillage chimique des fonds de fossés doit être utilisé avec<br />
une grande prudence, compte tenu des risques de pollution des nappes<br />
et des dommages aux propriétés riveraines.<br />
Voir à ce sujet la Note d'information « Traitement chimique des<br />
abords de chaussées » — septembre 1977 diffusée par le SETRA<br />
3. Le fauchage dans l'emprise des cunettes engazonnées doit être effectué<br />
régulièrement en même temps que celui de la berme.<br />
Canalisations<br />
Bouches et regards<br />
Bor<strong>du</strong>res - caniveaux (hors<br />
agglomération)<br />
Dégagement des obstacles accidentels à l'écoulement des eaux (dépôts)<br />
par curage des canalisations dès constatation <strong>du</strong> défaut.<br />
Réparation des maçonneries des regards, avaloirs et autres ouvrages<br />
d'assainissement, suivant constatation des défauts. Remplacement des<br />
tampons de fermeture et grilles des regards, bouches d'égoûts, caniveaux<br />
cassés ou trop déformés.<br />
Les ouvrages dégradés situés en bor<strong>du</strong>re immédiate de la chaussée<br />
devront être signalés provisoirement dès constatation <strong>du</strong> défaut et la<br />
remise en état doit intervenir dès que possible. Les ouvrages sur chaussée<br />
doivent faire l'objet d'une intervention d'urgence dès constatation<br />
<strong>du</strong> défaut (réparation provisoire ou signalisation).<br />
Dégagement des obstacles à l'écoulement des eaux dès constatation <strong>du</strong><br />
défaut.<br />
Remplacement ou mise à niveau des bor<strong>du</strong>res affaissées ou décalées à<br />
l'occasion des travaux d'entretien sur chaussée ou dès constatation <strong>du</strong><br />
défaut lorsque l'écoulement des eaux ou la sécurité des usagers est en<br />
cause.<br />
Nota : l'entretien des bor<strong>du</strong>res en agglomération n'est pas à la charge de<br />
l'État. Néanmoins, il convient d'attirer l'attention des collectivités sur le<br />
danger que peuvent présenter certains défauts (perturbation dans l'écoulement<br />
des eaux, ouvrages débordant sur la chaussée, saillie de gargouilles,<br />
etc.) et en cas d'urgence de remédier à leur défaillance.<br />
23
Nature des ouvrages<br />
Talus<br />
Règles d'entretien<br />
1. Purge éventuelle, nettoyage et reconstitution des talus dans les zones<br />
d'érosion ; reprise ou aménagement d'ouvrages d'assainissement<br />
(descentes d'eau). Les travaux doivent être réalisés en général rapidement<br />
pour éviter l'extension des dégradations.<br />
2. Purges des parois rocheuses pour éliminer les blocs instables suivant<br />
les constatations faites au cours des visites de routine.<br />
3. Eboulis et glissements importants : les travaux doivent être déterminés<br />
après une étude spécifique. Différentes solutions techniques peuvent<br />
être envisagées (soutènement, reprise et aménagement de pentes,<br />
drainage, etc.).<br />
Remarque :<br />
Les matériaux éboulés empiétant sur les chaussées ou à proximité immédiate<br />
doivent être dégagés dans les meilleurs délais. Une signalisation<br />
temporaire de danger doit être mise en place dès constatation des dégradations.<br />
Contrôle de la végétation<br />
La périodicité des interventions de fauchage et les limites des traitements<br />
sont définies de la manière suivante :<br />
a) Talus de déblais de pente faible permettant la circulation des engins<br />
(jusqu'à 2/1), ou talus fauché par un engin à bras déporté : fauchage<br />
de l'emprise totale une ou deux fois par an selon l'importance de la<br />
route.<br />
L'objectif souhaitable est de ne pas dépasser une quarantaine de centimètres<br />
sur une hauteur de 3 m pour les talus des routes importantes.<br />
b) Talus de déblais de grande hauteur (plus de 3 m) et de pente élevée<br />
(plus de 2/1) : fauchage sur 3 m de hauteur comme précédemment.<br />
La hauteur de 3 m peut être augmentée si l'on dispose de rotofaucheuses<br />
à bras déporté permettant d'atteindre des hauteurs supérieures<br />
et si les conditions de circulation de l'engin au sol le permettent.<br />
Au-delà de 3 m de hauteur, on doit envisager selon les conditions<br />
locales :<br />
un débroussaillage dont la périodicité est fonction de l'aspect de<br />
la végétation, de la gêne occasionnée, des risques d'incendie ou de<br />
glissements de neige.<br />
Le débroussaillage mécanique, difficile à pratiquer sur des surfaces<br />
peu accessibles, permet la reconstitution rapide d'une végétation<br />
arbustive basse efficace contre l'érosion, alors que le<br />
débroussaillage chimique, plus facile à mettre en œuvre, implique<br />
un retour à des surfaces herbeuses après destruction des ligneux.<br />
aucune intervention, pour permettre un boisement spontané progressif<br />
par évolution naturelle de la végétation. Cette règle peut<br />
s'appliquer partout où la sécurité des usagers et la commodité des<br />
riverains n'est pas remise en cause, et tout spécialement dans la<br />
traversée de zones boisées.<br />
c) Talus de remblais<br />
Les règles ci-dessus sont applicables au talus de remblais sur toute<br />
leur hauteur.<br />
Quand la situation des talus rend obligatoire leur maintien en herbe,<br />
l'utilisation de limitateurs de croissance associés à des désherbants<br />
sélectifs permet d'alléger la contrainte d'entretien.<br />
24
2. ENTRETIEN DES PLANTATIONS<br />
Nature des ouvrages<br />
Plantations<br />
Règles d'entretien<br />
Les règles concernant l'entretien :<br />
— des jeunes plantations jusqu'à leur établissement définitif,<br />
— des plantations d'alignement,<br />
— des haies libres ou taillées et des écrans sur terre-plein central<br />
— des masses boisées,<br />
sont développées dans le Guide technique des plantations des routes<br />
<strong>national</strong>es (à paraître) diffusé par le SETRA<br />
Pour effectuer cet entretien dans les meilleures conditions et prévenir les<br />
accidents susceptibles d'être occasionnés par les végétaux, il y a lieu de<br />
procéder à une visite annuelle de surveillance effectuée pendant la<br />
période de pleine végétation (fin mai à début septembre), ayant notamment<br />
pour but de détecter les arbres dangereux, âgés ou malades.<br />
Dans l'attente de la parution de ce Guide, on se reportera à :<br />
- la circulaire n° 69 100 <strong>du</strong> 30 septembre 1969 relative à l'entretien des<br />
plantations,<br />
- au fascicule n° 35 <strong>du</strong> Cahier des Prescriptions Communes<br />
— à la circulaire n° 72 144 <strong>du</strong> 30.8.1972 relative à l'abattage d'arbres<br />
le long des routes <strong>national</strong>es.<br />
3. ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE<br />
Nature des ouvrages<br />
Panneaux de signalisation<br />
Signalisation horizontale<br />
Bornes kilométriques<br />
Délinéateurs et balises<br />
Règles d'entretien<br />
Le nettoyage doit être assez fréquent pour que la lisibilité des panneaux<br />
des types A, AB et B soit toujours excellente.<br />
Pour les autres panneaux, notamment de type D, la lisibilité doit être<br />
correcte et l'aspect satisfaisant.<br />
Se référer au Guide « Propreté de la route » — décembre 1977 — diffusé<br />
par le SETRA.<br />
Elle doit être renouvelée périodiquement. Il est difficile de fixer des<br />
périodicités fixes applicables de manière générale, l'usure dépendant des<br />
qualités de pro<strong>du</strong>its utilisés, des conditions de trafic, des conditions climatiques<br />
(pneus à crampons, emplois de sels de déverglaçage, etc.).<br />
Les périodicités moyennes sont actuellement de l'ordre de :<br />
— 1 an pour les peintures,<br />
— 2 ans pour les pro<strong>du</strong>its plus élaborés.<br />
Elles sont à l'heure actuelle essentiellement utilisées pour le repérage de<br />
toutes les données sur le réseau et pour l'information de l'usager.<br />
Leur entretien comprend : le remplacement des bornes accidentées et le<br />
nettoyage ou la réfection des inscriptions ; les travaux doivent être exécutés<br />
en fonction des constatations faites au cours des visites et inspections,<br />
en particulier dès que la lisibilité depuis un véhicule circulant<br />
sur la chaussée à 60 km/h devient insuffisante.<br />
L'ordre de grandeur moyen des nettoyages annuels des délinéateurs est<br />
de 18.<br />
Se référer à ce sujet au Guide « Délinéateurs — conditions d'emploi —<br />
maintien en état — mars 1978 — Direction des Routes et de la Circulation<br />
Routière — Service de l'Exploitation Routière Et de la Sécurité —<br />
Division Exploitation Sécurité <strong>du</strong> S.E.T.R.A.<br />
25
Nature des ouvrages<br />
Glissières de sécurité<br />
Eclairage<br />
Bornes d'appels téléphoniques<br />
Règles d'entretien<br />
Le remplacement des éléments accidentés doit être effectué dès que possible<br />
après mise en place d'un balisage temporaire (attention au danger<br />
présenté par les extrémités non protégées).<br />
L'entretien comprend le remplacement périodique systématique des<br />
lampes, la périodicité étant fonction <strong>du</strong> matériel employé. Des remplacements<br />
intermédiaires peuvent être nécessaires, le délai de l'intervention<br />
dépendant de l'importance <strong>du</strong> défaut d'éclairage au point de vue de<br />
la sécurité (en particulier, l'éclairage des panneaux de signalisation doit<br />
être rétabli dès que possible).<br />
Les interruptions de service et les dégradations doivent être signalées à<br />
l'organisme chargé de l'entretien dès constatation. L'entretien des accès<br />
aux bornes et de la signalisation afférente reste entièrement à la charge<br />
des services de l'Equipement.<br />
4. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ANNEXES<br />
(Points d'arrêt, aires de repos et de service)<br />
Le nettoyage et l'enlèvement des détritus doit être fait au cours d'interventions périodiques dont la fréquence<br />
est fonction de l'utilisation de l'aire. Voir à ce sujet le Guide « Propreté de la route » — décembre 1977 — diffusé<br />
par le S.E.T.R.A.<br />
Les équipements divers doivent être remplacés ou réparés régulièrement.<br />
L'entretien des zones de stationnement et des voies d'accès et de circulation est effectué en application des<br />
règles d'entretien définies pour les chaussées ou pour les bandes d'arrêt.<br />
Les règles d'entretien concernant la végétation sont énoncées dans le Guide « Aires annexes » (à paraître) diffusé<br />
par le SETRA.<br />
26
TROISIEME PARTIE<br />
RECUEIL DES DONNÉES<br />
1. SURVEILLANCE SYSTÉMATIQUE A L'AIDE D'APPAREILS DE MESURE A<br />
GRAND RENDEMENT<br />
Les appareils permettant de relever des paramètres sur la chaussée en continu (ou avec une très grande fréquence)<br />
sont actuellement au nombre de quatre :<br />
— le déflectographe pour la mesure de la délexion,<br />
— l'APL (analyseur de profil en long) pour la mesure de l'uni,<br />
— le SCRIM pour la mesure <strong>du</strong> coefficient de frottement transversel (CF.T.),<br />
— le GERPHO (Groupe d'Examen Routier par PHOtographie) qui filme en continu la chaussée et permet<br />
ensuite le repérage et la quantification des dégradations.<br />
Le passage des trois premiers de ces appareils est programmé systématiquement sur le réseau suivant une certaine<br />
périodicité ; le GERPHO fait l'objet de dispositions particulières qui sont indiquées au § 1.2 ci-après.<br />
1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES<br />
Les mesures effectuées par les appareils à grand rendement ne sont exécutées que :<br />
— dans un seul sens de circulation pour les chaussées uniques bidirectionnelles,<br />
— sur une voie de chaque chaussée, en cas de chaussées unidirectionnelles séparées.<br />
Pour le déflectographe, la période de mesure est un élément particulièrement important ; les valeurs relevées<br />
ne seront significatives que si le passage de l'appareil a lieu au printemps.<br />
1.1.1. « Point zéro »<br />
Une première série de mesures dans le cadre <strong>du</strong> point zéro doit être réalisée après la construction ou le renforcement<br />
de la chaussée. Celui-ci est réalisé un an après les travaux pour tenir compte, en particulier, <strong>du</strong> temps<br />
de prise des assises traitées aux liants hydrauliques.<br />
1.1.2. Mesures périodiques<br />
Après le point zéro, le passage des appareils doit être renouvelé périodiquement.<br />
Les périodicités souhaitables sont actuellement difficiles à définir pour deux raisons :<br />
— on ne dispose pas encore d*une expérience suffisante de l'évolution moyenne dans le temps des indicateurs<br />
d'état concernés,<br />
— pour des problèmes de coût, on ne peut renouveler chaque année l'ensemble des mesures sur tous les itinéraires.<br />
27
Le tableau ci-dessous fournit les périodicités retenues provisoirement pour l'exécution des mesures au titre <strong>du</strong><br />
programme systématique défini par l'Administration Centrale.<br />
-^—_ Appareils<br />
Années ^m<br />
^<br />
W<br />
Déflectographe<br />
SCRIM<br />
APL<br />
n(l)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
n + 4<br />
•<br />
•<br />
•<br />
n + 6<br />
•<br />
n + 8<br />
•<br />
•<br />
•<br />
n + 10<br />
•<br />
n + 12<br />
•<br />
(1) L'année n est l'année d'inscription de l'itinéraire au programme d'entretien, c'est-à-dire en principe l'année qui suit la construction<br />
ou le renforcement.<br />
Si les responsables de l'entretien considèrent que des mesures sont nécessaires en dehors des périodicités prévues,<br />
ils ont la possibilité d'en demander le financement dans le cadre <strong>du</strong> programme opérationnel de travaux<br />
d'entretien.<br />
Cette procé<strong>du</strong>re doit permettre d'adapter la surveillance systématique à l'évolution de l'état de la chaussée<br />
et de faire exécuter des mesures dans les deux sens sur certaines sections où le diagnostic se révèle particulièrement<br />
délicat.<br />
Les études particulières de laboratoire, sur des sections plus localisées, qui s'avéreraient nécessaires à l'issue<br />
de l'application des règles d'entretien, pourront être financées suivant le même principe.<br />
•<br />
•<br />
1.2. CAS PARTICULIER DU GERPHO<br />
Le programme <strong>du</strong> passage de cet appareil sur les itinéraires fait l'objet de dispositions particulières.<br />
En effet, si le GERPHO permet de relever avec précision les défauts présentant une certaine gravité, la saisie<br />
des premiers indices de dégradations peut s'avérer difficile, car celles-ci ne sont pas toujours très visibles et<br />
de ce fait un seul passage annuel <strong>du</strong> GERPHO ne peut remplacer l'inspection visuelle détaillée qui peut être<br />
faite au bon moment. En outre, il ne^permet pas de repérer le phénomène d'orniérage.<br />
Dans ces conditions, le passage <strong>du</strong> GERPHO n'est actuellement programmé que sur un certain nombre de<br />
sections particulières : zones sur lesquelles on veut suivre, avec précision, l'évolution des dégradations ; routes<br />
ou autoroutes très fortement circulées où les inspections visuelles détaillées sont très difficiles à réaliser ;<br />
chaussées en béton.<br />
2. INSPECTIONS VISUELLES DÉTAILLÉES<br />
La surveillance <strong>du</strong> réseau ne peut reposer uniquement sur les mesures des appareils à grand rendement; on a<br />
vu en effet que la périodicité de leur passage était relativement grande et que le relevé des dégradations à<br />
l'aide <strong>du</strong> GERPHO ne fournissait pas une vue exhaustive de l'état de la chaussée.<br />
Le relevé de l'état des dépendances ne peut, quant à lui, être effectué par aucun appareil.<br />
Une surveillance visuelle, réalisée par le personnel chargé de l'entretien <strong>du</strong> réseau, est donc indispensable.<br />
Actuellement, ce personnel procède à des « tournées de routine » qui ont pour but de détecter les incidents<br />
aléatoires qui ont pu se pro<strong>du</strong>ire sur la route et qui sont susceptibles de mettre en cause la sécurité des usagers<br />
(dégradations soudaines de la chaussée ou de ses dépendances : amorces de nids de poule, affaissements<br />
localisés, présence de pro<strong>du</strong>its caustiques ou glissants à la suite d'un accident, détérioration des panneaux de<br />
signalisation, etc.). Ces « tournées de routine » sont, en général, effectuées par un seul agent se déplaçant en<br />
voiture à vitesse modérée, souvent dans le cadre de déplacements liés à son travail ou sur son trajet domiciletravail.<br />
Mais pour pouvoir appliquer un entretien préventif, il est nécessaire de procéder à des inspections visuelles<br />
détaillées des chaussées et dépendances faisant l'objet de comptes ren<strong>du</strong>s écrits sur lesquels les dégradations<br />
sont relevées en localisation et en importance.<br />
28
2.1. PROCÉDURES DE RÉALISATION DES INSPECTIONS DÉTAILLÉES<br />
Compte tenu des moyens disponibles dans les services, les inspections visuelles détaillées ne peuvent être trop<br />
fréquentes ; il faut néanmoins en prévoir au moins une par an. La période la plus favorable semble être la fin<br />
de l'hiver, époque de l'année où l'on peut constater le maximum de dégradations (ouverture dès fissures,<br />
remontées de boues, etc.).<br />
Une deuxième inspection sur les zones les plus dégradées serait cependant souhaitable à la fin de l'été pour<br />
actualiser le relevé, juste avant la préparation des programmes d'entretien (en particulier,en ce qui concerne<br />
le fluage et l'orniérage).<br />
L'équipe d'inspection doit comprendre au moins un agent ayant une bonne connaissance des dégradations<br />
susceptibles d'être rencontrées sur le réseau.<br />
Le répertoire des dégradations doit permettre une identification de ces dégradations selon une terminologie<br />
commune à tous les services.<br />
La période la plus favorable pour bien voir les dégradations se situe après une pluie lorsque la chaussée est en<br />
cours de séchage. Il serait, bien enten<strong>du</strong>, peu réaliste de recommander de ne faire d'inspections détaillées que<br />
dans ces conditions ; il conviendra cependant d'éviter les temps de pluie ou de trop forte chaleur (les relevés<br />
à pied seraient d'ailleurs très pénibles dans de telles conditions).<br />
Il faudra également tenir compte des conditions d'éclairement ; au cours des déplacements à pied, il semble<br />
préférable de progresser en tournant le dos au soleil.<br />
La méthode à utiliser pour réaliser les inspections détaillées dépend en grande partie des moyens disponibles<br />
en personnel et en matériel et <strong>du</strong> type de route concerné (chaussée bidirectionnelle ou chaussée unique, présence<br />
ou absence d'accotements, etc..) ; il n'est donc pas possible d'indiquer un mode opératoire qui convienne<br />
dans tous les cas. A titre indicatif, on peut cependant décrire les principales méthodes qui ont été<br />
employées jusqu'à présent et qui se divisent en deux types : inspections entièrement faites à pied ou inspections<br />
faites en partie depuis un véhicule.<br />
2.1.1. Inspections détaillées entièrement faites à pied<br />
L'inspection est effectuée par au moins deux agents qui parcourent à pied l'ensemble de l'itinéraire. Pour les<br />
chaussées bidirectionnelles à deux voies, ils se placent de part et d'autre de la route, chacun relevant les<br />
dégradations de la voie située de son côté, en se déplaçant sur l'accotement.<br />
L'un des deux « inspecteurs » doit être muni d'une planchette sur laquelle sont disposées les feuilles de relevés<br />
des dégradations qu'il remplit au fur et à mesure avec ses propres constatations et celles annoncées par<br />
son coéquipier.<br />
La localisation peut se faire à partir <strong>du</strong> bornage hectométrique, s'il existe, ou à l'aide d'un cyclomètre tenu<br />
par le deuxième inspecteur ; il peut s'avérer utile de se munir d'une règle et d'un décimètre pour le relevé des<br />
ornières.<br />
Toutes les précautions doivent être prises pour assurer la sécurité des agents, en particulier dans les sections<br />
dangereuses (routes fortement circulées, accotements ré<strong>du</strong>its, etc.). Parmi les mesures à prendre, on peut<br />
citer :<br />
— le port de gilets réfléchissants,<br />
— une signalisation de chantier mobile (avec limitation de vitesse à 60 km/h et interdiction de dépasser) disposée<br />
de part et d'autre des hommes à pied, sur une section n'excédant pas 2 km,<br />
— la protection de l'inspecteur qui circule à droite de la chaussée par un véhicule équipé d'un gyrophare,<br />
roulant derrière lui à vitesse ré<strong>du</strong>ite. Ce dispositif mobilise un troisième agent pour la con<strong>du</strong>ite,<br />
mais celui-ci peut également s'occuper de la localisation des dégradations si le véhicule est équipé d'un<br />
compteur métrique.<br />
Pour les chaussées bidirectionnelles à trois voies, le relevé des dégradations sur la voie centrale est très délicat,<br />
mais généralement, la saisie des deux voies extrêmes qui sont en principe les plus dégradées sera suffisante.<br />
Pour les chaussées séparées unidirectionnelles, l'un des deux inspecteurs circule sur la bande d'arrêt ou l'accotement,<br />
protégé par le véhicule équipé <strong>du</strong> gyrophare ; l'autre inspecteur circule sur le terre-plein central. Si la<br />
chaussée comporte plus de deux voies, les dégradations des voies centrales ne pourront pas être relevées, le<br />
même problème se posera pour la voie de gauche si le terre-plein central est très ré<strong>du</strong>it.<br />
Dans tous les cas, il pourra s'avérer judicieux de profiter de la neutralisation d'une voie (pour cause de travaux,<br />
marquages horizontaux ou fauchage des accotements, par exemple) pour réaliser l'inspection détaillée.<br />
A titre indicatif, les relevés visuels effectués jusqu'à présent ont permis des rendements de 5 à 10 km de<br />
chaussée par jour.<br />
Pour les routes à 2 chaussées séparées, un relevé doit être fait pour chaque chaussée.<br />
29
2.1.2. Inspections détaillées faites en partie depuis un véhicule<br />
Cette méthode mobilise également 2 ou 3 agents. Le véhicule (équipé d'un gyrophare) roule à vitesse modérée,<br />
en utilisant en partie l'accotement si cela est possible.<br />
L'un des agents relève les dégradations sur les deux voies et les transcrit lui-même sur la feuille de compte<br />
ren<strong>du</strong> ou les dicte à un troisième ; la localisation s'effectue à l'aide <strong>du</strong> compteur <strong>du</strong> véhicule (un compteur<br />
métrique paraît souhaitable). Les dégradations peuvent être relevées en quantités ou simplement en présence.<br />
La méthode qui semble la mieux adaptée consiste à :<br />
— relever les dégradations en essayant d'évaluer sommairement les quantités sur les sections peu dégradées,<br />
— compléter par des inspections à pied (suivant la méthode <strong>du</strong> 2.1.1.) sur les sections les plus dégradées ou<br />
sur des sections sur lesquelles apparaît un doute au moment de l'application <strong>du</strong> guide technique.<br />
Cette méthode fournit des relevés de dégradations moins précis que les inspections visuelles entièrement faites<br />
à pied ; de plus, elle s'adapte mal aux chaussées à trois voies. Elle s'avère par contre plus « sécurisante »<br />
et moins fatigante pour les agents. A titre indicatif, les rendements obtenus jusqu'à présent ont été de 10 à<br />
15 km d'itinéraires par jour.<br />
2.2. ETABLISSEMENT DU COMPTE RENDU<br />
2.2.1. Relevé des dégradations<br />
Les dégradations doivent être relevées en quantités et portées sur des feuilles de compte ren<strong>du</strong> dont un modèle<br />
est fourni en fin de chapitre.<br />
Il ne s'agit, bien enten<strong>du</strong>, que d'un exemple que chacun pourra améliorer afin de l'adapter à ses besoins particuliers.<br />
2.2.2. Modèle de compte ren<strong>du</strong> d'inspection détaillée<br />
Le modèle fourni en fin de chapitre permet de relever 2 km de chaussée par feuille (échelle 1/10 000 e ).<br />
Pour chaque dégradation, deux lignes représentant les voies gauche et droite de la chaussée ont été réservées ;<br />
chacune des colonnes représente un tronçon de 50 m. Les dégradations doivent donc être quantifiées<br />
sommairement, dans l'unité indiquée en regard de chacune d'entre elles (nombre, mètre linéaire ou mètre<br />
carré), et reportées dans les cases élémentaires de 50 m.<br />
Famille des déformations<br />
1. Affaissement de rive et bourrelets.<br />
On inscrit la longueur de chaussée dégradée par tronçon de 50 m. Des précisions (affaissement seul, bourrelet<br />
seul, ou les deux ensemble, largeur de chaussée concernée, etc.) peuvent être indiquées en observation.<br />
2. Flaches<br />
On inscrit le nombre de flaches relevées sur 50 m de voie.<br />
3. Orniérage<br />
Un orniérage d'une profondeur inférieure à 15 - 20 mm est difficilement perceptible à l'œil. 11 sera donc intéressant<br />
de se munir d'une règle et d'effectuer un contrôle systématique tous les 50 m, par exemple (dans la<br />
mesure où les conditions de trafic le permettent).<br />
On indiquera, dans chaque case, la longueur de chaussée orniérée et en observation le type d'orniérage dont il<br />
s'agit (grand ou petit rayon — voir à ce sujet le Répertoire des dégradations) ainsi que sa profondeur.<br />
Familles des fissures<br />
4. Faïençage<br />
On inscrit la surface affectée par cette dégradation, par tronçon de 50 m.<br />
5. Fissures transversales de retrait<br />
On inscrit le nombre de fissures par tronçon de 50 m. Leur état (fissures courtes ou en pleine largeur, fissures<br />
fines ou épaufrées, fissures ramifiées, départs de matériaux) sera mentionné en observation.<br />
30
6. Fissures longitudinales de fatigue (dans les traces des roues des véhicules)<br />
On inscrit dans chaque case la longueur de chaussée concernée par ceite dégradation.<br />
7. Autres fissures<br />
On inscrit dans chaque case la longueur de chaussée concernée par cette dégradation. Le type de fissure (tassement,<br />
épaulement, raccordement de deux bandes d'enrobés) sera indiqué en observation.<br />
Famille des arrachements - Famille des remontées<br />
8. Nids de poule<br />
On inscrit le nombre de nids de poule par tronçon de 50 m. On indiquera en observation s'il s'agit de nids de<br />
poule en formation ou rebouchés.<br />
9. Désenrobage, plumage<br />
On indiquera par un D ou un P la dégradation dont il s'agit et la longueur de chaussée qu'elle affecte par<br />
tronçon de 50 m.<br />
10. Ressuage, glaçage<br />
On indiquera par un R ou un G la dégradation dont il s'agit, et la longueur qu'elle affecte par tronçon de<br />
50 m.<br />
11. Remontées de fines (laitance)<br />
On inscrit le nombre de remontées par tronçon de 50 m.<br />
A utres dégradations<br />
On peut indiquer ici des dégradations trop peu fréquentes pour figurer dans la liste ci-dessus : pelade,<br />
remontée d'eau, signes de perméabilité de l'enrobé (traces humides restant sur la chaussée après une pluie),<br />
usure par les pneus à crampons, etc.<br />
Comme on l'a vu précédemment, la ligne « observations » permet, pour certaines dégradations, d'en préciser<br />
l'origine et le niveau.<br />
Etat des dépendances<br />
On peut noter ici les travaux à effectuer sur les dépendances et leur localisation (accotement à déraser, fossé<br />
à curer, panneaux de signalisation à remplacer, etc.).<br />
31
RELEVÉ des DÉGRADATIONS<br />
ITINERAIRE RN Dépt. SUBDIVISION DATE de L'INSPECTION ETAT de la<br />
CHAUSSEE<br />
sèche<br />
très humide<br />
•<br />
DÉGRADATIONS<br />
SUR CHAUSSÉES<br />
UNITE<br />
structure! £jj |<br />
sécurité I m 1<br />
confort J O |<br />
TIFI<br />
z m<br />
PR: 2 4 6 8<br />
PR = 2 4 6 8<br />
PR :<br />
Déformations<br />
1. Défauts de rive<br />
Affaissements. Bourrelets<br />
2. Flaches<br />
3. Orniérage<br />
m<br />
nb<br />
m<br />
•<br />
•<br />
• •<br />
4. Faïençage<br />
m 2<br />
•<br />
Fissures<br />
5. Fissures transversales<br />
de retrait<br />
6. Fissures longitudinales dans<br />
les traces des roues<br />
nb<br />
m<br />
•<br />
•<br />
•<br />
7. Autres fissures (épaulement,<br />
joint, etc.)<br />
m<br />
8. Nids de poule<br />
nb<br />
•<br />
Arrachements<br />
Remontées<br />
9. Désenrobage, plumage<br />
10. Glaçage, ressuage<br />
m<br />
m<br />
• •<br />
•<br />
11. Remontées de fines (laitance)<br />
nb<br />
•<br />
AUTRES DEGRADATIONS<br />
OBSERVATIONS<br />
ETAT DES DEPENDANCES
ANNEXE<br />
FICHES DE RENSEIGNEMENTS<br />
SUR LES APPAREILS DE MESURE<br />
A GRAND RENDEMENT<br />
I. DÉFLECTOGRAPHE<br />
1. DÉFINITION DE LA DÉFLEXION<br />
La déflexion est le déplacement vertical, exprimé en l/lOO e mm, d'un point de la surface de la chaussée, sous<br />
une charge verticale.<br />
2. DESCRIPTION DES APPAREILS DE MESURE<br />
L'appareil qui permet de mesurer la déflexion à des cadences importantes est le déflectographe.<br />
Deux générations d'appareils ont été mis au point :<br />
2.1. Le déflectographe LACROIX LPC (déflectographe 01)<br />
Il s'agit d'un camion avec essieu arrière à roues jumelées qui supporte les éléments suivants :<br />
— une poutre de référence en forme de T, équipée de deux bras palpeurs (le traîneau),<br />
— un système de transmission de la mesure et d'enregistrement,<br />
— un lest portant la charge de l'essieu arrière à 13 tonnes.<br />
33
La mesure se déroule de la façon suivante :<br />
1) Le traîneau est déposé sur le sol sur lequel il s'appuie en trois points constituant un plan de référence fixe.<br />
2) Le camion parcourt une distance égale à un demi-tour de roue (environ 1,70 m) jusqu'à ce que les jumelages<br />
arrière viennent coiffer les palpeurs. On enregistre le déplacement vertical de l'extrémité de chaque<br />
bras palpeur à l'aide d'un capteur à in<strong>du</strong>ctance (qui transforme le déplacement vertical en un signal électrique<br />
pouvant être enregistré sur film ou sur bande magnétique).<br />
3) Le traîneau est ramené en position initiale (vers l'avant des jumelages) et le processus recommence.<br />
Deux valeurs de déflexion sont donc enregistrées (une sous chaque jumelage) ; la valeur mesurée sous le<br />
jumelage côté gauche est la déflexion en axe, et sous le jumelage côté droit, la déflexion en rive.<br />
Ce type d'appareil est utilisé pour les chaussées de faible rigidité (dites chaussées souples traditionnelles) car<br />
sa précision est insuffisante dans le domaine des petites déflexions assorties de grands rayons de courbure.<br />
2.2. Le déflectographe LACROIX LPC à châssis long (déflectographe 03)<br />
Poutre de référence en T équipée de deux bras palpeurs<br />
II résulte de diverses améliorations de l'appareil précédemment décrit. Son principe de fonctionnement est le<br />
même mais il se distingue par :<br />
— un traîneau plus long et une position inversée de la poutre en T,<br />
— un camion à châssis long (empattement d'environ 6,75 m),<br />
— un ensemble aménagé pouvant comporter salle de travail, cabine photographique et couchette.<br />
L'intérêt principal de ces modifications réside dans le fait que le plan de référence, constitué par la poutre en<br />
T, est plus éloigné des essieux. 11 subit donc une influence moins grande de la part de la déformation de la<br />
chaussée provoquée par le passage des essieux.<br />
De plus, cet appareil permet de mesurer les petites déflexions assorties de grands rayons de courbure avec<br />
une bonne précision ; il est donc adapté à la surveillance des chaussées à assises traitées aux liants hydrocarbonés<br />
ou aux liants hydrauliques.<br />
2.3. Caractéristiques des appareils<br />
Caractéristiques<br />
Vitesse d'avancement<br />
Cadences (en continu)<br />
Pas de mesure<br />
Réglage<br />
Seuil inférieur de détection<br />
Observations<br />
Déflectographe LACROIX LPC<br />
Déflectographe LACROIX LPC<br />
châssis long<br />
2 km/h<br />
4 km/h<br />
10 à 15 km/j avec 600 mesures/km<br />
20 à 30 km/j<br />
3,70 à 4,10 m<br />
3,40 m<br />
suivant l'état de la chaussée<br />
2 possibilités<br />
0 - 150/100 e mm<br />
0- 90/100 e mm<br />
0 - 300/100 e 3 possibilités<br />
mm<br />
0 - 150/100 e mm<br />
0 - 300/100 e mm<br />
5/100 e 2/100 e<br />
Les mesures sont faites en général dans une zone proche des bandes de<br />
roulement des véhicules : 0,80 et 2,50 m des bords de chaussée.<br />
34
3. EXPLOITATION DES RÉSULTATS<br />
Ces mesures peuvent être restituées sous deux formes :<br />
- le déflectogramme est un enregistrement sur film qui fournit l'ensemble des mesures sous forme d'une<br />
série de virgules dont la longueur est proportionnelle à la déflexion,<br />
- le listing restitue sur un graphique l'ensemble des points de mesure alignés par pas de 20 m.<br />
Différentes exploitations statistiques (histogrammes, moyennes, etc.) sont également possibles.<br />
Bibliographie<br />
— SIFFERT M., Les Déflectographes en France et dans les pays étrangers, Bull, liaison Labo. <strong>routier</strong>s P. et<br />
Ch., 40, sepl.-oct. 1969, p. 31-32.<br />
— A UTRET P., Utilisation <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it Rd pour l'auscultation des chaussées à couche de base traitée, Bull,<br />
liaison Labo. <strong>routier</strong>s P. et Ch., 42, déc. 1969, p. 67-80.<br />
— A UTRET P., Evolution <strong>du</strong> déflectographe Lacroix - Pourquoi ?, Bull, liaison Labo. P. et Ch., 60,juill.-<br />
août 1972, p. 11-17.<br />
— LEGER PH. et A UTRET P., Utilisation des mesures de déflexion pour le dimensionnement et la surveillance<br />
des chaussées, 3 e conférence inter<strong>national</strong>e sur le dimensionnement des chaussées souples, Londres,<br />
1972, et Bull, liaison Labo. P. et Ch., 62, nov.-déc. 1972, p. 43-57.<br />
— BRIANT G. et KOBISCH R., Déflectographe Lacroix, Visualisation des déflexions supérieures à un<br />
seuil donné, Bull, liaison Labo. P. et Ch., 67, sept.-oct. 1973, p. 19-21.<br />
35
II. ANALYSEUR DE PROFIL EN LONG<br />
1. DÉFINITION DES DÉFAUTS D'UNI<br />
Les défauts d'uni peuvent être caractérisés par leur longueur d'onde et leur amplitude ou par leur flèche verticale.<br />
Longueur d'onde<br />
Flèche<br />
Amplitude<br />
- Caractérisation des défauts d'uni.<br />
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL DE MESURE<br />
Le seul appareil utilisable en continu à des cadences élevées est l'Analyseur dynamique de Profil en Long<br />
(APL).<br />
! APL<br />
I bit race<br />
II comprend un ensemble mécanique tracté et constitué par :<br />
— un bras rigide équipé d'une roue type vélomoteur,<br />
— un châssis reposant sur le bras par un ressort et un amortisseur qui assure le contact permanent<br />
roue/chaussée,<br />
— un attelage avec cardan et dispositif de réglage en hauteur pour la liaison avec le véhicule tracteur,<br />
— un pen<strong>du</strong>le inertiel servant de référence pour mesurer par capteur les débattements angulaires <strong>du</strong> bras<br />
porte-roue tra<strong>du</strong>isant les dénivellations <strong>du</strong> profil indépendamment des mouvements <strong>du</strong> véhicule tracteur.<br />
I<br />
Cadre<br />
Bras porte-roue<br />
. Roue palpeuse<br />
- Schéma de principe d'une remorque APL<br />
36
La vitesse d'auscultation est de 72 km/h, ce qui permet une cadence de relevés de 150 à 200 km par jour.<br />
L'appareil utilisé pour la surveillance <strong>du</strong> réseau est bitrace. Il enregistre deux signaux A et B correspondant à<br />
chacune des roues (côté rive et côté axe). La valeur cumulée des énergies représentées par ces deux signaux,<br />
est comparée à une gamme de valeurs d'étalonnage. Ceci permet d'attribuer, par tronçon de 200 m, une note<br />
(ou classe) d'uni dans trois gammes de longueur d'onde.<br />
La note d'uni est comprise entre 1 et 10 :<br />
1 correspond à la moins bonne chaussée auscultée,<br />
10 correspond à la meilleure chaussée auscultée.<br />
Les valeurs obtenues sont exprimées dans les trois gammes de longueur d'onde suivantes :<br />
ondes courtes : 1 à 3,30 m<br />
ondes moyennes : 3,30 à 13 m<br />
grandes ondes : 13 à 40 m<br />
La relation entre les notes d'uni et les flèches moyennes rencontrées est donnée par le tableau suivant :<br />
Classes<br />
d'uni<br />
en<br />
tangage<br />
Grandes<br />
ondes<br />
13-40 m<br />
Flèches moyennes obtenues<br />
par étalonnage (en mm)<br />
Ondes<br />
moyennes<br />
3,3-13 m<br />
Ondes<br />
courtes<br />
1-3,3 m<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
8<br />
10<br />
12<br />
16<br />
20<br />
24 .<br />
30<br />
38<br />
48<br />
2,4<br />
3<br />
3,8<br />
4,7<br />
5,9<br />
7,4<br />
9,2<br />
11,6<br />
14,4<br />
0,8<br />
1<br />
1,2<br />
1,6<br />
2<br />
2,4<br />
3<br />
3,8<br />
4,8<br />
3. EXPLOITATION DES RESULTATS<br />
Les mesures sont restituées sous forme de listings qui donnent les notes d'uni par tronçon de 200 m dans<br />
chacune des trois gammes de longueur d'onde. Différentes exploitations statistiques (histogrammes, etc.)<br />
sont également possibles.<br />
Bibliographie :<br />
— Fiches sur les matériels des Laboratoires des Ponts et Chaussées<br />
• Analyseur de profil en long (APLJ - Remorque de mesure - n° 1 A AC 76.<br />
• Analyseur de profil en long - A PL 72 - A PL Recherche - n° 1 B AC 76.<br />
— LEGER Ph. - L'uni des revêtements <strong>routier</strong>s - Bull, liaison Labo <strong>routier</strong>s P. et Ch. - 49 - décembre 1970.<br />
— ROUQUES G. et L UCAS J. - « Méthodes modernes de surveillance <strong>du</strong> réseau <strong>routier</strong> - Supplément 512<br />
R.G.R.A. (septembre 1975), repris dans Bull, liaison Labo. P. et Ch. - 84 -juillet-août 1976.<br />
— L UCA S J. et VIA NO A. - « Mesure systématique de l'uni sur le réseau <strong>routier</strong> - A PL à grand rendement,<br />
version 1978 » Bull, liaison Labo. P. et Ch. - 101 - mai-juin 1979.<br />
37
III. APPAREIL SCRIM<br />
(Sideway force coefficient routine investigation machine)<br />
1. DÉFINITION DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT TRANSVERSAL<br />
Le paramètre, représentatif de l'adhérence, qui est relevé à grande cadence par le SCRIM est le coefficient de<br />
frottement transversal (CF.T.).<br />
V = Vitesse constante<br />
8 = Angle de pincement<br />
(ou de dérive ou d'envirage)<br />
N = Réaction transversale<br />
R - Réaction verticale<br />
II s'agit <strong>du</strong> rapport entre la force de réaction N perpendiculaire au plan de rotation de la roue et la réaction<br />
normale au sol <strong>du</strong>e à la charge sur la roue (la roue de mesure faisant un angle 8 avec le sens de déplacement <strong>du</strong><br />
véhicule).<br />
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL<br />
Vue générale <strong>du</strong> SCRIM<br />
Cet apareil est constitué par un camion supportant :<br />
— un ensemble de mesure,<br />
— un dispositif d'arrosage alimenté par une citerne.<br />
Vue de la roue de mesure<br />
L'ensemble de mesure est composé d'une roue de mesure à pneu lisse, chargée par une masse de 200 kg pouvant<br />
se déplacer verticalement indépendamment <strong>du</strong> mouvement <strong>du</strong> camion ; un ressort amortisseur permet à<br />
la roue de rester en contact avec le sol. L'angle 0 de pincement (ou de dérive ou d'envirage) est égal à 20°.<br />
La réserve d'eau est d'environ 5 000 litres.<br />
Les mesures sont effectuées en continu à 60 km/h (1), dans le flot de la circulation ; la cadence de relevé est<br />
de 150 à 200 km/jour.<br />
L'eau est répan<strong>du</strong>e devant la roue de mesure au débit constant de 0,5 1/sec. L'appareil enregistre une valeur<br />
<strong>du</strong> CF.T. tous les 20 mètres, correspondant à la moyenne de 8.mesures uniformément réparties sur chaque<br />
zone de 20 mètres. La valeur <strong>du</strong> CF.T. varie théoriquement entre 0 et 1.<br />
L'appareil donnant un très grand nombre de îésultats (5 000 à 10 000 par jour), le traitement informatique<br />
est indispensable.<br />
(1) L'appareil permet d'effectuer des mesures à 100 km/h pour l'auscultation des autoroutes.<br />
38
3. EXPLOITATION DES RÉSULTATS<br />
Les mesures sont restituées sous forme de listings qui donnent une valeur <strong>du</strong> CF.T. par tronçon de 20 m.<br />
Différentes exploitations statistiques (histogrammes, etc.) sont également possibles.<br />
Bibliographie :<br />
— Fiche sur l'appareil S.C.R.f.M. diffusée par la division Laboratoire <strong>du</strong> CE. T.E. de L YON.<br />
— ROUQUES G. et LUCAS J. - « Méthodes modernes de surveillance <strong>du</strong> réseau <strong>routier</strong> ». Supplément 512<br />
- R.G.R.A. (septembre 1975), repris dans Bull, liaison Labo. P. et Ch. - 84 -juillet-août 1976.<br />
— Mesure <strong>du</strong> coefficient de frottement transversal d'un revêtement avec l'appareil SCRIM - Projet de<br />
mode opératoire LCPC -juillet 1978.<br />
39
IV. GERPHO<br />
(Groupe d'examen <strong>routier</strong> par photographie)<br />
1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL<br />
rt<br />
Avance <strong>du</strong> film<br />
2OO<br />
- Schéma de principe de l'appareil.<br />
-* Défilement de I» chaussé<br />
[.'appareil à grand rendement permettant le relevé en continu des dégradations est le GERPHO (Groupe<br />
d'examen <strong>routier</strong> par photographie). Il est constitué des éléments suivants :<br />
— un véhicule porteur (fourgonnette) muni d'un support mécanique de caméra,<br />
- une caméra 35 mm à défilement continu équipée d'un objectif de focale 14,5 mm,<br />
— un dispositif d'asservissement de l'avance <strong>du</strong> film à la vitesse <strong>du</strong> véhicule,<br />
- une source lumineuse d'éclairage de la chaussée (5 projecteurs de 1 000 W chacun) et un dispositif<br />
d'asservissement de cet éclairage à la vitesse <strong>du</strong> véhicule,<br />
— un pupitre de commande et de signalisation,<br />
— un groupe électrogène de 10 kilovolt ampères<br />
Dislance focale 14,5 r<br />
utile <strong>du</strong> film 23 r<br />
Plan film<br />
Hauteur utile 2.90 r<br />
Signalisation horizontale -pv<br />
Surface de la chaussée<br />
Signalisation horizontale<br />
, i,7>, " , • , f> '/,,, j<br />
•• s////////////A//////////////////////A//////////<br />
Largeur de chaussée filmée 4,60 m<br />
Caractéristiques géométriques de la prise de<br />
II permet de photographier en continu la chaussée sur une largeur de 4,60 m (film à l'échelle 1/200), soit une<br />
voie de circulation plus une partie de la voie adjacente et de l'accotement (une bobine de film de 120 m permet<br />
de phtoographier 24 km de voies). Le relevé de la totalité d'une chaussée bidirectionnelle à deux voies<br />
nécessité donc un passage dans chaque sens.<br />
Les photographies se font de nuit ; le rendement est de 200 km de voie par nuit sur un itinéraire continu<br />
(<strong>du</strong>rée de travail effectif : 4 à 8 heures), le véhicule roulant en moyenne à 50 km/h.<br />
40
2. EXPLOITATION DES RÉSULTATS<br />
L'exploitation est réalisée par un procédé semi-manuel au moyen d'une table de visualisation qui permet<br />
l'observation simultanée des deux voies de circulation à l'agrandissement 4 (échelle 1/50).<br />
• • -•-• • •-•-• • •-•
Page laissée blanche intentionnellement
Ce document est propriété de l'Administration et ne peut être repro<strong>du</strong>it,<br />
même partiellement, sans l'autorisation <strong>du</strong> Directeur <strong>du</strong> Laboratoire Central<br />
des Ponts et Chaussées ou <strong>du</strong> Directeur <strong>du</strong> Service d'Etudes Techniques des<br />
Routes et Autoroutes (ou de leurs représentants autorisés).<br />
© SETRA - LCPC - 1979
Page laissée blanche intentionnellement
Page laissée blanche intentionnellement
D7905