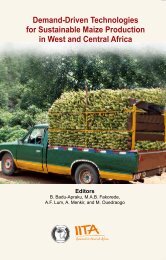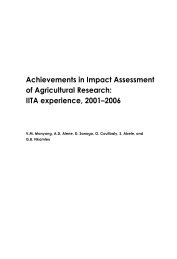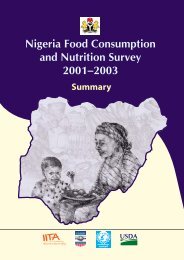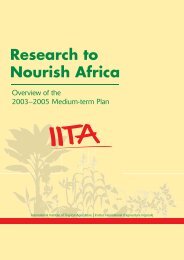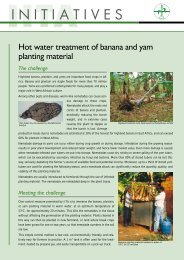WASNET 10 french now.indd - IITA
WASNET 10 french now.indd - IITA
WASNET 10 french now.indd - IITA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Bulletin du réseau sur les semences en Afrique occidentale (<strong>WASNET</strong>)<br />
CORAF / WECARD<br />
Secretariat: PO Box 9698, K.I.A. Accra, Ghana<br />
No. <strong>10</strong>, décembre 2002 ISSN 1595–2312<br />
Voici le dixième numéro du bulletin du Réseau ouestafricain<br />
des semences et plants (<strong>WASNET</strong>). Ce réseau<br />
se penche sur les besoins et préoccupations des pays<br />
ouest-africains en matière de semences et plants et rassemble<br />
en une structure des acteurs publics et privés de la région,<br />
dans le but de les encourager à œuvrer ensemble au renforcement<br />
du développement national et régional de l’industrie<br />
semencière.<br />
Ce bulletin n’est pas seulement un outil pour communiquer<br />
les dernières nouveautés de <strong>WASNET</strong> au personnel chargé des<br />
semences et plants en Afrique de l’Ouest et au-delà. Il a également<br />
pour but d’informer les lecteurs de ce qui se passe dans<br />
le secteur semencier et dans d’autres réseaux ou associations<br />
connexes dans le monde. Mieux encore, il peut être considéré<br />
comme un forum de discussion où lecteurs et contributeurs<br />
d’articles peuvent et sont encouragés à poser des questions et<br />
à y répondre.<br />
Depuis avril 2002, le Réseau <strong>WASNET</strong> est coordonné et<br />
géré par l’Institut international d’agriculture tropicale (<strong>IITA</strong>).<br />
Il est financé par le Ministère allemand de la coopération<br />
économique et du développement (BMZ) à travers la coopération<br />
technique allemande (GTZ). Afin de faciliter le contact<br />
entre le réseau et la cellule ouest-africaine de développement<br />
des semences (WASDU), le réseau installa son bureau de<br />
coordination au sein du Council for Scientific and Industrial<br />
Research–CSIR (Conseil pour la recherche scientifique et<br />
industrielle) à Accra (Ghana). Un fait marquant dans la vie<br />
du <strong>WASNET</strong> est sa reconnaissance comme l’un des réseaux<br />
opérant sous la tutelle de la Conférence des responsables de<br />
la recherche agronomique africains (CORAF).<br />
Il est également très encourageant de noter qu’une procédure<br />
ouverte et transparente a permis à l’Institut international<br />
d’agriculture tropicale de recruter officiellement pour le réseau<br />
un coordonnateur permanent dont les fonctions englobent :<br />
• la mise en place d’un secrétariat ;<br />
• la liaison avec les représentants nationaux du réseau, les<br />
chercheurs nationaux et internationaux, le personnel<br />
(public et privé) chargé des semences dans chaque pays,<br />
les organismes semenciers et para-semenciers, nationaux<br />
et internationaux ;<br />
• la coordination des activités avec d’autres réseaux opérant<br />
en Afrique et dans des projets connexes ;<br />
• l’établissement d’alliances stratégiques avec les donateurs,<br />
les organismes et instituts de recherche travaillant sur les<br />
mêmes thèmes ;<br />
• le renforcement de la complémentarité et de la synergie<br />
entre et à l’intérieur des pays membres ;<br />
• l’élaboration d’un plan et d’un programme de travail pour<br />
le réseau ;<br />
• la mise au point d’un système de suivi et d’évaluation des<br />
activités du réseau ;<br />
• l’identification et la définition de programmes de formation<br />
pour les pays membres ;<br />
• l’organisation des réunions du réseau (Assemblée générale,<br />
Comité directeur)<br />
• la centralisation et la diffusion, à tous les pays membres,<br />
d’informations courantes sur les semences et plants par<br />
rapport aux technologies, à la production, l’approvisionnement,<br />
les stocks tampons, les besoins, etc. ;<br />
• l’assistance aux pays membres dans l’exécution des tâches<br />
qui leurs sont assignées ;<br />
• l’assistance aux pays membres dans la mise en œuvre des<br />
activités confiées aux représentants nationaux ;<br />
• l’assistance aux pays membres quant à leur participation<br />
aux activités internationales liées aux semences et<br />
plants ;<br />
• la préparation d’une proposition de projet pour la poursuite<br />
du réseau et une recherche active de sources de<br />
financement ;<br />
Sommaire<br />
Protection des obtentions végétales en Afrique .....................................................................................................2<br />
Les systèmes semenciers nationaux .....................................................................................................................15<br />
Autres contributions...........................................................................................................................................28<br />
Stages, rencontres, publications ..........................................................................................................................34<br />
1
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
• la préparation de propositions de projets pour des activités<br />
spécifiques du réseau et la mobilisation de fonds ;<br />
• la compilation, l’édition et la publication/distribution<br />
du bulletin officiel du réseau (2 numéros par an) ;<br />
• la compilation, l’édition et la publication de<br />
documents préparés par les pays membres en<br />
collaboration avec la cellule ouest-africaine<br />
de développement des semences ;<br />
• l’élaboration, la publication et la traduction des<br />
publications relatives à la technologie des<br />
semences et plants.<br />
Le poste d’Assistant de recherche et de Coordonnateur du<br />
Réseau ouest-africain des semences et plants (<strong>WASNET</strong>)<br />
basé à Accra (Ghana) a été offert par l’Institut international<br />
d’Agriculture tropicale (<strong>IITA</strong>) à M. Norbert G. Maroya qui<br />
entra en fonction le 1 er mai 2002. Il est responsable devant le<br />
Coordonnateur du Projet semencier et à travers lui, devant le<br />
Directeur de la Recherche et développement (R&D).<br />
M. Maroya est détenteur d’un diplôme en Agronomie générale<br />
et d’un diplôme d’ingénieur agronome de la Faculté des<br />
Sciences Agronomiques (FSA), de l’Université Nationale<br />
du Bénin (UNB), en République du Bénin. Au cours des<br />
vingt derniers mois (août 2000 à avril 2002), M. Maroya fut<br />
employé par l’Agence allemande de coopération technique<br />
(GTZ) en qualité de spécialiste du matériel de plantation des<br />
plantes à racines et tubercules au Projet <strong>IITA</strong>/GTZ/CSIR<br />
(Promotion, production et commercialisation des semences<br />
en Afrique de l’Ouest), basé au CRI (Crops Research Institute)<br />
à Kumasi (Ghana). Précédemment à ce poste, il fut chercheur<br />
et responsable du Programme de recherche sur le manioc à<br />
l’Institut des recherches agricoles du Bénin (INRAB), de<br />
septembre 1985 à juillet 2000. Pendant cette période, de mai<br />
1993 à décembre 1997. Monsieur Maroya fut Coordonnateur<br />
national du Projet ESCaPP <strong>IITA</strong>/CIAT/FIDA. De nationalité<br />
béninoise, il est marié à Cathérine et possède deux fils et deux<br />
filles, Kenneth, Gwladys, Ange-Joel et Merveille.<br />
Le dernier numéro du bulletin s’est penché sur le secteur semencier<br />
privé en Afrique. Le présent numéro met plutôt l’accent<br />
sur la protection des obtentions végétales. Dans cette optique,<br />
il présente l’Accord révisé de Bangui et aborde la protection<br />
des obtentions végétales en vertu de la Convention UPOV<br />
révisée. Des systèmes semenciers nationaux (Cameroun, Sierra<br />
Leone et Cote d’Ivoire) y sont présentés. Une communication<br />
y est faite par la Fédération internationale du commerce des<br />
semences (FIS). On y trouve aussi d’autres contributions<br />
relatives aux semences et plants.<br />
Protection des obtentions végétales en Afrique<br />
Protection des obtentions végétales en Afrique:<br />
opportunités et perspectives<br />
W.R. Gazaro<br />
Introduction<br />
Les pressions combinées de la pauvreté, de la croissance démographique<br />
et de la dégradation de l’environnement constituent<br />
d’importants obstacles pour l’agriculture et le développement<br />
humain, surtout dans les pays en développement.<br />
Aujourd’hui, plus de 800 millions de personnes sont chroniquement<br />
sous-alimentées dans le monde et les prévisions<br />
montrent que d’ici 2020, il y aura 2 milliards de personnes<br />
de plus à nourrir. Il est donc clair qu’un défi réel devrait être<br />
relevé pour faire face aux problèmes de la sécurité alimentaire<br />
et de la durabilité. Etant donné que les possibilités d’accroître la<br />
surface cultivée sont limitées, notre sécurité alimentaire dépendra<br />
à l’avenir d’un ensemble de politiques de production et de<br />
distribution soigneusement élaborées, auxquelles viendront<br />
s’ajouter des stratégies scientifiques qui allieront les agriculteurs<br />
aux laboratoires de recherche pour maximiser l’amélioration du<br />
germoplasme et les systèmes d’exploitation agricole.<br />
Jusqu’à récemment, la recherche agricole a été en grande<br />
partie financée par des investissements publics, et ses résultats<br />
ont été mis gratuitement à la disposition de la population.<br />
Mais aujourd’hui, et particulièrement en Afrique,<br />
la recherche agricole du secteur public est confrontée à<br />
une crise grave. De nombreuses institutions nationales de<br />
recherche agricole manquent d’argent pour acheter des équipements<br />
ou payer les salaires. De ce fait, les crédits à affecter<br />
à la recherche agricole sont réduits à un moment où leur<br />
importance pour le développement économique demeure<br />
critique. Cette baisse de financement conduit à une baisse<br />
de productivité agricole alors que les besoins des populations<br />
se font de plus en plus pressants. Un cercle vicieux s’installe.<br />
Quelle stratégie adopter et dans quel contexte?<br />
Contexte général<br />
A l’aube du nouveau millénaire, la mondialisation et la privatisation<br />
sont parmi les tendances les plus évidentes et les<br />
plus fondamentales qui affectent les débats sur la propriété, la<br />
conservation et l’échange de matériels biologiques.<br />
L’article 27.3(b) de l’Accord sur les aspects des droits de propriété<br />
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les<br />
2
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
ADPIC) fait obligation aux Etats membres de l’Organisation<br />
Mondiale du Commerce (OMC) de protéger les obtentions<br />
végétales par des brevets, par un système sui generis efficace<br />
ou par une combinaison de ces deux moyens.<br />
L’obligation de protéger les droits des obtenteurs de nouvelles<br />
variétés inscrites dans l’Accord sur les ADPIC s’applique<br />
déjà aux pays développés membres de l’OMC et est entré en<br />
vigueur pour les pays en développement depuis le 1 er Janvier<br />
2000 notamment le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon<br />
et le Sénégal. Pour les pays les moins avancés, cette échéance<br />
est fixée en 2006.<br />
L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle étant<br />
l’Office national de chacun des etats membres, il était donc<br />
normal, d’encourager lesdits etats à procéder à la révision de<br />
l’Accord de Bangui afin de disposer d’une législation conforme<br />
à leurs engagements internationaux.<br />
Ainsi dans le cadre de cette révision, l’OAPI consacre à l’Accord<br />
de Bangui révisé, une annexe toute entière intitulée « de<br />
la protection des obtentions végétales ».<br />
Le souci majeur de l’Organisation est d’instaurer un système<br />
de protection efficace des obtentions végétales conforme à<br />
l’Acte de 1991 de la Convention de l’UPOV.<br />
En effet, l’OAPI est convaincue que la protection des obtentions<br />
végétales est un outil puissant pour l’amélioration du<br />
secteur semencier et partant pour le développement agricole<br />
de ses etats membres.<br />
Intérêt de la création des nouvelles<br />
variétés<br />
On peut se poser la question de savoir ce que vient faire le<br />
système de protection dans l’agriculture.<br />
Aujourd’hui, le secteur de l’agriculture a besoin de relever<br />
beaucoup de défis face aux difficultés du moment.<br />
En effet, la croissance démographique de plus en plus élevée<br />
et la multiplication des crises à travers le monde, y compris<br />
les calamités naturelles poussent les agriculteurs à créer de<br />
nouvelles variétés à haut rendement et plus résistantes afin de<br />
lutter contre les déficits alimentaires importants engendrés<br />
par ces problèmes.<br />
Les problèmes environnementaux de plus en plus pressants<br />
poussent la recherche agronomique à créer et à mettre en place<br />
des espèces sélectionnées destinées aux activités de reboisement<br />
et de régénération des forêts.<br />
La création de nouvelles variétés végétales a pour avantage de<br />
réduire les charges, de libérer du temps et enfin de mettre à la<br />
disposition de la société en général et des agriculteurs en particulier,<br />
des semences de qualité supérieure. Tout ceci ayant pour<br />
conséquence, l’amélioration de niveau de vie en général.<br />
Nous pouvons prendre comme exemple, les variétés améliorées<br />
de café, et cacao qui ont permis aux agriculteurs africains<br />
de produire davantage et à moindre coût et d’être capables de<br />
vendre leurs récoltes sur le marché international.<br />
Les variétés améliorées sont un élément indispensable et très<br />
avantageux pour toute politique d’amélioration quantitative<br />
et qualitative de la production alimentaire et de la production<br />
d’énergie renouvelable et de matières premières. L’amélioration<br />
des plantes exige cependant, un investissement important<br />
de matière grise, de travail, de moyens matériels et financiers<br />
et naturellement de temps.<br />
La propriété intellectuelle intervient dans l’agriculture pour<br />
stimuler et favoriser l’activité créatrice des variétés végétales<br />
et répondre ainsi aux besoins de la société. C’est pourquoi<br />
la possibilité pour l’obtenteur de nouvelles variétés d’obtenir<br />
certains droits exclusifs sur toute variété intéressante, améliore<br />
ainsi ses chances d’obtenir un retour sur investissement et de<br />
réunir les fonds nécessaires à la poursuite d’autres activités de<br />
sélection.<br />
En l’absence d’une protection adéquate par la propriété<br />
industrielle, l’amélioration des plantes n’attire pas les investissements<br />
privés et en l’absence de l’amélioration des plantes,<br />
le paysan africain devra se contenter des variétés traditionnelles<br />
non productives.<br />
Annexe X de l’Accord de Bangui révisé<br />
Les Etats membres de l’Organisation africaine de la propriété<br />
intellectuelle (OAPI) ont adopté et signé le 24 février 1999 un<br />
nouvel Accord de Bangui modifiant leur système supranational<br />
de propriété intellectuelle et établissant en particulier, en<br />
son annexe X, un régime de protection des variétés végétales.<br />
Je suis heureuse de vous annoncer que cet Accord a été déjà<br />
ratifié et vient d’entrer en vigueur le 28 février 2002.<br />
L’annexe X de l’Accord de Bangui révisé protège les nouvelles<br />
variétés végétales, non seulement pour sauvegarder les intérêts<br />
des obtenteurs, mais également pour favoriser le développement<br />
de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture, et<br />
ce, pour le bien de la société dans son ensemble.<br />
La protection déploie ses effets dans plusieurs domaines ; le<br />
point commun est que les variétés améliorées sont un élément<br />
indispensable et très avantageux des politiques d’amélioration<br />
quantitative et qualitative de la production alimentaire, de la<br />
production d’énergie renouvelable et des matières premières.<br />
A cet effet, la protection des obtentions végétales régie par<br />
l’Annexe X vise à :<br />
• promouvoir des investissements dans l’amélioration des<br />
plantes<br />
• développer des variétés adaptées aux conditions particulières<br />
des pays<br />
• renforcer la sécurité alimentaire par l’augmentation<br />
de la quantité, la qualité et la diversité des denrées<br />
alimentaires<br />
• utiliser des variétés résistantes aux maladies et parasites<br />
• proteger l’environnement et la biodiversité par la réduction<br />
des pressions sur les écosystèmes naturels consécutive<br />
à une meilleure productivité des terres cultivées, par<br />
l’augmentation des espèces et des variétés cultivées<br />
• attirer des variétés étrangères<br />
3
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
• développer la production et le commerce des semences<br />
et plants<br />
• faciliter le transfert de technologie et du savoir-faire en<br />
la matière<br />
• bénéficier des semences de qualité à haut<br />
• faciliter l’exportation d’un produit de la récolte et du<br />
produit final<br />
• Améliorer le niveau de vie et la qualité de vie des paysans<br />
africains<br />
Tout en poursuivant les objectifs ci-dessus, l’annexe X<br />
de l’Accord de Bangui révisé comporte des caractéristiques<br />
propres.<br />
Caractéristiques de l’annexe X de<br />
l’accord de Bangui révisé<br />
1. Le titre de protection des variétés végétales est le certificat<br />
d’obtention végétale et non le brevet comme dans certaines<br />
législations. C’est pourquoi l’annexe X dispose en son article<br />
2 que :« l’obtention d’une variété végétale nouvelle donne à<br />
l’obtenteur le droit à un titre de protection appelé certificat<br />
d’obtention végétale ». Le certificat d’obtention végétale<br />
confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter et le droit<br />
d’interdire à toute personne d’exploiter sans son consentement<br />
la variété faisant l’objet du certificat, sous les conditions et<br />
dans les limites fixées par l’annexe X.<br />
2. les espèces sauvages, c’est-à-dire qui n’ont pas été plantées<br />
ou améliorées par l’homme, ne peuvent pas être protégées<br />
(article 3).<br />
3. Les variétés qui ne seront plus nouvelles à la date d’entrée en<br />
vigueur de l’annexe X ne peuvent pas être protégées, excepté<br />
lorsque la demande:<br />
• est déposée dans l’année qui suit la date d’entrée en<br />
vigueur de l’annexe X ; et la variété<br />
• a été inscrite au catalogue national des variétés<br />
• a fait l’objet d’un certificat d’obtention végétale ailleurs<br />
• a fait l’objet de pièce établissant à la satisfaction de<br />
l’Organisation la date à laquelle la variété a cessé d’être<br />
nouvelle<br />
4. Pour bénéficier de la protection, la variété doit être nouvelle,<br />
distincte, homogène et stable.<br />
5. les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne<br />
s’étendent pas :<br />
• aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non<br />
commerciales ;<br />
• aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche ;<br />
• aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles<br />
variétés ;<br />
• à l’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation,<br />
à des fins de reproduction ou de multiplication, du produit<br />
de la récolte qu’il a obtenu par la mise en culture, sur sa<br />
propre exploitation, d’une variété protégée, à l’exception<br />
des plantes fruitières, forestières et ornementales ;<br />
• aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le<br />
dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale.<br />
6. Les doits conférés par le certificat d’obtention végétale sont<br />
indépendants des mesures adoptés par les Etats membres en<br />
vue de réglementer sur leur territoire, le contrôle et la commercialisation<br />
du matériel des variétés, ou l’importation et<br />
l’exportation de ce matériel.<br />
7. La durée de protection est de 25 ans à compter de la délivrance<br />
du certificat d’obtention végétale.<br />
8. Le Gouvernement d’un Etat peut décider que la variété<br />
sera exploitée sans le consentement du titulaire du certificat<br />
d’obtention végétale par un service de l’Etat ou par un tiers<br />
désigné par le Gouvernement lorsque :<br />
• l’intérêt public en particulier, l’approvisionnement de<br />
l’Etat membre en denrées alimentaires ou la santé publique<br />
l’exige ; ou<br />
• un organe judiciaire ou administratif a jugé que la manière<br />
dont le titulaire d’obtention végétale ou son preneur de<br />
licence exploite la variété est anticoncurrentielle, et que<br />
le Gouvernement est convaincu que l’exploitation de la<br />
variété en application de cette disposition permettra de<br />
remédier à cette pratique<br />
En conclusion, le législateur de Bangui a tenu à bien<br />
délimiter les variétés végétales pouvant faire l’objet de<br />
protection par certificat. Hors mis ces cas, les espèces<br />
sauvage ainsi que les variétés anciennes relèvent du domaine<br />
public. Elles appartiennent aux communautés nationales,<br />
régionales ou locales. Leur protection, exploitation et<br />
promotion sont réglementées par des textes autre que<br />
l’Accord de Bangui.<br />
Ces textes sont pris par l’autorité nationale compétente et sont<br />
complétés le cas échéant par d’autres conventions internationales.<br />
L’Accord de Bangui ne porte aucunement préjudice à<br />
l’existence d’autres textes qui devraient régir les espèces et les<br />
variétés qu’elle ne régit pas.<br />
Opportunités et perspectives pour les<br />
pays africains<br />
Chaque pays qui adopte et met en œuvre le système de la<br />
protection des variétés peut être assuré d’un développement<br />
important de son industrie semencière, de la recherche à la<br />
production. Cela donne alors à l’agriculture une bien meilleure<br />
chance de rester compétitive. La Protection des Obtentions<br />
Végétales devrait permettre un développement important des<br />
activités d’obtenteur et de vendeur de semences.<br />
Les différentes statistiques agricoles disponibles dans de nombreux<br />
pays depuis le début du siècle, permettent de porter<br />
un regard avec une certaine acuité, sur l’évolution de la production<br />
et le rendement de la plupart des espèces cultivées<br />
majeures. L’ensemble de ces données montre<br />
• une relative stabilité du rendement entre les années 1900<br />
et 1930<br />
• un accroissement régulier de la productivité de 1930 à<br />
1960<br />
• une augmentation encore plus rapide dans les années<br />
1960 à 1990<br />
4
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Les experts agronomes sont tous d’accord que ces gains de<br />
productivité sont liés à l’amélioration des plantes et au changement<br />
des techniques culturales.<br />
Différents modèles ont tenté de faire la part entre le facteur<br />
génétique et le facteur agronomique et ceux-ci aboutissent<br />
généralement à un gain de productivité dû à l’amélioration<br />
des plantes entre 40 et 50% du gain total.<br />
Il est important de signaler que depuis 1960, l’efficacité de<br />
l’amélioration des plantes et donc du secteur de l’industrie<br />
semencière s’est considérablement accrue et a contribué<br />
largement au développement de la production agricole, tout<br />
particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. Les<br />
droits des obtenteurs ont un impact réel sur l’amélioration<br />
des plantes et sur l’industrie semencière.<br />
En mettant en place la protection, les etats membres de<br />
l’OAPI se doivent de sauvegarder les intérêts des obtenteurs<br />
qu’ils soient du secteur public ou privé et de garantir ainsi<br />
l’approvisionnement des semences de qualité supérieure aux<br />
agriculteurs.<br />
Il deviendra ainsi possible de mettre en place dans les pays<br />
signataires de l’Accord de Bangui, des systèmes de collecte des<br />
droits de licence pour les semences de variétés protégées, ceci<br />
pour tous les opérateurs de la filière.<br />
En effet, tout producteur de semences se doit de rémunérer<br />
l’obtenteur de la variété et ces droits de licence constituent<br />
un élément du prix de la semence. Cette collecte des<br />
droits de licence peut générer des montants importants<br />
à redistribuer aux obtenteurs, ce qui leur permettra de<br />
maintenir un effort de recherche très significatif. Cet effort<br />
de recherche représentera naturellement une force particulièrement<br />
innovante dans le développement de l’agriculture<br />
en Afrique.<br />
L’existence d’une protection assure un progrès permanent des<br />
obtentions par rapport aux variétés existantes. Tout obtenteur a<br />
le droit d’utiliser une variété comme source initiale de variation<br />
ou ressource génétique, ceci dans le but d’obtenir de nouvelles<br />
variétés et de les commercialiser. Cette possibilité connue sous<br />
le nom d’exemption de recherche, rend possible pour chaque<br />
obtenteur d’utiliser dans son schéma de sélection de toute<br />
autre variété nouvelle, ce qui garantit un plus large progrès<br />
pour l’ensemble des améliorateurs. Cette exemption pour la<br />
recherche veut également dire qu’il n’y a aucun obstacle à ce<br />
que les variétés protégées enrichissent les banques de gènes,<br />
garantissant ainsi la conservation du patrimoine génétique.<br />
Comme évoqué plus haut, la protection des obtentions végétales<br />
a un impact certain sur l’industrie semencière pouvant<br />
déboucher sur un développement des marchés nationaux<br />
et internationaux. L’accroissement de la demande pour les<br />
semences grâce à la protection est un facteur favorisant<br />
l’industrialisation des structures de production notamment<br />
l’agro-industrie, la pharmacie, et la création d’emplois. Les<br />
pays membres de l’OAPI peuvent être assurés d’un développement<br />
important de son industrie semencière, de la recherche<br />
à la production. Cela pourra donner alors à l’agriculture une<br />
bien meilleure chance de rester compétitive avec un accès<br />
particulier sur les marchés nationaux et internationaux.<br />
Les paysans africains pourront évoluer progressivement d’une<br />
agriculture de subsistance à une agriculture moderne améliorant<br />
ainsi le niveau de vie dans les campagnes. L’ Accord de<br />
Bangui offre des perspectives nouvelles pour notre continent<br />
qui pourra profiter des transferts de technologies avec pour<br />
objectif de sortir le paysan de la misère et du statu quo.<br />
Mme Regine Were Gazaro, Ingenieur Examinateur des brevet de l’Organisation<br />
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), BP 887 Yaoundé, Cameroun.<br />
Tel :.(+237)-2202990 Fax : (+237)-2201844. E-mail:regine.gazaro@oapi.wipo.net<br />
Protection des obtentions végétales en vertu de la<br />
convention UPOV<br />
M.P. Th. Senghor<br />
Introduction<br />
1. Le présent document est un guide sous forme de questionsréponses<br />
destiné à donner aux lecteurs des connaissances de base<br />
sur la notion de protection des obtentions végétales et à montrer<br />
les enjeux économiques et juridiques qui en découlent.<br />
Qu’est-ce que la protection des obtentions<br />
végétales ?<br />
2. La protection des obtentions végétales, également appelée<br />
“droit d’obtenteur”, est un droit d’exploitation exclusif accordé à<br />
l’obtenteur d’une nouvelle variété végétale. Il s’agit d’une forme de<br />
droit de propriété intellectuelle, au même titre que les brevets, le<br />
droit d’auteur, les marques et les dessins ou modèles industriels.<br />
3. La protection des obtentions végétales offre certaines<br />
similitudes avec les brevets d’invention industrielle. Ces<br />
deux formes de protection confèrent à leurs titulaires une<br />
certaine forme de droit exclusif qui constitue une incitation<br />
à l’innovation.<br />
4. On peut aussi comparer la protection des obtentions végétales<br />
avec le droit d’auteur, puisqu’elle permet au propriétaire<br />
de la variété protégée d’en limiter la reproduction (copie).<br />
5. Le droit d’obtenteur est une forme de protection sui generis<br />
indépendante, adaptée à l’objet de la protection des obtentions<br />
végétales, qui présente avec d’autres droits de propriété<br />
intellectuelle certaines similitudes mais aussi des différences<br />
fondamentales.<br />
5
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Pourquoi protéger les obtentions végétales ?<br />
6. Les nouvelles variétés végétales qui offrent un meilleur<br />
rendement ou présentent une résistance aux parasites ou aux<br />
maladies ou encore une meilleure adaptabilité au système de<br />
production sont un facteur essentiel d’accroissement de la<br />
productivité et de la qualité des produits dans l’exploitation<br />
agricole, horticole et sylvicole.<br />
7. La création de nouvelles variétés exige un investissement<br />
important en savoir, en travail, en moyens matériels et en<br />
argent et peut prendre de nombreuses années (de <strong>10</strong> à 15 ans<br />
pour de nombreuses espèces végétales). Une fois mise sur le<br />
marché, une nouvelle variété peut souvent être reproduite par<br />
d’autres sans difficultés, privant ainsi l’obtenteur de la possibilité<br />
de tirer un profit légitime de son investissement.<br />
8. Conférer à l’obtenteur d’une nouvelle variété le droit<br />
exclusif d’exploiter cette variété non seulement l’encourage à<br />
investir dans l’amélioration des plantes, mais contribue également<br />
au développement de l’agriculture, de l’horticulture<br />
et de la sylviculture.<br />
Qu’est-ce que l’UPOV ?<br />
9. L’Union internationale pour la protection des obtentions<br />
végétales est une organisation intergouvernementale qui a son<br />
siège à Genève et dont le sigle, UPOV, est dérivé de sa dénomination<br />
en français.<br />
<strong>10</strong>. L’UPOV a été créée par la Convention internationale pour<br />
la protection des obtentions végétales, signée à Paris en 1961<br />
et entrée en vigueur en 1968. La Convention a été révisée à<br />
Genève en 1972, 1978 et 1991. Les parties à la Convention<br />
(“les membres”) se sont engagées à octroyer des droits d’obtenteur<br />
pour protéger les obtentions végétales conformément<br />
aux principes établis par la Convention et donc de manière<br />
harmonisée au niveau international.<br />
11. En mars 1991, une conférence diplomatique s’est tenue<br />
à Genève et s’est soldée par l’adoption à l’unanimité par les<br />
membres de l’UPOV du nouvel Acte de 1991 de la Convention<br />
UPOV (ci-après dénommé “Acte de 1991”). Le nouvel<br />
Acte de 1991 ne devait entrer en vigueur que lorsque cinq États<br />
l’auraient ratifié ou y auraient adhéré. Il est entré en vigueur le<br />
24 avril 1998. L’Acte de 1991 ne lie que les états qui ont choisi<br />
d’y adhérer. Les membres actuels ne deviendront liés par lui que<br />
lorsqu’ils auront modifié leur législation et déposé un instrument<br />
de ratification ou d’adhésion au nouvel acte.<br />
Pays ou organisations qui ont initié le processus<br />
d’adhésion à l’Union avec le Conseil de l’UPOV<br />
Azerbaïdjan, Biélorussie, Costa Rica, Égypte, Géorgie, Honduras,<br />
Inde, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Ex-République<br />
yougoslave de Macédoine, Maroc, Nicaragua, Tadjikistan,<br />
Tunisie, Venezuela, Yougoslavie, Zimbabwe, Union Européenne,<br />
Organisation africaine de la propriété intellectuelle<br />
(République du Bénin, Burkina Faso, République du Cameroun,<br />
République Centrafricaine, République du Tchad,<br />
République du Congo, République de la Côte d’Ivoire,<br />
Guinée Équatoriale, République Gabonaise, République de<br />
Guinée, République de Guinée-Bissau, République du Mali,<br />
République Islamique de Mauritanie, République du Niger,<br />
République du Sénégal, République Togolaise (16).<br />
Autres États qui ont eu des contacts avec l’Union en<br />
vue de développer des législations conformes à la<br />
Convention UPOV (40)<br />
Albanie, Algérie, Arménie, Bahrayn, Barbades, Burundi,<br />
Cuba, Chypre, Djibouti, Dominique, République Dominicaine,<br />
Salvador, Fiji, Ghana, Grèce, Guatemala, Islande,<br />
Indonésie, Jamaïque, Madagascar, Malawi, Malaysia, Ile<br />
Maurice, Oman, Pakistan, Pérou, Philippines, Arabie Saoudite,<br />
Seychelles, Sri Lanka, Suriname, Tanzanie, Thaïlande,<br />
Tonga, Turquie, Turkménistan, Ouzbékistan, Viet Nam,<br />
Yougoslavie, Zambie<br />
12. Au 20 février 2002, l’UPOV comptait 50 membres. La<br />
date de leur admission est indiquée dans le tableau 1. La<br />
liste des états qui ont adopté une législation sur la protection<br />
des obtentions végétales mais qui ne sont pas encore<br />
membres de l’UPOV et des États qui sont en train d’élaborer<br />
une législation sur la protection des obtentions végétales est<br />
c-dessous.<br />
L’Allemagne, le Danemark, les États Unis d’Amérique, Israël,<br />
le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède ont ratifié le<br />
nouvel acte tandis que l’Australie, la Bulgarie, la Fédération de<br />
Russie, l’Estonie, le Kirghizistan, la République de Moldova, la<br />
Slovénie, la Finlande et la Roumanie, y ont adhéré. Les autres<br />
membres de l’UPOV sont liés par l’Acte de 1978, à l’exception<br />
de la Belgique et de l’Espagne qui sont toujours liées par<br />
l’Acte de 1961/72. Cependant, l’Afrique du Sud, le Bélarus, la<br />
Croatie, la Géorgie, l’Irlande, l’Italie, le Kazakhstan, le Maroc,<br />
la Pologne, la République de Corée, la Slovaquie et le Tadjikistan<br />
ont adopté des législations conformes à l’Acte de 1991 et<br />
devraient adhérer à l’Acte de 1991 en temps voulu.<br />
13. La Communauté européenne a adopté un règlement qui prévoit,<br />
pour une demande unique, l’octroi d’un droit d’obtenteur<br />
valable dans les 15 États de la Communauté européenne. Ce<br />
règlement est en outre conforme à l’Acte de 1991. La décision<br />
345, qui porte création d’un système de protection des obtentions<br />
végétales pour les pays du Pacte andin (Bolivie, Colombie,<br />
Équateur, Pérou, Venezuela), permet à ces pays de se doter de<br />
législations conformes à l’Acte de 1991. La Bolivie, la Colombie<br />
et l’Équateur ont des législations conformes à l’Acte de 1991<br />
mais adhèrent jusqu’à présent à l’Acte de 1978 uniquement.<br />
14. Un système régional de protection a été mis en place par<br />
l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).<br />
Il offrira une protection unifiée (une seule demande conduisant<br />
à la délivrance d’un titre de protection unique), applicable<br />
dans les 16 états énumérés ci-après dès lors que les deux tiers<br />
d’entre eux auront ratifié l’Accord de Bangui révisé (en date<br />
du 24 février 1999) :<br />
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire,<br />
Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali,<br />
Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal,<br />
Tchad, Togo.<br />
6
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Table 1. États parties à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales<br />
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. *<br />
Convention UPOV (1961), révisée à Genève (1972, 1978 et 1991)<br />
Situation le 7 décembre 2001<br />
État Date à laquelle l’État est Nombre d’unités Acte le plus récent 1 de la Convention auquel l’État est<br />
devenu membre de l’UPOV de contribution partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte<br />
Afrique du Sud 6 novembre 1977 1,0 Acte de 1978 8 novembre 1981<br />
Allemagne <strong>10</strong> août 1968 5,0 Acte de 1991 25 juillet 1998<br />
Argentine 25 décembre 1994 0,5 Acte de 1978 25 décembre 1994<br />
Australie 1 er mars 1989 1,0 Acte de 1991 20 janvier 2000<br />
Autriche 14 juillet 1994 1,5 Acte de 1978 14 juillet 1994<br />
Belgique 2 5 décembre 1976 1,5 Acte de 1961/1972 5 décembre 1976<br />
Bolivie 21 mai 1999 0,2 Acte de 1978 21 mai 1999<br />
Brésil 23 mai 1999 0,25 Acte de 1978 23 mai 1999<br />
Bulgarie 24 avril 1998 0,2 Acte de 1991 24 avril 1998<br />
Canada 4 mars 1991 1,0 Acte de 1978 4 mars 1991<br />
Chili 5 janvier 1996 0,2 Acte de 1978 5 janvier 1996<br />
Chine 23 avril 1999 0,5 Acte de 1978 3 23 avril 1999<br />
Colombie 13 septembre 1996 0,2 Acte de 1978 13 septembre 1996<br />
Croatie 1 er septembre 2001 0,2 Acte de 1991 1 er septembre 2001<br />
Danemark 4 6 octobre 1968 1,5 Acte de 1991 24 avril 1998<br />
Équateur 8 août 1997 0,2 Acte de 1978 8 août 1997<br />
Espagne 5 18 mai 1980 1,5 Acte de 1961/1972 18 mai 1980<br />
Estonie 24 septembre 2000 0,2 Acte de 1991 24 septembre 2000<br />
États-Unis d’Amérique 8 novembre 1981 5,0 Acte de 1991 6 22 février 1999<br />
Fédération de Russie 24 avril 1998 0,5 Acte de 1991 24 avril 1998<br />
Finlande 16 avril 1993 1,0 Acte de 1991 20 juillet 2001<br />
France 7 3 octobre 1971 5,0 Acte de 1978 17 mars 1983<br />
Hongrie 16 avril 1983 0,5 Acte de 1978 16 avril 1983<br />
Irlande 8 novembre 1981 1,0 Acte de 1978 8 novembre 1981<br />
Israël 12 décembre 1979 0,5 Acte de 1991 24 avril 1998<br />
Italie 1 er juillet 1977 2,0 Acte de 1978 28 mai 1986<br />
Japon 3 septembre 1982 5,0 Acte de 1991 24 décembre 1998<br />
Kenya 13 mai 1999 0,2 Acte de 1978 13 mai 1999<br />
Kirghizistan 26 juin 2000 0,2 Acte de 1991 26 juin 2000<br />
Mexique 9 août 1997 0,75 Acte de 1978 9 août 1997<br />
Nicaragua 6 septembre 2001 0,2 Acte de 1978 6 septembre 2001<br />
Norvège 13 septembre 1993 1,0 Acte de 1978 13 septembre 1993<br />
Nouvelle-Zélande 8 novembre 1981 1,0 Acte de 1978 8 novembre 1981<br />
Panama 23 mai 1999 0,2 Acte de 1978 23 mai 1999<br />
Paraguay 8 février 1997 0,2 Acte de 1978 8 février 1997<br />
Pays-Bas <strong>10</strong> août 1968 3,0 Acte de 1991 8 24 avril 1998<br />
Pologne 11 novembre 1989 0,5 Acte de 1978 11 novembre 1989<br />
Portugal 14 octobre 1995 0,5 Acte de 1978 14 octobre 1995<br />
République de Corée 7 janvier 2002 0,75 Acte de 1991 7 janvier 2002<br />
République de Moldova 28 octobre 1998 0,2 Acte de 1991 28 octobre 1998<br />
République tchèque 1 er janvier 1993 0,5 Acte de 1978 1 er janvier 1993<br />
Roumanie 16 mars 2001 0,2 Acte de 1991 16 mars 2001<br />
Royaume-Uni <strong>10</strong> août 1968 5,0 Acte de 1991 3 janvier 1999<br />
Slovaquie 1 er janvier 1993 0,5 Acte de 1978 1 er janvier 1993<br />
Slovénie 29 juillet 1999 0,2 Acte de 1991 29 juillet 1999<br />
Suède 17 décembre 1971 1,5 Acte de 1991 24 avril 1998<br />
Suisse <strong>10</strong> juillet 1977 1,5 Acte de 1978 8 novembre 1981<br />
Trinité-et-Tobago 30 janvier 1998 0,2 Acte de 1978 30 janvier 1998<br />
Ukraine 3 novembre 1995 0,5 Acte de 1978 3 novembre 1995<br />
Uruguay 13 novembre 1994 0,2 Acte de 1978 13 novembre 1994<br />
1<br />
On entend par “Acte de 1961/1972” la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l’Acte additionnel du <strong>10</strong><br />
novembre 1972; on entend par “Acte de 1978” l’Acte du 23 octobre 1978 de la Convention; on entend par “Acte de 1991” l’Acte du 19 mars 1991 de la Convention.<br />
2<br />
Avec la notification prévue à l’article 34.2) de l’Acte de 1978.<br />
3<br />
Avec une déclaration indiquant que l’Acte de 1978 n’est pas applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong.<br />
4<br />
Avec une déclaration indiquant que la Convention de 1961, l’Acte additionnel de 1972, l’Acte de 1978 et l’Acte de 1991 ne sont pas applicables au Groenland et aux îles Féroé.<br />
5<br />
Avec une déclaration indiquant que la Convention de 1961 et l’Acte additionnel de 1972 sont applicables à tout le territoire espagnol.<br />
6<br />
Avec une réserve conformément à l’article 35.2) de l’Acte de 1991.<br />
7<br />
Avec une déclaration indiquant que l’Acte de 1978 est applicable au territoire de la République française, y compris les départements et territoires d’outre-mer.<br />
8<br />
Ratification pour le Royaume en Europe.<br />
7
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Figure 1. Evolution de la protection des obtentions végétales.<br />
60000<br />
50000<br />
Titres émis<br />
Titres en vigueur<br />
Membres de l’Union<br />
1991 Entrée en vigeur<br />
de l’Acte<br />
60<br />
50<br />
Nombres de titres<br />
40000<br />
30000<br />
20000<br />
1978 Entrée en vigeur<br />
40<br />
30<br />
20<br />
Membres de l’Union<br />
<strong>10</strong>000<br />
0<br />
1973<br />
1975<br />
1977<br />
1979<br />
1981<br />
1983<br />
1985<br />
1987<br />
1989<br />
1991<br />
1993<br />
Les tâches administratives seront accomplies par l’OAPI, qui<br />
a son siège à Yaoundé. Des institutions choisies et agréées<br />
par l’OAPI procéderont à l’examen de la distinction, de<br />
l’homogénéité et de la stabilité des variétés candidates ; il est<br />
probable que des services agricoles qui disposent des installations<br />
nécessaires et ont une certaine expérience de l’examen des<br />
variétés (par exemple, les centres de certification des semences)<br />
soient appelés à apporter leur contribution au fonctionnement<br />
du système commun de protection.<br />
15. En matière de traités relatifs à la propriété intellectuelle, il<br />
existe un principe général selon lequel lorsqu’une nouvelle version,<br />
améliorée, de l’acte d’un traité entre en vigueur, il devient impossible<br />
d’adhérer à “l’ancienne” version. C’est le cas en ce qui concerne<br />
l’Acte de 1978 de la Convention UPOV. À compter du 24 avril<br />
1998, il est devenu impossible pour un État d’adhérer à l’UPOV<br />
sur la base d’une loi conforme à l’Acte de 1978. Une exception<br />
a été prévue pour les États qui avaient déjà entamé la procédure<br />
d’adhésion, à condition que cette procédure soit achevée au<br />
24 avril 1999. Trois États se trouvant dans cette situation (l’Inde,<br />
le Nicaragua et le Zimbabwe) ont récemment bénéficié d’un sursis<br />
supplémentaire afin de mener la procédure à son terme.<br />
16. La figure n° 1 donne une indication du développement<br />
progressif de la protection des obtentions végétales en termes<br />
de nombre de titres de protection accordés.<br />
17. Dans cet exposé introductif, nous décrirons les principes<br />
fondamentaux de la Convention UPOV tels qu’ils sont exprimés<br />
dans les actes de 1961 et 1978. Ces principes semblent<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
avoir bien fonctionné dans la pratique. Ils sont globalement<br />
repris dans l’Acte de 1991. La révision effectuée en 1991 était<br />
en réalité une amélioration visant à faire de la Convention<br />
un instrument adapté au XXI e siècle. Aussi, bien que les actes<br />
de 1961 et 1978 soient aujourd’hui dépassés par l’entrée en<br />
vigueur de l’Acte de 1991, ils constituent toujours pour de<br />
nombreux États la base d’adhésion à la Convention UPOV.<br />
C’est pourquoi on trouvera dans le présent exposé une comparaison<br />
des principales caractéristiques de l’Acte de 1978 et<br />
de l’Acte de 1991 ainsi qu’une explication des raisons qui ont<br />
présidé aux changements introduits en 1991.<br />
Pourquoi avoir modifié la Convention<br />
UPOV en 1991?<br />
18. Pourquoi avoir modifié la Convention UPOV alors qu’elle<br />
fonctionnait bien? C’est qu’à sa naissance, en 1961, elle avait<br />
consacré certaines notions qui étaient nouvelles en matière de<br />
propriété intellectuelle. En 1991, une trentaine d’années d’expérience<br />
avait été acquise dans l’application de ces principes et les<br />
membres avaient conscience qu’un certain nombre d’améliorations<br />
pouvaient être apportées. La découverte de la structure de<br />
la molécule d’ADN a été annoncée en 1953. Il s’en était suivi,<br />
pendant la période comprise entre 1961 et 1991, des découvertes<br />
scientifiques et des progrès techniques aux répercussions<br />
profondes sur l’amélioration des plantes et la protection des<br />
obtentions végétales. Chacun des changements opérés en 1991<br />
visait à résoudre un problème mis en lumière par l’expérience<br />
acquise ou résultant du progrès scientifique et technique.<br />
<strong>10</strong><br />
0<br />
8
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Quelles sont les fonctions de la Convention<br />
UPOV ?<br />
19. Tous les actes de la Convention UPOV remplissent cinq<br />
fonctions principales. Ils fixent, pour les membres,<br />
• les conditions d’octroi de la protection : la nouveauté,<br />
la distinction, l’homogénéité, la stabilité et une dénomination<br />
appropriée de la variété candidate<br />
• l’étendue de la protection : les droits, les exceptions,<br />
l’épuisement, la limitation, le règlement économique<br />
• la durée minimale de la protection<br />
• le champ d’application de la protection : le nombre<br />
minimal de genres et espèces végétaux dont les variétés<br />
doivent être protégées<br />
• les principes fondamentaux relatifs au droit de<br />
propriété<br />
Quelles sont les conditions d’octroi de la protection<br />
aux termes des actes de 1961 et 1978 ?<br />
20. Les actes de 1961 et 1978 fixaient trois conditions techniques<br />
et deux autres conditions à l’octroi de la protection<br />
et interdisaient l’imposition de conditions différentes ou<br />
supplémentaires. Pour être effectivement protégée, la variété<br />
doit pouvoir être identifiée. La Convention a donc posé la distinction,<br />
l’homogénéité et la stabilité comme les trois critères<br />
techniques auxquels doit satisfaire une variété candidate pour<br />
être identifiée. Les deux conditions non techniques étaient<br />
que la variété doit être “nouvelle” en ce sens qu’elle ne doit<br />
pas voir été vendue ou offerte à la vente avant certaines dates<br />
et qu’elle doit avoir reçu une dénomination appropriée. La<br />
Convention interdit d’ajouter toute autre condition supplémentaire<br />
à l’octroi de la protection. Ces conditions ont bien<br />
fonctionné dans la pratique et aucun changement majeur n’a<br />
été introduit en 1991.<br />
Quelle est l’étendue minimale de la protection ?<br />
21. Les textes de 1978 et de 1991 de la Convention précisent<br />
les actes relatifs au matériel de reproduction ou de<br />
multiplication (c’est-à-dire les semences ou les plants) d’une<br />
variété protégée qui nécessitent une autorisation préalable de<br />
l’obtenteur. Ces actes sont les suivants :<br />
Acte de 1978 Acte de 1991<br />
Production à des fins<br />
d’écoulement commercial<br />
Offre à la vente<br />
Commercialisation<br />
Production ou reproduction<br />
– Conditionnement aux fins de la<br />
reproduction ou de la multiplication<br />
Offre à la vente<br />
Vente ou autre forme de commercialisation<br />
– Exportation<br />
– Importation<br />
– Détention à l’une des fins<br />
mentionnées ci-dessus<br />
22. Il est évident que, bien que l’Acte de 1991 énonce les<br />
actes commerciaux nécessitant l’autorisation de l’obtenteur,<br />
il y a peu de différence quant au fond entre les deux textes.<br />
Dans la pratique, les exportations et les importations peuvent<br />
rarement avoir lieu indépendamment de la vente ou de la commercialisation.<br />
Si l’Acte de 1991 se veut plus précis, c’est pour<br />
permettre à l’obtenteur de faire respecter ses droits en pratique<br />
et plus rapidement, par exemple, lorsque le matériel se trouve<br />
à quai dans le cas d’une importation ou d’une exportation ou<br />
encore dans un entrepôt dans le cas d’une détention.<br />
23. Des changements substantiels sont, en revanche, intervenus<br />
en ce qui concerne la production. En vertu de l’étendue<br />
minimale de la protection conférée par l’Acte de 1978,<br />
l’autorisation de l’obtenteur était exigée uniquement pour “la<br />
production à des fins d’écoulement commercial”. Si la production<br />
n’était pas destinée à la commercialisation, elle sortait<br />
du cadre du droit d’obtenteur. De ce fait, si des semences<br />
étaient produites à la ferme aux fins d’un nouveau semis sur la<br />
même exploitation et non aux fins de la vente, la production<br />
sortait aussi du cadre du droit d’obtenteur. Il en est résulté un<br />
“privilège de l’agriculteur” consistant, pour celui-ci, à pouvoir<br />
ressemer les semences sur sa propre exploitation sans aucune<br />
obligation à l’égard de l’obtenteur de la variété. Il faut bien<br />
comprendre que cette liberté se déduisait implicitement de<br />
l’Acte de 1978, en raison de l’étendue minimale limitée de<br />
la protection prévue par cet acte. Le texte proprement dit de<br />
l’acte ne fait aucune mention expresse de ce privilège. Certains<br />
membres de l’UPOV ont choisi d’élargir la protection à toute<br />
« production », sans la limiter à la seule “production à des<br />
fins d’écoulement commercial”; dans ce cas, il n’y avait pas,<br />
juridiquement parlant, de privilège de l’agriculteur.<br />
24. L’étendue minimale de la protection telle qu’elle est<br />
définie dans l’Acte de 1978 posait toutefois un problème<br />
en ce sens que la protection s’appliquait non seulement aux<br />
espèces pour lesquelles il était pratique courante que les<br />
agriculteurs conservent des semences (par exemple, dans le<br />
cas de céréales autogames comme le riz et le blé), mais aussi<br />
aux arbres fruitiers, aux cultures de plantation et aux plantes<br />
ornementales. Si un obtenteur d’arbres fruitiers vendait un<br />
arbre à un arboriculteur, celui-ci pouvait utiliser l’arbre en<br />
question pour le multiplier et peupler les nombreux hectares<br />
de son verger, lequel produirait des fruits pendant de nombreuses<br />
années alors que l’obtenteur n’aurait été rémunéré<br />
que pour la vente d’un seul arbre. Et le progrès technique<br />
n’a fait qu’aggraver ce type de problème. Ainsi, les techniques<br />
modernes de culture de tissus ont permis d’accroître de<br />
manière très facile et rapide les approvisionnements dans le<br />
cas de nombreuses variétés végétales. C’est pourquoi, dans<br />
la révision de 1991 de la Convention, le droit de l’obtenteur<br />
à l’égard de la production du matériel de reproduction ou<br />
de multiplication a été étendu de la “production à des fins<br />
d’écoulement commercial” à l’ensemble de la “production”.<br />
Mais si l’on s’était arrêté là, les agriculteurs ne pourraient<br />
plus conserver librement le produit de leurs récoltes en<br />
tant que semences alors que cette pratique est courante et<br />
la quasi-totalité des membres de l’UPOV ne l’auraient pas<br />
accepté. C’est pourquoi l’article 15.(2) de l’Acte de 1991<br />
énonce une exception facultative qui permet aux membres<br />
d’exclure les semences de ferme de l’étendue du droit d’obtenteur<br />
et d’adopter en la matière des solutions spécialement<br />
9
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
adaptées à leur agriculture nationale. Tous les membres de<br />
l’UPOV ou presque qui ont adhéré à l’Acte de 1991 ont,<br />
sous une forme ou sous une autre, opté pour un privilège<br />
de l’agriculteur.<br />
25. En 1961, lorsque la Convention UPOV a vu le jour, la<br />
question s’est posée de savoir si le droit d’obtenteur devait<br />
s’étendre, au-delà du matériel de reproduction ou de multiplication,<br />
au produit de la récolte résultant de ce matériel. Il a été<br />
admis que, dans certains cas, il était difficile que l’obtenteur<br />
soit rémunéré adéquatement en l’absence d’un tel droit. Les<br />
membres, conscients du fait que le matériel récolté entre fréquemment<br />
dans l’alimentation, n’étaient guère enclins à exiger<br />
l’extension obligatoire du droit de l’obtenteur jusqu’au produit<br />
final de la variété. Ils ont cependant expressément prévu, à<br />
l’article 5.4) de l’Acte de 1961, que les membres pouvaient<br />
accorder aux obtenteurs, dans leur législation nationale, un<br />
droit plus étendu “pouvant notamment s’étendre jusqu’au<br />
produit commercialisé”.<br />
26. Quelques pays ont saisi cette possibilité pour étendre le<br />
droit d’obtenteur au produit final dans le cas de certaines<br />
espèces. Faute, cependant, d’une telle extension dans le cadre<br />
de l’étendue minimale de la protection, un problème s’est<br />
posé pour de nombreux obtenteurs : le matériel d’une variété<br />
pouvait être importé d’un pays A, où il était protégé, dans un<br />
pays B où il ne l’était pas. Il pouvait alors être utilisé dans ce<br />
pays B pour obtenir un produit final, par exemple des fleurs<br />
coupées, qui était alors réexporté vers le pays A. Dès lors que<br />
le produit final ne relevait pas du droit de l’obtenteur, celui-ci<br />
ne pouvait rien faire pour mettre fin à cette pratique. Résultat<br />
: non seulement l’obtenteur n’était pas rémunéré pour son<br />
travail, mais les producteurs du pays A et d’autres pays où la<br />
variété était protégée devaient faire face à une concurrence<br />
déloyale de la part des producteurs du pays B qui “pirataient”<br />
la variété.<br />
27. Dans l’Acte de 1991, les membres de l’UPOV reconnaissent<br />
que les obtenteurs doivent pouvoir prendre des mesures<br />
dans les cas susmentionnés mais ils se refusent toujours à leur<br />
accorder ce droit inconditionnel qu’ils pourraient exercer en<br />
relation avec des actes accomplis à l’égard du produit de la<br />
récolte. Les actes qui peuvent être accomplis à l’égard du<br />
produit de la récolte sont les suivants :<br />
Acte de 1978 Acte de 1991<br />
Les États sont libres d’étendre<br />
la protection nationale au<br />
produit de la récolte.<br />
Le droit d’obtenteur s’étend<br />
au produit de la récolte<br />
i) à condition que ce produit ait<br />
été obtenu par utilisation non<br />
autorisée du matériel de<br />
reproduction ou de multiplication<br />
de la variété protégée, et<br />
ii) à condition que l’obtenteur<br />
n’ait pu raisonnablement exercer<br />
son droit en relation avec ledit<br />
matériel.<br />
Par conséquent, la portée du droit que l’obtenteur peut exercer,<br />
conformément aux dispositions de l’Acte de 1991, en<br />
relation avec le produit de la récolte ne s’étend pas au-delà de<br />
la résolution de problèmes pratiques.<br />
28. Dans l’Acte de 1978, le droit d’obtenteur s’étend à la<br />
variété protégée et, implicitement, à toute variété qui ne peut<br />
être nettement distinguée de la variété protégée. Il s’applique<br />
aussi à toute variété reproduite à des fins commerciales par<br />
un emploi répété de la variété protégée (c’est-à-dire à toute<br />
variété hybride F 1<br />
dont la production repose sur l’utilisation de<br />
la variété protégée en tant que parent). Dans l’Acte de 1991,<br />
le droit d’obtenteur est élargi aux variétés “essentiellement<br />
dérivées” de la variété protégée.<br />
Les variétés couvertes par le droit d’obtenteur sont:<br />
Acte de 1978 Acte de 1991<br />
La variété protégée.<br />
La variété protégée.<br />
Implicitement, toute variété Expressément, toute variété<br />
ne pouvant être nettement qui ne se distingue pas<br />
distinguée de la variété nettement de la variété<br />
protégée.<br />
protégée.<br />
Les variétés dont la production Les variétés dont la production<br />
nécessite l’emploi répété de nécessite l’emploi répété<br />
la variété protégée.<br />
de la variété protégée.<br />
– Les variétés essentiellement<br />
dérivées.<br />
29. Qu’est-ce qu’une variété essentiellement dérivée ? Pourquoi,<br />
dans la Convention UPOV, la portée de la protection<br />
a-t-elle été étendue aux variétés essentiellement dérivées ? Pour<br />
répondre à ces questions, il faut revenir sur certains principes<br />
de base de l’Acte de 1978. Les deux Actes prévoient les exceptions<br />
obligatoires au droit d’obtenteur suivantes :<br />
Acte de 1978 Acte de 1991<br />
Emploi de la variété protégée<br />
comme source initiale de<br />
variation en vue de la<br />
création d’autres variétés<br />
et commercialisation de<br />
celles-ci (“exception en<br />
faveur de l’obtenteur”)<br />
Actes accomplis aux fins de la<br />
création de nouvelles variétés<br />
et actes accomplis aux fins de la<br />
commercialisation de ces autres<br />
variétés (à moins qu’il ne s’agisse<br />
de variétés essentiellement dérivées)<br />
(“exception en faveur de l’obtenteur”).<br />
– Actes accomplis à titre expérimental.<br />
– Actes accomplis dans un cadre<br />
privé à des fins non commerciales.<br />
30. L’Acte de 1978 prévoit qu’une variété obtenue par le jeu<br />
de l’exception en faveur de l’obtenteur et grâce à l’emploi de<br />
la variété protégée comme source initiale de variation peut<br />
faire l’objet d’une protection et être librement commercialisée<br />
par celui qui l’a mise au point à condition qu’elle se distingue<br />
nettement de la variété initiale. Dans la pratique, cela signifie<br />
qu’une légère modification, volontaire ou involontaire, de la<br />
variété existante, telle qu’une mutation, suffit pour obtenir une<br />
<strong>10</strong>
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
protection de la variété ainsi modifiée dans la mesure où celleci<br />
se distingue nettement de la variété initiale. Cette situation<br />
posait problème à un certain nombre d’obtenteurs, notamment<br />
aux obtenteurs de plantes ornementales ; cependant, la majorité<br />
d’entre eux s’en accommodaient sachant que la recherche<br />
excessive de légères modifications de variétés existantes n’est pas<br />
une stratégie de création variétale compétitive.<br />
31. Avec l’apparition du génie génétique, les choses auraient<br />
pu changer. En effet, s’il faut <strong>10</strong> à 15 années, voire plus,<br />
pour mettre au point des variétés vraiment nouvelles, par les<br />
méthodes conventionnelles de création variétale, il semblait<br />
que, grâce au génie génétique, il serait désormais possible, en<br />
ajoutant simplement un ou plusieurs gènes, de modifier des<br />
variétés de nombreuses espèces en l’espace de quelques mois,<br />
en laboratoire. Si la variété modifiée se distinguait nettement<br />
de la variété initiale, elle pouvait, conformément à l’Acte de<br />
1978, être protégée sans que la contribution de l’obtenteur de<br />
la variété initiale ne soit reconnue. Dès lors, pourquoi perdre<br />
de nombreuses années et gaspiller de vastes ressources à mettre<br />
au point des variétés véritablement nouvelles si d’autres pouvaient<br />
se les approprier de cette manière ? La situation devenait<br />
d’autant plus intolérable qu’il semblait y avoir une interdépendance<br />
entre le système des brevets et le système de protection<br />
des obtentions végétales quand le gène concerné faisait l’objet<br />
d’une protection par brevet. En effet, si l’obtenteur d’une variété<br />
initiale ajoutait un gène breveté à sa propre variété, la variété<br />
ainsi modifiée pouvait, dans de nombreux cas, être revendiquée<br />
par le titulaire du brevet au détriment de l’obtenteur, privé de<br />
l’exploitation de la variété modifiée. En outre, si le chercheur<br />
en génie génétique incorporait dans une variété initiale un gène<br />
qu’il avait fait breveter, il pouvait obtenir une protection pour la<br />
variété ainsi modifiée et exploiter celle-ci sans avoir d’obligation<br />
envers l’obtenteur de la variété initiale. La situation n’était pas<br />
satisfaisante et certains étaient manifestement lésés.<br />
32. Les responsables se trouvaient face à un défi : ils savaient,<br />
d’une part, que l’amélioration des plantes par les moyens classiques<br />
porte souvent sur les interactions complexes entre de<br />
nombreux gènes et, d’autre part, que les améliorations obtenues<br />
par les chercheurs en génie génétique ont pour origine,<br />
en règle générale, l’utilisation d’un ou de quelques gènes. S’ils<br />
voulaient encourager l’amélioration des plantes, ils devaient<br />
modifier le système de la propriété intellectuelle de telle sorte<br />
que ces deux types d’activité soient encouragés.<br />
33. Le débat qui s’en suivit sur la politique à mener s’est soldé<br />
par l’incorporation, dans l’Acte de 1991, de la notion de<br />
variété essentiellement dérivée : lorsqu’une variété est principalement<br />
dérivée d’une autre variété, c’est à-dire de la variété<br />
initiale, elle peut faire l’objet d’une protection si elle est nouvelle,<br />
distincte, homogène et stable mais ne peut être exploitée<br />
sans l’autorisation du propriétaire de la variété initiale tant que<br />
celle-ci demeure protégée. C’est ainsi que l’équilibre entre le<br />
système de protection des obtentions végétales et le système<br />
des brevets a pu être rétabli ; le nouveau cadre mis en place<br />
encourage les personnes ayant des intérêts dans la création<br />
variétale à collaborer avec celles ayant des intérêts dans les<br />
nouvelles techniques du génie génétique.<br />
Quelle est la durée minimale de la protection ?<br />
34. Aucun changement majeur n’a été apporté aux règles<br />
relatives à l’annulation ou à la déchéance de la protection.<br />
Toutefois, les règles relatives à la durée minimale de la protection<br />
ont été modifiées comme suit :<br />
Acte de 1978 Acte de 1991<br />
Arbres et vigne 18 ans 25 ans<br />
Autres plantes 15 ans 20 ans<br />
De l’avis des états membres de l’UPOV, il était nécessaire<br />
de prévoir une durée de protection plus longue afin que le<br />
système de protection des obtentions végétales attire les investissements<br />
à long terme indispensables à cette activité risquée<br />
que constitue la création variétale “classique”.<br />
Quel est le nombre minimal de genres et espèces<br />
végétaux dont les variétés doivent être protégées ?<br />
35. Lorsque la Convention UPOV a vu le jour en 1961, il n’existait<br />
que peu de données d’expérience sur cette nouvelle tâche qui<br />
consistait à déterminer si des variétés se distinguaient nettement<br />
de toute autre variété dont l’existence était notoirement connue.<br />
Les auteurs de la convention ont décidé d’agir avec circonspection.<br />
C’est pourquoi ils n’ont pas voulu que les États membres<br />
soient tenus de protéger les variétés de tous les genres et espèces<br />
végétaux ; ils ont préféré que ces états s’engagent, d’une part, à<br />
protéger le “plus grand nombre de genres et espèces botaniques”<br />
et, d’autre part, à appliquer les dispositions de la convention à au<br />
moins cinq genres ou espèces au moment de l’entrée en vigueur<br />
de la convention sur leur territoire et à 13 genres ou espèces botaniques<br />
au minimum après huit ans. Dans l’Acte de 1978, c’est à<br />
24 genres ou espèces au minimum que doivent être appliquées<br />
les dispositions de la convention au bout de huit ans.<br />
36. Lorsque la Convention a été révisée en 1991, l’incorporation<br />
d’une disposition visant à protéger tous les genres et<br />
espèces végétaux n’a posé aucun problème particulier. On s’accordait<br />
aussi à penser que les obtenteurs devaient être davantage<br />
encouragés à travailler sur de nouvelles espèces. Or, c’est par ce<br />
point que la convention péchait car les obtenteurs n’étaient pas<br />
sûrs d’obtenir une protection une fois les travaux terminés.<br />
37. C’est pourquoi l’Acte de 1991 prévoit que la protection<br />
doit être accordée aux variétés de tous les genres et espèces<br />
végétaux. Les États déjà membres de l’Union disposent d’un<br />
délai de cinq ans pour atteindre cet objectif, contre <strong>10</strong> ans<br />
pour les nouveaux membres de l’Union.<br />
38. La situation au regard des Actes de 1978 et 1991 peut être<br />
résumée comme suit :<br />
Acte de 1978 Acte de 1991<br />
Protection du “plus grand<br />
Protection d’au moins 15 genres<br />
nombre de genres et espèces ou espèces végétaux au moment<br />
botaniques”. de l’adhésion à l’Acte de 1991<br />
Protection d’au moins cinq Protection de tous les genres et<br />
genres ou espèces au moment espèces végétaux à l’expiration<br />
de l’adhésion à l’Acte de 1978, d’un délai de <strong>10</strong> ans après<br />
ce chiffre passant à 24 à l’adhésion à l’Acte de 1991<br />
l’expiration d’un délai de huit ans.<br />
11
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Tableau 2. Au dessous est la comparaison entre la protection par brevet et la protection par un système de<br />
protection des obtentions végétales.<br />
Protection par brevet<br />
Protection des obtentions végétales<br />
I. Objet de la protection invention (industrielle) obtention végétale<br />
II. Conditions de la protection<br />
1. examen des documents requis requis<br />
2. essais en plein champ non requis requis<br />
3. matériel végétal en vue de l’examen non requis (peut toutefois être déposé) requis<br />
4. conditions d’octroi de la protection a) nouveauté a) nouveauté commerciale<br />
b) possibilité d’application industrielle b) distinction<br />
c) non-évidence (activité inventive) c) homogénéité<br />
d) divulgation suffisante d) stabilité<br />
e) dénomination appropriée<br />
III. Étendue de la protection<br />
1. détermination de l’étendue de déterminée par les revendications établie par la législation nationale (ou par la Convention<br />
la protection de la demande de brevet UPOV dans le cas des États membres de l’UPOV)<br />
2. utilisation d’une variété protégée peut nécessiter l’autorisation du titulaire ne nécessite pas l’autorisation du titulaire du droit<br />
pour créer d’autres variétés du brevet (exception au droit d’obtenteur)<br />
3. utilisation de matériel de reproduction peut nécessiter l’autorisation du titulaire souvent, ne nécessite pas l’autorisation du titulaire<br />
ou de multiplication d’une variété du brevet du droit<br />
protégée mise en culture par un<br />
agriculteur en vue d’une plantation<br />
ultérieure dans la même exploitation<br />
IV. Dénomination de la variété non requise requise<br />
V. Durée de la protection 20 ans à compter de la date de la 18 ans pour les arbres et la vigne, 15 ans pour les<br />
demande<br />
autres espèces, à compter de la date de la délivrance<br />
du titre de protection (portée à 25 ans et à 20 ans<br />
respectivement dans l’Acte de 1991)<br />
Les règles relatives au traitement national<br />
39. Le traitement national (c’est-à-dire l’égalité de traitement<br />
pour les ressortissants et les étrangers sur le territoire d’un<br />
état membre) et la clause de la nation la plus favorisée (c’està-dire<br />
l’égalité de traitement, pour les ressortissants de tous<br />
les Etats membres, sur le territoire de chacun des autres états<br />
membres) sont des principes clés de non-discrimination dans<br />
les accords sur la propriété intellectuelle. Ils régulent les relations<br />
entre les obtenteurs dans un pays membre et fournissent<br />
une base pour la coopération entre états membres. Dans la<br />
Convention UPOV, les membres sont tenus d’appliquer le<br />
traitement national aux nationaux et aux résidents d’autres<br />
États membres de l’UPOV. En vertu de l’Acte de 1978, les<br />
états membres peuvent limiter le bénéfice de la protection de<br />
tout genre et toute espèce aux nationaux et aux résidents des<br />
membres de l’Union qui appliquent la Convention à ce genre<br />
ou à cette espèce. Cette disposition de réciprocité ne figure<br />
pas dans l’Acte de 1991. Ainsi, dans ce dernier, l’application<br />
de la clause de la nation la plus favorisée a été rétablie, ce qui<br />
contribue au renforcement de la coopération entre tous les<br />
membres de l’Union.<br />
40. Les deux actes prévoient que l’obtenteur bénéficie d’un<br />
droit de priorité lorsqu’il a déposé une demande de protection<br />
pour la même variété auprès d’un autre état membre de<br />
l’UPOV, c’est-à-dire qu’une demande subséquente est traitée<br />
comme si elle avait été déposée à la date de dépôt de la première<br />
demande. Ces dispositions peuvent jouer un rôle important<br />
lorsqu’il s’agit de déterminer la nouveauté et la distinction<br />
d’une variété aux fins de l’octroi d’une protection.<br />
Comment la protection d’une invention<br />
par brevet peut-elle être comparée à la<br />
protection d’une variété par un système<br />
de protection des obtentions végétales ?<br />
41. Le tableau 2 présente une comparaison générale entre<br />
la protection d’une invention par brevet et la protection<br />
d’une variété par un système de protection des obtentions<br />
végétales.<br />
Dans quelles circonstances un pays<br />
devrait-il mettre en place un système de<br />
protection des obtentions végétales ?<br />
42. Un système de protection des obtentions végétales présente<br />
un intérêt pour tout pays qui estime, compte tenu de<br />
sa situation nationale, qu’un système d’incitation fondé sur<br />
l’octroi de droits exclusifs aux individus et aux entités qui<br />
s’occupent de création variétale favorisera quantitativement ou<br />
qualitativement l’activité dans ce domaine. On trouve parmi<br />
les États membres de l’UPOV des pays où l’amélioration des<br />
plantes est réalisée par des services étatiques ou par des particuliers<br />
ou des organisations privées ou par une combinaison<br />
des deux secteurs.<br />
43. Tous les membres de l’UPOV ont estimé qu’un système<br />
d’incitation fondé sur les principes de la Convention UPOV<br />
encouragerait l’amélioration des plantes au mieux de leurs<br />
intérêts. Par la mise en place d’un système de protection des<br />
obtentions végétales, les états cherchent à stimuler l’activité<br />
nationale d’amélioration des plantes, à encourager les obten-<br />
12
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
teurs venant d’autres pays à satisfaire aux conditions qu’ils<br />
ont fixées, à créer un environnement sûr permettant aux<br />
obtenteurs ou semenciers étrangers de produire des semences<br />
de variétés protégées en vue de leur réexportation ou à faire de<br />
leur industrie semencière nationale un secteur basé moins sur<br />
les services et plus sur la recherche-développement.<br />
Quel est l’effet de l’accord sur les ADPIC ?<br />
44. Les négociations commerciales de l’Uruguay Round se<br />
sont achevées le 15 avril 1994. Elles se sont soldées par l’Accord<br />
instituant l’Organisation mondiale du commerce (qui<br />
remplace le GATT) et un certain nombre d’accords spécifiques<br />
qui figurent en annexe de cet accord. L’un de ces accords est<br />
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle<br />
qui touchent au commerce (l’Accord sur les ADPIC). L’Accord<br />
sur les ADPIC établit des normes minimales en matière<br />
de protection de la propriété intellectuelle. L’accord exige<br />
notamment des États membres de l’Organisation mondiale du<br />
commerce (OMC) qu’ils assurent la protection des obtentions<br />
végétales par des brevets ou par ce que l’on appelle un système<br />
de protection sui generis efficace ou par une combinaison de<br />
ces deux moyens. En vertu de l’Accord sur les ADPIC, tous<br />
les pays en développement autres que ceux qui entrent dans la<br />
catégorie des pays les moins avancés (“PMA”) doivent assurer<br />
la protection des obtentions végétales au moyen de droits de<br />
propriété intellectuelle au plus tard le 1 er janvier 2001. Les<br />
PMA ont jusqu’au 1 er janvier 2006 pour faire de même.<br />
La protection des droits des obtenteurs<br />
est-elle préjudiciable à la conservation<br />
des ressources phytogénétiques ?<br />
45. L’article 5(3) de la Convention UPOV prévoit expressément<br />
qu’une variété protégée peut être librement utilisée par d’autres<br />
pour créer de nouvelles variétés, c’est-à-dire qu’elle reste librement<br />
accessible en tant que ressource phytogénétique.<br />
46. L’expérience des États membres de l’UPOV a montré<br />
que la protection des obtentions végétales accroît le nombre<br />
d’obtenteurs et, par conséquent, élargit la gamme des variétés<br />
améliorées accessibles aux agriculteurs, avec une augmentation<br />
potentielle de la possibilité de variation génétique.<br />
47. Les avantages substantiels que les nouvelles variétés offrent<br />
aux agriculteurs peuvent inciter ceux-ci à arrêter de cultiver<br />
les variétés existantes ou les variétés de pays au profit de nouvelles<br />
variétés, qu’elles soient ou non protégées par des droits<br />
d’obtenteur. Il faut trouver les moyens de mettre les nouvelles<br />
variétés importantes à la disposition des agriculteurs d’une<br />
manière générale tout en encourageant la poursuite de l’exploitation<br />
des variétés existantes ou des variétés de pays afin<br />
de maintenir la diversité génétique.<br />
48. Lors de sa 25 e conférence, tenue en novembre 1999,<br />
l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et<br />
l’agriculture (FAO) a entériné une interprétation de l’Arrangement<br />
sur les ressources phytogénétiques selon laquelle il<br />
n’existe pas d’incompatibilité entre les droits d’obtenteur et<br />
l’arrangement.<br />
Comment la protection des obtentions<br />
végétales est-elle administrée au niveau<br />
national ?<br />
49. La protection des nouvelles variétés est assurée dans la<br />
plupart des États membres de l’UPOV par une demande de<br />
protection adressée à l’autorité nationale compétente désignée<br />
à cet effet.<br />
50. Les avantages d’une variété nouvellement créée ne peuvent<br />
être réalisés que si du matériel de reproduction ou de multiplication<br />
authentique de la variété est disponible.<br />
51. Ainsi, il existe en pratique un rapport indéniable entre les<br />
mesures d’incitation à l’amélioration des plantes et les mesures<br />
destinées à assurer la disponibilité de semences authentiques<br />
de qualité élevée des variétés végétales supérieures. De nombreux<br />
pays n’autorisent la vente de nouvelles variétés végétales<br />
importantes que lorsque ces variétés ont été examinées de<br />
manière indépendante lors d’essais officiels.<br />
52. La majorité des États membres de l’UPOV ont élaboré<br />
leurs dispositions institutionnelles nationales en matière de la<br />
protection des obtentions végétales en fonction de la pratique<br />
des organismes chargés du contrôle de la qualité des semences et<br />
de l’examen des variétés. Dans de nombreux cas, les conditions<br />
techniques de la protection des obtentions végétales, à savoir la<br />
distinction, l’homogénéité et la stabilité, font partie des conditions<br />
d’inscription d’une variété dans une liste officielle.<br />
53. Il peut souvent s’avérer judicieux d’inscrire la protection<br />
des obtentions végétales dans le cadre d’une politique agricole<br />
nationale de contrôle de la qualité des semences et de l’élaboration<br />
d’une liste nationale des variétés recommandées pour<br />
la culture ; il convient cependant de noter que la Convention<br />
UPOV pose le principe de l’indépendance entre l’octroi de<br />
la protection et les décisions relatives à la réglementation du<br />
commerce des semences.<br />
54. A l’inverse, étant donné que la protection des obtentions<br />
végétales est une forme de propriété intellectuelle, un certain<br />
nombre d’États ont choisi de confier l’administration de la<br />
protection des obtentions végétales à des institutions étatiques<br />
qui sont déjà chargées d’une ou plusieurs formes de propriété<br />
intellectuelle. En Hongrie, en Italie (et très récemment au<br />
Bélarus, en Bulgarie et en République de Moldova), l’office<br />
des brevets reçoit des demandes de protection et délivre les<br />
titres correspondants, mais délègue l’examen technique de la<br />
distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés aux<br />
experts du Ministère de l’agriculture. En Nouvelle Zélande, le<br />
système de protection des obtentions végétales est administré<br />
par un office indépendant au sein du Ministère du commerce,<br />
lequel est également chargé des brevets et des marques. Aux<br />
États-Unis d’Amérique, principalement pour des raisons historiques,<br />
la protection des variétés multipliées par voie végétative<br />
(autres que celles qui se multiplient par tubercule) est confiée<br />
à l’Office des brevets et des marques, alors que la protection<br />
des variétés à reproduction sexuée et des variétés qui se multiplient<br />
par tubercule est confiée au Service de la protection des<br />
obtentions végétales du Ministère de l’agriculture.<br />
13
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Quel est le rôle du Bureau de l’UPOV ?<br />
55. La Convention UPOV a créé une “Union” de pays—les<br />
états membres—qui sont convenus d’offrir aux obtenteurs des<br />
autres états membres de l’Union le même accès à la protection<br />
de leurs variétés que celui qu’ils accordent aux obtenteurs<br />
nationaux. L’appartenance à l’UPOV permet à tout État doté<br />
d’une législation de protection des obtentions végétales adaptée<br />
de tirer profit de l’expérience cumulée des États membres<br />
et de contribuer à la promotion mondiale de l’amélioration<br />
des plantes. Un effort constant de coopération intergouvernementale<br />
est nécessaire pour harmoniser les activités des États<br />
membres et cela nécessite l’appui d’un secrétariat spécialisé.<br />
Quelles sont les activités de l’UPOV ?<br />
56. Les principales activités de l’UPOV consistent à promouvoir<br />
la coopération internationale, principalement entre les États<br />
membres, et à aider les pays à mettre en place une législation<br />
dans le domaine de la protection des obtentions végétales.<br />
57. La coopération entre les États membres, notamment sous<br />
forme d’accords pour l’examen de la distinction, de l’homogénéité<br />
et de la stabilité des obtentions végétales, est bien établie.<br />
Ces accords permettent aux États membres de limiter les coûts et<br />
le temps nécessaires pour déterminer si les obtentions végétales<br />
remplissent les conditions de protection. Il est évident que cette<br />
coopération aura un effet bénéfique sur le niveau d’investissement<br />
dans l’amélioration des plantes dans les États membres et<br />
sur la diffusion de variétés de qualité parmi les États membres.<br />
58. Le fait que la convention contienne des dispositions relatives<br />
aux conditions de base qui doivent figurer dans la législation<br />
des États qui souhaitent faire partie de l’Union crée de fait<br />
une certaine harmonie dans les législations sur la protection<br />
des variétés. Cette harmonie, outre qu’elle offre un avantage<br />
évident aux obtenteurs, favorise une coopération active entre<br />
les États membres, au niveau administratif comme au niveau<br />
technique. La volonté d’agir au moindre coût a supposé un<br />
processus constant d’amélioration et de perfectionnement de<br />
cette coopération, généralement sur la base de recommandations<br />
et d’accords et formulaires types établis par l’Union.<br />
59. Pour accomplir ces tâches, l’UPOV a créé, sous les auspices<br />
du Conseil, les organes ci-après :<br />
1) Comité consultatif<br />
2) Comité administratif et juridique<br />
3) Comité technique<br />
Le Comité technique dirige les groupes de travail techniques<br />
ci-après :<br />
Groupe de travail technique sur les plantes agricoles<br />
Groupe de travail technique sur les systèmes d’automatisation<br />
et les programmes d’ordinateur<br />
Groupe de travail technique sur les plantes fruitières<br />
Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et<br />
les arbres forestiers<br />
Groupe de travail technique sur les plantes potagères<br />
Comment les obtenteurs exercent-ils<br />
leurs droits en pratique ?<br />
60. L’article n° 5 prévoit que toute autorisation donnée par<br />
l’obtenteur en ce qui concerne la production ou la commercialisation<br />
de sa variété peut être subordonnée aux conditions<br />
par lui définies. Sous réserve des dispositions législatives<br />
nationales, l’obtenteur est donc libre de décider s’il exerce son<br />
droit exclusif en produisant et en offrant lui-même à la vente<br />
l’ensemble du matériel de reproduction ou de multiplication<br />
de sa variété qui est requis par le marché ou s’il accorde des<br />
licences à des tiers, peut-être en contrepartie d’une redevance.<br />
La pratique varie d’un État à l’autre mais, d’une manière<br />
générale, s’agissant des espèces pour lesquelles des volumes<br />
très importants de semences doivent être produits et vendus,<br />
lorsque les capacités de stockage des semences des agriculteurs<br />
influent sur le prix que ceux-ci seront prêts à payer, les obtenteurs<br />
choisissent la méthode de production et de distribution<br />
au moindre coût. Par exemple, s’agissant des céréales à paille,<br />
dans la plupart des pays européens des licences sont accordées<br />
très largement à des organisations telles que des coopératives<br />
locales et des marchands de grains, qui offrent un large éventail<br />
de services et de fournitures aux agriculteurs. Les organisations<br />
de ce type produisent les semences au niveau local, sous contrat,<br />
et les revendent aux agriculteurs locaux en limitant ainsi<br />
au minimum le coût du transport. L’obtenteur se contente de<br />
percevoir une redevance sur chaque tonne de semences vendue.<br />
Dans le cas d’une production de semences plus spécialisée,<br />
telle que la production de certaines espèces allogames, de<br />
variétés hybrides ou de semences potagères de qualité élevée,<br />
l’obtenteur choisira probablement de contrôler de très près<br />
la production de semences afin de maintenir la qualité et la<br />
renommée de sa variété. Dans ce cas, il prélèvera directement sa<br />
rémunération sur le prix des semences. Il existe de nombreuses<br />
situations différentes, en fonction de la structure commerciale<br />
de la distribution des semences dans chaque pays et des aspects<br />
environnementaux et logistiques de la production et de la distribution<br />
des semences de chaque espèce.<br />
Comment un pays devient-il un membre<br />
de l’UPOV ?<br />
61. Les participants à ce séminaire souhaiteront sans doute<br />
savoir comment un État peut devenir membre de l’UPOV.<br />
Tout d’abord, l’État en question doit avoir adopté et être en<br />
mesure d’appliquer une loi sur la protection des obtentions<br />
végétales qui soit conforme aux règles établies par l’Acte de<br />
1991 de la Convention UPOV. Il doit ensuite demander l’avis<br />
du Conseil de l’UPOV sur la conformité de sa législation avec<br />
l’Acte. Si l’avis du Conseil est positif, l’État considéré peut<br />
déposer auprès de l’UPOV un instrument d’adhésion à l’Acte<br />
de 1991 (document juridique) et fournir à l’UPOV certaines<br />
informations, y compris sa proposition de contribution financière.<br />
Il deviendra membre de l’UPOV un mois plus tard.<br />
62. On constate depuis 1961 une augmentation régulière du<br />
nombre de pays membres de l’UPOV. Ces pays ont tous pris<br />
la décision d’adopter une législation sur le droit d’obtenteur<br />
conforme à la Convention UPOV après un examen détaillé et<br />
14
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
approfondi de leur situation nationale. Ils sont probablement<br />
tous arrivés à la conclusion que l’amélioration des plantes doit<br />
bien souvent être réalisée à l’intérieur des frontières nationales<br />
si l’on veut en tirer un profit maximal et qu’un système d’incitation<br />
aux obtenteurs entraîne un accroissement de l’activité<br />
totale d’amélioration de plantes adaptées à leur territoire.<br />
Ces activités, mises en œuvre dans le cadre de programmes<br />
indépendants les uns des autres, répondent probablement à<br />
des objectifs d’amélioration divers et mobilisent des sources<br />
génétiques variées.<br />
Les systèmes semenciers nationaux<br />
Système semencier du Cameroun<br />
M. Tchoumtchoua<br />
Introduction<br />
Le Cameroun couvre une superficie de 475 000 km 2 et est<br />
situé à l’extrémité Nord-Est du Golf de Guinée. Il s’étend<br />
du 9 ème au 16 ème degré de longitude et s’étale du 2 ème au 13 ème<br />
degré de latitude Nord. Au Sud, il est limité par la Guinée<br />
Equatoriale, le Gabon, et le Congo; à l’Ouest par le Nigéria<br />
et le Tchad qui borde le pays au Nord ; à l’Est par la République<br />
Centrafricaine et le Tchad. Il se présente sous forme<br />
d’un triangle mal formé d’environ 700 km de base et de 1 200<br />
km de côté. Le pays se caractérise par sa grande diversité de<br />
paysages, de climats, de sols et de végétation. Cette diversité<br />
détermine une grande variabilité de systèmes de productions.<br />
La population camerounaise est estimée à 15 millions d’habitants<br />
avec un taux de croissance annuel de 2,8 %.<br />
Historique de la filière semences<br />
A l’indépendance (1960), le gouvernement avait basé sa politique<br />
semencière sur un réseau de fermes de multiplication de<br />
matériel végétal disséminées dans tout le pays et relevant du<br />
Ministère de l’Agriculture. Mais ces structures dotées d’une<br />
gestion fortement centralisée, ne répondaient pas aux besoins<br />
réels des agriculteurs tant en ce qui concerne les cultures<br />
vivrières que pour les cultures de rente.<br />
Pour les sociétés de filière (CDC, SOCAPALM, SODECO-<br />
TON, SEMRY...), la problématique semencière constituait<br />
dès leur création un élément de l’approche sectorielle. Il revenait<br />
à ces sociétés d’assurer l’approvisionnement des paysans<br />
en semences améliorées ou de s’auto-approvisionner pour les<br />
plantations en régie. Par contre, jusqu’en 1976, les cultures<br />
vivrières ne faisaient pas l’objet de programmes semenciers<br />
particuliers.<br />
En 1980, un plan national semencier a été élaboré avec le<br />
concours de la FAO. Son exécution a été confiée à la Mission<br />
de développement des semences et des cultures vivrières<br />
(MIDEVIV) bénéficiant des subventions de l’état et des<br />
bailleurs de fonds.<br />
En 1990, dans le cadre de l’ajustement structurel, et à cause<br />
de ses coûts récurrents et dans la perspective de l’arrêt de<br />
financement de la plupart des bailleurs de fonds, le Gouvernement<br />
prit la décision de dissoudre la MIDEVIV et de<br />
libéraliser la production et la commercialisation de semences<br />
et plants. L’ensemble des structures de la MIDEVIV fut mis<br />
en liquidation.<br />
Situation actuelle de la filière semencière<br />
La situation actuelle se caractérise par une désarticulation<br />
des principales fonctions de la filière semencière, à savoir la<br />
sélection créative et la sélection conservatrice des variétés,<br />
la multiplication, le conditionnement et la distribution<br />
des semences.<br />
Cela est dû principalement au passage sans transition d’un<br />
système administré dans lequel l’état assurait l’ensemble des<br />
fonctions, à un système où le secteur privé, sans moyens ni<br />
préparation est appelé à remplir l’essentiel de ces fonctions.<br />
Cette situation se traduit par une inadéquation entre l’offre<br />
et la demande.<br />
L’offre souffre de<br />
• la dégénérescence du matériel de base due aux<br />
difficultés financières et de gestion des centres<br />
de recherche<br />
• la présence sur le marché d’opérateurs vendant<br />
du matériel végétal de mauvaise qualité<br />
• le manque de financement adapté à la production<br />
semencière<br />
• l’absence d’un réseau efficace de distribution<br />
et de commercialisation des semences et plants<br />
La demande pâtit de<br />
• l’absence d’un système de vulgarisation du matériel<br />
végétal performant<br />
• l’absence de financement propre pour l’acquisition<br />
des semences sélectionnées<br />
Par ailleurs, l’environnement institutionnel de la filière se<br />
caractérise par l’insuffisance de collaboration et de coordination<br />
entre les acteurs (Recherche agricole, Ministère de<br />
l’agriculture et secteur privé).<br />
Cette situation décourage les agriculteurs et les contraint<br />
à recourir aux semences fermières sans renouvellement au<br />
détriment des rendements agricoles.<br />
15
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Perspectives : politique et programme<br />
semenciers<br />
La politique semencière constitue l’un des éléments cadre de<br />
la nouvelle politique agricole. Elle préconise le désengagement<br />
de l’État des fonctions de production des biens et services<br />
marchands pour permettre le développement d’un secteur<br />
privé semencier efficient.<br />
La politique semencière se base sur les axes stratégiques<br />
suivants :<br />
• privatisation des activités de production et de<br />
commercialisation des semences et plants<br />
• définition et partage des tâches des différents<br />
acteurs au sein de la filière<br />
• mise en place d’un cadre institutionnel et<br />
réglementaire flexible et incitatif<br />
Au regard des orientations arrêtées dans le cadre de la nouvelle<br />
politique semencière, les fonctions au sein de la filière semencière<br />
se répartissent comme suit :<br />
Acteurs<br />
Fonctions<br />
Le Secteur privé : – La sélection variétale<br />
(sélectionneurs, – La multiplication des semences<br />
multiplicateurs, – La collecte, le conditionnement et le<br />
conditionneurs, traitement des semences<br />
distributeurs) – La commercialisation des semences<br />
– L’importation et l’exportation des semences<br />
La Recherche<br />
publique ou<br />
privée agricole<br />
Le Ministère de<br />
l’Agriculture<br />
(Service chargé<br />
des Semences)<br />
– La sélection créative<br />
– La sélection conservatrice<br />
– La production des semences de pré-base<br />
– Le suivi des essais multi-locaux des variétés<br />
La mise en œuvre de la politique et du<br />
programme semencier national est<br />
essentiellement axée sur<br />
– La promotion de la production et de l’utilisation<br />
des semences certifiées ou sélectionnées<br />
– L’homologation des variétés<br />
– La tenue du Catalogue National des espèces<br />
cultivées ou commercialisées au Cameroun<br />
– La tenue du fichier des professionnels ayant<br />
une activité semencière au Cameroun<br />
– Le suivi de l’application de la loi semencière<br />
et de ses textes d’application<br />
– Le contrôle et la certification des semences<br />
en vue de garantir leur qualité vis-à-vis des<br />
agriculteurs<br />
– Le contrôle de commercialisation des semences<br />
Les options stratégiques retenues pour le programme national<br />
semencier s’inscrivent en droite ligne de la nouvelle<br />
politique agricole.<br />
Elles s’articulent autour des principes simples qui doteront<br />
le Cameroun d’un secteur semencier viable, capable<br />
de s’adapter à l’évolution de la demande en semences et<br />
plants performants. Ces options stratégiques se définissent<br />
comme suit :<br />
• Le développement durable d’un secteur privé<br />
semencier<br />
• La prise en compte de ce que recherche l’utilisateur<br />
de la semence<br />
• La garantie d’approvisionnement régulière en<br />
semences pour les agriculteurs<br />
• La recherche agricole comme point de départ<br />
de la chaîne de multiplication des semences<br />
• Le contrôle de qualité et la certification des<br />
semences pour garantir la qualité des semences<br />
du matériel végétal mis à la disposition des<br />
agriculteurs<br />
Le programme semencier national a comme objectif de mettre<br />
en place une filière semencière moderne qui assure de façon<br />
pérenne la disponibilité et l’accessibilité aux semences et plants<br />
performants au plus grand nombre d’exploitations agricoles.<br />
Pour sa mise en œuvre, le programme semencier national se<br />
structure autour de quatre composantes que sont :<br />
• la promotion du secteur privé semencier<br />
• la promotion de l’utilisation des semences<br />
de qualité auprès des agriculteurs<br />
• la consolidation de la production des semences<br />
de pré-base au niveau de la recherche agricole<br />
• le renforcement institutionnel et réglementaire du<br />
Service national des semences du ministère<br />
de l’agriculture<br />
Sur la base de la politique et du programme semenciers<br />
présenté brièvement ci-dessus, le gouvernement vient<br />
d’élaborer avec le concours de la FAO, un projet d’appui<br />
au programme semencier national. Sa mise en œuvre<br />
permettra le développement d’une filière semencière<br />
moderne constituée de véritables professionnels de la<br />
semence.<br />
Maurice Tchoumtchoua; Chef, Service des Semences, Ministère de<br />
l’Agriculture, Cameroun. BP 12 837 Yaoundé, Cameroun.<br />
Tél : (237) 231 67 71 / (237) 231 55 52 / (237) 778 38 24 ;<br />
Fax :(237) 231 67 70 ; E.mail : mautchoum@yahoo.fr<br />
16
Le secteur semencier en Côte d’Ivoire<br />
A. Yao<br />
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Introduction<br />
La filière ivoirienne des semences et plants a été longtemps<br />
dominée par l’intervention de l’état dans toutes les étapes, de<br />
la création à la distribution. Ceci a été prouvé par la création<br />
sur tout le territoire des stations de recherche, des centres de<br />
production, de conditionnement et distribution de matériel<br />
végétal en quantité suffisante. Cependant, la production en<br />
régie s’est avérée trop coûteuse, par rapport aux faibles niveaux<br />
des rendements, rendant le matériel produit onereux et peu<br />
accessible aux agriculteurs. Dans le but d’encourager la production,<br />
l’état a pris en son temps des mesures incitatives telles<br />
que la gratuité des semences de riz decidée en 1983. Cette<br />
mesure n’a, en aucun cas, amelioré ni la qualité ni la quantité<br />
des rendements.<br />
Par ailleurs, le matériel de production en régie a subi une forte<br />
dégradation et une baisse de production, auxquelles ne saurait<br />
remédier l’état confronte aux énormes contraintes budgetaires<br />
liées d’une part à la mévente des principaux produits d’exportation<br />
et d’autre part par la dévaluation du franc CFA. Vue<br />
toutes ces contraintes, l’état s’est désengage progressivement<br />
des acticités de production et de commercialisation en incitant<br />
la prise en main par le secteur privé. Depuis le désengagement<br />
de l’état, le secteur semencier s’organise au rythme de la structuration<br />
des filières agricoles elles-mêmes.<br />
La production et l’utilisation du matériel<br />
végétal<br />
La production et l’utilisation des semences des variétés<br />
améliorée de plantes cultivées sont plus ou moins développées<br />
selon les filières.<br />
La production<br />
La filière des semences et plants connaît deux systèmes<br />
d’organisation: le système formel et le système informel.<br />
Le système formel<br />
Le système formel repose sur les composantes classiques qui<br />
sont : la création variétale, la production et la diffusion du<br />
matériel végétal, la législation intégrant le contrôle de qualité<br />
et la certification, les appuis institutionnels.<br />
Le système formel ivoirien a longtemps bénéficié des appuis<br />
institutionnels importants, parmi lesquelles on peut citer la<br />
création des infrastructures suivantes :<br />
• 40 centres de bouturages et 8 centres de production<br />
de baguettes de caféier<br />
• 1 centre de production de graines germés de palmier<br />
• 3 centres de production de cabosses de cacao<br />
• 1 centre de production de noix germées de cocotier<br />
• 1 station de production de semences de prébase<br />
de coton<br />
• 1 champ semencier d’anacardier<br />
• 1 ferme de production des semences<br />
d’oignon<br />
• 2 fermes semenciers de céréales et de soja<br />
• 1 ferme de production de semences<br />
fourragères<br />
• 3 collections d’igname et de manioc<br />
• 3 collections de bananier plantain<br />
• 2 stations de production de semences<br />
et plants d’agrumes et d’arbres fruitiers<br />
• plusieurs jardins à bois et centre de<br />
production de plants d’hévéas<br />
Le système formel se caractérise par une activité réduite en<br />
production des semences céréalières, les appuis apportés par<br />
l’état étant sensiblement réduits du fait de son désengagement<br />
des activités de production et de distribution.<br />
Les deux fermes semencières de Doumba (Odienné) et<br />
Sokourala (Touba) fonctionnent grâce au soutien du projet<br />
de Dévelopment de la région nord-ouest (Projet soja). Ces<br />
fermes qui fonctionnent déjà en dessous de leur capacité<br />
risquent de fermer comme les autres à la fin du finalement<br />
du Projet soja.<br />
Le secteur privé n’est pas motivé à reprendre les infrastructures<br />
mises en place par l’état du fait de l’environnement défavorable<br />
aux prix aux producteurs des denrées alimentaires en<br />
général et aux producteurs de paddy en particulier.<br />
Au cours des 3 derniéres campagnes, la production des semences<br />
de riz, de maïs, de soja et de coton se présente en dents de<br />
scie avec une tendance à la baisse selon le tableau 1.<br />
Le système formel comprend deux modes de production: la<br />
production en régie et la production par contrat de culture.<br />
La production en régie<br />
C’est le mode de production industrielle de matériel végétal,<br />
qui se pratique dans les fermes semencières d’état, dans les<br />
entreprises industrielles de palmier à huile, d’hévéa, de canne à<br />
sucre, d’ananas, et de banane d’exportation, utilisant de grands<br />
moyens matériels et humains.<br />
Le coût de revient du matériel végétal est si élevé, que ne peut<br />
l’acquérir aisément l’agriculteur à faible niveau de revenu. Ce<br />
mode de production est courant dans les stations de recherche<br />
qui produisent surtout du matériel de prébase ou de base dont<br />
le prix est souvent six fois plus élevé que le matériel certifié des<br />
générations postérieures.<br />
La production en régie fournit une part importante des plants,<br />
boutures et vitroplants de la plupart des cultures industrielles<br />
d’exportation mais sa contribution à la production des<br />
semences de céréales n’excède guère <strong>10</strong>% de l’ensemble des<br />
besoins nationaux.<br />
17
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Tableau 1. Production et distribution du matériel végétal.<br />
Espèce Nature du matériel végétal Unité 97/98 98/99 99/2000<br />
Riz<br />
Maïs<br />
Soja<br />
Coton<br />
Caféier<br />
Manguier<br />
Anacardier<br />
Kolatier<br />
Canne à sucre<br />
Manioc<br />
Banane plantain<br />
Cacaoyer<br />
Ananas<br />
Banane poyo<br />
Hévéa<br />
“<br />
semences<br />
“<br />
“<br />
“<br />
boutures<br />
plants<br />
“<br />
“<br />
boutures<br />
“<br />
rejets<br />
vitroplants<br />
plants<br />
bois de greffe<br />
kg<br />
“<br />
“<br />
“<br />
u<br />
“<br />
“<br />
“<br />
“<br />
“<br />
“<br />
“<br />
“<br />
“<br />
“<br />
m<br />
904 296<br />
284 791<br />
500 000<br />
12 709 000<br />
791 802<br />
52 700<br />
407 400<br />
4 160<br />
3 189 700<br />
2 175 000<br />
120 000<br />
33 000<br />
300 000<br />
1 300 000<br />
2 215 560<br />
–<br />
307 821<br />
140 860<br />
580 000<br />
12 486 000<br />
15 842 122<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
342 000<br />
–<br />
–<br />
423 087<br />
1 270 434<br />
1 859 <strong>10</strong>2<br />
273 045<br />
477 000<br />
177 940<br />
306 000<br />
13 372 000<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
2 728 843<br />
933 201<br />
2 059 204<br />
4<strong>10</strong> 413<br />
La production par contrat de culture<br />
La production par contrat de culture consiste en un partenariat<br />
entre un établissement de traitement et de distribution de<br />
matériel végétal sélectionné et des multiplicateurs, qui sont<br />
pour la plupart des agriculteurs.<br />
L’établissement apporte au multiplicateur du matériel “mère”<br />
(semences de base) à multiplier, les facteurs de production et<br />
l’encadrement requis.<br />
Le multiplicateur s’engage à respecter les conseils techniques<br />
qu’apporte l’établissement et à lui livrer la récolte qui lui sera<br />
payé à un prix rémunérateur fixé d’avance dans le contrat écrit<br />
signé des deux parties.<br />
La totalité des semences de riz, de maïs et de coton distribuées<br />
par la CIDT est produite par contrat de culture par les paysans<br />
multiplicateurs de la zone cotonnière, pour qui ce mode de<br />
production assure un débouché certain.<br />
Ce mode de production fournit du matériel végétal de bonne<br />
qualité à un coût relativement plus bas que le mode de production<br />
en régie (le rapport étant souvent de 1⁄2).<br />
L’avenir du système formel est dans la production par contrat<br />
de culture, qui demande une formation et un suivi régulier<br />
des multiplicateurs. Ce mode de production constitue une<br />
charnière entre les systèmes formel et informel.<br />
Le système informel<br />
Le système informel est le système traditionnel, dont une<br />
infime partie de la production est contrôlable. Les premières<br />
générations du matériel végétal introduites auprès des producteurs<br />
multiplicateurs sont suivies par leurs pourvoyeurs dont<br />
le souci est d’injecter au système de matériel de bonne qualité<br />
18<br />
dont les souches doivent être renouvelées à partir des noyaux<br />
de prémultiplications ou de base dont les productions sont<br />
contrôlées et certifiées (notamment les générations de prébase<br />
dans le cas des semences de céréales).<br />
Les pourvoyeurs des semences de prébase sont les instituts de<br />
recherche, les services de vulgarisation qui veillent à constituer<br />
parmi les agriculteurs les noyaux de production de matériel<br />
de base, dont la production est ensuite distribuée aux multiplicateurs<br />
de matériel de qualité améliorée.<br />
Afin d’éviter de rendre coûteuses les semences de base et les<br />
semences de qualité améliorée qui en sont issues, ces deux catégories<br />
de semences ne sont pas certifiées. Elles sont écoulées<br />
dans le cas du riz, selon le circuit traditionnel, ce qui les rend<br />
plus accessibles aux agriculteurs.<br />
Le système informel fournit la quasi totalité des semences des<br />
céréales et des autres cultures vivrières.<br />
Il a besoin d’appuis institutionnels importants pour être amélioré<br />
au profit du grand nombre de producteurs. Les actions<br />
entreprises au plan national, visent à créer et à pérenniser<br />
les bases de multiplication de matériel de base, à former les<br />
agriculteurs en vue de produire du matériel végétal de qualité<br />
améliorée.<br />
Le système informel renové, appelé système communautaire<br />
de multiplication, bénéficie déjà des appuis logistiques<br />
à travers le projet FIDA, le Projet national riz, dans<br />
les différentes régions : Nionfoin et Nabyon dans le<br />
Nord, Lokakpli, N’gattadolikro dans le centre, Gagnoa et<br />
Man a l’ouest. Grâce à ce système, 500 ha sont emblavés<br />
au cours de la campagne 1999/2000 en deux nouvelles<br />
varietes pluviales de riz interspécifiques créées récemment<br />
par l’ADRAO.
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Tableau 2. Importations et exportations de matériel végétal situation partielle.<br />
Rubrique Espèce Matériel Unité<br />
Importations Bananier Vitroplants<br />
u<br />
Légumes Semences<br />
kg<br />
Autres Semences<br />
kg<br />
Quantités<br />
97/98 98/99 99/2000<br />
1 200 000<br />
19 145<br />
23 9<strong>10</strong><br />
180 304<br />
<strong>10</strong> 646<br />
2 373<br />
–<br />
–<br />
–<br />
exportations<br />
Hévéa<br />
Bois de greffe<br />
m<br />
180<br />
–<br />
4 604<br />
Cocotier<br />
Noix<br />
kg<br />
26 000<br />
–<br />
650 000<br />
Autres<br />
Semences<br />
kg<br />
77 530<br />
–<br />
70 000<br />
Ananas<br />
Rejets<br />
kg<br />
–<br />
–<br />
600 000<br />
Dans la mise en oeuvre de ce système sont impliqués les<br />
instituts de recherche (ADRAO, CNRA), les projets<br />
régionaux (PACIL, BAD-OUEST), l’ANADER, le Projet<br />
national riz, les ONG (OVDL et IDC) et l’administration<br />
semencière qui a fait tester et examiner les nouvelles variétés<br />
pendant trois ans en station et chez les paysans, avant<br />
de les admettre au catalogue officiel et les autorités à la<br />
vulgarisation.<br />
Ce système communautaire, s’il s’avérait intéressant, pourrait<br />
servir de modèle à la dissémination des variétés d’autres espèces<br />
cultivées et favoriser le développement du marché local<br />
de semences.<br />
Pour appuyer ce système, le service semencier ivoirien a bénéficié<br />
d’un projet d’appui à la production des semences communautaires<br />
de nouvelles variétés de riz africain. Ce projet est<br />
financé conjointement par l’Etat de Côte d’Ivoire, le PNUD<br />
et la banque mondiale.<br />
Structures de production<br />
• ANADER et CNRA pour les boutures et plants<br />
de caféiers, CNRA pour les cabosses et les<br />
plants de cacaoyer, graines, noix germées et<br />
plants d’arbres fruitiers<br />
• ANADER pour noix et plants d’anacardier,<br />
semences d’oignon<br />
• OCAB pour vitroplants et rejets de<br />
bananiers et d’anans<br />
• CHC, SOGB, SAPH, HEVEGO, SAID, pour<br />
es bois de greffes, plants greffés d’hévéa<br />
• CIDT, PNR, Projet soja, pour la production de<br />
semences de riz, de mais<br />
• CIDT, CNRA pour la production des<br />
semences de coton<br />
• Projet Soja pour la production de semences<br />
de soja<br />
• Association professionnelle des horticulteurs<br />
de Côte d’Ivoire (APHCI) pour les boutures<br />
et plants de plantes ornementales.<br />
Le niveau d’utilisation de matériels<br />
améliorés<br />
– les filières ananas, bananes, papayes, cocotiers, palmiers,<br />
hévéa, coton, ainsi que la filière horticole, utilisent a<br />
<strong>10</strong>0% du matériel; végétal amélioré<br />
– les filières café, cacao utilisent à 40% du matériel sélectionné<br />
issu du CNRA des centres de bouturages gérés par<br />
les services de vulgarisation<br />
– le système vivrier traditionnel, qui connaît un certain<br />
retard est progrressivement pénétré par les semences<br />
améliorées de céréales (maïs, riz) et de plantes à racines<br />
tubercules (manioc, igname)<br />
– La riziculture irriguée emploie les semences améliorées<br />
issues des instituts de recherche et 30% des sulfaces<br />
cultivées en maïs emploient des semences de variétés<br />
sélectionnées de maïs composites<br />
– Les cultures de manioc bénéficient des variétés créées par<br />
le CNRA et l’<strong>IITA</strong><br />
La commercialisation ou distribution<br />
des semences et plants<br />
La commercialisation s’exerce à travers le circuit formel et le<br />
circuit informel, celui-ci drainant le plus important volume<br />
des transactions non contrôlées.<br />
La commercialisation par le circuit formel est dominée par<br />
sociétés d’importation et de distribution de semences de<br />
plantes maraîchères.<br />
Les structures intervenant dans la commercialisation sont :<br />
Semivoire, Aventis Crop Sciences (ex: SOFACO et Rhône<br />
Poulenc), Callivoire, SYNGENTA (ex-Novartis).<br />
La situation partielle des mouvements à l’importation et à<br />
l’exportation est illustrée par le tableau 2<br />
Perspectives<br />
La tendance du marché national des semences et plants est<br />
à la hause, face à l’engouement des populations à l’égard des<br />
programmes de développement agricole.<br />
19
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Tableau 3. Nouvelle organisation de la filière des semences et plants.<br />
Partenaires Acteurs Attributions<br />
Pouvoirs publics<br />
Ministère chargé<br />
de l’enseignement<br />
supérieure et de la<br />
recherche scientifique<br />
Ministère chargé de<br />
l’Industrie<br />
CNRA et autres Instituts<br />
Grandes écoles<br />
Universités<br />
Office ivoirien pour la propriété<br />
industrielle (OIPI)<br />
Amélioration génétique<br />
Création variétale (des lignées)<br />
Expérimentation. Caractérisation<br />
Appui scientifique<br />
Expertise<br />
Gestion du système de protection des<br />
obtentions végétales<br />
Ministère chargé de<br />
L’agriculture et des<br />
ressources animales<br />
Organe consultatif<br />
Comité technique<br />
d’Inscription au catalogue<br />
officiel des espèces et<br />
variétés<br />
Secteur privé<br />
Direction générale des productions<br />
(DGP) et les services spécialisés<br />
(LANADA (laboratoire de<br />
semences), service des semences<br />
et plants, ANADER (service de<br />
vulgarisation, production des<br />
végétaux)<br />
Commission d’homologation et ses<br />
sections specialisées<br />
Familles professionnelles<br />
Entreprises<br />
Coopératives<br />
Laboratoires agréés<br />
ONG<br />
Opérateurs privés :<br />
– agriculteurs<br />
– obtenteurs<br />
– distributeurs<br />
Planification, législation, suivi<br />
et certification, appui divers<br />
facilitation, promotion, accès au<br />
crédit, prévulgarisation, recherche<br />
et développement, vulgarisation,<br />
organisation, conseil, formation,<br />
information et animation, élaboration<br />
et diffusion de catalogue offiiciel des<br />
espèces et variétés.<br />
Examen des variétés<br />
Avis aux pouvoirs publics pour :<br />
– agrément des professionnels<br />
– importation et exportation des<br />
semences et plants<br />
Création variétale<br />
Contrôle de qualité<br />
Production de matériel de base<br />
Production de matériel certifié<br />
Conditionnement<br />
Commerce et distribution<br />
Dans ce contexte les besoins de l’agriculteur sont au centre des<br />
préoccupations de la filière des semences et plants.<br />
L’agriculteur sera associé au processus de recherche et<br />
développement et de prévulgarisation des nouvelles<br />
variétés menées par les services de vulgarisation et les<br />
sélectionneurs. Il prendra aussi une part active dans le<br />
processus de multiplication du matériel végétal sélectionné,<br />
et entrera progressivement dans le partenariat interprofessionnel.<br />
L’appui à la filière des semences et plants doit viser à<br />
la responsabilisation des différents partenaires, à l’émergence<br />
de l’interprofession, basée sur un partenariat, une<br />
synergie et une division du travail schématisée par le tableau<br />
3 qui suit.<br />
Angèle Yao, Chargée de l’Inspection des semences, Ministère de l’agriculture et<br />
des ressources animales (MINAGRA); BP V82, Côte d’Ivoire.<br />
Tel : (+225) 202<strong>10</strong>833 Fax : (+225) 20214618<br />
20
Le secteur semencier en Sierra Leone<br />
A.B. Kargbo<br />
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Introduction<br />
La Sierra Leone est un petit pays qui se présente comme un<br />
cercle irrégulier d’une superficie de 72 300 km 2 (soit 53.620<br />
km 2 de terre arable ou 74,1% de la superficie totale), avec une<br />
population d’environ 4,5 millions, caractérisée par un taux de<br />
croissance annuel de 3%. Il est limité au nord et à l’est par la<br />
République de Guinée ( Conakry), au sud-est par le Liberia<br />
et à l’ouest par l’Océan Atlantique.<br />
Les sols et le climat en Sierra Leone favorisent une bonne<br />
productivité agricole et des revenus agricoles élevés. La topographie<br />
et les précipitations y sont très variées. Il compte<br />
quatre zones agro-climatiques distinctes: les plaines côtières,<br />
la forêt pluviale, la forêt pluviale de transition et les savanes<br />
forestières. Les précipitations chutent de 5,500 mm en<br />
moyenne dans la péninsule de Freetown à environ 2,000<br />
mm le long de la frontière septentrionale. Les températures<br />
moyennes annuelles y varient de 30 à 40 degrés dans la<br />
région côtière et de 34 à 36 degrés à l’intérieur. Près de 75%<br />
des 5,4 millions d’hectares que couvre la Sierra Leone sont<br />
constitués de terres arables réparties en terres de plateaux<br />
relativement peu fertiles (80 %), et en terres marécageuses<br />
fertiles (20 %). Dans l’est et le sud du pays, la pluviométrie,<br />
le climat et les types de sols sont propices à la culture du<br />
café, cacao, caoutchouc et palmier à huile, tandis que dans<br />
le nord, la longue saison sèche et la pratique de la culture<br />
itinérante sont plutôt favorables à la culture des céréales et<br />
des légumineuses et aux maraîchages. Le tabac et la canne<br />
à sucre y sont deux cultures importantes pratiquées par les<br />
petits exploitants et les producteurs contractuels.<br />
Une gamme variée de cultures vivrières y pousse sous jachère<br />
dans les hautes terres. D’après une enquête menée en 1980,<br />
96% des agriculteurs cultivent le riz, et 35% des riziculteurs<br />
pratiquent la culture pure ou la monoculture. Dans<br />
les associations culturales à base de riz, on rencontre souvent<br />
le sorgho, le maïs, le mil, le manioc, le sésame (Sesamum<br />
indicum), le haricot et l’arachide. La plupart des paysans<br />
sèment le riz de première saison après écobuage, et on y<br />
observe une variété de séquences culturales dont riz-jachère,<br />
riz-riz, riz-arachide, riz-manioc, riz-mil, riz-sorgho (et autres<br />
petites céréales).<br />
Les sols des bas-fonds marécageux sont relativement plus<br />
fertiles et se prêtent à une densité culturale plus forte. Traditionnellement,<br />
les producteurs préfèrent les hautes terres, mais<br />
le gouvernement encourage une plus grande utilisation des<br />
vallées intérieures du fait des multiples potentialités qu’elles<br />
renferment.<br />
Alors que les milieux salins constitués par les marécages de<br />
mangrove n’offrent qu’une seule culture de riz, les périmètres<br />
herbacés environnants peuvent, quant à eux, permettre des<br />
cultures multiples sur les digues et les terres plus hautes.<br />
Le système de multiplication des<br />
semences et plants (système formel)<br />
Les institutions qui interviennent dans la création et les<br />
essais variétaux sont la Station de recherche sur le riz (RRS)<br />
et l’Institut de recherche agricole (IAR) qui sélectionnent et<br />
lancent des hybrides, par le truchement du National Seed<br />
Board-NSB (Office national des semences), de même que<br />
des variétés améliorées pour multiplication et distribution<br />
à l’échelle nationale à travers le Projet de multiplication<br />
semencière.<br />
Ce projet maintient trois exploitations de sélection conservatrice<br />
dans chacun de ses trois centres semenciers afin de<br />
confirmer la pureté et la qualité des semences fournies sous<br />
forme de panicule aux producteurs contractuels.<br />
Le riz bénéficia de la plus grande attention. Ceci n’est guère<br />
surprenant d’autant que la production de riz, principale<br />
denrée de base en Sierra Leone, n’a pas atteint le niveau<br />
d’autosuffisance alimentaire prévu pour les dix dernières<br />
années. En effet, pour faire face à la demande nationale en<br />
matière de consommation de riz, le gouvernement sierra<br />
léonais a, pendant la même période, dépensé chaque année<br />
en moyenne 20 millions de dollars des Etats-Unis pour<br />
importer du riz.<br />
Sélection paniculaire comme méthode<br />
de conservation varietale<br />
Cette méthode est souvent appliquée aux cultures autogames<br />
telles que le riz. En effet, il s’agit souvent d’un mélange de plusieurs<br />
lignées pures homozygotes. Des lignées pures peuvent<br />
être obtenues par la sélection et la multiplication de panicules<br />
simples. Les panicules ainsi sélectionnées sont baptisées Génération<br />
Zéro ou G0.<br />
Elles sont semées en lignes pures, en pépinière, avec la panicule<br />
d’une variété donnée semée en une seule ligne. Le repiquage<br />
est réalisé par variété, en plein champ et en lignes simples séparées.<br />
L’élimination de plants malades doit être permanente.<br />
La prochaine génération est ainsi obtenue et est intitulée<br />
Génération 1 ou G1. La poursuite de l’opération<br />
de conservation conduit à la génération appelée G2<br />
(Génération 2).<br />
Lors des diverses phases d’entretien une grande attention<br />
est accordée au développement de la plante. Toutes les<br />
pratiques culturales, notamment l’épuration, sont mises<br />
en œuvre.<br />
De G2, l’obtention se développe en semence homologuée qui<br />
peut être mise à la disposition du producteur. Le producteur<br />
contractuel intervient dans toutes ces opérations à l’exception<br />
du programme G0.<br />
21
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Population en<br />
culture<br />
Semence certifiée<br />
Semence<br />
certifiée<br />
Sélection paniculaire<br />
Selection de la panicule<br />
Fermage<br />
sous<br />
contrat<br />
Generation<br />
zero “G 0”<br />
1 ère generation<br />
“G 1”<br />
2 ème generation<br />
“G 2”<br />
La multiplication semencière fait intervenir différentes étapes<br />
ou méthodes. Mais de manière générale, sélectionneurs, agences<br />
agricoles et agences semencières internationales, dans bon<br />
nombre de pays de par le monde, ont retenu quatre étapes<br />
essentielles. Au Projet de multiplication des semences en<br />
Sierra Leone, ces quatre étapes sont utilisées avec quelques<br />
amendements mineurs :<br />
Semence de pré-base<br />
La semence de pré-base est obtenue à la Station nationale<br />
de recherche sur le riz à Rokupr après plusieurs années de<br />
sélection et d’essais-rendement. Les pratiques culturales sont<br />
normalement déterminées pendant la même période. Les<br />
essais en milieu réel commencent d’habitude autour de la<br />
génération F5-F7 selon le degré d’uniformité des caractères<br />
recherchés. Ainsi, la semence de pré-base est le matériel le<br />
plus pur en matière de pureté variétale ; elle est produite par<br />
le sélectionneur lui-même ou son contrôle direct. Il s’agit de la<br />
toute première étape de la multiplication semencière à petite<br />
échelle. C’est aussi une base constante pour l’augmentation<br />
de la semence de base. En ce moment, la semence de pré-base<br />
est maintenue comme la génération zéro (G0) par le Projet<br />
de multiplication semencière.<br />
Semence de base<br />
Après que le sélectionneur ait donné un nom à la variété, la<br />
semence est désignée semence de base et lancée par la NSB. La<br />
semence de base est ensuite mise en culture ou en multiplication<br />
par le sélectionneur ou, dans notre cas, par les producteurs<br />
de semences de base. La nomenclature du SMP pour cette<br />
catégorie de semences relève de la première génération (G1) et<br />
de la deuxième génération (G2). La production de semences<br />
de base pourrait bien se faire en station expérimentale, par<br />
exemple à RRS Rokupr, lieu de multiplication de la semence<br />
de pré-base. Quel que soit le producteur de semences de base<br />
choisi parmi les contractuels du SMP, la production doit être<br />
surtout contrôlée et approuvée. La semence de base est à l’origine<br />
de toutes les autres catégories de semences.<br />
Semence homologuée. C’est la troisième étape du processus<br />
de multiplication des semences. Les semences homologuées<br />
proviennent des semences de base. Les opérations de production<br />
et de manutention doivent répondre à certaines normes<br />
établies par les agences publiques et les sélectionneurs. Pour<br />
la production de semences certifiées, la qualité requise doit<br />
être satisfaite. Une superficie de 3000 hectares (7500 acres) a<br />
été consacrée à la multiplication des treize variétés populaires<br />
initialement multipliées.<br />
Semence certifiées. Celle-ci constitue la 3 e ou la 4 e phase de<br />
la multiplication des semences pour une large distribution<br />
aux paysans. Il s’agit de descendants de semences de base et de<br />
semences homologuées. Les agents certificateurs doivent être<br />
qualifiés. Le gros des semences de riz distribuées aux producteurs<br />
dans le cadre du Projet de multiplication des semences<br />
Production de semences de base et homologuées pendant la campagne 1994/95.<br />
A multiplier Superficie Rendmt projeté<br />
No. Variété Catégorie Station en kg couverte Hectares % x 12 bu/ac<br />
1. ROK 3 G1 Makeni 140.000 5600 2240,00 80,14 67.200<br />
2. ROK 3 G1 Kobia 500 20 8,00 0,29 240<br />
3. ROK <strong>10</strong> G1 Makeni <strong>10</strong>.000 400 160,00 5,72 4.800<br />
4. ROK <strong>10</strong> G1 Kobia 7.250 290 116,00 4,15 3.480<br />
5. ROK 14 G1 Makeni 1.250 50 20,00 0,72 600<br />
6. Lac 23 (ROK 17) G1 Makeni 5.000 200 80,00 2,86 2.400<br />
7. CP 4 G1 Makeni 6.400 256 <strong>10</strong>2,40 3,66 3.072<br />
8. ROK 22 G1 Kobia 1.850 74 29,60 1,06 888<br />
9. ROK 24 G1 Makeni 2.450 98 39,20 1,40 1.176<br />
Total 174.700 6988 2795 ,20 <strong>10</strong>0,00 83.856<br />
Note :<br />
Par rapport aux récoltes projetées en 1995 avec des rendements minimums atteignant 83.856 boisseaux, 54.027 boisseaux ont été réalisés, soit<br />
un déficit de 29.829 boisseaux (35,5 %) imputable à la guerre menée par les rebelles, guerre ayant provoqué le déplacement d’environ 40% des<br />
producteurs contractuels à l’époque des récoltes.<br />
22
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
provient de la catégorie des semences homologuées telle que<br />
décrite ci-dessus. Les paysans ou les organismes utilisateurs<br />
peuvent recycler ces semences pendant 2 ou 3 ans avant de<br />
solliciter leur renouvellement par le SMP.<br />
6.1 Au total, le tableau régulier de la production de semences<br />
de riz pour les différentes catégories et pour chaque campagne<br />
annuelle se décompose comme suit :<br />
Acres<br />
Hectares<br />
G0 Semences pré-base <strong>10</strong> 4,0<br />
G1) Semences de base 82 32,8<br />
G2) 655 262,0<br />
RS Semences homologuées 6241 2496,4<br />
6988 2795,2<br />
Le système informel<br />
La diffusion des semences améliorées et d’autres matériels de<br />
plantation fournis par les stations de recherche, de même que<br />
celle du matériel de source non officielle, s’effectue progressivement<br />
par échange d’un paysan à un autre. Cette pratique est<br />
très répandue parmi les paysans sierra leonais pour les cultures<br />
et les espèces ligneuses d’intérêt économique.<br />
Souvent, les variétés ou les cultivars introduits sont baptisés<br />
selon que le paysan à l’origine de l’introduction appartienne<br />
à telle ou telle localité. Les systèmes semenciers autochtones<br />
sont caractérisés par de faibles niveaux d’organisation et de<br />
développement institutionnel. Ils sont connus sous différentes<br />
appellations. Les expériences d’Afrique et d’ailleurs<br />
montrent que les petits exploitants des systèmes traditionnels<br />
ont leur propre capacité à produire et à distribuer des<br />
semences.<br />
L’appui d’urgence de la FAO à la<br />
production de semences de riz de<br />
qualité en Sierra Leone<br />
La dernière guerre des rebelles a eu de graves répercussions sur<br />
la filière de la multiplication des semences en Sierra Leone. Le<br />
Projet de multiplication semencière, fruit d’un accord bilatéral<br />
entre les gouvernements de Sierra Leone et de la République<br />
Fédérale d’Allemagne, fut chargé de la conservation des<br />
semences de qualité et de l’approvisionnement des paysans<br />
en semences de 1980 à 1998. En raison de cette guerre, tous<br />
les trois centres régionaux appuyés par le Projet ont fermé leurs<br />
portes. Actuellement, le pays ne dispose d’aucune institution<br />
pour s’occuper de la conservation et de la multiplication des<br />
semences de qualité dont les semences de base et les semences<br />
certifiées.<br />
L’utilisation des pratiques agricoles traditionnelles a induit<br />
une forte baisse de rendements chez les cultures vivrières<br />
annuelles, et chez le riz en particulier. L’absence de technologies<br />
a aussi contribué à la chute de productivité et de<br />
rentabilité de ces systèmes de production. En outre, la<br />
guerre conduite pendant dix ans par les rebelles a entraîné<br />
un exode massif des populations rurales, des pertes matérielles<br />
et une destruction des infrastructures qui a mis à<br />
mal la production agricole et vivrière. En particulier, la<br />
sécurité alimentaire des ménages s’est considérablement<br />
détériorée. Malgré la faiblesse des rendements, le riz continue<br />
d’occuper la première place dans le panier alimentaire<br />
des ménages ruraux.<br />
Actuellement, plusieurs agences interviennent dans la fourniture<br />
d’intrants agricoles aux paysans vulnérables, de même<br />
qu’aux personnes qui retournent au pays et aux déplacés<br />
internes. Pendant la grande campagne de l’année 2000, au<br />
total 6.826 tonnes de semences de riz ont été distribuées pour<br />
couvrir une surface estimée à <strong>10</strong>9.225 ha. La majeure partie<br />
des semences de riz distribuées aux paysans etait achetée sur<br />
place. Pour faire face à la hausse de la demande en semences<br />
de riz de bonne qualité, le projet veut répondre à l’urgente<br />
nécessité d’institutionnaliser le système de production de<br />
semences en fournissant aux producteurs des intrants pour la<br />
production de semences de riz de qualité et en les formant en<br />
techniques de production semencière.<br />
Le projet ciblera des zones sécurisées et accessibles dans les<br />
districts de Bombali et de Moyamba, les chefferies de Koya et<br />
de Lokomasama dans le district de Port Loko; et les chefferies<br />
de Mambolo, Magbema et Masungbala dans le district de<br />
Kambia. Dans ces zones, les paysans ont accès aussi bien aux<br />
hauts plateaux qu’aux basses terres pour la multiplication de<br />
semences de riz. L’augmentation de la production de semences<br />
de qualité dans ces régions aidera à combler les déficits de<br />
production dans les zones qui souffrent encore des incursions<br />
de rebelles. Les enseignements tirés du projet permettront<br />
d’étendre les activités de production semencière l’année suivante<br />
afin de mettre en place un système de contrôle de qualité<br />
impliquant les communautés.<br />
Objectifs de l’assistance<br />
Le but du projet est d’accroître la sécurité alimentaire en augmentant<br />
la production rizicole. Ses activités iront en complément<br />
à l’aide d’urgence fournie en matière agricole, et seront<br />
adaptées aux conditions locales. Ses objectifs se présentent<br />
comme suit :<br />
i. Apporter de l’aide à 500 agriculteurs dans la gestion du<br />
système de production de semences de riz de qualité supérieure<br />
dans les districts de Bombali et de Moyamba, et<br />
dans les chefferies de Koya et Lokomasama dans le district<br />
de Port Loko ; et les chefferies de Mambolo, Magbema et<br />
Masungbala dans le district de Kambia.<br />
ii.<br />
Garantir la hausse de la production alimentaire en fournissant<br />
aux producteurs de semences des intrants et une<br />
formation en techniques de production appropriées en<br />
vue de la production de semences de qualité supérieure.<br />
iii. Accroître le nombre de producteurs de semences de qualité<br />
et veiller à la disponibilité à temps de telles semences<br />
à des prix raisonnables.<br />
iv. Réhabiliter la banque de gènes des cultivars de riz dans les<br />
microclimats où il existe une forte demande de semences<br />
de riz, notamment de variétés locales.<br />
23
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Programme de travail<br />
Le projet sera exécuté par la FAO en collaboration étroite<br />
avec le personnel du projet de production des semences à<br />
MAFMR, la Station de recherche sur le riz, l’ICRC et d’autres<br />
partenaires. Au démarrage du projet, MAFMR identifiera un<br />
coordonnateur national de projet et la FAO recrutera deux<br />
consultants nationaux (1 spécialiste de la multiplication des<br />
semences et 1 agronome). Le comité se réunira régulièrement<br />
pour dresser l’état d’avancement du projet et relever les contraintes<br />
rencontrées dans l’exécution du projet.<br />
A peu près 500 paysans ayant des expériences en matière<br />
de production semencière seront identifiés. Trente paysans<br />
novateurs, soit cinq de chacune des chefferies cibles seront<br />
sélectionnés pour une formation aux aspects de gestion de la<br />
production semencière. Ces derniers formeront à leur tour<br />
leurs voisins à travers des contacts personnels ; les parcelles de<br />
production semencière feront office de parcelles de démonstration.<br />
En gros, un périmètre de <strong>10</strong>00 acres sera consacré aux<br />
activités semencières, soit 300 acres dans les hauts plateaux et<br />
700 acres dans les basses terres. Cette répartition peut varier<br />
compte tenu de l’adaptabilité pour la production semencière.<br />
Les variétés à très haut rendement telles que ROK 3, ROK<br />
5, ROK <strong>10</strong>, ROK 16, ROK 17, ROK 23, et ROK 24 seront<br />
produites et distribuées aux producteurs de semences. Ce<br />
programme est actuellement en cours.<br />
Résultats attendus<br />
Les résultats attendus sont :<br />
i. Au total 500 familles agricoles bénéficieront directement de<br />
conseils techniques et d’une formation en matière de production<br />
et de transformation dans les districts de Bombali et<br />
de Moyamba, et dans les chefferies de Koya et Lokomasama<br />
dans le district de Port Loko, et les chefferies de Mambolo,<br />
Magbema et Masungbala dans le district de Kambia.<br />
ii.<br />
Des semences de source sûre seront disponibles pour<br />
une multiplication et une distribution plus poussées. Un<br />
minimum de <strong>10</strong>20 tonnes de semences (180 tonnes des<br />
300 acres des hauts plateaux, soit un rendement de 600<br />
kg/acre et 840 tonnes des 700 acres des basses terres, soit<br />
un rendement de 1200 kg/acre) de qualité fiable sera produit.<br />
Les semences ainsi obtenues suffiront pour couvrir<br />
4500 acres dans les hauts plateaux et 42 000 acres dans les<br />
basses terres au cours de la campagne rizicole suivante.<br />
iii. L’augmentation en qualité et en quantité des semences<br />
disponibles renforcera les capacités communautaires dans<br />
le domaine de la production semencière. Aussi, assisterat-on<br />
à l’émergence de groupements de producteurs de<br />
semences de très haute qualité.<br />
iv. La hausse de la production vivrière entraînera de meilleures<br />
conditions socio-économiques pour les agriculteurs.<br />
Le rôle de la vulgarisation agricole dans la<br />
distribution et l’utilisation des semences<br />
Durant cette période d’urgence consécutive à la guerre, l’industrie<br />
semencière s’emploie à distribuer des semences de variétés<br />
locales et améliorées de riz, d’arachide et de légumes.<br />
Les contraintes auxquelles l’industrie semencière est confrontée<br />
sont :<br />
• perte rapide de la pureté des semences de riz, et donc leur<br />
remplacement au bout de quelques années ;<br />
• importation de variétés de palmier à huile sans aucun<br />
renseignement sur les caractéristiques d’adaptabilité ;<br />
• stockage de semences légumières pendant de longues<br />
périodes et leur vente sans des tests de germination préalables<br />
au laboratoire d’analyses des semences du NSB.<br />
En outre, les agents vulgarisateurs traitent avec les petits producteurs<br />
qui emploient les petites technologies et sont plus<br />
habitués aux méthodes traditionnelles. Le ministère responsable<br />
des services de vulgarisation, actuellement en cours de restructuration,<br />
apporte une contribution minimale pour l’éducation<br />
des agriculteurs sur les questions de vulgarisation.<br />
Pour les raisons ci-avant, il importe de fournir un appui économique<br />
et technique au développement et à l’amélioration des<br />
systèmes agricoles utilisés par les petits exploitants pauvres.<br />
Le rôle de la vulgarisation agricole<br />
La vulgarisation agricole vise à :<br />
• expliquer les techniques qui sous-tendent la<br />
distribution et l’utilisation des variétés améliorées<br />
• démontrer les méthodes modernes de production<br />
de semences améliorées<br />
• montrer l’impact de l’emploi des semences distribuées<br />
Il faut une vulgarisation efficace pour garantir des pratiques<br />
agricoles supérieures, et ce pour obtenir de bonnes semences<br />
et renforcer l’utilisation/l’adoption des technologies de haut<br />
niveau.<br />
Des messages et pratiques techniques saines et adéquates,<br />
accompagnés d’un soutien économique opportun aux opérations<br />
agricoles, permettront :<br />
• de minimiser les risques et la réticence des paysans à<br />
adopter de nouvelles technologies semencières.<br />
• d’augmenter la confiance des producteurs à accepter et à<br />
s’impliquer eux-mêmes dans l’élaboration des nouvelles<br />
technologies à même d’avoir un impact important sur<br />
leur vie.<br />
• d’aider les producteurs à bien comprendre les différents<br />
aspects de la technologie ainsi que l’importance des<br />
semences distribuées.<br />
Ce sont là les effets initiaux d’une adoption continue de la<br />
technologie semencière.<br />
Les éléments relatifs aux pratiques améliorées englobent :<br />
• un bon choix de semences<br />
• un semis opportun<br />
• un taux d’ensemencement adéquat<br />
• des recommandations appropriées pour l’épandage des<br />
engrais et les méthodes utilisées<br />
• le désherbage adéquat à temps<br />
• une formation en plein champ à l’utilisation de pratiques<br />
améliorées susceptibles d’accroître le rendement cultural,<br />
24
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
dispensée aux associations paysannes dans les régions non<br />
touchées par la guerre<br />
• la culture en composante secondaire de variétés améliorées<br />
précoces de pomme de terre dans les bas-fonds<br />
(marécages) aménagés<br />
• la multiplication et la distribution de boutures de manioc<br />
amélioré exemptes de mosaïque<br />
Efforts en matière de recherche<br />
Les progrès enregistrés dans le domaine de la recherche<br />
dans l’industrie semencière couvrent les principales cultures<br />
vivrières de la Sierra Leone. L’objectif est de créer des variétés<br />
améliorées à haut rendement et résistantes aux maladies et<br />
ravageurs, et de mettre au point des pratiques agronomiques<br />
à même d’accroître la production des variétés améliorées.<br />
Le riz<br />
La Station de recherche sur le riz (RRS) qui détient un mandat<br />
exclusif pour l’amélioration du riz, a obtenu NERICAS, un nouveau<br />
plant de riz mise au point par l’ADRAO. Ce matériel est en<br />
cours de transformation en semences de base puis homologuées<br />
en vue d’une large distribution aux paysans riziculteurs.<br />
Autres cultures vivrières<br />
Le manioc, la patate douce, le maïs, l’igname, le niébé, et le soja<br />
sont en cours d’évaluation aux fins d’amélioration variétale.<br />
Le manioc et la patate douce<br />
De hauts rendements ont été élaborés pour ces cultures précoces<br />
et très prisées par les consommateurs. Depuis 1986, des<br />
variétés de manioc et de patate douce plus productives que<br />
les variétés locales ont été créées dans des conditions à faible<br />
apport d’intrants (par exemple sans engrais).<br />
Le maïs<br />
Trois variétés performantes à bonne teneur protéique sont<br />
actuellement en cours de promotion. Le pop corn est un<br />
amuse-gueule très populaire en Sierra Leone. Ces variétés<br />
sont toujours en cours d’évaluation malgré qu’elles ne soient<br />
pas très prometteuses.<br />
Arachide<br />
Plusieurs variétés notamment JL 24, Marace, Gambe, etc. ont<br />
été mises au point. Bien qu’elle soit considérée comme une<br />
variété très prometteuse, la JL 24 a produit des gousses vides<br />
ces dernières années.<br />
Le niébé<br />
Trois variétés à graine blanche sont actuellement en cours de<br />
multiplication et de distribution. Il est recommandé de semer le<br />
niébé en petite saison à partir du mois d’octobre chaque année,<br />
quand il pleut moins, afin de limiter les avortements floraux.<br />
L’igname<br />
Les activités sur l’igname ont démarré en 1999 avec environ 200<br />
génotypes provenant de l’<strong>IITA</strong>. Dans le domaine du transfert de<br />
technologies, l’Institut de recherches agricoles promeut<br />
• l’élaboration de guides de production végétale<br />
• la publicité électronique et de presse<br />
• les ateliers participatifs<br />
• les stations extérieures (5), pour la mise au point de<br />
matériel de plantation<br />
Synthèse des données de production/récupération du projet de multiplication semencière 197–1994<br />
Année<br />
Coût de production/Bu<br />
Le<br />
Total<br />
(25 kg Bu)<br />
Tonnes<br />
métriques<br />
Prix de vente/<br />
Bu Le<br />
Montant (revenu)<br />
Le M<br />
Subvention<br />
Le M total<br />
Nb total<br />
hectares<br />
Nb. paysans<br />
contractuels<br />
1978/79 49,00 12.000,00 300,00 9 0,<strong>10</strong>8 0,480 3636,40 304<br />
1979/80 43,00 25.217,00 630,43 12 0,303 0,782 731,30 706<br />
1980/81 42,00 27.631,00 690,78 12 0,332 0,829 1.666,30 1.250<br />
1981/82 66,00 15.267,00 381,68 15 0,229 0,776 1.551,00 1.560<br />
1982/83 50,00 31.911,00 797,78 25 0,798 0,798 1.680,00 2.000<br />
1983/84 46,00 54.769,00 1.369,9 30 1,644 0,877 2.046,00 2.575<br />
1984/85 61,00 31.733,00 793,33 35 1,111 0,825 2.400,00 2.875<br />
1985/86 77,00 31.564,00 789,<strong>10</strong> 75 2,367 0,063 2.345,00 3.000<br />
1986/87 728,00 74.000,00 1.850,00 560 41,400 12,430 3.113,60 4.123<br />
1987/88 1.118,00 45.000,00 1.125,00 860 38,700 11,6<strong>10</strong> 4.318,40 5.962<br />
1988/89 1.118,00 50.000,00 1.250,00 860 43,00 12,900 3.413,60 4.509<br />
1989/90 1.573,00 80.000,00 2.000,00 1.2<strong>10</strong> 96,800 29,040 3.322,40 4.227<br />
1990/91 2.470,00 55.634,00 1.390,00 1.900 <strong>10</strong>5,705 31,7<strong>10</strong> 3.423,20 3.658<br />
1991/92 6.890,00 40.078,00 1.001,95 5.300 212,413 63,720 2.654,40 2.870<br />
1992/93 11.437,50 80.533,00 2.013,33 9.000 724,797 196,300 2.684,00 2.197<br />
1993/94 11.437,50 95.253,22 2.381,33 9.000 857,279 232,180 3.184,00 3.044<br />
Total 37206,00 750.617,22 18.765,43 28.903 2.126,896 595,320 38.896,60 44.860<br />
Moyennes 2,325,38 46.913,58 1.172,84 1.806,44 132,937 37,208 2.431,04 2.803,75<br />
Note:<br />
1978–1980 Le projet tenait ses propres exploitations. Fermage contractuel intensifié après 1980.<br />
Quantité moyenne récupérée = 0,47 tonnes métriques /hectare (18,63 boisseaux) soit approximativement 7,45 boisseaux/acre de semences de riz traités.<br />
25
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Contraintes et goulots d’étranglement au<br />
developpement de l’industrie semencière<br />
La politique et la règlementation semencières<br />
Peu de place faite au secteur privé dans la polique<br />
semencière du gouvernement. Des lois appropriées et<br />
une politique claire sont essentielles au développement de<br />
la filière semencière. Ces instruments devraient préciser les<br />
objectifs du gouvernement en ce qui concerne la production<br />
et la distribution des semences, définir les rôles des secteurs<br />
public et privé, et identifier des mesures spécifiques visant<br />
à stimuler la participation du secteur privé. Les cadres politiques<br />
devront être définis ensemble avec toutes les parties<br />
prenantes. Les politiques varient souvent en fonction du<br />
niveau de développement atteint par la filière semencière<br />
dans les pays.<br />
Faiblesse ou absence de lois et règlements semenciers. Les<br />
législations semencières sont sensées favoriser le développement<br />
de la filière et encourager les innovations.<br />
L’absence de droits pour l’obtenteur. Cette situation constitue<br />
une entrave à l’investissement étranger sur le marché<br />
semencier national et à l’épanouissement des opérateurs<br />
semenciers nationaux. Les droits de l’obtenteur doivent aussi<br />
s’appliquer au secteur public. Ceci inciterait les programmes<br />
d’amélioration variétale mises en oeuvre par ce secteur.<br />
Procédures d’homologation/enregistrement des variétés.<br />
Les procédures de lancement et d’homologation des nouvelles<br />
variétés sont souvent trop lourdes et parfois partiales ou subjectives.<br />
Dans bon nombre de pays, l’introduction de variétés<br />
de sources étrangères n’est guère aisée. Diverses actions doivent<br />
être prises afin d’améliorer la diffusion des variétés modernes<br />
au profit des agriculteurs.<br />
Manque de mesures incitatives en faveur du secteur privé.<br />
Les gouvernements devront déployer d’énormes efforts pour<br />
attirer l’investissement privé. Les mesures incitatives au profit<br />
des firmes privées devront être renforcées. En effet, les activités<br />
semencières ne sont rentabilisées qu’à long terme.<br />
Les secteurs public et privé<br />
Associations de l’industrie semencière. L’absence d’associations<br />
semencières professionnelles est perçue comme une contrainte<br />
majeure. La formation de ces associations (présentes<br />
dans la plupart des économies développées) garantira la prise<br />
en compte effective des préoccupations du secteur privé dans<br />
la formulation de la politique semencière. En outre, cela aidera<br />
à une meilleure coordination au sein du secteur privé d’une<br />
part, et entre les entreprises privées et les agences chargées de la<br />
réglementation d’autre part. La FAO et les agences donatrices<br />
ont fourni l’appui nécessaire au secrétariat de l’Association<br />
Semencière Asie-Pacifique. Cette dernière peut servir de<br />
modèle pour l’Afrique de l’Ouest.<br />
Promotion de nouvelles variétés. Davantage d’efforts doivent<br />
être déployés afin d’encourager la demande des semences<br />
de variétés modernes. Diverses méthodes publicitaires devront<br />
être utilisées.<br />
Manque de synergie entre les secteurs, public et privé. Une<br />
synergie renforcée aiderait à éliminer la duplication des efforts<br />
et à permettre à l’un ou l’autre secteur de se focaliser sur les<br />
avantages comparatifs respectifs.<br />
Rôles des instituts nationaux et<br />
internationaux<br />
Production de semences de pré-base. Cette activité apparut<br />
comme un important goulot d’étranglement en Sierra Leone.<br />
La production des semences de pré-base incombe aux programmes<br />
nationaux. Toutefois sur ce plan, les centres de recherche<br />
agricole internationaux (CIRA) peuvent être appelés à jouer<br />
un rôle de catalyseur et fournir le matériel initial à certains<br />
programmes nationaux.<br />
Priorités en matière de recherche. L’impact de la recherche<br />
est limité du fait du faible niveau d’adoption d’un nombre<br />
élevé des variétés améliorées disponibles et de l’adaptation<br />
insuffisante de certaines variétés. Ces problèmes persistent<br />
du fait d’une documentation insuffisante sur l’adoption des<br />
variétés et leur impact.<br />
Rôles des ONG et des groupements de<br />
producteurs<br />
En dehors des situations de crise et de développement, les<br />
ONG devraient en général s’atteler au renforcement des<br />
capacités et à la formation, plutôt qu’à des interventions<br />
directes. Elles devraient chercher à renforcer les institutions,<br />
les installations et structures administratives locales, plutôt<br />
qu’à développer de nouveaux canaux et structures ; aider<br />
à la création de groupements de producteurs et d’organisations<br />
communautaires similaires, renforcer les capacités<br />
locales dans des domaines clefs et déléguer progressivement<br />
les responsabilités aux communautés locales ; aider les<br />
groupements de producteurs « informels » à s’insérer<br />
dans un cadre plus formel (ex : sociétés agréées, financement<br />
de crédit ).<br />
Manque de compétences d’entreprise. Même les producteurs<br />
qui possèdent des aptitudes en matière de production<br />
semencière sont souvent peu qualifiés quant à la commercialisation,<br />
la gestion des petites entreprises, la tenue des comptes<br />
et la comptabilité. Les ONG doivent, au besoin, fournir une<br />
formation adéquate dans ces domaines.<br />
Manque de compétence des ONG. La plupart des ONG<br />
n’ont pas l’esprit d’entreprise et ont des lacunes dans la gestion<br />
des petites entreprises. Elles ne peuvent donc renforcer<br />
les communautés dans ces domaines. Les ONG elles-mêmes<br />
auraient besoin d’une formation et d’un appui que les agences<br />
donatrices ou publiques pourraient fournir.<br />
Faible organisation des communautés. Les ONG et les<br />
groupements de producteurs devront renforcer les organisations<br />
communautaires. Ceci aiderait les communautés locales<br />
à mieux articuler leurs besoins et faciliterait leur responsabilisation.<br />
Ainsi, elles prendront conscience de leurs droits et<br />
obligations. Le cas échéant, la formation sur la dynamique de<br />
groupe devrait être envisagée.<br />
26
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Manque de coordination entre les ONG et les agences<br />
publiques. Les ONG devront tisser des liens étroits avec les<br />
services de vulgarisation et d’autres agences publiques intervenant<br />
dans la même zone. Ceci pourrait aider à garantir la<br />
complémentarité entre les différentes agences, maximiser les<br />
avantages comparatifs, et minimiser la duplication des efforts<br />
ainsi que le gaspillage des ressources.<br />
Problème de durabilité. Beaucoup de groupements de producteurs<br />
et d’ONG disparaissent dès que l’appui des bailleurs<br />
de fonds leur est retiré. La durabilité des petits projets semenciers<br />
communautaires peut être garantie grâce à une meilleure<br />
conception des programmes mettant l’accent sur la viabilité<br />
économique, des interventions acceptables au plan social, et<br />
une structure de développement encline à l’autonomie et<br />
financièrement stable.<br />
Plan semencier d’urgence<br />
L’opportunité du financement. Les plans d’urgence font<br />
appel à un appui logistique complexe ainsi qu’à des ressources<br />
financières importantes. Une mobilisation rapide des fonds<br />
revêt une importance cruciale. Qui plus est, la capacité des<br />
dispositifs d’urgence à obtenir et à distribuer des semences<br />
devra être renforcée. Pour ce faire, des stocks de semences de<br />
sécurité devront être normalement mis en place dans chaque<br />
district ou région. Des ponts pourraient être établis avec les<br />
stocks nationaux afin de disposer d’un stock tampon régional<br />
pour les situations de crise. Présentement, la mise en place de<br />
ces stocks se heurte aux difficultés de financement. Toutefois,<br />
cette mesure pourrait être initiée grâce aux dispositions qui<br />
pourraient être déjà prises en prévision d’une prochaine crise.<br />
Coordination. Une mauvaise coordination entre les agences<br />
est due à plusieurs facteurs : plans de secours mal conçus,<br />
manque d’informations sur les circuits semenciers, mauvais<br />
ciblage (sur-offre/pénuries) lié aux difficultés à évaluer le<br />
nombre de ménages affectés, suivi inadéquat des mouvements<br />
et de l’adoption des semences, détournement des semences de<br />
l’usage alimentaire, et mauvaise coordination entre les agences<br />
chargées de l’exécution et/ou entre les donateurs, les ONG et<br />
le gouvernement.<br />
Qualité semencière. Il est impossible d’imposer des règlements<br />
stricts, les semences étant généralement importées dans<br />
des situations d’urgence où la disponibilité est plus déterminante<br />
que la qualité, d’où le risque d’introduire des maladies<br />
et ravageurs exotiques. Un tel risque ne saurait être écarté.<br />
Toutefois, il peut être minimisé si les fournisseurs de semences<br />
communiquent aux agences de secours les informations sur<br />
la sensibilité aux maladies/ravageurs, la qualité de la graine,<br />
l’adaptation, la phénologie, le taux de semis, la performance<br />
escomptée, pour chaque variété stockée. Sur la base de ces<br />
informations, les agences de secours pourront prodiguer des<br />
conseils aux producteurs.<br />
Adaptation. A cause du manque de temps ou de semences<br />
convenables, les agences de secours sont souvent obligées de<br />
distribuer du matériel non adapté ou totalement inadéquat,<br />
ex : distribution de variétés hybrides pour répondre à la pénurie<br />
en variétés-populations.<br />
Durabilité. Un certain nombre d’installations et de mécanismes<br />
(ex : structures de stockage, méthodes de suivi, canaux de distribution)<br />
sont élaborés lors du déploiement des plans de secours.<br />
Mais en général, aucune politique n’existe quant aux mesures à<br />
prendre après le retrait des agences de secours. En conséquence,<br />
les communautés locales sont souvent incapables d’utiliser ces<br />
installations en renfort à leur propre capacité à répondre aux<br />
situations d’urgence futures ou de veiller à ce que ces mécanismes<br />
continuent de fonctionner en situation normale.<br />
Les sytèmes d’information sur les<br />
semences<br />
Mauvaise compréhension des besoins et pratiques des<br />
producteurs. La circulation de l’information entre le sélectionneur<br />
et le producteur est souvent insuffisante, ce qui se<br />
traduit par la création de cultivars non adaptés, et donc une<br />
faible adoption. Divers facteurs expliquent cette situation. Il<br />
est possible que les producteurs qui participent aux essais ne<br />
soient pas représentatifs de leurs communautés (par exemple<br />
en termes de genre, de la taille de l’exploitation et des attitudes<br />
vis-à-vis des risques ). Le manque de communication entre les<br />
producteurs novateurs et le reste de la communauté tend à<br />
limiter l’adoption. Enfin, le manque de données sur l’adoption<br />
limite l’aptitude du sélectionneur à identifier les contraintes et<br />
à répondre à la préférence exprimée par les producteurs.<br />
Manque d’informations sur les variétés disponibles. L’information<br />
ne circule pas efficacement entre les sélectionneurs<br />
et le personnel chargé de la vulgarisation, et entre les sociétés<br />
(notamment celles du secteur public) et les paysans. Ces derniers<br />
ne sont pas souvent renseignés sur la disponibilité, le prix<br />
et les caractéristiques des variétés modernes qui ont été créées<br />
mais qui n’ont pas fait l’objet d’une large diffusion. Le flux de<br />
l’information s’améliorera avec une plus forte implication du<br />
secteur privé. En effet, pour survivre, les firmes privées doivent<br />
compter sur un système de commercialisation efficace et<br />
répondre promptement aux besoins exprimés par les producteurs.<br />
Toutefois, vu que le secteur public a des chances de jouer<br />
un rôle plus important dans un futur proche, la National Seed<br />
Board devra assurer la diffusion de l’information au public.<br />
Conclusions/recommandations/<br />
perspective<br />
Bien qu’il soit considéré comme un secteur de développement<br />
prioritaire, l’agriculture fut longtemps privée de ressources<br />
avec de graves conséquences pour l’économie rurale et<br />
donc, pour l’économie nationale. Parallèlement, l’environnement<br />
macro-économique décadent dans lequel le secteur<br />
a évolué n’a fait qu’exacerber une situation rendue difficile<br />
par la chute des cours des principales cultures de rente sur le<br />
marché mondial.<br />
Le manque de contrôle gouvernemental au niveau macroéconomique<br />
a eu pour conséquences, entre autres, des taux<br />
d’inflation élevés, la dévaluation de la monnaie nationale,<br />
une réserve en devises insuffisante et des taux d’intérêts réels<br />
fortement négatifs. Cette situation découragea les investissements<br />
privés dans le secteur et entraîna une grave pénurie<br />
27
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
des intrants importés, d’où une baisse du pouvoir d’achat des<br />
consommateurs, des prix à la production peu attractifs et des<br />
revenus agricoles bas.<br />
Il faut que le gouvernement fasse l’état des lieux et formule<br />
des stratégies réalistes dans le domaine de la macro-économie,<br />
tout en gardant à l’esprit l’ampleur de l’économie parallèle.<br />
Ainsi, il aidera à maîtriser l’inflation, stabiliser la monnaie<br />
et garantir une bonne disponibilité en devise étrangère<br />
pour l’achat des intrants essentiels, non seulement agricoles<br />
mais aussi en carburant, véhicules de transport et pièces de<br />
rechange. L’on devrait aussi se pencher sur les mesures à<br />
même de favoriser la production agricole. En d’autres termes,<br />
il faudra une analyse approfondie de la politique de fixation<br />
des prix des intrants et extrants, y compris des tarifs appliqués<br />
aux importations et aux exportations agricoles, dans le but<br />
d’encourager les paysans à produire davantage.<br />
Alfred B. Kargbo, Manager of Seed Multiplication Project (Sierra Seed),<br />
PMB 231, Freetown, Sierra Leone. Tel : (+232) 22 241683/ 241870<br />
Fax : (+232) 22241960 E-mail : serraseeds@sierratel.sl or muzamil@sierratel.sl<br />
Autres contributions<br />
Les associations semencières : Qui sont-elles?<br />
Quel est leur rôle?<br />
B. Le Buanec<br />
La structure de l’industrie semencière<br />
L’industrie semencière a quatre niveaux d’égale importance :<br />
• Les sociétés semencières, publiques ou privées, sont soit<br />
entièrement intégrées depuis la recherche et la sélection<br />
des plantes jusqu’à la commercialisation, ou soit spécialisées<br />
en une ou plusieurs sections<br />
• Les associations nationales<br />
• Les associations régionales<br />
• Les associations internationales<br />
Les premières associations nationales ont été créées à la fin<br />
du XIX e siècle et au début du XX e siècle, mais certains pays<br />
sont encore en train de mettre leur propre association en<br />
place. L’une des plus anciennes, si non la plus ancienne, est<br />
L’American Seed Trade Association (l’Association américaine<br />
du commerce des semences), fondée en 1883. Parmi les plus<br />
jeunes, on peut citer, à titre d’exemples, les associations de la<br />
Yougoslavie et de l’Ouganda, créées en 2001, et certaines sont<br />
encore en voie de création.<br />
La deuxième étape du processus de structuration a vu<br />
l’émergence d’organismes internationaux dans la première<br />
moitié du XX e siècle, entre la première et la deuxième guerres<br />
mondiales. Le premier congrès international sur le commerce<br />
des semences, qui s’est tenu en 1924 à Londres, décida de<br />
mettre en place la Fédération internationale du commerce des<br />
semences. L’Association internationale des sélectionneurs pour<br />
la protection de la propriété intellectuelle fut créée en 1938.<br />
Ces deux organisations fusionneront en mai 2002 pour former<br />
la Fédération semencière internationale, ISF, qui compte des<br />
membres ordinaires et/ou associés dans 68 pays.<br />
Après la deuxième guerre mondiale, des blocs commerciaux<br />
ont commencé à se développer. En Europe, la première association<br />
régionale, l’Association du commerce des semences<br />
de la Communauté européenne, COSEMCO, vit le jour en<br />
1961, suivie en 1977 de l’Association des sélectionneurs de<br />
la Communauté européenne, COMASSO. Ces deux associations<br />
fusionnèrent en 2001 pour former l’ESA, Association<br />
semencière européenne. En 1986, la FELAS, Fédération<br />
latino-américaine des associations semencières, est créée, suivie<br />
en 1994 de l’APSA, Association semencière Asie-Pacifique et<br />
en 1999 de l’AFSTA, Association africaine du commerce des<br />
semences. En plus de ces associations formelles, des réseaux<br />
semenciers ont été également mis en place : le Réseau semencier<br />
de l’Asie occidentale et de l’Afrique du nord, WANA,<br />
en 1992, le Réseau ouest-africain des semences et plants,<br />
<strong>WASNET</strong> en 1999, et le Réseau semencier d’Europe de l’est,<br />
EESNET en 2000.<br />
Le rôle des associations semencières<br />
Voici à présent les objectifs de l’ISF et comment nous sommes<br />
organisés pour les atteindre :<br />
• représenter les intérêts de ses membres au niveau international,<br />
notamment en ce qui concerne l’élaboration des<br />
politiques internationales<br />
• améliorer les relations entre ses membres et les aider à<br />
résoudre les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés<br />
• encourager et appuyer le développement des associations<br />
semencières nationales et régionales<br />
• accroître la reconnaissance de l’importance et de la valeur<br />
de la contribution majeure de ses membres à la sécurité<br />
alimentaire mondiale, à la diversité génétique et à l’agriculture<br />
durable, notamment par le développement, la<br />
production et l’utilisation de semences de haute qualité<br />
grâce à la technologie moderne<br />
28
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Elaboration des politiques internationales<br />
Comme vous le savez, la semence est l’un des produits les<br />
plus réglementés du monde. Elle est régie par un ensemble<br />
de lois et de règlements relatifs à l’homologation des variétés,<br />
la certification des semences, la protection de la propriété<br />
intellectuelle, la certification phytosanitaire, la biosécurité et<br />
l’hygiène des aliments.<br />
Aperçu des organes internationaux pertinents. Pour pouvoir<br />
agir efficacement, il faut d’abord avoir un aperçu des organes<br />
internationaux jouant un rôle dans la réglementation des<br />
semences.<br />
Traditionnellement, ces organisations étaient peu nombreuses<br />
et relativement spécialisées : l’Organisation de coopération et<br />
de développement économiques, OCDE, pour la certification<br />
des semences échangées au-delà des frontières; l’Union internationale<br />
pour la protection des obtentions végétales, UPOV,<br />
pour la protection de la propriété intellectuelle ; l’Organisation<br />
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,<br />
FAO, pour les ressources phytogénétiques et les questions<br />
phytosanitaires ; l’Association internationale pour les tests<br />
semenciers, ISTA, pour les essais sur les semences.<br />
Plus récemment, outre l’adoption d’autres conventions ou<br />
traités internationaux et l’évolution de l’industrie semencière,<br />
surtout grâce à la biotechnologie moderne, plusieurs organisations<br />
sont venues s’ajouter aux organisations “conventionnelles”<br />
: la Convention sur la diversité biologique, CBD, pour les<br />
règles d’accès et d’utilisation des ressources génétiques, ainsi<br />
que de biosécurité, l’Organisation mondiale du commerce,<br />
OMC, pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, les<br />
obstacles techniques au commerce et les droits de propriété<br />
intellectuelle ; l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle<br />
pour les droits de propriété intellectuelle.<br />
Une fois établie la liste de ces organisations qui influent sur<br />
l’activité semencière, il est indispensable de se faire connaître<br />
et d’acquérir le statut d’observateur officiel.<br />
Consensus et prise de position sur les questions à l’étude. Naturellement,<br />
un réseau d’information efficace est indispensable.<br />
Lorsqu’un nouveau problème survient au niveau international,<br />
il est exposé lors des réunions pertinentes par les membres<br />
ou par le secrétariat. Suite à cet exposé, on peut décider ce<br />
qui suit :<br />
• prendre une action immédiate si le problème est jugé très<br />
important par l’ensemble des membres<br />
• ne donner aucune suite, si le problème est jugé, thématiquement<br />
ou géographiquement, hors de propos ou sans<br />
rapport avec le mandat des associations<br />
• demander un document de travail, si d’autres informations<br />
sont indispensables à la prise de décision<br />
• lancer des initiatives/expériences ad-hoc pour obtenir les<br />
compétences nécessaires<br />
Lorsqu’un problème est jugé très important, et que des informations<br />
suffisantes ont été réunies, le secrétariat, en collaboration<br />
avec le comité approprié, prépare un projet d’exposé<br />
de position. Ce document est ensuite distribué aux membres<br />
pour leurs observations. Si tout le monde est du même avis,<br />
une version amendée prenant en compte toutes les contributions<br />
est soumise à l’Assemblée des membres pour adoption.<br />
Si les contributions sont divergentes, la version amendée est<br />
soumise à une deuxième tour de commentaires avant la soumission<br />
à l’Assemblée générale et, le cas échéant, des réunions<br />
ad-hoc sont convoquées.<br />
D’habitude, les positions sont généralement adoptées à l’unanimité<br />
au sein de l’ISF. En dépit des différences culturelles<br />
et socio-économiques, les membres ont les mêmes objectifs<br />
globaux qui consistent, entre autres, à faciliter le mouvement<br />
transfrontalier des semences et à protéger la propriété intellectuelle.<br />
A défaut d’unanimité, tous les exposés de position de<br />
la FIS/ASSINSEL ont été adoptés à une majorité supérieure<br />
à 90%.<br />
Récemment la FIS et l’ASSINSEL ont appouvé des exposés de<br />
position sur plusieurs thèmes. En voici quelques exemples :<br />
• Motion sur la présence adventive de matériel GM dans<br />
les semences. (2001)<br />
• Exposé de position sur des obtentions végétales génétiquement<br />
améliorées. (2001)<br />
• Motion sur une base de données mondiale sur la description<br />
phénotypique des variétés. (2001)<br />
• Motion sur la révision de l’Engagement international de<br />
la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation<br />
et l’agriculture. (2001)<br />
• Protection des lignées parentales. (2000)<br />
• Essais DUS. (2000)<br />
• Elaboration des obtentions végétales et protection de la<br />
propriété intellectuelle. (1999)<br />
• Accès aux ressources phytogénétiques et au partage des<br />
avantages. (1988)<br />
• Exposé de position sur l’accréditation pour la certification<br />
de l’OCDE. (1995)<br />
Présentation et défense des positions aux fora internationaux.<br />
Lorsqu’une position est adoptée, il incombe au secrétariat<br />
et aux membres de la présenter et de la défendre. Pour des<br />
raisons d’efficacité, la position doit être au préalable soumise<br />
aux personnes chargées de la réglementation aux trois<br />
niveaux :<br />
• aux ministères nationaux compétents, qui participent aux<br />
discussions internationales par l’intermédiaire d’associations<br />
nationales, puisqu’en fin de compte les décisions<br />
sont prises par les représentants des pays<br />
• aux organismes régionaux ou sous-régionaux appropriés<br />
tels que la Commission européenne, l’OUA, la SADC,<br />
le Pacte andin<br />
• et naturellement, au cours des réunions internationales où<br />
les problèmes sont discutés. Etant donné qu’il y a de plus<br />
en plus de réunions, le fardeau doit être partagé entre le<br />
personnel du secrétariat et les membres, surtout ceux du<br />
pays qui doit abriter la réunion internationale. En outre,<br />
la coopération avec les associations internationales alliées,<br />
telles que celles du Réseau agroalimentaire international,<br />
IAFN, est très utile.<br />
29
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Améliorer les relations entre ses membres et<br />
les aider à résoudre les problèmes auxquels ils<br />
pourraient être confrontés<br />
L’ISF mène trois actions principales pour réaliser cet objectif :<br />
L’organisation d’un congrès annuel. Les congrès annuels constituent<br />
l’une des meilleures occasions offertes aux semenciers du<br />
monde d’établir de nouveaux contacts, de rencontrer des clients<br />
et des fournisseurs, de négocier des contrats d’affaires dans un<br />
environnement chaleureux. Le premier congrès international<br />
sur le commerce des semences en 1924 a connu la participation<br />
de 55 personnes de 9 pays différents. De nos jours, ces<br />
congrès rassemblent jusqu’à 1500 personnes venant de 57 pays.<br />
Cet engouement montre que la participation aux congrès est<br />
probablement la manière la plus économique de s’impliquer<br />
activement dans l’entreprise semencière internationale.<br />
La mise au point des règles de commerce et d’arbitrage. Le<br />
commerce mondial des semences s’est nettement accru pendant<br />
les 30 dernières années, comme le montre le tableau<br />
ci-dessous.<br />
30<br />
1970 1977 1980 1985 1994 1996 1998<br />
Valeur en milliers de $EU 860 <strong>10</strong>76 1200 1300 2900 3300 3600<br />
Base <strong>10</strong>0 en 1970 <strong>10</strong>0 125 140 151 337 383 418<br />
Chaque année, de nombreux contrats internationaux de production<br />
et de commerce sont signés, et la normalisation est<br />
nécessaire pour éviter les incompréhensions, les conflits et les<br />
litiges. C’est la raison pour laquelle les deux points suivants<br />
étaient à l’ordre du jour du premier congrès international sur<br />
les semences en 1924 : règles sur le commerce et l’arbitrage à<br />
l’échelle internationale.<br />
La première édition des règles commerciales de la FIS, sur les<br />
semences fourragères, a été adoptée en 1929 et les premières<br />
règles d’arbitrage ont été adoptées en 1930. Depuis ce temps,<br />
les règles ont été régulièrement mises à jour et actuellement<br />
l’industrie semencière utilise un corpus complet de règles pour<br />
faciliter le commerce international des semences. Ces règles<br />
sont gratuitement mises à la disposition de tous sur le site<br />
Internet de la FIS :www.worldseed.org et je ne les présenterai<br />
pas dans les détails.<br />
Les chapitres principaux sont les suivants :<br />
Règles commerciales :<br />
• Contrats avec les producteurs de semences.<br />
• Contrats entre les marchants de semences<br />
• Dispositions générale<br />
• Conclusion d’un contrat<br />
• Conditions d’un contrat<br />
• Exécution d’un contrat<br />
• Contrôle de la qualité et analyses<br />
• Litiges<br />
Règles d’arbitrage :<br />
• Clause d’arbitrage<br />
• Organisation d’un arbitrage<br />
• Demande d’arbitrage<br />
• Désignation des arbitres<br />
• Appel<br />
La mise au point de directives, d’un code de conduite et d’autres<br />
outils éventuels. Il est naturellement impossible d’avoir ici une<br />
approche systématique, et les activités sont conçues cas par cas.<br />
A titre d’exemples, voici certains des évènements qui ont eu<br />
lieu à la FIS/ASSINSEL au cours des <strong>10</strong> dernières années.<br />
• Initiatives internationales relatives à l’hygiène des semences<br />
visant à faciliter la détection des maladies transmises<br />
par les semences et à éviter les barrières commerciales<br />
injustifiées.<br />
• Directives à suivre en cas de problèmes phytosanitaires<br />
associés à l’import-export.<br />
• Codification harmonisée des pathogènes des cultures<br />
maraîchères et une définition commune de la relation<br />
plante-pathogène.<br />
• Directives sur les bonnes pratiques d’utilisation et les<br />
conditions normales requises pour le traitement des<br />
semences.<br />
• Directives sur la prévention et le traitement des révendications.<br />
• Collecte de statistiques, par produit ou par pays.<br />
• Directives sur l’évaluation de la dérivation essentielle dans<br />
la sélection végétale.<br />
• Annuaire du commerce des semences incluant une nouvelle<br />
rubrique “Pages Jaunes” destinée aux fournisseurs<br />
de l’industrie semencière.<br />
• Le calendrier des événements internationaux relatifs aux<br />
semences.<br />
La majeure partie des informations est disponible sans frais<br />
sur notre site Internet depuis 1997, à l’adresse suivante :<br />
http://www.worldseed.org<br />
Récemment, nous avons également élaboré un secteur restreint<br />
uniquement accessible par mot de passe à des groupes spécifiques<br />
désireux de partager des informations confidentielles.<br />
Cette liste n’est pas exhaustive et, avant de terminer cette<br />
partie de mon exposé, permettez-moi de vous livrer des informations<br />
sur une initiative très intéressante récemment conçue<br />
par la FIS : un régime d’assurance global relatif aux erreurs<br />
et omissions des semenciers, auprès de Lloyds à Londres. Ce<br />
régime fut mis en place en 1999 après discussion avec plusieurs<br />
compagnies d’assurance. Actuellement, nous avons une<br />
assurance auprès de 20 compagnies dans les sept pays suivants<br />
: Etats-Unis, Israël, Italie, Grèce, Australie, France et Pays-Bas.<br />
Certaines compagnies ont des filiales dans d’autres pays, tels<br />
que le Japon et le Brésil. Tout le chiffre d’affaires assuré s’élève<br />
à environ 770 millions de dollars des Etats-Unis. Le régime<br />
est ouvert à n’importe quelle société semencière dans les pays<br />
où la FIS a des membres.<br />
Encourager le développement d’associations semencières nationales<br />
et régionales. Afin de se doter d’un système semencier global<br />
efficace, il est nécessaire d’avoir les quatre niveaux, à savoir,<br />
les sociétés semencières, les associations nationales, les associations<br />
régionales et les associations internationales.
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
L’ISF s’efforce de favoriser le développement de tous ces<br />
niveaux.<br />
Nous acceptons des sociétés comme membres associés dans<br />
les pays où il n’y a aucune association nationale, ou si les<br />
associations existantes ne souhaitent pas être actives au plan<br />
international. Cela permet aux sociétés de participer aux<br />
congrès de l’ISF, d’avoir des contacts commerciaux à l’échelle<br />
du globe et de bénéficier de toutes les facilités proposées par<br />
la Fédération, y compris les règles commerciales, l’arbitrage,<br />
l’assurance, etc. Mais, naturellement, le travail le plus important<br />
pour faciliter le développement des sociétés semencières,<br />
en termes de législation, de crédit etc., doit se faire au niveau<br />
national et c’est la raison pour laquelle nous encourageons le<br />
développement des associations nationales.<br />
Nous assistons les associations nationales particulièrement de<br />
trois manières :<br />
• en encourageant les sociétés semencières d’un pays donné<br />
à créer une association semencière. Le cas échéant, nous<br />
apportons un appui technique à la mise en place.<br />
• en répondant aux questions d’ordre technique et juridique<br />
soulevées par les associations nationales.<br />
• en envoyant des représentants d’ISF assister à leurs réunions<br />
nationales.<br />
Au niveau régional, nous avons encouragé diverses initiatives<br />
soit, par exemple, en organisant des réunions pour la création<br />
d’AFSTA, en accueillant des sites régionaux sur notre site<br />
Internet, ou soit en apportant des conseils, ou une combinaison<br />
de ces divers moyens.<br />
Accroître la reconnaissance de l’importance et de la valeur de<br />
la contribution de l’industrie semencière à la sécurité alimentaire<br />
mondiale et à l’agriculture durable. Afin de réaliser ce<br />
quatrième objectif, nous menons essentiellement deux types<br />
d’actions :<br />
Nous assistons à des réunions et à des colloques où nous<br />
pouvons expliquer notre travail et son importance pour<br />
l’agriculture et l’horticulture.<br />
Nous publions des articles dans divers journaux, ainsi que<br />
des brochures, dont certains constituent des points de repère<br />
pour nos activités :<br />
• Nourrir les 5000 millions en 1981.<br />
• Nourrir les 8 milliards et conserver la planète en 1997.<br />
• Des semences pour l’humanité: Sélection végétale,<br />
semences et agriculture durable en 2002.<br />
Les associations régionales. Mutatis mutandis, les objectifs des<br />
associations régionales devraient être similaires aux objectifs<br />
des associations internationales, et il n’est pas nécessaire de<br />
répéter encore ce qui vient d’être dit sur l’ISF.<br />
Je me contenterai de développer deux idées ici. Premièrement,<br />
étant donné que 68 pays sont impliqués dans l’élaboration et<br />
l’approbation de communications et de directives à l’ISF, au<br />
lieu de devoir refaire tout le travail, et afin d’éviter les contradictions,<br />
l’organisation régionale devrait s’inspirer sans réserve<br />
du travail d’ISF.<br />
Les documents très techniques tels que les règles commerciales,<br />
les règles d’arbitrage, les directives sur le traitement des<br />
revendications, etc., pourraient être adoptés littéralement.<br />
En revanche, les documents ayant un contenu plus politique<br />
devraient être adaptés pour tenir compte des contextes socioéconomiques<br />
et politiques.<br />
Deuxièmement, je considère personnellement que l’objectif<br />
principal de l’industrie semencière devrait consister à faire<br />
intervenir les répondants des divers organismes intergouvernementaux<br />
dans la réglementation des semences. Les bons<br />
exemples sont l’ASE, Association semencière européenne qui<br />
sert de répondant à la Commission européenne et au Parlement<br />
européen, et l’AFSTA qui sert de répondant à l’OUA.<br />
En Afrique, des associations sous-régionales, ou mieux, des<br />
comités spéciaux au sein d’AFSTA pourraient être envisagés<br />
au niveau de la SADC, de l’UDEAC et de la CEDEAO pour<br />
ne citer que quelques possibilités.<br />
Les associations nationales. Les associations nationales sont les<br />
chevilles ouvrières de tout le système car elles contribuent à<br />
rassembler les sociétés semencières et à préparer les positions<br />
aux niveaux international et régional. Mais nous aurons cet<br />
après-midi une session spéciale sur ce thème et je ne voudrais<br />
pas empiéter sur les exposés qui suivront.<br />
Bernard Buanec, Secrétaire général de la Fédération semencière<br />
internationale (FIS), Suisse, Tel : +334)1223654420<br />
E-mail: b.lebuanec@worldseed.org<br />
Ne fais pas partie des 75% d’idiots !<br />
N. Gregg<br />
Ne dilapide pas les recettes de ton entreprise ! Comment dilapidons-nous<br />
nos sous ? Personne ne jette ses sous à volonté,<br />
mais beaucoup le font par idiotie.<br />
Nous devons tous mériter notre pain. Personne (sauf quelques<br />
imbéciles de parents) nous donneront ce dont nous avons<br />
besoin ou ce que nous désirons.<br />
Beaucoup de pays ne tiennent pas de statistiques. Mais aux<br />
USA, grosso modo 75% d’entre nous sommes employés par<br />
le secteur industriel ou commercial privé.<br />
Parmi ceux-ci, quelque 75% possèdent ou sont employés par<br />
de petites entreprises. Une petite entreprise emploie moins<br />
de 25 personnes.<br />
31
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Et parmi ces entreprises, plus de 75% perdront de l’argent<br />
et feront faillite au bout de 5 ans. Le capital investi est<br />
perdu, et ces entreprises sont aussi endettées. Cette partie<br />
de leur vie est perdue. Elles sont connues comme mauvaises<br />
en affaires.<br />
Elles ont dilapidé leurs sous et bien davantage.<br />
A quoi est due cette situation ?<br />
La Small Business Administration-SBA (Administration des<br />
petites entreprises) du gouvernement des Etats-Unis déclare<br />
que la plupart des cas de banqueroute sont dus à une mauvaise<br />
planification par les propriétaires ou directeurs d’entreprise.<br />
Ils ne savent donc quoi faire, quoi ne pas faire, quand,<br />
comment le faire, etc.<br />
Qu’est-ce que c’est qu’un bon plan ?<br />
Avant d’entreprendre un voyage, vous examinez la carte routière<br />
pour y localiser votre destination et choisir le meilleur<br />
moyen pour l’atteindre. Vous planifiez ainsi votre voyage.<br />
Dans une affaire, vous avez une destination. La connaissezvous<br />
? Répondre que “vous allez gagner votre pain” ne signifie<br />
pas que vous avez une destination. Vous devez savoir ce que<br />
vous allez faire, comment le faire et avoir des repères tout au<br />
long pour pouvoir mesurer le progrès accompli.<br />
Pour cela, il vous faut un bon plan d’affaires qui réponde<br />
aux questions quoi, quand et comment, et qui précise ce que<br />
vous ne devez pas faire, et tout ce qui pourrait affecter votre<br />
entreprise en bien ou en mal.<br />
Qu’est-ce une entreprise qui réussit ?<br />
Une entreprise qui réussit: est une entreprise soigneusement<br />
planifiée; le propriétaire identifie un besoin ressenti par les<br />
gens, et s’efforce de le satisfaire à un prix qu’ils sont disposés à<br />
payer ; il leur fait savoir que le service est disponible et le leur<br />
offre de manière satisfaisante. Il se rend ainsi crédible auprès<br />
de ses clients.<br />
Une entreprise qui réussit n’est pas : une idée brûlante qui vous<br />
vient à l’esprit ; alors vous empruntez de l’argent, trouvez un<br />
emplacement et voila! vous ouvrez vos portes. Exemple: Dans<br />
mon village, une personne possédait une merveilleuse sauce<br />
barbecue dont elle détenait le secret, et pensait qu’elle pouvait<br />
la vendre. Ainsi, elle dépensa tout son argent et en emprunta<br />
davantage pour ouvrir un restaurant et vendre son barbecue.<br />
Elle ne chercha pas à savoir s’il existait un débouché ou si son<br />
restaurant était bien situé. Elle ne fit pas de publicité. Elle s’est<br />
contentée d’ouvrir sa porte et de s’asseoir pour que les gens<br />
viennent à elle. Personne ne vint ! Au bout de 12 mois, elle<br />
se voit obliger de fermer ses portes et de chercher un emploi<br />
pour pouvoir rembourser l’ardoise laissée par la banqueroute<br />
de son restaurant de barbecue.<br />
Quelle est la différence entre réaliser<br />
un bénéfice et jeter de l’argent ?<br />
Savoir ce qu’on peut faire et ce qu’on doit faire avant de<br />
commencer!<br />
Il s’agit d’étudier minutieusement la situation, d’identifier<br />
de façon réaliste ce que vous pouvez faire, et de faire un<br />
plan réaliste qui prenne en compte le comment, quoi,<br />
quand et où.<br />
Comment faire un plan réaliste ?<br />
Une idée brûlante vous vient à l’esprit. Vous ne devez pas<br />
vous asseoir dans un bureau climatisé; allez sur le terrain pour<br />
examiner la situation:<br />
• Qui sont les clients potentiels ?<br />
• Dans quelle localité les trouve-t-on ?<br />
• De quoi ont-ils besoin ? Quelle quantité<br />
achèteront-ils ?<br />
• Quel prix sont-ils prêts à payer ?<br />
• En ont-ils vraiment les moyens ?<br />
• Puis-je leur fournir la quantité qu’ils désirent<br />
acheter ?<br />
• Puis-je leur en fournir suffisamment de manière<br />
à réaliser un bénéfice ?<br />
• Le produit, est-il déjà en vente ?<br />
• Y-a-t-il une place pour moi dans cette<br />
concurrence ?<br />
• Puis-je vendre suffisamment et réaliser un<br />
bénéfice à un prix que les clients sont<br />
disposés à payer ?<br />
• Puis-je bien gérer l’entreprise de manière à<br />
attirer d’autres clients et maintenir les coûts<br />
d’exploitation à un niveau bas ?<br />
Quel est votre plan ?<br />
Vous voulez d’une entreprise qui réussit ! Parlez simplement<br />
de plan d’affaires.<br />
Plusieurs années d’étude et d’effort ont permis d’essayer différents<br />
types de plan et d’aboutir à ce qui est maintenant connu<br />
comme plan d’affaires. Cet outil s’avère très utile lorsqu’il est<br />
préparé de manière réaliste.<br />
Quel est le contenu du plan d’affaires ?<br />
Tout ce qui peut affecter, risque d’affecter ou affectera nécessairement<br />
votre entreprise en bien ou en mal !<br />
On peut s’y prendre de plusieurs façons. La US SBA<br />
vous propose le format suivant. Rappelez-vous que<br />
le format du plan d’affaires ne fait qu’organiser et indiquer<br />
le résultat que vous vous êtes fixé à partir de l’étude<br />
réalisée au départ.<br />
Plan d’affaires pour la période du__________ au ________<br />
Date(s)<br />
Préface<br />
Table des matières<br />
Liste des tableaux<br />
Liste des figures<br />
Résumé analytique<br />
32
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Chapitre 1. Introduction<br />
Finalité<br />
Objectif de l’activité projetée<br />
Description<br />
Chapitre 2. Votre société<br />
Raison sociale<br />
Forme de propriété et statut juridique<br />
Type d’activité<br />
Objectifs de la société<br />
Production commerciale et surface<br />
Produits/Services offerts<br />
Clients principaux<br />
Chapitre 3. Produits et services<br />
Principaux produits à vendre<br />
Produits secondaires à vendre<br />
Services offerts<br />
Chapitre 4. Le marché, le commerce ou l’industrie où nous<br />
allons mener nos activités<br />
Marché et clients<br />
Situation actuelle<br />
Perspectives<br />
Produits et développement<br />
Tendances susceptibles d’influencer nos affaires<br />
Sources d’informations utilisées<br />
Chapitre 5. Etude et analyse de marché/client/concurrence<br />
Qui sont les clients<br />
Taille et tendances du marché<br />
Concurrence<br />
Notre part du marché et nos ventes, avantages et performance<br />
attendue<br />
Hypothèses<br />
Chapitre 6. Notre plan de marketing<br />
Stratégie globale de marché<br />
Fixation des prix<br />
Stratégies de vente<br />
Publicité et promotion<br />
Chapitre 7. Plan d’exploitation<br />
Stratégie et plans<br />
Emplacement (s)<br />
Heures/jours/saisons ouvrables<br />
Installations et équipement<br />
Personnel<br />
Chapitre 8. Gestion<br />
Organisation<br />
Cadre supérieur<br />
Direction et indemnisation du propriétaire<br />
Chapitre 9. Avantages pour la région et pour les personnes<br />
que vous servez<br />
Avantages escomptés<br />
Accès amélioré pour les clients<br />
Appui au développement local<br />
Avantages économiques pour la région et<br />
les clients<br />
Chapitre <strong>10</strong>. Plan financier<br />
Sources et utilisations des fonds<br />
Analyse pro forma du flux de trésorerie<br />
Prévisions des pertes et profits<br />
Bilan pro forma des opérations prévues<br />
Pièces jointes<br />
Tout élément qui appuie—ou s’oppose—à vos<br />
études, conclusions, etc.<br />
Dois-je inclure des informations qui ne<br />
sont pas favorables ?<br />
Absolument ! Tout ne peut être rose dans un plan d’affaires<br />
qui peut vous faire perdre de l’argent! Le plan d’affaires est une<br />
évaluation réaliste à froid pour savoir si vous pouvez réaliser<br />
ou non des profits, combien et comment.<br />
Et si toute cette étude et tout cet<br />
effort montrent que je fonctionnerai<br />
à perte ?<br />
Alors, diable ! oubliez cette “idée brûlante” et cherchez une<br />
autre affaire!<br />
Comment utiliser un plan d’affaires ?<br />
Vous utilisez un plan d’affaires pour :<br />
• décider de vous embarquer ou non dans<br />
une affaire donnée ;<br />
• orienter toutes vos opérations—achats, ventes,<br />
publicité, etc.<br />
• voir périodiquement si vous vous en<br />
sortez - ou si vous devez laisser tomber<br />
immédiatement<br />
• Vous l’adressez à une banque pour un prêt.<br />
Beaucoup de banques demandent de nos<br />
jours un plan d’affaires<br />
Allez-vous gaspiller votre vie et votre<br />
argent ?<br />
Allez-vous risquer de dilapider votre argent en vous embarquant<br />
dans une affaire à l’aveuglette ? Seule une planification<br />
rigoureuse et réaliste vous permettra de réussir. Puis, respectez<br />
votre plan d’affaires !<br />
Sinon, vous allez dilapider votre argent ! Pourquoi ne pas être<br />
efficace—ne gaspillez pas des années à investir vos sous dans<br />
une entreprise qui bat de l’aile ! Si vous en avez à jeter, pensez<br />
à ma poubelle !<br />
Nathan (Top) Gregg dans “University International Business Studies” c/o B. Gregg,<br />
PO Box 1756, Starkville, MS 39760, USA. Tel/fax: +1 601 3230035; E-mail:<br />
topgregg@bully.net<br />
33
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Stages, rencontres, publications<br />
Réunions/ séminaires/congrès/<br />
cours<br />
2–8 février 2003: Congrès international de la<br />
patho logie végétale (ICPP),<br />
Christ church, Nouvelle<br />
Zélande.<br />
9–11 juin 2003: Congrès de la Fédération<br />
inter nationale sur le commerce<br />
des semences, FIS, Bangalore,<br />
Inde.<br />
12–13 juin 2003: FIS: Conférence sur le<br />
traitement des semences,<br />
Bangalore, Inde.<br />
23–27 juin 2003: Organisation de coopération et<br />
de développement économiques<br />
(OCDE): Réunion annuelle<br />
sur les plans semenciers, Paris,<br />
France.<br />
06–11 juillet 2003 15 e Congrès international<br />
sur la protection végétale,<br />
Beijing, Chine.<br />
17–20 juillet 2003 BioThailand 2003: Technologie<br />
pour la vie, Bangkok,<br />
Thaïlande.<br />
Livres<br />
Farmers and plant breeders in partnership<br />
Edité par P. Hanacziwskyj<br />
Publié par le Department for International Development Plant<br />
Sciences Research Programme, Centre for Arid Zone Studies,<br />
University of Wales, Bangor, Gwynedd LL57 2UW. Gratuit<br />
sur demande. 28 pages. Reliure souple. Tel: +44 1248 382922.<br />
Fax: +44 1248 371533. Email: dfid.psp@bangor.ac.uk; website:<br />
www.dfid-psp.org<br />
Traditionnellement, les programmes d’amélioration végétale<br />
visaient essentiellement les caractéristiques que les<br />
chercheurs considèrent comme les plus importantes pour<br />
une large adoption. Les paysans étaient rarement consultés<br />
au sujet de leurs besoins, d’où le faible taux d’adoption des<br />
nouvelles variétés.<br />
Mais lorsque sélectionneurs et producteurs se mettent<br />
ensemble, les deux groupes en profitent–les sélectionneurs<br />
assistent à l’adoption de nouvelles variétés par les<br />
producteurs et ceux-ci obtiennent de nouvelles variétés qui<br />
correspondent aux besoins locaux. C’est cela l’essence de<br />
cette plaquette–sélectionneurs et producteurs travaillent<br />
ensemble pour créer des variétés adaptées aux besoins<br />
endogènes.<br />
Farmers and plant breeders in partnership montre comment<br />
les deux groupes peuvent collaborer à leur avantage<br />
réciproque.<br />
R. Tripp. 2001. Seed provision and<br />
agricultural development: the<br />
institutions of rural change<br />
Nombre des controverses autour de la mondialisation, la propriété<br />
intellectuelle, la protection, la biotechnologie et l’avenir<br />
de l’agriculture ont des répercussions sur l’approvisionnement<br />
des semences. Ce livre jette un profond regard sur les forces<br />
et faiblesses de la gestion des semences dans les systèmes de<br />
culture traditionnels, retrace l’histoire de la sélection végétale<br />
formelle ainsi que l’origine du commerce des semences, et<br />
examine les systèmes semenciers contemporains dans les pays<br />
industrialisés et en développement.<br />
En outre, ce livre décrit les principaux types d’interventions<br />
au sein des systèmes semenciers des pays en développement<br />
et explique la cause de l’échec d’un bon nombre de ces systèmes.<br />
Les exemples sont tirés de la recherche conduite en<br />
Asie, Afrique et Amérique latine, ainsi que d’une recherche<br />
documentaire extensive.<br />
Il en résulte un tableau exhaustif de l’approvisionnement en<br />
semences qui permet aux lecteurs de transcender les points de<br />
vue simplifiés à l’excès qui dominent les débats sur le développement<br />
agricole. Pour commander, prière de contacter:<br />
publications@odi.org.uk ou le site:http://www.odi.org.uk/<br />
publications/order.html<br />
Seed technologists training manual<br />
Ce manuel offre la plus large couverture de la technologie<br />
des tests semenciers, avec plus de 450 pages, 150 photos<br />
en couleur, et 735 dessins de graines, le tout présenté en<br />
15 chapitres et autorisé par les plus grands spécialistes du<br />
domaine. Il traite de :<br />
i. Importance des tests semenciers<br />
ii. Botanique de base du test semencier<br />
iii. Identification des semences<br />
iv. Echantillonnage et sous-échantillonnage<br />
des semences<br />
v. Evaluation de la teneur en eau des semences<br />
vi. Technologies de valorisation des semences<br />
vii. Evaluation de la pureté physique<br />
viii. Test de germination des semences<br />
ix. Dormance des semences<br />
34
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
x. Test de viabilité des semences<br />
xi. Test de vigueur des semences<br />
xii. Tests pathologiques (Santé)<br />
xiii. Tolérances des tests semenciers,<br />
xiv. Evaluation de la pureté génétique et<br />
xv. Utilisation de scanners pour une meilleure<br />
évaluation des semences/plantules.<br />
Cet excellent manuel est un outil précieux pour les stagiaires<br />
et praticiens des technologies semencières, les étudiants,<br />
chercheurs et agences publiques. Pour commander, s’adresser<br />
à la Society of Commercial Seed Technologists,c/o Andy<br />
Evans, 2021 Coffey Rd., 202 Kottman Hall, Colombus,<br />
Ohio 432<strong>10</strong>, USA; E-mail: evans@osu.edu; Website:http:<br />
//www.seedtechnology.net<br />
35
<strong>WASNET</strong> News <strong>10</strong><br />
Pour les nouveaux lecteurs seulement<br />
Pour les lecteurs de E-mail<br />
Prière de compléter et de faire parvenir à l’adresse<br />
ci-dessous :<br />
Nom :<br />
Si vous voulez recevoir ce bulletin par courrier<br />
életronique, prière de compléter et de faire<br />
parvenir votre E-mail à l’adresse ci-dessous :<br />
Fonction :<br />
wasnet@ghana.com<br />
Addresse :<br />
Nom :<br />
Fonction :<br />
Veuillez retourner à :<br />
West Africa Seed and Planting Material<br />
Network (<strong>WASNET</strong>)<br />
PO Box 9698, KIA, Accra, Ghana<br />
Tel/Fax: +233-21 765567<br />
E-mail: wasnet@ghana.com<br />
Adresse :<br />
E-mail:<br />
Téléphone :<br />
36