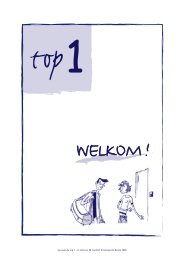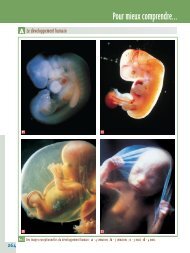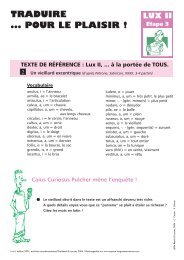Chapitre 1 Molécules d'eau - Secondaire - De Boeck
Chapitre 1 Molécules d'eau - Secondaire - De Boeck
Chapitre 1 Molécules d'eau - Secondaire - De Boeck
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
<strong>Chapitre</strong> 1<br />
<strong>Molécules</strong> d’eau :<br />
molécules incontournables<br />
•<br />
A. SOLUBILITÉ DES COMPOSÉS DANS L’EAU<br />
1. Mise en situation<br />
Tâche<br />
2. Appropriation du concept : solubilité des composés dans l’eau<br />
3. Expression de la solubilité<br />
B. MODÈLES DE SOLUTIONS AQUEUSES<br />
1. Mise en situation<br />
Tâche<br />
2. Appropriation des concepts : électrolytes et non-électrolytes<br />
3. Modèles de solutions aqueuses<br />
4. Écriture des équations de dissociation et d’ionisation<br />
C. MISE EN ÉVIDENCE D’IONS EN SOLUTION AQUEUSE<br />
ET RÉACTION DE PRÉCIPITATION<br />
1. Mise en situation<br />
Tâche<br />
2. Appropriation du concept : réaction de précipitation<br />
3. Écriture des équations traduisant des réactions de précipitation<br />
4. Mise en évidence d’ions dans une eau de distribution<br />
D. ACTIVITÉS D’APPROPRIATION<br />
E. RESSOURCES À INTÉGRER<br />
Pour en savoir plus… Eau de distribution, eau de source et eaux minérales<br />
naturelles : comment s’y retrouver ?<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
Danse folle<br />
Belle farandole<br />
Univers explosé<br />
Éléments surchauffés.<br />
Voici qu’apparaît H.<br />
Sa nature généreuse<br />
Aux liaisons dangereuses<br />
L’incite. Ce n’est pas un lâche.<br />
Approche, ami de l’homme !<br />
Tel un fidèle majordome,<br />
Tu orchestres ma respiration.<br />
Molécule<br />
Oxygène, voici l’inspiration.<br />
Quel couple merveilleux<br />
Lorsque, chagrin des cieux,<br />
Vous purifiez le monde entier.<br />
O H ! s’exclamait Lavoisier,<br />
Ignorant la bigamie<br />
<strong>De</strong> l’élément laxiste.<br />
Un coquin de chimiste,<br />
Défiant la loi établie,<br />
Osa te nommer H deux O<br />
Puisque de toi il s’agit, Eau !<br />
VANEL 1992<br />
L’eau, dont la formule H 2 O n’a été établie qu’en 1805 par Gay-Lussac 1 et von Humboldt 2 , est très<br />
abondante sur Terre : elle recouvre environ 80 % de la surface du globe. Elle est aussi le principal<br />
constituant des organismes vivants : l’eau représente à peu près 60 % de la masse d’un être<br />
humain.<br />
L’eau est le meilleur solvant pour bon nombre de composés, formant ainsi des solutions aqueuses.<br />
Ainsi, par exemple, dans l’organisme :<br />
●<br />
des médicaments doivent être absorbés en solution aqueuse afin que leur action soit efficace<br />
et rapide (sirops, perfusions, gouttes nasales, injections,…) ;<br />
1. Louis-Joseph Gay-Lussac (1778-1850), physicien et chimiste français.<br />
2. Alexander von Humboldt (1769-1859), naturaliste allemand.<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
8 <strong>Chapitre</strong> 1<br />
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
●<br />
la sève et le sang sont en partie des solutions aqueuses de composés minéraux et organiques<br />
qui sont transportés au sein de tout le végétal ou de l’organisme.<br />
Ainsi, par exemple, dans l’industrie :<br />
● le sel de cuisine (NaCl), le sucre de table (saccharose C 12 H 22 O 11 ), …, sont obtenus par cristallisation<br />
de leurs solutions aqueuses ;<br />
● le cuivre et d’autres métaux sont fabriqués par électrolyse de solutions aqueuses de leurs<br />
sels ;<br />
● l’eau de Javel, le vinaigre, l’acide utilisé dans les accumulateurs au plomb (batteries), …, sont<br />
respectivement des solutions aqueuses de NaClO, CH 3 COOH, H 2 SO 4 .<br />
L’eau est également utilisée en tant que réactif, aussi bien dans la nature (photosynthèse, hydrolyse<br />
de l’amidon et des protéines lors de la digestion, …) que dans l’industrie (fabrication des<br />
savons, formation de dihydrogène par électrolyse de l’eau, …).<br />
Dans ce chapitre, nous allons, au travers de situations telles que :<br />
● la problématique des marées noires ;<br />
● les risques d’électrocution en milieu humide ;<br />
● la recherche d’ions dans une eau de distribution ;<br />
répondre aux questions suivantes :<br />
● comment expliquer que certains composés sont solubles dans l’eau et d’autres pas ?<br />
● comment expliquer que toutes les solutions ne sont pas conductrices de l’électricité ?<br />
● comment déterminer la présence de composés dissous dans l’eau ?<br />
•••••••••••••••••••••••••••<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
<strong>Molécules</strong> d’eau : molécules incontournables<br />
9
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
A. Solubilité des composés<br />
dans l’eau<br />
1. MISE EN SITUATION<br />
Les naufrages de pétroliers émaillent régulièrement l’actualité.<br />
Une de leurs conséquences est l’apparition de marées noires,<br />
comme le signale le bulletin d’information ci-joint.<br />
Cela résulte du fait que le pétrole ne se dissout quasiment pas<br />
dans l’eau de mer.<br />
Afin de répondre à la question « Comment expliquer que certains<br />
composés sont solubles dans l’eau et d’autres pas ? », une série<br />
d’expériences permettra de déterminer des critères de dissolution<br />
pouvant s’appliquer à un maximum de composés.<br />
Naufrage du pétrolier<br />
Prestige<br />
Jeudi 5 décembre 2002<br />
… <strong>De</strong>s nappes de fioul lourd qui s’est<br />
échappé de l’épave du pétrolier forment<br />
une marée noire qui touche les côtes espagnoles.<br />
<strong>De</strong>s mesures sont prises au cas où<br />
cette marée noire risquerait d’atteindre les<br />
côtes françaises.<br />
AFP<br />
TÂCHE<br />
Rechercher quels types de composés sont solubles ou non solubles dans l’eau (C.G.1)<br />
Matériel<br />
● 5 tubes à essais<br />
● Matériel pour la production de HCl (g)<br />
Réactifs<br />
● Eau distillée ou déminéralisée à température ambiante<br />
● NaCl (s) ; I 2 (s) ; C 8 H 18 (essence) ; HCl (g) ; NaOH (s) ; C 6 H 5 – CH = CH 2 (styrène)<br />
Mode opératoire<br />
● Placer 10 mL d’eau déminéralisée, dans chaque<br />
tube à essais.<br />
● Ajouter respectivement, dans chaque tube à essais,<br />
2 mL de chacun des composés liquides ou 0,5 g des<br />
composés solides.<br />
● Agiter si nécessaire et observer s’il y a dissolution<br />
ou non.<br />
● Production de HCl (g) (par le professeur) : préparer<br />
le montage ci-contre et réaliser l’expérience (sous<br />
hotte) :<br />
– Introduire 5 grammes de NaCl dans le ballon.<br />
H 2<br />
SO 4<br />
HCl<br />
NaCl<br />
HCl<br />
HCl<br />
H 2<br />
O<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
10 <strong>Chapitre</strong> 1<br />
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
●<br />
– Par l’entonnoir, verser 30 mL de H 2 SO 4 concentré et chauffer modérément.<br />
– Le gaz HCl est recueilli dans un flacon par déplacement d’air.<br />
– Le gaz en excès est conduit dans l’eau d’un berlin.<br />
Observer s’il y a dissolution ou non.<br />
Tableau des observations<br />
Réaliser un tableau dans lequel les composés seront classés en composés solubles ou non<br />
solubles dans l’eau.<br />
Interprétation des observations<br />
Rechercher, à partir des formules de structure des composés, des hypothèses permettant<br />
de justifier les différences de solubilité.<br />
2. APPROPRIATION DU CONCEPT :<br />
SOLUBILITÉ DES COMPOSÉS DANS L’EAU<br />
Nous savons que :<br />
●<br />
une dissolution est un phénomène au cours duquel un composé (le soluté) se dissout dans<br />
un liquide (le solvant) ;<br />
● le soluté est le composé qui se dissout (sel de cuisine, savon, sels de bain, …) ;<br />
● le solvant est le composé qui dissout (eau dans le cas d’une boisson, d’un bain) ;<br />
Une solution est un mélange homogène formé par un soluté dissous dans un solvant et, si le solvant<br />
est de l’eau, il s’agit d’une solution aqueuse.<br />
Nous avons remarqué, lors de la réalisation de la tâche, que les composés ne sont pas tous solubles<br />
dans l’eau.<br />
Voici la classification normalement obtenue :<br />
composés solubles<br />
NaCl ; NaOH ; HCl<br />
composés non solubles<br />
diiode ; styrène ; essence<br />
2.1 Interprétation<br />
●<br />
En 4 e , il a été montré que la molécule d’eau est polaire car<br />
– elle possède des liaisons covalentes polarisées ;<br />
– la résultante des charges partielles positives ne coïncide<br />
pas avec la résultante des charges partielles négatives.<br />
<strong>De</strong> ce fait, la molécule possède deux pôles distincts :<br />
H 2 O est une molécule polaire.<br />
H<br />
2 δ –<br />
2 δ + H<br />
ou plus<br />
simplement<br />
–<br />
+<br />
dipôle<br />
•••••••••••••••••••••••••••<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
<strong>Molécules</strong> d’eau : molécules incontournables<br />
11
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
●<br />
Si on analyse les formules de structure des composés solubles dans l’eau,<br />
Na + Cl – Na + OH – H δ+ Cl δ– Le chlorure de sodium NaCl, est extrait<br />
●<br />
on constate que ceux-ci possèdent :<br />
– soit des liaisons ioniques, comme dans NaCl ou NaOH.<br />
Ces composés renferment donc des charges positives et<br />
négatives (Na + et Cl – ou Na + et OH – ) : ce sont des composés<br />
ioniques ;<br />
– soit des liaisons covalentes polarisées comme dans<br />
HCl (g) : la résultante des charges partielles positives ne<br />
coïncide pas avec la résultante des charges partielles<br />
négatives : ce sont des molécules polaires.<br />
Si on analyse les formules de structure des composés non<br />
solubles dans l’eau,<br />
dans des mines ou des salines ou par évaporation<br />
de l’eau de mer.<br />
Il sert de condiment (à consommer avec<br />
modération), est présent dans les sels de<br />
bain, est utilisé dans les adoucisseurs<br />
d’eau, facilite le déneigement, …<br />
Diiode<br />
I<br />
I<br />
Styrène<br />
CH = CH 2<br />
C 6 H 5<br />
Octane (hydrocarbure présent<br />
dans le pétrole et l’essence)<br />
H H H H H H H<br />
H C C C C<br />
H<br />
H C C C C<br />
H<br />
H<br />
H<br />
H<br />
H<br />
H<br />
H<br />
H<br />
on constate qu’ils sont constitués de molécules ayant une<br />
large prédominance de liens covalents parfaits (entre I et I<br />
dans le diiode ou entre C — C et C — H dans le styrène et<br />
dans l’octane) et aucun pôle positif ou négatif n’apparaît<br />
donc dans ces molécules.<br />
Il s’agit de molécules non polaires.<br />
En conclusion, on peut interpréter la solubilité dans l’eau par<br />
le fait qu’une attraction existe entre les pôles positifs et négatifs<br />
de l’eau et :<br />
●<br />
●<br />
les charges – et + des ions des composés à liaisons<br />
ioniques ;<br />
les pôles négatifs et positifs des molécules des composés<br />
covalents à liaisons polarisées, à condition que la résultante<br />
des charges partielles positives ne coïncide pas avec la<br />
résultante des charges partielles négatives.<br />
Ces ions ou molécules forment avec l’eau une solution aqueuse.<br />
L’iode est présent sous forme d’iodures<br />
dans l’eau de mer, dans des algues marines.<br />
Il est utilisé dans les lampes à iode (pour<br />
augmenter leur longévité), comme désinfectant<br />
dans la teinture d’iode.<br />
Ses sels sont utilisés pour le traitement de<br />
la glande thyroïde, en photographie, dans<br />
la fabrication du pain iodé,…<br />
Par contre, les molécules non polaires ne sont quasiment pas attirées par les molécules d’eau : elles<br />
sont donc très peu solubles dans l’eau.<br />
En termes de solubilité, on peut dire : « En général, ce qui se ressemble s’assemble ».<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
12 <strong>Chapitre</strong> 1<br />
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
Solvant<br />
Soluté<br />
Ionique<br />
ou<br />
polaire<br />
Non polaire<br />
polaire<br />
SOLUBLE<br />
TRÈS PEU SOLUBLE<br />
2.2 Le phénomène de formation des marées noires<br />
Ayant acquis le concept de « solubilité des substances dans l’eau », nous pouvons maintenant rendre<br />
compte du phénomène de formation des marées noires.<br />
Le pétrole, composé d’un ensemble de molécules d’hydrocarbures non polaires de la même famille<br />
que l’octane, a un comportement globalement non polaire et se dissout très peu dans l’eau, contrairement<br />
à des sels tels que NaCl et KCl (composés ioniques).<br />
Puisque la masse volumique du pétrole (0,993 g.mL –1 pour celui du pétrolier Prestige) est légèrement<br />
inférieure à celle de l’eau, la plus grande partie du pétrole flotte à la surface de l’eau : ceci<br />
explique la formation des nappes de pétrole lors du naufrage d’un pétrolier et leur dérive possible<br />
vers les côtes sous l’influence des marées et des vents dominants.<br />
Les moyens de lutte contre une marée noire sont mécaniques (installation de barrages flottants,<br />
nettoyage des plages, …), chimiques (usage de détergents) ou biologiques (utilisation de bactéries<br />
« mangeuses » d’hydrocarbures) mais n’évitent pas une destruction partielle de la flore et de la<br />
faune du milieu marin.<br />
Étant donné qu’il vaut mieux prévenir que guérir, il serait indispensable que les conditions de<br />
transport du pétrole soient mieux sécurisées (généralisation des pétroliers à double coque, routes<br />
de navigation moins encombrées) et respectées (inspection régulière des bateaux et dégazage<br />
aux endroits prévus).<br />
Ainsi, des accidents à répétition tels ceux du Prestige en 2002, de l’Erika en 1999, de l’Exxon Valdez<br />
en 1989, …, ne seraient plus à craindre.<br />
•••••••••••••••••••••••••••<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
<strong>Molécules</strong> d’eau : molécules incontournables<br />
13
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
3. EXPRESSION DE LA SOLUBILITÉ<br />
La solubilité molaire est le nombre maximum de moles de soluté dissous dans un litre de solution<br />
à une température donnée. On la note « s » et son unité est « mol.L –1 ».<br />
La solubilité massique est le nombre maximal de grammes de soluté dissous dans un litre de<br />
solution à une température donnée. On la note « s » et son unité est « g.L –1 ».<br />
Lorsque la valeur de la solubilité est atteinte dans une solution, on ne peut plus dissoudre de soluté<br />
dans cette solution : la solution est saturée. Si on continue à ajouter du soluté à une solution<br />
saturée, celui-ci ne se dissout plus et un dépôt apparaît dans le cas d’un soluté solide.<br />
Le tableau suivant montre que la solubilité dans l’eau, à 20 °C, varie fortement d’un composé à<br />
l’autre :<br />
composé solubilité (mol.L –1 ) solubilité (g.L –1 )<br />
CaCO 3 9,5.10 –5 0,01<br />
NaCl 6,0 350<br />
NaOH 10,5 420<br />
C 12 H 22 O 11 3,9 1334<br />
La solubilité variant fortement d’un composé à l’autre, par convention, sont considérés comme :<br />
● solubles, les composés dont la solubilité est supérieure à 0,1 mole par litre de solution ;<br />
●<br />
peu solubles, les composés dont la solubilité est inférieure à 0,1 mole par litre de solution. Le<br />
terme « insoluble » est souvent utilisé pour désigner ces composés.<br />
En se basant sur la convention précédente, un tableau qualitatif des composés solubles et peu solubles<br />
(appelés aussi « insolubles ») dans l’eau a été établi. En voici un extrait :<br />
Anions<br />
Nitrate<br />
Chlorure<br />
Sulfure<br />
Sulfate<br />
Cations<br />
–<br />
NO 3<br />
Cl –<br />
S 2–<br />
2–<br />
SO 4<br />
Na + K + Ca 2+ Fe 2+ Ag + Pb 2+<br />
soluble<br />
peu soluble (insoluble)<br />
n’existe pas ou<br />
se décompose dans l’eau<br />
La lecture de ce tableau montre que :<br />
● NaCl, CaCl 2 , Pb(NO 3 ) 2 sont des composés solubles ;<br />
● AgCl, CaSO 4 , PbS sont des composés peu solubles.<br />
Un tableau plus complet est donné en annexe, p. 256.<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
14 <strong>Chapitre</strong> 1<br />
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
Exercices<br />
●<br />
●<br />
●<br />
Calculer et exprimer en g.L –1 et en mol.L –1 la solubilité des composés suivants<br />
et déterminer s’ils sont solubles ou peu solubles, en se basant sur la convention<br />
établie au point 3 :<br />
– PbCl 2 si 1,2 g sont dissous dans 250 mL de solution saturée ;<br />
– CaCl 2 si 372,5 g sont dissous dans 500 mL de solution saturée ;<br />
– AgCl si 3,9.10 –4 g sont dissous dans 200 mL de solution saturée.<br />
Calculer la masse de chlorure de potassium que contient 1 litre de solution<br />
saturée, sachant que la solubilité de ce composé est 4,66 mol.L –1 .<br />
Calculer la masse de carbonate de calcium que<br />
contiennent 250 mL de solution saturée, sachant<br />
que la solubilité de ce composé est 9,5. 10 –5<br />
mol.L –1 .<br />
Couche de calcaire<br />
Le carbonate de calcium CaCO 3 , appelé<br />
calcaire, est présent dans la craie et le<br />
marbre, dans les coquilles d’œufs et de<br />
coquillages.<br />
Il est transformé en chaux vive, CaO, par<br />
chauffage.<br />
On l’utilise pour la fabrication de ciments<br />
(combiné à de la silice et de l’alumine<br />
d’où le terme aluminosilicate de calcium).<br />
Ajouté au papier, il confère à ce dernier un<br />
éclat plus blanc et un toucher plus lisse.<br />
Le calcaire est, entre autres, responsable<br />
de l’entartrage des tuyaux où circule une<br />
eau dure qui a été chauffée.<br />
●<br />
Lire l’article ci-dessous et vérifier si les renseignements de l’article sont conformes<br />
à la convention concernant les substances solubles ou peu solubles :<br />
« Le sulfate de baryum est un produit de contraste utilisé lors d’examens<br />
radiographiques des tissus mous du tube digestif.<br />
Il se présente sous la forme d’une poudre blanche cristalline<br />
peu soluble dans l’eau. La solubilité du sulfate de baryum est de<br />
2,4.10 –4 g dans 100 mL de solution aqueuse.<br />
En radiologie, le sulfate de baryum est utilisé sous la forme d’une<br />
suspension aqueuse appelée baryte. C’est un produit qui n’est ni<br />
digéré, ni absorbé. La seule contre-indication à l’utilisation de la<br />
baryte est la présence préalable d’une perforation du tube digestif :<br />
au contact des tissus, le sulfate de baryum entraîne une réaction<br />
inflammatoire. »<br />
Radiographie<br />
de l’intestin<br />
•••••••••••••••••••••••••••<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
<strong>Molécules</strong> d’eau : molécules incontournables<br />
15
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
B. Modèle de solutions aqueuses<br />
1. MISE EN SITUATION<br />
Nous venons d’étudier la solubilité des composés dans l’eau et nous savons maintenant que certains<br />
composés sont solubles dans l’eau et forment des solutions aqueuses.<br />
L’eau de distribution est l’une de ces solutions aqueuses. Or, cette eau est conductrice du courant<br />
électrique, puisqu’on peut s’électrocuter si, en prenant un bain, un appareil électrique branché<br />
tombe dans l’eau.<br />
Il serait donc intéressant de savoir sous quelle forme les différents composés dissous sont présents<br />
au sein de ces solutions aqueuses. Pour ce faire, nous allons mesurer la conductivité électrique<br />
de l’eau distillée et de quelques solutions aqueuses afin d’établir un modèle des solutions<br />
aqueuses.<br />
TÂCHE<br />
Mesurer la conductivité électrique de solutions aqueuses en vue de les classer<br />
en solutions conductrices et non conductrices (C.G.1,3)<br />
Appareillage<br />
● La conductivité électrique des solutions se mesure à l’aide<br />
d’un appareil appelé conductimètre qui détermine la capacité<br />
d’une solution à conduire le courant. La conductivité est<br />
généralement exprimée en microsiemens par cm (µS.cm –1 ).<br />
● Si on ne possède pas de conductimètre, on peut employer le<br />
montage ci-après en veillant à conserver constantes la différence<br />
de potentiel et la distance entre les électrodes. Ce<br />
montage permet de mesurer l’intensité du courant passant<br />
dans la solution, nous donnant ainsi une idée de la conductivité<br />
de cette solution. L’intensité du courant sera mesurée<br />
en ampères (A) : plus sa valeur est élevée, plus la solution<br />
est conductrice.<br />
Matériel<br />
● Berlin de 100 mL<br />
● Cylindres gradués de 50 mL<br />
● Appareil pour déterminer la conductivité (conductimètre ou ampèremètre)<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
16 <strong>Chapitre</strong> 1<br />
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Extrait de Chimie 5e - 6e, P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, A. Tadino, <strong>De</strong> <strong>Boeck</strong> & Larcier, 2004<br />
Réactifs<br />
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
Eau déminéralisée fraîchement bouillie<br />
Eau de distribution<br />
Eau minérale<br />
Solutions aqueuses environ 1 mol.L –1 de : NaCl, HCl, NaOH,<br />
C 12 H 22 O 11 (sucre), CH 3 OH(méthanol), CH 3 COCH 3 (acétone),<br />
CH 3 COOH (acide acétique)<br />
Mode opératoire<br />
●<br />
●<br />
Plonger les électrodes propres dans 50 mL d’eau distillée contenue<br />
dans un berlin et mesurer la conductivité de la solution<br />
électrodes<br />
ou l’intensité du courant.<br />
Faire de même avec les différentes solutions en ayant soin, entre chaque expérience,<br />
de rincer les électrodes à l’eau distillée.<br />
Tableau des observations<br />
A<br />
V<br />
5 V<br />
Échantillon<br />
testé<br />
Conductivité (µ S.cm –1 )<br />
ou intensité (A)<br />
Échantillon<br />
testé<br />
Conductivité (µ S.cm –1 )<br />
ou intensité (A)<br />
Eau distillée<br />
HCl<br />
Eau de distribution<br />
NaOH<br />
Eau minérale<br />
sucre<br />
NaCl<br />
méthanol<br />
Acide acétique<br />
acétone<br />
Analyse des résultats<br />
1. Classer les solutions aqueuses en solutions conductrices ou non conductrices.<br />
2. Après lecture de l’article ci-dessous, expliquer pourquoi certains composés dissous<br />
dans l’eau rendent conductrice la solution obtenue.<br />
« Svante Arrhénius, savant suédois, est né à Wyk-Uppsala le 19 février 1859.<br />
En 1882, il s’intéressa à la conductivité de solutions diluées et publia ses premiers résultats<br />
dans deux articles rédigés en français sous le titre : « Recherches sur la conductibilité<br />
galvanique des électrolytes ».<br />
Dans sa brillante théorie, Arrhénius admettait que les composés dissous étaient susceptibles<br />
d’exister en solution diluée sous deux formes, l’une dissociée en ions responsables de<br />
la conductivité électrique, l’autre non dissociée et donc sous une forme moléculaire. Cette<br />
formation d’ions se heurta au scepticisme de nombreux scientifiques, tant parmi les chimistes<br />
que parmi les physiciens, qui avaient des difficultés à admettre que les propriétés<br />
du sodium et du chlore, par exemple, étaient très différentes de celles des ions provenant<br />
de la dissociation du chlorure de sodium dissous dans l’eau.<br />
•••••••••••••••••••••••••••<br />
Téléchargeable sur www.espace-sciences.com<br />
<strong>Molécules</strong> d’eau : molécules incontournables<br />
17