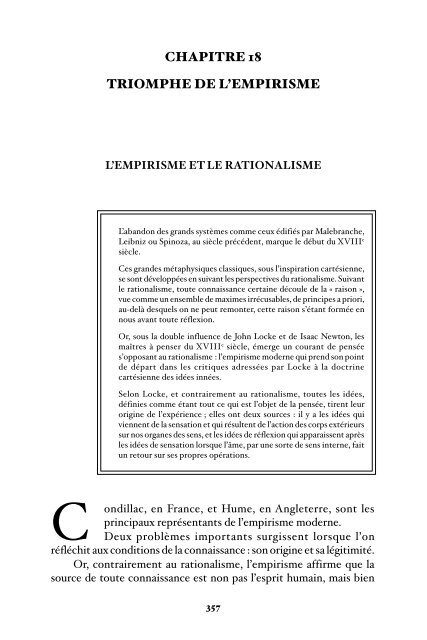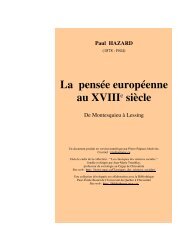CHAPITRE 18 TRIOMPHE DE L'EMPIRISME - Les Classiques des ...
CHAPITRE 18 TRIOMPHE DE L'EMPIRISME - Les Classiques des ...
CHAPITRE 18 TRIOMPHE DE L'EMPIRISME - Les Classiques des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
le triomphe de l’empirisme<br />
<strong>CHAPITRE</strong> <strong>18</strong><br />
<strong>TRIOMPHE</strong> <strong>DE</strong> L’EMPIRISME<br />
L’EMPIRISME ET LE RATIONALISME<br />
L’abandon <strong>des</strong> grands systèmes comme ceux édifiés par Malebranche,<br />
Leibniz ou Spinoza, au siècle précédent, marque le début du XVIII e<br />
siècle.<br />
Ces gran<strong>des</strong> métaphysiques classiques, sous l’inspiration cartésienne,<br />
se sont développées en suivant les perspectives du rationalisme. Suivant<br />
le rationalisme, toute connaissance certaine découle de la « raison »,<br />
vue comme un ensemble de maximes irrécusables, de principes a priori,<br />
au-delà <strong>des</strong>quels on ne peut remonter, cette raison s’étant formée en<br />
nous avant toute réflexion.<br />
Or, sous la double influence de John Locke et de Isaac Newton, les<br />
maîtres à penser du XVIII e siècle, émerge un courant de pensée<br />
s’opposant au rationalisme : l’empirisme moderne qui prend son point<br />
de départ dans les critiques adressées par Locke à la doctrine<br />
cartésienne <strong>des</strong> idées innées.<br />
Selon Locke, et contrairement au rationalisme, toutes les idées,<br />
définies comme étant tout ce qui est l’objet de la pensée, tirent leur<br />
origine de l’expérience ; elles ont deux sources : il y a les idées qui<br />
viennent de la sensation et qui résultent de l’action <strong>des</strong> corps extérieurs<br />
sur nos organes <strong>des</strong> sens, et les idées de réflexion qui apparaissent après<br />
les idées de sensation lorsque l’âme, par une sorte de sens interne, fait<br />
un retour sur ses propres opérations.<br />
C<br />
ondillac, en France, et Hume, en Angleterre, sont les<br />
principaux représentants de l’empirisme moderne.<br />
Deux problèmes importants surgissent lorsque l’on<br />
réfléchit aux conditions de la connaissance : son origine et sa légitimité.<br />
Or, contrairement au rationalisme, l’empirisme affirme que la<br />
source de toute connaissance est non pas l’esprit humain, mais bien<br />
357
<strong>Les</strong> gran<strong>des</strong> figures du monde moderne<br />
l’action du monde extérieur sur le sujet : la connaissance tire sa<br />
légitimité de la vérification expérimentale et non pas d’une démonstration<br />
rationnelle. Pensons ici à l’axiome d’Aristote qui exprime,<br />
en quelque sorte, la thèse fondamentale de l’empirisme : « rien n’est<br />
dans l’esprit qui ne fût d’abord dans les sens » ; ou encore à la proposition<br />
de Locke selon laquelle « l’esprit est une page blanche vide de tout<br />
caractère », une « tabula rasa ».<br />
De plus, puisque la science newtonnienne se développe par<br />
l’expérimentation et qu’elle refuse les hypothèses et les principes<br />
abstraits, Condillac et Hume, par exemple, prendront la science<br />
expérimentale comme modèle de la connaissance. Ils l’utiliseront, entre<br />
autres, pour attaquer les doctrines rationalistes du siècle passé.<br />
LA MÉTAPHYSIQUE COMME SCIENCE<br />
C<br />
omme beaucoup d’hommes du XVIIIe siècle, Hume<br />
aussi bien que Condillac tenteront de faire de la métaphysique<br />
une science. Et c’est en ce sens que l’on peut<br />
parler d’une révolution métaphysique et d’un triomphe de l’empirisme.<br />
Pour Condillac, par exemple, il existe deux métaphysiques. Il y a<br />
l’ancienne, celle <strong>des</strong> cartésiens, qui est fausse, vaine, ambitieuse, et qui<br />
ne représente qu’un « ramassis d’abstractions », et la nouvelle<br />
métaphysique, la vraie, celle de Locke, qui contient la connaissance<br />
dans les bornes de l’expérience et qui peut ainsi atteindre <strong>des</strong> vérités.<br />
Hume, de même, nous dira qu’il faut détruire la fausse métaphysique.<br />
Il voudra montrer qu’il faut employer dans l’étude de l’esprit<br />
humain la « méthode expérimentale », illustrée par Newton dans la<br />
mécanique céleste. Il se proposera d’être, en quelque sorte, le Newton<br />
<strong>des</strong> sciences morales et d’établir une espèce de géométrie mentale.<br />
Hume nous invite même, à la fin de l’Enquête sur l’entendement<br />
humain, à un autodafé symbolique. Il nous dit :<br />
Quand persuadé de ces principes, nous parcourons les bibliothèques,<br />
que nous faut-il détruire ? Si nous prenons en main un volume de<br />
théologie ou de métaphysique scolastique, par exemple, demandonsnous<br />
: contient-il <strong>des</strong> raisonnements abstraits sur la quantité ou le<br />
nombre ? Non. Contient-il <strong>des</strong> raisonnements expérimentaux sur <strong>des</strong><br />
questions de fait et d’existence ? Non. Alors mettez-le au feu, car il ne<br />
contient que sophismes et illusions.<br />
Hume comme Condillac reprennent les principes ou les thèses<br />
principales qui définissent l’empirisme lockéen. Tous deux, cependant,<br />
358
le triomphe de l’empirisme<br />
vont prendre rapidement leurs distances par rapport à l’explication et<br />
à l’application de ces principes.<br />
DAVID HUME ET LE SCEPTICISME CRITIQUE<br />
David Hume, 1711-1776<br />
gravure d’après le tableau de Allan Ramsay<br />
D<br />
avid Hume est né en Écosse, à Édimbourg, en 1711 d’une<br />
famille de petite noblesse ; il meurt en 1776.<br />
Grand voyageur, il mène une vie assez mondaine et<br />
fréquente les salons parisiens. En 1766, rentrant en Angleterre, il offre<br />
à son ami Rousseau de le prendre avec lui. Le philosophe, persuadé<br />
d’être persécuté par la coterie <strong>des</strong> Encyclopédistes, cherchait à ce<br />
moment-là asile hors de Paris. Il faut dire que Rousseau entretenait<br />
<strong>des</strong> relations assez troubles avec bon nombre de ses contemporains,<br />
Condillac excepté. Et Hume n’y échappera pas : Rousseau finira par<br />
croire que même le « bon David » fait partie de la conspiration<br />
contre lui.<br />
359
<strong>Les</strong> gran<strong>des</strong> figures du monde moderne<br />
Parmi l’œuvre de Hume, le Traité de la nature humaine, publié en<br />
1739, est son ouvrage fondamental. Cependant, en plus d’une théorie<br />
de la connaissance, Hume traitera de sujets aussi divers que la religion,<br />
la morale, la politique.<br />
Il écrira, notamment, une Histoire de la Grande-Bretagne qui lui<br />
vaudra un grand succès.<br />
<strong>Les</strong> perceptions et la théorie de la copie<br />
Dans son Traité de la nature humaine, Hume défend la thèse selon<br />
laquelle les perceptions sont tout ce qui peut être présent à l’esprit. Il<br />
faut remarquer qu’il parle de perceptions et non d’idées comme chez<br />
Locke. Ce sera précisément en proposant de nouvelles significations<br />
pour les termes « idée » et « impression », et aussi grâce à sa théorie de la<br />
copie, que Hume estimera possible de « détruire le mythe <strong>des</strong> idées<br />
innées », comme il le dit lui-même. Ce que Locke, soutient-il, n’a pas<br />
réussi à faire.<br />
Selon Hume, il y a deux espèces de perceptions humaines. <strong>Les</strong><br />
impressions constituent la première espèce. Ce sont les perceptions<br />
les plus fortes et les plus vives : par exemple, lorsque l’on goûte un plat<br />
exquis ou lorsque l’on sent une odeur de parfum agréable. La deuxième<br />
espèce de perceptions, à savoir les idées, sont <strong>des</strong> perceptions moins<br />
fortes et moins vives car elles sont en fait <strong>des</strong> copies <strong>des</strong> impressions :<br />
par exemple, lorsque l’on se remémore le goût de ce plat ou encore<br />
l’odeur de ce parfum.<br />
Dans cet extrait tiré de l’Enquête sur l’entendement humain,<br />
Hume montre clairement que les idées ne sont que <strong>des</strong> copies plus<br />
faibles et moins vives de l’impression correspondante.<br />
Que signifie inné ? Si inné équivaut à naturel, alors il faut accorder que<br />
toutes les perceptions et toutes les idées de l’esprit sont innées ou<br />
naturelles en quelques sens que nous prenions ce dernier mot, que ce<br />
soit en l’opposant à peu commun, à artificiel ou à miraculeux. Si, par<br />
inné, on signifie contemporain de notre naissance, la discussion semble<br />
frivole ; cela ne vaut pas la peine de rechercher à quel moment<br />
commence la pensée, avant, après, ou à notre naissance. En outre, le<br />
mot idée est couramment pris par Locke et par les autres dans un sens<br />
très imprécis, semble-t-il : il représente toutes nos perceptions, nos<br />
sensations et nos passions aussi bien que nos pensées. Or, si l’on accepte<br />
ce sens, je désirerais savoir ce qu’on peut vouloir dire quand on affirme<br />
que l’amour de soi, ou le ressentiment <strong>des</strong> injustices subies, ou la passion<br />
entre les sexes ne sont pas innés. Mais, si l’on admet ces termes<br />
impressions et idées, au sens exposé ci-<strong>des</strong>sus et que l’on entende par<br />
inné ce qui est primitif, ce qui n’est copié d’aucune perception<br />
360
le triomphe de l’empirisme<br />
antérieure, alors nous pouvons affirmer que toutes nos impressions sont<br />
innées et que nos idées ne le sont pas. Pour être franc, je dois avouer<br />
que, à mon avis, Locke fut, sur cette question, la dupe <strong>des</strong> gens de l’École<br />
qui, employant <strong>des</strong> termes sans les définir, étirèrent leurs controverses<br />
et les allongèrent fastidieusement sans jamais toucher le point en<br />
discussion. Une ambiguïté semblable et de semblables ambages courent,<br />
semble-t-il, à travers les raisonnements de ce philosophe sur ce sujet<br />
aussi bien que sur la plupart <strong>des</strong> autres questions.<br />
La possibilité de connaître<br />
On qualifie généraslement la position empirique de David Hume<br />
de sceptique, mais cela doit être compris dans un sens très précis.<br />
Pour Hume, il est important de ne pas juger hâtivement, d’avancer<br />
à pas prudents, de revoir nos conclusions et, surtout, d’enfermer dans<br />
les limites de l’expérience les recherches de l’entendement.<br />
361
<strong>Les</strong> gran<strong>des</strong> figures du monde moderne<br />
En ce sens, la philosophie de Hume est une critique : critique de<br />
l’entendement, de la morale, de la littérature, de l’art. En revanche, il<br />
est possible d’atteindre <strong>des</strong> vérités et, par conséquent, on ne doit pas<br />
comprendre le scepticisme humien au sens courant du terme, mais<br />
plutôt comme un scepticisme qu’il qualifie lui-même de « mitigé » ou<br />
ce qu’il nomme une philosophie « académique ».<br />
Hume distingue deux genres d’objets de la raison humaine ou de<br />
nos raisonnements.<br />
Il y a les relations d’idées dont s’occupent les sciences de la<br />
géométrie, de l’algèbre et de l’arithmétique, et toute affirmation à leur<br />
sujet est démonstrativement certaine. Elles sont démonstrativement<br />
certaines parce que, selon Hume, une démonstration se fonde<br />
seulement sur la comparaison <strong>des</strong> idées, et que les propositions de la<br />
géométrie, de l’algèbre et de l’arithmétique peuvent être découvertes<br />
par la seule opération de la pensée.<br />
<strong>Les</strong> faits sont le deuxième genre d’objets de la raison humaine. Il<br />
est évident, pour Hume, que leur vérité ne peut être établie de la même<br />
façon que pour les relations d’idées. Contrairement aux démonstrations<br />
pour qui leur contraire implique une contradiction, le contraire d’un<br />
fait est toujours possible. Par exemple, la proposition suivant laquelle<br />
« le soleil ne se lèvera pas demain », n’est pas moins une proposition<br />
intelligible et n’implique pas plus une contradiction que l’affirmation<br />
selon laquelle « le soleil se lèvera demain ». Ces deux propositions ne<br />
sont pas contradictoires car l’esprit peut concevoir aussi facilement et<br />
distinctement l’une et l’autre. L’esprit peut concevoir le contraire d’un<br />
fait comme s’il concordait avec la réalité.<br />
La causalité<br />
Hume est aussi célèbre pour sa critique de la relation de causalité.<br />
Selon lui, il y a dans l’esprit humain <strong>des</strong> principes qui déterminent<br />
les relations par lesquelles l’esprit associe les idées ; ils sont ce par quoi<br />
deux idées sont connectées. Ces principes universels d’association<br />
produisent donc <strong>des</strong> relations nommées « naturelles », l’esprit passant<br />
naturellement d’une idée à une autre ; c’est pourquoi Hume les compare<br />
aussi à une « espèce d’attraction ». Pensons ici à Newton.<br />
Suivant Hume, la causalité est un <strong>des</strong> trois principes d’association.<br />
Elle est la seule, cependant, qui nous permet de faire <strong>des</strong> raisonnements<br />
ou bien <strong>des</strong> inférences sur les faits qui ne sont pas présents à nos sens<br />
ou à notre mémoire. Grâce à la causalité il nous est possible d’affirmer<br />
que, si nous voyons de la fumée, le feu n’est pas trop loin.<br />
362
le triomphe de l’empirisme<br />
Pour Hume les idées ne sont que <strong>des</strong> copies de leur impression<br />
correspondante. Si nous avons l’idée de causalité, celle-ci dès lors doit<br />
dériver de son impression correspondante ; une force productive doit<br />
Édimbourg à l’époque de Hume<br />
se manifester à nos sens, par exemple. Or, pour Hume, il n’y a aucune<br />
force qui se manifeste de cette façon.<br />
Pour reprendre l’exemple qu’il donne de la boule de billard,<br />
évoquons une boule de billard qui se meut sur la table vers une autre<br />
boule de billard, qui, elle, est en repos ; on se rend immédiatement<br />
compte que la boule en repos acquiert un mouvement aussitôt qu’elle<br />
est en contact avec la boule en mouvement. On a ici un exemple de la<br />
relation de cause à effet telle que vue ou sentie. Mais, selon Hume, rien<br />
ne prouve encore que la matière est dotée d’une force ou d’une énergie<br />
intrinsèque. La seule chose que nous percevons, c’est que les boules de<br />
billard en mouvement communiquent, à chaque fois, leur impulsion<br />
en touchant aux boules en repos. En d’autres termes, on s’aperçoit qu’il<br />
n’y a qu’une conjonction constante entre les objets.<br />
363
<strong>Les</strong> gran<strong>des</strong> figures du monde moderne<br />
Hume accepte donc la conclusion cartésienne selon laquelle la<br />
matière n’est pas dotée de pouvoir propre. Et, en ce sens, il s’oppose à<br />
la conclusion générale <strong>des</strong> empiristes selon laquelle la force productive<br />
existe dans la matière. Mais si les empiristes soutenaient que la force<br />
existe dans la matière, c’était, avant tout, pour ne pas être obligés d’avoir<br />
recours à Dieu comme principe d’explication. Comme on le voit dans<br />
cet extrait tiré de l’Abrégé du traité de la nature humaine, Hume<br />
n’accepte pas pour autant la solution cartésienne au problème de la<br />
causalité.<br />
On suppose communément qu’il y a une connexion nécessaire entre la<br />
cause et l’effet, et que la cause possède quelque chose que nous appelons<br />
pouvoir, force, ou énergie. La question est la suivante : quelle idée<br />
s’attache à ces termes ? Si toutes nos idées ou pensées dérivent de nos<br />
impressions, ce pouvoir doit lui-même se manifester soit à nos sens,<br />
soit à notre sentiment interne. Mais tant s’en faut qu’aucun pouvoir se<br />
manifeste de lui-même aux sens dans les opérations de la matière, que<br />
les cartésiens ne se sont fait aucun scrupule d’affirmer que la matière<br />
est complètement dépourvue d’énergie et que toutes ses opérations<br />
sont exécutées uniquement par l’énergie de l’Être suprême. Mais la<br />
question revient toujours : quelle idée avons-nous de l’énergie ou du<br />
pouvoir, même dans l’Être suprême ? Toute notre idée d’une divinité<br />
(d’après ceux qui nient les idées innées) n’est autre chose qu’une<br />
composition de ces idées que nous acquérons en réfléchissant sur les<br />
opérations de notre propre esprit. Or, pas plus que la matière, notre<br />
esprit ne nous fournit la notion d’énergie. Lorsque nous considérons a<br />
priori notre volonté ou volition, en faisait abstraction de l’expérience,<br />
jamais nous ne sommes capables d’en inférer un effet quelconque. Et<br />
lorsque nous nous nous appuyons sur l’expérience, celle-ci nous montre<br />
seulement <strong>des</strong> objets contigus, successifs et conjoints de manière<br />
constante. En somme, donc, ou bien nous n’avons pas du tout d’idée<br />
de la force et de l’énergie, et ces mots sont entièrement dépourvus de<br />
signification ; ou bien ils ne peuvent rien signifier d’autre que cette<br />
détermination de la pensée, acquise par l’habitude, à passer de la cause<br />
à son effet ordinaire.<br />
L’esprit ne peut jamais, par la simple analyse, trouver l’effet dans<br />
la cause supposée. Tous les raisonnements qui concernent la cause et<br />
l’effet sont fondés, selon Hume, sur l’expérience. C’est parce que nous<br />
avons eu, par le passé, <strong>des</strong> exemples de l’existence d’une sorte d’objets<br />
et que nous nous souvenons aussi <strong>des</strong> exemples d’une autre sorte<br />
d’objets qui les ont toujours suivis, que nous nommons la première sorte<br />
d’objets : « cause », et la deuxième sorte d’objets : « effet ». Autrement<br />
dit, c’est parce que dans notre expérience passée nous avons toujours<br />
364
le triomphe de l’empirisme<br />
perçu de la fumée se dégager du feu, que nous disons du feu qu’il est la<br />
cause de la fumée.<br />
L’accoutumance<br />
Il y a pourtant une distinction fondamentale entre le fait d’affirmer<br />
que nous avons trouvé par expérience que telle sorte d’objets a toujours<br />
été suivie de telle autre sorte d’objets, et le fait d’affirmer que <strong>des</strong> objets<br />
semblables à la première sorte seront suivis, dans le futur, d’objets<br />
semblables à la deuxième sorte.<br />
La première affirmation nous renvoie à la relation de causalité telle<br />
que nous la trouvons entre deux objets qui sont présents à nos sens ou<br />
à notre mémoire. Pensons derechef à l’exemple de la boule de billard.<br />
La deuxième affirmation, quant à elle, est plus difficile à expliquer,<br />
puisque nous nous rendons compte que l’esprit fait <strong>des</strong> inférences ; par<br />
exemple, à la vue de la fumée, il infère qu’il y a du feu mais cette inférence<br />
n’est justifiée par aucune sorte de raisonnement. Or, si l’esprit n’est<br />
soutenu par aucun argument pour faire une inférence de la cause à<br />
l’effet, il doit être dirigé par un autre principe. Ce principe, c’est le<br />
principe de l’accoutumance, de l’habitude. C’est par accoutumance,<br />
ou habitude, que nous attendons l’effet lorsqu’une cause apparaît.<br />
L’accoutumance est donc « le grand guide de la vie humaine ». Il<br />
faut comprendre que, pour Hume, il est important ici de connaître<br />
comment la nature humaine évolue, c’est-à-dire comment elle devient<br />
un sujet de la connaissance et de l’action. Selon lui, l’homme est avant<br />
tout fait pour l’action et il est aussi fortement influencé par ses<br />
tendances naturelles et ses instincts.<br />
La philosophie humienne a comme point de départ les croyances de<br />
l’homme et tente d’en rechercher le principe.<br />
En ce qui concerne la causalité, par exemple, Hume soutient qu’il n’y<br />
a pas de causalité dans le monde physique où nous ne retrouvons, en<br />
réalité, qu’une conjonction constante d’objets. Nous croyons pourtant<br />
à la causalité entre les objets. Hume n’aura pas recours à Dieu pour<br />
expliquer ce fait, comme Descartes, par exemple ; il ne dira pas non<br />
plus que nous nous trompons et que nous devrions abandonner les<br />
croyances erronées. Au contraire, puisqu’il est évident que nous tenons<br />
à nos croyances, il s’agira d’en expliquer le principe et d’étudier<br />
comment les croyances naturelles, comme la croyance en la causalité,<br />
par exemple, rendent possible l’expérience nécessaire à la pensée.<br />
365
<strong>Les</strong> gran<strong>des</strong> figures du monde moderne<br />
CONDILLAC ET LE SENSUALISME RADICAL<br />
Étienne Bonnot de Condillac, 1715-1780<br />
É<br />
tienne Bonnot de Condillac, est né à Grenoble en 1715, d’une<br />
famille de parlementaires ; il meurt en 1780. Renonçant au<br />
sacerdoce, il vivra une partie de sa vie à Paris où il<br />
fréquentera les philosophes contemporains les plus marquants,<br />
notamment Rousseau et Diderot qui resteront <strong>des</strong> amis fidèles.<br />
Parmi l’œuvre considérable de Condillac, son Traité <strong>des</strong><br />
sensations, publié pour la première fois en 1754, est sans doute son<br />
ouvrage le plus connu, ainsi que le texte sur les Mona<strong>des</strong>, ouvrage<br />
récemment sorti de l’anonymat, où Condillac fait une critique de<br />
Leibniz et de son ouvrage intitulé La Monadologie.<br />
À la fin du XVIIIe siècle, et au début du XIXe siècle, un groupe<br />
nommé « Idéologues », et, en particulier, Destutt de Tracy et Cabanis,<br />
leurs chefs de file, s’inspireront fortement de l’œuvre de Condillac. Ils<br />
lui emprunteront, entre autres, sa méthode : l’analyse. Condillac sera<br />
366
le triomphe de l’empirisme<br />
aussi reconnu comme étant le précurseur de la psychologie génétique,<br />
ou psychologie de l’intelligence, et de la pédagogie moderne.<br />
La sensation comme unique source de la connaissance<br />
Condillac reprend les thèses empiristes de Locke mais les dépasse<br />
radicalement.<br />
Contrairement à Locke, il soutient que toutes nos connaissances<br />
viennent de la seule sensation.<br />
On retrouve ici la thèse fondamentale du sensualisme, à savoir<br />
que la sensation est l’unique source de toutes nos connaissances, ce qui<br />
est une <strong>des</strong> formes possibles de l’empirisme. De la sensation naissent<br />
donc toutes nos idées, mais aussi, et c’est ce qui fait l’originalité de<br />
Condillac, toutes nos facultés.<br />
Dans ce passage tiré de l’Extrait raisonné du Traité <strong>des</strong> sensations,<br />
Condillac exprime clairement cette thèse ; pour lui, chacune de nos<br />
facultés apparaît comme une transformation de la sensation initiale,<br />
et c’est en ce sens que l’on parle de sensation transformée.<br />
Le principal objet de cet ouvrage est de faire voir comment toutes nos<br />
connaissances et toutes nos facultés viennent <strong>des</strong> sens, ou, pour parler<br />
plus exactement, <strong>des</strong> sensations : car dans le vrai, les sens ne sont que<br />
cause occasionnelle. Ils ne sentent pas, c’est l’âme seule qui sent à<br />
l’occasion <strong>des</strong> organes ; et c’est <strong>des</strong> sensations qui la modifient, qu’elle<br />
tire toutes ses connaissances et toutes ses facultés. Cette recherche<br />
peut infiniment contribuer aux progrès de l’art de raisonner ; elle le<br />
peut seule développer jusques dans ses premiers principes. En effet,<br />
nous ne découvrirons pas une manière sûre de conduire constamment<br />
nos pensées, si nous ne savons pas comment elles se sont formées.<br />
Qu’attend-on de ces philosophes qui ont continuellement recours à<br />
un instinct qu’il ne saurait définir ? Se flattera-t-on de tarir la source de<br />
nos erreurs, tant que notre âme agira aussi mystérieusement ? Il faut<br />
donc nous observer dès les premières sensations que nous éprouvons ;<br />
il faut démêler la raison de nos premières opérations, remonter à<br />
l’origine de nos idées, en développer la génération, les suivre jusqu’aux<br />
limites que la nature nous a prescrites : en un mot, il faut, comme le dit<br />
Bacon, renouveler tout l’entendement humain.<br />
L’hypothèse de la statue<br />
S’il y a une seule chose à laquelle on pense lorsqu’on se réfère à<br />
Condillac, c’est sans aucun doute à sa célèbre hypothèse de la statue.<br />
Condillac nous présente cette hypothèse dans le Traité <strong>des</strong> sensations :<br />
il propose de remplacer par une statue fictive, l’homme originel.<br />
Cette statue est organisée comme nous, intérieurement, mais elle<br />
est animée d’un esprit qui est privé de toute espèce d’idées.<br />
367
<strong>Les</strong> gran<strong>des</strong> figures du monde moderne<br />
Condillac entend démontrer deux choses à l’aide de cette<br />
hypothèse.<br />
Il veut d’abord montrer que toutes nos facultés tiennent leur<br />
source de la sensation. Il faut savoir que Condillac, dans son Essai sur<br />
l’origine <strong>des</strong> connaissances humaines (premier ouvrage publié en 1746),<br />
considérait l’abstraction et le jugement comme irréductibles.<br />
Cependant, dans son Traité <strong>des</strong> sensations, il va jusqu’au bout de<br />
ses démonstrations en admettant une seule source de la connaissance :<br />
la sensation qui, en se transformant, explique toutes les facultés :<br />
l’attention, lorsque la statue est en présence d’une première sensation,<br />
la mémoire, lorsqu’il y a persistence de cette sensation, la comparaison,<br />
lorsqu’il y a attention à la sensation présente et à la sensation passée,<br />
etc. L’entendement est l’ensemble <strong>des</strong> facultés ainsi engendrées.<br />
À l’époque de Condillac, on s’interroge beaucoup sur l’influence<br />
qu’a chacun <strong>des</strong> cinq sens sur le fonctionnement de l’esprit. Condillac,<br />
et c’est la deuxième chose qu’il souhaite montrer, va soutenir une<br />
position radicale : il y a une équivalence <strong>des</strong> cinq sens. Il attribuera<br />
même à la statue, comme premier sens, celui de l’odorat, ce sens étant<br />
considéré comme le plus primitif de tous les sens. Il montrera ensuite<br />
que toutes les facultés de la statue peuvent être engendrées à l’aide de<br />
ce seul sens.<br />
Le problème de Molyneux<br />
Selon l’opinion commune de l’époque, c’est le sens de la vue qui<br />
nous fait découvrir les grandeurs, les distances et l’existence du monde<br />
extérieur, ou, en d’autre mots, il y a primauté de la vue dans la perception<br />
spatiale et dans la connaissance du monde extérieur. Dans son Essai<br />
sur l’origine <strong>des</strong> connaissances humaines, Condillac soutiendra cette<br />
même idée. Cependant, très discuté à cette époque, il y a le célèbre<br />
« problème de Molyneux » auquel philosophes et médecins tentent de<br />
répondre.<br />
LE PROBLÈME <strong>DE</strong> MOLYNEUX<br />
Le problème de Molyneux est un problème abstrait mais central dans<br />
toute théorie de la connaissance. Il s’agit du passage de la sensation au<br />
jugement que le sensualisme espérait résoudre expérimentalement en<br />
étudiant les réactions d’un aveugle recouvrant la vue.<br />
Formulé par William Molyneux, l’ami de Locke, il s’énonce comme<br />
suit : un aveugle-né, recouvrant soudain la vue, saurait-il distinguer par<br />
la vue une sphère d’un cube qu’il distinguait auparavant par le toucher ?<br />
368
le triomphe de l’empirisme<br />
Molyneux avait répondu par la négative ; Locke, Berkeley, Voltaire l’ont<br />
approuvé. Dans son Traité <strong>des</strong> sensations, Condillac se rangera dans<br />
le camp de ces derniers. Pour lui, pas plus que l’odorat, le goût ou l’ouïe,<br />
la vue n’engendre le monde. C’est le toucher qui juge <strong>des</strong> grandeurs,<br />
<strong>des</strong> formes et <strong>des</strong> existences extérieures.<br />
Portrait de Nicolas Saunderson par L.Vanderbanck<br />
gravé par C.F. Fritzsch<br />
Diderot (Lettre sur les aveugles), tout en acceptant les critiques de<br />
Condillac contre le schématisme de Locke, critiquera à son tour l’Essai<br />
sur l’origine <strong>des</strong> connaissances en évoquant, d’une part, le monde<br />
original de l’aveugle (le « génial Saunderson », notamment), et, d’autre<br />
part, en rappelant l’aventure de Berkeley, « incapable de découvrir l’être<br />
pensant dans ce kaléïdoscope <strong>des</strong> sensations ».<br />
Dans le passage qui suit, tiré du Traité <strong>des</strong> sensations, Condillac<br />
nous explique que la statue apprend progressivement, par une série<br />
d’essais, à régler ses mouvements en vue de sa propre conservation, et<br />
à les lier à ses désirs, à sa volonté afin de pouvoir agir sur le monde.<br />
Nous avons remarqué, quand nous considérions l’odorat, l’ouïe, la vue<br />
et le goût, chacun séparément, que notre statue était toute passive par<br />
rapport aux impressions qu’ils lui transmettaient. Mais actuellement,<br />
369
<strong>Les</strong> gran<strong>des</strong> figures du monde moderne<br />
elle peut être active à cet égard dans bien <strong>des</strong> occasions : car elle a en<br />
elle <strong>des</strong> moyens pour se livrer à l’impression <strong>des</strong> corps, ou pour s’y<br />
soustraire. Nous avons aussi remarqué que le désir ne consistait que<br />
dans l’action <strong>des</strong> facultés de l’âme, qui se portaient à une odeur, dont il<br />
restait quelque souvenir. Mais depuis la réunion de l’odorat au toucher,<br />
il peut encore embrasser l’action de toutes les facultés propres à lui<br />
procurer la jouissance d’un corps odorifiant. Ainsi, lorsqu’elle désire<br />
une fleur, le mouvement passe de l’organe de l’odorat dans toutes les<br />
parties du corps : et son désir devient l’action de toutes les facultés<br />
dont elle est capable. Il faut remarquer la même chose à l’occasion <strong>des</strong><br />
autres sens. Car le toucher les ayant instruits, continue d’agir avec eux,<br />
toutes les fois qu’il peut leur être de quelque secours. Il prend part à<br />
tout ce qui les intéresse ; leur apprend à s’aider réciproquement ; et<br />
c’est à lui que tous nos organes, toutes nos facultés, doivent l’habitude<br />
de se porter vers les objets propres à notre conservation.<br />
Le langage<br />
Le langage tient un rôle très important dans la pensée de Condillac.<br />
En effet, pour le philosophe, s’il n’y a pas de langage, il n’y a pas<br />
d’idées générales et, s’il n’y a pas d’idées générales, la connaissance du<br />
monde est impossible. Le langage permet de fixer nos idées.<br />
Le langage, autrement dit,<br />
permet à l’homme d’analyser ses<br />
pensées, de les composer, de les<br />
décomposer, et de leur donner<br />
<strong>des</strong> noms et de les regrouper.<br />
C’est donc à l’aide du langage<br />
que l’homme peut constituer, à<br />
partir <strong>des</strong> données particulières<br />
<strong>des</strong> sens, les idées générales qui<br />
sont abstraites.<br />
Cependant, et ceci est très<br />
important, une langue peut être<br />
mal construite ; elle peut s’appuyer,<br />
par exemple, sur <strong>des</strong><br />
généralisations hâtives. Or seule<br />
l’analyse, pour Condillac, permet<br />
de corriger ces erreurs en<br />
décomposant et en recomposant<br />
à nouveau nos idées.<br />
370<br />
Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794),<br />
le fondateur de la chimie moderne, dans son laboratoire
le triomphe de l’empirisme<br />
Il est donc indispensable que nos langues soient bien faites puisque<br />
toute langue bien faite exprime une connaissance exacte de la réalité.<br />
C’est aussi en ce sens que l’on doit comprendre l’affirmation de<br />
Condillac suivant laquelle « toute science est une langue bien faite ».<br />
Ce sera sur elle que s’appuiera explicitement le savant Lavoisier pour<br />
créer sa nouvelle nomenclature <strong>des</strong> éléments chimiques.<br />
371<br />
Sonia DÉragon
Condillac<br />
http://perso.infonie.fr/mper/textes/IdjCondi.html<br />
Retour à la ligne du temps