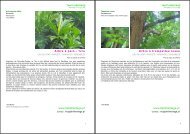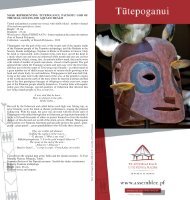Livret Témoins de la Bombe - Assemblée de la Polynésie française
Livret Témoins de la Bombe - Assemblée de la Polynésie française
Livret Témoins de la Bombe - Assemblée de la Polynésie française
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Témoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe<br />
Pour donner du sens aux non-dits<br />
Le big-bang <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe n’en finit pas <strong>de</strong> propager ses<br />
on<strong>de</strong>s sur tout l’univers polynésien. Pas vraiment <strong>de</strong><br />
discours scientifique ou même rationnel au long <strong>de</strong> ces<br />
trente-trois témoignages. Comment être rationnel, en<br />
effet, quand le big-bang s’enracine dans le comble <strong>de</strong><br />
l’irrationnel et le déni <strong>de</strong> toute humanité <br />
Pour l’exposition « Témoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe », Marie-Hélène<br />
Villierme et Arnaud Hu<strong>de</strong>lot, chacun selon son art, ont<br />
transcrit ces voix polynésiennes avant qu’elles ne s’estompent.<br />
Pour ne pas oublier.<br />
Marie-Hélène, <strong>la</strong> photographe, fixe ces trente-trois<br />
regards en autant <strong>de</strong> splendi<strong>de</strong>s portraits étayés <strong>de</strong><br />
quelques phrases, parfois indignées, parfois résignées,<br />
où l’émotion transparaît pudiquement.<br />
Arnaud Hu<strong>de</strong>lot, le réalisateur, s’est effacé <strong>de</strong>rrière <strong>la</strong><br />
parole <strong>de</strong>s témoins. Les vidéos déroulent <strong>de</strong> longs monologues<br />
empreints <strong>de</strong> souvenirs échappés à l’oubli du<br />
temps, <strong>de</strong> <strong>de</strong>uils inexpliqués ou subis dans l’indifférence<br />
générale et <strong>la</strong> peur ou encore <strong>de</strong> tentatives d’explications<br />
du chamboulement social si mal assumé.<br />
Cette histoire est d’une tristesse infinie ! Tels ces mots<br />
jamais prononcés sur les atolls nucléaires tant ils auraient<br />
pu effrayer et dissua<strong>de</strong>r. Ou encore cette bombe<br />
qu’aujourd’hui, certains n’osent plus désigner par son nom<br />
: « cette chose-là » dit Jacqueline. Ou encore ces ma<strong>la</strong>dies<br />
sans nom que les mé<strong>de</strong>cins se retiennent <strong>de</strong> qualifier. Ou<br />
encore ce remords à peine voilé où certains s’imaginent<br />
encore coupables d’avoir touché à l’argent <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe.<br />
Espoir quand même, avec cette fierté d’avoir résisté, à<br />
mains nues pourrait-on dire, face au rouleau compresseur<br />
du déferlement d’une propagan<strong>de</strong> monnayée, avec<br />
cet ar<strong>de</strong>nt désir aussi d’une mémoire à construire pour<br />
les générations à venir.<br />
Bruno Barrillot<br />
1
Mémoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> CEP<br />
En 2006, le rapport sur les essais nucléaires <strong>de</strong> l’Assemblée <strong>de</strong> <strong>la</strong> Polynésie<br />
française inscrivait <strong>la</strong> recommandation suivante :<br />
« La Commission d’enquête recomman<strong>de</strong> que soit créé, dans le cadre <strong>de</strong>s institutions<br />
du Pays, un institut qui soit un centre d’archives et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémoire <strong>de</strong>s<br />
essais nucléaires mis à <strong>la</strong> disposition du public… Il recueillera toute <strong>la</strong> documentation<br />
disponible, écrite et audiovisuelle sur les essais nucléaires. Cet institut<br />
pourra produire <strong>de</strong>s documents, expositions à disposition <strong>de</strong> tous publics<br />
polynésiens, mais aussi <strong>de</strong>s touristes <strong>de</strong> passage dans le Pays. La Commission<br />
d’enquête recomman<strong>de</strong> que <strong>la</strong> mémoire <strong>de</strong> tous les Polynésiens qui ont travaillé<br />
sur les sites d’essais nucléaires <strong>de</strong>puis 1963 soit conservée… »<br />
S’appuyant sur cette volonté <strong>de</strong>s élus polynésiens et confortée par le soutien<br />
<strong>de</strong>s gouvernements <strong>de</strong> <strong>la</strong> Polynésie, <strong>la</strong> Délégation pour le suivi <strong>de</strong>s conséquences<br />
<strong>de</strong>s essais nucléaires a engagé <strong>de</strong>puis 2010 un programme intitulé<br />
« Mémoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> CEP ». L’objectif est <strong>de</strong> conserver, <strong>de</strong> créer et <strong>de</strong><br />
diffuser, selon une diversité d’approches, - livres, expositions, documents<br />
audiovisuels, internet - les paroles, les souvenirs, les écrits, les images…<br />
rappe<strong>la</strong>nt ces 30 années d’essais nucléaires qui ont bouleversé l’univers <strong>de</strong>s<br />
Polynésiens. La diversité <strong>de</strong>s moyens permettra d’atteindre <strong>la</strong> diversité <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société polynésienne, <strong>de</strong>puis les plus jeunes générations sco<strong>la</strong>risées souvent<br />
ignorantes <strong>de</strong> ce passé pourtant récent jusqu’aux anciens qui revivront ainsi<br />
<strong>la</strong> mémoire oubliée.<br />
Déjà, <strong>de</strong>s historiens, <strong>de</strong>s écrivains, <strong>de</strong>s journalistes, ont publié leurs<br />
approches <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> par <strong>de</strong>s livres ou <strong>de</strong>s documentaires télévisés.<br />
Des sites internet ont été créés dont www.moruroa.org à l’initiative <strong>de</strong> l’Assemblée<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Polynésie et beaucoup d’autres, mis en ligne par <strong>de</strong>s personnes<br />
individuelles ou par <strong>de</strong>s associations tel www.moruroaetatou.com qui<br />
égraine l’actualité <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong>s essais sur les victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe.<br />
Le programme « Mémoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> CEP » <strong>de</strong> <strong>la</strong> Délégation se veut en<br />
complément <strong>de</strong> toutes ces initiatives, insistant sur l’approche « polynésienne »<br />
trop longtemps ignorée, sans exclusive cependant.<br />
Peuple jeune et encore <strong>de</strong> culture orale - à quand un concours d’orero sur<br />
l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> CEP ! -, les Polynésiens apprécient l’image et <strong>la</strong> parole<br />
plus que l’écrit. Dans <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong>s moyens qui lui sont donnés, <strong>la</strong> Délégation<br />
a voulu privilégier le recueil indispensable <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémoire audiovisuelle <strong>de</strong>s<br />
« Témoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe » qui sera prolongé et complété par <strong>la</strong> déclinaison<br />
d’autres présentations <strong>de</strong> cette page d’histoire du CEP. Cet ensemble <strong>de</strong><br />
documents constitueront autant d’éléments qui prendront p<strong>la</strong>ce dans le futur<br />
« centre <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémoire » dont <strong>la</strong> création s’avère aujourd’hui indispensable.<br />
Remerciements<br />
B B<br />
Marie-Hélène Villierme, Arnaud Hu<strong>de</strong>lot et l’équipe <strong>de</strong> tournage <strong>de</strong>s interviewes<br />
filmées « Témoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe » remercient vivement tous ceux et celles qui ont<br />
bien voulu partager leur histoire et leurs convictions. Nous sommes certains<br />
que leurs témoignages toucheront le cœur <strong>de</strong> leurs contemporains, polynésiens<br />
ou étrangers, comme celui <strong>de</strong>s générations à venir qui sont, en finale,<br />
les véritables <strong>de</strong>stinataires <strong>de</strong> cette mémoire collective. Pour ne pas oublier.<br />
Liste <strong>de</strong>s portraits<br />
PIA Raymond<br />
GOODING Régis<br />
OTCENASEK Jaros<strong>la</strong>v<br />
TAHA Raymond<br />
TETARIA Charles<br />
LOWGREEN Yannick<br />
BARRILLOT Bruno<br />
BRANDER Maoake<br />
AVIU Chantal<br />
LENOIR Heiava<br />
CHAN Marius<br />
COPPENRATH Hubert<br />
GOLAZ Jacqueline<br />
COURNEE François<br />
REGNAULT Jean-Marc<br />
TEFAARERE Hirohiti<br />
PALACZ Daniel<br />
HOWELL Patrick<br />
DU PREL Alex<br />
DOOM John<br />
TEMARU Oscar<br />
MARAEA Taaroanui<br />
HIRSHON Unutea<br />
ARAPARI Temarama<br />
ARAKINO Michel<br />
CHAN Maxime<br />
TUHEIAVA Richard<br />
LARGETEAU Emilienne<br />
LARGETEAU Pierre-Emile<br />
PUGIBET Marc<br />
SPITZ Chantal<br />
BRYANT Jacky<br />
OLDHAM Ro<strong>la</strong>nd<br />
2 3
Raymond Pia<br />
Raymond Pia a commencé à travailler au CEP en 1968, jusqu’en 1996<br />
quand il a pris sa retraite. Il a été recruté comme manœuvre par<br />
une société sous-traitante, <strong>la</strong> So<strong>de</strong>tra, puis il a fait plusieurs métiers,<br />
mais il a travaillé longtemps sur les barges comme sou<strong>de</strong>ur, <strong>de</strong>puis le<br />
temps <strong>de</strong>s essais aériens, puis <strong>de</strong>s essais souterrains.<br />
Raymond précise ses conditions <strong>de</strong> travail : « Voilà, j’ai été travailler<br />
là-bas pour avoir <strong>de</strong> l’argent. Avant <strong>de</strong> faire mon contrat, on ne nous<br />
a pas du tout dit qu’on courrait <strong>de</strong>s risques. On nous a fait signer<br />
comme quoi nous ne <strong>de</strong>vons absolument rien dire <strong>de</strong> ce que nous<br />
verrons, on dit ça « le secret » et sinon vous risquez <strong>la</strong> prison. Mais<br />
pour dire qu’il y a risques, non, on ne nous a absolument pas indiqué<br />
qu’il y avait <strong>de</strong>s problèmes. »<br />
Raymond décrit les faits à partir <strong>de</strong> ce qu’il constatait. Il n’avait pas<br />
peur au moment du tir parce que lui et ses collègues polynésiens<br />
n’étaient pas informés du déroulement <strong>de</strong>s tirs. « Donc on était là, on<br />
ne se souciait pas tellement <strong>de</strong> ce qui al<strong>la</strong>it se passer. »<br />
«<br />
Six ans après sa mise à <strong>la</strong> retraite, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die s’est déc<strong>la</strong>rée : il a<br />
fallu l’évasaner en France, à Villejuif pour une radiothérapie. Raymond<br />
gar<strong>de</strong> en lui cette gran<strong>de</strong> inquiétu<strong>de</strong> : « Mon témoignage, c’est<br />
pour les générations à venir, c’est eux qui subiront les conséquences.<br />
Aujourd’hui, tu t’aperçois bien qu’il y a beaucoup <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies au Pays<br />
maintenant. Dans le temps, il n’y avait pas toutes ces ma<strong>la</strong>dies chez<br />
nous. Nous, nous avons dépassé les 60 ans. Mais <strong>la</strong> jeunesse, pour<br />
<strong>de</strong>main Il est trop tard, le mal est fait. Voilà mon témoignage ! »<br />
»<br />
4 5
Régis Gooding<br />
Régis Gooding a travaillé à Moruroa alors qu’il avait 16 ans, au temps<br />
<strong>de</strong>s essais aériens « pour ai<strong>de</strong>r mon papa à nourrir mes 4 frères et<br />
mes 3 sœurs ». Il raconte comment un gamin <strong>de</strong> 16 ans pouvait vivre<br />
si loin <strong>de</strong> sa famille sur un site aussi dangereux : une vie presque<br />
rêvée avec <strong>de</strong>s loisirs inconnus, le cinéma, les jeux nautiques…<br />
« C’était <strong>la</strong> belle vie parce qu’on n’avait pas <strong>de</strong> souci pour le repas. Le<br />
linge était <strong>la</strong>vé sur le bateau. On était là vraiment pour faire avancer<br />
le travail pour <strong>la</strong> bombe atomique. Mais tout était fait pour qu’on ne<br />
s’ennuie pas sur p<strong>la</strong>ce. On était occupés. »<br />
Régis décrit <strong>la</strong> bombe, comme il l’a vue <strong>de</strong>puis le bateau-base et à<br />
Moruroa, sans oublier les interdictions… « Comme si on pouvait<br />
empêcher un Polynésien <strong>de</strong> manger du poisson ! » Discrimination <br />
« Après un tir, les techniciens du CEA venainent avec <strong>de</strong>s tenues, <strong>de</strong>s<br />
masques à gaz, tout couvert, en b<strong>la</strong>nc quoi, avec <strong>de</strong>s chaussures et<br />
<strong>de</strong>s gants et les Polynésiens, les travailleurs locaux, ils avaient leurs<br />
c<strong>la</strong>quettes, short, débar<strong>de</strong>ur, sans rien quoi. Ils n’avaient même pas<br />
<strong>de</strong> gants. Voilà leur tenue <strong>de</strong> travail. »<br />
Régis n’est resté qu’un an à Moruroa, mais, <strong>de</strong>venu militaire il y a été<br />
envoyé en 1977 avec une section militaire. Il a été témoin d’un effondrement<br />
après un tir souterrain et du raz-<strong>de</strong>-marée qui a suivi. « C’est<br />
à partir <strong>de</strong> là que les légionnaires ont construit un mur <strong>de</strong> protection<br />
et aussi à installer <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>teformes <strong>de</strong> sécurité. »<br />
Le papa <strong>de</strong> Régis avait lui aussi travaillé à Moruroa. Ma<strong>la</strong><strong>de</strong>, il a été<br />
quand même embauché au CEA <strong>de</strong> Mahina. Il a eu tellement d’eczéma<br />
qu’on lui a dit <strong>de</strong> ne plus revenir travailler. Il est mort finalement <strong>de</strong><br />
son cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau alors qu’on lui par<strong>la</strong>it « d’eczéma ». Il s’indigne :<br />
« Pourquoi, on oublie comme ça ceux qui ont servi cette bombe atomique<br />
: il a été à Muru, il a contracté le cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, mais ce n’est<br />
pas <strong>de</strong> sa faute, c’est <strong>la</strong> faute <strong>de</strong> qui alors Parce qu’il a respiré l’air<br />
polynésien qui est contaminé Mais qui a amené cette contamination »<br />
«<br />
»<br />
6 7
Jaros<strong>la</strong>v Otcenasek<br />
Jaros<strong>la</strong>v Otcenasek a travaillé au tout début à <strong>la</strong> construction <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions<br />
du CEP à Tahiti. « Avant, je travail<strong>la</strong>is un peu et je gagnais<br />
20 francs <strong>la</strong> semaine. En travail<strong>la</strong>nt au CEP, on gagnait 140 francs<br />
<strong>la</strong> semaine. Donc vous voyez l’écart. Donc c’est ça qui a fait le déséquilibre<br />
: tout le mon<strong>de</strong> a abandonné pêche, agriculture, élevage. Ce<br />
qu’on gagnait en trois mois, on le gagnait en une semaine. Alors tout<br />
le mon<strong>de</strong> s’est engouffré dans cette voie-là, mais sans savoir les dangers<br />
que représentait <strong>la</strong> bombe atomique… »<br />
Jaros<strong>la</strong>v explique les conséquences <strong>de</strong> ce rush sur l’argent du CEP :<br />
« Tout le mon<strong>de</strong> est accouru sur Papeete. Avant, on <strong>de</strong>scendait une<br />
fois par semaine ou une fois par mois à Papeete juste pour acheter<br />
le strict nécessaire : <strong>la</strong> farine, le sucre etc. Mais <strong>de</strong>puis que le CEP est<br />
arrivé, même ceux <strong>de</strong>s îles sont venus s’agglomérer sur Papeete, ça<br />
a été construction sur construction. Les gens ont quitté leurs îles et<br />
les districts pour s’agglomérer dans <strong>la</strong> ville. Alors, aujourd’hui, pour<br />
les faire revenir dans leurs îles ou dans leurs districts c’est vraiment<br />
très très dur. »<br />
La prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong>s dangers du nucléaire s’est faite lentement :<br />
« Ce<strong>la</strong> a pris un certain nombre d’années quand on a commencé à voir<br />
<strong>de</strong>s copains qui mourraient, qui tombaient ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s : c’était toujours<br />
ceux qui travail<strong>la</strong>ient sur les sites à Moruroa et Fangataufa. Quand ils<br />
revenaient, on leur interdisait d’en parler. S’ils commençaient à raconter,<br />
alors on les mettait <strong>de</strong>hors carrément, on les reprenait plus. Alors<br />
on s’est dit qu’il y a quelque chose que l’armée est en train <strong>de</strong> nous<br />
cacher. Mais on a mis longtemps, longtemps, c’était tabu d’en parler. »<br />
Jaros<strong>la</strong>v porte un jugement sévère sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> CEP : « Pour moi,<br />
ça a été très néfaste parce qu’on n’a eu aucune retombée… on a<br />
aujourd’hui les ma<strong>la</strong>dies et un pays qui va très mal. Je voudrais dire à<br />
<strong>la</strong> jeunesse : Levez-vous et battez-vous, jusqu’au jour où <strong>la</strong> France va<br />
nous donner cette reconnaissance, va nous <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r pardon <strong>de</strong> nous<br />
avoir fait du mal. Alors certainement je serais fier d’être Français tout<br />
simplement. »<br />
«<br />
»<br />
8 9
Raymond Taha<br />
Après avoir quitté l’école à 13 ans à cause du décès <strong>de</strong> ses parents,<br />
Raymond Taha a commencé à travailler à Moruroa à l’âge <strong>de</strong> 16 ans<br />
pour subvenir aux besoins <strong>de</strong> sa famille. Il a été embauché en 1965<br />
comme ai<strong>de</strong>-mécanicien à <strong>la</strong> société Dumez-Citra.<br />
Raymond se souvient encore <strong>de</strong>s préparatifs <strong>de</strong>s premières bombes<br />
à Moruroa en 1966 : « Et à Faucon, il y avait un grand ballon, je crois<br />
c’est pour soutenir ce qui va se passer dans le <strong>la</strong>gon <strong>de</strong> Moruroa,<br />
avec <strong>la</strong> bombe nucléaire qui va sauter en-<strong>de</strong>ssous. Alors au moment<br />
où les sociétés portaient ce ballon pour le gonfler, les jeunes gens du<br />
CEA sont là pour l’arroser, pour éviter que ça explose au soleil. »<br />
Raymond décrit une curieuse ambiance <strong>de</strong> travail : « On nous a interdit<br />
le droit à <strong>la</strong> parole. Je me rappelle avant <strong>de</strong> quitter l’école, on<br />
n’a pas le droit <strong>de</strong> parler le tahitien en c<strong>la</strong>sse et arrivés à Moruroa,<br />
c’était le même principe : on n’a pas le droit <strong>de</strong> parler entre nous<br />
les amis, les copains et on est soupçonnés, on est observés par<br />
les chefs d’entreprise et même par les chefs d’équipe. » Bien sûr, il<br />
gar<strong>de</strong> le souvenir <strong>de</strong> tous les interdits alimentaires : ne pas manger<br />
<strong>de</strong> poisson, ne pas boire <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong> coco… Il se rappelle même<br />
d’un copain qui a transgressé l’interdit, qui est tombé ma<strong>la</strong><strong>de</strong> et<br />
décédé au bout <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux jours.<br />
«<br />
Raymond a eu cinq enfants dont une petite fille qui est décédée d’une<br />
malformation <strong>de</strong>s poumons. « J’ai compris que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die qu’elle a<br />
eue, ça vient <strong>de</strong> moi », dit-il. En 1994, c’était son tour : « J’ai attrapé<br />
<strong>la</strong> leucémie au mois <strong>de</strong> mars 1994. J’ai commencé à avoir <strong>de</strong>s saignements<br />
<strong>de</strong> nez un vendredi. Le lundi matin, je me suis présenté aux<br />
urgences à l’hôpital <strong>de</strong> Mamao et trois jours après, j’ai été évasané<br />
en métropole, à l’Hôtel-Dieu. Je suis arrivé, il y avait aussi <strong>de</strong>s anciens<br />
là-bas. Je suis resté le seul sur huit, mira<br />
»<br />
10 11
Charles Tetaria<br />
Mé<strong>de</strong>cin. Ancien ministre.<br />
Jeune mé<strong>de</strong>cin polynésien au temps du CEP, il témoigne <strong>de</strong> son expérience<br />
à l’hôpital civil <strong>de</strong> Mamao : « De mon séjour aux urgences,<br />
je n’ai jamais eu à traiter, à m’occuper <strong>de</strong>s personnes qui avaient<br />
quelque chose en rapport avec Moruroa. Même s’il y avait <strong>de</strong>s évacuations<br />
sanitaires… C’était l’armée qui al<strong>la</strong>it chercher les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s<br />
ou les blessés à Moruroa et Fangataufa, mais pour les soigner directement<br />
à l’hôpital militaire Jean-Prince, puis en France…» Et ce rappel<br />
amer <strong>de</strong> <strong>la</strong> mainmise <strong>de</strong>s armées sur <strong>la</strong> santé publique en Polynésie :<br />
« La Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, le Directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, c’était un mé<strong>de</strong>cin<br />
militaire ; à l’hôpital <strong>de</strong> Mamao à l’époque, le directeur <strong>de</strong> l’hôpital<br />
<strong>de</strong> Mamao, c’était un militaire. Presque tous les chefs <strong>de</strong> service <strong>de</strong><br />
l’hôpital <strong>de</strong> Mamao, c’était <strong>de</strong>s militaires. »<br />
Charles Tetaria constate que <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong>s Polynésiens<br />
s’est faite tardivement. Les consciences se sont réveillées avec le<br />
« taui » <strong>de</strong> 2004, après <strong>de</strong>s années d’étouffement par un gouvernement<br />
qui affirmait que « <strong>la</strong> bombe atomique, ce n’était pas grandchose<br />
! »<br />
Il termine par un immense regret, un manquement à nos responsabilités<br />
: « Si on considère qu’il y a eu le fait nucléaire, ce qu’on aurait<br />
dû faire, c’est <strong>de</strong> très vite <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce un service <strong>de</strong> santé,<br />
un service médical <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce pour tous ces travailleurs, chose<br />
qu’on a jamais faite. »<br />
Mais là, pense-t-il, « le pays a mal joué » ! Si le suivi a été mis en p<strong>la</strong>ce<br />
tout <strong>de</strong>rnièrement, il le voit comme un retour en arrière : « Un mé<strong>de</strong>cin<br />
militaire pour le suivi <strong>de</strong> nos ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s polynésiens On a l’impression<br />
<strong>de</strong> revivre les situations antérieures ! »<br />
«<br />
»<br />
12 13
Yannick Lowgreen<br />
Yannick Lowgreen a été embauché au CEA en 1982. Il avait 26 ans.<br />
« Avant <strong>de</strong> rentrer, le CEA a fait une enquête comme ça se fait pour tous<br />
ceux qui vont travailler dans <strong>de</strong>s sites secret défense ou confi<strong>de</strong>ntiel<br />
défense. » Entré comme employé <strong>de</strong> bureau, il s’est spécialisé et a reçu<br />
une formation <strong>de</strong> technicien dans les forages.<br />
Yannick décrit avec précision le déroulement <strong>de</strong>s forages « grands diamètres<br />
» où seront <strong>de</strong>scendus les bombes, mais aussi le déroulement<br />
<strong>de</strong>s post-forages <strong>de</strong>stinés à récupérer <strong>de</strong>s matières radioactives après<br />
l’explosion souterraine : « Il fal<strong>la</strong>it aller très vite pour ne pas chopper<br />
<strong>de</strong> dose, il y avait un château <strong>de</strong> plomb, un réceptacle ouvert en plomb<br />
pour éviter que les radiations sortent une fois que <strong>la</strong> carotte est p<strong>la</strong>cée<br />
à l’intérieur. Donc quand <strong>la</strong> carotte arrivait, l’opération se dérou<strong>la</strong>it au<br />
maximum entre une quinzaine <strong>de</strong> secon<strong>de</strong>s et <strong>la</strong> minute. »<br />
Un jour, on a détecté un problème lors d’une prise <strong>de</strong> sang : « Ils se<br />
sont rendu compte qu’il y avait un problème. Donc je suis <strong>de</strong>scendu à<br />
l’hôpital Jean-Prince à Tahiti et ils ont analysé ça. Le mé<strong>de</strong>cin m’a dit :<br />
étant donné que tu es un mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong> bretons, <strong>de</strong> corses, <strong>de</strong> danois,<br />
<strong>de</strong> polynésiens, on peut trouver ce genre <strong>de</strong> problème. Mais ils ont<br />
dit que c’était pas du tout lié au travail que je faisais. J’ai repris mon<br />
travail, je n’ai pas été déc<strong>la</strong>ré inapte. Jusqu’à présent il n’y a rien. »<br />
«<br />
Yannick Lowgreen fait partie <strong>de</strong> ceux qui considèrent plutôt les bienfaits<br />
économiques du CEP : « Beaucoup <strong>de</strong> gens trouvaient du travail,<br />
donc c’est déjà quelque chose d’important. Bien sûr, tout n’a pas été<br />
parfait en ces 30 ans <strong>de</strong> nucléaire. Il y a eu <strong>de</strong>s problèmes, mais ça<br />
n’a pas apporté que du mal. Ca a apporté aussi du bien : si on a une<br />
université, si on a <strong>de</strong>s écoles qui ont été construites aujourd’hui, c’est<br />
un peu grâce à ça. Bien sûr, c’est un peu tout ça qu’on <strong>la</strong>isse à <strong>la</strong><br />
génération à venir. »<br />
»<br />
14 15
Bruno Barrillot<br />
Bruno Barrillot raconte son parcours qui l’a conduit à se préoccuper<br />
<strong>de</strong>s essais nucléaires, citant les rencontres et les faits qui ont été déterminants.<br />
Il parle notamment du choc, lorsqu’en 1990, il a découvert<br />
Mangareva, avec son abri antiatomique pour <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion - en fait un<br />
hangar - et le blockhaus super protégé <strong>de</strong>s militaires.<br />
Il décrit les difficultés <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche pour approcher <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérité <strong>de</strong>s<br />
essais nucléaires, mais aussi le grand réseau <strong>de</strong> solidarité qui s’est<br />
créé en Europe, dans le Pacifique, au Japon et le reste du mon<strong>de</strong> pour<br />
soutenir les victimes <strong>de</strong>s essais nucléaires. Ce réseau n’a pu se constituer<br />
qu’avec le dynamisme <strong>de</strong> John Doom, <strong>de</strong>s Eglises protestantes <strong>de</strong><br />
Polynésie et du mon<strong>de</strong>, <strong>de</strong> militants polynésiens <strong>de</strong>s ONG Hiti Tau, du<br />
parti indépendantiste Tavini Huiraatira. Pour Bruno Barrillot, l’histoire <strong>de</strong><br />
Moruroa e tatou, <strong>de</strong> l’association <strong>de</strong>s vétérans AVEN en France n’a pu<br />
se construire qu’avec l’appui <strong>de</strong> ce réseau mondial qui ne leur a jamais<br />
fait défaut, jusqu’à aujourd’hui.<br />
Travail<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>puis 3 décennies sur le sujet, le chercheur connaît parfaitement<br />
le déroulement <strong>de</strong>s 30 années d’essais nucléaires à Moruroa et<br />
à Fangataufa ainsi que leurs répercussions sur <strong>la</strong> Polynésie et les Polynésiens.<br />
Dans un <strong>la</strong>ngage très vigoureux, il rapporte <strong>de</strong>s faits, souvent<br />
inconnus <strong>de</strong>s Polynésiens eux-mêmes. Il ne s’en <strong>la</strong>isse pas compter par<br />
<strong>la</strong> propagan<strong>de</strong> officielle qui, constamment, minimise les risques sanitaires<br />
et environnementaux. « Mais comment, aujourd’hui, mesure-t-on<br />
les conséquences <strong>de</strong>s essais, si ce n’est dans <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>s Polynésiens !<br />
Combien <strong>de</strong> femmes et <strong>de</strong> jeunes Polynésiens sont atteints <strong>de</strong> cancers<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> thyroï<strong>de</strong> et qui étaient enfants à l’époque <strong>de</strong>s essais aériens <br />
Combien <strong>de</strong> cancers, combien <strong>de</strong> leucémies qui mettent dix ans, vingt<br />
ans, trente ans à se déc<strong>la</strong>rer ! Je ne dis pas que tout vient <strong>de</strong>s essais<br />
nucléaires, bien sûr, car il y a <strong>de</strong>s tas d’autres causes avec <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnité<br />
apportée avec l’argent <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe. Mais on peut quand même penser<br />
que les essais nucléaires sont pour quelque chose dans le problème<br />
très grave <strong>de</strong> santé publique qui se pose ici avec ce développement<br />
phénoménal <strong>de</strong>s cancers et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cardiovascu<strong>la</strong>ires. »<br />
Ce témoignage multiplie les faits précis, les atteintes potentielles à <strong>la</strong><br />
santé <strong>de</strong>s Polynésiens <strong>de</strong> tous les archipels et dénonce <strong>de</strong> nombreux<br />
inci<strong>de</strong>nts ignorés ou déc<strong>la</strong>rés sans importance par les autorités du CEP.<br />
Un « J’accuse » véhément auquel <strong>la</strong> France <strong>de</strong>vra bien répondre un jour !<br />
«<br />
»<br />
16 17
Maoake Bran<strong>de</strong>r<br />
Maoake Bran<strong>de</strong>r est originaire <strong>de</strong> l’atoll <strong>de</strong> Tureia, l’atoll habité le plus<br />
proche <strong>de</strong> Moruroa. Iil était enfant à l’époque <strong>de</strong>s essais aériens et il<br />
habite toujours Tureia.<br />
Maoake explique <strong>la</strong> vie à Tureia : « Pendant les essais aériens, <strong>la</strong> vie <strong>de</strong><br />
Tureia a tout <strong>de</strong> suite basculé dans un rythme militaire. Les militaires<br />
ont un programme <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée sur Tureia pour tous les jours et on<br />
est obligé <strong>de</strong> suivre ce rythme. » Il décrit ce qui se passait dans son<br />
atoll lorsqu’il y avait un essai à Tureia avec « <strong>la</strong> mise à l’abri » <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion dans les blockhaus, l’évacuation vers Tahiti au temps <strong>de</strong>s<br />
premiers essais <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe H en 1968 et les nombreuses visites<br />
médicales : « Toutes les visites médicales <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion se faisaient<br />
plusieurs fois dans l’année au temps <strong>de</strong>s essais aériens. »<br />
Au temps <strong>de</strong>s essais souterrains, Tureia est déserté par les militaires,<br />
presque abandonné. Mais ce qui reste aujourd’hui dans <strong>la</strong> tête <strong>de</strong>s<br />
gens <strong>de</strong> Tureia, c’est <strong>la</strong> peur d’un effondrement à Moruroa : « Après<br />
les essais souterrains sont arrivés, il n’y a pratiquement plus personne,<br />
juste une maintenance avec <strong>la</strong> météo et puis voilà. On a un<br />
grand souci, je peux dire même presque officialisé, c’est que les fissures<br />
qui se sont faites à Moruroa s’é<strong>la</strong>rgissent année après année<br />
et lors <strong>de</strong> son passage à Tureia, Jurien <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gravière nous a confirmé<br />
qu’il y a un risque d’effondrement <strong>de</strong> Moruroa. »<br />
Maoake explique à sa manière les problèmes <strong>de</strong> santé <strong>de</strong>s gens <strong>de</strong><br />
Tureia : « Il se peut même que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Tureia est celle qui a<br />
le plus <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies, d’évasan sur Papeete pour se faire soigner. On<br />
nous dit que c’est à cause <strong>de</strong>s cigarettes, du tabac, du maa, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
bouffe. Mais si les radiations sont tombées au sol, il est vrai que les<br />
racines <strong>de</strong> <strong>la</strong> cocoteraie et <strong>de</strong> toutes les p<strong>la</strong>ntes qui produisent les<br />
fruits qu’on a mangés, il se pourrait que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die est due à tout ce<br />
qu’on a mangé à Tureia. »<br />
«<br />
»<br />
18 19
Chantal Aviu<br />
Chantal Aviu est <strong>la</strong> veuve d’un docker qui travail<strong>la</strong>it périodiquement à<br />
Moruroa pour aller décharger les bateaux ravitail<strong>la</strong>nt le CEP.<br />
« C’était bien payé. Pour ça, il n’y a pas <strong>de</strong> reproches. Mais, ils n’ont<br />
pas pensé aux conséquences. On ne leur a rien dit. Ils ne savaient<br />
pas. Une fois, mon mari se trouvait sur les quais, pendant une pause<br />
<strong>de</strong> casse-croûte, avec d’autres copains. C’est ce jour qu’il a eu peur.<br />
Et quand il est revenu, il m’a dit : Dommage. On a besoin <strong>de</strong> l’argent.<br />
Mais Moruroa m’a fait peur. Il était sur le quai, le tir a été fait mais<br />
on ne leur a pas donné <strong>de</strong> protection, <strong>de</strong> masque… non. Ils étaient<br />
comme ça. Il a cru qu’il n’al<strong>la</strong>it plus nous revoir. »<br />
Un jour <strong>de</strong> 1988, au retour <strong>de</strong> Moruroa, son mari portait d’étranges<br />
taches sur le corps : « Il a déc<strong>la</strong>ré sa ma<strong>la</strong>die au début du mois d’avril<br />
88 et là, en peu <strong>de</strong> temps, il a été évasané en France. En l’espace <strong>de</strong><br />
4-5 jours après, on m’appelle qu’il est décédé. Il n’y a pas d’explication<br />
: il est mort, il est mort ! »<br />
«<br />
Chantal est encore aujourd’hui révoltée : « La bombe atomique française,<br />
elle est comme toutes les autres bombes… elle tue, elle rend<br />
infirmes les enfants, elle nous donne <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies, <strong>de</strong>s cancers, voilà<br />
! C’est comme les autres nations qui ont leur bombe atomique, mais<br />
eux ils ont reconnu qu’elle tue… »<br />
»<br />
20 21
Heiava Lenoir<br />
Heiava Lenoir est <strong>la</strong> secrétaire <strong>de</strong> Moruroa e tatou. Elle présente son<br />
travail d’accueil <strong>de</strong>s anciens travailleurs <strong>de</strong> Moruroa, <strong>de</strong> leurs veuves<br />
qui viennent s’inscrire à l’association. Son travail consiste aussi à ai<strong>de</strong>r<br />
à <strong>la</strong> constitution <strong>de</strong>s dossiers médicaux, à préparer les courriers à<br />
envoyer, avec toutes les difficultés qu’ont ces anciens qui sont d’une<br />
autre génération : « Ils ont un problème <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngage, ils ne connaissent<br />
pas trop le français, ils ont besoin qu’on les ai<strong>de</strong>, qu’on les aiguille dans<br />
leurs démarches pour récupérer <strong>de</strong>s papiers. »<br />
Heiava décrit les réactions <strong>de</strong>s anciens travailleurs g<strong>la</strong>nées dans les<br />
rencontres quotidiennes : « Parmi les personnes qui viennent me voir, il y<br />
en a, qui reçoivent un gros dossier comme ça, eh bien, ils sont contents,<br />
même si ils ne savent pas ce qu’il y a <strong>de</strong>dans, ils sont contents parce<br />
qu’ils ont reçu leur dossier ! Certains disent : Ca y est, mon dossier, il<br />
est arrivé, donc l’association pourra faire quelque chose pour moi ! Il y<br />
en a d’autres, ils ne sont pas contents du tout ! J’ai travaillé tant d’années…<br />
pourquoi je ne reçois que ce petit dossier ! » Et elle remarque :<br />
« C’est difficile <strong>de</strong> parler à une personne qui est âgée, ma<strong>la</strong><strong>de</strong> et tout ! »<br />
Heiava a souvent affaire aux enfants <strong>de</strong> vétérans qui sont très mal informés<br />
<strong>de</strong> ce qui se passait à Moruroa : « Il y a <strong>de</strong>s anciens travailleurs qui<br />
viennent au bureau avec leur famille. L’ancien travailleur s’exprime, et<br />
à côté <strong>de</strong> ça, il y a soit <strong>la</strong> fille, soit <strong>la</strong> femme, enfin <strong>la</strong> famille qui disent<br />
en tahitien : Ah, Papa a perdu un peu <strong>la</strong> tête. Il dit un peu n’importe<br />
quoi… Mais quand j’écoute parler les anciens travailleurs, je fais<br />
remarquer qu’il dit <strong>la</strong> vérité et qu’il n’a pas perdu <strong>la</strong> tête. Parce qu’en fait<br />
<strong>la</strong> famille n’est pas au courant <strong>de</strong> ce qui s’est passé et ne connaissent<br />
rien sur les essais nucléaires. »<br />
Heiava conclut : « Il faut bouger pour que les essais nucléaires fassent<br />
partie <strong>de</strong> l’éducation à l’école, qu’on fasse au moins <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s essais<br />
nucléaires dans l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Polynésie française. Il faut que les jeunes<br />
soient bien informés <strong>de</strong> ça, <strong>de</strong>s conséquences qu’il y a eu et qu’il faut<br />
se bouger pour militer contre ça… et que ça soit plus tabou dans les<br />
familles. »<br />
«<br />
»<br />
22 23
Marius Chan<br />
Marius Chan a été affecté en tant que gendarme sur le site nucléaire<br />
<strong>de</strong> Moruroa entre 1978 et 1980, c’est-à-dire pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s essais souterrains. Il décrit le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> gendarmerie sur l’atoll<br />
nucléaire : « On <strong>de</strong>vait contrôler tout : personne n’a le droit d’arriver<br />
sur le site nucléaire sans passer par <strong>la</strong> gendarmerie. Et j’en ai établi <strong>de</strong>s<br />
fiches ! Je peux me permettre <strong>de</strong> dire : ces fiches sont rassemblées, elles<br />
sont entre les mains <strong>de</strong> l’Etat en France. Qu’on ne vienne pas me dire<br />
aujourd’hui qu’il n’y en a plus. Ce n’est pas vrai. Tout était fiché. »<br />
Gendarme tahitien, Marius adapte sa fonction <strong>de</strong> « gardien <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />
et du règlement » à <strong>la</strong> culture et aux comportements <strong>de</strong> ses compatriotes<br />
polynésiens. Les pratiques alimentaires traditionnelles <strong>de</strong>s<br />
Polynésiens étaient interdites sous peine d’exclusion définitive <strong>de</strong> leur<br />
emploi sur le site nucléaire. « Il m’est arrivé <strong>de</strong> prendre en f<strong>la</strong>grant<br />
délit <strong>de</strong>s Polynésiens en train <strong>de</strong> pêcher. Je me disais : « Si je fous un<br />
rapport, ils prennent <strong>la</strong> Caravelle et perdront leur emploi à Moruroa.<br />
Alors, je les grondais ! » Et pour finir, Marius avoue qu’il lui est même<br />
arrivé <strong>de</strong> partager le poisson pêché sur le récif !<br />
«<br />
Ce n’est que progressivement que Marius entrevoit le danger. Il<br />
constate que les militaires ou les techniciens qu’il doit escorter<br />
portent <strong>de</strong>s tenues <strong>de</strong> protection spéciales alors que lui n’a que son<br />
uniforme <strong>de</strong> gendarme, short et chemisette. Il est témoin <strong>de</strong>s premières<br />
failles provoquées sur l’atoll <strong>de</strong> Moruroa par les tirs souterrains…<br />
Alors, il pose <strong>de</strong>s questions à ses supérieurs hiérarchiques<br />
qui lui répon<strong>de</strong>nt : « T’occupe pas. Occupe-toi <strong>de</strong> ton sa<strong>la</strong>ire. Et puis tu<br />
as à manger et à boire ! »<br />
Aujourd’hui, Marius vit avec sa ma<strong>la</strong>die, l’ab<strong>la</strong>tion d’un rein dont<br />
même les mé<strong>de</strong>cins néo-zé<strong>la</strong>ndais qui l’ont opéré n’osent abor<strong>de</strong>r<br />
l’origine éventuelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> tumeur qu’il a fallu enlever.<br />
»<br />
24 25
Mgr Hubert Coppenrath<br />
Archevêque <strong>de</strong> Papeete <strong>de</strong>puis 1999.<br />
Prêtre affecté aux Tuamotu <strong>de</strong> l’Ouest du temps du CEP, le père Hubert<br />
a été frappé par les perturbations sociales, familiales et morales qui<br />
ont frappé les popu<strong>la</strong>tions insu<strong>la</strong>ires vidées <strong>de</strong> leurs forces vives pour<br />
les besoins <strong>de</strong> Moruroa : « Donc il restait les vieil<strong>la</strong>rds et les plus<br />
timorés si bien qu’on sentait que <strong>la</strong> vie s’éteignait petit à petit… Ailleurs,<br />
à Tahiti, on s’est installé dans une facilité <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> plus en plus<br />
gran<strong>de</strong>, les gens ont pris beaucoup <strong>de</strong> mauvaises habitu<strong>de</strong>s, celle<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> vie facile, celle <strong>de</strong> ne plus travailler et l’agriculture s’est étiolée<br />
petit à petit. »<br />
Bien avertis <strong>de</strong>s bouleversements sociaux, les responsables <strong>de</strong><br />
l’Eglise reconnaissent qu’ils n’ont pas pris conscience tout <strong>de</strong> suite<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong> ces expériences pour <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. « J’ai<br />
le souvenir <strong>de</strong> prêtres racontant qu’il y avait <strong>de</strong>s aviateurs qui avaient<br />
été irradiés, mais il y avait aussi <strong>de</strong>s gens qui ont été irradiés, on ne<br />
l’a pas dit, mais je l’ai su après. On a soigné, on a pris <strong>de</strong>s précautions<br />
pour le personnel militaire mais pour les civils ils n’en ont pas<br />
pris autant… » Mgr Hubert se rappelle bien du Père Florentin, un<br />
peu fantasque, mais opposé farouchement aux essais. De nationalité<br />
belge, il a été expulsé !<br />
Mgr Hubert reconnaît que l’Eglise catholique est maintenant mieux<br />
informée. « Une partie <strong>de</strong> Tahiti a reçu une irradiation assez forte,<br />
<strong>de</strong>s gens qui n’ont jamais les pieds à Moruroa peuvent être victimes<br />
<strong>de</strong> ces irradiations. C’est le cas par exemple à Mangareva. Alors, c’est<br />
vraiment un problème difficile d’autant qu’il faut bien se dire qu’actuellement<br />
<strong>la</strong> France n’est pas prête à dépenser beaucoup. »<br />
Et ce conseil pour l’avenir : « Il va falloir oublier cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> facilité<br />
et prendre son courage à <strong>de</strong>ux mains pour chercher un moyen<br />
pour que ce territoire vive. »<br />
«<br />
»<br />
26 27
Jacqueline Go<strong>la</strong>z<br />
Ancienne directrice d’école à Mangareva <strong>de</strong> 1962 à 1969.<br />
Jacqueline se souvient : « On voyait arriver <strong>de</strong> grands bateaux dans <strong>la</strong><br />
ra<strong>de</strong> <strong>de</strong> Rikitea : <strong>de</strong>s grands bateaux qui arrivaient par le sud, par <strong>la</strong><br />
Terre <strong>de</strong> feu. Les commandants étaient contents <strong>de</strong> voir <strong>de</strong>s enfants,<br />
au bout d’un mois, un mois et <strong>de</strong>mi, <strong>de</strong>ux mois <strong>de</strong> voyage. Nous étions<br />
les premiers à les recevoir. Ils se sont installés à Taku fin 63 début 64.<br />
Il y a eu un grand changement. Toute <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion a été perturbée<br />
quand même. »<br />
Avait-elle été mise au courant <strong>de</strong> ce qui se préparait à Moruroa <br />
Pas du tout : « J’ai appris qu’on al<strong>la</strong>it prendre Moruroa et faire <strong>de</strong><br />
ces îles <strong>de</strong>s stations <strong>de</strong> tirs nucléaires, <strong>de</strong> <strong>la</strong>ncement <strong>de</strong> bombes atomiques.<br />
Nous on ne savait rien <strong>de</strong> tout ça. On ne savait même pas ce<br />
que c’est qu’une bombe. On ne nous prévenait pas avant le tir <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
bombe. C’est simplement quand on voyait les militaires qui étaient un<br />
peu excités ! »<br />
Jacqueline s’inquiétait pourtant : « On s’était rendu compte qu’il y avait<br />
<strong>de</strong>s enfants ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s. Je tenais un cahier du dispensaire et dans ce<br />
cahier, tous ceux qui passaient voir l’infirmier M. Durand, étaient inscrits,<br />
ce qu’ils avaient : il y avait <strong>la</strong> diarrhée, ils vomissaient et je me<br />
rappelle bien un vieux papa qui est venu me dire : « Mais regar<strong>de</strong>z,<br />
ma fille, elle perd ses cheveux ! ». Moi, je ne savais pas pourquoi et<br />
alors j’ai écrit sur le cahier, à M. Durand, que certains élèves perdaient<br />
leurs cheveux. » Un jour, ce cahier lui a été « emprunté » par<br />
<strong>de</strong>s officiers <strong>de</strong> passage. Elle ne l’a jamais revu.<br />
L’ancienne directrice d’école décrit <strong>la</strong> vie à Mangareva avec une vivacité<br />
empreinte <strong>de</strong> tristesse, sans oublier qu’elle-même a vécu <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die,<br />
les séjours au Val <strong>de</strong> Grâce : « J’ai eu <strong>de</strong> <strong>la</strong> chance d’être partie<br />
en France me soigner. Je connais beaucoup <strong>de</strong> Mangaréviens qui ne<br />
sont plus. »<br />
«<br />
»<br />
28 29
François Cournée<br />
Ancien gendarme à Mangareva entre 1969 et 1971.<br />
François Cournée décrit son activité <strong>de</strong> gendarme, chargé <strong>de</strong> l’administration<br />
locale à une pério<strong>de</strong> où les municipalités n’avaient pas<br />
encore été créées. Rien ne lui échappait <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie quotidienne <strong>de</strong>s<br />
Mangaréviens, y compris le recensement <strong>de</strong>s femmes enceintes !<br />
Pendant les campagnes <strong>de</strong> tirs, le gendarme, chef <strong>de</strong> poste, avait une<br />
fonction supplémentaire : « Mon travail, en cas <strong>de</strong> retombées consistait<br />
à rassembler les popu<strong>la</strong>tions et <strong>de</strong> les mettre sous abri. » Doté<br />
d’une bonne mémoire, François Cournée décrit avec force détails <strong>la</strong><br />
mise à l’abri <strong>de</strong>s Mangaréviens, notamment lors du tir Phoebé d’août<br />
1971. Quant à connaître les risques, il avoue : « La popu<strong>la</strong>tion, même<br />
nous, on n’était pas briefés, personne n’était scientifique, même moi,<br />
je n’ai pas une formation scientifique, je suis <strong>de</strong> formation secondaire<br />
et c’est tout. On nous disait : ‘La France fait <strong>de</strong>s expérimentations’<br />
Mais on ne voyait pas ça sous les conséquences <strong>de</strong> ce poison et on ne<br />
voyait pas <strong>de</strong>s dégâts. »<br />
Breton et bon chrétien, le gendarme <strong>de</strong> Mangareva avait <strong>de</strong> bonnes<br />
re<strong>la</strong>tions avec l’autorité morale <strong>de</strong>s Gambier, le Père Daniel. Le prêtre<br />
était au courant <strong>de</strong> tout. François Cournée nous met dans <strong>la</strong> confi<strong>de</strong>nce<br />
: « Les officiers étaient vraiment aux petits soins du père Daniel<br />
et le père Daniel, il avait ce qu’il vou<strong>la</strong>it… il défendait peut-être les<br />
intérêts religieux, mais il défendait sa popu<strong>la</strong>tion. Et en plus, je savais<br />
que le père Daniel c’était l’oreille <strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> Paris aux Gambier.<br />
Il était un « honorable correspondant » du « service » spécialisé <strong>de</strong><br />
l’époque. »<br />
Aujourd’hui, l’ancien gendarme s’indigne : « La popu<strong>la</strong>tion paie et le<br />
paie cher ! Ce que je veux surtout dire, c’est que ces expérimentations<br />
ont eu lieu, on ne peut pas y revenir. Mais au moins qu’on ait <strong>la</strong><br />
décence <strong>de</strong> reconnaître ce qu’on a fait et puis qu’on in<strong>de</strong>mnise ces<br />
gens-là. Ces gens souffrent dans leur chair, dans leur famille, dans<br />
leur cœur. Qu’on ait le courage <strong>de</strong> le dire ! »<br />
«<br />
»<br />
30 31
Jean-Marc Regnault<br />
Jean-Marc Regnault est historien. Pour lui, il est évi<strong>de</strong>nt que les essais<br />
nucléaires sont un élément majeur <strong>de</strong> l’histoire contemporaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Polynésie : « Mon première objectif avait été d’étudier <strong>la</strong> vie politique<br />
au regard <strong>de</strong>s essais nucléaires. Je vou<strong>la</strong>is voir comment <strong>la</strong> France<br />
a pu imp<strong>la</strong>nter ses essais ici, quelles résistances elle a rencontré<br />
ou quelles résistances n’a-t-elle pas rencontré, comment ça s’est<br />
fait et comment finalement les hommes politiques ont re<strong>la</strong>tivement<br />
bien accepté cette chose Donc, j’ai travaillé sur les archives locales<br />
essentiellement, les débats à l’assemblée territoriale notamment et les<br />
témoignages <strong>de</strong>s hommes politiques <strong>de</strong> l’époque. »<br />
L’historien raconte toutes les difficultés pour obtenir ou retrouver une<br />
documentation souvent restée fermée à l’attention <strong>de</strong>s chercheurs.<br />
Il a consacré une gran<strong>de</strong> part <strong>de</strong> ses travaux pour savoir si l’éviction<br />
du député Pouvanaa en 1958 avait un lien avec l’imp<strong>la</strong>ntation du CEP<br />
en Polynésie française : « Voilà un monsieur qui est arrêté sous un<br />
prétexte étonnant ! Il aurait voulu mettre le feu à <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Papeete !<br />
Donc, il est arrêté, mis en prison, jugé, condamné. Mais j’ai trouvé que<br />
c’était un peu suspect. Donc, je me suis dit, est-ce qu’il y aurait un lien<br />
entre son arrestation et cette volonté <strong>de</strong> <strong>la</strong> France <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s essais<br />
nucléaires. C’est comme ça que j’ai cherché <strong>de</strong>s documents et j’ai<br />
questionné les documents pour trouver une réponse. »<br />
«<br />
Jean-Marc Regnault déroule tout le fil <strong>de</strong> sa longue et passionnante<br />
recherche pour trouver le lien entre l’arrestation <strong>de</strong> Pouvanaa et<br />
l’imp<strong>la</strong>ntation du CEP. Il évoque aussi, à l’occasion, tout le contexte<br />
politique tant <strong>de</strong> <strong>la</strong> métropole que <strong>de</strong> <strong>la</strong> Polynésie qui entoura les<br />
30 ans <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s essais nucléaires. Il explique les revirements<br />
constants <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse politique locale et abor<strong>de</strong> également <strong>la</strong><br />
construction <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s fortunes grâce au CEP : « Tout le mon<strong>de</strong> a<br />
profité, d’une façon ou d’une autre, du CEP. Un industriel m’a dit un<br />
jour : Ce n’est pas très glorieux, l’argent qu’on a gagné. Mais on l’a<br />
gagné quand même ! »<br />
»<br />
32 33
Hiro Tefaarere<br />
Ancien dirigeant syndicaliste<br />
Après un court passage à Moruroa, Hiro Tefaarere a fait une carrière<br />
dans <strong>la</strong> police nationale puis, après <strong>la</strong> création du syndicat A Tia i Mua,<br />
il a été engagé dans les conflits du travail <strong>de</strong> Moruroa en tant que<br />
secrétaire général <strong>de</strong> ce syndicat.<br />
Il témoigne : « A Moruroa, l’apartheid existait. Il y avait sur p<strong>la</strong>ce<br />
quatre catégories géographiques, sociales, humaines qui travail<strong>la</strong>ient<br />
: les gradés du CEA - les ingénieurs du CEA -, les gradés <strong>de</strong><br />
l’Armée – les officiers <strong>de</strong> l’Armée -, les travailleurs du CEA, <strong>de</strong> l’Etat<br />
affectés en Polynésie, ceux <strong>de</strong>s entreprises sous-traitantes qui travail<strong>la</strong>ient<br />
pour le CEP et i<strong>de</strong>m pour les entreprises sous-traitantes qui<br />
travail<strong>la</strong>ient pour le CEP. Ici, le mon<strong>de</strong> politique s’en foutait : retraites,<br />
assurance ma<strong>la</strong>die, rien ! Précaires, ils ouvraient leur gueule, ils prenaient<br />
l’avion, ils rentraient à Tahiti. Voilà pourquoi je par<strong>la</strong>is d’apartheid<br />
et je m’étais promis, juré <strong>de</strong> mettre un terme à ces problèmes<br />
<strong>de</strong> discrimination raciale. »<br />
«<br />
En 1995, Hiro Tefaarere parle d’une sorte d’union sacrée <strong>de</strong>s partis,<br />
<strong>de</strong>s associations, <strong>de</strong> l’Eglise protestante contre <strong>la</strong> reprise <strong>de</strong>s essais :<br />
« On a réussi en cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> mai-juin 95 à septembre 95, à faire<br />
<strong>la</strong> démonstration à l’Etat que tout un peuple ne vou<strong>la</strong>it plus <strong>de</strong> ces<br />
explosions nucléaires. »<br />
Il dresse un bi<strong>la</strong>n amer <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> CEP en Polynésie : « Nous faisons<br />
partie <strong>de</strong> ces rares peuples au mon<strong>de</strong>, <strong>de</strong> ces rares civilisations<br />
au mon<strong>de</strong> qui sont passées <strong>de</strong> l’ère <strong>de</strong> <strong>la</strong> pirogue à ba<strong>la</strong>ncier, <strong>de</strong> l’ère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pirogue à rames, à l’ère du nucléaire et du computer en une<br />
génération, notre génération. »<br />
»<br />
34 35
Daniel Pa<strong>la</strong>cz<br />
Daniel Pa<strong>la</strong>cz est entrepreneur. Au début <strong>de</strong>s essais en 1966, il était à<br />
Moruroa :<br />
« Le Chélif rapatriait le matériel contaminé <strong>de</strong> Mururoa sur Hao pour le<br />
décontaminer. On prenait du matériel juste après le tir aérien : il était<br />
trié par l’armée parce qu’une partie était <strong>la</strong>gonnée. Le reste, c’était soit<br />
disant hyper-contaminé : on avait ça sur le pont, carrément, avec <strong>de</strong>s<br />
ban<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>stiques pour ne pas trop s’approcher. Et puis arrivé à Hao, il<br />
y avait une base <strong>de</strong> décontamination un peu après le vil<strong>la</strong>ge. On débarquait<br />
ça : une partie était encore détruite et une partie était <strong>la</strong>vée directement<br />
sur p<strong>la</strong>ce. Ils appe<strong>la</strong>ient ça <strong>la</strong> décontamination : <strong>de</strong>s gens avec<br />
<strong>de</strong>s <strong>la</strong>nces à incendie et un produit détergent quelconque <strong>la</strong>vaient les<br />
engins à décontaminer. Ca cou<strong>la</strong>it dans le <strong>la</strong>gon. » Daniel Pa<strong>la</strong>cz explique<br />
le principe <strong>de</strong>s « <strong>la</strong>gonnages » qui se faisaient, à son époque, n’importe<br />
où. Peu <strong>de</strong> matériel a été conservé, contaminé ou non.<br />
Comme civil, il a travaillé à Moruroa avec les plongeurs <strong>de</strong> son entreprise<br />
: « Nous on plongeait, on faisait 4 plongées par jour et chaque<br />
plongeur quand il remonte, indique son fond. On savait que le maximum<br />
qu’on pouvait atteindre c’était 34 mètres et puis un jour il y a quelqu’un<br />
qui est monté et qui a dit 42 mètres ! Tout le mon<strong>de</strong> a rigolé, mais en<br />
fait le <strong>la</strong>gon s’était vraiment affaissé et c’est à ce moment-là que l’atoll a<br />
commencé à pencher. » Et pourtant, Daniel Pa<strong>la</strong>cz re<strong>la</strong>te l’hécatombe :<br />
« Pour ce qui était <strong>de</strong>s plongeurs, beaucoup étaient <strong>de</strong>s gens sérieux : il<br />
y en avait qui étaient diacres. La plupart ne consommaient pas d’alcool<br />
et ne fumaient pas et ils sont morts <strong>de</strong> cancers <strong>de</strong> <strong>la</strong> gorge, <strong>de</strong> cancers<br />
du foie, même pas à 38 ans, quelques années après. Je crois que sur<br />
<strong>la</strong> vingtaine <strong>de</strong> plongeurs qu’on était, <strong>de</strong> toute l’équipe, on doit rester à<br />
2 ou 3 je crois. »<br />
«<br />
Le témoignage <strong>de</strong> Daniel Pa<strong>la</strong>cz est précis et très fort. Son jugement sur<br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> CEP est très dur : « Alors qu’on aurait pu avoir l’auto-suffisance<br />
et créer d’autres industries, qu’on aurait pu exporter. On a loupé<br />
le coche complètement. Je pense que justement l’Etat français est responsable,<br />
parce qu’on a voulu acheter <strong>la</strong> parole <strong>de</strong>s hommes politiques<br />
mais on ne les a pas contrôlés. Comme ici c’est un petit pays, les seuls<br />
qui ont eu droit à <strong>la</strong> parole, on les a <strong>la</strong>issés faire et maintenant on se<br />
retrouve avec <strong>de</strong>s scandales… Alors maintenant, il y en a peut-être qui<br />
vont ramasser mais c’est trop tard : l’argent est parti et on est à zéro. »<br />
»<br />
36 37
Patrick Howell<br />
Patrick Howell, ancien ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, se décrit comme « un<br />
enfant <strong>de</strong> l’Eglise » où il a été éduqué. Après <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s universitaires<br />
<strong>de</strong> chirurgien-<strong>de</strong>ntiste, il s’est engagé dans les premières associations<br />
<strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’environnement et plus tard, dans le « Comité<br />
Paix et développement » regroupant <strong>de</strong>s associations, Eglises,<br />
groupes politiques. « Nous avions l’impression que nous étions dans<br />
un débat <strong>de</strong> dominants dominés parce que nous, nous n’avions rien<br />
et <strong>de</strong> l’autre côté, il y avait les moyens, il y avait <strong>la</strong> connaissance et<br />
nous, on <strong>de</strong>mandait tout simplement à pouvoir partager objectivement<br />
les connaissances qui étaient censées nous être données pour<br />
y voir c<strong>la</strong>ir. »<br />
Patrick Howell porte un jugement sans concessions sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
CEP : « Nous sommes passés <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> <strong>la</strong> pierre à l’âge du nucléaire<br />
en même pas <strong>de</strong>ux cents ans. L’histoire a pu être digérée par un<br />
grand pays comme <strong>la</strong> France, alors que chez nous, c’est un peu<br />
comme si vous preniez un enfant <strong>de</strong> l’école maternelle et que vous le<br />
mettiez dans <strong>la</strong> cour du campus universitaire. »<br />
Et il esquisse <strong>de</strong>s propositions pour l’avenir : « Il faut créer <strong>de</strong>s conditions<br />
pour que le Polynésien, après cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> traumatisme, soit<br />
bien dans sa peau, bien dans sa tête pour construire un pays conformément<br />
à ce qui se vit ailleurs. Il serait grand temps que l’Etat ait une<br />
approche différente vis-à-vis <strong>de</strong> ce pays d’outre-mer parce que nous<br />
avons plus que servi <strong>la</strong> France dans <strong>la</strong> constitution <strong>de</strong> son savoir-faire<br />
en matière nucléaire. »<br />
«<br />
»<br />
38 39
Alex du Prel<br />
Journaliste. Fondateur <strong>de</strong> Tahiti Pacifique Magazine<br />
Alex du Prel présente les moyens d’information <strong>de</strong>s années CEP : « A<br />
l’époque <strong>de</strong>s essais, il y avait <strong>de</strong>ux journaux, les <strong>de</strong>ux quotidiens dont<br />
un avait un grand tirage, c’était La Dépêche. Bon, ils racontaient ce<br />
que le CEP vou<strong>la</strong>it bien dire. Donc toute l’information était verrouillée.<br />
Le seul à l’époque qui faisait « mousser » un peu était Bengt Danielsson<br />
et sa femme Marie-Thérèse. Lui était Suédois, il était consul <strong>de</strong><br />
Suè<strong>de</strong> ici. D’ailleurs, <strong>la</strong> France a <strong>de</strong>mandé à <strong>la</strong> Suè<strong>de</strong> <strong>de</strong> lui retirer son<br />
exequatur, après qu’il ait publié un livre qui avait eu un grand succès,<br />
« Moruroa mon amour ».<br />
En 1991, Alex du Prel crée un mensuel indépendant, Tahiti Pacifique<br />
Magazine qui a révolutionné l’information sur <strong>la</strong> Polynésie : « Lorsque<br />
j’ai commencé le magazine, il ne faut pas oublier que <strong>la</strong> bombe était le<br />
moteur économique du territoire : on ne pouvait pas ne pas s’intéresser<br />
au nucléaire. Donc, j’avais contacté le CEP à l’époque : ils disaient<br />
: « Oui, oui, vous pouvez… » J’avais fait un grand dossier en 91.<br />
C’était au moment aussi où Greenpeace était venu, alors j’avais fait les<br />
<strong>de</strong>ux côtés et j’en étais assez content puisque j’ai eu les félicitations<br />
du CEP et les félicitations <strong>de</strong> Greenpeace ! Bon j’étais le petit « gratte,<br />
gratte », mais les essais étaient pratiquement finis. »<br />
«<br />
Alex du Prel porte un regard luci<strong>de</strong> sur les transformations <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société polynésienne engendrées par le CEP : « Tout a basculé avec<br />
cette arrivée d’argent qui a transformé une société rurale et îlienne,<br />
pour mettre en p<strong>la</strong>ce un système d’éducation calqué sur <strong>la</strong> métropole.<br />
De 1960 à 2010, pendant 50 ans, on a dépensé une fortune chaque<br />
année pour transformer une popu<strong>la</strong>tion qui vivait en phase avec son<br />
environnement en une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> consommateurs à l’image <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société industrielle européenne. Et tout le dilemme aujourd’hui, c’est :<br />
Que faire avec cette société puisqu’il n’y a pas <strong>de</strong> production dans<br />
ce pays. »<br />
»<br />
40 41
John Doom<br />
Ancien secrétaire général <strong>de</strong> l’Eglise Protestante Maohi.<br />
John Doom a eu sa première « expérience » <strong>de</strong>s essais nucléaires en<br />
1963 alors qu’il était diacre <strong>de</strong> <strong>la</strong> paroisse française <strong>de</strong> Papeete. Avec<br />
le pasteur Jean Adnet, apprenant <strong>la</strong> construction du CEP, ils avaient<br />
publié un petit article dans le journal paroissial réc<strong>la</strong>mant une enquête<br />
publique « commodo-incommodo ». Résultat : le pasteur fut interdit <strong>de</strong><br />
séjour à Tahiti pendant plus <strong>de</strong> 6 mois !<br />
Trois ans plus tard, le 2 juillet 1966, John Doom se trouvait à Mangareva<br />
comme interprète du ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> France d’Outre-mer. L’histoire<br />
est connue, les Gambier furent copieusement contaminées par<br />
le nuage <strong>de</strong> <strong>la</strong> première bombe <strong>de</strong> Moruroa… et les officiels s’éclipsèrent<br />
au plus vite <strong>la</strong>issant <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion locale sans information.<br />
Racontant ses premières armes au micro <strong>de</strong> l’ORTF, John se souvient<br />
d’un rapport qu’il dut faire aux autorités pour avoir <strong>la</strong>issé passer à<br />
l’antenne, après un essai, <strong>de</strong>s messages a<strong>la</strong>rmants <strong>de</strong>s gens <strong>de</strong>s îles.<br />
Secrétaire général <strong>de</strong> l’Eglise protestante, John raconte les difficultés<br />
internes qui ont fait qu’officiellement le Syno<strong>de</strong> n’a pris position<br />
publiquement contre les essais qu’en 1982, non sans mal d’ailleurs.<br />
Mais <strong>de</strong>puis, l’opposition <strong>de</strong> l’Eglise tient bon et, à partir <strong>de</strong> 1996, elle<br />
s’engage aux côtés <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong>s essais et <strong>de</strong> Moruroa e tatou.<br />
Il faut dire que <strong>de</strong>puis 1989, John Doom est <strong>de</strong>venu le Directeur du<br />
Bureau Pacifique du Conseil Œcuménique <strong>de</strong>s Eglises à Genève, poste<br />
« stratégique » qui facilite l’internationalisation du combat contre les<br />
essais nucléaires français.<br />
John Doom est un « pilier » <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’opposition aux essais<br />
nucléaires en Polynésie, ce qui l’incite à encourager les jeunes générations<br />
: « Les essais sont terminés, c’est c<strong>la</strong>ir, mais les conséquences,<br />
nous en aurons pour <strong>de</strong>s centaines, si ce n’est pour <strong>de</strong>s milliers d’années…<br />
ce n’est pas quelque chose qui est <strong>de</strong>rrière nous. Vous les<br />
jeunes générations, vous <strong>de</strong>vez vous engager : il y va <strong>de</strong> l’avenir <strong>de</strong><br />
notre peuple. Regar<strong>de</strong>z autour <strong>de</strong> vous. Posez <strong>de</strong>s questions à vos<br />
parents. Il n’y a pas une personne dans une famille en Polynésie qui<br />
n’est pas affectée. Formez-vous ! Préoccupez- vous <strong>de</strong> notre avenir. »<br />
«<br />
»<br />
42 43
Oscar Temaru<br />
Oscar Temaru a connu Moruroa avant les essais et aux débuts <strong>de</strong>s<br />
essais aériens dans le cadre <strong>de</strong> son travail <strong>de</strong> fonctionnaire <strong>de</strong>s<br />
douanes. En 1976, les agents tahitiens constataient <strong>la</strong> présence <strong>de</strong><br />
nombreux panneaux d’interdiction sur l’atoll : « Nous interdire <strong>de</strong><br />
boire <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong> coco ou d’aller pêcher, c’est impensable. Alors <strong>de</strong>s<br />
dockers, <strong>de</strong>s ouvriers n’ont pas fait attention à ça. Ils sont quand<br />
même allés à <strong>la</strong> pêche et on les a retrouvés dans un état piteux. » Par<br />
<strong>la</strong> suite, <strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s douanes fera appel à <strong>de</strong>s non-tahitiens.<br />
Oscar Temaru évoque sa longue carrière militante antinucléaire, à<br />
travers le Pacifique, au Japon, au Kazakhstan, en France. A Tahiti,<br />
dit-il « On nageait contre-courant. Le CEP faisait vivre plusieurs milliers<br />
<strong>de</strong> familles. » Il revient sur les pério<strong>de</strong>s « dures » du combat<br />
contre les essais : <strong>la</strong> révolte <strong>de</strong>s dockers d’octobre 1987 où il fut<br />
c<strong>la</strong>irement menacé, l’embrasement <strong>de</strong> septembre 1995 qui n’était<br />
pas programmé…<br />
Oscar Temaru réfléchit à haute voix sur les leçons à tirer <strong>de</strong> ce long<br />
combat : « Alors qu’il y a tant <strong>de</strong> choses à faire dans ce mon<strong>de</strong>. Des<br />
millions et <strong>de</strong>s millions <strong>de</strong> personnes meurent <strong>de</strong> faim et <strong>de</strong>s milliards<br />
et <strong>de</strong>s milliards ont été dépensés pour ça. Est-ce que ça va<strong>la</strong>it<br />
le coup Quand on voit les problèmes qu’il y a en France même<br />
aujourd’hui : est-ce que les Français savent ce qui a été dépensé ici <br />
Des milliards ont été injectés dans ce pays, mais qui ont profité à qui <br />
… Et aujourd’hui, on parle <strong>de</strong>s problèmes sociaux <strong>de</strong> ce pays, allez<br />
voir dans tous les quartiers.»<br />
«<br />
»<br />
44 45
Taaroanui Maraea<br />
Taarii Maraea est aujourd’hui prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Eglise Protestante Maohi.<br />
Enfant, il se souvient que son père avait travaillé quelques temps à<br />
Moruroa ainsi que <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> sa famille. « Je sais aussi que<br />
beaucoup <strong>de</strong> vil<strong>la</strong>geois étaient encouragés à partir et quelque fois<br />
par les pasteurs ou en tout cas par quelques responsables d’Eglise.<br />
Peut-être étaient-ils inconscients <strong>de</strong> ce qui se passait mais ce qui<br />
était primordial pour eux, c’était d’améliorer les conditions <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s<br />
familles dans les îles. »<br />
C’est vers 18-19 ans, entré à l’Ecole pastorale à Tahiti, que Taarii<br />
prend conscience <strong>de</strong>s revendications contre les essais nucléaires<br />
dont il n’avait jamais entendu parler auparavant. La question<br />
nucléaire était très sensible, même dans l’Eglise : « Bien que l’Eglise<br />
institutionnellement et officiellement s’était prononcée au travers<br />
d’articles, <strong>de</strong> messages contre les essais nucléaires, il était hors <strong>de</strong><br />
question qu’on nous <strong>la</strong>issât participer à <strong>de</strong>s manifestations antinucléaires<br />
à l’époque. » Ce n’est qu’en 1995 qu’il y aura une réelle<br />
prise <strong>de</strong> conscience dans l’Eglise… jusqu’à ce jour où le syno<strong>de</strong><br />
décida <strong>de</strong> défiler dans les rues <strong>de</strong> Papeete pour s’opposer à <strong>la</strong><br />
reprise <strong>de</strong>s essais.<br />
Tout n’était pas gagné. Taarii rappelle les difficultés pour obtenir le<br />
soutien et l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pasteurs au moment <strong>de</strong> l’enquête sociologique<br />
auprès <strong>de</strong>s anciens travailleurs <strong>de</strong> Moruroa en 1996. A l’époque viceprési<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> l’Eglise, il a dû subir les pressions <strong>de</strong>s Renseignements<br />
généraux. Heureusement, il y eut le soutien du réseau Solidarité<br />
Europe Pacifique qui permettait <strong>la</strong> réflexion et <strong>la</strong> cohérence sur les<br />
suites à donner après <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s essais.<br />
Aujourd’hui, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Eglise, Taarii souhaite que <strong>la</strong> nouvelle<br />
génération réfléchisse au prix payé par les Polynésiens en échange<br />
<strong>de</strong>s essais. « C’est une histoire qui doit être enseignée et aussi assumée,<br />
une histoire qu’on ne doit pas oublier. »<br />
«<br />
»<br />
46 47
Unutea Hirshon<br />
Tea Hirshon s’est engagée dans <strong>la</strong> lutte contre les essais <strong>de</strong>puis le<br />
début en même temps que son engagement dans le parti indépendantiste.<br />
Les <strong>de</strong>ux combats étaient liés : « Si nous n’avions pas été<br />
sous tutelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> France, les essais nucléaires n’auraient pas pu se<br />
faire chez nous. »<br />
Tea témoigne au nom du parti Tavini Huiraatira et elle emploie souvent<br />
le « nous ». « Bien que les essais aient constitué une violence à<br />
l’égard <strong>de</strong>s Polynésiens et <strong>de</strong> leur environnement, nous avons choisi<br />
<strong>la</strong> non-violence pour notre combat ». Il fal<strong>la</strong>it aux militants une gran<strong>de</strong><br />
force <strong>de</strong> caractère, appuyée même par <strong>la</strong> prière, pour affronter les<br />
forces <strong>de</strong> l’ordre lors <strong>de</strong>s manifestations publiques. Tea rappelle le<br />
temps où non seulement les opposants étaient peu nombreux, mais<br />
où ils étaient confrontés aux bataillons <strong>de</strong> policiers. Mais ils n’étaient<br />
pas sans soutien dans les pays du Pacifique, en France, aux côtés<br />
d’associations comme Greenpeace ou <strong>de</strong> chercheurs engagés. Chargée<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> communication et anglophone, Tea a beaucoup aidé le mouvement<br />
dans ses re<strong>la</strong>tions extérieures.<br />
Puis vint le temps du « taui », en 2005. Les indépendantistes et antinucléaires<br />
ont gagné les élections ! Tea Hirshon a présidé <strong>la</strong> première<br />
commission d’enquête sur les essais nucléaires décidée par<br />
l’Assemblée <strong>de</strong> <strong>la</strong> Polynésie. C’est à partir <strong>de</strong> ce moment-là que l’Etat<br />
a été contraint <strong>de</strong> « bouger » et que <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong>s conséquences<br />
<strong>de</strong>s essais nucléaires s’est peu à peu généralisée dans <strong>la</strong><br />
société polynésienne.<br />
L’histoire et le combat ne sont pas terminés, il reste une gran<strong>de</strong><br />
inquiétu<strong>de</strong> pour le futur du pays : « C’est un réel danger pour nous<br />
lorsqu’on sait qu’il y a <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité qui est enfermée dans le<br />
ventre <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux atolls. Tout ça nous ne le maîtrisons pas. »<br />
«<br />
»<br />
48 49
Temarama Arapari<br />
En 1982, l’Eglise protestante maohi et son syno<strong>de</strong> ont décidé <strong>de</strong><br />
s’opposer officiellement contre les essais nucléaires français à Moruroa<br />
et aussi dans les autres pays du mon<strong>de</strong>. A ce moment-là, le pasteur<br />
Temarama, s’est engagé aux côtés d’une organisation non gouvernementale<br />
<strong>de</strong> Polynésie qui s’appelle Hiti Tau.<br />
Le pasteur Temarama raconte avec émotion l’épopée <strong>de</strong> juillet 1995<br />
où, avec Mgr Gaillot et Oscar Temaru, à bord du bateau Le Greenpeace,<br />
ils sont allés jusqu’à Moruroa pour protester contre <strong>la</strong> reprise<br />
<strong>de</strong>s essais décidée par le prési<strong>de</strong>nt Jacques Chirac.<br />
« Je savais que les militaires ne <strong>de</strong>vaient pas nous tamponner à mort,<br />
et que c’était une technique pour arrêter les manifestations ou bien<br />
pour arrêter un bateau. C’était juste pour faire peur et pour que le<br />
bateau <strong>de</strong> Greenpeace puisse s’arrêter. Mais on ne s’est pas arrêté,<br />
on a continué jusque sur le quai <strong>de</strong> Moruroa. »<br />
Il gar<strong>de</strong> encore le souvenir ému du retour à Tahiti quelques jours plus<br />
tard : « Je n’oublierais jamais l’arrivée à Tahiti du bateau <strong>de</strong> Greenpeace<br />
<strong>de</strong> retour <strong>de</strong> Moruroa. On a vu le peuple tout b<strong>la</strong>nc dans <strong>la</strong> ville<br />
<strong>de</strong> Papeete qui nous accueil<strong>la</strong>it et qui nous disait qu’on avait réussi.<br />
Des échos annonçaient que Chirac al<strong>la</strong>it procé<strong>de</strong>r à un tir. Ils ont arrêté<br />
les tirs l’année d’après en 1996. »<br />
«<br />
»<br />
50 51
Michel Arakino<br />
Michel Arakino est né sur l’atoll <strong>de</strong> Reao où il a grandi. Il habite<br />
aujourd’hui Tahiti.<br />
Michel raconte ses souvenirs d’enfant : « Ce qui était très bien pour<br />
nous, à neuf-dix ans, c’était pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s tirs, on al<strong>la</strong>it<br />
dans <strong>de</strong>s maisons qui étaient gonflées à l’air pour nous protéger <strong>de</strong>s<br />
retombées. Mais après ces retombées, on al<strong>la</strong>it sur les gros navires<br />
qui étaient au <strong>la</strong>rge. C’était bien parce qu’on avait distribution <strong>de</strong><br />
bonbons et on nous faisait <strong>de</strong>s contrôles médicaux … Il y avait <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>de</strong>cins qui nous contrô<strong>la</strong>ient, qui nous regardaient. »<br />
Après son service militaire en métropole, Michel a été embauché dans<br />
l’armée pour le Service Mixte <strong>de</strong> Contrôle Biologique à Moruroa. « On<br />
est allé sur l’atoll <strong>de</strong> Fangataufa : <strong>la</strong> Légion étrangère a récupéré <strong>de</strong>s<br />
terres qu’on a ramenées sur Moruroa où on a fait un petit jardinet.<br />
Des scientifiques faisaient le suivi <strong>de</strong>s traces <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité dans<br />
ce jardin. On n’était pas équipés comme il fal<strong>la</strong>it mais d’après nos<br />
responsables, il n’y avait aucun risque. Nous avons fait <strong>de</strong>s récoltes<br />
<strong>de</strong> pastèques, <strong>de</strong> melons, <strong>de</strong> patates douces, <strong>de</strong> concombres… Les<br />
scientifiques nous disaient : « c’est bon ! » et parce qu’ ils disaient<br />
« C’est bon ! » on a mangé <strong>de</strong>s légumes… le rab nous servait à faire<br />
<strong>de</strong>s sa<strong>la</strong><strong>de</strong>s. »<br />
Michel fut ensuite plongeur et il était chargé <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s échantillons<br />
d’eau sur les têtes <strong>de</strong> puits souterrains : « On mesurait les<br />
fuites radioactives aux orifices qui <strong>la</strong>issés lors <strong>de</strong>s forages par les<br />
passages <strong>de</strong> câbles. On ne pourra pas dire que c’était minime : il y<br />
avait <strong>de</strong>s fuites mesurables dans une zone <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 500 mètres <strong>de</strong><br />
diamètre… » Il fut même « contrôlé positif » !<br />
Michel raconte aussi toutes les pressions du mon<strong>de</strong> militaire et politique<br />
qu’il a subies lorsqu’il a décidé d’adhérer à Moruroa e tatou.<br />
«<br />
»<br />
52 53
Frère Maxime Chan<br />
Ancien professeur <strong>de</strong> mathématiques<br />
De retour à Tahiti à 28 ans en 1968, le jeune professeur ne se pose<br />
pas <strong>de</strong> questions : « Au début, je ne pensais pas qu’il y avait <strong>de</strong> problèmes<br />
pour les essais nucléaires et nous étions très réceptifs au<br />
message officiel. D’autant plus qu’avec l’arrivée du CEP c’était un<br />
changement extraordinaire pour Tahiti. C’était l’irruption du mon<strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>rne avec tous ses moyens. »<br />
Moruroa Ce n’était pas le sujet : « Personnellement je n’ai jamais<br />
parlé <strong>de</strong> ce<strong>la</strong> en c<strong>la</strong>sse. J’ai fait toutes les couches <strong>de</strong> <strong>la</strong> sixième<br />
jusqu’en terminale, toutes les sections, mais jamais on a discuté <strong>de</strong><br />
ce<strong>la</strong> en c<strong>la</strong>sse. » Dans le milieu <strong>de</strong>s années 1980, Frère Maxime prend<br />
conscience <strong>de</strong>s atteintes à l’environnement à Tahiti, mais dans les<br />
réunions, <strong>la</strong> question nucléaire était « tabu ». « Et ce n’était pas choquant<br />
parce que c’était comme ça dans <strong>la</strong> société. » C’est <strong>la</strong> reprise<br />
<strong>de</strong>s essais par Jacques Chirac en 1995 qui l’a incité à s’informer et<br />
à s’engager. Un éveil qui est venu <strong>de</strong> façon très lente : « une maturation<br />
», dit-il.<br />
Educateur dans l’âme, il regar<strong>de</strong> l’avenir : « Pour les générations à<br />
venir, il y a un travail <strong>de</strong> mémoire absolument nécessaire. Et <strong>de</strong>uxièmement,<br />
il faut tirer <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> cet événement là où on<br />
n’a pas véritablement pris conscience <strong>de</strong> <strong>la</strong> portée <strong>de</strong> ce qui s’est<br />
passé. Troisièmement, il faut arriver à dominer notre propre histoire<br />
à l’avenir. Par exemple, l’exploitation <strong>de</strong>s ressources maritimes, c’est<br />
peut-être un projet qui va nous permettre <strong>de</strong> nous sortir <strong>de</strong> nos difficultés<br />
actuelles. »<br />
«<br />
»<br />
54 55
Richard Tuheiava<br />
Richard Tuheiava est aujourd’hui sénateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Polynésie française à<br />
36 ans. Il gar<strong>de</strong> quelques souvenirs d’enfants <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> CEP. Dans<br />
<strong>la</strong> famille, c’était le silence complet : « Mon père était fonctionnaire,<br />
directeur d’école et malgré les discussions que j’ai pu avoir avec mon<br />
père, c’était le sujet à ne pas traiter, à ne pas discuter. » Il a le souvenir<br />
<strong>de</strong> quelques faits étonnants : « J’avais <strong>de</strong>s oncles qui avaient accès<br />
au magasin du CEP d’Arue où les choses ne coûtaient pas cher et<br />
moins cher en tout cas que dans un magasin ordinaire. Donc, on se<br />
posait <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir d’où venait cette cuve <strong>de</strong> vin… A Mahina,<br />
on voyait les gran<strong>de</strong>s éoliennes au siège du CEA… On voyait que <strong>de</strong>s<br />
tontons ou <strong>de</strong>s cousins partaient pendant plusieurs années. »<br />
Le jugement du sénateur est maintenant plus catégorique :<br />
« Aujourd’hui, on en revient à <strong>de</strong>s choses plus réalistes, on commence<br />
à découvrir le pot aux roses, on commence à comprendre <strong>la</strong> manipu<strong>la</strong>tion,<br />
<strong>la</strong> corruption <strong>de</strong>s consciences et, finalement, à comprendre<br />
que pour <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>ur d’un pays, on a fait le malheur d’un peuple. »<br />
Richard Tuheiava se mouille sur le terrain parlementaire pour faire<br />
reconnaître le droit <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong>s essais et aujourd’hui, il re<strong>la</strong>nce<br />
le débat au Sénat sur les conséquences environnementales <strong>de</strong>s<br />
essais : « La Polynésie a en son sein <strong>la</strong> plus grosse décharge nucléaire<br />
en milieu océanique au mon<strong>de</strong>. Il n’y a pas d’autre île où on a <strong>la</strong>issé<br />
plus d’une centaine <strong>de</strong> puits bouchés on ne sait pas <strong>de</strong> quelle<br />
manière. On fait confiance à <strong>la</strong> chimie, à <strong>la</strong> vitrification pour que ça<br />
tienne ! Et il y a <strong>de</strong>s parties <strong>de</strong> l’atoll sur le point <strong>de</strong> s’effondrer à tel<br />
point qu’on est obligé <strong>de</strong> le surveiller <strong>de</strong>puis Paris. Il n’y a pas d’autre<br />
endroit comme ça au mon<strong>de</strong>, en milieu océanique. »<br />
La conclusion est pleine d’incertitu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> gravité : « Je peux me<br />
permettre d’imaginer que, dans les années 60, pour les besoins <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> dissuasion nucléaire, on a peut-être sacrifié quelques gènes polynésiens<br />
à ce type d’expériences. Voilà ! Mais ça, je crois que c’est le<br />
cours <strong>de</strong> l’histoire qui nous le dira. »<br />
«<br />
»<br />
56 57
Emilienne Largeteau<br />
Emilienne est l’épouse d’un ancien travailleur <strong>de</strong> Moruroa. Ils ont eu<br />
cinq enfants et Pierre-Emile, alors que son père travail<strong>la</strong>it à Moruroa,<br />
est né en 1986 avec une malformation <strong>de</strong>puis sa naissance. Après <strong>de</strong><br />
nombreuses interventions dans les hôpitaux parisiens, Pierre-Emile<br />
est <strong>de</strong>venu paraplégique à l’âge <strong>de</strong> 17 ans.<br />
Emilienne raconte comment elle a vécu avec son fils, au fil <strong>de</strong>s années,<br />
les péripéties d’une maman tahitienne dans Paris : « En 86, c’est <strong>la</strong><br />
première fois que j’al<strong>la</strong>is à Paris et je me suis beaucoup débrouillée<br />
seule, parce qu’on nous a juste dit : dès que vous arrivez à l’aéroport,<br />
on vous récupère pour vous envoyer à votre foyer et l’enfant à<br />
l’hôpital. Arrivés là-bas, on a déposé l’enfant à l’hôpital et moi, on m’a<br />
déposé au Rosier Rouge. Le len<strong>de</strong>main, heureusement que j’avais<br />
une copine qui se trouvait sur p<strong>la</strong>ce, c’est elle qui m’a emmenée pour<br />
prendre le métro et je ne savais pas où ça se trouvait. On nous a dit<br />
que le métro, ça se trouvait dans le sol et moi je cherchais sur <strong>la</strong> route<br />
où se trouvait l’entrée. Je cherchais comme une taupe !... »<br />
La vie d’Emilienne est maintenant étroitement imbriquée avec celle<br />
<strong>de</strong> son grand garçon. Elle dit toujours « nous ». Quand parfois les<br />
démarches sont difficiles ou que les services <strong>de</strong> <strong>la</strong> CPS font obstacle<br />
à <strong>de</strong>s traitements, Emilienne gar<strong>de</strong> courage : « Quand je partais, je<br />
<strong>la</strong>issais les enfants avec <strong>la</strong> famille ici, je partais là-bas. Je me soutiens<br />
avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> mon fils. Il a été un bon soutien, mon fils, malgré sa<br />
ma<strong>la</strong>die : il sait aussi soutenir les personnes qui sont à côté <strong>de</strong> lui. »<br />
«<br />
»<br />
58 59
Pierre-Emile Largeteau<br />
Pierre-Emile Largeteau a 26 ans. C’est un « enfant <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe ». A<br />
sa naissance, son père travail<strong>la</strong>it en équipe à Moruroa pour ramasser<br />
les poissons morts après les explosions souterraines sur les p<strong>la</strong>ges<br />
du <strong>la</strong>gon. Handicapé <strong>de</strong> naissance, il a dû être évacué sanitaire très<br />
rapi<strong>de</strong>ment en France avec sa maman. Ses parents et les mé<strong>de</strong>cins<br />
ont voulu qu’il soit sco<strong>la</strong>risé entre ses séjours parisiens. Pierre-Emile<br />
se souvient : « Je pensais que j’étais normal comme ça, lorsque j’ai<br />
vu que d’autres n’avaient pas mes problèmes. Malgré mon handicap,<br />
j’ai été normalement à l’école et j’ai poursuivi ma sco<strong>la</strong>rité. Je portais<br />
<strong>de</strong>s couches et mes camar<strong>de</strong>s se moquaient <strong>de</strong> moi. J’avais honte. »<br />
A 17 ans, il est <strong>de</strong>venu paraplégique et se dép<strong>la</strong>ce dans en chaise<br />
rou<strong>la</strong>nte. Malgré tout, avec énergie, il a <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> poursuivre <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s : « Je vou<strong>la</strong>is réussir dans ma sco<strong>la</strong>rité, il y a eu <strong>de</strong>s moments<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>ssitu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> découragement. J’ai été jusqu’en Terminale S et<br />
je voudrais y arriver, mais entre ma ma<strong>la</strong>die et les étu<strong>de</strong>s, c’est dur.<br />
J’aurais voulu décrocher mon Bac et partir en France pour poursuivre<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s. » Hé<strong>la</strong>s, <strong>de</strong> nouvelles complications l’obligent à <strong>de</strong> nouveaux<br />
séjours dans les hôpitaux parisiens où sa mère l’accompagne<br />
fidèlement, <strong>la</strong>issant ses les autres enfants aux bons soins <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille.<br />
Et les séjours durent parfois plusieurs mois. Pierre-Emile s’interroge<br />
sur cette ma<strong>la</strong>die qui lui est tombée <strong>de</strong>ssus et qu’il doit subir au quotidien<br />
: « Il m’arrive <strong>de</strong> me <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r pourquoi ce<strong>la</strong> m’arrive à moi et<br />
seulement à moi dans <strong>la</strong> famille. Je souhaiterais dans un proche avenir<br />
que l’on me dise d’où vient le mal dont je souffre, car j’ai déjà passé<br />
une partie <strong>de</strong> ma jeunesse dans les hôpitaux sans savoir le pourquoi<br />
et aujourd’hui je suis dans une chaise rou<strong>la</strong>nte. »<br />
Bien sûr, Pierre-Emile a compris les causes probables <strong>de</strong> son handicap.<br />
Il ne se prive pas d’interpeller ces ingénieurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe qui ne<br />
s’étaient guère préoccupés <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong> leurs expériences<br />
sur les générations polynésiennes : « De quoi mon avenir sera fait <br />
Messieurs les ingénieurs <strong>de</strong>s essais nucléaires avez-vous seulement<br />
songé un moment que ce que vous avez préparé était criminel pour<br />
une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> jeunesse <strong>de</strong> mon pays, dont je suis une victime »<br />
«<br />
»<br />
60 61
Marc Pugibet<br />
Marc Pugibet a 26 ans. C’est un enfant <strong>de</strong> l’après-CEP. «Les informations<br />
concernant le CEP sont très faibles : ça ne fait pas partie <strong>de</strong>s<br />
programmes sco<strong>la</strong>ires, ce n’est pas également <strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> discussions<br />
primordiaux dans <strong>la</strong> vie <strong>de</strong> tous les jours. On ne s’y intéresse pas<br />
vraiment. On a l’impression que c’est loin ! »<br />
Pourtant, le père <strong>de</strong> Marc a travaillé à Moruroa dans les années 90,<br />
«mais je ne sais pas ce qu’il faisait, je sais simplement qu’il travail<strong>la</strong>it,<br />
qu’il partait même pour longtemps. On le voyait un mois dans l’année,<br />
je ne sais pas combien <strong>de</strong> temps il y a travaillé. J’avais aux alentours <strong>de</strong><br />
7-8 ans à l’époque. Quand il partait, on y al<strong>la</strong>it, on lui disait au revoir.<br />
On le revoyait… Un jour, maman nous dit « Papa revient », voilà on est<br />
contents ! C’est tout ce que je sais par rapport à son travail. Je pense<br />
qu’il était simple ouvrier <strong>de</strong> maintenance sur le site. Quand mon père<br />
s’en al<strong>la</strong>it ça faisait un vi<strong>de</strong> quand même. Ca faisait un grand vi<strong>de</strong> car je<br />
ne voyais que ma sœur et ma mère. »<br />
Marc explique comment se posait <strong>la</strong> question du temps <strong>de</strong> ses parents<br />
et il tente d’en tirer quelques recommandations pour <strong>la</strong> jeunesse :<br />
« Quand on proposait un poste à Moruroa, nos parents vont dire tout<br />
<strong>de</strong> suite oui, le sa<strong>la</strong>ire y est, ça permet <strong>de</strong> faire vivre le foyer. Mais ils ne<br />
se tracassaient pas du nucléaire, <strong>de</strong>s conséquences sur l’environnement,<br />
sur <strong>la</strong> personne… Ils n’avaient pas les mêmes connaissances,<br />
les mêmes informations que nous probablement. Donc les choix qu’ils<br />
ont faits, je ne sais pas s’ils les assument, mais l’important <strong>de</strong> les reconnaître.<br />
On ne peut pas leur rejeter tort, ils prenaient comme ça venait.<br />
Maintenant, je pense que c’est un grand travail que les générations<br />
futures doivent faire, faire un travail <strong>de</strong> mémoire pour nos parents qui<br />
n’ont pas eu <strong>la</strong> possibilité d’acquérir cette connaissance. En tant que<br />
jeune, on a ce <strong>de</strong>voir envers nos aînés <strong>de</strong> faire ce travail <strong>de</strong> recherche,<br />
<strong>de</strong> militantisme, d’information sur les essais nucléaires. Pas pour accuser<br />
nos parents, mais pour leur faire prendre conscience et leur faire<br />
connaître ce que <strong>la</strong> société <strong>de</strong> leur époque a malheureusement eu<br />
comme conséquence sur <strong>la</strong> société actuelle. »<br />
«<br />
»<br />
62 63
Chantal Spitz<br />
Ecrivain.<br />
Chantal Spitz décrit ses premières expériences <strong>de</strong> manifestante contre<br />
les essais nucléaires : « Quand je suis rentrée à <strong>la</strong> maison, je me<br />
suis un peu fait sonner les cloches quand même… parce que c’était<br />
pas <strong>de</strong>s comportements tolérables pour cette aristo-bourgeoisie qui<br />
domine. »<br />
Après avoir longuement évoqué <strong>la</strong> sombre connivence d’une certaine<br />
société polynésienne avec le système colonial puis le CEP, l’auteur<br />
résume <strong>la</strong> douleur <strong>de</strong> son peuple : « On vient <strong>de</strong> vivre 30 années<br />
tellement terrifiantes que je ne sais pas si on va s’en remettre un jour<br />
et ce qui me fait peur c’est qu’on va passer toute cette douleur à nos<br />
enfants, nos petits-enfants, parce qu’on n’aura pas eu d’outils et <strong>de</strong>s<br />
moyens pour traverser cette histoire. » Et <strong>de</strong> préciser : « Je crois qu’on<br />
peut mesurer les dégâts <strong>de</strong> l’environnement, éventuellement, on fait<br />
<strong>de</strong>s mesures, on prend tel taux <strong>de</strong> radioactivité, les coraux morts,<br />
pas <strong>de</strong> problème… Les dégâts dans les têtes et dans les âmes on<br />
fait comment On ne peut pas mesurer et on ne peut même pas<br />
s’empêcher <strong>de</strong> les transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants ».<br />
Chantal Spitz termine cependant avec cette note <strong>de</strong> fierté : « Mais<br />
c’était déjà grand <strong>de</strong> marcher ! En tout cas, les premières marches,<br />
c’est vraiment grand <strong>de</strong> marcher. C’était, je ne veux pas dire courageux,<br />
mais, il fal<strong>la</strong>it le faire. Je dis, il fal<strong>la</strong>it oser le faire ! »<br />
Message d’espoir et <strong>de</strong> dignité adressé aux jeunes générations <br />
«<br />
»<br />
64 65
Jacky Bryant<br />
Ecologiste, fondateur <strong>de</strong> Heiura les Verts<br />
Jacky Bryant avait 6 ou 7 ans quand il a entendu parler <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe<br />
pour <strong>la</strong> première fois. Puis, dit-il : «Quand j’ai commencé le métier d’enseignant<br />
dans les années 75, il n’était pas bon <strong>de</strong> s’afficher comme<br />
un antinucléaire, comme un écologiste. C’était toujours pointé du doigt<br />
comme <strong>de</strong>s emmer<strong>de</strong>urs, <strong>de</strong>s contestataires ou <strong>de</strong>s gens manipulés ! »<br />
Adhérent à ce moment à l’association Ia ora te natura, il précise : «<br />
J’avais beaucoup apprécié l’approche parce que c’était une remise<br />
en question <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité, d’une vision culturelle d’un pays et que le<br />
nucléaire était le sujet qui nous permettait d’entrer dans ce débat. »<br />
Il déci<strong>de</strong> aussi <strong>de</strong> s’engager en politique au Ia Mana te Nunaa : « Je<br />
prends véritablement conscience du choix en politique, d’un pays qui<br />
fait son choix entre <strong>la</strong> gauche et <strong>la</strong> droite, entre <strong>la</strong> solidarité et le libéralisme.<br />
Donc toute cette construction politique s’est fondée au départ<br />
d’un engagement antinucléaire. Tout simplement parce que <strong>de</strong>rrière<br />
l’affichage <strong>de</strong> <strong>la</strong> sûreté nationale, <strong>de</strong> l’armement qui al<strong>la</strong>it protéger <strong>la</strong><br />
République, les montants qui étaient reversés à <strong>la</strong> Polynésie auraient<br />
pu construire <strong>la</strong> Polynésie <strong>de</strong> manière beaucoup plus juste et beaucoup<br />
plus solidaire. Or, on s’est rendu compte que l’argent qui arrivait<br />
al<strong>la</strong>it toujours dans <strong>la</strong> poche <strong>de</strong>s mêmes personnes. Pour ma part,<br />
c’était quelque chose <strong>de</strong> très révoltant, cette espèce <strong>de</strong> fracture sociale<br />
mais qui pouvait être facilement achetée puisqu’il suffisait d’arroser. »<br />
«<br />
Jacky Bryant est conscient qu’aujourd’hui, <strong>la</strong> jeunesse <strong>de</strong> ce pays a<br />
besoin d’un « personnage historique » auquel se référer : « Peut-être<br />
qu’au travers <strong>de</strong> ce futur Centre <strong>de</strong> mémoire, le nucléaire va <strong>de</strong>venir<br />
ce ‘personnage historique’, si je peux utiliser le terme, dont un peuple<br />
a besoin. Un pays, une jeunesse, a besoin d’un référent historique,<br />
c’est absolument nécessaire. On ne peut pas construire l’avenir si on<br />
n’a pas ce référent. »<br />
»<br />
66 67
Ro<strong>la</strong>nd Oldham<br />
Ro<strong>la</strong>nd Oldham est prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’association Moruroa e tatou <strong>de</strong>puis<br />
sa création en 2001. Il se souvient d’avoir milité contre les essais<br />
nucléaires quand il avait 16 ans.<br />
Ro<strong>la</strong>nd Oldham est bien connu pour son jugement sévère sur les<br />
hommes politiques <strong>de</strong> ce pays qui se sont <strong>la</strong>issés corrompre par l’argent<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe : « Beaucoup <strong>de</strong> nos déci<strong>de</strong>urs, justement à cause<br />
<strong>de</strong> ce gain d’argent, ont participé à cette aventure. Même s’ils avaient<br />
<strong>de</strong>s doutes, c’est vrai que l’argent était assez convaincant et les rares<br />
hommes politiques qui se sont opposés aux essais nucléaires ont eu<br />
<strong>de</strong>s mésaventures avec l’Etat français. »<br />
Il dénonce le pouvoir <strong>de</strong> persuasion <strong>de</strong> l’Etat : « Il faut comprendre<br />
qu’il y a une machine <strong>de</strong> propagan<strong>de</strong> qui était très puissante. Et je me<br />
rappelle, il y a déjà 10 ans <strong>de</strong> ce<strong>la</strong>, que parler <strong>de</strong>s essais nucléaires<br />
aux journalistes, c’était très difficile. Le len<strong>de</strong>main matin ceux qui<br />
osaient parler <strong>de</strong>s essais nucléaires, étaient ratatinés dans <strong>la</strong> presse<br />
comme pas possible. Donc, il faut admettre les choses comme elles<br />
sont : cette machine était tellement forte que les hommes politiques,<br />
et même le pouvoir religieux ici en Polynésie, ont adhéré aux essais<br />
parce qu’on voyait plutôt les retombées économiques importantes<br />
mais justement ce sont ces retombées économiques qui ont bouleversé<br />
<strong>la</strong> société polynésienne. »<br />
Il poursuit : « L’Etat a utilisé une formule qui a bien marché pendant<br />
40 ans, c’est-à-dire, on achète et puis on fait les essais nucléaires, les<br />
gens ferment les yeux et on a adhère au mensonge. Aujourd’hui, j’ai<br />
l’impression que l’Etat utilise cette même formule qui marche. Quand<br />
on voit nos hommes politiques profiter <strong>de</strong> <strong>la</strong> vague, du travail qui a<br />
été effectué par les associations, non pas pour que les victimes soient<br />
in<strong>de</strong>mnisées, mais pour aller voir l’Etat français négocier plus d’argent<br />
pour une politique sans projet pour <strong>la</strong> Polynésie. »<br />
«<br />
Ro<strong>la</strong>nd Oldham a conscience qu’il faudra plusieurs générations pour<br />
continuer le combat contre les conséquences <strong>de</strong>s essais nucléaires<br />
et qu’il faut maintenant s’adresser aux jeunes générations : « Quand<br />
on pense qu’il y a eu près <strong>de</strong> 150 essais souterrains à Moruroa et<br />
Fangataufa, je pense que c’est <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> concentration d’essais<br />
nucléaires sur un atoll aussi petit. On est là à se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r ce qu’il en<br />
sera <strong>de</strong> l’avenir, puisqu’il y a déjà <strong>de</strong>s fuites et qu’une bonne partie <strong>de</strong><br />
l’atoll <strong>de</strong> Moruroa s’effondre. Il y a <strong>de</strong>s vrais dangers qui concernent<br />
<strong>de</strong>s générations et <strong>de</strong>s générations. Et je pense que l’un <strong>de</strong>s combats<br />
les plus importants <strong>de</strong> Moruroa e tatou sera <strong>de</strong> faire adhérer nos<br />
jeunes générations à ce combat-là. »<br />
»<br />
68 69
Hommage<br />
Marie-Thérèse Danielsson<br />
Marie-Thérèse et Bengt Danielsson ont vécu à Tahiti au temps <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> préparation et <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion du Centre d’Expérimentation du<br />
Pacifique au début <strong>de</strong>s années 1960 et ils y ont pratiquement passé<br />
tout le reste <strong>de</strong> leur vie. Ethnologue et écrivain suédois, Bengt avait<br />
débarqué en Polynésie en 1947 sur le ra<strong>de</strong>au du Kon Tiki. Installé à<br />
Paea, le couple accueil<strong>la</strong>it les écrivains, artistes, hommes politiques<br />
et militants du mon<strong>de</strong> entier <strong>de</strong> passage à Tahiti. Marie-Thérèse<br />
avait en charge <strong>la</strong> convivialité et les re<strong>la</strong>tions extérieures du couple.<br />
Elle avait su nouer <strong>de</strong>s soli<strong>de</strong>s amitiés avec les personnalités politiques<br />
polynésiennes qui souvent, s’interrogeaient sur les risques<br />
<strong>de</strong>s expériences nucléaires.<br />
Le premier livre, co-signé par Bengt et Marie Thérèse Danielsson, sur<br />
les essais nucléaires « Moruroa mon amour » publié en 1974, est un<br />
véritable réquisitoire sur le comportement <strong>de</strong> l’Etat français à l’égard<br />
<strong>de</strong>s Polynésiens pour imposer ses expériences atomiques. Ce livre eut<br />
un retentissement mondial tel qu’il contribua sans aucun doute à <strong>la</strong><br />
décision du Prési<strong>de</strong>nt Giscard d’Estaing <strong>de</strong> renoncer, l’année suivante,<br />
aux essais aériens. A Tahiti, alors que <strong>la</strong> presse était muselée et que<br />
les flots d’argent déversés obscurcissaient bien <strong>de</strong>s consciences, les<br />
Danielsson exprimaient in<strong>la</strong>ssablement leur opposition aux essais, ce<br />
qui leur valut <strong>de</strong> nombreuses mesures vexatoires <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong><br />
l’Etat français. De nationalité suédoise et consul <strong>de</strong> Suè<strong>de</strong> en Polynésie,<br />
Bengt Danielsson fut même déchargé <strong>de</strong> ce poste à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s autorités françaises !<br />
Au fil <strong>de</strong>s années, Marie-Thérèse fut l’ambassadrice et l’infatigable<br />
globe-trotter <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte <strong>de</strong>s Polynésiens et <strong>de</strong>s peuples du Pacifique<br />
contre les armes nucléaires. Elle était connue dans le mon<strong>de</strong> entier<br />
comme une femme engagée « pour <strong>la</strong> paix et <strong>la</strong> liberté ». Prési<strong>de</strong>nte<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Ligue polynésienne <strong>de</strong>s femmes pour <strong>la</strong> paix et <strong>la</strong> liberté, elle<br />
fut invitée à Moscou - reçue par Mikhaïl Gorbatchev -, à Pékin, à Dili<br />
(Timor Oriental) lors du récent conflit d’indépendance, en Australie,<br />
en Nouvelle-Zé<strong>la</strong>n<strong>de</strong>, aux Etats-Unis et dans <strong>de</strong> nombreux pays<br />
d’Europe. En 1991, le couple Danielsson, aux côtés <strong>de</strong> Jeton Enjain<br />
sénateur <strong>de</strong> Ronge<strong>la</strong>p <strong>de</strong>s Iles Marshall, reçurent <strong>de</strong>s mains du roi<br />
<strong>de</strong> Suè<strong>de</strong> le prix Nobel alternatif « Right Livelihood Award » pour leur<br />
action en faveur <strong>de</strong>s peuples victimes <strong>de</strong>s essais nucléaires. En 2001,<br />
Marie-Thérèse Danielsson et son amie Tetua Doom, étaient présentes<br />
au temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong> Moruroa e tatou, l’association <strong>de</strong>s anciens<br />
travailleurs <strong>de</strong> Moruroa.<br />
Marie-Thérèse s’est toujours rangée aux côtés <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong>s<br />
essais nucléaires. Non sans raison. En effet, <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> sa fille unique<br />
Maruia, décédée <strong>de</strong>s suites d’un cancer alors qu’elle avait vingt ans,<br />
est restée comme une ombre tout au long <strong>de</strong> sa vie. Comme beaucoup<br />
<strong>de</strong> familles polynésiennes dont elle a partagé les tragiques douleurs,<br />
Marie-Thérèse était convaincue <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
<strong>de</strong> sa fille et <strong>la</strong> radioactivité dispersée par les essais nucléaires qui ont<br />
pollué <strong>de</strong>s archipels <strong>de</strong> <strong>la</strong> Polynésie.<br />
Marie-Thérèse Danielsson est décédée en février 2002, quelques<br />
années après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> son mari en 1997. Elle reste présente à<br />
notre mémoire comme <strong>la</strong> sentinelle vigi<strong>la</strong>nte qui aura su nous alerter<br />
<strong>de</strong>s dangers <strong>de</strong>s essais nucléaires pour le présent et pour les générations<br />
futures. Avec son mari Bengt, elle n’aura certes pas été seule à<br />
réagir, mais sans son action persévérante étendue au mon<strong>de</strong> entier, le<br />
cri <strong>de</strong>s Polynésiens contre les essais français n’aurait peut-être jamais<br />
été entendu avec autant <strong>de</strong> force et sans autant d’écho pour que les<br />
droits <strong>de</strong>s victimes soient enfin reconnus.<br />
B B<br />
70 71
Souscription<br />
Un livre-album « Témoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe »<br />
Les portraits photographiques et l’intégrale <strong>de</strong>s interviewes filmées vont être<br />
publiés dans un livre album intitulé « Témoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe » édité par Univers<br />
Polynésiens.<br />
D’une centaine <strong>de</strong> pages, en format (21 X 29,7) à l’italienne et couverture<br />
cartonnée, ce livre <strong>de</strong> mémoire comportera les portraits noir et b<strong>la</strong>nc <strong>de</strong><br />
Marie-Hélène Villierme et les récits intégraux recueillis par Arnaud Hu<strong>de</strong>lot<br />
seront illustrés par <strong>de</strong>s photos couleurs du tournage <strong>de</strong> Marie-Hélène Villierme<br />
et <strong>de</strong> Tenahe Faatau.<br />
Quelques pages complèteront l’information du lecteur avec <strong>de</strong>s documents<br />
- cartes, photos d’époque, tableaux, exposés sommaires - nécessaires à<br />
<strong>la</strong> bonne compréhension <strong>de</strong>s témoignages dans le contexte <strong>de</strong>s 30 années<br />
d’essais nucléaires en Polynésie française.<br />
Le prix <strong>de</strong> souscription <strong>de</strong> ce livre album « Témoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe » est <strong>de</strong><br />
4000 F cfp.<br />
Dès sa diffusion en librairie, son prix <strong>de</strong> vente sera augmenté.<br />
La sortie publique est prévue pour mars 2012.<br />
Formu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> Bon <strong>de</strong> souscription<br />
M. Mme…………………………………………….<br />
Adresse …………………………………………….<br />
Tél ou email ………………………………………..<br />
Souscrit pour……. exemp<strong>la</strong>ire(s) du livre « Témoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> bombe » à<br />
4 000 Fcfp l’unité.<br />
Ci-joint un chèque <strong>de</strong> ……………<br />
Découper ou recopier le formu<strong>la</strong>ire et adresser-le, avec votre chèque, à :<br />
Univers Polynésiens<br />
BP 21 768 98713 PAPEETE<br />
Tahiti - Polynésie Française<br />
Pour les virements :<br />
Univers Polynésiens<br />
Banque <strong>de</strong> POLYNESIE<br />
Agence Bruat<br />
Po Box 530 - 98 713 Papeete - TAHITI<br />
Co<strong>de</strong> banque: 12149<br />
Co<strong>de</strong> guichet: 06732<br />
N° compte: 32002338381<br />
Clé RIB: 23<br />
Co<strong>de</strong> IBAN : FR76 12149 06732 32002338381 23<br />
BIC - Adresse SWIFT : BPOLPFTP<br />
72