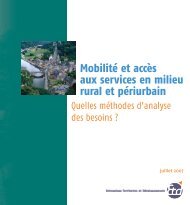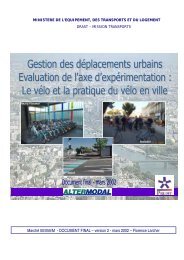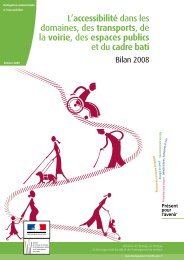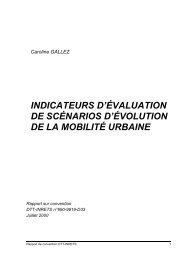PROJET «AVEA» - Club innovations transports des collectivités
PROJET «AVEA» - Club innovations transports des collectivités
PROJET «AVEA» - Club innovations transports des collectivités
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ANALYSE DE LA DEMANDE<br />
ETUDE DE MARCHE<br />
EPFL - LEM<br />
LOGISTIQUE, ECONOMIE, MANAGEMENT<br />
CH - 1015 LAUSANNE<br />
Tél.: 00 41 21 693 24 65 Fax: 00 41 21 693 50 60<br />
RAPPORT<br />
ENQUÊTES « AVEA »<br />
<strong>PROJET</strong> <strong>«AVEA»</strong><br />
O. Benmoussa<br />
Lausanne, 15.06.01<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 1<br />
ÉCOLE POLYTECHNIQUE<br />
FÉDÉRALE DE LAUSANNE
NOTE PRELIMINAIRE<br />
Des entretiens semi-directifs (entre 1 heure et 1h30 par établissement) ont été réalisés<br />
dans une cinquantaine d’entreprises, généralement avec les responsables du transport et<br />
de la logistique. L’objectif de ces entretiens était de rassembler <strong>des</strong> informations<br />
qualitatives et quantitatives sur les thèmes suivants :<br />
- caractéristiques générales de l’établissement ou de l’entreprise enquêtée (taille,<br />
localisation …)<br />
- produits et processus de production (produits, gammes, équipements …)<br />
- caractéristiques de la demande (clients, marché en terme de volume …)<br />
- relation avec les clients, les fournisseurs et les sous-traitants (flux de<br />
marchandises, moyens de communication …)<br />
- stocks (niveau <strong>des</strong> stocks d’entrants et de produits finis, localisation, temps de<br />
livraison …)<br />
- organisation du transport de marchandises (transport générique ou spécialisé,<br />
contraintes spécifiques, effectué en compte propre ou sous-traité, partage modal)<br />
- stratégie logistique (interne ou sous-traitance …)<br />
- localisation sur le réseau d’infrastructures.<br />
Les informations collectées lors de ces entretiens ont été complétées, dans la mesure du<br />
possible, grâce à d’autres sources : publications, étu<strong>des</strong> sectorielles, entretiens avec <strong>des</strong><br />
organisations professionnelles et <strong>des</strong> administrations territoriales.<br />
Ci-<strong>des</strong>sous la liste <strong>des</strong> transporteurs, levageurs et commissionnaires de transport ayant<br />
participé aux entretiens :<br />
- EDF SETRAL Service Transport Lourd - M. POMMERY - Chargé d'affaires<br />
- EDF SETRAL - M. PETTRE - Chef adjoint d’agence<br />
- TRANSEST - M. MALIVERNEY - Technico-commercial Affrètement Fluvial<br />
- SAFCOMAR - M. NOIR - Conseiller en <strong>transports</strong> internationaux<br />
- SERMAT DANZAS - M. GRASSET GOTHON - Chargé d'affaires<br />
- PANALPINA - M. HEDINGER - M. TOBLER - Vice-président et Chargé d’affaires<br />
- SCAC/SDV - M. LAPIERRE - M. OLLIVIER - Directeurs<br />
- PONTICELLI - M. MILLER - Chargé d'affaires<br />
- CP TRANS - M. BENCHABANE - Mme VINANT - Chargé d'étu<strong>des</strong><br />
- FOSTRANS - M. GOMILA<br />
- FOSTRANS (MANNESMANN) - M. YOURIEFF<br />
- MEDIACO MAXILIFT - M. CHAUVOT<br />
- MONTALEV LEVAGE - M. BILLARD - Directeur adjoint<br />
- VAN SEMEUREN/MAMMOET - M. VAN SEMEUREN - M. STOOF - Présidents<br />
- CAPELLE / SCALES - M. CAPELLE - Directeur du site d’Alès<br />
- GROUPE CAT RENAULT - M. LUCE - Responsable <strong>des</strong> dépannages<br />
- MORBILLANAISE DE NAVIGATION - M. LE GALL - Responsable <strong>des</strong> affrètements<br />
- FORTRANS SHIPPING - M. JOURDAN - Directeur d’exploitation<br />
- FRIDERICI SA - André FRIDERICI - Directeur, administrateur<br />
- GROUPE CAT - M. TIREAU - M. LE PARCO - Chargé d’étu<strong>des</strong><br />
- CARGOLUX - M. ZENNER - Chargé d’étu<strong>des</strong><br />
- ZIMEX AVIATION - M. SCHMED - Directeur <strong>des</strong> opérations aériennes<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 2
Par ailleurs, on présente ci-après la liste <strong>des</strong> chargeurs potentiels de l’AVEA ayant accepté<br />
de répondre au questionnaire proposé.<br />
AERONAUTIQUE - AEROSPATIAL<br />
- AIRBUS INDUSTRIE - M. MORALES - Responsable transport<br />
- ARIANE ESPACE - M. AUDOUIN - Responsable transport<br />
- ARIANE ESPACE - M. C0LLET - Chef de production opérationnelle<br />
- STARSEM - M. D. TAC VORIAN – Satellites<br />
- APCO – M. BODEN – Directeur commercial<br />
CONSTRUCTION ET MATERIEL MINIER<br />
- LIEBHERR - M. CONRAD - Chef du service transport<br />
- CATERPILLAR – M. APPELS – Directeur logistique Europe<br />
- SPIE BATIGNOLLES - M. ROCHER - Directeur technique<br />
- LA MAISON TRANSPORTABLE - M. MALIE ET M. TREGUILLY - Directeur Général et<br />
Responsable transport<br />
- ELECTROWATT - M. TURI - Ingénieur<br />
- SPIE BATIGNOLLES - M. RICHARD - Etude et conseil de chantier<br />
- BOUYGUES TP – M. JACQUET – Directeur technique adjoint<br />
- GTM - M. COUSIN – M. DEMILCAMPS - Directeurs<br />
- EIFFEL CONSTRUCTION – M. DZIMIRA – Responsable transport<br />
- SETRA - MME ABEL MICHEL - Chef du centre technique <strong>des</strong> ouvrages d'art<br />
- BONNARD ET GARDEL – M. EPARS – Membre de la DG<br />
- LOSINGER - M. REROLLE - Directeur technique<br />
- FREY & ASSOCIES - M. FREY – Directeur<br />
- AMSLER & BOMBELI - M. BOMBELI – Directeur<br />
- RAZEL FRERES – M. BOUDOT – Directeur de projet<br />
- ZWAHLEN & MAYR – M. FLUCKIGER – Fondé de pouvoir<br />
- VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION – M. VERVAET – Directeur commercial<br />
- DIC – M. DAUNER – Directeur<br />
- TUCHSCHMID ENGINEERING – M. KERN – Ingénieur<br />
- PRELCO - M. RINALDI – Directeur<br />
- BOCA - M. BARBEAU - Directeur<br />
- SGE – M. FORTIER – Directeur technique adjoint<br />
EQUIPEMENT INDUSTRIEL - ENERGIE<br />
- GE ENERGY PRODUCTS – M. MALAVAL – Réalisation transport<br />
- VA TECH HYDRO – M. Kaufmann – Ingénieur Etu<strong>des</strong><br />
- FRAMATOME – M. PELLEGRY – Responsable transport<br />
- GROUPE CNIM - M. MONTAL - Service logistique transport<br />
- FIRE POWER ENTREPOSE – M. GERARD - M. BLANC - Directeur et Ingénieur<br />
- NFM TECHNOLOGY - M. LAMBERT – M. RINGOT – Directeur <strong>des</strong> achats et Ingénieur<br />
Etu<strong>des</strong><br />
- AIR LIQUIDE – M.DEHAINE – Responsable service expédition<br />
- THERMONDYN - M. GOULVEN – Responsable transport<br />
- ALSTOM – M. BERNARD – M. BOUCHET BERT MANOZ – M. BERTHET -<br />
Responsables transport et Chef de conception transformateurs<br />
- VALOREM – M. LE LANN - Chargé d'affaires – Marché <strong>des</strong> éoliennes<br />
- HYDRO QUEBEC ET SOCIETE D’ENERGIE DE LA BAIE JAMES – M. COLASURDO –<br />
Directeurs-Projets<br />
- WARTSILA NSD – M. JENZER – Directeur technique<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 3
PETROLIER/PARA-PETROLIER<br />
- BOUYGUES OFF-SHORE – M. JUHEL – Responsable transport<br />
- TECHNIP – M. MAC TAGGART - Responsable transport<br />
HUMANITAIRE<br />
- OCHA – M. DE MONTRAVEL – M. BALABANOV - Chef du groupement <strong>des</strong> ressources<br />
militaire et protection civile<br />
- Programme Alimentaire Mondial – M. KEUSTERS – Responsable opérations<br />
- CNUCED – M. HUNTER – Chef de division<br />
- CICR - M. SCHNIDER – M. SCHAFFNER - Responsable logistique et opérations<br />
aériennes<br />
- MSF - M. DAL - Responsable logistique<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 4
Fiche 1 :<br />
18/11/1999<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Commissionnaire de transport<br />
I/ La situation actuelle du transport exceptionnel par route :<br />
Acheminer un colis lourd d’un point A à un point B ne pose pas en soi de gran<strong>des</strong> difficultés.<br />
Par contre, la configuration <strong>des</strong> routes (sinuosité, carrefours, giratoires à l’entrée <strong>des</strong><br />
localités, gabarit et résistance <strong>des</strong> ouvrages d’art…) ainsi que la réglementation existante du<br />
transport exceptionnel par route (demande d’autorisation et délais, limitations…) le rende de<br />
plus en plus délicat à préparer et de surcroît à prévoir, ce qui implique <strong>des</strong> risques financiers<br />
conséquents.<br />
De ce fait, la plupart <strong>des</strong> entreprises manipulant <strong>des</strong> pièces lour<strong>des</strong> se concentrent à<br />
proximité <strong>des</strong> voies d’eau.<br />
II/ L’AVEA :<br />
Dans sa configuration actuelle, il serait plutôt utilisé comme engin de manutention,<br />
moyennant un positionnement aussi performant, si ce n’est plus, qu’une grue et non pas<br />
pour le transport, de surcroît de longue distance, compte tenue de sa forme non<br />
aérodynamique.<br />
En outre, ce commissionnaire penserait au lancement au départ de deux configurations :<br />
- une pouvant transporter jusqu’à 200 tonnes<br />
- et une autre apte transporter 500 tonnes.<br />
De plus, l’entreprise propose la constitution d’une cellule d’étude type composée au moins<br />
<strong>des</strong> profils suivants : un pilote de dirigeable, un transporteur, un manutentionnaire, un<br />
industriel, un responsable de la réglementation, Aérospatiale en tant que bureau technique<br />
et un décideur. Parallèlement à cette cellule, <strong>des</strong> travaux seraient également menés au sein<br />
d’un comité <strong>des</strong> usagers pour arriver à finaliser un concept qui satisfasse un maximum de<br />
corps de métiers, utilisateurs déclarés de l’AVEA.<br />
III/ Le marché :<br />
Moyennant une configuration plus aérodynamique et un positionnement précis en tant<br />
qu’engin de manutention, l’AVEA pourra s’emparer d’une grande part du transport<br />
exceptionnel effectué actuellement par voie fluvio-maritime ou aérienne.<br />
Selon <strong>des</strong> prévisions, le report modal de l’avion vers l’AVEA peut avoisiner les 50% et celui<br />
du fluvio-maritime vers l’AVEA, quelques pour-cent qui représentent néanmoins un gros<br />
chiffre d’affaires compte tenu du volume total du transport de colis lourds par voie d’eau. De<br />
plus, il serait intéressant de contracter un partenariat avec les armateurs qui verraient, en<br />
l’AVEA, un moyen de transport complémentaire plutôt que concurrentiel du navire,<br />
contrairement aux exploitants du rail et de l’avion. On pourrait même s’attendre à <strong>des</strong><br />
acquisitions d’AVEA de la part de certaines compagnies maritimes.<br />
Concernant, le transport exceptionnel par route, celui-ci sera pratiquement incontournable<br />
pour les opérations terminales qui peuvent être <strong>des</strong> trajets de quelques centaines de mètres,<br />
d’où deux ruptures de charges :<br />
- la première se situant à l’emport initial de la marchandise au niveau du transbordement<br />
remorque-AVEA<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 5
- la seconde se situant au niveau du transbordement AVEA-remorque près du site final de<br />
livraison.<br />
IV/ Quelques opérations-types où l’AVEA peut être utilisé :<br />
1. Soit un transport d’une turbine hydroélectrique de 150 à 200 tonnes pour le Chili.<br />
Ce transport nécessite un coût d’ « aménagement » routier en ce qui concerne la<br />
reconstruction <strong>des</strong> ponts, le relevage de fils électriques…qui constituent autant de coûts<br />
annexes qu’imprévisibles car ils ne peuvent pas toujours être perçus à l’avance, ce qui<br />
gêne quelque peu le coût prévisionnel <strong>des</strong> opérations facturées par les entreprisesfournisseurs<br />
qui désirent obtenir un prix au m 3 de la part de leur commissionnaire pour<br />
pouvoir les budgétiser.<br />
En intégrant ces aspects, l’AVEA, plus sûre, serait tout à fait concurrentiel par rapport<br />
aux moyens traditionnels et générerait même <strong>des</strong> gains.<br />
2. Un autre exemple concerne l’acheminement d’un ensemble turbine (220 tonnes) +<br />
alternateur (195 tonnes) + groupe auxiliaire de démarrage (48 tonnes) de Belfort à<br />
Saint-Ouen où un portique lourd existe pour le déchargement au moyen notamment<br />
de vérins et de lits de roulement.<br />
Cet ensemble va donc emprunter le transport par route de Belfort à Strasbourg puis par<br />
voie d’eau de Strasbourg à Rotterdam puis Saint-Ouen, où il y aura un transport terminal<br />
routier.<br />
En détaillant les coûts, on arrive à :<br />
- 305'000 FF pour le transport et les manutentions terminales sur le trajet Belfort-<br />
Strasbourg,<br />
- 270'000 FF pour le transbordement et le reste du trajet jusqu’à Saint-Ouen,<br />
- 200'000 FF pour le déchargement au port de Saint-Ouen,<br />
- 80'000 FF pour arriver au site final de livraison,<br />
- 85'000 FF pour le déchargement sur site,<br />
- 90'000 FF pour l’emplacement à l’endroit requis ( coût du ripage et du vérinage).<br />
Soit, en totalité, un coût d’opération de 1,03 millions de francs français, et ce pour une<br />
opération ne nécessitant pas une mise à niveau du matériel à l’emplacement final (pas<br />
de fosse, les opérations ayant été effectuées au niveau du terrain ; dans le cas contraire,<br />
on pourrait s’attendre à un surcoût de l’ordre de 200'000 FF ).<br />
L’AVEA, même avec un coût de 4FF/t.km, ferait la même opération en une journée et à<br />
un coût global de 670'000 FF, d’où le gain financier directement percevable auquel<br />
s’ajoute le gain provenant <strong>des</strong> immobilisations écourtées.<br />
3. Un autre exemple concerne l’affrètement d’un Boeing 747 qui coûte, pour un trajet<br />
Suisse-côte ouest <strong>des</strong> Etats-Unis, une bagatelle de 1 millions de FF pour 100 tonnes<br />
seulement. Là, on voit encore l’utilisation, on ne peut plus intéressante, de l’AVEA.<br />
En effet, un transport de 500 tonnes exigerait une somme de 5 millions de FF à<br />
laquelle il faudra ajouter les coûts d’entreposage au niveau <strong>des</strong> aéroports de départ<br />
et d’arrivée, et les coûts d’acheminement sur site final.<br />
L’AVEA, de porte à porte pratiquement, sera quasiment plus rapide que l’avion et<br />
beaucoup moins cher.<br />
4. L’AVEA pourrait faire aussi du groupage, transportant simultanément <strong>des</strong> charges<br />
lour<strong>des</strong> et de la marchandise générale lorsque de la place est disponible, et ceci<br />
surtout pour les trajets de retour de livraison ce qui permettra d’éviter les retours à<br />
vide et de proposer <strong>des</strong> tarifs plus attrayants.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 6
D’un point de vue purement industriel, on assistera également avec l’AVEA à une<br />
modification du processus de production dans la mesure où l’on produira autrement, avec un<br />
niveau de qualité meilleures car toutes les opérations d’assemblage et de contrôle se feront<br />
en usine pour la plupart <strong>des</strong> industries <strong>des</strong> pièces et <strong>des</strong> machines plus volumineuses et par<br />
suite plus performantes.<br />
On prendra comme exemple la fabrication de transformateurs d’une masse d’environ 90<br />
tonnes qui, en raison de chocs pouvant se produire pendant le transport, sont modularisés :<br />
on enlève l’huile de fonctionnement et le conditionneur qu’on transporte à part, ce qui génère<br />
<strong>des</strong> coûts supplémentaires auxquels vont s’ajouter les coûts de réassemblage et de test du<br />
matériel sur site. Avec l’AVEA, et moyennant une fiabilité et une sécurité de transport<br />
appropriées (absence de chocs), on pourra transporter le tout d’un seul bloc, supprimant les<br />
opérations de désassemblage en usine, de transport de l’huile et du conditionneur et de<br />
réassemblage sur site, en plus d’une disponibilité plus rapide du matériel.<br />
En conclusion de l’entretien, il ressort un besoin pressant de finalisation du concept pour<br />
pouvoir définir plus précisément les conditions d’exploitation et prendre une décision finale<br />
quant à l’utilisation ou pas de l’AVEA, en complément <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> existants ou en<br />
remplacement de certains.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 7
Fiche 2 :<br />
23/11/1999<br />
Implantation : Région de Toulouse<br />
Secteur d’activité retenue : Construction de maisons moyenne gamme pré-fabriquées et<br />
équipées en usine<br />
Il s’agit d’une entreprise familiale créée, sous sa forme actuelle, au début <strong>des</strong> années 1980.<br />
Site de production<br />
I/ Présentation de l’entreprise :<br />
Entièrement préconstruites en usine suivant un procédé totalement inédit d’assemblage, les<br />
maisons sont bâties «étape par étape», en béton armé vibré, identique à celui utilisé pour les<br />
ouvrages d’art, sur la chaîne de construction à l’abri <strong>des</strong> intempéries et de l’humidité.<br />
«L’entreprise en question réalise actuellement, en usine, <strong>des</strong> maisons de 57 m 2 à 120 m 2 ,<br />
avec une capacité de deux par semaine, et que l’on transporte par modules sur site où ils<br />
sont réassemblés.<br />
C’est actuellement la seule entreprise en France à intervenir dans un tel marché. 120<br />
maisons sont construites en moyenne par an et plus de 1'500 ont été réalisées depuis 17<br />
ans.<br />
On présente ci-après les étapes clés de la production, et l’on verra comment l’AVEA pourrait<br />
modifier ce processus.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 8
A l’acheminement succède la livraison et donc la mise en place sur site qui s’effectue grâce<br />
à un chenillard spécialement conçu pour acheminer la maison sur tout type de terrain<br />
accessible en voiture.<br />
Avec l’AVEA, les opérations d’assemblage sur la chaîne de construction seront simplifiées<br />
dans la mesure où l’on ne modularise pratiquement plus les maisons, ce qui diminue les<br />
coûts (moins de jointoyage, de problèmes d’étanchéité, plus de doubles murs…), engendre<br />
un gain de temps et procure une plus grande marge de manœuvre dans le style et<br />
l’architecture octroyés à la maison (maisons sur deux niveaux, à architecture plus<br />
complexe…). De plus, l’AVEA permettra d’avoir moins de personnel au niveau du poste<br />
d’assemblage<br />
L’opération de découplage sur site, pour permettre le transport <strong>des</strong> maisons, sera éliminé et<br />
à l’origine d’un gain de temps non négligeable.<br />
Enfin, l’opération de livraison et de mise en place sur site sera grandement facilitée et<br />
écourtée, surtout si l’on arrive à positionner l’AVEA de manière très précise au-<strong>des</strong>sus de la<br />
zone désirée. De même, toutes les opérations de finition sur place disparaîtront et se feront<br />
entièrement en usine d’où un gain en qualité et moins de risque de détérioration sur site à la<br />
suite de nombreuses manipulations délicates.<br />
Les travaux de fondation seront aussi simplifiés car on pourra concevoir <strong>des</strong> maisons avec<br />
radier général intégré qu’on posera directement sur un terrain préalablement terrassé et<br />
recouvert d’une couche de polystyrène qui rend la pose de la maison par l’AVEA plus souple<br />
et améliore en même temps l’étanchéité.<br />
Cette modification <strong>des</strong> étapes de production, suite à l’introduction de l’AVEA, va également<br />
pousser à la reconfiguration de la chaîne de construction qui deviendrait plus importante et<br />
s’enrichirait d’un système de pont roulant permettant de déplacer <strong>des</strong> entités plus lour<strong>des</strong>.<br />
En effet, avec l’AVEA, on ne se contentera plus de murs modularisés de 10 m de long au<br />
maximum, mais plutôt de murs d’un seul tenant et par suite plus encombrants.<br />
L’AVEA pourra également avoir un effet sur le comportement structural <strong>des</strong> maisons dans la<br />
mesure où on pourrait réaliser la toiture en béton armé également et rendre ainsi le logement<br />
anticyclonique.<br />
II/ La situation actuelle du transport :<br />
Le transport <strong>des</strong> maisons préfabriquées se heurtent également au problème du gabarit<br />
routier qui impose à l’entreprise de s’adapter aux possibilités limitées de transport pour<br />
pouvoir vendre son produit.<br />
Avec l’AVEA, il sera possible de concevoir <strong>des</strong> maisons plus gran<strong>des</strong> et plus chères et peutêtre<br />
plus rentables pour l’entreprise.<br />
III/ Le marché :<br />
120 à 150 maisons sont réalisées actuellement par an. Si l’on disposait d’ores et déjà de<br />
l’AVEA et sous réserve de gains effectifs, plus de 60 % du marché actuel irait à l’AVEA.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 9
En outre, avec un tel engin, le marché se développerait et l’on pourra opérer aisément à<br />
l’échelle européenne dans la mesure où le transport ne prendrait pas plus d’une journée.<br />
Au niveau national exclusivement, on pourra prendre, avec l’AVEA, 10 % du marché <strong>des</strong><br />
maisons individuelles, soit une production annuelle de près de 1'900 maisons de taille et de<br />
géométrie diverses et pouvant être vendues à <strong>des</strong> tarifs dépassant le millions de francs<br />
français. Un tel marché imposera l’ouverture de nouveaux sites de production. On voit ici un<br />
parfait exemple du transport en tant que facteur de croissance économique.<br />
En outre, avec l’Aile Volante, on pourra s’attendre à une diminution <strong>des</strong> tarifs de vente<br />
pratiquées de l’ordre de 10 à 20 %, en raison d’un développement de l’activité, d’une<br />
meilleure organisation et d’une économie possible sur les matériaux.<br />
Un marché annexe de déplacement de maisons d’un endroit à un autre, de construction et<br />
de transport d’équipements touristiques (hôtel-restaurant) en site montagneux pourra aussi<br />
se développer, concurrençant ainsi la construction traditionnelle.<br />
IV/ Quelques chiffres :<br />
♣ Une maison de 100 m 2 exige 800 heures de travail. Avec l’AVEA, on peut gagner<br />
une centaine d’heures, soit une moyenne de 75'000 FF pour une telle superficie ; si<br />
l’on suppose le mètre-carré à 6'000 FF et nécessitant 8 heures de travail.<br />
♣ Avec un coût journalier de 150'000 FF pour louer les services de l’AVEA (en<br />
configuration transport de porte à porte et manutention), les gains, intégrant la<br />
production, le transport, la manutention et les travaux de fondations, s’élèveraient à<br />
90'000 FF par maison de 100 m 2 .<br />
En conclusion, l’AVEA serait un produit très intéressant pour ce type d’industrie en pleine<br />
expansion et peut offrir de nouvelles perspectives et s’adapter à <strong>des</strong> utilisations spécialisées<br />
comme la livraison de plusieurs maisons à la fois, l’une au-<strong>des</strong>sus de l’autre, nécessitant<br />
alors une définition précise du système de levage et d’ancrage de la charge et une<br />
organisation d’emplacement <strong>des</strong> entités à livrer selon une méthode de type LIFO (Last in,<br />
First out) par exemple.<br />
Pour ceci, il devient également urgent de finaliser le concept de l’AVEA.<br />
On présente, ci-<strong>des</strong>sous, une esquisse du système d’ancrage d’une maison à transporter<br />
par AVEA.<br />
De plus, la perception du public à l’égard de l’AVEA peut être assez conciliante dans le fait<br />
qu’il s’agisse d’un moyen de transport d’une composante sociale importante qu’est l’habitat.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 10
Fiche 3 :<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Trois secteurs principaux seraient intéressés par un transport par dirigeable, compte tenu<br />
<strong>des</strong> difficultés de transport <strong>des</strong> charges lour<strong>des</strong> par les moyens usuels :<br />
- la chaudronnerie/la vantellerie avec <strong>des</strong> produits tels les réservoirs à gaz, les<br />
vapocraqueurs, les portes de barrages et d’écluses<br />
- la mécanique lourde (ponts roulants)<br />
- les sous-ensembles de pièces off-shore : le marché est toutefois en récession<br />
actuellement en Europe, seuls <strong>des</strong> sites en Corée, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient<br />
seraient intéressés, ce qui impliquerait de baser l’AVEA sur ces contrées.<br />
I/ La situation actuelle du transport de charges lour<strong>des</strong> :<br />
Pour illustrer cette rubrique, on prendra l’exemple d’une opération sur Madagascar.<br />
Il s’agit de la livraison de plusieurs réservoirs sur Madagascar où les infrastructures sont<br />
quasi-inexistantes (pas d’investissement routier ni portuaire depuis fort longtemps, on ne<br />
peut donc pas débarquer par bateau) et qui ont poussé l’industriel à les construire sur place<br />
à partir d’une importation de tôles cintrées par avion, ce qui implique d’énormes dépenses (1<br />
million de francs français pour 20 t de tôle) ; par ailleurs, la fabrication sur place engendre<br />
énormément de risques sur les délais (productivité de la main d’œuvre, arrêt de la fabrication<br />
en hiver à cause de l’impraticabilité <strong>des</strong> routes par les camions, qui 9 fois sur dix, sont en<br />
panne…) et les prix.<br />
L’AVEA serait certainement un moyen efficace et rentable pour un tel type d’opération.<br />
II/ La chaudronnerie :<br />
a/ Présentation :<br />
Il s’agit du marché <strong>des</strong> réservoirs de stockage <strong>des</strong> gaz ; marché essentiellement tourné vers<br />
la grande exportation et les territoires d’outre-mer (Vietnam, Colombie, Maroc, Sénégal,<br />
Tchéquie, Chine, Martinique, Guadeloupe, Réunion).<br />
Dans ce genre d’opération, le coût du transport varie entre 15 et 20 % du prix de vente <strong>des</strong><br />
réservoirs.<br />
En outre, les clients désirent que la fabrication soit totalement terminée en usine et<br />
contrôlée, plutôt que d’expédier <strong>des</strong> tôles cintrées, de les assembler et de les peindre sur<br />
site.<br />
En outre, à part la possibilité de transport de pièces préassemblées en usine, l’AVEA<br />
permettra <strong>des</strong> gains de temps considérables réduisant à quelques jours seulement les<br />
immobilisations financières, en même temps qu’il permet de maîtriser les risques et de<br />
budgétiser les coûts.<br />
En effet, un assemblage sur place ne permet pas de chiffrer facilement le coût de l’opération<br />
qui peut donc fluctuer considérablement en raison de plusieurs facteurs :<br />
- la nature de la main d’œuvre, généralement moins qualifiée et moins productive dans les<br />
PVD qu’en France : on estime une rentabilité de l’ouvrier étranger égale à 60 voire 80 %<br />
de celle de l’ouvrier français<br />
- la réglementation du travail du pays client<br />
- le contexte douanier plus complexe : le régime <strong>des</strong> admissions temporaires, la taxation<br />
<strong>des</strong> divers types de marchandises soumises à <strong>des</strong> droits de douane différents selon la<br />
catégorie (avec l’AVEA, on n’aurait qu’un seul type de pièce donc moins de<br />
complications douanières)<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 11
A ceux-ci, s’ajoute le paramètre «durée de chantier» qui doit être la plus courte possible afin<br />
de ne pas perdre d’argent. Avec l’AVEA, on resterait très peu de temps à <strong>des</strong>tination.<br />
b/ Quelques opérations-types :<br />
- Soit l’acheminement de trois colis pour le Maroc, de 72 m de longueur, 8 m de diamètre<br />
et de 630 t pièce.<br />
Le parcours actuel emprunte le Rhin, avec une orientation <strong>des</strong> cylindres à 45º pour<br />
passer sous les ponts, à partir d’une usine de production pied dans l’eau, il suit alors un<br />
transbordement à Rotterdam puis un acheminement maritime jusqu’au port de Jorf<br />
Lasfar au Maroc, spécialisé dans l’exportation du phosphate et de ses dérivés et où<br />
donc les infrastructures ne permettent pas de recevoir ce genre de colis, ce qui impose<br />
une reconstruction d’un pont métallique sur le pont existant, en plus de calculs de<br />
vérification de la capacité <strong>des</strong> quais.<br />
A ceci, s’ajoute le fait qu’avec <strong>des</strong> pièces de 10 m de diamètre, il serait impossible<br />
d’emprunter le Rhin et il faudrait alors construire un nouveau site de production à Saint-<br />
Nazaire.<br />
Naturellement, avec l’AVEA, il n’y aurait plus de problèmes de ce genre ; encore faut-il<br />
avoir les autorisations de survoler les espaces aériens <strong>des</strong> pays étrangers.<br />
Le coût de cette opération s’est chiffré à 6 millions de francs français pour les trois colis<br />
et sur un durée de trois semaines, soit approximativement 300'000 FF par jour.<br />
Trois AVEA, sous réserve d’un prix adéquat, pourraient réaliser l’opération en trois<br />
jours, réduisant ainsi les immobilisations financières et le volume <strong>des</strong> finitions sur site<br />
(peinture, petites soudures…). Une enveloppe de 500'000 FF par jour et par pièce serait<br />
convenable dans un tel cas.<br />
- Egalement, au Maroc, il est prévu prochainement de remplacer <strong>des</strong> réservoirs<br />
sphériques d’un site de stockage et d’embouteillage de gaz en fonctionnement par <strong>des</strong><br />
nouveaux. Là, le risque de soudure est important et il serait tout à fait opportun de livrer<br />
les produits finis et assemblés.<br />
III/ La mécanique lourde :<br />
Il s’agit de la fabrication essentiellement de ponts roulants (pont polaire de Ling Ao en<br />
Chine)et tournants.<br />
Un exemple d’opération traite du remplacement d’un pont tournant à Sète de 150 tonnes.<br />
Pour <strong>des</strong> raisons de transport, Eiffel était acculée à construire le pont sur le quai, ce qui<br />
engendre <strong>des</strong> dépenses supplémentaires : frais de mission et logement du personnel,<br />
voitures de location, bureau de chantier, groupe électrogène…<br />
Avec l’AVEA, on aurait pu éviter ces coûts et s’orienter vers une production usine en<br />
comparant le coût généré par les deux procédés.<br />
En général, il en sera toujours ainsi et l’AVEA, pour prendre <strong>des</strong> parts de marché, sera<br />
constamment comparés aux autres possibilités et proposé au client qui aura la décision<br />
finale.<br />
A partir de ce constat, il est difficile de prévoir précisément le marché futur de l’AVEA, car on<br />
procédera toujours cas par cas mais, avec un coût raisonnable, on peut observer un report<br />
de 100 % du marché de la chaudronnerie vers l’AVEA, marché estimé à 100 millions de<br />
francs français pour la société interviewée ici dans les 10 ans à venir.<br />
En outre, il est certain qu’on observera l’émergence d’un nouveau marché et un glissement<br />
de l’offre vers <strong>des</strong> produits finis en usine, de plus en plus élaborés et donc de meilleures<br />
qualités.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 12
On peut prévoir également que le marché de pièces lour<strong>des</strong> comme les ponts roulants<br />
emprunterait facilement l’AVEA car il s’agit de produits élaborés donc assez chers pouvant<br />
alors supporter un coût de transport élevé ; néanmoins, l’avantage de l’AVEA se situera<br />
surtout au niveau de la possibilité de livrer le client à l’intérieur même du bâtiment devant<br />
recevoir le pont roulant car, actuellement, ce sont les engins de manutention qui coûtent le<br />
plus cher et qui présentent un risque d’opération non négligeable. L’AVEA doit donc être<br />
apte à déposer sa charge au centimètre près, au moins.<br />
IV/ Les ouvrages d’art :<br />
On pourrait construire <strong>des</strong> travées de pont en métal entièrement en usine et les mettre en<br />
place grâce à l’AVEA sur site, ce qui serait d’un intérêt capital pour l’unité spécialisée dans la<br />
construction <strong>des</strong> ponts.<br />
En effet, on pourra économiser toutes les dépenses d’organisation logistique sur site<br />
(logement pour le personnel, grue, matériel de poussage…).<br />
L’AVEA déposera alors les travées finies et peintes (plus de travail de peinture sur chantier<br />
qui prenait beaucoup de temps et exigeait de grosses dépenses) sur les piles de ponts<br />
qu’ont viendra uniquement souder, d’où un gain en temps et en argent considérable.<br />
L’économie à réaliser serait au moins de 2'500 FF/t pour les opérations de montage<br />
uniquement auxquelles s’ajoutent les coûts épargnés <strong>des</strong> travaux de peinture qu’on ne<br />
réalisera donc plus sur chantier avec l’AVEA.<br />
Ainsi, en faisant un bilan intégrant les coûts épargnés sur les postes «montage et peinture<br />
sur site», le coût du transport traditionnel de l’ordre de 500 à 600 FF/t et le coût du transport<br />
par AVEA, on peut dégager le gain substantiel issu de l’utilisation de l’Aile Volante, et par<br />
suite quantifier le report modal sur l’AVEA.<br />
En conclusion, un marché important pour l’AVEA existe et générera immanquablement <strong>des</strong><br />
économies aussi bien au niveau de l’industriel que du client. Toutefois, il est nécessaire de<br />
fournir un concept définitif de l’aérostat pour pouvoir entamer <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de comparaison<br />
<strong>des</strong> coûts, seules habilitées à chiffrer au cas par cas les gains, sachant que <strong>des</strong> prévisions<br />
sont difficiles à fournir dans ces situations de <strong>transports</strong> exceptionnels qui représentent<br />
chacune un cas particulier à étudier spécifiquement.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 13
Fiche 4 :<br />
30/11/1999<br />
Implantation : Châlon Saint-Marcel<br />
Secteur d’activité retenue : Industrie nucléaire<br />
I/ Présentation de l’usine :<br />
L’industrie <strong>des</strong> composants lourds pour l’énergie nucléaire fait suite à la longue tradition<br />
d’activités métallurgiques et mécaniques spécialisées du pôle Creusot/Châlon.<br />
L’usine de Châlon Saint-Marcel est au centre de la chaîne de réalisation <strong>des</strong> chaudières<br />
nucléaires fournies par le groupe concerné. Elle en constitue aussi la plus grosse unité<br />
industrielle.<br />
A partir <strong>des</strong> données de l’ingénierie, elle assure la fabrication <strong>des</strong> composants lourds <strong>des</strong><br />
réacteurs à eau pressurisée : cuves, générateurs de vapeur et pressuriseurs.<br />
Les métiers de base de l’usine sont ceux de la chaudronnerie, comprenant en particulier la<br />
réalisation de soudures épaisses, et de la mécanique lourde.<br />
L’usine intervient également dans la conception :<br />
- en amont, par l’adaptation <strong>des</strong> données de dimensionnement, issues de l’ingénierie,<br />
aux contraintes de la production, du transport et du contrôle qualité<br />
- en aval, par la réalisation <strong>des</strong> dossiers d’analyse de comportement qui constituent la<br />
justification par le calcul de la tenue <strong>des</strong> composants aux conditions d’utilisation<br />
spécifiées.<br />
En outre, l’usine de Chalon Saint-Marcel a une capacité annuelle de production supérieure à<br />
2 centrales à 4 boucles soit :<br />
- 2 cuves<br />
- 8 générateurs de vapeur<br />
- 2 pressuriseurs<br />
- composants connexes type accumulateur, échangeurs auxiliaires…<br />
ou l’équivalent en composants de remplacements :<br />
- par exemple 18 à 20 générateurs de vapeur.<br />
Quelques ordres de grandeur illustrent la notion de «composant lourd» :<br />
- une masse allant jusqu’à 500 tonnes (générateur de vapeur type 1'300 MWe ou 1'450<br />
MWe)<br />
- une hauteur de 22 m (générateur de vapeur type 1'300 MWe)<br />
- un diamètre de près de 5m (cuve type 1'450 MWe)<br />
II/ Le transport <strong>des</strong> composants :<br />
Framatome utilise principalement la voie d’eau qui offre jusqu’à présent la plus grande<br />
souplesse pour le transport de matériel de fort gabarit et de poids importants.<br />
Les voies fluviales permettent la circulation de convois poussés :barges avec pousseurs de<br />
plus de 1'300 tonnes pour les voies d’eau à grand gabarit. Ces barges sont ballastables pour<br />
leur donner une assiette horizontale et faire varier les tirants d’air et d’eau en fonction <strong>des</strong><br />
difficultés du trajet ; elles sont de type roll-on/roll-off ou non, et sont alors utilisées en fonction<br />
<strong>des</strong> ports équipés ou non de moyens de levage.<br />
Les voies maritimes, quant à elles, offrent la possibilité d’utiliser <strong>des</strong> navires-cargos équipés<br />
de cales renforcées et dotées de systèmes d’arrimage appropriés ou <strong>des</strong> navires spécialisés<br />
équipés de mâts de manutention, ou de type roll-on/roll-off. On choisit l’un ou l’autre type de<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 14
navire en fonction de contraintes économiques ou de distance et en fonction <strong>des</strong> moyens de<br />
manutention du port d’arrivée.<br />
Leur utilisation se fait comme suit : Framatome présente ses colis au port de chargement, le<br />
long du bord du navire où ils sont pris en charge par la compagnie de navigation et délivrés<br />
le long du quai ou en magasin au port de <strong>des</strong>tination. L’organisation et la responsabilité <strong>des</strong><br />
pré et post cheminements, en amont comme en aval du transport maritime, incombent à<br />
Framatome, la prestation du transporteur se limitant au transfert de port à port.<br />
En France, la compagnie d’électricité nationale, en collaboration avec la groupe enquêté ici,<br />
s’est engagé à long terme avec <strong>des</strong> prestataires mettant à sa disposition de façon<br />
permanente :<br />
- trois barges ballastables<br />
- quatre navires de mer<br />
- trois grues de 550 tonnes<br />
- une bigue de 650 tonnes au Havre.<br />
On peut imaginer un contrat à long terme avec <strong>des</strong> prestataires assurant la disponibilité d’un<br />
certain nombre d’AVEA dans le cadre du programme de renouvellement <strong>des</strong> centrales<br />
nucléaires.<br />
En ce qui concerne le transport par route <strong>des</strong> composants lourds, il est actuellement presque<br />
toujours indispensable, au moins sur une petite partie du trajet. Pour ce type de transport, les<br />
voies d’accès au site nécessitent fréquemment <strong>des</strong> aménagements ou <strong>des</strong> détours : routes<br />
étroites ou sinueuses, ouvrages d’art, agglomérations étroites. Le pôle transport et logistique<br />
du groupe en question assure la coordination de ces aménagements après avoir obtenu les<br />
autorisations nécessaires.<br />
En outre, pour <strong>des</strong> problèmes de manutention à l’intérieur du bâtiment réacteur où le<br />
générateur est introduit horizontalement, la pratique actuelle veut que chaque générateur de<br />
500 tonnes monobloc est transporté en deux parties qui pèsent respectivement 155 et 355<br />
tonnes.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 15
La construction du bâtiment réacteur prend une dizaine d’années et il est inconcevable, pour<br />
<strong>des</strong> raisons de sécurité, de livrer la cuve et le générateur au stade du béton pour une<br />
opération complète et sans rupture de charge en AVEA. Pour utiliser le dirigeable du début à<br />
la fin de l’opération de transport/levage, on doit prévoir de redéfinir la conception totale du<br />
système actuel, ce qui n’est pas envisageable vu que le nucléaire vit probablement ses<br />
dernières années.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 16
Fiche 5 :<br />
2/12/1999<br />
Implantation : Lille<br />
Secteur d’activité retenue : Transports spéciaux - service masses indivisibles<br />
I/ Présentation de l’entreprise :<br />
La société concernée ici est spécialisée dans les <strong>transports</strong> de masses indivisibles lour<strong>des</strong> et<br />
encombrantes ainsi que dans l’acheminement et la manipulation <strong>des</strong> matières radioactives.<br />
Elle propose à la fois <strong>des</strong> prestations routières et ferroviaires et. réalise également les<br />
opérations de manutentions lour<strong>des</strong> au sol pour les entrées ou les sorties <strong>des</strong> bâtiments<br />
d’usines.<br />
II/ Le marché :<br />
Selon l’avis de la personne interviewée, le marché du transport par AVEA est à créer et le<br />
domaine d’intervention de l’Aile Volante serait principalement constitué d’opérations que les<br />
moyens actuels ne peuvent remplir. Actuellement, environ 15 opérations par an seraient<br />
refusées au niveau de l’unité enquêtée en raison de leurs dimensions que ni la route, ni le fer<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 17
ne peuvent tolérer. En effet, l’AVEA se créerait progressivement son marché en incitant les<br />
industriels à construire plus gros.<br />
Concernant le marché de la manutention, l’AVEA, sous réserve de précision dans le<br />
positionnement au moins équivalente à celle d’une grue, serait trop cher pour <strong>des</strong> opérations<br />
de manutention longue (2 à 3 mois) sur chantier qui nécessitent actuellement un coût<br />
quotidien global de 80'000 FF pour une grue de 800 t. Par contre, il serait intéressant pour<br />
<strong>des</strong> prestations globales « transport + manutention » de charges hors gabarit ferroviaire ou<br />
routier, annihilant ainsi les ruptures de charge.<br />
En outre, la personne interrogée serait favorable à un transport intermodal route-AVEA qui,<br />
selon cette personne, serait incontournable dans la mesure où l’AVEA ne pourra pas<br />
accéder systématiquement aux sites de livraison impliquant donc une approche terminale<br />
routière.<br />
Quant au gain de temps que procurerait l’AVEA, l’intérêt se situerait uniquement au niveau<br />
du transport <strong>des</strong> charges très lour<strong>des</strong> et/ou très encombrantes en prenant l’exemple d’un<br />
colis de 6,50 m de large et de 6 m de haut qui nécessiterait 40 jours pour relier Lille à<br />
Toulouse, soit 2'000 km en empruntant les voies permettant l’accès à un tel convoi. L’AVEA<br />
réaliserait ce transport en deux jours au plus avec, en prime, une sécurité accrue et <strong>des</strong><br />
coûts épargnés.<br />
En définitive, selon l’entreprise enquêtée, l’AVEA opérera dans le créneau <strong>des</strong> <strong>transports</strong><br />
hors gabarit et au niveau <strong>des</strong> sites inaccessibles. Concernant le produit lui-même, il est<br />
conseillé de mettre tout d’abord sur le marché la version 200 t de l’AVEA que l’on complétera<br />
par la configuration 500 t après une période d’observation.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 18
Fiche 6 :<br />
6/12/1999<br />
Implantation : Belfort<br />
Secteur d’activité retenue : Production de turbines<br />
I/ Présentation de l’entreprise :<br />
L’entreprise visitée produit une gamme de turbines à gaz de grande puissance, conçoit et<br />
fournit <strong>des</strong> centrales complètes clés en main tout en proposant un service global aux<br />
utilisateurs.<br />
On propose ci-après quelques caractéristiques <strong>des</strong> turbines fabriquées par cette firme:<br />
Type de turbine Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Poids (t)<br />
Turbine 6 FA 10,00 3,60 4,60 110<br />
Turbine 9 E<br />
Sans diffuseur<br />
10,00 5,00 5,50 215<br />
Turbine 9 EC 10,00 5,20 5,50 280<br />
Turbine 9 FA+ 11,00 5,20 5,20 320<br />
Turbine 9 H 12,50 5.50 5,50 380<br />
Par ailleurs, on évalue comme suit leur fréquence de circulation, Bourogne (autre site de<br />
production en France <strong>des</strong> turbines à gaz de grande puissance)-Strasbourg et éventuellement<br />
Bourogne-Belfort (siège social et site de production <strong>des</strong> turbines à gaz de grande<br />
puissance), par année :<br />
Type de turbine Nombre<br />
Turbine 6 FA 15<br />
Turbine 9 E<br />
Sans diffuseur<br />
15<br />
Turbine 9 EC 15 ? Produit futur<br />
Turbine 9 FA+ 15 à 20<br />
Turbine 9 H 15 ? Produit futur<br />
II/ La situation actuelle du marché du transport de charges lour<strong>des</strong> et/ou encombrantes :<br />
Trois tendances se dégagent :<br />
- <strong>des</strong> centrales de plus en plus gran<strong>des</strong><br />
- <strong>des</strong> pièces de plus en plus lour<strong>des</strong>, volumineuses, fragiles et chères à livrer dans <strong>des</strong><br />
délais courts (en général, moins d’une année entre la signature du contrat et la<br />
livraison)<br />
- <strong>des</strong> contraintes techniques rigi<strong>des</strong> de transport (infrastructures inexistantes,<br />
insuffisantes, ou impraticables, en hiver notamment, …) ; on est par exemple limité à<br />
275 tonnes en transport routier entre Belfort et Strasbourg et soumis au contraintes de<br />
gabarit pour la voie ferrée.<br />
En outre, la situation devient urgente car <strong>des</strong> besoins certains en machines plus puissantes<br />
donc plus volumineuses et lour<strong>des</strong> se feront ressentir faisant évoluer le marché actuel <strong>des</strong><br />
300 à 500 tonnes vers les 1'000 tonnes d’ici 10 à 15 ans.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 19
Concernant la chaîne globale du transport <strong>des</strong> centrales (500 tonnes environ) et <strong>des</strong><br />
turbines de plus de 275 tonnes, les différentes phases se résument en :<br />
- un montage en usine<br />
- un test de fonctionnement<br />
- un démontage pour le transport<br />
- un remontage sur le site de <strong>des</strong>tination<br />
- et enfin un second test de fonctionnement<br />
engendrant donc une perte de temps, d’argent mais aussi de qualité pour <strong>des</strong> questions<br />
d’infrastructure !<br />
Il devient donc pressant de trouver <strong>des</strong> solutions d’acheminement adéquates.<br />
III/ Les moyens actuels du transport de charges lour<strong>des</strong> et/ou encombrantes :<br />
♣ La route :<br />
Flexible mais soumise à <strong>des</strong> contraintes techniques et opérationnelles (dimensionnement<br />
<strong>des</strong> chaussées, obstacles, lenteur <strong>des</strong> convois- la vitesse peut atteindre 10 km/h-…)<br />
♣ Le train :<br />
Embranchement <strong>des</strong> sites de <strong>des</strong>tination, problème de gabarit…<br />
En outre, un colis de 400 tonnes sur 150 km nécessiterait jusqu’à trois jours<br />
d’acheminement et atteindrait un coût de 700 kFF !<br />
♣ La voie fluvio-maritime :<br />
Nécessite généralement un transport routier d’approche initiale et/ou terminale et<br />
engendre <strong>des</strong> détours pour rejoindre les ports d’embarquement et de débarquement, -<br />
équipés de portiques, de grues…- et de là les sites de <strong>des</strong>tination ; un trajet direct de 400<br />
km peut ainsi facilement se transformer en un parcours de 2'000 km en suivant la voie<br />
fluvio-maritime qui, dans de nombreux cas, représente la solution unique<br />
d’acheminement de sa charge. Cependant, les coûts restent abordables.<br />
♣ L’avion :<br />
Limité à 120 tonnes et nécessite <strong>des</strong> infrastructures aéroportuaires sur-dimensionnées ;<br />
constitue généralement un transport d’urgence en raison de son coût qui avoisine,<br />
seulement pour la partie aérienne et en faisant abstraction de la manutention, 400 à 600<br />
k$ en fonction de la distance pour un colis de 100 tonnes.<br />
Concernant les coûts de transport <strong>des</strong> centrales d’environ 500 tonnes produits par la dite<br />
firme, 80 % d’entre eux s’inscrivent dans la fourchette 3 à 5 millions de francs français.<br />
IV/ L’AVEA :<br />
Jusqu’à 200 kFF pour une journée de 8 heures, l’AVEA resterait compétitif dans le cadre <strong>des</strong><br />
<strong>transports</strong> <strong>des</strong> produits de l’entreprise interviewée. En outre, il permettrait une modification<br />
du processus de production ou du moins de sa logistique en permettant un assemblage et<br />
un test définitif en usine améliorant ainsi la qualité du produit, et ce particulièrement pour les<br />
petites centrales de 500 tonnes. Toujours dans les effets élargis, l’Aile Volante inciterait les<br />
industriels à produire <strong>des</strong> éléments plus importants et par suite plus puissants, de même qu’il<br />
participerait au désenclavement et à l’industrialisation de régions reculées et difficiles<br />
d’accès, ne serait-ce que par leur électrification.<br />
D’un point de vue transport une fois de plus, on gagnera irrémédiablement en temps et en<br />
rupture de charges et… éventuellement sur le TRANSPORT également. Le gain de temps<br />
est estimé à au moins 50 % par rapport à une prestation globale maritime sur de longues<br />
distances.<br />
Quant au champ d’intervention de l’AVEA, celui-ci bénéficierait d’un report modal d’environ<br />
20 % de son marché potentiel durant les 3 voire 4 premières années pour devenir<br />
progressivement un moyen standard accepté de tous.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 20
Du point de vue produit, l’entreprise visitée opterait pour une configuration 500 tonnes et un<br />
transport sous-élingue et non en soute pour <strong>des</strong> raisons d’encombrement.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 21
Fiche 7 :<br />
8/12/1999<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Entreprise générale de construction<br />
Cette réunion avait pour principal objectif de présenter à un groupe de personnes les<br />
caractéristiques générales de l’AVEA et de les faire réfléchir sur les applications potentielles<br />
du dirigeable dans le domaine du génie civil.<br />
Il s’agit d’une <strong>des</strong> premières entreprises de construction de l’Hexagone. Elle opère, aussi<br />
bien en France qu’à l’étranger, dans le domaine du bâtiment et <strong>des</strong> travaux publics qui<br />
représente 33 % de son activité, de même qu’elle intervient dans les <strong>transports</strong>, où elle<br />
conçoit et réalise <strong>des</strong> infrastructures et <strong>des</strong> systèmes de transport urbains et interurbains,<br />
dans l’industrie, notamment pétrochimique, et enfin dans la maintenance <strong>des</strong> installations<br />
particulièrement dans les secteurs industriels et nucléaires.<br />
I/ Applications en génie civil :<br />
Parmi les applications en génie civil, on distingue :<br />
- le transport de travées de ponts en béton (20 t/m) de 20 à 30 m de long<br />
- le transport de travées de ponts en métal (6 t/m) jusqu’à 80 m de long<br />
- le transport d’ouvrages de franchissement assemblés en atelier et prêts à l’emploi<br />
(passages supérieurs d’autoroutes…)<br />
- réparation et maintenance de ponts ; on pourra « enlever » <strong>des</strong> travées endommagées<br />
et les remplacer par <strong>des</strong> neuves<br />
- transport monobloc de tunneliers déjà montés et prêts à l’emploi ; on perdra ainsi moins<br />
de temps à l’assembler sur le site<br />
II/ Modification du dimensionnement et <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de construction :<br />
En utilisant l’AVEA, les pratiques de construction de ponts (poussage, lançage,<br />
encorbellement, sur cintre fixe ou mobile) seront revues ainsi que le dimensionnement <strong>des</strong><br />
éléments :<br />
- poussage : le calcul <strong>des</strong> sections ne prendrait plus en compte la phase de montage où<br />
20 % environ de la quantité d’armatures est utilisée pour supporter le poids <strong>des</strong> travées<br />
suivantes qui sont poussées progressivement jusqu’à ce qu’ils atteignent leur place<br />
définitive ; on générerait donc un gain de matière, un « assouplissement » <strong>des</strong><br />
fondations et par suite pécuniaire de par l’usage de l’AVEA<br />
- lançage : cette pratique faisant appel aux grues mobiles tendrait à laisser place à<br />
l’AVEA, dans la limite de coûts raisonnables, surtout pour les grosses charges.<br />
Cependant, l’utilisation de l’AVEA impliquerait de connaître parfaitement certains aspects<br />
techniques, notamment le système de treuillage pour pouvoir positionner adéquatement les<br />
points d’attache.<br />
En outre, l’AVEA inciterait également à une réorganisation logistique <strong>des</strong> chantiers dans la<br />
mesure où, si l’on venait à l’utiliser, on ne prévoirait par exemple plus de routes d’accès<br />
préalables et par suite, on observerait la suppression <strong>des</strong> montants de ce poste dès que la<br />
fiabilité du système serait éprouvée.<br />
Toutefois, l’utilisation de l’AVEA sera subordonnée à une analyse <strong>des</strong> coûts cas par cas par<br />
rapport aux métho<strong>des</strong> traditionnelles et la décision finale sera laissée au mandataire.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 22
Pour conclure, l’AVEA ouvrira <strong>des</strong> possibilités dans le domaine de la construction mais,<br />
pour pénétrer ce secteur, il devra être fiable et disponible 24h/24 (sauf contrainte<br />
atmosphérique critique).<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 23
Fiche 8 :<br />
9/12/1999<br />
Implantation : Paris<br />
Secteur d’activité retenue : Production d’air comprimé, industrialisation de gaz,<br />
équipements de distillation et de traitement <strong>des</strong> gaz<br />
L’entretien a été mené avec le responsable <strong>des</strong> <strong>transports</strong> au sein de la division Engineering.<br />
Comme colis lourds, il s’agit principalement de colonnes de distillation de 150 tonnes<br />
environ, de 6,50 m de diamètre et de 30 à 50 m de long.<br />
Ces colonnes sont actuellement transportées, sur le tronçon principal, par navire colis-lourds<br />
de capacité 70'000 m 3 . Air Liquide en affrète 12 à 15 par an et en profite également pour<br />
transporter de la marchandise conventionnelle ; autant dire que l’AVEA ne pourrait être<br />
utilisé que dans <strong>des</strong> missions ponctuelles à l’image de l’Antonov à moins que la demande en<br />
navire colis-lourds devienne importante et provoque un surenchérissement dans les<br />
prochaines années.<br />
Cependant, l’utilisation de l’AVEA nécessite de préciser certains éléments techniques et par<br />
suite conceptuels de l’Aile Volante vis à vis du système de treuillage, du roulis, du tangage,<br />
du nombre de g…<br />
Notons que c’est le dirigeable qui devrait s’adapter au transport <strong>des</strong> colonnes et non pas le<br />
contraire ; on entend par là qu’il n’est pas question d’envisager de modification du processus<br />
de fabrication au sein de cette entreprise suite à la mise sur le marché de l’AVEA en raison<br />
<strong>des</strong> caractéristiques particulières de ces colonnes d’épaisseur 7 mm en acier inox (une<br />
augmentation de cette épaisseur à <strong>des</strong> fins de levage ou d’augmentation de résistance<br />
grèverait leurs prix).<br />
Par ailleurs, en raison de la fragilité de ces colonnes de distillation, il est préférable<br />
d’envisager un transport en soute et, éventuellement, horizontalement sous élingue avec <strong>des</strong><br />
fixations adaptées lorsque les conditions atmosphériques sont clémentes. Ces aspects de<br />
transport devrait être étudiés de plus près par les techniciens et ingénieurs de l’entreprise<br />
visitée et nécessiterait donc une définition complète de l’Aile Volante.<br />
Pour conclure, la société visitée voudrait être informée régulièrement <strong>des</strong> développements<br />
de l’AVEA et s’intéresse d’ores et déjà à l’évolution du concurrent Cargolifter.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 24
Fiche 9 :<br />
14/12/1999<br />
Implantation : Colmar<br />
Secteur d’activité retenue : Production de pelles hydrauliques<br />
I/ Présentation de l’entreprise:<br />
Les exigences imposées aux machines de chargement et de transport utilisées dans les<br />
mines à ciel ouvert et les carrières du monde entier, <strong>des</strong> rendements de chargement et de<br />
transport élevés pour <strong>des</strong> frais de fonctionnement réduits, <strong>des</strong> forces de pénétration et de<br />
cavage importantes en extraction directe, une grande disponibilité et une longue durée de<br />
vie dépendent <strong>des</strong> conditions de travail et <strong>des</strong> matériaux à extraire.<br />
La génération de pelles hydrauliques version mines, associée à la gamme <strong>des</strong> tombereaux<br />
Diesel électriques, répondent à ces exigences et offrent de nombreux avantages.<br />
Les machines sont adaptées aux applications les plus diverses. Une conception robuste et<br />
un dimensionnement généreux assurent <strong>des</strong> rendements élevés pendant de longues<br />
pério<strong>des</strong> de fonctionnement.<br />
Parmi les pelles hydrauliques pouvant susciter un intérêt de transport par AVEA, on repère :<br />
- la R 994 dont le poids en ordre de marche entièrement équipée est de 230 tonnes<br />
- la R 995 dont le poids en ordre de marche entièrement équipée est de 390 tonnes<br />
- la R 996 dont le poids en ordre de marche entièrement équipée est de 590 tonnes<br />
Actuellement, ces machines sont de conception modulaire à <strong>des</strong> fins de transport mais<br />
surtout pour permettre <strong>des</strong> travaux d’entretien et <strong>des</strong> remplacements de composants aussi<br />
rapidement et aisément que possible.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 25
II/ Le marché <strong>des</strong> pelles :<br />
On ne peut pas donner de prévisions.<br />
Toutefois, on peut distinguer en analysant les données historiques deux cycles de 4 ans<br />
distincts :<br />
- une conjoncture haute qui correspond en même temps à la capacité de production de<br />
l’entreprise :<br />
o 20 R 994/an<br />
o 4 R 995/an<br />
o 6 R 996/an<br />
- une conjoncture basse :<br />
o 10 R 994/an<br />
o 2 R 995/an<br />
o 3 R 996/an<br />
Dans un tout autre ordre, on donne ci-après un exemple d’opération prochaine de transport<br />
d’une pelle R 995 à <strong>des</strong>tination de l’Australie ; notons que le marché international actuel se<br />
répartit entre l’Indonésie et l’Australie.<br />
Tout d’abord, le transport de cette machine se fera en sous-ensembles de 65 tonnes en<br />
empruntant :<br />
un tronçon routier Colmar-Strasbourg<br />
une partie fluviale Strasbourg-Anvers ou Rotterdam<br />
une partie maritime Anvers ou Rotterdam- Sydney<br />
Cette opération coûtera jusqu’à Sydney 1,2 millions de francs français, sans compter le<br />
transit intérieur australien jusqu’au site de livraison. En outre, l’opération demandera 5<br />
semaines de transit et 2 à 3 semaines de préparation et d’évacuation <strong>des</strong> colis au niveaux<br />
<strong>des</strong> différents sites (usine de Colmar, ports de Strasbourg, de Rotterdam ou d’Anvers...).<br />
Avec l’AVEA, toutes ces opérations (on n’aura plus la partie préparation <strong>des</strong> colis) prendront<br />
une dizaine de jours (22000 km) impliquant un gain de temps et par suite un gain monétaire<br />
au niveau de la préparation technique <strong>des</strong> colis mais aussi au niveau du règlement de la<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 26
facture si le contrat de base stipule un paiement final à la livraison, qui, somme toute, reste<br />
rare en raison du prix de ces pelles qui s’élève facilement à 30 millions de francs (paiement<br />
par traite, leasing…).<br />
Dans un tel cas, l’AVEA pourrait ne pas être rentable dans le cadre d’une prestation<br />
complète par rapport à l’acheminement maritime mais pourrait le devenir dans le cadre d’un<br />
transport intermodal AVEA/navire où l’on gagnerait une semaine de préparation <strong>des</strong> colis et<br />
une vingtaine de jours comprenant le transit routier au départ de Colmar et, éventuellement à<br />
l’arrivée au départ de Sydney, l’évacuation sur Strasbourg, le stationnement au niveau <strong>des</strong><br />
ports fluvio-maritimes…ramenant ainsi la durée d’acheminement vers le site de <strong>des</strong>tination à<br />
environ 4 semaines au lieu de 8.<br />
Par ailleurs, l’AVEA pourrait être largement utilisé sur le marché européen à <strong>des</strong> tarifs<br />
concurrentiels, principalement vers le nord de l’Angleterre, le sud de l’Italie, l’Espagne et la<br />
Grèce représentant un potentiel de 5 machines par an.<br />
Dans d’autres cas où l’utilisation de l’AVEA serait exceptionnelle (<strong>transports</strong> d’urgence pour<br />
ne pas écoper de pénalités lour<strong>des</strong> dans ce domaine, transport de dépannage…) à l’image<br />
de l’Antonov (qui nécessiterait plusieurs allers-retours ou un multi-affrètement dans le cas de<br />
machines de près de 400 t car sa charge utile est limitée à 120 tonnes) ou d’un affrètement<br />
navire-roulier en catastrophe, on n’hésitera pas à utiliser l’Aile Volante qui sera toujours<br />
meilleur marché !<br />
III/ L’AVEA : modification du processus de production<br />
Premièrement, l’AVEA ne permettrait pas à l’état actuel d’envisager <strong>des</strong> pelles plus<br />
performantes pour une raison principale tenant à <strong>des</strong> limitations techniques (puissance du<br />
moteur…) qui freinent ce développement.<br />
Deuxièmement, concernant la production elle-même, l’AVEA ne changera pas les habitu<strong>des</strong><br />
d’une conception modulaire qui est principalement dictée par la maintenance <strong>des</strong> pelles qui<br />
doit rester simple ; une construction monobloc entraverait la souplesse de ces opérations<br />
d’entretien.<br />
Troisièmement, l’usage de l’AVEA ne nécessitera pas une reconfiguration du site de Colmar<br />
car les pelles sont mobiles et donc peuvent sortir d’elle-même de l’atelier de production<br />
jusqu’à une aire de stockage où elles seront enlevées par l’AVEA.<br />
A contrario, un transport par AVEA devrait être décidé dès la phase de production de la<br />
machine pour positionner et concevoir adéquatement les points de levage ; pour ce, il serait<br />
préférable d’imaginer une solution amovible, indépendante du moyen de transport, telle un<br />
berceau sur lequel se mettrait en place la pelle et qui serait soulever par l’AVEA. La<br />
conception précise d’un tel moyen nécessiterait de connaître la configuration finale de l’Aile<br />
Volante.<br />
Hormis les aspects de coûts d’affrètement de l’AVEA, celui-ci devrait être disponible en<br />
terme d’appareil en tout temps et ne pas engendrer de listes d’attente qui risquent d’être<br />
préjudiciables au succès commercial du système ; cette phase de réservation et de gestion<br />
commerciale est déterminante.<br />
D’autres aspects tels la sécurité et la fiabilité du système seront également à discuter, tout<br />
comme le transport sous élingue ou en soute interne déterminant d’un point de vue<br />
résistance <strong>des</strong> matériaux entrant dans la composition <strong>des</strong> pelles ; à 10'000 m, l’acier et les<br />
systèmes électriques équipant les machines pourraient être endommagés si on choisit<br />
l’option « transport sous élingue » sans prendre de mesures de protection spéciales. Ces<br />
points devront être précisés avec le personnel technique de l’AVEA et ceux de la présente<br />
société.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 27
En conclusion, l’entreprise visitée est très intéressé par le projet et pourrait y participer<br />
d’avantage sous réserve d’autorisation de la maison mère en Allemagne qui est déjà<br />
intégrée dans la conception de la « nacelle » du Cargolifter.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 28
Fiche 10 :<br />
16/12/1999<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Transport exceptionnel<br />
I/ Le marché actuel :<br />
Actuellement, en France et en Europe, le programme nucléaire est arrêté. En conséquence,<br />
on n’observe que certaines opérations ponctuelles de dépannage (remplacement de<br />
transformateurs de 75 tonnes unitaires, de rotors de 135 tonnes occasionnellement) à raison<br />
d’une fréquence de 3 à 5 par an. A l’international, on a quelques opérations notamment en<br />
Chine.<br />
D’un point de vue coût, un transformateur de 75 tonnes qui va de Creil à la vallée du Rhône,<br />
soit un parcours de 500 km environ, coûte entre 900 kFF et 1200 kFF par train et 500 kFF<br />
voire 300 kFF par route dans le cas d’un transporteur étranger bradant ses prix.<br />
Pour un générateur de vapeur de 300 tonnes, l’opération peut coûter, sur le même trajet,<br />
2500 kFF par voie ferroviaire.<br />
On propose ci-<strong>des</strong>sous une carte précisant la localisation <strong>des</strong> unités de fabrication et/ou de<br />
stockage <strong>des</strong> rotors, <strong>des</strong> stators, <strong>des</strong> transformateurs et <strong>des</strong> générateurs avec leur<br />
puissance nominale ainsi que <strong>des</strong> sites nucléaires de production d’électricité.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 29
Concernant les prévisions du marché futur, il est impossible à l’heure actuelle d’en fournir car<br />
ce secteur énergétique dépend très largement <strong>des</strong> orientations politiques futures : relancerat-on<br />
le nucléaire ou pas ?<br />
Dans l’affirmative, on devra opérer un premier changement vers 2005-2010 jusqu’à<br />
concurrence <strong>des</strong> 54 tranches soient près de 210 générateurs de vapeur ; dans le cas<br />
contraire, on devra prévoir d’autres types de production d’énergie tels les turbines à<br />
combustion de poids unitaire 300 tonnes et de puissance nominale 20 MW, les éoliennes…<br />
Quelque soit l’orientation, il existera un marché pour l’AVEA que l’on ne peut<br />
malheureusement pas quantifier actuellement mais qui se précisera d’ici deux années.<br />
Dès la définition du programme de renouvellement, l’entreprise en question pourrait prendre<br />
<strong>des</strong> parts dans l’AVEA en terme d’investissement comme il a été déjà pratiqué avec la SNCF<br />
via une <strong>des</strong> ses filiales.<br />
II/ L’AVEA :<br />
Il permettrait, sous réserve de conditions techniques tenant à la fois à l’AVEA et à sa charge,<br />
notamment la précision du positionnement, le comportement <strong>des</strong> matériaux et <strong>des</strong> flui<strong>des</strong><br />
<strong>des</strong> générateurs en altitude…, de bénéficier d’une certaine souplesse dans le transport<br />
(rapidité, linéarité <strong>des</strong> trajets - plus de détours -), de gagner du temps et même peut-être de<br />
réaliser <strong>des</strong> économies sur ces opérations d’acheminement du matériel de production<br />
d’électricité. Dans le cas d’utilisation de l’AVEA, d’autres aspects plus précis seront étudiés<br />
tels les points de treuillage de la charge emportée.<br />
D’autre part, eu égard aux opérations <strong>des</strong> dernières années, il a été exprimé plutôt un besoin<br />
dans une configuration de l’Aile Volante de charge utile 200 tonnes quitte à combiner deux<br />
versions de 200 t, si possible techniquement, pour transporter un générateur de 300 t.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 30
Du point de vue modification du processus de production, l’AVEA pourrait, à moyen voire<br />
long terme et dans le cas où la conjoncture politique le permettrait et où <strong>des</strong> besoins de<br />
consommation se ressentiraient, « encourager » la fabrication de tranches de 2000 MW,<br />
nécessitant donc <strong>des</strong> générateurs plus lourds et plus volumineux<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 31
Fiche 11 :<br />
20/12/1999<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Aérospatial<br />
L’intérêt porté au projet AVEA par la société en question consiste à « désenclaver »<br />
certaines régions comme la Suisse ou l’Allemagne qui produisent <strong>des</strong> éléments du lanceur et<br />
qui empruntent actuellement la voie d’eau et la route moyennant un détour considérable pour<br />
rejoindre le port du Havre à partir duquel ces pièces sont acheminées vers la Guyane.<br />
Il s’agit principalement :<br />
- de coiffes de 20 tonnes chacune (15 m de long et 6 m de large) du lanceur Ariane se<br />
présentant sous forme de deux demies coquilles logées dans <strong>des</strong> conteneurs au départ<br />
de Suisse<br />
- d’ « œufs », dans lesquels on loge le satellite, de 5,40 m de diamètre et pesant 15<br />
tonnes chacun.<br />
Le rôle de l’AVEA serait donc de réduire les ruptures de charges, de gagner du temps et de<br />
s’affranchir <strong>des</strong> contraintes de volume qui caractérisent ces « colis » ; leur poids n’étant pas,<br />
pour sa part, un facteur limitant.<br />
Un tel marché se chiffrerait à 5 <strong>transports</strong> dans les 3 années à venir et à 7 voire 8 <strong>transports</strong><br />
pour les années qui suivront.<br />
Concernant d’éventuelles modifications du processus de production voire de la logistique<br />
interne du constructeur (approvisionnement, sites de production…), l’AVEA ne modifierait en<br />
rien les habitu<strong>des</strong> de l’entreprise visitée, sachant que la manière d’opérer actuellement est<br />
satisfaisante et ne nécessite pas un changement qui irait bouleverser les pratiques d’un<br />
programme européen bien rôdé.<br />
En conclusion, l’apport de l’AVEA serait de désenclaver les composants venant de Suisse ou<br />
d’Allemagne. De plus, l’AVEA se limiterait donc à sa mission de transport et ne changerait en<br />
rien les pratiques actuelles du Constructeur.<br />
Ci-<strong>des</strong>sous, l’étude de cas prévue, en février 2001, avec l’entreprise en question dans<br />
cette fiche, sous réserve de plus amples informations techniques, en l’occurrence sur le<br />
comportement du dirigeable (sensibilité prévue aux aléas climatiques), le système de<br />
ballastage (nature, temps), l’interface de levage (nature du système, performances, précision<br />
du positionnement), et économiques (estimation fiable du coût d’exploitation du dirigeable<br />
basée sur l’évaluation de l’investissement nécessaire au niveau du dirigeable en tant que tel<br />
et de ses éléments d’appoint - motorisation, système de guidage et de levage …).<br />
Le dirigeable AVEA serait principalement utilisé pour le transport de « modules » de fusées.<br />
Ces éléments se présentent actuellement sous forme de conteneurs dont le plus grand offre<br />
les dimensions suivantes : L 35 m * l 7 m * h 7 m<br />
Le poids maximal est de 70 tonnes.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 32
Ces éléments sont fabriqués sur plusieurs sites : Brême, Zurich, Lac de Constance,<br />
Toulouse, Paris. Les sites de Zurich, lac de Constance et Toulouse (transport routier)<br />
présentent <strong>des</strong> problèmes d’acheminement auxquels pourrait remédier le dirigeable.<br />
Cette étude, outre l’aspect transport, s’intéressera à la modification <strong>des</strong> processus<br />
logistiques dans la mesure où il faudra évaluer l’aspect opérationnel et économique du<br />
transport <strong>des</strong> éléments de la fusée par AVEA vers 1 ou 2 ports « Hub », en l’occurrence le<br />
Havre, à partir duquel se ferait le transfert vers la Guyane, par voie maritime. A ce niveau,<br />
une nouvelle organisation doit être proposée et expertisée. Des éléments de réglementation<br />
du survol et/ou de la manutention en zone portuaire doivent être apportés.<br />
En outre, sous réserve <strong>des</strong> contraintes techniques et <strong>des</strong> coûts subséquents, le dirigeable<br />
pourrait effectuer un transport massifié <strong>des</strong> éléments de la navette spatiale (groupage) qui<br />
engendrerait immanquablement un bénéfice au niveau de la phase « transport ». Il reste<br />
alors à évaluer le coût <strong>des</strong> phases complémentaires, y compris au niveau de la fabrication<br />
<strong>des</strong> éléments considérés. Ce dernier point devra également faire l’objet d’une expertise.<br />
En résumé, l’étude devra concilier les contraintes techniques, opérationnelles et, à plus<br />
faible impact, les aspects politiques. Au vu de ces conditions et d’une analyse comparative<br />
avec les moyens actuels utilisés pour le transport <strong>des</strong> différents éléments préalablement<br />
identifiés, une analyse économique aboutissant à un calcul de rentabilité sera effectuée.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 33
Fiche 12 :<br />
22/12/1999<br />
Implantation : Grenoble<br />
Secteur d’activité retenue : Production de roues de turbines<br />
I/ Présentation de l’entreprise :<br />
Il s’agit d’une <strong>des</strong> entreprises leader mondiale dans la fourniture de services et<br />
d’équipements pour la production d’énergie parmi lesquels les turbines à gaz, les centrales à<br />
cycle combiné et les centrales thermiques à vapeur.<br />
Dans le secteur <strong>des</strong> turbines à gaz, la firme en question tire parti du nombre croissant de<br />
projets privés de centrales commerciales aux Etats-Unis et de la demande correspondante<br />
pour <strong>des</strong> turbines à gaz à haut rendement.<br />
Dans le domaines <strong>des</strong> centrales thermiques à vapeur, plusieurs comman<strong>des</strong> majeures ont<br />
été remportées pour <strong>des</strong> centrales au charbon : centrale de Manjung en Malaisie (3*660<br />
MW), de Ho Ping à Taiwan (2*660 MW), de Neyvelli en Inde (250 MW) ; ainsi que pour <strong>des</strong><br />
chaudières à lit fluidisé circulant pour la centrale de Guayama à Porto Rico (2*250 MW) et<br />
pour <strong>des</strong> chaudières supercritiques <strong>des</strong>tinées à la centrale de Wai Gao Xiao en Chine (2*900<br />
MW).<br />
En Europe et en Amérique du Nord, la dite entreprise a remporté plusieurs succès dans le<br />
domaine <strong>des</strong> modernisations et réhabilitations d’installations existantes. La société va ainsi<br />
réhabiliter la centrale au charbon de Turow en Pologne et remplacer plusieurs turbines à<br />
vapeur en Amérique du Nord.<br />
Par ailleurs, la division grenobloise dont il s’agit ici est spécialisée dans la fabrication <strong>des</strong><br />
gran<strong>des</strong> roues <strong>des</strong> turbines hydrauliques.<br />
II/ Le marché :<br />
Actuellement, trois roues de 450 tonnes chacune, de 10,6m de diamètre et de 5m de haut<br />
ont été commandées à l’unité de Grenoble pour le barrage <strong>des</strong> Trois Gorges en Chine.<br />
Au départ de Fos, les pièces mettront deux mois pour arriver sur le barrage dont une<br />
quinzaine de jours de transport en Chine à la charge du client. Le problème majeur pour<br />
l’unité visitée se situe donc au niveau de l’acheminement de Grenoble à Lyon où de grosses<br />
modifications d’un montant avoisinant les 50 millions de francs français seraient à attendre<br />
en raison de l’inadéquation <strong>des</strong> infrastructures existantes, alors que le prix de la roue s’élève<br />
à 70 millions de francs français ! Autant dire que cette option ne sera pas retenue et que l’on<br />
sera obligé d’aménager un « site de production » sur un port fluvial ou maritime avec tous les<br />
aléas que cela comporte (main d’œuvre supplémentaire à payer, frais de déplacements du<br />
personnel qualifié, problèmes d’usinage, de tournage, qualité finale de la pièce…) : on<br />
estime un surcoût par rapport à une production sur Grenoble de 3 millions de francs français.<br />
Précisons par ailleurs que la plus grande partie du marché de l’entreprise interviewée se<br />
situe et continuera de l’être pour de nombreuses années en Chine, en Indonésie, en Lettonie<br />
et en Amérique du Sud ; avec l’AVEA et dans le cas où il serait compétitif par rapport aux<br />
métho<strong>des</strong> actuelles, un premier problème pourrait se poser concernant les autorisations de<br />
survol <strong>des</strong> différents pays traversés.<br />
Cependant, il est pratiquement certain que l’Aile Volante serait intéressante dans le cadre<br />
d’un transport combiné AVEA/navire permettant de réaliser <strong>des</strong> gains importants au départ<br />
routier de Grenoble ou a fortiori de supprimer <strong>des</strong> coûts de fabrication sur <strong>des</strong> sites<br />
portuaires aménagés pour la circonstance, et ce malgré le prix de l’AVEA qui vient en<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 34
supplément de celui de l’affrètement d’un navire qui peut atteindre les 450000 $ pour une<br />
<strong>des</strong>tination comme la Chine.<br />
Par ailleurs, <strong>des</strong> pièces plus mo<strong>des</strong>tes de 80 tonnes environ sont également fabriquées par<br />
l’unité en question mais ne posent pas de problèmes particuliers de transport ; là, l’AVEA ne<br />
sera peut-être pas compétitif par rapport aux moyens usuels. A priori, l’AVEA serait<br />
intéressant à partir de 120 à 150 tonnes. Il faut ajouter également ici l’intérêt de<br />
l’établissement en question concernant la commercialisation d’une configuration 500 t de<br />
l’AVEA quitte à faire, quand cela s’avérera nécessaire, du groupage pour atteindre cette<br />
charge utile ; la configuration 200 tonnes n’apporterait rien aux activités de cette entreprise.<br />
Quant aux prévisions du marché, il n’est pas possible d’en fournir en raison de son caractère<br />
aléatoire. Toutefois, sur la seule opération du barrage <strong>des</strong> Trois Gorges, 14 comman<strong>des</strong> sur<br />
24 ont été passées. Les dix en suspens dont la livraison interviendrait dans un peu moins de<br />
10 ans pourraient être <strong>des</strong> opérations réalisées par AVEA au départ d’Europe ou de Chine<br />
dans le cas très probable où ce pays acquerra un savoir-faire dans ce domaine.<br />
III/ L’apport de l’AVEA :<br />
L’apport de l’AVEA se situe, comme on l’a vu, au niveau du transport <strong>des</strong> grosses pièces<br />
mais également permet d’éviter <strong>des</strong> fabrications coûteuses sur site aménagé<br />
exceptionnellement pour la circonstance (sites portuaires). Ces frais, combinés avec les<br />
intérêts bancaires (gain de temps pratiquement de deux mois si l’AVEA s’avère rentable pour<br />
effectuer à lui-seul et non en transport intermodal la livraison), inciteront les dirigeants à<br />
opter pour le dirigeable.<br />
D’un autre côté, l’AVEA ne permettra pas de modification du processus de production<br />
directement en raison de contraintes techniques et budgétaires (<strong>des</strong> éléments séparés puis<br />
soudés coûtent moins chers qu’une pièce coulée en aciérie de 400 tonnes !).<br />
Toutefois, il inciterait, sous réserve bien sûr de rentabilité, à un redéploiement géographique<br />
de l’approvisionnement : on pourrait, avec l’AVEA, s’adresser à d’autres fonderies offrant un<br />
meilleur tarif que le Creusot (aciérie la plus importante de France, fournisseur <strong>des</strong> principales<br />
usines de production de matériels lourds et/ou encombrants) et qui, actuellement, sont<br />
inaccessibles de par les coûts de transport. L’AVEA stimulerait ainsi une certaine<br />
concurrence, entre les fournisseurs, positive pour les entreprises et a fortiori pour le client<br />
final.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 35
Fiche 13 :<br />
5/01/2000<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Levageur<br />
L’objectif de cette rencontre a été de vérifier certains ordres de grandeur du coût de la<br />
manutention, mais surtout de calibrer les applications de l’AVEA dans le domaine<br />
aérostatique.<br />
I/ Présentation de l’entreprise :<br />
Ses activités touchent le levage, la manutention, le montage, la maintenance industrielle et<br />
les <strong>transports</strong> spéciaux. L’entreprise est propriétaire de 300 grues mobiles, réparties dans 25<br />
agences en France, dont <strong>des</strong> grues télescopiques de 650 tonnes et <strong>des</strong> grues treillis de<br />
1000 tonnes. L’entreprise dispose également de remorques vérinables de capacité allant<br />
jusqu’à 5000 tonnes pour <strong>des</strong> opérations de manutention au sol.<br />
Par ailleurs, le chiffre d’affaires du marché de levage du dit établissement est de 500 millions<br />
de francs français par an sur un total national de plus d’1 milliard de FF. Ce chiffre prend en<br />
compte également les petits colis à partir de 250 kg ; la part <strong>des</strong> gros tonnages représente<br />
10 à 15 % du chiffre d’affaires soit environ 50 millions de francs français par an pour l’entité<br />
en question<br />
II/ Le coût d’une opération de levage/manutention :<br />
On ne peut pas en réalité donner un coût ou un prix global, en FF/tonne par exemple, en<br />
raison de la grande diversité <strong>des</strong> situations (site de l’opération, configuration<br />
géomorphologique, matériel à utiliser…) qui impose une étude cas par cas.<br />
Toutefois, on propose ci-après une base grossière du coût d’une opération de levage<br />
(uniquement ; il ne s’agit pas ici d’une opération de transport intégrant <strong>des</strong> phases de<br />
manutention) d’une charge indivisible de 600 tonnes, à l’aide de deux grues treillis, qui<br />
s’élèverait à 4 millions de francs français. L’AVEA, avec un coût à l’heure même deux fois<br />
supérieurs au 35000 FF (calcul découlant de l’évaluation faite par Aerospatiale) estimés<br />
serait toujours rentable et les levageurs n’hésiteraient pas à l’utiliser, sous réserve de<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 36
sécurité et de fiabilité, dans le cadre de telles opérations. Notons que ce genre de missions<br />
s’élève à quelques unités par an sur l’ensemble de la France.<br />
La majorité du marché concerne le levage de pièces moyennes d’une cinquantaine de<br />
tonnes mais qui nécessite <strong>des</strong> portées de 90 m et plus, ce qui est extrêmement difficile à<br />
réaliser par grue ; l’AVEA trouverait encore ici une application intéressante économiquement.<br />
III/ L’apport de l’AVEA :<br />
L’Aile Volante serait particulièrement adaptée au levage de pièces même moyennes en<br />
poids mais nécessitant une portée de plus de 50 m.<br />
En outre, avec l’AVEA, on contournerait tous les problèmes actuels de franchissement <strong>des</strong><br />
obstacles qui grèvent le coût <strong>des</strong> opérations de manutention et de levage.<br />
Cependant, certaines caractéristiques de l’AVEA seraient exigées par les levageurs :<br />
- les aspects sécurité et comportement de l’aérostat vis à vis du vent : détermination de la<br />
vitesse maximale d’opération tolérable par l’Aile Volante<br />
- précision du positionnement : elle doit être au moins équivalente à celle d’une grue<br />
- utilisation de l’AVEA : possibilité d’accouplement de deux dirigeables de 500 t pour lever<br />
par exemple une charge de 1000 tonnes (principe utilisé actuellement avec les grues)<br />
- transport sous-élingue et éventuellement en soute interne pour les longues distances.<br />
Dans un tout autre ordre, les levageurs pourraient se constituer en association regroupant<br />
les 5 plus importants européens pour l’acquisition et l’exploitation d’AVEA, soit une part<br />
d’une centaine de millions de FF par partenaire et par appareil, ce qui équivaut au prix<br />
d’achat d’une grue de 1000 tonnes.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 37
Fiche 14 :<br />
12/01/2000<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Ensemblier industriel<br />
I/ Présentation de l’entreprise :<br />
Les activités de cet ensemblier s’exercent dans les domaines de la production et du<br />
traitement d’hydrocarbures, de la pétrochimie et <strong>des</strong> engrais ainsi que dans le domaine<br />
industriel à travers les usines clés en main, les unités de traitement d’eau et de<br />
<strong>des</strong>salement…<br />
Par ailleurs, ce groupe est présent principalement en Europe de l’Ouest, au Moyen Orient et<br />
en Afrique. Son résultat en 1998 s’élevait à 760 millions de francs français.<br />
II/ Le marché actuel et l’AVEA :<br />
Les usines clés en main sont conçues sous forme de modules variant de 30 à 800 tonnes, la<br />
plupart ne dépassant pas les 500 tonnes. Ces ensembles sont construits un peu partout<br />
dans le monde avec une majorité dans les pays à main d’œuvre peu chère comme<br />
Singapour.<br />
Ils sont acheminés par navire roulier ou semi-submersible.<br />
Pour pouvoir disposer de tels vaisseaux, il faut généralement un préavis de 3 à 6 mois et<br />
leur affrètement se chiffre à environ 20'000 $/jour comprenant le coût propre de location du<br />
navire, les frais portuaires, les frais de pilotage et d’amarrage.<br />
Par ailleurs, un bateau de 20000 m 3 rentabilisé permet de charger environ 800 tonnes<br />
(maximum 1'000 tonnes), soit un coût de 70 à 80 $/m 3 chargé.<br />
Cependant, il est assez rare d’opérer en bateau complet ; on aurait alors un coût de 130<br />
$/m 3 pour un colis de 200 à 300 tonnes cubant aux alentours de 2000 m 3 sur une distance<br />
de 5000 km. En utilisant l’AVEA et en projetant un coût moyen de 70'000 FF/h, on aboutirait<br />
à une facture de prestation globale de 3,5 millions de francs français, soit pour un même<br />
colis de 200 à 300 tonnes, un coût de 280 $/m 3 .<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 38
Ce dernier serait inintéressant à premier abord par rapport au 130 $/m 3 pratiqué<br />
actuellement en transport maritime. Toutefois, ce coût de l’AVEA considère une prestation<br />
complète, de l’usine de fabrication du module considéré au site final d’utilisation, ce qui n’est<br />
pas le cas pour le transport maritime qui nécessiterait encore un ou <strong>des</strong> moyens<br />
d’acheminement complémentaires.<br />
Concernant les effets externes de l’AVEA, ceux-ci se résumeraient en :<br />
- un gain de temps : en effet, si le délai est raccourci d’un mois suite à l’usage de l’Aile<br />
Volante et sur la base d’un bonus mensuel de 2 à 4%, on réaliserait un gain de 8 à 16<br />
millions de dollars pour une usine clé en main d’une valeur de 400 millions de dollars.<br />
Toutefois, ce paramètre « gain de temps » (internalisé ou pas) et sa valorisation est à<br />
prendre avec beaucoup de précaution. Cette valeur devra être recoupée avec un<br />
questionnaire basé sur la méthode <strong>des</strong> préférences déclarées afin de réduire tout biais<br />
informationnel.<br />
- une modification du processus de production dans la mesure où certaines opérations<br />
telles l’habillage (calorifugeage, échelles…) du module se feraient désormais en usine<br />
et non plus sur le site final permettant un gain substantiel ; les opérations de finition sur<br />
le site client coûte environ 70 $/m 2 alors qu’il ne reviendrait qu’à 10 $/m 2 en usine.<br />
En outre, l’AVEA impliquerait, en fonction de sa disponibilité, d’autres avantages touchant à<br />
l’aspect « gain de temps » dans la mesure où, pendant la fabrication, il arrive souvent de<br />
procéder à <strong>des</strong> modifications fortuites demandées par le département Engineering Process<br />
et qui entraînent <strong>des</strong> problèmes de délai et par suite un affrètement maritime d’urgence<br />
coûteux ; l’Aile Volante permettrait alors de réaliser ces missions en respectant autant que<br />
possible la date de livraison.<br />
Quant à la tendance d’évolution du marché à moyen voire long terme, celle-ci n’est guère<br />
prévisible car elle dépend d’une multitude de facteurs politico-économiques et de<br />
l’industrialisation <strong>des</strong> pays clients qui peuvent acquérir un savoir-faire pour construire<br />
localement les ensembles qu’on leur expédie actuellement :<br />
- la conjoncture économique (période de crise, de fusion - donc de pause dans les<br />
investissements -…) <strong>des</strong> grosses compagnies pétrolières<br />
- la conjoncture politique <strong>des</strong> pays émergents, demandeurs de raffineries<br />
- le prix du baril ; il fluctue lui-même aléatoirement, ce qui permet aucunement de<br />
« pronostiquer » la croissance du marché…<br />
Cependant, on peut donner ci-<strong>des</strong>sous une photographie du marché actuel :<br />
- en 1999, 55 colis de 90 à 500 tonnes ont été expédiés à Abu-Dhabi (Emirats Arabes<br />
Unis) dont 26 au départ d’Italie, 19 de France - Dunkerque - (parmi lesquels 3 colis de<br />
500 tonnes), 1 du Portugal et 9 de Hollande ; 30 colis à <strong>des</strong>tination de Midar en Egypte<br />
dont aucun au départ de France (tous ont été envoyés à partir de l’Italie et de<br />
l’Espagne) ; pour l’année 2000 courante, il n’y a pas de comman<strong>des</strong> passées par les<br />
pays arabes<br />
- en 2000, 148 colis dont 37 seront expédiés vers le Vénézuela au départ de l’Italie et de<br />
l’Espagne (le reste est au départ de Singapour, de la Corée et du Japon) et <strong>des</strong><br />
comman<strong>des</strong> sont en cours de signature avec les ex- pays satellites de l’URSS<br />
(Turkménistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan)<br />
En résumé, le marché de cet ensemblier se situe principalement à l’étranger et on n’observe<br />
que quelques opérations en France (3 en 1999).<br />
Pour conclure, la société visitée est partisan <strong>des</strong> configurations 200 et 500 tonnes de l’AVEA<br />
et prévoit également un marché naissant du 1000 tonnes éventuellement.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 39
Fiche 15 :<br />
20/01/2000<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : ensemblier industriel<br />
I/ Présentation de l’entreprise :<br />
Il s’agit de l’un <strong>des</strong> principaux ensembliers internationaux de l’industrie para- pétrolière<br />
offshore-onshore. Son activité s’étend également aux services de maintenance,<br />
essentiellement pour les raffineries, les usines pétrochimiques et les plates-formes offshore,<br />
aux travaux de génie civil maritime ou fluvial et à la réalisation de projets clés en main de<br />
terminaux d’importation et de réservoirs de gaz liquéfiés.<br />
II/ Le marché actuel et l’AVEA :<br />
Le colis moyen de l’industrie pétrolière pèse environ 3000 à 4000 tonnes. A première vue, un<br />
engin capable de transporter 500 tonnes est intéressant et probant pour une première<br />
expérience sur le marché mais reste banal ; on devrait proposer également à moyen terme<br />
une configuration AVEA de 1000 tonnes permettant un positionnement précis et qui pourrait<br />
intervenir valablement sur les plates-formes. On pourrait, à ce moment là, si l’AVEA s’avère<br />
rentable d’un point de vue transport, gain de temps…et dans le cas d’opérations nécessitant<br />
un acheminement par route même sur de courts parcours envisager une « modularisation »<br />
de l’ensemble de 2000 tonnes en deux colis de 1000 tonnes chacun ; cette pratique ne<br />
générerait pas de surcoûts au niveau de la production car la conception de ces unités est<br />
modulaire dans son principe de base.<br />
Néanmoins, avec la configuration 500 tonnes, l’Aile Volante réaliserait également <strong>des</strong><br />
opérations de remplacement de pièces tels <strong>des</strong> mâts de 5 à 15 tonnes ou <strong>des</strong> équipements<br />
semi-lourds qui exigent actuellement l’emploi de grues flottantes à raison de 100000 voire<br />
150000 US$/jour. Ce marché de remplacement et/ou d’équipement supplémentaire en plateforme<br />
comprend une quinzaine de missions par an correspondant à la part de Bouygues<br />
Offshore et localisées essentiellement en Afrique.<br />
En outre, l’AVEA pourrait, sous réserve de compétitivité, intervenir sur le marché onshore.<br />
En effet, à titre d’exemple, on réalise actuellement une vingtaine d’unités terrestres de<br />
séparation de compression de gaz de 150 à 200 tonnes unitaires. Avec les moyens<br />
traditionnels, le coût de la partie principale maritime à <strong>des</strong>tination de la Russie s’élève à 1<br />
million de dollars pour les 20 colis dont le transport se fait par groupage générant <strong>des</strong><br />
économies d’échelle par effet de masse, ce que l’AVEA ne permettrait pas compte tenu de<br />
ses 500 tonnes de charge utile.<br />
Par contre, sur <strong>des</strong> opérations similaires et entièrement terrestres (<strong>transports</strong> routier et<br />
éventuellement fluvial) ne favorisant pas le groupage, l’AVEA serait rentable. On peut<br />
prendre comme exemple une opération d’une centaine de tonnes sur 700 km au départ de<br />
Pau et à <strong>des</strong>tination de l’Italie nécessitant un montant de 400000 FF ; l’AVEA pourrait<br />
s’avérer compétitif et même pratiquer du groupage (livraison par paire) dans ce genre<br />
d’opération lorsque le marché le permet et par suite s’emparer d’un tel créneau d’une<br />
trentaine de colis par an qui correspondent uniquement à la part de la société interviewé.<br />
Dans un tout autre ordre, les techniciens chargés du projet AVEA devrait étudier de concert<br />
avec ceux de l’établissement visité certains aspects techniques comme la tenue <strong>des</strong><br />
matériaux en vol, de la peinture qui, pour les activités para-pétrolières, est adaptée à un<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 40
milieu chaud et salé, tout à l’encontre d’un transport sous-élingue qui met en contact la<br />
charge avec un milieu froid en altitude. Ces points, dérisoires pour l’instant, méritent toutefois<br />
une réflexion dès à présent pour ne pas se heurter à <strong>des</strong> incompatibilités lors de la mise sur<br />
le marché de l’AVEA qui pourraient entraver son développement.<br />
On devrait également définir le type de contrat d’affrètement de l’AVEA qui pourrait soit<br />
rejoindre un modèle maritime avec ses 7 clauses parmi lesquelles celle stipulant les<br />
conditions en cas de situation cyclonique, soit un modèle type aérien ou éventuellement un<br />
contrat spécifique Aile Volante empruntant <strong>des</strong> clauses aux pratiques aériennes et maritimes<br />
à la fois.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 41
Fiche 16 :<br />
27/01/2000<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Transporteur et commissionnaire de transport<br />
I/ Présentation de l’entreprise :<br />
Il s’agit d’un groupe présent au niveau de toutes les étapes du transport et intervient :<br />
- dans les <strong>transports</strong> aérien et routier<br />
- dans le transport maritime<br />
- dans la manutention portuaire, le stockage, le courtage et la consignation <strong>des</strong> navires.<br />
Ainsi, le groupe maîtrise l’ensemble <strong>des</strong> métiers du transport :<br />
- organisation du transport international de bout en bout<br />
- agence maritime et logistique portuaire en Europe<br />
- transport maritime de marchandises par lignes régulières<br />
- logistique <strong>des</strong> pays en voie de développement.<br />
Enfin, le groupe a développé un pôle d’excellence dans le transport de colis lourds de<br />
grande taille et d’usines clés en main.<br />
II/ Le marché :<br />
Le marché de ce « consortium » se fait majoritairement à l’international (Afrique, Asie<br />
essentiellement) donc sur de gran<strong>des</strong> distances et reste lié à un transport maritime principal<br />
dont les coûts fluctuent considérablement en fonction <strong>des</strong> caractéristiques chargées, mais<br />
également, <strong>des</strong> configurations <strong>des</strong> pays <strong>des</strong>tinataires.<br />
Ainsi, un affrètement pour le Moyen-Orient et l’Asie coûterait 1,5 millions de francs français<br />
et permettrait de transporter sur un même vaisseau plusieurs colis (groupage). Cependant,<br />
en période de crise asiatique, un affrètement au départ de ces pays coûtait 0 FF car les<br />
armateurs avaient besoin de navire au départ de ce continent ; a fortiori, l’affrètement au<br />
départ d’Europe avait doublé.<br />
Par ailleurs, dans de nombreux ports africains, la location d’un navire reste très coûteuse<br />
(largement supérieure à 2 millions de FF) en raison d’une offre mo<strong>des</strong>te de bateaux à faible<br />
tirant d’eau capables d’y accéder.<br />
III/ L’AVEA :<br />
L’AVEA, sous réserve de compétitivité, pourrait largement être utilisé par le dit groupe pour<br />
le transport de bout en bout ou dans le cadre d’une approche intermodale qui s’avérerait<br />
peut-être plus rentable.<br />
En outre, l’AVEA pourrait également inciter à un redéploiement géographique <strong>des</strong> usines<br />
colis lourds qui se localiseraient dans <strong>des</strong> régions à main d’œuvre peu chère, ce qui<br />
contribuerait à augmenter la part de marché de l’Aile Volante.<br />
Concernant l’exploitation forestière qui est une <strong>des</strong> activités principales de cet « omnium »,<br />
l’usage de l’AVEA en Afrique, où ce groupe exploite le bois, est à bannir en raison de<br />
facteurs socio-politiques : l’AVEA contribuerait dans ce cas à l’appauvrissement <strong>des</strong><br />
populations indigènes qui verraient décroître leur activité de transport par route et de<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 42
manutention ainsi que l’exploitation du chemin de fer ; l’économie de ces pays serait<br />
déstabilisée.<br />
Dans un tout autre ordre, il serait demandé, en temps opportun, <strong>des</strong> précisions quant à la<br />
finesse du positionnement de l’AVEA, son système de treuillage qui déterminera les points<br />
de levage de la charge… et le type de contrat d’assurance prévu.<br />
Par ailleurs, le groupe n’exclut pas l’exploitation future de l’AVEA par l’intermédiaire de son<br />
entité de transport maritime et souhaite participer aux réunions du comité <strong>des</strong> usagers.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 43
Fiche 17 :<br />
9/02/2000<br />
Implantation : Dunkerque<br />
Secteur d’activité retenue : Chaudronnerie<br />
I/ Présentation de l’entreprise :<br />
Il s’agit d’une entreprise opérant dans le secteur de la chaudronnerie, produisant <strong>des</strong><br />
équipements allant jusqu’à 1000 tonnes, de 6 à 7 m de diamètre et de 50 m de long.<br />
II/ Le marché :<br />
Tourné principalement vers l’international, le marché de ce chaudronnier susceptible d’être<br />
intéressé par l’AVEA se chiffre à un dizaine d’opérations par an.<br />
En effet, l’activité <strong>des</strong> réservoirs de stockage construits sur site ne peut rejoindre une<br />
production en usine et un transport éventuel en AVEA moyennant un acheminement<br />
modulaire en raison de la nature même de ces réservoirs à toit flottant sans structure<br />
résistante véritable. Il est toutefois possible, dans le cas de petits réservoirs de 20 à 25 m de<br />
diamètre, de réaliser un transport par AVEA, sous réserve de rentabilité, en raidissant leur<br />
base, leur coiffe et leur robe ; ce type de réservoirs n’est, par ailleurs, pas produits par<br />
l’établissement visité.<br />
Cependant, dans le cadre de cette activité, l’AVEA pourrait être utilisé pour l’acheminement,<br />
vers les sites d’exploitation (surtout dans les pays où les infrastructures manquent ou sont<br />
inadaptées obligeant actuellement à opérer par colis d’une vingtaine de tonnes), de tôles et<br />
d’éléments de charpentes d’une centaine de tonnes unitaires servant dans la construction de<br />
ces énormes réservoirs. Une telle opération d’acheminement <strong>des</strong> tôles…coûte actuellement<br />
de Dunkerque à Carthagène en Espagne, soit un parcours d’environ 2000 km, 1,4 millions<br />
de francs français.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 44
Dans le domaine de la chaudronnerie (marché actuellement en crise mais en voie de<br />
reprendre compte tenu du prix croissant du baril de pétrole), l’AVEA pourrait être utilisé pour<br />
l’acheminement vers <strong>des</strong> sites difficilement accessibles actuellement ou dans le cadre d’un<br />
transport intermodal AVEA/navire (a priori, l’Aile Volante ne pourra pas concurrencer le<br />
transport maritime et réaliser en conséquence une prestation complète de transport sur <strong>des</strong><br />
longues distances - 5000 km et plus -) où l’aérostat opérerait sur la dizaine de kilomètres<br />
séparant le lieu physique de l’établissement visité (l’AVEA enlèverait la charge, une fois<br />
sortie sur rail, de l’aire de stockage, on n’aura donc pas besoin de reconfigurer le site de<br />
l’unité industrielle en question) du port de Dunkerque. Ce transport d’approche serait<br />
compétitif par rapport à la route actuellement pour les gros tonnages qui demandent un<br />
aménagement spécial <strong>des</strong> parcours.<br />
En outre, selon l’organisation d’exploitation de l’AVEA, on l’utiliserait également en bout de<br />
chaîne au niveau <strong>des</strong> pays <strong>des</strong>tinataires (surtout si les infrastructures sont inadaptées ou<br />
inexistantes) où le dirigeable viendrait enlever la charge du navire pour la transporter<br />
directement et sans rupture sur le site final ; ces manœuvres nécessiteraient <strong>des</strong> contrats<br />
globaux avec <strong>des</strong> commissionnaires de transport, en plus de l’accord <strong>des</strong> autorités locales<br />
qui viennent souvent imposer un transitaire indigène - comme c’est le cas notamment dans<br />
certains pays africains - qui ne disposerait pas forcément <strong>des</strong> compétences en vue de<br />
l’usage de l’Aile Volante.<br />
D’autres opérations, minoritaires en nombre, consistant en <strong>des</strong> déplacements ponctuels<br />
intra-usine d’éléments de chaudronnerie ou éventuellement de sphères de stockage dans le<br />
cadre du remodelage <strong>des</strong> unités de production peuvent être réalisées par l’AVEA à un<br />
rythme d’une tous les 2 ans représentant la part dans ce créneau de l’entreprise en question.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 45
Fiche 18 :<br />
Il s’agit là de la <strong>des</strong>cription d’une opération modèle faisant appel à l’industriel-chargeur, au<br />
commissionnaire de transport et au transporteur, selon la pratique actuelle.<br />
16/05/2000<br />
Implantation/origine de la « marchandise » : Meyrin (Genève/Suisse)<br />
Activités concernées : Production d’équipements énergétiques (transformateurs de 3 à 400<br />
t), commission de transport, transport exceptionnel<br />
Opération lourde : Production et livraison d’un transformateur de 346 tonnes pour les Etats-<br />
Unis en février 2000<br />
Trajet emprunté : Meyrin-port de Bâle puis acheminement fluvio-maritime vers les USA<br />
Durée : 15 jours sur le tronçon Meyrin-Bâle uniquement, en transport combiné fer-route en<br />
raison principalement de contraintes structurales au niveau du pont de Harberg qui a exigé<br />
l’usage de wagons ferroviaires spéciaux grevant fortement le coût de transport<br />
Coût estimé : 3 Mio CHF sur le tronçon Meyrin-Bâle<br />
Organisation actuelle :<br />
Les transformateurs sont produits, dans les ateliers d’un gros équipementier à Genève, sur<br />
coussins d’air à l’intérieur d’une halle fermée. Ils évoluent tout au long de celle-ci et sont pris<br />
en charge par un pont roulant qui manutentionne le transformateur et le positionne<br />
directement sur wagon spécial depuis l’intérieur de la halle.<br />
A priori, l’AVEA ne serait pas utilisable par l’industriel-chargeur en question au moins dans<br />
un premier temps en raison de réaménagements nécessaires (halle à toit ouvrant ou<br />
portique pour le prolongement du pont roulant qui ferait sortir le produit de l’atelier pour être<br />
levé et transporté par AVEA) non propices à négociation au moment de l’enquête.<br />
Hormis cet état de fait, il semblerait très intéressant de disposer de l’Aile Volante qui pourrait<br />
s’avérer hautement compétitif pour <strong>des</strong> transformateurs dès 50-60 tonnes de base. En effet,<br />
un transformateur complètement monté prêt à l’usage quadruple son poids initial. En effet,<br />
disposer d’un produit complètement assemblé en usine accroîtra la qualité, permettra une<br />
meilleure gestion <strong>des</strong> coûts (équipe réduite au niveau du site final de livraison…) et <strong>des</strong><br />
délais, ce qui mobilisera également moins les ressources financières engagées. Cependant,<br />
il faudra alors mieux coordonner les différentes équipes impliquées dans le produit final<br />
qu’est le transformateur prêt à l’emploi, c’est à dire que les différentes pièces venant<br />
compléter le module de base doivent être disponible juste à temps et selon l’ordre technique<br />
préétabli ; on ne pourra plus tolérer de décalage dans la production afin de réduire au strict<br />
nécessaire la présence du produit en usine et par suite limité les coûts mobilisés. En outre,<br />
d’un point de vue opérationnel, il faudra également revoir et ce, dès la conception, bon<br />
nombre de détails importants comme l’emplacement <strong>des</strong> points d’attache « AVEAtransformateur<br />
»…<br />
Concernant les attentes de l’industriel en question et de son commissionnaire :<br />
- Positionnement et manutention précis de la charge de l’ordre en vue d’un emplacement<br />
direct sur le site final de livraison et également dans la perspective d’un transport<br />
combiné (AVEA-voie d’eau par exemple)<br />
- Disponibilité en terme d’appareils lors de l’exploitation de l’AVEA<br />
- Délivrance aisée <strong>des</strong> autorisations de survol (il semblerait actuellement impossible<br />
d’obtenir une autorisation de survol de la zone de Meyrin, limitrophe de l’aéroport de<br />
Genève-Cointrin - on se heurterait aux autorités militaires et civiles suisses). Là encore,<br />
le problème de la réglementation intra et inter nations est soulevé et mérite d’être traité<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 46
parallèlement aux évaluations technico-économiques pour pouvoir esquisser au moins<br />
un élément de réponse qui mettrait en confiance les clients pressentis de l’AVEA<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 47
Fiche 19 :<br />
30/05/2000 :<br />
Implantation : Grenoble<br />
Activité : Chaudières industrielles<br />
L’établissement en question est un ensemblier dans la prestation chaudronnerie. Il s’agit<br />
d’une entreprise spécialisée dans la commercialisation de chaudières industrielles pesant<br />
jusqu’à 500 tonnes.<br />
Ce segment se subdivise grossièrement en deux catégories :<br />
- Chaudières mono-directionnelles verticales constituées de plusieurs blocs ; une<br />
chaudière de 500 t peut être composée de 7 compartiments<br />
- Chaudières bi-directionnelles comprenant une partie horizontale (300 t) et une autre<br />
verticale (200 t) ; les dimensions sont de l’ordre de :<br />
♣ Pour la partie verticale : hauteur : 26 m<br />
longueur : 11 m<br />
profondeur : 5 m<br />
♣ Pour la partie horizontale : hauteur : 7,5 m<br />
longueur : 16 m<br />
profondeur : 4 m<br />
Actuellement, les chaudières verticales sont transportées par bloc.<br />
La partie verticale <strong>des</strong> chaudières bi-directionnelles est acheminée par « tronçon de<br />
parcours » et la partie horizontale, en distinguant les vaporisateurs <strong>des</strong> économiseurs<br />
(faisceaux de convection).<br />
D’un point de vue pratique, une remorque prend les modules de chaudières posés sur <strong>des</strong><br />
plots et les achemine un à un jusqu’à l’aire de stockage du client. Là, une grue les prend en<br />
charge et les place aux endroits convenus. Il est à noter que, compte tenu du bras de levier<br />
limité <strong>des</strong> grues, l’entreprise en question est contrainte dans la majorité <strong>des</strong> cas (levage de<br />
30 à 50 m) de faire appel à <strong>des</strong> grues lour<strong>des</strong> de 500 voire 1000 tonnes de capacité pour<br />
<strong>des</strong> charges nominales d’une centaine de tonnes. On dénote ici un surcoût qui pourrait être<br />
occulté par un acheminement et un levage par AVEA.<br />
A ceci s’ajoute les opérations de soudage qui seront faites en atelier et non plus chez le<br />
client, ce qui permet d’écarter tous les coûts liés à l’échafaudage, au calage et à la<br />
délocalisation <strong>des</strong> équipes. En outre, la qualité ne peut être qu’améliorée quand ces<br />
opérations sont faites en usine.<br />
Concernant les coûts, illustrons-les par le transport d’une chaudière verticale de 500 tonnes,<br />
constituée de 7 blocs, sur une distance de l’ordre de 300 à 400 km.<br />
Prix du transport sans levage : 50 000 FF par bloc<br />
Levage :<br />
Prix de la mobilisation/démobilisation de la grue (1000 t) : 350 000 FF<br />
Prix à la journée : 35 000 FF<br />
Soit un total « Transport + Levage » de 875 000 FF.<br />
A ce ceci, on devra ajouter l’équivalent monétaire du temps nécessaire à l’assemblage de la<br />
chaudière chez le client, soit 750 FF/h, ce qui engendre un gain de temps monétarisé de<br />
l’ordre de 100 000 à 200 000 FF en faveur de l’AVEA (Temps épargné d’environ 15 jours).<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 48
D’un point de vue « process », l’AVEA n’induira directement ni la modification <strong>des</strong> processus<br />
de production en profondeur, ni l’émergence sur le marché de chaudières plus puissantes.<br />
Seul <strong>des</strong> soudures supplémentaires définitives seront effectuées en usine en vue d’un<br />
transport par dirigeable ; ces soudures étant pratiquées actuellement chez le client. Par<br />
ailleurs, la construction <strong>des</strong> chaudières se fait horizontalement (hauteur sous crochet faible<br />
au niveau de l’atelier de construction) ; l’AVEA sera donc appelé à prendre, dans un premier<br />
temps, la chaudière horizontalement et à la placer verticalement à une fin d’usage.<br />
Parallèlement à cet aspect, l’Aile Volante pourrait inciter à une modification <strong>des</strong> processus<br />
logistiques de l’établissement visité à deux égards :<br />
- L’entreprise en question est une firme commerciale qui sous-traite la production de ses<br />
chaudières à <strong>des</strong> firmes polonaises, italiennes…Avec l’avènement de l’AVEA combinée à<br />
sa flexibilité et à sa rapidité, elle pourrait traiter sa production avec <strong>des</strong> groupes<br />
asiatiques bénéficiant ainsi d’un gain à l’achat de ses chaudières ; la main d’œuvre<br />
orientale étant meilleur marché que l’européenne (à même niveau de performances et de<br />
qualité, les chaudières asiatiques sont 20 % moins chères)<br />
- Une logique de flux tendus serait appliquée dans ce domaine grâce aux performances du<br />
dirigeable. En effet, on ne fait appel actuellement à la grue pour le levage <strong>des</strong> éléments<br />
de chaudières qu’une fois tous disponibles sur l’aire de stockage du client. Ceci permet<br />
de minimiser le risque de mobilisation d’une grue face au danger latent d’un retard de<br />
livraison de la chaudière.<br />
Avec l’AVEA, sous réserve <strong>des</strong> aléas climatiques (comportement du dirigeable face aux<br />
conditions atmosphériques), on pourrait opérer en flux tendus et gagner 1 semaine au<br />
niveau de la phase transport ; semaine en plus pour la conception en usine ou en moins<br />
pour le client !<br />
A titre d’information, la pénalité de retard de livraison est de 700 000 FF pour une<br />
semaine.<br />
Il est à noter que la pratique du flux tendu ne pourrait être effectivement adoptée par les<br />
entreprises du « lourd » qu’une fois les performances du dirigeable (comportement au<br />
vent… ; soulignons que pour une grue, il est impossible de manœuvrer dès que le vent<br />
atteint les 30 km/h) précisément définies et que ce dernier ait fait preuve de sa fiabilité.<br />
Concernant le marché, il est actuellement de 2 chaudières de 300 à 500 t par an. L’évolution<br />
restera quasi-stable ces prochaines années.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 49
Fiche 20 :<br />
05/06/2000<br />
Implantation : Vernier (Genève)<br />
Activité : Eléments de construction préfabriqués<br />
Il s’agit d’un établissement qui réalise <strong>des</strong> panneaux de construction préfabriqués bidimensionnels<br />
et <strong>des</strong> modules 3D. Son aire géographique commerciale s’étend actuellement<br />
à la Suisse romande.<br />
Parmi ses réalisations, l’entreprise en question a « construit » en 1985 le motel de Fournex<br />
(région Genève-Lausanne) entièrement à l’aide de modules tri-dimensionnels fabriqués en<br />
usine. Cette expérience est restée unique et n’a pas eu d’impact en Suisse romande. Ceci<br />
est à déplorer car la préfabrication offre une qualité de logement meilleure (système optimal<br />
d’isolation phonique, meilleure finition en usine). L’entreprise visitée en a fait l’expérience en<br />
recourant au système NEOPREN permettant de s’affranchir de la chape. Ce système reste,<br />
de surcroît, facile, rapide à mettre en œuvre et moins cher que la construction ordinaire avec<br />
chape et matériaux d’isolation phonique.<br />
De plus, le coût de la préfabrication est moins cher que dans le cas d’une construction<br />
traditionnelle. Notons une réduction probable du coût de la main d’œuvre de 20 à 30%.<br />
Dans cette optique, un système de transport de charges lour<strong>des</strong> tel que l’AVEA constitue<br />
une opportunité certaine pour le développement de la préfabrication.<br />
D’un point de vue exploitation, l’AVEA devra répondre à certaines contraintes :<br />
- précision du positionnement notamment pour l’aboutage de modules : précision du<br />
système « AVEA + cannelures de guidage » de l’ordre du cm<br />
- comportement vis à vis <strong>des</strong> aléas climatiques<br />
- survol <strong>des</strong> zones urbaines et éventuellement pro-aéroportuaires<br />
Marché :<br />
En suisse, le marché de la maison individuelle transportable ne semble pas porteur en raison<br />
d’une volonté aiguë de personnalisation de sa maison. La preuve a été apportée par cette<br />
entreprise et d’autres du même segment qui n’ont pas réussi à pénétrer ce marché. En effet,<br />
la préfabrication, pour être rentable, doit standardiser ses modèles selon <strong>des</strong> formes<br />
géométriques régulières.<br />
En outre, le développement de l’habitat groupé moyenne gamme, <strong>des</strong> chaînes hôtelières et<br />
<strong>des</strong> résidences universitaires (selon la volonté politique) pourraient constituer un élan à la<br />
préfabrication qui serait renforcé par un système de transport comme le dirigeable de<br />
charges lour<strong>des</strong> et/ou encombrantes.<br />
Ainsi, si ce marché se développe et l’AVEA prouve sa fiabilité, <strong>des</strong> entreprises de<br />
préfabrication verraient le jour et d’autres se développeraient davantage. Des « usines »<br />
intégrales de construction apparaîtraient avec <strong>des</strong> chaînes de moulage, de jointure <strong>des</strong><br />
modules, <strong>des</strong> ateliers de peinture, <strong>des</strong> cellules d’équipements d’intérieur…<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 50
Fiche 21 :<br />
05/06/2000<br />
Implantation : Renens (Lausanne/Suisse)<br />
Activité : Bureau d’étu<strong>des</strong> dans les domaines de l’électromécanique et de la construction<br />
hydraulique<br />
Le transport par AVEA serait rentable pour <strong>des</strong> masses indivisibles de plus de 100 t. Un<br />
marché de moins de 100 tonnes existerait au niveau de zones difficiles d’accès. Ainsi, en<br />
Suisse, le Jura serait un pôle pour l’AVEA, principalement pour le transport d’éoliennes (> 50<br />
t).<br />
Concernant la modification <strong>des</strong> processus de production, l’AVEA pourrait avoir un impact<br />
positif sur la conception <strong>des</strong> transformateurs ; on pourrait disposer les bobines de manière<br />
différente offrant plus de facilité et de souplesse dans la fabrication.<br />
Quant aux générateurs, on pourrait fabriquer <strong>des</strong> unités plus performantes donc plus<br />
massives et volumineuses.<br />
D’un point de vue exploitation, outre les contraintes de fiabilité, de disponibilité et de<br />
précision de positionnement, le dirigeable doit être facilement manœuvrable compte tenu<br />
<strong>des</strong> installations électriques (ligne HT) qui peuvent être aux abords <strong>des</strong> zones de<br />
chargement/déchargement.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 51
Fiche 22 :<br />
07/06/2000<br />
Implantation : Orsay (Région parisienne)<br />
Activité : Entreprise de construction / Génie Civil<br />
Le dirigeable interviendrait essentiellement au niveau de la mise en œuvre <strong>des</strong> ouvrages de<br />
franchissement et <strong>des</strong> grands ouvrages d’art en béton, acier et en construction mixte.<br />
Il aura donc un impact direct sur les procédés de construction (méthode par encorbellement<br />
multi-points, par poussage) et indirect sur le dimensionnement <strong>des</strong> structures.<br />
Concrètement, un dirigeable d’une capacité de 1000 t de charge utile transportera une<br />
travée en béton armée, double voie, de L50 m * l13m * E0,6m, soit 400 m 3 de béton.<br />
Ouvrages d’art :<br />
L’AVEA permettrait l’emplacement de voussoirs sur pile (VSP), voussoirs ou tout au moins<br />
leur amorçage (phase la plus délicate) fabriqués en usine.<br />
Pour un AVEA de 500 tonnes, il faut prévoir un voussoir de 400 tonnes de poids propre et<br />
réserver les 100 tonnes restantes aux équipages qui sont une sorte de coffrage métallique<br />
servant à l’assemblage <strong>des</strong> travées ou morceaux de travées venant se fixer au voussoir.<br />
Dans le cas où le voussoir est encastré à la pile, on peut modifier le processus de<br />
dimensionnement et de construction en réalisant l’encastrement du VSP à la pile par <strong>des</strong><br />
barres de précontraintes. A ce niveau, une optimisation <strong>des</strong> coûts « encastrement par<br />
précontrainte + transport et levage par AVEA versus voussoir solidaire à la pile + transport et<br />
manutention conventionnels » doit être considérée.<br />
Il est à noter qu’une réflexion concernant la modification du processus de construction par<br />
AVEA doit être menée. En l’occurrence, l’assemblage progressif <strong>des</strong> travées ou partie de<br />
travées à partir du voussoir engendre un problème de dissymétrie créant à la fois <strong>des</strong> efforts<br />
flexionnel (moment négatif ) et torsionnel (effet du vent sur la structure) qu’il va falloir corriger<br />
au fur et à mesure de l’avancement de la construction (ex : mise en place d’un contrepoids<br />
mobile). Une fois encore, une confrontation <strong>des</strong> techniques disponibles en Génie Civil avec<br />
l’usage du dirigeable lourd doit être menée.<br />
L’aérostat peut également contribuer à la construction <strong>des</strong> piles et pylônes de ponts par<br />
l’empilement <strong>des</strong> différentes sections dont la continuité sera assurée par la précontrainte.<br />
Dès lors, l’AVEA peut, sur le principe, intervenir dans la construction. Toutefois, <strong>des</strong><br />
questions restent poser :<br />
- coût d’exploitation du dirigeable<br />
- aspects techniques : vitesse ascensionnelle, temps de ballastage, précision systémique<br />
du positionnement.<br />
Ouvrages de franchissement :<br />
L’AVEA pourrait assurer le transport et la mise en place de passages supérieurs<br />
d’autoroutes en acheminant l’ouvrage entier ou la moitié de celui-ci entièrement construit en<br />
usine. Au-delà <strong>des</strong> avantages directs « rapidité d’exécution et qualité », la construction via<br />
AVEA permettra de réduire les nuisances du chantier en question en plus d’accélérer<br />
l’ouverture <strong>des</strong> infrastructures routières voire ferroviaires d’où un gain financier intéressant.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 52
Pratiquement, un AVEA de 500 de tonnes de charge utile peut transporter un passage<br />
supérieur de double-voies de dimensions : L20 m, l12 m, E0.8 m.<br />
Tout comme les ouvrages d’art, il faudra, dans le cas <strong>des</strong> ouvrages de franchissement,<br />
prévoir, dès leur dimensionnement, une structure capable de reprendre les efforts engendrés<br />
par l’interface de levage de l’AVEA (taux d’acier nécessaire, …).<br />
Il est à noter que, par rapport aux métho<strong>des</strong> de construction traditionnelles, une importante<br />
économie sera faite au niveau du poste « étaiement » et par suite main-d’œuvre.<br />
- Economie d’étaiement : (20*12) * 6 = 1440 * 100 = 144 000 FF<br />
- Economie sur le temps de transfert <strong>des</strong> étaiements : gain de délai sur les frais fixes de<br />
chantier ⇒ difficile à estimer ; il faut prendre un exemple de cas concret<br />
- Economie d’encadrement du chantier auquel on peut ajouter les frais indirects de<br />
déplacement <strong>des</strong> grues.<br />
Macroscopiquement, un passage supérieur d’autoroute nécessite 4 mois de réalisation. En<br />
utilisant l’AVEA et d’après les premières estimations, on peut gagner 1 mois de travail, soit<br />
25% sur les frais de chantier qui représentent une économie globale de 10% sur le prix de<br />
l’ouvrage.<br />
Ainsi, l’AVEA pourrait être, sous contrainte de coûts, favorablement utilisé dans la<br />
construction, notamment au niveau de sites fluviaux et en altitude, généralement difficiles<br />
d’accès. On préconise un dirigeable de charge utile 1000 tonnes pour la construction en<br />
béton et de 500 tonnes pour la construction métallique (370 kg/m 2 ou 8.5 t/ml). On pourrait<br />
alors transporter <strong>des</strong> parties importantes de ponts, limiter le volume de travail sur site (moins<br />
d’opérations de soudage) et par conséquent améliorer la qualité et réduire les nuisances de<br />
chantier tout en générant <strong>des</strong> économies notables d’un point de vue coûts et délais.<br />
Se plaçant dans une logique d’optimisation réseau, le dirigeable pourrait être rentable sur<br />
<strong>des</strong> chantiers multi-opérations de grande envergure (30-40 km de long). L’AVEA, secondé<br />
ou non par la grue aérostatique, gérera l’ensemble <strong>des</strong> opérations du chantier avec plus de<br />
flexibilité qu’une construction grutée (modification de la logistique <strong>des</strong> chantiers). En outre,<br />
dans de semblables cas, l’indexation tarifaire du dirigeable pourrait être vue à la baisse car<br />
on se trouverait, dès lors, dans une situation de rendements croissants. Pour pouvoir<br />
appréhender correctement ce type d’opérations, il est nécessaire d’effectuer une étude de<br />
cas concrètes. Cependant, il semblerait que de tels cas seraient de plus en plus rares en<br />
Europe occidentale compte tenu de son réseau de communication déjà amplement<br />
développé.<br />
D’un point de vue coûts, il est à retenir qu’un transport par semi-remorque de 20 tonnes préassemblées<br />
sur 500 km revient à 250 FF/t.<br />
En projetant un coût de 35 000 FF par heure de vol effectif pour un AVEA 500t, le transport<br />
sur une distance de 500 km reviendrait à 560 FF/t soit 2 plus cher que la semi-remorque. Par<br />
contre, ce coût de l’AVEA comprend un certain nombre d’avantages que l’on a listé plus<br />
haut. Compte tenu de ces éléments, l’entreprise en question estime acceptable un prix<br />
de l’AVEA de l’ordre de 25 000 FF/h pour le 200 tonnes et de 35 000 FF/h pour le 500<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 53<br />
6 m
tonnes avec une marge d’incertitude de ±30%. Au-delà, l’AVEA ne serait guère<br />
compétitif, même dans une vision systémique.<br />
D’un point de vue « marché », l’établissement en question estime, pour sa part, pouvoir<br />
utiliser l’AVEA 5 à 6 fois par an sur <strong>des</strong> ouvrages d’art et une quinzaine de fois annuellement<br />
dans le cadre de la construction d’ouvrages de franchissement.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 54
Fiche 23 :<br />
08/06/2000<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Activité : Entreprise de construction /Génie Civil<br />
Il est à noter que cette entreprise participe au programme REX (Réalisations<br />
expérimentales) qu’elle a mis au point en partenariat avec le Plan Construction Architecture<br />
du ministère du Logement afin de réfléchir à <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> et <strong>des</strong> procédures plus<br />
performantes pour le secteur du bâtiment. Là, l’AVEA pourrait bénéficier de ce programme<br />
afin de mettre sur pied une simulation de la construction d’un bâtiment ou d’un ensemble<br />
immobilier par la technique du dirigeable lourd.<br />
Génie civil :<br />
Tout d’abord, l’entreprise en question estime que la construction par AVEA, plus<br />
particulièrement celle de ponts, ne peut être rentable que dans deux cas de figure :<br />
- l’ouvrage est complexe et d’une grande envergure (ex : viaduc de Millau, TGV Est)<br />
- l’ouvrage est standard et fait appel à une haute répétitivité <strong>des</strong> tâches et du matériels<br />
(fabrication standardisée, au niveau d’usines de préfabrication, de voussoirs sur pile, de<br />
pylônes …permettant de bénéficier d’économies d’échelles).<br />
En outre, le marché de la construction par AVEA se situerait en majorité dans les pays<br />
développés et à économie de transition. En effet, dans les pays accusant un retard de<br />
développement, les ouvrages sont généralement simples et la main d’œuvre bon marché ;<br />
l’usage de l’AVEA ne serait probablement pas rentable. Par ailleurs, il semblerait que l’AVEA<br />
puisse trouver de nombreuses applications en matière de construction d’ouvrages d’art aux<br />
Antilles où un grand nombre d’opérations est fait par hélicoptère.<br />
Bâtiment – maison individuelle :<br />
Sous réserve <strong>des</strong> coûts d’exploitation de l’AVEA et de contraintes techniques (sensibilité<br />
systémique de pose de l’ordre du mm pour éviter tout choc et fissuration possible), le marché<br />
du bâtiment et de la maison individuelle pré-fabriquée et éventuellement complètement<br />
équipée en usine est à recréer voire à développer. Il est à noter, cependant, que l’usage de<br />
l’AVEA ne serait bénéfique que dans la mesure où le site à construire révèle une forte<br />
répétitivité <strong>des</strong> tâches et un volume d’activité par site au-delà d’un seuil critique de rentabilité<br />
à fixer. Ce serait le cas de la construction de grands ensembles immobiliers où, pour <strong>des</strong><br />
raisons de délais, de prix de revient éventuellement, la structure « poteau-dalle » avec postaménagement<br />
de l’espace intérieur serait délaissée en faveur d’une préfabrication en usine.<br />
Les bâtiments uniques à étages multiples type HLM <strong>des</strong> années 50-60 ne sont plus de mises<br />
et connaissent actuellement un démantèlement à cause de problèmes sociaux qu’ils ont pu<br />
engendrés. On évolue vers <strong>des</strong> constructions Rez +4, Rez +5 avec une moyenne de 23<br />
logements par bâtiment.<br />
Aussi, pour être compétitif avec l’AVEA, il faudrait un ensemble de bâtiments R +4, R+5 pour<br />
disposer d’une haute répétitivité ; standardisation de la construction et <strong>des</strong> éléments à mettre<br />
en place.<br />
De même, on ne dispose actuellement pas d’unités importantes de production de modules<br />
pour bâtiments compte tenu <strong>des</strong> problèmes de transport (acheminement <strong>des</strong> modules) qui<br />
se posent et surtout du caractère particulier et diffus <strong>des</strong> constructions. Il est à constater que<br />
le désir <strong>des</strong> clients du BTP est à la différenciation par rapport au voisin, ce qui n’est pas le<br />
propre <strong>des</strong> usines de préfabrication. A cet effet, et sous réserve d’une réelle rentabilité de la<br />
construction par AVEA, il faudra élargir le choix proposé au « consommateur » afin de ne<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 55
pas aboutir à une homogénéisation de l’espace, largement refusée par la société. La<br />
localisation <strong>des</strong> unités BTP de production et leur spécialisation éventuellement régionale<br />
doivent être soigneusement pensées et faire l’objet d’une évaluation coûts-avantages qui ne<br />
peut être correctement menée qu’à travers un cas concret représentatif du futur habitat préfabriqué.<br />
Aussi, la typologie du marché, le plan de charge du BTP en France, l’analyse <strong>des</strong><br />
besoins et la nature <strong>des</strong> spécificités régionales permettront de choisir l’emplacement <strong>des</strong><br />
unités de production/construction et leur nombre à l’échelle nationale.<br />
Il faut toutefois remarquer que l’AVEA peut favoriser le développement du marché moyenne<br />
gamme de la maison individuelle tel qu’il a été initié par les maisons Phoenix (Groupe Misa).<br />
Notons au passage, pour la construction d’ensembles résidentiels, le problème de<br />
l’intervention de l’AVEA en site péri-urbain voire urbain. La réglementation doit se pencher<br />
dès à présent sur ce problème.<br />
Par ailleurs, dans le cadre <strong>des</strong> programmes de lutte contre l’habitat insalubre développés par<br />
certaines régions en voie de développement, l’AVEA peut contribuer à une urbanisation<br />
rapide sous réserve de l’acceptation de ces pays et de la facilitation <strong>des</strong> procédures<br />
administratives (taxes <strong>des</strong> produits finis importés). A noter que l’AVEA peut être, le cas<br />
échéant, exploité par les dites zones.<br />
En conclusion, la firme interviewée n’a pas vocation de faire actuellement de la maison<br />
individuelle. Son champ d’activités est national et international, principalement en Afrique où<br />
elle intervient via la garantie FMI. Si l’opportunité se présente, elle étudierait soigneusement<br />
la solution AVEA en analysant ses caractéristiques (techniques et comportementales –<br />
sensibilité aux conditions climatiques ?) et livrant ainsi les conditions d’utilisation<br />
(comportement, conditionnement nécessaire <strong>des</strong> matériaux).<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 56
Fiche 24 :<br />
13/06/2000<br />
Implantation : Winthertur (Suisse)<br />
Activité : Construction de moteurs marins<br />
Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans le commerce de moteurs marins produits sous<br />
licence en Asie et dans certains pays européens où existe encore une certaine dynamique<br />
<strong>des</strong> chantiers navals.<br />
Les moteurs marins pèsent de 100 à 2000 tonnes pièce. Les plus gros producteurs sont la<br />
Corée, la Chine, l’Italie et la Pologne.<br />
Concernant la Corée et la Chine, tout est prévu de manière à ce que le moteur soit<br />
facilement intégré au bateau. L’AVEA pourrait éventuellement être utilisé de manière<br />
ponctuelle pour faire face à un retard dans les plannings de production. Il faudrait toutefois<br />
connaître avec précision le processus de fabrication et la structure <strong>des</strong> coûts pour délimiter<br />
adéquatement le marché de l’AVEA. A noter, par exemple, que Hyundaï produit en moyenne<br />
deux bateaux par semaine.<br />
En effet, en Corée du Sud, la production de moteurs marins se fait à Ulsan. La majorité <strong>des</strong><br />
<strong>transports</strong> se font par voie fluvio-maritime. Un transport Ulsan-Rostock, soit 10 000 km (4 à 5<br />
semaines de bateau), coûte 500 000 $ US pour 1900 tonnes réparties en 75 colis dont les 3<br />
plus important font 550 t, 490 t et 330 tonnes.<br />
En Pologne, la production de moteurs marins se fait à Poznan et sont acheminés par voie<br />
terrestre jusqu’à Gdansk ou Gdynia sur la mer Baltique, soit sur un parcours de près de 300<br />
km, en ligne droite, où l’AVEA pourrait opérer.<br />
De manière générale, l’AVEA n’induira pas de modification au niveau <strong>des</strong> processus de<br />
production (moteur à 2 temps) mais immanquablement au niveau de la chaîne logistique.<br />
Pour pouvoir caractériser ce changement au niveau logistique, une convention d’étude<br />
devrait être adoptée avec les principaux commissionnaires de transport (Danzas, TNT,<br />
KuehneNagl, Panalpina) représentant l’établissement visité et ses fournisseurs (Hyundaï<br />
Heavy Industries Corporation LTD*, Hanjin Heavy Industries ; ces entreprises pourraient<br />
fournir une vision plus juste de l’importance du marché <strong>des</strong> moteurs marins à l’égard de<br />
l’AVEA).<br />
Par ailleurs, la société en question dispose d’un marché de 5 moteurs marins lourds<br />
(moyenne 500 tonnes ; 15 moteurs de plus de 100 tonnes) en moyenne par an, réalisant la<br />
plupart <strong>des</strong> transactions commerciales « marines » au départ d’Asie.<br />
Concernant l’AVEA et hormis <strong>des</strong> opérations ponctuelles (retard dans les plannings de<br />
production induisant un retard de livraison et <strong>des</strong> pénalités conséquentes, opérations<br />
urgentes), le marché en question n’est de loin pas conséquent. Il s’agit d’un marché de faible<br />
activité. Dans le cas d’un transport par AVEA de moteurs marins, il faudra assurer un<br />
conditionnement adéquat du moteur et un calage de ce dernier par soudage au berceau de<br />
transport afin d’éviter toute vibration néfaste.<br />
* Hyundaï Heavy Industries Corporation LTD<br />
Engine and machinery division<br />
M. K.H KIM<br />
General Manager<br />
1, Cheonka-Dong, Dong-Ku / Ulsan – République de Corée<br />
Tel : 0082 52 230 7281 / 7287 à 7290<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 57
Fax : 0082 52 250 9811 / 230 7427<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 58
Fiche 25 :<br />
15/06/2000<br />
Implantation : Lyon<br />
Activité : Equipements industriels<br />
Il s’agit d’une entreprise qui conçoit, fabrique et met en place <strong>des</strong> équipements mécaniques<br />
lourds, ou complexes, de très haute technicité. Elle intervient ainsi dans les domaines<br />
pétroliers (gaziers), énergétiques, de l’industrie lourde (manutention, levage), du Génie Civil<br />
(tunneliers) et dans le cadre d’applications spécifiques (systèmes automatisés - télescopes,<br />
enceintes, centrifugeuses …-, réalisations industrielles - pales, moules, bâtis de moteurs,<br />
corps de turbines …-).<br />
Parmi les applications spécifiques traitées par cette firme, on trouve le transport d’un<br />
télescope de 580 t (280 t pour la partie pivotante et 300 t pour le reste) depuis le Creusot<br />
jusqu’à Hawaï et son implantation à 4500 m d’altitude ou encore le transport et la mise en<br />
place de la rotule de la future digue de Monaco (partie mécano-structurée assurant la liaison<br />
entre la digue et la culée) d’un poids unitaire de 280 t.<br />
Schéma industriel :<br />
L’entreprise en question sous-traite en général les composants entrant dans la fabrication de<br />
ses machines. Lors de la sous-traitance de parties lour<strong>des</strong> et/ou encombrantes, <strong>des</strong><br />
problèmes de transport vers le lieu d’assemblage final du Creusot se posent, en plus d’une<br />
perte de productivité liée aux opérations de montage à blanc chez le fournisseur, de<br />
démontage pour les besoins du transport et enfin de remontage au niveau de l’usine de<br />
production de l’établissement visité.<br />
A cette phase, succède celle du morcellement du produit fini pour <strong>des</strong> raisons de livraison au<br />
client final. La chaîne de transport utilisée comprend la route, le fluvial et le maritime avec<br />
une contrainte majeure au niveau de la disponibilité <strong>des</strong> moyens de transport, notamment le<br />
mode maritime où, pour <strong>des</strong> raisons de délais, l’entreprise décrite ici est contraint d’affréter<br />
<strong>des</strong> navires spéciaux pour ses <strong>transports</strong> d’où un surenchérissement <strong>des</strong> coûts avec,<br />
cependant, un risque notable de dépassement <strong>des</strong> délais (pénalités de retard d’où<br />
contraction d’assurances complémentaires). Le transport maritime reste très aléatoire.<br />
Aussi, l’AVEA devrait être disponible et offrir <strong>des</strong> garanties sérieuses concernant le respect<br />
<strong>des</strong> délais ⇒ définition du nombre d’AVEA en exploitation à différents horizons compte tenu<br />
du volume global prévisible du marché en faveur du dirigeable lourd et simulation d’une<br />
exploitation en réseau de l’AVEA en fonction <strong>des</strong> principales liaisons O-D pressenties,<br />
simulation du comportement de l’AVEA vis à vis <strong>des</strong> aléas climatiques/courbe analytique<br />
d’exploitabilité.<br />
Tunneliers :<br />
Une <strong>des</strong> applications les plus prometteuses pour l’AVEA est le transport de tunneliers (tête<br />
de tunnelier puis remorques).<br />
Un tunnelier est une machine d’excavation composée <strong>des</strong> parties suivantes :<br />
- Une tête de coupe<br />
- Un bouclier<br />
- Un train suiveur constitué de remorques et d’une table de convoyage de voussoirs<br />
On trouve <strong>des</strong> petits tunneliers de quelques centaines de tonnes et <strong>des</strong> plus gros pouvant<br />
atteindre plusieurs milliers de tonnes équipés.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 59
L’apport de l’AVEA se situerait essentiellement au niveau de la modification et de la<br />
simplification de la chaîne de transport et <strong>des</strong> intermédiaires qui y interviennent. Au niveau<br />
de la production, il n’y aura pour ainsi dire pas d’évolutions notables en raison de contraintes<br />
déterminantes non liées au transport : transport amont <strong>des</strong> composants sous-traités,<br />
construction multi-blocs pour <strong>des</strong> besoins de maintenance et de sécurité (redondance <strong>des</strong><br />
systèmes électriques le plus souvent), de manutention en usine de production, utilisation du<br />
tunnelier à partir de puits de <strong>des</strong>cente où une certaine maniabilité est requise …L’AVEA<br />
pourrait seulement limiter les opérations de désassemblage en usine, ainsi que le nombre de<br />
modules constituant le tunnelier. En effet, moins on a de « morceaux », plus les opérations<br />
de montage/démontage sont économiques et les essais réalisés en amont faciles à<br />
exécuter.<br />
Par ailleurs, l’AVEA permettrait également le transport en masse indivisible <strong>des</strong> remorques<br />
du tunnelier équipées ou non, une à une ou groupées si le poids le permet. Notons que<br />
certaines remorques équipées pèsent jusqu’à 900 t l’unité.<br />
Marché :<br />
D’un point de vue marché et compte tenu de l’activité générale de la firme enquêtée, sur les<br />
300 10 6 FF de chiffre d’affaires, la moitié pourrait être concernée par un transport par AVEA<br />
dont le 1/3 serait constitué d’opérations sur territoire français, les 2/3 restant <strong>des</strong>tinés à<br />
l’international (Europe + Chine essentiellement).<br />
Contraintes :<br />
Parmi les contraintes assignées à l’AVEA, on retrouve par ordre d’importance :<br />
1/ Fiabilité de l’AVEA ⇒ intégrité de l’équipement (impact sur le taux <strong>des</strong> primes<br />
d’assurance)<br />
2/ Précision du positionnement à l’empotage et au dépotage dur l’AVEA<br />
3/ Respect <strong>des</strong> délais, ce qui implique disponibilité <strong>des</strong> moyens de transport<br />
Etude de cas :<br />
A la suite de cette présentation générale, il a été convenu le 18 janvier 2001 de procéder à<br />
une étude d’un cas concret visant le transport de deux tunneliers équipés de 650 tonnes<br />
chacun (5.71 m de diamètre) <strong>des</strong>tinés à l’excavation <strong>des</strong> tunnels (sur 14 km) du mini-métro<br />
automatique de la ville de Copenhague.<br />
Cette étude de cas est en cours de réalisation. On présentera ci-après une <strong>des</strong>cription du<br />
scénario de transport conventionnel avec <strong>des</strong> premières remarques quant à l’apport de<br />
l’AVEA.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 60
Un <strong>des</strong> deux tunneliers du métro<br />
automatique de Copenhague<br />
Système électrique (moteurs et câblage) :<br />
L’AVEA permettrait la suppression de<br />
quelques liaisons électriques suite au<br />
« packaging » qu’il pourrait opérer<br />
Tête et boucliers du tunnelier<br />
Manutention <strong>des</strong> composants du tunnelier<br />
(ici un bouclier) : <strong>des</strong>cente dans le puits<br />
d’excavation. L’AVEA devrait également<br />
opérer avec précision sur <strong>des</strong> éléments<br />
manifestement plus lourds et plus<br />
volumineux<br />
Plusieurs solutions de transport se présentaient pour le transport <strong>des</strong> deux tunneliers de<br />
Copenhague de l’usine de l’établissement en question (Le Creusot) au site de Copenhague.<br />
Cinq solutions ont été étudiées :<br />
1- Le Creusot-Châlon et Le Creusot-Arles (pour trois colis hors-gabarit ne pouvant pas<br />
emprunter le trajet Le Creusot-Châlon) : Route<br />
Châlon-Fos : Barge<br />
Fos-port Copenhague : Navire<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 61
Port-site Copenhague : Route<br />
Montant ex ante : 1421 KFF pour un tunnelier<br />
2- Le Creusot-Châlon et Le Creusot-Arles (pour trois colis hors-gabarit ne pouvant pas<br />
emprunter le trajet Le Creusot-Châlon) : Route<br />
Châlon-Copenhague : Fluvio-maritime<br />
Copenhague-site : Route<br />
Montant ex ante : 1183 kFF pour un tunnelier<br />
3- Le Creusot-Strasbourg : Route<br />
Strasbourg-Anvers : Barge<br />
Anvers-Copenhague : Navire<br />
Copenhague-site : Route<br />
Montant ex ante : 1366 kFF pour un tunnelier<br />
4- Le Creusot-Strasbourg : Route<br />
Strasbourg-Copenhague : Fluvio-maritime<br />
Copenhague-site final : route<br />
Montant ex ante : 1213 kFF pour un tunnelier<br />
5- Le Creusot-Le Havre : Route<br />
Le Havre-Copenhague : Navire<br />
Copenhague-site : Route<br />
Montant ex ante : 1628 kFF pour un tunnelier<br />
Le comparatif ci-<strong>des</strong>sus a permis de ne retenir que les deux solutions les plus économiques<br />
pour poursuivre la négociation. On voit ici que le coût reste le paramètre prépondérant.<br />
D’après le questionnement opéré auprès de l’entreprise ici décrite, les paramètres<br />
déterminants pour le choix de l’AVEA seraient, en premier lieu, le coût puis la fiabilité et la<br />
disponibilité du système. Viendront ensuite d’autres paramètres tels que la facilitation du<br />
processus et <strong>des</strong> opérations logistiques, la diminution du nombre d’intermédiaires …<br />
Il est à noter que le changement <strong>des</strong> colisages de remorques (largeur passant de 4.1 et 4.3<br />
m à 4.5 et 4.7 m) a conduit à changer le type de bateau d’où un surcoût par rapport aux<br />
estimations financières ci-<strong>des</strong>sus. La location du bateau est passé de 540 kFF à 770 kFF.<br />
On retrouve ici une notion d’encombrement, pratiquement inexistante dans le cas de l’AVEA<br />
qui est plus flexible à cet égard.<br />
Par ailleurs, l’entreprise en question a négocié et passé les comman<strong>des</strong> séparément pour :<br />
- le transport routier d’approche (France)<br />
- le chargement <strong>des</strong> bateaux (port lourd et aproport)<br />
Le reste de la prestation ne peut pas être séparée car il faut mieux faire assurer la gestion<br />
<strong>des</strong> interfaces et ruptures de charge par un seul interlocuteur.<br />
- chargement de colis à Arles<br />
- déchargement <strong>des</strong> colis au port de Copenhague<br />
- transfert sur site<br />
- déchargement <strong>des</strong> camions sur site<br />
En outre, la solution Châlon a été retenue car :<br />
- l’acheminement via Strasbourg est impossible en cas de « basses eaux » sur le Rhin<br />
- la solution fluvio-maritime est éprouvée<br />
- les prestataires intervenant dans l’acheminement sont connus<br />
- il s’agit de la solution meilleur marché<br />
Encore une fois, on remarque le poids à donner aux paramètres fiabilité de la solution<br />
(disponibilité de l’AVEA, sensibilité connue et maîtrisée aux aléas climatiques …afin de<br />
forger une image de confiance chez le client-industriel). En outre, un transport intégral par<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 62
AVEA permet une visibilité plus claire car le nombre d’intervenants dans la chaîne de<br />
transport se trouve notablement réduit.<br />
En résumé, le transport intégral par AVEA permettra de :<br />
- diminuer les coûts liés à l’assemblage et au désassemblage en usine<br />
- réduire le nombre de lots de transport et les coûts de conditionnement s’y référant<br />
- simplifier la chaîne logistique de transport en limitant le nombre d’intervenants, en<br />
éliminant les multiples interfaces et ruptures de charge se trouvant pour la plupart sur un<br />
chemin critique en matière d’ordonnancement, en évitant les stockages intermédiaires<br />
nécessaires pour optimiser le plan de charge <strong>des</strong> navires<br />
- gagner du temps qui sera utilisé pour fabriquer le tunnelier ; il s’agira ici plutôt d’une<br />
satisfaction orientée client qu’un gain pouvant être monétarisé.<br />
Une remarque primordiale s’impose et devient critique quant à la résolution du cas présent :<br />
il s’agit d’un effet réglementaire concernant l’autorisation d’opérer en site urbain, en<br />
l’occurrence Copenhague. A défaut de réponse précise, les personnes chargées de la<br />
réglementation et de la certification de l’AVEA devront fournir une grille d’évaluation se<br />
basant sur <strong>des</strong> éléments techniques propres à l’aérostat permettant d’appréhender une<br />
probabilité quant à l’octroi de l’autorisation ; démarche empruntée aux autorisations<br />
d’opérations en site urbain dans le cas <strong>des</strong> hélicoptères.<br />
La suite de cette étude de cas sera consacrée à définir plusieurs scénarii probables qui<br />
seront décrit qualitativement et quantitativement.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 63
Fiche 26 :<br />
16/06/2000<br />
Airbus Industrie : Transport du fuselage et de la voilure de l’A 380<br />
Implantation : Toulouse<br />
Activité : Constructeur d’avion<br />
- A ne pas diffuser -<br />
Airbus est en phase de développement de son très gros porteur, l’A 380. A noter que le<br />
marché potentiel <strong>des</strong> très gros porteurs est estimé dans les 25 ans à venir à 1200 avions<br />
passagers et 300 cargo. Airbus compte détenir environ la moitié de ce marché.<br />
Compte tenu du caractère européen de l’entreprise, la voilure de l’A 380 sera fabriquée à<br />
Silchester (Royaume-Uni), le fuselage à Saint-Nazaire et à Hambourg selon le type de<br />
modèle (différenciation par spécialisation du site). L’assemblage se fera à Toulouse. Il se<br />
pose alors un problème quant à l’acheminement de la voilure et du fuselage, sachant qu’ils<br />
sont hors gabarit pour le Beluga (problème d’encombrement) et nécessiteraient alors un<br />
découpage multi-blocs insatisfaisant d’un point de vue production industrielle. La solution<br />
retenue actuellement est la voie combinée maritime/route avec tous les impacts qu’elle peut<br />
occasionner. Des tronçons routiers devront alors être aménagés en conséquence, voire<br />
construits, et sauvegardés.<br />
Toutefois, compte tenu de la durée prévue de production de l’A 380 (dont la mise en<br />
exploitation se ferait fin 2003) sur près de 30 ans, la solution par dirigeable lourd (AVEA et<br />
Cargolifter) n’est pas écartée et fera l’objet d’une évaluation par les services appropriés<br />
d’Airbus Industrie.<br />
Les spécificités suivantes doivent être retenues :<br />
Poids maximum <strong>des</strong> pièces : 60 à 100 tonnes<br />
Volume : (L)45 m * (l)10 m* (h)2.5 m pour la voilure<br />
(L)25 m * (l)8 m *(h)9 m pour le fuselage<br />
A cet effet, il est demandé un contenant de dimensions 50 m *15 m *10 m.<br />
Par ailleurs, il est à noter que <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> précises devront être menées sur le plan technique<br />
où un dossier AVEA devra être remis, comportant en outre <strong>des</strong> indication contenant le prix<br />
<strong>des</strong> prestations AVEA « transport et levage ». Une étude logistique devra également être<br />
menée en collaboration avec les gestionnaires de projet d’Airbus où une optimisation réseau<br />
AVEA sera réalisée afin de minimiser les coûts d’exploitation. Avec la possibilité de faire du<br />
groupage, une solution de type concept « omnibus » serait étudiée. L’AVEA transporterait, à<br />
la fois, la voilure (à partir de Silchester) et le fuselage (à partir de Saint-Nazaire ou de<br />
Hambourg) d’un même appareil.<br />
Parmi les paramètres techniques à étudier, on relève :<br />
- le comportement de l’AVEA face aux aléas climatiques/courbe analytique d’évolution<br />
- la stabilité en vol et les effets de « couche limite » se développant à proximité du sol<br />
- la précision du positionnement : <strong>des</strong>cription technique <strong>des</strong> moyens à mettre en œuvre<br />
- l’équilibrage <strong>des</strong> masses ; problème se posant par ailleurs de manière accrue au<br />
Cargolifter<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 64
Fiche 27 :<br />
19/06/2000<br />
Implantation : Tolochenaz (Suisse)<br />
Activité : Transporteur<br />
Friderici SA est spécialisée dans tout type de <strong>transports</strong> et de levages :<br />
- Transport conventionnel, groupage et lots complets<br />
- Transport en vrac<br />
- Transport de denrées alimentaires<br />
- Déchets industriels et voirie<br />
- Transports exceptionnels suisses et internationaux<br />
- Logistique et entreposage<br />
- Levage, manutention et déménagements industriels<br />
Dans le domaine du transport exceptionnel, le transporteur en question a réalisé de<br />
nombreux acheminements dont le transport d’un transformateur de 346 tonnes -<br />
(L)10766mm, (l)4290mm, (H)4550mm - de Genève à Bâle, en février 2000. Ci-<strong>des</strong>sous,<br />
quelques précisions concernant ce transport.<br />
Véhicules du convoi :<br />
1 Merce<strong>des</strong> 8*6 lesté<br />
1 Iveco 8*6 lesté<br />
1 Iveco 4*4 lesté<br />
1 semi-remorque Nicolas 10 lignes (AV)<br />
1 semi-remorque Nicolas 12 lignes (AR)<br />
3 voitures d’escorte<br />
Véhicules annexes :<br />
1 Merce<strong>des</strong> 8*4 avec grue de 12 t<br />
1 Manitou MRT 1850<br />
1 grue hydr. 80 t<br />
Divers tracteurs et semi-remorques<br />
Sortie du parking ABB :<br />
Mise en place de 100 tonnes de tôles de 30 mm, y compris dallages pour couverture de 36<br />
m de voies de chemin de fer et 50 m de parking<br />
Pont de la parquetterie à Romont :<br />
Mise en place de 80 tonnes de tôles de 30 mm et ponts métalliques pou « chevaucher » le<br />
pont en béton existant sans toucher la dalle route<br />
Gare de Morat :<br />
Platelage de la cour et renforcement par ponts métalliques pour compenser la mollesse du<br />
sol<br />
Il est à ajouter à tout cela le relevage de lignes électriques, la réparation de routes<br />
endommagées par le convoi, le contournement de certains tronçons non praticables ce qui<br />
allonge le trajet, les préparatifs techniques et administratifs qui, dans le cas présent, ont fait<br />
l’objet d’étu<strong>des</strong> qui ont duré près de deux ans ainsi que toute la logistique qui prévaut dans<br />
un tel type de transport qui a coûté près de 3 millions de Francs suisses (12 10 6 FF). A noter<br />
que les seules autorisations de passage communales et cantonales ont atteint la somme<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 65
d’environ 320000 FF, escortes comprises, et ce pour un parcours routier qui se situera aux<br />
environs de 250 km.<br />
Le transport hors-normes par dirigeable ne sera plus soumis aux limitations <strong>des</strong> gabarits<br />
routiers, ferroviaires et fluviaux, éliminera une bonne partie du temps consacré aux étu<strong>des</strong><br />
d’acheminement du convoi, les coûts techniques de relevage <strong>des</strong> lignes, de renforcement<br />
<strong>des</strong> ponts …, permettra de concevoir <strong>des</strong> pièces dans une logique indépendante du<br />
transport (quoique la modification <strong>des</strong> processus de production de pièces lour<strong>des</strong> ne sera<br />
pas déterminant), améliorera la productivité en usine (suppression <strong>des</strong> coûts de<br />
montage/démontage à une fin de transport), simplifiera la logistique à mettre en place et<br />
réduira les nuisances du transport exceptionnel routier (pollutions environnementale et<br />
visuelle versus bilan externe du dirigeable lourd). Dans certains cas, le coût du transport par<br />
AVEA pourrait même être meilleur marché. Seules <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de cas concrets et une<br />
analyse statistique permettront de vérifier cette affirmation.<br />
De manière générale et sous réserve du degré de sensibilité de l’AVEA aux aléas<br />
climatiques, il s’agit, à premier abord, d’un moyen plus sûr, plus apte à respecter les délais<br />
de livraison par rapport à un transport fluvial obligé où il est courant, par exemple, de devoir<br />
attendre un niveau d’eau adéquat pour opérer. Lors d’un transport effectué par le<br />
transporteur ici décrit entre Châlon et Bâle, ce dernier a dû retarder, de 5 semaines, le<br />
bateau chargé en raison <strong>des</strong> hautes-eaux sur le Rhin. Il s’agit là d’un risque important car il<br />
génère, non seulement, <strong>des</strong> pénalités de retard mais également une surfacturation liée aux<br />
frais d’immobilisation du matériel annexe et de grue. Il est à noter que l’immobilisation d’une<br />
grue de 400 t peut coûter de 32000 FF à 80000 FF/jour ; à ajouter à cela, le coût de location<br />
qui se situe entre 20000 et 60000 FF, la journée !<br />
Ce risque n’est pas couvert entièrement par les assurances et génère <strong>des</strong> taux de prime<br />
extrêmement élevés.<br />
Marché de l’AVEA :<br />
Au niveau du transporteur en question, le marché actuel de l’AVEA serait, en moyenne, de<br />
10 à 20 opérations par an en Suisse et France voisine, comprenant le transport<br />
d’équipements énergétiques lourds et le levage de ponts/passerelles à une fin de<br />
remplacement. Là, les critères de fiabilité, de rapidité et de précision de pose (similaire à<br />
celle d’une grue) seront exigés. Les aspects logistiques devront également être étudiés en<br />
détail et quantifiés (coûts d’aménagement <strong>des</strong> aires de chargement/déchargement de<br />
l’AVEA, modification du tracé <strong>des</strong> lignes H.T se trouvant, en général, à proximité <strong>des</strong><br />
« usines-chargeurs » et clients.<br />
Par ailleurs et en guise d’indication, pour un parcours d’environ 300 km, exigeant une durée<br />
de 10 h (comprenant le transport à proprement dit, le chargement/déchargement de la pièce<br />
transportée et les phases d’approche), un coût horaire de 25000 à 35000 FF pour 200 t reste<br />
intéressant, dans la mesure où il correspond approximativement au tarif pratiqué par la voie<br />
ferrée pour autant que le colis accepte le gabarit ferroviaire !<br />
Dans le cas de coûts de transport particulièrement élevés par dirigeable (effets de distance),<br />
un mode combiné où l’AVEA - à la place du transport routier - effectuerait les <strong>transports</strong><br />
terminaux, en bout de chaîne, devrait être envisagé.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 66
Fiche 28 :<br />
20/06/2000<br />
Implantation : Lausanne (Suisse)<br />
Activité : bureau d’étu<strong>des</strong> en Génie Civil<br />
L’AVEA serait profitable dans le domaine de la construction en montagne<br />
(restaurants/bâtiments, pylônes, éoliennes), <strong>des</strong> ouvrages d’art, de l’hydraulique et <strong>des</strong><br />
lignes de gazoducs de grand gabarit. Pour ce dernier point, un marché intéressant serait en<br />
développement en Libye.<br />
D’un autre côté, l’AVEA serait particulièrement adapté au transport de tunneliers qui exigent<br />
actuellement 3 à 4 mois de remontage sur site d’opérations, d’où, dans ce cas, une valeur<br />
monétarisée du temps qui permet un commencement prompt <strong>des</strong> travaux. Par ailleurs, grâce<br />
à l’AVEA, la réutilisation du tunnelier ne serait plus problématique car l’on pourrait facilement<br />
le récupérer.<br />
Par ailleurs, l’AVEA pourrait induire un redéploiement géographique de l’industrie de la<br />
construction dans la mesure où, actuellement, les usines de préfabrication de voussoirs pour<br />
ponts et tunnels sont localisées à proximité de chantiers et ont une durée de vie limitée à<br />
celle du chantier qu’elles approvisionnent, ne bénéficiant nullement d’économies d’échelle<br />
(favorisées par une extension <strong>des</strong> aires de marché), ni de probables économies d’envergure<br />
dans le cas d’une multi-production. La rentabilité et le potentiel de productivité de l’usine s’en<br />
trouvent alors réduits.<br />
A cet effet, s’ajoute celui d’un cycle d’approvisionnement limité dans la mesure où les<br />
camions ne peuvent transporter plus de 60 voussoirs par jour, ce qui influe sur le rythme<br />
d’avancement du chantier ; de plus, ces <strong>transports</strong> sont mal appréciés par les autorités qui<br />
veulent limiter les nuisances occasionnées (bruit, pollution locale - émissions toxiques de<br />
soufre, d’oxyde d’azote et de composés organiques volatils -, augmentation sporadique du<br />
trafic, usure <strong>des</strong> chaussées, augmentation du risque d’accidents, dénaturalisation du<br />
paysage et impacts indirects sur la faune et la flore … autant de coûts externes à la charge<br />
de la collectivité !).<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 67
Fiche 29 :<br />
21/06/2000<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Entreprise de construction / Génie Civil<br />
Pour ces entreprises de construction / Génie Civil, l’analyse AVEA est à discrétiser en<br />
fonction <strong>des</strong> trois volets suivants :<br />
- construction de bâtiments, secteur le plus actif dans le domaine du BTP puisqu’il connaît<br />
une croissance soutenue et représente plus de la moitié du chiffre d’affaires généré par<br />
le génie civil dans sa globalité<br />
- construction de ponts, d’ouvrages d’art de grande envergure, d’ouvrages souterrains<br />
(transport de tunneliers) …<br />
- constructions complexes : ex :couverture de stade préalablement construite et<br />
assemblée en usine que l’AVEA transporterait et mettrait en place grâce au concours<br />
d’éléments de levage et de positionnement annexes. Une étude de cas comparative<br />
concernant la simulation de la mise en place de la couverture du Stade de France serait<br />
significative pour démontrer la rentabilité de l’AVEA dans de tels types d’opérations. A<br />
cet effet, <strong>des</strong> précisions plus pointues concernant notamment l’interface opérationnelle<br />
de levage propre à l’AVEA (positionnement, maniabilité …) doivent être connues, ainsi<br />
qu’une approximation du coût de l’investissement global AVEA entaché, le cas échéant,<br />
d’une marge d’incertitude technique permettant de proposer une comparaison<br />
économique acceptable, tenant compte <strong>des</strong> processus de construction et logistiques.<br />
Par expérience, l’AVEA ne serait pas un moyen rentable pour la construction de bâtiments<br />
courants. De plus, on retrouve cette même remarque, dans le cas <strong>des</strong> constructions rapi<strong>des</strong><br />
de type « Formule 1 » dont la logistique <strong>des</strong> opérations est actuellement parfaitement<br />
maîtrisée. Une technique AVEA modifierait divers processus sans permettre un gain notable.<br />
Par contre, la construction assistée par AVEA pourrait s’avérer intéressante dans le cas de<br />
complexes immobiliers à construire ou de bâtiments imposants (15 à 20 étages au minimum)<br />
présentant une forte répétitivité. L’AVEA pourrait, à partir d’une usine de préfabrication,<br />
transporter <strong>des</strong> étages complets, sous réserve <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de dimensionnement qu’il va<br />
falloir adapter. En effet, avec un AVEA de 500 t, on pourrait transporter un étage équipé de<br />
500 m 2 (1 t/m 2 ). Dans une construction en acier, le potentiel est évidemment plus important.<br />
En somme, l’AVEA serait intéressant pour la construction d’ouvrages complexes ou de<br />
grande envergure et dans le cas de réalisations à forte répétitivité. Il pourrait également<br />
trouver <strong>des</strong> applications dans les brèches et les ponts-piétons ⇒ rapidité de mise en œuvre,<br />
nuisances du chantier limitées.<br />
Cependant, le constructeur en question reste sceptique quant à l’application de l’aérostat<br />
lourd dans le bâtiment et prévoit une période probatoire où l’AVEA devrait faire ses preuves<br />
dans <strong>des</strong> domaines plus représentatifs de son marché réel tels que la construction<br />
d’ouvrages importants, le transport d’ensembles industriels et d’équipements énergétiques.<br />
Outre une conception dimensionnelle adaptée à un transport par AVEA qu’on ne pourrait<br />
apprécier financièrement qu’à travers l’étude détaillée d’un cas concret, le dirigeable lourd<br />
modifierait la logistique <strong>des</strong> chantiers en simplifiant le processus et en réduisant le nombre<br />
de tâches critiques grâce à un regroupement d’activités permis par la construction de sousensembles<br />
imposants en usines de préfabrication qu’on ne devra plus diviser à <strong>des</strong> fins de<br />
<strong>transports</strong>. Il y aurait donc diminution de la séquentialité <strong>des</strong> opérations. Par suite et comme<br />
on peut le justifier, sur un cas concret, par la méthode PERT, la durée <strong>des</strong> chantiers s’en<br />
trouverait réduite, ce qui génère <strong>des</strong> gains directs (mobilisation plus courte de la main<br />
d’œuvre, simplification de certaines métho<strong>des</strong> de construction comme par exemple réduction<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 68
du nombre de coffrages nécessaires, de soudures, du temps mort nécessaire aux<br />
phénomènes de retrait/de cure du béton …), mais également indirects par la mise en<br />
exploitation de l’infrastructure plus tôt, d’où un retour sur investissement plus prompt. Cette<br />
remarque trouve un intérêt certain pour les chantiers importants s’étalant sur <strong>des</strong> années qui<br />
peuvent voir leur durée de réalisation réduite de plusieurs mois.<br />
Aussi, l’analyse de la demande AVEA nécessite une réflexion sur la rentabilité <strong>des</strong> usines de<br />
préfabrication, ainsi que sur le nombre nécessaire et leur implantation optimale à travers le<br />
territoire français qui peut être pris comme modèle. Cette réflexion, à mener à la suite d’un<br />
calcul de rentabilité directe sur un cas concret - prouvant la faisabilité économique de l’AVEA<br />
- tel que la construction du futur viaduc de Millau, pourrait alors être généralisée à d’autres<br />
régions.<br />
Dans cette optique, plusieurs précisions techniques doivent être fournies à savoir :<br />
- définition et <strong>des</strong>cription opérationnelle du système de ballastage (ballastage à air<br />
comprimé ou à eau, temps de ballastage nécessaire)<br />
- précision de pose et degré de correction éventuelle <strong>des</strong> moteurs<br />
- spécification de l’interface de levage (points d’ancrage, poutre de rigidité, manipulation<br />
du « colis » transporté en phase de vol d’approche pour le mettre en position finale<br />
d’emploi, temps de pose)<br />
- maniabilité du dirigeable et degré de sensibilité aux conditions atmosphériques<br />
En fonction de certains <strong>des</strong> paramètres ci-<strong>des</strong>sus (précision et temps de pose, efficience du<br />
ballastage, maniabilité du dirigeable), l’AVEA pourrait pénétrer le marché du levage et de la<br />
manutention - important en matière de construction d’ouvrages d’art - qui constituerait une<br />
prestation incorporée dans l’activité globale du dirigeable comprenant le transport et la<br />
manutention. En référence à une logique d’économie industrielle, ce paquetage de<br />
prestations peut générer <strong>des</strong> économies de gamme ou d’envergure exprimant le fait qu’il<br />
peut être moins coûteux de proposer un service joint que deux services distincts. A ceci,<br />
s’ajoute <strong>des</strong> économies de dimension associées à l’accès à de nouveaux marchés. Ainsi, les<br />
coûts supplémentaires de location d’une grue, les coûts d’amenée et les coûts<br />
d’immobilisation pourraient être éludés par l’AVEA qui n’est pas, à l’image de la grue, limité<br />
par une portée de levage maximale de 90 m.<br />
Par ailleurs, outre les facteurs listés plus haut, on présente ci-après la configuration AVEA<br />
souhaitée par le constructeur en question :<br />
- Charge utile : 500 à 1000 tonnes<br />
- Distance franchissable : 1000 km<br />
- Vitesse au sol : 50 km/h voire moins. En effet, la vitesse importe peu dans le domaine de<br />
la construction de grande envergure où les chantiers durent plusieurs années. Un gain<br />
de quelques jours n’est pas significatif ; il s’agit d’un problème d’organisation<br />
indépendant du transport. De plus, le coût marginal d’augmentation de la vitesse est,<br />
sans aucun doute, élevé sans générer une part supplémentaire de marché notable, du<br />
moins en génie civil.<br />
- Altitude : jusqu’à 5000 m<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 69
Appendice :<br />
On présente ci-après le marché actuel <strong>des</strong> ponts routiers, autoroutiers et ferroviaires réalisés<br />
au courant de l’année 1998 en tant qu’équipement nouveau ou reconstruit. D’après le<br />
SETRA (Service d’Etu<strong>des</strong> Techniques <strong>des</strong> Routes et Autoroutes), le marché potentiel<br />
susceptible d’intéresser l’AVEA suivrait, dans les 10 prochaines années, une évolution<br />
semblable à celle de la période 1990-1998 avec <strong>des</strong> ordres de grandeurs maintenus.<br />
Evolution de l’activité ouvrages d’art entre 1990 et 1998<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 70
Synthèse par département du nombre d’ouvrages construits<br />
A partir de cette carte de concentration géographique par département du nombre<br />
d’ouvrages construits, on peut, via un modèle de localisation, esquisser une analyse<br />
d’implantation <strong>des</strong> unités de préfabrication <strong>des</strong>servies par AVEA avec une contrainte de<br />
couverture maximale du territoire à partir d’un minimum d’entités industrielles, garantissant<br />
ainsi une rentabilité optimale. L’algorithme GA « greedy adding » serait à même de résoudre<br />
ce type de problème. La méthode démarre avec un jeu de solution vide puis ajoute à ce jeu<br />
les meilleures localisations l’une après l’autre. Le premier centre couvre le bassin le plus<br />
important tout en respectant le jeu <strong>des</strong> contraintes. Chaque site ajouté couvre la plus grande<br />
partie possible <strong>des</strong> bassins restants et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les zones viables<br />
se trouvent servies ou que le nombre maximum de sites admis soit atteint. Bien évidemment,<br />
d’autres facteurs devraient être considérés, tels que la dimension politique, l’existence ou<br />
non d’une main d’œuvre qualifiée localement, le comportement de tel ou tel concurrent ou<br />
partenaire, et justifient le recours à une logique décisionnaire qui doit aller de pair avec la<br />
modélisation mathématique.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 71
Ponts routiers : répartition entre ouvrages courants et non courants (résultats<br />
globaux)<br />
Distribution selon le coût : opérations nouvelles de construction de ponts routiers<br />
La densité maximale d’ouvrages routiers en effectif se situe entre 1.64 et 3.28 millions de FF.<br />
Coût moyen par type :<br />
PC = 3 359 140 FF HT<br />
PNC = 47 699 947 FF HT ⇒ forte valeur ajoutée du projet<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 72
Distribution selon le coût : opérations de reconstruction de ponts routiers<br />
La densité maximale d’ouvrages routiers reconstruits en effectif se situe entre 0.66 et 1.64<br />
millions de FF.<br />
Coût moyen par type :<br />
PC = 2 017 980 FF HT<br />
PNC = 7 800 000 FF HT ⇒ forte valeur ajoutée du projet<br />
Sur la base <strong>des</strong> recoupements entre les statistiques et les divers compte-rendus de réunions<br />
propres au domaine de la construction, il est pressenti une fort part du transfert modal en<br />
faveur du dirigeable à partir <strong>des</strong> projets de type « ponts non courants » qu’ils soient, comme<br />
on le verra, routiers, autoroutiers ou ferroviaires. Un modèle de choix modal et <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de<br />
cas concrets basés sur la technologie AVEA auront pour but de justifier cette affirmation.<br />
Ponts autoroutiers : répartition entre ouvrages<br />
courants et non courants<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 73
Distribution <strong>des</strong> ponts autoroutiers selon le coût<br />
La densité maximale d’ouvrages en effectif se situe entre 1.64 et 2.62 millions de FF.<br />
Coût moyen par type :<br />
PC = 3 027 974 FF HT<br />
PNC = 14 094 343 FF HT<br />
Ponts SNCF : répartition entre ouvrages courants et non courants<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 74
Distribution <strong>des</strong> ponts autoroutiers selon le coût<br />
La densité maximale d’ouvrages en effectif se trouve dans la tranche 1.6 à 3.3 millions de<br />
FF.<br />
Coût moyen par type :<br />
PC = 2 954 228 FF HT<br />
PNC = 36 362 500 FF HT<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 75
Fiche 30 :<br />
23/06/2000<br />
Implantation : Aigle (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Chaudronnerie<br />
Il s’agit d’une entreprise helvétique de construction métallique dont l’activité est<br />
essentiellement nationale.<br />
Ses réalisations portent notamment sur la fabrication en usine <strong>des</strong> tabliers de ponts et <strong>des</strong><br />
charpentes pour bâtiments, centres commerciaux et de loisirs … qui constituent l’activité<br />
prépondérante actuellement.<br />
A une fin de rentabilité, l’AVEA devrait être particulièrement adapté au transport et au levage<br />
de structures métalliques porteuses. Dans cette optique, outre la précision de pose qui doit<br />
être semblable à celle d’une grue, une <strong>des</strong>cription précise de l’interface de levage doit être<br />
fournie : définition <strong>des</strong> points d’accrochage, répartition et modularité de ces mêmes points,<br />
système de réglage, rapidité, fiabilité et sécurité de manœuvre.<br />
En outre, l’utilisation de l’AVEA dans le sous-segment « charpente métallique » ne serait<br />
rentable que dans deux cas de figure :<br />
- Structure complexe alliant finesse architecturale, haute qualité de finition, travaux<br />
d’assemblage complexes et longs générant <strong>des</strong> frais notables de délocalisation de la<br />
main d’œuvre et une nuisance accrue du chantier par sa durée de réalisation (aspect<br />
social de la valeur du temps implicite, par ailleurs, dans la décision du client de faire<br />
appel ou pas au système de dirigeable lourd). Comme exemple de structures<br />
susceptibles d’être transportées par AVEA, on peut citer la couverture du centre <strong>des</strong><br />
congrès de Lucerne (Suisse). Dès lors, à part les aspects techniques concernant le<br />
dimensionnement <strong>des</strong> pièces sustentées en fonction de la phase de levage/transport (la<br />
pièce devrait résister à son poids propre et aux efforts tranchants et flexionnels<br />
supplémentaires développés durant la manipulation) qui peut induire un renforcement<br />
<strong>des</strong> structures non nécessaire jusqu’alors - effet de déséconomie - , les problèmes de<br />
réglementation (survol et exploitation en zone urbaine) doivent être éclaircis avant toute<br />
décision relative à l’adoption future du dirigeable comme moyen lourd de transport<br />
industriel.<br />
- Bâtiments et halles métalliques importants et présentant une forte répétitivité. On se<br />
trouve là dans un contexte de standardisation <strong>des</strong> constructions qui ne constitue pas la<br />
tendance observée.<br />
Par ailleurs, bien que le créneau « ouvrages d’art » ne soit actuellement pas très porteur en<br />
Suisse en raison d’infrastructures d’ores et déjà équipées, l’AVEA pourrait intervenir dans le<br />
cadre de travaux d’extension et de remplacement de structures vieillissantes, ainsi que dans<br />
la construction de ponts et de passerelles en villes qui peuvent connaître dans les années à<br />
venir une saturation de leur réseau. Une analyse prospective <strong>des</strong> vingt prochaines années<br />
devrait être menée, sous réserve <strong>des</strong> contraintes technique et d’exploitation propres à<br />
l’AVEA.<br />
De même, lorsque l’aspect fonctionnel de l’AVEA sera mieux connu, il est nécessaire de<br />
traiter en détail le cas d’une construction d’un bâtiment, d’une halle ou d’une structure<br />
métallique complexe afin de dégager la rentabilité du dirigeable lourd dans ce domaine.<br />
Au niveau de la production, l’AVEA pourrait induire de profonds changements par la<br />
préfabrication en usine d’éléments de structures plus importants aptes à être transportés de<br />
manière indivisible. Cependant, <strong>des</strong> contraintes subsistent concernant la manipulation de<br />
ses pièces imposantes en usine. Des investissements liés aux systèmes internes de levage<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 76
(ponts roulants lourds extensifs ; il est à noter qu’actuellement, les usines disposent de ponts<br />
roulants d’une capacité maximale avoisinant les 40 tonnes) permettant de faire sortir la pièce<br />
produite au niveau de l’aire de chargement du dirigeable devront être pris en compte dans la<br />
décision d’utilisation de l’AVEA. En outre, il devra être adopter une nouvelle gestion de la<br />
production où l’on peut concevoir plusieurs postes de fabrication <strong>des</strong> diverses parties<br />
constituant la pièce finale qui convergent vers une unité d’assemblage située le plus près de<br />
la sortie de l’usine donnant vers l’aire de chargement AVEA qui sera également équipée en<br />
fonction du degré de pose du dirigeable. Des systèmes de guidage pourraient être prévus<br />
afin d’aider le dirigeable à se positionner précisément.<br />
Ainsi, on voit qu’il est primordial de connaître certaines données techniques inhérentes à<br />
l’aspect fonctionnel du dirigeable, en plus du coût estimé d’exploitation de l’AVEA afin de<br />
mener un calcul de faisabilité économique intégrant les investissements supplémentaires<br />
nécessaires. De prime abord, l’AVEA ne sera rentable pour le chaudronnier en question que<br />
dans le cas d’un volume minimal annuel de missions supérieur ou égal à trois afin d’amortir<br />
les dépenses d’équipement entreprises.<br />
Dans le sillon d’une valeur révélée, un coût de 600 FF/t (contre 200 FF/t pour un convoi de<br />
20 tonnes de charge utile en transport classique) transportée serait convenable dans le cas<br />
d’un transport exceptionnel sur la base d’une masse indivisible de 200 t acheminée sur 100<br />
km ; coût incluant, bien évidemment, les opérations de levage sur une durée globale<br />
« transport + manutention » prise égale à 4 heures.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 77
Fiche 31 :<br />
26/06/2000<br />
Implantation : Genève (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Fabrication de transformateur - Département production<br />
Un moyen de transport de charge utile 200 ou 500 tonnes monobloc permet d’éliminer les<br />
opérations de démontage en usine suite à la phase de test obligatoire avant laquelle le<br />
matériel, en l’occurrence le transformateur, a été complètement monté.<br />
Il est à noter que l’opération de désassemblage d’un transformateur de 200/300 t équipé de<br />
ses deux batteries nécessite deux semaines de travail, soit une économie de l’ordre de :<br />
- 100 CHF/h pour le transformateur<br />
- 10000 CHF/h pour les deux batteries<br />
sur une durée de 80 heures (2 semaines)<br />
⇒ économie ≅ 800000 CHF<br />
De plus, les deux semaines de travail ainsi épargnées (sans valeur ajoutée pour le client)<br />
pourront être utilisées pour d’autres tâches valorisantes, améliorant la capacité de production<br />
de l’usine.<br />
Outre cet aspect, la conception du transformateur se fera selon les contraintes imposés par<br />
le transport. La forme du transformateur ou plus précisément de sa cuve autoporteuse sera<br />
en U renversé afin de respecter le gabarit <strong>des</strong> tunnels ferroviaires d’où un surcoût de l’ordre<br />
de 5 à 10% par rapport au coût global du transformateur équipé. Le transport par AVEA n’est<br />
astreint à aucun gabarit et par suite pourrait faire épargner au fabricant le surcoût dont il est<br />
question ici qui peut être conséquent dans le cas de ces gros transformateur dont le coût est<br />
de l’ordre de 7 10 6 CHF.<br />
⇒ économie ≅ 350000 à 700000 CHF<br />
Par ailleurs, une possibilité de transport monobloc non astreinte aux contraintes de gabarit<br />
(ferroviaire, routier, voie d’eau) pourrait simplifier les étu<strong>des</strong> d’acheminement, ce qui<br />
constituerait un gain de l’ordre de 500 h pour un transformateur de 200/300 t. Avec 150<br />
CHF/h, on atteint donc une économie de l’ordre de 70000 CHF.<br />
Outre les facteurs de précision de positionnement, de fiabilité du dirigeable et de son<br />
système de levage qui devront être précisément fournis pour toute étude ultérieure, le<br />
transport du transformateur par AVEA devra respecter les normes suivantes de sécurité :<br />
- 5 g au maximum dans les directions transversale et longitudinale<br />
- 3 g au maximum dans la direction verticale<br />
Ces valeurs concernent le transport maritime qui constitue aujourd’hui la limite<br />
dimensionnante ; le transport par rail imprimant, pour sa part, seulement 1 g dans les<br />
directions transversale et longitudinale et 0.5 g dans la direction verticale.<br />
Ces limitations nécessitent donc la mise en place de protections spéciales dont la valeur<br />
pécuniaire se situe entre 2 et 5% du coût global du transformateur équipé.<br />
A noter que si l’AVEA permettait <strong>des</strong> <strong>transports</strong> imprimant un nombre de g inférieur<br />
strictement à la limite maritime, on assisterait à une baisse <strong>des</strong> coûts de protections du<br />
transformateur qui pourrait entraîner le recours à un transport intégral par AVEA, y compris<br />
pour les trajets long courrier où l’on aurait tendance à combiner les mo<strong>des</strong> AVEA et<br />
maritimes. Cette précision devra être fournie afin d’affiner les simulations économiques<br />
futures.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 78
En outre, d’un point de vue purement fonctionnel, il sera nécessaire de mettre au point un<br />
contenant (conditionnement du transformateur) apte à être transporté par AVEA et par tout<br />
autre mode, en l’occurrence la voie maritime, dans le cadre d’une logique combinée afin<br />
d’annihiler les ruptures de charges susceptibles de se produire lorsque l’on fait appel à<br />
divers mo<strong>des</strong> de transport le long de la chaîne logistique.<br />
D’un point de vue coût, les valeurs suivantes avancées :<br />
- 30000 à 35000 FF/heure de vol et d’opération effective dans le cas d’une charge de 200 t<br />
indivisible<br />
- 40000 à 45000 FF/heure de vol et d’opération effective dans le cas d’une charge de 500 t<br />
indivisible<br />
représentent, en moyenne, un coût similaire au transport routier exceptionnel. Par<br />
conséquent, les facteurs principaux qui permettront le choix de l’AVEA plutôt que la route<br />
seraient :<br />
- gain économique au niveau de la production et retombées qualitatives suite à une<br />
fabrication et à un assemblage quasi-complet en usine<br />
- garantie de disponibilité du dirigeable (organisation optimale d’exploitation et<br />
renseignement sur la vulnérabilité du dirigeable aux conditions atmosphériques)<br />
- garantie de sécurité et de fiabilité du système<br />
- simplification <strong>des</strong> opérations logistiques et du nombre d’acteurs au sein de la chaîne de<br />
transport (l’AVEA peut, dans de nombreux cas, être le seul moyen de transport et de<br />
manutention le long de la chaîne d’où une limitation du nombre d’intervenants et une<br />
simplification <strong>des</strong> procédures)<br />
- gain de temps<br />
- assouplissement de mesures législatives (transport de nuit …)<br />
D’un point de vue marché, l’AVEA pourrait se voir attribuer 15 à 30 opérations en moyenne<br />
(comprenant équipements nouveaux et en réparation) par an sur la base <strong>des</strong> contrats de l’<br />
entreprise interviewée. Les <strong>des</strong>tinations les plus courantes restent : les Etats-Unis,<br />
l’Amérique centrale et le Maghreb. Parmi ces opérations, 70 % constitue <strong>des</strong> transformateurs<br />
de moins de 200 t, le reste <strong>des</strong> gros transformateurs de plus de 250 tonnes.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 79
Fiche 32 :<br />
28/06/2000<br />
Implantation : Vevey (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Equipement spatial<br />
Il s’agit d’une société où 50% de son chiffre d’affaires est orienté vers les équipements<br />
spatiaux, 40% vers les besoins de l’industrie nucléaire et la manutention lourde et les 10%<br />
restant orienté ingénierie (étu<strong>des</strong>).<br />
Ainsi, elle réalise <strong>des</strong> structures métalliques ou en composites pour les pièces de vol, de la<br />
machinerie et de l’outillage spécial et intervient dans la conception et la fabrication de<br />
moyens de levage (ponts roulants, ponts passerelles, ascenseurs …) et de contenants de<br />
transport, notamment pour le compte de Contraves SA (transport <strong>des</strong> coiffes <strong>des</strong> fusées<br />
Ariane) et de Matra (transport <strong>des</strong> lanceurs EADS).<br />
En partenariat avec <strong>des</strong> lanceurs, l’équipementier en question a réalisé un conteneur de 11<br />
m de long, 5 m de large et 4 m de haut. L’AVEA permettrait le transport de pièces voire <strong>des</strong><br />
coiffes de lanceurs en un seul bloc au lieu de deux d’où un conteneur de dimensions doubles<br />
(22*10*8 m).<br />
Pour Ariane 5, l’entreprise ici considérée a réalisé un conteneur 35*7*7m. La difficulté<br />
d’acheminement dans ce domaine est liée à l’encombrement et non pas au poids. Un<br />
dirigeable de charge utile 50 tonnes est suffisant, à moins d’opter pour un 200 tonnes dans<br />
une optique de groupage - modification logistique du groupe européen Arianespace qui peut<br />
ne pas être acceptée en raison de critères politiques - à effet de rendement d’échelle (dans<br />
ce cas, les éléments ne seront plus transportés dans leur configuration finale d’utilisation ;<br />
<strong>des</strong> manœuvres complémentaires seront nécessaires - cf plus bas). Il est à noter, par<br />
ailleurs, que l’AVEA n’introduira pas , dans le domaine spatial, de modifications <strong>des</strong><br />
processus de production tout au plus <strong>des</strong> modifications d’acheminement logistique !<br />
D’autres parties du lanceur restent problématiques quant à leur transport ; il s’agit :<br />
- <strong>des</strong> chambres cryogéniques jusqu’à 25 m de long et 5 m de diamètre fabriquées<br />
obligatoirement au bord d’une voie d’eau d’où une implantation fixe de ce type d’usine.<br />
Notons qu’un transport de chambre cryogénique par Beluga entre Toulouse et Kourou<br />
coûte 1 million de FF auquel il faut ajouter les <strong>des</strong>sertes terminales ; le transport reste<br />
trop cher d’où le recours à la voie d’eau. Si l’AVEA est aussi coûteux, le transfert ne se<br />
fera certainement pas en sa faveur, du moins sur le parcours global. L’AVEA pourrait<br />
s’inscrire dans une logique de transport combiné avec le navire. Pour ne pas engendrer<br />
de rupture de charges et faciliter le transfert de la pièce du dirigeable vers le bateau ou<br />
vice versa, <strong>des</strong> techniques spécifiques doivent être élaborées et intégrer leur coût à la<br />
totalité de la chaîne de transport pour décider quant à la faisabilité économique de<br />
l’AVEA dans ce domaine plutôt volumineux que lourd.<br />
- <strong>des</strong> boosters (25 m de long). Ils sont transportés vide et remplis de dynamite sur site.<br />
Par ailleurs, les éléments de la fusée Ariane sont transportés horizontalement en raison de<br />
leur encombrement et doivent alors être mis en position verticale d’utilisation, ce qui exige<br />
que la structure soit apte à subir ces manœuvres qui constitue la phase dimensionnante. Si<br />
l’AVEA peut transporter verticalement ces pièces (en position finale d’utilisation), il n’est plus<br />
nécessaire de recourir, lors de la production, au renforcement <strong>des</strong> structures d’où <strong>des</strong> gains<br />
induits à la conception mais également à l’utilisation (énergie de propulsion moins importante<br />
car dispositif plus léger). Dès lors, on pourrait observer un report complet du transport vers<br />
l’AVEA. Une étude détaillée, prenant en compte les spécificités techniques du dirigeable, doit<br />
être menée.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 80
En conclusion, l’établissement en question serait intéressée par l’AVEA au niveau de la<br />
réalisation/conception de ses structures, en phase industrielle. Il pourrait être un partenaire<br />
technique pour la partie fabrication.<br />
Pour appréhender le marché « spatial » de l’AVEA, une étude concrète devra être menée<br />
avec <strong>des</strong> lanceurs comme Arianespace. D’autres sociétés comme STARSEM et<br />
SEALAUNCH peuvent être déterminantes dans le détermination du volume de ce marché.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 81
Fiche 33 :<br />
3/07/2000<br />
Implantation : Lausanne (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Maisons individuelles préfabriquées<br />
Il s’agit d’une entreprise de construction de maisons à ossature bois à partir de panneaux ou<br />
de modules fabriqués en usine. Elle est affiliée à la société Alouette qui construit près de<br />
1000 maisons par an déployée sur 3 sites, l’un au Canada et les deux autres aux Etats-Unis.<br />
Par ailleurs, le potentiel de développement de la préfabrication est énorme sur le continent<br />
américain (au Canada, chaque site de production rayonne sur une distance de 500 km).<br />
Plusieurs chantiers voient le jour dont un gigantesque au Nicaragua, avec 50000 maisons<br />
construites à partir de panneaux préfabriqués en usine et transportés.<br />
Toutefois, il semblerait, d’après le directeur de la société Alouette (qui réalise entre autre le<br />
projet nicaraguayen), que l’utilisation d’un AVEA ne serait guère rentable et que la technique<br />
actuelle par panneaux ou modules est préférable et parfaitement maîtrisée. Notons que cette<br />
« idéologie » a été infirmée par d’autres spécialistes de la maison préfabriquée.<br />
En outre, les grands constructeurs français pensent que dans le cas d’un renouveau du<br />
logement standardisé et sur <strong>des</strong> chantiers présentant une forte répétitivité, l’apport de<br />
l’AVEA serait considérable.<br />
Une étude de cas précise pourrait définitivement confirmer ou non la faisabilité économique<br />
du dirigeable lourd quant au créneau de la maison préfabriquée entièrement en usine et<br />
transportée monobloc jusqu’au site final d’utilisation.<br />
On propose ci-après une analyse préliminaire de l’utilisation potentielle de l’AVEA dans le dit<br />
segment.<br />
Le secteur d’activité de la maison préfabriquée connaît un développement timide en raison<br />
<strong>des</strong> contraintes de transport (poids et encombrement) qui ne permettent pas de réaliser <strong>des</strong><br />
modules complets. Ceux-ci doivent alors être subdivisés et réassemblés sur site moyennant<br />
un redéploiement important de main d’œuvre et l’assistance de matériels de levage (grue).<br />
Une autre technique, plus sectaire, est la construction par panneaux - plus facile à manipuler<br />
que les modules - qui devient prépondérante lorsque la maison à construire se trouve loin<br />
<strong>des</strong> ateliers de préfabrication (au-delà de 500 km). Le transport par conteneurs<br />
conventionnels s’impose alors.<br />
Prenons l’exemple d’une villa de 140 à 160 m 2 construite par panneaux ; le 1/3 du coût est<br />
affecté aux matériaux et les 2/3 restants à la main d’œuvre/construction. Or, on peut, grâce à<br />
l’utilisation de l’AVEA et à la technique qu’il induirait, diminuer ce dernier coût. En effet,<br />
- 15% sont <strong>des</strong> coûts de déplacement de la main d’œuvre<br />
- 10% pour surveiller les travaux effectués<br />
- 10% liés à une improductivité due au travail dans <strong>des</strong> conditions difficiles non protégées<br />
comme en usine<br />
- 15% de surcoût relié à un employé de chantier qui coûte plus cher qu’un ouvrier d’usine.<br />
Ainsi, la technique induite AVEA permettrait de diminuer les coûts « main d’œuvre » d’un<br />
facteur 2 par rapport à la construction panneaux et 1.5, par rapport à la construction modules<br />
devant encore être réassemblés sur site. Sur une maison de 400000 CHF (superficie ≅ 150<br />
m 2 ), l’AVEA permettrait un gain de l’ordre de 100000 CHF.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 82
400000 CHF<br />
Matériaux :50000<br />
Main d’œuvre :100000<br />
CVSE :100000<br />
Terrassement :75000<br />
Taxes et frais de raccordement :50000<br />
CVSE = Chauffage, ventilation, climatisation, électricité, sanitaire<br />
A ceci, il faut ajouter la part du transport <strong>des</strong> panneaux et <strong>des</strong> grues de construction qui<br />
s’ajoutent au frais de chantier ; ces grues pourraient être éliminer dans le cas d’une pose<br />
contrôlée et précise du dirigeable, ce qui accroît son attractivité et par suite son marché<br />
potentiel. Un définition plus précise de ce sujet doit être fournie par l’équipe technique AVEA.<br />
Parallèlement, la préfabrication complète en usine assure une meilleure qualité du produit<br />
final qui peut représenter, en valeur internalisée, jusqu’à 5% du coût global de la maison. Par<br />
ailleurs, le délai de livraison de la maison serait considérablement réduit par rapport à une<br />
construction panneau (près de 2 mois en moyenne), ce qui satisfait d’autant plus le client si,<br />
en sus, on lui livre une maison complètement équipée (chauffage, plomberie, électricité).<br />
A partir de ce constat, un bilan doit être fait afin de comparer financièrement l’apport AVEA<br />
(parties transport et modifications susceptibles d’être générées au niveau de la conception<br />
pour répondre à un transport sous élingues tenant compte d’un développement probable<br />
d’efforts supplémentaires à balancer, dans le cas <strong>des</strong> modules isolés, sur les coûts <strong>des</strong><br />
contreventements et <strong>des</strong> murs temporaires nécessaires au transport selon les mo<strong>des</strong><br />
actuels) aux techniques actuelles. Il est à noter, que compte tenu de l’amélioration de la<br />
qualité grâce à l’AVEA (meilleure isolation grâce à une pose et à un traitement plus<br />
appropriés <strong>des</strong> joints en usine …), la réduction du temps de « livraison » (diminution de la<br />
durée de chantier), la possibilité de composer plus librement sa maison, la clientèle pourrait<br />
opter pour une technique induite AVEA à concurrence d’un surcoût de 10% en moyenne par<br />
rapport à la pratique actuelle.<br />
En Suisse romande, le marché de la maison préfabriquée est encore à développer dans la<br />
mesure où seulement 30 maisons en moyenne par an sont construites de la sorte et que les<br />
usines de préfabrication restent de taille très mo<strong>des</strong>te, ne permettant pas de faire face à une<br />
demande plus importante. Il est à noter que ce créneau ne peut être rentable qu’à partir de<br />
200 maisons produites par an.<br />
En Suisse alémanique, le marché est plus significatif (50 à 100 maisons en moyenne par an)<br />
avec un doublement attendu de cette activité dans les 5 années à venir.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 83
Fiche 34 :<br />
5/07/2000<br />
Implantation : Aigle (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Bureau d’étu<strong>des</strong> en génie civil (construction métallique)<br />
Une configuration AVEA de 500 t serait particulièrement adaptée au transport d’éléments en<br />
construction métallique voire mixte.<br />
En effet, une charge utile de 500 tonnes correspond à une travée de pont double voie de 60<br />
m de long environ, alors qu’actuellement, on est limité à une trentaine de mètres en phase<br />
de transport. Avec l’AVEA, la mise en œuvre se fera plus simplement (on diminuera d’un<br />
facteur 2 le nombre de soudures avec une modification au niveau <strong>des</strong> procédures générales<br />
de construction - Cf fiches 22 et 29) et plus rapidement ; délais d’autant plus appréciable que<br />
l’ouvrage d’art doit être construit sur un cours d’eau ou en site difficile d’accès (zones<br />
montagneuses). C’est le cas notamment du pont du Dättwilertal devant le tunnel de Baregg<br />
(canton d’Argovie). En effet, le creusement du tunnel a été subordonné à la construction du<br />
pont - servant notamment de support au tunnelier - dont la durée a été de 12 mois. Avec<br />
l’AVEA, le délai aurait pu être réduit de 5 mois, soit une économie brute de l’ordre de 4,6<br />
millions CHF (coût du pont = 11 millions CHF) qui peut être ajustée par la valeur du temps<br />
ramenée à l’ensemble du chantier « pont + tunnel », une mise en exploitation plus tôt donc<br />
une satisfaction meilleure <strong>des</strong> usagers (entrée plus rapide de recettes) et par les externalités<br />
négatives qu’on aurait pu évitées à savoir une part non négligeable <strong>des</strong> nuisances de<br />
chantiers (émissions sonores, polluantes, gêne de l’écosystème, désagréments causés à la<br />
population environnante …).<br />
Outre l’utilisation de l’AVEA pour la construction de ponts (en Suisse, il s’agira d’ouvrages de<br />
petite envergure soit de l’ordre de 200 m de long où le gain de temps permis par l’AVEA<br />
serait par contre très appréciable), le dirigeable lourd pourrait être exploité dans le cadre du<br />
renouvellement <strong>des</strong> biens d’équipement (démontage/montage de ponts sur un délai très<br />
court visant à perturber le moins possible le trafic).<br />
D’un point de vue contraintes, un positionnement précis assimilable à celui d’une grue est<br />
naturellement requis, en plus d’un système de suspente multi-points correspondant aux<br />
zones d’efforts tranchants maximales. Ceci implique la mise au point d’un système flexible<br />
permettant de multiplier les zones d’attache et de les positionner selon le diagramme <strong>des</strong><br />
efforts. En outre, la partie de structure transportée ne doit subir pratiquement aucune<br />
déformation (flèche maximale de l’ordre de 3 cm pour une longueur d’environ 50 m ; f = 5 ql 4<br />
/384 EI avec q : effort nominal, l : longueur et EI : module de rigidité), ce qui induit une<br />
rigidification du système global de levage pour conserver l’horizontalité de la structure. On<br />
propose ci-après un schéma allant dans ce sens.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 84
Quille rigidifiant<br />
la structure<br />
Dirigeable<br />
Travée de pont<br />
Système de<br />
levage<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 85
Appendice : Statistiques<br />
Routes nationales suisses : 6 ème programme de construction à long terme (horizon 2015)<br />
En effet, la plupart <strong>des</strong> réalisations susceptibles d’intéresser le dirigeable AVEA se<br />
situeraient dans les cantons d’Argovie, du Jura, de Berne et du Valais.<br />
Ponts :<br />
Ouverture<br />
En service<br />
Ouvrages Projets de détail Longueur<br />
Surface<br />
en m<br />
en m 2<br />
Ponts < 100 m 8 572 13 255<br />
Ponts : 100 - 300 m 2 369 11 485<br />
Ponts > 300 m 1 589 14 370<br />
Total 11 1530 39 110<br />
Passages supérieurs 9 582 10 255<br />
Total 9 582 10 255<br />
Total général 24 2112 49 365<br />
Projets de détail approuvés (Etat fin 1999)<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 86
Tunnels :<br />
Canton Ouvrage Tube (m) Nombre de voies<br />
SZ/UR Fronalp 7 047 2<br />
Total 1 7 047<br />
OW Kaisersthul 1 000 2<br />
BE/OW Brünig 3 700 2<br />
Total 2 4 700<br />
GR San Fedele,<br />
2 400 2<br />
Roveredo<br />
Total 1 2 400<br />
Tunnels planifiés (état fin 1999)<br />
Canton Ouvrage 1 tube (m) 2 tubes (m) Nombre de voies<br />
ZH Milchbuck<br />
2.Etappe<br />
1 910 3+3<br />
ZH Hafnerberg 1 275 2+2<br />
ZH Uetliberg 4 500 2+2<br />
ZH Islisberg 4 890 2+2<br />
ZH Lochhof 350 2+2<br />
ZH Isenberg 150 2+2<br />
ZH Eigi 120 2+2<br />
ZH Rüteli 450 2+2<br />
Total 8 1 910 11 735<br />
NW/OW Lopper 2.Etappe 1 562 2<br />
NW/OW Lopper Ost 1 480 2<br />
NW/OW Verbindung<br />
N2/N8<br />
2 030 2<br />
Total 3 5072<br />
OW Tschorren 800 2<br />
OW Lugern 1 800 2<br />
Total 2 2 600<br />
VS Tranchée<br />
Gorwetsch<br />
1 705 2+2<br />
VS Ermitage 380 2+2<br />
VS Pfyngut 2 115 2+2<br />
VS Susten 2 070 2+2<br />
VS Turtmann 1 140 2+2<br />
VS Riedberg,<br />
Gampel<br />
500 2+2<br />
VS Raron 760 2+2<br />
VS Lonza, Visp 1 595 2+2<br />
Total 8 10 265<br />
GR Isla-Bella<br />
2.Etappe<br />
2 435 2<br />
Total 1 2 435<br />
JU Neu Bois 1 100 2+2<br />
JU Bure 2 965 2<br />
JU Bois de<br />
Montaigne<br />
830 2+2<br />
JU La Beuchille 930 2+2<br />
JU Choindez 2 870 2<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 87
Total 5 5 835 2 860<br />
BE Pré Boivin,<br />
Moutier<br />
1 200 2+2<br />
BE Graitery 2 490 2<br />
BE Court 1 000 2<br />
BE Sorvilier 195 2<br />
BE Bévilard 160 2<br />
BE Malleray 525 2<br />
BE Champ Quiller 480 2<br />
BE Reconvilier 180 2<br />
BE Sous le Mont 1 320 2<br />
Total 9 6 350<br />
Tunnels : projet général (état fin 1999)<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 88
Fiche 35 :<br />
6/07/2000<br />
Implantation : Luxembourg (Gd Duché du Luxembourg)<br />
Secteur d’activité retenue : Transport aérien de fret<br />
Il s’agit d’un transporteur aérien spécialisé dans le fret. Ses prestations se déclinent sous<br />
deux formes :<br />
- un marché de lignes régulières prédominant composé d’un fret conventionnel<br />
- un marché du charter « timide » opérant dans le fret exceptionnel<br />
Le transporteur en question est un « challenger » dans le marché <strong>des</strong> lignes régulières du<br />
fret aérien mais accuse un retard dans le marché du charter qui est développé par d’autres<br />
compagnies, notamment le transporteur britannique Air Foyle (Antonov Airlines) exploitant<br />
l’AN 124 pouvant transporter jusqu’à 129 tonnes de charge en masse indivisible nécessitant<br />
toutefois <strong>des</strong> infrastructures aéroportuaires spécifiques.<br />
Par ailleurs, outre ce type de transporteurs spécialisés, <strong>des</strong> structures plus conventionnelles<br />
dont le métier de base n’est pas le transport aérien entendu comme tel s’attaquent au<br />
charter, parmi lesquelles <strong>des</strong> commissionnaires de transport. Cette situation est quelque peu<br />
alarmante pour le transporteur aérien ici interviewé qui peut craindre une mainmise sur le<br />
secteur du fret par certains « transitaires » qui seront, à moyen terme, à même de proposer<br />
un service complet au client (peut-être même au niveau <strong>des</strong> lignes régulières !) : préparatif et<br />
architecture de l’acheminement, formalités administratives, transport principal à proprement<br />
dit et contrôle général de la chaîne de transport. De plus, il est à noter que la<br />
« centralisation » de la gestion <strong>des</strong> <strong>transports</strong> peut présenter, chez certains chargeursindustriels,<br />
un avantage considérable pour la négociation globale du fret.<br />
Aussi, un intérêt notable a été décelé de la part de la direction du transporteur en question<br />
au stade même du développement <strong>des</strong> dirigeables de charges lour<strong>des</strong> (AVEA, Cargolifter<br />
pour l’essentiel) ; ceci relève bien évidemment d’une structure de veille technologique.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 89
L’entreprise attend donc de voir l’évolution <strong>des</strong> développements techniques du<br />
dirigeable lourd pour prendre la décision d’investir ou non dans ce segment de<br />
marché.<br />
Toutefois, si sa décision devient ferme quant à l’exploitation du dirigeable, notamment<br />
l’AVEA pour sa capacité d’emport importante, ce transporteur complétera sa panoplie d’offre<br />
de service dans le segment du fret aérien. Il pourra en outre renforcer sa position dans le fret<br />
exceptionnel, asseoir plus fermement sa réputation de transporteur aérien global, améliorer<br />
la personnalisation et la qualité du service en terme ne serait ce que d’adaptabilité de l’offre<br />
aux évolutions de situations et aux événements exceptionnels …<br />
De nouvelles offres peuvent également se concrétiser telle que la mise en place de<br />
systèmes de partenariat (vers <strong>des</strong> économies de réseaux) entre le dit transporteur aérien et<br />
un armateur maritime dans le cas de clients désirant un transport principal par navire-cargo<br />
et <strong>des</strong> <strong>des</strong>sertes terminales, incluant le levage, par AVEA. Ceci permettra au chargeur de<br />
gagner un temps appréciable par rapport à la filière d’acheminement traditionnelle et de<br />
réduire le temps de transit du navire au port (rapidité du transit, amélioration de la cadence<br />
de manutention qui sera effectuée par l’AVEA ou un de ses produits dérivés, la grue<br />
aérostatique) et par suite les coûts portuaires et de transit qui peuvent atteindre les 500 $ par<br />
heure. Ce schéma pourrait être fréquent dans le cas de <strong>transports</strong> intercontinentaux longs<br />
alourdissant le coût du transport s’il se faisait intégralement par AVEA. Il s’agit ici de tracer<br />
une limite en deçà ou au delà de laquelle le transport intégral par AVEA sera intéressant<br />
pécuniairement ou non.<br />
Il y a lieu de comprendre également la plus-value pour le dirigeable en question en tant que<br />
produit complémentaire du transport aérien conventionnel et son réel intérêt vis à vis de la<br />
clientèle potentielle.<br />
Le fait d’associer l’exploitation de l’AVEA au transporteur en question aura plusieurs effets<br />
parmi lesquels :<br />
- bénéficier de son expérience en matière de navigation et de sécurité ainsi que du<br />
personnel technique et navigant déjà habitué à l’expérience aérienne.<br />
- donner plus d’élan à l’Aile Volante pour une pénétration réussie dans le marché global du<br />
transport exceptionnel (effet d’appartenance à une structure déjà éprouvée).<br />
- profiter de l’apport de son réseau commercial.<br />
Du côté du client, celui-ci bénéficiera d’un transport plus adapté à ses besoins (le chargeur<br />
ne sera plus contraint à modulariser à l’extrême sa pièce à une fin de transport, ce qui<br />
engendre <strong>des</strong> coûts supplémentaires de montage/démontage à l’usine de production d’une<br />
part et chez le <strong>des</strong>tinataire d’autre part), plus rapide, sans rupture de charge et à un coût<br />
compétitif - selon cas - lorsque l’on intègre toutes les phases en amont et en aval du<br />
transport principal (procédures administratives diverses, stockage temporaire, levage,<br />
<strong>des</strong>sertes terminales). Par ailleurs, avec l’AVEA, le chargeur-industriel aura la possibilité,<br />
selon la nature de la « pièce », à appliquer le concept tant prôné actuellement de<br />
l’ « identification retardée <strong>des</strong> produits » qui consiste à différer au maximum la production et<br />
la personnalisation <strong>des</strong> produits désormais conçus sous forme d’éléments de base et de<br />
sous-éléments de base.<br />
A une fin de rentabilité mais également de réactivité et de rapidité de service, le transporteur<br />
en cause ici devra établir progressivement, à l’échelle internationale, <strong>des</strong> bases de<br />
stationnement de l’AVEA à proximité <strong>des</strong> régions principales productrices et consommatrices<br />
<strong>des</strong> pièces lour<strong>des</strong> et encombrantes. Par ailleurs, d’un point de vue management, il devra<br />
adopter, dans certains cas, une stratégie de prix adaptée à la configuration de la demande<br />
afin d’optimiser ses recettes (pratiques dérivées du yield management). Ceci revient, dans le<br />
cas de cette « compagnie aérienne », à inciter par exemple les clients à accepter un<br />
transport de leur marchandise conventionnelle par AVEA de 200 t (au lieu du B 747 - 400)<br />
après groupage - un dégroupage se fera sur les plates-formes aéroportuaires du<br />
transporteur à l’image de ce qui se fait pour l’avion - moyennant une réduction tarifaire et ce,<br />
afin d’éviter un retour à vide de l’aérostat après une mission de fret exceptionnel. Cette<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 90
manière de procéder (substitution de l’AVEA à l’avion ou vice-versa et ce, en fonction du<br />
contexte) permettra à la compagnie en question de rentabiliser ses opérations et par là<br />
même de proposer au client <strong>des</strong> tarifs intéressants (pratique de réseau).<br />
Aussi, l’offre de service AVEA induira de nouvelles procédures administratives, notamment<br />
douanière, dans la mesure où pour les masses indivisibles, le transport se fera de porte à<br />
porte sans passage par <strong>des</strong> bureaux de douane. Dès lors, la pratique <strong>des</strong> visites de douane<br />
dans les locaux professionnels du <strong>des</strong>tinataire de la marchandise et <strong>des</strong> déclarations en<br />
douane anticipée doit être prévue et programmée avec le commissionnaire de transport en<br />
charge du colis lourd.<br />
Cependant, avant d’intégrer le dirigeable lourd dans une logique de lignes régulières, l’AVEA<br />
devra faire ses preuves sur le marché du charter qui reste discret au niveau de l’aérien. De<br />
plus, il s’agit d’une demande qui devra être créée dans la mesure où un transport monobloc<br />
de 200 t voire de 500 t par une compagnie aérienne n’a jamais encore été effectué et que ce<br />
créneau « grosses pièces industrielles » est mal connu par ces transporteurs. Une période<br />
d’essai sera hautement probable.<br />
D’un point de vue technique, <strong>des</strong> questions concernant l’impact de la concentration de la<br />
charge au niveau de l’aérostat ont été posées et constituent un point fondamental aux côtés<br />
<strong>des</strong> aspects réglementaires (définition <strong>des</strong> couloirs aériens !).<br />
En conclusion, la mise en place d’un nouveau service d’envergure importante suite à<br />
l’émergence du dirigeable lourd entraîne diverses opérations (réorganisation administrative à<br />
l’interne, investissements nécessaires, élaboration de nouvelles stratégies, …) au sein de la<br />
structure préexistante qui doivent être correctement identifiées afin de reproduire une offre<br />
de qualité à l’attention du client.<br />
Dans cette optique, l’AVEA pourrait contribuer dans le cas du transporteur interviewé au<br />
développement et à la professionnalisation de son pôle fret lourd et, de manière globale, au<br />
renforcement de sa position à l’échelle internationale.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 91
Fiche 36 :<br />
11/07/2000<br />
Implantation : Le Creusot<br />
Secteur d’activité retenue : Equipements énergétiques (compresseurs centrifuge et<br />
alternatif, turbines vapeur, générateurs …)<br />
Il s’agit d’une ancienne filiale de Framatome, aujourd’hui détenue par Nuovo Pignone, ellemême<br />
filiale de General Electric.<br />
Jusqu’à présent, il s’agissait d’une entreprise spécialisée dans le gros équipement industriel<br />
qui tend actuellement à commercialiser <strong>des</strong> turbines et <strong>des</strong> compresseurs de moyenne<br />
envergure (max.70 t ;au-delà, l’activité a été transférée à d’autres unités de Nuovo Pignone).<br />
Il est à noter que le marché <strong>des</strong> équipements industriels (turbines, groupes, transformateurs,<br />
compresseurs) est détenu à l’échelle internationale par 5 gros équipementiers à savoir<br />
Alstom, General Electric, Siemens Voith, VAtech et Solar (Caterpillar) qui se partagent<br />
pratiquement à part égale l’activité générale du dit secteur.<br />
Transport :<br />
Concernant cet équipementier, le transport est limité à 200 t de charge globale avec une<br />
hauteur maximale de convoi de 5,60 m compte tenu du tracé et du dimensionnement de<br />
l’unique liaison (routière) reliant Le Creusot à Châlon Sur Saône.<br />
Il est à noter que, face à ces envois exceptionnels, deux choix d’itinéraires se présentent à<br />
Thermodyn, à savoir :<br />
1 er itinéraire : Le Creusot - Châlon Sur Saône par route express<br />
Barge (mode fluvial) jusqu’à Port Saint-Louis du Rhône (port lourd aux environs<br />
de Marseille)<br />
2 ème itinéraire : Le Creusot-Châlon Sur Saône par route express<br />
Châlon Sur Saône - Strasbourg par route<br />
Strasbourg - Anvers par voie maritime<br />
En moyenne, le trajet « Le Creusot - Strasbourg » se fait en 5 jours pour 390 km. D’un point<br />
de vue coût, le transport de deux colis de 47 t et 77 t chacun revient à 180 000 FF, incluant<br />
les frais du transporteur, ceux de la gendarmerie, l’enlèvement <strong>des</strong> barrières et l’octroi <strong>des</strong><br />
autorisations nécessaires.<br />
L’AVEA, à raison d’une vitesse commerciale de 100 km/h , pourrait garantir la liaison en 1<br />
journée au maximum, incluant les phases d’approche, de positionnement et de manutention.<br />
Ainsi, compte tenu <strong>des</strong> avantages pouvant être générés par l’aérostat lourd,<br />
- au niveau de la production : suppression du désassemblage pour les besoins du<br />
transport, de la modularité à une seule fin d’acheminement en dehors de toute<br />
considération d’entretien ultérieur de l’équipement considéré, mise à la consommation<br />
immédiate chez le client final (disparition d’opérations de montage pouvant inclure le<br />
soudage en site non équipé d’où un impact sur la qualité finale du produit), allongement<br />
du temps de production qui n’est plus tronqué par l’étape « Transport »<br />
- au niveau logistique : simplification de la chaîne de transport et de ses acteurs,<br />
standardisation par sous-segment d’activité du conditionnement de la pièce à transporter,<br />
réduction notable du temps d’acheminement, suppression de certaines contraintes<br />
opérationnelles (gestion du risque lié au délai de transport vue d’un point de vue<br />
multimodal = « correspondances » entre les mo<strong>des</strong> routier, fluvial et maritime)<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 92
L’établissement en question est disposée à opter pour l’AVEA, sous réserve d’une fiabilité<br />
prouvée, d’une disponibilité certaine et d’une réglementation souple, dans <strong>des</strong> limites<br />
tarifaires allant jusqu’à 15% (10 à 15%) en sus <strong>des</strong> prix de transport pratiqués actuellement.<br />
Il est à noter que ce ratio peut être vu à la hausse pour <strong>des</strong> opérations particulières qui, en<br />
raison de leur tonnage et de leurs caractéristiques techniques, nécessitent une fabrication<br />
extra muros à proximité de voies d’acheminement, en l’occurrence maritime (location<br />
d’arsenaux à équiper en fonction <strong>des</strong> besoins d’où délocalisation du matériel et de la main<br />
d’œuvre nécessaires et surcoûts).<br />
Marché :<br />
Antérieurement à sa restructuration, la charge de production de l’unité considérée était de<br />
l’ordre de 10 turbines par an d’un poids moyen de 150 tonnes. Ses zones de distribution<br />
étaient principalement :<br />
- Afrique du Nord (Algérie, Maroc)<br />
- Europe<br />
- Moyen-Orient<br />
Aussi, compte tenu du marché actuel et de son évolution, il est recommandé de disposer dès<br />
la première mise en exploitation industrielle de l’AVEA <strong>des</strong> configuration 200 et 500 t, avec<br />
une prééminence du 200 t.<br />
Contraintes/Exigences :<br />
- Fiabilité du système AVEA ⇒ taux prévisible <strong>des</strong> primes d’assurances<br />
- Définition du degré de sensibilité aux conditions atmosphériques ⇒ déterminer le nombre<br />
de jours moyens opérationnels de l’AVEA (notion de disponibilité)<br />
- Fournir une fourchette de prix d’exploitation<br />
- Définir un système standard de conditionnement de la charge en fonction de la nature du<br />
système de levage (cette information est nécessaire au niveau même de la conception<br />
de la pièce qui doit renfermer un certain nombre de points d’ancrage adéquatement<br />
répartis selon les efforts développés en phase de transport)<br />
- Eviter les ruptures de charge, notamment déterminer la procédure d’empotage <strong>des</strong> colis<br />
lourds (possibilité de transbordement direct sur le bateau ou nécessité de dépose sur un<br />
site de déchargement et reprise sur camion - là, l’intérêt du dirigeable s’en trouve réduit !<br />
- ; la possibilité de transbordement direct comporte à la fois un avantage financier et<br />
opérationnel dans la mesure où il n’est pas nécessaire de disposer de bateaux équipés<br />
de grues lour<strong>des</strong>, flotte rare et à affrètement double voire triple du prix <strong>des</strong> navires<br />
conventionnels)<br />
- Précision du positionnement du dirigeable et de son interface de levage (simulation du<br />
dirigeable au-<strong>des</strong>sus d’une usine où passent <strong>des</strong> lignes de haute tension à 500 m du lieu<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 93
présumé de chargement). Le système de treuillage devrait être dynamique pour corriger<br />
l’orientation de la charge face au vent ; une autre solution serait de rendre le dirigeable<br />
captif en phase de chargement/déchargement de sa charge<br />
- Aspect réglementaire : survol et opérations en zones urbaines et péri-urbaines. Notons<br />
que l’usine visitée est en ville ; transport de nuit (actuellement, le transport exceptionnel<br />
est interdit de nuit en France, contrairement à d’autres pays comme la Belgique !)<br />
- Aspects fonctionnels : Distance franchissable minimum requise : 4 000 km<br />
Altitude de vol : plus de 5 000 m<br />
On propose ci-après une composition standard d’un envoi effectué par l’unité industrielle en<br />
question. On peut déjà proposer un transport monobloc de l’ensemble qui pèse seulement<br />
187 981 kg conditionnés. Il pourrait s’agir de regrouper en phase de production et de<br />
transporter en état d’utilisation immédiate l’ensemble « Skid générateur » équipé, ainsi que<br />
le module « Skid turbine ». Par ailleurs, une économie substantielle sera faite sur le<br />
conditionnement et les conteneurs de transport.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 94
Fiche 37 :<br />
12/07/2000<br />
Implantation : Vevey (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Equipements énergétiques (turbines Pelton, Francis et axiales,<br />
groupes bulbes …)<br />
Cette entreprise dont le siège social se trouve à Linz (Autriche) figure parmi les 5 leaders<br />
mondiaux en matière de fabrication d’équipements énergétiques à usage industriel (25 à<br />
30% du marché mondial).<br />
Cette entreprise sous-traite une partie de ses équipements en Corée, au Mexique, au Maroc,<br />
au Pérou, en Russie et en Tchéquie.<br />
Parmi les cas de figure susceptibles d’être intéressés par un transport AVEA, on retient le<br />
cas du projet Deriner (Nord de la Turquie) qui constitue un cas typique d’application du<br />
dirigeable lourd.<br />
Il s’agit, en effet, du transport d’équipements d’une masse totale de 700 tonnes modularisée<br />
en multiples colis pour <strong>des</strong> raisons de transport (gabarit <strong>des</strong> tunnels notamment) au départ<br />
de Vevey (Suisse) et de Linz (Autriche).<br />
Compte tenu du planning de production et de livraison, un AVEA de capacité 200 tonnes<br />
(altitude : plus de 5 000 m, distance franchissable : 10 000 km, vitesse : 100 km/h) est<br />
susceptible de réaliser la globalité <strong>des</strong> <strong>transports</strong> <strong>des</strong> éléments lourds et encombrants sans<br />
devoir modulariser à l’extrême au niveau de la production.<br />
Il est à noter, qu’actuellement, il est prévu d’effectuer l’acheminement <strong>des</strong> divers colis par le<br />
nord (Linz-Deriner) d’où un coût de l’opération avoisinant les 400 000 CHF pour un délai de<br />
transport de deux mois.<br />
A ceci, il faudra ajouter les équipements nécessaire au niveau du port de Hopa (à une<br />
centaine de kilomètres de Deriner) non équipé pour recevoir <strong>des</strong> colis lourds.<br />
L’AVEA pourrait, pour sa part, réaliser le transport et la manutention en deux jours<br />
(distance : 2 000 km) d’où un gain appréciable en terme d’ordonnancement de la production<br />
dans la mesure où les équipements ou partie de ceux-ci peuvent être commandés plus tard<br />
- au bon moment - aux sous-traitants. On s’achemine, ainsi, vers une logique de flux tendus.<br />
D’un autre côté, les intérêts financiers régissant les termes de l’échange commercial entre<br />
les diverses parties ne sont pas vraiment significatifs mais sont à prendre en compte dans la<br />
facture globale. Ils s’élèvent à 2 voire 3% par an.<br />
Par ailleurs, un autre avantage lié au transport par dirigeable pourrait tenir à sa disponibilité<br />
à l’image <strong>des</strong> acheminements par route. En effet, le schéma de production de l’entreprise en<br />
question ici est soumis à une contrainte externe concernant le transport maritime. La liaison<br />
maritime Hopa n’est assurée que deux fois par mois. Dans le cas où cette contrainte est<br />
transgressée, un affrètement spécial doit être envisagé, ce qui peut surenchérir d’un facteur<br />
3 le coût du transport.<br />
En résumé, l’apport du dirigeable pourrait concerner les <strong>transports</strong> exceptionnels de<br />
l’équipementier ici considéré dans <strong>des</strong> proportions avoisinant la cinquantaine<br />
d’acheminement par an, auquel on peut ajouter <strong>des</strong> <strong>transports</strong> ponctuels en remplacement<br />
de l’Antonov <strong>des</strong>tiné à remédier en urgence aux vices de fabrication pouvant se produire.<br />
A cette charge de trafic, on peut mentionner le marché induit par le dirigeable à la suite d’une<br />
modification <strong>des</strong> processus de production qui serait à analyser plus en détail sur un cas<br />
pratique.<br />
En effet, selon les chantiers, l’apport du dirigeable serait plus ou moins probant. S’il s’agit de<br />
manœuvre en « caverne », le besoin de modularité poussé est dicté par ce type de mise en<br />
œuvre et non pas par le transport. L’intérêt de l’AVEA serait réduit dans ce cas.<br />
Par contre, s’il s’agit d’installations ouvertes, l’AVEA permettrait une mise en œuvre<br />
simplifiée (transport et manutention mono-bloc de turbines), plus rapide (suppression<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 95
d’opérations à faible valeur ajoutée sur site comme le soudage et l’assemblage d’éléments<br />
qui auraient pu être faits en usine) dans <strong>des</strong> délais appréciables et dans une qualité<br />
meilleure.<br />
C’est notamment le cas pour les installations en puit vertical sous réserve d’une précision de<br />
manœuvre de l’ensemble « AVEA + système de guidage » qui doit avoisiner le centimètre.<br />
Les étapes de mise en œuvre peuvent se décomposer comme suit :<br />
- Descente de l’aspirateur préfabriqué en usine (poids : 20 à 150 t)<br />
- Pose de la bâche (20 à 150 t)<br />
- Travaux de bétonnage<br />
- Pose de l’alternateur (plus de 200 t)<br />
Autre alternative : construction monobloc « aspirateur+bâche+alternateur » avec un système<br />
de support provisoire, l’ensemble posé par AVEA puis étape de bétonnage final<br />
⇒ GAIN DE TEMPS ET ECONOMIE SUBSTANTIELLE<br />
Il est à noter cependant qu’une étude détaillée devrait être menée pour valider cette<br />
alternative qui tendrait à se généraliser par la suite. Une analyse intégrant également les<br />
capacités de manutention à l’intérieur <strong>des</strong> unités de production doit être opérée en même<br />
temps qu’une évaluation <strong>des</strong> coûts suite à un rééquipement éventuel de l’usine.<br />
Il faut aussi mentionner que si l’AVEA est adopté comme mode principal de transport, une<br />
réorganisation, un changement de stratégie de l’entreprise industrielle pourrait être mené à<br />
savoir la définition d’unités spécialisées par nature et type de produit qui fabriqueront<br />
entièrement la pièce considérée ou encore la mise en place d’une usine « Hub » qui se<br />
chargera de l’assemblage final.<br />
Toutefois, avant de se prononcer sur une refonte d’organisation, il faut que l’AVEA puisse<br />
justifier :<br />
- sa fiabilité<br />
- sa disponibilité et sa régularité (nombre d’appareils et contraintes opérationnelles)<br />
- ses performances techniques (système de levage, précision du positionnement …)<br />
- son coût d’exploitation (fourchette d’estimation basée sur ses aspects techniques)<br />
Une fois ces paramètres maîtrisés, une simulation devra être faite et conclure sur sa<br />
rentabilité économique.<br />
Dès lors, <strong>des</strong> considérations touchant le processus de production seront analysées telles<br />
que, en premier lieu, la mise au point d’un nouveau système d’ajustement <strong>des</strong> bagues sur<br />
les répartiteurs afin d’optimiser le levage et le diagramme <strong>des</strong> efforts auxquels est soumise<br />
la charge durant sa phase de transport.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 96
Fiche 38 :<br />
20/07/2000<br />
Implantation : Lausanne (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Bureau d’étu<strong>des</strong> en Génie Civil<br />
Séance essentiellement d’information :<br />
Outre les travaux de construction de passage sur ou sous voies et d’ouvrages d’art, l’AVEA<br />
pourrait transporter <strong>des</strong> modules industriels voire <strong>des</strong> blocs complets comme c’est le cas <strong>des</strong><br />
salles de commande et <strong>des</strong> cages d’ascenseurs du CERN (Genève) d’une base de 35 m 2<br />
chacun. Ces modules, au nombre de 35, sont à transporter sur une distance d’une centaine<br />
de km. Sous réserve d’un positionnement précis de l’AVEA et de ses systèmes d’appoint<br />
(précision similaire à celle d’une grue), ce dernier peut également opérer la <strong>des</strong>cente de ces<br />
modules le long du puit d’accueil, d’où un gain économique probable et une sécurité accrue<br />
<strong>des</strong> modules qui ne subiront pas de rupture de charges.<br />
Il serait éventuellement intéressant d’étudier de plus près ce cas.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 97
Fiche 39 :<br />
2/08/2000<br />
Implantation : Zurich (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Bureau d’étu<strong>des</strong> généraliste en Génie Civil<br />
Séance essentiellement d’information :<br />
→ Applications de l’AVEA :<br />
- Construction de ponts<br />
- Construction de sta<strong>des</strong> : l’AVEA induira une plus grande flexibilité d’utilisation <strong>des</strong> sta<strong>des</strong><br />
(on pourrait passer aisément d’un stade de capacité 20 000 personnes à une autre<br />
configuration d’une capacité de 50 000<br />
- Mise en place de toitures de stade : c’est notamment le cas de la toiture du stade Saint<br />
Jacques à Bâle où l’on a dû modifier la conception pour <strong>des</strong> raisons de transport<br />
- Construction en milieu urbain et problèmes logistiques de transport dans les gran<strong>des</strong><br />
cités qui peuvent être annihiler si l’AVEA peut y opérer (Cf. réglementation et précision<br />
de pose)<br />
- Irrigation de terres désertiques (transport d’eau, de réservoirs)<br />
- Trafic transalpin : transport en une fois de 12 camions de 40 tonnes groupés ⇒ analyse<br />
et intérêt environnementaux<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 98
Fiche 40 :<br />
3/08/2000<br />
Implantation : Baden (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Equipements énergétiques à usage industriel (Générateurs,<br />
turbines, transformateurs, chaudières et leurs sous-équipements)<br />
Les principaux centres de production de l’équipementier en question se trouvent en Suède,<br />
en Allemagne (Mannheim et Bier), en Pologne (Lodz et Dabrowa Gornicza), en Suisse<br />
(Baden et Genève), en France (Paris et Grenoble), en Grande Bretagne (Stamford), aux<br />
Etats-Unis (Richmond), au Canada et au Japon (Kawasaki) avec <strong>des</strong> fournisseurs en Europe<br />
et en Australie et <strong>des</strong> clients finaux en Afrique (Maroc, Côte d’Ivoire), en Amérique du Nord<br />
et du Sud (Brésil, Argentine, Pérou).<br />
La répartition <strong>des</strong> sites de production européens par type de pièces est comme suit (à la<br />
date de cet entretien) :<br />
- France/Paris : transformateurs<br />
- France/Grenoble : turbines<br />
- Suisse/Genève : transformateurs<br />
- Suisse/Baden : ensemblier<br />
- Allemagne/Bier : rotors<br />
- Allemagne/Mannheim : ensemblier, générateurs et turbines à gaz<br />
- Grande-Bretagne/Stamford : transformateurs<br />
- Pologne/Lodz et Dabrowa Gornicza : ensemblier, générateurs et turbines à gaz<br />
L’organisation est telle que certaines unités comme celles de Baden et Mannheim<br />
constituent <strong>des</strong> unités d’assemblage qui concentrent les différentes pièces en provenance<br />
d’usines spécialisées. C’est le cas par exemple de Bier qui approvisionnent Lodz et<br />
Mannheim en rotors. On peut donc prévoir une aire de stationnement AVEA à proximité <strong>des</strong><br />
sites de concentration/production <strong>des</strong> unités industrielles du groupe en question. D’autre<br />
part, l’AVEA peut relier les sites d’approvisionnement et d’assemblage de l’industriel ici<br />
considéré lorsqu’il s’agit de transporter de gros éléments comme on le rencontre souvent<br />
entre Bier et Mannheim, Bier et Lodz, Genève et Baden.<br />
En outre, il est à noter que bon nombre de transport transite par l’axe fluvio-routier<br />
Mannheim - Rotterdam, soit sur une distance de 500 km. A titre indicatif, un transport de 340<br />
tonnes sur cet axe coûte environ 150 000 CHF avec une contrainte majeure qui ne permet<br />
les <strong>transports</strong> exceptionnels que durant le week-end. A cet aspect réglementaire lié à une<br />
fluidification du trafic sur le Rhin, s’ajoute le problème <strong>des</strong> hautes et basses eaux qui<br />
paralyse le transport.<br />
En conséquence et sous réserve d’aspects réglementaires, opérationnels et techniques,<br />
l’AVEA est en mesure d’être un moyen plus flexible et moins contraignant. D’autres<br />
avantages peuvent être identifiés comme les gains financiers liés au coût du capital<br />
immobilisé pendant le transport qui peut prendre plusieurs mois ; les taux à ramener au coût<br />
de la « marchandise » transportée sont de 7 à 7,5% l’an en Allemagne et de 5% en Suisse.<br />
Marché :<br />
L’établissement de Baden en question ici produit environ 100 turbines à gaz par an d’un<br />
poids compris entre 165 et 370 tonnes et près de 300 générateurs de plus de 150 t à l’unité.<br />
Il est à noter également le développement en cours de générateurs dont le poids avoisine les<br />
500 tonnes.<br />
Ainsi, en permettant un transport monobloc, en rendant définitif les montages à « blanc » en<br />
usine pour essai, l’AVEA, en justifiant sa disponibilité, sa fiabilité et en adoptant ses coûts<br />
peut devenir le mode de transport privilégié de ces gros ensembliers. En outre, face à une<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 99
activité dense permettant le développement d’un concept fidélité, le coût d’exploitation de la<br />
flotte AVEA « mise à disposition » de l’entreprise considérée serait vu à la baisse dans la<br />
mesure où l’on pourrait planifier une optimisation d’exploitation en réseau du dirigeable<br />
limitant ainsi, et entre autres, ses trajets à vide.<br />
D’autre part, il a été formellement précisé par l’équipementier en question, la nécessité de<br />
disposer de dirigeables d’une capacité d’emport supérieure à 200 tonnes. En effet, compte<br />
tenu du plan de production de l’activité « Power » d’ABB, <strong>des</strong> aérostats de 500 tonnes<br />
seraient bien adaptés.<br />
D’un point de vue technique, il est primordial d’éviter lors du transport tout effort torsionnel<br />
qu’aurait à subir la pièce. Il faut donc réfléchir à la fixation <strong>des</strong> éléments transportés.<br />
Il faut également mentionner que l’établissement visité est enclin à négocier directement le<br />
transport de ses pièces à haute valeur ajoutée avec les divers transporteurs sans passer par<br />
l’entremise de commissionnaires de transport. Le fait de disposer d’un unique interlocuteur -<br />
l’AVEA assurant le transport intégral de l’équipement considéré sans rupture de charges -<br />
constitue un avantage réel en faveur de l’aérostat lourd.<br />
Par ailleurs, de par la participation du gros équipementier en question à la Commission<br />
mondiale <strong>des</strong> Grands barrages et sa forte visibilité dans les programmes de limitation <strong>des</strong><br />
gaz à effet de serre, elle joue un rôle actif dans les initiatives internationales visant à<br />
améliorer l'environnement (Cf. état <strong>des</strong> équipements dans la région nord de l’Amazonie où<br />
l’on doit éviter la construction d’infrastructures lour<strong>des</strong> pour préserver l’environnement ;<br />
l’AVEA pourrait être un moyen de substitution permettant un développement économique<br />
homogène de la région !). Dans cette optique, l’AVEA étant un mode de transport a priori<br />
moins nocif que les moyens concurrents, son adoption serait facilitée. Dans les analyses<br />
futures d’étu<strong>des</strong> économiques, une part concernant les externalités négatives <strong>des</strong> <strong>transports</strong><br />
devrait être abordée en soulignant les caractéristiques de l’AVEA à la lumière <strong>des</strong><br />
développements techniques - prise en compte <strong>des</strong> émissions de CO2, de NOx et <strong>des</strong><br />
Composés Organiques Volatiles (COV) selon les divers mo<strong>des</strong> de transport -.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 100
Fiche 41 :<br />
3/08/2000<br />
Implantation : Marseille → siège de Fostrans<br />
Secteur d’activité retenue : Entreprise intégrale de transport, levage et transit<br />
Compte tenu du marché actuel de ce transporteur/levageur et de l’évolution prévisible pour<br />
les années futures, il est souhaitable de disposer d’une flotte de dirigeable d’une capacité<br />
allant de 200 à 1 000 tonnes.<br />
En effet, le marché de cette entreprise (transport et levage au départ et à <strong>des</strong>tination<br />
d’usines, opération de revamping pouvant être, par ailleurs, facilitées par l’AVEA) se<br />
discrétise comme suit (par an) :<br />
- 10 à 15 pièces de 500 tonnes avec en tout une centaine de pièce dans la gamme 160 à<br />
500 t avec une nette tendance vers le créneau 500 à 1 000 tonnes<br />
- 5 pièces de 1 000 tonnes unitaire<br />
- 2 pièces de 1 500 tonnes<br />
D’autre part, d’un point de vue caractéristiques, l’AVEA pourrait être utilisé pour <strong>des</strong><br />
<strong>transports</strong> en montagne, ainsi que pour la pose de télescopes et autres moyens de mesure<br />
d’où une altitude d’opération minimale de 5 000 m. Une distance franchissable de 10 000 km<br />
et une vitesse commerciale de 100 km/h sont appréciables.<br />
Par ailleurs, <strong>des</strong> précisions devront être fournies quant au système de treuillage dans un<br />
objectif de complémentarité entre le dirigeable et le navire par transfert direct de la charge.<br />
On devra également définir le système de ballastage et le temps nécessaire à cette<br />
opération d’équilibrage <strong>des</strong> masses, en même temps que la précision du positionnement, la<br />
vitesse d’ascension et de dépose de la charge, ainsi que le coût prévisible d’exploitation du<br />
dirigeable basé sur une comptabilité <strong>des</strong> postes techniques. Notons qu’actuellement, les<br />
phases de transport et manutention incluant la police d’assurance représentent, en<br />
moyenne, 0,5% de la valeur finale de la marchandise à transporter. Des précisions<br />
concernant la certification doivent être fournies dans la mesure où cette composante a un<br />
impact majeur au niveau de l’exploitation (survol <strong>des</strong> zones urbaines, transport de nuit). Des<br />
considérations touchant à la sécurité doivent être éclaircies afin de pouvoir estimer les taux<br />
d’assurance applicables à la fois au moyen de transport (AVEA) et à la pièce sustentée.<br />
Toujours d’un point de vue opérationnel, une possibilité de rotation en l’air <strong>des</strong> charges serait<br />
à étudier. Cette option permettrait de préparer, durant la phase d’approche, la pièce<br />
transportée en position finale d’utilisation. Il s’agit d’une procédure intéressante pour le<br />
transport de colonnes verticales qui seront, en raison de problèmes aérodynamiques, plus<br />
enclins à être transportées en phase horizontale. La mise à la verticale se ferait en phase<br />
d’approche finale.<br />
Par ailleurs, d’un point de vue logistique, l’usage d’un dirigeable lourd est justifié ne serait-ce<br />
que lorsque l’on observe un arrêt complet <strong>des</strong> <strong>transports</strong> pendant plusieurs mois en raison<br />
par exemple de crues/décrues de voies d’eau. C’est le cas notamment du Danube entre<br />
Bratislava et Rotterdam (axe très fréquenté) qui peut être fermé pendant trois mois de suite<br />
par an. A ceci, il faut ajouter un intérêt direct pour le transporteur dans la mesure où un<br />
transport de 1 500 km (Bratislava - Rotterdam) peut être fait en deux jours par AVEA au lieu<br />
de 15 jours par les moyens conventionnels en temps normal, d’où une productivité accrue et<br />
une meilleure rotation du matériel de transport.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 101
Fiche 42 :<br />
4/08/2000<br />
Implantation : Rome<br />
Secteur d’activité retenue : Distribution de vivres (Organisme humanitaire et d’aide en cas<br />
de catastrophe)<br />
L’organisme ici considéré est habilité à venir en aide aux populations sinistrées, notamment<br />
par l’acheminement de vivres et de matériels de première nécessité. Il achemine directement<br />
3 à 3,5 millions de tonnes par an de vivres, en plus de 1,5 millions de tonnes/an<br />
indirectement grâce au concours <strong>des</strong> divers gouvernements.<br />
Parmi les multiples opérations menées, on distingue :<br />
- les opérations dites « régulières » <strong>des</strong>tinées à alimenter <strong>des</strong> camps d’une région<br />
déterminée sur une longue période. C’est le cas notamment <strong>des</strong> camps de réfugiés <strong>des</strong><br />
Grands Lacs africains ou encore ceux du Mozambique …<br />
- les opérations exceptionnelles à la suite de catastrophes naturelles où il est question<br />
d’évacuer en masse la population et de l’alimenter en urgence.<br />
Pour répondre à ces deux situations différentes de par leur nature, on optera pour deux<br />
configurations différentes de l’AVEA.<br />
Dans le premier cas, il s’agit de disposer d’un moyen de transport <strong>des</strong>tiné à remplacer<br />
l’hélicoptère qui reste cher et moyennement efficient compte tenu de sa charge utile limitée<br />
ou encore l’acheminement terrestre (routier) lent, risqué (sécurité) et encombrant (convois<br />
pouvant s’étaler sur plusieurs kilomètres) quant cela est possible (Cf. état <strong>des</strong> infrastructures<br />
en Afrique par exemple). Dans cet optique, le dirigeable idéal devrait permettre une charge<br />
utile de 50 à 60 tonnes avec un système de « largage » <strong>des</strong> vivres efficace et rapide afin que<br />
l’aérostat puisse <strong>des</strong>servir dans un délai raisonnable plusieurs points qui peuvent être<br />
distants de seulement quelques kilomètres (développement d’un concept de distribution de<br />
vivres à l’image du camionnage). Ainsi, le principe de ballastage doit être optimisé afin de<br />
garantir la souplesse nécessaire à l’aérostat.<br />
Dans le second cas, on se retrouve dans le segment du dirigeable lourd capable de<br />
sustenter 200 à 500 tonnes de charge utile avec la possibilité de transporter <strong>des</strong> personnes<br />
dans le cas <strong>des</strong> évacuations urgentes et massives <strong>des</strong> populations.<br />
D’un point de vue contraintes et afin d’évaluer correctement la faisabilité économique du<br />
dirigeable dans ce segment de marché, <strong>des</strong> précisions concernant les normes de sécurité<br />
applicables à l’aérostat, sa fiabilité et sa manœuvrabilité doivent être fournies en plus <strong>des</strong><br />
aspects réglementaires. Les limitations à l’exploitation doivent également être esquissées<br />
afin de décider quant à la faisabilité opérationnelle du dirigeable d’un point de vue<br />
humanitaire dans <strong>des</strong> régions à fort potentiel de conflit.<br />
A noter par exemple qu’un ballastage à eau limiterait l’intérêt du dirigeable dans la mesure<br />
où une grande partie <strong>des</strong> opérations d’assistance humanitaire se trouve en zone aride. Un<br />
ballastage à air comprimé serait plus efficient sous réserve <strong>des</strong> délais de ballastage et de la<br />
flexibilité <strong>des</strong> manœuvres qui en découle.<br />
D’un autre point de vue, l’utilisation du dirigeable lourd doit être acceptée par les divers pays<br />
où se déroulent les opérations. Des contacts doivent d’ores et déjà être pris au niveau<br />
informationnel voire diplomatique afin de cerner ce problème d’acceptabilité.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 102
Fiche 43 :<br />
9/08/2000<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Entreprise de construction / Génie Civil<br />
Les remarques formulées par cette entreprise de Génie Civil rejoignent celles <strong>des</strong> autres<br />
constructeurs comme on pourrait le remarquer à travers les compte-rendus précédents.<br />
Aussi, son intérêt pour le dirigeable est motivé par l’étude de cas du Viaduc de Millau dont<br />
on présentera ci-après l’analyse préliminaire.<br />
Le dirigeable lourd AVEA pourrait être utilisé dans le transport de parties de travées et de<br />
voussoirs. Actuellement, le poids moyen d’un voussoir préfabriqué est de 100 à 150 tonnes,<br />
alors que la tendance observée est de 200 à 250 tonnes. L’AVEA pourrait alors être un<br />
moyen idéal permettant une construction plus rapide et donc une mise à l’exploitation et un<br />
retour sur investissements relativement plus tôt. De plus, d’un point de vue organisation, la<br />
fabrication <strong>des</strong> travées et <strong>des</strong> voussoirs pourrait se faire en usine en dehors du chemin<br />
critique d’où un risque réduit quant à l’ordonnancement et à l’avancement <strong>des</strong> tâches sur un<br />
chantier.<br />
Cependant, <strong>des</strong> exigences relatives à l’exploitation de l’aérostat doivent être respectées :<br />
- définition du système de treuillage avec possibilité de dépose directe à l’endroit souhaité<br />
d’où une précision d’approche et du système « AVEA + gui<strong>des</strong> » analogue à celle d’une<br />
grue avec une option certaine de maintenir le dirigeable en position contrôlée sur une<br />
période d’une demi-journée à une journée - pour une construction en béton ; seulement<br />
quelques heures pour une construction métallique où le jointoiement se fait plus<br />
facilement - afin de permettre la réalisation de la liaison de l’élément considéré avec le<br />
reste de l’ouvrage (partie antécédente). Cette exigence de maintien du dirigeable en<br />
position devient caduque dans le cas de la mise au point d’un système provisoire<br />
d’assemblage supportant la charge. Son coût devrait, par contre, être pris en compte<br />
dans les conclusions de la faisabilité économique du dirigeable dans le domaine de la<br />
construction <strong>des</strong> grands ouvrages d’art.<br />
- manœuvrabilité du dirigeable : l’aérostat doit être flexible à la navigation. A noter que la<br />
distance entre deux pylônes dans le cadre du viaduc de Millau est de 342 m pour les<br />
travées centrales, de 204 m pour les travées de rive avec une hauteur de pylône de 90<br />
m. Mentionnons que le rapport charge utile/poids propre du dirigeable a un impact sur sa<br />
maniabilité. Ainsi, une proportion 50/50 est favorable d’un point de vue rigidité, mais<br />
néfaste d’un point de vue manœuvrabilité. La propension idéale serait 75/25.<br />
- sensibilité du dirigeable aux conditions de vent : il est à noter qu’actuellement les limites<br />
de travail avec une grue sont fixées à une vitesse de vent de 72 km/h avec une pénibilité<br />
accrue dès 60 km/h. En deçà, avec les moyens actuels, l’exploitation et le travail ne sont<br />
guère influencées par les aléas atmosphériques.<br />
A celles-ci, il faut ajouter l’aspect sécurité et fiabilité du dirigeable qui constituent <strong>des</strong><br />
spécifications communes à tous les segments d’activités susceptibles d’intéresser le<br />
dirigeable.<br />
A/ Présentation du cas « Viaduc de Millau » :<br />
Le futur Viaduc de Millau sur l'autoroute A75, devant relier Clermont-Ferrand à Béziers et<br />
Montpellier, sera l'un <strong>des</strong> ouvrages d'art les plus marquants du début du siècle. Il s'agit d'un<br />
ouvrage de 2460m de longueur comportant huit travées haubanées, la plus longue<br />
atteignant 342m. La chaussée à 2 fois 2 voies suspendues à près de 270m au <strong>des</strong>sus du<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 103
Tarn, présentera une grande courbe et une pente légère de 3% pour améliorer la visibilité de<br />
l'ouvrage et sécuriser l'usager. Les sept piles du viaduc seront constituées d'un fût en béton<br />
armé de forme pyramidale, se dédoublant en V renversant, permettant d'ancrer les haubans,<br />
répartis en semi-harpes.<br />
La construction de l'ouvrage nécessitera environ 127 000 mètres cubes de béton, 19 000<br />
tonnes d'acier de béton armé, 5000 tonnes d'acier de précontrainte ( câbles et haubans ).<br />
Coupe transversale Tablier à 270m de haut<br />
Les procédés de construction :<br />
Les problèmes de montage en matière de ponts ont pris une grande importance. Dans<br />
beaucoup de cas, il s’agit :<br />
- de mettre en place <strong>des</strong> éléments préfabriqués au sol, très lourds et<br />
encombrants<br />
- de réduire les délais pour assurer une mise en service rapide.<br />
De manière générale, on distingue de façon très schématique quatre types de montage :<br />
- Le lancement : l’ouvrage, ou la partie d’ouvrage, <strong>des</strong>tiné à être lancé est<br />
construit dans un atelier forain de niveau avec le plan de lancement. Ce<br />
dernier peut-être une plate-forme de travail placée au centre de l’ouvrage ou<br />
le remblai d’accès à la culée de ce dernier.<br />
- La mise en place par encorbellement : cette technique consiste à construire<br />
un pont à caisson, par exemple, en porte à faux à partir d’une pile. Les<br />
éléments partiels peuvent être entièrement préfabriqués (longueur pouvant<br />
avoisiner les 30m) et mis en place grâce à un portique ou à une ossature<br />
placée sur le tronçon antérieur.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 104
- La mise en place par levage : il s’agit, dans ce cas, de construire l’ouvrage<br />
dans sa quasi-totalité au sol et de le lever au moyen de systèmes<br />
spécialement conçus pour supporter <strong>des</strong> charges importantes.<br />
- Le montage à la bigue ou à la grue : il est possible, dans un site fluvial, de<br />
lever <strong>des</strong> tronçons de poutres grâce à une bigue pour <strong>des</strong> éléments de<br />
quelques centaines de tonnes. En site maritime, la puissance de levage peut<br />
atteindre quelques milliers de tonnes.<br />
Objectifs / résultats de l’étude :<br />
L’objectif essentiel de cette étude est de vérifier la potentialité d’application du dirigeable au<br />
domaine <strong>des</strong> travaux publics via un cas concret qui fera office de projet pilote pour les<br />
constructions futures.<br />
L’étude confronte directement la solution de construction adoptée dans le cas du viaduc de<br />
Millau avec un procédé sollicitant le dirigeable. Dans cette optique, une <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> deux<br />
processus est esquissée, listant, entre autres, les avantages et inconvénients de chacun.<br />
La solution « dirigeable » se base sur une expertise technique et réglementaire <strong>des</strong><br />
performances de l’aérostat qui est effectuée sous la responsabilité de l’ONERA.<br />
Afin de mettre en évidence la modification <strong>des</strong> processus logistiques que pourrait entraîner<br />
le dirigeable, <strong>des</strong> outils de programmation tels PERT sont mis à profit en parallèle avec une<br />
<strong>des</strong>cription qualitative. De plus, une analyse technico-économique supplémentaire est faite<br />
dans le cas où la méthode « dirigeable » entraînerait une modification du dimensionnement<br />
<strong>des</strong> structures (absence d’effort de torsion, de risques de déversement - structures<br />
métalliques principalement -, …grâce à l’introduction du dirigeable).<br />
En définitive, un rapport de synthèse mentionne les principales conclusions auxquelles<br />
aboutit l’étude avec, si possible, <strong>des</strong> résultats généraux concernant les situations concrètes<br />
où la solution « dirigeable » serait préconisées en comparaison avec les procédés de<br />
construction existants. Parmi les déterminants du choix, on trouve :<br />
- le site de construction<br />
- la nature et les caractéristiques de l’ouvrage<br />
- le délai de construction<br />
- la qualité<br />
- le coût généralisé de la construction comprenant :<br />
o le coût de transport et de manutention par dirigeable<br />
o le coût de la construction de l’ouvrage<br />
o l’impact <strong>des</strong> effets externes générés dont, notamment, les nuisances de<br />
chantier dans le cas de travaux de longue durée.<br />
B/ Analyse :<br />
Il a été retenu, pour cette simulation « Dirigeable lourd - Viaduc de Millau », l’étude de la<br />
version métal de l’ouvrage.<br />
Deux parties du viaduc ont été particulièrement considérées :<br />
- les pylônes mixtes Acier-Béton<br />
- les éléments du tablier<br />
Parmi les interrogations les plus importantes, on trouve :<br />
- caractéristiques / performances du dirigeable (charge utile, vitesse, limite d’opérabilité<br />
eu égard aux conditions atmosphériques - vent maîtrisable à 10 m/s, durée<br />
d’amortissement…)<br />
- dimensions<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 105
- bilan de masse : un ratio de 0,6 ((masse totale - masse à vide) / capacité de levage<br />
de l'hélium) constitue l’objectif fixé pour le dirigeable lourd en question<br />
o effet de redistribution <strong>des</strong> efforts par la structure métallique du dirigeable<br />
o reprise <strong>des</strong> efforts par l’enveloppe<br />
- positionnement dans l’espace<br />
o mouvement vertical : non déterminant grâce entre autres à une stabilité<br />
verticale naturelle conférée par la grande inertie du dirigeable<br />
o mouvement horizontal / problème de tangage et positionnement de la charge<br />
(centre de gravité) : déterminant<br />
o mise en œuvre de systèmes de guidage propres au génie civil et permettant<br />
d’atteindre un seuil de positionnement préalablement défini<br />
o <strong>des</strong> effets dynamiques ne pouvant être repris par les systèmes provisoires<br />
d’assemblage seraient générés par la masse « dirigeable » confrontée à<br />
l’environnement immédiat. Ces effets ne peuvent être acceptés par les<br />
éléments de structure transportés. Ainsi, il devra être garanti une vitesse<br />
d’accostage maîtrisée permettant d’éviter les à-coups ; à noter que cette<br />
vitesse devra être de l’ordre est de quelques cm/mn d’après les civilistes,<br />
constructeurs du viaduc. Il va donc falloir prévoir un système permettant de<br />
passer progressivement d’un état dynamique à un autre statique. On peut<br />
imaginer un système par vérinage qui amènerait en vitesse contrôlée la<br />
charge en question à partir d’une cinquantaine de centimètres de sa position<br />
finale. On pourra reprendre et adapter certains mécanismes utilisés en milieu<br />
nautique.<br />
- stabilisation de la charge par rapport au dirigeable : satisfaisante<br />
- ballastage<br />
o deux solutions possibles à développer : lest à air comprimé, à eau. Le lest à<br />
eau présente de nombreux inconvénients opérationnels liés à la présence de<br />
l’eau au niveau <strong>des</strong> sites de déchargement où un pompage serait nécessaire<br />
en plus <strong>des</strong> zones froi<strong>des</strong> où l’eau risque de geler en automne/hiver.<br />
o le problème de ballastage intervient au moment du transfert de la charge<br />
principalement une fois que l’élément transporté par l’aérostat est suspendu<br />
sur un système provisoire en attente de son assemblage avec le reste du<br />
viaduc<br />
o le ballastage agit toujours dans le même sens. Dans le cas d'un ballastage à<br />
eau, nécessité d'avoir une réserve permanente de plusieurs centaines de m 3<br />
d'eau au voisinage immédiat du point de dépose de la charge<br />
- réglementation<br />
- exploitation du dirigeable<br />
o structures exploitantes<br />
o aire de stationnement du dirigeable, mât d’amarrage pour les opérations<br />
nécessitant une attente prolongée de l’aérostat, absence de hangars<br />
- appréciation du transport intermodal pour <strong>des</strong> distances supérieures à 500 km : cas<br />
où les constructeurs s’approvisionneront en matériaux préfabriqués auprès de<br />
fournisseurs hors aire d’influence du chantier<br />
- disponibilité de l’aérostat en vue d’une programmation de mise en œuvre en « flux<br />
tendu » <strong>des</strong> matériaux préfabriqués<br />
Scénarii d’étude :<br />
L’étude se décline comme suit :<br />
Scénario 1 : Simulation « détaillée » d’exploitation d’un dirigeable de 150 (+20%)<br />
tonnes de charge utile et comparaison avec la méthode de construction prévue pour<br />
le viaduc sur la base de considérations logistiques et économiques. On prend<br />
essentiellement en compte ici la construction du tablier et <strong>des</strong> pylônes.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 106
Scénario 2 : Esquisse d’exploitation d’un dirigeable de 300 tonnes de charge utile.<br />
Des considérations concernant le dimensionnement <strong>des</strong> structures sont avancées en<br />
plus <strong>des</strong> aspects logistiques et économiques.<br />
Le scénario 1 décrira les étapes de mise en œuvre d’éléments de tabliers de 11 m de portée.<br />
Cette dernière ne modifie pas la conception même de l’ouvrage car le porte à faux reste<br />
acceptable eu égard de la disposition <strong>des</strong> haubans. L’apport du dirigeable se situe ici dans<br />
l’intérêt d’acheminer vers le chantier en masse indivisible un élément préfabriqué de 11 m en<br />
usine alors qu’actuellement, celui-ci est conduit, au niveau du site de construction, en<br />
plusieurs parties qui seraient assemblées dans une usine foraine.<br />
On effectue également une analyse <strong>des</strong> pylônes qui seront dès lors constitués de deux<br />
parties au lieu de 15, d’où moins d’opérations de soudage difficilement contrôlées sur un<br />
chantier à 200 m d’altitude (humidité, température) et un travail en parallèle de coffrage et de<br />
bétonnage du premier élément en attente du second (ordonnancement efficient <strong>des</strong> tâches).<br />
L’intérêt de ce scénario réside dans la <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> opérations logistiques suite à l’usage<br />
du dirigeable. Un diagramme GANTT avec une identification <strong>des</strong> tâches critiques est mis en<br />
œuvre et comparé à la solution réelle prévue. Pour réaliser cette analyse, une <strong>des</strong>cription<br />
exhaustive <strong>des</strong> tâches a été menée.<br />
Il est aussi à noter que l’exploitation de l’aérostat impliquerait un mode de construction par<br />
encorbellement multi-points (d’où rapidité d’achèvement du chantier et moindres nuisances<br />
occasionnées) alors que la méthode préconisée par le dossier public « viaduc de Millau »<br />
table sur une méthode de construction séquentielle avec pour origine les culées extrémités<br />
de l’ouvrage, en raison d’une efficience économique liée principalement à<br />
l’ordonnancement/avancement du matériel (chariots, grue derrick de montage en plus de<br />
l’étaiement provisoire servant d’appui en phase de construction) utilisé.<br />
Le scénario 2 met en œuvre <strong>des</strong> éléments de tablier de 300 tonnes, soit environ 30 m de<br />
portée. En plus <strong>des</strong> processus logistiques convenablement décrits, une modification de la<br />
conception de l’ouvrage est à attendre en raison de l’impossibilité de disposer d’un porte-àfaux<br />
de 30 m. Les systèmes de fixation provisoires, le dimensionnement et l’emplacement<br />
<strong>des</strong> haubans doivent être revus en considérant l'intérêt de ce mode opératoire eu égard les<br />
contraintes associées. Ce scénario n’est toutefois pas étudié en détail comme le premier.<br />
Outre <strong>des</strong> considérations techniques, logistiques et l’esquisse d’un procédé de construction<br />
initié par le dirigeable (caractérisation, intégration du dirigeable dans la problématique <strong>des</strong><br />
chantiers, coexistence possible avec le matériel conventionnel de construction comme les<br />
grues - réglementation de chantier à définir -, …), cette étude permet d’évaluer la faisabilité<br />
économique d’exploitation de l’aérostat dans le champ de la construction <strong>des</strong> grands<br />
ouvrages d’art.<br />
Plusieurs postes sont susceptibles de générer <strong>des</strong> économies :<br />
- économie de l’haubanage initial (cas <strong>des</strong> ponts haubanés)<br />
- économie de matière<br />
o coût de fabrication de l’ossature métallique<br />
o coût de soudage<br />
- éventuellement coût de la main d’œuvre.<br />
Cas <strong>des</strong> ponts métalliques et mixtes<br />
D’autres aspects sont monétarisés comme le gain de temps. Il est à noter qu’un mois de<br />
chantier (pour une opération de l’envergure du viaduc de Millau) implique 5 à 7 millions de<br />
FF de dépenses.<br />
Nota : La construction du viaduc de Millau a été octroyée au groupe Eiffage dont sa filiale<br />
Eiffel Construction qui réalisera les tronçons en métal du Grand Viaduc dans son usine de<br />
Lauterbourg. La problématique d’acheminement et de subdivision <strong>des</strong> colis reste la même.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 107
Fiche 44 :<br />
14/08/2000<br />
Implantation : Genève (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Bureau d’étu<strong>des</strong> en Génie Civil<br />
Outre l’utilisation du dirigeable pour la construction d’ouvrages d’art et de franchissement,<br />
l’AVEA est susceptible d’être exploité dans le cadre de la construction de complexes<br />
touristiques et résidentiels présentant une forte répétitivité <strong>des</strong> plans (sorte de préfabrication<br />
d’éléments en série en usine donnant lieu à <strong>des</strong> effets d’échelle) et <strong>des</strong> tâches. A noter que<br />
l’on dénote actuellement, en Suisse, 8 complexes de 100 villas qui seront ouverts à la<br />
construction dans deux ans et qui se prêteraient particulièrement bien à une assistance<br />
AVEA.<br />
Parallèlement à ce marché, on rencontre celui <strong>des</strong> hôtels « préfabriqués » de type Formule 1<br />
ou Novotel, ainsi que celui de la pose et du levage de pans de faça<strong>des</strong> actuellement<br />
entreprises par grue en plusieurs éléments ! Il se pose, notamment ici, la question de travail<br />
en zones urbaines lorsqu’un bâtiment est rénové (changement <strong>des</strong> faça<strong>des</strong> en l’occurrence).<br />
Dans le domaine <strong>des</strong> grands travaux, l’AVEA permettrait la mise en place de portes<br />
monolithiques de barrages entre les piles supports permettant à la fois de s’affranchir <strong>des</strong><br />
opérations de coffrage du béton en hauteur qui coûtent chères, ainsi que de la gêne et <strong>des</strong><br />
coûts induits occasionnés aux populations évacuées et à l’agriculture suite au changement<br />
du lit <strong>des</strong> cours d’eau.<br />
D’un point de vue ponctuel, le dirigeable lourd servirait au déplacement de statues, de<br />
châteaux, d’églises … à fort impact patrimonial lorsqu’ils constituent un obstacle à la<br />
réalisation de nouveaux équipements.<br />
D’un point de vue contraintes, outre la définition du système de treuillage, de la précision de<br />
pose du dirigeable au moins équivalente à celle d’une grue, de la fiabilité du système<br />
« AVEA + charge » (question de sécurité), les points d’attache du dirigeable à la charge<br />
doivent être convenablement étudiés dans une optique de flexibilité permettant de réaliser le<br />
transport de l’élément sous contraintes similaires à sa phase d’utilisation : on ne devrait pas<br />
introduire d’efforts supplémentaires dus au transport ; la travée ou partie de travée doit être<br />
suspendue au droit <strong>des</strong> zones d’effort tranchant maximum en phase d’exploitation de<br />
l’ouvrage. Dans cette optique, le transport sera optimisé et ne donnera pas lieu à un<br />
surdimensionnement superfétatoire.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 108
Fiche 45 :<br />
16/08/2000<br />
Implantation : Genève (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Aide humanitaire<br />
En matière d’aide humanitaire, l’AVEA pourrait réaliser le transport de vivres, de matériel<br />
(véhicules), d’hôpitaux préfabriqués dans le cadre d’opérations d’urgence (zones sinistrées :<br />
inondation, tremblement de terre …) ou de « pipeline » pour les zones répertoriées<br />
nécessitant un approvisionnement continue et de durée indéterminée.<br />
Dès lors, les opérations urgentes, ponctuelles pour la plupart, nécessite un acheminement<br />
de colis lourds et encombrants visant <strong>des</strong> dirigeables de fortes capacités (200 à 500 t), ce<br />
qui n’est pas le cas pour les opérations de « pipeline » assurant un ravitaillement continue de<br />
la population considérée ; <strong>des</strong> AVEA d’une charge utile de 40 à 60 tonnes sont les plus<br />
adéquats.<br />
D’un point de vue contraintes d’exploitation, une configuration 40 à 60 tonnes développant<br />
une autonomie de 10 000 km ou une possibilité de ravitaillement est souhaitée. Par ailleurs,<br />
compte tenu de l’exploitation du dirigeable en zone dangereuse, <strong>des</strong> garanties concernant sa<br />
fiabilité sont nécessaires, en plus de certaines exigences notamment en matière d’approche<br />
et de décollage ⇒ vitesse d’ascension et de <strong>des</strong>cente appréciable pour minimiser les risques<br />
de tirs ; précisons, par exemple, que les avions opérant dans ces régions ont été équipés<br />
afin de décoller sur de courtes distances voire selon un mouvement hélicoïdal (à noter<br />
également que les avions utilisés dans ces zones ont <strong>des</strong> consignes précises concernant<br />
l’amorce de <strong>des</strong>cente réduite à 1.5 voire 3 km du lieu précis d’atterrissage ; l’AVEA devrait<br />
au moins respecter cette contrainte d’un point de vue sécurité) ! Dans cette optique, une<br />
vitesse supérieure à 100 km/h (de l’ordre de 200 km/h comme celle développée par d’autres<br />
dirigeables lourds) serait appréciable pour <strong>des</strong> raisons sécuritaires.<br />
Une autonomie importante de l’ordre de 10 000 km ou un ravitaillement en vol est nécessaire<br />
en raison d’une possibilité d’approvisionnement en carburant qui peut défaillir en plus de<br />
l’aspect économico-logistique qui contraindrait à développer un concept « omnibus » de<br />
livraison <strong>des</strong> vivres/matériels transportés par AVEA de 50 t de charge utile par exemple.<br />
D’autres contraintes telles que la disponibilité du dirigeable, sa sensibilité aux conditions<br />
atmosphériques restent similaires aux autres domaines d’activités recensés susceptibles<br />
d’intéresser l’AVEA.<br />
D’un point de vue volume d’opérations, il n’est pas possible de fournir d’estimations en<br />
raison de l’inexistence de programmes d’action prévisionnel.<br />
Toutefois, on trouvera ci-<strong>des</strong>sous quelques exemples de transport traités par l’organisme<br />
humanitaire ici interviewé et qui peuvent constituer <strong>des</strong> applications probables AVEA.<br />
- Angola : transport de 2 000 tonnes par mois entre Benguela et Kuito (557 km) à l’aide<br />
de deux boeing 727 de charge utile 20 tonnes unitaire et d’un Hercule de 19 t aux<br />
prix respectifs de 230 $ US/t et de 560 $ US/t. Ces prix comprennent uniquement le<br />
transport par avion et le fuel sans chargement/déchargement. Le transport par<br />
camion reste trop risqué et ne peut donc être envisagé.<br />
- Somalie : 20 000 t/mois, soit 10 bateaux pouvant être relayés en permanence par 12<br />
à 14 Hercules imprimant un coût de transport entre le Kenya et la Somalie de 1 100 $<br />
US/t ; autre alternative : utilisation d’un bateau porte-hélicoptère au large de la<br />
Somalie et distribution finale en 15 minutes par hélicoptère à un prix de 200<br />
$US/tonne livrée. On comprend ici qu’un prix annoncé de 35 000 FF/200 t par heure<br />
reste très compétitif (≈ 24 $ US/t et par heure d’opérations) !<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 109
Fiche 46 :<br />
17/08/2000<br />
Implantation : Eeklo (Belgique)<br />
Secteur d’activité retenue : Chaudronnerie<br />
Séance essentiellement d’information :<br />
Il s’agit d’une entreprise leader spécialisée dans la chaudronnerie qui gère les opérations de<br />
fabrication, de transport et de montage d’éléments métalliques. Située en Belgique, elle<br />
dispose de deux unités de « production », l’une à Eeklo et l’autre, à Bumar, à une dizaine de<br />
kilomètres de Gand. Ce second site dispose d’un portique de 72 tonnes et s’apprêterait, par<br />
ailleurs, moyennant quelques aménagements, à accueillir un dirigeable de l’envergure de<br />
l’AVEA : configuration adaptée de l’usine pour faire sortir les pièces lour<strong>des</strong> et encombrantes<br />
par <strong>des</strong> systèmes de rouleaux apte à supporter <strong>des</strong> charges élevées (de l’ordre de 200 t<br />
voire plus), aire libre de stockage et de prise en charge par l’AVEA à proximité de l’usine,<br />
absence d’obstacles majeurs telles que lignes à haute tension.<br />
D’un point de vue marché, selon ce chaudronnier, l’AVEA ne serait pas probant, en général,<br />
dans le transport et la manutention de halles et de bâtiments à charpente métallique. Par<br />
contre, il en va tout autrement dans le domaine <strong>des</strong> ouvrages d’art et de franchissement.<br />
Cette entreprise estime, au niveau de son marché, un volume annuel AVEA, sous réserve de<br />
disponibilité, de fiabilité et d’un coût compétitif, d’une centaine d’opérations de charge utile<br />
unitaire variant entre 300 et 1 000 tonnes sur <strong>des</strong> distances de 500 à 1 000 km. La majorité<br />
sont <strong>des</strong> ponts de moyenne envergure de longueur 500 m à 1 000 m. Il est à noter<br />
qu’actuellement le transport se fait par convoi exceptionnel multi-essieux de charge utile<br />
maximum de 100 t à un coût de l’ordre de 1 000 FF/t. Compte tenu <strong>des</strong> coûts directs et<br />
indirects <strong>des</strong> opérations de levage, de soudage, d’étaiement et de délocalisation d’équipes,<br />
un surcoût de l’ordre de 35 %, incluant le levage par AVEA, serait accepté.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 110
Fiche 47 :<br />
22/08/2000<br />
Implantation : Bâle (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Commissionnaire de transport<br />
Séance essentiellement d’information :<br />
Contraintes :<br />
- définition technique plus précise du dirigeable<br />
- définition et optimisation du système de treuillage (précision du positionnement)<br />
- réglementation (règes de survol urbain et nocturne)<br />
- estimation du coût d’exploitation sur la base de la définition technique du dirigeable<br />
- exploitation en mode combiné maritime possible<br />
- structure et modèle d’exploitation prévu à une fin de disponibilité et d’optimisation<br />
réseau du dirigeable<br />
Configuration AVEA :<br />
- modèles de 200 t et 500 t ⇒ tendance vers le 1 000 tonnes pour le transport <strong>des</strong><br />
usines clés en main<br />
- vitesse : 100 km/h<br />
- distance franchissable : plus de 2 000 km<br />
Avantages a priori à l’exploitation :<br />
- simplification de la chaîne logistique (meilleure identification <strong>des</strong> acteurs en nombre<br />
réduit)<br />
- qualité de la prestation (tracking facilité, gain de temps, décongestion <strong>des</strong> halles de<br />
stockage grâce à une prise en charge globale chez le client-chargeur, opérations<br />
administratives simplifiées - déclaration unique en douane pour un envoi complet au<br />
lieu de multiples déclarations correspondant à plusieurs colis pas forcément<br />
transportés en même temps -, opérations de conditionnement et d’ emballage chez le<br />
client, par ailleurs hautement simplifiées car moins de colis pour une unité -)<br />
- taux de primes d’assurance à tendance plus bas en raison d’une moindre<br />
manutention <strong>des</strong> charges liée donc à un risque plus faible d’avaries. On évoluera<br />
d’un schéma de transport conventionnel à l’international route - fluvial - maritime -<br />
fluvial - route à un autre complètement AVEA ou encore AVEA - maritime - AVEA.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 111
Fiche 48 :<br />
23/08/2000<br />
Implantation : Genève (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Aide humanitaire et intervention en cas de catastrophe<br />
Séance essentiellement d’information :<br />
Ce Bureau a pour but de coordonner les moyens locaux, ceux <strong>des</strong> Nations Unies, <strong>des</strong><br />
Organisations Non Gouvernementales et <strong>des</strong> pays donateurs. Il s’agit d’une instance<br />
subdivisée en deux services, l’un gérant les moyens civils, l’autre les moyens militaires.<br />
Un dirigeable lourd de charge utile 50 tonnes (un aérostat de plus forte capacité entraînerait<br />
<strong>des</strong> problèmes d’organisation et contraindrait à mettre en place <strong>des</strong> zones de stockage à<br />
proximité <strong>des</strong> camps dans le cas de régions siège de conflits, d’où toute une organisation<br />
pour garder ce stock et bien sûr l’entretenir ⇒ coûts supplémentaires) répondrait<br />
favorablement au concept actuel de l’aide humanitaire. La principale contrainte est son prépositionnement<br />
géographique qui doit être tel qu’il puisse répondre en urgence et dans de<br />
délais brefs aux besoins. Diverses solutions sont possibles parmi lesquelles :<br />
- un dirigeable ou plusieurs à proximité <strong>des</strong> plates-formes logistiques régionales de<br />
stockage<br />
- un dirigeable ou plusieurs basés au niveau de l’emplacement du stock central d’aide<br />
humanitaire. Il s’agit ici de l’approche préconisée par l’UNICEF<br />
Afin de répondre adéquatement à ce besoin, <strong>des</strong> modèles d’exploitation proposés par les<br />
Nations Unies, voire aussi par <strong>des</strong> ONG, et l’organe voire l’état commercialisant l’AVEA<br />
doivent être étudiés.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 112
Fiche 49 :<br />
5/09/2000<br />
Implantation : Grimbergen (Belgique)<br />
Secteur d’activité retenue : Matériel minier et de génie civil<br />
Il s’agit d’une entreprise internationale - dont le bureau de logistique générale se trouve en<br />
Illinois (USA) - commercialisant divers produits dont les principaux :<br />
- matériel minier et de construction : excavatrices (80 t), chargeuses sur roue, camions<br />
(60 t) munis d’une plate-forme de 5 m environ nécessitant un transport bi-colis ⇒<br />
matériel à remonter et à souder sur chantier. Il est à noter que la puissance<br />
développée par cette gamme de matériel minier est sans cesse en augmentation<br />
d’où un poids et un encombrement progressivement plus élevés<br />
- moteurs diesel, moteurs marins de petite et grande gamme (90 t)<br />
- usines clés en main et turbines à gaz (2 nd producteur mondial de turbines à gaz) : la<br />
maison-mère de cette activité se trouve à San Diego et reste une entité indépendante<br />
d’un point de vue logistique du groupe abordé dans cette fiche. On ne traitera pas ici<br />
ce segment.<br />
On trouve divers sites de production notamment aux Etats-Unis et en Europe (Allemagne,<br />
Espagne spécialisés dans la production <strong>des</strong> moteurs marins, Belgique pour le matériel<br />
minier …). Les clients, pour leur part, sont présents sur tous les continents avec une<br />
concentration particulière en Afrique du Sud, en Australie, en Russie, en Amérique du Sud et<br />
au Moyen-Orient. Les flux physiques les plus importants se répartissent entre les axes :<br />
- Espagne / Australie<br />
- Espagne / Afrique du Sud<br />
- Belgique / Afrique du Sud<br />
- Allemagne / Russie<br />
De par sa présence commerciale internationale, l’entreprise en question ici a dû mettre au<br />
point un réseau de vente concrétisé par divers concessionnaires indépendants en charge de<br />
zones spécifiques.<br />
Compte tenu du gabarit <strong>des</strong> pièces transportées, celles-ci sont subdivisées en plusieurs colis<br />
(à noter notamment qu’aux Etats-Unis, le transport exceptionnel n’est pour ainsi dire pas<br />
autorisé dans la mesure où un convoi civil ne peut excéder 30 t de charge utile) suivant, en<br />
général, une transaction commerciale de type CFR - Cost & Freight - c’est à dire que le titre<br />
de propriété est transféré au concessionnaire au niveau du port de <strong>des</strong>tination de la<br />
marchandise. La mise à disposition du client final, le réassemblage <strong>des</strong> diverses parties du<br />
matériel sont du ressort du concessionnaire. Le fabricant perd donc, non seulement, le<br />
contrôle total de l’acheminement de la machine considérée, mais surtout celui de la qualité<br />
finale du produit et de son prix de vente.<br />
Ainsi, avec la simplification du processus de transport (transport en masse indivisible au lieu<br />
d’un transport multi-modulaire complexe) que permet le dirigeable lourd, certaines<br />
entreprises reprendront en charge les fonctions d’acheminement et de marketing de leurs<br />
produits jusqu’au client final. Cette redistribution de compétence en faveur du chargeur<br />
(fabricant) lui permettra, avec l’aide du commissionnaire de transport, d’avoir un contrôle<br />
optimal <strong>des</strong> coûts et de la qualité finale de son produit.<br />
En pratique, on s’orientera vers une organisation plus efficiente du marché dans la mesure<br />
où un fabricant aura tendance à déplacer la fonction marketing, au sens large, vers son<br />
concessionnaire / prestataire industriel si ce dernier est plus performant que lui. Dans le cas<br />
contraire où le fabricant est plus efficient sur un segment de marché, il y accomplira la<br />
fonction marketing.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 113
Il s’ensuit alors la mise en place d’un réseau de distribution comme suit :<br />
Fabricant<br />
Commissionnaire<br />
de transport<br />
Concessionnaire /<br />
Prestataire industriel<br />
Client final<br />
Réunion de toutes les fonctions<br />
• Conception<br />
• Production<br />
• Transport<br />
• Promotion<br />
• Mise en oeuvre<br />
Par ailleurs, outre la volonté de contrôler son produit jusqu’à la livraison finale avec le souci<br />
d’une productivité optimale, l’AVEA permettra de lisser la part budgétaire de certains postes,<br />
notamment :<br />
- les coûts de pré-acheminement<br />
- les coût d’immobilisation du matériel grutier<br />
- les coûts d’amenée à la fois chez le concessionnaire et chez le client final<br />
(comptabilisation pratiquement double)<br />
- les coûts multimodaux, principalement pour <strong>des</strong> trajets de longueur courte et<br />
moyenne effectués intégralement par dirigeable (y compris la manutention) sans<br />
rupture de charge<br />
- les coûts administratifs (coût d’accompagnement <strong>des</strong> charges exceptionnelles,<br />
multiples déclarations douanières liées aux divers lots d’une même machine …<br />
Parallèlement à ces éléments généraux, l’AVEA permettra de réaliser <strong>des</strong> <strong>transports</strong><br />
auparavant effectués uniquement par avion d’où capacité de charge limitée et coûts<br />
exorbitants. C’est le cas notamment <strong>des</strong> marchés de la société en question situés en bon<br />
nombre en Sibérie et en Alaska.<br />
D’un point de vue exploitation et compte-tenu <strong>des</strong> gammes AVEA de 200 et 500 tonnes eu<br />
égard au poids moyen d’un camion minier ou d’une excavatrice de 80 t, il serait nécessaire,<br />
pour <strong>des</strong> raisons évidentes d’effet d’échelle, que l’AVEA puisse opérer en situation de<br />
groupage de plusieurs machines. Il faudrait, dès lors, définir le système à adopter (berceau,<br />
points d’ancrage, conditionnement de la marchandise afin qu’elle ne soit pas détériorée par<br />
un transport en altitude …). A cette condition, s’ajoute celle de la possibilité d’un transport<br />
combiné sans rupture de charge AVEA/Bateau. Ceci implique un degré de précision de pose<br />
de l’AVEA hautement fiable, en plus de l’aspect conditionnement de la charge : en effet,<br />
celle-ci doit être correctement protégée afin de supporter un transport en pontée, sachant<br />
que l’air salin engendre <strong>des</strong> dégâts au niveau <strong>des</strong> équipements hydrauliques équipant les<br />
moteurs, le matériel minier …Des étu<strong>des</strong> détaillées dans ce sens devront être menées afin<br />
d’identifier les propriétés souhaitées et le coût <strong>des</strong> développements qui sera à imputer au<br />
transport par dirigeable !<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 114
Fiche 50 :<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 115
6/09/2000<br />
Implantation : Zurich (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Transport aérien<br />
Une part importante du marché routier <strong>des</strong> <strong>transports</strong> exceptionnels et celui <strong>des</strong> envois<br />
indivisibles lourds et encombrants par avion sera progressivement transféré vers l’AVEA. A<br />
noter qu’un transport par Antonov AN 124 peut atteindre 100 CHF/kg transporté. Compte<br />
tenu de la configuration du marché du dirigeable lourd et d’un coût de production avoisinant<br />
les 900 millions de FF pour le prototype, le prix d’usage de cet aérostat serait hautement<br />
compétitif sous réserve de finalisations techniques adéquates (levage et manutention<br />
garanties par AVEA, précision de pose, fiabilité du système pour l’essentiel) et d’un réseau<br />
d’exploitation correctement orchestré.<br />
Cependant, il n’est pas possible actuellement de déterminer précisément l’évolution du<br />
marché AVEA en raison de la forte rupture de pratique qu’il est en mesure d’induire.<br />
Dans le volet humanitaire par exemple, un dirigeable de 500 tonnes provoquera une<br />
réorganisation logistique complète de la chaîne de distribution dans la mesure où il faudra<br />
prévoir <strong>des</strong> aires (halles) de stockage à partir <strong>des</strong>quelles on peut prévoir un transport final<br />
par dirigeable de moindre capacité : 40 à 60 tonnes. L’avantage de cette organisation tient à<br />
l’économie de gain qu’impliquerait l’AVEA, notamment au niveau du coût d’exploitation <strong>des</strong><br />
avions qui sont en nombre important pour répondre au ravitaillement de zones comme la<br />
Somalie nécessitant un approvisionnement de 20 000 t/mois et <strong>des</strong> coûts administratifs<br />
(pilotes, logisticiens en nombre élevé compte tenu <strong>des</strong> multiples flux à traiter, assistants<br />
d’opérations …). Cependant, pour que le dirigeable puisse répondre de manière efficiente et<br />
à moindre coût, il est nécessaire de prévoir, en fonction de la localisation <strong>des</strong> zones<br />
susceptibles de <strong>des</strong>servir, <strong>des</strong> bases de stationnement <strong>des</strong> aérostats. A cet effet, une<br />
structure exploitante et un réseau doivent être esquissés en collaboration avec les différents<br />
partenaires de l’étude : le dirigeable doit être disponible et positionné judicieusement afin de<br />
répondre à <strong>des</strong> besoins urgents, notamment en matière d’aide humanitaire. Il en va<br />
également de son coût d’exploitation !<br />
Interrogations techniques :<br />
- distribution de la charge/répartition de masse au niveau du dirigeable<br />
- dépendance vis à vis <strong>des</strong> conditions atmosphériques : limites opérationnelles<br />
o temps d’opérabilité par an<br />
o stationnement <strong>des</strong> AVEA à l’écart de « routes » réputées instables<br />
météorologiquement et ce en fonction, <strong>des</strong> zones pressenties de <strong>des</strong>serte - à<br />
plus ou moins grande proximité de ces dernières - et <strong>des</strong> impératifs de<br />
rentabilité économique ⇒ notion de réseau optimisé afin de garantir un<br />
fonctionnement quasi-permanent du dirigeable en configuration chargée<br />
(limitation <strong>des</strong> retours à vide d’où efficience économique) : développement<br />
d’un concept de flux continu<br />
- fiabilité et sécurité du système<br />
- berceau ou autre support de transport<br />
- procédé d’arrimage de la charge<br />
- manoeuvrabilité de l’AVEA/ motorisation<br />
- durée de vie/amortissement de l’aérostat<br />
- conditionnement adéquat <strong>des</strong> masses transportées surtout dans le cas d’un transport<br />
à haute altitude non protégé par un contenant fermé qui présente l’inconvénient de<br />
limiter l’encombrement de la charge sustentée<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 116
Fiche 51 :<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 117
7/09/2000<br />
Implantation : Région parisienne<br />
Secteur d’activité retenue : Transporteur et commissionnaire de transport / Pôle Projets<br />
industriels<br />
Séance essentiellement d’information :<br />
Configuration AVEA ciblée : gamme 200 et 500 t sachant que le marché, dans les 10<br />
prochaines années, glissera vers <strong>des</strong> produits de masse supérieure à 500 t<br />
Exigences à l’exploitation :<br />
- définition du système de treuillage<br />
- précision de pose analogue à celle d’une grue avec aisance de manœuvrabilité du<br />
dirigeable de sorte à rester concurrentiel avec la grue pour l’étape manutention<br />
- sensibilité aux aléas atmosphériques/gestion <strong>des</strong> effets de bord à proximité du sol<br />
(notamment en phase d’approche)<br />
- possibilité de groupage<br />
- impact de la réglementation : transport de nuit et opérations en zone urbaine et périurbaine<br />
- coût d’exploitation pressenti : à noter qu’un transport ponctuel de 100 t indivisible en<br />
Antonov AN 124 depuis la France jusqu’au Brésil, soit une distance de 10 000 km<br />
coûte environ 3 millions de FF.<br />
Fiche 52 :<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 118
12/09/2000<br />
Implantation : Frauenfeld (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Chaudronnerie<br />
Il s’agit d’une <strong>des</strong> plus importantes entreprises de construction métallique en Suisse.<br />
Son marché s’étend principalement à la Suisse et au Sud de l’Allemagne. Le volume<br />
d’activité transférable à l’AVEA (gamme 200 t principalement) est en moyenne de deux<br />
ouvrages par an. L’intervention de l’AVEA dans le domaine du bâtiment serait<br />
disproportionnée dans la mesure où la construction de halles ou de complexes<br />
« métalliques » est de nature aisée et maîtrisée. L’apport ne serait que superfétatoire et<br />
n’engendrerait pas de gains intéressants.<br />
Le domaine de prédilection du dirigeable en matière de constructions métalliques<br />
concernerait donc les ouvrages d’art et de franchissement, ainsi que <strong>des</strong> constructions<br />
complexes telles que couverture de stade… Ponctuellement, on pourrait faire appel au<br />
dirigeable dans le cas de sites difficiles d’accès. Il est à mentionner cependant que le<br />
recours à l’AVEA au sein du chaudronnier en question est conditionnée par la construction<br />
d’une nouvelle halle de fabrication pouvant traiter <strong>des</strong> pièces de 200 tonnes monobloc<br />
(moyens de manutention à l’intérieur de la halle, système de sortie <strong>des</strong> pièces devant être<br />
prises en charge par le dirigeable). Cet investissement ne pourra être décider qu’après une<br />
période d’essais fructueux du dirigeable. Notons aussi qu’un volume de deux ouvrages par<br />
an transportés par AVEA reste minoritaire pour justifier la construction d’une nouvelle<br />
infrastructure. L’évolution du marché aura un impact certain sur cette décision.<br />
Exigences à l’exploitation :<br />
- coût estimé à l’exploitation : actuellement, un transport exceptionnel coûte à<br />
l’entreprise visitée ici 100 CHF/t sur une distance de 200 à 300 km pour un poids<br />
moyen de l’ordre de 80 tonnes. Le coût constitue, pour cette entreprise, le paramètre<br />
déterminant. Les facteurs logistiques, qualités et possibilités d’évolution <strong>des</strong> pièces<br />
fabriquées (plus importantes, à plus haute valeur ajoutée) ne viennent qu’en seconde<br />
position.<br />
- Système dynamique de treuillage :les points d’attache doivent prendre en compte les<br />
zones d’effort maximal de chaque pièce<br />
- aspect réglementaire, essentiellement le déroulement d’opération en zone urbaine<br />
- précision de pose : assimilable à une grue ; comportement du dirigeable au vent<br />
(limite opérationnelle)<br />
- disponibilité du dirigeable (notion de réseau)<br />
Fiche 53 :<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 119
14/09/2000<br />
Implantation : Berne (Suisse)<br />
Secteur d’activité retenue : Entreprise de construction / Génie Civil<br />
Le marché du dirigeable dans le secteur du Génie Civil concernerait principalement la<br />
réalisation de ponts et d’équipements complexes. Toutefois, la préfabrication ne devrait pas<br />
aboutir à une standardisation <strong>des</strong> constructions.<br />
D’autres applications sont susceptibles d’avoir recours au dirigeable ; il s’agit de :<br />
- l’exploitation <strong>des</strong> carrières : en effet, l’ouverture d’une carrière est extrêmement<br />
difficile à obtenir. Le transport à distance et en flux continu de granulats dans <strong>des</strong><br />
délais optimaux pourrait se faire par dirigeable lourd de 200 voire 500t.<br />
- la mise au net de l’environnement direct <strong>des</strong> grands chantiers : sachant qu’en Suisse<br />
le constructeur d’un projet est tenu d’évacuer les déblais du chantier en ayant droit à<br />
un nombre pré-défini de trajets par camion, un dirigeable de grande envergure<br />
pourrait être un moyen de contourner cette contrainte qui pose problème dans de<br />
nombreuses situations. Le coût d’exploitation de l’aérostat reste ici problématique<br />
dans la mesure où les déblais n’engendrent pas de richesse et ne justifient peut-être<br />
pas de recourir à un mode onéreux ; un contrat lierait dans ce cas le constructeur à<br />
l’exploitant du dirigeable traçant les conditions d’un accord global « construction de<br />
l’équipement par transport AVEA d’éléments préfabriqués + évacuation <strong>des</strong> déblais<br />
en fin de chantier » permettant de justifier financièrement la phase « évacuation <strong>des</strong><br />
déblais ».<br />
Dans le secteur <strong>des</strong> ponts et ouvrages d’art, le mode de construction (poussage,<br />
encorbellement, lançage) a un fort impact sur le coût de l’opération globale, sachant que bon<br />
nombre d’organismes, comme la SNCF, règle la facture sur la base du produit fini, c’est à<br />
dire <strong>des</strong> quantités de béton et de précontrainte mises en œuvre. L’AVEA permettrait une<br />
simplification du processus de construction d’où une économie attendue substantielle sous<br />
réserve <strong>des</strong> modifications au niveau du dimensionnement <strong>des</strong> structures ; la phase de<br />
transport deviendra dimensionnante : il faudra déterminer si ceci aura un impact sur la valeur<br />
économique structurale de la réalisation projetée.<br />
De plus, avec le gain de temps permis, l’ouvrage pourrait être ouvert au trafic plus tôt et, audelà<br />
<strong>des</strong> intérêts financiers qui se montent à 3 voire 4% par an, générer <strong>des</strong> gains directs<br />
(cas <strong>des</strong> passages à péage) et sociaux (baisse de congestion par report de trafic vers le<br />
nouvel équipement, baisse du taux d’accidents, développement économique régional dans<br />
certains cas …) permettant de financer plus rapidement le coût de l’infrastructure.<br />
Dans le domaine <strong>des</strong> bâtiments, l’AVEA sera utilisé pour les constructions complexes, ainsi<br />
que pour <strong>des</strong> sites difficiles d’accès (pas de route d’acheminement, construction en<br />
montagne, construction importante en ville sous réserve de la réglementation ⇒ gain de<br />
temps permis par les éléments préfabriqués et leur transport par dirigeable, ainsi qu’une<br />
limitation temporelle <strong>des</strong> nuisances occasionnées aux riverains). Notons toutefois une limite<br />
technique liée à la préfabrication qui ne peut être usitée dans les zones sismiques d’où une<br />
part de marché éludée.<br />
D’un point de vue global, un chantier de construction de bâtiment(s) se décompose d’un<br />
point de vue coût comme suit :<br />
- 60% affectés aux travaux d’aménagement (assainissement, finitions …)<br />
- 40% affectés à la structure (dimensionnement, matériel, matériaux, main d’œuvre,<br />
construction)<br />
L’AVEA interviendra sur le plan économique au niveau de ces derniers 40% qui se<br />
subdivisent de la sorte :<br />
- 10% : main d’œuvre<br />
- 20% : matériaux<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 120
- 10% : matériel<br />
- 60% : construction avec une forte part d’intervention de la main d’œuvre à raison de<br />
35 à 40% ; là une mécanisation <strong>des</strong> procédures permise par l’AVEA pourrait<br />
engendrer <strong>des</strong> économies substantielles<br />
De manière générale, le recours au dirigeable pourrait également être motivé par <strong>des</strong><br />
considérations d’ordre environnemental :<br />
- réduction <strong>des</strong> nuisances de chantier à l’égard <strong>des</strong> populations environnantes<br />
- diminution de l’impact du chantier sur la faune et la flore<br />
- préservation du paysage<br />
Il s’agit d’un facteur particulièrement important dans le cas de constructions en zones<br />
sensibles ex : le Center Park du Valais construit à 1 500 m d’altitude<br />
Contraintes d’exploitation :<br />
- coût<br />
- précision de pose<br />
- sensibilité aux conditions atmosphériques<br />
- sécurité<br />
- disponibilité<br />
- réglementation (travail en site urbain)<br />
Fiche 54 :<br />
15/09/2000<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 121
Implantation : Bordeaux → centre logistique<br />
Secteur d’activité retenue : Aide humanitaire<br />
Séance essentiellement d’information :<br />
Il s’agit ici d’une organisation non gouvernementale dont l’objectif principal est de fournir<br />
l’aide sanitaire nécessaire (kits médicaux de poids moyen 8 tonnes pour 100 personnes) aux<br />
populations sinistrées.<br />
L’AVEA sera particulièrement intéressant pour les opérations d’urgence (évacuation de<br />
personnes suite à une inondation par exemple : cas du Bangla<strong>des</strong>h) et de distribution de<br />
l’aide en zones difficiles d’accès ou à climat rude (aide au Tadjikistan en hiver où toutes les<br />
voies de communication sont coupées à cause de l’enneigement, ce qui implique, dans ces<br />
cas, l’usage de l’hélicoptère d’où un coût élevé).<br />
Compte tenu <strong>des</strong> volumes distribués par cette organisation et de la nature de ses missions,<br />
la configuration idéale du dirigeable serait, en général, un aérostat de charge utile 40 à 60<br />
tonnes, à vitesse de croisière supérieure à 100 km/h (en raison de problèmes de sécurité en<br />
phase d’approche au-<strong>des</strong>sus <strong>des</strong> zones de conflits). Par ailleurs, le dirigeable doit être<br />
facilement manœuvrable notamment durant les phases d’ascension et de <strong>des</strong>cente où il est<br />
plus exposé aux tirs ennemis. Des précisions devront être fournies en matière de<br />
comportement de l’aérostat au vent, ce qui permettra de déterminer le nombre de jours<br />
opérationnels par an. La précision de pose ne constitue par contre pas une contrainte<br />
déterminante pour ce secteur d’activité économique.<br />
Concernant le marché du dirigeable, celui-ci reste significatif dans la mesure où plusieurs<br />
acheminements sont faits en commun avec d’autres ONG tels que Médecins du Monde et le<br />
CICR. Ces ONG pourraient occasionnellement utiliser <strong>des</strong> dirigeables de plus grande<br />
envergure (200t) pour l’approvisionnement de leur base logistique régionale en période de<br />
crise nécessitant un transport d’urgence.<br />
Fiche 55 :<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 122
6/03/2001<br />
Implantation : Québec (Canada)<br />
Secteur d’activité retenue : Transport exceptionnel/Autorités provinciales<br />
Le climat canadien exerce un impact certain sur le transport de par la période de gel qui<br />
s’étend du mois de décembre à mars et qui paralyse le transport fluvial, principal vecteur <strong>des</strong><br />
charges lour<strong>des</strong> et/ou encombrantes, notamment dans l’arrière-pays de la province du<br />
Québec. Il suit alors une période de dégel du mois de mars à celui de mai où l’on observe<br />
une réduction de la capacité routière de près de 20% en terme pondéral due notamment à la<br />
contrainte de répartition de la charge qui doit respecter l’axial de dégel.<br />
La disponibilité de l’AVEA à ces pério<strong>des</strong> peut orienter favorablement le chargeur à utiliser le<br />
transport lourd par dirigeable. Sachant qu’un acheminement exceptionnel durant ces<br />
pério<strong>des</strong> est possible, ceci induira une redéfinition de l’ordonnancement activités-tâches <strong>des</strong><br />
entreprises concernées s’accompagnant d’une augmentation de la productivité.<br />
Par ailleurs, l’AVEA favoriserait l’émergence de nouveaux marchés, notamment au niveau<br />
minier où le dirigeable impliquerait l’ouverture de nouvelles mines - au nord du Québec et à<br />
l’ouest (principalement en Abitibi, région de Noranda) - à fort potentiel commercial<br />
auparavant non exploitées à cause de problèmes d’acheminement ne permettant pas leur<br />
valorisation. La construction de chemins de fer ne peut être envisagé dans ces régions (nord<br />
du Québec) en raison de lourds travaux de maintenance annuels (après la période de dégel<br />
où l’assise de la voie ferrée devrait être refaite) qui annihileront l’efficience économique liée à<br />
l’exploitation <strong>des</strong> minerais visés. Un autre marché est susceptible de représenter une part<br />
substantielle : il s’agit de l’exploitation du bois (débardage <strong>des</strong> forêts), principalement dans la<br />
province de la Colombie britannique où le recours à l’hélicoptère reste cher, ce qui implique<br />
<strong>des</strong> produits dérivés non compétitifs.<br />
D’un point de vue équipements industriels, le marché canadien de l’électrification est quasi<br />
terminé (2 gros chantiers encore, celui de la Romaine - 250 MW - et d’East Main Rupert - 1<br />
300 MW - à accessibilité aisée) ; l’AVEA interviendrait par contre dans le « revamping » c’est<br />
à dire le remplacement <strong>des</strong> transformateurs et autres équipements lourds dans la mesure où<br />
les lignes de chemin de fer qui ont permis l’acheminement de ces équipements n’ont pas été<br />
entretenus et un bon nombre a disparu (cas <strong>des</strong> centrales situées dans le nord québécois).<br />
La plupart <strong>des</strong> transformateurs mis en place l’ont été durant la décennie 1970-1980 avec une<br />
durée de vie moyenne <strong>des</strong> équipements de 35 ans, d’où une recru<strong>des</strong>cence d’activité en<br />
faveur de l’AVEA prévisible pour 2005 - 2015. L’alternative directe au dirigeable serait la<br />
route, ce qui impliquerait la fermeture à certaines heures <strong>des</strong> autoroutes, la réhabilitation de<br />
tronçons routiers terminaux …ce qui entraînerait <strong>des</strong> refus de la part de certaines<br />
municipalités. L’estimation du marché en nombre est comme suit - sur la base de la<br />
configuration de l’équipement québécois qui comprend une majorité de centrales hydroélectriques,<br />
1 centrale nucléaire et une autre thermique - : 64 groupes de 250 à 2 200 MW,<br />
soit 32 transformateurs de 70 à 300 tonnes.<br />
Dans le domaine de la construction, il est fréquent de transporter <strong>des</strong> poutres de type C<br />
(classification Transport exceptionnel canadien) c’est à dire d’un poids de 65-70 tonnes<br />
unitaire. Ces <strong>transports</strong> se heurtent de plus en plus au refus <strong>des</strong> municipalités traversées qui<br />
les orientent vers le réseau routier secondaire qui pose <strong>des</strong> problèmes quant au poids et<br />
dimensions du convoi. La volonté du MTQ (Ministère <strong>des</strong> Transports du Québec) serait de<br />
favoriser, quant à l’octroi <strong>des</strong> contrats, les unités de préfabrication les plus proches du<br />
chantier considéré pour réduire la gêne occasionnée par le transport. D’un point de vue<br />
réglementation de la concurrence, le MTQ n’a aucun moyen de pression pour faire accepter<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 123
cette mesure. Le recours à l’AVEA serait donc bénéfique et pourrait être favorisé par<br />
l’adoption d’une tarification spéciale.<br />
D’un point de vue contraintes d’exploitation, on retrouve les mêmes éléments que lors <strong>des</strong><br />
précédents compte-rendus (précision du positionnement, sécurité, disponibilité, sensibilité<br />
aux aléas atmosphériques …). Toutefois, la structure et les textiles de l’enveloppe AVEA<br />
devrait être en mesure de supporter <strong>des</strong> variations rapi<strong>des</strong> (du jour au lendemain) et<br />
notables de température : -30°C à +10°C. De plus, la nature et la cotation <strong>des</strong> risques du<br />
point de vue sécurité et exploitation inhérentes à un transport par AVEA doivent être<br />
identifiés.<br />
Une estimation du coût d’exploitation de l’AVEA sur la base d’éléments techniques doit être<br />
fournie. Il faut être en mesure de fournir une fonction analytique permettant d’appréhender le<br />
coût ; fonction qui prend notamment en compte sous forme matricielle ou autre la force et la<br />
position angulaire <strong>des</strong> vents sous contrainte d’une limite opérationnelle.<br />
Fiche 56 :<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 124
7/03/2001<br />
Implantation : Montréal (Canada)<br />
Secteur d’activité retenue : Equipements industriels et construction (Génie Civil)<br />
Il s’agit d’une étude de cas concernant le transport de deux vannes sphériques et de deux<br />
transformateurs de puissance au chantier Sainte-Marguerite 3.<br />
I/ Présentation du cas :<br />
TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE :<br />
Quantité : 2<br />
Itinéraire : Départ par bateau de Varennes vers Sept-Iles (environ 800 km)<br />
Transport par barge de Sept-Iles vers Gallix (environ 25 km)<br />
Transport par fardier de Gallix vers le chantier Ste-Marguerite 3<br />
(environ 90 km)<br />
Poids :<br />
Dimensions : (chacun)<br />
Transfo. seul : 246 245 kg. chacun<br />
Transfo. plus accessoires : 335 000 kg. Chacun<br />
Longueur : 8 821 mm<br />
Largeur : 4 168 mm<br />
Hauteur : 5 326 mm<br />
Coût du transport : Environ 500 000 $ Can.<br />
VANNES SPHERIQUES :<br />
Quantité : 2<br />
Itinéraire : Transport par barge de Tracy vers Gallix (environ 800 km)<br />
Transport par fardier de Gallix vers le chantier Ste-Marguerite 3<br />
(environ 90 km)<br />
Poids :<br />
Dimensions : (chacune)<br />
Vanne seul : 139 000 kg. chacune<br />
Vanne plus accessoires : 200 000 kg. chacune (environ)<br />
Longueur : 3 858 mm<br />
Largeur : 5 955 mm<br />
Hauteur : 5 100 mm<br />
Coût du transport : Environ 500 000 $ Can.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 125
II/ Analyse préliminaire :<br />
La méthodologie d’étude se subdivise en trois étapes :<br />
- Une première phase où l’on axe la réflexion principalement sur le maillon « transport<br />
et manutention »<br />
- Une seconde étape où l’on considère la chaîne logistique dans sa globalité, du<br />
fournisseur au client final. Une attention particulière est consacrée à la modification<br />
<strong>des</strong> processus logistiques et de production qu’induirait le dirigeable, mais également<br />
à la définition <strong>des</strong> opérations de levage, de manutention, de transbordement que<br />
peuvent connaître les pièces transportées aussi bien chez le chargeur que chez le<br />
client final. La comptabilité financière de l’opération est modifiée tout au long de la<br />
supply chain ; il va falloir donc correctement ventiler les charges et dresser le bilan<br />
global <strong>des</strong> coûts engendrés par l’exploitation du dirigeable. A cet effet, une<br />
<strong>des</strong>cription du processus complet tel qu’il est pratiqué actuellement est menée et<br />
confrontée à la solution par aérostat lourd afin de dresser une comparaison étape par<br />
étape.<br />
- Au vu <strong>des</strong> résultats aussi bien technique que financier de la seconde phase d’étude<br />
et après une évaluation du marché potentiel du dirigeable lourd AVEA au niveau du<br />
continent américain permettant d’aboutir à certaines conclusions, un calcul général<br />
de rentabilité économique de l’aérostat, sur la base d’une optimisation d’exploitation<br />
en réseau, pourra être effectué.<br />
La réflexion, prévalant pour la première étape, est structurée en deux volets tenant compte<br />
de la phase de définition technique que connaît encore l’AVEA :<br />
- Interface manutention (empotage/dépotage) :<br />
o liste de procédés souples et efficaces pour la manutention. On retient celui qui<br />
paraît le plus probable d’être mis au point pour mener la suite de la<br />
simulation ; procédé qui doit être le plus flexible possible pour répondre aux<br />
cas les plus fréquents<br />
o aire nécessaire d’empotage/dépotage compte tenu de la précision d’approche<br />
et/ou de manœuvre du dirigeable en éclaircissant autant que possible si<br />
l’AVEA doit se poser ou opérer en altitude<br />
o possibilité d’empotage/dépotage sur un navire à quai et au large (transport<br />
combiné - cf. scénarii plus bas)<br />
o estimation du temps nécessaire à la manutention<br />
- Interface transport :<br />
o aspects réglementaires : survol <strong>des</strong> zones urbaines, « tracé » détaillé du trajet<br />
jusqu’à Sainte Marguerite 3 ; démarche itérative qui doit prendre compte <strong>des</strong><br />
performances du dirigeable (altitude - survol de zones montagneuses -,<br />
distance de franchissement nécessitant ou pas <strong>des</strong> ruptures de charge,<br />
vitesse, comportement du dirigeable face au vent…)<br />
o aspects opérationnels : comportement du dirigeable face aux conditions<br />
atmosphériques, conditionnement de la charge, réflexion sur la sécurité…<br />
A/ Caractéristiques d’exploitation :<br />
1. Performances a priori de l’AVEA :<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 126
(Valeurs techniques retenues pour la présente analyse)<br />
Longueur 200 à 250 m (selon le modèle)<br />
Largeur 100 m (selon le modèle)<br />
Hauteur 100 m (selon le modèle)<br />
Charge utile Jusqu’à 500 tonnes (év. 1000 t)<br />
Altitude de vol Jusqu’à 5 km pour les opérations usuelles<br />
Vitesse de croisière 100 km/h<br />
Distance franchissable Jusqu'à 10’000 km<br />
B/ Évaluation du trajet :<br />
1. Choix de l’altitude de vol:<br />
H (m) 0 1000 2000 3000<br />
ρair(kg/m 3 ) 1,225 1,112 1,007 0,7361<br />
ρhélium(kg/m 3 ) 0,169 0,154 0,139 0,02<br />
A 5000 m, on perd environ 40% de la charge supportée par l’air. Compte tenu de la<br />
topographie de la région, on recherchera un plafond vers 1000 m avec les conséquences sur<br />
éventuellement la longueur du trajet qui serait alors de l’ordre de 800 km en suivant<br />
approximativement le Saint Laurent.<br />
2. Temps du trajet :<br />
. Distance ≅ 800 km à 100 km/h ⇒ 8 h<br />
. Avec un vent défavorable de face à 70 km/h sur le trajet ⇒ 27 h<br />
Il importe donc de connaître sur une base annuelle la météorologie de la région d’étude pour<br />
estimer correctement le temps de transport, voire choisir en conséquence le tracé détaillé du<br />
trajet (zones de moindre turbulence).<br />
C/ Calcul rapide du dirigeable :<br />
Mdirigeable= Mcharge + Mstructure + Mhélium = V * ρair<br />
On dit que Mstructure = V * IC (avec IC = indice constructif égal environ à 0,3 – 0,4 ; prenons<br />
0,35 dans la suite <strong>des</strong> calculs)<br />
⇒<br />
Mcharge = V* ρair – V*ρhélium – V* IC<br />
D’où V = Mcharge / (ρair - ρhélium - IC)<br />
Au plafond 1000 m : (avec ρhélium = 0,154 kg/m 3 )<br />
Si Mcharge = 500 t ⇒ V = 822 10 3 m 3<br />
Masse de gaz = V*ρhélium = 127 10 3 kg<br />
Masse d’air déplacée = Massedirigeable (H=1000 m) = V* ρair = 914 10 3 kg<br />
Masse de la structure = V* IC = 287 10 3 kg<br />
D/ Interface empotage/dépotage :<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 127
La pièce transportée (transformateur, vanne sphérique, …) peut reposer sur un berceau<br />
ouvert ou fermé (à la manière d’un conteneur) selon la nature de la charge et l’exigence du<br />
chargeur ou bien être suspendue à un système à élingues.<br />
1. Transport sur berceau :<br />
L’interface d’empotage/dépotage peut être discrétisée comme suit :<br />
- Approche/Positionnement du dirigeable<br />
- Descente de l’aérostat à une altitude fixée<br />
- Arrimage du dirigeable<br />
- Descente au sol du berceau qui peut être lesté ou non (la solution « berceau lesté »<br />
peut être plus favorable d’un point de vue technique lors de la compensation de la<br />
charge après dépotage)<br />
- Empotage de la charge<br />
Dépotage du lest<br />
- Remontée du berceau<br />
- Désarrimage du dirigeable<br />
- Montée du dirigeable jusqu’à l’altitude de « croisière »<br />
a. Descente du dirigeable :<br />
Pour que le dirigeable arrive au sol, il faut l’alourdir c’est-à-dire récupérer l’air nécessaire.<br />
A cet effet, il faut : Massedirigeable = Masseair déplacé<br />
Massedirigeable (H=0) = 822 10 3 * 1,225 = 1007 10 3 kg<br />
Pour <strong>des</strong>cendre, il faut donc lester le dirigeable par de l’air :<br />
Masselest = Massedirigeable (H=0) - Massedirigeable (H=1000 m)<br />
⇒ Masselest = 93 10 3 kg<br />
En supposant une masse volumique moyenne de 1,17kg/m 3 sur le trajet de la <strong>des</strong>cente, il<br />
faut donc absorber 80 10 3 m 3 .<br />
En outre, en tenant compte d’une puissance minimale <strong>des</strong> compresseurs de 350 kW<br />
(rendement = 0,75), le temps de <strong>des</strong>cente est de 270s ; soit une vitesse moyenne de<br />
<strong>des</strong>cente de 3,7m/s.<br />
⇒ Ce qu’il faut retenir de ces résultats est que le temps de <strong>des</strong>cente dû au<br />
lestage d'air est négligeable. Il dépendra plus sûrement <strong>des</strong> contraintes imposées par les<br />
vitesses de déplacement admissibles par la charge notamment à l'approche du sol. Dans<br />
ces conditions, on adoptera un temps de <strong>des</strong>cente de 30 mn.<br />
b. Arrimage de l’AVEA / Descente du berceau :<br />
Comme il a été signalé dans la partie précédente, le temps de <strong>des</strong>cente de l’aérostat n'est<br />
nullement critique.<br />
Par contre, on estime la partie « arrimage + <strong>des</strong>cente du berceau/de la charge » à 2 heures.<br />
Cette estimation pourra être validée en partie par les levageurs car l’opération de levage par<br />
AVEA sera très voisine de la pratique de manutention actuelle.<br />
c. Lest d’eau/d’air et désarrimage :<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 128
Temps de chargement du lest d’eau après déchargement :<br />
Soit une charge de 500 tonnes. On peut compenser cette dernière en 30 mn par l’usage de<br />
pompes développant une puissance commune de 300 kW à raison d’un débit de 0,3 m 3 /s<br />
sous une pression de 10 bars (on suppose le berceau/la charge à 100 m en <strong>des</strong>sous du<br />
dirigeable).<br />
Dans le cas d’une solution de ballastage à air dans un temps imparti de 30 mn, les<br />
compresseurs devront également développer une puissance installée de 300 kW.<br />
Par ailleurs, on estime de même la partie « lest d’eau/d’air et désarrimage de la charge » à 2<br />
heures. Notons ici que l’opération de remontée du berceau est quasiment identique à celle<br />
de la <strong>des</strong>cente à un paramètre près dû à la variation de l’énergie potentielle qui peut<br />
légèrement ralentir le régime.<br />
Le temps de remontée de l’aérostat, quasi-symétrique à l’opération de <strong>des</strong>cente (la<br />
remontée pourrait se faire plus rapidement car l’on est en régime de détente), est évalué à<br />
30 mn.<br />
En définitive et en première approximation, on peut considérer que le temps nécessaire à la<br />
phase d’empotage/dépotage de la pièce transportée est de l’ordre de 5 heures.<br />
Remarque : La solution de ballastage à air comprimé est en cours d’étude technique. Elle est<br />
bien évidemment plus intéressante d’un point de vue exploitation que la solution à eau qui<br />
contraint le dirigeable à opérer à proximité d’une source aquifère, ce qui n’est guère le cas<br />
d’une solution à air comprimé laquelle ne restreint pas le champ d’action de l’AVEA et, par<br />
ailleurs, est plus respectueuse de l’environnement.<br />
2. Transport sous élingues :<br />
Le processus est identique à celui du transport sur berceau avec l’avantage qu’il est plus<br />
flexible dans la mesure où, lorsque cela est possible, on peut transporter la charge en<br />
position d’exploitation. Le temps de déchargement ou manutention (plus l’outillage annexe<br />
éventuel) de la pièce du berceau peut être gagné.<br />
Notons également que d’après le rapport technique d’Aérospatiale, la <strong>des</strong>cente du système<br />
d’élingues se ferait plus rapidement que le procédé « berceau ».<br />
En définitive, le transport <strong>des</strong> vannes sphériques voire <strong>des</strong> transformateurs depuis le lieu de<br />
production jusqu’au chantier Sainte Marguerite 3 se ferait en 18 heures environ par<br />
dirigeable (transport + chargement, déchargement et levage), c’est-à-dire dans la journée<br />
lorsque les conditions atmosphériques le permettent ; à défaut, dans le cas d’un vent<br />
défavorable (70 km/h), l’acheminement se ferait en deux jours (37 heures environ).<br />
E/ Interface transport et scénarii :<br />
1. Interface de transport :<br />
Le transport par dirigeable respectera les conditions d’exploitabilité dictées par les autorités<br />
réglementaires en suivant les standards mondiaux JAR et FAR. Le survol de zones urbaines,<br />
le transport nocturne … sont autant d’éléments qui sont en cours de traitement et<br />
extrêmement liés au taux de fiabilité du dirigeable qui oriente la position <strong>des</strong> autorités<br />
réglementaires.<br />
En outre, il n’y a pas de conflits possibles avec l’aviation civile commerciale du fait <strong>des</strong><br />
couloirs d’acheminement différents puisque le plafond de vol du dirigeable est de l'ordre de<br />
3000/4000 m pour les opérations usuelles.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 129
Par ailleurs, d’un point de vue sécurité, la nature même du dirigeable lui procure un taux au<br />
moins égal à celui de l’avion de ligne régulière. Il peut se poser sans dégâts voire continuer<br />
de voler sur une certaine distance même en état dégradé (ex : MAP percés).<br />
Concernant les primes d’assurance « marchandises », celles-ci prendront en compte la<br />
faible voire inexistante rupture de charge qui diminue notablement le risque d’avaries.<br />
Du point de vue purement administratif, le franchissement de frontières sans passage obligé<br />
par <strong>des</strong> points de contrôle (ex : aéroports) est conceptuellement possible en raison de la<br />
facilitation <strong>des</strong> procédures douanières et autres que l’on observe à l’échelle internationale.<br />
Cette remarque est bien sûr générale et à ne pas prendre en compte dans l’étude de cas qui<br />
nous intéresse ici.<br />
B/ Scénarii :<br />
Cas <strong>des</strong> vannes sphériques :<br />
Compte tenu de la masse <strong>des</strong> vannes en questions, celles-ci pourraient être transportées les<br />
deux en une seule fois, complètement équipées et sans rupture de charge depuis Tracy<br />
jusqu’au chantier de Sainte Marguerite 3. Les indications concernant le temps de transport<br />
intégrant le levage ont été précisées en partie III.<br />
Cas <strong>des</strong> transformateurs :<br />
Compte tenu de la masse <strong>des</strong> transformateurs qui excède la limite <strong>des</strong> 500 tonnes que l’on<br />
s’est fixée, plusieurs scénarii sont possibles et doivent être analysés en fonction de divers<br />
facteurs incluant notamment <strong>des</strong> paramètres logistiques prenant en compte le comportement<br />
du chargeur, les délais, la notion de qualité et a fortiori le coût de l’opération.<br />
Scénario A : Transport <strong>des</strong> deux transformateurs de puissance groupés mais non<br />
équipés (masse totale d’environ 493 tonnes). Ce scénario est intéressant dans le cas<br />
seulement où le coût du transport propre par AVEA peut concurrencer les moyens<br />
conventionnels et que le gain de temps est appréciable. En effet, il faut noter que<br />
l’équipement devra se faire sur chantier, ce qui nécessite de délocaliser <strong>des</strong> équipes de<br />
travail et de l’outillage. Le bénéfice « qualité en usine » ne pourra également pas être retenu<br />
dans ce cas.<br />
Scénario B : Transport d’un transformateur à la fois complètement équipé ; les<br />
paramètres délais, qualité et surcoût de finition plaident en faveur de l’aérostat. Il est à<br />
craindre cependant le coût du transport qui sera doublé (2 AVEA opérationnels ou 2<br />
voyages).<br />
Scénario C : Transport optimisé en réseau<br />
- par bateau de Varennes aux Sept-Iles<br />
- « distribution <strong>des</strong> transformateurs » <strong>des</strong> Sept-Iles au chantier Sainte Marguerite 3 sur<br />
115 km à l’aide du même dirigeable ayant transporté juste auparavant les vannes<br />
sphériques ; ceci permet d’éluder les coûts de mobilisation/démobilisation du<br />
dirigeable et d’opérer une exploitation en réseau afin de rentabiliser au mieux<br />
l’opération SM 3 (notion d’économies de réseau et d’envergure).<br />
Notons que ce scénario envoie aux possibilités d’intermodalité dirigeable lourd/navire.<br />
Outre les aspects topographiques et météorologiques (vent, neige) permettant le choix<br />
précis du trajet, <strong>des</strong> informations techniques sur les pièces transportées (vannes,<br />
transformateurs) doivent être apportées, en particulier le plan de manutention et les<br />
contraintes à observer dans le cas d’un transport par dirigeable sous élingues ou sur<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 130
erceau. S’il advient <strong>des</strong> modifications au niveau de la production (renforcement de parties,<br />
moindre modularité …), celles-ci doivent être décrites et quantifiées en terme de coûts.<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 131
TRANSPORT DES VANNES SPHÉRIQUES ET DES TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE AU CHANTIER SAINTE-MARGUERITE 3<br />
Transformateurs de Puissance (2)<br />
Fabriqués à VARENNES<br />
Transport par bateau<br />
Environ 800 km<br />
<strong>PROJET</strong> STE-MARGUERITE 3<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 132<br />
Vannes Sphériques (2)<br />
Fabriquées à TRACY<br />
SEPT-ILES
TRANSPORT DES VANNES SPHÉRIQUES ET DES TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE AU CHANTIER SAINTE-MARGUERITE 3<br />
Transport par Bateau<br />
Environ 800 km<br />
GALLIX<br />
Transport par Barge<br />
Environ 25 km<br />
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 133<br />
<strong>PROJET</strong> STE-MARGUERITE 3<br />
CENTRALE 882 MW<br />
SEPT-ILES<br />
Transport terrestre<br />
Environ 90 km
O. Benmoussa Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / LEM 134