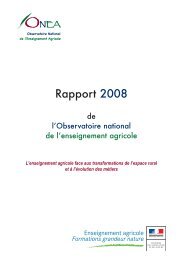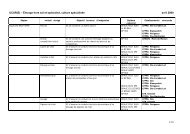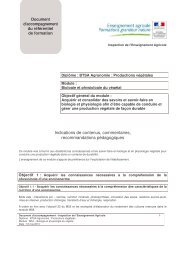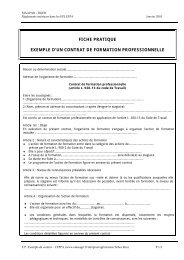Rapport 2002 - ChloroFil
Rapport 2002 - ChloroFil
Rapport 2002 - ChloroFil
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Observatoire National de l’Enseignement Agricole<strong>Rapport</strong>annuelEdition <strong>2002</strong>
L’Observatoire National de l’Enseignement AgricoleLe PrésidentLe Vice-présidentLes MembresLe <strong>Rapport</strong>eurLe <strong>Rapport</strong>eur adjointRené RémondPierre SagetJean-Louis BlancMichel BouletGérard de CaffarelliMichel DeschampsArmand FrémontJoseph GauterPhilippe LacombeFrançoise OeuvrardFrançois OrivelJean-Louis HermenKatia StrupiekowskiJean-Louis Hermen et Katia Strupiekowski ont assuré la coordination et la rédaction de ce rapport.
Le rapport <strong>2002</strong>Le rapport <strong>2002</strong> ..................................................................................................1Les recommandations de l’ONEA ...........................................................2Les thèmes particuliers .....................................................................5 L’établissement de formation, acteur du développement ..................7 Le point sur... ...............................................................................................85 Les journées d’étude de l’ONEA : Le rôle éducatif de l’internat .................87 Les licences professionnelles au Ministère de l’Agriculture,de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales ..............................99Panorama de l'enseignement agricole .........................................113 L’année <strong>2002</strong>-2003 : les premiers chiffres .........................................115 Sommaire du panorama ................................................................................118Annexes ............................................................................................................255
Pour mener à bien ses différents travaux, l’ONEA tient des réunions plénières régulières. Ilréalise en outre, par l’intermédiaire de son rapporteur et de son rapporteur adjoint, un travail spécifiqueen relation étroite avec la Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère del’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales (MAAPAR).Depuis la publication de l’édition 2001 de son rapport, l’ONEA s’est rendu à l’EPL du Mans, pourune journée de travail sur le thème « L’établissement de formation, acteur du développement ». Il aentendu dans ce cadre :Jean LE PIOUFLE, Directeur de l’EPL du MansJean-Pierre MAIGNANT, Directeur du CFPPADaniel RAGON, Directeur de l’exploitation agricoleMireille BEUCHER, Chargée des missions de coopération internationale et d’insertionFrançois FOSSARD, Formateur au CFPPANathalie GUESDON, Enseignante en économie (Ingénieur d’agronomie)Benoît LE MEUR, Enseignant en éducation socioculturelle (PCEA)Christian PELTIER, Enseignant en histoire et géographie (PCEA)Valérie REDON, Enseignante en économie (Ingénieur d’agronomie)Marie-Claude TREGOUET, Formatrice au CFPPAPar ailleurs, un comité de pilotage a été mis en place dans le cadre du travail monographique réaliséen Midi-Pyrénées sur le thème du développement. Ce comité était composé de représentants desdifférentes familles de l’enseignement agricole régional :Jean-Régis BONNEVIALE, Direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt Midi-PyrénéesFrançois-Xavier BOYER, Directeur du CREAP Midi-Pyrénées - Languedoc - RoussillonSerge CHEVAL, Directeur régional des maisons familiales et rurales Midi-PyrénéesFrançois DASCON, Enseignant ENFABernard MONDY, Enseignant ENFABernard PATOUREAUD, Chef du SRFD Midi-Pyrénées
Le <strong>Rapport</strong> <strong>2002</strong> est le cinquième rapport présenté par l’ONEA, conformément auxmissions fixées par son arrêté de création.On y retrouve les grandes parties constitutives habituelles :Les thèmes particuliers proposent un bilan des travaux et réflexions engagés par l’ONEA surdes aspects du fonctionnement de l’enseignement agricole dans le cadre de l’ensemble de sesmissions, sujets soumis par le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et desAffaires Rurales, en raison de leur actualité et de leur importance pour le système ;Le Point sur... permet de revenir sur certains des thèmes particuliers traités dans les précédentsrapports, l’ONEA assurant ainsi une fonction de veille vis-à-vis des constats et recommandationsqu’il formule ;Le Panorama de l’enseignement agricole est un outil d'information, d’analyse et depilotage à l’adresse de tous les acteurs et partenaires du système. Cette année, dans le cadre des Thèmes particuliers, l’ONEA a porté son attention sur :L’établissement de formation, acteur du développementQuels types de développement mettent en oeuvre les établissements de formation ?Comment se construisent les actions ?Quel est l’impact de ces actions de développement sur le territoire ? A la rubrique Le point sur... nous présentons un premier bilan sur la nouvelle offre de formation quesont les licences professionnelles, ainsi qu’une synthèse de la journée d’étude organisée par l’ONEAsur le thème : “Le rôle éducatif de l’internat” Enfin, en début du Panorama nous présentons les premières tendances observées à la rentrée <strong>2002</strong>-2003.1
Les recommandations de l’ONEAA l’issue des travaux réalisés au cours de sa sixième année de fonctionnement, l’ONEA fait lesrecommandations suivantes :L’établissement de formation, acteur du développement Le développement, dans son acception la plus large, est au cœur des missions dévolues àl’enseignement agricole. Il participe de son identité, de sa place originale dans le paysageéducatif français. Les actions des établissements dans ce domaine témoignent du lien nécessaireentre la formation, la recherche et le développement. De ce fait, elles ont un rôle stratégiquedans la reconnaissance et la promotion de l’enseignement agricole. Elles doivent êtredéfendues, soutenues, valorisées. L’établissement constitue, du fait de son autonomie et de son expertise, un lieu de rencontreprivilégié entre les différents acteurs présents sur son territoire. A ce titre, il faut rappeler lerôle essentiel qu’il a à jouer pour son milieu en tant qu’acteur du développement. Face aux incertitudes et interrogations concernant le développement agricole et rural, lesétablissements ont la responsabilité particulière de concourir au renouvellement desproblématiques et des politiques dans ce domaine. On ne peut qu’encourager les expériences etappeler à l’ouverture d’une réflexion d’ensemble sur les pratiques. Toutefois, il nous paraîtimportant de souligner qu’il ne peut y avoir de développement sans orientations nationalesfortes. La mise en œuvre des actions de développement passe par des partenariats multiformes qu’ilnous paraît nécessaire de susciter, de renforcer et de formaliser, ainsi que par le renforcementdes collaborations de l’enseignement agricole avec les directions techniques du ministère auxdifférents niveaux territoriaux.A l’adresse de la DGERRessources humaines et compétences Les actions de développement nécessitent des capacités d’analyse et d’ingénierie : ingénieriedu développement dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des actions, ingénieriefinancière quant à l’élaboration de montages budgétaires de plus en plus complexes. Il estimportant de souligner le développement de ces nouvelles compétences dans l’exercice desdifférents métiers de la communauté éducative des établissements de formation agricole.2
Dans cette optique, il nous apparaît indispensable que soient proposées à l’ensemble despersonnels impliqués dans ces actions (ingénieurs, enseignants, administratifs, responsablesd’exploitation), et ce pour les plus jeunes dès leur recrutement, des sessions de formation surl’importance stratégique de ces actions et les moyens de leur mise en œuvre. Il convient à cesujet de souligner le rôle de relais essentiel que peuvent jouer les personnels en place en termesde transmission des savoirs et savoir-faire requis. Le rôle incontestable qu’ont joué et que jouent encore aujourd’hui les ingénieurs dans lesactions de développement des établissements de formation nous amène à attirer l’attention del’Administration sur la mission qui leur sera confiée à l’avenir quant au lien formation –recherche – développement.Pilotage national Les initiatives des établissements dans le champ du développement nécessitent desaccompagnements : administratifs, financiers, méthodologiques, scientifiques (capitalisationde la pensée, notamment). Elles réclament de plus la mise en place d’une véritable politiqued’évaluation, de veille et de prospective. Les réseaux thématiques et géographiques ont une fonction de diffusion et d’échangesdéterminante dans le soutien de ces actions. Il conviendrait d’en améliorer le pilotage national.A l’adresse des collectivités territoriales S’agissant des Régions, l’ONEA attire leur attention sur le caractère déterminant desmoyens affectés, en matière d’infrastructures d’accueil (amphithéâtres, centres deressources…), mais aussi d’orientations stratégiques des exploitations agricoles et atelierstechnologiques, dans la capacité d’action des établissements de formation. L’ONEA appelle par ailleurs l’ensemble des collectivités territoriales à mieux prendre encompte l’établissement de formation agricole comme vecteur du développement. Il apparaît àce titre pertinent de renforcer son intégration aux projets de territoires, dans toutes leurscomposantes, en soutenant la mise en place de partenariats formalisés.A l’adresse des établissements L’intégration des actions de développement au projet des établissements est essentielle à ladimension stratégique de leur politique. Cette intégration doit être étendue au voletpédagogique, trop souvent négligé. Une participation active des élèves aux actions, quel quesoit leur champ, est indispensable. Il est essentiel pour les établissements de mettre en œuvre une démarche de qualité, la qualitédu diagnostic conditionnant la qualité de l’action de développement et son impact. Cettedémarche doit aussi concourir à l’évaluation des actions. Les partenariats des établissements doivent être renforcés, diversifiés, pérennisés.Les licences professionnelles3
Dans un contexte de construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur, la DGERdoit faire preuve d’une implication plus forte à l’égard du développement des licencesprofessionnelles. Cette nouvelle offre de formation a un rôle privilégié d’interface entre l’enseignementtechnique et l’enseignement supérieur ; il convient d’étudier les conditions d’une participationplus grande des écoles supérieures agronomiques aux licences professionnelles.4
LES THEMESPARTICULIERS
L’établissement de formation,acteur du développement7
SommairePréambule..................................................................................................................................Première partie — Une problématique à construire..................................................................I- Quelques repères historiques.....................................................................................................II- Le triangle « développement - territoire - établissement de formation..............................................III- Du développement agricole au développement territorial..............................................................A- Le développement agricole.................................................................................................B- Pour une approche du développement territorial......................................................................C- Le développement durable..................................................................................................IV- Eléments de construction d’une problématique...........................................................................111313192222252627Deuxième partie — Les actions de développement des établissements :un premier bilan.......................................................................................I- Recueil des informations : la méthodologie mise en oeuvre...........................................................A- L’enquête nationale...........................................................................................................1- Mode opératoire......................................................................................................2- Structure des établissements répondants.......................................................................B- Les monographies............................................................................................................II- Les actions conduites : état des lieux........................................................................................A- Etablissements et actions conduites : données quantitatives......................................................B- Caractérisation des établissements ne menant pas d’action........................................................C- Champs des actions et établissements..................................................................................D- Les domaines d’actions......................................................................................................E- Les types d’actions : une relation forte avec le champ de l’action .............................................F- Les actions conduites, une caractérisation à quatre dimensions : statut d’enseignement, champ,domaine, type de l’action..................................................................................................III- Les processus de conception et de mise en oeuvre des actions: facteurs internes, facteurs externes......A- Des actions souvent mises en place à l’initiative des établissements... avec l’appui desprofessionnels.................................................................................................................B- Les facteurs internes de l’établissement « facilitateurs » de la mise en oeuvre des actions dedéveloppement................................................................................................................1- Les apprenants mobilisés..........................................................................................2- L’inscription dans les projets de l’établissement............................................................3- L’implication des personnels.....................................................................................C- Les facteurs externes et le partenariat lors de la mise en oeuvre des actions.................................1- L’inscription dans le projet de développement local........................................................2- Des partenariats plus ou moins forts selon les champs d’action.......................................292929293032333336384144464747505053555858598
Troisième partie —De l’établissement acteur du développement au développement moteurde l’établissement.....................................................................................I- L’établissement, lieu de conception et de mise en oeuvre d’actions de développement .......................A- Des actions de développement en quantité relativement importante et caractérisées par une grandediversité........................................................................................................................B- Qualité et diversité : quelques exemples d’actions de développement.........................................C- Diversité des actions de développement et caractéristiques des établissements.............................II- Les conditions facilitatrices des actions de développement : des éléments de réponse.........................A- Les variables endogènes...................................................................................................B- Les variables exogènes.....................................................................................................B- Typologie d’établissements et mode d’organisation : les éléments facilitateurs du développement..III- Impacts des actions de développement : le cercle vertueux pour l’établissement..............................65656566717373757780Les recommandations...............................................................................................................829
Confrontés à ces nouveaux défis, l’enseignement agricole et plus particulièrement les établissements deformation doivent tendre à répondre aux exigences du développement agricole, mais aussi aux attentes dedéveloppement de leur territoire de proximité, voire aux demandes émergentes de la société, et ceci sansqu’apparaissent clairement les lignes de force des transformations en cours.Comment l’établissement peut-il être acteur du développement agricole et territorial ? Quelles missionscela concerne-t-il ? L’expérimentation - développement ? L’animation rurale ? Ou est-ce l’ensemble desmissions mises en synergie ?La rencontre territoire-établissement est une démarche complexe, avec des mises en oeuvre de partenariatssouvent difficiles à organiser. L’implication réelle des établissements dans le développement, qu’il soitagricole ou territorial, est souvent mal connue : peu d’informations spécifiques existent, et l’évaluation deces actions est difficile à réaliser. Sans doute la complexité du sujet traité — diversité des actions, desintervenants, des partenariats, des financements — expliquent ces insuffisances. Toutefois, ledéveloppement est une réalité forte, inscrite clairement dans la loi comme dans les pratiques : c’est un enjeumajeur et stratégique qui renvoie à la nature même de l’enseignement agricole.C’est pourquoi l’ONEA a souhaité réaliser un premier état des lieux, tout en mesurant les limites d’unetelle étude qui a tout d’abord le mérite d’apporter des informations et de répondre à certaines interrogations.Dans une première partie, le document tente une mise en perspective historique montrant le lien fort —lien présent depuis le début — entre enseignement agricole et développement. Ainsi, pouvons-nousconforter notre question de départ — L’établissement de formation agricole est-il acteur du développement ?— et préciser notre approche.Dans une deuxième partie, consacrée à l’observation des faits, nous avons rassemblé deux typesd’informations : des informations quantitatives nationales, à partir d’une enquête exhaustive auprès desétablissements, afin de mesurer la « réalité » des actions de développement ; des informations plusqualitatives de type monographique sur certains établissements.Enfin, dans une troisième partie conclusive, nous avons tenté de mettre en lumière le rôle primordial del’établissement en tant qu’acteur du développement, les conditions facilitatrices du développement de cesactions et leurs impacts, ainsi que leur aspect stratégique.12
Première partie — Une problématique à construireLa prise en compte des diversités territoriales ne s’est réellement affirmée qu’après la Libération etsurtout à partir de 1963, avec la création de la DATAR, suite à un exode rural massif et à l'apparition degraves déséquilibres au niveau de l'occupation de l'espace. Dans un contexte de forte croissance, la DATARreçoit pour mission de favoriser une meilleure répartition de l'activité et des hommes sur le territoire.Concernant les politiques de formation, ce n’est qu’à la fin des années 70, devant les difficultés rencontréespar l’Etat dans la gestion des contradictions du système scolaire (accroissement des taux d’échec, processusd’orientation mal maîtrisé, remise en cause du modèle adéquationiste) qu’une politique de rapprochementavec les territoires prenant en compte leurs disparités commence à émerger.Cependant dans l’enseignement agricole, et ce depuis longtemps, la renommée des écoles fondées sur « uneproduction et une région » favorisait la prise en compte des diversités territoriales : Rouffach et laviticulture, Marmilhat et l’élevage, par exemple. En fait, l'agronomie a toujours été considérée comme une« science de la localité, mais aussi de la diversité ».L’Etat va être ainsi amené à redéfinir son rôle et à déléguer une partie de ses pouvoirs aux échelons locaux,notamment à l’établissement public local d’enseignement : collèges et lycées, partenaires des territoiresruraux pour des projets communs de développement.I- Quelques repères historiquesL’Histoire nous enseigne que l’Ecole a toujours été soumise, dans ses rapports avec le territoire, à unedialectique entre le central et le local.Jusqu’à la fin de l’ancien régime, l’école relève de l’Eglise, centre d’impulsion général, sous le doublecontrôle du curé de paroisse et de l’assemblée du village : elle est objet local ; avec commeconséquences une inégale répartition des établissements sur le territoire, des contenus pédagogiquesdisparates et une grande diversité dans les compétences des maîtres.Dès la Révolution française 1 , on observe la construction du modèle liant l’Ecole à l’Etat et au Droit: mise en place progressive par l’Etat d’une instruction publique comme élément constructeur de l’identiténationale et républicaine, en réaction à un « Etat féodal morcelé ».C’est la naissance du modèle vertical d’éducation : l’éducation devient alors nationale. L’Etatentreprend « d’homogénéiser » le territoire : Création des lycées sous le Consulat et de l'Université impériale ensuite. Obligation faite aux communes d’ouvrir au moins une école primaire (Loi Guizot - 1833) Loi de 1882 (Jules Ferry) proposant les fondements d’une instruction publique.Dans le même temps, la diversité des territoires est aussi prise en compte, notamment dans l'enseignementagricole. C'est le cas en 1848, lors de l'institutionnalisation de l'enseignement professionnel del'agriculture 2 . Dès l’origine, les établissements de l’enseignement agricole sont acteurs du développement.La modernisation de l’agriculture, sur la base de l’appel aux connaissances scientifiques et la recherche deplus grandes performances du sol (fertilisation), des plantes et des bêtes (sélection) est une dimensionessentielle de l’action du Ministère de l’Agriculture dès sa création. Cette action est alors conduite par les1Le premier « Plan d’Education Nationale » a été rédigé en 1792 par le député de l’Yonne, Le Pelletier de Saint – Fargeau, et présentéà la Convention le 13 juillet 1793 par Maximilien de Robespierre2Le décret d'Octobre 1848 organise, sous tutelle du Ministère de l'Agriculture, l'enseignement professionnel en trois niveaux avectrois types d'établissements :- la ferme-école au niveau local,- l'école régionale,- l'Institut national agronomique.13
professeurs départementaux d’agriculture. Ceux ci deviendront, au début du vingtième siècle, ingénieurs desservices agricoles. Les établissements sont créés avec l’appui financier des autorités locales. Ils sontimplantés sur des exploitations agricoles choisies pour leur performance technico-économique et devantjouer le rôle de « modèle » : c’est l’« exploitation agricole-école ». L’établissement intervient donc dansl’évolution de l’agriculture locale.Par la suite, la loi du 2 août 1918, jette les bases de la rénovation de la formation professionnelle agricoleet fait figure de précurseur quant à la « territorialisation » des politiques de formation : les programmessont définis localement pour être adaptés aux territoires de proximité. L’article 13 de cette loi insiste surles fonctions « externes » de l’établissement : « Les professeurs, en dehors de leurs cours réguliers, pourrontêtre appelés à faire des conférences aux agriculteurs de la région sous la direction du directeur des servicesagricoles du département et après entente avec le directeur de l’établissement dont ils dépendent. Un comitéde consultations, comprenant tout le personnel enseignant, est établi dans chaque école pour donnergratuitement des renseignements. »Ce n'est que l'année suivante que l'Education Nationale, lors de la création des premiers établissements del'enseignement technique et professionnel, va intégrer la notion de diversité territoriale avec la mise enplace des Commissions locales professionnelles (loi Astier 1919), « chargées de déterminer etd'organiser les cours obligatoires pour les besoins des professions commerciales et industrielles de lalocalité ».Ainsi l'Etat et les acteurs de la profession agricole vont-ils mettre en place un système de formation quidevra accompagner les changements de la politique agricole. C’est à cette période qu’apparaît la missiond’aménagement avec la création du corps des ingénieurs du Génie rural.Le 10 décembre 1925, le ministre de l’Agriculture, Jean Durand, appelle, dans une circulaire, les directeursde tous les établissements d’enseignement agricole, de l’Institut national agronomique aux écolestechniques, à assurer la liaison entre les écoles et le public agricole. Il précise les différentes formes quepeut prendre cette collaboration entre l’école et le monde rural : visites de groupes d’agriculteurs dansl’établissement ; conférences dans l’école avec projections cinématographiques ; visites des cultures et deschamps de démonstration ; présentation d’animaux ou de matériel, etc.En 1926, sont créés les Comités départementaux de l'enseignement agricole. Durant cettepériode, la diffusion du progrès agricole va se faire essentiellement par la voie de la vulgarisation. Onobserve alors une forte liaison entre enseignement et vulgarisation avec notamment l'appui des ingénieursdes directions des services agricoles (DSA).Le 28 avril 1937, un arrêté ministériel prévoit que les directeurs, les professeurs et les chefs de pratique desécoles d’agriculture peuvent être chargés d’actions en direction des agriculteurs : conférences publiques faitespar les directeurs, applications et démonstrations publiques par les chefs de pratique ; enfin, les professeurspeuvent assurer les fonctions de professeur d’agriculture dans la région où est implantée l’école. Et, unelongue circulaire, en date du 4 mai, du ministre de l’Agriculture, George Monnet, aux directeurs des servicesagricoles et aux directeurs des écoles attire leur attention sur l’importance de cette extériorisation. Dans unepériode où les conditions techniques et économiques connaissent de profonds changements, il souligne lerôle de l’enseignement agricole pour préparer « les petits exploitants – qui sont légion chez nous – à penserpar eux-mêmes, à examiner sous l’angle de la raison les phénomènes naturels, les questions économiqueset sociales et à faire ensuite application des résultats de leurs réflexions dans leur travail quotidien et leursrapports mutuels ». Cette action est nécessaire ; elle est aussi facilitée par l’attitude des agriculteurs quisouhaitent être informés rapidement et par celle des jeunes qui s’organisent en groupements professionnels.En 1959, la profession agricole, en partenariat avec l’Etat, obtient la clarification d’un statut de lavulgarisation : « diffusion des connaissances techniques, économiques et sociales nécessaires àl'agriculture ».14
Cependant ce n’est qu’au lendemain de la 2 ème Guerre mondiale que l’impératif de modernisation — sousl’impulsion de la politique de planification — est pris en compte par l’Education Nationale, avec la volontéde construire un véritable système éducatif 1 . On passe alors d’une phase d’ « Etat éducateur » à une phased’ «Etat développeur », rôle que l’Etat avait anticipé pour la production agricole. A partir des années1960, face aux besoins de modernisation industrielle et agricole et aux « goulets d’étranglement », enparticulier les pénuries de main-d’œuvre qualifiée auxquelles se heurtait le développement économique, ontété amorcées les bases d’une planification des flux scolaires.En ce qui concerne le secteur agricole et agroalimentaire, les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962vont dans ce sens et traduisent la volonté politique de moderniser l’agriculture française ; la loi surl’enseignement agricole va alors conférer un rôle majeur à la formation initiale pour répondre à la demandeet accompagner les changements. Parallèlement, cette loi conforte l’idée d’une nécessaire adaptation de cetenseignement aux réalités locales.Fonction de production agricole et enseignementL’incontournable confrontation au travail« Les fonctions de production agricole ne permettent pas facilement uneindustrialisation-standardisation complète du procès de travail (nécessité del’observation, de la connaissance des spécificités du lieu, des animaux, desplantes... décision «sur le champ», pensée dans le temps...) ; d’où la visionhabituelle de l’agronomie, science de la diversité. Tous ces constats ont conduità un enseignement agricole confrontant les formés et les formateurs,intellectuellement et même physiquement, au travail : c’est vrai des écolespratiques aux écoles d’ingénieurs y compris les plus prestigieuses.Cette confrontation au travail est intégrée, structurellement et positivement, à laformation :- elle participe à la formation et à la progression scientifique (observation,expérimentation, modélisation...),- elle est pleinement conforme aux valeurs de la république (améliorationdu bien-être par la science, respect du travail, solidarité des travaillleurs...),- elle est mise au service du développement personnel et collectif (qu’ils’agisse d’une remédiation ou d’une préparation à des tâches de productionou d’encadrement ou d’une réflexion sur la vie sociale et la citoyenneté...),- le milieu professionnel est naturellement associé à une formation ainsiconçue.Une telle conception est évidemment très différente de celle d’un enseignementqui isole, protège, sépare... ou encore de celle d’un enseignement qui craint de sesalir dans le travail, de se compromettre avec les réalités économiques ou dedéchoir en s’intéressant aux techniques ou à l’organisation sociale...(...)1La réforme Haby de 1975 entérine l’usage courant du terme.15
(...)Dans ces conditions, la formidable modernisation agricole (technique,économique, sociale, politique) de la deuxième moitié du XX ème siècle a impliquél’enseignement de diverses manières. L’enseignement, principalement laformation continue (publique, privée, confessionnelle, professionnelle...), aapporté une contribution reconnue à la conception et à l’accompagnement duprocessus de modernisation. Cette dernière a ensuite appelé un développementmassif de la formation sous toutes ses formes : formation secondaire (en vued’améliorer la compétence des agriculteurs mais aussi en vue de faciliter lamobilité de la main-d’oeuvre libérée par les gains de productivité), formationcontinue, constitution d’un appareil de développement, enseignement supérieuret recherche agronomiques.»Philippe Lacombe, Directeur scientifique, INRA.C’est durant cette période qu’est créé le corps des ingénieurs d’agronomie investis d’une mission dedéveloppement et d’enseignement : « au professeur départemental d’agriculture, homme orchestre de lamodernisation de l’agriculture et à l’ingénieur des services agricoles « ami des agriculteurs » succède« l’ingénieur d’agronomie » chargé du contrôle du développement et de la formation professionnelleagricole 1 . » Mais, si jusqu’aux années 60, le rôle de vulgarisateur des techniques modernes n’a guère étécontesté aux ingénieurs des services agricoles, il n’en est pas de même par la suite. Il faut dire qu’auparavantceux-ci portaient une modernisation qui ne bouleversait pas la structure sociale du milieu agricole et rural.Certes, l’exode rural avait commencé dès le XIXème siècle mais il touchait surtout les salariés etdomestiques agricoles. Le nombre des exploitations était, lui, resté relativement stable. C’est unbouleversement profond qui s’engage à la fin des années 50 et surtout au début des années 60, avec le votedes lois agricoles. Bousculée par de fortes innovations scientifiques et techniques, par l’explosion desenjeux financiers, l’agriculture rentre dans le jeu du marché. En une génération, la paysannerie françaiseporte une transformation qui, dans l’histoire n’a d’équivalent que dans le mouvement anglais des enclosures(encore celui-ci s’est-il étalé sur une période bien plus longue). Il ne s’agit plus de diffusion de techniquesnouvelles mais de la transformation profonde d’un milieu et de l’invention de nouveaux typesd’exploitations agricoles accompagnés d’une réduction forte de la population agricole : les sociologuesparleront de la « fin des paysans » 2 et d’ « une France sans paysans » 3 .Le décret de 1966 introduit ainsi la notion de développement agricole ; il s’agit d’associer à la pratiquede vulgarisation agricole des années d’après-guerre (foyers de progrès agricole, CETA, CIVAM) la formationet la recherche appliquée et d’intégrer les avancées techniques dans le contexte de l’exploitation agricoleprise dans sa globalité : contraintes sociales et économiques, territoire, cadre européen…1De la vulgarisation au développement, jalons pour une histoire : 1912-1966 Michel Boulet.Communication aux 2èmes journées du Savoir Vert - Sept 1994 – ARC et SENANS2« La fin des paysans » — Henri Mendras — 19673« Une France sans paysans » — M. Gervais, C. Servolin, J. Weil — 196516
Au niveau local, on assiste alors à la transformation des foyers de progrès en Centres de formationprofessionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) 2 , cogérés par l’Etat et la profession agricole.Parallèlement est créée au plan national l'ANDA (association nationale pour le développement agricole)avec un Conseil d'administration composé paritairement de représentants de la profession et del'administration et présidée par un professionnel.L'essentiel des activités de développement va alors passer sous la responsabilité de la profession agricole,qui « devient seule responsable de la diffusion des connaissances avec toutefois le concours del'administration ». Les ingénieurs d’agronomie n’apparaissent, eux, que comme représentants de l’Etat danscertaines structures paritaires de développementPlus généralement, il est alors admis que la condition première du développement (agricole – rural –territorial) passe par une formation de base dynamisée : c'est-à-dire la mise en place d’un enseignementtechnique (formation initiale, formation continue) performant, impliquant des contacts (réseaux)« enseignants – partenaires du développement » et des actions de formation complémentaire ou d’appuitechnique.Ainsi, alors que le processus de modernisation engagé dans l’agriculture menait à un nécessairedéveloppement de la formation, la profession agricole a revendiqué et obtenu une place croissante, devenuedominante, dans l’exercice des responsabilités de diffusion des techniques agricoles et d’animation dudéveloppement local ; longtemps gérées par un service d’Etat (animé par les ingénieurs des servicesagricoles), ces tâches sont passées sous l’autorité de la profession agricole au nom de la promotion dumilieu et de l’exercice des responsabilités.Mais, le bouleversement qui a marqué l’agriculture à cette époque ne pouvait pas être porté par les seulsmodernisateurs d’Etat qu’étaient les ingénieurs des services agricoles : il n’était pas de l’ordre de la seuleaction de la puissance publique mais de la dynamique interne d’un milieu. Celui-ci a trouvé les formesd’organisation efficaces avec la JAC et le CNJA et s’est doté des outils institutionnels et financiers pourprendre en charge son propre développement (les services d’utilité agricole de développement, les institutstechniques, le fonds national de développement agricole). Les ingénieurs des services agricoles, devenusingénieurs d’agronomie ne sont pas totalement écartés du jeu : ils gardent une place dans la cogestion et,chargés de mettre en place un enseignement technique agricole de masse, ils doivent inventer une nouvellemanière d’agir en s’appuyant, non plus sur l’autorité administrative des directions des services agricolesmais sur les tout nouveaux lycées agricoles. Leurs adjoints, ingénieurs des techniques agricoles, dans lescentres de formation professionnelle et de promotion agricoles, s’engagent alors dans les formations depréparation à l’installation des jeunes agriculteurs. Reste que les ingénieurs des services agricoles se sonttrouvés démunis, ils se sont sentis « remerciés » et « renvoyés » dans les lycées, ne conservant qu’unefonction de coordination. Or, les établissements n’étaient pas centres de développement. Pour le corpsd’agronomie, ce fut vécu comme une dépossession de leur mission historique.Par la suite, sous la poussée de facteurs externes tels que la mondialisation des échanges, la constructioneuropéenne, la transformation du système productif, mais aussi de facteurs internes tels que les lois dedécentralisation, la loi quinquennale sur l’emploi, le cadre national de référence des politiques de formationdevient moins visible. Aux côtés de l’Etat, d’autres acteurs sont présents sur le terrain de l’éducation et dela formation : les collectivités territoriales, les syndicats mixtes, les comités locaux « éducation –économie », les EPLE, les branches professionnelles… D’un rôle de développeur, l’Etat passe àun rôle de régulateur et attribue implicitement ou explicitement ses anciennes prérogatives oufonctions de développement à des niveaux intermédiaires voire locaux.1La formation des adultes a été relancée par la loi de juillet 1959 sur la promotion sociale.17
Ce sont les lois de décentralisation de 1982, 1983 et 1985 qui amorcent la rupture avec « le modèle verticalde Jules Ferry », en introduisant à nouveau le rapport « établissement de formation – territoirelocal ».Dès 1982, l’enseignement agricole, lors des premières réflexions de mise en œuvre de la rénovation, mettaitl’accent sur ce qui fait sa spécificité : « l'adaptation aux réalités régionales » ; ce qui se concrétisera par unprojet pédagogique élaboré par chaque établissement avec les lois de 1984 portant sur la rénovation del’enseignement agricole et sur la réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignementagricole privés. L’établissement devient un élément central du système éducatif agricole et est doté, pourles établissements publics, de la personnalité civile et de l’autonomie financière (EPLEFPA - décret denovembre 1985) 1 . Dans les établissements publics, l'existence d'un Conseil d'Administration, présidé parune personnalité extérieure va conforter leur fonction d'acteur du territoire. Au-delà, les missions mêmesdes établissements sont redéfinies : leur rôle en matière de développement agricole et d’animation rurale estaffirmé. On est alors dans un contexte de remise en cause du modèle de développement des années 60 et deses conséquences : surproduction, pollutions, désertification des zones rurales. Les Etats généraux dudéveloppement agricole (1982 et 1983), qui ont précédé les lois de 1984, furent conduits sous la doubleanimation de la profession et des services du ministère. Le corps d’agronomie et les établissementsd’enseignement agricole y participèrent activement. Des séances publiques furent organisées à tous lesniveaux territoriaux : petites régions agricoles, régions, niveau national. Il en résulta l’idée que l’actiond’appui auprès des agriculteurs comportait trois volets qu’il convenait à la fois de distinguer et de lier : larecherche, la formation et le développement. C’est dans cette optique que devait s’inscrire l’action des lycéeset des CFPPA, au sein desquels les ingénieurs d’agronomie étaient appelés à jouer un rôle moteur en termesde développement. Les établissements privés, ayant une mission de service public, furent associés de mêmeque les établissements publics à cette conception du développement. Dans ce lien entre formation, rechercheet développement, l’action de l’Etat était réafirmée.La mutation amorcée dans le positionnement des établissements avec les lois de 1984 sera par la suiteconfirmée par la loi d’orientation sur l’éducation de 1989 qui fait de l’EPLE l’unité de base du systèmeéducatif, avec un concept à la fois corollaire et central, celui de projet d’établissement.La loi quinquennale pour l’emploi (1993) parachève cette évolution territorialisée, en transférantprogressivement en région les compétences et les moyens que l’Etat conservait à la formationprofessionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.L’Etat va être ainsi amené à redéfinir son rôle et à déléguer une partie de ses pouvoirs aux échelons locaux,et notamment en matière de formation à l’établissement public local d’enseignement ; avec l’arrivée denouveaux acteurs, on assiste à un approfondissement de la prise en compte de la diversité territoriale avecune ferme volonté de mettre en place des politiques de développement localisées.L’établissement agricole « n’est plus seulement un lieu où sont dispensés des savoirs définis par desprogrammes, mais il devient aussi un acteur de la vie locale qui participe au développement de son territoireet adapte sa formation aux besoins locaux et régionaux ainsi qu’aux besoins liés à ses secteurs d’activité» 2 ,avec par exemple la mise en place des modules d'initiative locale (MIL). De fait, le processus de formationva se construire en se « confrontant » à la réalité de la production agricole tant physiquementqu'intellectuellement.1Cette émergence de l’établissement de formation en tant que personne morale concerne également l’enseignement privé2Thérèse Charmasson, Michel Duvigneau, Anne-Marie Lelorrain, Henri Le Naou - «L'enseignement agricole, 150 ans d'histoire» -Educagri - 199918
Depuis sa création et dans la continuité des écoles d’agriculture et des écoles ménagères agricoles,l’enseignement agricole est donc étroitement associé aux actions de développement qu’elles soient agricolesou territoriales, notamment à partir des exploitations agricoles des établissements quand elles existent,mais aussi dans un cadre pédagogique ou d’expertise – conseil, voire de nouvelles entités territoriales.En particulier, les lois de 1984 ont pris acte de ces « fonctions de développement » en confiant àl’enseignement agricole la mission de « contribuer à la liaison entre les activités de développement,l’expérimentation et la recherche agricole et para-agricole ». Ainsi quatre missions sont dévolues au servicepublic d'enseignement agricole : Assurer une formation technologique et scientifique initiale, une formation professionnellecontinue ; Participer à l'animation du milieu rural ; Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la rechercheagricoles et para-agricoles ; Participer à des actions de coopération internationale.La loi d’orientation agricole de 1999 marque la volonté du législateur d’inscrire dans les textes la notionde développement durable et d’organisation du développement agricole, mais aussi la prise en compte duterritoire (Contrat territorial d’exploitation). L'enseignement agricole est partie prenante de cette nouvellestratégie : il voit ses missions élargies et son ancrage territorial conforté. Aux quatre missions de 1984,la loi de 1999 ajoute celle d'insertion scolaire, sociale et professionnelle et surtout affiche l'articulation etla complémentarité de l'ensemble de ces missions afin d'améliorer la formation des diférents publicsconcernés, mais aussi d'accompagner les nouvelles orientations de la politique agricole.La mise en œuvre du développement agricole voulu par la loi, ainsi que les actions autour du CTE(remplacé par le CAD, Contrat d’Agriculture Durable) et du développement durable font potentiellementdes établissements de formation agricole des acteurs centraux du développement de leur territoire deproximité 1 .II- Le triangle « développement – territoire – établissement de formation »Du concept de territoire construit géographiquement et administrativement, on évolue vers une approcheplus souple où les jeux d’acteurs introduisent de l’indétermination : les espaces en construction.Plus généralement, les nouvelles interrelations entre les différents centres d’impulsion politique et lesdifférents centres d’initiative sociale et éducative peuvent générer de nouveaux espaces où vont s’ébaucherdes formes nouvelles de politiques éducatives et de formation dans leur rapport au territoire. On assisteainsi à la rencontre d’acteurs, appartenant à des sphères diverses — économiques, sociales, culturelles,politiques, etc — et qui manifestent une volonté commune d’être des partenaires d’actions territorialiséesou localisées : SIVOM 2 , Syndicats mixtes, Districts, Communautés urbaines, « Pays », etc.Ces rencontres d’acteurs suscitent de nouveaux lieux d’échanges, notamment dans la relation« établissement de formation – territoire » avec l’émergence de nouveaux cadres : les réseaux.Ces derniers vont permettre la mise en œuvre d’articulations spatiales complexes : horizontales entre lesacteurs d’un même territoire, verticales entre les différents niveaux territoriaux des politiques de formation1“ L’acteur du territoire est défini comme une personne physique ou morale qui, par son engagement personnel, professionnel,politique, syndical, associatif... intervient sur un territoire donné et prend une part déterminante à l’évolution de ce territoire et desprojets qui sont mis en oeuvre” — CEP de Florac — Glossaire Formation et territoire.2Syndicat intercommunal à vocation multiple.19
et des politiques de branches professionnelles — local, régional, national, européen, international —.De fait, le réseau conduit à créer des relations entre des individus, mais aussi entre institutions où travaillentces individus : établissements de formation, entreprises, exploitations agricoles, chambres d’agriculture,collectivités territoriales, etc.En reliant des éléments pour le moins épars, le réseau vise un territoire virtuel, source d’échanges entreindividus et institutions, où coexistent le niveau individuel et le niveau collectif, avec dans le cas présentun dénominateur commun : le développement. S'appuyant sur un large partenariat, le réseau vadiffuser l'information, favoriser l'échange des expériences et l'appui aux transferts. L'enseignement agricoles'appuie sur de nombreux réseaux qu'ils soient thématiques, par pays, ou transversaux : quel est leur rôledans l'émergence, la conduite, la diffusion et la coordination des actions de développement ?Dans ces nouvelles configurations, les établissements de formation vont être amenés à jouer des fonctionsd’interface entre des politiques nationales, régionales ou infra régionales et ce dans des domaineséconomiques, techniques, mais aussi sociaux et culturels.Il s’agira donc d’étudier si et à quelles conditions les établissements d’enseignement professionnel ettechnique agricole deviennent des acteurs du « développement économique, technique, social et culturel »,en identifiant et caractérisant leurs différentes actions inscrites dans la durée, et éventuellement leur impactsur leur « territoire de proximité ».De fait, les interactions entre l’établissement et ses environnements vont s’inscrire dans une dynamiquelocale, dynamique qui va se développer sur un territoire de proximité, au sens de « constitution d’unmilieu » : « milieu de vie et milieu naturel, lieu d'identité, lieu de projet, de négociation et degouvernance » 1 .Les nouvelles approches économiques valorisent le territoire, à travers notamment le concept « d’espace –territoire », défini comme un point de rencontre entre les acteurs (lieu de marché et de régulation sociale):elles lui donnent un rôle plus important notamment en termes de développement économique,d’aménagement, de maîtrise dans la recomposition du tissu industriel ou agricole (la L.O.A. de 1999s’inspire de cette approche).Le territoire peut être un milieu « facilitateur de l’innovation », tant économique que technique,sociale ou culturelle, ce qui va induire une approche globale — systémique — du développement.En particulier, cette approche met en valeur la production d’externalités et l’importance des effets deproximité spatiale dans l’évolution des processus technologiques : création par exemple d’entités tellesque les technopôles et plus récemment le concept de plate-forme technologique 2 .Appliquée à l’établissement de formation, l’externalité — au sens de production extérieure àl’établissement — peut jouer un rôle (positif ou négatif) sur ses modes de fonctionnement et ses résultats,notamment en termes de bénéfices récoltés par la société — ici le territoire — qui dépassent le gain privéattendu par l’élève ou le stagiaire en matière de formation. L’établissement, dont la mission essentielle entermes de « production » est la formation des hommes, va contribuer à la production d’externalitéspositives, tant en termes de prestations de service, de transferts de technologie, de mise à disposition deressources humaines (enseignants - élèves) et de compétences au service du territoire.1J. Gauther, in "Initiative de l'enseignement agricole", Juin <strong>2002</strong>, Dossier "Formation et territoire : quels liens ?"2Il s’agit de mutualiser des équipements, de partager des ressources intellectuelles et des moyens au bénéfice du tissu de PME-PMIet de leur développement technologique, en leur offrant des travaux finalisés, des formations, des actions de prestation de serviceset des expertises, avec ou éventuellement sans intervention d’élèves ou d’étudiants ». MEN. Direction de la Technologie. Noteinterne - Décembre 1999.Dans l'enseignement agricole, cette réalité est ancienne comme le montre notamment les établissements spécialisés dans lesdomaines agroalimentaires : ENIL, brasserie, sucrerie, etc.20
Les plates-formes technologiquesUn dispositif pour la participation des lycéesau développement économique régionalLa loi sur l’innovation de juin 1999 a posé les bases d’un concept nouveau, celuides plates-formes technologiques (PFT). En particulier, le deuxième volet de cetteloi permet aux établissements de formation IUT et lycées technologiques etprofessionnels de réaliser des prestations de services pour les PME-PMI, avec unecontrepartie financière.Rôle et missions des PFT Un soutien au développement des entreprises : la mission des PFT est defavoriser l’innovation et le développement technologique en faisantbénéficier les PME-PMI et les TPE des moyens humains ettechnologiques des établissements de formation en leur donnant accès à uneexpertise fiable et abordable.L’offre de ces PFT s’articule autour :- d’interventions, d’études, de réalisations de projets (avec ou sansélèves),- de la mise à disposition de matériel,- de la veille et de la diffusion technologique, de la formation. Une réponse adaptée et ciblée : la PFT répond aux besoins des PME-PMIde confronter leurs activités et de progresser, tout en respectant descontraintes de coût, de délai et de qualité. La PFT répond à ces besoinsgrâce à ses compétences de niveau technologiques ; elle est aussi capabled’assurer les liens nécéssaires avec des laboratoires de recherche ou d’autresacteurs du transfert technologique. Un plus pour la formation : ces coopérations sont l’illustration d’uneconvergence d’intérêt, économique pour l’entreprise, pédagogique pourl’établissement de formation. De fait, les PFT participent audéveloppement de l’économie régionale.PME - PMI : petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industriesTPE : très petites entreprisesDans cet esprit, les lois sur l'enseignement agricole de 1984 et la loi d'orientation agricole de 1999 créentavec les missions assignées aux établissements « un espace facilitateur » de production d’externalitéspositives dans les établissements de formation tant en termes de développement agricole (expérimentation– transfert de technologie) que de développement et d’animation rurale ou d’insertion sociale etprofessionnelle.21
On peut par exemple citer en termes d’externalités : Les services rendus aux entreprises dans des domaines tels que les processus de fabrication,mise à disposition de matériels ou de logiciels performants, etc., Les services rendus aux particuliers dans les domaines de la santé, du sport, de la culture, etc., Les transferts de technologie, tels que la mise au point d’un prototype, une étude de marché,etc., L'expérimentation de variétés, de cultures, de pratiques, de processus, etc. Des actions de formations complémentaire s ou d’appui technique, Des actions de partenariat avec un territoire, etc.Les interactions entre l’établissement de formation et les acteurs de « son territoire » font de lui un acteurà part entière du développement. Encore faut-il que l’établissement se dote d’une stratégie active (projetd’établissement), soit « en prise » avec son territoire (appropriation des valeurs, capacité de diagnostic), etpuisse dégager dans le temps des moyens (humains et financiers) afin d’inscrire dans la durée ses actions dedéveloppement. Autrement dit, quelles sont les conditions favorables pour que ce triangle apparaisse ?III- Du développement agricole au développement territorial« Le mot développement est polysémique et doit être qualifié pour savoir de quoi on parle : les adjectifsqui lui sont le plus souvent adjoints sont "agricole", "rural", territorial", "culturel", "économique" et"social". On ajoute aujourd'hui la perspective plus large de développement durable. » 1A- Le développement agricoleA la vulgarisation agricole des années d’après-guerre (centres d’étude techniques agricoles, foyers de progrèsagricoles, etc.) succède, comme nous l’avons vu précédemment, la phase de développement agricole àcompter du milieu des années 60 : création du corps des ingénieurs d’agronomie (1965) et mise en placed’un fonds national pour le développement agricole géré par l’ANDA 2 en 1966. A un développementagricole porté par l'Etat, succède alors un développement soutenu par la profession.Par la suite les Etats généraux du développement agricole (1982) vont proposer une série d’orientationscorrespondant aux nouvelles attentes de l’agriculture (plus d'économie et plus d'autonomie). Elles resterontsans suite sur les plans législatif et réglementaire. Mais, sur le terrain, les exploitants et leurs conseillersvont travailler en s'inspirant des résolutions adoptées. Ce n’est qu’en 1999 que la LOAmarquera la volontédu législateur d’inscrire dans les textes le principe d’organisation du développement agricole avecimplicitement sa réforme qui sera mise en place en <strong>2002</strong>.L’objectif du développement agricole est alors clairement affiché : « contribuer à l’adaptation dans la duréede l’agriculture et de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques,économiques et sociales ».1Intervention d'Eric Marshall doyen de l'inspection de l'enseignement agricole auprès de l'ONEA. Séance plénière du jeudi 7 mars<strong>2002</strong>2c.f. encart page 2622
La réforme du développement agricoleElle fait suite à la loi de 1999 qui définit le développement agricole de manièrenouvelle en référence aux objectifs de développement durable, de qualité desproduits, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et demaintien de l’emploi en milieu rural. Décidée en 2000, cette réforme pérennisele partenariat entre pouvoirs publics et organisations agricoles.Tout d’abord, elle poursuit un objectif général de cohérence entre politique dedéveloppement et politique agricole en prenant en compte les articulationsterritoriales : Conseil Supérieur d’Orientation et ANDA au niveau national,conférence régionale pour le développement de l’agriculture et commissiondépartementale.« La rénovation du dispositif organisée autour de l’ANDA, composéeparitairement entre l’Etat et la profession, le renforcement de la liaison entre ledéveloppement, la recherche et la formation, doivent permettre de relancer ladynamique de développement en impliquant l’ensemble des acteurs sur des projetsnouveaux. Ainsi est réaffirmé le rôle que doit jouer dans les programmesrégionaux de développement agricole l’enseignement agricole en lien avec sonterritoire et ses différents partenaires ».Plus précisément cette réforme poursuit quatre grands objectifs :1- Assurer une meilleure transparence de l’utilisation des crédits et améliorerl’évaluation des actions.2- Renforcer le lien entre recherche publique et développement agricole.3- Privilégier les financements des projets.4- Redéfinir la participation de l’Etat dans l’orientation des actions et la gestionde crédits.1Source : Site Educagri.fr / Janvier <strong>2002</strong>Les domaines concernés par le développement agricole sont les suivants : Actions de recherche appliquée, Actions d’études, d’expérimentation, d’expertise, Actions de diffusion des connaissances par l’information, la démonstration, la formation et leconseil, Actions d’appui aux initiatives locales ou territoriales.L’ANDA est chargée d’élaborer et d’évaluer les programmes. Les chambres d’agriculture confortent leurspouvoirs en devenant les partenaires privilégiés du développement agricole. Cette réforme est aussil’occasion de conforter les établissements de l’enseignement agricole comme acteurs du développement.23
L’agence du développement agricole et ruralLe ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des AffairesRurales a annoncé le 23 décembre dernier la création de l’Agence dudéveloppement agricole et rural (ADAR) en remplacement de l’ANDA (Agencenationale pour le développement agricole) :« Dans le cadre de la loi de finances rectificative <strong>2002</strong>, l’Agence duDéveloppement Agricole et Rural (ADAR) vient d’être créée et succède àl’Association Nationale pour le Développement Agricole (ANDA).La création de l’ADAR, établissement public, repose sur quelques principes : Le maintien des solidarités entre territoires et filières, La participation des professionnels, La simplification et la modernisation du fonctionnement dudéveloppement agricole, La baisse du niveau global de prélèvement sur les agriculteurs, L’amélioration de l’évaluation des programmes. »Communiqué de presse — Site Internet MAAPARMais l’agriculture et les agriculteurs n’ont plus comme seule fonction de produire des biens alimentaires.A cette fonction économique va s’ajouter une fonction sociale et une fonction environnementale :préservation du patrimoine, aménagement du territoire et son occupation équilibrée. Dès lors, leurs projetsde développement rejoignent les objectifs collectifs de leurs territoires et de la société toute entière.Les missions dévolues à l’enseignement agricole telles qu’elles sont inscrites dans la LOA de 1999répondent à ces nouvelles attentes, tant en termes de développement territorial (CTE) 1 , que dedéveloppement durable.1Un nouveau dispositif a été créé : le CAD (contrat d’agriculture durable). Le CAD doit être l’aboutissement du projet d’unagriculteur dans les domaines économique, social et environnemental. Il sera constitué de deux volets : économique et social d’unepart, environnemental de l’autre. — Communication d’Hervé GAYMARD aux organisations professionnelles agricoles — 29novembre <strong>2002</strong>.24
B- Pour une approche du développement territorialLa définition la plus communément admise est celle d’un « processus de diversification et d’enrichissementdes activités économiques et sociales sur un territoire à partir de la mobilisation et de la coordinationde ses ressources et de ses énergies, et qui s’inscrit dans la durée » 1 .C’est un processus qui part du « bas », c'est-à-dire des acteurs présents sur le territoire par opposition auxprocessus venus « d’en haut » (de l’Etat ou d’organismes centraux) dans une logique d’aménagement duterritoire. C’est donc un processus « endogène » (issu du territoire lui-même) par opposition à desinitiatives « exogènes » résultant de décisions centrales ou extra-territoriales.Le « territoire de proximité » est la configuration spatiale « idéale » capable de procurer flexibilité etsouplesse, tout en réduisant les coûts de transaction, l’incertitude, en améliorant l’information, enfavorisant la diffusion des externalités positives et le jeu des économies d’échelle grâce à la coordinationdes acteurs et leur proximité (cf. chapitre précédent). De fait, le développement d'un territoire n'est pasunidimensionnel : il concerne le secteur de la production de biens (dans notre cas la production agricole),mais aussi les services aux particuliers et aux entreprises, les champs de la culture, du sport et des loisirs,la participation à la vie citoyenne. Autrement dit, le développement suppose des champs d'actions qui serenforcent les uns et les autres et créent ainsi une dynamique collective et une forte transversalité.Comme nous le verrons par la suite (données de l'enquête nationale), il n'y a pas « étanchéité » entre lesdifférentes actions de développement (agricole, territorial, durable, etc), mais au contraire une « certaineporosité », ce qui rend difficile toute tentative de typologie.En quoi un système de formation (ici un établissement de formation) peut-il contribuer au développementterritorial ?Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, c’est tout d’abord par les mécanismes de l’offrequ’un établissement de formation va concourir au développement de son territoire. Il s’agit de l’impact del’offre de l’établissement sur le tissu économique et social (entreprises, collectivités, associations…) et enparticulier des capacités de production, de prestations de services, de développement des formations. Entrouvant sur place une main-d’œuvre qualifiée répondant à leurs besoins, les employeurs auront par exempleune propension plus forte à s’installer sur ce territoire. De même, les entreprises, les exploitationsagricoles, les groupements de professionnels pourront envisager de nouer des liens de coopérationtechnologique : stages, échanges de personnel, programme de recherche, brevets, etc., avec lesétablissements de formation.Mais les mécanismes de la demande (logique du multiplicateur keynesien) peuvent aussi contribuer audéveloppement territorial. Ce sont les effets directs, par exemple les dépenses liées au développement ou àla construction de l’établissement dont vont bénéficier les entreprises locales, les dépenses deconsommation engendrées par les revenus supplémentaires correspondant aux emplois créés parl’établissement, ou bien les dépenses de fonctionnement liées au développement de l’établissement.Ce sont aussi les effets indirects, tels que la croissance de la population attirée par un environnementéducatif porteur, la consommation des élèves-étudiants et des familles et en dernier ressort les retombéesfiscales pour les collectivités locales.Délibérément notre approche « établissement acteur du développement » va se situer dans l’analyse et lesimpacts des mécanismes de l’offre de formation et de services, la formation jouant un rôle essentiel dansle développement territorial dans la mesure où elle améliore l’efficacité de la main-d’œuvre, et« l’établissement pôle de formation » étant un élément central du développement technologique tout encréant des effets externes (externalités).1Xavier Greffe — Décentraliser pour l’emploi — Economica — 198825
C- Le développement durableLe concept de développement durable est surtout lié à celui de l’environnement : « Nous n’héritons pasde la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants » (Antoine de Saint-Exupéry ) .De fait, les problèmes d’environnement et la conservation des ressources naturelles sont devenus prioritairesen matière de développement. Le développement durable implique qu’il n’y ait pas de contradiction entre laprotection de l’environnement et le développement et ce dans une conception intégrée, multidimensionnelle(globale) des besoins humains, de l’économie, des rapports sociaux et de l’action publique, ce qui luiconfère une forte dimension éthique. En 1999, les parlementaires ont inscrit, dans la loi d’orientationagricole, l’objectif du développement durable, objectif repris la même année par la loi d’orientation pourl’aménagement et le développement durable (Loi Voynet).Par exemple, quelles sont les composantes du développement durable à l’échelle des exploitationsagricoles ?On peut citer quatre types de relation qui vont construire cette approche du développement 1 . Tout d’abord c’est un développement viable, c'est-à-dire la mise en œuvre du lien économiquequi renvoie au marché et au processus de production et donc à des sources de revenus stables dans letemps. C’est un développement vivable qui permet un lien social fort avec les autres agriculteurs maisaussi avec l’ensemble des acteurs sociaux du territoire : « la vivabilité » traduit la qualité de vie del’exploitant et de sa famille. C’est ensuite un développement qui facilite la transmission : le lien intergénérationnel estl’un des fondements du système de l’agriculture familiale et renvoie aussi à l’idéal de solidarité entregénérations, qui est au cœur du sens donné au développement durable, et au-delà à l’image del’activité agricole que l’on veut transmettre et sa place dans la société rurale. Enfin, c’est un développement qui prend en compte la notion de renouvellement des ressourcesnaturelles sur le long terme, avec un lien écologique ou environnemental : c’est le conceptde « reproductibilité » environnementale. C'est-à-dire, la qualité écologique des pratiques agricoles,la prise en compte de la diversité des systèmes de production et des innovations techniques vont êtredes facteurs importants de la construction de ce lien écologique.Caractère reproductibleRessources naturellesLien économiqueLien écologiqueCaractère viableMarchésProcessus de productionDéveloppement durablede l’exploitation agricoleCaractère transmissibleFamillesLien socialLien intergénérationnelCaractère vivableActeurs territoriaux1Selon Etienne LANDAIS26
IV- Eléments de construction d'une problématiqueL'analyse des textes, et notamment les orientations données par les différentes lois, montre que depuis sonorigine l'enseignement agricole a eu une mission de développement local. Qu'en est-il aujourd'hui sur leterrain ?La décennie 90 est marquée par une importante production législative, qui a donné un nouvel essor àl'intercommunalité et a consolidé l'approche territoriale du développement avec l'émergence des pays. Leslois d'Orientation agricole et d'Orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoireconfortent une politique d'aménagement et de développement appuyée sur le triptyque : territoire - projet -contrat, avec le principe de développement durable.En ce qui concerne l'enseignement agricole, le rappel de ce cadre législatif illustre bien les tensions qu'ilpeut susciter entre les politiques nationales (le caractère injonctif de la loi) et la capacité d'initiative et lesmoyens donnés aux acteurs locaux, en particulier aux établissements de formation. En d'autres termes lesétablissements ont-ils la capacité de répondre aux missions assignées par la loi ?A la question de départ « L'établissement de formation, acteur du développement ? », les chapitresprécédents nous ont permis de préciser cette interrogation, de la contextualiser et de proposer un cadrethéorique :« La mise en œuvre du développement agricole voulu par la loi, ainsi que les actions autour du CTE et dudéveloppement durable font potentiellement des établissements de formation agricole des acteurs centrauxdu développement de leur territoire de proximité… »« … Il s'agit donc d'étudier si et à quelles conditions les établissements d'enseignement professionnel ettechnique agricole deviennent des acteurs du "développement économique, technique, social et culturel", enidentifiant et caractérisant leurs différentes actions inscrites dans la durée, et éventuellement leur impact surleur "territoire de proximité"… »« … Les interactions entre l'établissement de formation et les acteurs de "son territoire", font de lui unacteur à part entière du développement. Encore faut-il que l'établissement se dote d'une stratégie active(projet d'établissement), soit en prise sur son territoire (appropriation des valeurs) et puisse dégager dans letemps des moyens (humains et financiers) afin d'inscrire dans la durée ces actions de développement… ».Enfin « la polysémie du mot développement nous oblige à le qualifier, afin de donner du sens aux actionsmises en œuvre et à identifier le domaine d'impact sur le territoire : agricole, rural, territorial, culturel,économique, social, durable… ».Le contexte est avant tout juridico-organisationnel, mais aussi socio-économique : Juridique car, comme nous l'avons montré, il est fortement dépendant de l'environnement juridiquedu système de formation, que ce soient les lois de 1984, 1989 et 1999, que les lois de décentralisationet d'aménagement. Comment les établissements répondent et se situent par rapports aux objectifsfixés par la loi ?27
Le mode d'organisation de l'établissement nous paraît aussi important : organisationadministrative avec l'EPLEFPA et ses différentes composantes, organisation pédagogique(alternance), mise en réseau, etc… Par exemple, quelle place et quel rôle ont les exploitationsagricoles et les ateliers technologiques dans la mise en œuvre des actions de développement ?Quel est le degré de participation et d'implication des personnels de l'établissement dans la mise enœuvre des actions de développement ? Quels sont les freins, les blocages ? Et quels sont les typesde personnel qui participent à ces actions : chef d'établissement, enseignants et formateurs,ingénieurs et techniciens, responsables d'exploitations ou d'ateliers technologiques ?Quelle est l'implication ou la participation des élèves, apprentis et stagiaires dans les actions dedéveloppement ?Quel est le rôle des réseaux dans la conception, la conduite, la coordination des actions dedéveloppement ? Mais aussi le mode d'organisation du territoire : organisation d'un "pays", existence d'unsyndicat mixte… Les actions de développement sont mises en œuvre dans un territoire en liaisonavec différents environnements : politiques, économiques, sociaux… Quels sont les partenaires del'établissement lors de la mise en œuvre de ces actions ? Y a-t-il contractualisation ? Quel est le degréd'implication d'un établissement et de ses personnels dans le développement agricole et territorial ?Le modèle d'analyse que l'on va adopter par la suite fera référence à l'approche systémique (l'établissementen interaction avec ses environnements), mais aussi à l'approche organisationnelle (le type d'organisationfacilitateur ou non d'actions de développement) et aux théories économiques du développement, et plusparticulièrement les mécanismes de l'offre et la production d'externalités.En quoi un établissement de formation facilite les innovations, assure les coordinations de projet, lamédiation entre les acteurs, accompagne les apprentissages sur son territoire de proximité ?28
Deuxième partie — Les actions de développement des établissements :un premier bilanI- Recueil des informations : la méthodologie mise en oeuvreLes résultats présentés dans ce chapitre sont issus d’une enquête nationale exhaustive auprès desétablissements de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole publics et privés. Ilssont complétés, d’un point de vue qualitatif, par des enquêtes monographiques réalisées auprès de certainsétablissements de la région Midi-Pyrénées (1) .A- L’enquête nationale1- Mode opératoire857 établissements ont été interrogés : 215 établissements publics, 642 établissements privés, dont 231 àtemps plein et 411 à rythme approprié.Cette enquête a été réalisée par voie postale, de février à mai <strong>2002</strong>, par le biais d’un questionnairecomportant deux parties complémentaires.La première partie était constituée d’une fiche établissement permettant de rassembler quelqueséléments pouvant a priori expliquer l’activité des établissements en termes de développement :caractéristique de l’offre de formation, structures pédagogiques, ressources humaines, présence etorientations d’une exploitation agricole ou d’un atelier technologique, présidence du conseild’administration, participation de l’établissement à des réseaux, principaux partenaires de l’établissement.La seconde partie (fiches actions) avait pour objectif de caractériser les actions menées par lesétablissements depuis septembre 2000. Cette fiche, dont un exemplaire était à renseigner pour chaqueaction menée, comprenait des questions relatives : aux centres ou secteurs d’activité engagés, au domaineet type de l’action, à ses objectifs, aux missions associées, aux responsables et participants à l’action, àl’initiative de l’action, à l’intégration de publics d’apprenants, à l’inscription dans des projets et procédures(développement local, développement durable, multifonctionnalité, CTE), aux partenariats mis en placedans le cadre de l’action et à leur contractualisation.Ce questionnaire a été élaboré par les membres de l’ONEA et soumis aux responsables des différentesfamilles de l’enseignement agricole, ainsi qu’à la plupart des personnalités auditionnées par l’ONEA toutau long de son année de travail sur ce thème du développement. (c.f. questionnaire en annexe).Au sein des établissements les destinataires étaient à la fois les chefs d’établissements et les responsablesdes actions. Les questionnaires étaient accompagnés d’un vade-mecum à l’usage des personnels concernés.Par ailleurs, les établissements avaient à leur disposition les coordonnées des personnes gérant l’enquêteafin d’obtenir tout renseignement supplémentaire nécessaire.Initialement prévue pour la fin du mois d’avril, la clôture de l’enquête a été repoussée à la fin du mois demai pour tenir compte des contingences des établissements et permettre au plus grand nombre de participerà ce questionnement.Enquête nationale réalisée sous la direction de Jean-Louis HERMEN et Katia STRUPIEKOWSKI.Enquêtes monographiques réalisées par Christine GIRARD — Centre d’économie rurale de Midi-Pyrénées - CERMIP29
2- Structure des établissements répondantsA la date de clôture, 250 établissements ont répondu à l’enquête : 68 du public, 75 du privé à temps pleinet 107 du privé à rythme approprié.Le taux de réponse est relativement faible : 29,2% au total (31,6% pour le public ; 32,5% pour le tempsplein et 26% pour le rythme approprié). Néanmoins, une relance téléphonique auprès d’un échantillond’établissements non répondants a permis de vérifier la représentativité des résultats issus de l’enquête. (c.f.encart page suivante).Les statuts public et privé à temps plein sont relativement sur-représentés, parmi les établissementsrépondants, par rapport au niveau national. A l’inverse, le privé à rythme approprié est sous-représenté.Graphe 1 : Statut des établissements répondantsEnquêteNational27,2% 30,0%25,1% 27,0%42,8%48,0%publics privés à temps plein privés à rythme appropriéLa taille des établissements, en termes de nombre d’élèves en formation initiale, est globalement prochede la structure nationale. Au sein des statuts, les établissements de 401 à 500 élèves et de plus de 600 élèvessont sur-représentés, pour le public, dans la population répondante. Dans le privé, ce sont les petitsétablissements (jusqu’à 100 élèves) qui sont sur-représentés. Néanmoins, pour le privé à temps plein, lesgrands établissements (400 à 500 et plus de 600) sont aussi légèrement plus nombreux parmi lesrépondants qu’en moyenne. Pour l’ensemble des statuts, on note juste une présence un peu plus marquée(+3 points) des établissements de plus de 300 élèves parmi les répondants par rapport à la donnée nationale.En ce qui concerne les niveaux de formation proposés par les établissements répondants, on note que leprivé à rythme approprié est majoritairement représenté (en nombre d’établissements proposant desformations de ce niveau parmi les répondants) pour le niveau V, le public pour le niveau III et le niveauIV, de même que le privé à temps plein pour ce dernier niveau.Le public est logiquement le statut dans lequel l’apprentissage est le plus répandu. Il en est de même pourla formation continue. Ceci renvoie à des différenciations entre statuts, d’ordre constitutif, qui ne sontcertainement pas sans effet sur la façon d’aborder la problématique du développement, la quasi-majorité desétablissements publics étant organisés en EPL.Pour ce qui est des secteurs de formation, schématiquement, le public est tourné vers le grand secteur de laproduction (production, transformation, forêt aménagement), tandis que le privé à temps plein est davantageorienté vers les services (services aux personnes, services aux entreprises, commercialisation), le privé àrythme approprié se consacrant de manière équivalente à ces deux grands secteurs. Dans le détail, lessecteurs qui dominent dans les différents statuts sont la production, la forêt aménagement et lacommercialisation pour le public ; les services aux personnes, la production et la commercialisation pourle privé à temps plein ; la production et les services aux personnes pour le privé à rythme approprié.30
On peut penser, a priori, que ces facteurs structurent l’action des établissements dans le domaine dudéveloppement. Peuvent en effet se révéler déterminants, d’une part la structuration en EPL et la présenceou non d’un atelier technologique ou d’une exploitation agricole dans les établissements en termes denombre et d’ampleur d’actions, d’autre part les niveaux et les secteurs de formation en termes de type etdomaine d’actions.Les établissements non répondantsUne enquête téléphonique auprès d’un échantillon d’une centaine d’établissementsreprésentatifs de non-répondants a permis de vérifier l’absence de biais majeurs. Cesont les chefs d’établissement ou leurs adjoints qui ont été joints. La non réponse est le plus souvent motivée par la négligeance (un peuplus de la moitié des établissements), mais aussi par la surcharge de travailet le manque de moyen (30%) ; quelques-uns ne se sont pas sentis concernéspar l’étude (10%) ; un seul établissement a émis un refus de répondrecatégorique. L’absence d’actions de développement n’explique pas le fait de ne pasavoir répondu à l’enquête, les structures des populations de répondants et denon répondants étant à cet égard proches :31% des établissements de l’échantillon de répondants n’ont pas réaliséd’action contre 25% de l’échantillon des non-répondants.Les valeurs par famille d’enseignement sont les suivantes :Public : 10% des répondants contre 6% des non-répondantsPrivé à temps plein : 28% des répondants contre 22% des non-répondantsPrivé à rythme approprié : 46% des répondants contre 38% des nonrépondants Au contraire, compte tenu des actions déclarées par téléphone, ilsemble que les informations recueillies lors de l’enquête postale minorent lesactions de développement. En outre, certains établissements interrogés, quine menaient pas d’actions dans l’intervalle de temps de référence de l’enquête,ont indiqué mettre en place des projets d’actions à venir.31
B- Les monographiesAfin d’éclairer et d’approfondir les données recueillies au plan national, des enquêtes monographiques ontété réalisées, essentiellement en Midi-Pyrénées. Les interrogations ont été réalisées par le biais d’entretienssemi-directifs auprès de différents interlocuteurs : chefs d’établissement, proviseurs adjoints, chefsd’exploitation, enseignants responsables d’actions, etc. (c.f. grille d’entretien en annexe).L’échantillonnage des établissements retenus en Midi-Pyrénées a été défini en accord avec les responsablesrégionaux de l’enseignement agricole : SRFD de la DRAF Midi-Pyrénées, CNEAP (Midi-Pyrénées,Languedoc-Roussillon) et MFR (Midi-Pyrénées).Les établissements ont été choisis en fonction de facteurs favorisant ou freinant a priori les actions dedéveloppement :Les établissements périurbains de l’agglomération toulousaineEPLEFPA d’Auzeville (31)Lycée privé de la Cadène (31)MFR de Donneville (31)Les établissements en fort partenariat avec le territoire : communauté de communes,pays, etc.EPLEFPA de Figeac (46)MFR de Brens (81)Les établissements en partenariat interrégionalEPLEFPA de Vic-en-Bigorre (65)Lycée privé de Masseube (32)Les établissements présentant un pôle d’excellence techniqueEPLEFPA de Rodez (12)Lycée privé de La Raque (11)EPLEFPA d’Albi (81)Les établissements ayant une filière ServicesMFR de Peyregous (81)EPLEFPA d’Auch (32)Les établissements de petite taille et en difficultéMFR de Mane (31)Les entretiens menés auprès des différents acteurs ont de manière très forte mis en évidence l’intérêt,l’implication, voire la passion que suscite le développement au sein de l’enseignement agricole, avectoutefois une question préalable récurrente de la part des acteurs : « Quelle définition du mot développementpouvez-vous me donner ? »32
II- Les actions conduites : état des lieuxA- Etablissements et actions conduites : données quantitativesPrès de 70% des établissements répondants déclarent avoir mené au moins une action depuis septembre2000. C’est le cas pour 90% des établissements publics et 72% des établissements privés à temps plein.Ce sont seulement 54% des établissements privés à rythme approprié qui ont mené au moins une action.Graphe 2 : Part des établissements ayant conduitau moins une actiondepuis septembre 2000 par statut69,2%89,7%72,0%54,2%tous statutsconfonduspublicsprivés à tempspleinprivés à rythmeapproprié521 actions ont été recensées, soit une moyenne de 2 actions par établissement (3 par établissement menantau moins une action). Les établissements du public apparaissent produire davantage d’actions (4 actions enmoyenne, 252 au total) ; les établissements du privé à rythme approprié déclarent un nombre moyend’actions plus réduit (une action en moyenne, 125 au total), pour 2 actions en moyenne dans le privé àtemps plein (144 au total).Graphe 3 : Nombre d’actions menées par établissementPour les établissements menant au moins une actionPour tous les établissements répondants3,02,14,13,72,71,92,21,2tous statutsconfonduspublics privés TP privés RACeci nous permet d’évaluer un nombre d’actions de développement menées par les établissements del’enseignement secondaire agricole se situant dans une fourchette de 1700 à 2000 sur la période considérée.33
Si on examine la répartition des établissements, en fonction du nombre d’actions menées, on note que 2groupes dominent dans le public : celui des établissements ayant conduit 3 actions et celui desétablissements ayant mené 5 actions. Pour le privé à temps plein, ce sont les classes de 0, 1 ou 2 actionsqui prennent le dessus. Ceci est encore plus marqué dans le privé à rythme approprié. Au total, 31 % desétablissements n’ont déclaré aucune action et 36 % en déclarent 1 ou 2. Si l’on revient sur lesétablissements déclarant ne s’être engagés dans aucune action, on peut s’interroger sur les différentielsobservés : 10 % des établissements publics, 28 % du privé à temps plein et 46 % du privé à rythmeapproprié. Quels sont les facteurs explicatifs du volume d’activité des établissements en termes dedéveloppement ?50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%Graphe 4 : Répartition des établissements selon le nombre d'actions menéespar statut0 action1 action2 actions3 actions4 actions5 actions6 actions7 à 10 actionsPlus de 15 actionsPublic Privé TP Privé RA EnsembleDeux AFC, relatives au nombre d’actions, montrent bien que les établissements s’ordonnent de façon claireen fonction de deux variables : le statut d’enseignement (public, privé à temps plein et privé à rythmeapproprié) et le niveau de l’offre de formation (VI et Vbis et V uniquement, niveau IV et moins, présencedu niveau III).Ainsi, la présence de formations de niveau III dans les établissements s’avère structurante quant au nombred’actions menées.Graphe 5 : AFC Nombre d’actions / Niveaux de formation proposésMax V : Etablissements proposant desformations de niveau inférieur ou égal à VMax IV : Etablissements proposant desformations de niveau inférieur ou égal à IVNiv III : Etablissements proposant desformations de niveau III, entre autres niveaux56Niv III3Max V042Max IV134
De manière relative, les statuts privés correspondent à un nombre faible d’actions, tandis que le public estlié à un nombre d’actions important.Graphe 6 : AFC Nombre d’actions / Statuts d’enseignementPUB : Etablissements publicsPTP : Etablissements privés à temps pleinPRA : Etablissements privés à rythme approprié4PTP20PRA13PUB56En revanche, la taille de l’établissement et les secteurs de formation proposés ne sont pas des variablesexplicatives quant au nombre d’actions.Résultats de l’enquête et statuts d’enseignementN.B. :Tout au long de ce chapitre, nous ferons référence, par commodité, aux statutsd’enseignement. Il convient de ne pas perdre de vue un fait sur lequel l’ONEAinsistait déjà dans ses précédentes études : les établissements des différents statutsd’enseignement ont des caractéristiques très fortement discriminantes (taille, ofre deformation par niveau, secteurs, etc.). Parler, par exemple, de très petitsétablissements publics ou de très grandes maisons familiales n’a pas de sens auniveau d’une enquête nationale. Ainsi, faire référence aux différents statuts équivautà faire référence à des séries de caractéristiques particulières des établissements etvice versa. En ce sens, si les statuts d’enseignement se distinguent, ils ne sont passtrictement comparables sans prise en compte systématique de leurs caractéristiquesrespectives.Le lecteur doit donc se garder de tout jugement au strict point de vue des statutsd’enseignement.35
B- Caractérisation des établissements ne menant pas d’actionSur les 250 établissements considérés, 77 n’ont pas mené d’actions ; ce qui représente 31% de l’échantillonétudié. Une première constatation est la forte proportion d’établissements privés : 70 sur 77.Parmi les établissements privés qui ne mènent aucune action, ce sont ceux relevant du rythme appropriéqui sont nettement majoritaires (49 sur 70, soit 70%), alors qu’ils représentent 59% des établissementsprivés répondants.Au total, selon leurs déclarations, ne sont engagés dans aucune action durant la période considérée parl’enquête 1 :10% des établissements publics,28% des établissements privés à temps plein,46% des établissements privés à rythme approprié.On peut rapprocher ces indicateurs du niveau d’absence des ingénieurs dans les établissements. En effet, ontdéclaré ne pas compter d’ingénieurs dans leur personnel :15% des établissements publics,35% des établissements privés à temps plein,71% des établissements privés à rythme approprié.Que ce soient les observations faites lors du questionnement national oulors des entretiens (dans le cadre des monographies) et des entretienstéléphoniques, il se dégage une « ligne de force » en l’absence d’actionsde développement : un regret... des tentatives d’explication... unerecherche de projets...Un directeur de LPA : « Il n’y a pas d’action de développement menée dans notreétablissement, du moins officiellement. Du développement nous en faisons chaquejour, mais rien n’est concrétisé par écrit... Faute de disponibilité de personnel,manque d’ingénieur 1 , etc. »Un directeur d’EPL : « En l’absence d’ingénieurs et de proviseur adjoint, la prioritéde l’établissement porte sur la formation et l’insertion professionnelle de nosjeunes... Cependant, l’établissement est régulièrement partenaire lors desmanifestations locales... »(...)1Souligné dans le texte.1Ceci doit toutefois être nuancé par la difficulté que nous évoquions à partager une définition commune du développement, enparticulier hors du champ du strict développement agricole. Rien n’exclut en effet que certaines actions du champ territorial n’aientpas été déclarées. En ce sens notre enquête reflète davantage l’activité « perçue » comme de l’ordre du développement par lesétablissements et par là-même la notion de développement qui simpose à eux à travers les différentes sources et directives auxquellesils ont accès.36
Concernant le niveau des formations dispensées au sein des établissements qui ne mènent pas d’actions,seulement 12 établissements sur 77 (15%) proposent des formations de niveau III.Par contre, la taille des établissements, en termes de nombre d’apprenants, ne semble pas être une variableexplicative de l’absence d’action.(...)Un directeur de MFR : « Notre établissement dispense de la formation de niveau V ;nous assistons à des réunions mais nous collaborons peu avec les organismesprofessionnels dans le cadre du développement. De plus, les programmes sont tropchargés pour nous permettre de libérer du temps pour agir dans ce sens... C’estregrettable, mais aussi bien du côté des partenaires que du nôtre les moyensn’existent pas. Nous allons à l’essentiel : la formation de nos élèves, la préparationà l’examen, l’éducation. »Un directeur de lycée privé « Etant dans les secteurs «services», nous n’avons pasd’actions de développement, mais plutôt des actions ponctuelles (PUS) auprèsd’organismes caritatifs... Les problèmes rencontrés sont surtout le manque detemps, car les élèves sont majoritairement demi-pensionnaires (plus de 80%) donctributaires des transports scolaires. »(...)La structuration de l’établissement, notamment la présence d’une exploitation ou d’un ateliertechnologique, s’avère aussi déterminante, tout au moins « facilitatrice », en termes de développementcomportant un volet agricole.(...)Un directeur de lycée privé : « Le fait de ne pas avoir d’exploitation est unhandicap... Il n’y a pas dans l’établissement d’action étiquetée « développement »,mais nous travaillons en partenariat souvent « de fait » avec le tissu local.»Mais certains établissements, qui ne déclarent pas d’action, sont dans unprocessus de constrution et de réalisation d’actions de développement :Un directeur d’EPL : « Depuis la rentrée 1999, l’établissement est doté d’un ateliertechnologique orienté vers les travaux paysagers et l’horticulture. Les deuxpremières années ont permis la mise en route et le rôdage. Cet outil, servant enpremier lieu pour la formation pratique de nos apprenants, doit au fil du temps servirà la mise en place d’actions de développement et d’expérimentation...»Un directeur de MFR : « Les actions de développement local conduites par notreétablissement ne sont encore, à ce jour, qu’en phase d’étude et de prospective... Lesaxes de développement se situeraient dans le secteur du tourisme, del’environnement et du patrimoine naturel. »37
C- Champs des actions et établissementsN.B. : Se reporter à la page suivante concernant des éléments de définition des champs d’actionSont relativement majoritaires les actions de développement territorial 1 (36% des actions) et les actions dedéveloppement dit « mixte » — touchant à la fois à l’agricole et au territorial — (35%). Les actions dedéveloppement agricole au sens strict sont relativement moins nombreuses (29%). Ce qui ne signifie pasque l’agricole est minoritaire puisqu’il apparaît dans le développement mixte. En effet, par union des sousensembles,71% des actions touchent (exclusivement ou pas) au développement territorial et 64% de prèsou de loin au développement agricole. Ceci illustre plutôt la « territorialisation » forte du développementagricole, dans le sens des orientations évoquées dans le premier chapitre.Graphe 7 : Répartition des actions selon leur champpar statut d’enseignementDéveloppement agricole seulDéveloppement territorial seulDéveloppement mixte29,0%36,3%34,7%41,7%14,3%44,0%21,5%57,6% 56,0%20,8%12,0%32,0%Ensemble Public Privé TP Privé RAOn repère dès à présent des différenciations entre statuts : le public est davantage tourné vers ledéveloppement agricole (42% de leurs actions) et le développement mixte (44%) ; le privé à temps pleinet le privé à rythme approprié vers le développement territorial (respectivement 58% et 56%). Par ailleurs,pour les statuts privés, le développement agricole est plus présent dans le temps plein, et le développementmixte dans le rythme approprié. Il semblerait que l’absence d’exploitation constitue une lacune de supportpour un développement agricole « en interne » ; ce qui n’empêche pas un développement agricole « enexterne », associé au développement territorial, qui est facilité par le partenariat pédagogique lié àl’alternance.Trois AFC 2 permettent de mettre en relation champs d’action et caractéristiques des établissements.1L’unité de mesure est le nombre d’actions.2Voir graphes de ces AFC pages suivantes.38
Champs et domaines d’actions : éléments de définitionDans le cadre de la fiche-action renseignée par les établissement pour chaque actionmenée, les responsables ont été interrogés sur la nature des actions. (c.f.questionnaire en annexe - question F5).Ils étaient notamment invités à préciser si l’action considérée relevait : du développement agricole du développement territorial à la fois du développement agricole et du développement territorial.Nous parlons de « champ d’action » concernant le choix fait par lesinterlocuteurs quant à cette classification. Nous avons ainsi, relativement aux casde figure possibles précédents, trois champs d’action : celui du développement agricole celui du développement territorial celui du développement dit « mixte ».Ce dernier champ se situe à l’intersection de développement agricole et dudéveloppement territorial stricto sensu. Il s’est formé par la déclaration spontanéedes responsables d’actions. Cette catégorie s’est construire sur la base desrenseignements donnés par les établissements, les actions étant reliées à la fois àl’agriculture et au territoire. Pour ne citer que quelques exemples, la mise en placede CTE ou la participation à la conception d’un Pays qui inclut un volet agricultureentrent dans le cadre du développement «mixte».Les domaines d’actions précisent, eux, les aspects considérés au sein des champsd’action. Ainsi, étaient proposés comme domaines les rubriques qui suivent.Concernant le développement agricole : « Produit, patrimoine génétique » « Processus de production, technologique, organisationnel, qualité » « Commercialisation » « Gestion de l’entreprise » « Autre », à préciser.Concernant le développement territorial : « Espaces naturels, patrimoines naturels, aménagement» « Environnement, écologie» « Tourisme, image du territoire » « Culture » « Autre », à préciser.Nous verrons, pour ce qui est du développement territorial, que deux aspectssupplémentaires forts sont ressortis des déclarations des responsables : celui del'insertion et de l’emploi et celui du social.Les réponses à ces domaines d’actions n’étaient bien évidemment pas exclusives.Dans le cadre du développement mixte, au moins un domaine de chaque groupe(développement agricole, développement territorial) était signifié.39
Au niveau du statut d’enseignement, il apparaît clairement que les actions relevant du développementagricole seul et à la fois du développement agricole et du développement territorial sont liées auxétablissements publics. A l’opposé, des proximités sont dégagées entre actions relevant du développementterritorial et statuts privés, à temps plein ou bien à rythme approprié.Graphe 8 : AFC Champs d’action / Statuts d’enseignementD. mixtePUBD. agricolePRAD. territorialPTPPUB : Etablissements publicsPTP : Etablissements privés à temps pleinPRA : Etablissements privés à rythme appropriéD. agricole : Développement agricoleD. territorial : Développement territorialD. mixte : Développement mixteUne deuxième AFC confirme que les actions relevant du développement agricole ou d’un champ mixtetrouvent un terrain plutôt favorable dans les établissements qui proposent une offre de formation qui vajusqu’au niveau III (BTSA). Par contre, on observe une forte proximité entre les actions de développementterritorial et une offre de formation de niveau inférieur (VI, Vbis, V et au mieux IV) proposée par lesétablissements.Graphe 9 : AFC Champs d’action / Niveaux de formation proposésD. agricoleMax VNiv.IIID. territorialD. mixte Max IV40Max V : Etablissements proposant des formations deniveau inférieur ou égal à VMax IV : Etablissements proposant des formationsde niveau inférieur ou égal à IVNiv III : Etablissements proposant des formations deniveau III, entre autres niveauxD. agricole : Développement agricoleD. territorial : Développement territorialD. mixte : Développement mixte
Enfin, et cela corrobore les observations précédentes, les actions territoriales sont liées aux établissementsproposant une offre de formation tertiaire, alors que l’on observe une forte proximité entre offre deformation dans le secteur de la production et développement agricole ou mixte ; ce qui est somme toutelogique.Graphe 10 : AFC Champs d’action / Secteurs de formation proposésD. agricoleProd D. territorial Serv.Sect. mixteD. mixteProd : Offre de formation dans le secteur de la production(Production agricole, Transformation, Forêt-aménagement)Serv. : Offre de formation dans le secteur des services(Services aux personnes, aux entreprises, Commercialisation)Sect. mixte. : Offre de formation à la fois dans lesecteur de la production et dans le secteur des servicesD. agricole : Développement agricoleD. territorial : Développement territorialD. mixte : Développement mixteD- Les domaines d’actionsLa plupart (56%) des actions relèvent de 2 domaines et plus 1 .Les domaines les plus cités, que les actions s’y rapportent de manière exclusive ou en association avecd’autres domaines, sont : les processus de production (47% des actions y sont liées), l’environnement, l’écologie (27%) le tourisme, l’image du territoire (27%), les espaces naturels, le patrimoine naturel, l’aménagement (22%).A posteriori, sont aussi apparus deux secteurs importants : le social avec notamment l’aide aux personnes (8,5%), l’emploi (insertion, création d’emplois) (10%).Une lecture transversale fait apparaître deux lignes de force qui donne le sens de ces actions : les actions liées au développement durable, les actions oeuvrant à la valorisation des territoires, de leurs produits, de leurs métiers.1Lorsqu’une action touche à plus d’un domaine, elle est considérée au titre de chacun des domaines cités par l’établissementconcerné.41
Graphe 11 : Domaines impliqués dans les actions(Toutes actions et tous établissements confondus)Part des actions relevant exclusivement ou entre autres du domaine...Produit15,0%Processus prod.47,1%CommercialisationGestion entrepriseAutre agricole3,8%7,9%11,9%Espaces, patrimoine naturels, amgtEnviron., écologieTourisme, image territoire22,1%27,3%26,5%CultureSocialEmploiAutre territorial12,7%8,5%10,0%5,4%Guide de lecture : 47,1% des actions recensées font référence aux processus de production, entre autres domaines ouexclusivement.Dans les établissements publics, les domaines des processus de production (71,7%) et, dans un degrémoindre, celui de l’environnement et de l’écologie (34,7%) sont sur-représentés. Par contre, le social(0,8%), le tourisme et l’image du territoire (21,5%) et, dans une moindre mesure, l’emploi (5,6%) sontsous-représentés.Graphe 12 : Domaines impliqués dans les actions des établissements publics(et comparaison à l’ensemble des établissements)ProduitProcessus prod.CommercialisationGestion entrepriseAutre agricoleEspaces, patrimoine naturels, amgtEnviron., écologieTourisme, image territoireCultureSocialEmploiAutre territorial18,3%12,0%10,0%4,4%21,1%21,5%13,5%0,8%5,6%4,0%34,7%Tous statutsPublic71,7%42
A l’inverse, dans les établissements privés (à temps plein et à rythme approprié), ce sont les domaines dusocial et du tourisme, image du territoire qui sont nettement sur-représentés.S’y ajoutent le domaine de la culture pour les établissements privés à temps plein et ceux de lacommercialisation agricole, des espaces naturels, patrimoines naturels, aménagement et surtout de l’emploipour les établissements privés à rythme approprié.Deux domaines sont nettement sous-représentés : les processus de production et l’environnement, écologie.Graphe 13 : Domaines impliqués dans les actions des établissements privés à temps plein(et comparaison à l’ensemble des établissements)ProduitProcessus prod.CommercialisationGestion entrepriseAutre agricoleEspaces, patrimoine naturels, amgtEnviron., écologieTourisme, image territoireCultureSocialEmploiAutre territorial13,9%27,8%9,7%6,3%2,8%Tous statutsPrivé à temps plein22,2%18,1%30,6%13,9%16,0%7,6%6,9%Graphe 14 : Domaines impliqués dans les actions des établissements privés à rythme approprié(et comparaison à l’ensemble des établissements)ProduitProcessus prod.CommercialisationGestion entrepriseAutre agricoleEspaces, patrimoine naturels, amgtEnviron., écologieTourisme, image territoireCultureSocialEmploiAutre territorial9,6%20,0%14,4%5,6%4,0%24,0%23,2%9,6%15,2%21,6%6,4%Tous statutsPrivé à rythme approprié32,0%43
E- Les types d’action : une relation forte avec le champ de l’actionLes champs d’actions s’entendent ici soit de manière exclusive, soit associés entre eux : Développement agricole seul ou associé au développement territorial, Développement territorial seul ou associé au développement agricole.Chaque action qui fait référence à plus d’un type d’action est considérée au titre de chacun des types signifiéspar le responsable ayant répondu à l’enquête.En ce qui concerne le champ du développement agricole, champ où les établissements publics sontnettement plus actifs, deux types d’actions dominent largement : la recherche et l’expérimentation (31%des actions recencées) et la vulgarisation (26%).Selon les statuts d’enseignement, ces deux types d’actions dans le champ du développement agricole sontnettement discriminants. La recherche et l’expérimentation : 51% des actions du public font référence à ce volet, pour 16%dans le privé à temps plein et 6,5% dans le privé à rythme approprié. La vulgarisation : 34% des actions du public y touchent pour 16% dans le privé à temps plein et21% dans le privé à rythme approprié.Expérimentation et développementL’exemple de l’enseignement agricole public lorrainà travers le réseau des exploitations agricoles des EPLEFPA En Lorraine, chacun des cinq EPLEFPA dispose d’une exploitationagricole ; si chacune d’elles est une exploitation de polyculture-élevage, ellesaffichent toutes cependant des particularités en matière d’expérimentation et dedéveloppement. Chaque exploitation, au-delà de leurs quatre missions, la production et la commercialisation de produits et/ou de services, la pédagogie, comme outil à la disposition de l’EPL, le développement agricole et l’expérimentation, la coopération internationale et l’insertion,est engagée sur une dynamique globale vers un système durable. Des domaines d’intervention variés :Ferme de la Marchande (LEGTA de Château-Salins)« Une exploitation agricole fortement impliquée dans son territoire pourconstruire l’agriculture de demain »Laboratoire de recherche pour l’agriculture durable : former «l’écocitoyen» dedemain, construire un système durable, participer à l’animation rurale et audéveloppement local, consolider et ouvrir des partenariats forts et pluriels.Ferme de Braquemont (EPLEFPA des Vosges)« Montagnes et plaines, pour une durabilité plurielle »Des actions expérimentales : vaches laitières (traitement des eaux blanches, parexemple), ovins (parasitisme...), montagne (évolution du paysage, etc.)Un contrat territorial d’exploitation.Le développement d’un partenariat avec un céréalier voisin.(...)44
(...)Ferme des Ménils (EPLEFPA de Metz)« L’anticipation au service de la profession »Des actions expérimentales dans le domaine des productions végétales(amélioration des itinéraires, par exemple), des productions animales (le robot detraite...), de l’environnement (qualité des eaux...)Ferme de Popey (EPLEFPA de la Meuse)« Quatre missions : la production agricole, la formation, les expérimentations,la coopération »Réduction des concentrés, valorisation des fourrages produits sur l’exploitation,etc.Ferme de Pixerecourt (EPLEA de Meurthe et Moselle)« Une exploitation de type polyculture-élevage en zone périurbaine »Une implication environnementale forte de par sa situation géographique (jachère« faune sauvage », par exemple), mais aussi sociale (réseau « fermes dedécouverte »), des expérimentations (amélioration génétique en race pure d’untroupeau ovin à laine Mérinos).Un seul type d’actions est nettement discriminant dans le champ du développement territorial, celui del’animation (44% des actions tous statuts confondus). C’est aussi le cas, mais dans une moindre mesure,pour l’aide à la gestion de projet (14% de l’ensemble des actions) et l’audit, conseil, diagnostic (14%). L’animation concerne 59% des actions des établissements du privé à rythme approprié, pour 57%des actions du privé à temps plein et 29% des actions du public. L’aide à la gestion de projet territorial est un type d’actions que l’on recense surtout dans lesétablissement à rythme approprié (20% de leurs actions) et, dans une moindre mesure, dans leprivé à temps plein (17%) ; il est relativement peu important dans le public (9,5%). L’audit, conseil, diagnostic est relativement plus important dans les actions mises en oeuvre parles établissements privés à rythme approprié (20%) ; il est faible dans les deux autres systèmes.Tableau 1 : Types d’actions selon le statut d’enseignementDéveloppementagricole seulou en associationDéveloppementterritorial seulou en associationRecherche, expérimentationInnovationTransfert de technologieAudit, conseil, diagnosticVulgarisationAide à la gestion de projetAutre type agricoleRecherche, expérimentationInnovationTransfert de technologieAudit, conseil, diagnosticAnimationAide à la gestion de projetAutre type territorialTousstatutsPublic Privé TP Privé RA30,9% 51,2% 16,2% 6,5%10,6% 16,3% 6,3% 4,0%8,5% 13,9% 2,8% 4,0%13,1% 13,5% 9,9% 16,1%25,9% 33,7% 16,2% 21,0%9,7% 10,3% 7,7% 10,5%4,1% 2,8% 5,6% 4,8%11,4% 18,7% 3,5% 5,6%6,2% 9,1% 4,2% 2,4%4,1% 6,0% 2,1% 2,4%13,7% 12,7% 9,9% 20,2%44,0% 29,4% 57,0% 58,9%14,1% 9,5% 16,9% 20,2%4,1% 2,4% 6,3% 4,8%45
F- Les actions conduites, une caractérisation à quatre dimensions : statutd’enseignement, champ, domaine, type de l’actionA l’issue de ce chapitre permettant de caractériser les actions de développement menées par les différentsétablissements de l’enseignement agricole, on peut dresser un premier constat descriptif, sans préjuger d’uneanalyse ultérieure, selon les statuts d’enseignement.Les établissements publics 4 actions de développement en moyenne par établissement,soit 252 actions sur 521 recensées. Les actions se situent surtout dans le champ du développementagricole seul (105) ou associé au développement territorial (111). Dans ce champ, le domaine dominant est celui des processus deproduction, technologique, organisationnel, qualité (71%). Les types dominants de ces actions sont la recherche etl’expérimentation et la vulgarisation.Les établissements privés à temps plein 2 actions de développement en moyenne par établissement,soit 144 actions sur 521 recensées. Les actions se situent surtout dans le champ du développementterritorial seul (83) ou, à un degré moindre, associé au développementagricole (30). Dans ce champ du développement territorial, les domainesdominants sont ceux du tourisme, image du territoire (31%), avecdans une moindre mesure ceux des espaces naturels, patrimoinenaturel, aménagement (22%), d’environnement, écologie (18%),mais aussi du social (16%). Parmi les types d’actions dominants, un seul émerge nettement :l’animation (57%), suivi de l’aide à la gestion de projet (17%).Les établissements privés à rythme approprié 1 action de développement en moyenne par établissement,soit 125 actions sur 521 recensées. Les actions se situent surtout dans le champ du développementterritorial seul (70) ou, à un degré moindre, associé au développementagricole (40). Plusieurs domaines sont impliqués dans ces actions : tourisme,image du territoire (32%), espaces naturels, patrimoine naturel,aménagement (24%), environnement, écologie (23%), social (15%),mais il est intéressant de noter que, contrairement aux autres statuts,un domaine a une part relativement importante, celui de l’emploi(21%). Parmi les types d’actions, on remarque l’animation (59%), maisaussi l’aide à la gestion de projet (20%) et l’audit, conseil, diagnostic(20%) en développement territorial.46
III- Les processus de conception et de mise en oeuvre des actions : facteurs internes,facteurs externesLes actions de développement s’inscrivent dans la durée : la plupart sont pluriannuelles (65%), c’est-à-direqu’elles se déroulent sur plusieurs années ou qu’elles se répètent tous les ans si leur manifestation estponctuelle.Par exemple, dans le domaine du développement culturel, le lycée de Vic-en-Bigorre (65) organise depuis8 ans des journées « Champs et contre champs » consacrées aux courts-métrages. Cette action dedéveloppement est réalisée dans le cadre de la contractualisation DRAC / DRAF de Midi-Pyrénées et enpartenariat avec le lycée de l’Education nationale de Vic.La pluriannualité concerne surtout les actions de développement agricole (71% des actions de ce champ) etle développement mixte (69%). Les actions de développement territorial seul sont un peu plus souvent decourte durée et ponctuelle, mais la majorité d’entre elles demeurent pluriannuelles (56%).Un directeur d’EPL : « Une des clefs de l’impact des actions de développement surla qualité de notre action auprès des jeunes et aussi du territoire est la capacité d’uneéquipe à se mobiliser sur la durée autour des projets initiés. Dans tout processus dedéveloppement le plus délicat n’est pas le lancement de l’action, mais bien sadurabilité... »A- Des actions souvent mises en place à l’initiative des établissements...avec l’appui des professionnelsTous statuts et tous champs d’actions confondus, il s’avère que dans plus de la moitié des cas (52%)l’initiative de l’établissement est prépondérante, soit de manière exclusive, soit en association avec despartenaires.Ceci est plus marqué dans les champs du développement territorial (60%) et du développement mixte (59%)que du développement agricole (34%).En développement territorial, après l’établissement, ce sont les demandes d’élus qui initient les actions. Enrevanche, en développement agricole, c’est très majoritairement à la demande des professionnels (81%) queles actions sont mises en oeuvre.Quelques exemples issus des entretiens menés dans les établissements de Midi-Pyrénées permettentd’illustrer ces tendances.Un exemple d’action de développement agricole à l’initiative del’établissement avec l’appui des acteurs institutionnels et professionnels :La plate-forme technologique Viandes et salaisons du lycée public de RodezAu sein de la deuxième région française pour la production de salaisons sèches,aucun organisme dans le département de l’Aveyron ne dispose de la taille et descompétences nécessaires pour accompagner à lui seul le développement des filièresde transformation en produits carnés.(...)47
(...)Au début des années 90, le lycée « La Roque » crée un hall technologique, avecl’appui du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, afin de proposer unoutil de proximité aux agriculteurs en matière de salaisons. Toutefois, jusqu’aumilieu des années 90, ce hall a des « difficultés » à se positionner comme centre decompétences, notamment en termes de formation continue : forte concurrence avecle CRITT agroalimentaire de la chambre de commerce.Devant cette situation « conflictuelle », c’est le directeur départemental del’agriculture qui a impulsé le rapprochement entre : le centre technique de la viande, l’antenne du CRITT agroalimentaire del’Aveyron représenté par les CCI de Rodez et de Millau, le centre technique de la conservation des produits agricoles (Ministère del’Agriculture) ; il prend la direction du CRITT agroalimentaire et donne ainsiune stratégie nationale à la filière viande et affirme la stratégie despécialisation de Rodez le hall technologique du lycée de La Roque de Rodez, qui offre une palette deservices aux entreprises et conforte ses bases en termes de ressourceshumaines : embauche via le CFPPA d’un ingénieur d’études qui sera lapersonne ressource en expertise.En janvier 2001, la plate-forme technologique (PFT) « centre de ressources viandeset salaisons » est officialisée. Une convention de contractualisation reconnaît aucentre de ressources du lycée « ses stratégies, son espace de formation national, sespartenaires ». L’action de développement agricole « création PFT Viandes etsalaisons », avec pour domaine d’action « les processus de production,technologique, organisationnel, qualité » et des actions de type « recherche,expérimentation », « transfert de technologie », n’a pu se mettre en place que grâceà la mutualisation de tous les acteurs, satisfaisant ainsi les professionnels des IAA.La PFT permet ainsi de développer les volets suivants : l’axe expérimentation : analyses, tests de matières premières, mise au pointde nouveaux produits, appui technique... l’axe formation : apprentissage gestuel, observation des démarchesexpérimentales, développement de l’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées(création d’une licence professionnelle) l’axe développement économique : les collectivités territoriales font appel àRodez-La Roque en tant qu’experts.L’atelier canard expérimentation du lycée public de Vic-en-Bigorre :une action de développement agricole à l’initiative de la professionL’idée de départ vient du groupe Euralis (coopérative agricole) qui avait racheté lebrevet d’un petit laboratoire privé local. Ce brevet portait sur la digestion des lisierspar des champignons filamenteux.(...)48
(...)En tant que professionnel de la filière de production du porc et du canard, Euralis estconfronté aux problèmes de pollution de l’environnement et subit de fortescritiques. Le lycée de Vic qui possédait un atelier de gavage a ainsi été contacté parcette coopérative agricole afin de monter une station expérimentale de traitementbiologique d’effluents d’ateliers de gavage. Cette station d’expérimentation, portantsur les processus de production, a été réalisée en partenariat avec la chambred’agriculture des Hautes-Pyrénées et l’ADEME 1 .1 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.Le projet d’établissement élément moteur de la constructionde la plate-forme technologique « eaux, boues, déchets »du lycée d’Albi-FonlabourCette action de développement mixte (agricole et territorial) est née indirectementd’une crise relativement longue (1990-1995) au sein de l’EPLd’Albi-Fonlabour :déficit de management, déficit d’image, baisse des effectifs, relations distendues avecles milieux professionnels, exploitation agricole non viable...L’arrivée d’un nouveau proviseur va permettre un repositionnement de l’EPLautourd’un projet d’établissement mobilisateur : « Pour le Tarn vert ». Il s’agit de mettreen oeuvre les procédés « garants de la qualité de l’espace rural ». Ainsi, la stratégied’Albi-Fonlabour va s’articuler autour de trois pôles de formation (production,aménagement et filière eau), avec l’émergence d’un pôle d’excellence sur l’eau et lesdéchets prenant appui sur le BTSAGEMEAU. En outre, cette stratégie va s’appuyersur l’opportunité de prendre en fermage quatre hectares qui se libéraient en borduredu Tarn, et de restaurer ainsi la viabilité de l’exploitation (production de céréales).La filière eau s’appuie désormais sur une exploitation de quatre hectares irrigableset bénéficie d’une installation d’irrigation moderne. Parallèlement, les entreprisesdu secteur des métiers de l’eau font état d’un manque de compétences des élèves enautomatismes, ainsi qu’en gestion des boues des stations d’épuration. En partenariatavec le lycée d’Albi (EN), deux certificats de spécialisation post-BTS sont proposés,puis une licence professionnelle « Eaux, boues, déchets », avec l’Universitéscientifique de Toulouse II (1999).En 2000, un groupement d’intérêt scientifique est créé sur l’axe « eaux et déchets » :pollutions ponctuelles en espace rural. Ce GIS, outre les établissementsd’enseignement supérieur concernés par cet axe de recherche, regroupe les deuxlycées précédemment cités (Enseignement agricole, Education nationale), ainsi quele CRITT (Chimie, bio-industries, génies des procédés) et les partenairesinstitutionnels.(...)49
(...)Ainsi, l’EPL d’Albi-Fonlabour via son CFPPA est une interface entre le GIS(projets de recherche), les partenaires contractuels (CRITT) et institutionnels et les« clients » des filières viandes, viticole, textile, lait, ainsi que les demandeursgestionnaires de l’eau de l’intercommunalité. La suite logique de ce pilotaged’action de développement est l’accord, au printemps <strong>2002</strong>, pour la mise en placed’une plate-forme technologique au sein de l’EPL, qui va permettre, en partenariatavec le GIS et les CRITT de répondre aux objectifs de ce pôle de compétences :1Recherche de technologies applicables à la gestion globale des effluents enespace rural dispersé2Evaluation de l’impact environnemental des rejets et valorisation3Structuration d’une réponse locale et régionale aux problèmes posés : diffusion des connaissances transfert de technologies.B- Les facteurs internes de l’établissement « facilitateurs » de la mise en oeuvre desactions de développement1- Les apprenants mobilisésLes 3/4 des actions mobilisent une population d’apprenants : élèves, stagiaires , apprentis...Le domaine d’action semble jouer sur le degré d’implication des apprenants : 63% des actions de développement agricole se font avec les élèves, les stagiaires et/ou lesapprentis, 80% des actions de développement mixte, 88% des actions de développement territorial.Sur l’ensemble des actions de développement impliquant une population d’apprenants, 85%mobilisent des jeunes en formation initiale scolaire, 29% des stagiaires de la formation continue et 12,5%des apprentis. Ceci est à mettre en relation avec la répartition des apprenants selon leur mode de formation,75% relevant de la formation initiale scolaire. Les élèves sont un peu plus fréquemment intégrés auxactions de développement territorial — même si les écarts avec les autres champs ne sont guèreimportants —, tandis que les stagiaires et les apprentis sont davantage impliqués dans les actions liées deplutôt à l’agricole : développement agricole ou développement mixte.Tableau 2 : Nombre d’actions impliquant des apprenants par mode de formation - Tous statutsDéveloppementagricoleDéveloppementterritorialTous statutsDéveloppementmixteEnsembleSur totalactionsseulseulFormation initiale 66 82,5% 149 89,8% 119 82,1% 334 85,4% 64,1%Apprentissage 16 20,0% 11 6,6% 22 15,2% 49 12,5% 9,4%Formation continue 30 37,5% 26 15,7% 56 38,6% 112 28,6% 21,5%Total actions avec apprenants 80 100,0% 166 100,0% 145 100,0% 391 100,0% 75,0%Aucun public d'apprenants 71 47,0% 23 12,2% 36 19,9% 130 25,0% 25,0%50
Tableau 3 : Données de cadrage, répartition des effectifs nationaux de formés en 2001 par modePublic Privé EnsembleEff. % par mode Eff. % par mode Eff. % par modeElèves 69221 61,4% 103770 88,1% 172991 75,0%Apprentis 22533 20,0% 5955 5,1% 28488 12,4%Stagiaires 20960 18,6% 8085 6,9% 29045 12,6%Ensemble 112714 100,0% 117810 100,0% 230524 100,0%Répartition par statut 48,9% 51,1% 100,0%L’examen des situations observées selon les statuts d’enseignement conforte ces tendances au-delà dedifférenciations entre statuts en termes de structuration des établissements (l’EPL public face auxétablissements privés organisés en secteurs d’activité) et d’orientation variable vers les différents champs.Ainsi, la présence plus affirmée des stagiaires dans les champs du développement agricole et dudéveloppement mixte se vérifie-t-elle dans les trois statuts. Il en est de même de la prégnance de laformation initiale et de la participation des élèves légèrement plus marquée en développement territorial.Tableau 4 : Nombre d’actions impliquant des apprenants par mode de formation - PublicDéveloppementagricoleDéveloppementterritorialPublicDéveloppementmixteEnsembleSur totalactionsseulseulFormation initiale 36 81,8% 28 84,8% 69 83,1% 133 83,1% 52,8%Apprentissage 13 29,5% 7 21,2% 19 22,9% 39 24,4% 15,5%Formation continue 22 50,0% 11 33,3% 42 50,6% 75 46,9% 29,8%Total actions avec apprenants 44 100,0% 33 100,0% 83 100,0% 160 100,0% 63,5%Aucun public d'apprenants 61 58,1% 3 8,3% 28 25,2% 92 36,5% 36,5%Tableau 5 : Nombre d’actions impliquant des apprenants par mode de formation - Privé à temps pleinDéveloppementagricoleDéveloppementterritorialPrivé à temps pleinDéveloppementmixteEnsembleSur totalactionsseulseulFormation initiale 20 87,0% 72 94,7% 26 100,0% 118 94,4% 81,9%Apprentissage 0 0,0% 2 2,6% 1 3,8% 3 2,4% 2,1%Formation continue 3 13,0% 4 5,3% 2 7,7% 9 7,2% 6,3%Total actions avec apprenants 23 100,0% 76 100,0% 26 100,0% 125 100,0% 86,8%Aucun public d'apprenants 8 25,8% 7 8,4% 4 13,3% 19 13,2% 13,2%En revanche, les apprentis, dont 80% sont formés dans le public, occupent les différents champs d’actionde manière assez comparable dans ce statut ; mais ils sont davantage intégrés en développement territorialou mixte dans le privé à temps plein et en développement agricole dans le privé à rythme approprié.Tableau 6 : Nombre d’actions impliquant des apprenants par mode de formation - Privé à rythme appropriéDéveloppementagricoleDéveloppementterritorialPrivé à rythme appropriéDéveloppementmixteEnsembleSur totalactionsseulseulFormation initiale 10 76,9% 49 86,0% 24 66,7% 83 78,3% 66,4%Apprentissage 3 23,1% 2 3,5% 2 5,6% 7 6,6% 5,6%Formation continue 5 38,5% 11 19,3% 12 33,3% 28 26,4% 22,4%Total actions avec apprenants 13 100,0% 57 100,0% 36 100,0% 106 100,0% 84,8%Aucun public d'apprenants 2 13,3% 13 18,6% 4 10,0% 19 15,2% 15,2%51
...avec une plus forte participation des niveaux III et IV. . .En termes de niveau de formation, les niveaux V et IV sont plus fréquemment cités comme associés auxactions (respectivement 52% et 54% des actions pour 36% au niveau III et un peu plus de 12% aux niveauxVI et Vbis). Néanmoins, si l’on tient compte de la représentation des différents niveaux de formation entermes d’effectifs (données de cadrage au niveau national), la participation des niveaux III et IV estrelativement plus importante. En particulier, les formés de niveaux III constituent, tous modes deformation confondus, 13% des effectifs et participent à 36% des actions.Tableau 7 : Nombre d’actions impliquant des apprenants par niveau de formation - Tous statutsDéveloppementagricoleDéveloppementterritorialTous statutsDéveloppementmixteEnsembleSur totalactionsseulseulNiveaux VI et V bis 6 7,5% 20 12,0% 15 10,3% 41 10,5% 7,9%V 46 57,5% 92 55,4% 67 46,2% 205 52,4% 39,3%IV 49 61,3% 73 44,0% 88 60,7% 210 53,7% 40,3%III 43 53,8% 28 16,9% 71 49,0% 142 36,3% 27,3%Autre 4 5,0% 4 2,4% 11 7,6% 19 4,9% 3,6%Total actions 80 100,0% 166 100,0% 145 100,0% 391 100,0% 75,0%« L’ouverture du BTSA GEMEAU en septembre <strong>2002</strong> nous donne l’outil pour lesfutures actions de développement » note un directeur de lycée privé. Et un directeurde maison familiale ajoute : « La présence des cycles de BTSA permet de situer lesactions dans le cadre de la recherche action en relation avec les référentiels ACSE etTC ». Dans le même sens, le proviseur d’un lycée précise : « Dans le secteurServives, via le BTS, ce sont les apprenants qui sont acteurs du développementlocal de par leurs projets variés »Tableau 8 : Données de cadrage, répartition des effectifs nationaux de formés en 2001 par niveauVI et Vbis V IV III EnsembleRépartitionpar modeElèves 33734 59794 57190 22273 172991 75,0%Apprentis 16318 7423 4747 28488 12,4%Stagiaires 13200 11119 4726 29045 12,6%Ensemble 33734 89312 75732 31746 230524 100,0%Répartition par niveau 14,6% 38,7% 32,9% 13,8% 100,0%On note de plus des variations selon le champ des actions : si les formés de niveau III sont nettement moinssollicités que les autres en développement territorial (17% des actions contre respectivement 55% au niveauV et 44% au niveau IV), ils se révèlent comparativement davantage présents en développement agricole(54% des actions contre 61% au niveau IV et 57,5% au niveau V) et en développement mixte (49% desactions pour respectivement 61% et 46% aux niveaux IV et V).52
2- L’inscription dans les projets de l’établissementUne bonne intégration dans le projet d’établissement...En règle générale, les actions de développement sont inscrites dans le projet d’établissement, avec peu dedifférences selon les statuts des établissements et les champs d’action : 83% des actions des établissements privés à rythme approprié sont inscrites dans leur projetd’établissements ; 77% dans le privé à temps plein et le public ; 81% des actions du champ du développement territorial ; 78% des actions du champ du développement agricole ; 75% des actions du champ du développement mixte.Un proviseur de lycée public souligne l’importance du projet d’établissement dansla relation « territoire - développement - établissement », alors que dans son EPLle projet n’est pas encore stabilisé : « Le territoire local doit être mieux connu,appréhendé, pour définir les axes stratégiques du projet d’établissement, en tenantcompte de l’ensemble des ressources de l’établissement... L’absence d’un projetd’établissement (écrit) rend difficile l’approche et la précision sur les actions dedéveloppement. Une multitude d’actions et de ressources existantes, sans un réelencadrement, en termes de développement territorial ou agricole, montre lepartenariat important de l’établissement dans le développement de son te ritoire.Toutes ces ressources sont à intégrer dans un projet d’établissement.»L’EPL du Mans, acteur du développementUn projet, des axes stratégiques Un credo : L’établissement percevait comme nécessaire de reconsidérer larelation agriculture-société, notamment de modifier les pratiques enagriculture. Des situations nouvelles à prendre en compte : L’établissement s’était coupé de la production et de la profession,essentiellement en raison de son offre de formation. Il était confronté aux enjeux du périurbain. Il subissait une érosion de ses effectifs d’apprenants mais discernaitparallèlement des besoins de formation pour favoriser l’installationde nouveaux agriculteurs. Une démarche de projet : L’établissement, pôle d’animation local, lieu d’expression, dediffusion, d’action.(...)53
(...) Des axes stratégiques pour l’établissement : Promouvoir et assurer l’insertion sociale, scolaire et professionnellede chaque apprenant ; Accompagner chaque apprenant dans son projet personnel, social etprofessionnel en mettant en place une organisation qui renforce ladimension éducative de la formation ; Participer à la construction de l’identité du territoire, développer,renforcer les liens avec les acteurs sociaux et économiques (axestructuré par le projet d’exploitation) ; Développer l’exercice des « autres missions » en s’attachant àrenforcer la synergie des missions ; Un projet structuré par l’exploitation agricole : Reprendre contact avec le territoire ; S’orienter vers de meilleures pratiques agricoles, produire autrement,avoir une conduite citoyenne, dans un contexte de mitage duterritoire et de coexistence des exploitants agricoles et des néoruraux; Aller dans le sens de la LOA et de la multifonctionnalité ; Introduire le concept de développement durable dans la formationselon les trois piliers : économique, agri-environnemental, social. Des cadres structurels : Projet agri-urbain manceau Plate-forme expérimentale de la Sarthe Site expérimental en développement durable Réseau agriculture durable Des partenaire s : Chambre d’agriculture Chambre des métiers Direction régionale de l’agriculture et de la forêtrégionale des affaires culturelles Direction régionale de l’environnement CEZ Professionnels agricoles/ Direction Des externalités : Construction de l’image, de la notoriété de l’établissement,développement d’un « vivier potentiel » Production de savoirs, transmission de savoirs, accompagnementdes changements Création d’un centre régional de développement agricole Un axe fort de réflexion :Comment être agriculteur à la périphérie des grandes villes ?54
...En revanche, l’intégration des actions de développement dans le projet pédagogiquesemble plus facile lorsqu’elles s’inscrivent dans le champ du développement territorial.Cela se vérifie quels que soient les statuts d’enseignement : près de 90% de ces actions pour le public, plusde 80% pour les établissements privés.Un chef d’établissement confirme cette réalité : « la participation d’un établissementde formation agricole au développement local est réelle et importante dans la mesureoù les programmes de formation obligent à réaliser des projets en direction desacteurs locaux. De plus, les apprenants bénéficient des expériences et des pratiquesdu territoire. Les établissements se doivent d’être présents et actifs dans ledéveloppement du territoire ; c’est à mon avis une mission importante du chefd’établissement. »Un autre ajoute : « Dans un établissement de «services», il est relativement aisé des’insérer dans le développement local et l’animation rurale, de par les différentsprojets pédagogiques (PUS) ou éducatifs. »Pour ce qui est des actions de développement agricole, seules 52% entrent dans le cadre du projetpédagogique. Ce phénomène est encore plus marqué dans le public où à peine 40% de ces actions sontreliées au projet pédagogique.« Les actions de développement agricole, réalisées sur les unités de production(exploitation et atelier technologique) n’intègrent pas facilement les apprenants. »souligne un chef d’établissement.3- L’implication des personnelsUne ressource humaine diversifiée...Les responsables des actions les plus fréquemment cités sont enseignants (47% des actions),directeurs d’exploitation (28%) ou chefs d’établissements (26%).On note bien évidemment des variations selon le champ des actions : les responsables d’exploitationapparaissent très logiquement en première ligne en développement agricole (48% des actions pour 44% auxenseignants et 11% aux chefs d’établissements) ; ils ont une présence tout aussi affirmée que lesenseignants en développement mixte (38% pour 39% des actions aux enseignants).En termes de statuts d’enseignement, la responsabilité des actions est, en relation notamment avecl’orientation plus « agricole » des actions des établissements, plus souvent donnée aux responsablesd’exploitation dans le public (48% des actions). Dans le privé à temps plein, les enseignants sont aupremier plan (58% des actions). Dans le privé à rythme approprié, en l’absence d’exploitation, et comptetenu certainement de la taille plus réduite des établissements, les directeurs et les enseignants se partagentla responsabilité des actions (respectivement 41% et 47%).En termes de participation des personnels aux actions, l’enquête montre que la plupart desactions (68%) se font avec la collaboration de 1 à 3 enseignants. Le nombre moyen d’enseignants engagésdans une action est plus faible en développement agricole (1,74). Les actions de développement mixtenécessitent logiquement la participation de davantage d’enseignants (3,59 en moyenne, pour 2,89 dans lecadre du développement territorial).55
Toujours en moyenne, les actions mobilisent davantage d’enseignants dans l’enseignement à privé à tempsplein et ce quel que soit le champ d’action (2,19 en agricole, 3,13 en territorial et 4,1 en développementmixte). Dans le public, leur participation est inférieure à la moyenne en développement agricole (1,5) maissupérieure dans les autres champs (3,19 en territorial et 3,69 en mixte). Le cas de figure inverse est observédans le privé à rythme approprié (2,47 en agricole, 2,44 en territorial et 2,93 en mixte).L’analyse des groupes de compétence des enseignants engagés dans les actions montre que ledéveloppement agricole mobilise en priorité les enseignants en technologie de production et lesresponsables d’exploitation.Le développement territorial fait davantage appel aux enseignants socioculturels et d’économie ; mais, entermes de nombre d’actions impliquant au moins un enseignant de tel groupe de compétence, lesenseignants en technologie de production sont placés, dans ce champ, en troisième position.En développement mixte, les compétences mobilisées sont bien évidemment plus diverses : on retrouve,entre autres, les enseignants en technologie de production, les responsables d’exploitation, les économisteset les enseignants socioculturels. Ce champ fait appel à des équipes pluridisciplinaires larges.Tous champs confondus, ces grands groupes se détachent quel que soit le statut d’enseignement, avec desvariations en fonction des orientations de chacun, exception faite évidemment du responsable d’exploitationdans le privé à rythme approprié. Dans le privé à temps plein, l’enseignant en économie est supplanté parl’enseignant en français ou en biologie.Enfin, la présence des ingénieurs dans les établissements semble un atout important pour la miseen oeuvre des actions de développement agricole ou de développement mixte : ces actions se caractérisentpar le fait que les établissements correspondants (surtout publics) disposent d’un nombre plus importantd’ingénieurs (au moins 2 ingénieurs) et d’une exploitation ou d’un atelier technologique ; par oppositionaux actions de développement territorial pour lesquelles les établissements (surtout privés) ne comptent pasou peu d’ingénieurs dans leur personnel et souvent pas de structures telles que celles citées précédemment.Tableau 9 : Répartition des établissements selon le nombre d’ingénieurs et le statut0 ing. 1 ing. 2 ing. 3 ing. 4 ing. 5 ing et plus TotalPublic 10 3 8 7 5 35 68Privé TP 26 10 9 5 3 22 75Privé RA 76 13 8 4 4 2 107Ensemble 112 26 25 16 12 59 250La ressource humaine « en question » . . .La question de la ressource humaine nécessaire à la conception et à la réalisation des actions dedéveloppement suscite de nombreuses réactions de la part des chefs d’établissement, tant sur les moyens etles compétences à mettre en oeuvre, les effectifs, que la disponibilité des personnels, etc.« Pour assumer des actions de développement, il faut pouvoir disposer depersonnels ayant d’une part des disponibilités et d’autre part la fibre dudéveloppement : aimer les contacts, savoir intervenir, pouvoir médiatiser, construiredes dossiers et obtenir des financements. » Un proviseur.56
« Il faut des initiateurs, des concepteurs et des développeurs... Bref, uneéquipe au complet, avec des compétences et des disponibilités. » confirme un autreproviseur par ailleurs ingénieur de formation.Au-delà des compétences nécessaires à la mise en oeuvre des actions de développement, c’est le manque demoyens et le manque de disponibilités qui sont soulignés.« De nombreuses actions seraient possibles à envisager, mais on se heurte toujoursau facteur limitant des moyens en personnels. Le personnel enseignant est mobiliséentièrement sur la mission d’enseignement. Les décharges pour les autres missionssont quasi impossibles, sauf exception. Trop d’actions réalisées reposent sur lebénévolat. »Un autre responsable note les limites à ces actions : « Elles sont souvent liées à ladisponibilité des personnels à cause de leur cours, de l’organisation scolaire. Lespersonnels doivent s’impliquer sur leur temps libre. »Un proviseur précise : « La limite est atteinte en matière de disponibilité despersonnels et de moyens... L’implication dans ces actions reposent en grande partiesur du bénévolat, qui a lui même ses limites... »Un autre chef d’établissement : « Il y a peu de reconnaissance du travail réalisé etla recherche des moyens est une constante ; ce qui provoque à terme ladémobilisation des équipes. Faire durer un projet longtemps relève du miracle... »Parallèlement, le rôle que peuvent avoir les ingénieurs dans les actions de développement est souvent misen exergue par les chefs d’établissement du public.« La mise à disposition de temps libéré pour les ITA est un élément essentiel etindispensable pour l’exercice des missions de développement et d’expérimentation ;même s’ils ne sont pas les seuls à mener des actions, ils peuvent jouer un rôled’initiateur, d’animateur primordial. »En guise de conclusion sur les facteurs internes, on peut citer cette remarque d’un proviseur :« Le bénéfice (des actions de développement) est triple : Pour les enseignants : se maintenir au courant des évolutions, lier descontacts avec le milieu professionnel ; Pour les apprenants : élargissement du champ des apprentissages,possibilité d’insertion auprès des partenaires (stages, emploi) ; Pour l’EPL : rayonnement, reconnaissance.»57
C- Les acteurs externes et le partenariat lors de la mise en oeuvre des actions1- L’inscription dans un projet de développement localLes liens des établissements avec leurs environnements peuvent être appréciés à travers les partenariats misen place, mais aussi par le biais de l’inscription éventuelle des actions dans des projets globaux en liaisonavec le territoire. Or, 95% des actions de développement territorial recensées et 61% des actions dedéveloppement mixte sont déclarées comme s’inscrivant dans un projet de développement du « territoire deproximité », pour 56% à l’ensemble des actions ; la part des actions de développement agricole liées à unprojet du « territoire de proximité » est plus faible (un peu plus d’un tiers tous statuts confondus). Cetteinscription dans un projet de développement local concerne la majeure partie des actions des établissementsprivés à rythme approprié (68%) et des établissements publics (53%) pour un peu moins de la moitié desactions des établissements du privé à temps plein.« Ces actions permettent à l’école de s’intégrer dans le développement local et auxélèves d’être auteurs d’une partie de ce développement. Elles font prendre conscienceaux élèves et aux stagiaires de la complexité des relations entre les différentspartenaires d’un projet. Le développement agricole et territorial de la région ne doitpas oublier que le développement s’est fait et doit continuer à se faire en partenariatavec les établissements d’enseignement. »Un directeur de lycée privé.21% des actions sont inscrites dans une procédure (CTE, PAD, PPDA). C’est le cas pour près d’un tiers(32%) des actions des établissements publics ; 11% des actions des établissements du privé à temps pleinet 10% des actions du privé à rythme approprié. Ces procédures concernent avant tout des projets dedéveloppement mixte : 41% des actions de ce champ tous statuts confondus, 54% des actions du publicpour 21% des actions du privé à temps plein et 17% des actions du privé à rythme approprié. Près de 15%touchent au développement agricole ; 7% à des actions de développement territorial.Le rôle moteur des CTE pour les établissements publics...En particulier, 9% de l’ensemble des actions se réalisent dans le cadre d’un CTE individuel ; ce qui signifieque 47% des actions inscrites dans le cadre d’une procédure relèvent d’un CTE individuel. C’est le cas pour16% des actions du public ; 31% de leurs actions de développement mixte. Dans le privé à temps plein etle privé à rythme approprié, 3% des actions concernent un CTE individuel (de 5% à 7% de leurs actions dedéveloppement mixte).De plus, 3% de l’ensemble des actions (15% des actions s’inscrivant dans une procédure) relèvent d’un CTEcollectif. L’avantage est là encore au public : près de 5% de leurs actions sont concernées pour environ 1%des actions du privé.Au total, 12% des actions recensées sont inscrites dans le cadre d’un CTE, soit 62% des actions relevantd’une procédure.Plus d’un quart des actions sont déclarées inscrites dans une démarche d’appui à la multifonctionnalité desexploitations agricoles. C’est le cas pour 34% des actions des établissements publics, 16% des actions duprivé à temps plein et 23% des actions du privé à rythme approprié.58
... et l’importance de l’approche en termes de développement durableEnfin, la plus grande majorité des actions (85%) s’inscrivent dans une stratégie de développement durabledu territoire. Cette orientation est un peu plus forte dans le public : 95% de leurs actions pour 79% desactions du privé à rythme approprié et 71% des actions du privé à temps plein.Tableau 10 : Cadres dans lesquels s’inscrivent les actions des établissementsEn % du nombre d’actionsTousétablissementsPublic Privé TP Privé RAProjet de développement local 55,7% 53,1% 49,6% 67,8%Procédures(CTE, PAD, PPAD, etc.)Appui à la multifonctionnalitédes exploitations agricoles21,1% 32,4% 10,6% 9,6%26,4% 34,0% 16,1% 22,8%Développement durable du territoire 85,2% 94,5% 71,2% 79,0%Incontestablement, les actions menées par les établissements reposent sur des orientations fortes,raisonnées et structurées, en termes de développement du territoire et de ses activités, parmi lesquellesl’activité agricole. Ces actions mises en œuvre par les établissements en interrelation avec leursenvironnements se déclinent sous diverses formes, mais avec une préoccupation prépondérante communede projection dans le temps long : celle d’un développement durable du territoire.2- Des partenariats plus ou moins forts selon les champs d’actionLa majorité des actions se font avec 1 (22,3%), 2 (16,5%), 3 (13,1%) ou 4 (13,1%) partenaires. Les actionsde développement agricole se réalisent avec un faible nombre de partenaires (50% avec 1 ou 2 partenaires).C’est aussi le cas, dans une moindre mesure, des actions de développement territorial (40% à 1 ou 2partenaires). En revanche, le développement mixte, qui renvoie à des actions plus larges, fait un peu plusappel à des partenariats multiples : 41% des actions sont mises en œuvre avec 5 partenaires et plus (maistout de même 56% avec 1 à 4 partenaires).On note, lorsque l’on considère les différents statuts, que le public développe davantage de partenariats :36% des actions se font avec 5 partenaires et plus (contre 30% tous statuts confondus). Ceci tient au champdu développement territorial (47% des actions des établissements publics y intègrent 5 partenaires et plus)et au champ du développement mixte (48%). A l’opposé, le développement agricole se fait, de manièreencore plus marquée dans ce statut, avec 1 ou 2 partenaires (52% des actions de développement agricole dupublic).Dans le privé à temps plein, ce sont les actions avec 1 ou 2 partenaires qui dominent (48%) et ce quel quesoit le champ d’action : développement agricole (58%), développement territorial (45%) ou développementmixte (47%).59
Dans le privé à rythme approprié, contrairement aux autres statuts, c’est le développement agricole quisemble mobiliser le plus de partenaires : 40% des actions avec 3 ou 4 partenaires et autant avec 5partenaires et plus. (On revient là sur la différence que crée l’absence d’exploitation dans les établissementsqui nécessite de travailler en partenariat avec des exploitants, du fait de la pédagogie en alternance). Ledéveloppement territorial requiert, lui, comme par ailleurs, un nombre limité de partenaires (43% desactions avec 1 ou 2 partenaires), mais les actions avec 3 ou 4 partenaires sont toutefois sur-représentéespar rapport à la situation tous statuts confondus (31%). En termes de développement mixte, le rythmeapproprié se situe dans une position intermédiaire entre le temps plein (1 à 2 partenaires) et le public (5 etplus) avec 43% des actions à 3 ou 4 partenaires.Tous établissements confondus, les partenaires les plus sollicités sont, dans l’ordre, les structuresterritoriales (54% des actions y font appel), les acteurs économiques (52%), les organisationsprofessionnelles agricoles (46%) et les institutions d’Etat (41%).NB : On recense dans cette partie le nombre d’actions impliquant, exclusivement ou entre autres, tel ou tel partenaire, une actionétant décomptée autant de fois qu’elle intègre de partenaires. Par voie de conséquence, le nombre de partenaires dans chaque actioninflue sur la présence plus ou moins forte des différents types de partenaires en comparaison d’un statut à l’autre ou d’un champ àl’autre.Le développement agricole privilégie logiquement les partenariats avec les acteurs économiques (60% deces actions) et les organisations professionnelles (49%), la recherche (33%). Le développement territorialconcerne surtout les structures territoriales (73%), les associations (48%) et les institutions d’Etat (35%).Le développement mixte associe en premier lieu organisations professionnelles (57%), structuresterritoriales (58%) et acteurs économiques (57%).Graphe 15 : Nombre d’actions par type de partenariats engagés(Tous statuts et toutes actions)Institutions d'Etat40,5%Struct. territoriales53,8%Org. prof. agricoles45,5%Acteurs éco.51,6%Associatifs29,1%Formation14,6%Recherche20,2%Crédit9,1%Autres15,8%Compte tenu des orientations de leurs actions vues précédemment, les établissements publics travaillentdavantage que la moyenne avec les institutions d’Etat (56% des actions; +15 pts), la recherche (32% ;+12 pts), les organisations professionnelles (56% ; +11 pts) et les établissements de formation (18% ;+3 pts). On retrouve la place privilégiée des institutions d’Etat, quel que soit le champ d’action, enparticulier en développement territorial (77% de ces actions, mais pour seulement 35 actions au total dansce champ). Les OPA (respectivement 45% et 78%) et la recherche (respectivement 37% et 36%) sontsurtout concernées par le développement agricole et le développement mixte, tandis que les structuresterritoriales sont partenaires majeurs en développement territorial et mixte (respectivement 71% et 60%).On note aussi pour ce statut des relations supérieures à la moyenne, en termes de nombre d’actions, avecles associations et les organismes de formation en développement territorial et mixte.60
Les établissements du privé à temps plein, si les structures territoriales restent parmi leurs principauxpartenaires, sollicitent, à la marge, davantage que la moyenne les acteurs économiques (54% des actions ;+2 pts), les associations (31% ; +2 pts), les organismes de crédits (16% ; +3 pts). Mais ce qui est surtoutfrappant est que certains partenaires sont très nettement en retrait par rapport à ce que l’on observe pourl’ensemble des établissements : les institutions d’Etat (16% des actions ; -24 pts), les organisationsprofessionnelles agricoles (30% ; -16 pts) et la recherche (6% ; -14 pts). Ceci tient évidemment aux champset types d’intervention des établissements du privé à temps plein, mais aussi certainement aupositionnement des établissements et aux relations qu’ils nourrissent sur l’ensemble de leurs activités avecl’extérieur.L’opération « un lycée, un laboratoire » en Midi-Pyrénées1998avec l’appui de l’ADERMIP*Une mise en réseau pour les établissements de l’enseignement agricole L’objectif central était de favoriser les relations entre les lycées techniques etprofessionnels et les laboratoires de recherche publics de Midi-Pyrénées. Lebut final de cette mise en contact est d’apporter un appui scientifique ettechnique fort aux entreprises basées sur l’ensemble du territoire régional. On peut globalement illustrer les relations entre le milieu académique et lemilieu économique selon le schéma ci-après :Milieu académiqueMilieu économiqueUniversitésOrganismes de rechercheGrands groupesCRITTCentres de transfertPME-PMI High techLycées techniques etprofessionnelsPME-PMI, ArtisansExploitants agricolesLiens naturelsLiens factuels à améliorer Les liaisons horizontales fonctionnent relativement bien, mais sontà développer. Les liaisons verticales sont encore à l’étape embryonnaire et sont àdévelopper fortement pour favoriser le partenariat entre le milieuacadémique et le milieu économique.(...)61
(...) Exemples de fonctionnement : la plate-forme de compétences d’Albi « Eaux- Boues - Déchets » ou celle de Rodez sur la viande.*ADERMIP : Association pour le développement de l’enseignement, de l’économie et desrecherches de Midi-PyrénéesPlus précisément, on note, en développement agricole (seulement 31 actions), des liens supérieurs à la moyenneavec les acteurs économiques (74% ; +14 pts) et les organismes de crédit (13% ; +9 pts) et surtout des relationsfaibles avec les institutions d’Etat (6,5% ; - 25 pts) et la recherche (16% ; -17 pts) dans ce champ. Endéveloppement territorial, les structures territoriales sont un peu plus présentes qu’en moyenne (77% de cesactions ; +4 pts) ; par ailleurs, on retrouve la faiblesse des relations avec l’Etat (22% ; -14 pts). Endéveloppement mixte (seulement 28 actions), les acteurs centraux sont les acteurs économiques (68% ; +10,5pts) ; trois types d’acteurs sont bien plus discrets que pour l’ensemble des établissements : les OPA (43% ;-27 pts), les structures territoriales (36% ; -22 pts) et surtout, une fois encore, l’Etat (14% ; -38,5 pts).Forma Ter 1Dispositif d’appui aux EPL dans leurs liens au territoire Avec le soutien de l’Union européenne, un centre de ressources interactif,commun aux enseignants, formateurs et agents de développement des territoiressera disponible sur Internet en 2003. Un « lien ressource formation et territoire » en appui aux dynamiques localesportées par les collectivités et les acteurs locaux (projets de territoire) enpartenariat avec les établissements de formation : diagnostic de territoire,accompagnement de projets, emplois, insertion sociale et professionnelle desjeunes, etc. Le dispositif « Forma Ter » : une démarche d’étude-actionLe site est le résultat d’une démarche de construction progressive d’un dispositifen lien direct et permanent avec ses utilisateurs. Un outil d’échange, d’information, de diffusion et de mise en réseau construiten partenariat avec le Portugal, l’Espagne, la Roumanie et la France : mise encommun des savoirs, expériences et compétences.1In Initiative de l’enseignement agricole — n°5 — Juin <strong>2002</strong>Guy Levêque — CEP de Florac.62
Dans le privé à rythme approprié, enfin, les structures territoriales et les acteurs économiques sont aussiau premier plan (respectivement pour 63% et 56% de leurs actions) avec d’ailleurs une présence plusmarquée qu’en moyenne des premières (+9 pts). Les associations sont de plus des partenaires privilégiés(38% ; +9 pts). A l’opposé, la recherche (10% ; -10 pts), les institutions d’Etat (34,5% ; -6 pts) et lesOPA (40% ; -5 pts) sont plus en retrait. Il est difficile de tirer des conclusions sur les partenaires de cestatut en termes de développement agricole strict (seulement 14 actions), mais la place des OPA, de larecherche et de la formation ainsi que des institutions d’Etat y apparaît importante. On retrouve de mêmedes relations fortes avec les structures territoriales (70% des actions ; -3 pts), les associations (50% ; +2pts) et les acteurs économiques (41% ; +3 pt) en développement territorial. En développement mixte, lerythme approprié mène des actions en partenariat en particulier avec les acteurs économiques (74% de cesactions ; +17 pts) et les structures territoriales (69% +11 pts), mais aussi avec les OPA (67% ; -3 pts).C’est la recherche qui est, comparativement à la moyenne, moins associée (13% ; -14 pts) ; tout ceci pourun nombre quoi qu’il en soit très limité d’actions dans ce champ pour ce statut : 39 actions intégrant aumoins un partenaire.... avec une contractualisation apparemment faible...Pour ce qui est de la contractualisation des partenariats, elle est relativement faible ou non déclarée. Onpeut donc s’interroger sur la validité des informations recueillies sur ce point. En effet, 64% des actionssont caractérisées par l’absence de contrat et 21% reposent sur un contrat unique. L’absence decontractualisation est encore plus marquée dans le champ du développement territorial (73% de ces actions)et dans celui du développement mixte (65%) pour 52% des actions en développement agricole. Le nombremoyen de contractualisations par action dans ces trois champs est respectivement de 0,55 pour ledéveloppement territorial, 0,87 pour le développement mixte et 0,91 pour le développement agricole.Dans le public, les actions sont davantage contractualisées : 49% d’entre elles. Le nombre moyen decontractualisations est de 1,14 en développement agricole, 0,75 en développement territorial et 0,98 endéveloppement mixte. 75% des actions des établissements privés à temps plein et 76% des actions desétablissements privés à rythme approprié sont déclarées être réalisées hors contrat.... et de nature financière, technique, scientifique ou logistiqueLorsque l’on s’intéresse à la nature des partenariats, en termes de nombre d’actions auxquelles participentles différents partenaires, tous champs d’actions et statuts d’enseignement confondus, on vérifie que lescollectivités territoriales se placent au premier plan pour ce qui est du soutien financier — elles apportentune aide de cet ordre à 43% des actions — , suivies des institutions d’Etat (29%), les organismes de créditsn’apparaissant intervenir que dans 10% des actionsLes partenariats scientifiques concernent très logiquement avant tout les organismes de recherche (14% desactions), mais aussi les institutions d’Etat (9%) et les OPA (8%). Les organisations professionnellesagricoles et les acteurs économiques jouent un rôle prépondérant en termes de soutien technique(respectivement pour 39% et 35% des actions). Suivent les associations (21%). Ces trois derniers groupesde partenaires se révèlent aussi en tête pour ce qui est des collaborations logistiques (respectivement 15%,19% et 15% des actions).63
Tableau 11 : Nature et type des partenariatsTous champs de développementFinancier Scientifique Technique LogistiqueInstitutions d'Etat 143 28,9% 46 9,3% 99 20,0% 34 6,9%Struct. territoriales 213 43,1% 14 2,8% 120 24,3% 104 21,1%Org. prof. agricoles 82 16,6% 41 8,3% 191 38,7% 75 15,2%Acteurs éco. 105 21,3% 26 5,3% 171 34,6% 95 19,2%Associatifs 28 5,7% 19 3,8% 104 21,1% 74 15,0%Formation 17 3,4% 24 4,9% 58 11,7% 28 5,7%Recherche 30 6,1% 70 14,2% 73 14,8% 28 5,7%Crédit 38 7,7% 2 0,4% 8 1,6% 4 0,8%Autres 49 9,9% 16 3,2% 39 7,9% 33 6,7%Total actions 494 494 494 494Guide de lecture : 28,9% des actions se réalisent, entre autres, en partenariat financier avec des institutions d’Etat.Ces tendances sont confirmées quand on analyse, pour chaque partenaire, la place des différents type decollaboration dans leur engagement (part des actions de telle ou telle nature dans le total des actions danslesquelles est engagé chaque partenaire) : la collaboration de l’Etat et des structures territoriales est enpremier lieu financière, celle des OPA, des acteurs économiques, des associations et des établissements deformation davantage technique. On note juste que les organismes de recherche, s’ils sont premierspartenaires scientifiques, participent à un peu plus d’actions sur des aspects techniques : leur collaborationest scientifique pour 70% des actions dans lesquelles ils s’engagent et technique dans 73%.Lorsque l’on distingue les différents champs d’actions, on note que, dans le cadre du développementagricole, la part de l’engagement de la plupart des partenaires (collectivités territoriales, OPA, acteurséconomiques, associations et organismes de recherche) en termes financiers est un peu plus importantequ’en moyenne (dans la structure de leur participation). C’est aussi le cas, sur l’aspect scientifique, desinstitutions d’Etat, des OPA, des établissements de formation et de recherche et des acteurs économiques.Enfin, le soutien technique des organismes de recherche et des établissements de formation est un peu plusappuyé.Quel que soit son type, la mise en oeuvre du partenariat est souvent complexe et peut varier selon les lieux,l’histoire de chaque établissement, les personnes, au-delà de variables structurelles plus générales :« Historiquement la profession a toujours été réticente quand il s’est agi d’associerl’enseignement agricole au développement ; cette tendance est particulièrementprégnante au niveau du local »Un proviseur d’EPLPour beaucoup d’établissements, cette recherche de partenariat demeure incontournable :« L’établissement ne disposant pas d’exploitation agricole, nous avons fait le choixd’un positionnement volontariste sur le développement territorial global. Nospartenaires sont très nombreux, car nous sommes un acteur majeur dudéveloppement sur notre territoire en déprise »Un proviseur d’EPLEnfin, les « petits établissements » soulignent leurs difficultés à mobiliser beaucoup de partenaires, car ilsne peuvent répondre à toutes les sollicitations.64
Troisième partie — De l’établissement acteur du développementau développement moteur de l’établissementDès leur origine, au XIXème siècle, les établissements (« l’exploitation agricole - école » 1 ) sont intervenusdans l’évolution de l’agriculture locale. Cette conception s’est maintenue durant la première moitié duXXème siècle, l’établissement devenant un pôle de compétences à destination des agriculteurs, avec,comme nous l’avons vu dans la première partie, une nette baisse d’influence par la suite au profit desorganisations professionnelles et la marginalisation des ingénieurs d’agronomie.L’inscription territoriale de l’agriculture retrouve aujourd’hui une considération que la grande vague demodernisation des « 30 glorieuses » avait oublié au profit d’une vision systématique, homogène, monotonedes conditions de production et des modes d’organisations. Or, la production agricole et forestière occupel’essentiel des territoires et on découvre, via les externalités et les préférences des consommateurs et desusagers, la multifonctionnalité. En outre, la qualité des produits est largement fondée sur l’origine, lesconditions d’obtention, la traçabilité. Enfin, le territoire définit les conditions de vie et tend à devenir unlieu possible pour l’innovation collective et l’élaboration des projets. De fait, tous ces changementsconduisent à considérer l’agriculture non seulement à travers son intégration dans les filièresagroalimentaires, mais aussi dans son insertion territoriale. Sans contexte, cette évolution a eu desconséquences sur le renouvellement de la mission de développement, mais aussi d’animation rurale,conférée aux établissements. Dans un contexte d’accompagnement du changement, le legislateur a donnéaux établissements de l’enseignement agricole une place, un rôle comme acteur du milieu, du fait de leurdouble proximité professionnelle et territoriale.C’est un fait que les établissements — et c’est un des résultats patents de notre étude — s’engagent de plusen plus dans cette voie du développement agricole et du développement territorial, grâce notamment à leurbonne insertion dans le milieu.A la question initialement posée « Les établissements de l’enseignement agricole sont-ils acteurs dudéveloppement économique, technique, social, culturel? », les enquêtes nationales et celles plus qualitativesréalisées en Midi-Pyrénées permettent de répondre par l’afirmative au vu de la quantité et de la diversité desactions recensées et d’une tendance forte à s’impliquer encore davantage dans le développement.I- L’établissement lieu de conception et de mise en oeuvre d’actions dedéveloppementA- Des actions de développement en quantité relativement importante et caractériséespar une grande diversitéDe septembre 2000 au printemps <strong>2002</strong>, le nombre d’actions de développement, dans l’acception large duterme, menées par l’ensemble des établissements techniques agricoles peut être estimé aux alentours de2000. N’ayant pas de point de référence, il est dificile de porter un jugement sur ce chiffre : toutefois,relativement à la taille de l’enseignement agricole dans le paysage éducatif français, ce nombre nous paraîtsignificatif quant à son impact sur le territoire national.1BOULET, Michel - « La formation des acteurs de l’agriculture : l’école des paysans »In : BOULET, Michel, dir. Les enjeux de la formation des acteurs de l’agriculture, 1760-1945Actes du colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999 - Dijon : Educagri éditions, 2000, 526p ; pp. 23-3065
L’analyse qualitative des actions de développement permet, elle, de dégager une grille de lecture mettant enlumière leur diversité.On peut distinguer trois niveaux de lecture : l’axe sectoriel : production, commercialisation, social, culturel, emploi, etc. la sphère d’intervention : milieu professionnel agricole, milieu social de proximité, mixitédes deux dans des contextes territoriaux différents (territoire périurbain, territoire rural...) le niveau ou l’intensité de l’intervention : de l’offre ponctuelle de main-d’oeuvre oude services, par exemple, à la recherche ou la mise en place d’actions pérennes dans le cadred’une politique globale de l’établissement.Ces trois axes structurent la nature et le type d’action. Au-delà, les actions se caractérisent par des cadresd’intervention, notamment par le type de partenariats mis en place, les contractualisations, etc.B- Qualité et diversité : quelques exemples d’actions de développementL’analyse des intitulés d’actions nous permet de mettre en évidence un certain nombre de catégoriesd’actions. Nous proposons ici quelques exemples, qui illustrent la diversité des actions menées par lesétablissements de l’enseignement agricole tant en termes de développement agricole, que de développementterritorial ou de développement « mixte ».Formation agricole Formations diverses auprès d’agriculteurs, de salariésagricoles Création de FOAD à destination des agriculteurs Vulgarisation sur les déchets de l’agriculture et le respect del’environnement Formation agriculture durable Formation à l’élaboration de CTEEmploi Insertion agricoles Pépinières d’entreprises dans le cadre d’un projet dedéveloppement d’une zone horticole Diagnostic de l’emploi en conchyliculture sur le territoire Etude des potentialité d’emploi en agriculture biologique Chantiers d’insertion en agro-alimentaire Aide à la gestion de projets de réorientation des agriculteurs ;études de faisabilité Etude sur les besoins locaux de salariés agricoles Etude sur les opportunités locales d’installations alternatives66
Essais Expérimentation en agro-alimentaire, en production animale, en production végétaleLes actions de ce type sont très nombreuses et souvent trèsspécifiques. Il est difficile d’en proposer quelques exemplesreprésentatifs de leur diversité. Elles englobent la recherche,l’expérimentation, l’innovation sur les produits, les variétés, lesraces et sur les processus de production, avec un souci fréquentde « mieux produire », de produire en respectantl’environnement (agriculture biologique, agriculture durable).Essais Expérimentation Prise en compte de la qualité de l’eau Unité expérimentale de traitement des effluents biologiques Actualisation des données cadastrales dans le cadre d’un projetlocal de suivi de la qualité de l’eau Recherches diverses sur le respect de l’environnement et laqualité de l’eauRespect de l’environnement Agriculture durable Agriculture biologique Journée de communication sur l’agriculture durable Communications sur les méthodes de diagnostic enagriculture durable ; démonstrations Elaboration carte des risques EnvironnementCommercialisation des produits agricoles Etude de marché commercialisation de produits fermiers Etude d’impact d’une AOC sur le développement du territoire Aide au projet de mise en place de magasins de produitsbiologiques, de produits du terroir, etc.Valorisation du patrimoine animal ou végétal Valorisation métiers de l’agriculture Mise en place de labels Création de conservatoires végétaux, valorisation de labiodiversité Création de conservatoires des vins régionaux Valorisation de l’âne de Haute-AuvergneConseil Diagnostic Transfert de technologie Services Aide projets agriculture Communications ESB Politique globale de promotion et de développement del’aquaculture Journée technique vigne et vin Veille stratégique filière bois à l’international Aide projets agriculture ; suivi comptable67
Structure d’appui GIS Pôles de compétence Réseaux Centres de ressources Plate-forme technologique en agro-alimentaire GIS cultures fruits légumes Centre de ressources pastoralisme Réseau professionnels de la forêtAnimation sociale du territoire à destination des personnes âgées Services d’aide à domicile Organisation d’olympiades du troisième âge Aménagement de résidences du troisième âge Animations en maison de retraite Centre local d’information et d’orientation à destination despersonnes âgées et de leurs familles à destination des enfants et des jeunes à destination des malades et des handicapés Création d’une halte-garderie Découverte du patrimoine local ; animation auprès de jeunesenfants Projet éducatif local Action journalisme auprès d’enfants Intervention auprès d’enfants hospitalisés Animations liées au cirque auprès d’enfants handicapés Opération d’aménagement horticole avec des enfantshandicapés à destination de publics divers à destination de publics en difficulté Association de rapprochement des générations Actions de protection animale (SPA) Association de lutte contre la précarité Soutien aux femmes isolées en milieu ruralAnimation culturelle et sportive du territoire Participation à la politique culturelle du territoire Salon du livre Gestion du centre documentaire d’une école maternelle etprimaire Rencontres champs / contrechamps (cinéma) Etude d’audience d’une radio locale Organisation d’un raid équestre Mise à disposition d’équipements sportifs pour desassociations68
Prévention santé environnement Communication sur maladies rares auprès de la population Communication sur les risques routiers Communication sur les conduites à risques Communication sur le tri sélectif des déchets ménagersauprès de la population Information du grand public sur la préservation de la forêtInsertion, création d’emploi sur le territoire Aide à la création d’entreprises Création d’une entreprise de services en milieu rural Etude sur les besoins en emploi de service sur le territoire Association d’insertion Chantiers d’insertion Participation aux réflexions locales sur le développement del’emploi sur le territoire Insertion sociale par la cultureFormation à destination de toutes les populations du territoire Formation aux NTIC de publics divers Formation sur la mise en valeur du patrimoine du territoire Formation à distance - divers secteurs Participation à la conception du pays ; aspect formationAccueil Communication touristique Valorisation des activités non agricoles du territoire Exposition photographique sur le territoire Film Son et lumières Etude sur le développement du tourisme local Exposition sur l’histoire du commerce local Foire de l’artisanatValorisation du patrimoine bâti et du patrimoine naturel Aménagements Réhabilitation et aménagement de sites divers : anciensjardins, marais, cours d’eau, canaux, moulins, gîtes, parcs,mise en place de tables de lecture du paysage, espacesdétentes, chemins de randonnée, vergers, etc Etudes des écosystèmes Création d’arboretums, de sentiers botaniques,d’observatoires de la faune Organisation de manifestations dans le cadre des journées dupatrimoine Création et exposition de la maquette d’une vallée Diagnostic sur le patrimoine ; programme Leader269
Projets de développement du territoire Pays Animation et conseil en développement dans le cadre deprojets agri-urbains Aide à l’élaboration d’une politique globale dedéveloppement local Etude sur le développement économique local Participation à la conception de pays ; divers aspects :agriculture, emploi, formationMise en relation agriculture / territoire Image de l’agriculture Valorisation des produits agricoles Fermes ouvertes Communication sur les pratiques en agriculture auprès dela population Festival Brebis Lacaune Filière Roquefort Création d’un parc ; valorisation des processus deproduction en horticulture Salon local de l’agriculture Valorisation, aide à la commercialisation de produits duterroir Valorisation, aide à la commercialisation de produits àl’international Foires aux végétaux, foire aux dindes, etc.La diversité des actions recensées montre bien le caractère polysémique de la notion de développement. Onpeut retenir plusieurs qualifications des actions sachant qu’il y a transversalité, du fait notamment de leurterritorialisation, de leur caractère rural ou périurbain. Les actions de développement agricole concernent l’ensemble des actions (recherche,expérimentation, transfert de technologie, audit, conseil, diagnostic, services divers, aide à la gestion deprojet, vulgarisation, etc.) à destination des professionnels de l’agriculture, de la forêt, de l’agroalimentaire,dans le champ de la science et des techniques liées à leurs métiers, y compris dans leurs aspectséconomiques et commerciaux. Le développement territorial a trait aux actions des champs de l’économique, du social, del’emploi, de l’insertion, du patrimoine bâti, naturel, de l’environnement à destination de la communautécitoyenne du territoire. Le développement mixte concerne toutes les actions transversales aux deux champs précédents. Iltouche en particulier aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, au développement durable,à la gestion des relations entre citoyens et professionnels dans les zones périurbaines, à la mise en oeuvredes savoir-faire des professionnels de l’agriculture dans des projets de développement du territoire, auxprojets territorialisés des professionnels (CAD notamment), à l’emploi et à l’insertion des professionnels.Dans ce dernier champ, les professionnels de l’agriculture et les citoyens du territoire (le deuxième cercleincluant le premier) sont bénéficiaires des actions.Ce dernier champ dit « mixte », loin d’être un appendice du développement agricole et du développementterritorial, revêt une ampleur qui illustre les mutations de la société : retour à la nature, au rural, prise encompte grandissante des attentes sociétales par les professionnels en termes de qualité des produits, derespect de l’environnement, de gestion de la proximité des espaces territoriaux de production agricole d’unepart, de milieu de vie des néo-ruraux ou périurbains d’autre part. In fine, la prise en compte de ces nouvellesexigences tend à faire de ce champ le plus présent des trois dans les actions des établissements.70
C- Diversité des actions de développement et caractéristiques des établissementsAu-delà de la distinction entre établissements publics, privés à temps plein, privés à rythme approprié, cesont l’organisation même des établissements, leurs ressources humaines, les caractéristiques de leur offrede formation, leur capacité à générer du partenariat, qui vont induire des actions de type et d’intensité divers.Dans la diversité des actions de développement, le clivage « public / privé » apparaît clairement. Toutefois,il existe aussi des différences entre les deux statuts du privé et à l’inverse un caractère commun à tous lesétablissements : l’inscription importante dans le projet d’établissement.Il est évident que, dans les établissements publics, l’organisation de l’EPL et notamment la présence d’uneexploitation agricole, d’un CFPPA, des ingénieurs (IA ou ITA), d’une offre de formation allant du CAPAau BTSA, voire à la licence professionnelle, induit un nombre élevé d’actions de développement 1 plutôtorientées vers la production agricole ou « mixte » avec des responsables d’actions qui sont souvent desingénieurs et/ou des chefs d’exploitation. Le partenariat est semble-t-il relativement faible endéveloppement agricole, notamment avec les organisations professionnelles agricoles. Ceci peut en parties’expliquer d’un point de vue historique. A l’origine, si l’enseignement privé s’est constitué en étroiterelation avec les organisations professionnelles, le public était évidemment le « bras » de l’Etat. Ce quisignifie qu’en matière de vulgarisation les établissements privés véhiculaient les orientations de laprofession et les établissements publics défendaient les priorités de la politique agricole du gouvernement.L’atout des établissements publics était de travailler en liaison avec les DSA. Il y avait donc coupure etparfois conflit entre public et privé. Mais cette coupure était en partie comblée par la confiance accordéeaux ingénieurs des services agricoles par les agriculteurs. Cette coupure s’est approfondie avec le décret de1966 qui confiait la responsabilité du développement agricole à la profession, même s’il eut des variationsselon les départements. Aussi subsiste-t-il une grande différence entre les établissements publics et lesétablissements privés : les premiers ont besoin de rechercher des partenaires professionnels quand lesseconds sont insérés dans les institutions professionnelles.Dans le privé à temps plein, une offre de formation plutôt orientée vers les services, l’absence fréquented’exploitation, l’implication traditionnelle avec les acteurs du territoire (acteurs économiques, associations,élus) vont dans le sens d’actions plutôt du champ du développement territorial, mais en nombrerelativement moins important que dans le public. Les domaines d’actions dominants sont le tourisme,l’image du territoire mais aussi le social.L’inscription dans le projet pédagogique de l’établissement et la participation des formés sont, semble-t-il,un élément important, et les responsables des actions sont le plus souvent des enseignants.On retrouve les mêmes tendances dans les établissements du privé à rythme approprié avec toutefoisquelques spécificités. L’offre de formation davantage orientée vers les services, l’implication des acteursexternes (du fait de leur mode de formation en alternance) tels que les élus, socioprofessionnels, structuresde développement local, font que les actions sont plutôt centrées sur le développement territorial,notamment dans les domaines de l’animation ou de l’aide à la gestion de projets de territoire. Toutefois, sices établissements, malgré leur bonne insertion dans les institutions professionnelles et plus généralementun partenariat fort avec le milieu professionnel, génèrent peu d’actions de développement comparativementaux établissements publics, les partenariats dans le cadre de leurs actions, notamment de développementagricole, sont eux particulièrement développés. Est à noter, comme dans les établissements privés à tempsplein, une inscription forte de ces actions dans les projets pédagogiques et une participation importante desélèves à ces actions, actions dont la responsabilité incombe le plus souvent aux directeurs d’établissementet aux enseignants.1Ces actions de développement pérennes, du fait des partenariats qu’elles génèrent et de leur capacité à accompagner leschangements, peuvent aussi être des facteurs facilitateurs de régulation voire de conception de nouvelles offres de formation. C’estle cas par exemple pour les licences professionnelles conçues à partir de partenariats « école - entreprises », à l’écoute de nouveauxmétiers ou de nouvelles compétences qui ont été détectés au sein d’une plate-forme technologique. c.f. licences professionnellesd’Albi et Rodez.71
Tableau 12 : Synthèse des caractéristiques des actions et contextes différenciés selon les statutsPUBLIC PRIVE TP PRIVE RAOffre de formation Présence Niveau III Max IV Max VOffre de formation Production Services ServicesNombre d’actions Nombre important Nombre faible Nombre faibleChamps d’actionDéveloppement agricoleDéveloppement mixteDéveloppement territorialDvlpt agricoleDéveloppement territorialDvlpt mixteD o m a i n e sd’actionsProcessus de productionEnvironnement, écologieTourisme,image du territoireSocialProcessus de productionTourisme, image du territoireSocialEspaces naturels, patrimoineEmploiTypes d’actionsRecherche, expérimentationVulgarisationAnimationAnimationAide gestion projet territoireRecherche, expérimentationVulgarisationAnimationAide gestion projet territoireAudit conseil diagnosticterrit.InitiativeDemandes professionnelsInitiative établissementElusStructures dvlpt localElusInscription dansprojet établissementInscription dansprojet pédagogiqueImportante Importante ImportanteRelativement + faible Importante ImportanteParticipationdes formésRelativement faiblePlace non négligeable apprent.Place encore - négligeable FCGlobalement fortePlace non négligeable FCGlobalement fortePlace non négligeable apprent.Place encore - négligeable FCResponsablesdes actionsChef d’exploitationEn majorité des ingénieursEnseignantsDirecteursEnseignantsParticipationdes enseignantsNombreux en DTet DMFaible en DAGlobalement moins nombreuxPlus importantePlus nombreuxnotamment en DACompétencesdes enseignantsTechnologies de productionResponsable exploitationTechnologie de productionSocioculturelTechnologies de productionSocioculturelSciences économiquesInscription dansprojet dedéveloppement localAssez forteUn peu plus de la moitiédes actionsFortePartenariatFortSurtout en DT et DMFaible en DAFaible1 à 2 partenaires / actionIntermédiaireRelativement fort en DA72Structures territorialesEtatStructures territorialesActeurs économiquesType de partenariat OPAActeurs économiquesAssociationsRecherche FormationAssociationsCréditNon majoritaireContractualisationTrès faibleTrès faiblemais la plus importanteDA : Développement agricole DT : Développement territorial DM : Développement « mixte »
II-Les conditions facilitatrices des actions de développement :des éléments de réponseA- Les variables endogènesLa lecture de l’analyse factorielle à composantes multiples présentée ci-après permet de préciser certainescaractéristiques d’un environnement interne propice à la présence d’actions de développement. Tout d’abord, on peut noter une forte proximité entre la mise en oeuvre d’actions de développementagricole et la présence d’une exploitation agricole ou d’un atelier technologiqueau sein des établissementsainsi qu’avec la présence d’ingénieurs parmi les personnels. En ce qui concerne, l’offre de formation, cesactions sont liées à une dominante production et à la présence du niveau III (BTSA).Compte tenu du fait que ces caractéristiques sont le plus fréquemment rencontrées dans les établissementspublics, une proximité entre ce statut et les actions de développement agricole est observée. Bienévidemment, la réunion de ces attributs dans des établissements privés jouent certainement d’une certainemanière en ce sens. Enfin, ces actions de développement agricole mobilisent peu ou pas d’enseignants etimpliquent peu le public d’apprenants. Les actions de développement territorial sont marquées par une proximité avec une offre de formationtertiaire, de niveau inférieur ou égal au niveau Vet éventuellement de niveau IV. Elles sont liées à l’absenced’exploitation agricole ou d’atelier technologique, à la faible présence d’ingénieurs, à un engagementimportant des enseignants et à l’implication d’un public d’apprenants. Compte tenu de ces caractéristiques,il n’est pas étonnant d’observer un lien avec les établissements privés à temps plein ou à rythme approprié. Les actions de développement mixte sont, elles, liées à la présence d’ingénieurs, à une ofre de formationde niveau III ou IV, à une mobilisation des enseignants et des apprenants ; une proximité est observée avecles établissements publics ou privés à temps plein.En résumé, il se dégage quelques variables explicatives d’un environnement interne de l’établissementfacilitatrices d’actions de développement.1/ Le fait qu’un établissement propose une offre de formation allant jusqu’au niveau III est un atout(80% des établissements ne menant pas d’actions ne proposent pas ce niveau).2/ La présence d’ingénieurs est un élément important pour mener des actions de développementagricole ou mixte.3/ la présence d’une exploitation agricole ou d’un atelier technologique et d’une ofre de formationdans le secteur de la production facilite les actions de développement agricole.De ce premier groupe de variables, il ressort indéniablement que l’EPL, du fait de son organisation, dela présence d’ingénieurs, de son offre de formation de niveau élevé est un milieu facilitateur de miseen oeuvre d’actions de développement, notamment de développement agricole.De façon plus générale, et ce quels que soit les établissements, l’existence d’une offre de formation deniveau élevé et de personnes qualifiées crée un environnement et des effets de « prise d’initiatives »favorables au développement du tissu économique et social du territoire de proximité : adaptabilité, capacitéd’initiative, dynamisme...73
Graphe 16 : AFCM Actions / EtablissementsLecture AFCMVariables prises en compteCaractéristiques des actions : 3 variablesChamp de l’action - 3 modalités :Développement agricole (D. agricole)Développement territorial (D.territorial)Développement mixte (D. mixte)Mobilisation des enseignants - 3 modalités :0 ou 1 enseignant (0-1 enseig)2 enseignants (2 enseig)3 enseignants et plus (3 enseig)Mobilisation des apprenants - 2 modalités :pas d’apprenants (non apprenants)apprenants impliqués (apprenants)Caractéristiques des établissements : 5 variablesStatut - 3 modalités :Public (PUB)Privé à temps plein (PTP)Privé à rythme approprié (PRA)Exploitation agricole ou atelier - 2 modalités :Présence (Exploitation)Absence (Pas exploitation)Ingénieurs - 2 modalités :O ou 1 ingénieur (ing 0)2 ingénieurs et plus (ing 2)Niveaux de formation - 3 modalités :V et inférieur (Max V)IV et inférieur (Max IV)Présence du niveau III (Niv III)74Spécialités de formation - 3 modalités :Production (Prod)Services (Serv)Production et services (Sect. mixte)
4/ Les enseignants sont surtout porteurs d’actions de développement territorial ou d’actions mixtes.5/ Les apprenants, à travers le projet pédagogique, sont plutôt associés à ces actions.6/ L’offre de formation dans le secteur des services génère des actions de développement territorial.De ce deuxième groupe de variables, il ressort que les établissements du privé sont un milieu propiceaux actions de développement surtout territorial, avec des freins que sont l’absence d’ingénieurs et / oud’exploitation agricole, et de filières complètes de formation.B- Les variables exogènesPour parvenir à s’insérer dans le milieu local, chaque établissement doit pénétrer des réseaux d’acteursexistants, voire contribuer à créer ceux qui n’existent pas et dont on peut supposer un intérêt réel pour ledéveloppement local. L’implication de tous les acteurs locaux, l’articulation avec des formationsuniversitaires ou des laboratoires de recherche dans le but de constituer un véritable « effet de filière » oude « pôle de compétences » va contribuer à valider l’hypothèse de l’établissement professionnel acteur dudéveloppement de son territoire de proximité.1/ Dans les relations de partenariats qui vont ainsi se nouer, on peut distinguer deux types d’acteurs externesqui se différencient par leur attitude : ceux qui utilisent la richesse, la diversité et la réciprocité des échanges avec les établissements etcontribuent à créer un contexte propice aux actions de développement.« Le développement ne se décrète pas ; il faut avoir un réseau de partenaires qui vousprennent en considération et pouvoir leur fournir des référentiels crédibles sur le plantechnique, économique et pédagogique. »Un proviseur d’EPL ceux qui perçoivent ces établissements comme des prestataires de services essentiellement auxpopulations du territoire (mission de formation).L’indicateur « partenariats » permet d’affirmer la « qualité » des actions de développement. Outre lespartenariats professionnels, la contractualisation s’opère également avec des partenaires politiques.D’autre part, cette entrée « partenariats » est une clé pour appréhender le territoire sur lequel l’établissementest acteur.Sous ce point de vue, on doit noter le rôle incitatif des CTE et du développement durable, qui réintroduisentla notion de territoire et repositionnent l’établissement du fait de ses missions d’exemplarité comme acteurde son territoire.2/ Les caractéristiques des territoires, leur mode d’organisation vont être des éléments importants dans lamise en oeuvre ou non d’actions de développement. Comme l’écrit Armand Frémont, on peut distinguerpour un établissement scolaire lié à la formation professionnelle deux types de territoires : les territoiresdes entreprises en relation avec les spécialités de l’établissement, les territoires de proximité.75
Avec les territoires des entreprises, et notamment quand ils coïncident avec celui de l’établissement —lorsque les spécialités portent sur l’activité agricole ou sur des services sociaux ou culturels deproximité — on se trouve dans la configuration traitée au paragraphe précédent, avec la mise en oeuvre despartenariats.En revanche, en ce qui concerne les territoires de proximité des lycées agricoles, le contexte a beaucoupchangé du fait de l’urbanisation, de la périurbanisation, voire de la métropolisation. De fait, les lycéesagricoles peuvent se trouver dans une situation qui n’a plus rien de rural. Si l’on exclut le cas desétablissements agricoles maintenant englobés dans des banlieues urbanisées (cas semble-t-il exceptionnels),on est confronté à trois problématiques territoriales qui ne sont pas sans effet sur les actions dedéveloppement : Les établissements situés dans un espace périurbain, rural encore pour une partie del’environnement, urbain pour les activités liées à une ville proche. C’est semble-t-il le cas denombreux établissements et cela implique un renouvellement des pratiques, un repositionnementde l’établissement. C’est le cas, par exemple, comme nous l’avons souligné, de l’EPL du Mansqui pose en credo du renouvellement de son projet d’établissement la nécessité de reconsidérer larelation agriculture-société. Mais ces territoires périurbains ont aussi généré des partenariats trèsforts entre collectivités territoriales, entreprises, universités, organismes de recherche, autournotamment des plates-formes technologiques.A l’inverse, la confrontation entre le périurbain et le rural peut générer des rigidités, l’absence departenariats et donc des difficultés à faire émerger des actions de développement : c’est le cas, parexemple, du lycée agricole de Toulouse-Auzeville qui a peu de liens avec son territoire deproximité (SICOVAL 1 ). Les établissements situés en zone rurale fortement productive du point de vue agricole (Bretagne,régions viticoles ou céréalières ou d’élevage). On est ici dans un cas de figure classique où lessynergies développées entre les établissements, la profession agricole, les acteurs du territoiresont historiquement fortes, et de fait ce sont des milieux propices à de nombreuses actions dedéveloppement. Les établissements situés dans des zones de faible peuplement, à agriculture et élevage peuproductifs, à villes petites ou moyennes, assez isolées. On peut subdiviser ces types de territoireen deux sous-groupes : les territoires en reconstruction ou en émergence et les territoires endifficulté. Les premiers sont surtout concernés par une problématique de « pays ». Lesétablissements agricoles en tant qu’acteurs du développement ont, semble-t-il, ici plus qu’ailleursune forte responsabilité à engager.« Dans un milieu rural en grande difficulté un établissement de l’enseignementagricole doit se comporter comme un acteur de développement à part entière. »Un directeur de MFRDans ces territoires, les partenariats noués avec les collectivités locales, les représentants de l’Etat,la profession produisent un contexte favorable à l’innovation et plus largement à la requalificationdes territoires et à la mise en oeuvre d’actions de développement.1Syndicat intercommunal du sud-est toulousain.76
C- Esquisse de typologie d’établissements et mode d’organisation :les éléments facilitateurs du développementOn peut considérer les établissements d’enseignement agricole comme un ensemble fortement diversifié,tant en termes de caractéristiques, que de registre de réputation, de stratégies. Le croisement de ces différentesvariables va influer sur la place et le rôle de l’établissement en tant qu’acteur du développement. On peutschématiquement proposer une grille de lecture afin de positionner l’établissement.Tout d’abord l’établissement intervient dans des registres de réputation différents 1 : l’excellence scolaire, l’excellence technique, l’innovation sociale, la remédiation scolaire, la polyvalence de proximité.Il est clair que ce sont les registres d’excellence technique, d’innovation sociale et de polyvalence deproximité (petits établissements en milieu rural) qui sont a priori un signal positif d’acteur dudéveloppement.Des stratégies telles que la construction de pôles de compétences, de mise en réseau ne peuvent queconforter ce rôle ; alors qu’à l’inverse des stratégies de « dépendance-sursis » ou d’« identité-équité » sontmoins favorables.A cela s’ajoutent les caractéristiques propres de l’établissement, telles notamment la nature de sonorganisation, son mode de fonctionnement.Enfin, comme nous l’évoquions dans le paragraphe précédent, les établissements se situent sur desterritoires aux dynamiques variables, qui influent sur l’engagement des établissements en termes dedéveloppement.Les tableaux ci-après tentent de schématiser les différents cas de figure rencontrés lors de nos investigations,en donnant du sens à ces multiples variables. On peut les lire de la manière suivante :Selon le type de territoire, nous avons imaginé une graduation, à quatre niveaux, de l’intensité des actionsde développement allant de faible à forte ; ceci à titre indicatif, la graduation restant relative. En face, nousavons essayé d’identifier le degré et le type de réputation de l’établissement ainsi que certaines de sescaractéristiques facilitatrices des actions de développement. Ainsi se dessine une typologie d’établissementsprédictive de l’intensité du rôle de l’établissement (ou de son absence) en tant qu’acteur du développementdans un contexte territorialisé. Des registres de réputation tels que pôle technique, innovation sociale oupolyvalence de proximité, complétés par des réseaux de partenaires, une offre de formation attractive, unprojet d’établissement fort construisent indéniablement un environnement facilitateur d’actions dedéveloppement au sein d’un établissement de formation.1On parle ici de registre de réputation dominant, étant entendu que pour un même établissement il peut y avoir des chevauchements.77
L’établissement, acteur du développementTerritoire périurbainDéveloppement, de faible à fortRéputationAtoneExcellence scolaireEn repositionnementInnovation socialeDimension nationale ourégionalePôle techniqueCaractéristiquesMéconnaissance desnouveaux acteurs dudéveloppementPeu de partenairesinstitutionnelsou professionnelsRéseau en constructionRéseau de partenairesAppartenance au milieuFilière de formationincomplèteOffre de formationattractive et de qualitéOffre de formationcomplèteOffre de formationattractive et complèteCentre de ressourcesTerritoire rural dynamiqueDéveloppement, de faible à fortRéputationRemédiation scolaireExcellence scolairePolyvalencede proximitéInnovation socialeInnovation socialePôle techniqueCaractéristiquesPartenairesinstitutionnels etassociatifsPeu de partenairesprofessionnelsRéseau de partenairessocio-économiqueset associatifsPartenariat avec lescollectivités localesServices multi-produitsRéseau de partenairesprofessionnels etinstitutionnelsRecherche FormationAncrage historiquedans le territoire78
Territoire rural en reconstruction ou en émergenceDéveloppement, de faible à fortRéputationIsoléSans projetEn repositionnementPolyvalencede proximitéDéveloppementde filièreInnovation socialeInnovation socialeEquipe enseignantsdynamiqueCaractéristiquesPartenariatde proximitéen constructionDéveloppement deréseaux deprofessionnels etd’institutionnelsDéveloppement deréseaux deprofessionnels etd’institutionnelsTerritoire rural en difficultéDéveloppement, de faible à fortRéputationIsoléSans projetPôle de développementEquipe d’excellence(le territoire au coeurde la cultureprofessionnelle desenseignants)CaractéristiquesUn projetd’établissement fortUn partenariatinstitutionnel etprofessionnel enconstruction(territorial etextra-territorial)79
III- Impacts des actions de développement :le cercle vertueux pour l’établissementA- Impacts sur le territoireLes exemples les plus visibles sont les cas de formation de systèmes locaux supportant des synergies fortesentre les différents acteurs où l’établissement agricole tient un rôle déterminant : plates-formestechnologiques, halls technologiques, pôles de compétences. Ici l’établissement joue un rôle primordial entermes d’aménagement du territoire. L’implication de nombreux acteurs locaux, l’articulation avec desformations universitaires, des écoles d’ingénieurs, des laboratoires de recherche dans le but de constituer unvéritable effet de filière, de pôle de compétences (la licence professionnelle est un excellent exemple)contribue à valider l’hypothèse de l’établissement agricole acteur du développement local.Parallèlement, les établissements positionnés sur un registre de réputation de proximité, soutenus par lescollectivités locales, la profession agricole ont un impact sur la vie sociale et économique de leur territoire :lutte contre les exclusions et les discriminations, développement culturel, actions en faveur de l’emploi,actions en faveur du développement durable et de l’environnement, etc.B- Impacts sur l’établissement : le cercle vertueuxLa mission de développement dans sa transversalité avec les autres missions apporte à l’établissement desavantages certains.Tout d’abord quand les actions associent enseignants et apprenants au sein d’un projet pédagogique, desimpacts sur les contenus, les modes d’apprentissage ne peuvent être que bénéfiques, avec aussi desavantages acquis en termes de citoyenneté et d’insertion sociale notamment.Mais les actions de développement ont aussi un impact important sur l’image de l’établissement, sanotoriété, sa réputation et ce auprès de tous les acteurs de son territoire, comme l’écrit Jean-Pierre CARDI,Proviseur du lycée horticole de Romans.« La participation d’un établissement à des actions de développement lui permetd’être reconnu par le monde professionnel et plus largement par tous les acteurs duterritoire. Il acquiert aussi une légitimité externe et interne ; légitimité externe ence sens que les partenaires le reconnaissent comme étant capable d’apporter unerichesse à son territoire ; légitimité interne en ce sens que les personnels, enparticulier enseignants, se ressentent comme participant à la vie d’un territoire»Jean-Pierre Cardi, Proviseur Lycée horticole de RomansEn favorisant l’innovation et la créativité professionnelle mais aussi sociale, en ouvrant l’établissementaux changements, les actions de développement vont avoir tout d’abord un impact sur son offre deformation.En étant à l’écoute des changements, en s’appuyant sur le registre de réputation de l’excellence technique,en échangeant des informations et des personnes avec la profession, l’établissement va créer un état de80
« veille technologique », facilitateur de régulation ou de création de nouvelles offres de formation, et ainsirépondre à l’émergence de nouveaux métiers, de nouvelles compétences.Mais ce registre de réputation de l’établissement construit autour des actions de développement va aussijouer sur la demande de formation et la qualité de la ressource humaine de l’établissement : c’est ainsi queva s’établir progressivement un cercle vertueux qui va générer le développement de l’établissement.La notoriété, l’image de l’établissement vont avoir indéniablement un effet d’attractivité sur la demande deformation : le vivier d’élèves, d’apprentis, de stagiaires, l’aire de recrutement de l’établissement ne pourrontque se développer qualitativement et quantitativement. De même, on pourra observer un effet d’attractivitéà l’égard de la ressouce humaine de l’établissement, tant par la venue d’intervenants professionnels dequalité que par une demande accrue des enseignants désireux d’exercer dans ce pôle de compétences. D’acteurdu développement de son territoire, l’établissement va devenir acteur de son propre développement. C’estainsi que la mission de développement, mission transversale aux autres missions va occuper une placeessentielle en termes de gestion stratégique des établissements : Production d’outils d’analyse de l’évolution économique et sociale : veille technologique,intelligence économique. Rôle de « conseil » auprès des institutions, des entreprises, des agriculteurs. Mutualisation et valorisation des compétences au service d’un territoire ou d’un milieu. Conception cohérente de projets de partenariatsdéveloppement.: pérennisation des actions de Régulation de l’offre de formation. Construction du registre de réputation de l’établissement tant en termes de communicationinterne (projet collectif) que de communication externe (image, notoriété).81
Les recommandations de l’ONEAA l’issue des travaux réalisés au cours de sa sixième année de fonctionnement, l’ONEA fait lesrecommandations suivantes :L’établissement de formation, acteur du développement Le développement, dans son acception la plus large, est au cœur des missions dévolues àl’enseignement agricole. Il participe de son identité, de sa place originale dans le paysageéducatif français. Les actions des établissements dans ce domaine témoignent du lien nécessaireentre la formation, la recherche et le développement. De ce fait, elles ont un rôle stratégiquedans la reconnaissance et la promotion de l’enseignement agricole. Elles doivent êtredéfendues, soutenues, valorisées. L’établissement constitue, du fait de son autonomie et de son expertise, un lieu de rencontreprivilégié entre les différents acteurs présents sur son territoire. A ce titre, il faut rappeler lerôle essentiel qu’il a à jouer pour son milieu en tant qu’acteur du développement. Face aux incertitudes et interrogations concernant le développement agricole et rural, lesétablissements ont la responsabilité particulière de concourir au renouvellement desproblématiques et des politiques dans ce domaine. On ne peut qu’encourager les expériences etappeler à l’ouverture d’une réflexion d’ensemble sur les pratiques. Toutefois, il nous paraîtimportant de souligner qu’il ne peut y avoir de développement sans orientations nationalesfortes. La mise en œuvre des actions de développement passe par des partenariats multiformes qu’ilnous paraît nécessaire de susciter, de renforcer et de formaliser, ainsi que par le renforcementdes collaborations de l’enseignement agricole avec les directions techniques du ministère auxdifférents niveaux territoriaux.A l’adresse de la DGERRessources humaines et compétences Les actions de développement nécessitent des capacités d’analyse et d’ingénierie : ingénieriedu développement dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des actions, ingénieriefinancière quant à l’élaboration de montages budgétaires de plus en plus complexes. Il estimportant de souligner le développement de ces nouvelles compétences dans l’exercice desdifférents métiers de la communauté éducative des établissements de formation agricole.82
Dans cette optique, il nous apparaît indispensable que soient proposées à l’ensemble despersonnels impliqués dans ces actions (ingénieurs, enseignants, administratifs, responsablesd’exploitation), et ce pour les plus jeunes dès leur recrutement, des sessions de formation surl’importance stratégique de ces actions et les moyens de leur mise en œuvre. Il convient à cesujet de souligner le rôle de relais essentiel que peuvent jouer les personnels en place en termesde transmission des savoirs et savoir-faire requis. Le rôle incontestable qu’ont joué et que jouent encore aujourd’hui les ingénieurs dans lesactions de développement des établissements de formation nous amène à attirer l’attention del’Administration sur la mission qui leur sera confiée à l’avenir quant au lien formation –recherche – développement.Pilotage national Les initiatives des établissements dans le champ du développement nécessitent desaccompagnements : administratifs, financiers, méthodologiques, scientifiques (capitalisationde la pensée, notamment). Elles réclament de plus la mise en place d’une véritable politiqued’évaluation, de veille et de prospective. Les réseaux thématiques et géographiques ont une fonction de diffusion et d’échangesdéterminante dans le soutien de ces actions. Il conviendrait d’en améliorer le pilotage national.A l’adresse des collectivités territoriales S’agissant des Régions, l’ONEA attire leur attention sur le caractère déterminant desmoyens affectés, en matière d’infrastructures d’accueil (amphithéâtres, centres deressources…), mais aussi d’orientations stratégiques des exploitations agricoles et atelierstechnologiques, dans la capacité d’action des établissements de formation. L’ONEA appelle par ailleurs l’ensemble des collectivités territoriales à mieux prendre encompte l’établissement de formation agricole comme vecteur du développement. Il apparaît àce titre pertinent de renforcer son intégration aux projets de territoires, dans toutes leurscomposantes, en soutenant la mise en place de partenariats formalisés.A l’adresse des établissements L’intégration des actions de développement au projet des établissements est essentielle à ladimension stratégique de leur politique. Cette intégration doit être étendue au voletpédagogique, trop souvent négligé. Une participation active des élèves aux actions, quel quesoit leur champ, est indispensable. Il est essentiel pour les établissements de mettre en œuvre une démarche de qualité, la qualitédu diagnostic conditionnant la qualité de l’action de développement et son impact. Cettedémarche doit aussi concourir à l’évaluation des actions. Les partenariats des établissements doivent être renforcés, diversifiés, pérennisés.83
Bibliographie B. Charlot — La territorialisation des politiques éducatives — In L’école et le territoire — A. Colin —1994 T. Charmasson, M. Duvigneau, A.M. Lelorrain, H. Le Naou — L’enseignement agricole, 150 ansd’histoire — Educagri éditions — 1999 C. Coulet — La problématique du développement territorial et la formation — Séminaire céreq — 1995 M. Le Doaré — L’institution scolaire et le territoire — Mémoire de DEA — Université de Grenoble —1995 F. Dascon, C. Miqueu — Collèges et lycées partenaires des territoires ruraux — Mairie Conseil —Documentation française — 1997 DATAR — Territoires ; Les Pays — La documentation française J.L. Hermen, J.C. Lugan — Systèmes de formation et territoires, vers un modèle de régulationpartagée — In mélanges J. Vincent — Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse — 1998 J.L. Hermen — Territoires et offre de formation, l’espace de formation, un lieu de régulation ? —Céreq — Formation-emploi — Décembre 1996 J.L. Hermen, J.C. Lugan — L’établissement éducatif et son environnement ; Pour une approcheméthodologique territorialisée de l’efficacité des systèmes de formation — In Revue Savoir n°6 —1994 E. Landais — Agriculture durable : les fondements d’un nouveau contrat social ? — INRA — Le courrierde l’environnement — Avril 1998 C. Miqueu — Le président du Conseil d’administration de l’EPLEFPA — ENFA — DGER — 1997 P. Perrier-Cornet — Repenser les campagnes — DATAR — Bibliothèques des territoires — L’aube —<strong>2002</strong> C. De Rycke — La formation : une nécessité pour accompagner les changements dans les exploitationsagricoles — Conseil économique et social — 2000 CEP de Florac — Formation, partenariats et territoire : un guide pour l’action — Educagri éditions —2001 Collectifs Céreq — Construction et régulation de l’offre locale de formation — Documents n°117 —1996 Céreq — Régions - Formation - Emploi : Démarches et méthodes — Etudes Céreq — 1991 Ministère de l’Agriculture — Enseignements agricoles et formation des ruraux — Actes du colloqueUNESCO de janvier 1985 — Agri Nathan International Ministère de l’Agriculture — DGER — Du diagnostic à la prospective — Actes des deuxièmes journéesdu Savoir vert — Arc et Senans — 1994 Ministère de l’Agriculture — DGER — Prospea : Synthèse des débats conduits dans l’enseignementagricole public — Avril <strong>2002</strong> Ministère de l’agriculture — Formation et territoire : quels liens ? — In Initiatives de l’enseignementagricole — Juin <strong>2002</strong> Ministère de l’Agriculture — DGER — <strong>Rapport</strong> de l’inspection de l’enseignement agricole — 1997 et2001 Collectif sous la direction de D. Minot — Le projet de territoire — Ministère de l’Agriculture —Bergerie nationale — Ecole des territoires — 2001 Les lycées agricoles : un laboratoire d’innovation grandeur réelle — Cahiers pédagogiques — 1990 Collectif sous la direction de S. Ertul — L’enseignement professionnel court post-baccalauréat — PUF— Collection Education et formation — Juin 200084
Le point sur ... Les journées d’étude de l’ONEA : Le rôle éducatif de l’internat Les licences professionnelles au ministère de l’Agriculture, del’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales85
Les journées d’étude de l’ONEALe rôle éducatif de l’internatI.N.A. Paris Grignon — 10 octobre <strong>2002</strong>87
Introduction du Président René RémondCette journée organisée à l’initiative de l’Observatoire national de l’Enseignement agricole est unepremière. Créé en 1996, l’Observatoire existe depuis six ans. L’arrêté qui définit ses missions et sescompétences et qui est notre charte lui confie comme activité principale l’élaboration d’un rapport annuel.L’Observatoire a déjà produit quatre de ces documents. La préparation du cinquième est aujourd’hui fortavancée. L’architecture de ces rapports comporte pour chacun, à côté du panorama qu’on s’attache à rendreaussi complet que possible et qui s’enrichit d’année en année, l’étude plus fouillée, appuyée sur une largeenquête, auprès des établissements, d’un ou deux thèmes. Le quatrième rapport publié à la fin de 2001,traitait de la vie sociale et culturelle des élèves avec une attention toute particulière pour l’internat. Celuiciest en effet un élément original de l’enseignement agricole, une composante essentielle de sa pédagogiepratiquée et peut-être un facteur de sa réussite. Autant de raisons pour lesquelles il avait semblé auxmembres de l’Observatoire qu’il méritait de faire l’objet d’une étude approfondie. C’est pour ces mêmesraisons et parce aussi que le temps avait manqué lors de la présentation du rapport au Conseil national del’Enseignement agricole pour un large débat que l’idée nous est venue de prolonger étude et réflexion enconsacrant à ce sujet toute une journée.Ce faisant, l’Observatoire est dans son rôle : organisme indépendant, habilité à se saisir des questionsqui lui paraissent le mériter, qualifié pour adresser des recommandations aux pouvoirs publics, travaillanten harmonie avec la direction générale et avec l’aide de l’administration, il est un lieu de réflexion.Nous partirons des constats établis par le rapport et des conclusions qui avaient été l’aboutissement del’enquête. On s’interrogera sur les motivations qui poussent les élèves à choisir d’être internes : choix libreou contraint ? On s’intéressera à l’articulation de l’internat avec l’enseignement comme avec les décisionsprises à cet égard par les collectivités territoriales. On se demandera en dernier lieu si la formule esttransposable à d’autres secteurs du système éducatif et à quelles conditions. On se gardera d’y voir unesolution « miracle » et plus encore de l’envisager comme un moyen de remédiation au mal scolaire.De ces intentions et de ces objectifs procède tout naturellement le déroulement de la journée quis’articulera en trois temps sous forme de trois tables rondes. L’animation sera assurée de tout en bout parles membres de l’Observatoire qui assume la responsabilité entière de la journée. Le succès rencontré dèsl’annonce de la journée, fixée initialement au 17 mai et qui avait dû être reportée en raison du calendrierélectoral et l’affluence aujourd’hui nous confirment dans la conviction que le sujet appelle et mérite toutensemble qu’on lui consacre un temps de réflexion.89
Les tables rondesPremière table rondeLe rôle de l’internat dans la vie sociale et culturelledes élèves des établissements de l’enseignement agricoleSous la présidence de Philippe LACOMBE, Directeur scientifique INRA (ONEA)Exposé introductif de Michel BOULET, Professeur ENESAD (ONEA)Avec la participation de :Jean-Pierre BASTIEYves BERGERONMichel BOURDAISJean-Luc CHEMORINGilles LIOBARDAgnès ZARAGOZAChef du SRFD d’AquitaineDirecteur du lycée privé de Ressins — LoireDirecteur de l’EPL d’Aix-Valabre — Bouches-du-RhôneInspecteur de l’enseignement agricole — Vie scolaireCPE du LEGTA d’Auzeville — Haute-GaronneDirectrice de la MFR La Bagotière — CalvadosDeuxième table rondeLe rôle des pouvoirs publics — Etat et collectivités territoriales —dans le fonctionnement des internatsSous la présidence de Joseph GAUTER, Professeur ENSA Rennes (ONEA)Avec la participation de :Jean-François BOUDYBrigitte FEVREMarie-Odile NOUVELOTClaude BINAUDMarie-Françoise PEROL-DUMONTBernard SAINT-GIRONSDirecteur régional de l’agriculture et de la forêt d’AquitaineSous-directrice de la politique des formations de l’enseignementgénéral, technologique et professionnel — DGER — MAAPAREnseignante ENESADPrésident de la Comission des lycées du Conseil régional dePoitou-CharentesDéputée de Haute-Vienne, Vice-présidente du Conseil généralRecteur de l’académie de Nice90
Troisième table rondeLes internats de l’enseignement agricole et de l’Education nationale :spécificités,différences, complémentaritésSous la présidence de François ORIVEL, Directeur de recherche IREDU (ONEA)Exposé introductif de Georges FOTINOS, Inspecteur d’académieAvec la participation de :Robert BALLIONThierry GIRODOTMichel LESCOLEDidier BARGASDirecteur de recherche CNRSProviseur du LEGTA de Mirecourt — VosgesIngénieur général du GREFInspecteur général de l’Education nationaleEtablissements et vie scolaireLa synthèse des tables rondes a été assurée par Michel DESCHAMPS (ONEA).Le texte qui suit reprend l’essentiel des éléments de cette synthèse.91
Synthèse des travaux présentée par Michel DeschampsIl est des réunions qu’il est facile de synthétiser tant le nombre d’idées qu’elles expriment estinversement proportionnel au nombre de mots utilisés. J’ai le sentiment qu’ici ont été exprimées, en peude mots, beaucoup d’idées essentielles.Cette diversité tient, je n’en doute pas à la qualité des participants, à l’attachement aussi que nousportons tous à l’enseignement agricole ; elle tient, peut-être surtout, au fait que l’internat est au cœur debeaucoup d’interrogations contemporaines sur ce que c’est aujourd’hui qu’enseigner, qu’éduquer.De ce point de vue, la coïncidence entre le choix de l’Observatoire national de l’enseignement agricoleet la volonté du ministre de l’Education nationale de relancer la réflexion sur l’internat exprime bien lesrésonances actuelles de ce thème.L’animateur de l’une de nos tables rondes s’est plu à jouer avec les mots en télescopant le conceptd’internat et celui d’internement. Cela n’avait rien de gratuit. Nous savons bien que certains pensent àaborder les questions posées, aujourd’hui, par la jeunesse – mais si c’était de légitimes questions ? – nonpas à partir d’une démarche privilégiant l’éducatif mais à travers le prisme de la clôture, de l’hébergement,de l’enfermement. Et c’est peut-être le premier apport de notre journée que d’avoir réfléchi aux formes quepeut prendre, aujourd’hui, un internat, à la fois plus et mieux intégré dans un projet éducatifglobal mais totalement ouvert. Oui, nous avons, avant tout, pensé l’internat comme un lieu desocialisation, d’éducation, d’enseignement qui ne coupe les jeunes ni de leur milieu social, ni de leurfamille, ni de leurs familiers. C’est peut-être là une première rupture avec la conception traditionnelle de «la clôture scolaire » reflétant, consciemment ou non, une certaine méfiance envers le milieu et les familles.Pour autant, nous avons insisté sur le fait que cette ouverture de l’institution scolaire devait êtremédiatisée, éducative : il ne s’agit pas seulement d’ouvrir les portes et de laisser entrer le monde. Il s’agit,par une action délibérée, d’en faire un sujet d’études, d’éducation, de socialisation.Tout au long de notre journée, nous nous sommes, à plusieurs reprises, interrogés sur l’avenir sansqu’aucun ne prétende savoir ce que seraient nos internats, nos établissements, l’enseignement agricole etson projet éducatif, même à l’horizon du moyen terme. Mais j’ai le sentiment que nous avons dégagéquelques questions clefs auxquelles il s’agit bien de répondre.De façon très arbitraire mais contraint par le nombre et la diversité des sujets abordés aujourd’hui, j’aisélectionné trois de ces questions.L’ordre dans lequel je les présente est un choix de présentation ; il n’implique aucune hiérarchie entre desthèmes qui me semblent tous essentiels. Vous les avez d’ailleurs continuellement entrecroisés tout au longde vos interventions.92
I – Quelles conditions concrètes du droit à l’internat ?Aucun intervenant n’a été tenté de négliger ou de sous-estimer les questions « matérielles ». Locauxadaptés, personnels non seulement en nombre suffisant mais en position stable et formés à leur mission,aides sociales apportées aux familles : sans cette attention portée aux conditions concrètes de l’internatnotre journée n’aurait été que bavardages.Mais il s’en faut que vos interventions aient enfermé ces questions dans le quantitatif immédiat. Ledéveloppement de l’internat est inséparable de son amélioration et vous avez, le plus souvent, articulé lesquestions matérielles au projet éducatif qui les légitime.D’abord en soulignant l’importance déterminante de la formation des personnels, directement ouindirectement concernés par l’internat, y compris, avez-vous souhaité, en privilégiant des formations intercatégorielles.C’est une des conditions du travail en équipe que vous souhaitez, je crois, trèsmassivement. Mais il implique, ont fait remarqué plusieurs d’entre vous, que les emplois du temps, lescharges de travail permettent bien de dégager les temps de concertation, d’échanges de réflexion en communindispensables. C’est ainsi que vivra une communauté éducative réelle - « Une équipe soudée » -dans chaque établissement. Et plusieurs d’entre vous ont tenu à souligner le rôle, au sein de cettecommunauté éducative, des personnels d’accueil de service, de restauration scolaire.Mais cette communauté n’est possible avez-vous ajouté que si le rôle éducatif de chacun desadultes intervenant dans l’établissement est « clairement défini ».Nous n’avons pas besoin de plus « d’adultes » dans les établissements scolaires, comme on l’entenddire parfois de façon très approximative, mais de plus de professionnels. Et tout projet de réforme éducativedevrait privilégier la professionnalité, sa reconnaissance et son renforcement, des acteurs d’éducation. Maisencore faut-il que cette professionnalité, celle du proviseur, de l’enseignant, du conseiller d’éducation, dumaître d’internat, de l’aide éducateur, de l’agent, de l’infirmier … ainsi reconnue, précisée, renforcée, ne soitpas vécue comme légitimant le repli de chacun sur son propre savoir-faire.Encore faut-il qu’elle soit perçue comme un atout « pour trouver des solutions, ensemble », au sein del’équipe globale. Organiser les temps de rencontre entre les différents acteurs est, évidemment, essentiel.La description, faite par l’un d’entre vous, d’un établissement scindé en une « équipe de jour » et une« équipe de nuit » relève d’un scénario-catastrophe. Mais il ne s’agit pas seulement d’un problèmed’organisation et des moyens de cette organisation. Nous avons besoin d’une vraie réflexion (« unethéorisation » a même souhaité une intervenante) avec la contribution spécifique de chacun àl’équipe éducative commune.Ces contributions, les rôles et les professionnalités auxquels elles renvoient ne peuvent être considéréscomme, à tout jamais, arrêtés.Tandis que certains d’entre vous évoquaient le « vieillissement des personnels en place », nous avonsabordé les évolutions démographiques qui vont conduire à renouveler une partie importante de ces équipes.Ce n’est pas un phénomène propre à l’enseignement agricole, mais il nous pose deux nouveauxquestionnements, à la fois distincts et complémentaires.93
Premier questionnement : allons-nous savoir attirer aux métiers de l’enseignement et del’éducation les dizaines de milliers de jeunes dont va avoir besoin l’enseignement dans la décennie quivient, alors que, dans le même temps, l’ensemble de la Fonction publique et les entreprises privées vontavoir les mêmes besoins de recrutement, notamment en jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ?Deuxième questionnement, lié : allons-nous savoir, à la fois, transmettre à ces futurs jeunescollègues les valeurs qui donnent sens aux aspects techniques des professionnalités mais aussi leurfaire suffisamment confiance pour faire évoluer l’organisation et les métiers de l’Ecole de demain ?« Opportunité formidable » a dit l’un d’entre vous. Saurons-nous la saisir ?Notre journée de travail ne pouvait qu’attirer l’attention sur l’enjeu sans avoir le temps de le préciserdavantage. J’ai le sentiment que, contrairement à la crainte exprimée par l’un des intervenants de cet aprèsmidi,nous souhaitons bien voir abordée « sans tabou » cette question de l’évolution des professionnelsdans l’Ecole. Les métiers de l’Education du 21 ème siècle seront-ils identiques à ceux du 20 ème siècle ?Notre journée de travail n’a fermé aucune porte mais insiste fortement sur le devoir d’anticiper et surl’urgence d’une réflexion collective forte.Le besoin d’évolutions concertées doit aussi concerner l’architecture scolaire. Je regrette de nepouvoir reprendre, ici, faute de temps, cette partie passionnante de nos débats. Tout juste puis-je faire étatde ce sentiment, largement partagé, que l’innovation, la modernisation auxquelles, de toutes parts, sontinvités nos systèmes éducatifs s’accommoderaient mal d’une reconduction à l’identique des conceptions ducadre de vie scolaire, en général et de celui de l’internat, en particulier. Beaucoup a été fait en matière deconstruction et de restauration des locaux. L’audace architecturale – la bonne : celle qui prend en compte etanticipe les évolutions éducatives – semble plus rarement au rendez-vous. Faut-il parler de« conservatisme » de nos édiles régionaux ? La qualité des interventions des élus de collectivités territorialesqui ont pris la parole, ce matin, comme les promesses, voire déjà les résultats d’une concertation réelle,dans un certain nombre de collectivités, nous ont plutôt rassuré.II – Comment adapter mieux l’internat aux attentes nouvelles des jeunes ?Le constat de l’évolution de l’attente des jeunes (mais aussi celle des familles et celle de la société)envers la vie scolaire et, notamment, envers l’internat, comme la volonté d’en tenir compte étaientcommuns à l’ensemble des intervenants.Mais ces attentes sont-elles si claires, si convergentes, si facilement traduisibles en réponses éducativesprécises ? Notre journée a, d’une certaine façon, oscillé entre deux tentations :- Insister plutôt sur « la diversité croissante » de nos « nouveaux internes »- Mettre en lumière les constantes des attentes des générations nouvelles par rapport à cellesde leurs aînés.Hésitation renforcée par le fait que nous disposons de peu d’enquêtes, de peu d’études qui nous permettraientd’aborder de façon moins subjective les attentes de jeunes aujourd’hui. C’est aussi une des ambitions del’Observatoire national de l’enseignement agricole que de contribuer à cette connaissance par ses enquêtesannuelles auprès des établissements, et, aussi souvent que possible, auprès des élèves.94
À partir de nos expériences, nous avons privilégié, dans nos interventions, les réponses de l’internataux besoins d’éducation et de socialisation des jeunes, en termes de construction des comportements,d’épanouissement individuel, d’échanges au sein d’une même génération - « le jeune se construitavec les jeunes » - de formation à la citoyenneté.Je regrette, notamment sur ce dernier point, de ne pas pouvoir faire écho à nos échanges.Avons-nous eu tendance à « embellir la réalité », à gommer les réalités vraies de l’internat, à taire lesconduites à risques des jeunes que l’internat n’empêche pas et, peut-être, « favorise » ?Un participant à notre dernière table ronde nous l’a un peu reproché, à partir d’une interventionremarquablement argumentée. Avant lui, un témoignage bouleversant nous avait rappelé quellesconséquences dramatiques peuvent avoir les difficultés de vivre des adolescents et des jeunes adultes quenous accueillons. Parce qu’ils sont des lieux de vie, nos internats ne peuvent pas ne pas être aussi des lieuxde risques.Nous ne pouvons évidemment pas en rester là.Nous trouvons dans ces difficultés confirmation de l’exigence, plusieurs fois répétée aujourd’hui, d’uneformation plus approfondie des éducateurs ; j’insisterai également, mais à titre plus personnel carje crois que le sujet n’a pas été aussi directement abordé, sur la nécessité d’un renforcement de lamédecine scolaire et de son rôle de prévention, d’écoute, de soutien.Mais c’est sans doute la conception pédagogique même de l’internat qui doit être repensée.Vos interventions ont posé la question de la façon suivante :Notre approche de la vie en internat reste une approche collective, gommant, dans les faits, la nécessaireprise en compte des besoins individuels des internes. Notre système éducatif reste d’ailleurs globalementmal à l’aise avec les démarches d’individualisation.Le découpage des temps de vie scolaire, les règles de circulation au sein des établissements, la naturedes activités périscolaires proposées … ne sont que rarement pensés à partir de cette double dimension :apprentissage (et contraintes) de la vie collective – individualisation de la réponse éducative.L’enquête conduite par l’ONEA, dans ses réponses notamment sur les modes d’élaboration etd’appropriation des règlements intérieurs des établissements, est très révélatrice. Mais lesproblèmes posés appellent autre chose qu’une simple mise à jour des règles de vie dans l’internat et dansl’établissement. Ne faut-il pas repenser même certaines des spécificités dont nous sommes les plus fiers ?On voit bien que les formes actuelles des activités non scolaires : culturelles, socio-éducatives … posentun certain nombre de questions, y compris sur le lien entre la fonction proprement didactique de l’Ecole etsa fonction éducative.Les internes questionnés ne sous-estiment pas l’aide au travail scolaire, à la réussite des études que leurpermet l’internat, non seulement parce qu’il les met à l’abri des dispersions de la vie hors Ecole, parce qu’ilorganise l’étude, mais aussi parce qu’il favorise l’aide réciproque, entre pairs, en une sorte «d’enseignementmutuel » revisité. Pour eux, l’internat est bien, aussi, un lieu de travail. Cette donnée devraitnous prémunir contre l’erreur qui consiste à séparer la fonction didactique de la fonction proprementéducative, mieux reconnue, de l’internat.95
Une erreur à laquelle le rapport de l’ONEA n’a pas totalement échappé, si j’en crois les critiquesformulées par deux intervenants sur notre proposition de « charte de l’internat ». Au fond, constatant quel’internat, malgré la place effective qu’il occupe dans l’enseignement agricole, n’avait jamais fait l’objetd’enquêtes, d’études, d’évaluation, ni même de textes réglementaires d’ensemble, qu’il avait été un peulaissé de côté, nous avions voulu, par cette proposition de charte, lui rendre son caractère central. Mais cefaisant nous risquions tout autrement de l’isoler des autres réalités scolaires. Ce dont il s’agit c’est deprendre en compte la globalité du jeune scolarisé, élève et interne, engagé dans des activités de socialisation,dans des activités sportives, dans des activités culturelles et engagé dans des activités d’acquisition deconnaissances et dans un projet professionnel.Le lien entre l’internat et le projet professionnel proprement dit n’a fait l’objet que d’une seuleintervention mais tout à fait captivante. Par contre, la conviction que l’internat ne prend tout son sens ques’il est intégré dans un projet éducatif global, porté par l’ensemble de l’établissement, a suscité unlarge accord.Et nous n’avons eu garde d’oublier les rôles respectifs des parents et des partenaires professionnels del’établissement, même si leur représentation relativement faible à notre journée - il faudrait veiller à cetaspect dans les éventuelles prochaines initiatives de ce type – a pu minorer leur expression.III – Quelles responsabilités nouvelles des pouvoirs publics et des collectivitésterritoriales ?Les Régions ont déjà la responsabilité des constructions scolaires et de leur entretien, et donc celle desinternats. Mais notre journée de travail se tient alors que sont annoncés de nouveaux basculements de tutelleau profit des collectivités territoriales, y compris, semble-t-il, dans le domaine de l’éducation.Je n’ai pas senti ici de craintes a priori devant cette évolution annoncée mais ont été, par contre, formuléesdes exigences fortes :- d’égalité entre les territoire s- de transparence et de démocratie dans la prise de décision publique- de cohérence nationale du système éducatif.Ce sont là des exigences généralement associées à l’idée qu’on se fait du rôle de l’Etat même si, dansle passé, il l’a souvent bien mal rempli. Cependant, ce n’est pas dans les carences actuelles de l’Etat qu’ilfaut chercher les domaines de la décentralisation, mais dans une volonté partagée, par l’Etat et par lescollectivités territoriales, de mieux répondre aux besoins exprimés en matière d’enseignement, deformation, d’éducation des jeunes.Et c’est pourquoi plusieurs intervenants n’ont pas craint de bousculer déjà les partages de compétencesannoncés pour insister sur l’importance d’activités et de réalisations inter-régions, sur lacoopération entre les communes (celle qui est siège de l’établissement, celles qui accueillent sesantennes … et toutes celles qui envoient les élèves), sur la nécessité d’équipements collectifsouvert s, dans une logique de service public, même si à multipropriétés. Doivent se conjuguer le souci derationalité économique, le maintien du maillage du territoire en établissements d’enseignement etd’éducation de qualité, l’amélioration de l’insertion de ces établissements dans leur milieu.96
Le sens des responsabilités et les capacités d’initiative des acteurs locaux sont directement concernés.C’est un atout pour l’enseignement agricole que d’avoir noué, depuis longtemps, des relations et despartenariats territoriaux forts. Mais si l’Etat, en mettent en œuvre une nouvelle étape de décentralisation,entendait, en quelque sorte, se faire oublier en se détournant de ses responsabilités éducatives, il setromperait lourdement. Je n’ai pas compris que nos interventions allaient en ce sens et exprimaient moinsd’exigences envers l’Etat, en ses niveaux national et académiques : « l’internat a été trop longtemps délaissépar ses responsables » pour que l’Etat soit quitte.Et c’est pourquoi vous avez insisté sur les responsabilités budgétaires de l’Etat mais aussi sur laresponsabilité de conduire les évolutions institutionnelles annoncées dans des conditions qui ne fragilisentpas le système éducatif, qui n’affaiblissent pas sa capacité à produire de la cohérence nationale et àcontribuer à notre devenir commun.97
Les licences professionnellesau ministère de l’agriculture,de l’alimentation, de la pêcheet des affaires rurales99
Les fondements des licences professionnellesCréée en novembre 1999, la licence professionnelleconstitue un diplôme original qui vise àrépondre à de nouveaux enjeux en termes de formationqualifiante et d’insertion professionnelletant au plan national que dans le cadre européen,et qui s’inscrit dans une démarche innovante pourles universités dès sa phase d’élaboration.La licence professionnelle répond aux objectifsd’intégration à l’espace européen de l’enseignementsupérieur. Diplôme reconnu deniveau II, il se situe au premier niveau de l’architecturedite du « L.M.D. », au grade de licence. Ilparticipe à la diversification des parcours et sepositionne dans un cadre pluridisciplinaire tel quel’ont défini les ministres européens de l’éducation.Il doit intégrer l’acquisition «d’une compétenceen langues vivantes». «Une partie de la formationpeut être accomplie à l’étranger». Enfin,il doit satisfaire aux exigences d’insertion professionnelledans l’espace européen.La licence professionnelle a tout d’abord unobjectif d’insertion professionnelle. Elleest notamment conçue pour répondre aux nouveauxbesoins de formation perçus face à l’émergencede nouveaux métiers, de nouveaux champsd’intervention, à la transversalité des compétencesrelatives, et à la nécessité d’un niveau de qualificationprofessionnelle correspondant àun niveau d’emploi intermédiaire entrecelui des techniciens supérieurs et celui des cadressupérieurs ou ingénieurs. Elle est destinée àconduire «à l’obtention de connaissances et decompétences nouvelles dans les secteurs concernéset ouvre à des disciplines complémentaires outransversales». Elle doit «apporter les fondementsd’une activité professionnelle et conduire à l’autonomiedans la mise en oeuvre de cette activité»,«donner à ses titulaires les moyens de faire faceaux évolutions futures de l’emploi [...] et leurpermettre de continuer leur parcours de formationdans le cadre de l’éducation tout au longde la vie». Ce diplôme se doit donc de combinerprofessionnalisation, pluridisciplinarité etexigences académiques d’un niveau II de formation.Ces orientations nécessitent un engagement particulierdes universités et écoles de l’enseignementsupérieur et la mise en oeuvre de partena-riats étroits avec le milieu professionnelet l’enseignement professionnel et technologiquepost-baccalauréat (Lycées, IUT) ;ces partenariats doivent intervenir dès la conceptiondes licences. Ils entrent en jeu tant en termesde définition des formations au vu des opportunitésd’insertion sur le marché du travail, d’adaptationde la formation aux besoins en compétencesque d’interrelations entre apprenants et professionnelsdans le cadre de la formation.Une autre exigence porte sur l’organisation pédagogiquede ces licences professionnelles. Visantun public diversifié, jeunes en formationinitiale, adultes en formation continue, elles doiventêtre pensées, du point de vue de leur architecture,pour prendre en charge cette multiplicitédes publics et permettre des parcours différenciés,en intégrant la validation des acquis professionnels,la formation en alternance. Pourrépondre à ces objectifs, la licence professionnelle«articule et intègre enseignements théoriques,enseignements pratiques et finalisés, apprentissagede méthodes et d’outils, période de formationen milieu professionnel». Dans sa structurationmême, elle «réalise une mise en contact réelle del’étudiant avec le monde du travail». «La formationfait, en tant que de besoin appels aux nouvellestechnologies de l’enseignement et à desmodalités pédagogiques innovantes».Dans cette nouvelle offre de formation, l’enseignementagricole, dont les écoles supérieures peuventdélivrer le diplôme en cohabilitation avec lesuniversités, s’est montré très prompt à s’engagerdans les secteurs d’activité qui lui sont dévolus. Ilfaut dire que ce système est entré dans ce projet delicence professionnelle fort de son expériencetant en termes de pédagogie innovante et d’articulationentre savoir généraux et savoirs techniques,que de partenariat avec le milieu professionnel.Ce positionnement historique de l’enseignementagricole, son ouverture et sa capacité d’innovationsont autant d’éléments appuyant son désir d’êtrepartie prenante dans cette voie. En contrepartie, lalicence professionnelle offre une opportunité pourles établissements agricoles, surtout les lycées, deprolongement de leurs cursus, avec les enjeuxinhérents en termes de poursuites d’études de leursélèves et de développement de la capacité d’actiondes institutions de formation, par un meilleurpositionnement en termes d’image, de notoriété.101
L’offre de formationUne licence professionnelle sur dixest mise en oeuvre en partenariatavec l’enseignement agricoleEn 2000, onze licences professionnelles en partenariatavec l’enseignement agricole ont été habilitées.En 2001, ce sont vingt nouvelles licencesqui sont créées. Au total, à la dernière rentrée, 59licences professionnelles, auxquelles concourentdes établissements de l’enseignement agricole,ont été habilitées sur un total de 610, tous ministèresconfondus. En <strong>2002</strong>-2003, l’enseignementagricole collabore donc à près de 10% des licencesprofessionnelles existantes au plan national.Licences mises en oeuvreen partenariat avec l’enseignement agricole- Nombre cumulé1131592000 2001 <strong>2002</strong>Licences ayant recruté- Nombre cumuléUne large palette de secteurs de formationinvestis dans le champ du MAAPAR1028532000 2001 <strong>2002</strong>Cependant, toutes ces licences ne sont pas entréesen fonctionnement suite à leur habilitation troptardive ; 53 d’entre elles accueillent des étudiantsen <strong>2002</strong>.Les licences professionnelles sont regroupéesdans 46 dénominations nationales, réparties sur 8secteurs professionnels : Agriculture, Pêche, Forêt et Espaces verts Production et Transformations Génie civil, Construction, Bois Mécanique, Electricité, Electronique Echange et Gestion Communication et information Services aux personnes Services aux collectivités.Les licences mises en oeuvre en partenariat interministérielavec des établissements de l’enseignementagricole touchent à 7 secteurs décomposés àpartir des dénominations nationales, secteurs quirendent compte de la diversité des activités professionnellesrelatives au champ d’action de l’enseignementagricole. On distingue ainsi les 6groupes de dénominations suivants : Agriculture - Développement durable -Aménagement du territoire Eau Agroalimentaire Forêt - Espaces verts Commercialisation Environnement.A ces six groupes, s’ajoute un groupe «divers»qui comporte une formation en <strong>2002</strong> :« Nouveaux métiers de la formation, nouvellescompétences du formateur » (Université deDijon — ENESAD).Le tableau suivant donne le nombre de licenceshabilitées au total depuis la rentrée 2000 selon lessecteurs précédemment cités.Nombre cumulé de licences professionnelles habilitéespar secteur de formationAgricultureDéveloppement durableAménagement du territoireEauAgroalimentaireForêt Espaces vertsCommercialisationEnvironnementDivers2000532—1——20011141114——<strong>2002</strong>Total 11 31 59Deux secteurs de formation dominent en <strong>2002</strong>dans l’offre de formation qui engage l’enseignementagricole : l’agriculture, le développementdurable et l’aménagement du territoire (24 licencesprofessionnelles sur les 59 relevant d’un partenariatavec un ou plusieurs établissements soustutelle du Ministère de l’Agriculture, del’Alimentation, de la Pêche et des AffairesRurales) et l’agroalimentaire (18 sur 59).244184531102
Des activités professionnelles en lien avec lesnouveaux enjeux sociétaux vis-à-vis du mondeagricole et ruralLes formations proposées dans le cadre de ce nouveaudiplôme professionnel de niveau II en coopérationavec les établissements de l’enseignementagricole dénotent de l’attention forte portée par lesystème éducatif et les professionnels aux préoccupationset exigences renforcées de la sociétévis-à-vis du respect de l’environnement, de la qualitédes produits agricoles et agroalimentaires,d’une gestion équilibrée de l’espace, de la qualitéde vie hors des villes... Elles témoignent aussi dela veille assurée par ces acteurs quant aux métiersen émergence liés.Quelques exemples de dénomination de licencesprofessionnelles mises en place, parmi d’autres,illustrent très clairement cette orientation : Valorisation, animation et médiationdes territoires ruraux Promoteur du patrimoine rural Agent de développement en milieu rural Agriculture et développement durable Agriculture raisonnée :gestion agri-environnementale des systèmesde culture Des agrosystèmes aux territoires Management des organisationsdans le monde rural IAA : Management des risques industriels Sécurité sanitaire des aliments Contrôle qualité des produitsissus de l’agriculture et de la mer Aménagement du territoire et urbanisme :espaces périurbains. Agrodéveloppement et commerceinternationalLes champs de compétences visés sont plus généralementen accord avec les grandes orientationsdonnées à l’enseignement agricole, quel que soitle niveau de formation considéré : une productionagricole davantage respecteuse de ses environnements,la prise en compte des enjeux liés à lasituation périurbaine des activités agricoles, unequalité et une sécurité accrue des produits, la préservationet la gestion des espaces naturels, lavalorisation du patrimoine, l'animation rurale.Ces thèmes sont notamment dominants dans lesactions de développement menées par les établissementsde l’enseignement secondaire agricole(voir notre étude dans le présent rapport).Ce nouveau diplôme participe donc à terme de lamission de développement de l’enseignementagricole, par la formation de ressources humainesaptes à maîtriser de nouvelles problématiques et àanticiper les changements, et contribue à conforterdes pôles de compétences, systèmes localisésde formation «porteurs» d’actions de développement. Gestion des ressourceset production d’eau Technologie et gestion des eaux de santé Création d’activités nouvelles enagroalimentaireIl faut noter qu’au total 36 licences professionnellesont été habilitées depuis 2000 dans lechamp de l’enseignement agricole mais sansson partenariat. Développement, rechercheen arts culinaires industrialisés103
Les partenariatsLa majorité des licences habilitées mettent enoeuvre un partenariat université - lycéeLes licences professionnelles dans lesquelles estengagé l’enseignement agricole sont fondées surdes partenariats divers. Mais, en <strong>2002</strong>, le bilan serévèle particulièrement favorable pour les établissementssecondaires de l’enseignement agricolequi participent à la quasi totalité des formations,principalement le secteur public. En effet, sur les59 licences habilitées à cette date, 53 font appel àun partenariat avec un lycée public ou privé agricole.Parmi celles-ci, 42 engagent un EPLEFPAet 14 un lycée privé, 3 relevant des deux statutsd’enseignement.Les licences professionnelles habilitéesselon le type de partenariat en <strong>2002</strong>Type de partenariatUniversitéEcole supérieure agricole publiqueUniversitéEcole supérieure agricole privéeUniversitéEcole supérieure agricole publiqueEPLEFPAUniversitéEcole supérieure agricole publiqueLycée agricole privéUniversitéEcole supérieure agricole privéeLycée agricole privéUniversitéEPLEFPAUniversitéLycée agricole privéUniversitéEPLEFPALycée agricole privéNombre delicencesTotal Ecoles supérieures agricoles publiques 16Total Ecoles supérieures agricoles privées 25192130Total EPLEFPA 42Total Lycées agricoles privés 14Les écoles supérieures agronomiques (publiquesou privées) relevant du Ministère de l’Agriculture,de la Pêche, de l’Alimentation et des AffairesRurales ne sont, elles, partie prenante que dans 18des licences professionnelles habilitées. Ceci peuts’expliquer par les enjeux inhérents à la mise enplace de ces licences pour les différents établissements: ces nouvelles formations constituent83incontestablement une opportunité forte pour lesétablissements du secondaire de prolonger leuroffre de formation jusqu’au niveau II, d’élargirleur champ d’action et d’accroître leur crédibilité.Par ce biais, ils rehaussent leur image et renforcentleur attractivité vis-à-vis des acteurs et partenaires: vivier d’élèves potentiel, enseignants etformateurs susceptibles de postuler un emploi,acteurs professionnels et économiques avec lesquelsils coopèrent notamment dans le champ dudéveloppement, etc. Tout au moins, il apparaîtque la participation des lycées agricoles à unelicence professionnelle place leur offre de formationde niveau III existante (BTSA) dans une perspectiveélargie ; ce qui induit une meilleureconfiguration de ces bac+2, en particulier quant àla qualité et l’ampleur du recrutement tant des élèvesque des enseignants.Pour les établissements supérieurs agronomiques,les enjeux se posent en de tout autres termes. Lalicence professionnelle permet une diversificationde l’offre de formation, mais se positionne dansun créneau qui n’est pas celui du fonctionnementhabituel des écoles, tout au moins pour cellesrecrutant en majorité des élèves issus de baccalauréatsscientifiques et passés par les classes préparatoiresgénérales. Pour celles des écoles quiciblent l’excellence du cursus d’ingénieur, lalicence professionnelle ne revêt sans doute pasl’intérêt que peuvent y porter les établissementsdu secondaire. Au-delà, la licence professionnellenécessite une implication différenciée des enseignantsen comparaison de leur cadre d’activitéhabituel. Cependant, ce diplôme offre de nouvellespossibilités de coopération des écoles avec l’université,tant en termes d’enseignement que derecherche, qui peuvent inciter les écoles à s’engager.Il n’en reste pas moins en effet que 13 établissementsde l’enseignement supérieur agricole (dontdeux privés) sont partenaires d’une licence professionnelleà la rentrée <strong>2002</strong>, c’est-à-dire la majoritédes écoles sous tutelle du MAPAAR.Comparativement 43 EPLEFPA (sur 216 lycéespublic) et 11 établissements de l’enseignementsecondaire privé (sur 642) y collaborent.104
Une orientation vers l’agroalimentaire pourles établissements publics, tant secondairesque supérieurs ; vers la forêt et les espacesverts pour les lycées privés...mais une dominante agriculture, développementdurable, aménagement du territoirepour l’ensemble des établissementsDans les partenariats mis en place, outre la dominationdes secteurs de l’agriculture, développementdurable, aménagement du territoire et de l’agroalimentaire,on note que les établissementspublics, écoles ou lycées, mais aussi les lycéesprivés ont investis l’ensemble des secteurs, telsque définis précédemment. L’activité des établissementssupérieurs privés à cet égard est pluslimitée : deux licences sur les 59 répertoriées lesconcernent, toutes relevant du secteur « agriculture,développement durable, aménagement duterritoire ». Pour ce qui est des lycées, comptetenu de leur participation relative, il apparaîtque pour l’instant les établissements privéssont un peu plus impliqués que les établissementspublics dans le secteur de la forêt et desespaces verts, et dans une moindre mesure de del’eau, de la commercialisation et de l’environnement.Le public a lui fortement pris positiondans le domaine de l’agroalimentaire. Ceci rested’ailleurs vérifié pour les établissements supérieursde l’enseignement public.pour en savoir plus...voir listes des intitulés de licenceset partenariats en annexeLes licences professionnelles habilitéesselon le type de partenariat par secteur de formation en <strong>2002</strong>Type de partenariatet secteurAgriculturedvlpt durableAmgt territoireEauForêtEspaces vertsAgroalimentaireCommercialisationEnvironnementDiversEnsembleUniversitéEcole supérieure publique12115UniversitéEcole supérieure privée11UniversitéEcole supérieure publiqueEPLEFPA41319UniversitéEcole supérieure publiqueLycée agricole privé112UniversitéEcole supérieure privéeLycée agricole privé11UniversitéEPLEFPA1221113130UniversitéLycée agricole privé32218UniversitéEPLEFPALycée agricole privé1113TotalEcoles supérieures publiques615111116TotalEcoles supérieures privées22Total EPLEFPA 1711411242Total Lycées agricoles privés 61231114Total par secteur 24 4 18 4 5 3 1 59105
La carte des établissements agricoles partenaires en <strong>2002</strong>Des partenariats répartis sur la quasitotalité du territoire, malgré des inégalitésentre régionsVingt régions de France métropolitaineaccueillent au moins un établissement de l’enseignementagricole (secondaire ou supérieur, publicou privé) partenaire d’une ou plusieurs licencesprofessionnelles.Seule la région PACA est exclue de ces coopérations,concernant l’enseignement agricole.Certaines régions, à l’inverse, se distinguent entermes d’offre : en premier lieu la région Rhône-Alpes (11 licences), mais aussi le Nord-Pas-de-Calais (6 licences), l’Aquitaine (5), les Pays de laLoire (5). L’Auvergne et le Limousin ont unelicence en commun, de même que la Franche-Comté et la Bourgogne.NB : L’ENGREF est en partenariatavec l’UniversitéAntilles-Guyane et l’INRAdans le cadre d’une licencedans le domaine de l’environnement.1 Nombre de licences dans la régionSecteurs des licencesGuide de lecture : Sont représentés les établissements agricoles partenairesd’une licence professionnelle. Le secteur de la licenceconsidérée est codé par une couleur (voir légende ci-contre).Lorsque plusieurs établissements sont partenaires d’une mêmelicence, chaque établissement est indiqué, mais relié aux autres partenaires.Lorsqu’un établissement est partenaire de plusieurs licences,il est représenté autant de fois qu’il coopère, chaque point portantla couleur correspondant au secteur de la licence considérée.106
Les étudiants : premier bilan en <strong>2002</strong>Une croissance supérieure à la moyennedes effectifs des licences professionnellesLes licences professionnelles mises en place enpartenariat avec l’enseignement agricoleaccueillaient au total 235 étudiants en 2000-2001.Dans le même temps, ce sont 4364 étudiants quiintégraient ces formations, toutes licences professionnellesconfondues, au plan national. A cettedate, les effectifs de formés dans les licences intéressantles établissements de l’enseignement agricolereprésentaient ainsi 5,4% des effectifs globaux.A la rentrée suivante, les effectifs liés àl’enseignement agricole croissaient de manièreplus importante que les effectifs globaux :+157% à 605 étudiants pour +107% à l’ensembledes licences professionnelles à 9038 étudiants. Ilscomptent alors pour 6,7% des effectifs totaux.En <strong>2002</strong>, ce sont 1115 étudiants qui sont inscritsen formation dans les licences professionnellesauxquelles participent le MAAPAR ; la progressiondes effectifs est encore très forte : +84%.Evolution des effectifs des licences professionnellesmises en place en partenariat avec l’enseignement agricoledepuis la rentrée 2000Une majorité des étudiants en licenceprofessionnelle inscrits dans le cadre dela formation initialeLa formation initiale (hors apprentissage) est lemode de formation dominant, en termes d’effectifs,pour les licences professionnelles en coopérationavec les établissements sous tutelle duMAAPAR : autour de 80% des formés. La for-Répartition des effectifs des licences professionnellesmises en place en partenariat avec l’enseignement agricolepar mode de formationFormation initialeApprentissageFormation continueTotal2000 2001 <strong>2002</strong>183 495 88277,9 81,8 79,111 21 524,7 3,5 4,741 89 18117,4 14,7 16,2235 605 1115mation continue vient au deuxième rang, concernant16% des étudiants. L’apprentissage reste peudéveloppé dans cette filière : ce mode de formationconstitue moins de 5% des effectifs. Formationcontinue et apprentissage sont légèrement sousreprésentéspour les formations en partenariatavec l’enseignement agricole au regard de l’ensembledes licences professionnelles : celles-ciaccueillent à 6,8% des apprentis en 2001 1 et16,6% des stagiaires.1 Les chiffres pour l’année <strong>2002</strong>-2003 ne sont pas disponibles pourl’ensemble des licences.120011151000882800600400605495Formation initialeApprentissageFormation continueEnsemble200023518118389524111212000 2001 <strong>2002</strong>107
Prédominance des secteurs Agriculture -Développement durable - Aménagementdu territoire et Agroalimentaire, en termesd’effectifs de formésEn <strong>2002</strong>, tous modes de formation confondus,deux secteurs rassemblent près de 75% des effectifsdes licences professionnelles mises en placeen partenariat avec l’enseignement agricole : lesecteur Agriculture - Développement durable- Aménagement du territoire (45% deseffectifs avec 504 étudiants) et le secteurAgroalimentaire (27,4% des effectifs avec 305étudiants). Ces secteurs sont logiquement ceuxpour lesquels l’offre de formation est la plus développée.Suivent, en termes de nombre de formés,les secteurs de l’Eau (9,6%) et de la Forêt -Espaces Verts (7,7%).toire qui montrent les plus fortes progressionsd’effectifs : respectivement +309% (pour seulement65 étudiants supplémentaires) et +89% (237étudiants de plus).La formation continue davantage présenteen Agriculture - Développement durable- Aménagement du territoire ; l’apprentissageen AgroalimentaireLa part des différents modes de formation (formationinitiale, formation continue, apprentissage),évoquée précédemment, varie en fonction des secteursde formation considérés. Ainsi, distingue-tondes effectifs de stagiaires relativement importantsdans le secteur de l’Agriculture -Développement durable - Aménagement du territoire(près de 19%) et au sein de la formation auxnouveaux métiers de la formation (ENESAD) duRépartition des effectifs des licences professionnelles dans lesquelles l’enseignement agricole est partenairepar secteur de formation — Tous modes de formation confondus — en <strong>2002</strong>-2003Agriculture Développement durable Aménagement du territoire45,2%Eau9,6%Agroalimentaire27,4%Forêt Espaces vertsCommercialisationEnvironnementDivers7,7%6,5%1,3%2,2%A la dernière rentrée, le secteur del’Environnement fait son apparition (avec 15 étudiants),de même que la formation classée dans lesecteur Divers relative aux métiers de la formation(avec 25 étudiants). Parmi les secteurs déjàreprésentés en 2001, ce sont les secteurs de laForêt-Espaces verts et de l’Agriculture -Développement durable - Aménagement du terri-secteur Divers (25,5%). La formation continueest en revanche absente du secteur del’Environnement. L’apprentissage est lui développédans le secteur de l’Agroalimentaire (12%) etdans la formation citée ci-dessus (7,4%). Il échappeaux secteurs de l’Eau, de la Forêt, de laCommercialisation, et de l’Environnement.Répartition des effectifs des licences professionnelles dans lesquelles l’enseignement agricole est partenairepar secteur de formation — Tous modes de formation confondus2000 2001 <strong>2002</strong>Total FI App FC Total FI App FC Total FI App FCAgriculture — Dvlpt durable — Aménagement du territoire 149 100 11 38 267 202 17 48 504 394 15 95Eau 41 41 0 0 98 87 0 11 107 98 0 9Agroalimentaire 30 27 0 3 167 138 4 25 305 225 37 43Forêt — Espaces verts 21 21 0 0 86 76 0 10Commercialisation 15 15 0 0 52 47 0 5 73 67 0 6Environnement 15 15 0 0Divers 25 7 0 18Ensemble des licences professionnelles 235 183 11 41 605 495 21 89 1115 882 52 181108
Les premiers résultatsUn taux de réussite à l’examen de près de90%, supérieur à la moyenne nationaleLe taux de réussite des étudiants ayant suivi unelicence fonctionnant en partenariat avec des établissementsde l’enseignement agricole est, tousmodes de formation confondus, de 89% en 2001pour la première promotion et de 88% en <strong>2002</strong>.Selon les premières estimations, ce taux seraitcomparable pour les trois modes de formation :formation initiale, apprentissage et formationcontinue.Forêt - Espaces verts notamment, dans lesquelsrespectivement 91,8% et 95,2% des formés sontin fine diplômés.Mais, la performance en termes de réussite àl’examen se révèle forte quels que soient les secteurs.Le plus faible taux, pour la promotion<strong>2002</strong>, est observé pour le secteur de l’agroalimentaire; ce taux est pourtant tout à fait remarquablepuisque 85,6% des étudiants, apprentis oustagiaires décrochent le diplôme à l’issue de leurformation.En <strong>2002</strong>, on compte 531 diplômés, dont 44%dans le secteur de l’agriculture, 27% dans celui del’agroalimentaire, 17% dans celui de l’eau.Les premières promotions de diplômésdes licences professionnellesdans lesquelles l’enseignement agricole est partenairepar secteur de formationTous modes de formation confondusPromotion 2001 Promotion <strong>2002</strong>Inscrits Diplômés Tx réussite Inscrits Diplômés Tx réussiteAgriculture — Dvlpt durable — Aménagement du territoire 149 126 84,6 267 232 86,9Eau 41 0 0,0 98 90 91,8Agroalimentaire 30 0 0,0 167 143 85,6Forêt — Espaces verts — 21 20 95,2Commercialisation 15 13 86,7 52 46 88,5Environnement — — — — — —Divers — — — — — —Ensemble des licences professionnelles 235 139 59,1 605 531 87,8Lorsque l’on examine les résultats selon les groupesde formation, on note des taux de réussiteexceptionnellement élevés pour ceux qui comportentun faible nombre de formés : secteurs Eau etAu total 741 individus sont titulaires à ce jourd’une licence professionnelle mise en oeuvre enpartenariat avec l’enseignement agricole.Evolution du nombre de diplômés sur deux ansTous modes de formation confondusForêt Espaces verts20Commercialisation13462001<strong>2002</strong>Eau4190Agroalimentaire30143Agriculture Dvlpt durableAménagement duterritoire126232Ensemble des licencesprofessionnelles210531109
AnnexeLes établissements de l’enseignement agricole partenaires des licences professionnelles :liste des intitulés de diplômeshabilitées en 2000 habilitées en 2001 habilitées en <strong>2002</strong>Agriculture — Développement durable — Aménagement du territoireAgrotechniques végétalesGénie des biotechnologies végétalesExpérimentateur du végétalValorisation, animation et médiation des territoires rurauxPromoteur du patrimoine ruralAgriculture et développement durableMétiers de la vigne et du vinAgriculture raisonnée : gestion agri-environnementale des systèmes de cultureAgent de développement en milieu ruralManagement des entreprises agricoles et agroalimentairesResponsable de la qualité dans les filières fruits et légumesAgronomie : valorisation des produits et espaces montagnardsDroit et gestion des entreprises agricoles et agroalimentairesManager en entreprises d'horticulture et de paysageDes agrosystèmes aux territoiresTechnologies en physiologie et physiopathologie : applications à la pharmacologie et à la santé animaleProductions végétales : exploitation et valorisation des productions végétalesDiagnostic et suivi agri-environnementauxManagement des organisations dans le monde ruralConsultant ruralAnimateur agri-environnementalIngénierie de l'entreprise agricoleValorisation des ressources végétalesAgroéquipementsUniversité Reims — EPL de ChâlonUniversité Toulouse — ENFA ToulouseUniversité Le Havre — EPL Yvetot — CFA Fauville-en-CauxUniversité Bordeaux III — ENITAB — LEGTA PérigeuxUniversité Grenoble I — LEGTA AubenasUniversité Amiens — LEGTA AmiensUniversité Bordeaux II — ENITAB — LEGTA Blanquefort / Libourne / BergeracUniversité Montpellier III — LEGTA CarcassonneUniversité Caen — LEGTA Le RobillardUniversité du Littoral — IREO RollancourtUniversité Lyon I — ISARA — MFREO AnneyronUniversité Chambéry — LEGTA ChambéryUniversité Bretagne Sud — Guingamp — ESA AngersUniversité Angers — LEGTA AngersUniversité Grenoble I — EPL La Côte-Saint-AndréUniversité Grenoble I — ENVL — MFR MoiransUniversité Lille I — LEGTA ArrasUniversité Lille II — LEGTA LommeUniversité Lille III — IA GenechUniversité Limoges — ENITAC — LEGTA Neuvic — EPL Saint-FlourUniversité Metz — EPL MetzUniversité Nancy I — ALPA HarouéUniversité Orléans — LEGTA Chartres — LAP NermontUniversité Besançon — ENESAD — LEGTA VesoulEauGestion des ressources et production d'eauEau et environnementAnalyse et gestion du traitement des eaux, des boues et des déchetsTechnologie et gestion des eaux de santéUniversité Limoges — LEGTA AhunUniversité Strasbourg I — ENGEES — LEGTA ObernaiUniversité Toulouse III — LEGTA AlbiUniversité Bordeaux II — LEGTA Dax — ISNAB Villenave-d'Ornon110
AgroalimentaireCréation d'activités nouvelles en agroalimentaireMétiers de la valorisation des produits des filières viandesManagement et gestion de productions dans les industries agroalimentairesGénie des procédés agroalimentaires et maîtrise de la qualité des produits fraisResponsable du suivi global de l'élevage et de la transformation des produits animauxManagement d'équipes en productions agroalimentairesContrôle, prévention, entretien appliqués à la production et à la transformation des produits agricolesDéveloppement, recherche en arts culinaires industrialisésEmballage et conditionnement des produits du vivant (Biopack)Conduite de projets en IAA et gestion de la qualitéSécurité sanitaire des alimentsIAA : Alimentation option transformation laitièreIAA : Management des risques industrielsContrôle qualité des produits alimentaires issus de l'agriculture et de la merIAA : Alimentation : bio-transformation en industrie alimentaireIAA : Alimentation : hygiène et sécurité des produits agroalimentairesFormation des responsables techniques des unités de transformations agroalimentairesChef de projet informatique industrielle pour les IAAForêt — Espaces vertsCoordonnateur de projets en aménagement paysagerAménagement du paysageAménagement du paysageGestion et commercialisation des produits de la filière forestièreCommercialisationAgrodéveloppement et commerce internationalTechnico-commerciaux en agrofournitures et plants pour l'horticultureCommercialisation et signes de la qualité des vinsLogistiques et commercialisation des produits alimentaires fraisEco-marketing des produits biologiques, écologiques et fermiersEnvironnementProtection de l'environnementProtection de l'environnement : gestionnaire des déchetsAménagement du territoire et urbanisme : espaces périurbainsDiversNouveaux métiers de la formation, nouvelles compétences du formateurUniversité Lyon I — LEGTA Bourg-en-BresseINP Toulouse — LEGTA Rodez — ENFA — ENVTUniversité Bordeaux I — ISNAB Villenave-d'OrnonUniversité Caen — LEGTA Saint-LôUniversité Limoges — LEGTA Limogesniversité Nantes — ENITIA — LEGTA Saint-Herblain et LavalUniversité Perpignan — LEGTA PerpignanUniversité Rennes — ENSARUniversité Montpellier — ENSAM — LEGTA Perpignan — Castelnau-le-LezUniversité La Rochelle — LEGTA SurgèresUniversité Toulouse — IUT Auch — LEGTA AuchUniversité Besançon — ENIL — IBSAUniversité Brest — LEGTP Saint-Jacut-les-PinsUniversité Bretagne Sud — IUT Lorient — LEGTA PontivyUniversité Grenoble I — ENIL La Roche-sur-ForonUniversité Le Mans — IUT Laval — LEGTA LavalUniversité Nancy II — EPL Bar-le-DucUniversité Paris XI — ENSIAUniversité Lille III — IA GenechUniversité Limoges — LEGTA MeymacUniversité Nancy I — ENGREF Nancy — EHP Roville-aux-ChênesUniversité Grenoble II — CEFA MontélimarUniversité Bordeaux — LEGTA Sainte-LivradeUniversité Angers — LEGTA AngersUniversité Montpellier — ENSAM — LEGTA MontpellierUniversité Chambéry — LEGTA La Roche-sur-ForonUniversité Lyon III — LAP PoisyUniversité Antilles Guyane — ENGREF — INRAUniversité Artois — LEGTA Douai — IA GenechUniversité Lyon II — LEGTA VienneUniversité Dijon — ENESAD111
PANORAMADEL’ENSEIGNEMENTAGRICOLE113
L’année <strong>2002</strong> - 2003 : les premiers chiffresLes élèves - 0,5%172 122 élèves en <strong>2002</strong> - 2003Pour la troisième année consécutive, leseffectifs de l’enseignement technique agricole sont enbaisse. Mais, cette diminution du nombre d’élèvesaccueillis dans les formations initiales scolaires estmoins importante qu’en 2000 (-1,8%) et 2001 (-1,3%) :-870 élèves, soit -0,5%.Tous niveaux de formation confondus, c’estdans l’enseignement public et l’enseignement privé àtemps plein que les effectifs continuent de se réduire ; ilssont à l’opposé en reprise dans le privé à rythmeapproprié.Un examen plus précis met en lumière lesévolutions suivantes selon les statuts d’enseignement : une progression des effectifs aux niveaux VI, Vbis etV dans un ordre d’importance décroissant qui va duprivé à rythme approprié au temps plein en passant parle public ; une diminution des effectifs équivalente pour les troisstatuts au niveau IV ; une diminution des effectifs au niveau III plus marquéedans le public que dans le privé à temps plein, et dansce dernier statut que dans le privé à rythme appropriéNiveaux VI et VbisNiveau VNiveau IVNiveau IIIEvolution en %Public Privé TP Privé RA+3,3+1,1-2,7-5,0+1,9+0,6-2,8-4,2+3,6+1,9-2,9-3,1Enseignement publicEnseignement privé à temps pleinEnseignement privé à rythme approprié67 99854 04450 080 -1,8% -0,7% +1,4%Ceci s’explique par les niveaux de formationatteints par la nouvelle baisse des effectifs, les niveauxIV et III, dont la place est plus grande pour les statutspublic et privé à temps plein (66% et 40% de leurseffectifs respectifs en <strong>2002</strong>). Quant à l’évolution des différentes formations : au niveau Vbis, la filière technologique accueille prèsde trois fois plus de nouveaux élèves que la filièrepréparatoire n’en perd ; au niveau IV, la réduction des effectifs est logiquementtrès importante en BTA, mais toutes les filières sonten recul, mise à part la filière professionnelle ; au niveau III, le BTSA subit un net fléchissement deses effectifs, tandis que le mouvement est positif pourle post-BTSA.Les niveaux VI et Vbis sont en revanche denouveau dynamiques, confirmant leur reprise en 2001 ;c’est aussi le cas, cette année, du niveau V. Ces niveauxsont, eux, prépondérants dans l’enseignement privé àrythme approprié (79%). Les évolutions constatéesdepuis la rentrée 2000 tendent bien à retenir le facteurdémographique comme expliquant en grande partie, si cen’est de manière exclusive, la réduction de la populationscolaire agricole.CPA et CLIPA4e et 3e préparatoires4e et 3e technologiquesCAPABEPASeconde7877 90826 0486 17154 3558 431+ 39- 564+ 1534+ 210+ 522- 148+5,2%-6,7%+6,3%+3,5%+1,0%-1,7%Niveaux VI et Vbis34 743 +3,0%Baccalauréat S3 385-5-0,1%Niveau V60 526 +1,2%BTA13 179- 1577-10,8%Niveau IV55 607 -2,8%Baccalauréat technologique13 555 - 155 -1,1%Niveau III21 246 -4,6%Baccalauréat professionnel17 057 + 302 +1,8%BTSA20 706- 1041-4,8%Post-BTSA369+ 23+6,6%Classes préparatoires171- 9-5,0%115
Les flux d’entrée + 0,9%59324 nouveaux entrants, 50692 en classes d’entréeEn <strong>2002</strong>-2003, les flux de nouveaux élèvesdans les formations scolaires agricoles sont en reprise(+0,9%), toutes classes confondues, après deux années derecul. Ceci est le résultat d’une diminution des flux enclasses d’entrée 1 moins marquée que précedemment (-0,5%) et d’une croissance soutenue des flux en cours decycle 2 (+10,5%).Les flux en classes d’entrée ne sont en réalité endécroissance que dans l’enseignement public, alors qu’ilsétaient en reprise en 2001 dans ce seul statut. Ils sont àl’opposé de nouveau dynamiques dans le privé à tempsplein, et surtout dans le privé à rythme approprié.Classes d’entréeEnseignement publicEnseignement privé à temps pleinEnseignement privé à rythme approprié19 00316 02115 668 -4,4% +0,5% +3,5%Pour ce qui est des classes de cours de cycle, lenombre de nouveaux entrants est en augmentation fortedans les trois statuts. Les taux de croissance repérés sontinférieurs à ceux observés en 2000, mais au dessus desniveaux de 2001 pour le public et le privé à rythmeapproprié, le privé à temps plein ayant montré sur cepoint un fléchissement en 2001. une accentuation de la baisse des flux d’entrée auniveau IV, et surtout au niveau III.Il est à noter que les flux de nouveaux entrants en classede troisième, qui connaissaient une très forte croissanceen 1999, puis des évolutions positives plus modestes enparticulier en 2001, montrent un nouvel élan en <strong>2002</strong>.VI et Vbis - classes d’entréeV - classes d’entréeIV - classes d’entrée15 02321 31611 460+2,2%+3,2%-4,3%III - classes d’entrée 2 893 - 742 -20,4%VI et Vbis - cours de cycle 7 445 + 776 + 11,6%On constate plus précisément s’agissant des évolutionsdes flux en classe d’entrée par niveau et statut : dans le public, une baisse des flux qui persiste auxniveaux VI et Vbis et des reculs importants auxniveaux IV et III, mais une hausse marquée en classede troisième ; dans le privé à temps plein, une chute des flux auniveau III particulièrement élevée, mais desmouvements positifs aux autres niveaux, y comprispour ce seul statut au niveau IV ; dans le rythme approprié, à la fois des augmentationsplus élevées aux niveaux VI et Vbis et V et desdiminutions moindres aux niveaux IV et III.Classes d’entrée - Evolution en %Niveaux VI et Vbis+ 327+ 659- 514Public Privé TP Privé RA-1,7+2,0+3,6Cours de cycleEnseignement public1 566 +10,2%Niveau VNiveau IV+2,3-6,8+2,8+1,0+4,7-1,5Enseignement privé à temps plein2 909 +11,0%Niveau III-21,1-23,1-6,9Enseignement privé à rythme approprié4 157 +10,2%VI et Vbis - Cours de cycle+16,6 +12,7 +9,8116En classes d’entrée, les flux se caractérisent pardes mouvements contraires s’agissant des différentsniveaux de formation en <strong>2002</strong> : un renforcement de la reprise des flux de nouveauxélèves aux niveaux VI et Vbis ; une augmentation nette des flux au niveau V, qui metfin à une période de régression ;1Classes d’entrée : CPA, CLIPA, quatrièmes préparatoire,technologique, 1 ère année de CAPA, de BEPA, CAPA en 1 an, classe deseconde, première année de BTA, de baccalauréats technologique,professionnel, scientifique, première année de BTSA, BTSA en 1 an,post-BTS et classes préparatoires.2 Classes de cours de cycle : Troisièmes préparatoire, technologique,deuxième année de CAPA, de BEPA, de BTA, terminalestechnologique, professionnelle, scientifique, deuxième année deBTSA.Les classes de troisième accueillent de plus en plus de nouveauxentrants, compte tenu du nouveau schéma éducatif national. Elles sontdistinguées sous la rubrique «Niveaux VI et Vbis - Cours de cycle»,bien qu’intégrées aux flux d’entrée en cours de cycle.In fine, la part de nouveaux élèves dans leseffectifs totaux des formations scolaires del’enseignement agricole est en progression aux niveauxVI et Vbis en classes d’entrée mais plus encore en coursde cycle, et au niveau V. Elle est en repli en classesd’entrée de niveau IV, et surtout de niveau III.Reste qu’au total 54,6% des élèves en classesd’entrée sont de nouveaux arrivants (+0,5 point).Part des nouveaux élèves dans les classes d’entrée par niveau95,9%+0,8 ptVI et VbisCl. entréeet en cours de cycle aux niveaux VI et Vbis39,0%+2,5 ptVI et VbisCours Cycle64,4%+1,5 pts 35,3%-0,4 ptV IV III25,0%-4,7 pts
Les personnels publics9870 enseignants ... 4492 ATOSS ...1782 personnels d’éducation et de surveillanceConcernant les personnels de l’enseignementtechnique agricole public, l’année <strong>2002</strong>-2003 estmarquée par : une faible évolution des personnels enseignants(+0,9%), après une croissance plus soutenue en 2001(+5,3% en effectifs et +4,6% en ETP) ; Pour ce qui est des différents corpsd’enseignants, on souligne : une population d’IA qui ne cesse de se réduire ; une décroissance du nombre d’ITA qui advient en <strong>2002</strong>et se cumule aujourd’hui avec celle des IA ; une croissance du nombre de PCEA et PLPA,cependant moins soutenue qu’en 2001 ; une quasi stabilisation des professeurs d’EPS, comptetenu du recul noté l’année précédente ; à l’inverse de 2001, une forte réduction de lapopulation des ACR, accompagnée d’un nouveaudéveloppement de celle des ACE.EffectifsEvo. 01/02 ETP Evo. 01/0202-03 Eff. % 02-03 Eff. %Personnel de direction 339 +6 +1,8 337,0 +4,0 +1,2Inspecteurs 68 +3 +4,6 68,0 +3,0 +4,6Total enseignants 9870 +85 +0,9 8860,1 +77,5 +0,9Enseignants titulaires 8219 +253 +3,2 7601,6 +235,5 +3,2Enseignants non titulaires 1651 -168 -9,2 1258,5 -158,0 -11,2Education 387 +13 +3,5 345,9 +2,2 +0,6Surveillance 1395 +185 +15,3 1111,0 +119,0 +12,0ATOSS et techniciens conseillers 4492 +131 +3,0 4191,6 +120,8 +3,0IAITAPCEAPCENEPSPLPAPLPENIngénieur d’agronomieIngénieur des travaux agricolesProfesseur certifiéde l’enseignement agricoleProfesseur certifiéde l’éducation nationaleEducation physique et sportiveProfesseur de lycée professionnelagricoleProfesseur de lycée professionnelde l’éducation nationaleEff.ETPATOSSEffectifs physiquesEquivalents temps pleinPersonnel administratif, technique, ouvrier, desanté et de service un processus de déprécarisation qui se poursuit ; une croissance non négligeable des personnels desurveillance ; un maintien du développement de la population desATOSS, à un rythme comparable à celui de 2000 et2001.Effectifs Evo. 01/02 ETP Evo. 01/0202-03 Eff. % 02-03 Eff. %IA 368 -16 -4,2 353,1 -13,4 -3,7ITA 472 -20 -4,1 447,4 -21,0 -4,5PCEA 3658 +115 +3,2 3370,8 +101,0 +3,1PCEN 132 -1 -0,8 128,2 +1,0 +0,8EPS 291 -7 -2,3 277,0 -2,5 -0,9PLPA 3256 +189 +6,2 2988,1 +177,5 +6,3PLPEN 42 -7 -14,3 37,0 -7,1 -16,1ACE 822 -255 -23,7 651,0 -210,1 -24,4ACR 829 +87 +11,7 607,5 +52,1 +9,4ACEACRAgent contractuel d’enseignementAgent contractuel régionalLes caractéristiques des élèves76 025 filles en formation scolaire + 0,3 pt La part des filles s’accroît quelque peu en <strong>2002</strong>,tous statuts confondus : 44, 2%. C’est aux niveaux V etIV que le mouvement positif est repéré, à l’inverse desniveaux VI et Vbis et III où leur place se réduit.Eff. % Evo. en ptVI et Vbis 12578 36,2 -0,6V 32534 53,8 +0,8IV 23646 42,5 +0,5III 7267 34,2 -1,0Ensemble 76025 44,2 +0,3Public 24088 35,4 +0,3Privé TP 27997 51,8 +0,4Privé RA 23940 47,8 -0,2En relation avec le poids des niveaux deformation, la part des filles évolue positivement dans lepublic et dans le privé à temps plein, et diminue trèslégèrement dans le privé à rythme approprié.100 167 internes - 0,3 pt L’internat est encore un peu en recul en <strong>2002</strong>,dans tous les statuts d’enseignement, en particulier leprivé à rythme approprié ; mais ce statut est toujours,sur ce point, au premier plan.Eff. % Evo. en ptPublic 36552 53,8 -0,4Privé TP 22036 40,8 -0,1Privé RA 41579 83,0 -0,9Ensemble 100167 58,2 -0,3Plus de 58% des élèves, au total, sont quoi qu’ilen soit internes en <strong>2002</strong>-2003.117
Panorama de l’enseignement agricoleSommaireL’offre de formationLes diplômes de l’enseignement agricoleLes parcours de formation ..........................................................................................................................................120L’offre de formation initiale scolaire technologique et professionnelle par type de diplôme .........................................122L’offre de formation initiale technologique et professionnelle par secteur de formation .........................................124Les capacités d’accueil en formation initiale scolaireLes classes de niveaux VI, Vbis et V ..........................................................................................................................126Les classes de niveaux IV et III ..........................................................................................................................................128Les places offertes aux concours communs de l’enseignement supérieur long .........................................................130La demande de formationLes flux d’entrée dans l’enseignement agricoleDonnées générales ..........................................................................................................................................................132Les flux en classe d’entrée de niveaux VI et Vbis ................................................................................................................134Les flux en classe d’entrée de niveau V ................................................................................................................................136Les flux en classe d’entrée de niveau IV ................................................................................................................................138Les flux en classe d’entrée de niveau III ..........................................................................................................................140Les candidaturesCandidatures et intégrations dans les écoles supérieures recrutant sur concours communs — ENSA - ENIT ...............142Candidatures et intégrations dans les écoles supérieures recrutant sur concours communs — ENGEES - ENV ...............144L’origine scolaire des inscritsLa part des nouveaux entrants dans les inscrits en classe d’entrée des formations initiales scolaires ...............................146Les ressources et les coûtsLe financementEvolution du budget de l’enseignement agricole ..........................................................................................................148Les ressources humainesLes personnels de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole public .........................................150Les caractéristiques des personnels de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole public ...............152Les personnels de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole public dans les régions ...............154Les personnels contractuels de l’enseignement agricole privé ................................................................................................156Les caractéristiques des personnels contractuels de l’enseignement agricole privé ................................................................158Les personnels contractuels de l’enseignement agricole privé dans les régions ................................................................160Les personnels de l’enseignement supérieur ..........................................................................................................162Les établissementsLes établissements de formation initiale générale, technologique et professionnelle .........................................................164La taille des établissements de formation initiale générale, technologique et professionnelle .........................................166Les écoles supérieures ..........................................................................................................................................168Les centres de formation d’apprentis ..........................................................................................................................170Les centres de formation professionnelle continue ..........................................................................................................172118
Les formésLes formés de l’enseignement agricole en 2001Les formations de l’enseignement secondaire et supérieur court par la voie scolaire ...............................................174Les formations de l’enseignement supérieur long ..........................................................................................................176Les secteurs de formation de l’enseignement secondaire et supérieur court par la voie scolaire ...............................178Les formations de l’enseignement secondaire et supérieur court par la voie scolaire dans les régions ...............................180L’enseignement supérieur long dans les régions ..........................................................................................................182Les formations par l’apprentissage ..........................................................................................................................184Les secteurs de formation par l’apprentissage ................................................................................................................186L’apprentissage dans les régions ..........................................................................................................................188La formation continue ..........................................................................................................................................................190Les secteurs de formation continue ................................................................................................................................192La formation continue dans les régions ...............................................................................................................................194L’évolution des effectifs de formésEvolution structurelle des formations initiales scolaires ................................................................................................196Evolution structurelle des formations supérieures longues ..........................................................................................198Evolution sectorielle des formations initiales scolaires de niveau V ................................................................................200Evolution sectorielle des formations initiales scolaires de niveau IV ................................................................................202Evolution sectorielle des formations initiales scolaires de niveau III ................................................................................204Evolution structurelle des formations par l’apprentissage ..........................................................................................206Evolution sectorielle des formations par l’apprentissage de niveau V ................................................................................208Evolution sectorielle des formations par l’apprentissage de niveau IV ................................................................................210Evolution sectorielle des formations par l’apprentissage de niveau III ................................................................................212Evolution structurelle de la formation continue ..........................................................................................................214Evolution sectorielle de la formation continue de niveau V ................................................................................................216Evolution sectorielle de la formation continue de niveau IV ................................................................................................218Evolution sectorielle de la formation continue de niveau III ................................................................................................220Les origines socioprofessionnelles des formésLes élèves de la formation initiale scolaire ..........................................................................................................................222Les étudiants en formation initiale ................................................................................................................................226Les femmes en formationLes élèves de la formation initiale scolaire ..........................................................................................................................226Les étudiantes en formation initiale ..........................................................................................................................228Les apprenties ..........................................................................................................................................................230Les internesEvolution en formation initiale scolaire ................................................................................................................................232Les résultatsLes diplômesLes diplômés de l’enseignement général, technologique et professionnel .........................................................................234Les diplômés de l’enseignement technologique et professionnel par secteur de formation .........................................236Les diplômés de l’enseignement supérieur long ..........................................................................................................238La poursuite d’étudesPersévérance et performance dans les études des diplômés de l’enseignement secondaire et supérieur court .........240L’insertion professionnelleLa situation des diplômés uniques de niveau V quatre ans après l’obtention de leur diplôme ...............................................242La situation des diplômés uniques de niveaux IV et III quatre ans après l’obtention de leur diplôme ...............................244Les emplois des diplômés uniques de niveau V quatre ans après l’obtention de leur diplôme ...............................................246Les emplois des diplômés uniques de niveaux IV et III quatre ans après l’obtention de leur diplôme ...............................248Les secteurs d’activité des diplômés uniques de niveau V quatre ans après l’obtention de leur diplôme ...............................250Les secteurs d’activité des diplômés uniques de niveaux IV et III quatre ans après l’obtention de leur diplôme ...............252119
Les diplômes de l’enseignement agricoleEcolesnationalesvétérinaires120ENVConcours AclassepréparatoireLes formations agricoles : du CAPA aux écoles d’ingénieursEcolesprivéessouscontrat:ESAAESAPISABISAISARAESITPANiveaux VI et VbisNiveau VNiveau IVNiveau IIINiveaux II et IApprentissagepossibleParcoursexceptionnelEcolenationaled’Ingénieursdel’horticultureet dupaysageENIHPInstitutnationalsupérieurdeformationagroalimentaireINSFABaccalauréatsérie S(1)(2)Ecolesupérieuredu bois(3)ESBBaccalauréattechnologiqueEcolenationalesupérieuredu paysageENSPClassespréparatoiresen deux ansSeconde générale et technologiqueQuatrième et troisième de collègeBTAAccès aux écoles supérieures avec un niveau IV,le plus souvent un baccalauréat S.Accès aux écoles supérieures après une classepréparatoire en deux ans (concours A pour lesécoles recrutant sur concours communs).Accès aux écoles supérieures après un BTSA, BTSou DUT et éventuellement une classe préparatoirepost-BTS (concours C pour les écoles recrutant surconcours communs ; concours C2 pour certainsDUT à l’entrée des ENSA)Accès aux écoles supérieures avec un DEUG(concours B pour les écoles recrutant sur concourscommun)Accès aux écoles supérieures avec un niveau II(maîtrise) (concours D pour les écoles recrutant surconcours commun) ; avec un titre de docteur enmédecine, pharmacie, odontologie pour les ENV.Ecolenationaledu génie del’eau et del’environnementENGEESBTSAFormationdesingénieursforestiersFIFBaccalauréatprofessionnelBEPAQuatrième ettroisièmetechnologiquesClassePost-BTSen 1 anEcolesd’applicationENGREFENEDSADESATEcolesnationalesd’ingénieursdes travauxENITClasse depré-licenceen 1 anCAPAQuatrième ettroisièmepréparatoiresLP : Licence professionnelleCentres de3ème cycleISAAISPAIESIELEcolesnationalessupérieuresd’agronomieENSAENSIAENSHAPCLIPACAPAen 1 an(1) Entrée en 2ème année de l’INSFA pour les admissibles aux ENSA, ENIT et ENV(2) Entrée en 2ème année de l’INSFA, des écoles privées et des ENV(3) Entrée en 2ème année de l’INSFA, des écoles privées et des ENVDoctoratsLPPremier cycle Deuxième cycle Deuxième cycle Bac + 2 Bac + 4 Bac + 6 Bac + 8Enseignement secondaire Enseignement supérieurDiplôme de niveau IVCPAen 1ou 2ans(4) Titulaire d’une maîtrise es sciences :Entrée en 2ème année des ENSA, des ENIT et assimilées, de la FIFEntrée en 3ème ou quatrième année des écoles agricoles privéesEntrée en 2ème année de l’ESB(4)UnversitéMaîtriseDEUGDUT
Les parcours de formation L’enseignement agricole constitue un système éducatif complet proposant des parcours variés du niveauVI au niveau I. Les parcours se diversifient avec la mise en place des licences professionnelles. Ces parcours sont offerts en formation initiale scolaire mais aussi par la voie de l’apprentissage ou de laformation continue. L’enseignement agricole est un système ouvert présentant de nombreux points d’accès à différents niveauxde formation. Les formations supérieures peuvent déboucher, dans un certain nombre d’écoles habilitées, à laprésentation d’un doctorat.L’enseignement secondaire agricole, sous tutelle du Ministère de l’agriculture et de la pêche,comprend : un cycle d'orientation (quatrièmes et troisièmes), un cycle de détermination par la voie générale et technologique (seconde générale et technologique) par la voie professionnelle (CAPA, BEPA), un cycle terminal par la voie générale (baccalauréat S) par la voie technologique (BTA et baccalauréat technologique) par la voie professionnelle (baccalauréat professionnel).L'enseignement post-secondaire ou supérieur est dispensé dans les lycées, les grandes écoles et àl’Université : BTSA, classes préparatoires, licences professionnelles, diplômes d'ingénieurs,diplômes vétérinaires.L’offre de formationRepèresCPACLIPACAPABEPABTABac SBTSAClasse préparatoire à l'apprentissageClasse d'initiation pré-professionnelle en alternanceCertificat d'aptitude professionnelle agricoleBrevet d'études professionnelles agricolesBrevet de technicien agricoleBaccalauréat scientifiqueBrevet de technicien supérieur agricoleNiveau IVNiveau IIICycle long professionnel, technologique ougénéral (seconde générale ettechnologique,baccalauréatprofessionnel ou technologique, baccalauréatscientifique, brevet de technicien agricole)Premier cycle supérieur de deux années d'étudespost-baccalauréat (BTSA, classes préparatoires)Les niveaux de formationNiveaux VI et VbisNiveau VPremier cycle court pré-professionnel et classepréparatoire à l'apprentissage (4ème et 3ème,CPA)Second cycle court professionnel (CAPA etBEPA)Niveaux II et IFormations de niveau supérieur à Bac+2 (licenceprofessionnelle, diplômes d'ingénieur,vétérinaires, doctorats)Voir l’intitulé des sigles des écoles supérieures en annexeSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la recherche121
Les diplômes de l’enseignement agricoleEvolution du nombre de spécialités effectivement proposées en formation initiale scolaireselon le statut d’enseignementClasses d’entréePublic Privé à temps plein Privé à rythme approprié1985 1995 2000 20011985 1995 2000 2001 1985 1995 2000 2001CAPA 1 anCAPABEPABTABac technologiqueBac professionnelBTSABTSA en 1 anNombre de spécialitéseffectivement préparéesPublic Privé TP Privé RA1985 1995 1999 2000 2001 1985 1995 1999 2000 2001 1985 1995 1999 2000 2001CAPA en 1 an 14 7 2 2 1 18 12 8 7 4 20 17 12 10 7CAPA 2 7 7 9 3 5 7 10 3 7 8 11BEPA 22 24 25 25 25 18 20 20 20 21 17 22 23 23 23BTA 30 20 9 8 7 19 17 7 6 6 10 17 7 6 6Bac technologique 8 8 8 7 6 6 6 6 3 4 4 4Bac professionnel 6 16 17 18 3 13 14 14 5 15 16 17BTSA 24 32 30 30 30 17 28 27 27 27 3 16 18 20 19BTSA en 1 an 7 9 11 12 4 5 6 6 4 2 3 3Ensemble 90 106 106 108 109 72 93 91 93 94 50 87 88 90 90Les spécialités créées ou rénovées en 2000 et 2001Rénovées en 2000BEPABTSAAgriculture des régions chaudes spé. Elevage d'un herbivoreAgriculture des régions chaudes spé. Elevage porcinAgriculture des régions chaudes spé. Elevage avicoleAgriculture des régions chaudes spé. Culture de plein champAgriculture des régions chaudes spé. Productions florales et légumièresAgriculture des régions chaudes spé. Productions fruitièresAgriculture des régions chaudes spé. PépinièresGestion et maîtrise de l'eau spé. Maîtrise de l'eau en agriculture et aménagementGestion et maîtrise de l'eau spé. Etudes et projets d'aménagements hydrauliques urbains etagricolesGestion et maîtrise de l'eau spé. Gestion des services d'eau et d'assainissementCréées en 2000CAPABac ProBTSA 1 anServices en milieu ruralProductions aquacolesGénie des équipements agricolesIndustries agro-alimentaires spé. Industries alimentairesTechnico-commercial spé. Végétaux d'ornement122Rénovées en 2001Créées en 2001CAPABEPABTSABac ProSoigneur d'équidésTravaux forestiers spé. BûcheronnageTravaux forestiers spé. SylvicultureElevage canin et félinDéveloppement de l'agriculture des régions chaudesConduite et gestion d'un élevage canin et félin
L’offre de formation initiale scolaire technologique et professionnellepar type de diplôme Des modifications dans l’offre de formation de l’enseignement scolaire agricole très limitées en 2001 Niveau V : Transformations de quelques CAPA en 1 an en CAPA en 2 ans Niveau IV : Création d’un nouveau baccalauréat professionnel, amené à remplacer un BTA, dans le publicet le privé à rythme approprié Niveau III : Rénovation d’un BTSAEn 2001, l’offre qualitative de formation par type de diplôme de l’enseignement scolaire agricole estrelativement stable, en termes de nombre de spécialités proposées en classe d’entrée.Au niveau V, quelques CAPA en 1 an sont transformés en CAPA en 2 ans : trois concernant lesstatuts privés et un le public. Dans ce statut apparaît en outre un autre CAPA qui ne fonctionnait pasen 2000. En ce qui concerne le BEPA, aucune autre spécialité n’est proposée dans le public et dansle privé à temps plein. En revanche, dans le privé à rythme approprié, une spécialité supplémentaireapparaît. Enfin, une spécialité est rénovée dans le public et dans le privé à rythme approprié. Letransfert de CAPA en 1 an en CAPA en 2 ans est donc l'élément essentiel des modifications réaliséesen 2001 au niveau V. La structure CAPA / BEPA demeure, elle, inchangée.Au niveau IV, le mouvement de remplacement progressif des BTA par les baccalauréatsprofessionnels se poursuit dans le public, avec la création d’un nouveau baccalauréat professionnel.Ce diplôme apparaît aussi dans le privé à rythme approprié, mais sans que le BTA afférent soittotalement supprimé. Un baccalauréat technologique (diplôme de l’Education nationale) est enrevanche fermé dans le public. Dans le privé à temps plein, aucune modification n’est constatée.Après avoir été l’objet de fortes restructurations, l’offre de formation à ce niveau est doncextrêmement stable en 2001.Au niveau III, les rénovations de diplômes qui conduisaient à des modifications importantes del’offre ces dernières années ont laissé place à une stabilité quasi parfaite. Un BTSA est encore rénovéen 2001, qui concerne l’enseignement public. Ce statut ouvre en outre une spécialité qu’il neproposait pas jusqu’à présent. Le privé à rythme approprié ferme, lui, une spécialité de BTSA en2 ans.On aboutit ainsi, en 2001, à une offre de formation en CAPA, BEPA et BTA comparable dans les troisstatuts d’enseignement, avec peut-être un léger désavantage au privé à temps plein en BEPA. Enrevanche, l’offre en CAPA en 1 an reste davantage diversifiée dans les statuts privés. A l’opposé, leprivé à temps plein montre une offre un peu moins riche que les autres statuts en baccalauréatprofessionnel ; c’est le cas du privé à rythme approprié en BTSA, et des statuts privés en général enBTSA en 1 an.L’offre de formationRepèresStatuts d'enseignementVoir pages suivantesOptions et spécialitésUn diplôme est caractérisé par son type (CAPA, BEPA, etc.), la durée de la formation (CAPA en 1 an, CAPAen 2 ans etc.) et par la spécialité de formation à laquelle il fait référence.Une option de formation peut regrouper plusieurs spécialités. Par exemple : le BEPA option Aménagementde l’espace comprend les spécialités “travaux paysagers”, “travaux forestiers” et “entretien de l'espace rural”,spécialités qui déterminent le contenu du diplôme.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.123
Les diplômes de l’enseignement agricoleEvolution sectorielle de l’offre de formation initiale scolaire technologique et professionnelle :Nombre de spécialités effectivement proposées par niveau de formation et statut d’enseignementNiveau VPublic Privé à temps plein Privé à rythme approprié1995 1999 2000 2001201920183 5 3 1 33335563 1 32 1 32 1 31995 1999 2000 2001171717182 6 4 1 422664 1 43 1 42 6 4 1 41995 1999 2000 200124 2 6 5 1 424 2 6 5 1 3262522674 1 33 1 4Niveau IVPublic Privé à temps plein Privé à rythme approprié1995 1999 2000 20011616161655554 1 3 34 1 4 34 1 4 35 1 4 31995 1999 2000 20011212121344434 1 2 34 1 2 34 1235 1 2 21995 1999 2000 2001141313122 4 1 3 32 4 1 3 32 4 1 3 32 5 1 3 2Niveau IIIPublic Privé à temps plein Privé à rythme approprié1995 1999 2000 200116161514444412 1 911 1 910 1 97 141995 1999 2000 200112121212554388861 71 71 7111995 1999 2000 200188762 5 1 63 5 1 63 5 52 210Production Transformation Forêt AménagementServices aux entreprisesCommercialisationServices aux personnesunité :spécialitéde formation124Noter : Le nombre de formations proposées est décompté selon la définition suivante.Une formation est caractérisée par son type (CAPA, BEPA, etc.), la durée de la formation (CAPA en 1 an, CAPA en 2 ans, etc.) et parsa spécialité. Une option de formation peut comporter plusieurs spécialités. Sont considérées les seules classes d’entrée.Lecture : En 1995-1996, 18 formations de niveau V proposés dans l’enseignement agricole public ont trait à la Production. On encompte 20 en 1999-2000 et 20 en 2001-<strong>2002</strong>.
L’offre de formation initiale scolaire technologique et professionnellepar secteur de formation Stabilité de l’offre de formation scolaire agricole, en termes sectoriels On enregistre juste trois ouvertures nouvelles : en production au niveau V et en forêt-aménagement auniveau III dans le public, en commercialisation au niveau V dans le privé à rythme appropriéL’offre qualitative de formation scolaire agricole n’évolue que très peu en termes sectoriels en 2001.En effet, la majeure partie des modifications consistent en la rénovation de diplômes ou lasubstitution d’un diplôme à un autre au même niveau de formation et dans le même type despécialité ; ce qui laisse quasiment inchangé le nombre de spécialités effectivement proposées parniveau et secteur de formation.Au niveau V, dans le public, une spécialité de production agricole (Productions agricoles spécialitéProductions végétales) apparaît en CAPA, qui fait suite à l’ouverture en 1999 puis la fermeture en2000 de la spécialité Productions animales de la même option. En BEPA, le privé à rythme appropriégagne une spécialité liée à la commercialisation (Services spécialité vente de produits horticoles etjardinerie). Au-delà, les modifications sont liées à la rénovation de diplômes : trois CAPA en 1 ansont transformés en CAPA en 2 ans, deux dans le secteur de la forêt - aménagement (Travauxforestiers spécialité bûcheronnage et spécialité sylviculture) pour le privé et un en production(Soigneur d’équidés) pour les trois statuts.Au niveau IV, les variations dans l’offre de formation sont encore moins sensibles : une spécialitéde baccalauréat technologique dans le secteur des services aux entreprises (Sciences et technologiestertiaires spécialité Action et communication administratives) disparaît dans le public. Par ailleurs,en production, le baccalauréat professionnel Conduite et gestion d’un élevage canin et félin remplacele BTA Production spécialité Conduite de l’élevage canin. Ce baccalauréat fait aussi son apparitiondans le privé à rythme approprié, mais sans disparition totale du BTA, ce qui induit undéveloppement artificiel de l’offre de formation en production dans ce statut. Le privé à temps pleinmontre, lui, une offre de formation inchangée.Au niveau III, la spécialité Gestion des espaces naturels de l’option Gestion et protection de lanature est ouverte, en forêt-aménagement, dans le public. Dans le privé à rythme approprié, entransformation, la formation en Industries agroalimentaires spécialité Industries des viandes est,elle, fermée. Seules ces modifications ont une influence sur l’offre sectorielle de formation. On notetoutefois la rénovation du BTSA Développement de l’agriculture des régions chaudes proposée parle statut public.L’offre de formationRepèresSecteurs de formationLes spécialités de formation sont regroupées en cinq secteurs :Production, Transformation, Forêt Aménagement, Services auxpersonnes, Services aux entreprises. Dans nos analyses, ce derniersecteur est le plus souvent scindé en deux sous-secteurs :Commercialisation et Services aux entreprises. Lorsque le secteurServices aux entreprises apparaît sans que soitmentionnée la Commercialisation, celle-ci est alors incluse dansles Services aux entreprises.Les secteurs ont été construits à partir de la nomenclature desspécialités de formation du Conseil National de l'Information Statistique(C.N.I.S.).La nomenclature des secteurs auxquels il est fait référence dans cedocument est présentée en annexe.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.125
Les capacités d’accueil en formation initiale scolaireEvolution du nombre de classes de début de cycle selon les formations et les statuts — Niveaux VI et VbisPublic774PrivéCPA, CLIPA et 3 e d’accueilQuatrième technologiqueQuatrième préparatoireNiveaux VI et Vbis - Classes d’entrée4166134131881211098458213341991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 0125219310671991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01CPA et CLIPPA3ème Accueil4ème préparatoire4ème technologiqueEnsemble1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Public 52 42 37 33 35 35 33 33Privé TP — — 1 1 1 3 4 4Privé — 1 1 1 2 2 3 3Ensemble 52 43 39 35 38 40 40 40Public 6 2 1 — — — — —Privé TP 22 7 — — — — — —Privé RA 84 22 — — — — — —Ensemble 112 31 1 0 0 0 0 0Public 21 6 6 5 5 5 4 4Privé TP 162 112 109 105 103 104 100 98Privé RA 254 162 147 130 119 113 105 95Ensemble 437 280 262 240 227 222 209 197Public 109 116 113 105 93 85 83 84Privé TP 106 143 144 146 142 142 145 148Privé RA 146 199 215 231 240 246 255 265Ensemble 361 458 472 482 475 473 483 497Public 188 166 157 143 133 125 120 121Privé TP 290 262 254 252 246 249 249 250Privé RA 484 384 363 362 361 361 363 363Ensemble 962 812 774 757 740 735 732 734Evolution du nombre de classes de début de cycle selon les formations et les statuts — Niveau VPublic1263 Privé1149CAPA 1BEPA 1Niveau V - Classes d’entrée91789840835233438834625118 201991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 011991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01126CAPA 1BEPA 1Ensemble1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Public 18 12 11 12 13 14 16 20Privé TP 163 104 99 96 98 107 111 112Privé RA 183 126 132 132 132 133 131 139Ensemble 364 242 242 240 243 254 258 271Public 334 331 335 339 358 371 375 388Privé TP 407 387 392 388 394 399 402 394Privé RA 510 504 505 507 501 505 506 504Ensemble 1251 1222 1232 1234 1253 1275 1283 1286Public 352 343 346 351 371 385 391 408Privé TP 570 491 491 484 492 506 513 506Privé RA 693 630 637 639 633 638 637 643Ensemble 1615 1464 1474 1474 1496 1529 1541 1557
Les classes de niveaux VI, Vbis et V Stabilisation de l’offre aux niveaux VI et Vbis, après une période de forte contraction Développement de l’offre au niveau V, qui se poursuit, essentiellement par le CAPA, dans le public maisaussi le privé à rythme appropriéNiveaux VI et VbisSur la période longue et jusqu’à la rentrée 2000, l’offre quantitative de formation aux niveaux VI etVbis s’est fortement réduite. Près d’un quart de l’ensemble des classes d’entrée de ces niveauxdisparaissait au total, ce mouvement n’étant pas compensé par le développement des quatrièmestechnologiques.A la rentrée 2001, on note une certaine stabilité. L’enseignement public gagne une classe dequatrième technologique. Le privé à temps plein transforme deux de ses classes de quatrièmepréparatoire en quatrième technologique et affiche la création nette d’une classe dans cette mêmefilière. Le privé à rythme approprié montre une offre globalement stable, substituant dix classes dequatrième technologique à dix classes de quatrième préparatoire. Ceci conduit, tous statuts et toutesclasses d’entrée confondus, à l’ouverture nette de deux classes.Niveau VLe développement de l’offre de niveau V, en termes de classes d’entrée en fonctionnement, amorcéen 1995, se poursuit. Au total, seize classes supplémentaires sont répertoriées en 2001 : treize enCAPA (première année de CAPA en deux ans et CAPA en un an) et 3 en BEPA. C’est essentiellementle public qui bénéficie de ce mouvement ; ce statut gagne quatre classes de CAPA et treize classesde BEPA (soit dix-sept classes d’entrée de niveau V au total). Le privé à rythme approprié gagne sixclasses au total : huit classes d’entrée supplémentaires en CAPA sont recensées et deux disparaissenten BEPA. Le privé à temps plein perd, lui, sept classes au total : une classe d’entrée de CAPA estouverte pour huit classes de BEPA fermées.L’offre de formationRepèresBEPACAPABrevet d'études professionnelles agricolesCertificat d'aptitude professionnelle agricoleCLIPACPAClasse d'initiation pré-professionnelle en alternanceClasse préparatoire à l'apprentissageSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.127
Les capacités d’accueil en formation initiale scolaireEvolution du nombre de classes de début de cycle selon les formations et les statuts — Niveau IVPublic838Privé7026813662517213250224208867091 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01500366249217103 105862824391 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01SecondePremière S (ou D’)Première BTAPremière technologiquePremière professionnelleNiveau IV - Classes d’entréeSecondePremière S(et D' jusqu'en 92)Première BTAPremièreBac TechnoPremièreBac ProEnsemble1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Public 251 237 236 233 236 242 244 250Privé TP 96 100 98 98 97 97 96 92Privé RA 7 10 12 11 11 12 13 13Ensemble 354 347 346 342 344 351 353 355Public 72 75 74 73 72 71 72 70Privé TP 28 28 26 26 25 24 24 24Privé RA — — — — — — — —Ensemble 100 103 100 99 97 95 96 94Public 366 255 94 92 91 89 87 86Privé TP 214 204 128 131 136 138 137 135Privé RA 152 174 79 82 82 84 85 82Ensemble 732 633 301 305 309 311 309 303Public — 144 164 174 180 202 206 208Privé TP — 59 70 72 76 79 81 78Privé RA — 4 7 7 7 8 8 8Ensemble — 207 241 253 263 289 295 294Public 13 22 188 194 201 211 220 224Privé TP 1 5 84 89 92 97 103 104Privé RA 2 12 119 119 125 136 136 145Ensemble 16 39 391 402 418 444 459 473Public 702 733 756 766 780 815 829 838Privé TP 339 396 406 416 426 435 441 433Privé RA 161 200 217 219 225 240 242 248Ensemble 1202 1329 1379 1401 1431 1490 1512 1519Evolution du nombre de classes de début de cycle selon les formations et les statuts — Niveau IIIPublicPrivé296196BTSA 111217691 92 93 94 95 96 97 98 99 00 0191 92 93 94 95 96 97 98 99 00 011281991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Public 196 253 259 266 275 282 291 296BTSAPrivé TP 92 117 118 118 124 126 130 130Privé RA 21 38 42 42 47 47 49 46Ensemble 309 408 419 426 446 455 470 472Post-BTSA Public 5 9 13 13 14 14 14 14Classes prépa. Public 13 11 9 9 9 9 9 8
Les classes de niveaux IV et III Le développement de l’offre au niveau IV se poursuit par la classe de seconde et les premièresprofessionnelles, alors que les autres filières se replient Les mouvements positifs concernent le privé à rythme approprié et plus encore le public ; l’offre du privé àtemps plein est, elle, sujette à la baisse L’offre au niveau III ne se développe que par le public ; l’offre du privé à rythme approprié est en repli ; celledu privé temps plein est stableNiveau IVLe développement de l’offre de formation au niveau IV, en termes de classes d’entrée enfonctionnement, qui passait par une suppression progressive des classes de BTA, le développementde la filière technologique et la création puis le déploiement de la filière professionnelle agricole, sepoursuit en 2001. On recense, tous statuts confondus, sept classes supplémentaires au total. Ceci estle résultat de la progression toujours importante du nombre de premières professionnelles (quatorzeclasses supplémentaires) et de l’ouverture de deux nouvelles classes de seconde. Parallèlement, sixnouvelles classes de première année de BTA sont fermées, de même que deux classes de premièrescientifique et, en opposition à l’évolution antérieure positive, une classe de première technologique.Les mouvements négatifs s’appliquent essentiellement à l’enseignement privé à temps plein qui perdquatre classes de seconde, deux classes de première année de BTA et trois premières technologiques,et ne gagne qu’une classe de première professionnelle. Le privé à rythme approprié enregistre unnombre net d’ouverture de six classes, par l’ouverture de neuf premières professionnelles et lafermeture de trois premières années de BTA, l’offre restant stable par ailleurs. C’est encore le publicqui développe le plus son offre à ce niveau. Ce statut enregistre en effet un gain net de neuf classes,par l’ouverture de six nouvelles classes de seconde, deux premières technologiques et quatrepremières professionnelles, avec parallèlement la fermeture de deux classes de première scientifiqueet d’une première année de BTA.Niveau IIIL’offre de formation ne se développe que par le statut public : ouverture de cinq classes d’entrée enBTSA (première année de BTSA ou BTSA en un an), mais fermeture d’une classe préparatoire (mathsup bio). L’offre est stable dans le privé à temps plein. Le privé à rythme approprié a, lui, trois classesde première année de BTSA de moins en fonctionnement.L’offre de formationRepèresPremière SBTABTSAPremière scientifiqueBrevet de technicien agricoleBrevet de technicien supérieur agricoleLa notion de classe selon les statuts d’enseignementDans le secteur privé à rythme approprié, la loi fait référence à la notionde formation et non à celle de classe. La formation est déterminée parla spécialité ou par l'option en l'absence de spécialité. Dans le présentdocument, la notion de classe a été retenue pour tous les statutsd'enseignement.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.129
Les capacités d’accueil en formation initiale scolaireEvolution des places offertes aux concours d’entrée de l’INA-PG, de l’ENSAM, de l’ENSAR, de l’ENSIA, del’ENSBANA, de la FIF/ENGREF et de l’ENSHAP et répartition des places selon les différents concours en 2001Concours 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001A et AE 612 611 618 624 669 679 689 700B et BE 123 105 95 88 89 88 84 80C 37 41 43 42 41 37 36 33C2 — — — — 24 29 33 36Interne FIF 2 3 3 4 4 4 4 4Ensemble (hors D) 774 760 759 758 827 837 846 853D et DE Nd Nd Nd Nd 195 212 203 226Ensemble Nd Nd Nd Nd 1022 1049 1049 1079Interne FIFD et DEB et BEENSHAP : premiers concours en 1998.A et AE64,9%En 1997, 25 places au concours A spécifique à la FIF/ENGREF non comptabilisées.Concours A et AE (filières BCPST et TB) : les modifications pour le concours A en 1998 et 1999 sont dues à l'intégration des concours AE supplémentairesnon comptabilisés les années précédentes.Le concours C est devenu commun aux écoles (à l'exception de l'ENSBANA) en 1999. Auparavant, il y avait un concours C par école.Concours D et DE : 1 concours par école (INAP-G, ENSAM, ENSAR, ENSIA, ENSHAP/INH et FIF/ENGREF). Les données intégrales (écoles du MAAPARet de l’Education nationale) ne sont connues par la DGER qu’à partir de l’année 1998.C2C0,4%3,3%3,1%7,4%20,9%Evolution des places offertes aux concours d’entrée de l’ENITAB, de l’ENITACF, de l’ENESAD/ITA-FI, del’ENITHP et de l’ENITIAA et répartition des places selon les différents concours en 2001Concours 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001A 179 225 234 230 187 190 190 191B 56 45 48 48 45 48 48 53C 91 95 101 105 95 96 104 104Interne 5 5 4 4 6 7 7 10Interne exceptionnel — 20 20 — — — — —Etrangers 5 7 10 8 6 6 6 5Ensemble (hors D) 336 397 417 395 339 347 355 363EtrangersInterneD et DEC1,2%2,4%12,1%25,2%D et DE — 32 33 34 53 42 42 50Ensemble — Nd Nd Nd 392 389 397 413B12,8%ENITHP : derniers concours A, B et C en 1997 ; dernier concours D en 1998.Concours A : filières BCPST et TBPremier concours D en 1994.A46,3%Evolution des places offertes aux concours d’entrée de l’ENGEESet répartition des places selon les différents concours en 2001Concours 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001A 48 42 42 37 37 39 46 53Sur titres 6 8 8 8 12 12 14 14Etrangers 0 4 4 4 2 2 2 0Interne 4 4 4 5 5 6 4 4Ensemble 58 58 58 54 56 59 66 71InterneSur titresA5,6%19,7%74,7%Concours A: filières BCPST, PC et PSIEvolution des places offertes aux concours d’entrée des ENVet répartition des places selon les différents concours en 2001Concours 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001A 444 444 444 420 446 380 380 376B — — — 40 40 40 36 38C 16 16 16 10 12 12 18 20Ensemble (hors D et A de 98) 460 460 460 470 498 432 434 434A de 1998 — — — — — 100 99 —D et DE — — — — — 4 2 2Ensemble 460 460 460 470 498 536 535 436D et DECB0,5%4,6%8,7%130Concours A : filières BCPST et TB. Premier concours B en 1997. Premier concours D en1999 (concours d'admission directe en 2ème année d'école réservé aux titulaires d'undiplôme d'Etat de docteur en médecine, ou en pharmacie, ou encore en chirurgie dentaire.Concours A de 1998 : 199 candidats reçus au concours A de 1998 ont intégré les ENV en1999 (100) et 2000 (99).A86,2%
Les places offertes aux concours communsde l’enseignement supérieur long Evolution positive de l’offre de formation dans les ENSA dans le sens des concours A et D Ce sont les entrées par les concours B et D qui sont favorisées dans les ENIT, seul groupe d’écoles pourlequel le concours A n’est pas majoritaire en termes de places offertes L’ENGEES oriente davantage encore son recrutement vers le concours A Les ENV montre une offre relativement stable, ouvrant un peu leur recrutement sur les concours B et C, bienque le concours A demeure quasi exclusifENSAEn 2001, 30 places supplémentaires sont mises aux concours d’entrée des ENSA. Le concours D(+23 places) — qui perdait 9 places en 2000 — et le concours A (+11 places) — qui ne cesse deprogresser — bénéficient prioritairement de cette hausse, mais aussi le concours C2 (+3 places). Onnote en revanche, comme les années précédentes, une restriction de l’offre par la voie des concours B(-4 places de nouveau) et C (-3 places). Les concours A et D sont les deux principales voies derecrutement des ENSA : 65% des places sont réservées au premier, 21% au second. Ledéveloppement du recrutement par le concours C2, s’il reste limité, est à souligner : +50% en 3 ans.ENITCe sont 16 places supplémentaires qui sont mises aux concours d’entrée dans les ENIT en 2001.Cette évolution positive concerne avant tout les concours D (+8 places) et B (+5 places), mais aussile concours interne (+3 places) et le concours A (+1 place). La période longue confirme cetteorientation puisque, depuis 1995, ce sont les recrutements par les concours D, interne et B qui sedéveloppent le plus, suivi toutefois du concours C. Le concours A a, lui, perdu 15% de ses places. Ilreste pourtant dominant, en structure : 46% de l’offre. Le concours C, en recul, rassemble plus d’unquart des places. Le concours D progresse de 1,5 points à 12,1%.ENGEESLe recrutement se fait essentiellement par la voie du concours A. Ce concours bénéficie de 7 placessupplémentaires en 2001, comme ce fut le cas en 2000. Il constitue près des 3/4 de l’offre. Tous lesautres concours sont stables, mis à part le concours réservé aux étrangers qui perd 2 places.ENVHors concours A exceptionnel de 1998, le nombre de places à l’entrée des ENV est relativementstable et ce depuis 1999. En 2001, les concours B et C bénéficient chacun de 2 placessupplémentaires au détriment du concours A. Ce concours reste toutefois fortement dominant : 86%des places en 2001.L’offre de formationRepèresQUELQUES INFORMATIONS SUR LES CONCOURSLe concours A option BCPST concerne les titulaires d’un baccalauréat scientifique passéspar une classe préparatoire générale Biologie, chimie, physique et sciencesde la terre ; option TB concerne les titulaires d’un baccalauréat Sciences et techniques delaboratoire passés par une classe préparatoire Technologie et biologie. option PC (ENGEES) concerne les sortants de classes préparatoiresPhysique Chimie. option PSI (ENGEES) concerne les sortants de classes préparatoiresPhysique et Sciences de l’ingénieur.Le concours B concerne les titulaires d’un DEUG mention Sciences.Le concours C concerne les titulaires d’un BTSA, de certains BTS et DUT.Le concours D concerne les titulaires d’une maîtrise et certains diplômésingénieurs. Pour les ENV, ce concours est réservé aux titulaires d’un diplômed’Etat de docteur en médecine ou pharmacie ou chirurgie dentaire.NdBCPSTTBDEUGBTSADUTENSAENSHAPFIFENSIAENSBANAENGREFENVDonnée non disponibleBiologie, chimie, physique, sciences de laterreTechnologie et biologieDiplôme d’études universitaires généralesBrevet de technicien supérieur agricoleDiplôme universitaire de technologieEcole nationale supérieure agronomiqueEcole nationale supérieure d’horticulture etd’aménagement du paysageFormation des ingénieurs forestiersEcole nationale supérieure des industriesagricoles et alimentairesEcole nationale supérieure de biologieappliquée à la nutrition et à l’alimentationEcole nationale du génie rural, des eaux etdes forêtsEcole nationale vétérinaireSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur131
Les flux d’entrée dans l’enseignement agricoleEvolution des flux d’entrée dans l’enseignement agricoleselon le type de point d’entrée et le statut d’enseignementPrimo-entrantsdans l'enseignement agricole1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Evo.90-00Evo.00-01Classes d'entrée 15633 20725 21365 21848 21462 20819 19622 19879 +26% +1,3%PublicCours de cycle 821 834 987 839 944 1130 1336 1421 +63% +6,4%Ensemble public16454 21559 22352 22687 22406 21949 20958 21300 +27% +1,6%Privé TPClasses d'entrée 11248 16506 18135 17803 17609 17018 16463 15947 +46% -3,1%Cours de cycle 781 1290 1447 1748 1861 2469 2688 2620 +244% -2,5%Ensemble privé TP12029 17796 19582 19551 19470 19487 19151 18567 +59% -3,0%Classes d'entrée 7203 14782 15779 15812 15114 15488 15245 15136 +112% -0,7%Privé RACours de cycle 698 2276 2589 2525 2629 3248 3660 3772 +424% +3,1%Ensemble privé RA7901 17058 18368 18337 17743 18736 18905 18908 +139% +0,0%Classes d'entrée 34084 52013 55279 55463 54185 53325 51330 50962 +51% -0,7%EnsembleCours de cycle 2300 4400 5023 5112 5434 6847 7684 7813 +234% +1,7%Ensemble tous statuts36384 56413 60302 60575 59619 60172 59014 58775 +62% -0,4%Evolution de la répartition des flux d’entrée selon les niveaux de formationClasses d’entrée et cours de cycle19901998200140,5%30,4%38,2%36,3% 35,9%31,0%24,9%23,4%21,5%3,6%8,1%6,3%Niv. VI et Vbis Niv. V Niv. IV Niv. IIIRépartition des flux en classe d’entrée par niveau de formation selon le statut d’enseignement en 2001 - <strong>2002</strong>Classes d’entrée seulementPublic Privé à temps plein Privé à rythme approprié11,3%6,7%2,1%39,5%19,6%6,6%37,1%43,5%41,9%12,1%30,1%49,4%7,1%Ensemble23,5%40,5%Niveaux VI et VbisNiveau VNiveau IVNiveau III13228,8%
Données générales Légère baisse des flux d’entrée, dans le sens des évolutions de ces dernières années Progression des flux d’entrée en cours de cycle, recul en début de cycle Les flux sont en croissance, quel que soit le type de point d’entrée, dans le public ; ils sont stables dans leprivé à rythme approprié et en recul dans le privé à temps plein A la rentrée 2001, les niveaux VI et Vbis se positionnent au premier plan en termes de flux d’entréeLa rentrée 2001 est marquée par une très légère baisse des flux d’entrée en formation scolaire del’enseignement agricole, tous statuts d’enseignement et points d’entrée confondus : -0,4%.Cette évolution s’inscrit dans le mouvement négatif repéré depuis quelques années, mais s’avère bienmoins appuyée qu’en 2000 (-1,9%).Elle est la résultante d’une baisse du nombre des entrées en début de cycle (-0,7%) et d’uneprogression du nombre des entrées en cours de cycle (+1,7%).Elle masque aussi des évolutions contrastées selon le statut d’enseignement. En effet, l’enseignementpublic enregistre des entrées en croissance : +1,6%. Cette progression s’applique aux classes decours de cycle (+6,4% ; +85 élèves) mais aussi, bien que plus modérément, aux classes de début decycle (+1,3% ; +257 élèves).Dans le même temps, les flux d’entrée dans le privé à rythme approprié sont parfaitement stables.Dans ce statut, la baisse des flux en classe d’entrée, qui est conforme à l’évolution tous statutsconfondus (-0,7% ; -109 élèves), est compensée par la progression importante des flux en cours decycle (+3,1% ; +112 élèves).En revanche, le privé à temps plein est victime du mouvement à la baisse des flux d’entrée. Ce statutperd 516 nouveaux entrants (-3,1%) en début de cycle et 68 (-2,5%) en cours de cycle, soit un reculde -3% (-584 élèves) des flux d’entrée dans ce statut.Les évolutions positives repérées dans le public et, pour partie, dans le privé à rythme appropriéjouent sur la structure des flux d’entrée par niveau de formation, et ce à la faveur des niveaux VI etVbis. Ces niveaux concernent 36% des entrées dans les formations scolaires agricoles en 2001(+0,7 point par rapport à 2000). Tous les autres niveaux voient leur part dans les flux d’entrée évoluerà la baisse. Fait marquant de la rentrée 2001, le niveau V, qui jusqu’à présent était le point d’entréele plus important, cède sa place aux niveaux VI et Vbis : l’enseignement agricole accueille enpremier lieu, en termes de primo-entrants, des jeunes sans qualification, renforçant ainsi une de sesfonctions : celle de rémédiation dans le système éducatif national.La demande de formationRepèresFlux d’entrée en formation initiale scolaire :Elèves entrant une année donnée en formation initiale scolaire dansl’enseignement agricole et non inscrits dans ce système l’annéeprécédente.A titre de comparaison la structure des effectifs totaux par niveau deformation est la suivante, selon les statuts d’enseignement, en 2001 :VI et Vbis V IV IIIPublic 7,2% 25,6% 45,6% 21,6%Privé TP 21,0% 37,9% 30,7% 10,4%Privé RA 35,0% 43,5% 18,1% 3,5%Classe d’entrée (ou classe de début de cycle par opposition àcours de cycle) :On nomme classe d’entrée les classes de première année d’un cyclede formation. Ces classes sont :les classes de CLIPA et de CPA, les classes de quatrième, les classesde première année de CAPA, les classes de première année deBEPA, les classes de seconde, les classes de première scientifique,les classes de première année de BTA, les classes de premièretechnologique, les classes de première professionnelle, les classesde première année de BTSA, les classes de post-BTS, les classes depremière année de classe préparatoire.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.133
Les flux d’entrée dans l’enseignement agricoleEvolution des flux d’entrée en classe d’entrée de niveaux VI et Vbis1469613046105984 e technologique4 e préparatoireCPA, CLIPA3e accueil (jusqu’en 1996)6056Classes d’entrée - Niveau Vbis5539347114516271990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01Primo-entrants dansl'enseignement agricoleCPA, CLIPAet 3ème acc.Ensemble4èmepréparatoireEnsemble4èmetechnologiqueEnsembleNiveaux VI et Vbisclasses d'entrée1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Evo.90-00Evo.00-01Public 893 710 661 583 533 583 478 515 -46% +7,7%Privé TP 214 87 12 13 15 12 21 30 -90% +42,9%Privé RA 344 274 60 60 70 69 80 82 -77% +2,5%1451 1071 733 656 618 664 579 627 -60% +8,3%Public 378 153 134 130 87 130 76 63 -80% -17,1%Privé TP 2850 2096 2086 2021 1795 1820 1790 1711 -37% -4,4%Privé RA 2828 2792 2606 2145 1831 1962 1777 1697 -37% -4,5%6056 5041 4826 4296 3713 3912 3643 3471 -40% -4,7%Public 2272 2724 2654 2421 2067 1836 1763 1833 -22% +4,0%Privé TP 1565 2904 3188 2929 2705 2913 3034 3063 +94% +1,0%Privé RA 1702 4025 4567 4774 4562 5146 5517 5702 +224% +3,4%5539 9653 10409 10124 9334 9895 10314 10598 +86% +2,8%Public 3543 3587 3449 3134 2687 2549 2317 2411 -35% +4,1%Privé TP 4629 5087 5286 4963 4515 4745 4845 4804 +5% -0,8%Privé RA 4874 7091 7233 6979 6463 7177 7374 7481 +51% +1,5%Ensemble13046 15765 15968 15076 13665 14471 14536 14696 +11% +1,1%Flux d’entrée en cours de cycle au niveau Vbis en 2001Primo-entrants dansl'enseignement agricole3èmepréparatoire3èmetechnologiqueNiveau Vbiscours de cycleEnsemble1990 1995 1997 1999 2000 2001Evo. Evo.90-00 00-01Public 34 32 27 37 36 39 +6% +8,3%Privé TP 432 521 562 778 883 860 +104% -2,6%Privé RA 504 1027 899 876 809 862 61% +6,6%970 1580 1488 1691 1728 1761 +78% +1,9%Public 287 491 384 594 709 830 +147% +17,1%Privé TP 238 676 774 1265 1307 1342 +449% +2,7%Privé RA 179 1184 1481 2203 2615 2736 +1 361% +4,6%704 2351 2639 4062 4631 4908 +558% +6,0%Public 321 523 411 631 745 869 +132% +16,6%Privé TP 670 1197 1336 2043 2190 2202 +227% +0,5%Privé RA 683 2211 2380 3079 3424 3598 +401% +5,1%1674 3931 4127 5753 6359 6669 +280% +4,9%3 e technologique3 e préparatoireCours de cycle - Niveau Vbis666946311341674172897070490 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Les flux en classe d’entrée de niveaux VI et Vbis Reprise des flux d’entrée en début de cycle aux niveaux VI et Vbis Cette évolution positive concerne le privé à rythme approprié et surtout le public ; le privé à temps pleinmontre des flux en recul Les flux d’entrée en troisième augmentent fortement dans le public ; ils progressent aussi dans le privé àrythme approprié, alors que la croissance est peu sensible dans le privé à temps pleinLes flux d’entrée en classe de début de cycle dans l’enseignement scolaire agricole sont de nouveauen croissance à la rentrée 2001 : +1,1%. Cette évolution positive fait suite à une forte progressionjusqu’en 1996, un repli en 1997 et 1998, une reprise en 1999 et une stabilisation en 2000.C’est dans l’enseignement public que ces flux progressent le plus en 2001, alors qu’ils étaient enrecul en 2000 (+4,1% ; +94 nouveaux élèves).Ils sont toujours en augmentation dans le privé à rythme approprié (+1,5% ; +107 élèves), mais demanière moins soutenue qu’en 2000.En revanche, les flux d’entrée en classe de début de cycle dans le privé à temps plein sont, en 2001,en diminution (-0,8% ; -41 élèves).Globalement, l’évolution positive s’explique par une croissance des flux d’entrée en quatrièmetechnologique supérieure à la baisse des flux d’entrée en quatrième préparatoire, à laquelle s’ajoutela progression des flux d’entrée en CPA et CLIPA. Ces mouvements sont observés dans le public etle privé à rythme approprié. Dans le privé à temps plein, à l’inverse, la progression des flux d’entréeen quatrième technologique demeure insuffisante pour palier les pertes en quatrième préparatoire ;d’où le recul global.Parallèlement, on observe une très forte croissance des flux d’entrée en cours de cycle dans le public(+16,6% ; +124 nouveaux élèves). Ceci se vérifie dans le privé à rythme approprié, bien que demanière relativement moins marquée (+5,1% ; +174 élèves). Dans ces deux statuts, l’évolutionpositive concerne les classes de troisième technologique, mais aussi de troisième préparatoire. Dansle privé à temps plein, le mouvement est aussi positif (+0,5% ; +12 élèves), mais l’augmentation desentrées en troisième technologique compensent juste la baisse en troisième préparatoire.Ainsi, bien que la quatrième reste la classe d’entrée prépondérante au niveau Vbis dansl’enseignement agricole, le nouveau schéma national d’orientation affecte le recrutement dusystème : entre 31% et 33%, selon les statuts, des flux d’entrée à ce niveau se font en troisième (pour11% en 1990).La demande de formationRepèresNiveaux VI et VbisPremier cycle court pré-professionnel (quatrième et troisièmetechnologiques, quatrième et troisième préparatoires), classepréparatoire à l'apprentissage (CPA) et classe d'insertion préprofessionnelleen alternance (CLIPA).SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.135
Les flux d’entrée dans l’enseignement agricoleEvolution des flux d’entrée en classe d’entrée de niveau V2065718877Première année de BEPAPremière année de CAPA1107010840Classes d’entrée - Niveau V17902301990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01Primo-entrants dansl'enseignement agricoleCAPA 1EnsembleBEPA 1EnsembleNiveau Vclasses d'entrée1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Evo.90-00Evo.00-01Public 29 110 126 169 155 193 212 233 +631% +9,9%Privé TP 161 402 464 664 759 848 881 884 +447% +0,3%Privé RA 40 401 493 560 610 623 670 663 1575% -1,0%230 913 1083 1393 1524 1664 1763 1780 +667% +1,0%Public 4979 6504 6969 7318 7514 7532 7005 7144 +41% +2,0%Privé TP 3786 6562 7528 7171 6909 6555 6181 6059 +63% -2,0%Privé RA 2075 5878 6606 6761 6580 6246 5818 5674 +180% -2,5%10840 18944 21103 21250 21003 20333 19004 18877 +75% -0,7%Public 5008 6614 7095 7487 7669 7725 7217 7377 +44% +2,2%Privé TP 3947 6964 7992 7835 7668 7403 7062 6943 +79% -1,7%Privé RA 2115 6279 7099 7321 7190 6869 6488 6337 +207% -2,3%Ensemble11070 19857 22186 22643 22527 21997 20767 20657 +88% -0,5%136
Les flux en classe d’entrée de niveau V Nouvelle diminution des flux en classe d’entrée de niveau V en 2001, mais plus modérée que les évolutionsnégatives des années précédentes Le statut public montre, lui, des flux d’entrée qui progressent, à l’opposé des statuts privés Tous statuts confondus, c’est à la première année de BEPA que s’applique cette baisse entraînant la chutedes flux globaux d’entrée en début de cycle au niveau VComme c’est le cas depuis 1998, les flux d’entrée en classe de début de cycle au niveau V dansl’enseignement scolaire agricole sont en baisse en 2001. Mais ce mouvement est toutefois moinsimportant que les années précédentes : -0,5% (pour -110 nouveaux élèves), en comparaison de -6%en 2000.Par ailleurs, alors que le public montrait auparavant, sur la période longue, des mouvements moinssensibles, tant à la hausse qu’à la baisse, ce statut est le seul qui enregistre une évolution positive desflux d’entrée à ce niveau en 2001 : +2,2%, soit +160 élèves.Dans le même temps, les statuts privés et en particulier le privé à rythme approprié attire encoremoins de nouveaux élèves qu’en 2000, bien que les pertes soient moins marquées qu’auparavant. Lesentrées en début de cycle au niveau V diminuent en effet de -2,3% (-151 nouveaux élèves) dans leprivé à rythme approprié et de -1,7% (-119 nouveaux élèves) dans le privé à temps plein.Tous statuts confondus, ce sont toujours les entrées en première année de BEPA qui tirent à la baisseles flux au niveau V (-0,7% ; -127 élèves), tandis que les entrées en première année de CAPAprogressent (+1% ; +17 élèves).Mais les situations sont contrastées selon les statuts. Dans le privé à rythme approprié, les fluxd’entrée sont en recul dans les deux filières (respectivement -2,5% et -1%). Dans le public, aucontraire, ils progressent en BEPA (+2%) et plus encore en CAPA (+9,9%). Dans le privé à tempsplein, ils sont en repli en BEPA (-2%) et ne croissent que faiblement en CAPA (+0,3%).La demande de formationRepèresNiveau VSecond cycle court professionnel (CAPA et BEPA)Flux d’entrée en formation initiale scolaire :Elèves entrant une année donnée en formation initiale scolaire dansl’enseignement agricole et non inscrits dans ce système l’annéeprécédente.Classe d’entrée (ou classe de début de cycle par opposition àcours de cycle) :On nomme classe d’entrée les classes de première année d’un cyclede formation. Ces classes sont :les classes de CLIPA et de CPA, les classes de quatrième, les classesde première année de CAPA, les classes de première année de BEPA,les classes de seconde, les classes de première scientifique, lesclasses de première année de BTA, les classes de premièretechnologique, les classes de première professionnelle, les classes depremière année de BTSA, les classes de post-BTS, les classes depremière année de classe préparatoire.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.137
Les flux d’entrée dans l’enseignement agricoleEvolution des flux d’entrée en classe d’entrée de niveau IV119748693SecondePremière année de BTAPremière technologiquePremière professionnellePremière scientifique65847453Classes d’entrée - Niveau IV210014096429881342733581990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01346Primo-entrants dansl'enseignement agricoleSeconde GTEnsemblePremièrescientifiqueEnsemblePremièreBTAEnsemblePremièreBac technologiqueEnsemblePremièreBac professionnelEnsembleNiveau IVclasses d'entrée1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Evo.90-00Evo.00-01Public 5031 5725 5828 6140 5938 5793 5652 5568 +12% -1,5%Privé TP 1469 1805 1945 2054 2053 1904 1765 1781 +20% +0,9%Privé RA 84 105 110 123 141 128 134 104 +60% -22,4%6584 7635 7883 8317 8132 7825 7551 7453 +15% -1,3%Public 493 271 307 300 293 237 248 290 -50% +16,9%Privé TP 149 81 99 93 110 71 55 56 -63% +1,8%Privé RA642 352 406 393 403 308 303 346 -53% +14,2%Public 869 841 544 603 554 576 558 544 -36% -2,5%Privé TP 456 986 898 936 1072 1028 923 870 +102% -5,7%Privé RA 84 904 727 713 671 757 678 686 +707% +1,2%1409 2731 2169 2252 2297 2361 2159 2100 +53% -2,7%Public 1000 1018 1003 931 889 895 1006 +12,4%Privé TP 356 391 403 470 343 364 307 -15,7%Privé RA 25 45 34 48 31 22 29 +31,8%1381 1454 1440 1449 1263 1281 1342 +4,8%Public 46 325 545 490 552 528 451 443 +880% -1,8%Privé TP 10 12 112 108 168 94 158 111 +1 480% -29,7%Privé RA 2 102 221 275 211 183 180 179 +8 900% -0,6%58 439 878 873 931 805 789 733 +1 260% -7,1%Public 6439 8162 8242 8536 8268 8023 7804 7851 +21% +0,6%Privé TP 2084 3240 3445 3594 3873 3440 3265 3125 +57% -4,3%Privé RA 170 1136 1103 1145 1071 1099 1014 998 +496% -1,6%138Ensemble8693 12538 12790 13275 13212 12562 12083 11974 +39% -0,9%
Les flux en classe d’entrée de niveau IV Les flux d’entrée sont toujours en recul en début de cycle de niveau IV, mais de moindre manière queprécédemment Le public est, comme au niveau V, épargné par cette tendance à la baisse des flux d’entrée Les classes touchées sont les premières professionnelles, les premières années de BTA et les classes desecondeLe recul des flux d’entrée en début de cycle au niveau IV, amorcé en 1998, se poursuit en 2001. Lachute de ces entrées est cependant amortie en comparaison des années précédentes : -0,9% tousstatuts confondus (soit -109 nouveaux élèves), pour -3,8% en 2000 et -4,9% en 1999.Cette tendance à la baisse se vérifie en 2001 dans le privé à rythme approprié (-1,6%, mais -16nouveaux élèves seulement) et surtout dans le privé à temps plein (-4,3% ; -140 nouveaux élèves).En revanche, comme au niveau V, le public bénéficie ici d’une légère reprise de ses flux d’entrée :+0,6% (soit +47 élèves).Le recul touche en premier lieu les premières professionnelles (-7,1% ; -56 élèves), en particulierdans le privé à temps plein (-29,7% ; -48 élèves). Les premières années de BTA accueillent de mêmemoins de nouveaux entrants qu’en 2000 : -2,7%, soit -59 élèves. Dans cette filière, la baisse des fluxd’entrée touche le statut public, et plus encore le statut privé à temps plein, alors que le privé àrythme approprié montre un nombre d’entrées croissant. Les flux sont aussi en recul en classe deseconde (-1,3% ; -98 élèves) en raison d’évolutions négatives dans le public et le privé à rythmeapproprié, tandis que le privé à temps plein est là épargné.Pour le reste des filières, les flux d’entrée progressent : +4,8% aux premières technologiques (soit+61 nouveaux élèves), malgré un mouvement négatif dans le privé à temps plein, et +14,2% à lapremière scientifique (soit +43 nouveaux entrants).Il est à noter que le public évolue positivement, en termes de flux d’entrée, par la filière scientifiqueet la filière technologique. Le privé à temps plein ne progresse, sur ce plan des entrées, que dans lecadre de la seconde et de la première scientifique.La demande de formationRepèresNiveau IVCycle long professionnel, technologique ou général (seconde générale ettechnologique, baccalauréat professionnel, baccalauréat technologique,baccalauréat scientifique, brevet de technicien agricole).SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.139
Les flux d’entrée dans l’enseignement agricoleEvolution des flux d’entrée en classe d’entrée de niveau III36353456Première année de BTSAClasses d’entrée - Niveau III127512351990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 019485Classes préparatoires post - BTSA - BTS - DUT35Autres classes préparatoires51990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01Primo-entrants dansl'enseignement agricoleBTSA 1Ensemble1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Evo.90-00Evo.00-01Public 603 2208 2387 2527 2652 2343 2138 2061 +255% -3,6%Privé TP 588 1215 1412 1411 1553 1430 1291 1075 +120% -16,7%Privé RA 44 276 344 367 390 343 369 320 +739% -13,3%1235 3699 4143 4305 4595 4116 3798 3456 +208% -9,0%Post-BTS Public 5 54 73 60 89 61 51 94 +920% +84,3%EnsembleClassespréparatoiresEnsembleNiveau IIIclasses d'entréeEnsemble5 54 73 60 89 61 51 94 +920% +84,3%Public 35 100 119 104 97 118 95 85 +171% -10,5%35 100 119 104 97 118 95 85 +171% -10,5%Public 643 2362 2579 2691 2838 2522 2284 2240 +255% -1,9%Privé TP 588 1215 1412 1411 1553 1430 1291 1075 +120% -16,7%Privé RA 44 276 344 367 390 343 369 320 +739% -13,3%1275 3853 4335 4469 4781 4295 3944 3635 +209% -7,8%140
Les flux en classe d’entrée de niveau III Les flux d’entrée en début de cycle au niveau III continuent de diminuer de manière importante Bien que touché par cette baisse, le public est le statut qui résiste le mieux Le privé à temps plein est le plus marqué par cette régression des flux d’entréeAprès une période de très forte croissance des flux d’entrée en début de cycle au niveau III, la rentrée1999 marquait un tournant (-10,2%) que confirmait la baisse enregistrée à la rentrée 2000 (-8,2%).En 2001, cette tendance à la réduction des entrées de nouveaux élèves au niveau III se prolonge : cesont en effet 309 nouveaux élèves de moins (-7,8%), par rapport à 2000, qui intègrent une formationscolaire agricole à ce niveau.Cette année, tous les statuts sont touchés, y compris le privé à rythme approprié qui bénéficiait d’unsursaut en 2000. A ce niveau encore, le public sort son épingle du jeu puisque le recul enregistré dansles flux d’entrée y est de -1,9% (-44 élèves). C’est effectivement dans ce statut que les flux d’entréeen première année de BTSA chutent le moins (-3,6% ; -77 nouveaux élèves). Il bénéficie en outred’une croissance marquée des flux d’entrée en classes préparatoires post-BTSA, signe que cetteformation devient davantage attractive pour les diplômés de BTS ou de DUT souhaitant intégrer uneécole d’ingénieurs. Dans le même temps, on note en revanche le recul des flux d’entrée en classepréparatoire générale.Les statuts privés sont davantage marqués par le recul des flux d’entrée au niveau III. En particulier,ces flux régressent de -16,7% dans le privé à temps plein (soit -216 nouveaux élèves). Dans le privéà rythme approprié, si le recul reste relativement important, il concerne un volume moindre deformés (-49 nouveaux entrants).Une interrogation se pose, quels que soient les contrastes entre statuts, sur le recrutement des élèvesde BTSA. En effet, le niveau des entrées de nouveaux élèves en 2001 se situe aux alentours de celuienregistré en 1994, la poursuite d’études des diplômés de niveau IV de l’enseignement agricole nesuffit plus à palier le recul des flux d’entrée et les classes d’âges concernées par ce niveau deformation à venir sont des classes creuses.La demande de formationRepèresNiveau IIIPremier cycle supérieur de deux années d’études post-baccalauréat(BTSA, classes prépatoires).BTSA : Brevet de technicien supérieur agricoleSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.141
Les candidaturesLes étudiants candidats à l’entrée dans les écoles recrutant sur concours communs, les intégrés et le tauxd’intégration — L’INA-PG, l’ENSAM, l’ENSAR, l’ENSIA, l’ENSHAP, la FIF/ENGREF et l’ENSBANAConcours 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Candidats 1926 1681 1792 1952 1856 1748 1729 1740A et AEIntégrés 601 613 645 625 655 678 690 691Tx Intégration 31,2 36,5 36,0 32,0 35,3 38,8 39,9 39,7Candidats 789 457 496 566 610 501 455 386B et BEIntégrés 104 103 86 88 93 84 73 83Tx Intégration 13,2 22,5 17,3 15,5 15,2 16,8 16,0 21,5Candidats 272 238 259 260 297 302 292 243CIntégrés 26 22 19 25 29 28 26 21Tx Intégration 9,6 9,2 7,3 9,6 9,8 9,3 8,9 8,6Candidats — — — — 56 76 88 84C2Intégrés — — — — 11 16 32 32Tx Intégration 19,6 21,1 36,4 38,1Candidats 2987 2376 2547 2778 2819 2627 2564 2453EnsembleIntégrés 731 738 750 738 788 806 821 827TxIntégration 24,5 31,1 29,4 26,6 28,0 30,7 32,0 33,7Autres intégrés 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001D et DENind. Nind. Nind. Nind. Nind. 167 184 203Interne FIF2 2 3 4 3 2 3 3Ensemble733 740 753 742 791 975 1008 1033Candidats ENSA19261740Concours A et AEConcours B et BEConcours CConcours C27892721992 93 94 95 96 97 98 99 2000 0138624384Les étudiants candidats à l’entrée dans les écoles recrutant sur concours communs, les intégrés et le tauxd’intégration — L’ENITAB, l’ENITACF, l’ENESAD/ITA-FI, l’ENITHP et l’ENITIAAConcours 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Candidats 1751 1555 1656 1824 1771 1642 1641 1583AIntégrés 185 220 235 202 190 190 184 192Tx Intégration 10,6 14,1 14,2 11,1 10,7 11,6 11,2 12,1Candidats 781 613 519 595 565 496 420 387BIntégrés 56 45 48 48 45 48 53 53Tx Intégration 7,2 7,3 9,2 8,1 8,0 9,7 12,6 13,7Candidats 304 304 337 375 353 370 341 303CIntégrés 91 95 101 105 95 96 100 105Tx Intégration 29,9 31,3 30,0 28,0 26,9 25,9 29,3 34,7Candidats — 165 202 211 314 371 358 205DIntégrés — 32 33 31 54 42 45 49Tx Intégration — 19,4 16,3 14,7 17,2 11,3 12,6 23,9Candidats 2836 2637 2714 3005 3003 2879 2760 2478EnsembleIntégrés 332 392 417 386 384 376 382 399Tx Intégration 11,7 14,9 15,4 12,8 12,8 13,1 13,8 16,1Autres intégrés 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Interne5 5 4 4 6 7 7 10Interne exceptionnel— 20 20 — — — — —Etrangers0 2 3 2 3 5 3 2Ensemble337 419 444 392 393 388 392 411Candidats ENIT17511583142Concours AConcours BConcours CConcours C27813041992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01387303205
Candidatures et intégrations dans les écoles supérieuresrecrutant sur concours communs — ENSA - ENIT Baisse des candidatures à l’entrée des ENSA, par les concours B, C et C2 Le taux d’intégration évolue positivement par les concours B et C2 Baisse encore plus importante des candidatures à l’entrée des ENIT, et ce quel que soit le concours Croissance du taux d’intégration, en particulier par les concours D et CENSAHors concours D, les ENSA enregistrent encore, comme cela est le cas depuis 1999, une baisseimportante des candidatures à l’entrée. On décompte ainsi, pour la rentrée 2001, 111 candidats demoins qu’en 2000 (soit -4,3%).Ce sont, comme auparavant, les candidatures par la voie du concours B (-69 candidats ; -15,2%) etdu concours C (-49 candidats ; -16,8%) qui diminuent. On note de plus cette année un légerfléchissement concernant le concours C2 (-4 candidats).A l’inverse, on assiste à une légère reprise des candidatures aux concours A : +11 candidats, soit+0,6%.Parallèlement, le nombre d’intégrés continuent de croître quelque peu (+0,7% pour 6 étudiantssupplémentaires) ; ce qui mène à une nouvelle élévation du taux d’intégration — hors concours D —de +1,7 points à 33,7%. Ceci se trouve vérifié, plus précisément, pour le concours B (+5,5 points à21,5%) pour lequel la baisse des candidature se cumule à la hausse des intégrations, mais aussi pourle concours C2 (+1,7 points à 38,1%) pour un nombre stable d’intégrés.En revanche, le taux d’intégration par le concours A est relativement stable (-0,2 point à 39,7%), toutcomme celui du concours C (-0,3 point à 8,6%), en raison d’évolutions comparables du nombre decandidatures et d’intégrés, à la hausse pour le concours A et à la baisse pour le concours C.ENITLes candidatures à l’entrée des ENIT sont de même en recul depuis 1999. En 2001, on enregistre,hors concours interne et étrangers, 282 candidats de moins qu’en 2000 (-10,2%). Cette diminutiondu nombre de candidatures concerne tous les concours, en particulier le concours D (-153 candidats ;-42,7%) et le concours C (-38 candidats ; -11,1%), mais aussi le concours B (-33 candidats ; -7,9%)et le concours A (-58 candidats ; -3,5%).Parallèlement, le nombre d’intégrés est en croissance pour les concours A, C et D et stable pour leconcours B. Par voie de conséquence, les taux d’intégration progressent. C’est particulièrement lecas concernant le concours D (+11,3 points à 23,9%). Ce taux s’améliore de +5,4 points (à 34,7%)pour le concours C, de +1,1 points (à 13,7%) pour le concours B et de +0,9 point (à 12,1%) pour leconcours A. Au total, ce sont 16,1% des candidats aux ENIT — hors concours interne et étrangers —qui sont intégrés (+2,3 points).La demande de formationRepèresLes différents types de concoursVoir pages suivantesENSHAP : premiers concours en 1998Concours A en 1997 : Ne sont pas compris les candidats et lesintégrés au concours spécifique à la FIF/ENGREF.Le concours C est devenu commun aux ENSA (à l’exception del’ENSBANA) en 1999. Auparavant, il y avait un concours par école.ENITHP : derniers concours A, B et C en 1997 ; dernier concours D en1998.NdENSAENSHAPFIFENSIAENSBANAENGREFDonnée non disponibleEcole nationale supérieure agronomiqueEcole nationale supérieure d’horticulture etd’aménagement du paysageFormation des ingénieurs forestiersEcole nationale supérieure des industriesagricoles et alimentairesEcole nationale supérieure de biologie appliquéeà la nutrition et à l’alimentationEcole nationale du génie rural, des eaux et desforêtsSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur143
Les candidaturesLes étudiants candidats à l’entrée dans les écoles recrutant sur concours communs, les intégrés et le tauxd’intégration — L’ENGEESConcours 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Candidats 2295 2799 1734 2446 2091 1796 1536 1413AIntégrés 47 49 46 49 53 47 60 62Tx Intégration 2,0 1,8 2,7 2,0 2,5 2,6 3,9 4,4Candidats 25 52 91 160 101 108 109 57Sur titresIntégrés 4 4 5 6 6 6 4 7Tx Intégration 16,0 7,7 5,5 3,8 5,9 5,6 3,7 12,3Candidats 0 25 16 0 0 1 0 0EtrangersIntégrés 1 2 1 0 0 0 0 0Tx Intégration — 8,0 6,3 — — 0,0 — —Candidats 7 3 8 5 5 6 8 9InterneIntégrés 2 1 3 3 3 5 4 3Tx Intégration 28,6 33,3 37,5 60,0 60,0 83,3 50,0 33,3Candidats 2327 2879 1849 2611 2197 1911 1653 1479EnsembleIntégrés 54 56 55 58 62 58 68 72Tx Intégration 2,3 1,9 3,0 2,2 2,8 3,0 4,1 4,9Candidats ENGEES2295Concours A1413Autre : sur titre,étrangers, interne32661992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01Les étudiants candidats à l’entrée dans les écoles recrutant sur concours communs, les intégrés et le tauxd’intégration — Les écoles vétérinairesConcours 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Candidats Nd Nd 1729 1677 1674 1446 1564 1443AIntégrés 455 444 444 420 446 380 380 376Tx Intégration Nd Nd 25,7 25,0 26,6 26,3 24,3 26,1Candidats _ _ _ 560 474 415 424 429BIntégrés _ _ _ 40 40 40 36 38Tx Intégration _ _ _ 7,1 8,4 9,6 8,5 8,9Candidats Nd Nd 87 113 98 99 85 79CIntégrés 5 16 16 10 12 12 18 20Tx Intégration Nd Nd 18,4 8,8 12,2 12,1 21,2 25,3Candidats — — — — — 7 7 9DIntégrés — — — — — 4 2 2Tx Intégration — — — — — 57,1 28,6 22,2Candidats Nd Nd 1816 2350 2246 1967 2080 1960EnsembleIntégrés 460 460 460 470 498 436 436 436Tx Intégration Nd Nd 25,3 20,0 22,2 22,2 21,0 22,2Autres intégrés 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Ade 1998_ — — — — 100 99 —Ensemble460 460 460 470 498 536 535 436Candidats ENV17291443Concours AConcours B5604291441996 97 98 99 2000 01
Candidatures et intégrations dans les écoles supérieuresrecrutant sur concours communs — ENGEES - ENV Baisse des candidatures à l’entrée à l’ENGEES, notamment sur titres Amélioration du taux d’intégration Baisse des candidatures à l’entrée des ENV, par les concours A et C Hausse relative du taux d’intégrationENGEESLes candidats à l’entrée à l’ENGEES se font encore moins nombreux que précédemment. Onrecence, en 2001, 174 candidatures de moins (-10,5%) qu’en 2000. En particulier, le nombre decandidats sur titres se réduit quasiment de moitié (de 109 en 2000 à 57 en 2001). Le concours Arassemble aussi 123 candidats de moins (-8%).Or, par la voie de ces concours comme au total, le nombre d’intégrés est en augmentation. Le tauxd’intégration évolue donc positivement, de manière importante pour le concours sur titre, tout enrestant globalement faible : 4,9% des candidats à l’ENGEES en 2001 sont intégrés.RepèresENVEn 2001, les écoles nationales vétérinaires n’échappent pas à la règle : le nombre de candidatures àl’entrée se réduit (-120 candidats ; -5,8%), alors qu’il était en reprise en 2000.Les voies particulièrement sujettes à la baisse sont celles par le concours A (-121 candidats ; -7,7%)et le concours C (-6 candidats ; -7,1%). A noter que le concours D, voie de recrutement limitéeconcernant les ENV, compte, lui, 2 candidats de plus en 2001.Comme le nombre d’intégrés croît parallèlement pour les concours B et C, est stable pour le concoursD et faiblit peu pour le concours A, le taux d’intégration est globalement en hausse : +1,2 points à22,2%. Il évolue positivement surtout pour le concours C : +4,1 points à 25,3%.La demande de formationLe concours A option BCPST concerne les titulaires d’un baccalauréat scientifiquepassés par une classe préparatoire générale Biologie, chimie,physique et sciences de la terre ; option TB concerne les titulaires d’un baccalauréat Sciences ettechniques de laboratoire passés par une classe préparatoireTechnologie et biologie. option PC (ENGEES) concerne les sortants de classespréparatoires Physique Chimie. option PSI (ENGEES) concerne les sortants de classespréparatoires Physique et Sciences de l’ingénieur.Le concours B concerne les titulaires d’un DEUG mention Sciences.Le concours C concerne les titulaires d’un BTSA, de certains BTS etDUT.Le concours D concerne les titulaires d’une maîtrise et certainsdiplômés ingénieurs. Pour les ENV, ce concours est réservé auxtitulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ou pharmacie ouchirurgie dentaire.NdBCPSTTBPCPSIDEUGBTSADUTENGEESENVDonnée non disponibleBiologie, chimie, physique, sciences de la terreTechnologie et biologiePhysique ChimiePhysique et Sciences de l’ingénieurDiplôme d’études universitaires généralesBrevet de technicien supérieur agricoleDiplôme universitaire de technologieEcole nationale du génie de l’eau et del’environnement de StrasbourgEcole nationale vétérinaireSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur145
L’origine scolaire des inscritsEvolution de la part des nouveaux entrants dans les effectifs des formations par la voie scolaireselon le statut d’enseignementEnsemble des formations initiales scolaires - Classes d’entréePublic63,6%Privé à temps pleinPrivé à rythme appropriéEnsemble57,5%60,0%57,3%54,5%53,3%54,1%50,1%45,9%44,5%44,4%41,8%1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01Toutes classes29,1%27,5%27,3%25,0%40,1%35,3%32,5%38,1% 38,3%34,9% 34,5% 34,1%33,7% 34,0%29,9% 30,8%1990 1995 2000 2001Part des nouveaux entrants selon le niveau de formationTous statuts - Classes d’entréeNiveaux VI et VbisNiveau V87,6 90,3 90,1 91,2 95,1 94,9 95,2 95,1 94,4 95,8 95,7 95,240,8 47,2 49,3 54,3 61,6 62,2 64,0 64,2 63,4 63,0 62,8 62,91990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 011990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01Niveau IVNiveau III33,933,435,037,940,939,938,938,537,535,435,6 35,623,624,629,131,535,436,836,238,334,331,1 29,714,31990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 011990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01Détail par niveau de formation et statut d’enseignement146Part des nouveaux entrants dansles effectifs des classes d'entréeNiveauxVI et VbisNiveau VNiveau IVNiveau III1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Public 90,3 93,3 92,9 93,9 91,1 92,0 90,1 92,4Privé TP 87,5 94,6 95,5 94,4 94,9 95,6 95,9 93,5Privé RA 85,7 95,9 96,1 96,3 95,4 97,4 97,4 97,2Public 62,8 73,5 74,2 76,3 76,6 77,4 75,6 77,2Privé TP 37,6 59,8 63,3 62,6 60,3 59,9 60,3 60,3Privé RA 24,5 55,6 57,0 56,6 56,1 54,6 55,0 53,8Public 39,7 44,1 43,3 43,0 41,5 40,5 40,4 41,0Privé TP 30,1 36,2 36,0 35,8 36,6 32,6 33,4 32,4Privé RA 6,8 28,8 25,9 24,6 22,5 21,4 20,8 20,6Public 10,9 31,4 32,2 31,8 33,6 29,7 26,7 26,8Privé TP 22,3 44,4 46,8 45,8 48,4 45,1 40,5 36,1Privé RA 11,5 45,6 45,0 46,0 47,3 40,3 39,8 35,5
La part des nouveaux entrants dans les inscrits en classe d’entréedes formations initiales scolaires Part de nouveaux entrants en début de cycle en diminution en 2001 dans le privé, mais reprise dans le public Classes d’entrée et de cours de cycle confondues, cet indicateur est toutefois en croissance en 2001 Ce sont les niveaux VI et Vbis et III qui sont sujets à la baisse de la part des nouveaux entrants en début decycleLa part de nouveaux entrants dans les effectifs des classes de début de cycle de la formation scolaireagricole est toujours en recul dans les statuts privés.Ainsi, en 2001, ce sont 54,5% (-0,9 pt) des élèves inscrits en début de cycle dans le privé à tempsplein qui n’étaient pas élèves de l’enseignement scolaire agricole l’année précédente. Pour le privéà rythme approprié, ce chiffre s’élève à 60% (-0,6 pt).En revanche, toujours concernant les classes d’entrée, la part de nouveaux élèves dansl’enseignement public est en augmentation (+1 pt) : elle repasse au dessus de la barre des 50%.Néanmoins, notamment en raison d’un recrutement qui se développe en cours de cycle au niveauVbis (classes de troisième), la part de nouveaux élèves, classes de début et de cours de cycleconfondues, est, pour l’ensemble des niveaux de formation, en progression dans le public (+0,9 ptà 30,8%), mais aussi dans le privé à rythme approprié (+0,3 pt à 38,3%). Ceci mène à la progressionde cet indicateur pour l’ensemble des familles de l’enseignement agricole (+0,3 pt à 34%), malgré lerecul repéré dans le privé à temps plein (-0,4 pt à 34,1%).Malgré les fléchissements constatés, plus d’un tiers des élèves de la formation scolaire agricole en2001 n’étaient pas inscrits dans ce système et sous ce mode de formation en 2000.Les évolutions négatives s’appliquent aux niveaux VI et Vbis — 95,2% des élèves en classe d’entréede ces niveaux sont de nouveaux élèves pour 95,7% en 2000 — et au niveau III — 29,7% d’entrantsen début de cycle pour 31,1% en 2000 —.Pour les niveaux V et IV, la part des nouveaux entrants en début de cycle est, elle, relativement stable.On repère toutefois des évolutions inverses à l’ensemble des familles pour certains niveaux etstatuts : hausse de la part des entrants à tous les niveaux dans le public, baisse de cette part au niveauV dans le privé à rythme approprié et au niveau IV dans le privé à temps plein, le tout sur la base desclasses d’entrée.La demande de formationRepèresPart des nouveaux entrantsNombre d'élèves entrant une année donnée en formation initialescolaire dans l’enseignement agricole et non inscrits dans une de cesformations l’année précédente, rapporté aux effectifs totaux de l’annéedonnée.Les niveaux de formationcf. pages précédentesSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.147
Le financementEvolution du budget pour les missions de la DGEREn millions d'euros LFI 95 LFI 96 LFI 97 LFI 98 LFI 99 LFI 00 LFI 01 LFI 02Evo.01/02en %Evo.95/02en %I- DEPENSES ORDINAIRES 861,64 921,07 944,17 982,30 1049,31 1084,17 1145,18 1180,37 +3,1 +37,0Dépenses de personnelenseignement publicet recherche400,55 414,93 425,48 428,33 457,89 474,56 529,12 544,29 +2,9 +35,9Moyens de fonctionnementdes services (2)6,60 6,61 6,61 5,93 6,39 6,31 6,31 6,31 -0,0 -4,4Subvention de fonctionnement 48,66 51,18 49,71 53,50 55,82 58,85 54,79 56,55 +3,2 +16,2- aux établissementsd'enseignement public40,43 42,08 42,41 45,86 48,03 51,06 46,85 48,60 +3,7 +20,2- aux instituts de recherche 8,23 9,10 7,30 7,64 7,78 7,79 7,94 7,94 -0,0 -3,5Actions de formationet d'expérimentation (1-3)23,79 28,18 25,25 27,09 25,12 22,46 22,29 33,39 +49,8 +40,3Enseignement privé 310,39 344,40 362,69 391,69 423,97 440,43 449,72 456,00 +1,4 +46,9- enseignement technique 295,90 329,55 347,84 376,24 408,53 423,66 432,65 437,71 +1,2 +47,9- enseignement supérieur 14,48 14,85 14,85 15,44 15,44 16,77 17,07 18,29 +7,1 +26,3Bourses 70,80 74,80 73,46 74,80 79,15 80,60 81,98 81,50 -0,6 +15,1- enseignement technique 64,56 67,69 66,77 67,80 72,04 73,29 73,90 73,07 -1,1 +13,2- enseignement supérieur 5,48 6,17 5,95 5,95 6,06 6,10 6,86 6,86 -0,0 +25,2- stages à l'étranger 0,76 0,93 0,75 1,05 1,05 1,22 1,22 1,57 +28,7 +106,0Transports scolaires 0,08 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 +2,0 +150,5Réparation accidents du travaildes élèves et des étudiantsII- DEPENSES EN CAPITAL0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 2,13 +179,4 +179,4Autorisations de programme 14,56 13,48 15,58 13,32 13,29 13,06 14,99 23,08 +54,0 +58,5- enseignement public 13,39 11,97 12,15 9,99 9,99 9,60 11,68 14,27 +22,2 +6,6- enseignement privé 0,69 0,58 0,48 0,37 0,37 0,52 0,37 0,48 +31,2 -30,0- recherche 0,49 0,94 2,95 2,97 2,93 2,94 2,94 8,33 +183,1 +1 607,5Crédits de paiement 10,82 11,81 12,51 13,10 12,84 13,08 11,60 17,19 +48,2 +58,8- enseignement public 9,44 10,17 9,12 9,51 9,02 9,02 8,08 9,00 +11,4 -4,7- enseignement privé 0,89 0,70 0,62 0,63 0,66 0,73 0,58 0,42 -27,5 -52,9- recherche 0,49 0,94 2,77 2,96 3,16 3,32 2,94 7,78 +164,4 +1 494,8Total des DO et DC (CP) 872,46 932,88 956,68 995,40 1062,16 1097,25 1156,79 1197,56 +3,5 +37,3Budget pour les missions de la DGER :Evolution des dépenses ordinaires et crédits de paiement (en millions d’euros)1400,001200,001000,001062,151156,791197,56800,00773,55872,46956,72600,00674,59400,00200,001480,001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 <strong>2002</strong>
Evolution du budget de l’enseignement agricole Taux de croissance intermédiaire pour le budget de la DGER dans le cadre de la loi de finances <strong>2002</strong>,comparativement aux évolutions variables des sept années précédentes : +3,5% La hausse concernent surtout les crédits de paiement pour l’enseignement public et la recherche et, au seindes dépenses ordinaires, les réparations accidents du travail, les actions de formation et d’expérimentation, lesstages à l’étranger, l’enseignement supérieur privé, les subventions aux établissements d’enseignementpublic.Sur la période 1995-<strong>2002</strong>, le budget pour les missions de la DGER est sujet à des taux de croissanceannuels très variables.Progressant de manière importante en 1996 (+6,9%), 1999 (+6,7%) et 2001 (+5,4%), il est nettementmoins valorisé les autres années : +2,6% en 1997, +4% en 1998 et +3,3% en 2000.Pour <strong>2002</strong>, la croissance est intermédiaire : +3,5%.Les crédits de paiement connaissent une évolution particulièrement positive, puisqu’ils gagnent+48,2%. C’est l’enseignement public (+11,4%) et surtout la recherche (+164%) qui en bénéficient,car ces crédits sont en revanche en diminution pour l’enseignement privé (-27,5%).Pour ce qui est des dépenses ordinaires, elles sont en hausse de +3,1%.Les rubriques qui montrent les plus fortes revalorisation sont, dans l’ordre : La rubrique « Réparation accidents du travail des élèves et des étudiants » (+179% à2,13 millions d’euros) ; La rubrique « Actions de formation et d’expérimentation » (+49,8% à 33,39 millionsd’euros) ; La ligne « Stages à l’étranger » de la rubrique « Bourses » (+28,7% à 1,57 millionsd’euros) ; Les subventions à l’enseignement supérieur privé (+7,1% à 18,29 millions d’euros) ; Les subventions de fonctionnement aux établissements d’enseignement public(+3,7% à 48,60 millions d’euros) ;Sont en recul, les bourses de l’enseignement technique (-1,1%).Sur le long terme, ce sont les rubriques «Réparations accidents du travail des élèves et desétudiants » (+179,4%), « Transports scolaires » (+150,5%), « Stages à l’étranger » (+106%),« Enseignement privé » (+46,9%) et « Actions de formation et d’expérimentation » qui voient leursdotations croître le plus en relatif.Les ressources et les coûtsRepèresLFI : Loi de financeNB :Les chiffres évoqués ne prennent pas en compte les subventionsaccordées par les Régions aux établissements dans le cadre du régimede partage des compétences résultant des lois de décentralisation.Actions de formation et d’expérimentationCette rubrique comprend l’ensemble du chapitre 43 23 : Actions deformation et actions éducatives en milieu rural (préparation àl’installation, apprentissage, programme national formation et emploi enmilieu rural, formation et information des cadres syndicaux etprofessionnels de l’agriculture).SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheMission des Affaires générales149
Les ressources humainesLes personnels de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole publicEffectifs 1992 - 93 1995 - 961997 - 981999 - 2000 2000 - 012001 - 02Equivalentstemps pleinPersonnels de directionEnseignants titulairesEnseignants non titulaires(ACE)Education et surveillanceATOSSEnseignants non titulaires(ACR)Equiv.Equiv.Equiv.Equiv. Equiv.Eff.Eff.Eff.Eff.Eff.Eff.TPTPTPTPTP309 308 311 316 321 333Equiv.TP309,0 308,0 311,0 316,0 321,0 333,05752 6038 6382 6943 7325 79665524,0 5744,7 6128,0 6565,3 6888,0 7366,1958 1171 1077 976 988 1077681,8 819,4 771,4 731,6 772,8 861,11447 1492 1484 1689 1618 15841381,9 1418,8 1303,1 1456,3 1381,6 1335,73939 4272 4237 4068 4218 4377Nd3706,3 4060,3 3962,2 3800,7 3948,5 4085,6NdNd1140 977 742837,2 732,6 555,4Evolution des effectifs et répartition des enseignants titulaires par type de corps1992 1995 1997 1999 2000 2001IAITAPCEAPCENEPSPLPAPLPENETPETPETPETPETPETPETP436,3407,61727,2308,0261,32239,9143,7440,5408,61980,7323,3259,02223,6109,0415,5464,12528,3102,6279,72253,084,8388,3439,12893,0117,4283,62388,155,8378,3443,23089,1120,2300,22508,748,3366,5468,43269,8127,2279,52810,644,1%%%%%%%7,97,431,35,64,740,52,67,77,134,55,64,538,71,96,87,641,31,74,636,81,45,96,744,11,84,336,40,85,56,444,81,74,436,40,75,06,444,41,73,838,20,6Total ETP 5524,0 5744,7 6128,0 6565,3 6888,0 7366,1Evolution des effectifs et répartition des enseignants par groupe de compétences1501992 1995 1997 1999 2001ETP % ETP % ETP % ETP % ETP %Sciences économiques 746,9 12,3 760,3 11,9 789,3 11,6 822,5 11,4 849,3 10,9Sciences biologiques 1796,2 29,6 1704,1 26,7 1682,7 24,8 1745,1 24,2 1862,7 23,9Math Physique Chimie 929,3 15,3 1047,3 16,4 1106,1 16,3 1168,1 16,2 1248,6 16,0Education physique 265,1 4,4 279,2 4,4 294,2 4,3 343,3 4,8 384,4 4,9Education socioculturelle 213,3 3,5 253,0 4,0 278,5 4,1 325,9 4,5 410,5 5,3Français Philosophie Langues 962,7 15,9 1098,2 17,2 1178,4 17,4 1239,4 17,2 1304,5 16,7Responsables d'exploitation 169,9 2,8 178,0 2,8 189,0 2,8 201,0 2,8 207,6 2,7Chargé de CDI 111,5 1,8 147,9 2,3 208,4 3,1 263,8 3,7 271,9 3,5Divers enseignement 355,3 5,9 443,4 6,9 435,4 6,4 397,9 5,5 413,5 5,3Activités hors enseignement 306,5 5,1 280,6 4,4 325,1 4,8 342,2 4,7 226,2 2,9Formateur de CFPPA 207,2 3,4 195,0 3,1 302,9 4,5 361,5 5,0 611,7 7,9
Les personnels de l’enseignement général, technologiqueet professionnel agricole public Sur la période longue, les postes d’enseignants, notamment de PCEA, PLPA et ITA, mais aussi d’ACE etd’ATOSS se développent, à l’inverse en particulier des IA En 2001, le nombre des IA est toujours en diminution, au contraire de celui des ITA Le nombre d’enseignants non titulaires se réduit, par les ACR ; et la population totale des enseignantsprogresseDe 1992 à 2000, les évolutions que connaissent les effectifs des différents corps de personnels del’enseignement technique agricole se soldent par : un bilan relativement positif pour les enseignants titulaires (+24,7% à 6888 ETP en2000) et, parmi eux, les PCEA (+79% à 3089,71 ETP), les professeurs d’EPS(+14,9% à 300,2 ETP), les PLPA (+12% à 2508,7 ETP), les ITA (+8,7% à 443,2 ETP),mais aussi les ATOSS (+6,5% à 3948,5 ETP) ; un bilan plutôt négatif pour les PLPEN (-66% à 48,3 ETP), les PCEN (-61% à120,2 ETP), mais aussi et surtout pour les IA (-13,3% à 378,3 ETP). Par ailleurs, dansle même temps, les ACE progressaient de +13,3% à 772,8 ETP en 2000.En 2001, le nombre d’enseignants titulaires, en équivalents temps plein, de l’enseignement agricoleest en augmentation de +6,9% à 7366,1 ETP ; conjointement, le nombre d’enseignants non titulairesest en baisse (-5,9% à 1416,5 ETP), ce qui conduit à une croissance globale des emploisd’enseignants : +4,6% à 8782,6 ETP. Les ATOSS bénéficient aussi d’un mouvement positif : +3,1%à 4070,8 ETP. En revanche, la population des personnels d’éducation et de surveillance se réduit(-3,3% à 1335,7 ETP), en réalité en raison de l’évolution dans la filière surveillance (-6,1%) puisquela filière éducation est, elle, en développement (+5,6%).Au sein des enseignants, de nombreux corps s’avèrent en progression de 2000 à 2001 : les PLPA (+12%), les PCEA et les PCEN (+5,8%), les ITA (+5,7%), mais aussi les ACE (+11%).Parallèlement, les postes d’ACR (-24,2%), de PLPEN (-8,7%), de professeurs d’EPS (-6,9%) ettoujours d’IA (-3,1%) sont en diminution.Du côté des disciplines, on note, en structure, le développement des filières éducation physique etsportive, éducation socioculturelle, formateur de CFPPA (par voie de déprécarisation notamment) ;le recul des filières sciences économiques et des activités hors enseignement. Les autres groupes decompétences sont relativement stables.Les ressources et les coûtsRepèresACEACRATOSSIAITAPCEAPCENEPSPLPAPLPENCDICFPPANdETPAgent contractuel d’enseignementAgent contractuel régionalPersonnel administratif, technique, ouvrier, de santé et de serviceIngénieur d’agronomieIngénieur des travaux agricolesProfesseur certifié de l’enseignement agricoleProfesseur certifié de l’éducation nationaleEducation physique et sportiveProfesseur de lycée professionnel agricoleProfesseur de lycée professionnel de l’éducation nationaleCentre de documentation et d’informationCentre de formation professionnelle et de promotion agricoleDonnée non disponibleEquivalent temps pleinSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection général de l’enseignement et de la rechercheSous-direction l’administration de la communauté éducative151
Les ressources humainesPart des femmes par type de corps de personnelEn % des effectifs physiquesDirection17%17%18%19%EnseignantstitulairesEnseignantsnon titulairesEducationATOSS44%45%49%48%56%54%55%52%41%44%43%41%67%67%66%63%1992-19931995-19962000-20012001-<strong>2002</strong>Part du temps partiel ou du temps incomplet par type de corpsEn % des effectifs physiquesEnseignantstitulaires9%11%13%17%Enseignantsnon titulaires56%51%81%97%9%1521992-19931995-19962000-20012001-<strong>2002</strong>Educationet surveillanceATOSS10%29%31%15%15%17%20%
Les caractéristiques des personnels de l’enseignement général,technologique et professionnel agricole public Taux de féminisation qui ne progresse plus pour les enseignants titulaires et les personnels d’éducation Temps partiel en hausse pour tous les corps de personnels : temps incomplet qui se réduit pour les nontitulairesLe taux de féminisation des personnels de direction de l’enseignement général, technologique etprofessionnel agricole est toujours en progression. En 2001-<strong>2002</strong>, il gagne encore 1 point. A cettedate, 18% de ces personnels sont des femmes.Dans les autres corps, enseignants titulaires, enseignants non titulaires, personnels d’éducation, unetendance à un accroissement de la part des femmes, observée précédemment, est contrariée cesdernières années. Ce resserrement de la population féminine touche les personnels enseignantstitulaires en 2001 : -1 point à 48% de femmes par rapport à 2000. Il était repéré dès 1999 pour lespersonnels d’éducation. La part des femmes perd encore 2 points en 2001 à 41%. Pour lesenseignants non titulaires, ce taux est très fluctuant sur la période longue, mais plutôt en baissedepuis 1997. De 2000 à 2001, il perd 3 points à 52%.S’agissant des ATOSS, enfin, c’est la réduction de la population féminine qui s’impose commetendance lourde. En 2001, 63% de ces personnels sont des femmes : -3 points par rapport à 2000.Concernant le temps partiel des personnels, ou temps incomplet pour les non titulaires, il estglobalement en croissance pour les enseignants titulaires, les personnels d’éducation et desurveillance et les ATOSS, tandis qu’il décroît pour les enseignants non titulaires. En 2001, lesmouvements sont significatifs : +4 points à 17% pour les enseignants titulaires, +3 points à 20% pourles ATOSS, +2 points à 31% pour les personnels d’éducation et de surveillance. Pour les enseignantsnon titulaires, la réduction du temps incomplet porte sur une portion non négligeable de lapopulation : -5 points à 51%.Les ressources et les coûtsRepèresATOSSPersonnel administratif, technique, ouvrier, de santé et de serviceSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection général de l’enseignement et de la rechercheSous-direction l’administration de la communauté éducative153
Les ressources humainesLes enseignants de l’enseignement général, technologique et professionnel dans les régions depuis 1992Enseignants titulaires et non titulaires en équivalents temps pleinEnseignants en ETPen 2001-<strong>2002</strong>Inférieur à 50De 100 à 250De 250 à 350De 350 à 450De 450 à 550De 550 à 900Les enseignants et la part du temps partiel ou incomplet dans les régionsEffectifsETP2000-2001 2001-<strong>2002</strong>% tps partielou incompletEffectifsETP% tps partielou incompletEvolutiondes effectifs2000/2001Evolutiondu tempspartielou incompleten points154Alsace 167,8 19,3 179,1 18,5 +6,7 -0,8Aquitaine 532,0 11,6 578,1 10,7 +8,7 -0,9Auvergne 471,3 18,7 482,9 16,0 +2,5 -2,7Bourgogne 496,4 22,7 520,2 21,9 +4,8 -0,8Bretagne 450,7 13,3 460,6 12,8 +2,2 -0,5Centre 438,9 19,5 481,9 18,1 +9,8 -1,4Champagne-Ardenne 296,7 26,5 305,5 24,2 +3,0 -2,3Corse 34,0 25,0 42,2 19,0 +24,1 -6,0Franche-Comté 231,1 16,9 266,5 14,8 +15,3 -2,1Ile-de-France 312,9 14,9 316,2 13,4 +1,1 -1,5Languedoc-Roussillon 419,5 14,3 436,6 11,7 +4,1 -2,6Limousin 337,8 19,8 352,9 17,1 +4,5 -2,7Lorraine 257,9 23,5 263,4 18,8 +2,1 -4,7Midi-Pyrénées 939,1 15,5 871,6 13,3 -7,2 -2,2Nord-Pas-de-Calais 218,7 24,3 233,1 24,4 +6,6 +0,1Basse-Normandie 278,1 27,1 289,6 22,4 +4,1 -4,7Haute-Normandie 168,9 25,0 189,1 25,6 +12,0 +0,6Pays de la Loire 413,4 18,0 444,1 16,4 +7,4 -1,6Picardie 225,4 26,7 250,0 32,6 +10,9 +5,9Poitou-Charentes 427,3 15,1 445,7 12,4 +4,3 -2,7Provence-Alpes-Côte d'Azur 386,8 14,6 405,4 11,2 +4,8 -3,4Rhône-Alpes 697,9 15,8 724,1 14,7 +3,8 -1,1DOM TOM 190,8 12,1 243,8 16,1 +27,8 +4,1FRANCE 8393,4 17,9 8782,6 16,5 +4,6 -1,4
Les personnels de l’enseignement général, technologiqueet professionnel agricole public dans les régions La région Midi-Pyrénées est la seule à montrer des effectifs d’enseignants en diminution entre 2000 et 2001,mais elle est aussi celle dont les effectifs sont les plus importants Les DOM TOM, la Corse, la Franche-Comté, la Haute-Normandie, la Picardie, le Centre et l’Aquitaine profitentau contraire d’une dynamique marquée Recul du temps partiel ou incomplet dans la plupart des régions, notamment en Corse, en Lorraine, enBasse-Normandie et en Provence-Alpes-Côte d’AzurSur la période longue, les postes d’enseignants titulaires et non titulaires sont en croissance pourl’ensemble des régions.Entre 2000 et 2001, en équivalents temps plein, une seule région montre des effectifs d’enseignantsen diminution. Il s’agit de Midi-Pyrénées : -7,2% à 871,6 ETP.Les postes d’enseignants se révèlent particulièrement en croissance pour les régions suivantes : les DOM TOM (+28% à 243,8 ETP), la Corse (+24% à 42,2 ETP), la Franche-Comté (+15,3% à 266,5 ETP), la Haute-Normandie (+12% à 189,1 ETP), la Picardie (+10,9% à 250,0 ETP), le Centre (+9,8% à 481,9 ETP), l’Aquitaine (+8,7% à 578,1 ETP).L’Alsace et la Bourgogne complètent la liste des régions où cette croissance est supérieure àcelle concernant la France entière.Si l’on prend un peu plus de recul, on note que, sur deux ans (1999 à 2001), ces régions, hormisl’Alsace, demeurent celles pour lesquelles les effectifs sont les plus dynamiques. S’y ajoutentles Pays de la Loire. Par ailleurs, sur cette période, les effectifs d’enseignants de la région Midi-Pyrénées progressent, bien que moins qu’en moyenne : +7,2% sur deux ans à +8% à la Franceentière.Pour ce qui est du temps partiel ou incomplet, il est particulièrement développé en Picardie(33%), en Haute-Normandie (26%), dans le Nord-Pas-de-Calais (24%), en Champagne-Ardenne (24%), en Basse-Normandie et en Bourgogne (22%). En recul pour l’ensemble de laFrance entre 2000 et 2001, en structure, il est à l’inverse en progression en Picardie (+5,9 points)dans les DOM TOM, (+4,1 points à 16,1%), et, largement plus faiblement en Haute-Normandie(+0,6 point) et dans le Nord-Pas-de-Calais (+0,1 point). La part du temps partiel ou incompletdiminue à l’opposé particulièrement en Corse (-6 points à 19%), en Lorraine (-4,7 points à18,8%), en Basse-Normandie (-4,7 points) et en région PACA (-3,4 points à 11,2%).Les ressources et les coûtsRepèresETPEquivalent temps pleinSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection général de l’enseignement et de la rechercheSous-direction l’administration de la communauté éducative155
Les ressources humainesLes agents contractuels de l’enseignement agricole privé en 1999 et 2001 :Répartition par grade1999 2001Effectifs ETP Effectifs ETPIngénieurs 26 24,5 28 26,2Ingénieurs en chef 4 4,0 8 8,01ère classe 5 5,0 5 5,02ème classe 17 15,5 15 13,2Agrégés 1 1,0 1 1,0PCETA 996 939,7 993 932,5Hors classe 124 117,6 130 121,4Classe normale 872 822,1 863 811,1PLP2 1085 1011,9 1265 1170,7Hors classe 114 105,7 161 150,9Classe normale 971 906,2 1104 1019,9PLP1 897 786,3 655 578,0ACE 1453 1250,2 1784 1550,5Chefs de pratique des EREA 132 106,2 112 93,7Maîtres auxiliaires 147 115,1 131 103,8Catégorie I 8 7,1 14 12,1Catégorie II cycle court 84 64,7 68 54,7Catégorie II cycle long 47 36,8 43 32,1Catégorie III cycle court 7 5,5 5 4,0Catégorie III cycle long 1 1,0 1 1,0Hors fonction au 1er septembre 47 40,4 37 32,1Total 4784 4275,2 5006 4488,7Répartition par corps en 2001En équivalents temps pleinMaîtres auxiliairesChefs de pratiqueACEPLP1PLP2PCETAIngénieurs0,6%2,3%2,1%13,0%20,9%26,3%34,8%Répartition selon les disciplines en 20011562001Effectifs %Sciences économiques et commerciales 1023 20,4Sciences et techniques biologiques 489 9,8Sciences et techniques agronomiques des productions végétales 370 7,4Sciences et techniques des productions animales 170 3,4Sciences et techniques de l'aménagement de l'espace et de la protection du milieu 120 2,4Sciences et techniques des équipements agricoles 138 2,8Sciences et techniques des industries agroalimentaires 76 1,5Mathématiques 490 9,8Physique chimie 196 3,9Education physique et sportive 315 6,3Education socioculturelle 200 4,0Français 556 11,1Philosophie 16 0,3Langues 410 8,2Histoire et géographie 221 4,4Bureautique informatique 67 1,3Documentalistes 149 3,0Ensemble 5006
Les personnels contractuels de l’enseignement agricole privé Progression de +4,6% sur deux ans du nombre d’agents contractuels de l’enseignement privé Plus d’un tiers des agents sont ACE ; les PLP2 constituent la deuxième population en termes d’effectifs Deux groupes de disciplines dominent : les sciences économiques et commerciales et les sciences ettechniques dans leur ensemble et prioritairement, en leur sein les domaines de la biologie et desproductions végétalesEn 2001, les ACE constituent, en équivalents temps plein, près de 35% des agents contractuels del’enseignement privé. Viennent au second rang les PLP2 qui comptent pour un peu plus de 26% deces personnels. Les PCETA représentent, pour leur part, 21% de la population.A cette date, sont recensés 5006 agents contractuels de l’enseignement privé, soit 4488,7 enéquivalents temps plein. La présence des ingénieurs est négligeable (28), de même que celle desagrégés (1).Entre 1999 et 2001, les effectifs d’agents progressent globalement de +4,6% en effectifs physiques(soit +5% en équivalents temps plein).Les évolutions entre 1999 et 2001 se révèlent positives pour : les ACE (+24% à 1550,5 ETP), les PLP2 (+15,7% à 1170,7 ETP), les ingénieurs (+7,1% à 26,2 ETP).On note, au sein de ces catégories, la progression particulière des postes d’ingénieurs en chef (de 4à 8 ETP) et de PLP2 hors classe (de 105,7 à 150,9 ETP).A l’opposé, se réduisent les populations de : PLP1 (-26,5% à 578 ETP), chefs de pratique des EREA (-11,7% à 93,7 ETP), maîtres auxiliaires (-9,8% à 103,8 ETP).Les PCETA sont eux en nombre stable sur la période.Concernant les groupes de disciplines de ces agents, un groupe apparaît dominant : celui des scienceséconomiques et commerciales (20,4% des effectifs d’agents). Au-delà, l’ensemble des sciences ettechniques concernent 27,3% des agents, avec en tête les domaines de la biologie (9,8%) et desproductions végétales (7,4%).Les ressources et les coûtsRepèresACEPCETAPLPETPAgent contractuel d’enseignementProfesseur certifié de l’enseignement technique agricoleProfesseur de lycée professionnelEquivalent temps pleinSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’administrationSous-direction de la gestion des personnels157
Les ressources humainesLa part des femmes dans les agents contractuels de l’enseignement agricole privé en 2001Par grade en %Part des femmesIngénieurs 78,6Ingénieurs en chef 87,51ère classe 80,02ème classe 73,3Agrégés 100,0PCETA 57,1Hors classe 83,7Classe normale 52,7ACE 38,0PLP2 36,8Hors classe 46,6Classe normale 35,3PLP1 19,3Chefs de pratique des EREA 26,1Maîtres auxiliaires 38,5Catégorie I 42,9Catégorie II cycle court 41,7Catégorie II cycle long 30,2Catégorie III cycle court 60,0Catégorie III cycle long 0,0Total 38,9Les agents contractuels de l’enseignement agricole privé selon leur âge au 1 er septembre 2001En effectifsHommes60-6517Femmes60-652355-6021255-6014550-5554450-5532345-5047145-5033740-4545140-4534035-4056235-4033230-3552030-3533625-3025225-3012120-251320-2570 200 400 6000 200 400 600Temps partiel, incomplet, cessation progressive d’activité, congés formation en 2001Hommes Femmes EnsembleEffectifs % Effectifs % Effectifs %Temps partiels 156 5,1 40 2,0 196 3,9Temps incomplets 932 30,6 345 17,6 1277 25,5CPA 45 1,5 12 0,6 57 1,1CIF 24 0,8 13 0,7 37 0,7Ensemble 1157 38,0 410 20,9 1567 31,3Temps plein 1885 62,0 1554 79,1 3439 68,7Total général 3042 100 1964 100 5006 100158
Les caractéristiques des personnels contractuelsde l’enseignement agricole privé Une population d’agents contractuels de l’enseignement privé peu féminisée, mais une place dominantedes femmes parmi les ingénieurs et les PCTEA Un temps partiel peu répandu, mais un temps incomplet fréquentLa population des agents contractuels de l’enseignement agricole privé est relativement peuféminisée : un peu moins de 39% de femmes au total (pour environ 49% aux enseignants du public ;17% cependant des seuls titulaires).Néanmoins, s’agissant des agents contractuels de l’enseignement privé, on distingue de fortesvariations selon les corps. Les femmes sont en effet largement majoritaires parmi les ingénieurs(79%), notamment les ingénieurs en chef pour des effectifs totaux cependant très faibles. Ellesrestent majoritaires au sein des PCETA (57%).En revanche, sont davantage masculins les corps des maîtres auxiliaires (38,5% de femmes), ACE(38%), PLP2 et PLP1 (respectivement 36,8% et 19,1%), chefs de pratiques des EREA (26,1%).Pour ce qui est de l’âge des agents au premier septembre 2001, on repère, pour les hommes, troisclasses dominantes : les 35-40 ans, qui représentent 18,5% des effectifs masculins, les 50-55 ans pour 17,9%, les 30-35 ans pour 17,1%.Pour les femmes, les écarts entre les classes d’âges de 30 à 55 ans sont négligeables. Elles constituentainsi : 17,3% des effectifs pour la classe des 40-45 ans, 17,2% pour la classe des 45-50 ans, 17,1% pour les 30-35 ans 16,9% pour les 35-40 ans.Au total, près de 400 agents ont 55 ans et plus (7,9%).Le temps partiel est peu répandu dans les emplois des agents contractuels de l’enseignement privé :seuls 3,9% des agents sont dans cette situation. Les hommes sont prioritairement concernés : 5%contre 2% aux femmes.En revanche, le temps incomplet est nettement plus fréquent ; il touche 25,5% des agents, davantageles hommes (30,6%) que les femmes (17,6%).Les ressources et les coûtsRepèresACEPCETAPLPCPACIFAgent contractuel d’enseignementProfesseur certifié de l’enseignement technique agricoleProfesseur de lycée professionnelCessation progressive d’activitéCongé individuel de formationSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection général de l’administrationSous-direction de la gestion des personnels159
Les ressources humainesLes agents contractuels de l’enseignement agricole privé dans les régionsEn effectifs physiquesNombre d’agentsDe 10 à 100De 100 à 150De 150 à 250De 250 à 400De 500 à 750Plus de 1000Les agents contractuels de l’enseignement agricole privé en 2001par sexe selon les régions160Hommes Femmes Ensemble % FemmesAlsace 11 3 14 21,4Aquitaine 164 94 258 36,4Auvergne 92 44 136 32,4Bourgogne 97 18 115 15,7Bretagne 626 395 1021 38,7Centre 165 65 230 28,3Champagne-Ardenne 62 65 127 51,2CorseFranche-Comté 84 38 122 31,1Ile-de-France 60 61 121 50,4Languedoc-Roussillon 197 131 328 39,9LimousinLorraine 34 24 58 41,4Midi-Pyrénées 148 91 239 38,1Nord-Pas-de-Calais 174 202 376 53,7Basse-Normandie 69 62 131 47,3Haute-Normandie 26 31 57 54,4Pays de la Loire 440 278 718 38,7Picardie 89 72 161 44,7Poitou-Charentes 71 18 89 20,2Provence-Alpes-Côte d'Azur 66 32 98 32,7Rhône-Alpes 350 217 567 38,3Réunion 9 13 22 59,1TOM 6 11 17 64,7Total 3040 1965 5005 39,3
Les personnels contractuels de l’enseignement agricole privédans les régions Une région dominante, qui mobilise une grande partie des agents contractuels de l’enseignement privé : laBretagne ; elle est suivie des Pays de Loire et de Rhône-Alpes, en accord avec le poids de ces régions dansles effectifs d’élèves Des contrastes forts entre régions quant à la place des femmes dans les effectifs d’agentsEn 2001, la répartition des agents contractuels de l’enseignement privé sur le territoire français esttrès contrastée. On repère ainsi : une région prépondérante, la Bretagne, qui avec 1021 agents réunit plus de 20% de lapopulation ; deux régions fortes, les Pays de la Loire et Rhône-Alpes, qui comptent respectivement718 et 567 agents contractuels (respectivement 14% et 11%) trois régions pour lesquelles ces effectifs restent relativement importants, le Nord-Pas-de-Calais (376 agents), le Languedoc-Roussillon (328) et l’Aquitaine (258). A l’opposé, des régions ont des effectifs d’agents contractuels très faibles, telles quel’Alsace (14), les TOM (17), la Réunion (22), la Haute-Normandie (57) et la Lorraine(58).Ces différenciations correspondent bien évidemment à des disparités fortes en termes d’effectifsd’élèves accueillis dans les établissements selon les régions (cf. pages relatives aux effectifsrégionaux).S’agissant des effectifs régionaux sexués, on ne peut que mettre en exergue l’opposition entre desrégions pour lesquelles les effectifs d’agents contractuels de l’enseignement privé sont très fortementféminisés ou tout au moins où les femmes dominent : les TOM (64,7% de femmes), la Réunion(59,1%), la Haute-Normandie (54,4%), le Nord-Pas-de-Calais (53,7%), la Champagne-Ardenne(51,2%) ; et des régions ou à l’inverse les femmes sont peu présentes dans les effectifs : la Bourgogne(15,7%), Poitou-Charentes (20,2%) et l’Alsace (21,4%).Les ressources et les coûtsRepèresSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’administrationSous-direction de la gestion des personnels161
Les ressources humainesDotations en emplois des établissements publics d’enseignement supérieur depuis 1990Dotations en emplois1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Enseignants chercheurs713 827 836 843 844 844 845 860I P A C160 148 142 155 159 166 167 167A I T O S filière administrative 448 475 477 476 477 488 488 509A I T O S filière formation-recherche 875 850 855 861 867 884 894 898Ensemble A I T O S 1323 1325 1332 1337 1344 1372 1382 1407Ensemble Emplois 2196 2300 2310 2335 2347 2382 2394 2434Evolution des emplois d’enseignantsEvolution des emplois d’AITOSEnseignants chercheursIPAC713827845860875850894898448475 488509160 148167167AITOS Formation rechercheAITOS Administration90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 0190 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01Détail des dotations en emplois d’AITOS par catégorieFilière administrativeFilièreformation rechercheDotations en emplois1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Chef de mission 3 3 4 7Secrétaires généraux 20 18 18 18 18 18 18 18Catégorie A 34 54 54 58 55 58 59 59Catégorie B 49 124 127 126 131 134 135 135Catégorie C 345 279 278 274 270 275 272 290Conseillers de bibliothèque 1 1 1 1 1Ingénieurs de recherche 3 18 20 24 25 33 39 42Ingénieurs d'études 18 38 44 48 52 58 65 68Assistants ingénieurs 7 38 41 46 46 51 54 54Techniciens formation - recherche 118 189 189 190 192 196 200 198Catégorie C 729 567 561 552 551 545 535 535Emplois d’enseignants reconnus au sein des établissements privés au titre du calcul de leurs subventions162Emplois reconnusContrat Avenants93-97 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001ESA Purpan 45,62 45,91 47,73 48,03 48,42 50,15 51,15 50,83 50,91ESITPA 35,62 34,41 34,71 35,25 35,84 36,38 36,97 37,15 37,87Ecole supérieure du bois 11,77 12,10 14,50 14,67 14,20 15,87 17,54 18,73 18,63ISA de Beauvais 50,55 52,13 51,35 54,02 54,76 54,69 54,28 54,22 52,80ISA de Lille 41,71 42,18 42,18 42,38 43,53 43,66 44,80 45,34 45,27ESA d'Angers 44,15 45,28 46,67 47,32 48,03 48,61 50,43 51,06 51,10ISARA 37,50 38,66 39,48 40,68 40,97 41,11 41,58 42,18 42,72Ensemble 266,92 270,67 276,61 282,35 285,74 290,46 296,76 299,51 299,30
Les personnels de l’enseignement supérieur Création de quelques postes d’enseignants chercheurs, après une stabilisation en 2000 Ouverture plus importante de postes d’AITOS, en particulier de la filière administrative Les postes d’enseignants reconnus au titre des subventions aux établissements privés sont en croissancepour 4 écoles sur 7De 1990 à 2000, les dotations en emplois de l’enseignement supérieur public évoluaient ainsi : Croissance des emplois d’enseignants chercheurs jusqu’en 1997, puis stabilisation ; Stabilité globale des emplois d’IPAC sur la période 1990-1998, en reprise après uneréduction des dotations, et prolongement des créations de postes par la suite ; Développement de la filière administrative des AITOS jusqu’en 1999 et maintien deces dotations en 2000 ; Diminution des postes d’AITOS de la filière formation - recherche en début de périodeet développement à compter de 1995.En 2001, sont créés : 5 postes d’enseignants chercheurs 25 postes d’AITOS, 21 dans la filière administrative et 4 en formation - recherche.Les dotations en emplois d’IPAC demeurent, elles, inchangées.Au sein des AITOS de la filière administration, ce sont les emplois de catégorie B qui se sont le plusdéveloppés sur la période 1990-2000 : +86 postes pour +25 à la catégorie A. Dans le même temps,la catégorie C perdait 73 emplois. En 2001, les deux premières catégories sont stables, tandis que 18emplois de catégorie C sont créés. En ce qui concerne la filière formation - recherche, mis à part pourla catégorie C qui se réduit en raison de l’externalisation de certaines activités, tous les corpsmontrent des dotations en croissance sur la période 1990-2000. Ce mouvement est particulièrementimportant pour les ingénieurs de recherche et les ingénieurs d’études en termes relatifs, pour lestechniciens en volume. En 2001, 3 postes d’ingénieurs de recherche et 3 postes d’ingénieurs d’étudessont créés, tandis que 2 postes de techniciens disparaissent ; les autres dotations sont stationnaires.Dans le privé, les postes d’enseignants chercheurs reconnus au titre des subventions auxétablissements augmentaient pour toutes les écoles jusqu’en 1997, notamment pour l’ESB (+20,6%).Par la suite et jusqu’en 2000, les équivalents de postes continuaient globalement de croître, toujoursde manière plus soutenue pour l’ESB, mais on notait des fléchissements pour l’ISA de Beauvais surces trois années et pour l’ESA de Purpan en 2000. En 2001, 3 écoles, en premier lieu l’ISAB (-2,6%)mais aussi l’ISA de Lille (-0,2%) et l’ESB (-0,5%) évoluent à la baisse alors que des mouvementspositifs sont enregistrés pour l’ESA d’Angers (+0,1%), l’ISARA (+1,3%) et l’ESITPA (+1,9%).Les ressources et les coûtsRepèresIPACAITOSIngénieurs, professeurs agrégés et certifiésPersonnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvrierset de serviceLa filière formation-recherche de la catégorie des IATOS a été crééeen 1995. Auparavant, il existait une filière «ouvriers et service» dont lesemplois ont été intégrés à la catégorie C de la filière formationrecherche.La baisse des dotations en emplois d’AITOS de cette filièreentre 1990 et 1995 correspond à l’externalisation des fonctionsd’entretien et de maintenance. L’augmentation des emploisd’enseignants-chercheurs et des emplois de catégorie A de la filièreformation-recherche a été favorisée par la création des statuts de cesdeux catégories, respectivement en 1992 et 1995.Les établissements privés ne sont pas dotés d’emplois relevant dubudget de l’Etat. La Direction générale de l’enseignement et de larecherche leur verse une subvention égale au produit du nombred’enseignants théoriquement nécessaire à la formation et du coûtthéorique d’un enseignant. L’effectif reconnu d’enseignants reposesur un calcul prenant en compte le volume horaire type reconnu pourla formation d’un ingénieur et le nombre d’étudiants.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur163
Les établissementsEvolution du nombre d’établissements de formation initiale800700600500400300200PublicPrivé10001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Publics 261 224 218 216 216 216 216 217LEGTA 103 118 125 125 128 128 128 130LPA 125 103 90 89 87 87 87 86CFPAJ 29 2 2 1 — — — —supérieur 4 1 1 1 1 1 1 1Privés 752 644 638 638 642 645 644 642CNEAP 258 217 214 214 213 212 211 208UNMFREO 430 372 371 371 375 379 379 380UNREP 58 51 50 49 50 50 50 50Divers 6 4 3 4 4 4 4 4Privé TP 273 239 234 234 234 236 235 231Privé RA 479 405 404 404 408 409 409 411Ensemble 1013 868 856 854 858 861 860 859Ensemble public et privéhors supérieur1009 867 855 853 857 860 859 858Supérieur : Ecoles de l’enseignement supérieur proposant des formations de niveau III (BTSA). Cas de l’ENITIAA aujourd’hui.Répartition des établissements de formation initiale par statut et affiliation en 2001 - <strong>2002</strong>En % du nombre d’établissements24,2 44,3 5,8 0,525,2PublicCNEAPUNMFREOUNREPDivers autres privés164Hors ENITIAA de NantesGuide de lecture24,2% des établissements de formation sont desétablissements privés affiliés au CNEAP
Les établissements de formation initialegénérale, technologique et professionnelle Après une période de réduction du nombre d’établissements, de 1990 à 1997, relative stabilisation de cenombre total : + 5 établissements sur les quatre années qui suivent Mais mouvements contradictoires qui se compensent dans le privé entre le CNEAP et l’UNMFREODe 1990 à 1997, le nombre d’établissements de l’enseignement technique agricole a étéconsidérablement réduit, par le biais de fusions, de transformations de CFPAJ en antennes de lycéeou, pour certains établissements privés, de fermetures rendues inévitables par des difficultés d’ordrefinancier ou en termes de recrutement.C’est ainsi que ce nombre d’établissements est passé de 1013 (hors établissements de l’enseignementsupérieur public proposant des BTSA) à 854 en 1997, soit 159 établissements de moins.Bien que n’ayant pas toujours les mêmes causes, les pertes sur la période sont relativementcomparables pour les trois statuts d’enseignement : 16,3% des établissements du public (42 horssupérieur) disparaissent ; 14,3% des établissements du privé à temps plein (39) et 15,7% desétablissements du privé à rythme approprié (75).Les choses se stabilisent par la suite dans l’enseignement public. Un établissement fait toutefois sonapparition en 2001, le LPA de Velet (71), issu de la division de l’EPLEFPA d’Etang-Charolles.Dans le privé, on assiste tout d’abord à une multiplication des établissements (de 638 à 645 en 1999),puis à une nouvelle réduction de leur nombre total (à 642 en 2001) ; la situation est ainsi globalementéquivalente en 2001 à celle de 1998. Mais, ceci masque des mouvements internes contradictoires :en fait, sur la période 1997-2001, le CNEAP perd 6 établissements, alors que l’UNMFREO engagne 9, un établissement supplémentaire apparaissant en 1998 s’agissant de l’UNREP.In fine, en 2001, un peu plus de 25% des établissements relèvent du public ; un peu plus de 24% duCNEAP, un peu plus de 44% de l’UNMFREO, près de 6% de l’UNREP, tandis que 0,5% ne sont pasaffiliés à ces fédérations.Bien évidemment, ce nombre d’établissements n’est cependant pas strictement comparable, comptetenu des différenciations entre statuts dans la taille des établissements en termes d’effectifs de formés(voir pages suivantes).Les ressources et les coûtsRepèresCNEAPUNMFREOUNREPCFPAJConseil national de l’enseignement agricole privéUnion nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientationUnion nationale rurale d’éducation et de promotionCentre de formation professionnelle agricole pour jeunesSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.165
Les établissementsEvolution du nombre moyen d’élèves par type d’établissements1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Public 219,6 297,4 316,1 327,4 333,8 333,7 326,1 320,2LEGTA 345,9 404,0 414,2 424,6 427,3 426,2 415,6 407,0LPA 152,8 179,8 185,3 194,0 196,2 197,7 194,6 189,0CFPAJ 58,6 64,0 73,5 48,0 — — — —Privé 100,8 145,3 156,9 162,9 164,3 165,5 163,3 161,6CNEAP 158,7 217,2 234,5 241,3 245,6 246,3 240,4 238,0UNMFREO 67,2 107,1 116,7 121,9 122,3 124,7 125,5 124,5UNREP 99,4 122,9 128,9 133,1 135,2 135,8 128,5 130,6Non affiliés 31,7 87,8 74,0 134,3 138,0 127,8 111,8 106,8Privé TP 159,4 213,6 231,2 238,8 243,5 242,9 236,5 235,5Privé RA 67,4 105,0 113,9 118,9 118,9 120,9 121,2 120,1Ensemble public et privéhors supérieur131,0 184,4 197,3 204,3 206,8 207,6 204,0 201,6Evolution du nombre moyen d’élèves par établissement selon le statut d’enseignementPublic Privé temps plein Privé rythme approprié Ensemble297 3202201592142366710512013118420290 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 0190 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 0190 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 0190 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01Répartition des établissements selon leur taille (en nombre d’élèves)Répartition en %des établissementspar tailleselon leur statutGuide de lecturePrès de 50% des établissementsprivés à rythme approprié accueillententre 100 et 200 élèves.605040302010PublicPrivé à temps pleinPrivé à rythme approprié0< 100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-800 +800166en nombre d’établissements< 100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-800 800 et + TotalEnseignement public 6 50 58 36 35 19 11 1 216LEGTA 0 8 23 33 35 19 11 1 130LPA 6 42 35 3 0 0 0 0 86Enseignement privé 195 303 86 30 12 4 10 2 642CNEAP 27 88 43 24 11 4 9 2 208UNMFREO 141 200 35 4 0 0 0 0 380UNREP 24 15 7 2 1 0 1 0 50Non affiliés 3 0 1 0 0 0 0 0 4Privé TP 30 98 49 26 12 4 10 2 231Privé RA 165 205 37 4 0 0 0 0 411Ensemble public et privéhors supérieur201 353 144 66 47 23 21 3 858
La taille des établissements de formation initialegénérale, technologique et professionnelle Réduction du nombre moyen d’élèves par établissement, selon le sens de l’évolution des effectifs de formés Ce mouvement touche tous les types d’établissements, mis à part ceux, privés, qui sont affiliés à l’UNREP Les LEGTA demeurent les établissements les plus importants en moyenne, suivis des lycées privés duCNEAP ; les plus petites structures relèvent de l’UNMFREO ou sont des établissements privés non affiliésLes établissements de formation scolaire agricole accueillent à la rentrée 2001 en moyenne un peumoins de 202 élèves. Ce chiffre moyen d’élèves par établissement, après avoir fortement progressésur la période 1990-1999, de 131 à plus de 207 élèves en moyenne, se réduit quelque peu depuis deuxans : près de 4 élèves de moins en moyenne en 2000 et plus de 2 en 2001, suivant le sens del’évolution des effectifs totaux de la formation initiale scolaire agricole.Les établissements publics accueillent une moyenne de 320 élèves, avec une différenciation forteentre LEGTA et LPA : 407 aux premiers et 189 aux seconds. En termes de répartition desétablissements publics selon leur taille, la rentrée 2001 est marquée par la diminution de la part desétablissements se situant au-delà de 300 élèves, mais aussi des établissements accueillant moins de100 élèves. Ainsi, seule la catégorie des établissements formant de 100 à 200 élèves est-elle endéveloppement.Au sein de l’enseignement privé, ce sont les établissements du CNEAP qui forment le plus d’élèvesen moyenne : 238 (-2,4 élèves par rapport à 2000). Les établissements de l’UNREP occupent ladeuxième position avec 130,6 élèves en moyenne. Ce sont en outre les seuls à montrer une taillemoyenne en croissance par rapport à l’année 2000 (+2,1 élèves). Suivent les établissements del’UNMFREO (avec 124,5 élèves en moyenne ; -1 par rapport à 2000) et les établissements nonaffiliés (106,8 élèves en moyenne ; -5).Lorsque l’on considère les établissements par type de fonctionnement, on note cependant desévolutions similaires entre 2000 et 2001 : -1 élève à 235,5 élèves en moyenne pour le temps plein et-1,1 élèves à 120,1 élèves en moyenne pour le rythme approprié. Reste que 90% des établissementsprivés à rythme approprié accueillent moins de 200 élèves pour 55,4% des établissements du privéà temps plein, et 25,9% des établissements publics.Les ressources et les coûtsRepèresLEGTALPACNEAPUNMFREOUNREPTPRALycée d’enseignement général ettechnologique agricoleLycée professionnel agricoleConseil national de l’enseignement privéUnion nationale des maisons familialesrurales d’éducation et d’orientationUnion nationale rurale d’éducation et depromotionTemps pleinRythme appropriéNB : Jusqu’à présent, nous présentions, selon les données de la DGER,un nombre moyen d’élèves par établissement en intégrant l’ENITIIA deNantes qui propose un BTSA option industries agroalimentaire spécialitéindustrie alimentaire, en prenant en compte, pour cet établissement, lesseuls formés en BTSA. Nous rectifions cet indicateur en excluantl’ENITIAA ; d’où quelques variations dans les chiffres en comparaisondes rapports précédents de l’ONEA et des données de la DGER.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.167
Les établissementsLes établissements de l’enseignement supérieur long agricoleEtablissements privésEtablissements publicsEcoles vétérinairesCentres de troisième cycle1234567ENSP VersaillesINA - Paris GrignonENGREFENSIAINA - Paris GrignonISAAENVADOM TOM : ENGREF (Guyane)Les établissements : nombre d’étudiants en formation en 2001 - <strong>2002</strong>0 200 400 600 800 1000 12000 200 400 600 800 1000 1200INA-PGENVNENFAENSAMENSARENESADENITABENITACFENVTENVAENVLENSVEtablissements de formationvétérinaire publicsINH*ENITIAAENSIAEtablissements de formationagronomique publics0 200 400 600 800 1000 1200ENGREFESA168ENGEESINSFAENSPCNEARCISAAENGREF FIFIESIELISPA* INH : ENSHAP et ENIHPISAISABESAPISARAESITPAESBEtablissements privés
Les écoles supérieures L’enseignement supérieur agricole est composé d’établissements à l’offre de formation variée : écolesd’ingénieurs dans les domaines agronomique, forestier, agro-industriel, environnemental, paysager ;écoles vétérinaires et formations des professeurs de l’enseignement secondaire agricole L’INA de Paris Grignon, l’ENFA de Toulouse, l’ENSA de Montpellier, les ENV (Maisons-Alfort, Lyon, Nanteset Toulouse), l’ENSA de Rennes et l’ENESAD de Dijon comptent parmi les écoles les plus importantes entermes d’effectifs d’étudiants, stagiaires et apprentis dans le public L’ESA d’Angers, l’ISA de Lille et l’ISA de Beauvais occupent les premières places, en termes de taille, dansle privéRepèresENFAENSPIESIELISPAISAAENGREFENGEESINSFACNEARCENITIAAENESADENITACFENITABINHLes établissements (ou formations) de l’enseignement supérieur se déclinent en 7 catégories : les écoles d’ingénieurs publiques qui comportent 5 ENSA et assimilées (INA-PG, ENSAM,ENSAR, ENSHAP de l’INH et ENSIA) et 9 ENIT et assimilées (ENITAB, ENITAC,ENESAD, ENITIAA, FIF de l’ENGREF, INSFA, ENIHP de l’INH, ENGEES, EITARC duCNEARC) ; les écoles d’ingénieurs privées (ESA, ESAP, ISAB, ISA-ITIAPE, ISARA de la FESIA etESITPA, ESB) ; les écoles nationales vétérinaires (ENVA, ENVL, ENVN, ENVT) ; une école paysagiste (ENSP) ; les écoles d’application, dont une vétérinaire (ENGREF, ENESAD, ESAT du CNEARC,ENSV) ; les centres de troisième cycle (ISAA, ISPA, IESIEL) ; une école de formation initiale des professeurs des établissements d’enseignement secondaireagricole, l’ENFA.Les principaux pôles de formation sont Paris et la région Ile-de-France, le pôle ouest (Rennes,Nantes, Angers), Toulouse, Montpellier et Dijon. En termes d’effectifs, on distingue : l’INA-PG avecplus de 1100 formés, l’ENFA (plus de 900 formés) ; l’ESA, l’ISA, l’ISAB et l’ESAP du privé etl’ENSAM et les ENV (entre 650 et 770 formés) ; l’ENSAR et l’ENESAD et l’ISARA et l’ESITPA(460 à 530 formés) ; l’ENITAB, l’ENITACF, l’INH, l’ENITIAA, l’ENSIA, l’ENGREF, l’ENGEESet l’INSFA (230 à 390 formés) ; l’ENSP, la FIF-ENGREF, les centres de troisième cycle, l’ENSV, leCNEARC et l’ESB (moins de 200).Ecole nationale de formation agronomiqueEcole nationale supérieure du paysageInstitut d'études supérieures d'industrie et d'économielaitièresInstitut supérieur des productions animalesInstitut supérieur de l'agro-alimentaireEcole nationale du génie rural, des eaux et des forêtsEcole nationale du génie de l'eau et del'environnement de StrasbourgInstitut national supérieur de formationagroalimentaireCentre national d'études agronomiques des régionschaudesEcole nationale d'ingénieurs des techniques desindustries agricoles et alimentairesEtablissement national d'enseignement supérieuragronomique de DijonEcole nationale d'ingénieurs des travaux deClermont-FerrandEcole nationale d'ingénieurs des travaux deBordeauxInstitut national d’horticultureENSHAPENIHPENSIAENSARENSAMINA-PGENVTENVNENVLENVAESBESITPAISARAISAITIAPEISABESAPESAEcole nationale supérieure d’horticulture etd’aménagement du paysageEcole nationale des ingénieurs de l’horticulture et dupaysageEcole nationale supérieure des industries agricoles etalimentairesEcole nationale supérieure agronomique de RennesEcole nationale supérieure agronomique deMontpellierInstitut national agronomique Paris GrignonEcole nationale vétérinaire de ToulouseEcole nationale vétérinaire de NantesEcole nationale vétérinaire de LyonEcole nationale vétérinaire de Maisons-AlfortEcole supérieure du boisEcole supérieure d'ingénieurs et de techniciens pourl'agricultureInstitut supérieur d'agriculture de Rhône-AlpesInstitut supérieur d'agriculture de LilleInstitut des techniques de l’ingénieur enaménagement paysager de l’espaceInstitut supérieur agricole de BeauvaisEcole supérieure d'agriculture de PurpanEcole supérieure d'agriculture d'AngersLes ressources et les coûtsSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur169
Les établissementsEvolution du nombre de centres de formation d’apprentis par statutCentres publicsCentres privés24 24 27 26 30 3953 64 61 65 6293 95 98 100 100 100 100 100 101 101 1021991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001101 CFA gérés par un EPLEFPA1 CFA relevant de l’Education nationale42 CFA gérés par des établisssementsd'enseignement agricole privés15 du CNEAP15 de l'UNMFREO11 de l'UNREP1 non affilié20 CFA gérés par des Chambresd'agriculture, des organismesprofessionnels de l'agriculture ou del'agroalimentaire ou des organismesdivers.Evolution du nombre moyen d’apprentis en formation agricole par CFA87 85 94119 136 151 163 167 175 1741761991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Selon le statutNombre moyen d'apprentisdans les CFA publicsNombre moyen d'apprentisdans les CFA privés1996 1997 1998 1999 2000 2001181 209 225 228 229 22174 76 75 88 89 101Les CFA dans les régions en 2001Nombre moyen d’apprentis170Guadeloupe 1Martinique 1Réunion 2Nouvelle-Calédonie 1Alsace 315Aquitaine 275Auvergne 145Bourgogne 142Bretagne 95Centre 231Champagne-Ardenne 127Corse 25Franche-Comté 188Ile-de-France 138Languedoc-Roussillon 104Limousin 84Lorraine 209Midi-Pyrénées 111Nord-Pas-de-Calais 443Basse-Normandie 157Haute-Normandie 196Pays de la Loire 177Picardie 272Poitou-Charentes 192PACA 260Rhône-Alpes 346Guadeloupe 76Martinique 125Réunion 185Nouvelle-Calédonie 28France 176
Les centres de formation d’apprentis Davantage de centres publics proposant des formations agricoles en 2001 Moins de centres privés Baisse du nombre moyen par centre d’apprentis en formation agricole dans le public Croissance dans le privéSur la période longue 1991-2001, ce sont les centres privés de formation d’apprentis qui se sont leplus multipliés, de 24 centres en 1991 à 62 en 2001, soit 38 centres supplémentaires. Dans le mêmetemps, le nombre de centres publics passe de 93 à 102, soit 9 centres de plus seulement. Néanmoins,le mouvement est inverse en 2001 : on recense 3 centres privés de moins, pour 1 centre publicsupplémentaire.Parallèlement, le nombre moyen d’apprentis en formation agricole dans les centres publics, encroissance jusqu’en 2000, évolue à la baisse en 2001 : -8 apprentis pour 221 en moyenne. Dans lescentres privés, le nombre moyen d’apprentis agricoles est globalement en progression sur la période.En 2001, son accroissement est relativement important : +12 élèves à 101 en moyenne.C’est en Bourgogne qu’apparaît un nouveau centre public proposant des formations agricoles. Lesecteur privé, préparant à des diplômes du champ de l’enseignement agricole, perd lui 5 centres enBretagne (disparition d’1 centre, sortie du champ de l’agriculture d’un centre et fusion de 4 autrescentres en 1) et 1 centre en Aquitaine, tandis que 2 centres supplémentaires sont répertoriés en Ilede-Franceet 1 en Pays de Loire.La Bretagne demeure cependant la région qui compte le plus de centres (15), alors qu’elle ne se situequ’au 8 ème rang en termes d’effectifs d’apprentis en formation agricole. Suivent la région Midi-Pyrénées (13 centres ; au 7 ème rang en termes d’effectifs) et les Pays de Loire (12 centres ; au 2 ème rangen termes d’effectifs). La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au premier rang des régionsconcernant le nombre d’apprentis préparant un diplôme agricole, compte, elle, 9 centres.Le public continue de dominer en termes de centres par région, mis en part en Bretagne, dans lesPays de Loire, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Rhône-Alpes et, cette année, en Ile-de-France oùles deux statuts d'enseignement comptent chacun 5 centres.Le nombre moyen d’apprentis agricoles par CFA est en repli dans 14 régions dont notamment l’Ilede-France(-27 élèves en moyenne), la Martinique (-25) et la Bourgogne (-19). Ce nombre croît dans12 régions, en particulier la Bretagne (+28), Rhône-Alpes (+23) et l’Aquitaine (+16). Le Nord-Pasde-Calais(avec 473 apprentis en moyenne en formation agricole par centre) et Rhône-Alpes (324)demeurent les deux régions de tête en termes de nombre moyen d’apprentis en formation agricolepar centre.Les ressources et les coûtsRepèresCFAEPLEFPACentre de formation d’apprentisEtablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricolesNB : On considère ici le nombre moyen d’apprentis en formation agricole par centre hors effectifs relevant d’autres champsSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires ruralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.171
Les établissementsEvolution du nombre de centres de formation professionnelle continuerépondants aux enquêtes annuelles selon le statut1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Centres publics 231 239 239 223 224 209 210 209 201 195dont CFPPA 153 152 153 157 156 152 155 157 157 153Centres privés 361 345 384 348 359 387 369 349 331 312Ensemble 592 584 623 571 583 596 579 558 532 507Les centres de formation professionnelle continue en 2000 et 2001Centres publicsCFACFPPAPublics diversLEGTALPAEnsemble publicNombrede centres2000HeuresstagiairesHeuresstagiaires157 13 157 249 83 8047 93 496201 14 165 206Nombremoyen HS22 550 244 25 0117 216 438 30 92013 3578 147 779 18 47270 474Nombrede centres2001Nombremoyen HS20 446 406 22 320153 11 857 413 77 4993 125 976 41 99211 117 569 10 6888 153 556 19 195195 12 700 920 65 133Centres privésNombrede centres2000HeuresstagiairesHeuresstagiairesNombremoyen HSNombrede centres2001Nombremoyen HSCNEAP59 1 262 796 21 40357 1 273 933 22 350UNMFREO133 2 378 623 17 884127 2 220 926 17 488UNREP19 906 704 47 72118 890 237 49 458Non affiliés120 3 690 305 30 753110 3 218 522 29 259Ensemble privé 331 8 238 428 24 890312 7 603 618 24 371Evolution du nombre moyen de stagiairesselon le statut des centresEvolution du nombre moyen d’heures stagiairesselon le statut des centres4003503002502001501005001992 93 94 95 96 97 98 99 2000 0180 00070 00060 00050 00040 00030 00020 00010 00001992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01Centres publicsCentres privésCentres publicsCentres privésRépartition des heures stagiairespar type de centres publics en 2001Répartition des heures stagiairespar type de centres privés en 200112 700 920 heures stagiairesCFPPALEGTA7 603 618 heures stagiaires93%CFADivers public12%42%LPA1%1%CNEAPUNMFREOUNREP4%Non affilié1721%29%17%
Les centres de formation professionnelle continue La baisse du nombre de centres de formation professionnelle continue intervenant dans le champ del’enseignement agricole et répondant à l’enquête de la DGER se poursuit en 2001 dans le public et plusencore dans le privé Le nombre moyen d’heures stagiaires par centre, en formation agricole, régresse dans les deux statuts A l’opposé, cependant, le nombre moyen de stagiaires évolue positivementAprès avoir oscillé autour de 590 entre 1992 et 1998, le nombre de centres de formationprofessionnelle continue proposant des formations agricoles et répondant à l’enquête annuelle de laDGER apparaît en net recul depuis 1999. En 2001, on recense ainsi 507 centres répondants, soit 72centres de moins qu’en 1998 et 25 de moins qu’en 2000.Sur la période longue, le statut public, qui comptait 231 centres répondants en 1992, atteint unmaximum de 239 centres en 1993 et 1994 (+8) pour retomber à 201 en 2000 (-38). Le privé passe,lui, de 361 centres en début de période à un maximum de 387 en 1997 (+26) pour chuter à 331 en2000 (-56). En 2001, on dénombre, parmi les répondants, 6 centres de moins dans le public et 19 demoins dans le privé. A cette date, 61,5% des centres répondants sont privés, parmi lesquels près de41% relèvent de l’UNMFREO et plus de 35% sont non affiliés. Le public constitue un peu moins de38,5% des centres répondants dont plus 78% sont des CFPPA.Le nombre moyen d’heures stagiaires par centre de formation, compte tenu de la baisse des volumesd’activité, régresse dans les deux statuts entre 2000 et 2001: -7,6% dans le public (à un peu plus de65100 en 2001) et -2,1% dans le privé (à moins de 24 400 en 2001).Néanmoins, si le nombre moyen d’heures stagiaires a évolué globalement à la baisse, il n’en a pasété de même concernant le nombre moyen de stagiaires. Celui-ci progresse en effet dans les deuxstatuts sur la période longue 1992-2000. En 2001, on compte encore en moyenne 6 stagiaires de pluspar centre dans le privé (soit +3,3%, pour +52 stagiaires soit +37,7% depuis 1992). Dans le public,les gains sont de +125 stagiaires depuis 1992 (+51%), mais le nombre moyen de stagiaires se réduiten 2001 dans ce statut : -4 stagiaires (-1,1%).En termes de répartition des volumes d’heures stagiaires selon le type de centres, on note enfin en2001 la domination renforcée des CFPPA dans le public qui représentent 93% de l’activité publiqueet la prédominance des centres non affiliés dans le privé, ceux-ci assurant 42% de l’activité de cestatut.Les ressources et les coûtsRepèresCFACFPPALEGTALPACNEAPUNMFREOUNREPHSCentre de formation d’apprentisCentre de formation professionnelle et de promotion agricolesLycée d’enseignement général et technologique agricoleLycée professionnel agricoleConseil national de l’enseignement agricole privéUnion nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientationUnion nationale rurale d’éducation et de promotionHeures-stagiairesSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.173
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Les élèves inscrits en formation initiale scolaire dans l’enseignement agricole en 2001 - <strong>2002</strong>Enseignement secondaireEvolution 2001 / <strong>2002</strong> en %2001 - <strong>2002</strong>PublicEvo.PrivéEvo. Temps Evo. Rythme Evo.EnsembleEvo. 00/0100/0100/01 plein 00/01 approprié 00/01Eff. %CPA et CLIPA 616 -1,1 132 +9,1 38 _ 94 _ 748 +4 +0,54ème / 3ème préparatoires 215 -10,4 8 257 -2,1 4 169 -2,2 4 088 -2,0 8 472 -199 -2,34ème / 3ème technologiques 4 189 +1,6 20 325 +4,3 7 237 +5,0 13 088 +3,9 24 514 +903 +3,8Niveaux VI et Vbis 5 020 +0,6 28 714 +2,4 11 444 +2,3 17 270 +2,5 33 734 +708 +2,1CAPA 617 +10,6 5 344 +6,7 2 810 +7,2 2 534 +6,1 5 961 +393 +7,1BEPA 17 123 -3,1 36 710 -3,8 17 789 -4,5 18 921 -3,2 53 833 -2018 -3,6Niveau V 17 740 -2,7 42 054 -2,6 20 599 -3,0 21 455 -2,2 59 794 -1625 -2,6Seconde GT 6 310 -2,1 2 269 +1,3 2 115 +2,1 154 -7,8 8 579 -105 -1,2Baccalauréat S 2 601 -1,1 789 -3,4 789 -3,4 _ _ 3 390 -56 -1,6BTA 3 942 -4,1 10 814 -6,2 6 377 -6,7 4 437 -5,3 14 756 -877 -5,6Baccalauréat technologique 9 998 -1,7 3 712 -6,0 3 508 -6,8 204 +8,5 13 710 -415 -2,9Baccalauréat professionnel 8 688 +0,8 8 067 +2,5 3 926 +2,4 4 141 +2,5 16 755 +263 +1,6Niveau IV 31 539 -1,4 25 651 -2,8 16 715 -3,5 8 936 -1,6 57 190 -1190 -2,0Enseignement secondaire 54 299 -1,6 96 419 -1,2 48 758 -2,0 47 661 -0,5 150 718 -2107 -1,4Enseignement supérieur court2001 - <strong>2002</strong>Evolution 2001 / <strong>2002</strong> en %Evo. 00/01PublicEvo.PrivéEvo. Temps Evo. Rythme Evo.Ensemble00/0100/01 plein 00/01 approprié 00/01Eff. %BTSA 14 396 -0,5 7 351 -2,4 5 647 -3,1 1 704 +0,1 21 747 -247 -1,1Classes post-BTSA-BTS-DUT 346 +7,5 _ _ _ _ _ _ 346 24 +7,5Autres classes préparatoires 180 -4,8 _ _ _ _ _ _ 180 -9 -4,8Niveau III 14 922 -0,4 7 351 -2,4 5 647 -3,1 1 704 +0,1 22 273 -232 -1,0Enseignement supérieur court 14 922 -0,4 7 351 -2,4 5 647 -3,1 1 704 +0,1 22 273 -232 -1,0Ensemble enseignement secondaire et supérieur courtEvolution 2001 / <strong>2002</strong> en %Enseignement secondaireet supérieur courtPublicEvo.00/01PrivéEvo.00/01Tempsplein2001 - <strong>2002</strong>Evo.00/01RythmeappropriéEvo.00/01EnsembleEvo. 00/01Eff. %69 221 -1,4 103 770 -1,3 54 405 -2,1 49 365 -0,4 172 991 -2 339 -1,3La part des différents statuts d’enseignement selon les niveaux de formation en 2001 - <strong>2002</strong>Niveaux de formationPublicIII67,0%25,4% 7,6%Privé Temps pleinIV55,2%29,2%15,6%Privé Rythme appropriéV29,7%34,4%35,9%174VI et Vbis14,9%33,9%51,2%
Les formations de l’enseignement secondaireet supérieur court par la voie scolaire Effectifs une nouvelle fois en recul en 2001 : - 1,3% Le privé à temps plein est le statut le plus touché : - 2,1% Tous les niveaux de formation enregistrent des pertes d’effectifs, mis à part les niveaux VI et Vbis Sont particulièrement sujets à la baisse les BEPA et les baccalauréats technologiques En revanche, les CAPA se développent et le baccalauréat professionnel continue de progresser même sicette croissance ne compense plus les pertes en BTAComme c’est le cas depuis la rentrée 2000, les formations de l’enseignement secondaire et supérieurcourt par la voie scolaire montrent des effectifs en diminution en 2001 - <strong>2002</strong> : -1,3%. Du niveau VIau niveau III, l’enseignement agricole accueille ainsi près de 3340 élèves de moins qu’en 2000.Le privé à temps plein s’avère le statut le plus touché puisqu’il perd 2,1% de ses élèves (-1168). Suitl’enseignement public qui compte près de 2590 élèves de moins (-1,4%). Le privé à rythme appropriéparvient presque, lui, à maintenir ses effectifs (-0,4% ; -215 élèves).Il faut dire que les niveaux VI et Vbis sont, eux, en progression en 2001, dans le prolongement dela reprise enregistrée en 1999 après le creux des rentrées 97 et 98. On compte en 2001 plus de 700élèves supplémentaires à ces niveaux (+2,1%) tous statuts confondus. Ce mouvement positifbénéficie à tous les statuts d’enseignement, bien que davantage au privé. Ceci joue mécaniquementsur les effectifs globaux du privé à rythme approprié, les niveaux VI et Vbis concernant 35% desformés de ce statut (pour 21% dans le privé à temps plein et à peine plus de 7% dans le public). Lesautres niveaux de formation sont, eux, en recul.En premier lieu, le niveau V accuse une baisse d’effectifs de -2,6% (soit 1625 élèves de moins). Ceciest le fait des BEPA qui comptent plus de 2000 élèves en moins (-3,6%), alors que les formations deCAPA évoluent positivement : +393 élèves, soit +7,1%. Le recul du niveau V est plus marqué dansle privé à temps plein (-3%) que dans le public (-2,7%) ou le privé à rythme approprié (-2,2%).Le niveau IV subit de même une réduction significative de ses effectifs : -2%, soit près de 1200élèves de moins. Mis à part les BTA qui, disparaissant progressivement, perdent près de 900 élèves(-5,6%), on note en particulier la chute des effectifs des baccalauréats technologiques (-2,9% ;-415 élèves). Les classes de seconde et de première et terminale scientifiques montrent aussi unfléchissement. Seul le baccalauréat professionnel tire son épingle du jeu : cette filière gagne263 élèves (+1,6%). Il faut toutefois noter que ces évolutions tant à la hausse qu’à la baisse, quiprolongent les tendances observées en 2000, ont une moindre ampleur qu’à la rentrée précédente, sil’on exclut l’évolution des BTA qui demeure une donnée constante. Par ailleurs, on observe quelquesmouvements contraires si l’on distingue les statuts : progression des baccalauréats technologiquesdans le privé à rythme approprié (+8,5% pour des effectifs toutefois très réduits), croissance deseffectifs en seconde dans le privé à temps plein (+2,1%). Le privé à temps plein reste le statut le plusmarqué par le recul du niveau IV : -3,5% contre -1,6% au privé à rythme approprié et -1,4% aupublic.Les formésEnfin, le niveau III perd à nouveau 1% de ses étudiants. Ce sont les diminutions d’effectifs enclasses préparatoires générales et surtout en BTSA (-1,1% ; -247 étudiants) qui se confirment. Al’opposé, les classes post-BTSA sont en reprise : +7,5%, soit +24 élèves. Pour ce qui est des BTSAtoutefois, c’est essentiellement le privé à temps plein qui tire les effectifs à la baisse (-3,1% ;-178 étudiants), tandis que le public subit une décroissance plus modeste (-0,5% ; -70 étudiants) etque le privé à rythme approprié montrent des effectifs constants (+1 étudiant ; +0,1%).RepèresCPACLIPACAPAClasse préparatoire à l’apprentissageClasse d’initiation pré-professionnelle en alternanceCertificat d’aptitude professionnelle agricoleBEPABTABac SBTSABrevet d’études professionnelles agricolesBrevet de technicien agricoleBaccalauréat scientifiqueBrevet de technicien supérieur agricoleSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.175
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Les étudiants en formation initiale scolaire dans les écoles supérieures en 2001 - <strong>2002</strong>Formationsde baseTroisièmecycleAutresformationsEnsembleEffectifs %I N A - P G 683 358 6 1047 1009 1094 -85 -7,8E N S A M 355 194 110 659 602 536 +66 +12,3E N S A R 358 154 12 524 508 430 +78 +18,1E N S I A 254 73 7 334 322 306 +16 +5,2I N H ( E N S H A P ) 142 142 142 145 -3 -2,1E N S A 1792 779 135 2706 2583 2511 +72 +2,9E N I T A B 312 12 3 327 327 330 -3 -0,9E N I T A C F 299 18 1 318 309 314 -5 -1,6E N E S A D ( F I ) 260 260 260 241 +19 +7,9E N I T I A A 287 2 52 341 339 340 -1 -0,3E N G R E F ( F I F ) 121 121 121 118 +3 +2,5I N S F A 237 237 237 238 -1 -0,4I N H ( E N I H P ) 231 231 231 172 +59 +34,3E N G E E S 198 6 61 265 259 260 -1 -0,4E N I T et assimilées 1945 38 117 2100 2083 2013 +70 +3,5E N G R E F 183 148 331 282 259 +23 +8,9E N E S A D ( I A ) 38 9 3 50 50 58 -8 -13,8E N S V 77 77 59 17 +42 +247,1C N E A R C ( E S A T ) 101 33 134 134 145 -11 -7,6Ecoles d'application 399 190 3 592 525 479 +46 +9,6I S A A 118 7 125 17 22 -5 -22,7I S P A 7 7 7 12 -5 -41,7I E S I E L 15 15 15 20 -5 -25,0Centres 3ème cycle 118 29 147 39 54 -15 -27,8E N V A 629 36 665 665 695 -30 -4,3E N V L 637 37 674 674 626 +48 +7,7E N V N 618 13 631 631 624 +7 +1,1E N V T 624 16 640 640 617 +23 +3,7E N V 2508 102 2610 2610 2562 +48 +1,9E N S P 182 182 182 203 -21 -10,3E N F A 843 11 23 877 245 315 -70 -22,2Total Public 7787 1149 278 9214 8267 8137 +130 +1,6E S A 589 97 686 686 682 +4 +0,6E S A P 588 65 653 653 656 -3 -0,5I S A B 612 612 612 615 -3 -0,5I S A B Agro-santé 86 86 86 +86I S A 544 77 621 621 612 +9 +1,5I S A R A 469 14 483 483 480 +3 +0,6E S I T P A 466 466 466 461 +5 +1,1E S B 197 197 197 188 +9 +4,8Total Privé 3551 14 239 3804 3804 3694 +110 +3,0E N S E M B L E 11338 1163 517 13018 12071 11831 +240 +2,0E T P - Effectifs -678 -678Doubles comptes -126 -102 -41 -269Ensemble corrigé 10534 1061 476 12071EnsemblecorrigéRappel2000Evo. 2000 / 2001176Effectifs en 2001 - <strong>2002</strong>selon les modes et les types de formationFormationsde baseFormationsde troisième cycleAutres formationsEnsembleF scolaire Apprentissage F continue EnsemblePublic 7 787 50 210 8 047Privé 3 551 196 34 3 781Ensemble 11 338 246 244 11 828Ensemble corrigé 10 534 243 196 10 973Public 1 149 168 1 317Privé 14 0 14Ensemble 1 163 168 1 331Ensemble corrigé 1 061 115 1 176Public 278 351 629Privé 239 25 264Ensemble 517 376 893Ensemble corrigé 476 376 852Public 9 214 50 729 9 993Privé 3 804 196 59 4 059Ensemble 13 018 246 788 14 052Ensemble corrigé 12 071 243 687 13 001
Les formations de l’enseignement supérieur long Les effectifs de formés des écoles de l’enseignement supérieur agronomique et véterinaire continuent deprogresser : +2% en 2001 L’enseignement privé se montre globalement plus dynamique en formation initiale, notamment grâce àl’ouverture d’une nouvelle formation à l’ISAB Les formations de troisième cycle se développent de manière importante en formation initiale Pour ce qui est des autres modes de formation, l’apprentissage connaît une augmentation relative de seseffectifs particulièrement forte : + 4,3%En 2001-<strong>2002</strong>, l’enseignement supérieur agricole accueille en formation initiale près de13 000 étudiants (en équivalent temps plein et sans double compte). Ces effectifs progressent encoreà cette rentrée de 2%, soit 240 étudiants supplémentaires.La croissance des effectifs se révèle plus importante dans le privé : +110 étudiants soit +3% contre+1,6% au public pour 130 étudiants de plus. Ceci est en particulier le résultat de l’ouverture d’unenouvelle formation agro-santé à l’ISAB (+86 étudiants). Au sein du public, on note des croissancesd’effectifs relativement soutenues pour les écoles d’application (+9,6% ; +46 élèves), malgré desreculs au sein de l’ENESAD (IA) et du CNEARC, et pour les ENIT (+70 étudiants ; +3,5%) par lebiais de l’ENIHP de l'INH et de l’ENESAD (FI). Les évolutions enregistrées par les ENSA et lesENV sont plus modérées en valeurs relatives : +2,9% et +1,9%. Les gains sont d’une part le fait desENSA de Rennes et de Montpellier, d’autre part de l’ENVL et de l’ENVT, essentiellement. Pour lesautres écoles de ces deux groupes, les évolutions sont soit positives mais faibles, soit négatives. Lescentres de troisième cycle, l’ENSP et l’ENFA connaissent, eux, des reculs importants du nombre deleurs formés.En valeur, c’est en formation de base que l’on recense l’accroissement d’effectifs le plus fort : +186étudiants (+1,8%). Mais, avec 63 étudiants supplémentaires, les formations de troisième cyclegagnent +6,3%. Les autres formations (DNO, CES, DU, post-bac, BTSA, licence professionnelle,CESA, CESIA, DAA étrangers, DIU et autres formations de deuxième cycle) sont, elles, en très légerrecul : -1,9%. (-9 étudiants de moins seulement).Plus globalement, tous modes de formation confondus, l’enseignement supérieur agronomique etvétérinaire gagne 331 apprenants supplémentaires en 2001-<strong>2002</strong> (+2,6%). L’évolution estparticulièrement marquée pour l’apprentissage : +43% à 243 apprentis, pour +2,6% à la formationcontinue.Les formésRepèresNB : A partir de 2000-2001, l’enquête annuelle réalisée par la DGERauprès des écoles a donné lieu à un traitement approfondi par la sousdirectionde l’enseignement supérieur permettant : d’une part de repérer, pour certaines formations de troisième cycle, parmiles étudiants suivant une formation donnée, les étudiants inscrits dans lesécoles considérées des étudiants relevant de l’Université ; d’autre part, de distinguer plus finement en formation de troisième cycleles étudiants en formation initiale des stagiaires en formation continue.Ceci amène, pour les années 2000 et 2001, à resserrer le champ despopulations prises en compte au titre de la formation initiale, horsapprentissage. Par voie de conséquence, les statistiques présentées nepeuvent pas faire l’objet d’une comparaison stricte avec celles publiéesdans trois premiers rapports de l’ONEA (1997, 1998 et 1999).ENSAENITENVETPEff.DNODEADESSEcoles nationales supérieures agronomiquesEcoles nationales d’ingénieurs des travauxEcoles nationales vétérinairesEquivalent temps pleinEffectifs physiquesDiplôme national d’oenologieDiplôme d’études approfondiesDiplôme d’études supérieures spécialiséesLes corrections d’effectifsCes corrections ont pour objet de tenir compte à la fois des écartsentre les effectifs physiques de certaines formations et leurséquivalents temps plein et des doubles inscriptions de certainsétudiants.Ainsi en 2001, pour la formation initiale scolaire :L’ENGREF accueille 183 étudiants en formation de base, soit 137équivalents temps plein.L’ENFA accueille 843 étudiants, soit 211 ETP.L’ISAA forme 118 étudiants, dont 108 inscrits en formation dansune autre école.L’ENSV forme 18 étudiants inscrits en formation dans une autreENV.En outre, certains étudiants suivent une autre formationparallèlement à leur formation d’ingénieur. C’est le cas de : 38 étudiants en DEA à l’INA-PG, 16 étudiants en DEA et 41 étudiants en DNO à l’ENSAM, 16 étudiants en DEA à l’ENSAR, 3 étudiants en DEA et 9 étudiants en mastère à l’ENSIA, 9 étudiants en DESS à l’ENITACF, 2 étudiants en DESS à l’ENITIAA, 6 étudiants en DEA à l’ENGEES, 3 étudiants en DEA à l’ENGREF.Voir les intitulés des sigles des écoles en annexe.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur177
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Les inscrits en formation scolaire générale, technologique et professionnelleselon le statut d’enseignement en 2000-2001Enseignement publicFormations professionnelleset technologiquesFormations généralesEnsembleNiveauxVI et VbisNiveau V Niveau IV Niveau III EnsembleEffectifs 17 740 22 628 14 396 54 764% 100% 72% 96% 79%Effectifs 5 020 8 911 526 14 457% 100% 28% 4% 21%Effectifs 5 020 17 740 31 539 14 922 69 221Enseignement privé TPFormations professionnelleset technologiquesFormations généralesEnsembleNiveauxVI et VbisNiveau V Niveau IV Niveau III EnsembleEffectifs 20 599 13 811 5 647 40 057% 100% 83% 100% 74%Effectifs 11 444 2 904 14 348% 100% 17% 26%Effectifs 11 444 20 599 16 715 5 647 54 405Enseignement privé RAFormations professionnelleset technologiquesFormations généralesEnsembleNiveauxVI et VbisNiveau V Niveau IV Niveau III EnsembleEffectifs 21 455 8 782 1 704 31 941% 100% 98% 100% 65%Effectifs 17 270 154 17 424% 100% 2% 35%Effectifs 17 270 21 455 8 936 1 704 49 365Les inscrits en formation scolaire technologique et professionnelle par niveau et secteur de formationselon le statut d’enseignement en 2000-2001Niveau V - Public4,9%Niveau IV - Public4,1%Niveau III - Public12,9%4,0%12,8%1,8%7,1%2,7%4,0%20,5%53,8%7,9%27,4%51,7%15,9%22,6%45,9%Niveau V - Privé Temps plein8,1%Niveau IV - Privé Temps plein6,5%Niveau III - Privé Temps plein16,5%3,1%48,4%2,5%33,6%4,6%2,0%12,5%25,9%5,6%16,5%35,3%14,4%18,4%46,1%Niveau V - Privé Rythme approprié5,3%Niveau IV - Privé Rythme approprié7,1%Niveau III - Privé Rythme approprié23,6%1,6%0,6%14,0%38,0%40,5%0,8%1,0%13,0%40,2%37,9%2,7%3,7%20,4%49,6%178Production Transformation Forêt - AménagementServices aux entreprises Commercialisation Services aux personnes
Les secteurs de formation de l’enseignement secondaireet supérieur court par la voie scolaire Recul des effectifs des formations technologiques et professionnelles dans tous les statuts, mais aussi desformations générales dans le public Au niveau V, recul du poids de la production dans tous les statuts au profit des services aux personnes et,dans le public, de la forêt-aménagement Au niveau IV, progression de la part de la production dans les statuts privés ; de la forêt-aménagement dansle public et le privé à temps plein, mais aussi de la commercialisation dans ce dernier statut Au niveau III, progression du poids de la forêt-aménagement et des services aux personnes, mais aussi dela production dans le privé à rythme approprié ; recul en particulier de la commercialisationA la rentrée 2001, on observe une diminution des effectifs en formation scolaire dans les filièrestechnologiques et professionnelles, et ce davantage dans le privé à temps plein (-3,5% ; près de1450 élèves de moins) que le rythme approprié (-1,9%) ou le public (-1,5%). Parallèlement, lesformations générales sont en progression dans les statuts privés à temps plein (+1,9%) et à rythmeapproprié (+2,4%), surtout grâce à l’évolution des niveaux VI et Vbis. Dans le public, le recul de cesformations (-0,8%) se cumule aux réductions d’effectifs du technique.On note dans le public des pertes d’effectifs en particulier en production au niveau V (-512 élèves ;-5,1%) et IV (-172 ; -1,4%), en transformation au niveau V (-51 ; -6,7%), IV (-123 ; -6,4%) et III(-193 ; -7,8%), et en commercialisation au niveau III (-117 ; -5,9%). Les secteurs de la forêtaménagement et des services aux personnes se maintiennent ou progressent selon les niveaux.L’évolution est particulièrement positive au niveau III (respectivement +121 élèves soit +3,9% et+143 élèves soit +59%). Les services aux entreprises (niveaux V et IV seulement) sont en recul, maispour des effectifs globalement faibles.Dans le privé à temps plein, la baisse touche tous les secteurs aux niveaux V et IV, notamment, auniveau V, la production (-332 élèves ; -5,8%), la transformation (-45 ; -9,9%), la forêt aménagement(-111 ; -4,1%) et les services aux entreprises (-42 ; -6,1%), et au niveau IV, la production (-204 ;-4%), la transformation (-119 ; -13,3%), les services aux personnes (-215 ; -4,4%) et auxentreprises (-25 ; -6,8%). On retrouve au niveau III la production (-118 ; -4,3%), latransformation (-61 ; -7%) auxquelles s’ajoute la commercialisation (-178 ; -3,1%). A ce niveautoutefois la forêt aménagement (+2,6%) et surtout les services aux personnes (+61 ; +31%) sedéveloppent.Dans le privé à rythme approprié, on note surtout une baisse du nombre d’élèves enproduction (-352 ; -4,1%) ou en commercialisation (-177 ; -13,6%) au niveau V. Au niveau IV,tous les secteurs sont en recul mais sur la base d’effectifs plus réduits, hormis pour les servicesaux personnes (-74 ; -2,1%). Au niveau III, seuls deux secteurs subissent un fléchissement : latransformation (-38 ; -37%) et la commercialisation (-47 ; -10,5%). Parmi les autres secteurs, laproduction (+53 ; +6,7%) et les services aux personnes (+23 ; effectifs doublés) se révèlent lessecteurs les plus dynamiques.Les formésEn définitive, en termes de répartition sectorielle, on note : au niveau V, la progression des services aux personnes pour les trois statuts au détrimentsurtout de la production, mais aussi une part accrue de la forêt aménagement et de lacommercialisation dans le public, des services aux entreprises dans le privé à rythmeapproprié ; au niveau IV, la progression de la forêt aménagement dans le public et le privé à tempsplein, de la production dans le rythme approprié et le privé à temps plein, de lacommercialisation dans ce dernier statut, et, à la marge, des services aux personnes dans lepublic ; au niveau III, le développement de la forêt aménagement et des services aux personnesdans tous les statuts et de la production dans le privé à rythme approprié au détriment enpremier lieu de la transformation et de la commercialisation.RepèresLes secteurs de formationLa nomenclature des secteurs auxquels il est fait référence dans ce document est présentée en annexe.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.179
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Elèves en formation initiale scolaire en 2000- 2001Tous statuts et niveaux confondusde 0 à 500de 500 à 3000de 3000 à 5000de 5000 à 6500de 6500 à 8000de 8000 à 10000de 10000 à 15000de 15000 à 20000Elèves en formation initiale scolaire selon le niveau de formation en 2000- 2001Tous statuts confondusNiveaux VI et VbisNiveau IVNiveau absentMoins de 5%de 5 à 15%de 15 à 17%de 17 à 19%de 19 à 20%de 20 à 24%de 25 à 30%de 30 à 32%de 32 à 34%de 34 à 36%de 36 à 37%de 37 à 40%Plus de 50%Niveau Vde 25 à 30 %de 30 à 33%de 33 à 34%de 34 à 36%de 36 à 37%de 37 à 40%Niveau IIIde 25 à 30 %de 30 à 33%de 33 à 34%de 34 à 36%de 36 à 37%VI etVbisV IV III totalGuadeloupe 236 347 298 66 947Martinique 35 233 187 38 493Guyane 56 28 84Réunion 279 533 408 66 1 286TOM 593 721 152 22 1 488Elèves en formation initiale scolaire selon le statut d’enseignement en 2001Tous niveaux confondusPublicPrivéTemps pleinPrivéRythme appropriéStatut absent100 à 10001000 à 15001500 à 20002000 à 30003000 à 40004000 à 50005000 à 70007000 à 10230180Public Privé TP Privé RAGuadeloupe 421 526Martinique 426 67Guyane 84Public Privé TP Privé RARéunion 451 235 600TOM 586 131 771France 69 221 54405 49365
Les formations de l’enseignement secondaireet supérieur court par la voie scolaire dans les régions Rhône-Alpes, les Pays de Loire et la Bretagne forment toujours près d’un tiers des élèves en formationinitiale scolaire agricole 7 régions échappent à la baisse générale des effectifs : l’Alsace, la Bourgogne, la Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, PACA, la Guadeloupe et la Réunion 18 régions sont dominées par l’enseignement public ; 4 régions par l’enseignement privé à temps plein et5 régions par l’enseignement privé à rythme approprié De manière générale, le statut dominant influe sur les poids des différents niveaux dans les régions :niveaux VI et Vbis et V très présents dans les régions où l’enseignement privé à rythme approprié estdéveloppé, niveaux IV et III dans les régions où le public a une place importanteEn 2001-<strong>2002</strong>, on retrouve le trio de tête des régions en termes de nombre d’élèves en formationscolaire, dans un ordre inchangé : Rhône-Alpes (19450 élèves), les Pays de la Loire (18290) et laBretagne (18160) forment toujours près d’un tiers des effectifs nationaux.Pourtant, les Pays de la Loire et la Bretagne sont parmi les régions les plus touchées par la chute deseffectifs, perdant respectivement 3,6% et 3,4% de leurs élèves (pour -1,3% France entière). Cesrégions restent cependant moins fragilisées que d’autres telles la Corse (-17,9%), le Limousin(-3,9%) ou l’Auvergne (-3,9%). Un certain nombre de régions montrent toutefois une évolutionpositive de leurs effectifs : en particulier la Guadeloupe (+80 élèves ; +9,2%), la Bourgogne (+67 ;+1%), PACA (+39 ; +0,6%), mais aussi, même si cela porte sur des effectifs encore plus réduits, laRéunion (+23 ; +1,8%), l’Alsace (+18 ; +1,1%), la Haute-Normandie (+25 ; +0,8%) et Midi-Pyrénées (+6 ; +0,1%).Concernant la représentation des niveaux de formation, on distingue deux groupes principaux : les régions dans lesquelles les bas niveaux de formation (VI à V) sont sur-représentés parrapport à la moyenne nationale (Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Rhône-Alpes,Guadeloupe, Réunion, TOM), les régions dans lesquelles les niveaux de formation les plus élevés (IV et III) sont davantageprésents qu’en moyenne (Alsace, Auvergne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin,Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais). Cas particulier, le Languedoc-Roussillonprésente une sur-représentation du seul niveau III.Entre ces situations extrêmes, on repère des régions pour lesquelles ce sont les niveaux V et IV(Bretagne, PACA, Martinique, Guyane) ou V, IV et III (Corse, mais en l’absence des niveaux VI etVbis) qui sont sur-représentés. Enfin, quelques régions atypiques apparaissent : le Centre, la Haute-Normandie et la Bourgogne qui se distinguent en termes de part des niveaux VI et Vbis et IV, laFranche-Comté et Poitou-Charentes pour les niveaux VI et Vbis et III, l’Aquitaine pour les niveauxVI et Vbis, IV et III.Ceci est à mettre en relation avec les répartitions statutaires d’effectifs dans les régions. En effet, lesrégions du premier groupe, où dominent en comparaison de la moyenne nationale les niveaux VI àV, correspondent aux régions dans lesquelles le privé à rythme approprié est le plus présent,conjointement au privé à temps plein pour les Pays de la Loire. A l’inverse, les régions du deuxièmegroupe (niveaux IV et III) relèvent essentiellement du statut public, exception faite du Nord-Pas-de-Calais pour lequel le privé à temps plein est omniprésent et de l’Ile-de-France où ce dernier statutn’est pas négligeable. De même, la plupart des régions qui montrent une part des niveaux V et IVélevée ont un lien fort avec le public, en association avec le privé à rythme approprié pour la régionPACA. Seule se distingue la Bretagne dominée par le privé à temps plein. Enfin les régions où leniveau IV et/ou le niveau III est sur-représenté en association avec les niveaux VI et Vbis montrentune part de l’enseignement public importante, mais des parts des enseignements privés nonnégligeables, le plus souvent le rythme approprié.Les formésRepèresNiveaux VI et Vbis :Quatrièmes et troisièmes, CPA et CLIPANiveau V : CAPA et BEPANiveau IV : seconde générale et technologique, baccalauréatsprofessionnel, technologique, scientifique, brevet de technicien agricoleNiveau III : BTSA, classes préparatoiresSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.181
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Les étudiants en formation dans les régions en 2001Formation initiale scolaireEn effectifs non corrigésApprentissageFormation continuePart des étudiants en formation de base dans l’ensemble des formationsFormation initiale scolaireChiffres : Part des formations de base en %Les étudiants selon le statut des écoles dans les régions en 2001Toutes formations initiales scolairesPublicPrivéAbsence de formationsDe 100 à 300 étudiantsDe 300 à 400De 400 à 500De 600 à 700De 700 à 900De 1300 à 1550Plus de 2500182
L’enseignement supérieur long dans les régions L’Ile-de-France, les Pays de la Loire et Midi-Pyrénées en tête des régions en termes d’effectifs d’étudiantsen fomation initiale L’apprentissage est particulièrement développé en Nord-Pas-de-Calais On retrouve les Pays de la Loire, Midi-Pyrénées et l’Ile-de-France en bonne place en formation continue,derrière la Bourgogne Le Languedoc-Roussillon présente une part des troisièmes cycles en formation initiale relativement forte Le public est dominant dans la plupart des régions, accroissant même sa place dans certaines d’entre ellesL’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire est présent dans 14 régions. Trois régionsforment, en formation initiale, la majorité des étudiants : l’Ile-de-France (2614 étudiants en donnéesnon corrigées, c’est-à-dire sans tenir compte des doubles inscriptions et des équivalents temps plein),les Pays de Loire (2228) et Midi-Pyrénées (2170 étudiants, même si, pour cette dernière région leseffectifs sont moindres si l’on tient compte pour l’ENFA des équivalents temps plein).L’apprentissage est proposé dans 4 régions : Ile-de-France, Pays de la Loire, Picardie et Nord-Pasde-Calais.Il est surtout développé dans cette dernière région : 112 apprentis (près de 46% deseffectifs). Pour ce qui est de la formation continue, la Bourgogne se situe logiquement au premierplan par la présence de l’ENESAD, avec 211 stagiaires. Néanmoins, ce mode de formation estdavantage partagé par les régions que l’apprentissage. Aussi, si la Bourgogne rassemble près de 27%des stagiaires, les régions Pays de la Loire (150 stagiaires ; 16,5%), Midi-Pyrénées (123 ; 15,6%) ouIle-de-France (94 ; 11,9%) se situent-elles en bonne place sur ce créneau.Pour ce qui est de la formation initiale, pour une évolution de +4,8% à la France entière en donnéesnon corrigées (+2%, si l’on tient compte des doubles comptes et ETP), on note des évolutionsparticulièrement positives en Lorraine (+14,8%), en Picardie (+13,5%), en Rhône-Alpes (+8,9%), enBretagne (+8,8%) et en Languedoc-Roussillon (+6,6%). Quatre régions subissent un recul de leurseffectifs : il s’agit de l’Aquitaine, de l’Auvergne, de l’Alsace, mais pour des effectifs très faibles, etsurtout de l’Ile-de-France (-75 étudiants ; -2,8%).Les étudiants en formation initiale relèvent en premier lieu des formations de base, quelles que soientles régions. Néanmoins, certaines régions se distinguent telles le Languedoc-Roussillon où 39% desétudiants sont en troisième cycle (26,5%) ou dans d’autres formations, ou bien encore l’Alsace (23%dans d’autres formations et 2% en formation de troisième cycle). Cette diversification des formationsconcerne aussi la Bretagne (76% d’étudiants en formation de base) et l’Ile-de-France (76%), alorsque pour les autres régions les formations de base constituent de près de 90% à 100% des effectifs.Il faut dire que le phénomène est récent pour la Bretagne puisque, en part, la formation de base perd10 points au profit des formations de troisième cycle entre 2000 et 2001.Les formésPour ce qui est des statuts d’enseignement, le public est dominant dans la plupart des régions (11 sur14). Il est le seul statut présent dans 8 régions : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne,Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine. Il progresse en outre dans les autres régions où il estprésent : +4,6 points en Midi-Pyrénées à près de 70%, +0,8 pt en Pays de Loire à 60,4% et +3,2 ptsen Rhône-Alpes à 60,9%.RepèresLes grands types de formations les formations de base de bac+0 ou bac+2 à bac+5 ou bac +7 selonles écoles menant principalement au diplôme d’ingénieur ou audiplôme d’études fondamentales vétérinaires ; les formations de troisième cycle comprenant les mastères, les DEA,les DESS, les thèses, les DES vétérinaires, les CEAV, les DESV, lesmaîtrises vétérinaires ; les autres formations comprenant les DNO, CES, DU, post-bacs,BTSA, licences professionnelles, CESA, CESIA, DAA étrangers,DIU et autres formations de deuxième cycle.DEADESSDESCEAVDESVDNOCESDUETPDiplôme d’études approfondiesDiplôme d’études supérieures spécialiséesDiplôme d’études supérieuresCertificat d’études approfondies vétérinairesDiplôme d’études spécialisées vétérinairesDiplôme national d’oenologieCertificat d’études supérieuresDiplôme d’universitéEquivalents temps pleinSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur183
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Les apprentis en 2000 et 2001 selon le statut des centres28 86628 85423 08122 583Part des apprentis1999 2000 2001CFA publics 81,0% 80,0% 78,3%5 7856 271CFA privés 19,0% 20,0% 21,7%Ensemble CFA publics CFA privésLes effectifs d’apprentis par type de formation en 2001 - <strong>2002</strong> selon le statut des centres2001Evolutions 00/01Public Privé Total Public Privé TotalDiplômesCAPA et CAP 8 128 1 735 9 863 -6,1 +3,2 -4,6BEPA 4 152 1 008 5 160 -2,5 +6,9 -0,8BPA 767 191 958 -2,4 -9,9 -4,0Niveau V 13 047 2 934 15 981 -4,8 +3,4 -3,4BTA 398 192 590 -6,4 -5,9 -6,2Bac pro. 3 070 747 3 817 +0,1 +15,8 +2,9BP 2 351 439 2 790 -1,8 -6,6 -2,6Niveau IV 5 819 1 378 7 197 -1,1 +4,5 -0,1BTSA 3 272 1 270 4 542 +7,4 +18,5 +10,3Niveau III 3 272 1 270 4 542 +7,4 +18,5 +10,3Ingénieur 35 244 279 +20,2 +11,2Niveaux II et I 35 244 279 +20,2 +11,2Diplômes 22 173 5 826 27 999 -2,2 +7,3 -0,4Certificats de spécialisationNiveau V 88 16 104 +14,3Niveau IV 16 34 50 +138,1Niveau III 86 56 142 +12,7Certificats de spécialisation 190 106 296 +21,0 +30,9 +24,4Titres homologuésNiveau V 169 64 233 -14,2 -4,9Niveau IV (+ CCTAR) 19 157 176 -2,5 +0,0Niveau III 17 46 63 +70,4 +43,2Niveau II 72 72 +94,6Titres homologués 205 339 544 -10,5 +24,2 +8,4Ensemble apprentis 22568 6271 28839 -2,16 +8,40 -0,05Non comptabilisésdans ce tableau :14 apprentis enlicenceet 1 en mentioncomplémentaire.(centres publics).Part des différents statuts selon le type deformation (en % des apprentis)Part des différents statuts selon le niveau deformation (en % des apprentis - formations diplômantes)21%36%62%18%19%28%79%64%38%PublicPrivé82% 81%72%87%184DiplômesCertificats despécialisationTitreshomologués13%Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau I
Les formations par l’apprentissage Quasi stabilité des effectifs d’apprentis en 2001-<strong>2002</strong>, la croissance dans le privé palliant la baisse dans lepublic Tous statuts confondus, ce sont les formations diplômantes qui sont sujettes aux réductions d’effectifs Cependant, tous les types de formation sont en progression dans le privé, pour les seuls certificats despécialisation dans le public En formation diplômante, les niveaux de formation les plus bas (V et IV) montrent des effectifs diminués, àl’opposé des niveaux les plus élevés (III à I) qui se développent Ces mouvements sont issus des évolutions dans le public, tous les niveaux progressant dans le privéEn 2001-<strong>2002</strong>, les effectifs d’apprentis de l’enseignement agricole sont quasiment stables :-12 apprentis (-0,05%), à 28854 tous statuts confondus. Ceci masque cependant des évolutionsopposées puisque les CFA publics perdent près de 500 apprentis (-2,2%) tandis que les CFA privésaccueillent en parallèle environ 500 apprentis de plus (+8,4%). La part du public en termes devolume de formés se réduit donc de près de 2 points au profit du privé entre les rentrées 2000 et 2001.Tous statuts confondus, ce sont les formations menant à l’obtention d’un diplôme qui sont l’objet desréductions d’effectifs (-113 apprentis ; -0,4%). Les certificats de spécialisation se développent, eux,de manière importante (+58 ; +24,4%). Quant aux titres homologués, ils gagnent +8,4%(+42 apprentis).Au sein de ces évolutions, on distingue des mouvements positifs pour les centres privés quel que soitle type de formation : +31% aux certificats de spécialisation (+25 apprentis), +24% aux titreshomologués (+66 apprentis) et +7,3% aux diplômes (+395 apprentis). Dans le public, seuls lescertificats de spécialisation progressent (+21% ; +33 apprentis). Les titres homologués perdent10,5% de leurs effectifs (-24 apprentis) et les diplômes 2,2% (-508 apprentis).Concernant les niveaux de formation, pour ce qui est des formations diplômantes, ce sont les niveauxles plus élevés qui progressent : +10% au niveau III pour les BTSA et +11% aux niveaux II et I. Ceciest la résultante, pour le niveau III, d’une progression dans les deux statuts et, aux niveaux II et I,d’un développement dans le privé palliant la baisse des effectifs du public. Les compensations entrestatuts ne suffisent cependant pas à éviter les pertes globales aux niveaux inférieurs. Le niveau Vperd -3,4%, tous les diplômes étant affectés par cette réduction d’effectifs ; le niveau IV parvientpresque à se maintenir (-0,1%) grâce au développement des baccalauréats professionnels (+2,9%)alors que le brevet professionnel et surtout le BTA régressent. Statuts public et privé s’opposent unenouvelle fois puisque les niveaux V et IV publics subissent un fléchissement (respectivement -4,8%et -1,1%) alors que leurs effectifs augmentent dans le privé (+3,4% et +4,5%). On note en particulierle développement des BEPA (+6,9%) et des baccalauréats professionnels (+15,8%) dans ce statut.Enfin, concernant les titres homologués, on repère un schéma d’évolution similaire aux diplômes :recul du niveau V, stabilité du niveau IV, développement des niveaux III et II. En revanche, lescertificats de spécialisation évoluent positivement à tous les niveaux de formation et même demanière particulièrement forte au niveau IV .Les formésRepèresCAPABEPABPABTABPBTSACertificat d'aptitude professionnelle agricoleBrevet d'études professionnelles agricolesBrevet professionnel agricoleBrevet de technicien agricoleBrevet professionnelBrevet de technicien supérieur agricoleL’enquête 51 du ministère de l’Education nationaleLes résultats concernant l’apprentissage sont issus de l’enquête 51pilotée par le Ministère de l’Education nationale.Les niveaux de formationNiveau V : second cycle court professionnel (CAPA, BEPA et BPA).Niveau IV : cycle long professionnel ou technologique (baccalauréatprofessionnel, brevet de technicien agricole, brevet professionnel).Niveau III : premier cycle supérieur de deux années d'études postbaccalauréat(BTSA).Niveau I : formations supérieures de niveau supérieur à Bac+2(diplômes d'ingénieur).SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.185
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Les apprentis en 2001 - <strong>2002</strong>selon le niveau et le secteur de formation par statutProduction Transformation Forêt Métiers Services aux Commercialisation TotalAménagement du cheval personnes DistributionDiplômes, CS et THServices auxentreprisesPublic 6230 223 5181 1255 275 141 13305Niveau VPrivé 841 92 1170 414 328 169 3014Ensemble 7071 315 6351 1669 603 310 16319Public 3497 258 1750 54 70 225 5854Niveau IV Privé 792 158 259 18 195 147 1569Ensemble 4289 416 2009 72 265 372 7423Public 1305 621 915 26 508 3375Niveau III Privé 520 111 397 1 343 1372Ensemble 1825 732 1312 27 851 4747Public 49 49Niveaux II et I Privé 56 110 113 37 316Ensemble 105 110 113 37 365Public 11081 1102 7846 1309 371 874 22583Total Privé 2209 471 1939 432 524 696 6271Ensemble 13290 1573 9785 1741 895 1570 28854Evolution des effectifs d’apprentis entre 2000 et 2001selon le niveau et le secteur de formationTous statuts confondusEn %ProductionTransformationForêt AménagementMétiers du chevalServices aux personnesServices aux entreprisesCommercialisationDistributionEnsembleNiveau V Niveau IV Niveau IIIEnsemble V à IPublic Privé Ens. Public Privé Ens. Public Privé Ens. Public Privé Ens.-8,6 +5,9 -7,1 -4,4 +7,5 -2,4 +10,9 +18,2 +12,9 -5,3 +9,1 -3,2+10,4 +9,5 +10,1 -3,0 +3,9 -0,5 +8,2 +26,1 +10,6 +5,8 +15,2 +8,4-1,4 -0,2 -1,2 +3,7 +6,1 +4,0 +6,6 +16,1 +9,3 +0,6 +4,2 +1,3+0,2 +5,9 +1,5 Effectifs faibles+2,6 +5,4 +3,3-10,1 +4,5 -2,7 -7,9 -0,5 -2,6 Effectifs faibles -6,5 +2,7 -1,3-7,2 +19,0 +5,4 +11,4 +3,5 +8,1 +0,2 +27,5 +9,7 +1,5 +21,7 +9,6-4,8 +4,0 -3,3 -1,0 +5,3 +0,3 +7,8 +20,5 +11,2 -2,2 +8,4 -0,0Répartition des effectifs d’apprentis en 2001selon le niveau et le secteur de formation par statutCentres publicsNiveau VNiveau IVNiveau IIICOM1,1COM3,9COM15,0SP / SE2,1SP / SE1,2SP / SE0,8MC9,4MC0,9MCFA38,9FA29,9FA27,1T1,7T4,4T18,4P46,8P59,7P38,7Centres privésNiveau VNiveau IVNiveau IIICOM5,6COM9,4COM25,0SP / SE10,9SP / SE12,4SP / SE0,1MC13,7MC1,1MCFA38,8FA16,5FA28,9T3,1T10,1T8,1P27,9P50,5P37,9186Production Transformation Forêt Aménagement Métiers du cheval Services Commercialisation
Les secteurs de formation par l’apprentissage L’apprentissage agricole reste centré sur deux secteurs : la production et la forêt-aménagement L’activité est davantage diversifiée en termes sectoriels dans les CFA privés Le secteur de la production perd de nouveau des apprentis en 2001-<strong>2002</strong> En structure, la forêt-amenagement gagne du terrain dans le public aux niveaux V et IV et la production auniveau III ; dans le privé, c’est la production aux niveaux V et IV et la commercialisation aux niveaux V et IIIqui progressentEn 2001-<strong>2002</strong>, l’apprentissage agricole se positionne toujours sur deux secteurs dominants : laproduction, qui concerne 46% des jeunes en formation tous statuts et niveaux confondus, et la forêtaménagement, qui en rassemble près de 34%. Cette concentration des effectifs est encore plusmarquée dans le public : près de 84% des apprentis relèvent de ces deux secteurs (49% de laproduction seule) pour 66% dans le privé (35% en production). Ce dernier statut montre une activitésectorielle plus diversifiée ; notamment, 11% des effectifs dépendent de la commercialisation (3,9%dans le public), un peu plus de 8% des services aux personnes et aux entreprises (1,6% dans lepublic) et 7,5% de la transformation (4,9% dans le public).Pourtant, si le secteur de la production est dominant, il est de nouveau en recul en 2001-<strong>2002</strong>— comme cela était le cas l’année précédente — puisque l’on y compte 439 apprentis de moins(-3,2%) qu’en 2000-2001 pour l’ensemble des statuts. Autre secteur qui connaît une réduction, bienque moindre, de ses effectifs : les services aux personnes et aux entreprises (-12 apprentis ; -1,3%).Dans les deux cas, ce sont des pertes d’effectifs dans le public, non compensées par les progressionsdans le privé, qui expliquent ces évolutions. Les autres secteurs sont en croissance. On note surtoutdes accroissements d’effectifs importants dans les secteurs de la commercialisation (+137 apprentis ;+9,6%) et de la transformation (+122 apprentis ; +8,4%). En termes relatifs, ces évolutions sontencore plus notables dans le privé : +21,7% et +15,2%.Au-delà, on note en particulier, toujours en termes relatifs, dans le public les pertes d’effectifs enproduction et services aux niveaux V et IV et les gains en transformation au niveau V,commercialisation et forêt-aménagement au niveau IV, et production au niveau III. Dans le privé, cesont les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation qui progressent leplus aux niveaux V et III, tandis que la forêt-aménagement et la production se distinguent en ce sensau niveau IV.Compte tenu des volumes respectifs d’effectifs concernés par les secteurs, on souligne, in fine : dans le public, au niveau V, la progression de la forêt aménagement (+1,4 points) au détrimentde la production (-1,9 pts) ; au niveau IV, le même mouvement (+1,3 pts à la forêtaménagementpour -2,1 pts à la production) ; au niveau III, la progression de la production(+1,1 pts) au détriment de la commercialisation (-1,1 pts) ; dans le privé, au niveau V, le recul de la forêt-aménagement (-1,6 pts) au profit de lacommercialisation (+0,7 pt) et de la production (+0,5 pt) ; au niveau IV, le développement dela production (+1 pt) au détriment des services ; au niveau III, la progression de lacommercialisation (+1,4 pts) au détriment de la forêt-aménagement (-1,1 pts) et de laproduction (-0,7 pt).Les formésRepèresCAPABEPABPABTABPBTSAEPLEFPACertificat d'aptitude professionnelle agricoleBrevet d'études professionnelles agricolesBrevet professionnel agricoleBrevet de technicien agricoleBrevet professionnelBrevet de technicien supérieur agricoleEtablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricolesVoir la constitution des secteurs à partir de la nomenclature du conseil national de l’information statistique (C.N.I.S.) en annexe.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.187
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Les apprentis dans les régions en 2001Tous statuts et niveaux confondusTotalGuadeloupe 76Martinique 125Réunion 369TOM 28supérieur à lamoyenne en 1998supérieur au taux del’année précédenteLa part de l’apprentissage dans les régionsNiveaux V à III1998 2000 2001Alsace 27,0 28,8 29,4Aquitaine 18,8 19,1 18,0Auvergne 18,6 18,1 17,6Bourgogne 19,6 20,3 20,1Bretagne 7,9 7,5 8,6Centre 18,0 19,1 19,3Champagne-Ardenne 13,1 14,0 13,1Corse 14,8 14,2 19,5Franche-Comté 21,9 22,8 23,7Ile-de-France 29,0 30,7 32,9Languedoc-Roussillon 11,9 13,0 12,8Limousin 11,6 11,1 12,3Lorraine 22,2 24,8 24,2Midi-Pyrénées 13,8 14,3 14,2Nord-Pas-de-Calais 16,9 19,3 20,3Basse-Normandie 14,4 15,7 16,3Haute-Normandie 30,9 32,6 34,2Pays de la Loire 10,9 11,9 12,9Picardie 19,8 20,0 20,2Poitou-Charentes 13,4 14,8 14,7PACA 28,1 29,6 29,9Rhône-Alpes 10,4 11,4 12,3Guadeloupe 9,0 9,7 9,7Martinique 22,9 25,0 21,4Réunion 24,4 27,9 26,8TOM 4,4 3,1 3,0FRANCE 15,7 16,7 17,2Les apprentis dans les régions en 2001 - <strong>2002</strong>selon le niveau de formationTous statuts confondusNiveau VNiveau IVNiveau IIIDe 28% à 35%De 35% à 55%De 55% à 60%De 60% à 70%De 70% à 75%De 80% à 100%Les apprentis dans les régions en 2001 - <strong>2002</strong>selon le statutNiveau absentDe 13% à 15%De 15% à 20%De 20% à 25%De 25% à 30%De 30% à 40%De 40% à 42%Niveau absentDe 2% à 5%De 5% à 10%De 10% à 15%De 15% à 25%De 25% à 30%De 30% à 40%Niv. V Niv. IVGuadeloupe 61 15Martinique 108 17Réunion 319 50TOM 28 0188PublicPrivéStatut absentMoins de 50De 50 à 100De 100 à 300De 300 à 600De 600 à 800De 800 à 1000De 1000 à 1300De 1300 à 1450De 1450 à 1960Public PrivéGuadeloupe 76Martinique 125Réunion 369TOM 28
L’apprentissage dans les régions Les régions PACA, Pays de la Loire, Rhône-Alpes et Aquitaine toujours en tête concernant les effectifsd’apprentis en formation agricole Mais place de l’apprentissage dans la formation initiale la plus importante en Haute-Normandie, Ile-de-France, PACA et Alsace Majorité de régions montrant un niveau V sur-représenté en termes de structure des effectifs par niveau Statut public dominant dans la plupart des régionsDonnées de cadrageFranceEvo. 99/00+1,6%Evo. 00/01-0,05%En 2001, les quatre régions les plus importantes en termes d’effectifs d’apprentis en formationagricole (niveaux V à I) restent les mêmes qu’en 2000, mais dans un ordre quelque peu modifié :Provence-Alpes-Côte d’Azur (2340), Pays de la Loire (2124), Rhône-Alpes (2077) et Aquitaine quiperd sa deuxième place (1925). Suivent le Nord-Pas-de-Calais (1772) et le Centre (1614). Ces sixrégions rassemblent 41% des apprentis.L’Aquitaine est justement la région qui perd le plus grand nombre d’apprentis : -149 (-7,2%).L’Auvergne subit aussi une réduction importante de ses effectifs (-82 ; -7,5%), de même que laLorraine (-72 ; -6,9%) et, pour un volume plus faible, la Martinique (-25 ; -16,7%). Parallèlement,Rhône-Alpes compte 136 apprentis de plus (+7%), la Haute-Normandie près de 90 (+6,9%), laBretagne 83 (+6,2%). Parmi les progressions les plus importantes, on note aussi celle du Limousin(+7,1% ; +28) et de la Corse (+25% ; +10 apprentis). Pour autant, les régions où la part del’apprentissage dans la formation initiale de niveaux V à III est la plus forte restent : la Haute-Normandie (34%), l’Ile-de-France (33%), la région PACA (30%) et l’Alsace (29%). La place del’apprentissage y progresse d’ailleurs, surtout en Ile-de-France (+2,2 points) et en Haute-Normandie(+1,6 pts). A souligner aussi sa hausse en Corse (+5,3 pts à 19,5%).En termes de structure par niveau, la majorité des régions forment un groupe pour lequel laproportion d’apprentis relevant du niveau V est supérieure à la donnée nationale (57,3%), tandis queles parts des autres niveaux y sont inférieures. Au-delà des régions proposant seulement du niveau V(Corse et TOM) ou V et IV (Guadeloupe, Martinique, Réunion), on citera notamment l’Alsace(82,8% d’apprentis au niveau V), la Champagne-Ardenne (81,8%), la Picardie (74,7%) ou leLimousin (74,7%). Suivent le Centre, l’Ile-de-France, PACA et l’Aquitaine. Un deuxième groupemontre une part du niveau V supérieure à la moyenne mais conjointement à une sur-représentationdu niveau IV. Ce groupe est constitué de l’Auvergne, de la Lorraine, de la Bourgogne et duLanguedoc-Roussillon. Un troisième groupe montre des niveaux IV et III sur-représentés : Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Bretagne. Enfin, 4 régions montrent desstructures un peu particulières : le Nord-Pas-de-Calais (niveau IV sur-représenté mais parts desniveaux V et III proches de la moyenne), la Basse-Normandie (même schéma pour le niveau III), laHaute-Normandie (niveau III très présent, niveau V un peu en dessous de la moyenne mais niveauIV faible) et enfin Poitou-Charentes (niveaux V et III sur-représentés au détriment du niveau IV).Les formésLe statut public est exclusif dans 7 régions (Alsace, Champagne-Ardenne, Corse, Limousin,Guadeloupe, Martinique, Réunion) et dominant dans 16 de plus. Le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagneet les TOM se distinguent par la place du privé : respectivement près de 60%, 62% et 100% deseffectifs. Deux régions, parmi celles dont les effectifs sont les plus élevés, affichent toutefois une partdu statut public inférieure à la donnée nationale (78,3%) : Rhône-Alpes (65,8%) et Pays de la Loire(64,4%).RepèresLes niveaux de formationLes secteurs de formationVoir pages précédentesVoir pages précédentesSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.189
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Evolutions 2000 / 2001 du nombre de stagiaires et d’heures stagiaires par statutStagiairesHeures stagiaires749437186660915592812000200114 165 20612 700 920Centres publicsCentres privés8 238 428 7 603 618Centres publicsCentres privésLa formation continue en 2001 : stagiaires et heures stagiaires par formation et statut2001 Evo. 00/01Public Privé Ensembleen %HS S HS S HS S HS SDiplômesBPA 2156090 5414 497445 1095 2653535 6509 -13,3 -12,9Autres 1240098 3374 767873 1884 2007971 5258 -14,4 -9,3Niveau V 3396188 8788 1265318 2979 4661506 11767 -13,8 -11,3BTA 134621 229 35006 86 169627 315 -38,7 -30,3Bac 474739 856 310522 782 785261 1638 -16,8 -14,9BP 2765950 6167 813452 1644 3579402 7811 -8,5 -5,3Niveau IV 3375310 7252 1158980 2512 4534290 9764 -11,6 -8,1BTS 1168383 1916 702467 1347 1870850 3263 -0,2 +1,4Niveau III 1168383 1916 702467 1347 1870850 3263 -0,2 +1,4Niveaux II et I 159750 600 141299 352 301049 952 +12,5 +38,8Ensemble 8099631 18556 3268064 7190 11367695 25746 -10,4 -7,4Certificats de spécialisationCS V 208310 582 138149 438 346459 1020 +17,4 +17,4CSIL V 98962 337 26334 76 125296 413 -5,4 +6,4Niveau V 307272 919 164483 514 471755 1433 +10,4 +14,0CS IV 116627 452 32112 97 148739 549 +24,6 +40,4CSIL IV 160234 560 86996 246 247230 806 -10,3 -6,7Niveau IV 276861 1012 119108 343 395969 1355 +0,3 +8,0CS III 380793 1073 124068 390 504861 1463 +1,2 +3,7Niveau III 380793 1073 124068 390 504861 1463 +1,2 +3,7Ensemble 964926 3004 407659 1247 1372585 4251 +3,9 +8,4Titres homologuésEnsemble 397730 1236 776912 1681 1174642 2917 -11,9 -3,4Formations non diplômantesActives agricoles 6099 46 0 0 6099 46 -55,3 -61,0Prép. installation 163948 3574 311847 3379 475795 6953 +41,3 -7,5Autres 3068586 45450 2839136 45784 5907722 91234 -12,0 -2,4Ensemble 3238633 49070 3150983 49163 6389616 98233 -9,6 -2,9190Ensembleformation continue12700920 71866 7603618 5928120304538 131147-9,4 -3,5
La formation continue Forte baisse des heures stagiaires réalisées dans les centres de formation publics et privés Le nombre de stagiaires est lui aussi, en 2001, en recul Les niveaux V et IV sont, pour les formations diplômantes, les niveaux les plus atteints par cette baissegénéraleEn 2001, le volume d’heures stagiaires déclaré par les centres de formation professionnelle continue,publics et privés, s’avère en forte diminution : près de 2 099 100 heures de moins, soit une baisse de-9,4%. Ce mouvement, amorcé en 1995, est renforcé par la baisse importante du nombre de centresrépondants à l’enquête de la DGER : 507 en 2001 pour 532 en 2000.Les centres publics sont, cette année contrairement à précédemment, un peu plus touchés que lescentres privés : -10,6% contre -7,3%.On ne note pas de différences très importantes dans l’évolution des heures stagiaires selon le type deformation. En revanche, au sein des formations diplômantes, les niveaux de formation montrent desévolutions contrastées : Diminution importante des heures stagiaires de niveau V (-13,8%) et de niveau IV (-11,6%) ; Stabilité du niveau III (-0,2%) ; Progression des niveaux II et I (+12,5%).A noter qu’à l’inverse, au sein des certificats de spécialisation, c’est le niveau V qui progresse le plus(+10,4%). Pour ce type de formation, on souligne, en outre, le recul des certificats d’initiative locale.Parmi les formations diplômantes de niveau V, on observe un comportement similaire des BPA(-13%) et des autres diplômes de ce niveau (-14%). En revanche, au niveau IV, le BTA (-39%) et lesbaccalauréats (-17%) fléchissent davantage que le BP (-8,5%).Pour ce qui est du nombre de stagiaires, alors que l’on observait précédemment leur augmentation,tous statuts confondus, parallèlement à la chute des heures stagiaires réalisées, en raison d’unediversification de l’offre de formations courtes, ce nombre régresse aussi en 2001 : -3,5%. Le secteurpublic perd 4,1% de ses stagiaires. Le secteur privé ressent moins fortement cette tendance à labaisse : -2,7%.Les formésAu total, en 2001, le public réalise 62% des heures stagiaires (-1 point par rapport à 2000). Près de56% des heures stagiaires, tous statuts confondus, concernent des formations diplômantes (-0,6 pt) ;6,7% touchent aux certificats de spécialisation (+0,8 pt) ; 5,8% aux titres homologués (-0,2 pt) et31,5% aux formations non diplômantes (stables).Pour ce qui est des formations diplômantes, le niveau V, bien qu’en recul (-1,6 points) constitueencore 41% des heures stagiaires réalisées par les centres. Le niveau IV compte, lui, pour 39,9% desheures stagiaires (-0,6 pt). Les niveaux III et I gagnent pour leur part du terrain : respectivement+1,7 pts et +0,5 pt. Ils rassemblent ainsi 16,5% et 2,6% des heures stagiaires.RepèresBPABTABPBTSCSBrevet professionnel agricole (niveau V)Brevet de technicien agricole (niveau IV)Brevet professionnel (niveau IV)Brevet de technicien supérieur (niveau III)Certificat de spécialisationCSILHSSCertificat de spécialisation d’initiative locale. Peuventêtre créés par les DRAF sur le même modèle que lesCS.Heures stagiairesStagiairesSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.191
Les formés de l’enseignement agricole en 2001Répartition des heures stagiaires de l’année civile 2001selon les secteurs de formationDiplômes et certificats de spécialisationCentres publicsCentres privésNiveau V - Public : 3 703 460 hsNiveau V - Privé : 1 429 801 hsProd.43,0%Prod.40,2%Trans.5,8%Trans.2,0%Forêt-A41,0%Forêt-A27,6%Comm.1,0%Comm.8,7%Serv.2,8%Serv.8,1%A. Hipp.0,8%A. hipp.4,6%Autres5,6%Autres8,8%Niveau IV - Public : 3 652 171hsNiveau IV - Privé : 1 278 088 hsProd.72,8%Prod.72,5%Trans.4,6%Trans.2,7%Forêt-A12,5%Forêt-A2,6%Comm.2,9%Comm.11,7%Serv.0,7%Serv.0,7%Autres6,5%Autres9,8%Niveau III - Public : 1 549 176 hsProd.38,0%Niveau III - Privé : 826 535 hsProd.39,4%Trans.13,2%Trans.8,9%Forêt-A22,3%Forêt-A12,1%Comm.11,7%Comm.18,5%Serv.4,8%Serv.3,5%Autres10,0%Autres17,6%Production Transformation Forêt - AménagementCommercialisationServicesActivités hippiquesAutresRépartition des stagiaires de l’année civile 2001selon les secteurs de formationDiplômes et certificats de spécialisation192Stagiaires2001Niveau VNiveau IVNiveau IIIPartsPublic Privéts statuts Public PartsPartsPrivéPublic PrivéPublicts statuts ts statutsEnsembleParts ts statutsPrivéS HSProduction 4 164 1 397 42,1% 5 891 1 939 70,4% 1 061 525 33,6% 11 116 3 861 51,6% 54,2%Transformation 593 71 5,0% 351 61 3,7% 322 116 9,3% 1 266 248 5,2% 6,5%Aménagement 3 980 1 006 37,8% 887 80 8,7% 571 255 17,5% 5 438 1 341 23,3% 21,6%Commercialisation 77 300 2,9% 306 413 6,5% 419 290 15,0% 802 1 003 6,2% 6,7%Services 213 299 3,9% 31 23 0,5% 221 143 7,7% 465 465 3,2% 2,6%Activités hippiques 66 100 1,3% 0,0% 66 100 0,6% 0,7%Autres 614 320 7,1% 798 339 10,2% 395 408 17,0% 1 807 1 067 9,9% 7,8%Total 9707 3493 100% 8264 2855 100% 2989 1737 100% 20960 8085 100% 100%
Les secteurs de la formation continue Dominante production aux niveaux V et IV dans la structure des heures stagiaires de l’année 2001, plus fortedans le public, mais en progression dans le privé La forêt-aménagement constitue le deuxième secteur au niveau V dans les deux statuts, mais aussi auniveau IV dans le public ; dans le privé, c’est la commercialisation qui occupe une place non négligeable auniveau IV La répartition sectorielle est, au niveau III, davantage diversifiée, même si les secteurs précédents restentles plus représentésNiveau VLa production reste dominante dans les deux statuts. Ce secteur est pourtant en recul (-4,9 pts) dansles centres publics, alors que sa place s’accroît dans les centres privés (+1,4 pts).Au deuxième rang, le secteur forêt-aménagement rivalise avec la production en termes d’heuresstagiaires dans le public. Il a fortement progressé dans ce statut en 2001 (+4,6 pts), donnant ungroupe production agricole - production forestière et aménagement relativement stable dans lescentres publics. Dans le privé, la part de la forêt-aménagement est plus modeste, bien que de mêmeau deuxième rang. Ce secteur y est un peu en recul (-2,1 pts). Comme dans le public, les deuxsecteurs de tête considérés sont finalement relativement stables. Les autres secteurs de formationdemeurent dans le public très minoritaires. Seule la transformation se distingue quelque peu, bienqu’en baisse. Dans le privé, le niveau V apparaît un peu plus diversifié. En particulier, sontrelativement bien représentés la commercialisation et les services.Niveau IVA ce niveau, le secteur de la production est très largement dominant, comptant pour près des 2/3 desheures stagiaires réalisées par les centres. Il progresse en outre par rapport à 2000, surtout dans lescentres privés (+3,3 pts). Par voie de conséquence, la part des autres secteurs est relativement faible.La forêt-aménagement, en progression (+1,2 pts), se dissocie toutefois des autres secteurs dans lepublic. Dans le privé, cette deuxième place est occupée par la commercialisation, malgré un reculnotable (-3,3 pts) par rapport à 2000 en structure, au profit de la production.Niveau IIILes formésLe niveau III présente une répartition sectorielle plus équilibrée, et ce dans les deux statutsd’enseignement. La production y est bien évidemment aussi dominante, et même en progression dansle public (+2,4 pts). Mais la part des autres secteurs n’est pas négligeable. On retrouve un secteurforêt-aménagement relativement développé en particulier dans le public, alors que lacommercialisation est au deuxième rang dans le privé. La transformation, en particulier compte tenude sa place par ailleurs, est aussi relativement présente et en progression au sein du niveau III dansle public.RepèresLe secteur des activités hippiquesLes activités hippiques constituent un secteur important de formationprofessionnelle continue. En formation initiale, il est intégré au secteur«production» pour ce qui est de l’élevage et de l'entraînement deschevaux et au secteur «services aux personnes» en ce qui concerne larandonnée équestre.Pour la formation continue, la sous-direction de la politique desformations de l’enseignement général, technologique et professionnelprivilégie une présentation distincte de ce secteur, tout en respectant lacohérence de la nomenclature définie en annexe.Le secteur «autres»La répartition sectorielle présentée ci-contre prend en compte lesheures stagiaires et les stagiaires concernant les formationsdiplômantes et les certificats de spécialisations.Le secteur «Autres» comprend les certificats de spécialisationd’initiative locale (CSIL) et les formations diplômantes générales(baccalauréat) ou non spécifiées.SHSStagiairesHeures stagiairesSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.193
Les formés de l’enseignement agricole en 2001La formation continue dans les régions en 2001Toutes formationsen heures stagiairesDiplômes et certificats de spécialisationAutres formationsen heures stagiairesPart des diplômes et CSDe 47% à 50%De 50% à 60%De 60% à 65%De 65% à 70%De 70% à 80%De 80% à 85%De 145 229 à 450 000De 450 000 à 600 000De 600 000 à 700 000De 700 000 à 1 000 000De 1 000 000 à 1 200 000De 1 200 000 à 1 600 000De 1 600 000 à 1 652 261HSDiplômes Autreset CS formationsEnsembleGuadeloupe 68000 34125 102125Martinique 292233 24741 316974Guyane 29402 14296 43698Réunion 359083 524667 883750TOM 48475 28286 76761Les heures stagiaires par niveau de formation dans les régions en 2001Diplômes et certificats de spécialisationNiveau VNiveau IVNiveau IIIDe 23% à 34%De 34% à 38%De 38% à 41%De 41% à 46%De 46% à 53%De 53% à 68%De 68% à 78%HSDiplômeset CSMoins de 15%De 15% à 31%De 31% à 35%De 35% à 39%De 39% à 44%De 44% à 50%De 50% à 60%Niveau absentDe 0% à 10%De 10% à 13%De 13% à 19%De 19% à 25%De 25% à 32%De 32% à 36%Guadeloupe Martinique Guyane Réunion TOMV 53 297 167 772 21 713 161 522 10 635IV 14 703 109 509 7 689 190 881 19 600III 14 952 18 240II et I 6 680194Les heures stagiaires par statut dans les régions en 2001Part du public en %HS Public Privé % PublicGuadeloupe 74664 27461 73,1Martinique 310899 6075 98,1Guyane 43698 100,0Réunion 404306 479444 45,7TOM 76761 100,0FRANCE 12700920 7603618 62,6Part du publicDe 27% à 30%De 30% à 60%De 60% à 70%De 70% à 80%De 80% à 90%De 90% à 100%
La formation continue dans les régions Les cinq régions de tête, en termes d’heures stagiaires réalisées en 2001, demeurent : les Pays de la Loire,Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, la Bretagne et l’Aquitaine Les HS sont en progression dans cinq régions au niveau V : Corse, Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Languedoc-Roussillon et Lorraine Au niveau IV, dix régions montrent un mouvement positif, en particulier la Martinique, l’Alsace, la Franche-Comté, la Picardie Au niveau III, sur douze régions dont les HS progressent, on retient notamment Midi-Pyrénées, la Lorraine,Poitou-Charentes et la CorsePour l’année 2001, le nombre important de non réponses à l’enquête de la DGER dans certainesrégions, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les Pays de la Loire, enRhône-Alpes ou en Languedoc-Roussillon, parmi d’autres, rend hasardeuse toute considération desévolutions régionales d’heures stagiaires. Néanmoins, les Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, la Bretagne et l’Aquitaine demeurent les cinq régions de tête en termes d’heures stagiairesréalisées. Ces régions comptabilisent près de 36% des heures stagiaires effectuées durant cette annéecivile. Parmi elles, Midi-Pyrénées montre même une activité en croissance : +6%. Quatre régionssupplémentaires déclarent un volume d’heures stagiaires dépassant le million en 2001: il s’agit de laBourgogne, du Languedoc-Roussillon, de la région PACA et de Poitou-Charentes.La part des diplômes et certificats de spécialisation dans le total des heures stagiaires, relativementstable au plan national (37,3% ; -0,2 pt), est en croissance dans un peu moins de la moitié des régions,en particulier la Bretagne (+7,4 pts), la Réunion (+7,1 pts), la Haute-Normandie (+4,6 pts) et l’Ilede-France(+4,2 pts). Elle est notamment élevée en Corse (86%), dans le Nord-Pas-de-Calais (77%),en Limousin (76%), en Alsace (75%), en Bretagne et en Martinique (73%).En termes de niveaux de formation, pour les diplômes et les certificats de spécialisation, on note :Au niveau V, les heures stagiaires sont en recul dans la plupart des régions pour une perte de -12%au plan national. Cinq régions cependant montrent des évolutions positives : la Corse (+35%), leNord-Pas-de-Calais (+20%), l’Alsace (+11%), le Languedoc-Roussillon (+2,5%) et la Lorraine(+0,3%). La part de ce niveau (26% au plan national) est relativement importante en Martinique(46%), en Picardie (42%) et dans trois régions dans lesquelles les niveaux III et I sont absents :Alsace (52%), Guyane (49%), Guadeloupe (42%).Au niveau IV, ce sont dix régions pour lesquelles les heures stagiaires évoluent positivement pourun recul national de -10,8%. Se distinguent particulièrement la Martinique (+73%), l’Alsace (+63%),la Franche-Comté (+14%), la Picardie (+6%). Ce niveau (24,7% au plan national) occupe une placeimportante en Limousin (39%), en Corse (38%), en Auvergne et en Bretagne (37%).Au niveau III, niveau stable au plan national (+0,1%), on remarque des progressions importantesdes heures stagiaires en Midi-Pyrénées (+82%), en Lorraine (+41,5%), en Poitou-Charentes (+27%)et en Corse (+24%). Douze régions déclarent des heures stagiaires en progression à ce niveau en2001. Ce niveau (10,6% au plan national) reste particulièrement représenté en Bourgogne (20%), enAquitaine et en Lorraine (19%), mais aussi dans les TOM (35%) en l’absence de niveau V et I.Au niveau I, niveau bénéficiant au plan national d’une progression de +12,5% des HS, ce sont lesévolutions particulièrement positives en Languedoc-Roussillon (+269%), en Rhône-Alpes (+199%)et en Champagne-Ardenne (+97%) qu’il convient de souligner parmi les 8 régions (sur 12 proposantce niveau) enregistrant une hausse des heures stagiaires à ce niveau. Ce niveau comptant pour 1,2%des HS au plan national est très présent en Bourgogne (6,8%) et en Auvergne (4,5%).Les formésRepèresAutres formationsLes «autres formations» comprennent les titres homologués et lesformations non diplômantes.Les niveaux de formationNiveau V : BPA, CAPA, BEPA, CAP, BEP et certificats de spécialisationouverts aux titulaires d’un diplôme de niveau V.Niveau IV : baccalauréat professionnel, baccalauréat technologique,BTA, BP et certificats de spécialisation ouverts aux titulaires d’undiplôme de niveau IV.Niveau III : BTSA et certificats de spécialisation ouverts aux titulairesd’un diplôme de niveau III.Niveaux II et I : formations supérieures de niveau supérieur à Bac+2(diplômes d'ingénieur).SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.195
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs de formation initiale scolaire par niveau de formation et selon le statut d’enseignementPublicPrivéNiv. VI et VbisNiv. VNiv. IVNiv. III90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01Public 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Niveaux VI et Vbis 6 576 6 783 6 582 6 101 5 548 5 232 4 988 5 020Niveau V 15 097 16 459 17 597 18 312 18 926 18 757 18 235 17 740Niveau IV 24 911 29 713 30 533 31 427 32 361 32 642 31 977 31 539Niveau III 10 036 13 422 13 939 14 604 14 986 15 178 14 977 14 922Total 56 620 66 377 68 651 70 444 71 821 71 809 70 177 69 221Privé 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Niveaux VI et Vbis 21 718 25 916 27 039 26 975 26 026 27 004 28 038 28 714Niveau V 33 142 39 494 43 055 45 184 45 899 44 884 43 184 42 054Niveau IV 15 526 21 884 23 378 24 700 26 200 27 360 26 403 25 651Niveau III 5 404 6 283 6 660 7 059 7 348 7 512 7 528 7 351Total 75 790 93 577 100 132 103 918 105 473 106 760 105 153 103 770Evolution de la répartition des effectifs d’élèves en formation initiale scolaire selon les niveaux de formationVI et VbisV11,6%10,2%7,3%26,7%24,8%25,6%PublicVI et VbisV28,7%27,7%27,7%43,7%42,2%40,5%Privé199019952001IVIII17,7%20,2%21,6%44,0%44,8%45,5%IVIII20,5%23,4%24,7%7,1%6,7%7,1%Rappel 2000VI et VbisVIVIIIPublic7,1%26,0%45,6%21,3%Privé26,7%41,1%25,1%7,1%Evolution des effectifs selon le diplôme préparé58 16653 833CAPABEPA43 637Baccalauréat S196BTABac technologiqueBac professionnelBTSA27 74422 14721 74715 02916 63716 088 16 75514 75614 716 13 7104 5473 5623 7695 4755 9612693 6723 3901990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Evolution structurelle des formations initiales scolaires Reprise des niveaux VI et Vbis dès 1999 dans le privé et en 2001 dans le public Progression du niveau V jusqu’en 1998 et inversion de tendance à partir de 1999, confirmée en 2001 Développement du niveau IV jusqu’en 1999 ; depuis 2000, la seule progression des baccalauréatsprofessionnels ne suffit pas à insuffler un mouvement positif général Fléchissement du niveau III dans le public en 2000 ; dans le privé en 2001Niveaux VI et VbisEn recul depuis 1996 dans le public, les effectifs de ces niveaux reprennent en 2001 : +0,6%. Bienque ce regain porte sur des effectifs faibles (+32), il se révèle particulièrement positif au vu desévolutions passées. En effet, le public perdait entre 5% et 9% de ses effectifs chaque année entre1997 et 2000. Dans le privé, ces effectifs subissaient des fléchissements en 1997 et 1998 pour croîtreà nouveau en 1999 et 2000 (+3,8% chaque année). En 2001, la progression se poursuit, bien que plusmodérément : +2,4%. Ainsi, la part des niveaux VI et Vbis dans les effectifs totaux progresse-t-elledans les deux statuts. En 2001, ces niveaux constituent 7,3% (+0,2 point) des effectifs du public et27,7% (+1 point) des effectifs du privé.Niveau VLes effectifs d’élèves au niveau V se développent sur la période 1995-1998 dans les deux statuts :+15% sur trois ans dans le public et +16% dans le privé. Ceci porte sur des volumes importantsd’élèves puisque le public gagne près de 2500 élèves ; le privé, un peu plus de 6400. En 1999, latendance s’inverse : -0,9% dans le public et -2,2% dans le privé. Elle se confirme en 2000 :respectivement -2,8% et -3,8%. En 2001, la chute des effectifs se prolonge : le public perd près de500 élèves (-2,7%) et le privé 1130 (-2,6%). Ceci résulte des réductions d’effectifs en BEPA depuis1999 que ne peut compenser l’évolution positive des CAPA. Le niveau V se replie en structure en2001 : il représente 25,6% (-0,4 pt) des effectifs dans le public et 40,5% dans le privé (-0,6 pt). Ceniveau est cependant dominant dans le privé.Niveau IVLes effectifs de niveau IV augmentent jusqu’en 1999. De 1995 à 1999, l’évolution est davantagemarquée dans le privé : on y repère un gain de près de 5480 élèves sur quatre ans (+25%), tandis que2930 élèves de plus sont enregistrés dans le privé (+9,9%). En 2000, ce niveau est frappé par un reculde ses effectifs. Le privé est davantage touché : -3,5% (-957 élèves) pour -2% dans le public (-665).Ce mouvement est confirmé en 2001, même s’il est plus faible. Le public perd près de 440 élèves(-1,4%) ; le privé, environ 750 (-2,8%). Ceci s’explique par le cumul des réductions d’effectifs enbaccalauréat technologique et BTA à partir de 2000 avec la baisse subie par le baccalauréatscientifique dès 1999. En 2000 et 2001, seul le baccalauréat professionnel reste encore en croissance.Dominant dans le public, le niveau IV se maintient cependant en structure à 45,5%. Il perd un peude terrain dans le privé : -0,4 point à 24,7%.Les formésNiveau IIILe nombre d’étudiants croît tant dans le public que dans le privé de 1990 à 1999, malgré unfléchissement en 1995. Sur la période 1995-1999, on enregistre une progression des effectifs de+13,1% (+1756 étudiants) dans le public et de +19,6% (+1229 étudiants) dans le privé. En 2000, lepublic montre quelques signes de faiblesse. Il perd 200 étudiants (-1,3%), tandis que le privé semaintient (+0,2%). En 2001, le privé subit à son tour une chute de ses effectifs (-2,4%,-177 étudiants). Le public parvient presque, lui, à se maintenir : -0,4%. Le niveau III est, en structure,en progression dans le public (+0,3 pt à 21,6%). Il faiblit à peine dans le privé (-0,1 pt à 7,1%).RepèresNiveaux VI et VbisNiveau VQuatrièmes, troisièmes, CPA et CLIPACAPA et BEPANiveau IVNiveau IIISeconde générale et technologique, baccalauréatsprofessionnel, technologique, scientifique, BTABTSA et classes préparatoiresSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.197
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs d’étudiants des écoles supérieuresselon le cycle de formationFormations initiales de baseFormations initiales de base (dont apprentissage)1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001E N S A 1622 1639 1628 1697 1702 1852 1839E N I T et assimilées 1654 1683 1712 1784 1797 1834 1945E N S P 163 161 178 199 193 196 182Ecoles d'application 346 341 360 360 356 347 399Centres de 3ème cycle 138 142 119 109 114 113 121E N V 1978 2107 2092 2168 2267 2503 2508E N F A 256 208 380 360 406 573 843Ensemble Public 6157 6281 6469 6677 6835 7418 7837Ecoles de la F E S I A 2617 2692 2689 2721 2841 2901 3084E S I T P A 421 431 440 450 453 461 466E S B 144 136 164 192 212 188 197Ensemble privé 3182 3259 3293 3363 3506 3550 3747Ensemble 9339 9540 9762 10040 10341 10968 11584E T P -135 -120 -252 -264 -292 -343 -678Doubles comptes -144 -151 -131 -120 -119 -107 -129Ensemble corrigé 9060 9269 9379 9656 9930 10518 10777Comprend les formations initiales en apprentissage.Pour 2001 : INAP-G (47apprentis), Ecoles de la FESIA (199 apprentis dont 3 à l’ISAA , 43 à l’ESA, 41 à l’ISAB et 112 à l’ ISAL-ITIAPE.Formations de troisième cycleNB :Pour les formations detroisième cycle, les chiffresprésentés ci-contre sur lapériode 1995 - 1999 ne sontpas comparables avec ceuxdes années 2000 et 2001.En effet, la DGER a entretemps affiné ses procéduresde décompte des inscriptions.Voir page ci-contre lesRepères.* Donnée non disponibleavant 2000.Formation initiale et formation continueInscrits MAAPAR1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001E N S A 1047 923 924 881 928 699 862E N I T et assimilées 85 113 102 174 158 159 49E N S P 0 0 0 0 0 0 0Ecoles d'application 149 174 142 139 199 209 202Centres de 3ème cycle 33 39 47 40 43 41 33E N V 57 97 152 229 135 143 156E N F A 26 39 45 33 8 15Ensemble Public 1371 1372 1406 1508 1496 1259 1317Ecoles de la F E S I A 9 6 3 22 14E S I T P A 0 0 0 0E S B 1 1 0 0Ensemble privé 0 0 9 7 4 22 14Ensemble 1371 1372 1415 1515 1500 1281 1331ETP -22 -2 -41 -53Doubles comptes -134 -135 -93 -82 -88 -115 -102Ensemble corrigé 1237 1237 1322 1411 1410 1125 1176Dont formation continue* nd nd nd nd nd 127 115Formations de base11584Formations de troisième cycle9339976210341Tous étudiants (ancien décompte)Etudiants relevant des écoles du MAAPAR137114151500128113311981995 1996 1997 1998 1999 2000 20011995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Evolution structurelle des formations supérieures longues Croissance régulière des effectifs des formations supérieures de base dans les années 90, plus soutenuedepuis la rentrée 2000 Les écoles publiques se révèlent à cet égard plus dynamiques, notamment l’ENFA, les ENIT et les ENV, cesdernières montrant cependant des effectifs stables en 2001 On retrouve les ENIT et les ENV parmi les écoles dont le nombre d’étudiants inscrits en formation detroisième cycle croît le plus à la fin des années 90 De 2000 à 2001, s’agissant des troisièmes cycles, ce sont les effectifs d’étudiants en formation initiale quiaugmentent tandis que le nombre de stagiaires se réduitEn données non corrigées, on distingue deux périodes concernant l’évolution des effectifsd’étudiants en formation initiale de base dans les écoles publiques et privées : jusqu’en 1999, ils se développent de manière régulière au rythme de +2% à +3% par an ; à partir de 2000, ils progressent de manière plus soutenue (autour de +6% par an).Au total, sur la période 1995-2001, on dénombre près de 2250 inscriptions supplémentaires (+24%).Le statut public s’avère le plus dynamique, et ce quasiment à toutes les rentrées de la périodeconsidérée, mis à part en 1996 et surtout 1999. En particulier, on note un écart de +7,2 points enfaveur du public dans le taux de progression des effectifs à la rentrée 2000 : +8,5% au public pour+1,3% au privé. Sur la période longue 1995-2001, toujours en données non corrigées, on compte1680 étudiants de plus dans le public (+27%). Le privé affiche pour sa part un bilan de 565 étudiantssupplémentaires (+18%).En termes relatifs, dans le public, ce sont les effectifs non corrigés de l’ENFA (+230% ; +587étudiants), des ENV (+27% ; +530 étudiants) et des ENIT (+18% ; +291 étudiants) qui progressentle plus de 1995 à 2001. Seuls les centres de troisième cycle montrent des effectifs en recul (-12% ;-17 étudiants). Dans le privé, on souligne l’évolution particulière du nombre d’étudiants de l’ESB(+37% ; +53), alors que les écoles de la FESIA, majoritaires, impriment le rythme de croissanceglobal du privé (+17,8% ; +467 étudiants).En 2001, on note toutefois quelques mouvements différenciés : recul des effectifs des ENSA (-0,7%)et de l’ENSP (-7%), forte progression des étudiants inscrits en école d’application (+15%) et dansles centres de troisième cycle (+7%), stabilisation dans les ENV (+0,2%).S’agissant des troisièmes cycles, selon l’ancien décompte des inscriptions (c.f. Repères), le nombred’étudiants (formation initiale et continue) inscrits dans ce type de cursus a cru de +9,4% (+129étudiants) en données non corrigées de 1995 à 1999. Sur cette période, les ENV (+137%) et les ENIT(+86%) se révèlent les plus dynamiques, tandis que les effectifs des ENSA se réduisent (-11%). Parla suite, sur la base des nouvelles procédures de décomptes des inscriptions, il est donné de préciserl’évolution des inscriptions propres au MAPAAR : +3,9% (+50 inscriptions) de 2000 à 2001. Audelà,on distingue la forte progression des étudiants en formation initiale (+6,3% en donnéescorrigées), tandis que le nombre de stagiaires se réduit (-9,4%). En 2001, on compte au total 1061inscrits (1163 en données non corrigées) en formation de troisième cycle au titre de la formationinitiale et 115 au titre de la formation continue (168 en données non corrigées), s’agissant des formésrelevant du MAPAAR.Les formésRepèresENSAENITENSPENVFESIAESITPAESBETPSourcesEcoles nationales supérieures agronomiquesEcoles nationales des travaux agricolesEcole nationale supérieure du paysageEcoles nationales vétérinairesFédération des écoles supérieures d’ingénieurs en agricultureEcole supérieure d’ingénieurs et de techniciens pour l’agricultureEcole supérieure du boisEquivalent temps pleinLes corrections d’effectifsCes corrections ont pour objet de tenir compte à la fois des écarts entre leseffectifs physiques de certaines formations et leurs équivalents temps pleinet des doubles inscriptions de certains étudiants.Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieurNB : A partir de 2000, l’enquête annuelle réalisée par laDGER auprès des écoles a donné lieu à un traitementapprofondi par la sous-direction de l’enseignement supérieurpermettant : d’une part de repérer, pour certaines formations detroisième cycle, parmi les étudiants suivant une formationdonnée, les étudiants inscrits dans les écoles considéréesdes étudiants relevant de l’Université, et de les soustraire dudécompte initial ; d’autre part, de distinguer plus finement en formation detroisième cycle les étudiants en formation initiale desstagiaires en formation continue.Ceci amène, pour les années 2000 et 2001, à resserrer lechamp des populations prises en compte. Par voie deconséquence, les statistiques 2000 et 2001 ne peuvent pasfaire l’objet d’une comparaison stricte avec celles des annéesprécédentes.199
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs des formations initiales scolaires de niveau Vpar secteur de formation et selon le statut d’enseignementEnseignement publicProductionTransformationForêt - AménagementServices aux personnesServices aux entreprises etcommercialisation50 00045 00040 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0005 00001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Secteurs de formation 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 9 132 8 584 9 399 10 005 10 369 10 358 10 049 9 537Transformation 496 613 662 686 765 790 758 707Forêt Aménagement 1 971 3 269 3 560 3 667 3 806 3 696 3 621 3 634Services aux personnes 1 716 2 157 2 193 2 245 2 222 2 233 2 226 2 274Services aux entreprises etcommercialisation1 782 1 836 1 783 1 709 1 764 1 680 1 581 1 588Ensemble 15 097 16 459 17 597 18 312 18 926 18 757 18 235 17 740Enseignement privéProductionTransformationForêt - AménagementServices aux personnesServices aux entreprises etcommercialisation50 00045 00040 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0005 00001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Secteurs de formation 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 12 228 11 189 12 663 13 853 14 700 14 749 14 187 13 503Transformation 404 626 680 743 750 638 577 530Forêt Aménagement 2 697 4 608 5 222 5 613 5 894 5 800 5 750 5 575Services aux personnes 13 428 19 410 20 671 20 771 20 080 19 284 18 633 18 656Services aux entreprises etcommercialisation4 385 3 661 3 819 4 204 4 475 4 413 4 037 3 790200Ensemble 33 142 39 494 43 055 45 184 45 899 44 884 43 184 42 054
Evolution sectorielle des formations initiales scolairesde niveau V Dominante production dans le public ; services aux personnes dans le privé La forêt-aménagement est au deuxième rang dans le public ; la production dans le privé En structure, sur la période longue, les secteurs forêt-aménagement et services aux personnes ont uneplace accrue, au détriment de la production et des services aux entreprises et commercialisationDonnées de cadrage Niveau V Evo. 95/98 Evo. 98/99 Evo 99/00Public +15,0% -0,9% -2,8%Privé +16,2% -2,2% -3,8%Evo 00/01-2,7%-2,6%Secteur productionCe secteur concerne près de 54% des effectifs dans le public, pour 32% dans le privé en 2001. Enrepli en début de décennie 90, ce secteur s’est fortement développé par la suite et jusqu’en 1998.Entre 1995 et 1998, le public gagne 1785 élèves (+21%) ; le privé, 3511 élèves (+31%). La rentrée1999 marque un tournant avec la stabilisation des effectifs. Le recul advient en 2000 et 2001 : -3,0%puis -5,1% dans le public pour -3,8% puis -4,8% dans le privé. Depuis 1990, la part de ce secteurs’est resserrée de près de 7 points dans le public au niveau V et de près de 5 points dans le privé.Secteur transformationCe secteur est peu développé : 4% des effectifs du public et à peine un peu plus de 1% du privé. Ilprogresse de 1990 à 1998. Sur la période 1995-1998, il gagne 152 élèves (+25%) dans le public et124 (+20%) dans le privé. En 1999, la croissance se poursuit dans le public (+3,3%), mais le privésubit un premier recul (-14,9%). Par la suite, ce secteur perd des élèves dans les deux statuts : -4,1%puis -6,7% dans le public et -9,6% puis -8,1% dans le privé. En structure, il se maintient pourtantdans le privé (+0,1 pt par rapport à 1990) ; il gagne même du terrain dans le public (+0,7 pt).Secteur forêt-aménagementCe secteur occupe le deuxième rang dans le public avec 20,5% des effectifs en 2001. Il est plusmodeste dans le privé : 13%. En forte croissance dans les deux statuts entre 1990 et 1998, on compte537 élèves de plus (+16%) dans le public et 1286 dans le privé (+28%) sur la période 1995-1998.Mais, ce secteur n’échappe pas au recul à partir de 1999 : -2,9% puis -2,0% en 2000 dans le public ;-1,6% puis -0,9% dans le privé. En 2001, il se reprend toutefois un peu dans le public (+0,4%), alorsque la baisse est confirmée dans le privé (-3,0%). Ce secteur a quoi qu’il en soit pris de l’ampleur enstructure depuis 1990 : +7,4 pts dans le public et +5,2 pts dans le privé.Les formésSecteur services aux personnesDominant dans le privé (44%), ce secteur est plus modeste dans le public (13%). En croissancedepuis 1990, il gagne +3% dans le public et +3,5% dans le privé entre 1995 et 1998. Il se maintientencore en 1999 et 2000 dans le public (+0,5% puis -0,3%), alors qu’il fléchit dans le privé (-4% puis-3,4%). En 2001, ce secteur est le seul à ne pas voir ses effectifs se réduire : +2,2% dans le public et+0,1% dans le privé. Depuis 1990, sa part a crû de +1,4 pts dans le public et +3,9 pts dans le privé.Secteur services aux entreprises et commercialisationIl constitue 9% des effectifs dans les deux statuts. Sujet à des fluctuations sur la période longue, ilest en croissance dans le privé (+814 élèves ; +22%) entre 1995 et 1998, et se rétracte dans le public(-72 élèves ; -3,9%). Il chute par la suite dans les deux statuts : -4,8% puis -5,9% dans le public ;-1,4% puis -8,5% dans le privé. En 2001, le privé perd encore 6% de ses effectifs ; ceux du publicsont stables. En part, ce secteur perd près de 3 points dans le public et 4 dans le privé depuis 1990.RepèresNiveau V : CAPA et BEPASecteurs de formationLa nomenclature des secteurs auxquels il est fait référence dans cedocument est présentée en annexe.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.201
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs des formations initiales scolaires de niveau IVpar secteur de formation et selon le statut d’enseignementEnseignement public35 00030 000ProductionTransformationForêt - AménagementServices aux personnesServices aux entreprises etcommercialisationFormations générales25 00020 00015 00010 0005 00001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Secteurs de formation 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 11 864 11 182 11 017 10 913 11 577 12 055 11 879 11 707Transformation 747 1 755 1 944 2 022 2 142 2 138 1 907 1 784Forêt Aménagement 1 245 4 671 5 211 5 673 6 022 6 117 6 141 6 196Services aux personnes 410 1 081 1 312 1 425 1 450 1 546 1 601 1 610Services aux entreprises etcommercialisation1 529 1 742 1 603 1 614 1 555 1 499 1 375 1 331Formations générales 9 116 9 282 9 446 9 780 9 615 9 287 9 074 8 911Ensemble 24 911 29 713 30 533 31 427 32 361 32 642 31 977 31 539Enseignement privé35 00030 000ProductionTransformationForêt - AménagementServices aux personnesServices aux entreprises etcommercialisationFormations générales25 00020 00015 00010 0005 00001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Secteurs de formation 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 7 189 6 914 6 785 6 942 7 769 8 544 8 410 8 201Transformation 396 765 835 938 1 077 1 102 989 860Forêt Aménagement 752 2 621 3 054 3 364 3 442 3 583 3 497 3 416Services aux personnes 2 067 6 335 7 401 8 051 8 417 8 793 8 466 8 177Services aux entreprises etcommercialisation1 762 2 066 1 974 1 971 2 041 2 064 1 985 1 939202Formations générales 3 360 3 183 3 329 3 434 3 454 3 274 3 056 3 058Ensemble 15 526 21 884 23 378 24 700 26 200 27 360 26 403 25 651
Evolution sectorielle des formations initiales scolairesde niveau IV Dominante production dans les deux statuts Place importante des formations générales et de la forêt-aménagement dans le public ; des services auxpersonnes dans le privé Les parts de la production, des formations générales se sont pourtant considérablement réduites, au profitde la forêt-amenagement et des services aux personnes dans les deux statutsDonnées de cadrage Niveau IV Evo. 95/99 Evo. 99/00 Evo 00/01Public +9,9% -2,0% -1,4%Privé +25,0% -3,5% -2,8%Secteur productionIl est dominant en 2001 : 37% des effectifs du public et 32% du privé. Ces effectifs ont connu unepériode de repli jusqu’en 1997 dans le public, 1996 dans le privé. Ils sont en reprise jusqu’en 1999.Ceci se solde par une hausse de près de 8% dans le public de 1995 à 1999 et de 24% dans le privé.Ensuite, les effectifs régressent : -1,5% puis -1,4% dans le public ; -1,6% puis -2,5% dans le privé.Depuis 1990, sa part s’est singulièrement réduite : -10,5 pts dans le public et -14,3 pts dans le privé.Secteur transformationSa place est modeste : moins de 6% des effectifs du public et à peine plus de 3% du privé. Leseffectifs augmentent jusqu’en 1999, date de stabilisation pour le public. De 1995 à 1999, les gainssont de +22% dans le public et +44% dans le privé. En 2000 et 2001, ce secteur est touché par labaisse générale : -10,8% puis -6,4% dans le public et -10,3% et -13% dans le privé. Mais sa part resteaccrue par rapport 1990 : près de 3 pts de plus dans le public et près d’1 pt dans le privé.Secteur forêt-aménagementIl est au 3 ème rang parmi les effectifs de niveau IV avec 20% dans le public et un peu plus de 13%dans le privé. Il a connu un très fort essor sur la période longue. De 1995 à 1999, les effectifscroissent de +31% dans le public et +37% dans le privé. En 2000 et 2001, ils résistent dans le public(+0,4% puis +0,9%), mais se replient dans le privé (-2,4% puis -2,3%). Ce secteur a cependant gagnéen structure un terrain considérable depuis 1990 : +14,6 pts dans le public et +8,5 pts dans le privé.Secteur services aux personnesIl est très développé dans le privé (32%) et peu présent dans le public (5%). Il a connu undéveloppement important dans les deux statuts sur la période longue. De 1995 à 1999, son évolutionest un peu plus marquée dans le public : +43% pour +39% dans le privé. Il continue de croître dansce statut en 2000 (+3,6%) et 2001 (+0,6%), alors qu’il perd des élèves dans le privé (-3,7% et -3,4%).Mais c’est dans le privé que sa part progresse le plus depuis 1990 : +18,6 pts pour +3,5 pts au public.Secteur services aux entreprises et commercialisationFaiblement représenté dans le public (4,2%), il l’est à peine plus dans le privé (7,6%). Progressanten début de décennie 90, il s’est ensuite replié à partir de 1994. Il perd près de 14% de ses effectifsdans le public entre 1995 et 1999 ; il est stable dans le privé par un sursaut en 1988 et 1999. En 2000et 2001, les deux statuts sont atteints : -8,3% puis -3,2% au public et -3,8% puis -2,3% au privé. Entre1990 et 2001, la part de ce secteur se réduit de près de 2 pts dans le public et de 4 pts dans le privé.Formations généralesElles ont une place importante dans le public : 28% des effectifs pour 12% dans le privé. Leurseffectifs, après voir fluctué dans le public et s’être réduits dans le privé en début de décennie 90, ontconnu une période de croissance 1995 à 1997 dans le public, prolongée à 1998 dans le privé. Ils sereplient ensuite dans les deux statuts, le public perdant 3,4% de ses effectifs en 1999 puis 2,3% en2000 et 1,8% en 2001, alors que le privé, subissant encore davantage cette baisse les deux premièresannées (-5,2% puis -6,7%), maintient ses effectifs en 2001. Ces formations ont ainsi un poidsamoindri, par rapport à 1990, au sein du niveau IV : -8,3 pts dans le public et -9,7 pts dans le privé.Les formésRepèresNiveau IV : seconde générale et technologique, baccalauréatsprofessionnel, technologique, scientifique, BTA.Secteurs de formationVoir nomenclature en annexe.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.203
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs des formations initiales scolaires de niveau IIIpar secteur de formation et selon le statut d’enseignementEnseignement public16 00014 000ProductionTransformationForêt - AménagementServices aux personnesServices aux entreprises etcommercialisationFormations générales12 00010 0008 0006 0004 0002 00001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Secteurs de formation 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 6 251 6 216 6 445 6 795 6 819 6 756 6 638 6 614Transformation 1 712 2 465 2 575 2 698 2 769 2 663 2 478 2 285Forêt Aménagement 331 2 404 2 636 2 844 2 969 3 139 3 131 3 252Services aux personnes 72 138 241 384Services aux entreprises etcommercialisation1 331 1 850 1 746 1 730 1 820 1 939 1 978 1 861Formations générales 411 487 537 537 537 543 511 526Ensemble 10 036 13 422 13 939 14 604 14 986 15 178 14 977 14 922Enseignement privé16 00014 00012 000ProductionTransformationForêt - AménagementServices aux personnesServices aux entreprises etcommercialisation10 0008 0006 0004 0002 00001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Secteurs de formation 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 3 446 2 951 3 227 3 472 3 537 3 523 3 513 3 448Transformation 707 928 936 974 1 036 1 033 975 876Forêt Aménagement 68 977 1 127 1 221 1 247 1 286 1 349 1 385Services aux personnes 72 141 220 304Services aux entreprises etcommercialisation1 183 1 427 1 370 1 392 1 456 1 529 1 471 1 338204Formations généralesEnsemble 5 404 6 283 6 660 7 059 7 348 7 512 7 528 7 351
Evolution sectorielle des formations initiales scolairesde niveau III Dominante production, malgré un recul important en structure La forêt-aménagement connaît un développement considérable, se plaçant au second rang dès 1996 dansle public, en 2001 dans le privé La transformation occupe une place non négligeable au niveau III et parvient presque à se maintenir enstructure malgré le repli des effectifs de ces dernières annéesDonnées de cadrage Niveau III Evo. 95/98 Evo. 98/99 Evo 99/00Public +11,7% +1,3% -1,3%Privé +17,0% +2,2% +0,2%Evo 00/01-0,4%-2,4%Secteur productionIl est largement dominant : 44% des effectifs du public, 47% du privé. En décroissance entre 1992et 1995, le nombre d’étudiants se reprend ensuite. De 1995 à 1998, il gagne près de 10% dans lepublic, 20% dans le privé. Mais il fléchit à partir de 1999, surtout dans le public : -0,9% puis -1,7%,pour -0,4% puis -0,3% dans le privé. En 2001, c’est à l’inverse le privé qui est le plus touché : -1,9%contre -0,4% au public. La montée en puissance d’autres secteurs dont la forêt-aménagement pèsesur la part de la secteur : il perd 18 points dans le public de 1990 à 2001 ; 17 points dans le privé.Secteur transformationIl occupe une place non négligeable : 15% des effectifs du public, 12% du privé. Globalement enprogression depuis 1990, ses effectifs sont en croissance d’environ 12% entre 1995 et 1998 dans lesdeux statuts. Mais il n’échappe pas ensuite à la réduction d’effectifs : -3,8% en 1999 puis -6,9% dansle public ; -0,3% et -5,6% dans le privé. En 2001, cette tendance s’alourdit : -7,8% dans le public et-10,2% dans le privé. Il perd autour d’un point en structure dans les deux statuts entre 1990 et 2001.Secteur forêt-aménagementAu deuxième rang en structure, ce secteur rassemble 22% des effectifs du public et 19% du privé. Ilest le seul secteur à ne cesser de croître depuis 1990. Ses effectifs gagnaient +23,5% dans le publicet +27,6% dans le privé entre 1995 et 1998. En 1999, ils croissent encore respectivement de +5,7%et +3,1%. En 2000, ils sont stables dans le public (-0,3%) et progressent encore dans le privé(+4,9%), mais se reprennent en 2001 dans les deux statuts : +3,9% au public et +2,7% au privé. Lapart de ce secteur croît significativement depuis 1990 : +18,5 pts dans le public ; +17,6 dans le privé.Secteur services aux personnesIl apparaît en 1998. Ses effectifs sont multipliés par 5 dans le public, par 4 dans le privé sur la période1998-2001. Son poids reste toutefois limité : 2,6% des effectifs du public et 4,1% du privé en 2001.Les formésSecteur services aux entreprises et commercialisationIl rassemble 18% des effectifs du privé et 12% du public. Ses effectifs se repliaient entre 1994 et1996 dans le privé, 1997 dans le public pour reprendre ensuite. De 1995 à 98, le bilan est positif pourle privé (+2%), à l’inverse du public (-1,6%). En 1999, les effectifs sont dynamiques pour les deuxstatuts (+6,5% au public, +5% au privé). En 2000, ils faiblissent dans le privé (-3,8% pour +2% aupublic). En 2001, le recul est général : -9% pour le privé ; -5,9% pour le public. La part de ce secteurest presque stable entre 1990 et 2001 dans le public (-0,8 pt) mais perd près de 4 points dans le privé.Formations généralesCes formations publiques concernent 3,5% des étudiants de ce statut. Sur la période 1955-1998, ellesgagnent +10% en effectifs. Toujours en progression en 1999 (+1,1%), les effectifs chutent en 2000(-5,9%) pour se reprendre en 2001 (+2,9%).RepèresNiveau III : BTSA, Classes post-BTS, Classes préparatoiresLes formations généralesAu niveau III, les formations générales regroupent les classespréparatoires et les classes post-BTSA-BTS-DUTSecteurs de formationVoir la nomenclature en annexeSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.205
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs d’apprentis de 1990 à 2001Toutes formations17 72921 01024 966 27 278 28 407 28 852 28 8391995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Evolution des effectifs selon les formations suiviesLes diplômesApprentis 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001CAPA 7 917 7 970 8 898 10 101 10 698 10 498 10 339 9 863BEPA 1 354 3 573 4 084 4 638 5 132 5 307 5 200 5 160BPA ou BP 196BPA 695 727 767 832 1 003 998 958BP 952 1 790 2 433 2 597 2 864 2 865 2 790BTA 680 2 175 1 427 632 601 649 629 590Bac Pro 50 268 1 364 2 660 3 095 3 432 3 711 3 817BTSA 156 1 873 2 422 3 219 3 664 3 850 4 119 4 542Ingénieur 66 89 138 132 169 251 279Total Diplômes 10 353 17 572 20 801 24 588 26 751 27 772 28 112 27 999CAPABEPABPABac proBTABPBTSA103399863Les titres homologués et certificats de spécialisationApprentis 95 96 97 98 99 2000 01niveau V 97 108 134 221 225 336 337niveau IV 14 29 102 142 150 197 226niveau III 46 72 142 164 231 170 205Total 157 209 378 527 606 703 768TH niveau II : 29 en 1999, 37 en 2000 et 72 en 200152004119516045423711 38172865 2790998 9586295901992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Evolution de la répartition des effectifs d’apprentis par niveau de formationNiveau V58,5%56,6%69,6%Niveau IVNiveau III19,2%25,7%25,7%10,8%14,9%16,5%199520002001206Niveaux II et I0,4%1,0%1,2%
Evolution structurelle des formations par l’apprentissage L’apprentissage agricole s’est très fortement développé dans les années 1990 A partir de 1998, on note un ralentissement de la croissance de ses effectifs En 2001, ceux-ci parviennent juste à se maintenir Ce mouvement relève des formations diplômantes, et plus précisément des niveaux V et IVL’apprentissage a connu un essor considérable dans les années 1990. En 1996 et 1997, on enregistreencore des taux de croissance annuelle autour de +19%. Un premier ralentissement se fait sentir en1998, le nombre d’apprentis augmentant alors de +9,3%. Cette tendance se confirme les annéessuivantes : +4,1% en 1999 et seulement +1,6% en 2000. Reste que le nombre de jeunes accueillis enformation agricole par la voie de l’apprentissage a presque triplé en une décennie, de 10350 en 1990à 28850 en 2000, soit 18500 apprentis supplémentaires (+179%). En 2001, pourtant, les effectifs sontstables (-13 apprentis), cela préfigurant peut-être un tournant pour l’apprentissage agricole.Ce mouvement est dû à l’évolution des formations diplômantes puisque le nombre d’apprentispréparant un titre homologué ou un certificat de spécialisation ne cesse de croître : +141% entre 1995et 1997, +39% en 1998, +15% en 1999, +16% en 2000 et +9% en 2001. Dans le même temps, leseffectifs des formations diplômantes progressent de +40% de 1995 à 1997 (+7016 apprentis). Leurdéveloppement commence à se ralentir en 1998 (+8,8% ; 2163 apprentis supplémentaires). En 1999,leur taux de croissance est de +3,8% (1021 apprentis de plus). Il n’est plus que de +1,2% en 2000(+340 apprentis). En 2001, ces effectifs sont en diminution. L’apprentissage agricole perd alors unpeu plus de 110 apprentis dans ses formations diplômantes. Si le recul est faible (-0,4%), il n’en restepas moins marquant compte tenu des évolutions positives passées.Au sein des formations diplômantes, après avoir fortement concouru à l’expansion del’apprentissage, ce sont les niveaux V et IV qui entraînent son fléchissement aujourd’hui.Le niveau V en effet gagnait de 1000 à 2000 apprentis par an avant 1999, enregistrant des taux decroissance de 7 à 20%. En 1999, on ne dénombre plus que 146 apprentis de plus (+0,9%). Dès larentrée 2000, ce niveau perd des apprenants : -271 (-1,6%). La baisse s’accentue en 2001 : 556apprentis de moins sont recensés (-3,4%). Au sein du niveau V, toutes les formations sont touchées :le CAPA dès 1999, le BEPA et le BPA en 2000. On note juste en termes relatifs une contaction deseffectifs moins forte s’agissant du BEPA en 2001 (-0,8% contre -4,6% au CAPA et -4% au BPA).Le niveau IV comptait, lui, de 800 à 1200 apprentis de plus entre 1994 et 1997 (taux de croissanceentre +25% et +45%). En 1999 et 2000, on observe un premier seuil dans son fléchissement, son tauxde croissance s’établissant alors autour de +10%. En 2000, il est toujours dans un mouvementdynamique, mais sans comparaison aucune avec les évolutions passées (+3,7%). Il parvient juste àse maintenir en 2001 (-0,1%). Ce sont les BTA et les BP qui impriment ce mouvement, perdant desapprentis dès 2000 pour les premiers, en 2001 pour les seconds. Les baccalauréats professionnels, eneffet, ne cessent de se développer, même si cela est de façon de plus en plus modérée depuis 1998 :+95% en 1997, +16% en 1998, +11% en 1999, +8% en 2000 et +3% en 2001.Les formésLes niveaux III et I sont, eux, globalement en expansion sur l’ensemble de la période. Ilsconnaissent aussi un léger ralentissement de leur croissance ces dernières années, mais sanscommune mesure avec le mouvement qui touche les autres niveaux. Le niveau III gagne d’ailleursencore plus de 420 apprentis en 2001 (+10%).Par voie de conséquence, en structure, le niveau monte au sein de l’apprentissage agricole. Reste queprès de 57% des jeunes relèvent toujours du niveau V en 2001, toutes formations confondues.RepèresCAPABEPABPABTABPBTSATHSourcesCertificat d'aptitude professionnelle agricoleBrevet d'études professionnelles agricolesBrevet professionnel agricoleBrevet de technicien agricoleBrevet professionnelBrevet de technicien supérieur agricoleTitre homologuéLes niveaux de formationNiveau V : CAPA, BEPA et BPA.Niveau IV : Baccalauréat professionnel, BTA, BP.Niveau III : BTSANiveau I : Diplômes d’ingénieurMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.207
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs d’apprentisselon le secteur de formation de niveau VNB :Les travaux paysagers sont classés dans le secteur de la production jusqu’en 1994. Ils sont intégrés au secteur Forêt-Aménagement à partir de 1995.1991 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001Production 7 144 6 742 8 801 6 635 8 365 8 139 7 608 7 071Transformation 20 22 89 178 313 310 286 315Forêt Aménagement 357 426 542 4 887 5 935 6 151 6 426 6 351Métiers du cheval 1 158 1 078 1 337 1 565 1 738 1 648 1 644 1 669Services aux personneset aux entreprisesCommercialisation,technico-commercial, Distribution125 191 297 548247 530 620 603285 255 294 310TOTAL 8 804 8 459 11 066 13 813 16 883 17 033 16 878 16 319Niveau V18 00016 00014 000ProductionTransformationForêt - AménagementMétiers du chevalServices et commercialisation12 00010 0008 0006 0004 0002 00001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001208
Evolution sectorielle des formations par l’apprentissagede niveau V Développement de la production jusqu’en 1999, repli par la suite Progression globale de la transformation Développement de la forêt-aménagement jusqu’en 2000, recul en 2001 Effectifs en baisse pour les métiers du cheval en 1999, reprise ensuite Développement des services et stabilité de la commercialisationDonnées de cadrageEvo. 91/96 Evo. 96/98 Evo. 98/99 Evo 99/00Evo 00/01Niveau V+56,9% +22,2% +0,9% -0,9%-3,3%Sur la période longue, on distingue trois phases dans l’évolution de l’apprentissage de niveau V :baisse des effectifs en 1992 (-3,9%), très fort développement les six années suivantes(+8424 apprentis ; +99,6%), ralentissement en 1999 (+0,9%) qui annonce le repli des annéessuivantes (-0,9% en 2000 et -3,3% en 2001).La modification des nomenclatures au cours du temps rend difficile l’analyse des évolutionssectorielles avant 1996. On peut juste souligner la montée en puissance du secteur de latransformation et la forte croissance du tertiaire.A partir de 1996, les évolutions sectorielles sont les suivantes :Secteur productionCe secteur connaît une progression importante de 1996 à 1998 (+1730 apprentis ; +26,1%). Il est enrecul à partir de 1999 (-2,7%). Ce recul s’accentue les années suivantes : -6,5% en 2000 et -7,1% en2001. Il perd près de 5 points en structure entre 1996 et 2001, à 43% des effectifs de niveau V.Secteur transformationCe secteur continue de se développer entre 1996 et 1998 : 135 apprentis de plus en deux ans (+76%).Il voit, lui aussi, ses effectifs chuter en 1999 (-1%) et 2000 (-7,7%). Mais, il bénéficie d’un regainen 2001 : +29 apprentis, soit +10,1%. Sa place au sein du niveau V progresse un petit peu : 1,3% deseffectifs en 1996, pour 1,9% en 2001.Secteur forêt-aménagementCe secteur connaît un essor important de 1996 à 1998 : près de 1050 apprentis de plus (+21,4%). Parla suite, sa croissance est moins forte mais subsiste jusqu’en 2000 (+3,6% puis +4,5%). Il n’échappetoutefois pas à une baisse d’effectifs en 2001, bien que faible en comparaison des autres secteurs(-1,2%). Sa part dans le niveau V demeure accrue en 2001 par rapport à 1996 : +3,5 points à 38,9%.Secteur métiers du chevalCe secteur se développait encore entre 1996 et 1998 (+11%), mais subissait un recul dès la rentrée1999 (-5,2%). Le répit de l’année 2000 (-0,2%) est à l’inverse suivi par une nouvelle progression deseffectifs en 2001 (+1,5%). Il perd cependant du terrain, en structure, sur la période : -1,1 points à10,2% en 2001.Secteurs services aux personnes, services aux entreprises et commercialisationCes secteurs étaient, eux, globalement en recul de 1996 à 1998 (-2,9%). En 1999, les services sedéveloppent fortement (+115%), tandis que la commercialisation décline (-10,5%). En 2000, lesdeux secteurs connaissent une évolution positive comparable : +17% aux services et +15,3% à lacommercialisation. En 2001, ce sont les services qui sont touchés par le recul général des effectifs(-2,7%) alors que la commercialisation gagne du terrain (+5,4%). De 1998 à 2001, cependant lesservices voient leur place s’accroître (+2,2 pts à 3,7% en 2001). La commercialisation est, elle, stable(+0,2 pt à 1,9%).Les formésRepèresNiveau V : CAPA, BEPA et BPA, auxquels s’ajoutent les certificats despécialisation et les titres homologués de niveau V, dont l’accès estréservé aux titulaires d’un diplôme de niveau V.Voir la constitution des secteurs à partir de la nomenclature duconseil national de l’information statistique (C.N.I.S.) en annexe.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.209
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs d’apprentisselon le secteur de formation de niveau IVNB :Les travaux paysagers sont classés dans le secteur de la production jusqu’en 1994. Ils sont intégrés au secteur Forêt-Aménagement à partir de 1995.1991 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001Production 738 998 2 139 2 811 4 071 4 395 4 394 4 289Transformation 85 88 186 252 346 332 418 416Forêt Aménagement 24 50 89 1 235 1 607 1 811 1 932 2 009Métiers du cheval 17 32 42 72Services aux personneset aux entreprisesCommercialisation,technico-commercial, Distribution152 153 163 316375211 272 265314 344 372TOTAL 999 1 289 2 577 4 614 6 416 7 095 7 402 7 423Niveau IV8 0007 0006 000ProductionTransformationForêt - AménagementMétiers du chevalServices et commercialisation5 0004 0003 0002 0001 00001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001210
Evolution sectorielle des formations par l’apprentissagede niveau IV Fort développement de la production, mais repli en 2001 Croissance globale de la tranformation, malgré des variations ces dernières années Progression continue de la forêt-aménagement Le secteur des métiers du cheval, très minoritaire, est en croissance depuis 1998 Développement global du tertiaire, mais légère baisse des services en 2001Données de cadrageEvo. 91/96 Evo. 96/98 Evo. 98/99 Evo 99/00Evo 00/01Niveau IV+362% +39,1% +10,6% +4,3%+0,3%De même qu’au niveau V, on repère trois phases d’évolution de l’apprentissage de niveau IV :croissance élevée de 1991 à 1992 (+29%), développement encore bien plus important de 1992 à 1998(+100% de 1992 à 1994 ; +79% de 94 à 96 ; +39% de 96 à 98), premier ralentissement en 1999(+10,6%), largement confirmé en 2000 (+4,3%) et 2001 (+0,3%).La modification des nomenclatures ne permet pas une analyse des évolutions sectorielles avant 1996.Comme au niveau V, on repère seulement la montée en puissance du secteur de la transformation etle développement important du tertiaire.A partir de 1996, on souligne les évolutions sectorielles suivantes :Secteur productionCe secteur est le plus dynamique de 1996 à 1998 : +44,8% pour 1260 apprentis de plus. Sa croissanceest ralentie en 1999 (+8%). Parfaitement stable en 2000, il perd 2,4% de ses effectifs en 2001. Il perdainsi 3 points en structure sur la période à 57,8% en 2001.Secteur transformationIl connaît lui aussi un développement important de 1996 à 1998 (+37,3%). Il fléchit quelque peu en1999 (-4% ; -14 apprentis), mais se reprend largement en 2000 (+25,9%). En 2001, ce secteur eststable (-0,5% ; - 2 apprentis). Il est de même stable sur la période longue en structure (+0,1 pt à 5,6%en 2001).Secteur forêt-aménagementCe secteur se développe sur l’ensemble de la période, même si son taux de croissance est plus faibleces dernières années : +30,1% de 1996 à 1998, +12,7% en 1999, +6,7% en 2000 et +4% en 2001. Ilgagne un petit peu de terrain en structure (+0,3 pt à 27,1% en 2001).Secteur métiers du chevalCe secteur rassemble très peu d’apprentis, mais a vu ses effectifs multiplié par 4 entre 1998 et 2001,date à laquelle il est toujours en croissance. Il compte alors pour un peu moins de 1% des effectifsd’apprentis de niveau IV.Secteurs services aux personnes, services aux entreprises et commercialisationEn croissance modérée de 1996 à 1998 (+18,7%) en comparaison des autres secteurs, le tertiairegagne globalement +40% en 1999. En 2000, on repère que la dynamique la plus forte appartient auxservices : +28,9% pour +9,6% à la commercialisation. Mais ces mêmes services déclinent en 2001(-2,6%), alors que la commercialisation continue de progresser (+8,1%). En structure, ces deuxsecteurs évoluent à l’identique entre 1999 et 2001 : +0,6 pt à 3,6% aux services et 5% à lacommercialisation.Les formésRepèresNiveau IV : baccalauréat professionnel, BTA, brevet professionnel,auxquels s’ajoutent les certificats de spécialisation et les titreshomologués de niveau IV, dont l’accès est réservé aux titulaires d’undiplôme de niveau IV.Voir la constitution des secteurs à partir de la nomenclature duconseil national de l’information statistique (C.N.I.S.) en annexe.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.211
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs d’apprentisselon le secteur de formation de niveau IIINB :Les travaux paysagers sont classés dans le secteur de la production jusqu’en 1994. Ils sont intégrés au secteur Forêt-Aménagement à partir de 1995.1991 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001Production 129 192 747 825 1 439 1 520 1 617 1 825Transformation 32 65 139 275 550 630 662 732Forêt Aménagement 0 0 49 743 1 078 1 118 1 200 1 312Métiers du cheval 10 26 16Services aux personneset aux entreprisesCommercialisation,technico-commercial, Distribution169 273 433 651 73418 15 27795 776 851TOTAL 340 556 1 384 2 494 3 801 4 081 4 270 4 747Niveau III5 0004 5004 000ProductionTransformationForêt - AménagementMétiers du chevalServices et commercialisation3 5003 0002 5002 0001 5001 00050001995 1996 1997 1998 1999 2000212
Evolution sectorielle des formations par l’apprentissagede niveau III La production est le secteur qui se développe le plus sur la période longue La transformation connaît, elle aussi, un essor remarquable Si le secteur forêt-aménagement ne cesse de progresser, son évolution positive est un peu moins marquée L’évolution des services et de la commercialisation est plus fluctuante ; ces secteurs sont ceux quiévoluent le moins depuis 1996Données de cadrageEvo. 91/96 Evo. 96/98 Evo. 98/99 Evo 99/00Evo 00/01Niveau III+634% +52,4% +7,4% +4,6%+11,2%L’apprentissage agricole de niveau III connaît une période de très fort développement de 1991 à1998 : +64% entre 1991 et 1992 ; +149% de 1992 à 1994 ; +80% entre 1994 et 1996 ; +52% de 1996à 1998. Comme par ailleurs, un ralentissement important marque les rentrées suivantes : +7,4% en1999, +4,6% en 2000. En 2001, la croissance est remarquable compte tenu des évolutionsenregistrées aux autres niveaux de formation : +11%, avec près de 480 apprentis de plus.Comme aux niveaux V et IV, les modifications de nomenclature rendent invalide toute analyse del’évolution des secteurs production et forêt-aménagement avant 1996. Pour le reste, on note aussi àce niveau la montée en puissance du secteur de la transformation et la forte croissance du tertiaire.A partir de 1996, les évolutions sectorielles sont les suivantes :Secteur productionCe secteur est parmi les plus dynamiques entre 1996 et 1998 (+74,4%), gagnant plus de 610apprentis. En 1999, son évolution positive s’avère inférieure à celle de l’ensemble du niveau III(+5,6%). Mais ce secteur se reprend en 2000 (+6,4%) et surtout 2001 : +12,9% avec près de 210apprentis de plus. Ce secteur est celui qui gagne le plus de terrain dans la structure du niveau III de1996 à 2001 : +5,3 points à 38,4%.Secteur transformationIl double ses effectifs entre 1996 et 1998. Son évolution est ensuite plus modérée : +14,5% en 1999,+5,1% en 2000, ce qui reste toutefois supérieur à l’évolution globale du niveau III. En 2001, seseffectifs croissent de +10,6%, soit un taux situé juste en dessous de celui de l’ensemble du niveau.Sur la période longue, ce secteur est parmi les plus dynamiques : il gagne +4,4 points dans lastructure du niveau III, à 15,4% en 2001.Secteur forêt-aménagementLa progression de ce secteur est relativement forte entre 1996 et 1998, bien qu’inférieure à celle del’ensemble du niveau III : +45,1%. En 1999, son dynamisme faiblit quelque peu (+3,7%). Mais sacroissance est la plus élevée en 2000 (+7,3%). Elle demeure relativement importante en 2001, bienqu’inférieur à celle, globale, du niveau III : +9,3%. Cependant, compte tenu de la progression dessecteurs production et transformation sur la période longue, la forêt-aménagement voit sa place seréduire : -2,2 points, à quand même 27,6% en 2001.Secteurs services aux personnes, services aux entreprises et commercialisationL’évolution de ces secteurs est plus modérée entre 1996 et 1998 : +12,7% pour l’ensemble dutertiaire. En 1999, au contraire, ces formations voient leurs effectifs croître, en relatif, davantagequ’en moyenne (+10,8%). A cette date, les services et la commercialisation font l’objet d’unedissociation au sein de la nomenclature. Les services touchent une population très limitée : 18apprentis à cette date. Ils accusent un recul l’année suivante, peu significatif. La commercialisationperd elle aussi quelques apprentis (-2,4%). En 2001, ce secteur progresse sensiblement (+9,7%),quand les services accueillent 12 apprentis supplémentaires (+80%). Il perd toutefois du terrain entre1999 et 2001 (-1,6 pts à 17,9%), pour un secteur des services relativement stable.Les formésRepèresNiveau III : BTSA auquel s’ajoutent les formations débouchant sur uncertificat de spécialisation ou un titre homologué dont l’accès estréservé aux titulaires d’un diplôme de niveau III.Voir la constitution des secteurs à partir de la nomenclature duconseil national de l’information statistique (C.N.I.S.) en annexe.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.213
L’évolution des effectifs de formésEvolution des effectifs de stagiaires et des heures stagiaires de la formation continueToutes formationsStagiaires 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Centres publics 54 576 64 220 69 115 71 197 73 313 77 537 74 943 71 866Centres privés 50 171 53 944 58 300 62 911 57 680 54 722 60 915 59 281Ensemble 104747 118164 127415 134 108 130 993 132 259 135 858 131 147HS en millions 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Centres publics 12,4 16,2 15,5 15,3 15,0 14,8 14,2 12,7Centres privés 10,4 11,5 10,5 10,8 10,4 9,3 8,2 7,6Ensemble 22,8 27,7 26,0 26,1 25,4 24,1 22,4 20,3Evolution des heures stagiaires par niveau de formationDiplômes et certificats de spécialisation7 234 919Centres publicsNiveau VNiveau IVNiveau III5 325 497Centres privés4 088 0254 081 6133 703 4603 652 1712 107 9591 356 0531 595 2371 549 1761 818 4851 424 4371 747 4171 444 879779 0391 429 8011 278 088826 5351990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Evolution de la répartition des heures stagiaires par type de formationCentrespublicsRépartitionpar type de formationDiplômeset CSAutresformationsRépartition des diplômeset CS par niveauV IV III II et I1990 88,5 11,5 66,0 19,2 12,4 2,41995 72,5 27,5 51,8 33,3 13,6 1,31996 72,4 27,6 50,0 34,5 14,1 1,41997 71,5 28,5 47,3 37,0 14,2 1,51998 71,0 29,0 46,1 38,0 14,7 1,21999 70,1 29,9 43,7 39,3 15,6 1,42000 70,1 29,9 41,1 41,1 16,1 1,72001 71,4 28,6 40,8 40,3 17,1 1,8CentresprivésRépartitionpar type de formationDiplômeset CSAutresformationsRépartition des diplômeset CS par niveauV IV III II et I1990 83,7 16,3 61,3 20,9 16,4 1,41995 53,9 46,1 47,1 28,0 24,6 0,21996 52,7 47,3 48,3 31,2 19,3 1,31997 54,8 45,2 48,1 31,2 19,6 1,11998 52,1 47,9 45,2 32,4 20,7 1,71999 52,1 47,9 44,8 33,7 19,5 2,02000 49,4 50,6 43,0 35,5 19,2 2,42001 48,3 51,7 38,9 34,8 22,5 3,8Evolution des heures stagiaires par type de diplômeTous statuts6 941 131214BPABTABacBP4BTS3 910 9263 579 4023 061 2191 844 9632 653 5351 875 4991 870 8501 640 094943 9221 555 348273 414785 261276 698169 6271990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Evolution structurelle de la formation continue Croissance continue des effectifs de stagiaires dans les centres publics jusqu’en 1999 ; recul par la suite Effectifs des centres privés davantage sujets à des fluctuations ; le solde des évolutions depuis 1995, positifpour les deux statuts, est davantage favorable au public Progression du volume d’activité des centres, surtout publics, sur la période 1990-1995 ; Chute globale parla suite, le bilan étant plus lourd pour le privé La part du niveau V se réduit au profit des autres niveaux, notamment le niveau IVLes effectifs de stagiaires des centres publics connaissaient une croissance globale de +17,7% de1990 à 1995 (+9644 stagiaires). Dans le même temps, les effectifs des centres privés étaient sujets àun certain nombre de fluctuations, se soldant par un gain de +7,5% (+3773 stagiaires). Les effectifsdu public continuent de se développer jusqu’en 1999, de manière un peu plus marquée en 1996(+7,6%) et 1999 (+5,8%) que dans les années intermédiaires (+3%). Au total, sur cette période 1995-1999, les centres publics voient le nombre de leurs stagiaires augmenter de +20,7%, soit 13317stagiaires de plus. Du côté des centres privés, sur cette même période, on note une progression endébut de période (+8,1% en 1996 et +7,9% en 1997), mais les effectifs diminuent ensuite (-8,3% en1998 et -5,1% en 1999). Ainsi, le nombre de stagiaires du privé évolue-t-il peu de 1995 à 1999 :+1,4%, pour 778 stagiaires supplémentaires. En 2000 et 2001, on assiste à une inversion de tendancedans le public. Celui-ci perd successivement 2594 et 3077 stagiaires (-3,4% puis -4,1%). Dans leprivé, au contraire, les effectifs sont en forte augmentation en 2000 (+6193 stagiaires ; +11,3%).Mais ils cèdent à nouveau en 2001, bien que de façon moins importante que dans le public : -2,7%(-1634 stagiaires). Au total, le bilan 1995-2001 se révèle un peu plus positif pour le public (+11,9% ;+7646 stagiaires) que pour le privé (+9,9% ; +5337 stagiaires).Pour ce qui est des heures stagiaires, si malgré des fluctuations le volume d’activité des centres estglobalement en progression de 1990 à 1995 pour les centres privés (+10%) et plus encore pour lescentres publics (+31%), les évolutions ultérieures sont négatives. Pour les centres publics, le reculest particulièrement fort en 1996 (-4,2%), 2000 (-4,2%) et 2001 (-10,3%). Mais les pertes du publicsont relativement moins importantes que celles du privé pour la plupart des années considérées :l’activité de ce dernier est en baisse de -7,6% en 1996, -10,1% en 1999 (-1,7% au public) et -11,5%en 2000. Deux années font exception dans cette tendance générale : 1997 où le privé profite d’uneactivité accrue (+1,7% pour -1,4% au public) et 2001 où le recul de ses heures stagiaires est moinsmarquée que dans le public (-7,7%). La réduction des heures stagiaires sur la période 1995-2001reste ainsi un peu plus préoccupante dans le privé (-33,7%) que dans le public (-21,7%).Sur la période longue 1990-2001, la chute du volume d’heures stagiaires réalisées dans le cadre desformations diplômantes et des certificats de spécialisation (-17% dans le public et -58% dans leprivé) s’accompagne d’une croissance de l’activité dans les autres formations (+156% et +131%respectivement). Cependant, compte tenu de la baisse d’activité qui touche aussi les autresformations entre 1995 et 2001, en particulier ces dernières années, le bilan 1995-2001 est négatifpour les formations diplômantes (-23% au public et -41% au privé), mais aussi pour les autresformations (-19% au public et -26% au privé). En structure, l’avantage reste à ces dernières quigagnent quelques points sur la période.Les formésAu sein des formations diplômantes, on note la réduction progressive de la part du niveau V (-25 ptsdans le public et -22 pts dans le privé de 1990 à 2001) au profit des autres niveaux, en particulier duniveau IV, qui est cependant en retrait en structure en 2001. C’est essentiellement le BPA qui estl’objet de ce mouvement, en raison de l’exigence d’un niveau IV pour les installations aidées.RepèresCSHSBPABTABP4BTSCertificat de spécialisationHeures stagiairesBrevet professionnel agricole (niveau V)Brevet de technicien agricoleBrevet professionnel (niveau IV)Brevet de technicien supérieurAutres formationsLes «autres formations» comprennent les titres homologués et lesformations non diplômantes.Les niveaux de formationNiveau V : BPA, CAPA, BEPA, CAP, BEP et certificats de spécialisationouverts aux titulaires d’un diplôme de niveau V.Niveau IV : baccalauréat professionnel, baccalauréat technologique,BTA, BP et certificats de spécialisation ouverts aux titulaires d’undiplôme de niveau IV.Niveau III : BTSA et certificats de spécialisation ouverts aux titulairesd’un diplôme de niveau III.Niveaux II et I : formations supérieures de niveau supérieur à Bac+2(diplômes d'ingénieur).SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.215
L’évolution des effectifs de formésEvolution des heures stagiaires de la formation continue de niveau Vpar secteur de formation et statut d’enseignementPublic7 000 0006 000 000ProductionTransformationForêt AménagementActivités hippiquesServicesCommercialisationAutres5 000 0004 000 0003 000 0002 000 0001 000 00001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Secteurs de formation 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 2 903 586 2 754 499 2 641 174 2 548 929 2 250 003 1 957 349 1 591 957Transformation 540 363 437 203 354 287 363 610 323 374 310 381 216 627Forêt Aménagement 2 135 313 1 979 399 1 792 604 1 657 667 1 573 709 1 487 441 1 517 748Activités hippiques 70 489 91 358 72 849 58 486 57 718 44 247 28 541Services 93 976 86 231 45 637 53 003 52 357 52 307 103 118Commercialisation 60 003 46 672 42 273 37 625 51 520 48 630 38 123Autres 284 460 232 224 230 475 205 864 220 551 187 670 207 346Ensemble 6 088 190 5 627 586 5 179 299 4 925 184 4 529 232 4 088 025 3 703 460Privé7 000 000ProductionTransformationForêt AménagementActivités hippiquesServicesCommercialisationAutres6 000 0005 000 0004 000 0003 000 0002 000 0001 000 00001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001216Secteurs de formation 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 1 128 737 1 059 085 1 123 271 1 038 202 802 997 676 760 574 381Transformation 53 780 67 674 85 941 78 410 80 352 80 505 29 080Forêt Aménagement 761 933 754 279 666 508 664 017 727 691 518 258 394 087Activités hippiques 82 295 67 481 103 111 89 079 76 603 47 330 65 320Services 118 341 102 617 95 574 85 009 108 213 116 732 116 609Commercialisation 40 867 67 148 33 472 67 861 70 822 147 319 124 941Autres 727 946 576 231 731 574 414 770 305 783 160 513 125 383Ensemble 2 913 899 2 694 515 2 839 451 2 437 348 2 172 461 1 747 417 1 429 801
Evolution sectorielle de la formation continuede niveau VDans un contexte de baisse générale des heures stagiaires de niveau V de 1995 à 2001 : Progression de la part de la forêt-aménagement et des services dans le public ; baisse de la part de laproduction et de la transformation sur la période Progression de la part de la commercialisation, des services et des activités hippiques, de la production etde la forêt-aménagement dans le privéDonnées de cadrageNiveau VEvo. 1995/2001Public-39,2%Privé-50,9%Secteur productionDans les centres publics, les heures stagiaires réalisées dans ce secteur ne cessent de diminuer depuis1995, de manière encore plus appuyée ces dernières années. Elles chutent ainsi de -45,2% entre 1995et 2001. Dans le privé, la réduction des HS est encore plus marquée de 1997 à 2000. Le bilan est de-49,1% sur la période longue considérée. Sur cette même période, ce secteur perd près de 5 pointsen structure (à 43% en 2001) dans le public et progresse dans le privé (+1,4 pts à 40,2%).Secteur transformationExcepté en 1998, ce secteur voit aussi ces HS se réduire dans les centres publics. Le recul estparticulièrement fort en début de période, mais aussi et surtout en 2001. De 1995 à 2001, les HS ontrégressé de -59,9%. Dans le privé, après de fortes croissances en 1996 et 1997, les HS faiblissent en1998, se reprennent quelque peu en 1999, se stabilisent en 2000, pour finir par chuter très fortementen 2001. Elles se réduisent de -45,9% sur la période. Ce secteur perd 3 points en structure dans lepublic (à 5,8% en 2001). Il retrouve une place équivalente à 1995 (+0,2 pt à 2%) dans le privé, aprèsavoir progressé de près de 3 points entre 1995 et 2000.Secteur forêt-aménagementEn recul de 1995 à 2000, ce secteur se reprend quelque peu en 2001 dans le public. Ses HS accusentsur la période 1995-2001 une baisse qui reste inférieure à celle de l’ensemble du niveau V : -28,9%.C’est de même le cas dans le privé, malgré une contraction importante des HS en 2000 et 2001. Lesolde est de -48,3% sur la période. La part de ce secteur dans l’activité des centres au niveau Vprogresse donc : +5,9 pts à 41% en 2001 pour le public et +1,4 pts à 27,6% dans le privé.Secteur activités hippiquesL’activité des centres publics dans ce secteur s’est très fortement réduite à partir de 1997. Cephénomène est encore plus marqué en 2001. Au total, les HS ont chuté de -59,5% sur la période1995-2001. Dans le privé, les progressions importantes enregistrées en 1997 et 2001 réduisent lespertes subies les autres années : le recul sur la période est inférieur à la moyenne (-20,6%). La partfaible de ce secteur s’est un peu réduite dans le public (-0,4 pt à 0,8%) entre 1995 et 2001, alorsqu’elle gagne 1,7 points (à 4,6%) dans le privé.Secteur servicesCe secteur, à la faveur de mouvements positifs en 1998 et 2001, est le seul à voir ses HS progresserentre 1995 et 2001 dans le public : +9,7%. Dans le privé, ces évolutions positives, intervenant en1999 et 2000, limitent fortement le recul global : -1,5% sur la période. La part de ce secteur gagne1,2 points (à 2,8% en 2001) dans le public et double dans le privé (+4,1 pts à 8,2%).Secteur commercialisationCe secteur n’échappe pas au repli de ses HS dans le public, ne progressant sur la période 1995-2001qu’en 1999. Il perd ainsi 36,5% de ses HS. Dans le privé, à l’opposé, malgré des fléchissements en1997 et 2001, ce secteur montre des HS en progression de +206% sur la période. La part de ce secteurest faible et stable dans le public (1%). Elle gagne +7,3 points (à 8,7% en 2001) dans le privé.Secteur autresLes HS consacrées à ces formations régressent de -27,1% sur la période dans le public et de -82,8%dans le privé. Leur part s’accroît un peu dans le premier statut (+0,9 pt à 5,6%) et se réduit trèsfortement dans le privé (-16,2 pts à 8,8%).Les formésRepèresLe secteur AutresHSCertificats de spécialisation d’initiative locale (CSIL), formations diplômantes générales ou non spécifiées.Heures stagiairesSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.217
L’évolution des effectifs de formésEvolution des heures stagiaires de la formation continue de niveau IVpar secteur de formation et statut d’enseignementPublic4 500 0004 000 0003 500 000ProductionTransformationForêt AménagementServicesCommercialisationAutres3 000 0002 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 00001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Secteurs de formation 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 2 933 925 2 934 961 3 026 047 3 072 233 2 968 808 2 944 076 2 657 630Transformation 176 678 189 880 161 384 155 386 173 932 199 820 166 920Forêt Aménagement 418 259 427 327 461 921 467 476 503 616 463 425 456 822Activités hippiquesServices 19 720 29 992 31 321 58 759 54 130 55 815 25 680Commercialisation 159 661 85 865 112 041 78 208 108 717 140 896 108 355Autres 200 230 212 543 254 676 225 266 269 462 277 581 236 764Ensemble 3 908 473 3 880 568 4 047 390 4 057 328 4 078 665 4 081 613 3 652 171Privé4 500 0004 000 0003 500 000ProductionTransformationForêt AménagementServicesCommercialisationAutres3 000 0002 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 00001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001218Secteurs de formation 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 1 184 133 1 217 503 1 368 995 1 270 698 1 121 906 998 881 926 105Transformation 25 600 59 504 26 232 56 653 41 294 42 989 34 124Forêt Aménagement 80 634 51 499 33 158 25 144 66 448 35 953 33 400Activités hippiquesServices 49 562 25 558 34 013 7 727 30 009 10 451 9 244Commercialisation 178 261 191 207 188 098 196 177 232 811 216 311 149 450Autres 214 267 194 044 195 202 192 915 141 244 140 294 125 765Ensemble 1 732 457 1 739 315 1 845 698 1 749 314 1 633 712 1 444 879 1 278 088
Evolution sectorielle de la formation continuede niveau IVDans un contexte de baisse générale des heures stagiaires de niveau IV de 1995 à 2001 : Progression de la part du secteur forêt-aménagement et des « autres » formations dans le public ; relativestabilité de la transformation et des services sur la période Progression de la part de la production, de la transformation et de la commercialisation dans le privé ; reculdes autres secteursDonnées de cadrageNiveau IVEvo. 1995/2001Public-6,6%Privé-26,2%Secteur productionAprès une période de croissance, les heures stagiaires réalisées dans ce secteur par les centres publicssont en régression depuis 1999. Sur la période 1995-2001, elles diminuent davantage qu’enmoyenne : -9,4%. Dans le privé, elles étaient en baisse dès 1998. Mais, si le recul est important, ilest inférieur à celui de l’ensemble du niveau IV : -21,8%. Ainsi en structure, ce secteur est-il en replidans le public (-2,3 pts à 72,8% des HS réalisées en 2001), alors qu’il se développe dans le privé(+4,1 pts à 72,5%).Secteur transformationAlternant réduction (1997, 1998, 2001) et développement de ses HS sur la période, ce secteur montreune évolution globalement négative, mais limitée dans le public : -5,5%. Dans le privé, les fortescroissances des HS des années 1996, 1998 et la progression plus modeste de 2000 mènent à un bilantrès positif sur la période considérée : +33,3%. Ce secteur est relativement stable dans la structure duniveau IV du public (+0,1 pt à 4,6%) et progresse dans le privé (+1,2 pts à 2,7%).Secteur forêt-aménagementCe secteur s’est développé dans le public jusqu’en 1999. Le solde de l’évolution de ses HS sur lapériode 1995-2001 est positif : +9,2%. Dans le privé, il subit des baisses importantes de ses heuresstagiaires sur toute la période, mis à part en 1999 où, au contraire, celles-ci se développent trèsfortement. Il perd par conséquent 58,6% de ses HS sur la période. En structure, ce secteur progressedonc dans le public (+1,8 pts à 12,5%), alors qu’il est en recul dans le privé (-2 pts à 2,6%).Secteur servicesCe secteur s’est fortement développé dans le public sur la période 1995-2001, même s’il subit unebaisse importante en 2001. Ses HS croissent ainsi de +30,2%. Dans le privé, la croissance très forteobservée en 1999 ne suffit pas à inverser une tendance négative : -81,3% sur la période. Ce secteur,dont la place est infime dans les deux statuts (0,7% des HS), retrouve un niveau comparable à 1995dans le public (+0,2 pt) ; il est en repli dans le privé (-2,1 pts).Secteur commercialisationLes HS de ce secteur ne cessent tour à tour de croître puis de décroître ; le bilan sur la période 1995-2001 est négatif dans les deux statuts : -32,1% dans le public et -16,2% dans le privé. Sa part dansle niveau IV est cependant en croissance dans le privé (+1,4 pts à 11,7% en 2001), alors qu’ellediminue dans le public (-1,1 pts à 3%).Secteur autresCe secteur est globalement en croissance sur la période dans le public (+18,2% et +1,4 pts enstructure à 6,5% en 2001) ; on observe l’opposé dans le privé (-41,3% et -2,5 pts en struture à 9,8%).Les formésRepèresVoir la constitution des secteurs à partir de la nomenclature duconseil national de l’information statistique (C.N.I.S.) en annexe.Niveau IV : baccalauréats professionnels et technologiques, BTA, BPet certificats de spécialisation.Le secteur AutresCertificats de spécialisation d’initiative locale (CSIL), formationsdiplômantes générales (bac) ou non spécifiées.HS : heures stagiairesSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.219
L’évolution des effectifs de formésEvolution des heures stagiaires de la formation continue de niveau IIIpar secteur de formation et statut d’enseignementPublic1 800 0001 600 0001 400 000ProductionTransformationForêt AménagementServicesCommercialisationAutres1 200 0001 000 000800 000600 000400 000200 00001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Secteurs de formation 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 571 749 535 634 545 514 589 789 596 211 567 992 589 021Transformation 292 380 288 553 276 286 224 639 235 648 182 652 204 694Forêt Aménagement 229 037 232 901 273 791 265 551 273 503 352 843 345 251Activités hippiquesServices 104 211 109 631 108 289 94 130 95 449 77 674 74 294Commercialisation 374 031 322 081 251 575 261 480 226 706 224 130 181 276Autres 27 060 95 153 102 906 133 465 187 869 189 946 154 640Ensemble 1 598 468 1 583 953 1 558 361 1 569 054 1 615 386 1 595 237 1 549 176Privé1 800 0001 600 000ProductionTransformationForêt AménagementServicesCommercialisationAutres1 400 0001 200 0001 000 000800 000600 000400 000200 00001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001220Secteurs de formation 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Production 662 812 409 188 449 318 398 073 335 645 304 290 325 426Transformation 81 617 71 435 87 536 72 062 74 672 75 033 73 943Forêt Aménagement 208 609 163 873 191 238 152 071 126 801 104 960 100 016Activités hippiquesServices 104 063 80 287 57 650 58 498 50 259 38 520 29 018Commercialisation 259 001 180 191 144 709 128 949 135 368 143 067 152 616Autres 207 139 172 050 225 632 307 355 225 667 113 169 145 516Ensemble 1 523 241 1 077 024 1 156 083 1 117 008 948 412 779 039 826 535
Evolution sectorielle de la formation continuede niveau IIIDans un contexte de baisse générale des heures stagiaires de niveau III de 1995 à 2001 : Progression de la part des secteurs production, forêt-aménagement et des « autres » formations dans lepublic sur la période Progression de la transformation, des « autres » formations et de la commercialisation dans le privéDonnées de cadrageNiveau IIIEvo. 1995/2001Public-3,1%Privé-45,7%Secteur productionMis à part en 1996 et 2000, ce secteur évolue positivement sur la période 1995-2001 dans les centrespublics. Ses heures stagiaires progressent ainsi de +3% dans le temps long. En revanche, il subit desdécrues nombreuses dans le privé, que sont loin de compenser les mouvements positifs des années1997 et 2001. Au total, ce secteur accuse une régression de -50,9% de ses HS sur la période 1995-2001. Il perd ainsi, dans le même temps, du terrain dans ce statut en structure (-4,1 pts à 39,4% en2001), alors qu’il progresse dans le public (+2,3 pts à 38%).Secteur transformationCe secteur a montré dans le public quelques signes d’évolution positive en 1999 et 2001, mais ladécroissance des HS les autres années l’emporte in fine dans le bilan 1995-2001 : -30%. Il en est unpeu de même dans le privé, mais, le recul de la période 1995-2001, qui s’élèvent à -9,4%, y est bieninférieur à l’évolution de l’ensemble du niveau III privé. La part de ce secteur décline donc sur lapériode dans le public (-5,1 pts à 13,2% en 2001), quand elle s’accroît dans le privé (+3,6 pts à 8,9%).Secteur forêt-aménagementCe secteur faiblit quelque peu en 1998 et 2001 dans le public, mais les évolutions positives des autresannées se révèlent bien plus fortes : les HS de ce secteur augmentent de +50,7% entre 1995 et 2001.A l’inverse dans le privé, ce secteur est en recul sur la période, excepté en 1997 ; ses HS se réduisentde -52,1%. En structure, la forêt-aménagement est parmi les secteurs les plus dynamiques dans lepublic (+8 pts à 22,3% en 2001). Il perd du terrain dans le privé : -1,6 pts à 12,1%.Secteur servicesA quelques exceptions près, ce secteur montre des HS en forte régression dans les deux statuts sur lapériode 1995-2001, qui se soldent par les évolutions suivantes : -28,7% dans le public et -72,1% dansle privé. Peu développé, il perd respectivement -1,7 points (à 4,8% en 2001) et -3,3 points (à 3,5%)dans le public et le privé.Secteur commercialisationMis à part en 1998, les HS de ce secteur ne cessent de se réduire dans les centres publics entre 1995et 2001 : -51,5% sur la période. Dans le privé, après de fortes diminutions des HS en début depériode, le secteur évolue positivement à compter de 1999. Mais ceci est insuffisant pour mener à unsolde positif : -41,1% entre 1995 et 2001. Ce secteur est le plus touché, en termes de part dans leniveau III, dans le public : -11,7 points à 11,7%. Dans le privé, compte tenu de l’évolution des autressecteurs, il parvient à progresser : +1,5 pts à 18,5%.Secteur autresLes HS consacrées à ces formations ne régressent dans le public qu’en 2001. Le solde sur la période1995-2001 est très largement positif : +472%. Dans le privé, où les HS sont très fluctuantes sur lapériode, le mouvement négatif l’emporte, mais reste inférieur à la moyenne : -29,7%. Ce secteurprogresse donc en structure dans les deux statuts : +8,3 points (à 10% en 2001) dans le public et+4 points (à 17,6%) dans le privé.Les formésRepèresNiveau III : BTSA et certificats de spécialisation.HS : Heures stagiairesLe secteur AutresCertificats de spécialisation d’initiative locale (CSIL), formationsdiplômantes générales ou non spécifiées.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.221
Les origines ou catégories socioprofessionnelles des formésEvolution de la répartition des effectifs de formation initiale scolaireselon l’origine socioprofessionnelle des élèvesNiveaux VI à III - Tous statuts d’enseignement confondusEffectifs1990 1998 2000 2001Evo. 90-01Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % (en points)Agriculteur exploitant 45 452 34,3% 33 857 19,1% 32 848 18,7% 31 503 18,2% -16,1Artisan, commerçant 10 631 8,0% 14 850 8,4% 14 179 8,1% 13 678 7,9% -0,1Cadre, profession intellec. 7 693 5,8% 13 143 7,4% 12 403 7,1% 12 177 7,0% +1,2Profession intermédiaire 10 220 7,7% 18 748 10,6% 18 284 10,4% 18 115 10,5% +2,8Employé 20 663 15,6% 40 159 22,7% 41 730 23,8% 42 189 24,4% +8,8Salarié agricole 2 501 1,9% 3 121 1,8% 3 038 1,7% 3 123 1,8% -0,1Ouvrier non agricole 20 773 15,7% 32 370 18,3% 32 245 18,4% 31 550 18,2% +2,5Retraité 3 542 2,7% 3 555 2,0% 3 403 1,9% 3 301 1,9% -0,8Inactif 6 293 4,8% 9 375 5,3% 10 426 5,9% 10 647 6,2% +1,4Inconnu ou autre 4 641 3,5% 8 116 4,6% 6 770 3,9% 6 708 3,9% +0,4Ensemble 132 409 100% 177 294 100% 175 326 100% 172 991 100%Les origines socioprofessionnelles des élèvesselon le statut d’enseignement en 2001- <strong>2002</strong>Niveaux VI, Vbis, V, IV et III de formation confondusPublicLes origines socioprofessionnelles des élèvesselon le niveau de formation en 2001 - <strong>2002</strong>Tous statuts d’enseignement confondusNiveaux VI, Vbis et VAgriculteur exploitant21,9%Agriculteur exploitant13,9%Artisan, commerçant7,2%Artisan, commerçant7,9%Cadre, profession intellec.9,1%Cadre, profession intellec.4,3%Profession intermédiaire12,7%Profession intermédiaire8,0%EmployéSalarié agricole1,5%23,4%EmployéSalarié agricole2,2%26,4%Ouvrier non agricole14,4%Ouvrier non agricole22,1%Retraité1,8%Retraité1,8%Inactif5,1%Inactif8,3%Inconnu ou autre2,8%Inconnu ou autre5,1%Privé TPNiveau IVAgriculteur exploitant16,9%Agriculteur exploitant22,2%Artisan, commerçant8,6%Artisan, commerçant8,0%Cadre, profession intellec.6,7%Cadre, profession intellec.9,2%Profession intermédiaireEmployé10,7%21,7%Profession intermédiaireEmployé12,6%23,2%Salarié agricole1,5%Salarié agricole1,4%Ouvrier non agricole22,3%Ouvrier non agricole15,1%RetraitéInactifInconnu ou autre2,0%5,5%4,1%RetraitéInactifInconnu ou autre1,8%3,9%2,6%Privé RANiveau IIIAgriculteur exploitantArtisan, commerçant14,5%8,1%Agriculteur exploitantArtisan, commerçant7,8%25,9%Cadre, profession intellec.4,5%Cadre, profession intellec.12,9%Profession intermédiaire7,1%Profession intermédiaire15,3%Employé28,7%Employé19,2%Salarié agricole2,5%Salarié agricole1,0%Ouvrier non agricole19,2%Ouvrier non agricole10,1%Retraité1,9%Retraité2,8%Inactif8,3%Inactif2,9%222Inconnu ou autre5,2%Inconnu ou autre2,1%
Les élèves de la formation initiale scolaire La diversification des origines socioprofessionnelles des élèves de l’enseignement agricole, en particulierau détriment des enfants d’agriculteurs se poursuit Les enfants d’employés sont dominants et leur place progresse encore en 2001 Les enfants d’agriculteurs sont particulièrement présents dans le public ; les enfants d’ouvriers dans leprivé à temps plein et les enfants d’employés dans le privé à rythme approprié Plus le niveau de formation considéré est élevé, plus la représentation des élèves dont les parents sontagriculteurs, cadres ou exercent une profession intermédiaire est forteCes dix dernières années, la structure de la population des élèves de la formation initiale scolaireagricole s’est profondément modifiée, dans le sens d’une diversification des originessocioprofessionnelles.Les enfants d’agriculteurs, qui représentaient plus d’un tiers (34,3%) des élèves de l’enseignementagricole en 1990, ne constituent plus, en 2001, que 18,2% des apprenants. Dans le même temps, lesenfants de salariés agricoles gardent une place constante (1,8%). Mais, si l’origine traditionnellementagricole des élèves de l’enseignement agricole caractérise moins qu’auparavant les populations à lacharge des établissements du MAAPAR, elle reste quoi qu’il en soit largement sur-représentée encomparaison de son poids dans la population active française (2,4% d’agriculteurs selon l’INSEE).Ce sont aujourd’hui les enfants d’employés qui constituent la population dominante parmi les élèvesde l’enseignement agricole. Ils comptent pour plus de 24% des élèves. La part de cette populations’est fortement accrue depuis 1990 : +8,8 points. Elle présente d’ailleurs encore la progression la plussignificative en 2001.Viennent, au deuxième rang, au même niveau que les enfants d’agriculteurs, les enfants d’ouvriersnon agricoles (18,2% ; +2,5 points depuis 1990). Les professions intermédiaires se placent, elles, auquatrième rang en termes de population scolaire par origine socioprofessionnelle (10,5% des élèves ;+2,8 pts). Les enfants d’artisans et de commerçants et les enfants de cadres sont représentés demanière sensiblement identique (respectivement 7,9% et 7,0% de la population scolaire agricole).On note bien sûr des différenciations selon le statut d’enseignement considéré : davantage d’élèves dont les parents sont agriculteurs (21,9%), cadres (9,1%) ouexercent une profession intermédiaire (12,7%) dans le public ; davantage d’élèves dont les parents sont employés (respectivement 21,7% et 28,7%)ou ouvriers (respectivement 22,3% et 19,2%) dans le privé à temps plein et le privé àrythme approprié.Les formésOn observe de plus que dans chacun des statuts privés, c’est la part des enfants d’agriculteurs — etdes enfants de salariés non agricoles pour le privé à rythme approprié — qui se réduit le plus entre2000 et 2001.On notera enfin que l’élévation du niveau de formation considéré coïncide avec une présencerenforcée des élèves dont les parents sont agriculteurs, cadres ou exercent une professionintermédiaire, au détriment des enfants d’employés et d’ouvriers. Ceci est vérifié pour chacune desfamilles de l’enseignement agricole.RepèresLes niveaux de formationNiveaux VI et Vbis :Niveau V :Niveau IV :Niveau III :Classes de quatrième et de troisième, CPA et CLIPACAPA et BEPASeconde générale et technologique, baccalauréats professionnel, technologique, scientifique, BTABTSA, classes préparatoiresSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.223
Les origines ou catégories socioprofessionnelles des formésRépartition des effectifs des écoles supérieuresselon l’origine socioprofessionnelle des étudiants en 2001 - <strong>2002</strong>Formations initiales de baseE N S AE N I TEcolesd'applic.Centres3ème cycleE N VPublicEcolesF E S I AAutresprivéesPrivéEnsembleAgriculteurexploitantArtisan,commerçantCadre,prof. intellec.ProfessionintermédiaireEff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. %76 5% 204 10% 19 9% 4 18% 66 3% 369 6% 672 28% 144 22% 816 26% 1185 13,3%98 6% 111 6% 9 4% 3 14% 171 9% 392 7% 163 7% 56 8% 219 7% 611 6,9%1011 61% 758 39% 96 48% 6 27% 1200 60% 3071 53% 1007 41% 313 47% 1320 43% 4391 49,2%212 13% 388 20% 40 20% 1 5% 246 12% 887 15% 199 8% 74 11% 273 9% 1160 13,0%Employé 89 5% 229 12% 8 4% 5 23% 147 7% 478 8% 171 7% 23 3% 194 6% 672 7,5%SalariéagricoleOuvriernon agricole11 1% 18 1% 4 0% 33 1% 5 0% 2 0% 7 0% 40 0,4%39 2% 85 4% 4 2% 48 2% 176 3% 40 2% 16 2% 56 2% 232 2,6%Retraité 77 5% 109 6% 19 9% 3 14% 83 4% 291 5% 56 2% 17 3% 73 2% 364 4,1%Inactif 21 1% 25 1% 1 0% 16 1% 63 1% 14 1% 10 2% 24 1% 87 1,0%Autre 23 1% 18 1% 6 3% 7 0% 54 1% 115 5% 8 1% 123 4% 177 2,0%Ensemble 1657 100% 1945 100% 202 100% 22 100% 1988 100% 5814 100% 2442 100% 663 100% 3105 100% 8919 100%Ecoles répondantesENSA : INA P-G, ENSAM, ENSAR, ENSIA (1ère année ENSIA + 1 ère et 2 ème année ENSIA SIARC) et INH (ENSHAP).ENIT : ENITAB, ENITACF, ENESAD (FI), ENITIAA, ENGEES, ENGREF (FIF), INSFA et INH (ENIHP).Ecoles d'application : ENESAD (IA) et ENGREF (1 ère année).Centres de troisième cycle : IESIEL et ISPA.ENV : ENVA, ENVL, ENVN (1ère année) et ENVT.Ecoles de la FESIA : ESA, ESAP, ISAB, ISAB (AGRO SANTE), ISAL (1 ère année) et ISARA.Autres écoles privées : ESITPA et ESB.Origines socioprofessionnelles des étudiantsselon le statut d’enseignement en 1998 et 2001Formations initiales de baseEcoles publiquesEcoles privéesAgriculteurexploitant6,3%6,1%Agriculteurexploitant26,3%26,9%Artisan,commerçant6,7%8,9%Artisan,commerçant7,1%10,3%Cadre,prof. intellec.52,8%46,2%Cadre,prof. intellec.42,5%39,1%Professionintermédiaire15,3%17,6%Professionintermédiaire8,8%11,8%Employé8,2%9,7%Employé6,2%4,3%Salariéagricole0,6%0,1%Salariéagricole0,2%0,2%Ouvriernon agricoleRetraité3,0%3,0%5,0%5,5%20011998Ouvriernon agricoleRetraité1,8%2,1%2,4%2,8%20011998224InactifAutre1,1%1,3%0,9%1,7%InactifAutre0,8%1,3%4,0%1,2%
Les étudiants en formation initiale Prédominance des étudiants dont les parents sont cadres ou exercent une profession intellectuelle dans lesécoles agronomiques et vétérinaires Les enfants d’ouvriers sont très largement minoritaires Les enfants d’agriculteurs, davantage représentés dans le privé, sont au second rang tous statutsconfondus ; leur place est en croissance en 2001En 2000-2001, toutes écoles confondues, la majorité des étudiants (49,2%) en formation de base del’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire sont enfants de cadres ou de parents exerçantune profession intellectuelle.Au sein de ces étudiants, les enfants d’agriculteurs constituent le deuxième groupe par ordred’importance (13,3%) à quasi égalité avec les jeunes dont les parents exercent une professionintermédiaire (13%). Suivent les enfants d’employés (7,5%) et les enfants d’artisans ou decommerçants (6,9%)Les enfants d’ouvriers (2,6%) et plus encore de salariés agricole (0,4%) sont très fortementminoritaires dans les écoles supérieures agronomiques et vétérinaires.On repère toujours les mêmes différenciations entre écoles publiques et écoles privées, au-delà de ladomination des enfants de cadres qui leur est commune : davantage d’étudiants dont les parents exercent une profession intermédiaire dans lepublic (15,3%), avec une prégnance encore plus nette des enfants de cadres (52,8%) ; davantage d’enfants d’agriculteurs dans le privé (26,3%).La prédominance des étudiants dont les parents sont cadres ou exercent une profession intellectuelleest encore plus marqué dans les ENSA (61% de leurs effectifs en formation de base) et les ENV(60%).On note cependant entre 2000 et 2001 : un accroissement de la part des enfants d’agriculteurs dans le public (+0,7 point) etplus encore dans le privé (+1,5 points) ; mais aussi des étudiants dont les parentsexercent une profession intermédiaire (respectivement +1 point et +0,5 point) et desenfants d’employés (respectivement +0,7 point et +0,4 point) ; une baisse de la part des enfants d’artisans et de commerçants (respectivement-1,1 points et -1 point).Les formésRepèresFormations de baseLes formations de base concernent les formationsd’ingénieurs (de la première année ou de latroisième année de formation supérieure selon lesécoles à la cinquième ou la septième année) et lesquatre premières années de formation vétérinairefaisant suite à l’année de classe préparatoire etmenant à l’obtention du diplôme d’étudesfondamentales vétérinaires.ENSAENITENVFESIAINA-PGENSIAENESADENGREFCNEARCESATIESIELISAAEcoles nationales supérieures agronomiquesEcoles nationales d’ingénieurs des travauxEcoles nationales supérieures vétérinairesFédération des écoles supérieures d’ingénieurs en agricultureInstitut national agronomique - Paris GrignonEcole nationale supérieure des industries agricoles et alimentairesEtablissement national d’enseignement supérieur agronomique de DijonEcole nationale du génie rural, des eaux et des forêtsCentre national d’études agronomiques des régions chaudesEcole supérieure d’agronomie tropicaleInstitut d’études supérieures d’industries et d’économie laitièresInstitut supérieur de l’agro-alimentaireSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires ruralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur225
Les femmes en formationEvolution de la part des femmes en formation scolaireselon le niveau de formationTous statuts confondusEvolution de la part des femmesselon le statutTous niveaux confondus1994 1998 20011994 1998 200139%39% 37%54%52% 53%36%41% 42%30%35% 35%32%34%35%50%51%50%42%44%44%VI et Vbis V IV IIIPublic Privé EnsembleLa part des femmes selon le niveau et le secteur de formation en 2001Tous statuts d’enseignement confondusEffectifs 2001P T FA SP SE COM FG EnsembleF 12423 12423VI et VbisG 21311 21311VIVIIIEnsemble% F 37% 36,8%F 6446 697 744 19694 1564 2533 31678G 16594 540 8465 1236 151 1130 28116% F 28% 56% 8% 94% 91% 69% 53,0%F 5203 1583 1750 9110 750 1476 4137 24009G 14705 1061 7862 677 73 971 7832 33181% F 26% 60% 18% 93% 91% 60% 35% 42,0%F 2626 1951 1226 488 1294 252 7837G 7436 1210 3411 200 1905 274 14436% F 26% 62% 26% 71% 40% 48% 35,2%F 14275 4231 3720 29292 2314 5303 16812 75947G 38735 2811 19738 2113 224 4006 29417 97044% F 26,9% 60,1% 15,9% 93,3% 91,2% 57,0% 36,4% 43,9%Evolution de la part des femmes en formation initiale scolaire selon le secteur de formationTous niveaux de formation et statuts d’enseignement confondus1994 1998 200122%25% 27%53%58%60%15%16%16%93%93%93%85%91% 91%54%59%57%36%36%36%Production Transformation ForêtAménagementServicespersonnesServicesentreprisesCommerc.F. généralesPart des femmes selon le statut d’enseignement, le niveau et le secteur de formation en 2001226En %Production Transform. Forêt Amgt S. Pers. S. Ent. Commerc. F. Géné. EnsemblePub Ptp Pra Pub Ptp Pra Pub Ptp Pra Pub Ptp Pra Pub Ptp Pra Pub Ptp Pra Pub Ptp Pra Pub Ptp PraVI et Vbis 21 44 37 21 44 37V 28 27 29 59 54 48 11 6 7 94 94 95 94 87 93 75 69 65 39 62 55IV 27 23 29 61 58 60 21 16 8 90 93 94 94 89 82 63 61 56 34 35 45 35 49 55III 27 23 25 62 60 67 27 24 31 67 77 72 38 43 44 48 36 34 33Ensemble 27 25 29 61 58 57 20 13 9 90 93 94 94 88 91 53 60 58 30 42 37 35 51 48
Les élèves de la formation initiale scolaire Après s’être accrue, la part des filles en formation initiale scolaire agricole se stabilise depuis quelques années Les filles se font plus présentes aux niveaux IV et III de formation, même si elles sont majoritaires au seulniveau V Elles sont majoritaires dans l’enseignement privé à temps plein Leur présence dépend essentiellement des secteurs de formationLa part des filles dans les effectifs de formation initiale scolaire agricole s’est un petit peu accruedepuis 1994 : + 2 points de 42% à 44% en 1998, tous statuts confondus. Elle est stable depuis.Les femmes se font aussi plus présentes aux niveaux de formation les plus élevés, et à l’inverse plusdiscrètes aux niveaux de formation les plus bas. La part des femmes gagne 5 points (de 30% à 35%)au niveau III de 1994 à 1998, et est stable ensuite ; elle progresse de même de 5 points au niveau IVde 1994 à 1998 et gagne encore 1 point de 1998 à 2001 (42% à cette date). A l’opposé, les formationsde niveaux VI et Vbis accueillaient 39% de femmes en 1994. En 2001, ce taux a perdu 2 points (à37%). Enfin, au niveau V, les femmes représentaient 54% des effectifs en 1994 pour 52% en 1998et 53% en 2001. Le niveau V demeure toutefois le seul niveau où les femmes sont majoritaires.On note par ailleurs de fortes disparités concernant la part des femmes selon le statutd’enseignement. Elles sont majoritaires dans l’enseignement privé à temps plein (51%) ; elles sontrelativement très présentes dans le privé à rythme approprié (48%), tandis que le public reste trèsmasculin (35%). Dans ce statut, cependant, leur place s’est quelque peu développée depuis 1994(+3 points), alors qu’elle est stable sur la période pour le privé dans son ensemble.En termes sectoriels, on remarque que les formations prioritairement suivies par les femmes relèventdes services aux personnes (93,3% de femmes en 2001 ; stable par rapport à 2000), des services auxentreprises (91,2% ; +1,4 points par rapport à 2000), de la transformation (60,1% ; +0,3 point parrapport à 2000) et de la commercialisation (57% ; -0,9 point par rapport à 2000). Elles sont nettementmoins présentes dans les formations générales (36,4% ; stable par rapport à 2000), dans la production(26,9% ; +0,7 point par rapport à 2000) et surtout en forêt-aménagement (15,9% ; -0,1 point parrapport à 2000).Les formésLorsque l’on analyse en détail la part des femmes dans les formations agricoles selon le niveau, lesecteur et le statut d’enseignement, on observe qu’il n’y a pas de fortes disparités entre les statutsd’enseignement dans un même secteur de formation, mis à part en forêt-aménagement (11 pointsd’écart entre le public et le privé à rythme approprié à la faveur du public) et dans les formationsgénérales (12 points d’écart entre le public et le privé à temps plein à la faveur du second statut). Lesécarts sont plus importants quand on considère les différents niveaux de formation selon le statutd’enseignement. Le taux de féminisation est supérieur de 23 points dans le privé à temps plein encomparaison du public aux niveaux VI et Vbis et au niveau V. Il dépasse de 20 points dans le privéà rythme approprié celui du public au niveau IV. Au sein d’un même secteur et d’un même niveau,l’écart le plus important enregistré entre statut d’enseignement est de 13 points (en forêtaménagementau niveau IV entre le public et le privé à rythme approprié).La dominante sectorielle est donc déterminante en termes de taux de féminisation des formations.RepèresLes niveaux de formationNiveaux VI et Vbis :Niveau V :Niveau IV :Niveau III :Classes de quatrième et de troisième, CPA et CLIPACAPA et BEPASeconde générale et technologique, baccalauréats professionnel, technologique, scientifique, BTABTSA, classes préparatoiresSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.227
Les femmes en formationLa place des femmes dans les effectifs des formations supérieures initiales de baseHors apprentissageFormation de base initiale scolaireEtudiantesen formation2001 Rappels Etudiantes2001RappelsEff % 2000 1998 en formationEff % 2000 1998I N A - P G - I T I A A 425 62% 61% 59% I S A A 73 62% 67% 64%E N S A M 207 58% 61% 57% Centres 3ème cycle 73 62% 67% 64%E N S A R 224 63% 60% 60%E N S I A 169 67% 62% 65% E N V A 410 65% 64% 59%I N H ( E N S H A P ) 94 66% 68% 60% E N V L 414 65% 64% 64%E N S A 1119 62% 61% 60% E N V N 358 58% 56% 56%E N V T 367 59% 58% 57%E N I T A B 161 52% 46% 46% E N V 1549 62% 61% 59%E N I T A C F 164 55% 54% 48%E N E S A D ( F I ) 142 55% 49% 47% E N S P 98 54% 56% 49%E N I T I A A 184 64% 62% 59% E N F A 469 56% 61% 54%E N G R E F ( F I F ) 49 40% 44% 50%I N S F A 182 77% 76% 73% Total Public 4622 59% 59% 56%I N H ( E N I H P ) 144 62% 60% 60%E N G E E S 90 45% 41% 41% E S A 253 43% 45% 40%E N I T et assimilées 1116 57% 55% 53% E S A P 204 35% 34% 33%I S A B 243 40% 41% 39%E N G R E F 73 40% 39% 39% I S A B Ago-Santé 57 66%E N E S A D ( I A ) 25 66% 61% 62% I S A - I T I A P E 298 55% 54% 47%E N S V 46 60% 56% 69% I S A R A 236 50% 50% 46%C N E A R C ( E S A T ) 54 53% 46% 37% E S I T P A 192 41% 43% 44%Ecoles d'application 198 50% 46% 45% E S B 38 19% 19% 20%Total Privé 1521 43% 43% 40%Ensemble 6143 54% 54% 51%La place des femmes dans les effectifs des formationssupérieures initiales selon le type de formationTous statutsFormationsde base3ème cycleAutresformations54,2%53,7%49,4%41,0%47,2%46,2%20012000NB :En 2001, sur 246 étudiants par l’apprentissage àl’INA-PG, l’ISAA, l’ESA, l’ISAB et l’ISA-ITIAPE, 89sont des femmes.Le tableau qui suit donne les chiffres pour laformation continue :Formationde baseFormation continue3ème cycleAutresformationsEff % Eff % Eff %Public 37 18% 69 41% 92 35%Privé 14 41% 4 16%Ensemble 51 21% 69 41% 96 33%La place des femmes dans les effectifs des formations supérieures initiales de base selon le type d’école20011998200060%62% 64%57%62% 62%53% 54%59%49%45%50%40% 43%228ENSAENITENSPEcolesapplic.Centres3e cycleENVPrivé
Les étudiantes en formation initiale Présence dominante des femmes dans les formations de base de l’enseignement supérieur agronomique etvétérinaire public Taux de féminisation en croissance dans la plupart des types d’écolesToutes écoles confondues, les femmes sont majoritaires parmi les étudiants en formation de baseagronomique et vétérinaire : 54%. Leur place s’est accrue entre 1998 et 2000 (+3 points), mais elleest stable en 2001.Cette forte représentation des femmes relèvent en réalité des écoles publiques ; elles y constituent59% des effectifs, taux stable par rapport à 2000. La part des femmes en formation dans les écolesprivées est en effet un peu plus faible : 43% (de même stable).On citera notamment, parmi les écoles publiques les plus féminisées : l’INSFA (77%), l’ENSIA(67%), l’ENSHAP de l’INH et l’ENESAD-IA (66%), ainsi que l’ENVA et l’ENVL (65%).Plus globalement, c’est dans les ENSA et les ENV que les femmes sont le plus présentes (62%).Au sein des écoles privées, l’ISAB agro-santé et l’ISA-ITIAPE se distinguent toutefois, accueillantrespectivement 66% et 55% de femmes dans leurs effectifs en formation de base.Toutefois, en comparaison de la situation observée en 1998, le taux de féminisation est en croissancedans tous les types d’écoles, excepté dans les centres de troisième cycle, en particulier les écolesd’application (+5 points à 50% de femmes en 2001), l’ENSP (+5 points à 54%, en baisse toutefoispar rapport à 2000), les ENIT (+4 points à 57%).Reste que si les femmes sont majoritaires dans les formations de base, elles ne le sont pas dans lesautres types de formations. Elles représentent 49,4% des étudiants en formation de troisième cycle,taux en croissance toutefois de plus de 2 points entre 2000 et 2001. Elles ne comptent que pour 41%(-5 points par rapport à 2000) des étudiants dans les autres formations.Les formésRepèresVoir les sigles des écoles en annexeLes grands types de formationsOn distingue trois grands groupes de formation : les formations de base de bac+0 ou bac+2 à bac+5 ou bac +7 selonles écoles menant principalement au diplôme d’ingénieur ou audiplôme d’études fondamentales vétérinaires ; les formations de troisième cycle comprenant les mastères, les DEA,les DESS, les thèses, les DES vétérinaires, les CEAV, les DESV, lesmaîtrises vétérinaires ; les autres formations comprenant les DNO, les CES, les CESIA, lesDU, les licences professionnelles, les autres formations notammenten agro-alimentaire.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur229
Les femmes en formationLa part des femmes dans l’apprentissageselon le niveau et le secteur de formation en 2001Tous statuts confondusV IV III EnsembleF % F F % F F % F F % FProduction 1010 14,3% 696 16,2% 430 23,6% 2136 16,2%Transformation 51 16,2% 208 50,0% 410 56,0% 669 45,7%ForêtAménagementServices aux personnesServices aux entreprises150 2,4% 72 3,6% 184 14,0% 406 4,2%556 92,2% 245 92,5% 14 51,9% 815 91,1%Commercialisation 192 61,9% 226 60,8% 313 36,8% 731 47,7%Activités hippiques 875 52,4% 40 55,6% 915 52,6%Ensemble 2834 17,4% 1487 20,0% 1351 28,5% 5672 19,9%Evolution de la part des femmes en apprentissageselon le niveau de formationTous statutsLa place des apprenties en 2001selon le niveau de formation et le statutTous secteurs15%17% 18%20%29%28%18%20%niveau Vniveau IV16%24%17%30%Centres publicsCentres privésniveau V niveau IV niveau III Ensemble2001 2000 1998niveau IIIEnsemble29%27%18%26%Evolution de la part des femmes en apprentissageselon le secteur de formationTous statutsLa place des apprenties en 2001selon le secteur de formation et le statutNiveaux V à III81%91%P17%14%Centres publicsCentres privés44% 46%47%48% 46%53%T45%47%23016%16%4%4%P T FA SPSE200120001998CAHFASPSECAH4%6%45%51%58%37%89%93%
Les apprenties Au sein d’un apprentissage majoritairement masculin, la part des femmes ne cesse de progresser Les femmes sont davantage présentes dans les secteurs des services et de la commercialisation, desactivités hippiques et de la transformation ; au niveau III qu’au niveau IV et au niveau IV qu’au niveau V ;dans le privé que dans le public Cependant le taux de féminisation évolue, quand le niveau de formation s’élève, en faveur des secteurs plusglobalement masculins et en faveur du statut publicL’apprentissage agricole majoritairement masculin s’est encore quelque peu féminisé en 2001. Ilaccueille à cette date près de 20% de filles dans ses formations, soit 0,8 point de plus qu’en 2000.La part des femmes dans l’apprentissage dépend en premier lieu du secteur de formation considéré :peu présentes en forêt-aménagement (4,2% des effectifs d’apprentis dans ce secteur) ou enproduction (16,2%), elles occupent une place bien plus importante en transformation (45,7%) ou encommercialisation (47,7%) et sont même majoritaires dans le secteur des activités hippiques (52,6%)et plus encore dans les services aux personnes et services aux entreprises (91,1%).La domination des secteurs production et forêt-aménagement dans l’apprentissage agricole (80% deseffectifs en 2001) explique donc sa faible féminisation.Quoi qu’il en soit, la proportion de filles s’accroît dans la plupart des secteurs entre 2000 et 2001 :c’est en particulier le cas dans le secteur des activités hippiques (+2,9 points), les services auxentreprises et les services aux personnes (+2,6 points), la transformation (+1,6 points), mais aussis’agissant de la production (+0,6 point) et de la forêt-aménagement (+0,1 point). Seul le secteur dela commercialisation accueille un peu plus de garçons que précédemment (-0,4 point aux filles).Parallèlement, les filles sont d’autant plus présentes dans l’apprentissage agricole que le niveau deformation considéré est élevé. Pour les niveaux V et IV, cette présence est d’ailleurs confortée en2001 : +0,8 point pour les deux niveaux à respectivement 17,4% et 20%. Elle atteint 28,5% auniveau III. Fait intéressant, ce phénomène est vérifié au sein même des différents secteurs, pour lessecteurs à dominante masculine : ainsi le secteur de la transformation accueille-t-il 16,2% de fillesau niveau V pour 56% au niveau III (+39,8 points) ; la forêt-aménagement 2,4% au niveau V et 14%au niveau III (+11,6 points) ; la production 14,3% au niveau V pour 23,6% au niveau III(+9,3 points). En revanche, dans des secteurs où les filles sont globalement dominantes, les serviceset la commercialisation, ce sont les garçons qui, avec l’élévation du niveau de formation, se fontdavantage présents : 92,2% de filles dans les services au niveau V et 51,9% au niveau III(-40,3 points) ; 61,9% de filles en commercialisation au niveau V pour 36,8% au niveau III(-25,1 points).Les formésLa variable sectorielle joue aussi in fine sur la représentation des filles dans les différents statuts enapprentissage : alors que l’on ne note pas, mis à part dans le secteur des activités hippiques, de fortesdifférenciations dans les taux de féminisation entre statut public et statut privé au sein de chaquesecteur, ce dernier montre une population totale davantage féminisée : 26% de filles contre 18% aupublic. Ceci est vérifié au sein des niveaux V (24% contre 16%) et IV (30% contre 17%). Auniveau III, où le taux de féminisation est le plus élevé dans les secteurs de la transformation et desservices, la configuration inverse apparaît (27% de filles au privé contre 29% au public). On retrouvelà encore la composante sectorielle, ces deux domaines étant au niveau III nettement moinsreprésentés dans le privé que dans le public.RepèresLes niveaux de formationNiveau VNiveau IVNiveau IIINiveau ISourcesSecond cycle court professionnel (CAPA, BEPA et BPA)Cycle long professionnel ou technologique (baccalauréat professionnel, brevet detechnicien agricole, brevet professionnel)Premier cycle supérieur de deux années d'études post-baccalauréat (BTSA)Formations supérieures de niveau supérieur à Bac+2 (diplômes d'ingénieur).PTFASPSECAHProductionTransformationForêt-AménagementServices aux personnesServices aux entreprisesCommercialisationActivités hippiquesMinistère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.231
Les internesEvolution des effectifs d’élèves internes selon le niveau de formation et le statut d’enseignementPart d’internes tous statuts et niveaux confondusPublic 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001VI et Vbis 4230 3697 3512 3147 2861 2704 2505 2446V 10421 10661 11498 11748 11944 11807 11271 10971IV 19209 20463 20805 21194 21457 21247 20649 20241III 5215 4552 4230 4250 4065 3972 4073 3852Total public 39075 39373 40045 40339 40327 39730 38498 37510Privé 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001VI et Vbis 14985 17338 17924 17853 17313 17907 18753 19041V 22384 25114 27375 28866 29461 29072 27948 27023IV 11458 13549 14125 14827 15721 16395 15897 15183III 2769 2490 2567 2636 2445 2473 2504 2384Total privé 51596 58491 61991 64182 64940 65847 65102 63631Part internes (%) 68,5 61,2 60,5 59,9 59,4 59,1 59,1 58,5Evolution de la part des élèves internes dans les effectifs globaux selon le statut d’enseignement- tous niveaux de formation confondus -68,169,064,585,184,384,8 84,3 83,962,5 61,961,7 61,9 61,3Public62,359,343,758,342,955,341,754,941,954,240,8PrivéPrivé temps pleinPrivé rythme approprié1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Evolution de la part des élèves internes dans les effectifs globaux selon le niveau de formation- tous statuts confondus -75,868,067,964,264,4Niveaux VI et VbisNiveau VNiveau IV51,763,9 63,9 63,762,763,562,661,9Niveau III28,4 29,228,01990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Proportion d’internes selon le niveau de formation et le statut d’enseignement en 2001 (en %)Public48,786,7 87,661,8 64,235,5 40,048,978,525,830,837,7Privé temps pleinPrivé rythme approprié232VI et Vbis V IV III
Evolution en formation initiale scolaire La plus grande majorité des élèves de l’enseignement agricole sont encore internes en 2001, malgré le reculde ce régime scolaire L’internat est avant tout une spécificité des maisons familiales et rurales ; c’est dans le privé à temps pleinqu’il est le moins développé La proportion d’élèves internes fléchit surtout dans le public et le privé à temps plein L’internat est davantage choisi par les élèves des niveaux VI et Vbis dans le privé à rythme approprié, desniveaux V et IV dans les autres statuts ; il l’est comparativement peu au niveau IIIEn 2001, l’internat concerne 101141 élèves de l’enseignement agricole, tous statuts confondus, soit58,5% de sa population scolaire. Dans les dix dernières années, cependant, la proportion d’élèvesinternes s’est réduite de manière non négligeable ; on comptait en effet 68,5% de jeunes hébergés eninternat en 1990, soit 10 points de plus qu’aujourd’hui.Au-delà de cette évolution globale, on repère des différenciations fortes entre statuts d’enseignement.En 1990, l’internat était un peu plus développé dans l’enseignement public (69% d’internes) quedans le privé (68%). Mais cette relation s’inverse dès 1992. Depuis, l’écart n’a cessé de se creuserdans les taux d’hébergement en internat en faveur du privé. En 2001, 7 points les séparent : 54% desélèves du public relèvent de ce régime scolaire pour 61% des élèves du privé.Cette caractéristique de l’enseignement privé est en réalité du ressort des maisons familiales etrurales. Intégré dans leur pédagogie, fortement recommandé aux familles, l’internat y tient une placeprépondérante : près de 84% des élèves sont concernés. En revanche, seuls 41% des élèves del’enseignement privé à temps plein ont choisi ce mode d’hébergement en 2001. Entre outre, si laproportion d’élèves internes s’est en premier lieu réduite dans le public (-4,4 points de 1995 à 2000et -0,7 point en 2001), le privé à temps plein est aussi touché par cette tendance, en particulier en2001 (-1,8 points de 1995 à 2000 et -1,1 points en 2001). Du côté du privé à rythme approprié, cetteproportion fléchit bien moins : -0,8 point de 1995 à 2000 et -0,4 point en 2001.L’internat concerne aussi de manière inégale les différents niveaux de formation suivie par les élèves.Tous statuts confondus, compte tenu de la place du privé à rythme approprié aux niveaux VI et Vbis(51% des effectifs de ces niveaux) et, dans une moindre mesure au niveau V (36%), il n’est pasétonnant de constater une proportion d’élèves internes plus élevée à ces niveaux (respectivement63,7% et 63,5%) qu’au niveau IV (61,9%) et III (28%). Cependant, si effectivement c’est à cesniveaux VI, Vbis et V que le taux d’élèves internes est le plus fort dans le privé à rythme approprié(respectivement 86,7% et 87,6%), c’est aux niveaux V et IV qu’il se révèle supérieur dans le public(respectivement 61,8% et 64,2%) et le privé à temps plein (respectivement 40% et 48,9%). Parailleurs, au niveau IV, la part d’internes dans le privé à rythme approprié demeure forte : 78,5%.S’agissant enfin du niveau III, l’internat, qui était choisi par 51,7% des étudiants, tous statutsconfondus, en 1990, ne concerne plus que 28% des jeunes en 2001. C’est à ce niveau que la partd’apprenants internes a le plus reculé ces dix dernières années.Les formésIl n’en reste pas moins, malgré une diversification des régimes scolaires, que l’internat est unespécificité forte de l’enseignement agricole et que, dans le sens de la croissance soutenue deseffectifs qu’a connu cet enseignement dans les années 1990, la population de jeunes accueillis eninternat dans les établissements s’est beaucoup développée, même si elle se réduit quelque peudepuis 2000.RepèresLes niveaux de formationNiveaux VI et VbisNiveau VNiveau IVNiveau IIIClasses de quatrième et de troisième, CPA et CLIPACAPA et BEPASeconde générale et technologique, baccalauréats professionnel,technologique, scientifique, BTABTSA, classes préparatoiresN.B. : Sont comptabilisés comme «internes» les internes et les internes externés.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.233
Les diplômesEvolution des effectifs de diplômés de l’enseignement général, technique et professionnel agricole- hors unités capitalisables -Résultats (hors UC)CAPABEPABTABac pro.Bac techno.Bac SBTSATOTAL1991 1995 1998 1999 2000 2001 <strong>2002</strong>Evolution01/02Diplômés 9 643 10 408 5 522 6 297 5 618 5 731 5 101 -11,0%Inscrits 13 209 14 542 7 528 8 281 7 730 7 651 6 892 -9,9%Présents 12 001 13 065 6 710 7 544 6 849 6 892 6 174 -10,4%% déperdition 9,1% 10,2% 10,9% 8,9% 11,4% 9,9% 10,4% + 0,5 pt% de réussite 80,4% 79,7% 82,3% 83,5% 82,0% 83,2% 82,6% - 0,5 ptDiplômés 15 302 18 229 23 469 25 793 24 320 24 787 22 342 -9,9%Inscrits 21 970 24 700 30 697 31 888 31 226 30 588 28 629 -6,4%Présents 20 313 23 637 29 438 30 626 29 797 29 304 27 365 -6,6%% déperdition 7,5% 4,3% 4,1% 4,0% 4,6% 4,2% 4,4% + 0,2 pt% de réussite 75,3% 77,1% 79,7% 84,2% 81,6% 84,6% 81,6% - 2,9 ptDiplômés 9 780 9 383 6 350 5 681 5 918 5 885 5 406 -8,1%Inscrits 15 073 15 989 8 885 8 212 8 604 8 452 7 684 -9,1%Présents 14 690 15 189 8 247 7 781 8 129 7 904 7 294 -7,7%% déperdition 2,5% 5,0% 7,2% 5,2% 5,5% 6,5% 5,1% - 1,4 pt% de réussite 66,6% 61,8% 77,0% 73,0% 72,8% 74,5% 74,1% - 0,3 ptDiplômés 116 345 5 871 6 803 7 679 8 272 8 301 +0,4%Inscrits 182 482 7 403 9 029 9 783 10 593 10 804 +2,0%Présents 175 482 7 094 8 646 9 335 9 995 10 307 +3,1%% déperdition 3,8% 0,0% 4,2% 4,2% 4,6% 5,6% 4,6% - 1,0 pt% de réussite 66,3% 71,6% 82,8% 78,7% 82,3% 82,8% 80,5% - 2,2 ptDiplômés 2 248 4 770 5 146 5 847 5 550 5 417 -2,4%Inscrits 3 383 6 791 7 547 7 962 7 582 7 316 -3,5%Présents 3 254 6 568 7 345 7 672 7 222 7 008 -3,0%% déperdition 3,8% 3,3% 2,7% 3,6% 4,7% 4,2% - 0,5 pt% de réussite 69,1% 72,6% 70,1% 76,2% 76,8% 77,3% + 0,4 ptDiplômés 1 331 1 314 1 243 1 353 1 406 1 393 1 343 -3,6%Inscrits 2 206 1 814 1 783 1 779 1 799 1 754 1 593 -9,2%Présents 2 119 1 813 1 719 1 770 1 799 1 739 1 582 -9,0%% déperdition 3,9% 0,1% 3,6% 0,5% 0,0% 0,9% 0,7% - 0,2 pt% de réussite 62,8% 72,5% 72,3% 76,4% 78,2% 80,1% 84,9% + 4,8 ptDiplômés 5 899 8 386 8 943 9 919 11 294 11 044 11 081 +0,3%Inscrits 8 341 13 424 13 960 14 996 15 942 15 516 15 744 +1,5%Présents 7 767 12 202 12 957 14 058 14 708 14 385 14 690 +2,1%% déperdition 6,9% 9,1% 7,2% 6,3% 7,7% 7,3% 6,7% - 0,6 pt% de réussite 75,9% 68,7% 69,0% 70,6% 76,8% 76,8% 75,4% - 1,3 ptDiplômés 42 071 50 313 56 168 60 992 62 082 62 662 58 991 -5,9%Inscrits 60 981 74 334 77 047 81 732 83 046 82 136 78 662 -4,2%Présents 57 065 69 642 72 733 77 770 78 289 77 441 74 420 -3,9%% déperdition 6,4% 6,3% 5,6% 4,8% 5,7% 5,7% 5,4% - 0,3 pt% de réussite 73,7% 72,2% 77,2% 78,4% 79,3% 80,9% 79,3% - 1,6 pt14% 17% 18% 19%27%26%34% 35%CAPABEPABTABac pro.Bac techno.Bac SBTSA23 46924 32022 34259% 57%48% 46%16 1012341991 1995 2000 <strong>2002</strong>Niveau VNiveau IIINiveau IV11 29410 48011 0818 9438 5207 6796 3508 3015 8715 9185 4175 4065 5495 8475 5225 6185 1014 7701 3821 2431 406861 3431990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 <strong>2002</strong>
Les diplômés de l’enseignement général,technologique et professionnel Baisse du taux de réussite dans la plupart des diplômes en <strong>2002</strong> Mais amélioration très nette en baccalauréat scientifique et stabilité en baccalauréat technologique Les meilleurs taux sont observés pour le baccalauréat scientifique, mais aussi pour le CAPA, le BEPA et lebaccalauréat professionnel Baisse importante du nombre de diplômés en <strong>2002</strong> en CAPA, BEPA, BTANiveau VDepuis 1998, le taux de réussite à l’examen de CAPA oscille entre 82% et 83,5%. Il baisse un peuentre les sessions 2001 et <strong>2002</strong> : -0,5 point à 82,6%. Le taux de déperdition varie sur le long termeentre 9% et un peu plus de 11%. Il s’établit à un niveau intermédiaire en <strong>2002</strong> (10,4%). Ce taux dedéperdition en CAPA reste toutefois le plus élevé de tous les diplômes. Au total, 5101 candidats ontobtenu un CAPA en <strong>2002</strong> ; ce qui marque un recul important : -11% par rapport à 2001.Les résultats obtenus en BEPA, qui s’amélioraient nettement en 2001 après avoir fléchi en 2000,sont, en <strong>2002</strong>, de nouveau un peu moins bons ; on compte cependant 81,6% de candidatsréussissant l’examen (-2,9 points par rapport à 2001), soit un niveau égal à celui de 2000. Letaux de déperdition, qui ne connaît que de faibles fluctuations depuis 1995, se fixe à 4,4% à ladernière session. Ce diplôme subit une baisse importante du volume de ses promotions, enliaison avec l'évolution des effectifs de formés : 22342 lauréats en <strong>2002</strong>, soit un recul de -9,9%.Niveau IVLe taux de réussite au BTA est stable (-0,3 pt), après avoir progressé en 2001 (+1,7 pts). Il estde 74,1% en <strong>2002</strong>, soit près de 3 points en dessous du niveau enregistré en 1998. Le taux dedéperdition connaît un mouvement inverse : en croissance en 2000 et 2001 après s’être réduiten 1999, il perd 1,4 points en <strong>2002</strong> à 5,1%. A cette date, 5406 BTA sont délivrés (-8,1%).La réussite en baccalauréat professionnel, qui approchait 83% en 2001, se dégrade quelquepeu en <strong>2002</strong>, perdant 2,3 points à tout de même 80,5%. Le taux de déperdition, pour sa part, esten baisse ; ce qui compense la hausse enregistrée en 2001. Il retrouve ainsi un niveau inférieurà 5%. Le nombre total de diplômés, après une croissance soutenue ces dernières années, estrelativement stable en <strong>2002</strong> : +0,4% à 8301 bacheliers professionnels.La performance en baccalauréat technologique est un peu plus modeste, mais se maintient en<strong>2002</strong> : +0,4 point à 77,3%. Parallèlement, le taux de déperdition, qui avait augmenté de manièresignificative en 2001, se réduit de nouveau (-0,5 point à 4,2%). Le nombre de bachelierstechnologiques diminue depuis 2001 : -2,4% en <strong>2002</strong> à 5417.Le taux de réussite en baccalauréat scientifique ne cesse de progresser ces dernières années.Ce mouvement est marqué en <strong>2002</strong> : +4,8 points à 84,9%, et ce sans reprise du taux dedéperdition. En revanche, le nombre de diplômés est en baisse, de 3,6%, à 1343 en <strong>2002</strong>.Les résultatsNiveau IIIEn 2000 et 2001, la performance en BTSA s’était fortement améliorée. En <strong>2002</strong>, elle fléchit unpeu : -1,3 points à 75,4%. Mais le taux de déperdition est plus faible (-0,6 pt à 6,7%). Le nombrede diplômés est stable : 11081 (+0,3%).RepèresCAPABEPABTACertificat d’aptitude professionnelle agricoleBrevet d’études professionnelles agricolesBrevet de technicien agricoleBac proBac technoBac SBTSABaccalauréat professionnelBaccalauréat technologiqueBaccalauréat scientifiqueBrevet de technicien supérieur agricoleSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel.235
Les diplômesInscrits, présents et diplômés en <strong>2002</strong>par niveau et secteur de formationHors résultats de la Nouvelle CalédonieNiveau V Inscrits Présents Admis % admis / présents Evo. 01/02 (en pt)Production 14245 13466 11191 83,1% +0,2Transformation 614 593 497 83,8% -1,0Forêt - Aménagement 7238 6739 5483 81,4% +0,2Services aux entreprises 778 736 609 82,7% -6,7Services aux personnes 10651 10157 8198 80,7% -7,1Commercialisation 1813 1696 1371 80,8% -6,9Total 35339 33387 27349 81,9% -2,6Niveau IV Inscrits Présents Admis % admis / présents Evo. 01/02 (en pt)Production 11564 11091 8950 80,7% -1,2Transformation 1028 958 767 80,1% +0,7Forêt - Aménagement 5952 5703 4329 75,9% -1,4Services aux entreprises 335 320 232 72,5% -3,7Services aux personnes 4668 4425 3237 73,2% -0,3Commercialisation 1290 1158 886 76,5% +1,6Total 24837 23655 18401 77,8% -0,8Niveau III Inscrits Présents Admis % admis / présents Evo. 01/02 (en pt)Production 6855 6395 4698 73,5% -1,7Transformation 2156 2065 1718 83,2% +1,7Forêt - Aménagement 3968 3652 2675 73,2% -2,3Services aux entreprisesServices aux personnes 314 309 278 90,0% -2,9Commercialisation 2428 2248 1705 75,8% -2,5Total 15721 14669 11074 75,5% -1,3Part des secteurs dans les effectifs de diplômés par niveau (en %)Commercialisation5,0Services aux personnes30,0Services aux entreprisesForêt - Aménagement2,220,1Niveau VTransformation1,8Production40,9Commercialisation4,8Services aux personnes17,6Services aux entreprisesForêt - Aménagement1,323,5Niveau IVTransformation4,2Production48,6Commercialisation15,4Services aux personnes2,5Forêt - Aménagement24,2Niveau IIITransformation15,5236Production42,4
Les diplômés de l’enseignement technologique et professionnelpar secteur de formation Les meilleurs taux de réussite sont repérés en production et en transformation aux niveaux V et IV en <strong>2002</strong> Au niveau III, ce sont les services aux personnes et la transformation qui affichent les taux les plus élevés Les écarts entre secteurs en termes de performance croissent avec le niveau de formation considéré :faibles au niveau V, ils sont relativement importants au niveau III Le taux de réussite est en baisse à tous les niveaux dans la plupart des secteurs, mis à part en productionet forêt-aménagement au niveau V, en commercialisation et en transformation au niveau IV et dans cedernier secteur au niveau IIINiveau VLa production concerne 40,9% des diplômés (+0,3 point par rapport à 2001). Les services auxpersonnes constituent le deuxième groupe dominant (30% ; -1,3 pts). La forêt-aménagement sedéveloppe (20,1% des diplômés ; +2,1 pts). Les autres secteurs touchent à des effectifs plus réduitsde diplômés. Parmi eux, la commercialisation voit son poids se réduire (5% ; -0,7 pts par rapport à2001).On note peu d’écart entre secteurs en termes de taux de réussite : celui-ci varie de 80,7% dans lesecteur des services aux personnes à 83,8% dans le secteur de la transformation.La proportion de reçus, globalement en recul pour l’ensemble du niveau V, décline surtout dans letertiaire entre 2001 et <strong>2002</strong> : environ -7 points dans les services aux personnes, les services auxentreprises et la commercialisation.Niveau IVLa production est largement dominante, rassemblant près de 50% des diplômés en <strong>2002</strong>. C’est, à ceniveau, la forêt-aménagement qui se place au deuxième rang avec 23,5% des diplômés, suivie desservices aux personnes (17,6%).Les écarts, dans le taux de réussite, entre secteurs sont davantage marqués à ce niveau : de 72,5%pour les services aux personnes à 80,7% à la production.La performance des formés est en baisse dans la plupart des secteurs, en particulier dans les servicesaux entreprises (-3,7 points), alors qu’elle s’améliore en transformation (+0,7 point) et surtout encommercialisation (+1,6 points).Niveau IIIOn retrouve les dominantes production et forêt-aménagement, en termes de part des secteurs dans lapromotion de diplômés <strong>2002</strong> : respectivement 42,4% et 24,2%. Mais la commercialisation et latransformation concernent des populations non négligeables (15,4% et 15,5%).Les écarts entre secteurs quant au taux de réussite sont encore plus importants qu’au niveau IV. Lesservices aux personnes, récemment apparus, qui ne comptent encore que peu de formés pour lapromotion <strong>2002</strong>, affichent un taux de réussite de 90% ; tandis que dans les secteurs de la forêtaménagementet de la production, on parvient juste au dessus de 75%.A noter que le taux de réussite est en recul pour tous les secteurs, mis à part celui de la transformation(+1,7 points à 83,2%).Les résultatsRepèresLES NIVEAUX DE FORMATION Sont considérées ici :Niveau VNiveau IVNiveau IIICAPA et BEPABaccalauréat professionnel, baccalauréat technologique,baccalauréat scientifique, brevet de technicien agricoleBTSA, classes préparatoires toutes les formations (CAPA, BEPA) de niveau V, les formations technologiques et professionnelles deniveau IV à l’exception des diplômes de l’Educationnationale, les BTSA.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de la politique des formations de l’enseignement général, technologique et professionnel / BECD Toulouse237
Les diplômesLes diplômés de l’enseignement supérieurFormation initiale et continue de base - hors enseignants ENFA1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Diplômés ingénieurs des écoles nationales supérieures agronomiques et assimiléesI NA - P G - I T I A A 211 257 242 243 263 248 236 277E N S A M 92 109 117 125 105 123 111 114E N S A R 96 125 117 128 119 123 120 111E N S I A 85 80 77 88 74 82 86 94I N H ( E N S H A P ) — — — — — — — 50Total 484 571 553 584 561 576 553 646Diplômés ingénieurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux et assimiléesE N G E E S 39 54 58 51 56 54 58 59E N G R E F ( F I F ) 25 35 35 35 35 41 36 40E N I T A B 49 74 81 86 91 99 102 98E N I T A C F 43 47 64 70 79 103 90 121E N E S A D ( I T A - F I ) 49 66 79 69 75 79 83 78I N H ( E N I T H P ) 40 68 67 68 62 74 — —E N I T I A A 37 71 100 77 103 96 95 96I N S F A 48 47 48 44 44 49 51 51I N H ( E N I H P ) — — — — — — — —E N E S A D ( I T A - F C ) 20 37 31 25 20 25 21 35C N E A R C ( E I T A R C ) 24 19 24 12 20 15 _ 0Total 374 518 587 537 585 635 536 578Diplômés d'études fondamentales vétérinairesE N V A 140 121 126 117 120 121 132 113E N V L 123 116 120 114 124 117 128 112E N V N 138 96 123 128 106 131 114 124E N V T 135 119 116 117 101 133 109 129Total 536 452 485 476 451 502 483 478Diplômés ingénieurs ou vétérinaires inspecteurs des écoles d'applicationE N G R E F 49 63 61 55 61 58 56 61E N E S A D 27 61 41 23 21 22 30 30E N S V 30 10 17 22 38 38 17 15Total 106 134 119 100 120 118 103 106Diplômés des écoles de spécialisation et centres de 3ème cycleE N S H 44 45 5 — — — — —C N E A R C ( E S A T ) 28 47 44 41 23 31 41 46I E S I E L 9 7 5 10 13 13 8 22I S P A 8 5 4 10 11 13 14 10I S A A 9 2 9 5 12 12 5 8Total 98 106 67 66 59 69 68 86Diplômés de l'Ecole Nationale Supérieure du PaysageE N S P / D . P . L . G . 30 24 39 32 25 48 45 46E N S P 3 5 0 0 0 2 1Total 30 27 44 32 25 48 47 47Diplômés ingénieurs des établissements privés sous contratE S A A 89 126 123 129 126 126 142 139E S A P 91 108 121 130 108 109 120 109I S A L - I T I A P E 89 108 99 118 100 99 93 122I S A B 92 117 115 118 115 121 116 124I S A R A 80 81 83 84 87 85 88 91E S I T P A 89 82 81 72 85 93 89 86E S B 30 41 52 43 47 48 68 71Total 560 663 674 694 668 681 716 742Ensemble Public 1628 1808 1855 1795 1801 1948 1790 1941Ensemble Privé 560 663 674 694 668 681 716 7421997 98 99 2000 01B T S 23 25 25 20D. biotech. 21 20 0 0Autre 2e cycle 19 79 127 142Mastères 130 153 234 174 199C E S A 15 14 37 10 23C E S I A 11 1 5 0 1C E S 109 61 58 151 171D N O 30 23 24 50 42D U 52 44 6 11C E A V 18 65 39 22 51D E S V 6 7 2 10D A AD E I A AD S H AAutres diplômes et titres480 472 Nd Nd 555D E A 136 302 252 181 175D E S S 34 44 62 43 43D E S vétérin. 6 23 0 0 0Maîtrise vétérin. 1 1 4 2Internat vétérin. 17 0Doctorats 119 120 146 132 148Docteurs vét. 434 444 414 411 472Professeurs 279 321 349 387 573Total général2188 2471 2529 2489 2469 2629 2506 2683238Evolution des effectifs de diplômés en formation de base6636817426356465605715785365185764845024784523741991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001ENSAENITENVEcoles privées
Les diplômés de l’enseignement supérieur long Croissance soutenue du nombre de diplômés des formations de base de l’enseignement supérieuragronomique et vétérinaire en 2001 : +7,1% Progression plus marquée pour les écoles publiques : +8,4% Se distinguent en ce sens l’INA-PG, l’ENITACF, l’ENESAD (FC), l’ENVT, l’IESIEL et l’ISALDe 1991 à 1995, le nombre de diplômés des formations de base de l’enseignement supérieuragronomique et vétérinaire, tous modes de formation confondus, est passé de près de 2190 à 2470,soit une progression de +12,9%.Durant cette période, la croissance du nombre de diplômés est un peu plus soutenue pourl’enseignement privé (+18,4% de 560 à 663 diplômés) que pour l’enseignement public (+11,1% de1628 à 1808), notamment en raison des évolutions positives observées pour l’ESAA (+42% ;+37 diplômés) ou l’ISAB (+27% ; +25 diplômés). Seule l’ESITPA montre alors un bilan négatifquant à l’évolution de sa population de diplômés. Dans le même temps, au sein de l’enseignementpublic, le groupe des ENIT (+38%), celui des écoles d’application (+26%) ou encore des ENSA(+18%) se révèlent très dynamiques, mais l’évolution des ENV (-16%) limite le développement deseffectifs de diplômés du public.Par la suite, de 1995 à 2000, le nombre de diplômés connaît des évolutions très fluctuantes :croissance en 1996 (+2,3%), en 1999 (+6,5%), recul en 1997 (-1,6%), en 1998 (-0,8%), en 2000(-4,7%). Ceci conduit toutefois à un bilan positif : +1,4% de 2471 à 2506 diplômés. Seull’enseignement privé voit alors ses promotions de diplômés globalement se développer, malgré làaussi des fluctuations d’une année à l’autre : +8% de 663 à 716 diplômés. L’ESB (+65,9%), l’ESAA(+12,7%) et l’ESAP (+11,1%) se distinguent alors positivement. Dans le public, le bilan s’avèrenégatif, la population de diplômés se resserrant quelque peu : -1% de 1808 à 1790 diplômés. Cettepériode est particulièrement dommageable aux centres de troisième cycle (-35,8%), aux écolesd’application (-23,1%) et aux ENSA (-3,2%).En 2001 se réamorce une dynamique. Le nombre de diplômés gagne +7,1% par rapport à l’année2000, de 2506 à 2683 diplômés. Cette année, le bénéfice de la croissance va en premier lieu àl’enseignement public (+8,4% de 1790 à 1941 diplômés), bien que la progression soit aussiremarquable dans le privé (+3,6% de 716 à 742 diplômés). Au sein du public, on repère notammentles évolutions positives des ENSA (+16,8%), et parmi elles de l’INA-PG (+17,4%), et des centres detroisième cycle (+26,5%). Dans les autres groupes d’écoles, on souligne aussi un nombre dediplômés en forte croissance pour l’ENITACF (+34,4% de 90 à 121), pour l’ENESAD (ITA-FC : de21 à 35 diplômés), pour l’ENVT (+18,3% de 109 à 129), de l’IESIEL (de 8 à 22 diplômés). Dans leprivé, on note le développement sensible de la promotion de l’ISAL (+31,2%).Les résultatsEn structure, en 2001, 72,3% des diplômés relèvent de l’enseignement public (pour 71,4% en 2000).Les titulaires du DEFV constituent près de 18% des diplômés de l’enseignement supérieuragronomique et vétérinaire. Les ENSA (5 écoles) rassemblent 24,1% (+2 points) des diplômés pour21,5% aux ENIT (8 écoles).RepèresCEAVCESCESACESIADAADEADEAVDEFVDEIAADESSDNODSHADUCertificat d’études approfondies vétérinairesCertificat d’études supérieuresCertificat d’études supérieures agronomiquesCycle d’enseignement supérieur en industries agroalimentairesDiplôme d’agronomie approfondieDiplôme d’études approfondiesDiplôme d’études approfondies vétérinairesDiplôme d’études fondamentales vétérinairesDiplôme d’études en industries agroalimentaires approfondiesDiplôme d’études supérieures spécialiséesDiplôme national d’oenologieDiplôme de sciences horticoles approfondiesDiplôme d’universitéENSAENITENVEcoles nationales supérieures agronomiquesEcoles nationales d’ingénieurs des travauxEcoles nationales vétérinairesVoir les intitulés des sigles des écoles en annexe.NB : Ont été soustraits de ce tableau, comparativement auxprésentations des rapports précédents de l’ONEA, les« diplômés » de l’ENFA, essentiellement enseignants.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement de l’enseignement et de la rechercheSous-direction de l’enseignement supérieur239
La poursuite d’étudesSur l’ensemble des élèvesrépondants à l’enquêtediplômés en...parmi ceux qui poursuivent oureprennent des études...199352,4% poursuiventou reprennentdes études36% obtiennent un BEPA et 1% un autre diplôme de niveau V4% obtiennent un diplôme de niveau IV directement après le CAPA(essentiellement BPREA)CAPAApprentissage199550,8% poursuiventou reprennentdes études33% obtiennent un BEPA et 2% un autre diplôme de niveau V14% obtiennent un diplôme de niveau IV directement après le CAPA(essentiellement BPREA)199754,2% poursuiventou reprennentdes études40% obtiennent un BEPA et 2% un autre diplôme de niveau V13% obtiennent un diplôme de niveau IV directement après le CAPA(essentiellement BP)199368,1% poursuiventou reprennentdes études46% obtiennent un BEPA5% un autre diplôme de niveau VCAPAVoie scolaire199560,2% poursuiventou reprennentdes études41% obtiennent un BEPA5% obtiennent un autre diplôme de niveau V3% obtiennent un diplôme de niveau IV directement après le CAPA199768,5% poursuiventou reprennentdes études48% obtiennent un BEPA5% obtiennent un autre diplôme de niveau V3% obtiennent un diplôme de niveau IV directement après le CAPA199276,7% poursuiventou reprennentdes études55% obtiennent un BTA8% obtiennent un bacBEPAVoie scolaire199479,0% poursuiventou reprennentdes études50% obtiennent un BTA11% obtiennent un bac2% obtiennent un BP REA199682,3% poursuiventou reprennentdes études27% obtiennent un BTA7% obtiennent un bac technologique (EA ou EN) ou général37% un bac pro (EA ou EN), soit 44% un bac1% obtiennent un BP REA199369,8% poursuiventou reprennentdes études53% obtiennent un BTSA5% obtiennent un autre diplôme de niveau IIIBTAVoie scolaire199560,0% poursuiventou reprennentdes études37% obtiennent un BTSA6% obtiennent un autre diplôme de niveau III199758,2% poursuiventou reprennentdes études35% obtiennent un BTSA4% obtiennent un BTS, un DUT ou un DEUG2% obtiennent un diplôme paramédical de niveau bac et supérieurBactechnologique199594,9% poursuiventou reprennentdes études70% obtiennent un BTSA5% obtiennent un autre diplôme de niveau IIIBacprofessionnel199545,4% poursuiventou reprennentdes études18% obtiennent un BTSA10% obtiennent un autre diplôme de niveau III199246,1% poursuiventou reprennentdes études58% préparent une formation diplômante43% préparent une formation courte type CS26% obtiennent un diplôme de niveau IIBTSAVoie scolaire199439,3% poursuiventou reprennentdes études67% préparent une formation diplômante33% préparent une formation courte type CSPour 70%, ce sont des formations courtesPour 30%, des formations longues25% obtiennent un diplôme de niveau II240199636,0% poursuiventou reprennentdes études72% préparent une formation diplômante28% préparent un certificat de spécialisationPour 56%, ce sont des formations courtesPour 44%, des formations longues32% obtiennent un diplôme de niveau II
Persévérance et performance dans les études des diplômésde l’enseignement secondaire et supérieur court Reprise de la poursuite d’études des diplômés de CAPA, notamment scolaires et amélioration desperformances ultérieures Le BEPA mène majoritairement les diplômés à des études ultérieures : 80% d’entre eux La persévérance et la performance des BTA ne cesse de se dégrader Les diplômés de BTSA poursuivent moins que précédemment des études, mais réussisent mieux lorsqu’ilss’y engagentLes présentes pages et celles qui suivent présentent les résultats des enquêtes réalisées, quatre ansaprès l’obtention de leur diplôme, auprès des promotions de CAPA et de BTA 1993, 1995 et 1997,de BEPA et de BTSA 1992, 1994 et 1996, ainsi que des promotions 1995 de baccalauréatprofessionnel et de baccalauréat technologique.CAPAEntre les promotions 1993 et 1995, le taux de poursuite d’études des diplômés de CAPA évoluait àla baisse, tant pour les scolaires (-7,9 points de 68,1% à 60,2%) que pour les apprentis (-1,6 pointsde 52,4% à 50,8%). On assiste à une reprise de ce taux de poursuite d’études pour la promotion 1997,en particulier pour les formés par la voie scolaire. Ce sont en effet 54,2% (+3,4 points) des apprentisdiplômés à cette date et surtout 68,5% (+8,3 points) des scolaires qui poursuivent ou reprennent desétudes ; ce qui interroge sur la finalité professionnelle de ce diplôme pour ces derniers.Parallèlement, leur performance dans les études ultérieures s’améliore : 40% des apprentisobtiennent finalement un BEPA (pour 33% des diplômés 1995) et 48% des scolaires (pour 41%auparavant).BEPALa poursuite d’études suite au BEPA ne cesse de se renforcer de 76,7% des diplômés en 1992, à 79%de la promotion 1994 et 82,3% de la promotion 1996. Le BEPA n’est plus un diplôme terminal quepour une minorité d’élèves. On note, de plus, pour la dernière promotion une nette amélioration dela performance suite au BEPA. 72% des jeunes diplômés en 1996 décrochent par la suite un diplômede niveau IV, les baccalauréats professionnels et technologiques prenant le relais du BTA : 50% desjeunes poursuivant des études suite à l’obtention d’un BEPA en 1994 obtenaient un BTA ; ils sont44% à décrocher un bac parmi les jeunes diplômés de BEPA en 1996 ayant poursuivi des études et27% un BTA.BTAOn notait, en comparant les promotions 1993 et 1995, une tendance à la baisse des poursuites etreprises d’études des diplômés de BTA, renforcée par la suppression des BTA G (généralistes). Cemouvement se confirme avec la promotion 1997 : 58,2% des diplômés poursuivent des études pour60% à la promotion 1995. De plus, la détérioration des performances ultérieures se poursuit ; seuls35% d’entre eux obtiennent un BTSA (-2 pts et -18 pts par rapport à la promotion 1993). Cephénomène est certainement accentué par la concurrence d’autres diplômés à l’entrée des BTSA.Les résultatsBTSALa tendance à la baisse des poursuites d’études suite au BTSA se confirme aussi : 46% des diplômésen 1992 pour seulement 36% des diplômés en 1996. De même, l’orientation accentuée vers desformations diplômantes (72% des poursuites d’études de la promotion 1996) et des formationslongues (44%) est avérée. Les jeunes réussissent mieux : 32% des diplômés de BTSA en 1996 quiont poursuivi des études obtiennent un diplôme de niveau II.RepèresRemarques méthodologiquesLes enquêtes sont réalisées sous la responsabilité del’ENESAD. Elles sont effectuées auprès des inscrits en classeterminale, près de quatre ans après la fin du cycle. Lesdonnées présentées ne concernent que les diplômés.Enquête 2001 sur les diplômés de CAPA en 1997Jusqu’en 1999, les enquêtes sur le devenir des diplômés deCAPA étaient exhaustives et se réalisaient par voie postale,comme cela est encore le cas pour les diplômés d’autresformations. Ce type d’enquêtes est apparu inadapté au public deCAPA. Afin d’améliorer la fiabilité des informations recueillies, unenouvelle procédure a été mise en place. Ainsi, l’enquête réaliséeen 2001 sur les diplômés de CAPA porte-t-elle sur un échantillonreprésentatif (un peu plus de 600 scolaires et 800 apprentis) dejeunes formés contactés par téléphone.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheEtablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD)241
L’insertion professionnelleLa situation des diplômés de CAPA et de BEPAprès de quatre ans après l’obtention de leur diplômeDiplômés uniquesRépartition (%)des diplômés uniquespar type de situationEmploi stableActivitéEmploi précaire(dont emploi aidé)TotalEmploiInactivitéStage Recherche d'emploi Etudes S. NatNonrecherched'emploiDiplôme Promo. H F Ens H F Ens Ens Ens H F Ens Ens Ens EnsCAPAApprentis.CAPAV. scolaireBEPA1991 47,4 31,9 45,8 25,7 22,7 25,4 71,2 2,1 13,6 29,9 15,3 5,7 4,8 0,91993 44,0 30,4 42,4 22,5 26,0 23,0 65,4 2,2 15,4 31,5 17,3 6,3 7,5 1,31995 54,7 37,8 52,5 25,5 22,4 25,1 77,6 2,0 12,2 28,6 14,3 1,2 3,8 1,11997 60,9 32,9 56,5 28,4 32,9 29,1 85,6 0,9 4,9 21,9 7,7 3,9 0,4 1,51991 35,4 33,6 34,4 32,3 30,1 31,0 65,4 2,4 14,5 25,5 20,8 3,8 4,2 3,41993 32,0 22,6 27,1 29,5 31,5 30,6 57,7 2,7 19,1 33,8 26,7 4,7 5,3 2,81995 36,4 23,1 28,8 39,7 26,5 32,2 61,0 2,5 17,2 34,8 27,3 1,8 3,2 5,31997 55,0 25,0 38,0 30,9 33,6 32,4 70,4 2,9 6,7 26,5 18,0 5,8 — 2,91990 46,5 44,7 45,6 26,9 30,1 28,5 74,1 2,6 6,0 15,7 10,8 5,8 5,4 1,31992 46,1 39,0 42,6 20,0 24,7 23,9 66,5 1,9 8,3 20,3 14,2 8,4 6,6 2,41994 44,0 33,9 38,5 26,3 35,8 31,4 69,9 1,5 7,5 16,7 12,5 8,9 4,9 2,31996 49,8 33,3 39,4 26,9 38,0 33,9 73,3 1,6 5,9 14,3 11,2 8,6 2,5 2,8L’indicateur de chômage des diplômés uniques quatre ans après l’obtention de leur diplôme par promotionEn %CAPAvoie scolaireCAPAApprentissage9193959791939523,530,730,119,717,219,515,3CAPAVoie scolaireCAPA App.Indicateur de chômageGarçonsFilles1991 17,1 27,91993 23,2 36,91995 18,3 39,51997 7,1 29,91991 15,3 33,71993 18,3 34,5BEPA97909294968,112,417,214,913,0BEPA1995 13,0 30,81997 5,2 24,21990 7,3 17,01992 10,7 23,11994 9,5 19,11996 7,0 16,4Le taux d’insertion des diplômés uniques quatre ans après l’obtention de leur diplôme par promotionEn %CAPAvoie scolaireCAPAApprentissage9193959791939567,860,463,473,373,471,479,6CAPAVoie scolaireCAPA App.Taux d'insertionGarçonsFilles1991 70,3 661993 63,1 57,91995 76,8 53,41997 87,9 62,21991 75,1 58,81993 68,6 59,8242BEPA979092949686,477,068,471,474,9BEPA1995 81,9 64,31997 89,8 68,51990 77,0 76,31992 69,1 67,61994 72,0 71,01996 78,7 72,7
La situation des diplômés uniques de niveau Vquatre ans après l’obtention de leur diplôme CAPA apprentis : Très nette amélioration de la situation des diplômés uniques avec un indicateur dechômage perdant plus de 7 points à 8% en 2001 CAPA scolaire : même si elle est toujours moins favorable que celle des apprentis, la situation des diplômésuniques de CAPA par la voie scolaire s’améliore de manière encore plus marquée, et l’emploi va vers plusde stabilité BEPA : Mouvements encore positifs pour les diplômés uniques de BEPA mais progression des emploisprécairesCAPA par l’apprentissageOn constatait une dégradation de la situation des diplômés uniques de CAPA par l’apprentissageentre les promotions 1991 et 1993 : hausse de l’indicateur de chômage (+2,3 points à 19,5%), baissedu taux d’insertion. Par la suite, on notait une amélioration nette de la situation pour les diplômés1995. L’indicateur de chômage reculait alors de 4,2 points. Le taux d’insertion progressait de plus de8 points. Pour la promotion 1997, interrogée au printemps 2001, les indicateurs témoignent d’unesituation encore plus favorable : l’indicateur de chômage s’établit à 8,1% (-7,2 pts), ce mouvementprofitant essentiellement aux garçons (5,2%), l’écart hommes-femmes se creusant (24,2% aux filles).Le taux d’insertion est renforcé à 86,4% (+6,8 pts). 56,5% des diplômés uniques bénéficient d’unemploi stable (+4 pts) ; 29,1% occupent un emploi précaire (+4 pts). Parallèlement, la non recherched’emploi a un peu progressé, mais reste faible (1,5%). La poursuite d’études concerne, elle, uneproportion quelque peu accrue de jeunes : 3,9% (+2,7 pts).CAPA scolairePour les CAPA formés par la voie scolaire, la détérioration de la situation des diplômés uniques, entreles promotions 1991 et 1993 s’avérait nettement plus marquée. L’indicateur de chômage augmentaitde +7,2 points à 30,7%. Le taux d’insertion était en recul de 7,4 points. La situation évoluait peu pourla promotion 1995 : -0,6 point à l’indicateur de chômage et +3 points à l’insertion. En revanche, lapromotion 1997 profite d’une plus nette embellie. L’indicateur de chômage chute de 10,4 points ; letaux d’insertion progresse de +9,9 points. Reste que ce sont encore les garçons qui en bénéficient enpremier lieu (indicateur de chômage à 7,1% pour 29,9% aux filles). Ce sont ainsi 70,4% desdiplômés uniques qui sont en emploi en 2000 ; 38% en emploi stable, la part de ces emploisprogressant davantage (+9,2 pts) que les emplois précaires (+0,2 pt). Conjointement, la proportionde jeunes toujours en situation d’études a crû de 4 points à 5,8% des diplômés uniques. En revanche,moins de jeunes ne recherchent pas d’emploi (2,9% ; -2,4 pts).BEPADans le sens des évolutions déjà notées pour les diplômés de CAPA, on soulignait précédemmentune situation dégradée pour les diplômés uniques de BEPA en 1992 par rapport à la promotion 1990 :un indicateur de chômage en progression de 4,8 points à 17,2% ; un taux d’insertion réduit de8,6 points à 68,4%. Par la suite, la promotion 1994 profitait déjà d’un mouvement positif avecun indicateur de chômage en recul de 2,3 points (14,9%) et un taux d’insertion accru de 3 points.L’amélioration se confirme en 2000 pour la promotion 1996. L’indicateur de chômage perdencore près de 2 points (13%). Le taux d’insertion gagne 3,5 points à 74,9%. Ainsi, ce sont73,3% (+3,4 pts) des diplômés uniques qui sont en emploi en 2000. Les emplois précairesprogressent cependant plus que les emplois stables (+2,5 pts à 33,9% pour +0,9 pt à 39,4% auxemplois stables).Les résultatsRepèresDiplômés uniquesPopulation activeTaux d’insertionTaux de chômageSourcesDiplômés entrés directement sur le marché dutravail après l’obtention de leur titre oupoursuivant des études sans obtenir undiplôme de niveau supérieur à celui du diplômeconsidéré.Enquêtés en situation d’emploi, de stage ou derecherche d’emploi.= (population active - demandeurs d’emploi)/ population totale des diplômés uniques= demandeurs d’emploi / population activeEnquête 2001 sur les diplômés de CAPA en 1997Jusqu’en 1999, les enquêtes sur le devenir des diplômés deCAPA étaient exhaustives et se réalisaient par voie postale,comme cela est encore le cas pour les diplômés d’autresformations. Ce type d’enquêtes est apparu inadapté au publicde CAPA. Afin d’améliorer la fiabilité des informationsrecueillies, une nouvelle procédure a été mise en place. Ainsi,l’enquête réalisée en 2001 sur les diplômés de CAPA porte-tellesur un échantillon représentatif (un peu plus de 600scolaires et 800 apprentis) de jeunes formés contactés partéléphone.Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheEtablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD)243
L’insertion professionnelleLa situation des diplômés de BTA, baccalauréat technologique, baccalauréat professionnel et BTSAprès de quatre ans après l’obtention de leur diplômeDiplômés uniquesRépartition (%)des diplômés uniquespar type de situationEmploi stableActivitéEmploi précaire(dont emploi aidé)TotalEmploiInactivitéStage Recherche d'emploi Etudes S. NatNonrecherched'emploiDiplôme Promo. H F Ens H F Ens Ens Ens H F Ens Ens Ens Ens1991 53,6 47,3 51,7 23,4 24,3 23,7 75,4 4,0 5,6 14,1 8,1 5,5 5,8 1,2BTA1993 63,2 45,4 58,2 17,9 27,9 19,9 78,1 3,6 5,2 16,1 8,3 4,4 4,7 1,01995 69,3 41,2 58,1 17,0 36,1 24,7 82,8 2,0 5,3 13,1 8,4 3,8 2,0 1,01997 70,5 43,7 59,5 19,5 36,8 26,6 86,1 1,6 2,5 8,5 5,0 5,0 1,1 1,2Bac techno 1995 41,2 26,4 37,3 22,1 30,6 24,3 61,6 3,3 5,7 16,5 8,6 16,4 8,1 2,0Bac pro 1995 60,9 57,6 58,8 — — 21,4 80,2 0,6 — — 15,0 2,1 0,0 2,11990 74,3 71,8 73,9 18,3 17,7 18,1 92,0 1,2 3,9 8,0 4,8 1,1 0,6 0,2BTSA1992 76,6 58,2 72,0 15,4 23,6 17,4 89,4 1,7 4,7 12,2 6,6 1,3 0,6 0,41994 78,9 61,4 73,8 14,4 22,8 16,9 90,7 0,9 3,7 8,8 5,2 2,1 0,6 0,51996 77,2 60,9 72,3 16,5 27,2 19,7 92,0 0,9 2,9 6,1 3,8 1,9 0,3 1,0L’indicateur de chômage des diplômés uniques quatre ans après l’obtention de leur diplôme par promotionEn %BTA919,3Bac techno.Bac pro.BTSA93959795959092949,29,15,311,615,64,96,75,4Indicateur de chômageGarçons FillesBTA 1991 6,4 15,91993 5,8 17,71995 5,6 14,21997 2,7 9,4Bac techno. 1995 7,8 22,0Bac pro. 1995 11,6 18,2BTSA 1990 4,0 8,11992 4,8 12,71994 3,8 9,31996 2,9 6,4963,9244Le taux d’insertion des diplômés uniques quatre ans après l’obtention de leur diplôme par promotionEn %BTABac techno.Bac pro.BTSA9193959795959092949664,979,481,784,780,787,793,291,191,693,0BTATaux d'insertionGarçonsFilles1991 81,5 74,41993 84,3 74,91995 88,7 78,61997 92,0 81,6Bac techno. 1995 67,2 58,7Bac pro. 1995 88,4 76,31990 93,8 90,6BTSA 1992 93,5 83,81994 94,1 85,61996 94,6 89,1
La situation des diplômés uniques de niveaux IV et IIIquatre ans après l’obtention de leur diplôme Après une période de relative stabilité, amélioration significative de la situation des diplômés de BTA pourla promotion 1997 enquêtée en 2001 La situation des diplômés de BTSA de la promotion 1996 enquêtée en 2000 est encore meilleure que cellede la promotion 1994 ; mais la précarité des emplois gagne du terrainBTAEn termes d’indicateur de chômage, la situation des diplômés uniques de BTA évoluait très peu entreles promotions 1991, 1993 et 1995 : -0,1 point entre chaque promotion à 9,1% en 1999. Le tauxd’insertion montrait juste une évolution positive plus nette (+2,3 points puis +3 points à 84,7% en1999), les poursuites d’études et la mobilisation au service national s’effaçant quelque peu au profitdes situations d’emplois.Pour la promotion 1997, au contraire, l’amélioration de la situation des diplômés uniques est trèssignificative. Tout d’abord l'indicateur de chômage perd 3,8 points se fixant à seulement 5,3%.Parallèlement, le taux d’insertion progresse de 3 points à 87,7%. Ce redressement de la situation desdiplômés uniques de BTA réduit à juste 2,7% l’indicateur de chômage des garçons et, s’il est pourles filles plus élevé (9,4%), il se rétracte d’autant plus (-4,8 points). Plus de 86% (+3,3 points) desdiplômés uniques de BTA sont en emploi ; 59,5% bénéficient d’un emploi stable (+1,4 points), soitprès de 70% des jeunes en emploi.Dans le même temps, la poursuite d’études quatre ans après l’obtention de leur diplôme se fait unpeu plus présente (+1,2 points à 5%) et le service national recule (-0,9 point à 1,1%).BTSASuite à une détérioration de la situation des diplômés uniques de BTSA entre les promotions 1990 et1992 — indicateur de chômage en hausse de 1,8 points à 6,7% et taux d’insertion en baisse de2,1 points à 91,1% —, on notait, pour la promotion 1994, une évolution à nouveau positive puisquel’indicateur de chômage perdait 1,3 points (à 5,4%) et que le taux d’insertion gagnait 0,5 point (à91,6%).Ce mouvement se poursuit pour la promotion 1996. L’indicateur de chômage tombe à 3,9%(-1,5 points), tandis que le taux d’insertion atteint 93% (+1,4 points). Dans ce contexte, les fillesbénéficient d’une évolution privilégiée : leur indicateur de chômage régresse de 2,9 points (à 6,4%)pour -0,9 point aux garçons (à 2,9%). Cette embellie passe toutefois par une plus grande précaritédes emplois. En effet, en 2000, ce sont 72,3% des diplômés uniques qui déclarent un emploi stable(-1,5 points), pour 19,7% un emploi précaire (+2,8 points). En outre, si la part des poursuitesd’études, quatre ans après l’obtention du diplôme, varie peu, on note une petite progression de la partde diplômés qui font le choix de ne pas travailler : +0,5 point aux non recherches d’emplois.Les résultatsRepèresDiplômés uniquesPopulation activeTaux d’insertionTaux de chômageDiplômés entrés directement sur le marché dutravail après l’obtention de leur titre oupoursuivant des études sans obtenir undiplôme de niveau supérieur à celui du diplômeconsidéré.Enquêtés en situation d’emploi, de stage ou derecherche d’emploi.= (population active - demandeurs d’emploi)/ population totale des diplômés uniques= demandeurs d’emploi / population activeSourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheEtablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD)245
L’insertion professionnelleLes emplois des diplômés uniques de CAPA :répartition par catégorie d’emploisEn % des emploisCAPA scolaire1,7AgriculteurPromotion 1995 enquêtée en 19991995 19971,6Hommes Femmes Hommes FemmesPromotion 1997 enquêtée en 20013,3Eff % Eff % Eff % Eff %Aide familial0,4Agriculteur 7 2,9 1 0,5 2 1,6 2 1,7Agent surveillance Militaire 6,1Aide familial 12 4,9 3 1,4 1 0,8Employé FP Administratif11,1 Agt surveil. Militaire Employé FP Adm. 7 2,9 21 9,7 11 8,6 16 13,9Employé santé social 27 12,5 2 1,6 22 19,15,9Employé santé socialEmployé de commerce 10 4,1 34 15,7 1 0,8 24 20,99,9Employé services particuliers 1 0,4 43 19,9 8 7,09,5Employé de commerceOuvrier paysagiste agricole 111 45,3 23 10,7 68 53,1 10 8,710,3Ouvrier IAA 13 5,3 18 8,3 4 3,1 11 9,69,5 Autre ouvrier 80 32,6 46 21,3 38 29,7 20 17,4Employé services personnes3,3Autre divers 4 1,6 1 0,8 2 1,729,1Ouvrier paysagiste agricole32,1CAPA apprentisAgriculteurAide familialAgent surveillance MilitaireEmployé FP AdministratifEmployé santé socialservices personnesEmployé de commerceOuvrier paysagiste agricoleOuvrier IAAAutre ouvrierOuvrier IAAAutre ouvrierAutre divers5,12,31,01,81,30,91,25,94,64,94,63,25,24,36,76,221,628,323,927,352,550,1CAPA scolaireCAPA apprentissagePromotion 1995 enquêtée en 19991995 1997Hommes Femmes Hommes FemmesPromotion 1997 enquêtée en 2001Eff % Eff % Eff % Eff %Agriculteur 33 6,2 2 3,4 18 5,3Aide familial 29 5,5 1 1,7 7 2,1 2 4,2Agt surveil. Militaire Employé FP Adm. 25 4,7 4 6,8 17 5,0 1 2,1Employé santé social S. personnes 2 0,4 4 6,8 1 0,3 6 12,5Employé de commerce 5 0,9 14 23,7 8 2,3 12 25,0Ouvrier paysagiste agricole 282 53,2 27 45,7 177 51,9 18 37,5Ouvrier IAA 22 4,2 3 5,1 5 1,5Autre ouvrier 123 23,2 4 6,8 101 29,6 9 18,8Autre divers 9 1,7 7 2,1Autre divers1,51,8246Les emplois des diplômés uniques de BEPA :répartition par catégorie d’emploisEn % des emploisAgriculteurAide familialEmployé FP AdministratifEmployé santé socialEmployé de commerceEmployé servicespersonnesOuvrier agricolepaysagisteOuvrier IAAAutre ouvrier4,53,24,12,43,24,09,58,811,87,211,511,515,315,917,017,122,321,0Promotion 1994 enquêtée en 1998Promotion 1996 enquêtée en 2000BEPA1994 1996Hommes Femmes Hommes FemmesEff % Eff % Eff % Eff %Agriculteur 118 9,0 11 0,7 75 7,1 12 0,7Aide familial 108 8,2 10 0,6 60 5,7 6 0,4Employé FP Administratif 85 6,5 352 22,7 92 8,7 168 10,0Employé santé social 17 1,3 313 20,2 27 2,5 587 34,8Employé de commerce 48 3,7 204 13,1 53 5,0 270 16,0Employé services personnes 23 1,7 306 19,7 1 0,1 198 11,7Ouvrier agricole paysagiste 520 39,7 80 5,2 372 35,1 65 3,8Ouvrier IAA 39 3,0 53 3,4 37 3,5 73 4,3Autre ouvrier 306 23,4 179 11,5 264 24,9 207 12,3Autre divers 46 3,5 44 2,8 79 7,5 102 6,0
Les emplois des diplômés uniques de niveau Vquatre ans après l’obtention de leur diplôme Emplois d’ouvriers agricoles ou paysagistes dominants pour les CAPA scolaires ; mais progression de lacatégorie des employés, en particulier de la fonction publique, administratifs, de la santé et du social Emplois d’ouvriers agricoles ou paysagistes majoritaires pour les CAPA apprentis ; progression globale desemplois d’ouvriers, notamment des ouvriers autres qu’agricoles ou des IAA Les employés deviennent majoritaires parmi les diplômés uniques de BEPA, par le biais de la croissanceparticulière des emplois dans la santé, le social et le commerce De manière générale, les filles sont plus fréquemment employées, les garçons ouvriers ; ceci tournant àdes positions dominantes pour les CAPA scolaires et les BEPACAPA scolairesLes emplois d’ouvriers agricoles ou paysagistes sont dominants (32,1%), leur poids dans le total desemplois des diplômés uniques de CAPA en 1997 progressant même de quelques points (+3 points).Parallèlement, on assiste à une très légère baisse des emplois d’ouvriers des IAA (-0,5 point à 6,2%)et surtout à un recul des emplois d’ouvriers autres (-3,4 pts à 23,9%). Au total, la catégorie desouvriers se replie un petit peu (-0,9 pt à 62,2%). Dans le même temps, les employés se font plusnombreux dans cette population : +3,6 points à 34,6%. Ce sont surtout les employés de la fonctionpublique, administratifs, militaires et agents de sécurité qui gagnent du terrain (+5 pts à 11,1%), ainsique les employés de la santé et du social (+4 pts à 9,9%). C’est aussi le cas des employés decommerce, bien que plus faiblement (+0,8 pt à 10,3%). En revanche, la catégorie des employés desservices aux personnes se réduit très sensiblement : -6,2 points à 3,3%. Le nombre d’agriculteursvarie peu (-0,1 pt à 1,6%), mais on compte moins d’aides familiaux (-2,9 pts à 0,4%). L’examen dela distribution des emplois par sexe montre une différenciation nette entre hommes et femmes dansle rapport des catégories d’ouvriers et d’employés : 85,9% des hommes sont ouvriers, catégorie enprogression pour cette population (+2,7 pts) ; 60,9% des femmes, employées (+3,1 pts).CAPA apprentisLa majorité (50,1%) des diplômés uniques en 1997 sont ouvriers agricoles ou paysagistes auprintemps 2001, bien que cette population se réduise quelque peu en structure (-2,4 points). Uneseconde catégorie domine largement, et se développe : celle des ouvriers autres (+6,7 pts à 28,3%).Elles rassemblent ainsi à elles seules près de 80% des emplois. Minoritaires, la plupart des autresgroupes d’emplois sont en recul : en premier lieu les ouvriers des IAA (-3 pts à 1,3%) et les aidesfamiliaux (-2,8 pts à 2,3%), mais aussi les agriculteurs (-1,3 pts à 4,6%) et les employés de lafonction publique, administratifs, militaires, agents de surveillance (-0,3 pt à 4,6%). En revanche, lesemplois dans le commerce se développent (+2 pts à 5,2%) et plus modestement les emplois de lasanté et du social (+0,8 pt à 1,8%). Contrairement aux diplômés de CAPA scolaire, la catégorie desouvriers reste dominante pour les deux sexes. On constate toutefois un poids des ouvriers bien plusfort pour les garçons (83% en progression de 2,4 pts pour 56,3% aux filles) et une part d’employésloin d’être négligeable pour les filles (39,6% en progression de 2,3 pts pour 7,6% aux garçons).Les résultatsBEPAAu premier plan pour les BEPA diplômés uniques en 1996, les emplois dans le secteur de la santé etdu social sont en forte progression : +10,8 points à 22,3%. Autre catégorie tertiaire, les emplois dansle commerce se font aussi davantage présents ; ils gagnent 3 points à 11,8%. Les autres catégoriesd’employés sont, elles, en recul : -5,8 points aux employés de la fonction publique et administratifs(à 9,5%), -4,3 points aux employés des services aux personnes (à 7,2%). Au total, les employésgagnent du terrain ; ils constituent 50,8% (+3,7 pts) de la population des diplômés uniques de BEPAconsidérée. Parmi les emplois d’ouvriers, globalement en retrait (-4,2 pts à 37%), la catégorie desouvriers autres est stable. En revanche, celle des ouvriers agricoles et paysagistes se resserre (-5,1 ptsà 15,9%) alors que celle des ouvriers des IAA se développe un peu (+0,8 pt à 4%). Par ailleurs, ondénombre moins d’agriculteurs (-1,3 pts à 3,2%) et d’aides familiaux (-1,7 pts à 2,4%). Lesdifférenciations hommes-femmes sont nettes pour le BEPA : domination des ouvriers parmi lesgarçons (63,5% ; -2,6 pts), des employés parmi les filles (72,5% ; -3,2 pts).RepèresDiplômés uniquesIAAFPSourcesDiplômés entrés directement sur le marché du travailaprès l’obtention de leur titre ou poursuivant desétudes sans obtenir un diplôme de niveau supérieur àcelui du diplôme considéré.Industries agroalimentairesFonction publiqueAutre divers :CAPAArtisan, commerçant, agent de maîtrise, technicocommercial,technicien, moniteur, animateurBEPAArtisans, commerçants, cadres, personnels éducatifs,professions intermédiaires de santé, social et fonctionpublique, administratif, de même que les technicocommerciaux,agents de maîtrise et techniciens.Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheEtablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD)247
L’insertion professionnelleLes emplois des diplômés uniques de BTA :répartition par catégorie d’emploisEn % des emploisAgriculteurAide familialCadre Artisan CommerçantPersonnel éducatifP.I. santé socialP.I. administration commerceTechnicienAgent de maîtriseAgent Fonction publiqueEmployé administratifEmployé de commerceEmployé santé socialEmployé services personnesOuvrier IAAOuvrier paysagiste agricoleAutre ouvrier0,60,61,84,12,23,57,05,22,93,02,62,32,03,03,34,63,63,09,07,58,812,05,41,52,32,39,710,820,217,018,619,6Promotion 1995 enquêtée en 1999Promotion 1997 enquêtée en 2001BTA1995 1997Hommes Femmes Hommes FemmesEff % Eff % Eff % Eff %Agriculteur 557 29,8 41 3,8 540 26,0 30 2,3Aide familial 199 10,6 8 0,7 164 7,9 10 0,8Cadre Artisan Commerçant 9 0,5 9 0,8 12 0,6 9 0,7Personnel éducatif 20 1,1 34 3,1 31 1,5 105 8,1PI santé social 23 1,2 43 3,9 32 1,6 86 6,7PI administration commerce 67 3,6 19 1,7 69 3,3 33 2,6Technicien 49 2,6 29 2,7 49 2,4 29 2,2Agent de maîtrise 52 2,8 6 0,5 94 4,5 7 0,5Agent Fonction publique 60 3,2 38 3,5 88 4,3 67 5,2Employé administratif 9 0,5 97 8,9 11 0,5 91 7,1Employé de commerce 82 4,4 184 16,9 79 3,8 174 13,5Employé santé social 10 0,5 250 22,9 21 1,0 383 29,7Employé services particuliers 8 0,4 152 13,9 1 0,1 49 3,8Ouvrier IAA 39 2,1 28 2,6 38 1,8 39 3,0Ouvrier paysagiste agricole 486 26,0 66 6,0 583 28,1 77 6,0Autre ouvrier 199 10,6 88 8,1 262 12,6 101 7,8Les emplois des diplômés uniques de BTSA :répartition par catégorie d’emploisEn % des emploisAgriculteur Aide familial19,417,9Cadre ArtisanCommerçantPersonnel éducatif2,31,13,02,3Promotion 1994 enquêtée en 1998Promotion 1996 enquêtée en 2000P. I. santé social1,82,7P.I. FP et administration2,61,9248Technico-commercialTechnicienAgent de maîtriseEncadrementEmployé Fonctionpublique AdministratifEmployé santé socialservices personnesEmployé de commerceOuvrier agricolepaysagisteOuvrier IAAAutre ouvrier0,23,03,85,95,55,55,03,84,97,98,07,57,914,017,3BTSA1994 199620,0Hommes Femmes Hommes Femmes24,8Eff % Eff % Eff % Eff %Agriculteur Aide familial 575 23,8 69 7,6 495 22,5 58 6,6Cadre Artisan Commerçant 60 2,5 14 1,5 25 1,1 8 0,9Personnel éducatif 58 2,4 43 4,7 36 1,6 34 3,8P. I. santé social* 31 1,3 29 3,2 41 1,9 42 4,7P.I. FP et administration* 46 1,9 39 4,3 22 1,0 37 4,2Technico-commercial 446 18,4 130 14,4 323 14,7 108 12,2Technicien 427 17,7 236 26,1 480 21,8 284 32,1Agent maîtrise Encadrement 227 9,4 35 3,9 212 9,6 36 4,1Employé F. publique Adm. 91 3,8 105 11,6 95 4,3 76 8,6Employé santé social S pers. 1 — 6 0,7Employé de commerce 59 2,4 124 13,7 61 2,8 93 10,5Ouvrier agricole paysagiste 212 8,8 37 4,1 206 9,4 39 4,4Ouvrier IAA 76 3,1 25 2,8 85 3,9 32 3,6Autre ouvrier 108 4,5 19 2,1 118 5,4 32 3,6
Les emplois des diplômés uniques de niveaux IV et IIIquatre ans après l’obtention de leur diplôme Davantage d’emplois dans la catégorie des professions intermédiaires pour les diplômés uniques de BTA,mais aussi d’ouvriers La catégorie des employés et celle des professions intermédiaires intéressent prioritairement les femmes,tandis que les emplois d’ouvriers concernent surtout les hommes Domination des professions intermédiaires pour les BTSA, mais progression conjointe des emploisd’ouvriersRepèresBTAOn assiste, pour l’ensemble des diplômés uniques de BTA, entre les promotions 1995 et 1997, à unenouvelle progression des emplois d’ouvriers, ceux-ci se révélant dominants en 2001 : +2,1 points à32,7%. Plus précisément, ce sont les emplois d’ouvriers agricoles ou paysagistes (+1 pt à 19,6%) etd’ouvriers autres (+1,1 pts à 10,8%) qui se font plus fréquents. Parallèlement, les employés sont unpeu moins présents (-1,5 pts à 28,6%). Seules les catégories des employés de la fonction publique(+1,3 pts à 4,6%) et des employés de la santé et du social (+3,2 pts à 12%) montrent un mouvementpositif. Au-delà de ces groupes prédominants, les emplois d’agriculteurs (-3,2 pts à 17%) et d’aidesfamiliaux (-1,8 pts à 5,2%) perdent du terrain. Reste une progression non négligeable des professionsintermédiaires (+4,4 pts à 15,9%), qui résulte essentiellement d’un poids accru des personnelséducatifs (+2,3 pts à 4,1%), des professions intermédiaires liées à la santé et au social (+1,3 pts à3,5%) et des agents de maîtrise (+1 pt à 3%).La distribution des emplois est cependant très différenciée selon le sexe. Ainsi domine pour lesfemmes la catégorie des employés (59,2%), malgré un recul entre les deux promotions considérées(-6,9 points), et au sein de cette catégorie les employés de commerce (13,5% ; -3,4 pts) et lesemployées de la santé et du social (29,7% ; +6,8 pts). Pour les hommes, les emplois d’ouvriers sontau premier rang (42,5%) et en progression (+3,8 pts) ; et parmi eux les emplois d’ouvriers agricolesou paysagistes (28,1% ; +2,1 pts). A noter enfin le poids, bien qu’en retrait (-3,8 pts), des agriculteursdans la population masculine : 26%.BTSAS’agissant des diplômés uniques de BTSA, la catégorie des professions intermédiaires est dominanteen 2000 (53,7%) et en progression (+1,1 pts) entre les promotions 1994 et 1996. Ce sont les emploisde techniciens qui sont le plus représentés (24,8%), et qui se développent le plus (+4,8 pts). Viennentensuite les technico-commerciaux (14%) ; ceux-ci se montrant cependant en retrait (-3,3 pts). Autregroupe important parmi ces professions intermédiaires, les agents de maîtrise constituent 8,8% de lapopulation (stable). Fait marquant, c’est aujourd’hui parmi les diplômés de BTSA que l’on trouve,en relatif, le plus d’agriculteurs et aides familiaux, même si cette catégorie est quelque peu en recul :ils comptent pour 17,9% des BTSA uniques en emploi en 2000 (-1,5 pts). Parallèlement, si lesprofessions intermédiaires ont un poids accru, c’est aussi le cas de la catégorie des ouvriers (16,6% ;+2,3 pts), les ouvriers agricoles et paysagistes étant plus nombreux (7,9%), mais les ouvriers autresprogressant davantage (+1,1 pts à 4,9%), de même que les ouvriers des IAA (+0,8 pt à 3,8%). Lesemployés, minoritaires (10,7%), se font, eux, un peu moins nombreux (-0,7 pt). L’analyse de ladistribution des emplois selon le sexe montre que les professions intermédiaires ont une plus grandeplace dans les emplois féminins (61,1% contre 50,6% aux hommes) et qu’elles progressent demanière significative (+4,5 pts), en particulier au détriment de la catégorie des employés qui resteféminine (19,8% des femmes pour seulement 7,1% des emplois des hommes). A l’inverse, c’estparmi les hommes que les agriculteurs et aides familiaux sont prioritairement recensés (22,5% deleurs emplois pour 6,6% aux filles). C’est aussi le cas concernant les ouvriers (18,6% pour 11,6%aux femmes).Les résultatsDiplômés uniquesIAAP.I.FPSourcesDiplômés entrés directement sur le marché dutravail après l’obtention de leur titre oupoursuivant des études sans obtenir undiplôme de niveau supérieur à celui du diplômeconsidéré.Industries agroalimentairesProfession intermédiaireFonction publiqueBTSA :Professions intermédiaires de santé et socialesProfessions intermédiaires de santé pour la promotion1992Professions intermédiaires de la fonction publique etadministrativesProfessions intermédiaires de gestion pour la promotion1992Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheEtablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD)249
L’insertion professionnelleRépartition des emplois des diplômés uniques de CAPAselon le secteur d’activité de l’entreprise employeurEn % des emplois près de quatre ans après l’obtention du diplômeCAPA scolaireProductions agricolesProductions forestières et liées à l'aménagementIndustries liées à l'agricultureAutres industriesCommerce lié à l'agriculture et au milieu ruralAutre commerceServices liés à l'agriculture et au milieu ruralServices liés à l'aménagement et l'environnementAutres services17,111,26,75,47,15,013,513,76,99,56,75,88,913,77,58,3Promotion 1995 enquêtée en 1999CAPA scolairePromotion 1997 enquêtée en 20011995 1997H F H FProductions agricoles 23,7 9,8 15,0 7,0Productions forestières et liées à l'aménagement 11,9 0,9 9,4 0,9Industries liées à l'agriculture 6,4 7,9 3,1 7,0Autres industries 17,0 9,8 17,3 9,6Commerce lié à l'agriculture et au milieu rural 5,1 8,9 2,4 17,5Autre commerce 4,2 9,4 3,1 8,8Services liés à l'agriculture et au milieu rural 5,5 12,6 14,2 13,2Services liés à l'aménagement et l'environnement 13,1 1,4 15,0 0,9Autres services 13,1 39,3 20,5 35,125,627,4CAPA apprentisProductions agricolesProductions forestières et liées à l'aménagementIndustries liées à l'agricultureAutres industriesCommerce lié à l'agriculture et au milieu ruralAutre commerceServices liés à l'agriculture et au milieu ruralServices liés à l'aménagement et l'environnementAutres services14,215,45,61,511,217,94,06,91,23,63,75,19,312,311,010,726,639,8Promotion 1995 enquêtée en 1999Promotion 1997 enquêtée en 2001CAPA apprentissage1995 1997H F H FProductions agricoles 39,6 42,4 27,4 20,8Productions forestières et liées à l'aménagement 15,8 17,2 2,1Industries liées à l'agriculture 5,5 6,8 1,7Autres industries 12,1 3,4 18,4 14,6Commerce lié à l'agriculture et au milieu rural 2,7 15,2 5,0 20,8Autre commerce 0,6 6,8 3,5 4,2Services liés à l'agriculture et au milieu rural 3,1 8,5 3,2 18,8Services liés à l'aménagement et l'environnement 9,9 3,4 13,1 6,3Autres services 10,7 13,5 10,5 12,5Répartition des emplois des diplômés uniques de BEPAselon le secteur d’activité de l’entreprise employeurEn % des emplois près de quatre ans après l’obtention du diplôme250BEPAProductions agricolesProductions forestières et liées à l'aménagementIndustries liées à l'agricultureAutres industriesCommerce lié à l'agriculture et au milieu ruralAutre commerceServices liés à l'agriculture et au milieu ruralServices liés à l'aménagement et l'environnementAutres services4,04,83,713,710,67,97,714,7Rappel comparatifselon l’ancienne nomenclaturePromotion 1996 enquêtée en 2000BEPA1996H FProductions agricoles 29,4 3,9Productions forestières et liées à l'aménagement 10,3 0,1Industries liées à l'agriculture 4,8 4,8Autres industries 13,5 8,8Commerce lié à l'agriculture et au milieu rural 6,0 9,1Autre commerce 4,3 9,8Services liés à l'agriculture et au milieu rural 6,1 20,1Services liés à l'aménagement et l'environnement 8,2 0,9Autres services 17,4 42,5BEPA90 92 94 96Production agricole 34,3 30,6 24,2 17,7Activités liées à l'agriculture 20,0 13,8 13,3 18,3Tertiaire et autres activités non liées à l'agriculture 39,5 48,3 54,4 53,1Industries non liées à l'agriculture 6,2 7,3 8,1 10,9
Les secteurs d’activité des diplômés uniques de niveau Vquatre ans après l’obtention de leur diplôme Tertiarisation des emplois des CAPA scolaires, mais activités liées à l’agricole et au rural demeurantdominantes Le secteur production est toujours au premier plan pour les CAPA apprentis, mais en recul toutefois ;activités liées à l’agricole et au rural majoritaires Forte dominante tertiaire pour les BEPA ; des activités non liées à l’agricole et au rural devenant majoritairesCAPA scolaireEntre les promotions 1995 et 1997, on constate une tertiarisation des emplois des diplômés uniquesde CAPA par la voie scolaire. Ce sont ainsi 64,7% (+9,2 pts) des emplois qui relèvent d’entreprisesliées au commerce ou aux services, tandis que 16,6% (-7,2 pts) ont pour champs d’activité lesproductions agricoles et forestières et 18,7% (-2 pts) l’industrie. Sont en effet en recul, en premierlieu, les productions agricoles (-5,9 pts à 11,2%), les productions forestières (-1,3 pts à 5,4%) et lesindustries liées à l’agriculture (-2,1 pts à 5%). Ce sont les secteurs du commerce lié à l’agriculture etau monde rural (+2,6 pts à 9,5%), mais surtout des services liés (+4,8 pts à 13,7%), ainsi que lesservices autres (+1,8 pts à 27,4%) qui se révèlent les plus dynamiques. Ces services autresapparaissent ainsi dominants, suivis à égalité des services liés à l’agricole et au rural et des industriesautres. De manière générale, les activités liées à l’agriculture et au monde rural restent dominantes(53,1%), bien qu’en retrait (-1,1 pts). Des différenciations importantes sont observées selon le sexe :d’une part les activités liées à l’agricole et au rural dominent pour les seuls garçons (59,1% de leursemplois en relèvent pour 46,5% aux filles), d’autre part le tertiaire concerne beaucoup plus les filles(75,5% pour tout de même 55,1% aux garçons). Enfin, les productions agricoles et forestières sontavant tout masculines (24,4% des emplois des garçons pour 7,9% aux filles).CAPA apprentisLa tertiarisation des emplois se vérifie aussi concernant les diplômés uniques de CAPA parl’apprentissage ; ce champ gagne +9,4 points entre les promotions 1995 et 1997. Néanmoins,contrairement au cas des scolaires, le tertiaire n’est guère dominant (38,6%). Les productionsagricoles et forestières restent ainsi au premier plan (41,9% des emplois). Elles ne sont cependantplus majoritaires. Plus précisément, sont en recul les secteurs des productions agricoles (-13,2 pts à26,6%) et des industries liées à l’agriculture (-4,1 pts à 1,5%). Progressent à l’inverse les secteurssuivants : autres industries (+6,7 pts à 17,9%), services liés à l’aménagement et l’environnement(+3 pts à 12,3%), commerce lié à l’agriculture et au monde rural (+2,9 pts à 6,9%), autre commerce(+2,4 pts à 3,6%). On retrouve ainsi en tête des secteurs : les productions agricoles, les industriesautres que liées à l’agriculture, les productions forestières et les services liés à l’aménagement. Lesactivités, qu’elles soient primaires, secondaires ou tertiaires, liées à l’agriculture et au monde ruralsont ainsi majoritaires (67,8%), bien que les activités non liées progressent (+8,8 pts à 32,2%). Pource qui est des secteurs d’emploi selon le sexe, les emplois tertiaires ne sont dominants que pour lesfilles (62,6% contre 35,3% aux garçons), alors que les productions agricoles et forestièresrassemblent la majeure partie des emplois masculins (44,6% ; 22,9% aux filles). D’autre part, lesactivités liées à l’agricole et au rural sont ici majoritaires pour les deux sexes et ce de manièreéquivalentes (67,6% pour les garçons ; 68,8% pour les filles).Les résultatsBEPALa tertiarisation des emplois ne fait que se confirmer pour la promotion 1996 : 66,9% des emplois.La part belle revient plus précisément aux services : services autres (32,9%), services liés àl’agriculture et au monde rural (14,7%). Le secteur primaire se place au second rang (17,7%), enpremier lieu les productions agricoles (13,7%). Cependant, au total, ce sont les activités non liées àl’agricole et au rural qui dominent, de peu : 51,2% des emplois. Ceci n’est toutefois vérifié que pourles filles puisque 64,8% des emplois masculins relèvent de secteurs liés (pour 38,9% aux filles). Parailleurs, si le tertiaire est dominant pour les deux sexes (82,4% aux filles et 42% aux garçons), laproduction et l’industrie est loin d’être négligeable pour la population masculine.RepèresDiplômés uniquesSourcesDiplômés entrés directement sur le marché dutravail après l’obtention de leur titre oupoursuivant des études sans obtenir undiplôme de niveau supérieur à celui du diplômeconsidéré.Nomenclature sectorielle Voir note pages suivantesLes activités liées à l’agriculture comprennent les IAA,l’agrochimie, le machinisme agricole, le commerce de gros et dedétail de produits agricoles et alimentaires, les services auxentreprises agricoles, les activités vétérinaires.Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheEtablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD)251
L’insertion professionnelleRépartition des emplois des diplômés uniques de BTAselon le secteur d’activité de l’entreprise employeurEn % des emplois près de quatre ans après l’obtention du diplômeBTAProductions agricolesProductions forestières et liées à l'aménagementIndustries liées à l'agricultureAutres industriesCommerce lié à l'agriculture et au milieu ruralAutre commerceServices liés à l'agriculture et au milieu ruralServices liés à l'aménagement et l'environnementAutres services3,84,64,23,75,55,810,59,55,13,83,17,93,04,941,236,0Promotion 1995 enquêtée en 1999Promotion 1997 enquêtée en 200123,6BTA23,81995 1997H F H FProductions agricoles 59,9 9,4 53,0 8,6Productions forestières et liées à l'aménagement 5,7 0,4 7,3 0,4Industries liées à l'agriculture 3,4 5,5 3,3 4,4Autres industries 5,1 6,2 5,9 5,6Commerce lié à l'agriculture et au milieu rural 8,5 13,7 8,5 11,1Autre commerce 2,7 9,2 2,4 5,9Services liés à l'agriculture et au milieu rural 2,7 3,9 3,3 15,3Services liés à l'aménagement et l'environnement 4,2 1,1 6,8 1,9Autres services 7,8 50,6 9,4 46,8Répartition des emplois des diplômés uniques de BTSAselon le secteur d’activité de l’entreprise employeurEn % des emplois près de quatre ans après l’obtention du diplôme252BTSAProductions agricolesProductions forestières et liées à l'aménagementIndustries liées à l'agricultureAutres industriesCommerce lié à l'agriculture et au milieu ruralAutre commerceServices liés à l'agriculture et au milieu ruralServices liés à l'aménagement et l'environnementAutres services1,92,91,84,54,13,24,59,110,68,214,013,113,714,218,317,330,727,9Promotion 1994 enquêtée en 1998Promotion 1996 enquêtée en 2000BTSA1994 1996H F H FProductions agricoles 36,8 14,3 33,9 13,1Productions forestières et liées à l'aménagement 2,4 0,5 3,7 0,8Industries liées à l'agriculture 12,6 18,0 11,7 16,5Autres industries 4,0 5,6 3,1 6,4Commerce lié à l'agriculture et au milieu rural 17,5 20,6 16,6 18,9Autre commerce 4,4 5,0 3,0 3,7Services liés à l'agriculture et au milieu rural 12,5 16,7 12,4 18,8Services liés à l'aménagement et l'environnement 1,8 1,9 9,1 9,1Autres services 8,0 17,4 6,5 12,7
Les secteurs d’activité des diplômés uniques de niveaux IV et IIIquatre ans après l’obtention de leur diplôme Le tertiaire devient quasiment majoritaire pour les BTA, mais la production le talonne et les activités restenten général fortement liées à l’agricole et au rural Pour les BTSA, le tertiaire devient globalement majoritaire en 2000 pour la promotion 1996, mais lesproductions agricoles sont toujours en tête des secteurs décomposés ; le lien avec l’agricole et le rurals’affiche fortement, quelles que soient les activitésNB : l’ENESAD a mis en place de nouvelles nomenclatures de secteurs d’activités, dans le cadre deses dernières enquêtes sur les diplômés en 1996 de BEPA et de BTSA et en 1997 de CAPA et deBTA, afin de mieux rendre compte de ces activités, notamment quant à leur lien avec le mondeagricole et rural, et de permettre des mises en relation plus fines avec les secteurs de formation. Afinde pouvoir dégager des tendances d’évolutions, l’adoption de ces nomenclatures a donné lieu à unnouveau traitement des enquêtes antérieures sur les promotions 1994 de BTSA et 1995 de CAPA etde BTA. Les données présentées, dans nos rapports précédents, sur les promotions antérieures à1994, si elles demeurent valides, ne peuvent pas faire l’objet de comparaisons strictes avec lesnouveaux indicateurs.BTALes secteurs d’emplois tertiaires sont en progression pour les diplômés uniques de BTA entre lespromotions 1995 et 1997 ; devenant quasiment majoritaires, ils passent de 45,3% des emplois à49,9% (+4,6 pts). Ce sont les services liés à l’agriculture et au monde rural (+4,8 pts à 7,9%) et lesservices liés à l'aménagement et l’environnement (+1,9 pts à 4,9%) qui gagnent du terrain. Mais lesservices autres restent au premier plan dans les activités tertiaires (23,8% ; +0,2 pt des emploistotaux). Dans le même temps, les activités commerciales se font un peu moins présentes : -1 pointau commerce lié (à 9,5%) ; -1,3 points au commerce autre (à 3,8%). La production rassemblenttoutefois 40,6% des emplois des BTA (-4,4 pts). En leur sein, ce sont les productions agricoles quidominent (36% des emplois totaux), mais aussi qui sont en retrait (-5,2 pts), alors que les productionsforestières se développent un peu (+0,8 pt à 4,6%). Quoi qu’il en soit, les activités liées à l’agricoleet au rural sont toujours majoritaires : 66,7% des emplois (+0,9 pt). De fortes différenciations sonttoutefois observées selon le sexe : 81% des emplois des femmes relèvent du tertiaire et 58,3% nesont pas liées à l’agricole et au rural. Du côté des hommes, les emplois restent à majorité liés à laproduction (60,3%) et la plus grande part est liée à l’agricole et au rural (82,2%).BTSAPour les diplômés uniques de BTSA, la prise de majorité du tertiaire dans les secteurs d’emplois desjeunes advient avec la promotion 1996. Ce grand secteur gagne 3,1 points à 52% en 2000. Laproduction est au second plan avec 30,8% des emplois (-1,8 pts). L’industrie n’en rassemble que17,2% (-1,3 pts). Ce sont les services liés à l’aménagement et l’environnement qui gagnent le plusde terrain (+7,3 points à 9,1%), suivis des productions forestières (+1 pt à 2,9%). A l’inverse, sontparticulièrement en recul les productions agricoles (-2,8 pts à 27,9%) et les services autres que liésà l’agricole, à l’aménagement ou au rural (-2,4 pts à 8,2%). En structure, cependant, les productionsagricole restent en tête, suivies du commerce lié à l’agriculture (17,3%), des services liés (14,2%) etdes industries liées (13,1%). Par voie de conséquence, les secteurs liés à l’agricole et au rural sontfortement dominants : ils concernent 84,5% des emplois (+4,1 pts). Lorsque l’on examine lesemplois selon le sexe, on repère des différenciations classiques : le tertiaire est davantage présentpour les femmes (63,2% de leurs emplois) que pour les hommes (47,6%) ; la production à l’inverseconcerne davantage les hommes (37,6% contre 13,9% aux femmes).Les résultatsRepèresDiplômés uniquesDiplômés entrés directement sur le marché dutravail après l’obtention de leur titre oupoursuivant des études sans obtenir undiplôme de niveau supérieur à celui du diplômeconsidéré.SourcesMinistère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires RuralesDirection générale de l’enseignement et de la rechercheEtablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD)253
Annexes Questionnaire Actions de développement des établissements Grille de lecture Monographies Correspondance secteurs / groupes de spécialités du Conseil national de l’information statistique Arrêté constitutif de l’ONEA et arrêté de nomination des membres de l’ONEA Siglier255
Les actions de développementdes établissements de l’enseignement agricoledepuis septembre 2000Code établissementCachet de l’établissementPublicPrivé Temps pleinPrivé Rythme appropriéPublicCNEAPUNMFREOUNREPPrivé Non affiliéStructures de l’établissement à sa création1 Année de création de l’établissement :2 Mode(s) de formation proposé(s) à cette date :3 Niveau(x) de formation proposé(s) à cette date :Formation initiale scolaire (y compris rythme approprié)ApprentissageFormation continueVI et VbisVIVIII4 Secteur(s) de formation proposé(s) à cette date :Secteur dominantProductionTransformationForêt AménagementServicesFormation généraleAutre(s)Structures de l’établissement aujourd’hui5 Nombre d’apprenants en 2001-<strong>2002</strong> :Effectifs par niveauxVI Vbis V IV III Autre Ens.Formation initiale scolaire (y compris rythme approprié)ApprentissageFormation continue6 Formations proposées en 2001-<strong>2002</strong> :Cochez tous les secteurs de formation proposés selon le niveau et le mode de formationen indiquant de plus par la lettre D le secteur de formation dominant pour chaque niveau et pour l’ensemble des niveaux par mode de formation.(un D par colonne)Formation scolaire Apprentissage Formation continueVoir nomenclature jointeV IV III Ts niv. V IV III Ts niv. V IV III Ts niv.ProductionTransformationForêt AménagementServices aux personnesServices aux entreprisesCommercialisationFormation générale
Les personnels de l’établissement7 Effectifs : En cas d’affectation dans plusieurs centres, comptabiliser les effectifs pour chaque centre puis rétablir sans double compte dans le total.*ETP : Equivalents temps pleinà évaluer approximativementPersonnel de directionEnseignants, formateursdont non titulaires (public)Education et surveillancePersonnel administratif,technique, ouvrier, santé, serviceTotal établissement Formation scolaire Centre apprentis Formation adultes Exploitation, atelierEffectifsETP* Effectifs ETP* Effectifs ETP* Effectifs ETP* Effectifs ETP*8 Nombre d’ingénieurs dans le personnel de l’établissement :Ingénieurs d’Etat MAPAutres ingénieurs hors MAPAutres ingénieurs MAPTotal9 Fonction des ingénieurs de l’établissement : Chef d’établissement Responsable Formation initiale scolaire Responsable Apprentissage Responsable Formation continue Responsable Vie scolaire (CPE)Ingénieurs d’Etat MAP Autres ingénieurs MAP Responsable de l’exploitation (ou atelier technologique) EnseignantsNombre : Nombre : Autre, précisez .................................................................Autres ingénieursNombre :10 Ancienneté des personnels de direction dans l’établissement :1 an et moins de 2 à 5 ans de 6 à 10 ans plus de 10 ans Chef d’établissement Responsable Formation initiale scolaire Responsable Apprentissage Responsable Formation continue Responsable de l’exploitation (ou atelier technologique) Responsable Vie scolaire (CPE)11 Profil professionnel des personnels d’encadrement :Cochez tous les emplois de la liste qui ont été occupés dans le passé par les différents personnels de direction (réponses multiples possibles).Ne pas cocher si l’emploi actuelest le premier emploi. Chef d’établissement Responsable Formation initiale scolaire Responsable Apprentissage Responsable Formation continue Responsable Vie scolaire (CPE) Responsable de l’exploitation (ou atelier)Enseignant EA,formateurEnseignant EN,formateurExploitantagricoleCadreentreprise agroCadre privéautreAdministrationMAP12 Mandats politiques ou associatif actuels des personnels :(Cochez si élus parmi les personnels)Elu local Chef d’établissement Responsable Formation initiale scolaire Responsable Apprentissage Responsable Formation continue Responsable Vie scolaire (CPE) Responsable de l’exploitation (ou atelier)EludépartementalElurégionalMembreassociationAutre,précisez.................................................................................................................................................................................................................................................................. Enseignants (Dénombrer) ...........................................
L’exploitation agricole ou l’atelier technologique13 Votre établissement dispose-t-il d’une exploitation agricole ?OuiNonSi oui,14 Les orientations de votre exploitation sont......liées aux systèmes dominants de votre région...spécifiques à votre établissement...les deux15 Votre établissement dispose-t-il d’un atelier technologique ?OuiNonSi oui,16 Les orientations de votre atelier sont......liées aux systèmes dominants de votre région...spécifiques à votre établissement...les deuxLe conseil d’administration17 Quelle est la fonction du Président du conseil d’administration de votre établissement ?Mandat politiqueMandat(s) professionnel(s)Pour les mandats professionnels, préciser si responsabilitéparticulière :Elu localElu départementalElu régionalElu nationalChambres d’agricultureSyndicatsCoopérationCréditGroupe de vulgarisation agricole ou de développement (CETA, GVA, GEDA, CIVAM, etc)Associatif, précisez .........................................................................................................................................................................................Autre, précisez ................................................................................................................................................................................................L’établissement dans ses environnements.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MSA ......................................................................................................................................................................................................................18 Participez-vous à des réseaux thématiques... nationaux Oui Non régionaux Oui Non19 Si nationaux,le(s)quel(s) ?Actions culturellesAgriculture biologiqueAquacultureBiodiversité animaleCaprinsEducation à l’environnementForêtHorticultureProduits fermiersReseda*Tourisme ruralTruffe et cèpeVigne et vin*Reseda : Réseaud’éducation pour l’écouteet le développement del’adolescentAutres, précisez............................................................................................................................................................. Si régionaux, le(s)quel(s) ?.............................................................................................................................................................................20 Participez-vous à des réseaux territorialisés (labels, AOC, etc.) ?21 Participez-vous à des réseaux professionnels (foires, salons, etc.) ?OuiOuiNonNon22 Existe-t-il sur votre territoire des projets de développement local ?23 Si oui, êtes-vous impliqués dans ces projets ?24 Pouvez-vous nous citer vos cinq principaux partenaires et votre degré de relations ?Conseil régionalConseil généralCommunauté de communes, paysServices locaux ministères hors MAPChambre d’agricultureAutres organismes professionnels agricoles (syndicats, coopération, etc)AssociationsTissu économique localOrganismes de formation, de recherche et de développementCréditAutre, précisez ......................................................................................Oui Non Ne sait pasOui NonSuivies Occasionnelles
Une fiche action est à remplir pour chaque action menée (voir feuillet joint)Actions de développement menées par votre établissement depuis septembre 2000 et orientations25 A combien d’actions de développement avez-vous participé (et participez-vous actuellement) depuis septembre 2000 ?26 Combien de ces actions de développement ont été inscrites dans votre projet d’établissement ?27 Combien de ces actions de développement ont intégré activement des groupes d’apprenants ?28 Combien d’enseignants ont été mobilisés au total sur ces actions de développement ? dont enseignants lycée dont enseignants centre apprentis dont enseignants formation adulte29 Combien de personnes de votre personnel hors enseignants ont été mobilisés au total sur ces actions de développement ?30 Avez-vous des orientations thématiques fortes de développement pour le futur ?OuiNonSi oui, laquelleou lesquelles ?AgricultureQualitéPatrimoineTourismeEnvironnementEmploi, insertionCultureAutre, précisez ...........................................................................................................Remarques libres30 Quelles remarques souhaiteriez-vous faire sur les enjeux, les conditions favorables, les limites et problèmes rencontrés, les bénéficesévalués pour l’établissement et pour les apprenants, les liens avec la formation des actions menées ? sur les évolutions des pratiques,notamment dans la relation développement - formation ? sur l’évolution des partenariats ?Quelles réflexions portez-vous sur l’évolution du développement agricole et territorial de votre région ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire
Code établissementFiche - actionMerci de remplir une fiche pour chaque action de développement menée depuis septembre 2000F1 Centre(s) ou secteur(s) d’activité engagé(s) :Etablissement de formation scolaireCentre d’apprentisCentre de formation adulteExploitation ou atelierF2 Intitulé de l’action : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................F3 Cette action est.....ponctuellepluri-annuelleprévue sur :ansen coursachevéeF4 Date de début de l’action (mois, année) :/F5 Nature de l’action :Développement agricoleDéveloppement territorialDomaine d’action Produit, patrimoine génétiqueProcessus de production,technologique, organisationnel,qualitéCommercialisationGestion de l’entrepriseAutre, précisez..........................................................................................................................Espaces naturels, patrimoinesnaturels, aménagementEnvironnement, écologieTourisme, image du territoireCultureAutre, précisez..........................................................................................................................Type d’action Recherche, expérimentationInnovationTransfert de technologieAudit, conseil, diagnosticVulgarisationAide à la gestion de projetAutre, précisez..........................................................................................................................Recherche, expérimentationInnovationTransfert de technologieAudit, conseil, diagnosticAnimationAide à la gestion de projetAutre, précisez..........................................................................................................................F6 Précisez, si vous le souhaitez, les objectifs de l’action :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................F7 A quelle(s) mission(s) liez-vous cette action ?Formation Animation rurale Insertion Développement, expérimentation,recherche appliquéeCoopération internationale
F8 Les acteurs au sein de votre établissement (Cochez)Chefd’établissementResponsableF. scolaireResponsableApprentissageResponsableFormation continueResponsableexploitation ou atelierEnseignant ou grouped’enseignantsAutre Quel est le responsablede l’action dans l’établissement ? Quels sont les autres participantsen interne ?F9 Si le responsable de l’action est enseignant, quelle est sa compétence ?FrançaisMathématiquesTechnologie de productionanimale ou végétaleEducation socioculturellePhilosophiePhysique, ChimieHistoire GéographieEducation physiqueLanguesSciences biologiquesSciences économiquesResponsable exploitation (ou atelier)Autre, précisez ..........................................................................................................................F10 Le responsable de l’action est-il diplômé d’un titre d’ingénieur du MAP ? Oui NonF11 Si oui, est-il ingénieur d’Etat ? Oui NonF12 Si non, est-il diplômé d’un autre titre d’ingénieur ? Oui NonF13 Quelle est son ancienneté dans l’établissement ?ansF14 Nombre total de personnels participant à cette action :F15 Dont nombre total d’enseignants participant à cette action :F16 Nombre d’enseignants mobilisés sur cette action par groupe de compétenceNombre d’enseignants participant à cette actionFrançaisPhilosophieLanguesMathématiquesPhysique, ChimieSciences biologiquesTechnologie de production animale ou végétaleHistoire GéographieSciences économiquesEducation socioculturelleEducation physiqueResponsable exploitation ou atelierAutre, précisez.................................................................................................................................................................
F17 Cette action répond-t-elle.... à une demande de professionnels ?à une demande d’élus ?à une demande de structures engagées dans le développement local ?à une initiative de l’établissement ?à une initiative individuelle dans l’établissement ?à un autre type de demande ?Précisez : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................F18 Cette action s’inscrit-elle dans un projet pédagogique ? Oui NonF19 Quels sont les publics d’apprenants (élèves, stagiaires, apprentis) activement mobilisés sur cette action ? (cochez)Formation initiale scolaire (y compris rythme approprié)ApprentissageVI Vbis V IV III AutreFormation continueAucunF20 Cette action est-elle inscrite dans le projet d’établissement ? Oui NonF21 Cette action est-elle inscrite dans un projet de développement local ? Oui NonF22 Cette action s’incrit-elle dans le cadre d’une procédure (CTE, PAD, PPDA, etc) ? Oui NonF23 S’il s’agit d’un CTE, est-ce... un CTE individuel (de votre exploitation) ?un CTE collectif ?F24 Cette action s’inscrit-elle dans une démarche d’appui à la multifonctionnalité des exploitations agricoles ? Oui NonF25 Diriez-vous que cette action s’inscrit dans une stratégie de développement durable du territoire ? Oui Non Ne sait pas
F26 Les partenariats dans le cadre de cette action de développement agricole / territorial :Cochez les partenaires en indiquant la nature du partenariatPrécisez pour chacun des partenariats s’il y a eu contractualisationNature des partenariatsActeursFinancier Scientifique Technique LogistiqueAutres(Précisez)Contrat.(Cochezsi oui)Institutionnelsd’Etatniveauxdépartemental,régional,nationalStructuresterritorialesOrganisationsprofession.agricolesActeurséconomiquesPartenairesassociatifsFormationRechercheCréditAgriculture et pêcheAménagement du territoire et environnementEmploi et solidaritéEquipement, transport, logement (tourisme)Culture et communicationJeunesse et sportAffaires étrangèresDATARConseil régionalConseil généralPaysCommunauté de communesCommuneParcs naturels régionauxChambres d’agricultureSyndicatsCoopération (CUMA, SICA, SMIA, GIE, etc.)CNASEA / ADASEAExploitants agricolesEntreprises agro-alimentairesEntreprises du domaine touristiqueEntreprises services sociauxAutres entreprisesCIVAMAssos. spécifiques (foyers ruraux, Peuple et culture, CPIE, etc.)Associations culturelles et sportivesAutres associations non spécifiquesAutre établissement secondaire EAEtablissement d’enseignement supérieur agro. ou véto.Etablissements secondaires ENEtablissements supérieurs ENGRETAAFPAAutres instituts de formation hors associatifsINRAInstituts techniquesCETACRITTCentres de recherche universitaireEtablissements d’enseignement supérieur agro . ou véto.Banques et structures de financementFondationsAutres,précisezVotre établissementF27 Pourriez-vous évaluer le budget total de cette action (en euros) ?F28 Pourriez-vous évaluer le budget de cette action (en euros) pour votre établissement?Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire
Monographie: Trame de l'enquête par entretienI. Le projet d'établissementBUT : Définir la stratégie de l'établissement Ses objectifs et sa modalité de construction : Implications des enseignants, des agents extérieurs, autres Thèmes des actions en liaison avec le territoire A-t-il une réalité propre?II. Etapes marquantes dans le développement de l'établissementBUT : Par quel processus le développement s'est-il mis en place ? Nous ne cherchons pas à connaîtrel'histoire de l'établissement mais les mutations importantes qui ont impulsé des actions de développement. Les crises, les orientations… par exemple les lois relatives à la décentralisation, lesnouvelles formations mises en place.III. Caractéristiques de l'établissementBUT : Nous cherchons dans cette partie à dégager des variables explicatives. L'offre de formation et la nature du chef d'établissement ont-elles des effets sur les actionsde développement ?A- Caractérisation de l'offre de formationSelon les différentes filières de formation (par niveau et par filière) : l'établissement poursuit-il une stratégiede spécialisation (démarche d'innovation?) ou de polyvalence (démarche de proximité).Nous pourrons nous servir du questionnaire national pour traiter ces informations.D'après ces informations nous pourrons respectivement nous interroger sur : L'aire de recrutement des apprenants : infra départemental, départemental, plusieursdépartements, régional…et ainsi mieux prendre en compte la stratégie de communication desétablissements. L'aire d'insertion professionnelle : Est-ce que des études ont déjà été menées? De quelles informations disposent-ils? Nature de la concurrence et des concurrents : à quel niveau se situent-ils?
B- Profil du chef d'établissementSon parcours professionnel, sa mobilité, son ancienneté dans l'établissement…Son rôle éventuel ainsi que ses collaborateurs dans des structures d'animation locales, mandat associatif et/oupolitique…IV. Actions de l'établissementBUT : D'après les réponses aux questionnaires nationaux, mieux comprendre les actions menées ainsi queles partenariats mis en place.A- Inventaire des actions menées en faveur de :Développement agricole (qualité, expérimentation…)Nouveaux métiers, nouveaux emplois : la multifonctionnalité (environnement, services, tourisme…)InsertionFormation-développement : formation financée par le FSE (Fond Social Européen) en lien avec l'ADEPFO 1et l'ADEFPAT 2 qui étudient les projets de formation et qui donnent leur aval.B- Partenariats noués au cours des actions Origine Etapes : réunion, protocole, convention Perspectives : Par rapport aux objectifs de l'actionC.- La notion de territoireQuestions à poser pour mieux appréhender ce qu'on entend par territoire, ainsi que le degré de connexion aupays. Diverses questions en fonction du niveau de développement du pays. A quel territoire vous identifiez-vous? Avec qui travaillez-vous? Connaissez-vous la démarche Pays? Etes-vous au courant des réunions de la charte ? Y êtes-vous invité(e) (s) ? Participez-vous à une commission ? Connaissez-vous l'environnement socio-économique du pays et de l'incidence au niveau devotre établissement ? Appartenez-vous à un groupe de réflexion sur le diagnostique territoire, avec qui, comment ?1ADEPFO : Association pour le développement des Pyrénées par la formation2ADEFPAT : Association pour le développement par la formation des pays de l'Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
Correspondance secteurs / groupes de spécialités (CNIS)SecteursGroupes de spécialitésProductionHors ***.w- Commercialisation et vente de produits liés à l’agriculture210- Spécialités plurivalentes de l’agronomie et de l’agricultureSauf Gestion et maîtrise de l’eau211- Productions végétales, cultures spécialisées et protection descultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière)212- Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soinsaux animaux (y compris vétérinaires)Transformation22- Transformations220- Spécialités pluritechnologiques des transformations221- Agro-alimentaire, alimentation, cuisine222- Transformations chimiques et apparentées(y.c. industrie pharmaceutique)Sauf Traitement des eauxCe secteur comprend les formations liées à la transformation du bois.Forêt, Aménagement, EnvironnementHors ***.w- Commercialisation et vente de produits liés à l’agriculture213- Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche214- Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts,terrains de sport)34- Services à la collectivités341- Aménagement du territoire, développement, urbanisme342- Protection et développement du patrimoine343- Nettoyage et assainissement, protection de l’environnementCe secteur comprend les formations en Gestion et maîtrise de l’eau(in 210) et Traitement des eaux (in 220)Services aux personnes 33- Services aux personnesServices aux entreprises31- Echanges et gestion32- Communication et informationCommercialisation ***.w- Commercialisation et vente de produits liés à l’agricultureCNIS : Conseil national de l’information statistique
J.O. Numéro 188 du 13 Août 1996 page 12291MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, ET DE L’ALIMENTATIONArrêté du 31 juillet 1996 relatif à l'Observatoire national de l'enseignement agricoleNOR : AGRE9601567ALe ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Vu le livre VIII du code rural ;Vu le décret n° 95-773 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 avril 1996,Arrête :Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un Observatoire national de l'enseignement agricole.Art. 2. - L'Observatoire national de l'enseignement agricole a pour mission d'analyser, de synthétiser et de diffuser lesdonnées sur la connaissance, le suivi et l'insertion professionnelle des élèves, des étudiants, des apprentis et des stagiairesde l'enseignement agricole tant public que privé. Il produit et fait produire des études et des recherches sur les relationsentre les formations et les besoins d'emplois, et notamment sur les qualifications ainsi que sur les savoirs et les acquis desapprenants et leur évolution. Il formule des propositions et des recommandations sur ses domaines de compétence.Pour remplir ses missions, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux directions et aux services statistiques du ministèrechargé de l'agriculture ainsi qu'aux établissements placés sous sa tutelle. Il peut également solliciter tous renseignementset demander à procéder à toutes rencontres et consultations de documents qu'il estime utiles au bon déroulement de sesactivités. Il est habilité à conclure des protocoles de coopération avec des services ou des établissements publics dépendantd'autres ministères, notamment ceux chargés de l'éducation nationale, du Plan, de la formation professionnelle et dutravail.Il remet chaque année un rapport au ministre chargé de l'agriculture. Le rapport, après avoir été présenté au Conseilnational de l'enseignement agricole, est rendu public.Art. 3. - L'Observatoire national de l'enseignement agricole est composé de onze personnalités désignées en fonction deleurs compétences. Elles sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ansrenouvelable.Art. 4. - Le président de l'Observatoire national de l'enseignement agricole est nommé parmi les membres del'Observatoire, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Le vice-président de l'observatoire, nommé parmi ses membres pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargéde l'agriculture, prépare et organise les travaux de l'observatoire sous l'autorité du président.Art. 5. - L'Observatoire national de l'enseignement agricole peut entendre, sur convocation de son président, tous expertsdont la consultation lui paraît utile à l'accomplissement de ses missions.Art. 6. - L'Observatoire national de l'enseignement agricole détermine la périodicité, l'objet, le contenu et les conditionsde déroulement de ses travaux.L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président. S'y ajoutent les points dont l'inscription est demandée par leministre ou par au moins le quart de ses membres.Art. 7. - Le ministre chargé de l'agriculture assure le secrétariat de l'Observatoire national de l'enseignement agricole.Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui serapublié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 31 juillet 1996.Philippe Vasseur
J.O. Numéro 282 du 6 Décembre 2000 page 19379Arrêté du 28 novembre 2000 portant nomination à l'Observatoire national de l'enseignement agricoleNOR : AGRE0002362APar arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 28 novembre 2000 :Sont nommés membres de l'Observatoire national de l'enseignement agricole pour une durée de trois ans à compter du 1erseptembre 2000 :M. Blanc (Jean-Louis), directeur délégué auprès du directoire chargé des ressources en eau pour le groupe Suez-Lyonnaisedes eaux ;M. Boulet (Michel), professeur à l'établissement national de l'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;M. de Caffarelli (Gérard), ancien président d'organismes socio-professionnels agricoles ;M. Deschamps (Michel), inspecteur général de l'agriculture ;M. Frémont (Armand), ancien recteur, président du conseil scientifique de la DATAR ;M. Gauter (Joseph), professeur à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ;M. Lacombe (Philippe), directeur scientifique à l'Institut national de la recherche agronomique ;Mme OEuvrard (Françoise), chargée de mission à la direction de la programmation et du développement du ministère del'éducation nationale ;M. Orivel (François), directeur de recherche à l'institut de recherche sur l'économie de l'éducation à l'université de Dijon ;M. Rémond (René), président de la Fondation nationale des sciences politiques ;M. Saget (Pierre), secrétaire général du Conseil national des programmes au ministère de l'éducation nationale.M. Rémond (René) est nommé président de l'Observatoire national de l'enseignement agricole.M. Saget (Pierre) est nommé vice-président de l'Observatoire national de l'enseignement agricole.
SIGLESABRÉVIATIONSAACCACEACRAHAITOSATOSSAMEXAAdm.AccueilAgents contractuels d’enseignementAgents contractuels régionauxActivités hippiquesPersonnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de servicePersonnel administratif, technique, ouvrier, de santé et de serviceAssurance maladie des exploitants agricolesAdministratif (ve)BBAC PROBAC SBAC TECHNOBAPAATBCPSTBEPBEPABMEBP ou BP4BPABP REABTABTSBTSABTSA IAABaccalauréat professionnelBaccalauréat scientifiqueBaccalauréat technologiqueBrevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicienBiologie chimie physique et sciences de la terreBrevet d’études professionnellesBrevet d'études professionnelles agricolesBénéficiaires de mesures pour l’emploiBrevet professionnel (niveau IV)Brevet professionnel agricole (niveau V)Brevet professionnel de responsable de l’exploitation agricoleBrevet de technicien agricoleBrevet de technicien supérieurBrevet de technicien supérieur agricoleBrevet de technicien supérieur agricole en Industries agro-alimentairesCCAFMATECAPCAPACCTARCDICDICDDCEAVCEREQCESCESACFACFEVCFPAJCFPPACLIPACNASEACNEAPCNEARCCNISCNJACOMCPCPACSCPGECSCSILCSPCertificat d’aptitude à titre étranger aux fonctions de maître-assistantCertificat d’aptitude professionnelleCertificat d'aptitude professionnelle agricoleCertificat de capacité technique agricole et ruraleCentre de documentation et d'informationContrat à durée indéterminéeContrat à durée déterminéeCertificat d'études approfondies vétérinairesCentre d'études et de recherches sur l'emploi et les qualificationsCertificat d’études supérieuresCertificat d’études supérieures agronomiquesCentres de formation d'apprentisCertificat de fin d’études vétérinairesCentre de formation professionnelle agricole pour jeunesCentre de formation professionnelle et de promotion agricolesClasse d'initiation pré-professionnelle en alternanceCentre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricolesConseil national de l'enseignement agricole privéCentre national d'études agronomiques des régions chaudesConseil national de l'information statistiqueCentre national des jeunes agriculteursCommercialisationCrédits de paiementClasse préparatoire à l'apprentissageCertificat de spécialisationClasse préparatoire aux grandes écolesCertificat de spécialisationCertificat de spécialisation d’initiative localeCatégorie socioprofessionnelle
DDAADAGDATDCDEADEATDEFVDEGIADESSDESVDEUGDFADFGDGERDIDIADIATDIFDIIAADITADITHPDITIAADJADNODODPDDPLGDSHADSHGAPDTAADTAGDUDUTDiplôme d’agronomie approfondieDiplôme d’agronomie généraleDiplôme d’agronomie tropicaleDépenses en capitalDiplôme d'études approfondies (niveau I)Diplôme d’études appronfondies tropicalesDiplôme d’études fondamentales vétérinairesDiplôme d’études générales en industries agricoles et alimentairesDiplôme d'études supérieures spécialiséesDiplôme d'études spécialisées vétérinairesDiplôme d’études universitaires généralesDiplôme de foresterie approfondieDiplôme de foresterie généraleDirection générale de l’enseignement et de la rechercheDiplôme d’ingénieurDiplôme d’ingénieur agronomeDiplôme d’ingénieur d’agronomie tropicaleDiplôme d’ingénieur forestierDiplôme d’ingénieur des industries agricoles et alimentairesDiplôme d’ingénieur des techniques agricolesDiplôme d’ingénieur des techniques de l’horticulture et du paysageDiplôme d’ingénieur des techniques de l’horticulture et du paysageDotation installation aux jeunes agriculteursDiplôme national d'œnologieDépenses ordinairesDirection de la programmation et du développement (Education nationale)Diplômé par le GouvernementDiplôme de sciences horticoles approfondiesDiplôme de sciences horticoles générales et d’aménagement du paysageDiplôme de technologie agricole approfondieDiplôme de technologie agricole généraleDiplôme d’universitéDiplôme universitaire de technologieEEITARCENENESADENFAENGEESENGREFENIHPENITENITABENITADENITACFENITHPENITIAAENSAENSAMENSARENSBANAENSHENSHAPENSIAENSPENSVENVENVAENVLEcole d'ingénieurs des techniques agricoles des régions chaudesEducation nationaleEtablissement national d'enseignement supérieur agronomique de DijonEcole nationale de formation agronomiqueEcole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de StrasbourgEcole nationale du génie rural, des eaux et des forêtsEcole nationale d’ingénieurs de l’horticulture et du paysageEcole nationale d'ingénieurs des travauxEcole nationale d'ingénieurs des travaux de BordeauxEcole nationale d'ingénieurs des travaux de DijonEcole nationale d'ingénieurs des travaux de Clermont-FerrandEcole nationale d'ingénieurs des travaux horticoles et du paysageEcole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentairesEcole nationale supérieure agronomiqueEcole nationale supérieure agronomique de MontpellierEcole nationale supérieure agronomique de RennesEcole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l’alimentationEcole nationale supérieure d'horticultureEcole nationale supérieure d’horticulture et d’aménagement du paysageEcole nationale supérieure des industries agricoles et alimentairesEcole nationale supérieure du paysageEcole nationale des services vétérinairesEcole nationale vétérinaireEcole nationale vétérinaire de Maisons-AlfortEcole nationale vétérinaire de Lyon
ENVNENVTEPAEPLEFPAEPSEQUIPESAESAPESATESBESITPAETPEcole nationale vétérinaire de NantesEcole nationale vétérinaire de ToulouseEnvironnement Physique AgronomieEtablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricolesEducation physique et sportiveEquipements, agro-équipementsEcole supérieure d'agriculture d'AngersEcole supérieure d'agriculture de PurpanEcole supérieure d'agronomie tropicaleEcole supérieure du boisEcole supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agricultureEquivalent temps pleinFFAFESIAFGFIFForêt - AménagementFédération des écoles supérieures d’ingénieurs en agricultureFormation généraleFormation des ingénieurs forestiers de l’ENGREFHHSHeures stagiairesIIAIAAIESIELINA-PGINHINPSAINSFAIPACISAISAAISABISALISARAISPAITAITIAITIAPEITIPHIngénieur agronomeIndustries agro-alimentairesInstitut d'études supérieures d'industrie et d'économie laitièresInstitut national agronomique Paris GrignonInstitut national d’horticultureInstitut national de promotion supérieur agricoleInstitut national supérieur de formation agro-alimentaireIngénieurs, professeurs agrégés et certifiésInstitut supérieur d'agriculture de LilleInstitut supérieur de l'agro-alimentaireInstitut supérieur agricole de BeauvaisInstitut supérieur d'agriculture de LilleInstitut supérieur d'agriculture de Rhône-AlpesInstitut supérieur des productions animalesIngénieur des travaux agricolesInstitut des techniques de l’ingénieur pour l’agricultureInstitut des techniques de l’ingénieur en aménagement paysager de l’espaceInstitut des techniques de l’ingénieur en production horticoleJJ et AJournalisme et agricultureLLEGTALPALycée d'enseignement général et technologique agricoleLycée professionnel agricole
MMAPMinistère de l'Agriculture et de la PêcheNNDNFINTICDonnée non disponibleNouvelle formation d’ingénieurNouvelles technologies d’information et de communicationOONEAOVEObservatoire national de l’enseignement agricoleObservatoire de la vie étudiantePPPCPCEAPCENPEPSPLPAPLPENProductionPhysique ChimieProfesseur certifié de l'Enseignement agricoleProfesseur certifié de l'Education nationaleProfesseur d’éducation physique et sportiveProfesseur de lycée professionnel agricoleProfesseur de lycée professionnel de l'Education nationaleRRARER&DRythme appropriéRecherche d’emploiRecherche et développementSSESESGSILSPSPISTAESTIAASTPASTPVFServices aux entreprisesSciences économiques et sociales et gestionSpécialité d'initiative localeServices aux personnesSciences pour l’ingénieurSciences et techniques de l’agronomie et de l’environnementSciences et techniques des industries agroalimentairesSciences et techniques des productions animalesSciences et techniques des productions végétales et forestièresTTTHTPTransformationTitre homologuéTemps pleinUUNMFREOUNREPUT1Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientationUnion nationale rurale d'éducation et de promotionUniversité des Sciences sociales de Toulouse I