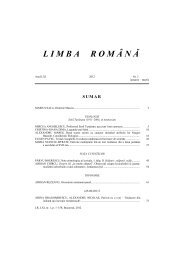GABRIELA PANÄ DINDELEGAN (coord.), Limba românÄ â Aspecte ...
GABRIELA PANÄ DINDELEGAN (coord.), Limba românÄ â Aspecte ...
GABRIELA PANÄ DINDELEGAN (coord.), Limba românÄ â Aspecte ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
526Comptes rendus 20dire des langues à OV et à VAux (le basque, le hindi). Greenberg a prédit aussi que, en règle générale,les langues VO utilisent des prépositions, tandis que les langues OV préfèrent les postpositions. Il y asans doute des exceptions : certaines langues iraniennes ont l’ordre OV et des prépositions, tandis quecertaines langues ouest- africaines, finno-ougriennes et sud-américaines ont VO et des postpositions.Ce paramètre a changé en vieil anglais, en latin vulgaire et, probablement, en grec classique.L’analyse du comportement des langues de ce point de vue démontre que d’habitude les langues onttendance à passer du type OV au type VO. Mais les prédictions ne sont pas infaillibles parceque l’ordre linéaire des mots dans la phrase est le résultat de l’interaction de plusieurs opérationsgrammaticales.2. Le chapitre Types of syntactic change [Les types de changement syntaxique] se donne pourfin de présenter les types de changement syntaxique et de démontrer que tout changement syntaxiqueest sous-tendu par un changement de paramètre.Le premier type de changement est la réanalyse, définie comme le mécanisme par lequel ilarrive un changement dans la structure de profondeur sans modification de la structure de surface. Laréanalyse est liée à l’acquisition de la première langue, puisque la grammaire est héritée degénération en génération à l’aide d’un corpus de phrases, ce corpus comportant des erreurs : c’est lasource de ce type de changement. L’apparition des auxiliaires de modalité (can, must, may, will, shall,ought) en anglais en constitue un exemple parmi d’autres. La disparition du Paramètre B (pour tousles verbes, excepté les verbes modaux) et l’accumulation des exceptions morphologiques, syntaxiqueset sémantiques (entraînant une opacité des verbes modaux, donc une violation du principe detransparence formulé par Lightfoot 1979) explique le passage de ces verbes autonomes dans la classedes auxiliaires modaux.Le deuxième type de changement est la grammaticalisation, processus par lequel desnouveaux morphèmes grammaticaux sont créés. Roberts explique la grammaticalisation (termeintroduit par A. Meillet en 1912) en termes génératifs comme le développement d’une nouvellecatégorie fonctionnelle. Un cas de grammaticalisation, étroitement lié au Paramètre D, est représentépar l’apparition d’une classe de mots négatifs en français (pas, point, aucun, rien, personne).L’explication en termes de paramètres est la suivante : dans le DP (groupe déterminant), en ancienfrançais, le NP (groupe nominal) se déplaçait vers la catégorie fonctionnelle NumP (le nombre)immédiatement dominée par DP ; la perte de ce déplacement a fait que les mots considérés (qui nesont d’ailleurs jamais co-occurrents avec l’article) soient réanalysés comme marqueurs de la catégorieNombre.Le troisième type de changement concerne la structure argumentale. L’hypothèse de départest qu’il y a une relation entre les θ-rôles et les fonctions grammaticales et que cette relation estlexicalement spécifiée pour chaque verbe. Cette structure argumentale peut être manipulée à l’aidedes opérations syntaxiques (voir le passif) ou bien elle peut changer dans le temps. L’auteur retientdeux exemples de ce type de changement en anglais : une fois perdu le marquage morphologiquecasuel, on a perdu le datif Expérimentateur des verbes psychologiques aussi bien que le datif quimarquait l’objet indirect Destinataire des constructions passivées (Mary [datif en anglais ancien, nonmarqué en anglais moderne] was sent a letter by John).Les complémenteurs sont le sujet du quatrième type de changement, illustré par le passage dulatin aux langues romanes : (a) la disparition de la structure ut /ne + subjonctif, remplacée parl’infinitif prépositionnel (avec la grammaticalisation des prépositions a/à, di/de en complémenteurs) ;(b) la restriction de l’usage de l’infinitif sans préposition aux verbes épistémiques ; (c) la disparitionde la construction accusatif + infinitif ; (d) la réanalyse du quod relatif comme complémenteur, lanouvelle structure remplaçant l’accusatif + infinitif. Ces changements ne sont pas sans enchaînementlogique : ut a disparu pour des raisons phonologiques, c’est pourquoi les prépositions de l’infinitif sesont grammaticalisées comme complémenteurs ; la perte des distinctions temporelles et aspectuellesde l’infinitif en latin vulgaire, donc la disparition de la catégorie fonctionnelle T, responsable del’attribution du cas accusatif au sujet, a entraîné la réanalyse de quod comme complémenteur d’uneproposition complétive qui a ensuite remplacé la structure accusatif + infinitif.