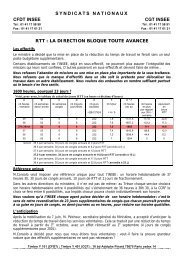Rapport d'orientation - cgt-insee
Rapport d'orientation - cgt-insee
Rapport d'orientation - cgt-insee
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Syndicat NationalCGT Insee18 ème congrèsAsnelles-sur-merOctobre 2006
Table des matières1. La situation où nous sommes....................................................................... 31.1. L’Europe........................................................................................................................................................ 31.1.1. La construction européenne ..........................................................................................................................31.1.2. L’Europe des syndicats...................................................................................................................................31.2. La France ...................................................................................................................................................... 41.2.1. Décrédibilisation des politiques ....................................................................................................................41.2.2. Le climat économique et social.....................................................................................................................41.2.3. Imposer la question sociale par la mobilisation .........................................................................................51.3. L’Insee et la statistique publique ...................................................................................................................... 51.3.1. La place de l’Insee dans la statistique européenne et internationale.....................................................51.3.2. Notre conception de l’information statistique publique et de son élaboration ......................................51.3.3. L’utilisation de l’information statistique.......................................................................................................61.3.4. la place particulière du syndicat CGT Insee................................................................................................72. Les principes et l’organisation de notre syndicat ......................................... 82.1. L’organisation ................................................................................................................................................ 82.1.1. Les sections .....................................................................................................................................................82.1.2. Le syndicat national........................................................................................................................................82.1.3. Le syndicat au sein du Minefi........................................................................................................................82.1.4. Les structures interprofessionnelles ............................................................................................................82.1.5. Le syndicat au sein des SSM.........................................................................................................................82.1.6. L’accueil des nouveaux ..................................................................................................................................92.2. Le fonctionnement syndical.............................................................................................................................. 92.2.1. Le débat démocratique ..................................................................................................................................92.2.2. Le fédéralisme .................................................................................................................................................92.2.3. L’unité d’action ................................................................................................................................................92.2.4. Revendications et négociations .................................................................................................................. 102.2.5. L’indépendance syndicale ............................................................................................................................ 102.3. Lutter pour les droits fondamentaux ................................................................................................................102.3.1. Lutter pour les droits des immigrés et des étrangers............................................................................. 102.3.2. Lutter contre l’exclusion et le racisme....................................................................................................... 102.3.3. Lutter pour les droits des femmes ............................................................................................................. 102.3.4. Lutter pour les droits des homosexuel(le)s .............................................................................................. 112.3.5. Lutter pour l’insertion des personnes handicapées ................................................................................. 113. Nos axes de réflexion et nos propositions.................................................. 123.1. Défense et amélioration des droits et acquis sociaux, des services publics, de l’égalité et des libertés ......................123.1.1. Défense de la protection sociale................................................................................................................. 123.1.2. Droit du travail .............................................................................................................................................. 123.1.3. Défense et développement des services publics...................................................................................... 133.2. Notre analyse sur l’Insee ................................................................................................................................153.2.1. Missions et moyens ...................................................................................................................................... 153.2.2. Gestion du personnel ................................................................................................................................... 163.2.3. Missions de l’Insee : nos revendications................................................................................................... 173.2.4. Statut du personnel et effectifs .................................................................................................................. 193.2.5. L’informatique ............................................................................................................................................... 193.2.6. Carrière et formation.................................................................................................................................... 203.2.7. Les conditions de travail .............................................................................................................................. 213.3. Au-delà des murs ..........................................................................................................................................233.3.1. Solidarité internationale...............................................................................................................................233.3.2. Le monde n’est pas une marchandise ....................................................................................................... 233.3.3. Criminalisation syndicale et militante ........................................................................................................ 23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 20061. La situation où nous sommes1.1. L’Europe1.1.1. La construction européenneLe 1er mai 2004, l'Union européenne est passée àvingt-cinq États membres avec l'accueil de dixnouveaux pays, essentiellement issus de l’ancienbloc de l’Est. Ce processus d'élargissement est loind'être achevé puisqu'une deuxième vagued'adhésion est prévue en 2007, tandis que denouvelles négociations se sont ouvertes dès 2005avec la Turquie et la Croatie. Au-delà du défiinstitutionnel d'un fonctionnement à vingt-cinq,l’élargissement de l'Europe a considérablementmodifié les équilibres économiques,démographiques, sociaux et politiques.Cet élargissement ne remet pas en cause lapolitique de l’Union européenne en matièred’immigration. Vu d’Afrique ou de pays de l’Est, l’UEapparaît comme une forteresse inaccessible.L’ouverture des frontières vers l’extérieur, larégularisation des personnes sans papiers, maisaussi les revendications concernant notamment lesrapports Nord/Sud (dette, etc.) font partie desenjeux importants selon nous pour la constructioneuropéenne. A cela s’ajoute l’offensive libérale « aunom de l’Europe » dans chaque pays de l’UE, quipasse par des reculs importants pour s’aligner surle moins-disant. Nous affirmons, quant à nous, quel’UE doit se structurer rapidement autour de valeurscommunes d’ouverture, de solidarité, de démocratieet de progrès social, sur la base de coopérations etnon sur les principes de « concurrence libre et nonfaussée » qui permettent des attaques gravescontre les services publics et les acquis sociaux dessalariés.Nous avons donc défendu l’idée qu’une constitutioneuropéenne, si elle était nécessaire, devait selimiter aux grands principes et ne pasinstitutionnaliser un système économique quel qu’ilsoit.Le « non » majoritaire des français au traitéconstitutionnel a été sans aucun doute la plusgrande victoire des antilibéraux depuis desdécennies. Cependant la Confédération CGT n'a pascapitalisé la dynamique créée avant le référendumpour lancer des revendications et mobiliser lessalariés.Le syndicat CGT de l’Insee espère bien entendu queles régions pauvres des 10 nouveaux membresbénéficient des aides dont leurs homologuesd’Europe du Sud ont bénéficié.Notre syndicat continuera à combattre pour uneautre Europe qui passe par une nécessaire rupturedémocratique profonde de son fonctionnement. LaCGT Insee souhaite participer, selon ses modestesmoyens, à la création d’une Europe élargie à tousceux qui le souhaitent, d’une Europe bâtie dansl’intérêt des citoyens et des travailleurs, d’uneEurope qui construise des services publicseuropéens, d’une Europe où le choix de chacunparticipera au choix de tous.1.1.2. L’Europe des syndicatsLa CES (Confédération Européenne des Syndicats)est une confédération de confédérations qui n’a pasd’adhérents directs. Les fédérations syndicalesadhérentes sont originaires de 34 pays ce quinécessite beaucoup de confrontations et dediscussions. Cette situation produit à la fois unelourde machinerie mais aussi des occasions decompréhension mutuellle et d’actions communes dela part de syndicats très différents au départ. Ainsi,des comités syndicaux interrégionaux tentent de serapprocher de la base ; de même, les fédérationssyndicales de branche favorisent l’émergenced’intérêts communs à l’ensemble des salariés. Lesmodes d’action de la CES vont de pressions sur leparlement européen et la Commission à desmanifestations européennes.L’établissement d’un rapport de force au niveaueuropéen se heurte à différents obstacles : adhésion de la CES à une conception libérale del’Europe ; diversité des modes de représentation,d’organisation et de puissance des syndicalismesnationaux ; absence d’un droit de grève européen ; diversité des modes de régulation dans lesdomaines politique, économique et social ;Mais on note une nette prise de conscience de ladimension européenne des droits et des acquissociaux des salariés, comme en témoignent desluttes récentes victorieuses étendant à tous lessalariés d’un site, indépendamment de leur origineen Europe, le bénéfice de la législation et du codedu travail national (chantiers navals, etc.).Parmi les questions d’actualité de la CES : commentse situer sur les suites du projet de Constitutioneuropéenne après les votes des différents Etats etson rejet par la France, sur les contenus,conséquences et luttes contre les effets négatifs desnombreuses directives les plus directement liéesaux droits des travailleurs (Bolkestein, entreautres) ? Comment structurer la CES ? Commentmettre en place une régulation mondiale ? Quellecoopération Nord-Sud ? La convergence syndicalese fera-t-elle par le biais de la CES ou enprivilégiant les relations bilatérales ? La questionqui nous est posée est l’intégration d’une dimensionsociale à la construction européenne.L’adhésion de la CGT à la CES et son accès àd’importantes responsabilités en son sein sont denature à infléchir les orientations de la CES dans unsens plus offensif, pour affirmer et consolider lesintérêts de tous les salariés européens.Réciproquement, cette adhésion n’est pas sanseffets sur le positionnement de la CGT sur l’Europe,source de débats intenses en son sein.Encore faut-il que les bases syndicaless’investissent dans ce sens. Le syndicat nationalCGT Insee assurera une formation sur les questions3/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006européennes et pourra solliciter des camaradescompétents sur ces sujets.Au travers de la participation de la fédération desfinances CGT à l’UNI (Union Network International),il participera au rassemblement international dessyndicats des « services publics » et du secteurprivé des services.1.2. La France1.2.1. Décrédibilisation des politiquesLa droite au pouvoir gouverne au bulldozer. Elleaccélère ce qu’elle a initié depuis son retour :libéralisation à tous les niveaux, démantèlement duservice public évidemment, où les départs à laretraite sont faiblement remplacés, privatisationsau bénéfice des proches du gouvernement (EDF-GDF, Autoroutes, SNCM…), alors qu’il estparfaitement connu que la concurrence ne bénéficiepas aux usagers. La privatisation a commencé avecle retour de la droite. Cette dernière accentue unepolitique du « tout répressif » y compris lors desmouvements sociaux et une politique d’annoncesoù les budgets pour le volet social ne sont pasprogrammés (logement social).Désavoué par les citoyens lors des électionsrégionales de 2004, où seules deux régions sontconservées par la droite, le gouvernement continuesa politique destructive. Il met en place uneréforme de la protection sociale qui remetprofondément en cause les principes de laprotection sociale solidaire pour tous les salariés etqui est particulièrement défavorable auxpopulations les plus fragiles (les plus démunis, lesétrangers sans papier). La réforme, baséeuniquement sur la « maîtrise des dépenses desanté » et visant à faire de la santé unemarchandise comme une autre a pour conséquenceun accroissement des dépenses de santé dessalariés. Elle ne propose aucune mesure concernantle financement alors que les entreprises bénéficienttoujours plus d’exonérations de charges et qu’ilfaudrait une réforme de fond de son financementpour que les profits soient davantage mis àcontribution. Or, la question du choix de sociétéétait bien la préoccupation majeure d’une grandepartie de celles et ceux qui ont voté non commel’ont montré les collectifs « du 29 mai ».Le gouvernement de Villepin poursuit la politique decasse sociale de son prédécesseur. Dès sespremiers jours, il met en place le Contrat NouvelleEmbauche qui permet aux chefs d’entreprises demoins de 20 salariés de licencier les salariés sansmotif pendant deux ans.Par contre, 6 mois plus tard, la création sur lemême modèle du Contrat Première Embauche pourles jeunes salariés de moins de 25 ans, entraîneune mobilisation historique, initiée par lesétudiants. La victoire de la rue aggrave lesdifficultés du gouvernement Villepin. Bien que legouvernement soit décrédibilisé, la question de salégitimité n’a jamais été débattue par lesorganisations syndicales.1.2.2. Le climat économique et socialDepuis l’arrivée de la droite au pouvoir, le climatsocial et économique français continue de sedégrader.Les salariés subissent la baisse du pouvoir d’achat,la diminution des aides, la stagnation des salaires,la précarisation de l’emploi avec la remise en causedu contrat de travail, le licenciement de masse etles privatisations présentées comme inévitables,alors que les profits des entreprises augmentent.Les blocages de salaires, les plans de licenciementet la pauvreté croissante sont de plus en plus malacceptés. Les prétendues délocalisationsobligatoires ne peuvent plus cacher la réalité de ladictature actionnariale alimentée par les sacrificessalariaux.De moins en moins de personnes peuventbénéficier d’une couverture sociale suffisante. Selonles normes européennes, une personne sur sept enFrance vit en dessous du seuil de pauvreté. Lesconditions de logement se dégradent pour denombreux salariés. Les bidonvilles se développentautour des grandes agglomérations.L’autisme gouvernemental devant les votessanctions successifs (régionales, européennes,référendum, …) et devant les mouvements sociauxstructurés très massifs (retraites, sécu, …) favorisel’émergence de phénomènes collectifs plusradicaux.La révolte des banlieues de novembre 2005 en estl’expression la plus flagrante. La stigmatisation et ladiscrimination vis à vis de ces zones et de cesjeunes créent, de longue date, un climat dedésespérance explosive et délétère y compris entrehabitant(e)s des cités. C’est à la suite d’allusionsinsultantes et inadmissibles du ministre del’intérieur, suivi du décès de deux jeunes apeurésfuyant les policiers, que la colère des habitant(e)sdes cités a explosé. Pour une partie d’entre eux,principalement masculine et jeune, elle s’estexprimée par la dégradation de véhicules d’autreshabitant(e)s, de services publics, etc., revêtantainsi un caractère autodestructif. Ce moyen d’actionn’a pas fait l’unanimité des habitant(e)s et a étécombattu par une partie d’entre eux (elles). Face àces émeutes, la seule réponse gouvernementale aété l’accentuation de la répression. De nombreuxjeunes ont été incarcérés suite à des procès trèsrapides voire expéditifs. Il n’y a eu aucune volontéréelle de compréhension de ces événements, niréponse aux urgences sociales dans ces quartierspar des mesures pour l’emploi, la formation, la luttecontre les discriminations,... Ces constats nousposent des problèmes en tant que syndicalistes :comment trouver des actions efficaces pourconstruire des solidarités syndicales et travailler àréduire les inégalités et l’insécurité sociale.Malgré la victoire estudiantine, il demeure évidentque les attaques contre les droits des travailleursvont continuer. La flexibilité et la précarisation(synonymes de paupérisation) sont issues de lavolonté politique d’un gouvernement libéral, relaisfidèle d’un patronat avide.4/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006Plus récemment, les luttes contre les expulsions desans-papiers ou les drames vécus par des centainesde familles (Cachan) montrent l’acuité de cesquestions et la nécessité d’une solidarité syndicale.1.2.3. Imposer la question sociale parla mobilisationAprès les luttes contre le CPE, un mouvement socialprend une nouvelle ampleur autour des sanspapiers.Il s’est enraciné autour du devenir desenfants, premières victimes de la politiquexénophobe du gouvernement et de ses pratiquesracistes. Ce mouvement, grâce à son enracinementet sa popularité, obtient des premiers succès.Pour nous, le mouvement syndical a laresponsabilité d’initier ou d’appuyer les luttes, deles coordonner et de les généraliser. Il doit êtrecapable de proposer une alternative et d’étendre lessolidarités d’action avec les nouvelles formes queprend le mouvement social (ATTAC face à lalibéralisation internationale, DAL face au problèmedu mal logement, RESF, etc.)Ces mobilisations ne doivent, en aucun cas, êtresubordonnées aux échéances électorales.1.3. L’Insee et la statistiquepublique1.3.1. La place de l’Insee dans lastatistique européenne etinternationaleBien que cela ne soit pas toujours visible, le niveaueuropéen est structurant pour l’organisationstatistique de chacun des pays membres.Symétriquement le chiffre tient une placeimportante dans les décisions politiques au niveaude l’Union européenne.Les décisions prises en commun à Eurostats’imposent à tous les INS (Instituts Nationaux deStatistiques), qui doivent les mettre en application,avec parfois un certain délai. Tous les aspects del’activité de l’Insee sont concernés, même lacollecte des données de base : nouvelles enquêtes,calendriers, nomenclatures.Dans la plupart des domaines, la qualité desdonnées est examinée, les méthodes de traitementsont classées selon leur fiabilité, et les INS doiventcorriger leurs points faibles dans certains délaisimpératifs.L’harmonisation statistique européenne etinternationale est indispensable pour lacomparabilité des données. Elle peut avoir desaspects négatifs (baisse de qualité quand l’Insee estplus opérationnel sur un domaine : cela a été le caslors de la mise en place d’Intrastat qui permet demesurer les échanges entre pays membres de l’UE ;mais aussi plus récemment sur les enquêtes auprèsdes ménages), mais elle est généralement positivepour les utilisateurs. Et des décisions européennesont conduit l’Insee à effectuer des travaux quin’auraient peut-être jamais été entrepris sans cela :par exemple l’obligation de fournir annuellementune courbe de distribution du revenu des ménages.La politique d’Eurostat et le positionnement del’Insee en matière européenne est peu lisible pourles agents de l’Insee, y compris parfois pour ceuxqui doivent participer à des travaux européens. Lamise en place du Code de bonnes pratiques sur laquestion de l’indépendance des instituts nationauxde statistiques sera intéressante : nous nousservirons de cet outil au sein du système statistiquepublic.Par ailleurs, le Conseil Européen pour l’InformationEconomique et Sociale (CEIES) dont la réforme esten cours, n’est pas l’équivalent du CNIS au niveaueuropéen. Nous devons militer pour qu’il ledevienne.Des remarques du même type peuvent être faitesen ce qui concerne les autres organisations dontl’Insee est membre au niveau international.Notre syndicat mènera une réflexion sur lesconséquences de la construction de l’Europe dans lechamp de la connaissance statistique et s’investira,avec la fédération des finances, sur les sujets leconcernant, plus particulièrement la défense et ledéveloppement des services publics.1.3.2. Notre conception del’information statistique publique etde son élaborationContre la conception libérale dominanteL’influence de la théorie néoclassique est toujoursdominante. Cela est dû à une imprégnationexceptionnelle du modèle libéral et de la penséeéconomique « orthodoxe », à la fois dans lesmédias, à l’Ensai comme à l’Ensae et dans lemonde universitaire. L’importance de l’Insee dansla statistique publique nous conduit à appuyer lesdémarches visant à promouvoir le pluralisme despensées économiques. C’est dans ce cadre ques’inscrit notamment notre soutien à l’initiative duBIP 40 (Baromètre des Inégalités et de laPauvreté). La création d’un comité scientifiqueinterne à « Economie et Statistique » initie un débatlégitime sur les orientations de la revue. Nousdemandons un plus grand pluralisme et uneféminisation de ce comité.1.3.2.1. A l’InseeEn région, l’information et les études produites parl’Insee et celles en collaboration avec les SSM sontmenacées par le Moyen-Terme Insee. Le risquen’est pas nul de ne répondre qu’aux demandes desservices publics, ou à celles de lobbies bienreprésentés localement, en renvoyant tous lesautres utilisateurs sur les sites internet sans aucuneaide à l’appropriation des informations. Enparticulier, la concertation avec les forcessyndicales ou associatives locales et la prise encompte de leurs besoins de connaissances ne sontpas une priorité de l’Insee.La statistique régionale s’est modifiée au cours desdernières années. L’organisation en pôles régionauxspécialisés (PSAR) a pour conséquence que l’Inseeet ses DR ne répondent plus qu’au travers d’une5/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006offre trop fermement encadrée par des outilsparfois contraignants dans un contexte de réductiongénérale de moyens : un schéma d’offre cohérente(SOC) permettant à l’Insee de proposer desréponses parfois trop standardisées ; desinjonctions nationales de ne travailler qu’enpartenariat avec des acteurs régionaux et locauxprioritaires en nombre limité ; des priorités définiesnationalement et contrôlées dans un systèmetatillon d’objectifs, d’indicateurs et de moyensorganisés autour des impératifs de gestion de laLOLF...Ainsi, les études régionales, qui doivent répondreaux divers besoins régionaux sur les inégalitéssociales, les caractéristiques structurelles desterritoires etc., risquent fort de ne plus êtrelargement ouvertes aux besoins des différentsacteurs de la société. Il faut donc préserver unespace d’études à l’initiative des DR Insee aux finsde prospective ou d’autres thèmes majeurs.La question du financement des travaux de l’Inseeconstitue un obstacle en soi. L’Insee ne travaille enprincipe en partenariat que sur la base d’un partagedes coûts. Il faut permettre aux partenaires sociauxou associatifs, généralement dépourvus de moyenssuffisants, d’accéder à la possibilité de fairetravailler l’Insee sur des sujets d’intérêt généraldont ils sont porteurs, conformément à sa missionpremière.Nous affirmons avec force notre opposition à uneorientation priorisant certains publics pour n’offrir àd’autres qu’un minimum, aussi vaste soit ceminimum. Cela pourrait se faire par exemple vial’impulsion donnée à la création de CRIES dans lesrégions. Ceci remettrait en question la politiqueactuelle de partenariat avec partage des coûtsobligatoire. De même se pose la question des liens,à développer, avec le monde universitaire. Lerisque de ne répondre qu’aux besoins des pouvoirspublics locaux ou à des lobbies bien représentésserait ainsi évité.Les orientations à moyen terme de l’Insee doiventpermettre un travail de qualité et intéressant pourles agents. Cela s’oppose aux réorganisations enpôles de production qui de plus manquent souventde proximité avec le terrain. Cela s’oppose aussi àla démarche actuelle de définition de « prioritésnégatives » en matière de statistique publique.Nous devons également, par nos interventions ausein de l’Insee, obtenir que la concertation auniveau régional soit accrue. Les CRIES n’existentpas dans toutes les régions, nous devons obtenirleur création (ou leur équivalent) en lien avec lesorganisations syndicales régionales.1.3.2.2. Dans les SSMEn France, les Services Statistiques de chaqueMinistère (SSM) assurent la collecte, le traitement,l’analyse et la diffusion de l’information statistiquerelevant de leurs domaines. L’Insee a un rôle decoordination, et selon l’importance de ces servicesministériels, gère en commun certains travaux ouapporte ses compétences. Certains SSM ont acquisun statut et une notoriété importants. Ils traitent dedossiers politiquement sensibles, tels que deschiffres du chômage et de l’emploi, la santé,l’éducation… Ils interviennent dans l’évaluation despolitiques publiques. Un réel débat et un contrôledes politiques menées nécessitent unprofessionnalisme et une indépendance scrupuleusede la part de tous les statisticiens.En région, la mise à disposition d’effectifs et demoyens financiers suffisants et le maintien de laprésence de personnel Insee de toutes catégoriessont nécessaires pour garantir le bonfonctionnement des SSM et le maintien de leursmissions.Notre collaboration avec les syndicats des SSM,notamment sur les sujets d’indépendance, maisaussi d’information comme dans le domaine duchômage et de l’emploi, doit être poursuivie enétablissant des revendications communes.1.3.2.3. Pluralisme et déontologie de lastatistique publiqueLe pluralisme des approches théoriques,méthodologiques et l’ouverture aux besoins detoute la société est une condition nécessaire del’information statistique publique. Les règles et lespratiques déontologiques professionnelles en sont lecomplément indispensable.L’existence et le respect de règles scientifiques etdéontologiques strictes dans la production, l’analyseet la diffusion des statistiques s’imposent. A cetégard, l’existence de chartes et codes de bonnespratiques acceptés au niveau européen par laprofession et s’imposant à tous, Etats et institutionsstatistiques, peut constituer un levier utile, ycompris en les rappelant à ceux qui les ont écrits !Plus généralement, nous voulons obtenir un largedébat devant aboutir à la définition et au respect derègles claires garantissant la fiabilité, l’honnêteté etla large capacité d’initiative et de diffusion deschiffres et des études. Le bureau du CNIS, sesformations et l’assemblée plénière sont des lieux oùnous ferons aussi porter ces revendications, entravaillant en concertation avec les représentantsconfédéraux CGT en leur sein.1.3.3. L’utilisation de l’informationstatistiqueLe chiffre peut représenter une arme dans lesmains des politiques afin de convaincre l’opinion.Ainsi, les hommes et femmes politiques cherchentdans le chiffre une caution scientifique et unargument « inattaquable » pour parvenir à leursfins. Cela amène à des utilisations d’étudestronquées, voire manipulées de façon malhonnête.Dans ce contexte, l’Insee doit garantir la pluralitéde ses études et simultanément, éviter l’écueil dudénigrement de la mesure statistique sans laquelleles jugements seraient laissés à l’arbitraire.Le système statistique public doit s’assurer de lapertinence des concepts et des méthodes qui ontprévalu à la construction des chiffres, garantir leurfiabilité, l’indépendance avec laquelle ils sontproduits et une diffusion transparente. Uneattention particulière doit prévaloir au sein du6/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006système statistique sur les sujets de société enpromouvant des travaux statistiques novateurs etdes études pluralistes.Ainsi, le colloque intersyndical Insee de mars 2006a permis d’identifier plusieurs enjeux majeursactuels ou à venir de la statistique publique : la mesure des inégalités ; les effets du désengagement de l’Etat despolitiques sociales et ses conséquencesinquiétantes en termes d’informationstatistique pertinente ; la mesure statistique des discriminations degenre, pour combattre ces dernières ; l’adaptation nécessaire de la statistiquepublique aux transferts de compétences nés de ladécentralisation ; la nécessité d’une fonction de coordinationstatistique au niveau régional, assurée parl’Insee ; la statistique publique conçue et mise auservice d’indicateurs en forte expansion, tropétroitement et directement liés à des actions etpolitiques publiques de niveau international(OCDE, Europe, …) ou national (LOLF, …) etconstruits dans la logique d’action de cespolitiques, au détriment d’une connaissancefondée sur des approches pluralistes.Il faut également renforcer l’attention sur lesconditions de diffusion et de mise à disposition del’information et sur les dates sensibles depublication, notamment au cours des échéancesélectorales.La statistique publique doit également, parl’existence du CNIS et de ses équivalentsrégionaux, définir ses orientations en fonction desquestions prioritaires mises au jour par la société.La valorisation du CNIS, instance incontournable,nous paraît positive. Cependant, comme dansbeaucoup d’instances nationales, une certainelourdeur de son organisation prévaut notammentpar la composition administrative de ses instancesd’organisation. Une sur-représentation de fait desspécialistes des domaines empêche souvent uneréelle confrontation d’arguments, et peut occulterdes débats pourtant nécessaires en ce lieu. Noussommes favorables à une meilleure représentationdes associations et autres acteurs sociaux deterrain au CNIS.Les représentants de la CGT au CNIS défendent uneconception de la statistique basée sur une analyseplus globale des phénomènes économiques etsociaux, et non pas seulement des statistiquesproduites au coup par coup au gré des demandes,qui seraient orientées vers la seule évaluation despolitiques publiques.Le syndicat national CGT de l’Insee souhaite que lesconfédérations syndicales et les partenaires sociauxpuissent participer à l’orientation des travauxstatistiques et aussi des études, notamment àtravers la reconstitution et la participation à uncomité des études de l’Insee.Récemment, notre travail commun avec laconfédération pour son intervention au sein duCNIS a permis plus d’efficacité syndicale. Notreaction syndicale doit se poursuivre en ce sens.1.3.4. la place particulière du syndicatCGT InseePar la spécificité de ses missions et l’aura de l’Inseedans les médias, le syndicat CGT de l’Insee estamené à être l’interlocuteur « expert » apportantun point de vue contradictoire au cours demouvements, par exemple les chiffres sur leContrat Nouvelle Embauche. Cette particularité ajusqu’à présent été sous-estimée et sous-exploitéedans un contexte où les relais de la pensée libéralene manquent pas. Au-delà de notre participation auRéseau d’Alerte sur les Inégalités (RAI),notamment par l’actualisation du BIP40, nousavons à avancer pour apporter une contradictionchiffrée et argumentée, comme par exemple laconstruction d’indices du pouvoir d’achat selon lacatégorie socio-professionnelle.7/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 20062. Les principes et l’organisationde notre syndicat2.1. L’organisation2.1.1. Les sectionsNotre structuration en sections implantées dans lesétablissements est essentielle pour permettre uneaction avec tout le personnel, qu’il soit titulaire, nontitulaire, ou employé par une autre entreprise maistravaillant dans l’établissement. Elle nous permetde mieux prendre en compte l’ensemble despersonnes travaillant aussi bien dans les directionsrégionales que dans les établissements parisiens,les centres nationaux informatiques, au Céfil, àl’Ensai et à l’Ensae.Mais il ne faut pas ignorer notre fragilité. Beaucoupde sections ne comptent que peu d’adhérents et unnombre restreint de militants. Cela risque à termede les démobiliser et d’entraîner la dissolution dessections les plus faibles. Les sections les plusimportantes se doivent donc d’aider au partage deleurs expériences.La vie de la section passe par la tenue régulière deréunions de syndiqués et l’organisation régulièred’HMI permettant d’échanger avec le personnel. Laparticipation de membres du BN est possible.L’existence et le fonctionnement de bureauxsyndicaux permet d’organiser l’action avec lessyndiqués et le personnel.Pour approfondir réflexions et échanges, laformation syndicale est indispensable. Elle peut êtrecentralisée pour les petites sections. Les sectionsles plus fortes s’engagent à parrainer une sectionqui le souhaite.2.1.2. Le syndicat nationalLe syndicat national est indispensable pourpermettre la mise en commun des expériences dessections locales et l’action collective face à lapolitique mise en œuvre par la direction de l’Insee.Il est le reflet de la vie des sections. Il doit aussipermettre la mise en commun des ressources afind’aider les personnels isolés et les sections dont lesmoyens sont réduits.Dans la mise en œuvre des projets de l'Insee, lesagents des DR peuvent se sentir opposés à ceux dela DG, les personnels d’exécution aux cadres, et lesagents entre eux à l’intérieur des services. Notreimplantation dans la plupart des établissementspermet de travailler à rassembler les personnelsdans leurs besoins communs, leurs revendicationscommunes, en tenant compte des apports dechacun.La Commission Exécutive (CE) est la direction dusyndicat. Elle doit représenter l’ensemble dessections. Les membres de la CE participent àl’animation de leur section où ils diffusent lesinformations nationales. Ils préparent les CE avecles syndiqués et le bureau de section.Les interventions dans les instances paritaires et lesrencontres avec la direction nationale se font sur labase des décisions de la CE.Le bureau national a un rôle d’animation, depropositions et d’application des décisions ducongrès sous la responsabilité de la CE.Notre syndicat considère comme une orientationprioritaire le fait de mettre à la disposition de sesadhérents, dans les meilleurs délais, toutes lesinformations nécessaires à leur activité. Le syndicatdans ses composantes nationales et locales se doitaussi d’informer le personnel.Le syndicat national mènera une réflexion pour sedonner les moyens d’améliorer la circulation del’information entre les sections et dans tout lepersonnel, permettre que les initiatives localessoient mieux connues et relayées dans toutes lessection et parmi le personnel.2.1.3. Le syndicat au sein du MinefiAu niveau départemental, les sections doivents’investir dans l’interdirectionnel. L’hygiène et lasécurité ainsi que l’action sociale sont structuréesdans des instances départementales à dimensionsfédérales. Celles-ci offrent un lien pour lesrevendications qui concernent directement lesagents. Plus généralement, la rencontre avec lesinstances CGT des administrations financières dudépartement permet l’organisation de luttes, dedébats et de formations dont nos sections nedoivent pas se priver. Le droit aux heuresd’informations syndicales interdirectionnelles n’estpas suffisamment utilisé.Au niveau national, nous devons également cultiverle travail avec les syndicats des autres Directionsdu ministère.2.1.4. Les structuresinterprofessionnellesAfin d’éviter le corporatisme et l’isolement, il estimportant d’avoir des contacts réguliers et deséchanges avec les autres travailleurs de la région.Cela permet de faire profiter les autres de notreexpérience et de bénéficier des leurs.Toute revendication de grande ampleur a besoin derelais extérieurs. Pour organiser les luttes,l’investissement dans les Unions Locales et lesUnions Départementales est donc nécessaire.L’ensemble de nos sections doit donc s’y investir etbien sûr, en payant la part de cotisation qui leurrevient, leur donner les moyens de fonctionner.Nous devons conjuguer nos forces pour faireaboutir nos revendications d’un service public dequalité. C’est pourquoi nous devons participer auxdifférents collectifs de fonctionnaires au sein desUnions Départementales (UD) et Unions Locales(UL) pour mieux travailler ensemble dansl’interministériel.2.1.5. Le syndicat au sein des SSMSauf cas particulier, le principe est que les agentsdes SSM adhèrent au syndicat CGT de leur lieu detravail. Le syndicat CGT de l’<strong>insee</strong> s’engage à8/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006transmettre à tous les agents travaillant hors del’Insee, en particulier aux syndiqués, toutes lesinformations leur permettant de se tenir au courantde ce qui se passe au sein de l’Institut.2.1.6. L’accueil des nouveauxL’accueil des agents nouvellement arrivés estfondamental, qu’ils soient nouveaux arrivants àl’Insee, nouveaux arrivants dans un établissementdonné ou nouveaux enquêteurs des réseauxMénages et Prix. Un premier contact est l’occasiond’une reconnaissance mutuelle, permettant deremettre en question les clichés dont touteorganisation est porteuse. Il convient doncd’accueillir les nouveaux arrivants de façonpersonnalisée. C’est l’occasion de faire savoir à lapersonne que la section est ouverte au dialogue etcherche l’enrichissement d’un regard neuf et desexpériences différentes. Il ne s’agit pas de placerune carte, mais de dialoguer et de convaincre. Laprésentation de la section, de ses objectifs, de sesméthodes et des actions réalisées est le point dedépart de ce dialogue. Le bureau national s’engageà concevoir un support avec la présentation dusyndicat, de ses instances, les noms desreprésentants syndicaux et des élus en CAP. Lorsde la première CE post-congrès, un groupe detravail sera constitué pour élaborer ce support.Chaque section pourra le compléter localementpour en faire un support complet à l'usage desnouveaux.2.2. Le fonctionnement syndical2.2.1. Le débat démocratiqueTous les points de vue sur la conduite des luttes etla stratégie syndicale sans exclusive de naturepolitique, doivent pouvoir s'exprimer dans lesyndicat.Les discussions ne doivent pas se trancher de façonarithmétique, elles doivent être ouvertes etapprofondies mais ne doivent pas empêcher lesyndicat national de prendre position en conclusiondes débats. Elles doivent s'appuyer essentiellementsur notre expérience syndicale.Au sein des établissements nous devons égalementveiller à construire les revendications avec lesagents ; c’est-à-dire provoquer suffisamment dediscussions pour que les opinions puissents’exprimer et enrichir les débats. Ensuite, il fautassocier les agents lors des actions décidées encommun.Cependant, la société a tendance a faire dusyndicat un fournisseur de services. Des salariésont tendance à « consommer » du syndicat commeils consomment d’autres produits et services. Pourenrayer cette dérive consumériste, nous devons lesinciter à prendre toute leur place dans la viesyndicale et les mobilisations.Nous ne nous satisfaisons pas du trop faible niveaud’implantation et d’adhésion actuels. De ce fait, lescollègues de travail ne bénéficient pas partout del’appui qu’apporte un syndicat pour la défenseconcrète et personnelle de leurs intérêts. Ils sont defait dessaisis de l’un de leur droits fondamentaux,par absence d’organisation vivante à leurdisposition. Réciproquement le syndicat nebénéficie pas de la connaissance complète dessituations seule capable de donner un sens à sacompréhension des initiatives et des orientationsdes directions de l’Insee. Le trop petit nombre desyndiqués appauvrit également la vie démocratiqueau sein de l’Insee car le syndicalisme n’y est pasreconnu à sa juste place.Le syndicat national considère que la participationcroissante des salariés à la vie syndicale, danstoutes ses composantes y compris l’adhésion,constitue l’une des priorités à venir.2.2.2. Le fédéralismeHistoriquement le fédéralisme est pour la CGT, avecl’affiliation à une Union départementale, le principede base de son fonctionnement démocratique. Dansce cadre, chaque organisation confédérée, chaquesyndicat, détermine en pleine autonomie sonorientation et son action sur les problèmesrevendicatifs, dans le cadre des statuts de la CGT.Cette détermination ne peut se réaliser qu’à la suitede larges débats démocratiques. Chaqueorganisation doit tenir compte des prises deposition des autres composantes de la CGT ou de laConfédération dans son ensemble. Elle n'est parcontre jamais tenue de faire sienne les positionsdes instances supérieures.Le respect de ce principe est finalement le meilleurgarant de l'unité de la CGT où chaque syndicat a lapleine responsabilité des positions qu'il prend dansle cadre des grands principes constitutifs admis partous.Le travail commun avec la fédération doit sepoursuivre : participation du syndicat national auxinstances fédérales, mais aussi investissement de lafédération dans les problématiques Insee.Les sujets revendicatifs présentent souvent uncaractère transversal. Nous développerons donctous les contacts nécessaires avec les instances dela CGT (UGFF, confédération, autres syndicats). Lesformations organisées par ces instances sont unoutil de décloisonnement du syndicat dont nous nedevons pas nous priver.2.2.3. L’unité d’actionL’unité syndicale est une aspiration forte dessalariés. La CGT est par nature unitaire. Nous nenous satisfaisons pas de l’émiettement syndicalactuel et oeuvrons, à notre niveau, à sonrassemblement.La CGT Insee recherchera l’unité avec les autresorganisations syndicales représentatives sansexclusive sur la base d’objectifs revendicatifsconvergents ; faire relayer une revendication parl’ensemble des syndicats, c’est lui donner unemeilleure chance d’aboutir.La recherche d’unité d’action ne doit pas freinernotre action revendicative et nous devrons enévaluer régulièrement les effets.9/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 20062.2.4. Revendications et négociationsNotre matériel syndical, journal ou tract, qu'il noussoit propre ou unitaire, met en avant desrevendications quantitatives (salariales,embauches, moyens, etc) et qualitatives (missionsà préserver ou à développer, etc.).La demande d'ouverture de négociations neconstitue en aucun cas une revendication, maisrésulte des mobilisations réalisées.2.2.5. L’indépendance syndicaleOuvert à toutes et tous sans exclusive, visant àdéfendre les intérêts des salarié(e)s, notre syndicatveille à préserver en toutes circonstances sonindépendance vis-à-vis des partis politiques et dugouvernement quel qu’il soit. Il préserve égalementson indépendance vis-à-vis de la direction del’Insee.Soumise à la logique du profit, la société actuelleest traversée par la lutte des classes et par demultiples contradictions dont les conséquencesconduisent à des inégalités et exclusions majeureset des affrontements d'intérêts. Les salariés(es) ontbesoin de se rassembler comme tel(les) pour sedéfendre, conquérir leur émancipation individuelleet collective et participer à la transformation de lasociété et du monde.Nos revendications sont élaborées sans jamais êtresoumises à ce qui est acceptable par le patronat etle gouvernement ou « absorbable » par le systèmeéconomique tel qu’il est. Notre liberté d’action endépend.Cette indépendance se traduit par le fait que lutterjusqu'au bout pour nos revendications peut passerpar la mise en cause du gouvernement lui-même,jusqu'à appeler à son départ.Refuser la cogestionLes récents rapports sur la « rénovation » ou la« modernisation » du dialogue social ont pour but,entre autres d’associer les salariés et les directionssyndicales à la gestion des ressources del’entreprise, le capital restant l’apanage desactionnaires. Le syndicat CGT Insee s’oppose àcette perspective. Il se battra pour refuser toutprojet de cogestion.L’indépendance financière de notre syndicat estaussi la garantie de son indépendance. Le syndicatveillera donc à préserver la maîtrise de sesressources.2.3. Lutter pour les droitsfondamentauxNotre syndicat veille au respect de tous les droitsfondamentaux, notamment envers les immigrés etles étrangers, et s’engage à lutter contre toutes lesformes de discrimination.2.3.1. Lutter pour les droits desimmigrés et des étrangersRafles, expulsions, rétention, travail clandestin,droit d'asile, regroupement familial, double peine,quotas d’entrée… Les migrations des pays sousdéveloppéset de dictatures amènent des réponsesrépressives de la part du gouvernement.Notre syndicat : se prononce pour la suppression totale de laclause de nationalité pour l'embauche destitulaires dans la fonction publique ; soutient les luttes des travailleurs immigrés etétrangers contre le racisme ; demande la régularisation immédiate despersonnes sans-papiers ; demande une simplification des procédures denaturalisation pour celles et ceux qui le désirent ; dénonce et combat les remises en cause dudroit d'asile ; refuse toutes les mesures discriminatoires(quotas sur diplômes ou métiers par exemple) etrépressives, notamment les expulsions ; se prononce pour la participation des résidentsquelle que soit leur nationalité aux élections ; demande l’abrogation de la loi Sarkozy surl’immigration jetable. deviendra signataire ou membre du Collectifunis contre une immigration jetable ; sera membre-soutien du Réseau EducationSans Frontières national. A ce titre il invite sesadhérents à s'impliquer dans les luttes et àparticiper aux collectifs locaux en tantqu'individus.2.3.2. Lutter contre l’exclusion et leracismeL’organisation en associations a permis auxpersonnes sans logis, aux personnes privéesd’emplois de rendre audibles leurs revendications.Notre syndicat national, par ses militants, s’engageaux côtés de ces associations (RAI, DAL, etc.). Ilestime qu’un syndicat de « sans emplois » doit êtredéveloppé et valorisé au sein de la CGT et avoir lesmoyens suffisants pour son fonctionnement.Dans un contexte de crise économique grave, dechômage élevé et de précarité, l'immigré etl'étranger sont désignés comme boucs émissaires.Les émeutes dans les banlieues en 2005 ont servide prétexte au gouvernement pour adopter undiscours ouvertement raciste. Notre syndicat luttecontre toute idéologie et toute manifestation racisteà l'Insee comme ailleurs.2.3.3. Lutter pour les droits desfemmesNotre syndicat combat pour l'égalité entre femmeset hommes, contre l'oppression des femmes et pourla satisfaction de leurs aspirations. Il lutte contretoute idéologie et toute manifestation sexiste àl'Insee comme ailleurs.Malgré les déclarations de principe, l’inégalité derevenus et de carrières entre hommes et femmesreste massive. Les femmes cumulent les obstaclespour l’accès aux emplois qualifiés et àresponsabilités : d’une part encore aujourd’hui elles10/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006sont peu présentes dans les formations quidébouchent sur les métiers les plus valorisés. Etinversement, les métiers où les femmes ont réussià s’implanter se dévalorisent. Elles restent très peunombreuses dans les écoles d’ingénieurs, etminoritaires dans les filières scientifiques ettechniques à partir d’un certain niveau. Par contre,elles sont massivement présentes dans les filièreslittéraires ou du tertiaire. D’autre part, lorsqu’ellesont les mêmes formations que les hommes, ellessont cantonnées dans des postes subalternes.Même dans la fonction publique, l'égalité affirméedans les textes est contredite dans les faits.L’Insee est très en retard sur l’égalitéprofessionnelle eu égard à son recrutement. Sadirection actuelle s’en satisfait manifestement et,malgré quelques nominations, ne prend aucunemesure concrète pour y mettre fin. La mobilitéexigée pour les cadres, par exemple, est un frein àla carrières des femmes. Nous dénonçons cettesituation. De plus, à quand la parité dans tous lesorganismes de direction de l’Insee ?Enfin, le droit à la contraception et à l’avortementsont toujours à revendiquer. En effet, le peu decampagnes pour la contraception, et le manque demoyens pour l’avortement sont une réalité quirelativise la possibilité pour les femmes d’y accéderfacilement. D’autre part des remises en causefrontales de ces droits ont eu lieu dans d’autrespays. Nous n’en sommes pas à l’abri et devonsnous y opposer.2.3.4. Lutter pour les droits deshomosexuel(le)sNotre syndicat combat l’homophobie. Il demandeune égalité des droits entre les homosexuels et leshétérosexuels au sein de la société. Il refuse toutesles discriminations à leur égard.Nous demandons pour toutes les personnes, quelleque soit leur orientation sexuelle ou état civil, lapossibilité d’adoption.Notamment, les droits des conjoints et pacsésdoivent être ouverts au maximum, comme c’est lecas pour les personnes mariées (pension dereversion, héritage…). une contribution financière au FIPHFP -Fondspour l'Insertion des Personnes Handicapées dansla Fonction Publique- si l’emploi de personneshandicapées est inférieur à 6%.Mais notre action doit être en priorité l’embauchede personnes handicapées.En effet, la possibilité offerte par la loi de soustraiterles travaux auprès des ESAT sert auxobjectifs « LOLF » de réduction de la massesalariale.Au lieu d’employer des vacataires, et du personnelstatutaire, les directions régionales peuvent soustraiterles travaux aux ESAT. Cela lui permet donc :de réduire la masse salariale tout en se ventant defaire du « social ». Les dépenses deviennent alorsdu fonctionnement et avec la fongibilitéasymétrique, ce budget ne peut plus être utilisépour embaucher ultérieurement du personnel.Nous demandons que : l’Insee présente un plan pour passer des 4,5%actuels à au moins 6% ; le décret du 18 janvier 2005 sur les modalitésde recrutement des personnes handicapées soitappliqué à l’Insee ; dès l’embauche, les personnels handicapésbénéficient d’un suivi ; des aménagements de postes soient mis enplace ; qu’aucune discrimination du fait d’un handicapn’empêche les promotions.La première CE post-Congrès s’attachera à relancerla direction de l’Insee afin de mettre en place legroupe de travail sur les travailleurs handicapés(Cf. vœu n°31 du CTP HS du 23 mai 2006).2.3.5. Lutter pour l’insertion despersonnes handicapéesNotre syndicat milite pour toute évolution positiveconcernant ce sujet afin que toute personne puissetrouver sa place dans la société civile et enparticulier dans le monde du travail.L’Insee doit au minimum se conformer à la loi fixantà 6 % la part de travailleurs handicapés.L'obligation d’emploi des travailleurs handicapéespeut être satisfaite par : l'emploi de personnes handicapées (6% deseffectifs, hors postes particuliers-ex: conducteurroutier-) ; la sous-traitance à des ESAT -Établissements etServices d’aide par la Travail- (ex ateliersprotégés, ex CAT) si l’emploi de personneshandicapées est inférieur à 6% ;11/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 20063. Nos axes de réflexion et nospropositions3.1. Défense et amélioration desdroits et acquis sociaux, desservices publics, de l’égalité et deslibertésLa défense de la protection sociale et des servicespublics est un enjeu de société, un enjeu pour lemouvement syndical et une priorité pour notreaction.3.1.1. Défense de la protection socialeLe système de Sécurité sociale a été mis en place àpartir de la seconde guerre mondiale pour faire face« à tous les aléas de la vie ». C’est un systèmebasé sur la solidarité, qui doit respecter lesprincipes de base qui sont que chacun contribueselon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Ilcouvre les domaines de la maladie, de la retraite,des prestations familiales et des accidents dutravail. Le principe des cotisations sociales permetde mettre en commun une partie des richessesproduites essentiellement par les salariés pour quechacun puisse se soigner, élever ses enfants, avoirune retraite digne.Ce sont les bases d’une société fondée sur lasolidarité entre les personnes et entre lesgénérations, facteur de la cohésion sociale.De fait, dès l’origine, des mutuelles et descomplémentaires privées ou publiques ont pris encharge des compléments de prestations. Alors queles assurés sociaux financent par leurs impôts etleurs cotisations leur sécurité sociale, lesemployeurs, eux, sont de plus en plus exonérés decotisations et ainsi dégagés de leursresponsabilités. Pour le Medef et ses représentants,une telle organisation solidaire n’est vue quecomme un coût pour les entreprises. Leur objectifest une société où l’individualisme prime.La réforme de la sécurité sociale de 2004 accentueles traits déjà pris sur les évolutions récentes. Lesforfaits (pour les consultations ou pour les séjourshospitaliers) se développent et pénalisent les plusfragiles. Des économies sont faites sur le dos desétrangers en rendant le bénéfice de l’AME(Assistance Médicale d’Etat) difficile. La mesurepositive de la CMU (Couverture Maladie Universelle)ne prend pas en compte toutes celles et ceux quidevraient l’être. Le gouvernement renforce le rôledes régimes complémentaires et donc celui del’assurance privée financée uniquement sur la basedu volontariat, en fait en fonction des moyens dechacun. Il attaque le régime complémentaire de lafonction publique pour y développer un vraisystème complémentaire concurrentiel, doncdéfavorable aux plus faibles.Par ailleurs, cette réforme instaure un systèmeinformatisé de gestion des patients qui, par biendes aspects, peut aboutir à un vrai flicage desdossiers médicaux de celles et ceux qui ne peuventpayer pour y échapper : en effet, pour êtreremboursé, il faut participer au parcours coordonnéqui impose, entre autres, l’inscription sur le dossierde toute consultation et acte médical. Ce systèmepèche par l’opacité et le coût de sa mise en place.Nous demandons la garantie d’une réelleconfidentialité des données médicalisées etl’interdiction de leur utilisation à des fins autres quemédicales.Notre syndicat et notre confédération proposentune amélioration et une simplification des modalitésde remboursement des soins et du versement desindemnités journalières, ainsi qu’une améliorationdes taux de remboursement. La sécurité socialedoit pouvoir développer ses missions de préventionet d’éducation sanitaire, mieux informer les assuréssociaux et les aider dans leurs démarches. Toutcela nécessite une réforme de tout le système, etnotamment de son financement. Pour cela il fautplus de démocratie dans la gestion des caissesprimaires. Comme autrefois, les administrateursdoivent être élus par les assurés sociaux, lareprésentation des salariés devant être majoritairedans les conseils d’administration. Cet éloignementapparaît comme une désappropriation des assuréssociaux. Des élections doivent être rétablies.Nous demandons que le risque de dépendancedevienne une prestation de la Sécurité Sociale.3.1.2. Droit du travailLe Medef qui dénie tout droit aux salariés est suivipar le gouvernement. Le Contrat NouvelleEmbauche permet aux entreprises de moins devingt salariés de licencier sans justification unsalarié pendant deux ans. Même si le ContratPremière Embauche a été retiré, l’objectif dugouvernement est d’arriver à un contrat unique :fin des CDI, la précarité pour tout le monde ! Lesyndicat demande le retrait du CNE et, plusgénéralement, de toutes les formes de contratsprécaires.La même approche vaut pour la gestion del’assurance chômage : le salarié privé d’emploi estperçu comme un fraudeur en puissance. La gestioncollective du problème qu’est le chômage estabandonnée au profit de la culpabilisation et leflicage de chacun et chacune.La question du statut public est également l’objetde nombreuses attaques : la possibilité de licencierles fonctionnaires est régulièrement évoquée.Comme cela a été le cas pour les retraites, lavolonté des gouvernements est bien de faire reculerles garanties des statuts privés et publics.Nous réclamons une sécurité sociale professionnellequi prenne en compte le parcours des salariés :recherche d’emploi, formation… et qu’elle soitfinancée par les entreprises. Mais nous refusons devoir banaliser cette revendication en simple filet deprotection minimum qui légitime la conception d’unsalarié jetable et banaliserait l’impact personnel etsocial du licenciement.Réduction du temps de travailLe chômage de masse continue de faire des dégâtsdans la société. Plus que jamais, le syndicalismedoit lutter pour le droit à l’emploi pour toutes et12/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006pour tous, et combattre toutes les politiques quis’opposent à la perspective de la disparition duchômage. Nous réaffirmons que la disparition duchômage passe notamment par la réduction dutemps de travail : travailler moins pour travaillertoutes et tous est notre principe de base.La réduction du temps de travail doit s’inscrire dansla loi, être générale et ne pas dépendre d’accordsde branche. Elle doit concerner la duréehebdomadaire et la durée maximale (journalière,hebdomadaire…). La durée hebdomadaire doitpasser à 32 heures. Cette nouvelle réduction de ladurée hebdomadaire du temps de travail devraitpermettre de réouvrir un débat sur l’organisation dutravail associant tous les agents, pour aller versune auto-organisation du temps de travail, tout entenant compte des contraintes spécifiques desservices en contact avec le public.Le Medef n’a jamais accepté la législation sur les 35heures, même si certains aspects de la mise enœuvre lui étaient favorables (annualisation dutemps de travail, …). Mais ce que veut le Medef,c’est à la fois l’absence de « contraintes » inclusesdans le Code du travail et le bénéfice de la flexibilitéet des réductions de « charges ». Les offensivescontre les 35 heures, en fait contre toute idée deréglementation sur le temps de travail vont sepoursuivre et pourraient s’étendre à la Fonctionpublique. Nous nous opposerons à toutes cestentatives de liquider ce qu’il reste des 35 heures,et sommes partisans d’une mobilisation unitairepour reconquérir une RTT sans flexibilité, sans« modération salariale » et avec les embauchescorrespondantes, y compris dans la FonctionPublique. Nous rejetons notamment l’augmentationdes heures supplémentaires, au nom d’un soidisant« droit individuel à travailler plus pourgagner plus ».Augmenter les salaires, maintenant !Le pouvoir d’achat des salaires ne cesse de sedégrader. Cette détérioration touche tous lessalariés, ceux du privé comme du public. Cettedérive doit être inversée, c’est une question dejustice sociale mais aussi d’efficacité économique etde lutte contre le chômage.Nous réclamons un rattrapage des pertes depouvoir d’achat et des augmentations de salaires,correspondant à un meilleur partage des fruits de lacroissance et des gains de productivité. Enparticulier, nous demandons un relèvementimmédiat du SMIC à 1500 € et à ce qu’aucunminimum de branche ne lui soit inférieur. Aucunemesure individuelle ou collective de typeintéressement, épargne salariale, actionnariatsalarié ou épargne retraite ne doit se substituer ausalaire.3.1.3. Défense et développement desservices publicsLes services publics constituent un enjeu primordialdans le débat économique et politique actuel. Ilspermettent à toutes et tous d’avoir accès à desbiens et services essentiels sur la base d’untraitement égalitaire de tou(te)s les usager(e)s. Ils13/23constituent un outil indispensable de l’actionpublique pour faire face aux enjeux économiques,sociaux, culturels et environnementaux auxquelsest confronté notre pays. Or, depuis plus d’unequinzaine d’années, les différents gouvernementsde l’Union européenne, et notamment les différentsgouvernements français, ont mis en œuvre unepolitique de privatisation et de déréglementationdes services publics. Ils ne cachent plus leurvolonté de recentrer l’Etat sur ses missionsrégaliennes, c’est à dire la police, la justice etl’armée. Pour eux, l’Etat doit limiter sesinterventions à des fonctions de prescription, deréglementation, d’ordre, de régulation du marché.Les services publics subsistants voient souvent unepartie de plus en plus importante de leurs missionsexternalisée et/ou sous-traitée, parfois avec desconséquences immédiates pour les personnels(exemple à DRIRE).Au niveau européen, l’optique est similaire. Onparle rarement de « services publics », mais plutôtde SIG (Services d’Intérêt Général). On affirme lanécessité de les ouvrir, dans leur grande majorité,à la concurrence. En revanche, rien n’est garanticoncernant le statut de leurs personnels et desadministrations et entreprises concernées.Notamment, des missions de service public peuventêtre confiées à des entreprises privées. Quant aurôle des SIG vis-à-vis de l’usager(e), il se réduit àgarantir un « service universel » accessible àtou(te)s, ce qui constitue un recul par rapport auxfonctions d’un service public.3.1.3.1. Des conséquences néfastes pourles personnels et les usager(e)sCes orientations ont partout conduit à une baissede la qualité du service rendu et à des régressionspour les personnels. Les salarié(e)s en lutte desdifférents services publics avaient largementanticipé les conséquences de cette politique.L’augmentation des tarifs et l’application de critèresde rentabilité aux dépens de la péréquationgéographique ont exclu une partie importante de lapopulation (suppression de nombreuses lignes detrain SNCF non rentables financièrement, parexemple). Les entreprises privatisées ont réduit etprécarisé leurs emplois, les conditions de travail despersonnels sont très souvent dégradées. En fait,pour les tenants de l’économie libérale et de lapensée unique dont les gouvernements successifsse font les représentants, les services publics etleurs personnels sont avant tout un coût à réduire.Le service rendu à la population d’une part, l’impactnégatif sur l’emploi d’autre part sont considéréscomme anecdotiques dans le « débat » tel qu’ils lemènent. Depuis le début des années 2000, lesattaques contre les services publics et leurs agents,notamment les fonctionnaires, s’accélèrent et sontde plus en plus présentes dans les discours et lespratiques. Les privatisations et mises enconcurrence s’enchaînent à allure rapide : EDF,GDF, ANPE, SNCF…Les personnels ne sont pas épargnés : réforme de leur statut (France Télécom, laPoste, plus récemment l’ANPE) ou transferts
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006massifs vers des statuts devenus moinsfavorables comme dans le cas des personnelsATOSS depuis 2003 ; taux de précarité dépassant maintenant celuidu privé avec le recours massif aux non-titulaires,vacataires ou encore « contrats aidés » ; stagnation des salaires et baisse du pouvoird’achat associée ; remise en cause de l’aide aux mutuelles de lafonction publique au nom de directiveseuropéennes sur l’égalité vis à vis de laconcurrence ; réductions d’effectifs notamment de titulaires,entraînant l’intensification du travail et la baissede la qualité du service rendu ; généralisation par la loi de juillet 2005 du CDIjusqu’alors dérogatoire dans la fonction publique,au lieu de titulariser les précaires dans un corpsde fonctionnaires ; enfin, propos récents du président de lacommission des finances du Sénat (juin 2006) surl’intérêt d’effectuer des licenciements« négociés » et massifs de fonctionnaires, afin de« faire des économies sur le budget de l’Etat ».3.1.3.2. Les réformes des années à veniret la LOLFLes projets et les réformes mises en œuvreactuellement prévoient davantage de flexibilité. Lesfusions de corps ou encore la réorganisation en« cadres de fonctions » (comme à la Poste ou àl’ANPE) y sont affirmés comme des moyens pourpermettre plus de mobilité et de déconcentration auchoix de l’employeur. D’autre part, l’externalisationd’activités, le recentrage sur « le cœur de métier »sont d’ores et déjà utilisés pour employer moins depersonnels fonctionnaires et réduire les missionseffectivement remplies par les services publics.Après la « décentralisation Raffarin » en 2003 quiremet gravement en cause l’égalité entreusager(e)s selon leur région, avec la mise en œuvrede la réforme budgétaire (LOLF) en janvier 2006combinée aux restrictions budgétaires, un niveausupplémentaire est franchi dans la dégradation desservices publics restants.La LOLF est un changement radical dans la gestiondes services publics : désormais, l’atteinted’objectifs chiffrés sera fondamentale pour justifierle bien fondé des dépenses. Dans un contexte de« maîtrise des dépenses », cela débouche sur la« poursuite du chiffre » et une mise sous pressiondans ce but des personnels et de la hiérarchie pour« faire de la productivité ». C’est déjà ce qui estconstaté dans des administrations comme l’ANPE oula police nationale qui n’ont pas attendu la LOLFpour se convertir à cette manière de fonctionner.L’indicateur prend alors dans les faits le pas sur laqualité réelle du service public rendu auxusager(e)s. En outre la fongibilité asymétriqueprévue dans la LOLF, associée à une refontecomplète du décompte des effectifs de personnelsest également rétrograde. Nous ne sommes plusdécompté(e)s par corps mais en équivalents tempsplein, sans différenciation notamment entre emploisprécaires et pérennes. La fongibilité asymétriquec’est la possibilité de convertir des crédits depersonnels (des « équivalents temps pleinrémunérés ») en crédits de matériel etfonctionnement. En revanche, il n'est pas possiblede transformer des crédits de matériel ou defonctionnement pour embaucher des personnels. Lafongibilité asymétrique pousse à la réduction dunombre de salariés dans la fonction publique. C’estpourquoi nous demandons son abandon.3.1.3.3. L’emploi publicNous refusons d’accepter cette politique deréduction des effectifs dont les conséquences sontnégatives pour les usagers et la vie des agents(carrières, promotions, mutations, conditions detravail, qualité du service rendu et sens trouvé autravail). Nous luttons contre l’externalisationd’activités provoquant le remplacement depersonnels fonctionnaires par des employé(e)ssouvent sous statut précaire comme dans lenettoyage par exemple. Nous demandons que cesfonctions soient exercées par des fonctionnaires.Si les gains de productivité dans certains domainesexistent, il serait nécessaire d’obtenir del’administration un vrai bilan de l’emploi, avec unchiffrage sérieux des besoins et en portantattention aux questions d’intensification du travaillors de sous effectifs, dégradant les conditions detravail et la qualité réelle du service rendu. Il fautégalement mener une réflexion sur les métierspermettant de faire cesser le recours à la soustraitance.Il faut recruter ou former dansl’administration des personnels avec lescompétences nécessaires. Pour cela, il faut étudierla possibilité de la création de corps spécifiques(informaticiens, ergonomes…) et utiliser l’ensembledes corps existants (ouvriers professionnels).La question du remplacement de fonctionnaires pardes CDI, CDD ou encore vacataires, de droit publicou privé, s’avère un enjeu fondamental aujourd’hui.Nous réaffirmons que la forme normale d’emploidans la fonction publique doit être le statut defonctionnaire, l’utilisation de non titulaires devantrelever de l’exception ponctuelle et dans desconditions tirées vers le haut (prise en charge desfrais de déplacement, droit à la formation,salaires…).Concernant les évolutions des statuts defonctionnaire, nous réaffirmons notre attachementà la séparation du grade et de l’emploi, à lagarantie de l’indépendance des fonctionnaires, à lagarantie de l’emploi, à la mobilité à l’initiative del’agent et non imposée. Ceci s’oppose aux actuelsprojets envisagés comme la refonte en « cadres defonctions », le salaire au mérite faisant suite auxcontrats d’objectifs individuels ou encore lamultiplication des statuts de non-titulairesdérogatoires (recrutements en CDI) venant de faiten remplacement de recrutements sous statut defonctionnaire.Nous posons également la question d’une réformede la comptabilité publique qui permette une14/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006transparence réelle concernant l’utilisation desmoyens budgétaires.3.1.3.4. Le développement des servicespublicsNous nous battons pour des services publicseuropéens qui garantissent les notions suivantes :proximité, égalité de traitement des usagers,solidarité avec les personnes les plus précarisées,participation à l’aménagement du territoire, statutdes salariés qui y travaillent, intervention desusagers dans les décisions qui conditionnent leurvie, etc. Ils devront être construits en s’inspirant detout ce qu’il y a de plus positif pour les usager(e)sainsi que les employé(e)s de ces services, dansl’organisation et le fonctionnement des différentsservices publics des membres de l’UnionEuropéenne. C’est pourquoi nous sommes opposésà tout projet, quelle qu’en soit la forme, deprivatisation des entreprises publiques ou dedéréglementation de services publics. Nous nousbattons pour obtenir l’appropriation publique dessecteurs de l’eau, de l’énergie, des transportscollectifs… en y interdisant toute concurrence.L’Etat doit assumer un rôle important dans ledomaine économique, social et environnemental.Nous affirmons la nécessité d’une politiqueéconomique ambitieuse pour l’emploi etl’aménagement du territoire.Il faut plus de moyens et donc mettre un terme auxexonérations de charges des entreprises.Malgré le passage de la réforme sur les retraites enjuillet 2003, notre syndicat continue de revendiquerun système de retraite par répartition. Il doit êtrebasé sur la solidarité entre les générations, etconsolidé sur sa structure de financement,notamment en faisant contribuer les revenus ducapital, en particulier des entreprises exonéréesjusqu’à présent. Nous refusons toute forme defonds de pension. Le syndicat sera à l’initiative etfédérateur de toutes les actions permettant laconvergence des luttes dans ce domaine. Nousrevendiquons la retraite à taux plein soit à 60 ansmaximum, soit à 37,5 annuités maximum, pourtous, public et privé confondus, avec au moins 75%de la meilleure période et aucune retraite inférieureau Smic.Le syndicat demande le retrait des décrets Balladur(1993) et de la loi Fillon (2004) sur les retraites etil agira à tous niveaux pour gagner cette bataille.Notre syndicat demande que la CGT se retire ducomité de labellisation de l’épargne salariale.3.2. Notre analyse sur l’Insee3.2.1. Missions et moyens3.2.1.1. Pour le maintien des missions del’InseeLa direction de l’Insee a défini dans un documentde Moyen-Terme sa vision de l’évolution de l’Insee.Même si, par de nombreux côtés, ce documententretient un certain flou, globalement, il tracenettement des perspectives défavorables audéveloppement d’un service public de l’informationéconomique et sociale ambitieux. Notre syndicat acombattu dès le début les aspects négatifs de ceprojet. Il appelle à la mobilisation pour mettre enéchec la direction et pour faire valoir d’autres choix.D’emblée, nous refusons la logique de la directionde l’Insee qui constitue la colonne vertébrale de sonprojet de Moyen-Terme, et affecte tous les secteursd’activité de l’Insee : adapter l’activité à desmoyens en baisse. Cette volonté de rétrécir lechamp des activités de l’Insee se manifeste autantdans la production statistique que dans la diffusionet les études, notamment en région. Elle se traduitaussi par le refus de la direction d’engager un débatpublic sur l’avenir des écoles et du Genes.Le syndicat de l’Insee réaffirme son attachement àla pluralité des missions de l’Insee : production duchiffre avec maintien de la proximité, études,diffusion, coordination, formation, recherche dansun esprit d’ouverture et de travail ; en partenariatavec les acteurs sociaux pas seulement basé sur laquestion des financements.Le maintien des directions régionales dans toutesles régions avec des activités diversifiées estessentiel.Production nationale et action régionale : laplace des enquêtes pourrait encore diminuer auprofit de l’exploitation, certes nécessaire, dessources administratives. Les enquêtes régionales oules extensions d’enquêtes sont menacées par lesrestrictions budgétaires et soumises de plus en plusà l’obligation de trouver des « partenaires »capables de financer les travaux. Certainesrénovations d’ampleur des systèmes de production(Sirène, Resane…) ont abouti ou risquent d’aboutirà la dégradation de la qualité des donnéesdisponibles et répondent mal aux besoinscroissants, notamment en région. Une inconnuerègne encore sur la capacité de l’Insee à diffuserdes informations statistiques de qualité à un niveaugéographique fin à partir du recensement rénové ;Coopération internationaleLa dimension internationale de l’activité de l’Inseedoit être réaffirmée et débattue. Il doit poursuivresa tradition de coopération avec de nombreux paysdu « Sud ». Afin d'améliorer la pertinenceéconomique et sociale des comparaisonsinternationales, il doit prendre part aux diversesrecherches actuelles relatives à la constructiond'indicateurs alternatifs ou complémentaires au PIBet mettre à profit les connaissances qu’il en tire.La construction de l’ « Europe Statistique » est unenjeu pour l’avenir de la statistique publique.Pourtant l’Insee opère dans ce domaine dans unegrande opacité : Eurostat fonctionne par appelsd’offre, après commandes de la Commission. Il n’ya pas d’équivalent du CNIS au niveau européen, etaucun compte rendu ni discussion au CNIS dutravail statistique réalisé par Eurostat. De même, àl’Insee, il reste difficile de connaître les stratégiesdéveloppées dans ces instances. Alors que l’Europe15/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006structure beaucoup de nos travaux nous devonsnous saisir de cette question.La dimension internationale de l’Insee doitégalement s’appliquer dans les zones « Afrique-Océan Indien » et Caraïbes.La diffusion est confinée dans un cadre deplus en plus strict : d’une part, les catalogues de« l’offre », établis centralement, après uneconcertation pas suffisamment développée,restreignent l’activité à certains domainesseulement et tendent à limiter l’intervention del’Insee à l’utilisation de méthodes ou de « kits »préfabriqués ; d’autre part les publics sontsegmentés et ceux jugés non prioritaires sontrenvoyés sur l’internet. Nous critiquons la prioritéaccordée à quelques « acteurs du débat public »(conseils régionaux, préfets, grandesagglomérations…), le corollaire étant ledélaissement du citoyen, des associations, dessyndicats et des communes peu fortunées. Enmatière de diffusion l’augmentation du volumed’informations proposées gratuitement sur l’internetest un progrès, mais nous contestons la politique dela direction de l’Insee consistant à réduire lesservices d’accueil et de traitement de la demandeen région. La priorité accordée à un certain publicse traduit dans les choix d’investissement de l’Inseepour l’action régionale. Ces investissements, confiéspour partie aux Pôles de service de l’actionrégionale, dépendent de plus en plus des seulsbesoins exprimés par ces publics particuliers. Lacapacité de l’Insee à satisfaire le besoins eninformation de l’ensemble des publics s’en trouveraamoindrie ;Nous réaffirmons également la nécessité dumaintien et du développement de la bibliothèque dela DG pour en faire une bibliothèque de référence,nationale et internationale en matière deconservation du patrimoine statistique et del’information.Administration des ressources : la centralisationdes services d’administration des ressources estconçue pour accompagner la baisse des effectifsdans la production statistique, les études et ladiffusion. Elle s’accompagne d’ores et déjà del’externalisation de certaines fonctions (accueil,PAO…) et elle pourrait préparer la mise en soustraitancede certaines tâches administratives et degestion. La création de pôles et de sites, premiertemps de la réforme des SAR, produira des effetsnégatifs sur les conditions de travail des agents,confinés dans des tâches parfois peu valorisantes,accroîtra les difficultés de mobilité de ces agents, etrisque de dégrader le service rendu à l’ensembledes autres agents en annulant l’avantage queconstitue la proximité.Le syndicat interviendra pour que la gestion despersonnels reste sur leurs lieux de travail enutilisant les outils de gestion adéquats.3.2.1.2. Le Moyen-Terme de la directionde l’Insee continue et aggrave unepolitique ancienneIl poursuit la mise en oeuvre, dans un domaineparticulier, de la politique de désengagement del’Etat, de baisse des dépenses publiques et deréduction de l’emploi public. Le « moinsd’enquêtes » s’applique depuis quelques années etles baisses d’effectifs sont déjà une réalité. Ainsi,par exemple, les « frais d’enquête » en 2004 sontinférieurs de 20 % à la moyenne des trois annéesprécédentes. Les effectifs des « divisions enquêtesménages » des DR sont, en 2004, en retrait de15 % par rapport à la moyenne des trois annéesprécédentes. Le volume des enquêtes sur le terrain,mesuré par la taille de l’échantillon a baissé de14 % en un an. Et, globalement, les DR ont perdu300 emplois en dix ans, entre début 1995 et fin2004, soit une baisse de 6,5 % de leur effectif.Le Moyen-Terme constitue aussi une aggravation decette politique. Ainsi, la direction de l’Insee annonceune baisse d’effectifs de l’ordre de 500 personnes àl’horizon 2010, c’est-à-dire une baisse en cinq ansbeaucoup plus forte que celle subie en dix ans, de1995 à 2004. Les taux de baisse avancés dans desnotes confidentielles ou dans des réunions vont de16 % pour l’action régionale à 20 % pourl’administration des ressources. Le Moyen-Terme2005-2010 comporte un autre élément nouveau : ilmenace à terme les directions régionales. En effet,nombre de « petits » établissements vont frôler leseuil en dessous duquel la question de leurmaintien se posera un jour ou l’autre. Nous avonsenregistré la promesse de la direction de maintenirtous les établissements, mais nous pensons que lapolitique qu’elle met en oeuvre risque de conduire àce que cette promesse ne puisse être tenuelongtemps.A cet égard, nous n’avons jamais réussi à obtenirde la Direction la définition d’un socle minimald’activités susceptible de pérenniser l’existence d’unétablissement régional.3.2.1.3. Pourtant il y a une croissance dela demandeOr, rien dans les évolutions de la société ne justifiede consacrer moins de ressources à la production età la diffusion d’informations économiques etsociales, dans le cadre d’un service publiccoordonnant l’activité de l’Insee et des servicesstatistiques ministériels. Au contraire ! La volontéde limiter l’activité de l’Insee, et plus généralementdu service public de statistique, est en contradictionavec la croissance forte de la demanded’information économique et sociale, qui semanifeste tant au niveau national qu’en région,demande qui tend également à devenir pluscomplexe. Le Moyen-Terme est aussi encontradiction avec la volonté des agents de voirleurs tâches enrichies et leurs qualificationsreconnues, d’une part au travers d’unerémunération prenant en compte cette qualificationet, d’autre part, au travers du droit à une évolutionde carrière sans blocage.3.2.2. Gestion du personnelDans le domaine de la gestion du personnel, onpeut noter une vraie régression.16/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006L’Insee a choisi la voie de la spécialisation tousazimuts pour obéir aux ordres de restrictionsbudgétaires et de diminutions d’emplois. Cela et lesrestructurations en pôles se traduit pour tous lesagents par une perte de qualification et desperspectives limitées de mobilité à l’intérieur d’unmême établissement. Et plus on descend dans lahiérarchie, plus cela se vérifie.Les méthodes de gestion se révèlent totalementinadaptées : gestion par objectif sans moyen niesprit d’équipe, spécialisation à outrance,individualisation des rémunérations et descarrières, autoritarisme croissant.La réforme de la notation renforce l’individualisme.Les quotas d’attribution empêchent touteadéquation entre le travail réel des agents et lanote.La tentative de remise sur les rails du suivi del’activité des agents au travers de SOFT est lamarque d’une direction soucieuse du respectpointilleux des règles au lieu d’être à la recherchede l’efficacité collective. Nous continuerons àexpliquer aux agents les méfaits de SOFT en lesappelant à boycotter le remplissage de l’application.Nous devons mobiliser sur nos propresconceptions : le travail d’équipe, ladéhiérarchisation des tâches, la prise en chargecollective des personnels en difficulté, l’informationet l’association des personnels à la définition de nosmissions de service public et à la façon de lesréaliser.Le ministère met en place la GPEEC (Gestionprévisionnelle des effectifs, des emplois et descompétences). C’est une classification des métiersqui influence la gestion des postes. Notre syndicat,en relation étroite avec la fédération, sera actif surce dossier, très sensible pour l’avenir des serviceset des métiers.3.2.3. Missions de l’Insee : nosrevendicationsNous réclamons un plan de développement del’Insee en phase avec les besoins croissants destatistiques.3.2.3.1. Mieux prendre en compte lademande socialeNous exigeons la mise en place d’un véritabledialogue avec la société, au niveau national commeen région, pour prendre en compte la demande desdifférents secteurs de cette société.Au niveau national : il faut mieux prendre encompte les demandes exprimées par le CNIS. Nousdemandons que les représentants au CNIS puissentintervenir aussi sur les programmes d’étude et derecherche de l’Insee et de la statistique publique(en DR et à la DG), afin que l’expression de leursbesoins ne se limite pas au champ étroit de laproduction statistique, mais s’étende à l’ensembledes formes de connaissance statistique ;Au plan local : il faut engager une vasteconcertation par la création de CRIES (Comitésrégionaux pour l’information économique et sociale)dans chaque région, et par un dialogue régulieravec les secteurs de la société peu consultés(associations, organisations syndicales desalariés…). L’Insee doit définir des règles depriorisation, afin de rendre transparents ses choixde travaux en fonction de ses moyens. Ces règlesdoivent aussi permettre de vérifier le caractèred’intérêt public de ces travaux, et d’éviter desdéséquilibres entre régions.3.2.3.2. Relance de la productionstatistiqueNous réclamons la relance de la productionstatistique, notamment des enquêtes, parallèlementà l’extension de l’exploitation des donnéesadministratives, pour répondre à une demandemultiforme, en croissance rapide et de plus en pluscomplexe.Nous demandons une expertise de la productionstatistique et de l’exploitation des fichiersadministratifs produites dans les DOM. Cetteexpertise permettra la reconnaissance de la qualitédes travaux menés dans ces DR. Nous demandonségalement que des moyens soient affectés pourpermettre l’utilisation de ces données à un niveauinfra-communal, niveau actuellement inexistantdans les DOM.Le recensement doit rester une mission pharede l’Insee. Pour assurer la qualité des résultats,l’Insee doit maîtriser toutes les phases duprocessus de production : production du Répertoired’immeubles localisés (RIL), collecte, contrôle de lacollecte et des traitements, production puisdiffusion des résultats. Nous nous opposons àl’externalisation de certaines phases, que ce soit leflashage, le contrôle ou d’autres phases. Nousréclamons de nouveaux investissements pouraméliorer la qualité du RIL, les méthodesstatistiques, les modalités et le contrôle de lacollecte. Nous revendiquons la prise en charge parl’Insee de la collecte des personnes vivant enhabitat mobile et des personnes sans logement.L’Insee doit respecter la promesse faite auxcommunes d’effectuer des enquêtes d’intérêtpropre rattachées à cette opération ;Les enquêtes auprès des ménages sontessentielles pour l’établissement d’une statistiquesociale diversifiée répondant aux défis sociauxactuels. Le socle d’enquêtes permanentes doit êtrecomplété par des enquêtes sur des thèmesinnovants. La dimension régionale doit être prise encompte, soit par des extensions d’échantillon, soitpar des enquêtes régionales dans le cadre d’unprogramme régional obligatoire. Les enquêtes Viefamiliale et vie Quotidienne et Santé qui existaienten 1999 doivent être réalisées à nouveau ;Sirène : l’Insee doit conserver la gestion de cerépertoire et en développer l’usage.Nous revendiquons : le renforcement des équipes pour répondre auxexigences de qualité statistique oubliées depuistrois ans ;17/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006d’effectifs des dix dernières années. Nous refusonsénergiquement et luttons contre la réduction deseffectifs du projet de moyen-terme 2010 actuel.Il faut aussi : stabiliser les effectifs du réseau d’enquêteurs,puis l’élargir pour accompagner l’augmentation duvolume d’enquêtes, et garantir les droits desagents enquêteurs par un contrat stable d’agentpublic ; remettre à niveau les crédits budgétaires, encommençant par porter les crédits d’enquêtes à25 millions d’euros par an et les créditsinformatiques à 30 millions d’euros par an(niveaux les plus hauts atteints au début desannées 2000) ; créer une enveloppe budgétaire spéciale pourles enquêtes d’initiative régionale ou lesextensions régionales d’enquêtes nationales.3.2.3.7. Diversifier les emploisLe contenu et l’enrichissement des postes de travaildoivent être une priorité, en lien avec lareconnaissance des qualifications et l’améliorationdes carrières des agents. Tous les établissementsdoivent avoir des travaux diversifiés et des effectifssuffisants afin de maintenir les compétences et lespossibilités de mobilité. Notamment : aucun site de production ne doit être supprimé.La priorité est de redonner à chaque DR lescompétences perdues dans l’application desdirectives Insee 2004 ; les sites informatiques doivent rester aunombre de cinq et doivent avoir chacun unvolume de travail qui assure sa pérennité ; les enquêtes Tourisme doivent être présentesdans toutes les DR, comme l’ensemble desenquêtes auprès des entreprises.3.2.4. Statut du personnel et effectifsPour notre syndicat, la question des effectifs del’Institut devient une question de plus en plusbrûlante, d’autant que nous sommes confrontés àune volonté du gouvernement de faire diminuerrapidement les effectifs de la Fonction Publique.Cette dimension est amplifiée par la pyramide desâges actuelle. Les recrutements de l’Insee sontd’autant plus masculins qu’ils se situent dans lescatégories élevées.La vie et le fonctionnement de certainsétablissements régionaux sont affectés par lemanque d’arrivées nouvelles, mais égalementaggravés par la réduction des travaux entrainantune mobilité interne réduite en terme de choix etd’intérêt.Le Moyen-Terme présenté par la direction se traduitpar le blocage des recrutements. C’est une menaceà court terme pour l’Insee. Nous devons enconvaincre les personnels et fixer des échéances demobilisation sur cette question. D’autant que lerecrutement serait également un facteur dedéblocage des carrières.Nous continuons notre action pour l’améliorationdes conditions d’emploi des précaires de l’Insee, enparticulier pour un statut qualifié pour lesenquêteurs. Cette orientation n’est partagée ni parle gouvernement, ni par la direction de l’Insee. Afortiori lorsque nous avons la certitude que legouvernement en place fera tout pour remettre encause le statut général des fonctionnaires ; ce quiinquiète un nombre croissant d’agents. De plus,l’ordonnance d’août 2005 créant le PACTE (Parcoursd’accès aux carrières territoriales, hospitalières etde l’Etat) permet de recruter des jeunes sansdiplôme. Mais il renforce la précarisation car ils sontstagiaires pendant deux ans sans garantie detitularisation. C’est le CPE de la Fonction Publique.Ce dossier est un enjeu de mobilisation pour notresyndicat.Nous refusons la diminution des effectifs, sourced’externalisation de travaux et de recours àl’intérim.Enfin, nous demandons à la direction d’adopter uncadre pour l’accueil des stagiaires. Ce cadre doitinclure les principes suivants : les stagiaires de niveau enseignement supérieuret en stage obligatoire de scolarité doivent êtrerémunérés par l’Insee, même s’ils conservent parailleurs leur statut de jeune en formation. Cetterémunération, à la charge de l’employeur, devraits’insérer dans un dispositif assurant aux étudiantsune allocation d’autonomie, à la charge de lacollectivité, comme le réclament certainssyndicats étudiants ; même rémunérés, les stagiaires ne doivent pasêtre utilisés comme main d’oeuvre deremplacement par l’Insee, et ne doivent paspallier la pénurie de personnel statutaire ; les clauses des conventions de stage spécifiantque « le travail des stagiaires ne doit pas êtreutilisé par l’employeur à son profit » doivent êtrerespectées.Nous réaliserons à l’attention des stagiaires unmatériel d’information sur leurs droits, en lesrenvoyant aussi vers les associations (Générationsprécaires, …) et des syndicats étudiants. La mobilitéaccrue des cadres, appliquée de façon dogmatique,pose des problèmes de capitalisation des savoirfaire. Le syndicat demande à la direction un bilande cette politique et construira des propositions etune position avec le personnel.3.2.5. L’informatique3.2.5.1. L’organisationLa question de la réduction du nombre de machinescentrales risque de se poser lors de l’examen duschéma directeur informatique. Notre syndicat atoujours considéré que l’existence de deuxmachines MVS à l’Insee est un gage de sécuritéminimum. Malgré tout, cette question ne remet pasen cause l’existence des centres informatiques. Eneffet il est maintenant admis par tous les acteurs del’informatique qu’il est possible d’exercer tous lesmétiers de l’informatique à distance (système,développement, et maintenance d’applications).Dans ce cadre, les priorités de l’administration sontla mise à niveau du réseau et des postes de travail.19/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006Sur le plan applicatif, la construction du systèmed’information Insee se poursuit. Les informaticienss’attachent à mutualiser les données utilisées parles différentes applications de façon à pouvoirfournir instantanément des données identiques àtous les utilisateurs qui souhaitent s’en servir.3.2.5.2. Dans les CNILa Direction s’oriente vers le recrutementd’informaticiens de niveau attaché. En effetl’administration, pour faire face aux départs à laretraite, souhaite mener une réflexion pouraugmenter le potentiel d’attachés informaticiens.Ce recrutement serait de 7 à 8 attachés par an àpartir de 2006.Un certain nombre de problèmes subsistent dansles CNI : Le passage en maintenance des applications posetoujours problème du fait de la non-intégration desmainteniciens dans les équipes de projets. Cesproblèmes sont plus importants lorsque l’applicationest réalisée exclusivement par une société deservice. Le manque d’effectifs ou de compétencetechnique risque de conduire l’administration àsous-traiter la maintenance des applications ; il estnotamment nécessaire d’assurer la pérennisationdes applications de gestion du personnel ; La mobilité accrue des cadres informaticiens posedes problèmes de capitalisation des savoir faire.Nous souhaitons une meilleure communicationentre les différents acteurs permettant une prise encharge et un transfert rapide des produits en place.3.2.5.3. Le CNI de LilleA l’horizon du Moyen-Terme en 2010, le CNI de Lilleserait transformé en « structure informatiquenationale », rattachée à la Direction régionale.Cette structure aura la responsabilité de laprogrammation des enquêtes : Blaise, Capi et AvalCapi.Pour notre syndicat l’activité de la structureinformatique doit être développée. Pour cela nousdemandons : l’attribution de travaux informatiques de portéenationale ; un plan de formation pour les agents afin derenforcer la connaissance des nouvellestechnologies déjà engagées ; l’affectation de cadres expérimentés et denouveaux agents issus de la filière informatiquede l’Ensai.3.2.5.4. La sous-traitanceLes échecs répétés dans la mise en production deprojets informatiques, développés par des sociétésde service confirment qu’il s’agit d’une mauvaiseorientation. Pourtant, dans son projet Moyen-Terme, la direction prévoit une sous-traitancemassive que ce soit pour Resane, BRPP2 oud’autres projets.Nous combattrons fermement cette orientation.Pour notre syndicat, la sous-traitance ne doit êtrequ’un moyen exceptionnel de répondre à unedemande spécifique et ne doit être envisagée que sielle met en oeuvre des compétences qui n’existentpas à l’Insee. De plus un transfert de compétencesvers les agents doit avoir lieu au cours de cestravaux exceptionnels.3.2.5.5. Les GIIR et les GIILLe projet consacré à la télédistribution est arrivé àson terme. Les ordinateurs peuvent êtremaintenant installés à distance. Ce qui entraînepour les agents une perte de compétences liée auxinstallations applicatives et à l’assistance qui y estrattachée. Les GIIR se retournentsystématiquement vers le point focal et lessupports nationaux. L’allongement du tempsd’intervention pénalise l’utilisateur.Un questionnaire élaboré par les instances del’informatique et envoyé dans les établissementsrégionaux sera la base des orientationsinformatiques régionales. Son orientation effectiveva avoir des conséquences graves pour l’existencemême d’équipes informatiques en région.Pour notre syndicat, les établissements régionauxdoivent conserver des services informatiques dignede ce nom. Le bon fonctionnement des services estlié à l’existence et au renouvellement descompétences régionales en matière d’assistance, deréseau, de logiciels. La présence d’un personnelcompétent en nombre suffisant est nécessaire. Lesinformaticiens régionaux doivent conserver leurtechnicité dans ces domaines et se tourner plusvers les utilisateurs et l’assistance logicielle.3.2.5.6. La fonction développementLa Direction affirme que la mise en place dusystème d’information régional doit favoriserl’existence de fonctions d’analyse et deprogrammation dans les établissements régionaux.Cette présence est souvent la condition deréalisation des enquêtes régionales. Pour remplirces tâches les informaticiens doivent pouvoirbénéficier de formations équivalentes à celles deleurs collègues des CNI mais aussi avoir lapossibilité d’utiliser les mêmes logiciels et langagesde développement.L’échec ou le retard de nombreuses applicationsinformatiques montre que le développement deprojets à l’Insee nécessite une bonne prise encompte des moyens (humains et financiers), desdélais (besoin de tests), de l’ergonomie desapplications et des postes, de la formation continuedes informaticiens et de la bonne concertation etprise en compte de l’avis des utilisateurs.3.2.6. Carrière et formation3.2.6.1. Carrières et rémunérationsSur cette question, nous ne pouvons accepter qu’unnombre croissant d’agents soient bloqués pour 5,20/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 200610 ou 15 ans dans leur carrière, ce délais’allongeant encore avec l’application du texteréformant le départ en retraite des fonctionnaires.D’une part, nous devons obtenir rapidement denouveaux échelons dans les grades concernés et ledéblocage massif des passages de corps et degrade, en particulier pour les catégories C et B. Eneffet, les plans ministériels de requalification neconstituent que des rustines concernant un faiblenombre d’agents. D’autre part, nous demandonsque le minimum indiciaire soit supérieur au niveaudu SMIC et même au moins égal à 1500 € net. Celademande alors un repyramidage de l’ensemble descarrières de la Fonction Publique.La mise en place par les différents Ministres d’unerémunération des fonctionnaires au mérite ou sousastreinte de résultats est très dangereuse. En fait,la multiplicité des situations des agents travaillant àl’Insee (qui a aussi des effets positifs en permettantla diversification des personnels et la mobilité entreadministrations) a déjà des effets très pervers :création de situations diverses (recrutement,rémunération, promotion) aboutissant en fait à unemultiplication de situations individuelles mettantdéjà largement en cause le statut de la FonctionPublique. L’opacité du système de gestion desprimes s’est accrue et cela a abouti à des inégalitéset à un éventail accru des primes.Un état des lieux est à mener avec les fédérationssyndicales et les syndicats de la Fonction Publique,et l’offensive contre toutes ces pratiques à relancer(en particulier sur les primes).Nous nous opposons à toute tentative de mise enplace de salaires et carrières au mérite et nousbattons pour des carrières linéaires.3.2.6.2. FormationDans un environnement de plus en plus changeant,la formation est toujours une de nos revendicationsimportantes. Elle permet un accroissement desqualifications des agents, un enrichissement de leurtravail, l’insertion et doit éviter la marginalisation.La formation fait partie intégrante de la carrière desagents. Par ailleurs, la formation en matièred’informatique doit, dans tous les cas, précéderl’utilisation d’un produit et être adaptée au travailde chacun : développeur, assistant de maintenance,gestionnaire de l’infrastructure, utilisateurs. Elledemande à être en phase calendaire avec la miseen place des matériels, logiciels ou applicationspour y trouver son efficacité maximale.Notre syndicat réaffirme avec force que laformation compte toujours trois aspectsindissociables : formation de culture générale,formation professionnelle, technique et à l’outil,préparation aux concours.Nous devons obliger la Direction à donner lesmoyens de la mise en œuvre des formations deculture générale. Elle est un moyen indispensablepour chaque agent, quelle que soit sa catégorie, depouvoir maintenir et/ou développer descompétences transversales d’ordre général,nécessaires à un épanouissement personnel et àune bonne insertion dans le milieu professionnelquel que soit le poste.3.2.6.3. Céfil - Ensai - EnsaeNous continuons nos visites au Céfil pour présenterla CGT. Nous sommes vigilants au règlement duproblème des remboursements de frais desstagiaires, notamment pour les stagiaires de laformation longue qui souvent y perdentfinancièrement pendant le stage.Les affectations doivent être connues avant ledébut de la scolarité. Nous veillons à ce que ladirection résolve ce problème dans les meilleursdélais.Nous demandons une révision du contenu desformations dispensées au Céfil afin qu’elles soientplus en phase avec les attentes des stagiaires et lesbesoins de l’Insee.Par ailleurs, les conditions de déroulement desstages doivent être revues.Nous allons poursuivre aussi les visites à l’Ensai.Notre bataille pour obtenir le remboursement desfrais de déménagement des stagiaires interne doits’accentuer. Pour l’Ensae, le syndicat devraitengager une rencontre avec les élèvesadministrateurs sur le même principe que la visite àl’Ensai.Nous suivrons les projets d’évolutions statutaires duGenes.Le syndicat entamera une réflexion d’ensemble surles orientations des écoles.3.2.6.4. ConcoursNous demandons que le concours de catégorie Asoit organisé dans les DOM. Actuellement, cesconcours ne sont organisés qu’en métropole , ce quiexclut tous les jeunes diplômés domiens.Nous demandons également que le concours decatégorie B soit organisé tous les ans dans chacundes DOM et non alternativement.Nous demandons que le concours de catégorie C,quand il est organisé, le soit dans chaque DOM.3.2.7. Les conditions de travail3.2.7.1. Ergonomie et conditions detravailL’ergonomie concerne l’ensemble descomposantes du poste de travail, de l’applicationinformatique et de l’organisation du travail. Elle doitêtre construite avec les agents et accompagnée.Elle doit faire l’objet d’une formation pour lesinformaticiens et les statisticiens. Elle ne doit pasêtre considérée comme une somme de recettesdestinées à améliorer le « confort » des usagers.Dès la conception d’un nouveau projetd’organisation ou de changement d’un poste detravail, l’ergonomie doit être prise en compte etdoit structurer tout projet. Tous les agents21/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006concernés par ce changement doivent intervenirdès le début du processus.Dans le domaine informatique, tout projet doitêtre accompagné avant sa mise en productiond’une formation adaptée à ce qu’on attend dechacun (différente pour les utilisateurs et lesassistants de maintenance ou les personneschargées de l’infrastructure). Les temps de réponsepour chaque applicatif doivent être compatiblesavec les normes ergonomiques. Les évolutionstechniques doivent prendre en compte le travailergonomique réalisé sur l’application. Une aide enligne détaillée doit être disponible sur tous leschamps qui demandent une intervention del’utilisateur.L’ergonomie, c’est aussi la prise en compte despostes de travail spécifiques des travailleurshandicapés. Dans ce domaine, l’ergonomie est unpoint crucial pour la personne. L’accueil d’unepersonne handicapée dans un service doit êtreréfléchi avant son arrivée pour examinerl’organisation du travail et quelles missions serontconfiées à cette personne. En fait toutl’environnement du bureau jusqu’au posteinformatique doit être adapté au handicap de lapersonne. Au bout de quelques semaines, un bilandoit être tiré pour adapter au mieux le poste detravail, s’il y a lieu.La démarche MAIOL était destinée à mieuxintégrer l’ensemble de cette dimensionergonomique. Dans les faits, elle est vidée de sonsens par l’exclusion d’une grande partie desutilisateurs réels et une conception hyperhiérarchique de l’organisation du travail. De plus,MAIOL exclut par principe les organisationssyndicales et se réduit souvent à une pseudoconcertation entre hiérarques nationaux etrégionaux.On peut en prendre pour exemple le recensementrénové. Le RP a entrainé l’apparition d’une tâcherégulière : la manutention des bulletins avant,pendant et après la collecte. MAIOL n’a pas abouti àdes solutions satisfaisantes pour les agents, commeles conclusions de l’étude ergonomique réalisée ànotre demande l’ont montré.L’hygiène et la sécurité ne se résument pas àl’ergonomie. Pour que les conditions de travail desagents soient optimales, les locaux dans lesquels ilstravaillent doivent être adaptés à leur mission etsûrs (au sens de l’hygiène et sécurité). Pour cela, larecherche sur la présence d’amiante doit êtresystématique, dès lors que des travaux sontengagés dans un établissement. Le prochaincombat à mener est l’éradication complète del’amiante dans tous les établissements. De même,les systèmes de ventilation, d’aération, dechauffage, de sécurité incendie des locaux doiventêtre régulièrement vérifiés et changés au besoin. Lechoix du mobilier doit être adapté aux locaux danslequel il va s’insérer, le personnel doit pouvoir sortirde son bureau sans difficulté en cas d’incendie. Cechoix doit être fait en concertation avec les agents.De façon plus générale, si nous voulons enrayer ladégradation des conditions de travail au sein del’Insee, la mise en place progressive des nouveauxtravaux nécessite et nécessitera toujours toutenotre vigilance quant à leur mode d'organisation.En ce qui concerne la sécurité des systèmesd’information et des données, nous partageons lesouci de la protection des données individuelles quenous collectons ou élaborons. Mais nous refusonstoute dérive sécuritaire visant les agents qu’elleprovienne de la direction de l’Insee ou du Minefi.3.2.7.2. PrécaritéLes avancées obtenues au niveau des enquêteurssont en permanence remises en cause, ce qui rendéprouvante la confrontation entre les délégués desenquêteurs et la Direction de l’Insee. D’autant quel'évolution des conditions de travail et de vie desenquêteurs dépend étroitement de la place desenquêtes ménages dans les missions et du budgetde l’Institut dans une conjoncture très défavorable.C'est pourquoi l'un de nos enjeux est d’obliger ladirection à accepter un réseau stable seule garantiede la qualité, à la base, des travaux.Parmi les actions à mettre en œuvre :Les organisations syndicales et les enquêteursmettront en place un comité d’entraide interrégionde façon à rendre combatifs les réseaux qui ontplus de difficulté à fonctionner et maintenir unebonne dynamique pour les autres.Des actionsseront menées afin que la direction mette en placele livre blanc ( problèmes de sécurité, agressionssur les enquêteurs)Un tour des DR sera fait pour connaître lessituations régionales : existence de rencontres avecla direction, actualisation des revendications.Une ou deux conférences téléphoniques annuellesseront mises en place.Il faudra proposer aux enquêteurs l’adhésionà laCGT même si les représentants d’enquêteursdoivent continuer à œuvrer sans soucid’appartenance syndicale. Un historique sera écrit sur l’évolution de lalutte des enquêteurs depuis les premiersmouvements. Il sera fait dans le but de porter àla connaissance des nouveaux enquêteurs lesluttes passées. Nous pourrons ainsi éviter : une perte de contact entre les enquêteurs ; un renouvellement total et voulu par ladirection des réseaux actuels d’enquêteurs ; un retour à une précarité aux ordres sanscontrepartie.Ce travail doit être pris en charge par tout lesyndicat, en lien avec les agents des Dems, qui ontà souffrir des restrictions de postes et de laconcurrence du recensement.Les contrats des chargés de mission en CDDactuellement en poste à l’Insee doivent être22/23
apport d’orientation CGT Insee - Congrès d’Asnelles-sur-mer octobre 2006renouvelés, s’ils le souhaitent, jusqu’à ce qu’unesolution d’intégration à l’Insee soit mise en place.3.3. Au-delà des murs3.3.1. Solidarité internationaleLes Forums Sociaux Mondiaux et Européens, lesrassemblements altermondialistes ont permis ausyndicalisme d’explorer d’autres modesrevendicatifs et de nouveaux contacts, afin dedéfendre les droits des salariés et au-delà, peserafin de réorienter la mondialisation en faveur d’undéveloppement bénéfique à tous.Les mobilisations européennes contre la directiveBolkestein ont montré qu’il était possible demobiliser les salariés sur ces questions et d’obtenirl’ouverture de débats publics sur des enjeuxinternationaux décisifs. Les mobilisations doiventencore s’amplifier pour faire face aux offensiveslibérales. Notre syndicat y participera activement.3.3.2. Le monde n’est pas unemarchandiseCertains processus de productions industrielles etagricoles font courir des risques graves à la planèteet à ses habitants, en dégageant les producteurs detoute vision à moyen terme de l’environnementdans lequel ils vivent.Ainsi, la pollution de l’air, de l’eau et des alimentss’aggrave. La production de déchets lentementdégradables, comme les déchets nucléaires,menace les générations présentes et futures. Lesdégradations que la planète subit ne seront pasrattrapables. Mais peu de réponses au niveaumondial sont données par les Etats pour développerla protection de l’environnement. Nous refusonstout brevetage du vivant et l’appropriation parcertains fabricants de semences. Les OGM(Organisme Génétiquement Modifiés) sont unemenace pour l’environnement : pour les plantesdont on ne contrôle pas la prolifération, et pour leshumains dont on ne connait pas les réactions qu’ilspourraient développer à long terme.La défense de l’environnement ne doit pas êtrel’enjeu d’un rapport de force entre les pays richeset les pays pauvres, entre les pays àfonctionnement libéral forcené et les autres. Nousdevons imposer les intérêts communs de toutes lespopulations en participant à des lieux deconvergence comme Attac, qui font entendre leurvoix, notamment lors des sommets mondiaux sur laplanète.Réduire les dépenses d’armementActuellement les dépenses mondiales d’armements’élèvent dans le monde à plus de 1000 milliards dedollars et sont en augmentation, en particulier pourla mise au point de nouvelles armes. Avec une trèsfaible partie de ces dépenses, on pourrait répondreà tous les besoins les plus urgents du globe. Lesstocks d’armes nucléaires gigantesques sont undanger grave pour l’humanité. Le syndicat CGT del’Insee se prononce pour la diminution des budgetsd’armement, en particulier celui de la France. Lesarmes nucléaires doivent être éliminées et lecommerce des armes prohibé. Il est urgentd’arrêter l’escalade sans fin des dépenses militaires,socialement insupportables et humainementpréjudiciables.3.3.3. Criminalisation syndicale etmilitanteDe plus en plus, l’action des salariés, des étudiantset lycéens, des paysans altermondialistes, desassociations de privés d’emplois, culturelles, despersonnes sans-papiers… est confrontée à despoursuites judiciaires, souvent consécutives à desinterventions policières musclées. Les procéduresjudiciaires visent à isoler, à poursuivre etcondamner des militants de mouvements dont legouvernement veut freiner la mobilisation. Souscouvert de « protéger » les biens privés, les actionsrevendicatives sont susceptibles d’être poursuivies :ce qui était dans les dernières années desexceptions, risque à terme de devenir la règle.Toute notre solidarité doit s’exprimer contre cespratiques. Pour nous, ces mesures répressives ontpour but d'intimider les acteurs des mouvements decontestation. Elles représentent un danger dansl'exercice du droit de grève, de manifester, deslibertés en général. Elles s'inscrivent dans uncontexte de remise en cause des droits et libertésdémocratiques qui conduit de plus en plus demilitants syndicaux ou associatifs à se retrouverdevant les tribunaux. En conséquence, notresyndicat s’associera à toutes les initiatives visant àdéfendre la liberté d’expression et de manifestation.23/23