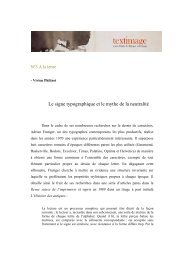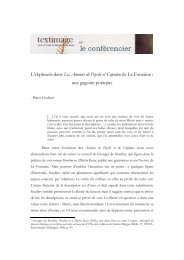ouvrir cet article au format pdf - textimage
ouvrir cet article au format pdf - textimage
ouvrir cet article au format pdf - textimage
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Varia 3- Geneviève Di RosaLes illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong>ou l’ombre portée de l’image manquante sur la réécriture bibliqueset ses transpositions visuellesLa relation texte/image, via la mise en forme linguistique ou iconographique d’unrécit, a trouvé historiquement un terrain de déploiement privilégié dans lespratiques éditoriales de la Bible. Celles-ci <strong>au</strong> XVIIIe siècle héritent d’une richetradition d’illustrations en regard du texte biblique ou d’un genre moins connuvisant un public laïc, les Figures de la Bible, que Max Engammare définit ainsi :[…] des recueils de gravures sur bois, plus tard sur cuivre, qui représententou signifient l’Écriture à travers des cycles d’estampes couvrant toute laBible, un seul Testament, voire un seul livre biblique – la Genèse etl’Apocalypse ayant alors la faveur des <strong>au</strong>teurs –, ou l’histoire d’un homme –David ou Joseph s’imposant en héros. Du texte fait corps avec l’image,puisque d’un point de vue graphique des énoncés divers accompagnent,enveloppent, sinon protègent la gravure […] 1 .L’influence du concile de Trente imprègne fortement le rapport à l’imagequi va bien <strong>au</strong>-delà de la simple idée d’une mise en image de l’Ecriture pour ceuxqui ne savent pas lire. Frédéric Cousinié dans Le Peintre chrétien 2 étudie lesfonctions à la fois éducative, pragmatique et esthétique de l’image biblique. Il1 M. Engammare, « Les Figures de la Bible. Le destin oublié d’un genre littéraire en image (XVIe-XVIIe s.) », dans Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, t. 106, n°2,1994. pp. 549-591.2 Fr. Cousinié, Le Peintre chrétien, Paris, L’Harmattan, 2000.
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »permet d’appréhender l’idée sous-jacente, structurante pour les peintres chrétiensdu XVIIe siècle, d’un christianisme-incarnation sensible du divin, substratcatholique des conceptions occidentales de l’image. Malgré les nombreux traitésthéoriques du Grand Siècle distinguant clairement la représentation de l’élémentreprésenté et les traités édifiants moralisant les récits bibliques, l’image continued’exercer un pouvoir, des pouvoirs ambigus, troubles, qu’elle soit le lieu detentation pour l’illustration des récits vétérotestamentaires les plus abominablesou scabreux 3 , ou le lieu d’une charge sacrale outrepassant une simpleprésentification de l’absent, <strong>au</strong> profit d’une énergie du « comme si de l’être là enson retour », ainsi que l’a si bien compris Louis Marin 4 . Ce qui singularise,spécifie, l’image biblique <strong>au</strong> XVIIIe siècle, est une évolution plurielle dont lesprémices se situent dans le siècle antérieur mais dont les effets, parfoisparadox<strong>au</strong>x, ne se déploient vraiment qu’alors: le fondement de la fidélité <strong>au</strong> textebiblique sur une approche archéologique, scientifique, caractéristique desLumières, l’<strong>au</strong>tonomisation de l’image, qui n’étant plus nécessairement soumise<strong>au</strong> littéraire invente ses propres procédés pour signifier le religieux, l’inventionpar les jansénistes d’une science des rapports qui ouvre à la richesse figurative,l’essor de l’illustration à finalité pédagogique 5 . L’évolution est esthétique mais<strong>au</strong>ssi plus largement culturelle, liée à l’histoire de l’exégèse. Le texte biblique3 De sa consultation de nombreux ouvrages de Figures de la Bible, Max Engammare conclut : « Laquantité de gravures dévolues <strong>au</strong>x épisodes scabreux, le soin mis à les réaliser, comme le grandnombre d’épigrammes et de commentaires négligeant toute condamnation invitent à croire qu’ilstémoignent simplement de l’attirance perpétuelle des hommes pour les délices de la chair, mêmeréprouvés » (Op. cit., p. 587). Un des programmes iconographiques les plus subversifs est celui deHans Sebald Beham qu’on peut voir notamment dans Biblisch Historien figürlich fürgebildetdurch den wolberümpten Sebald Behemvon Nuremberg, paru en 1533 à Francfort sur le Main,chez Christian Egenolff.4 L. Marin, Des pouvoirs de l’image, Paris, Seuil, 1993, pp. 12-14.5 Toute une grande partie de l’art janséniste se décline sous forme de gravures, d’estampes, desuites, qui sont <strong>au</strong>tant de pendants non seulement de l’activité illustrative menéetraditionnellement par les jésuites mais <strong>au</strong>ssi de la volonté d’illustration exh<strong>au</strong>stive qui, selonChristine Gouzi, caractérise les Lumières : « Cette volonté d’illustration exh<strong>au</strong>stive était unemarque des Lumières. L’Encyclopédie, ne pourrait se lire sans les planches qui l’accompagnent etqui explicitent heureusement certains <strong>article</strong>s techniques. Les saynètes décrivant la vie du diacrejouaient le même rôle que les illustrations du dictionnaire de D’Alembert : expliciter et démontrer,pour rendre les miracles opérés à l’intercession du diacre explicables et finalement tangibles »(L’art et le jansénisme <strong>au</strong> XVIIIe siècle, Paris, Nolin, 2007, p. 177).Textimage, Varia 3, hiver 2013 2
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »soumis à la critique rationaliste, normative, historique 6 , perd de son univocité ; lessources d’énonciation soupçonnées, divisées, le mythe biblique 7 compris dans saperspective eschatologique christocentrique se fragmente. Les récits se dérobant àl’interprétation univoque, il devient difficile de produire une illustration exacte.Voltaire peut dénoncer allégrement chez les apologistes persistant dans lareconduction du mythe biblique la rage de tout signifier 8 .C’est dans ce contexte d’invention de nouve<strong>au</strong>x rapports à la Bible que sesitue l’œuvre de Rousse<strong>au</strong>, Le Lévite d’Ephraïm, réécriture littéraire des chapitresXIX à XXI clôturant le Livre des Juges. Ce récit est emblématique des textesscandaleux sur lesquels pèse la critique morale des exégètes du XVIIe siècle. Soncanevas narratif est particulièrement horrible et violent, relatant une tentative desodomie contre le personnage du lévite d’Ephraïm faisant escale dans la tribu desBenjaminites après avoir retrouvé sa concubine enfuie chez ses parents, le viol etle meurtre de <strong>cet</strong>te dernière, l’appel à la vengeance du lévite dépeçant le corps desa femme en douze morce<strong>au</strong>x envoyés à chaque tribu d’Israël, l’exterminationquasi-totale de la tribu des Benjaminites, l’enlèvement des femmes de la seuletribu qui s’était dérobée à la vengeance, afin de régénérer celle des Benjaminites.Dans la tradition patristique, ce récit était rapproché de Genèse (XIX) avec Lothrecevant à Sodome la visite de deux anges sous forme humaine égalementmenacés de sodomie par les habitants, signe du dévoiement des hommess’éloignant du culte de Dieu. Cependant, le récit est d’une telle violence et d’unetelle immoralité qu’il incite les exégètes du XVIIe siècle à le rejeter ou qu’il trahitchez les illustrateurs un goût du scabreux 9 . L’histoire du Lévite devient sous la6 Selon les catégories établies par Bertram Eugène Schwarzbach dans « L’Encyclopédie de Diderotet d’Alembert » (Le Siècle des Lumières et la Bible, sous la direction d’Yvon Belaval, éd.Be<strong>au</strong>chesne, 1984).7 L’expression est de François Laplanche, dans La Bible en France, entre mythe et critique, XVIe-XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1994.8 Voltaire apostrophe ainsi les exégètes figuristes : « Allons, Abbadie, Sherlock, Houteville etconsorts, faites des phrases pour justifier ces fables de cannibales; prouvez que tout cela est untype, une figure qui nous annonce Jésus-Christ » (L’Examen important de milord Bolingbroke,édition critique de Roland Mortier, dans The Complete works of Voltaire/Les Œuvres complètes deVoltaire 62 : 1766-1767, Oxford, The Voltaire Foundation, 1987, ch. VII, pp. 127-362).9 « Que les programmes iconographiques s’arrêtent avec délectation sur l’ivresse de Noé, l’incestede Loth, les bains de Bethsabée et de Suzanne, comme nous n’avons eu cesse de les rencontrer,mais également sur les délices interdits de Sodome (Gn 18), les viols de Dina (Gn 34), de laTextimage, Varia 3, hiver 2013 3
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »plume de Voltaire un morce<strong>au</strong> de choix, un paradigme récurrent des « fables decannibales », qu’il ne cesse de dénoncer et de réécrire tant dans ses œuvres defiction que dans ses essais portant sur la Bible.La réécriture de Rousse<strong>au</strong> est posée d’emblée dans sa singularité,surgissant <strong>au</strong> moment où dans sa propre vie, il subit les premières affres de l’exil.Frédéric S. Eigeldinger dans son édition critique du Lévite d’Ephraïm 10 livre unesomme de recherches faisant <strong>au</strong>torité et permettant de connaître la genèse 11 del’œuvre, sa réfraction dans les Confessions, avec toute la prudence requise àl’égard de <strong>cet</strong>te réfraction valant comme construction a posteriori de la personnede l’<strong>au</strong>teur. L’idée de gageüre, d’œuvre défi, et d’œuvre expérimentale dont son<strong>au</strong>teur parle en termes de tentative et de réussite, préside donc à la constitution dutexte. Le pari est inscrit dans le projet, non seulement dans la rencontre entre unsujet atroce et un style sentimental, mais <strong>au</strong>ssi dans la littérarisation de la matricebiblique, dans <strong>cet</strong>te volonté de faire d’un récit dont la finalité principale pour lesrédacteurs deutéronomistes est religieuse et politique 12 , une fiction littéraire. Saréécriture procède principalement par ajout et déplacement : le re-tricotage dutexte biblique joue sur tous les nive<strong>au</strong>x – le référent historique, la structured’ensemble, le dispositif énonciatif, le système sémiotique des personnages – etprocède par greffe de styles littéraires. Le rédacteur connaît toutes lesinsuffisances de ce texte biblique qui résiste <strong>au</strong>x exégètes et fait les be<strong>au</strong>x jours deceux qui raillent l’Ancien Testament ou se délectent des récits scabreux. Mais lefemme du Lévite (Juges l9), de Thamar (2 Samuel 13) et gravent tant d’exactions en tous genresrévèlent plus que de nombreux discours ce pouvoir de l’image, maîtresse du plaisir »(M. Engammare, « Les Figures de la Bible. Le destin oublié d’un genre littéraire en image (XVIe-XVIIe s.) », art. cit., p. 587).10 Rousse<strong>au</strong>, Le Lévite d’Ephraïm, édition critique par Frédéric S. Eigeldinger, Paris, Champion,1999.11 F. S. Eigeldinger « incline à penser que Le Lévite d’Ephraïm a été pensé à Montmorency, queRousse<strong>au</strong> en a rédigé deux chants et demi durant son voyage vers la Suisse et que le texte étaitachevé en septembre 1762 ». En 1768, J.-J. <strong>au</strong>rait juste « apporté quelques corrections à sacopie » (Ibid., p. 29).12 C’est du moins l’exégèse dominante de ce récit qui a fait couler be<strong>au</strong>coup d’encre (voirJ. A. Soggin, Le Livre des Juges, Genève, Labor et fides, 1981). Cependant, Corinne Lanoirpropose une toute <strong>au</strong>tre interprétation, littéraire, selon laquelle les rédacteurs <strong>au</strong>raient été musprincipalement par une visée parodique, à relier à plusieurs écrits bibliques antérieurs. En ce sens,Voltaire serait be<strong>au</strong>coup plus proche des premiers rédacteurs que Rousse<strong>au</strong>… Voir C. Lanoir,Femmes fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le Livre des Juges. Genève, Labor et fides,2005.Textimage, Varia 3, hiver 2013 4
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »défi est <strong>au</strong>ssi personnel, doublement personnel, puisque Le Lévite rédigé dans lavoiture qui emporte Rousse<strong>au</strong> loin de Paris est une œuvre de consolation, desuppléance, et l’on sait grâce à Jean Starobinski 13 l’importance de la suppléancedans sa structure de pensée, et également une œuvre apologétique, visant àvaloriser son ethos <strong>au</strong>près des lecteurs en dévoilant sa capacité à s’abstraire duréel <strong>au</strong> lieu de sombrer dans l’esprit de vengeance. On le voit, be<strong>au</strong>coupd’éléments se nouent dans ce récit pour lequel Rousse<strong>au</strong> a eu plusieurs projetsd’édition dont l’un suffisamment abouti pour qu’il y adjoigne des noticesd’illustration, ultime greffon. Il rédige en effet quatre notices d’illustrationrythmant la macrostructure narrative à destination d’un dessinateur, dans laperspective d’une éventuelle édition regroupant Emile et Sophie ou les Solitaireset les Lettres à Sara, « après février 1764, alors qu’il pense à l’édition de sesœuvres et propose <strong>au</strong> peintre graveur Cl<strong>au</strong>de-Henri Watelet d’en êtrel’illustrateur » 14 .Les quatre sujets suivants se rapportent <strong>au</strong> Lévite d’Ephraïm et doivent parconséquent être dans le costume des premiers Hébreux et [représenter lespaysages] de la palestine.1.Une Vallée agréable [ou l’on aperçoit le long des oliviers] traversée par unruisse<strong>au</strong> et pleine de[s] rosiers de[s] grenadiers et <strong>au</strong>tres arbustes. […] une(sic) jeune et be<strong>au</strong> Levite offre à sa [jeune amante maîtresse, amante] jeunebien aimée une tourterelle qu’il vient de prendre <strong>au</strong> piège ; [elle] la [petitefille jeu] fille charmée caresse la tourterelle et la met dans son sein.Un sistre à l’antique est par terre [le long] sous les ombrages, sur les cote<strong>au</strong>xon voit des oliviers et dans le fond des montagnes [et la (?)].2.Le lévite sortant <strong>au</strong> point du jour de la maison de son hôte trouve à la porte [àla porte et tendant] sa bien aimée [étendue] la face contre terre et les bras13 Voir à ce propos l’<strong>article</strong> de Jean Starobinski « Sur la pensée de Rousse<strong>au</strong> », Le Remède dans lemal, Paris, NRF Gallimard, 1989, pp. 165-232.14 Le Lévite d’Ephraïm, éd. cit., p. 139. Pour F. S. Eigeldinger, ces quatre notices ainsi qu’unfragment de présentation « n’ont pas tous été rédigés à Môtiers, mais tous y ont été repris etcomplétés ». Il lui semble plus pl<strong>au</strong>sible que ces illustrations aient été conçues pour l’éditionneuchâteloise de ses œuvres complètes qu’en 1763 avec l’éditeur parisien Duchesne souhaitantréunir en un volume De l’imitation théâtrale, l’Essai sur l’origine des langues et Le Lévited’Ephraïm.Textimage, Varia 3, hiver 2013 5
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »étendus sur le [ciel] seuil. Il pousse un cri plaintif, il l’appelle il regarde il latouche ; Hélas elle étoit morte. Le lieu de la scène est une rue et l’onentrevoit une place dans le fond.3.Le Levite en habit lugubre raconte sa [triste] funeste histoire et implore lavengeance du peuple d’Israël assemblé a Maspha devant le tabernacle duSeigneur. A son recit tout le peuple pousse un cri d’indignation.4.Les [Benjami] filles d’Israël [s’étant] parées [et en habits (?)] s’étantrassemblées à Silo pour danser <strong>au</strong> son des flutes [sentant]. Les Benjaminitesentourés par la nation les surprennent les poursuivent les saisissent, [ets’emparant chacun de la sienne] s’emparent chacun de la sienne. [Les jeunesbe<strong>au</strong>tés épouvantées fuyent de toute leur force mais en vain, la (?) les[buissons] vignes les buissons les retiennent et les dechirent. La terre estjonchée de leurs bouquets et de leurs parures]. Dans la fuite de ces jeunesbe<strong>au</strong>tés épouvantées les vignes les buissons les ronces, retiennent etdéchirent [les] leurs voiles [de ces jeunes] La terre est jonchée de leurs[bouquets] fleurs et de leurs parures. C’est [sous] dans un <strong>au</strong>tre costumel’enlèvement des Sabines, mais sous un aspect plus gracieux pour desH[ommes] [sans armes et presque sans violence,] [toute la nation et duconsentement] [de l’aveu de toute la nation] 15 .Même si Rousse<strong>au</strong>, in fine, ne publiera jamais Le Lévite 16 , il nous sembleque pour comprendre les enjeux multiples de <strong>cet</strong>te réécriture biblique, il pourraitêtre intéressant de partir de l’analyse de l’image, entendue non comme figure derhétorique mais dans <strong>cet</strong>te double signification d’une illustration et d’une scènevisuelle écrite.*****On connait le goût de Rousse<strong>au</strong> pour les estampes manifesté déjà lors del’édition de la Nouvelle Héloïse ainsi que sa volonté de présider à leur invention :On sait combien Rousse<strong>au</strong> s’est attaché à l’illustration de la NH pour laquelleil a rédigé lui-même les instructions <strong>au</strong> graveur. Il écrivait d’ailleurs à Sophie15 BPUN, MsR 51, f° 16 ; OC II, p. 1926 ; les instructions de Rousse<strong>au</strong> sont également citées parF. S. Eigeldinger, éd. cit., pp. 141-142.16 Les raisons d’avortement des projets éditori<strong>au</strong>x ne sont pas liées directement <strong>au</strong> Lévited’Ephraïm ; voir à ce propos Frédéric S. Eigeldinger, « Des pierres dans mon jardin » (pp. 215-222). Mais nous pensons que l’absence d’édition trahit néanmoins un retrait de l’<strong>au</strong>teur.Textimage, Varia 3, hiver 2013 6
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »d’Houdetot le 5 décembre 1757 : « C’est toujours moi qui me chargerai del’exécution des estampes comme j’ai fait à mes <strong>au</strong>tres écrits afin qu’ellessoient mieux » (CC 587) 17 .Mais on n’a peut-être pas assez insisté sur ce qu’induit une telle prescription, laconception d’une langue ordonnatrice de signes visuels, alors même que Rousse<strong>au</strong>s’adresse à d’illustres graveurs qui ne sont pas de simples exécutants, et le lienconsubstantiel établi entre le texte et l’image, nécessitant une même source<strong>au</strong>ctoriale. En ce qui concerne Le Lévite d’Ephraïm, l’influence de l’éditionbiblique texte/image a certainement joué et transparaît dans le souci archéologiqueliminaire de représenter les figures humaines «dans le costume des premiersHébreux » et les paysages « de la Palestine » 18 . Même si on sait que Rousse<strong>au</strong> nes’est jamais passionné pour l’établissement exégétique des Ecritures et qu’il neremet pas en c<strong>au</strong>se leur historicité traditionnelle, il participe de la modernité quiconsiste à inscrire la Bible dans un champ culturel qui la dépasse. La comparaisonavec les illustrations gravées par J.-B. de Marne pour l’ouvrage de L<strong>au</strong>rent-Etienne Rondet en 1767, Figures de la Bible contenues en cinq cens table<strong>au</strong>x 19 ,révèle des points communs qui attestent les constantes d’un programmeiconographique et leur modernisation. Deux légendes sur trois, « Femme d’unlévite morte des violences qu’on lui a faites » et « Enlèvement des filles de Silopar les Benjaminites », sont à rapprocher des instructions deux et quatre deRousse<strong>au</strong>.Mais c’est surtout l’influence de la perception du récit comme scène, durécit faisant image, dont une des origines génériques est l’Idylle, qui a pu l’inciterà concevoir des illustrations. En effet, le style idyllique est caractérisé par cesuspens de la narration <strong>au</strong> profit de la scène visuelle. La réécriture du textebiblique consiste dans l’insert d’une succession de table<strong>au</strong>x, les plis dupalimpseste se nouant dans ce défi de la langue à créer du visuel. Nous avons17 Ibid., p. 135.18 Voir supra, p. 4.19 Figures de la Bible contenues en cinq cens table<strong>au</strong>x, gravés [par J.B. de Marne] d’après lesdesseins de Raphael, & des plus grands maîtres, accompagnés d’une courte explication pourl’instruction de la jeunesse, et précédés d’un discours préliminaire où se trouve l’histoire desfigures de la Bible, 1767. Cet ouvrage est <strong>au</strong>ssi célèbre pour la préface attribuée à L<strong>au</strong>rent-EtienneRondet et estimée comme la première critique historique du genre des Figures de la Bible.Textimage, Varia 3, hiver 2013 7
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »repéré dix inserts: idylle dans les vallons de Sichem (chant I, 5) ; désolation duLévite abandonné (chant I, 7) ; retrouvailles de la jeune femme et du Lévite (chantI, 8) ; adieux touchants <strong>au</strong> moment de la séparation de la jeune femme et sesparents (chant I, 12) ; la be<strong>au</strong>té mourante et les charognes (chant II, 8) ;découverte de la jeune femme morte sur le seuil de la porte (chant II, 9) ;vengeance du Lévite, coupe du corps et cendres sur la tête (chant II, 10) ;assemblée à Maspha (chant III,1) ; désolation du champ de bataille (chant III,12) ; retour honteux des Benjaminites (chant IV, 2) ; rapt des jeunes filles de Silo(chant IV, 6). Pour chacun des passages mentionnés, l’énonciateur utilise la lexiedu spectacle, soulignant ainsi la deixis, conformément à la tradition classique de lalittérature rivalisant avec la peinture. Si on met en regard ces table<strong>au</strong>x écrits et lesillustrations projetées, on observe qu’il y a correspondance par sélection d’uneimage par chant : l’idylle dans la vallée, la découverte de la femme morte « à laporte » de son hôte, le lévite implorant « la vengeance du peuple d’Israël assembléà Maspha », le rapt des danseuses de Silo par les Benjaminites.Entre texte et image, la notice illustrative projette une image tout en étantencore de l’écrit. Fr. Eigeldinger souligne l’importance du cinétisme dans lesreprésentations visuelles de Rousse<strong>au</strong> en citant le passage suivant :Dans les figures en mouvement, il f<strong>au</strong>t voir ce qui précède et ce qui suit, etdonner <strong>au</strong> temps de l’action une certaine latitude ; sans quoi l’on ne saisirajamais bien l’unité du moment qu’il f<strong>au</strong>t exprimer. L’habileté de l’Artisteconsiste à faire imaginer <strong>au</strong> Spectateur be<strong>au</strong>coup de choses qui ne sont passur la planche ; et cela dépend d’un heureux choix de circonstances 20 .Le mouvement impliquant la suggestion d’une temporalité régiteffectivement son esthétique iconographique : don de la tourterelle, méprise sur lamort de la concubine, discours du lévite et effets du discours sur l’assembléed’Israël, enlèvement des danseuses par des hommes non armés. La référence <strong>au</strong>xgenres pictur<strong>au</strong>x traditionnels ordonne également son imaginaire : gravure20 Extrait du Recueil d’estampes paru en 1761 chez Duchesne, dans OC II, Paris, Gallimard,« Bibliothèque de la Pléiade », 1961, p. 761, cité par Fr. Eigeldinger, p. 136.Textimage, Varia 3, hiver 2013 8
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »pastorale inspirée de Fr. Boucher 21 , peintures d’histoire sacrée ou profane avec laréférence <strong>au</strong>x Sabines. La troisième notice relève d’un sous-genre de la peintured’histoire conforme à l’idéal classique: la prédication, mise en scène de la paroledans son émission et dans sa réception, <strong>au</strong> point que la storia n’est pas représentéecomme texte mais comme parole et discours.Si on imagine aisément à partir de la plupart des notices comment lanarration iconographique peut suggérer en analepse et en prolepse diversesactions, la deuxième légende paraît plus difficile à réaliser en une imagesynthétique. Le mouvement ne porte pas sur des actions distinctes mais estintériorisé car il s’agit d’une méprise du regard :Le lévite sortant <strong>au</strong> point du jour de la maison de son hôte trouve à la porte [àla porte et tendant] sa bien aimée [étendue] la face contre terre et les brasétendus sur le [ciel] seuil. Il pousse un cri plaintif, il l’appelle il regarde il latouche ; Hélas elle étoit morte. Le lieu de la scène est une rue et l’onentrevoit une place dans le fond.On peut rendre en une image le fait que le lévite croit voir sa femme vivante alorsqu’elle est morte mais il est difficile de le montrer croyant et ne croyant pas lamême chose. D’ailleurs, la rédaction de la notice est marquée par l’hybridité : lepassage à un présent de narration – « il pousse un cri plaintif, il l’appelle ilregarde il la touche » – traduit que la phrase relève d’une <strong>au</strong>tre énonciation,glissant d’un énonciateur décrivant une représentation imaginaire à un narrateuren mode de vision interne <strong>au</strong> personnage, fluidifiant les frontières grâce <strong>au</strong>discours narrativisé. On a l’impression que l’énonciateur se laisse emporter parl’écriture comme si la puissance du présent de narration débordait dans le présentde l’énonciation. Or, il nous semble que <strong>cet</strong>te confusion fait sens, qu’elle indiqueun point trouble de la narration biblique, la méprise de la mort de la femme violée,nœud du récit biblique, souvent d’ailleurs glosé, parodié par les réécritures deVoltaire. Ou encore, elle indique un questionnement propre à Rousse<strong>au</strong> sur lareconnaissance d’un corps mort qu’on retrouve dans La Nouvelle-Héloïse où Juliedéclarée morte paraît ensuite vivante, renvoyant à une réflexion anthropologique21 Fr. Eigeldinger précise que Rousse<strong>au</strong> affectionnait une gravure de Blondel d’Azaincourt, LaFemme à la cage, réalisée d’après un dessin de l’école de Boucher (voir pp. 138-139).Textimage, Varia 3, hiver 2013 9
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »sur l’opacité des corps, sur la limite entre la vie et la mort. La dernière phrase dela notice insiste sur le dispositif spatial et l’idée de franchissement d’un seuil,comme si <strong>cet</strong>te projection visuelle à la frontière du visible et du dicible valaitsurtout comme limite. Mais le choix de <strong>cet</strong>te scène visuelle est d’<strong>au</strong>tant plusproblématique que dans ce même chant II se trouve une <strong>au</strong>tre scène narrative, ladécoupe du corps, qui <strong>au</strong>rait pu être privilégiée et dont l’absence intrigue.En effet, préalable même à l’écriture de scènes narratives, l’image quis’impose à l’évocation de la storia du lévite d’Ephraïm est celle de la découpe ducorps de la femme et son envoi <strong>au</strong>x douze tribus d’Israël. La vision du corpsfragmenté devient ainsi l’illustration absente qui hante d’<strong>au</strong>tant plus l’œuvre etétonne le lecteur qu’elle coïncide <strong>au</strong>ssi avec l’image génésique de la réécriturerousse<strong>au</strong>iste telle qu’elle apparaît dans la correspondance contemporaine. Lelibraire Duchesne écrit à Rousse<strong>au</strong> réfugié à Môtiers : « Il court ici (mais je ne l’aipas vu) un petit manuscrit intitulé Les 12. divisions de la femme, etc. que l’onvous attribue » 22 . Fr. Eigeldinger insiste sur le fait qu’il s’agit d’une rumeur,partant de Genève et de Berne pour s’étendre jusqu’à Stockholm ou Amsterdam 23 .C’est bien l’image d’un langage immédiat et puissant porté par « les douze partiesde la femme envoyées <strong>au</strong>x douze tribus » 24 qui faisait lever l’attente des futurslecteurs dont les correspondances épistolaires gardent la trace. L’écriture duscandale devenait promesse d’une écriture scandaleuse. On sait que la mention durécit de la découpe du corps est déjà présente dans L’Essai sur l’origine deslangues comme exemple d’un langage où « le signe a tout dit avant qu’on parle »,proche du concept du langage d’action de Condillac :Quand le lévite d’Ephraïm voulut venger la mort de sa femme, il n’écrivitpoint <strong>au</strong>x Tributs d’Israël ; il divisa le corps en douze pièces et les leurenvoya. A <strong>cet</strong> horrible aspect ils courent <strong>au</strong>x armes en criant tout d’une voix :non, jamais rien de tel n’est arrivé dans Israël, depuis le jour que nos pères22 Ibid., p. 15.23 Ibid., p. 16.24 Lettre du 12 Juillet 1764, CC 3396, cité par Frédéric S. Eigeldinger, p. 16.Textimage, Varia 3, hiver 2013 10
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »sortirent d’Egypte jusqu’à ce jour. Et la Tribu de Benjamin futexterminée 25 …Cette reprise n’est certainement pas étrangère <strong>au</strong> projet d’édition de rassembler enun volume De l’Imitation théâtrale, L’Essai sur l’origine des langues et Le Lévited’Ephraïm 26 , suggérant ainsi un <strong>au</strong>tre lien spéculatif, la réflexion sur le langage,dans sa dimension pragmatique, per<strong>format</strong>ive.Il nous semble intéressant de creuser ce paradoxe d’une imageirreprésentable, du moins irreprésentée visuellement, et en même temps à l’originede la représentation. Oscillant entre le dicible et le visible, l’image décrite dans lediscours mais absente des instructions pour les illustrations, hante le texte <strong>au</strong>xconfins de la représentation de façon telle qu’elle révèle que Le Lévite est régi par<strong>cet</strong>te question de la représentation des affects, de la monstration de l’horreur <strong>au</strong>xlimites du visible. L’absence d’illustration ne relève pas simplement d’unimpératif de bienséance classique mais a partie liée avec un questionnement sur lelangage, sur le récit comme scène, sur la mimesis spectaculaire. D’ailleurs, lacomparaison avec l’ouvrage déjà cité de L<strong>au</strong>rent-Etienne Rondet, Figures de laBible contenues en cinq cens table<strong>au</strong>x 27 , atteste que la représentation de ladécoupe du corps de la concubine faisait partie du champ des possibles : laseconde illustration s’intitule « Le Lévite met le corps de sa femme en pièces ».Remarquons en premier lieu que l’image génésique est significativementplacée en ouverture du premier chant dans le cadre d’un dispositif énonciatifinformé par une apostrophe (« Ô vous, hommes débonnaires »), qui impliquel’invention d’un je énonciateur réfléchissant et condensant son récit à venir sousforme d’un table<strong>au</strong> : « quel table<strong>au</strong> viens-je offrir à vos yeux ? Le corps d’unefemme coupé par pièces ; ses membres déchirés et palpitants envoyés <strong>au</strong>x douzeTribus ; etc. ». Le dédoublement de l’énonciation fait de l’énonciateur le doubledu lévite, et des lecteurs, le double du peuple d’Israël, tandis que le récit est lesuppléant des douze morce<strong>au</strong>x reçus par les tribus. Le dispositif énonciatif porte25 Essai sur l’origine des langues, ch. I. « Des divers moyens de communiquer notre pensée », OCV, pp. 376-377.26 Il s’agit de l’édition pour Duchesne en 1763 pour laquelle existe un projet de préface rédigé parRousse<strong>au</strong> introduisant ces trois œuvres.27 Voir supra, p. 6.Textimage, Varia 3, hiver 2013 11
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »la projection sur tout le texte d’une réécriture qui réfléchit l’échange présent avecla promesse, ou la gageüre, de se h<strong>au</strong>sser à <strong>cet</strong>te énergie-là du langage, mais <strong>au</strong>ssila crainte que les lecteurs, qui « de peur d’envisager les crimes de [leurs] frères,[aiment] mieux les laisser impunis », se détournent lâchement… Le défi estpartagé, les lecteurs eux-mêmes sont défiés de regarder l’horreur en face :A de tels forfaits celui qui détourne ses regards est un lâche, un déserteur dela justice ; la véritable humanité les envisage, pour les connaitre, pour lesjuger, pour les détester 28 .L’énonciateur affirme par une vigoureuse syntaxe que la contemplation del’horreur n’est pas une fin en soi : trois syntagmes verb<strong>au</strong>x introduits par lapréposition pour complètent le prédicat envisage. Cette triple finalité dessine lescontours d’une lecture participative qui débouche sur un acte de langage, uneréaction, un engagement discursif. Dans De l’Imitation théâtrale, ouvragethéorique publié en 1764 à Amsterdam, Rousse<strong>au</strong> dénonce l’illusion deconnaissance produite par la mimésis spectaculaire. Certes, l’essai est centré sur lethéâtre et prolonge la polémique suscitée depuis la Lettre à M. d’Alembert sur lesspectacles, mais l’argumentaire y est essentiellement fondé sur l’analogie avec lapeinture. Si Rousse<strong>au</strong> accepte de penser à l’intérieur du paradigme de l’imitationde la nature étendu à tous les arts dont Charles Batteux est l’épigone célèbre 29 , ildemeure très critique à l’égard de l’imitateur dont il pointe l’absence deconnaissances réelles de l’imité, ainsi qu’il le souligne à travers la métaphore filéedes trois palais :Je vois là trois palais bien distincts : premièrement, le modèle ou l’idéeoriginale qui existe dans l’entendement de l’architecte, dans la nature, ou tout<strong>au</strong> moins dans son <strong>au</strong>teur, avec toutes les idées possibles dont il est lasource ; en second lieu, le palais de l’architecte, qui est l’image de cemodèle ; et, enfin, le palais du peintre, qui est l’image de celui de l’architecte.Ainsi, Dieu, l’architecte, et le peintre, sont les <strong>au</strong>teurs de ces trois palais. Lepremier palais est l’idée originale, existante par elle-même ; le second en estl’image ; le troisième est l’image de l’image, ou ce que nous appelonsproprement imitation. D’où il suit que l’imitation ne tient pas, comme on28 Le Lévite, p. 71.29 Nous citons pour mémoire Les Be<strong>au</strong>x-Arts réduits à un même principe (1746) et Principes delittérature (1754).Textimage, Varia 3, hiver 2013 12
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »contrôle des affects par la raison. L’universalisme de Rousse<strong>au</strong> montre qu’il sesitue dans le domaine de la morale davantage que dans celui des conventionssociales. Pour celui qui ne craint pas de s’afficher en costume arménien, il n’estpas question d’adhérer à un quelconque code de bienséance mais l’expression del’intime n’exclut pas un contrôle de ses passions. Il reconnaît que l’imitationvisuelle de l’homme qui est éduqué pour contrôler ses passions et ne pas laisserlibre cours à l’épanchement visible de ses émotions, est difficile ; mais imiter despassions visibles, c’est céder <strong>au</strong> goût du vulgaire et créer une œuvre amorale :Nous dirons donc que la constance et la fermeté dans les disgrâces sontl’ouvrage de la raison, et que le deuil, les larmes, le désespoir, lesgémissements, appartiennent à une partie de l’âme opposée à l’<strong>au</strong>tre, plusdébile, plus lâche, et be<strong>au</strong>coup inférieure en dignité. Or, c’est de <strong>cet</strong>te partiesensible et faible que se tirent les imitations touchantes et variées qu’on voitsur la scène. L’homme ferme, prudent, toujours semblable à lui-même, n’estpas si facile à imiter ; et quand il le serait, l’imitation, moins variée, n’enserait pas si agréable <strong>au</strong> vulgaire ; il s’intéresserait difficilement à une imagequi ne serait pas la sienne, et dans laquelle il ne reconnaîtrait ni ses mœurs, nises passions: jamais le cœur humain ne s’identifie avec des objets qu’il sentlui être absolument étrangers 34 .La solution, ou le défi, serait d’imiter des hommes qui contrôlent encoreimparfaitement leurs affects mais tendent vers <strong>cet</strong>te maîtrise, ce qui leurconfèrerait et visibilité et intérêt. On peut penser que Le Lévite, récit d’imitationd’un temps où les hommes ne sont pas encore entièrement polis par les usages,constitue ce modèle idéal et que c’est dans <strong>cet</strong>te perspective que Rousse<strong>au</strong>imagine confier les gravures à Watelet.Pour revenir à l’ouverture du Lévite, on voit que l’énonciateur propose <strong>au</strong>contemplateur du terrible table<strong>au</strong> biblique une véritable connaissance qui n’enreste pas à l’apparence des choses. Sa fiction appelle un travail réflexif de la partdu lecteur (connaître), une prise de position (juger), et en dernier lieu seulementun partage émotionnel (détester). Pus loin dans le texte (chant IV, 1), la tribuJabès de Galaad qui se dérobe <strong>au</strong> combat contre les Benjaminites devient lemodèle du lecteur lâche. Cette exigence, dont la virulence est troublante, n’a34 De l’Imitation théâtrale, Op. cit.Textimage, Varia 3, hiver 2013 14
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »d’égal que le redoutable défi que l’énonciateur se donne à lui-même du langageénergique à travers la langue.C’est ainsi, qu’en second lieu, nous allons observer la réalisation de ce défià travers l’écriture de la narration de la découpe du corps située à la fin du chantII :Dès <strong>cet</strong> instant, occupé du seul projet dont son âme était remplie il fut sourd àtout <strong>au</strong>tre sentiment ; l’amour, les regrets, la pitié, tout en lui se change enfureur. L’aspect même de ce corps, qui devrait le faire fondre en larmes, nelui arrache plus ni plaintes ni pleurs : Il le contemple d’un œil sec et sombre ;il n’y voit plus qu’un objet de rage et de désespoir. Aidé de son serviteur, il lecharge sur sa monture et l’emporte dans sa maison. Là, sans hésiter, sanstrembler, le barbare ose couper ce corps en douze pièces ; d’une main fermeet sûre il frappe sans crainte, il coupe la chair et les os, il sépare la tête et lesmembres, et après avoir fait <strong>au</strong>x Tribus ces envois effroyables, il les précèdeà Maspha, déchire ses vêtements, couvre sa tête de cendres se prosterne amesure qu’ils arrivent et réclame à grands cris la justice du Dieu d’Israël 35 .La narration, <strong>au</strong> présent, est clairement focalisée sur le ressenti dupersonnage et dramatise ce moment crucial de la métamorphose radicale duLévite cessant d’être conduit par la passion amoureuse pour devenir l’hommed’un seul affect, la vengeance. Il n’est plus que cri, langage énergique de lavengeance qui s’exprime par le signe du corps découpé. Pour être efficace,entendu, vengé, il doit faire taire en lui tous ses affects, s’oublier lui-même,oublier le corps chéri, descendre <strong>au</strong> plus bas de l’abjection de son amour.L’atrocité de l’acte de morcellement corporel redouble l’atomisation de l’êtreviolenté et anime le désir de vengeance chez le peuple d’Israël. Une des leçons duLévite d’Ephraïm réside donc dans <strong>cet</strong>te terrible éducation du contrôle despassions qui passe par la découverte du rapport du couple, petite sociétégémellaire, à son extériorité… Mais ce qui nous intéresse surtout dans <strong>cet</strong>tenarration réside dans l’opposition explicite avec l’attitude éplorée habituellefavorisant le be<strong>au</strong> spectacle d’une piéta. En accord avec l’esthétique prônée dansDe l’Imitation théâtrale où Rousse<strong>au</strong> dénonce « ceux qui pleurent comme des35 Le Lévite d’Ephraïm, p. 91.Textimage, Varia 3, hiver 2013 15
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »femmes la perte de ce qui leur fut cher », le pathos demeure limité, les larmesévitées 36 .De même dans la lettre LXIV à M de Francueil en janvier 1753, Jean-Jacques suppute chez son ami endeuillé, M. de Jully qui consacre une chapelledomestique à la défunte, une délectation dans le be<strong>au</strong> malheur. Pour Rousse<strong>au</strong>,l’expression de l’intime se fige en signe ostentatoire et se déplace dans le domaineesthétique. Cette alliance de la sensibilité et de l’art représente le comble del’in<strong>au</strong>thenticité puisque lorsque l’art puise ses modèles dans les manifestationsvisibles des passions de la vie réelle, celles-ci sont déjà un simulacre, unereprésentation pensée pour l’exhibition, les manifestations sensibles étantinformées par ce regard de la société. La déréalisation théâtrale paraît atteindre lecœur de l’intime <strong>au</strong> point qu’Antoine Coypel dans sa conférence Sur l’esthétiquedes peintres peut conseiller <strong>au</strong>x artistes d’aller <strong>au</strong> théâtre pour étudier lesmanifestations extérieures des passions. On comprend mieux comment Rousse<strong>au</strong>peut être le chantre de l’expression sensible, le défenseur de l’intime et en mêmetemps le pourfendeur de certaines de ses manifestations, les larmes cristallisant saméfiance pour les débordements artificiels. Rousse<strong>au</strong> récuse donc les larmesquand elles sont données à voir, produites comme un objet de spectacle, « un be<strong>au</strong>malheur à peindre ». Ses observations dans la Lettre à d’Alembert aident <strong>au</strong>ssi àsaisir son parti pris :Si, selon la remarque de Diogène-Laërce, le cœur s’attendrit plus volontiers àdes m<strong>au</strong>x feints qu’à des m<strong>au</strong>x véritables ; si les imitations du théâtre nousarrachent quelquefois plus de pleurs que ne ferait la présence même desobjets imités, c’est moins, comme le pense l’Abbé Du Bos, parce que lesémotions sont plus faibles et ne vont pas jusqu’à la douleur, que parcequ’elles sont pures et sans mélange d’inquiétude pour nous-mêmes. Endonnant des pleurs à ces fictions, nous avons satisfait à tous les droits del’humanité, sans avoir plus rien à mettre du nôtre ; <strong>au</strong> lieu que les infortunésen personne exigeraient de nous des soins, des soulagements, desconsolations, des trav<strong>au</strong>x qui pourraient nous associer à leurs peines, qui36 Dans la séquence des adieux <strong>au</strong>x parents, les larmes sont réservées <strong>au</strong> gynécée féminin, alorsque le père « ne pleurait pas : ses muettes étreintes étaient mornes et convulsives ».Textimage, Varia 3, hiver 2013 16
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »coûteraient du moins à notre indolence, et dont nous sommes bien aise d’êtreexemptés 37 .Cette façon de mirer sa grandeur d’âme dans sa capacité à pleurer est unedérive narcissique de l’amour-propre. Rousse<strong>au</strong>, toujours dans la Lettre àd’Alembert, dénonce la purgation cathartique <strong>au</strong>x effets stériles car productriced’une « émotion passagère et vaine, qui ne dure pas plus que l’illusion qui l’aproduite; un reste de sentiment naturel, étouffé bientôt par les passions, une piétéstérile, qui se repaît de quelques larmes, et n’a jamais produit le moindre acted’humanité. Ainsi pleurait le sanguinaire Sylla <strong>au</strong> récit des m<strong>au</strong>x qu’il n’avait pasfait lui-même » 38 .Les larmes paraissent couler d’<strong>au</strong>tant plus d’abondance qu’ellesn’engagent pas l’être qui pleure. La sensibilité éveillée dans le cadre d’unspectacle n’exigeant pas d’implication personnelle s’avère être <strong>au</strong>x antipodes desvœux de Rousse<strong>au</strong> appelant un usager, un lecteur engagé, qui fasse corps et âmeavec l’œuvre reçue. Les scènes visuelles du Lévite dépassent ce pathos confortablepour l’amour-propre du lecteur ; elles donnent à voir ce qui est à la limite duvisible ou dans leur enchaînement, elles tracent une éducation de la sensibilité, leLévite apprenant à ne pas pleurer ou la courageuse Axa à la fin du récit nemanifestant pas son sacrifice par des larmes. Rousse<strong>au</strong> est pour l’intime, contre lacivilité imposée, artificielle, mais un intime où le cœur est contrôlé par la raison,grâce à la vertu. Par la narration de l’apprentissage de la maîtrise des affects, onpeut toucher le lecteur tout en l’édifiant, en faisant vibrer non seulement la cordesensible mais <strong>au</strong>ssi les sentiments et la conscience d’une certaine dignité.Cependant, le détour par l’illustration interroge sur la réalisation de <strong>cet</strong>teéducation <strong>au</strong>x passions, ne serait-ce que par l’absence intrigante de l’illustrationcentrale de la découpe du corps. Les instructions données par Rousse<strong>au</strong> nesemblent pas échapper à une forme d’esthétisation du be<strong>au</strong> malheur : la deuxièmelégende montre un Lévite éploré – « Il pousse un cri plaintif, il l’appelle il regarde37 Lettre à Mr d’Alembert, Lettre à d’Alembert rédaction et publication 1758, Chronologie,présentation, notes, dossier, bibliographie Marc Buffat, Paris, Flammarion, « Garnier-Flammarion », 2003, p. 31.38 Ibid., p. 30.Textimage, Varia 3, hiver 2013 17
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »il la touche ; Hélas elle étoit morte » – et la troisième un Lévite qui « implore » lepeuple assemblé à Maspha, tandis que l’énonciateur de la quatrième insiste sur lagracieuseté de la scène, l’édulcoration de la violence : « C’est [sous] dans un <strong>au</strong>trecostume l’enlèvement des Sabines, mais sous un aspect plus gracieux pour desH[ommes] [sans armes et presque sans violence] ». Or, l’écriture des table<strong>au</strong>xn’échappe pas toujours non plus à <strong>cet</strong>te artificialité de la monstration, comme parexemple dans la scène visuelle de la be<strong>au</strong>té mourante où affleure le discours directde l’énonciateur :O misérables, qui détruisez votre espèce par les plaisirs destinés à lareproduire, comment <strong>cet</strong>te be<strong>au</strong>té mourante ne glace-t-elle point vos férocesdésirs ? Voyez ses yeux déjà fermés à la lumière, ses traits effacés, son visageéteint ; la pâleur de la mort a couvert ses joues, les violettes livides en ontchassé les roses, elle n’a plus de voix pour gémir, ses mains n’ont plus deforce pour repousser vos outrages : Hélas ! elle est déjà morte ! […] 39 .Mais les réécritures visuelles peuvent s’éclairer dans la perspective d’unparcours esthético-moral : l’hypotypose de la be<strong>au</strong>té mourante conduitl’énonciateur à déclarer la concubine « déjà morte », ce qui peut signifier que leviol est mise à mort ; mais il se pourrait que ce soit l’hypotypose elle-même quitue la concubine en la transformant en image d’une be<strong>au</strong>té marmoréenne. De <strong>cet</strong>tevision esthétisée et glaciale d’une be<strong>au</strong>té minéralisée, d’une belle morte, le Lévitese détourne pour trancher dans la chair du corps, et ce faisant, il la ressuscitepuisque les « membres déchirés » sont dits palpitants 40 . Cette interprétationsémantique et dialectique d’une image par l’<strong>au</strong>tre ne semble pas possible pourl’ensemble des illustrations, précisément par l’absence de représentationiconographique du corps découpé. C’est pourquoi nous pressentons que <strong>cet</strong>teabsence si prégnante a justement pour effet de trahir les limites de l’entreprisemenée par Rousse<strong>au</strong>.L’illustration qui balise chaque chant, condense, met en relief les imagesdu récit, se détourne de sa source principielle comme pour mieux en marquer lalimite. On songe <strong>au</strong>x notions d’images limites ou d’images récalcitrantes39 Le Lévite., p. 89.40 Ibid., p. 71.Textimage, Varia 3, hiver 2013 18
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »suturer, étouper selon le telos à la fois moral et esthétique d’une éducation etd’une représentation des passions. Mais c’est encore une violence faite àl’intertexte biblique dont le telos est différent et dont le style est définiessentiellement par les manques 42 . François Van Laere a déjà souligné queRousse<strong>au</strong> introduit de force le style gessnérien et le rêve arcadien « dans un récitqui le nie » 43 . L’enjeu le plus fort de la réécriture est le rapport d’infraction d’unénoncé à l’<strong>au</strong>tre. Les illustrations éclairent donc la belligérance entre plusieursstyles littéraire ainsi que la violence faite <strong>au</strong> texte biblique. Elles rendent sensibles<strong>cet</strong>te tension <strong>au</strong> cœur de la réécriture qui rêvant de transformer le plomb en or, letexte scandaleux en texte édifiant, agit par infraction.Dans <strong>cet</strong>te perspective, il se pourrait d’ailleurs que l’image absente soit<strong>au</strong>ssi l’image honteuse 44 . L’image matricielle est porteuse de <strong>cet</strong>te ambiguïté :signifiant un langage d’action, la réalisation suprême d’une parole-acte, d’unlangage agissant immédiatement sur son destinataire, à l’opposé des arguties dulogos, elle ne peut masquer qu’en même temps elle puise <strong>au</strong>x sources d’uneviolence terrible, barbare, à la limite de l’anthropophagie et dont la motivation estla vengeance. Or, la violence vengeresse est l’affect que l’ethos de Rousse<strong>au</strong>récuse catégoriquement. Quand il relate dans les Confessions l’état d’esprit deJean-Jacques rédigeant dans sa voiture un premier jet du Lévite, il met en valeurun psychisme dénué de rancune, d’aigreur, d’idées vengeresses :C’est à <strong>cet</strong>te heureuse disposition, je le sens, que je dois de n’avoir jamaisconnu <strong>cet</strong>te humeur rancunière qui fermente dans un cœur vindicatif, pour lesouvenir continuel des offenses reçues, et qui le tourmente lui-même de toutle mal qu’il voudrait faire à son ennemi. Naturellement emporté, j’ai senti lacolère, la fureur même dans les premiers mouvements ; mais jamais un désirde vengeance ne prit racine <strong>au</strong>-dedans de moi. Je m’occupe trop peu del’offense, pour m’occuper de l’offenseur 45 .42 Voir à ce propos la magistrale étude d’Erich Auerbach dans Mimésis, la représentation de laréalité dans la littérature occidentale, Paris, Gallimard, 1968.43 Fr. Van Laere, Jean-Jacques Rousse<strong>au</strong> du phantasme à l’écriture, Les révélations du Lévited’Ephraïm, Paris, Minard, Archives des Lettres Modernes, n°81, 1967.44 Voir L’Image honteuse, sous la direction de Murielle Gagnebin et Julien Milly, Seyssel, ChampVallon, 2006.45 Les Confessions, Livre XI, OC I, p. 585.Textimage, Varia 3, hiver 2013 20
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »Enfouir l’image, lui dénier le passage à la visibilité illustrative peut traduire lacrainte d’invalider son entreprise de réhabilitation <strong>au</strong>près d’<strong>au</strong>trui, de présentationde sa nature heureuse sans fiel, sans aigreur. Certes par son existence même, LeLévite est la preuve apologétique que Rousse<strong>au</strong> ne ressasse pas les événements,qu’il est capable de s’évader, de s’immerger dans un univers très éloigné dumonde réel et d’y projeter ses propres chimères, mais le choix de ce récit bibliqueest intrinsèquement problématique : d’abord, parce qu’inéluctablement, il faitretour sur l’exil de l’<strong>au</strong>teur, ensuite parce qu’il a nécessairement à voir avec lavengeance. Le Lévite à c<strong>au</strong>se de sa fonction sacerdotale n’a pas été le boucémissaire premier des barbares, l’agressivité a été détournée sur sa femme,supplément de supplément ; par réaction, il devient le vengeur, simulacre non plusdu Christ souffrant mais simulacre du Dieu vengeur. En outre, le Lévite est unvengeur ambigu : tel un ange de dieu, il agit sans affects contrôlant tous sessentiments pour n’être plus que l’instrument divin de la vengeance ; maisl’étouffement de tous ses affects, <strong>au</strong> profit d’une fureur totale, inquiète, faitpressentir les effets dirimants d’une aveugle et excessive vengeance dont lesass<strong>au</strong>ts répétés des tribus d’Israël, et la surenchère dans l’horreur, sont lamétaphore. Même si Jean-Jacques peut se définir à l’opposé du Lévite commeexempt de tout ressentiment, les deux se rejoignent dans l’acte apologétique, qu’ilpasse par le langage visuel d’une brutalité extrême ou par le détour trèssophistiqué d’un récit biblique. Même si on n’attribue <strong>au</strong>cune valeur allégorique<strong>au</strong>tobiographique <strong>au</strong> Lévite d’Ephraïm, par son existence même, il est l’acteapologétique de J.-J. : il manifeste l’absence d’esprit de vengeance. Mais à partirdu moment où l’on rentre dans la transmission, l’exposé des dommages subis, onpose bien un acte de vengeance. Le mal subi appelle réparation, destruction de lac<strong>au</strong>se du mal, ce qui passe par plaider sa propre c<strong>au</strong>se 46 . La seule façon d’éviter cecycle de la vengeance est le silence, la posture christique de Jésus sur la croix. Onvoit dans quelle aporie est piégé Rousse<strong>au</strong> mais la situation est quasimentinéluctable car le silence eût été une <strong>au</strong>tre forme de mise à mort. L’apologie est46 Voir les analyses de Jean-Luc Marion s’appuyant sur la Généalogie de la morale de Nietzche,dans Prolégomènes à la charité, Paris, éd. de la Différence, 3e édition 2007.Textimage, Varia 3, hiver 2013 21
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »vitale de même que la nécessité de ressaisir son unité sous le regard d’<strong>au</strong>trui. Lepiège éludé transparaît donc dans le choix des illustrations enfouissant l’imagegénésique comme pour masquer l’écart entre l’œuvre produite et l’image quel’<strong>au</strong>teur veut donner de lui dans sa remémoration lors des Confessions.Les décalages entre texte et image, l’inadéquation ou l’absence tendent àrévéler les tensions à l’œuvre, voire l’échec d’une œuvre que finalement Rousse<strong>au</strong>ne publiera pas. Le fait que la rédaction du Lévite ait été étalée dans le temps etprise dans le projet apologétique de l’<strong>au</strong>teur explique certainement ce retraitéditorial : trop d’enjeux, parfois contradictoires, pesaient sur ce texte qui devait àla fois consoler son <strong>au</strong>teur, le réhabiliter <strong>au</strong>près du lecteur, unifier et moraliser letexte biblique, représenter des passions vertueuses… En même temps, ce récitmarque une étape importante dans la réflexion de Rousse<strong>au</strong>. Prélude <strong>au</strong>x grandsécrits <strong>au</strong>tobiographiques, il a valeur d’expérimentation et révèle des schèmesculturels essentiels. L’image-limite, l’illustration absente, font émergerl’imaginaire topique de la dislocation, la hantise d’une désagrégation, et del’<strong>au</strong>teur et de son œuvre, avec pour symbole le corps coupé/réuni et pour pratiquela réécriture biblique.Le Lévite d’Ephraïm révèle le fondement chrétien de <strong>cet</strong>te pensée de ladislocation du corps <strong>au</strong>quel seul le regard de Dieu peut conférer l’intégrité.Rousse<strong>au</strong> trouve dans le texte biblique la mise en scène du corps commeactualisation de la chair et comme son déploiement. Pour Philippe Lefebvre dansson <strong>article</strong> « Corps des messies chez Samuel » 47 , l’ensemble de la Bible narrel’« histoire de la chair-avec-Dieu » ; plus qu’un thème, le corps ordonne, structureles Livres. La perspective chrétienne nous semble renforcer l’interprétation dudiscours biblique comme un logos à la recherche d’un corps. C’est ainsi quePhilippe Lefebvre fait le lien entre le Livre des Juges, le Livre de Samuel etl’horizon du Nouve<strong>au</strong> Testament : la trace des corps crée la continuité d’un récitl’<strong>au</strong>tre, le corps violenté et dépecé de la concubine manifeste un espace, Gibéa,qui sera la capitale de Saül (en I Samuel 10-26), premier Roi, premier Messie,47 Ph. Lefebvre, « Corps des messies chez Samuel », dans Le Corps, lieu de ce qui nous arrive,sous la direction de Pierre Gisel, Genève, Labor et Fides, 2008.Textimage, Varia 3, hiver 2013 22
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »marqué dans son corps de l’onction divine, et qui dépèce <strong>au</strong>ssi des bœufs. L’échos’étend jusqu’à Jésus héritant d’un vécu du corps humilié, mutilé, qui donnera<strong>au</strong>ssi son corps en partage afin d’aboutir à l’unité, <strong>au</strong> rassemblement du peupledes croyants. La dynamique dislocation, meurtrissure, dispersion/unification,intégrité, rassemblement innerve donc déjà le texte biblique ou du moins la lecturequ’on peut en faire. Sans croire en l’Incarnation, Rousse<strong>au</strong> met en avant à traverssa réécriture du Lévite une pensée qui doit passer par le corps pour prendre sens,mais en même temps il éprouve toutes les difficultés conjointes à un tel projet.Que signifie manifester le corps, témoigner <strong>au</strong> lieu d’imiter, faire voir pour unécrivain ? Les principales greffes du rédacteur sont les scènes visuelles et lesparoles rapportées directement. Mais nous avons observé que l’hypotypose risquede s’inverser en imitation esthétisante tandis que le discours est toujours menacéde verbiage, en devenant une langue sans corps. Les illustrations sont <strong>au</strong>ssi le lieude <strong>cet</strong>te réflexion sur la représentation du corps: corps érotiques du « jeune etbe<strong>au</strong> Lévite » et de la jeune fille « charmée [qui] caresse la tourterelle et la metdans son sein », redoublement spéculaire du piège qui mine de l’intérieurl’idyllique locus amœnus ; dans la seconde légende, corps oblatif en posturechristique « la face contre terre et les bras étendus sur le seuil » de la jeunefemme, synthétisant le sacrifice de la croix et la déposition; absence du corps de lafemme dans l’illustration suivante <strong>au</strong> profit d’une représentation rhétorique decorps éloquents ; corps à corps d’hommes gracieux et de jeunes be<strong>au</strong>tésépouvantées, les Benjaminites « s’emparant chacun de la sienne » dans la dernièreinstruction qui donne à voir non seulement un corps réuni mais un corps quis’unit. Lire les illustrations dans <strong>cet</strong>te perspective fait ressortir l’appréhensiond’une progression : le piège gémellaire du couple est transmué en rapt subsumépar la régénération d’une nation, la trans<strong>format</strong>ion se fondant sur la mortsacrificielle. Mais l’image absente ne permet pas de voir le passage de la mort à larégénération et en termes esthétiques, la dernière illustration ne fait que reprendrela représentation idéalisée de la be<strong>au</strong>té des corps. Piétinement ou manque, onpourrait souligner que Rousse<strong>au</strong> butte sur le mystère eucharistique, l’épiphanie dela présence christique, mais pour celui qui ne croit pas dans l’Eucharistie, tout seTextimage, Varia 3, hiver 2013 23
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »passe plutôt comme s’il buttait sur la difficulté de manifester de façon sensible sapensée.L’image limite permet d’appréhender <strong>cet</strong>te butée d’un <strong>au</strong>teur en quête d’unnouve<strong>au</strong> langage. Déjà dans la Lettre à d’Alembert sur les spectacles 48 , Rousse<strong>au</strong>dénonçait le leurre d’une mimesis spectaculaire fondée sur la participation enapparence sensible mais distanciée du récepteur. Jacques Rancière y voit uneétape fondatrice essentielle de la remise en question de la puissance d’imitation dela mimésis et de l’efficacité de la transmission d’un message. Loin de se focalisersur la dénonciation de la portée morale du Misanthrope ou plus largement dugenre théâtral, Jacques Rancière, dans Le Spectateur émancipé, met en avant larupture esthétique initiée :Au-delà du procès fait <strong>au</strong>x intentions d’un <strong>au</strong>teur, sa critique désignaitquelque chose de plus fondamental: la rupture de la ligne droite supposée parle modèle représentatif entre la performance des corps théâtr<strong>au</strong>x, son sens etson effet 49 .Pour Rousse<strong>au</strong>, dans la continuité de Platon, c’est le dispositif représentatiflui-même, jugé comme hypocrite, trompeur, mensonger, qui doit disparaître. Safiction narrative Le Lévite d’Ephraïm, corollaire de ses essais De l’Imitationthéâtrale et L’Essai sur l’origine des langues, est une première expérimentationlittéraire pour inventer <strong>au</strong>tre chose. Par son récit du Lévite, écrit et imagé,Rousse<strong>au</strong> essaie de transformer de l’intérieur la mimesis des passions, de créer despersonnages animés d’affects plus vraisemblables car plus proches d’un état denature et un narrateur donnant accès à leur intériorité émotionnelle et à leursmotivations afin que le lecteur puisse partager leur point de vue et ressentir aveceux. Les nombreuses scènes visuelles écrites que nous avons détaillées ainsi quele soin apporté <strong>au</strong> projet d’une édition illustrée participent de ce même défi. MaisRousse<strong>au</strong> renforce ainsi l’artifice des conventions, idylliques ou classiques etpeine à humaniser son lévite ainsi qu’à créer de la proximité avec des personnagesqui appartiennent à un tout <strong>au</strong>tre univers culturel. C’est le paradoxe de <strong>cet</strong> opus de48 Lettre à d’Alembert sur les spectacles, 1760.49 J. Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, Editions La fabrique, 2008.Textimage, Varia 3, hiver 2013 24
G. Di Rosa, « Les illustrations du Lévite d’Ephraïm de Rousse<strong>au</strong> »la concordance extrême qui par cela-même et à force d’apports d’élémentsexogènes finit par ne pas tenir ses promesses.Cependant, <strong>cet</strong> écart a pu favoriser la prise de conscience chez Rousse<strong>au</strong>de la nécessité de faire table rase de la mimésis <strong>au</strong> profit d’une écriture<strong>au</strong>tobiographique, d’une narration à la première personne, narration du témoin,qui permettrait que la langue ait du corps et soit reçue dans son intégrité. La leçondu Lévite est celle du témoin : il ne s’agit pas de se présenter coupable ou innocentà juger, mais de se manifester totalement pour que le lecteur participe de sesaffects et des prises de conscience distanciées de ses affects. Nous pourrions direque la narration <strong>au</strong>tobiographique, les Confessions notamment, sont en laboratoiredans le creuset alchimique du Lévite préparant la pensée du témoignage ainsi quele grand malentendu d’un <strong>au</strong>teur qui s’engage dans son œuvre non pour être jugé,dépecé mais compris, rassemblé. En effet, ce trope chrétien de laséparation/unification se retrouve dans ses écrits contemporains à la premièrepersonne, La Lettre à Christophe de Be<strong>au</strong>mont 50 et les Lettres écrites de lamontagne 51 énonçant <strong>cet</strong>te souffrance profonde, intime, de voir son œuvredécoupée, défigurée par les lecteurs 52 , et tendant à réunifier la personne, l’œuvreet le style grâce à une écriture <strong>au</strong>tobiographique. L’ombre portée de l’imageabsente du corps découpé s’étend <strong>au</strong>x écrits apologétiques, explicatifs oùRousse<strong>au</strong> montre la part de mutilation faite à son œuvre et tend à la ressaisie deson intégrité, en fondant son langage dans l’unicité d’un sujet offert <strong>au</strong> lecteur.50 Lettre à Christophe de Be<strong>au</strong>mont, Amsterdam, Michel Rey, 1763 (OC IV).51 Lettres écrites de la montagne, rédaction et publication 1764, Préface Alfred Dufour, L’Aged’homme, 2008.52 Dans la Lettre à Christophe de Be<strong>au</strong>mont, Rousse<strong>au</strong> met en exergue <strong>cet</strong>te dé<strong>format</strong>ion enmontrant comment l’archevêque de Paris lit la Profession de foi du vicaire savoyard. On peutpenser <strong>au</strong>ssi à l’Abbé Bergier se servant pour rédiger son Déisme réfuté par lui-même (1762 et1769) des écrits de Rousse<strong>au</strong> afin de dénoncer l’Examen critique des apologistes et leChristianisme dévoilé du Baron d’Holbach.Textimage, Varia 3, hiver 2013 25