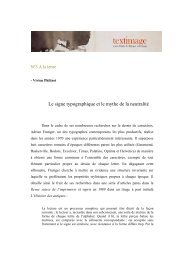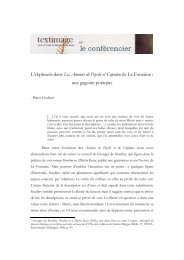L'image intradiégétique dans le récit fantastique - textimage
L'image intradiégétique dans le récit fantastique - textimage
L'image intradiégétique dans le récit fantastique - textimage
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
N°4 L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> I/II- Serge ZenkineL’image <strong>intradiégétique</strong> <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong>Dans son Discours du <strong>récit</strong> (1972), Gérard Genette a proposé d’appe<strong>le</strong>r<strong>intradiégétique</strong> un <strong>récit</strong> encadré, dont l’acte de narration fait partie desévénements d’un autre <strong>récit</strong> encadrant 1 . Quelques années plus tard, Mieke Bal aobservé que <strong>dans</strong> certains cas <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>intradiégétique</strong> peut être non seu<strong>le</strong>ment unévénement de l’histoire qui l’encadre, mais un élément de la structure actantiel<strong>le</strong>de cel<strong>le</strong>-ci, une sorte de « personnage » : ainsi <strong>le</strong>s contes de Schéhérazade seraientdes actants de sa propre histoire, qui empêchent indéfiniment l’exécution de lanarratrice, comme si un autre personnage s’y opposait 2 .La précision de Mieke Bal est importante pour notre propos, où il ne serapas question de <strong>récit</strong>s mais d’images <strong>intradiégétique</strong>s. D’ordinaire la narratologiea peu à faire avec <strong>le</strong>s images situées à l’intérieur des textes narratifs : qu’el<strong>le</strong>ssoient présentées visuel<strong>le</strong>ment (illustrations) ou représentées à travers unedescription verba<strong>le</strong> (portraits de personnages, paysages, ekphrasis, etc.), el<strong>le</strong>sconstituent des éléments non narratifs du texte, des « arrêts sur image » où <strong>le</strong> <strong>récit</strong>cesse de progresser – à moins qu’el<strong>le</strong>s n’interviennent <strong>dans</strong> l’intrigue. Or, c’estprécisément ce qu’el<strong>le</strong>s font <strong>dans</strong> certains textes qui mettent en scène des images1 Voir G. Genette, Figures III, Paris, Seuil, « Poétique », 1972, p. 238.2 Voir M. Bal, Narratologie, Paris, Klincksieck, 1977, p. 62.
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »des méta<strong>le</strong>pses 5 et, chez <strong>le</strong>s écrivains modernes, c’est un procédé courant deparadoxe et de <strong>fantastique</strong>, comme <strong>dans</strong> une nouvel<strong>le</strong> de Cortázar où <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteurd’un roman devient la victime du meurtrier, l’un des personnages de celui-ci.Mais alors <strong>le</strong> glissement méta<strong>le</strong>ptique se fait d’un <strong>récit</strong> à l’autre, profitant de <strong>le</strong>urhomogénéité. Par contre, il n’y a pas de commune mesure entre <strong>le</strong>s images<strong>intradiégétique</strong>s et <strong>le</strong>s <strong>récit</strong>s où el<strong>le</strong>s prennent place, c’est pourquoi <strong>le</strong>urinterpénétration – qui est el<strong>le</strong> aussi une sorte de méta<strong>le</strong>pse, une figure du texte –prend des formes particulièrement spectaculaires (image oblige !) etconflictuel<strong>le</strong>s 6 .Dans ce qui suit, nous allons dégager quelques aspects de ce« comportement anormal » des images <strong>intradiégétique</strong>s <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>. Onexaminera comme exemp<strong>le</strong>s cinq textes des écrivains romantiques, pour la plupartfrançais ; <strong>le</strong> corpus est certes très restreint mais représentatif ; d’autres œuvreslittéraires pourraient confirmer nos hypothèses.Le premier aspect est l’encadrement de l’image. On <strong>le</strong> sait, un thèmerécurrent du <strong>fantastique</strong> romantique est celui d’une figure représentée qui se met àbouger et à se mê<strong>le</strong>r des affaires des vivants. Historiquement, il apparaît bienavant <strong>le</strong> romantisme : on trouve <strong>dans</strong> l’hagiographie médiéva<strong>le</strong> des légendes devierges peintes ou sculptées qui s’animent, et <strong>le</strong> motif de la statue quittant sonsoc<strong>le</strong> remonte au mythe de Pygmalion et Galatée. Ce qui caractérisespécifiquement <strong>le</strong>s <strong>récit</strong>s <strong>fantastique</strong>s modernes, c’est l’accent qu’ils mettent sur<strong>le</strong> cadre qui entoure l’image <strong>intradiégétique</strong>, qui la sépare de l’espace « réel »(c’est-à-dire re<strong>le</strong>vant du niveau diégétique principal), qui prépare et diffère <strong>le</strong>contact avec el<strong>le</strong>.Les substances et <strong>le</strong>s formes des cadres sont variab<strong>le</strong>s. Ce peut être un cadreau sens propre du mot : par exemp<strong>le</strong> celui d’un tab<strong>le</strong>au acheté d’occasion au début5 Voir G. Genette, Figures III, Op. cit., p. 241 et suivantes, et du même auteur, Méta<strong>le</strong>pse. De lafigure à la fiction, Paris, Seuil, 2004.6 La méta<strong>le</strong>pse peut avoir lieu non seu<strong>le</strong>ment <strong>dans</strong> <strong>le</strong>s <strong>récit</strong>s verbaux mais éga<strong>le</strong>ment <strong>dans</strong> <strong>le</strong>sœuvres visuel<strong>le</strong>s, par exemp<strong>le</strong> chez Magritte ou Escher (voir certains artic<strong>le</strong>s du recueilMéta<strong>le</strong>pses : Entorses au pacte de la représentation, sous la direction de John Pier et Jean-MarieSchaeffer, Paris, Éditions de l’EHESS, 2005.) Avec <strong>le</strong>s images <strong>intradiégétique</strong>s <strong>fantastique</strong>s, il seproduit une méta<strong>le</strong>pse mixte, visio-verba<strong>le</strong>.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 3
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »du Portrait de Nikolaï Gogol (Portret, 1842), qui est mentionné dès la premièredescription de l’objet – « un tab<strong>le</strong>au dont l’énorme cadre, jadis magnifique, nelaissait plus apercevoir que des lambeaux de dorure » 7 – et <strong>dans</strong> <strong>le</strong>quel <strong>le</strong> nouveaupropriétaire, <strong>le</strong> peintre Tchartkov, découvre un prodigieux trésor de pièces d’or,comme si <strong>le</strong> vieil usurier représenté sur <strong>le</strong> portrait y avait déposé ces pièces dude<strong>dans</strong>. Ce peut être un piédestal, jouant en sculpture <strong>le</strong> même rô<strong>le</strong> de frontièresémiotique entre « l’art » et « la vie » que <strong>le</strong> cadre joue en peinture 8 . Ainsi <strong>le</strong>narrateur de La Vénus d’Il<strong>le</strong> de Prosper Mérimée (1837) fait preuve d’une certainebravoure quand il franchit cette frontière en grimpant irrespectueusement sur <strong>le</strong>soc<strong>le</strong> d’une statue de déesse antique : « Je m’accrochai sans trop de façon au coude la Vénus, avec laquel<strong>le</strong> je commençais à me familiariser » 9 . Ce peut être <strong>le</strong> lieuet l’ambiance où se trouve l’image <strong>intradiégétique</strong> : <strong>dans</strong> Ompha<strong>le</strong> de Théophi<strong>le</strong>Gautier (1834), la tapisserie mythologique qui va plus tard s’animer est introduitepar une description détaillée d’un vieux pavillon démodé dont el<strong>le</strong> sertd’ornement ; avec cette description, l’auteur obtient un premier effet dedépaysement. Ce peut être <strong>le</strong> temps que <strong>le</strong> héros – et <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur avec lui – met àaborder l’image : <strong>le</strong> narrateur du Portrait ova<strong>le</strong> d’Edgar Allan Poe (The OvalPortrait, 1842) demeure longtemps devant un tab<strong>le</strong>au sans l’apercevoir et, l’ayantentrevu, referme encore <strong>le</strong>s yeux pour « gagner du temps », différer laconfrontation directe avec l’image :Je lus longtemps, – longtemps ; – je contemplai religieusement, dévotement ;<strong>le</strong>s heures s’envolèrent, rapides et glorieuses. (...) Je jetai sur la peinture uncoup d’œil rapide, et je fermai <strong>le</strong>s yeux. (...) C’était un mouvement involontairepour gagner du temps et pour penser, – pour m’assurer que ma vue ne m’avaitpas trompé, – pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plusfroide et plus sûre 10 .7 N. Gogol, Nouvel<strong>le</strong>s, traduites du russe par Henri Mongault, Paris, Gallimard, s.a., p. 50.8 Sur <strong>le</strong>s fonctions sémiotiques du cadre voir <strong>le</strong>s travaux de l’éco<strong>le</strong> sémiotique de Tartu, enparticulier B. Uspenski, A Poetics of Composition : The Structure of the Artistic Text and Typologyof a Compositional Form [traduit du russe], Berke<strong>le</strong>y – Los Ange<strong>le</strong>s, University of CaliforniaPress, 1983.9 P. Mérimée, Romans et nouvel<strong>le</strong>s, t. II, Paris, Classiques Garnier, 1967, p. 99.10 E. A. Poe, Œuvres complètes, traduites par Char<strong>le</strong>s Baudelaire, Paris, Gibert Jeune, s.a., p. 275-276.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 4
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »Le « cadre » temporel, <strong>dans</strong> cette nouvel<strong>le</strong>, est doublé par un cadre spatial,formé d’autres images peintes, qui entourent <strong>le</strong> « portrait ova<strong>le</strong> » et dont <strong>le</strong>scadres matériels sont eux aussi bien évoqués :Les murs étaient tendus de tapisseries et décorés de nombreux trophéeshéraldiques de toute forme, ainsi que d’une quantité vraiment prodigieuse depeintures modernes, p<strong>le</strong>ines de sty<strong>le</strong>, <strong>dans</strong> de riches cadres d’or d’un goûtarabesque 11 .L’image bordée d’ornements et/ou d’autres images-ref<strong>le</strong>ts rappel<strong>le</strong> l’effetfascinant de la glace de Venise, très prisée par <strong>le</strong>s romantiques, notamment parGautier, qui l’évoque parmi <strong>le</strong>s meub<strong>le</strong>s du pavillon d’Ompha<strong>le</strong> (« Une guirlandede roses pompon circulait coquettement autour d’une glace de Venise » 12 ) et end’autres textes, tel Onuphrius (1832) dont <strong>le</strong> héros voit <strong>dans</strong> cette glace undiab<strong>le</strong> 13 . D’une manière généra<strong>le</strong>, la fascination ou l’état second où se trouve <strong>le</strong>personnage au rendez-vous avec une image <strong>fantastique</strong> peuvent eux-mêmes servirde « cadres » à cel<strong>le</strong>-ci : tel <strong>le</strong> sommeil de Tchartkov chez Gogol (ou, plusprécisément, une série de songes imbriqués l’un <strong>dans</strong> l’autre, qui forment autantde « cadres » pour l’apparition inquiétante de l’usurier du portrait), tel<strong>le</strong> la fièvredu narrateur de Poe, souffrant d’une b<strong>le</strong>ssure.Le statut narratif des cadres varie comme <strong>le</strong>ur substance et <strong>le</strong>ur forme :certains d’entre eux (ceux des tab<strong>le</strong>aux « réels ») sont dénotés et font partie dumonde fictionnel des personnages, tandis que d’autres (<strong>le</strong> laps de temps quiprécède l’apparition de l’image) sont réalisés au niveau de l’énonciation etressentis immédiatement par <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur. Mais ils ont la même fonction : marquer laséparation entre la figure et <strong>le</strong> fond, entre l’imaginaire et <strong>le</strong> symbolique ; cetteséparation doit être fermement posée d’abord pour être transgressée par la suite,lorsque l’image se met à bouger. Souvent formés d’autres images (ainsi l’un des« cadres » du portrait gogolien est une misérab<strong>le</strong> boutique d’art où Tchartkovdéterre cette œuvre <strong>dans</strong> un amoncel<strong>le</strong>ment de mauvaises peintures), ils11 Ibid., p. 275. Le tab<strong>le</strong>au principal, <strong>le</strong> « portrait ova<strong>le</strong> », est bien encadré lui aussi : « Le cadreétait ova<strong>le</strong>, magnifiquement doré et guilloché <strong>dans</strong> <strong>le</strong> goût moresque » (Ibid., p. 276).12 Th. Gautier, Romans, contes et nouvel<strong>le</strong>s, t. 1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,2002, p. 200. L’ornement de roses est un cadre supplémentaire qui doub<strong>le</strong> l’aura lumineuseproduite par <strong>le</strong>s facettes latéra<strong>le</strong>s de la glace.13 Voir Ibid., pp. 58-59.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 5
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »s’apparentent moins à ceux de la peinture d’aujourd’hui – de simp<strong>le</strong>s baguettesn’attirant pas l’attention – qu’aux cadres classiques, massifs et richement ornés :traçant des frontières entre « l’art » et « la vie », ils penchent eux-mêmes du côtéde « l’art ».Un cas particulièrement comp<strong>le</strong>xe d’encadrement – ou plutôt de transcadrement,de doub<strong>le</strong> contextualisation de l’image <strong>intradiégétique</strong> <strong>fantastique</strong> –est <strong>le</strong> conte de Gautier Arria Marcella (1852). Il nous présente d’abord l’image« physique » d’une femme pompéienne : une empreinte de son corps conservée<strong>dans</strong> la lave volcanique après l’éruption fata<strong>le</strong> du Vésuve ; <strong>le</strong> héros du conte, unjeune Français nommé Octavien, la visite <strong>dans</strong> un musée de Nap<strong>le</strong>s moderne(premier cadre institutionnel). La nuit d’après, se retrouvant en songe (deuxièmecadre onirique) <strong>dans</strong> Pompéi ressuscitée, Octavien traverse toute la vil<strong>le</strong> antique,en observant sa vie quotidienne, <strong>le</strong>s usages polis de ses habitants, ses spectac<strong>le</strong>sthéâtraux (troisième cadre culturel), avant de parvenir à la bel<strong>le</strong> Arria Marcellaqui lui semb<strong>le</strong> vivante mais qui est « en réalité » un simulacre magique. Toute lacivilisation antique revit pour préparer et encadrer l’épiphanie d’un corpsdésirab<strong>le</strong>, d’une image <strong>intradiégétique</strong> (fantasmatique) ; et toute l’aventured’Octavien se lit comme un cheminement d’une image à l’autre, à travers descadres consécutifs (des péripéties narratives) qui <strong>le</strong>s renferment.Le second aspect fonctionnel de l’image <strong>intradiégétique</strong> <strong>fantastique</strong>, c’estson ambiva<strong>le</strong>nce. Le plus souvent, <strong>le</strong>s <strong>récit</strong>s la motivent par <strong>le</strong> fait que l’imagereprésente une personne morte, d’une apparence séduisante mais faisant horreurcomme un cadavre. En ce sens, <strong>le</strong>s histoires d’images fascinantes et terrifiantess’inscriraient <strong>dans</strong> la tradition des mariages mythologiques avec des êtres del’autre monde, une tradition que <strong>le</strong>s romantiques ont souvent imitée <strong>dans</strong> <strong>le</strong>ursœuvres. Rien ne distinguerait alors Arria Marcella de Gautier où l’aventureamoureuse du héros est amorcée par sa rencontre avec <strong>le</strong> moulage d’un corpsféminin, du Pied de momie (1841) du même auteur, où une aventure semblab<strong>le</strong> apour début l’acquisition d’un pied de momie féminine. Cependant, un moulage ducorps est une image, et une partie du corps n’en est pas une : c’est la différenceTextimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 6
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »entre l’icône et <strong>le</strong> fétiche. Il s’agit donc de savoir en quoi consiste l’ambiva<strong>le</strong>ncespécifique de l’image.L’altérité ontologique du mort-vivant est systématiquement doublée, <strong>dans</strong><strong>le</strong>s <strong>récit</strong>s <strong>fantastique</strong>s, par une altérité culturel<strong>le</strong>. Quelquefois il s’agit d’unedifférence de religion : ainsi la Vénus d’Il<strong>le</strong>, chez Mérimée, est une ido<strong>le</strong> païenne,hosti<strong>le</strong> à la civilisation chrétienne ; el<strong>le</strong> fait peur aux paysans et dépasse <strong>le</strong>sstéréotypes allégoriques et mythologiques auxquels tente de la réduire unantiquaire borné. De même Arria Marcella, chez Gautier, est une païenne et <strong>le</strong>farouche chrétien Arrius Diomèdes, son père, la dénonce comme une « larve » 14 ,un esprit malfaisant sous l’apparence humaine. Plus souvent, l’altérité de l’imagetient à l’art qui l’a produite : en imitant <strong>le</strong> seul aspect visuel d’une personne, ilécarte son côté moral, d’où l’effet récurrent d’ambiguïté, contrastant avec laperfection esthétique de l’œuvre et la méchanceté du personnage qu’el<strong>le</strong>représente. Mérimée <strong>le</strong> dit à propos de la statue de Vénus, et d’après sadescription on comprend mieux <strong>le</strong> mécanisme structurel de cet effet :Ce n’était point cette beauté calme et sévère des sculpteurs grecs, qui, parsystème, donnaient à tous <strong>le</strong>s traits une majestueuse immobilité. Ici, aucontraire, j’observais avec surprise l’intention marquée de l’artiste de rendre lamalice arrivant jusqu’à la méchanceté. Tous <strong>le</strong>s traits étaient contractéslégèrement: <strong>le</strong>s yeux un peu obliques, la bouche re<strong>le</strong>vée des coins, <strong>le</strong>s narinesquelque peu gonflées. Dédain, ironie, cruauté, se lisaient sur ce visage d’uneincroyab<strong>le</strong> beauté cependant. En vérité, plus on regardait cette admirab<strong>le</strong> statue,et plus on éprouvait <strong>le</strong> sentiment pénib<strong>le</strong> qu’une si merveil<strong>le</strong>use beauté pûts’allier à l’absence de toute sensibilité 15 .Avec son œil de connaisseur, <strong>le</strong> narrateur de Mérimée détecte une anomaliede l’image sculptée : cette image n’est pas assez fixe, au lieu d’une « majestueuseimmobilité » classique el<strong>le</strong> affiche une grimace passionnée, qui est déjà unemenace. Tout se passe comme si la mobilité de l’image la rendait maléfique. ChezGogol, <strong>le</strong> portrait d’usurier présente lui aussi une anomalie : des yeux fascinants,dont <strong>le</strong> regard semb<strong>le</strong> sortir puissamment de la toi<strong>le</strong>. Dès la première scène du<strong>récit</strong>, ces yeux font recu<strong>le</strong>r de peur une femme du peup<strong>le</strong> (« Il regarde, il14 Ibid., t. 2, p. 311.15 P. Mérimée, Romans et nouvel<strong>le</strong>s, Op. cit., t. II, p. 97.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 7
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »regarde ! » 16 ), et ils déconcertent Tchartkov quand, après avoir rapporté <strong>le</strong> portraitchez lui, il se met à examiner son acquisition :Dans <strong>le</strong> cas présent, il ne s’agissait point d’un tour d’adresse, mais d’unphénomène étrange et qui nuisait même à l’harmonie du tab<strong>le</strong>au : <strong>le</strong> peintresemblait avoir encastré <strong>dans</strong> sa toi<strong>le</strong> des yeux arrachés à un être humain. Aulieu de la nob<strong>le</strong> jouissance qui exalte l’âme à la vue d’une bel<strong>le</strong> œuvre d’art, sirepoussant qu’en soit <strong>le</strong> sujet, on éprouvait devant cel<strong>le</strong>-ci une pénib<strong>le</strong>impression 17 .Des yeux qui bougent sur une image artificiel<strong>le</strong>, c’est un effet qui, <strong>dans</strong>Ompha<strong>le</strong> de Gautier, précède la scène où toute la figure de la bel<strong>le</strong> dame à la peaude lion d’Hercu<strong>le</strong> va s’animer et descendre de la tapisserie : « En me déshabillant,il me sembla que <strong>le</strong>s yeux d’Ompha<strong>le</strong> avaient remué (...). Je crus voir qu’el<strong>le</strong> avaitla tête tournée en sens inverse » 18 . Avant de sortir du cadre, l’image <strong>fantastique</strong>perd sa fixité, commence à « remuer », à faire des grimaces, à jeter des regards àl’extérieur. Dans sa plénitude, des points, des détails se détachent, se distinguentde la totalité et y introduisent la négativité propre au symbolique, au texte, au<strong>récit</strong>. L’image devient mouvante : un effet que la culture visuel<strong>le</strong> de l’époqueromantique recherchait <strong>dans</strong> certains types de fantasmagories, de lanternesmagiques 19 pour <strong>le</strong> perfectionner plus tard, à l’époque du cinéma. L’image senarrativise, devient « diégèse », acquiert une dimension temporel<strong>le</strong> propre au<strong>récit</strong>. Sa mise en mouvement est réalisée d’une manière origina<strong>le</strong> chez Poe : rienne bouge <strong>dans</strong> <strong>le</strong> portrait ova<strong>le</strong>, même quand il est contemplé par <strong>le</strong> narrateur enproie à la fièvre, mais l’élément narratif lui est ajouté de l’extérieur. À la fin de lanouvel<strong>le</strong>, la description du tab<strong>le</strong>au cède la place à son histoire, et de ce <strong>récit</strong> nousapprenons que <strong>le</strong> portrait a tué son modè<strong>le</strong>, la jeune épouse de l’artiste : une foisde plus, l’image se révè<strong>le</strong> être doub<strong>le</strong>, associer la beauté avec <strong>le</strong> maléfice.L’ambiva<strong>le</strong>nce de l’image <strong>intradiégétique</strong> tient donc à sa nature ambiguë :c’est une image cessant d’être une image, manifestant des traits d’une histoire16 N. Gogol, Nouvel<strong>le</strong>s, Op. cit., p. 51.17 Ibid., p. 56.18 Th. Gautier, Romans, contes et nouvel<strong>le</strong>s, Op. cit., t. 1, p. 202. Le jeune protagoniste du <strong>récit</strong>,séduit par Ompha<strong>le</strong> – autrement dit par la bel<strong>le</strong> marquise de T., représentée sous une apparencemythologique – est plutôt ému que terrifié par cette scène ; l’ambiva<strong>le</strong>nce de l’image est atténuée.19 Voir M. Milner, La Fantasmagorie : Essai sur l’optique <strong>fantastique</strong>, Paris, PUF, 1982 ; Ph.Hamon, Imageries : Littérature et image au XIXe sièc<strong>le</strong>, Paris, Corti, 2001.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 8
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »narrative. Le <strong>récit</strong> est une sorte de germe hétérogène qui pénètre <strong>dans</strong> la perfectionde l’image et qui la corrompt du de<strong>dans</strong>, comme un élément du Mal. Ensuite, cettedualité initia<strong>le</strong> peut être interprétée en termes d’évaluation secondaire, affectiveou mora<strong>le</strong>. El<strong>le</strong> sera lue comme une rupture entre <strong>le</strong> christianisme et <strong>le</strong> paganisme(La Vénus d’Il<strong>le</strong>, Arria Marcella), comme un désaccord entre l’éthique etl’esthétique (Le Portrait de Gogol et Le Portrait ova<strong>le</strong> de Poe), ou encore commel’ambiguïté d’une aventure amoureuse vécue par un ado<strong>le</strong>scent, chez qui <strong>le</strong> plaisirse mê<strong>le</strong> à la peur (Ompha<strong>le</strong>). Les deux Portraits, ceux de Gogol et de Poe,présentent un intérêt particulier en ce qu’ils introduisent l’image ambiva<strong>le</strong>nte <strong>dans</strong>une élaboration idéologique, qui s’étend <strong>dans</strong> <strong>le</strong> texte bien au-delà de l’imageproprement dite : chez Poe c’est l’histoire légendaire d’une œuvre d’art drainantvers el<strong>le</strong> la force vita<strong>le</strong> de la personne qu’el<strong>le</strong> représente, et chez Gogol, c’estl’opposition théorique d’images « bonnes » et « mauvaises » (divines etdiaboliques).Le troisième aspect des images <strong>intradiégétique</strong>s <strong>fantastique</strong>s est <strong>le</strong>urcaractère évanescent, qui peut être considéré comme une conséquence de <strong>le</strong>urinstabilité de nature. Surgissant souvent d’un milieu indéterminé (de « l’ombreprofonde » 20 , comme <strong>le</strong> portrait ova<strong>le</strong> chez Poe ; de la terre, comme la Vénusd’Il<strong>le</strong> ou l’empreinte du corps d’Arria Marcella ; d’une boutique de hasard,comme <strong>le</strong> portrait <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> de Gogol), cette image reste éphémère pourdisparaître à la fin du <strong>récit</strong>. Deux modes de disparition se distinguent : sedésintégrer et se perdre.Le simulacre magique (et onirique) d’Arria Marcella, après l’imprécationchrétienne de son père, se réduit à « une pincée de cendres mêlée de quelquesossements calcinés » 21 ; l’écrivain ne pouvait pas savoir que <strong>le</strong> même sortattendait l’autre image de la bel<strong>le</strong> Pompéienne, <strong>le</strong> moulage de son corps qui avaitété effectivement « trouvé en 1771, et effectivement visib<strong>le</strong> à l’époque où Gautier20 E. A. Poe, Œuvres complètes, Op. cit., p. 275.21 Th. Gautier, Romans, contes et nouvel<strong>le</strong>s, Op. cit., t. 2, p. 312.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 9
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »visitait Nap<strong>le</strong>s » mais qui « s’est décomposé depuis » 22 . L’évanouissement del’image annu<strong>le</strong> son ambiva<strong>le</strong>nce ; en devenant de la substance informe, l’imagephysique prouve qu’el<strong>le</strong> contenait bien un résidu matériel, neutre et irréductib<strong>le</strong>aux rapports formels. Un <strong>récit</strong> ne pourrait pas tomber en poussière, car il n’a pasde substance propre ; en revanche il n’est jamais innocent.Les choses se compliquent à la fin de La Vénus d’Il<strong>le</strong>, lorsque <strong>le</strong>s villageoisalarmés des malheurs que la statue a causés tentent de la transformer en un objetpieux :Mon ami M. de P. vient de m’écrire de Perpignan que la statue n’existe plus.Après la mort de son mari, <strong>le</strong> premier soin de Mme de Peyrehorade fut de lafaire fondre en cloche, et sous cette nouvel<strong>le</strong> forme el<strong>le</strong> sert à l’église d’Il<strong>le</strong>.Mais, ajoute M. de P., il semb<strong>le</strong> qu’un mauvais sort poursuive ceux quipossèdent ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Il<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s vignes ont gelédeux fois 23 .On voit qu’avec la statue de Vénus on n’a pas su se débarrasser de l’imageambiva<strong>le</strong>nte, et la cloche chrétienne prolonge <strong>le</strong>s méfaits de l’ido<strong>le</strong> du paganisme.Si, au début, on pouvait croire que la vio<strong>le</strong>nce de la Vénus tenait à sa formealtérée (« la malice arrivant jusqu’à la méchanceté »), après la destruction de cetteforme la vio<strong>le</strong>nce semb<strong>le</strong> passer <strong>dans</strong> sa substance (<strong>le</strong> bronze dont on a fabriquéune cloche). Pour justifier ce transfert de culpabilité – la substance matériel<strong>le</strong>n’étant plus neutre mais porteuse el<strong>le</strong>-même d’une énergie néfaste,indépendamment des formes qu’el<strong>le</strong> revêt – <strong>le</strong> <strong>récit</strong> doit recourir à des procédésspéciaux. Au niveau de l’énonciation, il l’évoque à travers un discours indirectattribué aux villageois superstitieux et par conséquent peu fiab<strong>le</strong>s ; et au niveauthématique il l’associe à une diminution presque dérisoire des dégâts : si « de sonvivant » la Vénus frappait ses victimes dramatiquement (un homme b<strong>le</strong>ssé, unautre tué, une jeune fil<strong>le</strong> devenue fol<strong>le</strong>), sa vengeance « posthume » se traduitprosaïquement par une mauvaise récolte. On l’a déjà dit, l’image <strong>intradiégétique</strong><strong>fantastique</strong> est « mauvaise » par son côté narratif, pour autant qu’el<strong>le</strong> n’est pastout à fait une image, et <strong>dans</strong> La Vénus d’Il<strong>le</strong> c’est toujours <strong>le</strong> <strong>récit</strong> qui, après la22 Th. Gautier, Œuvres, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1995, p. 1641, note de PaoloTortonese.23 P. Mérimée, Romans et contes, Op. cit., t. II, p. 118.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 10
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »suppression de l’image, prend en charge <strong>le</strong> principe du Mal tout en l’imputant,peut-être à tort, au métal de la statue.Mais souvent l’image ne se désintègre pas – el<strong>le</strong> est perdue, égarée parmid’autres objets du monde : ce qui arrive surtout <strong>dans</strong> <strong>le</strong> commerce. La tapisserieamoureuse d’Ompha<strong>le</strong>, une fois perdue de vue par <strong>le</strong> narrateur, refait surfacemomentanément chez un marchand de bric-à-brac, pour disparaître tout à faitavant d’être rachetée :Je revins avec l’argent ; la tapisserie n’y était plus. Un Anglais l’avaitmarchandée pendant mon absence, en avait donné six cents francs [deux centsfrancs plus cher] et l’avait emportée 24 .Chez Gogol l’histoire du portrait (plus précisément, deux histoires racontéesl’une après l’autre et formant un seul <strong>récit</strong>) commence et finit el<strong>le</strong> aussi <strong>dans</strong> descircuits commerciaux, d’abord sur un marché populaire de Saint-Pétersbourg oùTchartkov achète <strong>le</strong> portrait à un boutiquier ignorant, et puis au cours d’une venteaux enchères où ce même tab<strong>le</strong>au finit par disparaître mystérieusement, avant derentrer en circulation marchande.Sans achever sa phrase, <strong>le</strong> peintre [<strong>le</strong> narrateur de la seconde histoire] se tournavers <strong>le</strong> fatal portrait ; ses auditeurs l’imitèrent. Quel<strong>le</strong> ne fut pas <strong>le</strong>ur surprisequand ils s’aperçurent qu’il avait disparu ! Un murmure étouffé passa à traversla fou<strong>le</strong>, puis on entendit clairement ce mot : « Volé ! ». Tandis que l’attentionunanime était suspendue aux lèvres du narrateur, quelqu’un avait sans douteréussi à <strong>le</strong> dérober. Les assistants demeurèrent un bon moment stupides,hébétés, ne sachant trop s’ils avaient réel<strong>le</strong>ment vu ces yeux extraordinaires[ceux de l’usurier diabolique] ou si <strong>le</strong>urs propres yeux, lassés par lacontemplation de tant de vieux tab<strong>le</strong>aux, avaient été <strong>le</strong> jouet d’une vaineillusion 25 .Plusieurs motifs sont à re<strong>le</strong>ver <strong>dans</strong> ce dénouement. D’abord, la mise envente de l’image magique entraîne déjà sa disparition : avant même d’être cédée àquelqu’un, l’œuvre s’évanouit d’el<strong>le</strong>-même, et l’hypothèse d’un vol, énoncée parla voix d’on ne sait qui (« puis on entendit clairement ce mot : "Volé !" ») et avecune réserve de l’auteur (« avait sans doute réussi à <strong>le</strong> dérober »), ne sert qu’à24 Th. Gautier, Romans, contes et nouvel<strong>le</strong>s, Op. cit., t. 1, p. 207. On sait que <strong>le</strong> bric-à-brac est unlieu privilégié du monde <strong>fantastique</strong> : c’est là que <strong>le</strong> héros de La Peau de chagrin, et puis <strong>le</strong>narrateur du Pied de momie où Gautier imite <strong>le</strong> début du roman balzacien, acquièrent des objetsmagiques susceptib<strong>le</strong>s de changer <strong>le</strong>ur destin.25 N. Gogol, Nouvel<strong>le</strong>s, Op. cit., p. 107.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 11
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »rationaliser la fatalité narrative d’une « esthétique de disparition » avant la <strong>le</strong>ttre 26 .Cette hypothèse est aussi peu fiab<strong>le</strong> que la dernière phrase de la nouvel<strong>le</strong> deMérimée rapportant des propos superstitieux des habitants d’Il<strong>le</strong>. Ensuite, <strong>le</strong>portrait chez Gogol disparaît parmi « de vieux tab<strong>le</strong>aux », <strong>dans</strong> la masse d’autresimages (d’où el<strong>le</strong> avait été tirée, lors de son achat au marché), rejoignant <strong>le</strong> jeu desubstitutions symboliques où une œuvre en renvoie à d’autres. Enfin, l’imageartistique, ayant un cadre, une longue histoire et probab<strong>le</strong>ment un prix, finit parperdre toute matérialité et devenir une « illusion » éphémère (<strong>dans</strong> l’originalrusse, metchta, « rêve »). Tout se passe comme si <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, de son mouvementpropre, ruinait <strong>le</strong>s images, <strong>le</strong>s arrachait à la place fixe qu’el<strong>le</strong>s occupaient, <strong>le</strong>uren<strong>le</strong>vait l’être stab<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s réduisait à de purs simulacres, aux « rêves » d’un espritplus ou moins troublé. C’est ainsi que Poe, <strong>dans</strong> Le Portrait ova<strong>le</strong>, fait suivrel’image fascinante d’un <strong>récit</strong> qui raconte la création de cette image et où cel<strong>le</strong>-cicesse d’être visib<strong>le</strong>, disparaît en tant qu’image.* * *Il est temps de formu<strong>le</strong>r quelques conclusions, accompagnées de quelquesréserves.1. Tous <strong>le</strong>s trois aspects du fonctionnement narratif des images<strong>fantastique</strong>s concourent à <strong>le</strong>s doter d’une va<strong>le</strong>ur sacrée. En effet, l’encadrementdénote la mise à part d’une image, range cel<strong>le</strong>-ci <strong>dans</strong> la catégorie des objetsréservés, du « tout autre » ; l’ambiva<strong>le</strong>nce de ces objets (attraction/répulsion) estune propriété constamment évoquée <strong>dans</strong> <strong>le</strong>s études du sacré 27 ; enfin,l’évanescence de l’image <strong>fantastique</strong> l’apparente à une classe spécia<strong>le</strong> dephénomènes du sacré, <strong>le</strong> numineux, que la réf<strong>le</strong>xion post-heideggerienneréinterprète en termes d’épiphanies instantanées de « l’Être » ou de la26 Voir P. Virilio, Esthétique de la disparition, Paris, Galilée, 1989.27 Voir <strong>le</strong>s études classiques : É. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris,Alcan, 1912 ; R. Otto, Le Sacré : L’élément non rationnel <strong>dans</strong> l’idée du divin et sa relation avec<strong>le</strong> rationnel, Paris, Payot & Rivages, 1995 (première édition al<strong>le</strong>mande – 1918).Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 12
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »« présence » 28 . Le <strong>fantastique</strong> en littérature est une forme moderne et esthétisée dusacré, et l’image <strong>intradiégétique</strong>, grâce à son altérité de nature par rapport au <strong>récit</strong>où el<strong>le</strong> s’incruste, est particulièrement adaptée à cette fonction. Il s’agit bien d’unsacré non religieux, ne re<strong>le</strong>vant d’aucun culte ni d’aucune tradition spirituel<strong>le</strong> ; <strong>le</strong>stextes qu’on vient d’analyser ont été délibérément choisis pour illustrer ce fait. Siune image devient sacrée <strong>dans</strong> un <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong>, c’est grâce à un jeu deprocédés narratifs qui tendent à mettre en relief la tension entre la stabilité et laplénitude substantiel<strong>le</strong> de l’image et la discontinuité formel<strong>le</strong> du <strong>récit</strong>, engagé<strong>dans</strong> des processus d’échange et de développement temporel.2. La mise en <strong>récit</strong> d’une image entraîne sa mutation : l’image extérieure,fixée sur un support matériel (toi<strong>le</strong>, bronze, etc.), devient une image intérieure,purement menta<strong>le</strong>. Ainsi, l’image physique mais « encadrée » d’expériencespsychiques (rêve, délire, etc.) est renvoyée el<strong>le</strong> aussi au domaine desreprésentations menta<strong>le</strong>s ; <strong>le</strong>s sentiments ambigus qu’el<strong>le</strong> suscite tendentéga<strong>le</strong>ment à la mettre sur <strong>le</strong> même plan mental que ces émotions ; et ens’évanouissant el<strong>le</strong> perd toute consistance sensib<strong>le</strong> pour s’assimi<strong>le</strong>r à un « rêve ».Le cas d’Arria Marcella est exemplaire, où l’héroïne passe de l’état de moulagebien matériel à celui de figure fantasmatique d’un songe. Le destin de l’image<strong>intradiégétique</strong> se joue donc, <strong>dans</strong> <strong>le</strong>s <strong>récit</strong>s <strong>fantastique</strong>s, entre deux acceptions dumot image : « représentation matériel<strong>le</strong> » / « représentation menta<strong>le</strong> » ; et <strong>le</strong>stextes qui réalisent ce jeu se présentent eux aussi sous deux aspects : comme desdescriptions de formes et d’événements extérieurs et comme des évocations detroub<strong>le</strong>s intérieurs. La présente étude se veut sémiotique et ne s’applique qu’aupremier aspect : par méthode, el<strong>le</strong> décrit <strong>le</strong> fonctionnement de l’image<strong>intradiégétique</strong> comme une collision de deux modes de représentation, mimétiqueet diégétique. Se limitant à l’analyse objective des textes, el<strong>le</strong> fait peu de cas duvécu des spectateurs supposés (c’est-à-dire des personnages du <strong>récit</strong>) et des« spectateurs » effectifs (qui sont en réalité des <strong>le</strong>cteurs) de l’image<strong>intradiégétique</strong>. Leur expérience d’images « animées », changeantes et influentes,28 Voir H.U. Gumbrecht, Production of Presence : What Meaning Cannot Convey, StanfordUniversity Press, 2004.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 13
Serge Zenkine, « L’image intra-diégétique <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong> <strong>fantastique</strong> »manifestant des affinités inattendues avec <strong>le</strong>s hommes qui <strong>le</strong>s regardent ou y sontreprésentés – une expérience existentiel<strong>le</strong> et esthétique à la fois, qui s’impose à laréf<strong>le</strong>xion et à la figuration <strong>dans</strong> la culture moderne – constitue l’aspectphénoménologique du problème et pourrait faire l’objet d’une autre recherche.3. Historiquement, <strong>le</strong>s traits qu’on a dégagés <strong>dans</strong> <strong>le</strong>s <strong>récit</strong>s <strong>fantastique</strong>sne <strong>le</strong>ur sont pas tout à fait spécifiques, et peuvent se rapporter à d’autres images<strong>intradiégétique</strong>s. Citons un seul contre-exemp<strong>le</strong> : Le Chef-d’œuvre inconnu deBalzac (1831), un <strong>récit</strong> qui n’est pas <strong>fantastique</strong> (il ne s’y passe rien qui puisseêtre vu comme vraiment « irréel ») mais qui réunit tous <strong>le</strong>s trois aspects del’image <strong>intradiégétique</strong> <strong>fantastique</strong>. Fonctionnant comme un « cadre » narratif,son texte nous sépare longtemps d’un tab<strong>le</strong>au mystérieux, en soulignant du mêmecoup la va<strong>le</strong>ur de ce dernier ; <strong>le</strong> héros du <strong>récit</strong> investit toutes ses forces <strong>dans</strong> laconfection de son chef-d’œuvre, qui joue un rô<strong>le</strong> ambiva<strong>le</strong>nt <strong>dans</strong> sa vie enl’inspirant et en l’aliénant à la fois jusqu’à causer sa ruine mora<strong>le</strong> ; fina<strong>le</strong>ment,cette image qui devait être parfaite s’évanouit comme une illusion, ne laissant auxspectateurs du tab<strong>le</strong>au que la vue d’un gâchis de substances colorées. L’existencedes contre-exemp<strong>le</strong>s de cette sorte n’invalide pas la pertinence de l’analyse qu’onvient de faire, mais el<strong>le</strong> laisse supposer que <strong>le</strong>s <strong>récit</strong>s <strong>fantastique</strong>s de l’époqueromantique ne font qu’exemplifier d’une manière particulièrement évidente uneconfiguration visio-textuel<strong>le</strong> plus généra<strong>le</strong> qui se retrouve, probab<strong>le</strong>ment sous desformes variées, en d’autres genres et en d’autres arts (tel <strong>le</strong> cinéma). L’analyse deces formes relève el<strong>le</strong> aussi d’une étude à faire.Textimage, L’image <strong>dans</strong> <strong>le</strong> <strong>récit</strong>, printemps 2011 14