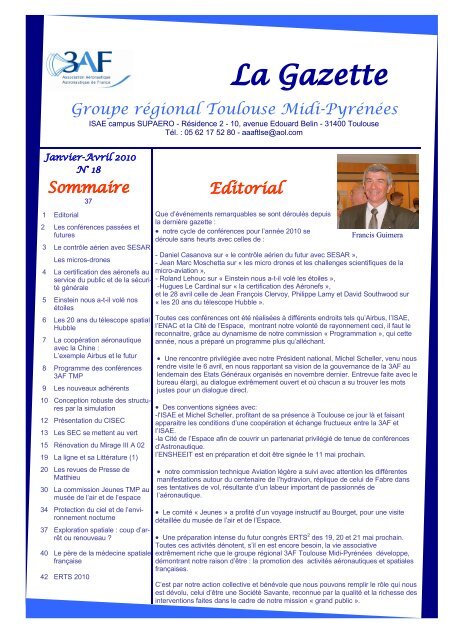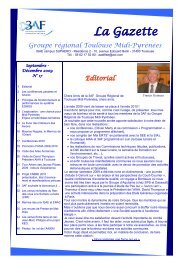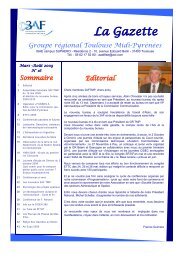Télécharger la Gazette n°18 (10 MO) - 3AF Toulouse Midi-Pyrénées
Télécharger la Gazette n°18 (10 MO) - 3AF Toulouse Midi-Pyrénées
Télécharger la Gazette n°18 (10 MO) - 3AF Toulouse Midi-Pyrénées
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La <strong>Gazette</strong>Groupe rÄgional <strong>Toulouse</strong> <strong>Midi</strong>-PyrÄnÄesISAE campus SUPAERO - RÅsidence 2 - <strong>10</strong>, avenue Edouard Belin - 31400 <strong>Toulouse</strong>TÅl. : 05 62 17 52 80 - aaaftlse@aol.comJanvier-Avril 20<strong>10</strong>NÄ 18Sommaire371 Editorial2 Les confÅrences passÅes etfutures3 Le contrÑle aÅrien avec SESARLes micros-drones4 La certification des aÅronefs auservice du public et de <strong>la</strong> sÅcuritÅgÅnÅrale5 Einstein nous a-t-il volÅ nosÅtoiles6 Les 20 ans du tÅlescope spatialHubble7 La coopÅration aÅronautiqueavec <strong>la</strong> Chine :L’exemple Airbus et le futur8 Programme des confÅrences<strong>3AF</strong> TMP9 Les nouveaux adhÅrents<strong>10</strong> Conception robuste des structurespar <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion12 PrÅsentation du CISEC13 Les SEC se mettent au vert15 RÅnovation du Mirage III A 0219 La ligne et sa LittÅrature (1)20 Les revues de Presse deMatthieu30 La commission Jeunes TMP aumusÅe de l’air et de l’espace34 Protection du ciel et de l’environnementnocturne37 Exploration spatiale : coup d’arrâtou renouveau ?40 Le pÇre de <strong>la</strong> mÅdecine spatialefranÜaise42 ERTS 20<strong>10</strong>EditorialQue d’ÅvÅnements remarquables se sont dÅroulÅs depuis<strong>la</strong> derniÇre gazette : notre cycle de confÅrences pour l’annÅe 20<strong>10</strong> sedÅroule sans heurts avec celles de :Francis Guimera- Daniel Casanova sur É le contrÑle aÅrien du futur avec SESAR Ö,- Jean Marc Moschetta sur É les micro drones et les challenges scientifiques de <strong>la</strong>micro-aviation Ö,- Ro<strong>la</strong>nd Lehouc sur É Einstein nous a-t-il volÅ les Åtoiles Ö,-Hugues Le Cardinal sur É <strong>la</strong> certification des AÅronefs Ö,et le 28 avril celle de Jean FranÜois Clervoy, Philippe Lamy et David Southwood surÉ les 20 ans du tÅlescope Hubble Ö.Toutes ces confÅrences ont ÅtÅ rÅalisÅes á diffÅrents endroits tels qu’Airbus, l’ISAE,l’ENAC et <strong>la</strong> CitÅ de l’Espace, montrant notre volontÅ de rayonnement ceci, il faut lereconnaitre, gràce au dynamisme de notre commission É Programmation Ö, qui cetteannÅe, nous a prÅparÅ un programme plus qu’allÅchant. Une rencontre privilÅgiÅe avec notre PrÅsident national, Michel Scheller, venu nousrendre visite le 6 avril, en nous rapportant sa vision de <strong>la</strong> gouvernance de <strong>la</strong> <strong>3AF</strong> aulendemain des Etats GÅnÅraux organisÅs en novembre dernier. Entrevue faite avec lebureau Å<strong>la</strong>rgi, au dialogue extrâmement ouvert et oä chacun a su trouver les motsjustes pour un dialogue direct. Des conventions signÅes avec:-l'ISAE et Michel Scheller, profitant de sa prÅsence á <strong>Toulouse</strong> ce jour lá et faisantapparaitre les conditions d’une coopÅration et Åchange fructueux entre <strong>la</strong> <strong>3AF</strong> etl’ISAE.-<strong>la</strong> CitÅ de l’Espace afin de couvrir un partenariat privilÅgiÅ de tenue de confÅrencesd’Astronautique.l’ENSHEEIT est en prÅparation et doit âtre signÅe le 11 mai prochain. notre commission technique Aviation lÅgÇre a suivi avec attention les diffÅrentesmanifestations autour du centenaire de l’hydravion, rÅplique de celui de Fabre dansses tentatives de vol, rÅsultante d’un <strong>la</strong>beur important de passionnÅs del’aÅronautique. Le comitÅ É Jeunes Ö a profitÅ d’un voyage instructif au Bourget, pour une visitedÅtaillÅe du musÅe de l’air et de l’Espace. Une prÅparation intense du futur congrÇs ERTS 2 des 19, 20 et 21 mai prochain.Toutes ces activitÅs dÅnotent, s’il en est encore besoin, <strong>la</strong> vie associativeextrâmement riche que le groupe rÅgional <strong>3AF</strong> <strong>Toulouse</strong> <strong>Midi</strong>-PyrÅnÅes dÅveloppe,dÅmontrant notre raison d’âtre : <strong>la</strong> promotion des activitÅs aÅronautiques et spatialesfranÜaises.C’est par notre action collective et bÅnÅvole que nous pouvons remplir le rÑle qui nousest dÅvolu, celui d’âtre une SociÅtÅ Savante, reconnue par <strong>la</strong> qualitÅ et <strong>la</strong> richesse desinterventions faites dans le cadre de notre mission É grand public Ö.
2Les confÄrencespassÄes etfutures
3Le contrÅle aÄrien avec SESARDaniel CASANOVA, SNA Sud,Laurent TEISSIER, ENACMalgrÅ une nature cyclique bien connue, sa croissance sur le long terme s’est affirmÅe: le trafic aÅrien mondialcroãt annuellement de 4 á 5%.Le transport aÅrien mondial fait face á une impasse annoncÅe: Le systÇme de gestionde trafic aÅrien tel qu’il existe actuellement ne pourra pas absorber cette croissance á l’horizon 2013 dans leszones á haute densitÅ de trafic que sont l’Europe et les Etats-Unis et á court terme l’Extrâme Orient.A travers l’outil lÅgis<strong>la</strong>tif, l’Europe et les Etats Unis ont dÅcidÅ de rÅpondre á ce double dÅfi par un programme ambitieuxde modernisation du systÇme de gestion du trafic aÅrien á l’Åchelle continentale á long terme (2020-2025)jouant tous deux <strong>la</strong> carte du partenariat public privÅ et concentrantles ressources disponibles vers <strong>la</strong> rÅalisation d’une vision du traficaÅrien. Les Etats Unis ont <strong>la</strong>ncÅ en 2003 le programme NextGen(Next Generation Air transportation System). En 2004, <strong>la</strong> CommissionEuropÅenne a <strong>la</strong>ncÅ SESAR (Single European Sky Air trafficmanagement Research) le volet technologique de sa politique globaledite ciel unique.SESAR est un concept opÅrationnel ‘De <strong>la</strong> porte d’embarquementá <strong>la</strong> porte d’embarquement’ : l’avion y constituant <strong>la</strong> rÅfÅrence maisconservant l’humain au cœur du systÇme. Il vise á rÅaliser des objectifsambitieux de haut niveau: capacitÅ du systÇme triplÅ, niveaude sÅcuritÅ multipliÅ par <strong>10</strong>, coét divisÅ par 2, empreinte environnementale rÅduite de <strong>10</strong>%.Le cœur du concept est <strong>la</strong> mise en œuvre d’une trajectoire contractuelle nÅgociÅe au prÅa<strong>la</strong>ble entre l’ensembledes acteurs sol et bord en 4 dimensions, i.e. avec une contrainte temporelle permettant de s’affranchir ou dumoins de minimiser les limitations de capacitÅ que l’incertitude en temps et volume sur les trajectoires suivies gÅnÇredans le systÇme actuel. Pour permettre l’Å<strong>la</strong>boration de cette trajectoire optimale tenant compte des besoinset contraintes de chacun SESAR s’appuiera sur un certain nombre d’avancÅes technologiques : numÅrisation, automatisation,et fiabilisation des Åchanges, systÇmes de gestion du vol, du trafic aÅrien et des flottes compagnieplus performants sur <strong>la</strong> dimension temporelle et coopÅratifs.Les micro-drones : Les challengesscientifiques de <strong>la</strong> micro-aviationJean-Marc <strong>MO</strong>SCHETTA, ISAELa miniaturisation des systÇmes et des sources d’Ånergie a permis l’essor de systÇmes aÅriens miniatures pourrÅaliser des missions de surveil<strong>la</strong>nce ou de prises de vue aÅrienne dans des zones difficiles d’accÇs ou rÅputÅesdangereuses. Ces missions de renseignements reprÅsentent un intÅrât Åvident pour les opÅrations militaires oude gendarmerie mais Ågalement pour un grand nombre d’applications civiles qui seront illustrÅes au cours de cetteconfÅrence. Sur le p<strong>la</strong>n scientifique et technique, <strong>la</strong> conception de micro-aÅronefs ne dÅpassant pas le mÇtre,voire <strong>la</strong> dizaine de centimÇtres doit âtre revue entiÇrement en raison de l’apparition de nombreuses difficultÅs physiquesspÅcifiques : Chute des rendements propulsifs, dÅgradation des coefficients aÅrodynamiques, accroissementde <strong>la</strong> sensibilitÅ des aÅronefs aux conditions aÅrologiques, etc.L’exposÅ a dÅbutÅ par l’analyse physique des effets spÅcifiquesau domaine des micro-drones et proposera un premier essai dec<strong>la</strong>ssification en fonction des missions confiÅes á ces systÇmes.De nombreuses illustrations ont ensuite ÅtÅ donnÅes á partir desprojets menÅs notamment á l’Institut SupÅrieur de l’AÅronautiqueet de l’Espace (ISAE) depuis de nombreuses annÅes, que ce soitdans le domaine des calcu<strong>la</strong>teurs embarquÅs ou dans le domainedes cellules de micro-drones. Ainsi, des configurations de nanodrones(Åchelle centimÅtrique) á un nouveau projet de mini-dronelongue endurance, en passant par des concepts de micro-dronesconvertibles, seront exposÅs et discutÅs.
5En partenariat avec <strong>la</strong> CitÅ de l’EspaceEinstein nous a-t-il volÄ nos Ätoiles ?Ro<strong>la</strong>nd LEHOUCQLe 21Çme siÇcle verra se multiplier les dÅcouvertes d’exo-p<strong>la</strong>nÇtes É proches Ö, c'est-á-dire á moins de 250annÅes-lumiÇre de notre systÇme so<strong>la</strong>ire. Il est tout á fait probable que l’amÅlioration des mÅthodes d’observationdepuis <strong>la</strong> Terre permettra d’en identifier quelques unes considÅrÅes comme habitables, c'est-á-dire susceptiblesd’abriter <strong>la</strong> vie basÅe sur <strong>la</strong> chimie du carbone.Il serait alors tentant d’aller vÅrifier ces informations in-situ. Mais le voyage interstel<strong>la</strong>ire pose des problÇmesinfiniment plus ardus que le voyage interp<strong>la</strong>nÅtaire. Plusieurs solutions sont pourtant imaginables, sans pourautant prÅsenter une grande crÅdibilitÅ en dehors des romans de Science-Fiction : Le voyage á vitesse ÅlevÅetout en restant non-re<strong>la</strong>tiviste (~ 0,1 c), le voyage á vitesse re<strong>la</strong>tiviste avec les caprices de l’espace-temps(paradoxe de Langevin, …), et le voyage á vitesse supraluminique ou quasi-instantanÅ.Un voyage effectuÅ au dixiÇme de <strong>la</strong> vitesse de <strong>la</strong> lumiÇre (vitesse non re<strong>la</strong>tiviste) vers l’Åtoile <strong>la</strong> plus proche denous, Proxima Centauri, distante de 4 annÅes-lumiÇre environ, nÅcessiterait 40 ans pour un passage á proximitÅá grande vitesse et sensiblement le double pour une arrivÅe á faible vitesse dans le systÇme du Centaure (2500 et 5 000 ans pour 250 annÅes-lumiÇre). Pour arriver á une telle vitesse et survivre á un aussi long voyage,les technologies actuelles sont soit inadaptÅes, soit constituent des impasses. L’Åtude DAEDALUS (British Interp<strong>la</strong>netarySociety) basÅe sur un systÇme de fusion pulsÅe á confinement inertiel (non maitrisÅ au sol)conduit pour un vÅhicule non habitÅ effectuant un aller simple avec passage á vitesse maximum, á un engin deplus de 50 000 tonnes ( 500 petites tonnes de charge-utile). Diverses variantes ont ÅtÅ imaginÅes pour pallier <strong>la</strong>durÅe des voyages, comme les vaisseaux de migrants, l’animation suspendue, <strong>la</strong> prolongation de <strong>la</strong> vie humaine,ou l’envoi d’embryons congelÅs.Le voyage á vitesse re<strong>la</strong>tiviste, pour allÅchant qu’il paraisse, apparait comme inaccessible avec <strong>la</strong> physiqueactuelle notamment au niveau de l’Ånergie nÅcessaire.Enfin le voyage supraluminique, voire instantanÅ, repose sur deux approches purement conceptuelles pour lesquellesil n’existe actuellement pas le moindre ÅlÅment de preuve : <strong>la</strong> distorsion de l’espace-temps (Einstein-Rosen et mÅtrique d’Alcubierre) et les É trous de ver Ö version moderne du sub-espace (ou hyperespace) cheraux auteurs de science-fiction.L’avenir du voyage interstel<strong>la</strong>ire parait aujourd’hui pour le moins incertain, et pour nos gÅnÅrations, impossible !
6En partenariat avec <strong>la</strong> CitÅ de l’espaceLES 20 ANS DU TELESCOPE SPATIAL HUBBLENouveau Film IMAXÇ É HUBBLE 3D ÑObservations du cielÉ TOP <strong>10</strong> Ñ des plus belles images - Ambiance musicale violon et altoRencontres et dÄbats avec :David SouthwoodDirecteur scientifique et de l’exploration robotique de l’ESA (Agence Spatiale EuropÅenne)Jean FranÖois ClervoyAstronaute de l’ESA, ayant É tenu Ö le tÅlescope á bout de brasPhilippe LamyAstronome á l’Observatoire d’Astronomie de Marseille ProvenceThierry ContiniAstrophysicien á l’OMP (Observatoire <strong>Midi</strong>-PyrÅnÅes) á <strong>Toulouse</strong>Colleen SharkeyRe<strong>la</strong>tions publiques et Education á l’ESO - Coordinatrice RP du Hubble Space TÅlescope pour l’ESAÉ Le 24 avril 1990, Il y a 20 ans, <strong>la</strong> navette spatiale amÅricainemettait en orbite un tÅlescope rÅvolutionnaire ádouble titre. D’une part il s’agissait du premier trÇs grandtÅlescope spatial du domaine visible, d’autre part il ÅtaitdestinÅ á âtre maintenu, rÅguliÇrement rÅparÅ en orbitepar des astronautes. Cette derniÇre caractÅristique futfinalement dÅterminante quand <strong>la</strong> NASA s’aperÜu troptard que son miroir comportait un dÅfaut majeur ! Nonseulement elle put rÅparer les choses mais les diffÅrentesmissions de service du tÅlescope, 5 au total*, amÅliorÇrenten permanence ses performances, pourtant dÅjáexceptionnelles… La derniÇre mission de service dutÅlescope s’est dÅroulÅe en 2009, mission au cours de<strong>la</strong>quelle les astronautes filmÇrent leur travail gràce á <strong>la</strong>camÅra IMAX 3D. Ils s’entrainÇrent pendant 18 mois á <strong>la</strong>manipuler. La CitÅ de l’espace, dÇs avril 20<strong>10</strong>, diffuseradonc le tout nouveau film Imax É Hubble 3D Ö. Au-deládes images toujours spectacu<strong>la</strong>ires des astronautesdans l’espace, ce film retracera l’ÅpopÅe et les grandesrÅussites du tÅlescope. Un film sur Åcran gÅant qui vousfera voyager en 3 dimensions dans les ciels Åpoustouf<strong>la</strong>ntset colorÅs, chargÅs de Ga<strong>la</strong>xies, d’Åtoiles, de p<strong>la</strong>nÇtes…Comment ne pas croire qu’il s’y cachent desmilliers ou des millions de mondes vivants! Hubble, parses extraordinaires rÅsultats en ce qui concerne <strong>la</strong> naissancedes Åtoiles, l’Univers profond, a aussi, á sa maniÇre,participÅ á cette quâte renouvelÅe de l’origine de <strong>la</strong>Vie…L’Europe, au travers notamment de l’ESA et l’ESO, apris une part trÇs importante dans le programme Hubble.Comment travaille-t-on avec un tÅlescope orbital, commentcoordonne-t-on <strong>la</strong> recherche ? Qui dÅcide de quoi ?Quelle est sa p<strong>la</strong>ce par rapport aux tÅlescopes terrestres,qui, eux aussi, ont beaucoup progressÅ ? Autant de questions auxquelles nos confÅrenciers, acteurs de cetterÅussite, tenteront de rÅpondre.
7Le 5 mai 20<strong>10</strong> Ü 18h,en partenariat avec <strong>Toulouse</strong> Business SchoolLa coopÄration aÄronautique avec <strong>la</strong> Chine :L’exemple AIRBUSLe futurprÄsentÄe parDaniel THERIAL, RetraitÄ AIRBUS,ancien Senior Vice-PrÄsident, CoopÄration Internationale(en charge notamment des re<strong>la</strong>tions avec <strong>la</strong> Chine)Cette prÅsentation montrera le lien existant entre le niveau de coopÅration industrielle aÅronautique et les commandesd'avions civils en prenant l'expÅrience AIRBUS depuis 1985. Un zoom sera fait sur <strong>la</strong> chaine de montage A320installÅe á Tianjin de faÜon á dÅmystifier le sujet et essayer de rÅpondre de faÜon positive au souci de transfert deknow how que certains se posent. Enfin quelques p<strong>la</strong>nches montreront pourquoi le gouvernement chinois a dÅcidÅde <strong>la</strong>ncer le programme de dÅveloppement "national' de l'avion de 150 p<strong>la</strong>ces, appelÅ le C919, ainsi que les questionsliÅes á sa compÅtition future avec Airbus et Boeing.L'opportunitÅ de coopÅration pour les fournisseurs occidentaux,mais aussi les risques associÅs seront Ågalement prÅsentÅs.La CoopÄration aÄronautiqueavec <strong>la</strong> Chine-L’exemple Airbus- Le futur1
Inbreeding effects on sperm production in c<strong>la</strong>m shrimp 133Ellmer, M. and Andersson, S. 2004. Inbreeding depression in Nigel<strong>la</strong> degenii (Ranuncu<strong>la</strong>ceae):fitness components compared with morphological and phenological characters. Int. J. P<strong>la</strong>nt Sci.,165: <strong>10</strong>55–<strong>10</strong>61.Fritzsche, P., Neumann, K., Nasdal, K. and Gattermann, R. 2006. Differences in reproductivesuccess between <strong>la</strong>boratory and wild-derived golden hamsters (Mesocricetus auratus) as aconsequence of inbreeding. Behav. Ecol. Sociobiol., 60: 220–226.Gage, M.J.G., Surridge, A.K., Tomkins, J.L., Green, E., Wiskin, L., Bell, D.J. et al. 2006. Reducedheterozygosity depresses sperm quality in wild rabbits, Orycto<strong>la</strong>gus cuniculus. Curr. Biol., 16:612–617.G<strong>la</strong>ettli, M. and Goudet, J. 2006. Inbreeding effects on progeny sex ratio and gender variation in thegynodioecious Silene vulgaris (Caryophyl<strong>la</strong>ceae). New Phytol., 172: 763–773.Good-Avi<strong>la</strong>, S.V., Nagel, T., Vogler, D.W. and Stephenson, A.G. 2003. Effects of inbreeding onmale function and self-fertility in the partially self-incompatible herb Campanu<strong>la</strong> rapunculoides(Campanu<strong>la</strong>ceae). Am. J. Bot., 90: 1736–1745.Husband, B.C. and Schemske, D.W. 1996. Evolution of the magnitude and timing of inbreedingdepression in p<strong>la</strong>nts. Evolution, 50: 54–70.Jarne, P. and Auld, J.R. 2006. Animals mix it up too: the distribution of self-fertilization amonghermaphroditic animals. Evolution, 60: 1816–1824.Jarne, P. and Charlesworth, D. 1993. The evolution of the selfing rate in functionally hermaphroditep<strong>la</strong>nts and animals. Annu. Rev. Ecol. Syst., 24: 441–466.Johannsson, M.H., Gates, M.J. and Stephenson, A.G. 1998. Inbreeding depression affects pollenperformance in Cucurbita texana. J. Evol. Biol., 11: 579–588.Lamunyon, C.W. and Ward, S. 1995. Sperm precedence in a hermaphroditic nematode (Caenorhabditiselegans) is due to competitive superiority of male sperm. Experientia, 51: 817–823.Margulis, S.W. and Walsh, A. 2002. The effects of inbreeding on testicu<strong>la</strong>r sperm concentration inPeromyscus polionotus. Reprod. Fertil. Develop., 14: 63–67.Nakahara, M. and Tsubaki, Y. 2008. Sperm mortality, insemination and fertilization in thedamselfly Ischnura senegalensis: comparisons between wild and inbred popu<strong>la</strong>tions. J. Ethol.,26: 145–151.Rausher, M.D. and Chang, S.M. 1999. Stabilization of mixed-mating systems by differences inthe magnitude of inbreeding depression for male and female fitness components. Am. Nat., 154:242–248.Richardson, B.J., Baverstock, P.R. and Adams, M. 1986. Allozyme Electrophoresis: A Handbook forAnimal Systematics and Popu<strong>la</strong>tion Studies. New York: Academic Press.Roff, D.A. 2002. Inbreeding depression: tests of the overdominance and partial dominancehypotheses. Evolution, 56: 768–775.Roldan, E.R.S., Cassinello, J., Abaigar, T. and Gomendio, M. 1998. Inbreeding, fluctuatingasymmetry, and ejacu<strong>la</strong>te quality in an endangered ungu<strong>la</strong>te. Proc. R. Soc. Lond. B, 265: 243–248.SAS Institute. 2003. JMP Statistical Software. Cary, NC: SAS Institute, Inc.Sassaman, C. and Weeks, S.C. 1993. The genetic mechanism of sex determination in the conchostracanshrimp Eulimnadia texana. Am. Nat., 141: 314–328.Schemske, D.W. and Lande, R. 1985. The evolution of self-fertilization and inbreeding depression inp<strong>la</strong>nts. 2. Empirical observations. Evolution, 39: 41–52.Schrempf, A., Aron, S. and Heinze, J. 2006. Sex determination and inbreeding depression in an antwith regu<strong>la</strong>r sib-mating. Heredity, 97: 75–80.Vidrine, M.F., Sissom, S.L. and McLaughlin, R.E. 1987. Eulimnadia texana Packard (Conchostraca,Limnadiidae) in rice fields in southwestern Louisiana. Southw. Nat., 32: 1–4.Weeks, S.C. 2004. Levels of inbreeding depression over seven generations of selfing in the androdioeciousc<strong>la</strong>m shrimp, Eulimnadia texana. J. Evol. Biol., 17: 475–484.Weeks, S.C. and Benvenuto, C. 2008. Mate guarding in the androdioecious c<strong>la</strong>m shrimp Eulimnadiatexana: male assessment of hermaphrodite receptivity. Ethology, 114: 64–74.
<strong>10</strong>COMMISSION STRUCTURES23/02/20<strong>10</strong>Synthàse de <strong>la</strong> JournÄe ScientifiqueÉConception robuste des structures par <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tionÑ12 Novembre 2009AIRBUS, <strong>Toulouse</strong>Dominique Barthe (Airbus)La conception de produits aÅronautiques et spatiaux innovants est rÅalisÅe avec une volontÅ trÇsforte de rÅduction des coéts et des cycles de dÅveloppement. La robustesse du processus de dÄveloppement,c'est-á-dire sa rÄsilience vis-á-vis des alÅas du programme et des variabilitÅs de toute sorte,est donc une qualitÅ trÇs recherchÅe sur le p<strong>la</strong>n industriel afin de faire converger le dÅveloppementdans les coâts et dÄ<strong>la</strong>is prescrits sur le produit attendu.La journÅe thÅmatique ‘Conception Robuste’ de <strong>la</strong> Commission Structures de <strong>la</strong> <strong>3AF</strong>, organisÅepar Airbus avec le soutien du groupe rÅgional <strong>3AF</strong> TMP, se proposait de prÅsenter un Åtat de <strong>la</strong> pratiqueindustrielle et de <strong>la</strong> recherche dans ce domaine. Elle a rassemblÅ un auditoire de 70 personnes de l’industrie,<strong>la</strong> recherche, et l’enseignement aÅrospatial. La matinÅe a ÅtÅ consacrÅe aux exposÅs gÅnÅraux(avions, satellites), l’aprÇs-midi á des exemples d’application.AprÇs l’introduction de P. Ladevàze (LMT Cachan), traitant du contexte gÅnÅral de <strong>la</strong> conceptionrobuste avec ses 3 Åtapes (Passage au Virtuel, Simu<strong>la</strong>tion, Dimensionnement & Optimisation) et insistantsur <strong>la</strong> prise en compte de <strong>la</strong> VariabilitÅ, J.Ch. Bonnet (Airbus) a prÅsentÅ un processus multidisciplinaireparamÅtrique ‘Charges Dimensionnement Conception’ permettant l’Åvaluation rapide de variantesen phase amont d’un Programme (Solution COLOSSUS pour A350). Ch. Cornuault (Dassault Aviation)a montrÅ comment <strong>la</strong> robustesse de conception et de justification des aÅronefs est assurÅe, parune approche pyramidale calculs/essais avec validation et reca<strong>la</strong>ge systÅmatique á tous les niveaux.Dans le secteur Spatial, B. Gergonne (Astrium Satellites) a mis en avant l’importance du compromisentre Robustesse/Performance/Coéts/DÅ<strong>la</strong>is ainsi que les amÅliorations nÅcessaires du ConcurrentEngineering et de l’intÅgration Conception/Calculs. J. Buffe (Thalàs Alenia Space) a, quant á lui, dÅveloppÅune dÅmarche originale d’optimisation de <strong>la</strong> performance technique avec finalitÅ Åconomique, introduisanten particulier le ‘coét de <strong>la</strong> dÅfail<strong>la</strong>nce’.
11La 1 Çre Table Ronde, animÅe par J.F. Imbert, a c<strong>la</strong>irementdÅgagÅ un consensus sur <strong>la</strong> dÅfinition de <strong>la</strong>conception robuste et <strong>la</strong> nÅcessitÅ d’approches multidisciplinaires/ multi-niveaux / multi-Åchelles / multicritÇres,soulignant nÅanmoins les dÅ<strong>la</strong>is trop longs detransfert des recherches vers l’industrie par l’intermÅdiairedes logiciels commerciaux standards.La JournÅe s’est poursuivie par quelques illustrationstypiques. M.Hardel (Astrium SAS Aquitaine) a montrÅcomment un processus itÅratif CAO/Calcul peutrÅduire le cycle d’une boucle de dimensionnement (iciun systÇme de verrouil<strong>la</strong>ge), en incluant des Åtudes desensibilitÅs pour Åliminer les concepts á risque et <strong>la</strong>prise en compte de renforts locaux dÇs le dÅbut de <strong>la</strong>conception. J.P.Lombard (Snecma Safran) a mis enavant le passage á un schÅma intÅgrÅ MÅca/AÅro/Optimisation (roues aubagÅes) avec emploi massif del’associativitÅ CAO/calcul, traitement des incertitudes,accroissement des moyens de calcul HP et utilisation d’outils dÅdiÅs. F.Seigneuret (Airbus), á travers un exemplede corrÅ<strong>la</strong>tion modÇle/essais structuraux (É Barrel A350 Ö), a prÅsentÅ un cas d’analyse robuste dÅtaillÅe avec propagationd’incertitudes, permettant l’identification des paramÇtres influents et ouvrant des perspectives prometteusesvers des techniques de dimensionnement robuste en phase plus amont.Une 2 iÇme Table Ronde, animÅe par Didier Gangloff (Cnes <strong>Toulouse</strong>),a clÑturÅ <strong>la</strong> Session en confirmant le volontarisme des Industrielsvers une rÅelle conception robuste par <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>tion, soulignantles avancÅes dÅjá rÅalisÅes tout en mesurant le chemin qui reste á parcourir: extension des approches probabilistes É a priori Ö (plutÑt utilisÅesaujourd’hui É a posteriori Ö), changement culturel et travail ÅducatifassociÅs, col<strong>la</strong>boration avec les Åditeurs de logiciels, dÅploiement denouveaux processus et outils standards, moyens de calcul.L’AssemblÅe dans son ensemble a saluÅ <strong>la</strong> qualitÅ des prÅsentationset dÅbats sur un sujet aussi fÅdÅrateur, et s’est retirÅe en remerciantles orateurs et animateurs.
12Le CiSECClub Inter associations des Systàmes EmbarquÄs CritiquesLa SEE, l'AAAF et <strong>la</strong> SIA, col<strong>la</strong>borent depuis plusieurs annÅes de maniÇre fructueuse, notamment enorganisant conjointement les diffÅrentes Åditions de <strong>la</strong> confÅrence internationale É Embedded Real-Time Software Ö. Cette manifestation, ancrÅe á <strong>Toulouse</strong>, cœur du pÑle de compÅtitivitÅ AerospaceValley, a rencontrÅ rapidement un vif succÇs bien au-delá des rÅgions Aquitaine et <strong>Midi</strong>-PyrÅnÅes. Fortesde ces expÅriences rÅussies et de <strong>la</strong> qualitÅ des tissus industriel et acadÅmique en Aquitaine et<strong>Midi</strong>-PyrÅnÅes, les trois associations se proposent de pÅrenniser ces synergies en crÅant le CISEC, surles SystÇmes EmbarquÅs intÅgrÅs au sein de vÅhicules de transport variÅs (avion, voiture, satellites...),critiques du point de vue de <strong>la</strong> séretÅ de fonctionnement, des impacts financiers, de <strong>la</strong> disponibilitÅ duservice, de l'image de marque, etc.Ce club a les ambitions suivantes :favoriser les Åchanges et <strong>la</strong> diffusion de l'innovation pour les SECpromouvoir les SEC auprÇs du grand public et des jeunesdÅvelopper des ponts avec des structures europÅennes simi<strong>la</strong>ires.Pour atteindre ces objectifs, le club se propose essentiellement d'organiser des sÅminaires, journÅesd'Åtudes ou ateliers de bon niveau technique. Il s'agit ainsi de :contribuer á une veille scientifique É partageable Ö de haut niveau. Les manifestations devraientidentifier les difficultÅs rencontrÅes par <strong>la</strong> communautÅ, les retours d'expÅrience positifs et lesbonnes pratiques, les technologies Åmergentes, les travaux de recherches...de rendre accessible au plus grand nombre les savoirs collectÅs. D'une part, le contenu des manifestationssera Åtabli en gardant á l'esprit une volontÅ de vulgarisation et de pÅdagogie. D'autrepart, on privilÅgiera le libre accÇs á ces manifestations et une <strong>la</strong>rge diffusion des matÅriaux collectÅsou Å<strong>la</strong>borÅs ultÅrieurement.offrir une tribune au plus grand nombre dans un cadre ouvert et serein, sans parti pris : choixd'intervenants variÅs, convivialitÅ des Åchanges... favoriser les synergies en dÅcloisonnant <strong>la</strong> communication entre :- les diffÅrents acteurs (industrie, recherche, enseignement, Åtat)- les diffÅrents secteurs industriels concernÅs- les diffÅrentes disciplines scientifiques concernÅes.
14Un beau challenge. M. Fernand Alby du CNES affronte un autre dÅfi : que faire de tout ce qui tourne autour de<strong>la</strong> Terre (satellites, mais aussi dÅbris de <strong>la</strong>nceur). Le risque de collision entre un objet devenu inutile et un satelliteest loin d’âtre nÅgligeable. Les techniques utilisÅes sont d’Åviter les dÅbris connus, de bruler les satellitesdans l’atmosphÇre ou encore de les Åjecter sur des orbites É poubelle Ö.Une semaine d’Åtudes aurait pu âtre consacrÅe á l’apport des SEC pour rÅduire <strong>la</strong> consommation de carburant(rÅduction de <strong>la</strong> trainÅe et de <strong>la</strong> masse voilure par les commandes de vol Ålectriques par exemple) et l’Åmissionde polluant (comme les Nox par un contrÑle fin des moteurs). Nous nous sommes consacrÅs á <strong>la</strong> seule ÅnergieÅlectrique utilisÅe par les circuits Ålectroniques. M. Bernard Courtois du CMP (Circuits Multi-Projets – Grenoble)a dressÅ le panorama des possibilitÅs qu’offrent les Circuits IntÅgrÅs et les MEMS pour <strong>la</strong> gÅnÅration, l’utilisationet le stockage de l’Ånergie. Mme Marise Barfleur du LAAS-CNRS a ensuite dÅveloppÅ les techniques disponiblesou futures pour faire des SEC autonomes. Par exemple pour un systÇme destinÅ á mesurer les effortssur une piÇce structurale d’un avion, et communiquer le rÅsultat á un systÇme central sans aucune alimentationÅlectrique.La journÅe est un succÇs gràce aux orateurs mais aussi par l’intensitÅ des dÅbats qui ont suivi chacune desprÅsentations. La prÅsence rÅguliÇre lors de nos journÅes d’orateur extÅrieur á <strong>la</strong> rÅgion montre <strong>la</strong> qualitÅ et <strong>la</strong>variÅtÅ des intervenants locaux (devant le micro et dans <strong>la</strong> salle) sur des sujets re<strong>la</strong>tifs aux systÇmes embarquÅs.Cette journÅe sera prolongÅe par une confÅrence É francophone sur l’Åco-conception en gÅnie ÅlectriqueÖ les 6 et 7 dÅcembre, www.confrege.<strong>la</strong>p<strong>la</strong>ce.univ-tlse.fr, organisÅe par le Laboratoire Lap<strong>la</strong>ce et nos amisde <strong>la</strong> SEE <strong>Midi</strong>-PyrÅnÅes.
15RENOVATION DU MIRAGE III A02 Ü l’ISAE SUPAERO9 Åtudiants de SUPAERO ont rÅnovÅ de novembre 2008 á novembre 2009 le Mirage III A02 prÅsent sur lecampus depuis 1973. La quasi totalitÅ de ces Åtudiants font partie de <strong>la</strong> commission Jeunes <strong>Midi</strong> PyrÅnÅes. Auterme de ce travail, <strong>la</strong> coopÅration de ces ÅlÇves avec des passionnÅs de <strong>la</strong> restauration d’avion (employÅs deDassault Avation, membres des Ailes Anciennes de <strong>Toulouse</strong> ou du Conservatoire Air et Espace d’Aquitaine) s’estrÅvÅlÅe âtre trÇs enrichissante. Cette p<strong>la</strong>quette prÅsente tout d’abord l’histoire de cet avion puis dÅcrit le dÅroulementde cette rÅnovationLe Mirage III naãt d'une demande de l'armÅe de l'air franÜaise datant de 1953 concernant un intercepteurlÅger. L'accent est mis sur les performances de l'avion en montÅe et en vitesse de pointe en vue de permettre l'interceptionde bombardiers stratÅgiques á haute altitude. La GAMD (GÅnÅrale AÅronautique Marcel Dassault) rÅpondá cet appel en dÅveloppant sur fonds propres un birÅacteur appelÅ MD 550 ÉMystÇre-DeltaÖ, qui vole en1955. AprÇs diverses modifications, dont l'instal<strong>la</strong>tion d'une postcombustion et d'un moteur-fusÅe, les deux prototypessont renommÅs Mirage I et II.La genÇseParallÇlement au dÅveloppement du MD550, <strong>la</strong> GAMD a donc <strong>la</strong>ncÅ l'Åtude du Mirage III, un monorÅacteurdelta conÜu suivant <strong>la</strong> loi des aires, dont le premier prototype, le Mirage III 01 ÉBalzacÖ, vole en 1956. Il incorporepour <strong>la</strong> premiÇre fois les ÉsourisÖ qui permettent de rÅguler l'Äcoulement dans les entrÄes d'air et des servocommandes.Dans un souci d'Äconomie, il est aussi prÄvu que <strong>la</strong> cellule puisse Åtre dÄclinÄe en diffÄrentes versionsspÄcialisÄes. L'Etat franÇais, jugeant l'avion prometteur, commande en 1957 dix avions de prÄsÄrie dÄsignÄs MirageIIIA.Un succÇs technique puis commercialChacun de ses dix avions sera affectÄ É une tÑche particuliÖreau cours des essais. Le Mirage IIIA nÄ02, qui dÄcolle pour<strong>la</strong> premiÖre fois le 17 FÄvrier 1959, est ainsi rÄservÄ aux essais Éhaute altitude de <strong>la</strong> fusÄe SEPR. C'est É cette occasion qu'il portele 20.02.1960 le record franÅais d'altitude Ç 82 500 ft soit25 km, avec É son bord Jean-Marie SAGET. Le nÜ03 Ätablitquand É lui le record du monde de vitesse sur <strong>10</strong>0 km le 18Juin 1959. Ces succÖs sont le symbole du renouveau de l'aÄronautiquefranÇaise moins de vingt ans aprÖs <strong>la</strong> deuxiÖme guerremondiale.
17Fiche technique du Mirage IIIA nä02 :Envergure: 7,58 mLongueur: 14,20 mHauteur: 4,25 mSurface a<strong>la</strong>ire: 34 mìMoteur: SNECMA ATAR 9B de 4 250 kgp de poussÅe (6000 kgp avec <strong>la</strong> postcombustion)Masse Ü vide: 4 840 kgMasse maximale: 6 900kgFusÄe d'appoint: SEPR 841PoussÄe de <strong>la</strong> fusÄe: 1 500 kgpVitesse maximale: Mach 2 á 40 000 ftMach 1.9 á 70 000 ftP<strong>la</strong>fond: 75 000 ft en "zoom" sans fusÅe: 82 500 ft avec fusÅe6 min 48 sec entre le làcher des freins et60 000 ft, Mach=1.880 sec pour accÅlÅrer de M=1,52 á M=1,8en montant de 38 000 á 60 000 ftSans rancune !Dans les annÅes 80, aprÇsavoir ÅtÅ kidnappÅ et recouvertd'une couche de peinture rosepar les ÅlÇves de l'INSA touteproche, l'appareil a ÅtÅ coulÅdans du bÅton pour empâcherquiconque de le dÅp<strong>la</strong>cer.... cequi explique l'aspect saugrenudes jantes !PrÄvu pour durerLa restauration ne concerne pas uniquement l'aspect extÅrieurde l'appareil... un des buts de cette opÅration Åtait d'arrâter <strong>la</strong>corrosion qui menaÜait le Mirage. Au cours des premiers joursde <strong>la</strong> restauration, en grimpant dans l'appareil pour le nettoyer,nous avons constatÅ que par endroit le mÅtal s'effritait aumoindre contact. Pour arrâter ce phÅnomÇne qui menace l'appareil,le logement rÅacteur a ÅtÅ recouvert d'un enduit protecteur.
18Extrait d'une lettre de Jean-Marie SAGET, pilote d'essai du Mirage IIIA 02:É Une Åtude a montrÅ que le record d'altitude pouvait âtre battu en utilisant <strong>la</strong> technique du zoom, c'est-ádired'une ressource amenant l'avion á forte assiette dans les couches denses de l'atmosphÇre, <strong>la</strong> trajectoireculminant en balistique á <strong>10</strong>5 000ft. Lá-haut, <strong>la</strong> pression atmosphÅrique n'est plus que de <strong>10</strong>mb et á Mach 1, <strong>la</strong>vitesse indiquÅe est de 50 kt.Le chantier de prÅparation comportait en particulier le montage d'une batterie supplÅmentaire pour assurerle fonctionnement en vol en cas de blocage du rÅacteur, l'extinction Åtant prÅvue au cours de <strong>la</strong> manœuvre, etpour le pilote d'un accÅlÅromÇtre sensible permettant de contrÑler <strong>la</strong> ressource initiale á 1,2g, ainsi que d'un altimÇtre0-<strong>10</strong>0 000 ft á une seule aiguille, graduÅe sur environ 300î, car il est difficile de lire un altimÇtre á 3 aiguillesen Åvolutions rapides, et …d'un chiffon antibuÅe pour assurer <strong>la</strong> visibilitÅ en cas d'atterrissage rÅacteur Åteint.Les vols ont eu lieu du 3 au 20 FÅvrier 1960. Premier zoom sans fusÅe en affichant une assiette de 30î ápartir de 40 000ft – Mach 2. L'avion atteint 73 300ft, <strong>10</strong>0kt, Mach 0.7, rÅacteur Åteint. Aucun problÇme de qualitÅde vol. Bon rallumage.Profil prÅvu des zooms avec fusÅe : mise en route en bout de piste avec 2200L de pÅtrole. DÅcol<strong>la</strong>ge etmontÅe plein gaz sec en Åloignement vers Nice (<strong>10</strong>8 Nm). AccÅlÅration Postcombustion maxi vers Mach 2 á 38000ft aprÇs demi-tour. Allumage fusÅe á 40 000 ft/ Mach 2 avec 260L x 2 aux jaugeurs. Ressource á 1,2g jusqu'á30î d'assiette (vers 60 000ft) puis manche au ventre pour afficher 45î d'assiette. L'assiette est ensuite prÅvue diminuerprogressivement du fait de <strong>la</strong> stabilitÅ statique jusqu'au sommet de <strong>la</strong> trajectoire. ÖL’Åquipe Åtudiante de cette restauration :Romain LA<strong>MO</strong>UR, Jean COLLARD, Arthur BA-BEAU, RÄmi LAM, Martin DEVYVER, FÄlix LOR-THIOIS, RaphaÅl SMADJA, Guil<strong>la</strong>ume FOURNIER(absent : Thibaut MIQUEL)Le Mirage III A02 sur son lieu d’exposition(Campus de SUPAERO) au terme du projet
19La Ligne et sa LittÄrature (1àre partie)Francis RenardLa Ligne c'est l'aventure dans les annÅes 20 de <strong>la</strong> crÅation d'une ligne aÅrienneessentiellement postale en partant de <strong>Toulouse</strong>, passant par le Maroc,le SÅnÅgal, puis, franchissant l'At<strong>la</strong>ntique Sud pour arriver au BrÅsil,l'Uruguay, l'Argentine et enfin au travers des Andes, au Chili. CrÅÅe par PierreGeorges LatÅcoÇre, continuÅe par Marcel Bouilloux-Lafont sous le vocablede l'AÅropostale, <strong>la</strong> Ligne va servir de rÅservoir historique á <strong>la</strong> Compagnie Air-France qui, en 1933, va regrouper en son sein les cinq principales CompagniesFranÜaises, dont bien sér l'AÅropostale.En puisant constamment dans l'extraordinaire passÅ de <strong>la</strong> Ligne, Air-FrancedÅ<strong>la</strong>issera les efforts rÅalisÅs en mâme temps sur les autres rÅseaux, oubliÅsles Åquipages vo<strong>la</strong>nt de nuit bien avant Mermoz, ceux qui disparaissent dans<strong>la</strong> MÅditerranÅe á bord de fragiles hydravions, qui Åchouent dans les montagnesg<strong>la</strong>cÅes de l'Europe Centrale, bref, quasiment oubliÅs Maurice Bajac,Chef-Pilote á Air-Union, Maurice NoguÇs, Chef-Pilote á Air-Orient, lui qui dÅfricheá travers les vents de sable, <strong>la</strong> mousson, les montagnes, plus de12.000 km de ligne pour arriver á Saïgon...La cÅlÇbre Ligne sera reconnue sous l'angle de monographies de ses richespersonnalitÅs, Jean Mermoz, Antoine de Saint-ExupÅry, Henri Guil<strong>la</strong>umet,sans oublier le grand metteur en scÇne de cetteÅpopÅe Didier Daurat. Ce dernier Åcrit É Dans le vent des hÄlices Ö ses mÅmoirespour justifier les mÅthodes de travail usitÅes á cette Åpoque. En premier lieul'adhÅsion et l'obÅissance quasiment absolue á son patron, PG LatÅcoÇre. DidierDaurat dispose á sa discrÅtion de pilotes issus de <strong>la</strong> guerre fortement tentÅspar l'aventure. Au fil des ans, le matÅriel, essentiellement des BrÅguet 14,dont <strong>la</strong> crÅation remonte á 1916, peut-âtre considÅrÅ par force comme duÉ consommable Ö, 59 totalement dÅtruits sur 171 utilisÅs ! On attendra <strong>la</strong> findes annÅes 20 pour voir enfin arriver les LatÅ 25, 26 et 28 qui vont vivifier unrÅseau trop fragile. Dans son rÅcit, Didier Daurat, grand tÅmoin de cette aventure,rend longuement hommage au travail de ses Åquipages et re<strong>la</strong>te <strong>la</strong> cruellefin de l'AÅropostale en 1931.Toujours dans l'apport du tÅmoignage direct, lelivre de Joseph Kessel,É Mermoz Öl'ami de Jean Mermoz dont il a eu le bonheur de recueillir longuement lesconfidences de celui-ci peu avant sa disparition.Autres tÅmoins de tout premier p<strong>la</strong>n, les journalistes Jacques Mortane É JeanMermoz Ö et Jean-GÅrard Fleury É Chemins du Ciel Ö et É La Ligne de Mermoz,Guil<strong>la</strong>umet, Saint-ExupÄry et leurs compagnons d'ÄpopÄe Öqui vÅcurent<strong>la</strong> vie de ses pionniers et se liÇrent d'amitiÅ avec eux. Sans oublier les propresÅcrits de Jean Mermoz É Mes Vols Ö.Antoine de Saint-ExupÅry va puissamment contribuer á faire connaãtre <strong>la</strong> Ligne parses ouvrages É Courrier Sud Ö, É Vol de Nuit Ö, É Terre des Hommes Ö, mâ<strong>la</strong>ntl'aviation á <strong>la</strong> littÅrature, son engagement á partir de 1926 dans cette ÅpopÅe seradÅterminante dansl'Åcriture de cette histoire. Ami de Guil<strong>la</strong>umet, admirateur de Mermoz, Saint-ExupÅryparticipe á tous les ÅvÇnements qui vont jalonner cette formidable aventure. TalentueuxÅcrivain, son ode á <strong>la</strong> fraternitÅ, puisÅe au sein de <strong>la</strong> camaraderie des Åquipages,marquera profondÅment les esprits. AprÇs <strong>la</strong> fin de l'AÅropostale, il sera tenuÅloignÅ par Air-France de l'aviation commerciale mais se rÅvÇlera un de nos plusgrands Åcrivains É Le Petit Prince Ö, ÖCitadelle Ö...Les rÅcits sont poignants, l'ombre de <strong>la</strong> mort est toujours prÅsente, en 1936, JeanMermoz, se confie et fait un triste bi<strong>la</strong>n, nous Åtions dix-huit, et il ÅgrÇne les noms,nous ne sommes plus que quatre, Guil<strong>la</strong>umet, Reine, St Ex et moi...Dans moins d'unedÅcennie, ils auront tous disparu...(A suivre)
20Les Revues de Pressede MatthieuAviation LÅgÇre
Revue de Presse nä8 dÄcembre 2009 – janvier 20<strong>10</strong>21EDITOTout d’abord, et pendant que je le peux encore,je tiens á vous souhaiter á tous, ainsi qu’á vosproches une trÇs bonne annÅe 20<strong>10</strong>, pleinede rÅussite.Concernant l’Aviation LÅgÇre, que pourraitonsouhaiter pour cette nouvelle annÅe? Une re<strong>la</strong>nce de l’activitÅ constructeuravec un statut c<strong>la</strong>ir des avions Robin et Cap permettraitune meilleure lisibilitÅ pour les clubssouhaitant continuer de former sur des machinesÅprouvÅes comme les DR. En effet, ces derniÇresannÅes, nombreux sont les clubs et les Åcolesde pilotage ayant optÅ pour des machinesamÅricaines alors que nous avons <strong>la</strong> chance d’avoirun constructeur national proposant des produits dequalitÅ ! Le dÅveloppement au niveau europÅende nouvelles motorisations concurrentielles orientÅes dans un cycle de ce que l’on pourraitnommer l’Energie Durable doit Åmerger. J’entends par lá, une motorisation consommant moins et moinspolluante, al<strong>la</strong>nt de pair avec l’arrivÅe de nouveaux carburants. Aujourd’hui, nous nous accordons tous á direque l’AVGAS est un carburant dÅpassÅ, beaucoup trop cher et trop polluant. L’arrivÅe de nouvelles motorisationsÅlectriques est aussi source d’espoir pour l’aviation lÅgÇre et gÅnÅrale. De nombreux produitssont en test avec ce type de motorisation et les rÅsultats sont plus qu’encourageants. L’accent doit aussi âtremis sur <strong>la</strong> É libÅration Ö du ciel europÅen. De nombreuses restrictions ont vu le jour ces derniÇresannÅes, trÇs contraignantes pour les passionnÅs du ciel et surtout totalement injustifiÅes. Une Åvolution doitâtre envisagÅe de maniÇre á satisfaire autant <strong>la</strong> sÅcuritÅ et <strong>la</strong> suretÅ du ciel, que le respect de notre activitÅ,qui n’est pas, et je le rÅpÇte, un caprice de gens fortunÅs. En rÅalitÅ, de nombreux dÅfis arrivent au momentoä s’ouvre cette nouvelle dÅcennie du XXIÇme siÇcle. A tous les acteurs de l’aviation lÅgÇre et gÅnÅralede les relever.ConstructeursAviasportLa justice donne raison á CEAPRLe 18 dÅcembre 2008, le Tribunal de Commerce de Dijon avait condamnÅ <strong>la</strong> sociÅtÅ CEAPR, repreneurd’une partie des activitÅs des sociÅtÅs Apex‐Aircraft et Apex‐Industries (constructeur des avions Robin),a payer 1,224 million d’euros au liquidateur des sociÅtÅs Apex. CEAPR avait fait appel de cette dÅcisionqui hypothÅquait Åvidemment ses chances de re<strong>la</strong>nce de son activitÅ. La cour d’appel de Dijon, dansun jugement du <strong>10</strong> novembre, vient de lui donner raison. Le jugement du 18 dÅcembre 2008 est annulÅpour cause de vices de procÅdure. C’est Åvidemment un grand sou<strong>la</strong>gement du cÑtÅ de Darois,oä CEAPR a repris depuis quelques mois <strong>la</strong> distribution des piÇces dÅtachÅes des avions Robin. Toutefois,ce nouvel Åpisode judiciaire vient rappeler que É l’affaire Apex Ö, si elle n’occupe plus le devant de <strong>la</strong>scÇne, n’est pas terminÅe.Diamond NewsDiamond‐Aircraft a terminÅ le premier retrofit d’un DA‐42 New Generation au profit de l’Åcole FTO espagnoleCesda‐de‐Reus. Les deux diesel TAE ont ÅtÅ remp<strong>la</strong>cÅs par deux nouveaux Austro‐Engine AE‐300, et toutesles modifications nÅcessaires ont ÅtÅ apportÅes á <strong>la</strong> cellule pour passer cet appareil au standard É New GenerationÖ. L’avionneur autrichien espÇre rÅduire prochainement le temps d’immobilisation estimÅ entre 2et 4 semaines maximum. (…)Tecnam newsÉ A new star is born Ö, c’est avec ce clin d’œ il appuyÅ vers son concurrent autrichien que l’avionneur italien aannoncÅ l’Å<strong>la</strong>rgissement de sa gamme avec le Tecnam MMA (pour Multi‐Mission Aircarft), prÅsentÅ commeÉ solution abordable de surveil<strong>la</strong>nce pour les organisations gouvernementales ou privÅes Ö. (…)
22Cirrus lÇve le pied sur le SF‐50 Vision‐JetCirrus‐Design a procÅdÅ rÅcemment á une nouvelle vague de licenciements portant sur 87 sa<strong>la</strong>riÅs supplÅmentaires.Parmi eux figurent des ingÅnieurs travail<strong>la</strong>nt sur le programme du SF‐50 Vision‐Jet. Le constructeurannonce aussi que les essais en vol sont provisoirement suspendus, que le premier prototype ne volequasiment plus et que <strong>la</strong> construction du deuxiÇme prototype ne sera <strong>la</strong>ncÅe que lorsque les fonds nÅcessairesauront pu âtre rÅunis. Des modifications significatives, notamment au niveau des volets, doivent âtre intÅgrÅes.Cirrus‐Design reconnait avoir ÅtÅ contraint de rendre des acomptes versÅs par des clients, comme ils’y Åtait engagÅ. Une premiÇre sÅrie d’annu<strong>la</strong>tions a ÅtÅ enregistrÅe en mars 2009 dans les jours qui ont suivi<strong>la</strong> liquidation d’Eclipse. (…) Pour l’heure, Cirrus se concentre sur les monomoteurs á pistons qui demeurentson cheval de bataille, mâme si les commandes se sont effondrÅes en 2009.L’essor des VLJ revu á <strong>la</strong> baisseEn 2008, les Åconomistes d’Honeywell, qui n’avaient pas anticipÅ l’effondrement de l’Åconomie amÅricaine,annonÜaient <strong>la</strong> livraison de 17 000 avions d’affaires entre 2008 et 2018 pour un montant total de 300milliards de dol<strong>la</strong>rs. DÅsormais, ils ne tablent plus que sur 11 000 livraisons pour un total de 200 Md$, etprÅvoient 700 livraisons en 20<strong>10</strong>, soit 50% de moins qu’en 2008. Face au retournement de <strong>la</strong>conjoncture, les prÅvisions de ventes de personnal jets (Diamond‐Jet, Piper‐Jet, Cirrus Vision, etc.) portentdÅsormais sur 1 000 á 1 500 unitÅs contre 4 000 á 5 000 il y a un an.Re<strong>la</strong>nce du MS‐760 ParisDaher‐Socata a cÅdÅ á l’amÅricain Jet‐Set le certificat de type et les droits de propriÅtÅ du birÅacteur MS‐760Paris, celui qui est aujourd’hui unanimement considÅrÅ comme le premier VLJ (Very Light Jet) de l’histoirede l’aviation. Il a volÅ pour <strong>la</strong> premiÇre fois le 29 juillet 1954, plus de quarante ans avant l’Eclipse‐500. DÅveloppÅpar Morane‐Saulnier á partir de 1954, ce quadrip<strong>la</strong>ce birÅacteur d’entrainement militaire et deliaison a immÅdiatement sÅduit les amÅricains. (…) Il y a encore 27 MS‐760 en Åtat de vol aux USA actuellement.(…) Jet‐set a repris (…) une trentaine de MS‐760 et une soixantaine de moteurs TurbomecaMarborÅ neufs ou reconditionnÅs. (…) Morane‐Saulnier avait construit au total 155 appareils. L’objectif deJet‐Set‐Aviation est de proposer des avions modernisÅs, ÅquipÅs de moteurs neufs et d’une nouvelle avionique.Il envisage aussi de transformer le MS‐760 en monorÅacteur avec un seul Pratt&Whitney JT15D‐4 ouWilliams FJ‐44. (…) Le prix de vente du nouveau MS‐760 Paris‐Jet É made in Florida Ö est fixÅ aux environsde 550 000$. Deux MS‐760 new‐ look composeront une patrouille acrobatique qui se produira en meetingsdÇs le dÅbut 20<strong>10</strong>.Info‐PiloteSo<strong>la</strong>r Impulse, premiers essaisLe 6 novembre, le prototype de So<strong>la</strong>r Impulse a quittÅ son hall de construction pour ses premiers essaisau sol. Les conditions mÅtÅorologiques Åtant favorables, l’astronaute C<strong>la</strong>ude Nicollier, directeurdes vols d’essais, a autorisÅ <strong>la</strong> sortie de l’appareil. Objectif du jour : tester les quatre moteurs del’appareil. Une fois en p<strong>la</strong>ce sur le tarmac de l’aÅroport de Dñbendorf, l’avion a reÜu son stabilisateur verticalde 6,40 m qui n’avait encore jamais ÅtÅ montÅ, faute de hangars suffisamment hauts ! A 11h20, MarkusScherdel, pilote d’essai de So<strong>la</strong>r Impulse (…) a procÅdÅ á <strong>la</strong> mise en route des quatre moteurs, qui n’avaientÅtÅ testÅs jusqu’alors qu’au banc d’essai. (…)Bugatti <strong>10</strong>0 : rendez‐vous en 2015FabriquÅ á <strong>la</strong> fin des annÅes 1930 á Paris, le prototype du Bugatti <strong>10</strong>0P n’a jamais volÅ. CachÅpendant <strong>la</strong> guerre, rachetÅ á un passionnÅ, l’appareil, a un temps sÅjournÅ á <strong>la</strong> FertÅ‐A<strong>la</strong>is avant d’âtredÅmantelÅ (ses moteurs seront vendus á un passionnÅ d’automobile). Dans les annÅes 1970, <strong>la</strong> cellule estproposÅe au MusÅe de l’Air et de l’Espace… qui <strong>la</strong> refuse ! L’appareil Åmigre au Etats‐Unis oä une Åquipe tentede le restaurer. L’avion est finalement donnÅ au musÅe de l’EAA (Oshkosh) qui l’expose depuis 1997. (…)Deux restaurateurs amÅricains ont dÅcidÅ de construire une rÅplique vo<strong>la</strong>nte de cet avion avantgardiste(bimoteur en tandem, arbres de transmission, hÅlices contrarotatives, volets crocodile, voilureen flÇche inverse, refroidissements audacieux..). Ils ont dÅjá reÜu l’aide de passionnÅs comme FrÅdÅricGasson (pour le model 3D), l’ISAÅ (pour les essais soufflerie), de l’IPSA (pour le calcul structure) (…).Au moins six ans de travail sont á prÅvoir avant de voir voler <strong>la</strong> rÅplique de cet avion.
23So<strong>la</strong>r Impulse a dÅcollÅ !Le 3 dÅcembre dernier, So<strong>la</strong>r Impulse a franchi une nouvelle Åtape dÅcisive de son programme en dÅcol<strong>la</strong>ntpour <strong>la</strong> premiÇre fois de l’aÅrodrome de Dñbendorf. Bertrand Piccard et AndrÅ Borschberg Åtaient naturellementprÅsents. (…)So<strong>la</strong>r Impulse a parcouru environ 350 m en ligne droite á une hauteur d’un mÇtre avant d’atterrir. (…)Big Frog : un Nemesis optimisÅLe 3 dÅcembre le team officialisait le partenariat qui le lie avec <strong>la</strong> sociÅtÅ Dassault SystÇmes. RÅunis autourde leur passion commune pour l’innovation, les deux entitÅs travaillent depuis plusieurs mois dÅjá á l’optimisationdu Nemesis, l’avion qui sera engagÅ par Big Frog ‐ aux courses de Reno [ndlr]. L’apport de DassaultSystÇmes a ÅtÅ prÅpondÅrant dans l’intÅgration du moteur diesel SMA qui propulsera l’apparel. (…)Premiers vols prÅvus au printemps 20<strong>10</strong>.Avions Robin : de nouvelles piÇces disponibles chez AEROdifSelon <strong>la</strong> p<strong>la</strong>teforme de distribution de piÇces dÅtachÅes AEROdif, 900 piÇces mineures seraient dÅsormaisdisponibles pour commande sur son site internet. Les piÇces ne sont malheureusement pasencore au catalogue. Dyn’Aviation devait obtenir son DOA fin 2009. Il semble que celui‐ci n’arriveraqu’en fÅvrier 20<strong>10</strong>. (…)MotorisationInfo‐Pilote150 hp en ÅtoileVous connaissez peut‐âtre le Rotec 2800, un moteur 7 cylindres en Åtoile dÅveloppant 1<strong>10</strong>hp commercialisÅpar <strong>la</strong> firme australienne Rotec depuis 2000. Forte du succÇs rencontrÅ par ce moteur, l’entreprisepropose Ågalement le Rotec R3600, un 9 cylindres toujours en Åtoile dÅveloppant 150hp á 3600 trs/min. (…)Ces moteurs fonctionnent á <strong>la</strong> <strong>10</strong>0LL. La consommation du R3600 est donnÅe pour 27 litres/heure á75% de <strong>la</strong> puissance. Refroidi par air, le R3600 est garanti 12 mois ou 200 heures (garantie limitÅe átrois ans).DiversAviasportSatisfactionL’AOPA‐France s’affirme trÇs satisfaite de l’avancement de l’IFR privÅ aprÇs les rÅcentes rÅunions entre <strong>la</strong>DGAC, l’AOPA, l’AÅro‐club de France et le GIPAG : É le ciel se dÅcouvre et nous rencontrons une DGACpragmatique, volontaire et dÅsireuse de mettre un terme á une situation qui ne satisfait pas les pilotes Ö, communique‐t‐elle.Parmi les avancÅes promises, á court terme selon l’AOPA‐ France, l’allÇgement du thÅoriqueIFR et <strong>la</strong> reconnaissance des IFR amÅricains.Mascotte activeIcarius Aerotechnics (icarius‐aerotechnics.com), l’entreprise de Gap‐Tal<strong>la</strong>rd leader mondial dans <strong>la</strong> maintenancedes avions <strong>la</strong>rgueurs, a cÅlÅbrÅ les 50 ans de sa mascotte F‐GODZ, le plus ancien PC‐6 en Åtat devol.Info‐PiloteFal<strong>la</strong>it pas l’inviter…C’est une histoire banale. Il y a quelques jours, les Silver Falcons (<strong>la</strong> patrouille nationale d’Afrique du Sud)rÅalisait un vol VIP. A bord des Pi<strong>la</strong>tus PC 7 de l’Åquipe figuraient donc des invitÅs. Quelques minutesaprÇs le dÅcol<strong>la</strong>ge, alors que les avions entamaient les premiÇres figures de leur programme, l’un des VIP amalencontreusement accrochÅ <strong>la</strong> poignÅe d’Åjection de son siÇge. Sanction immÅdiate, il a ÅtÅ ÅjectÅ duPi<strong>la</strong>tus ! (…) L’homme aurait ÅtÅ projetÅ á plus de 300 ft au dessus du PC‐7. Le parachute s’Åtant dÅployÅcorrectement, le passager s’est heureusement posÅ sain et sauf. L’homme a ÅtÅ rÅcupÅrÅ et ramenÅsur l’aÅroport de Langebaanweg (d’oä les PC‐7 avaient dÅcollÅ) par un hÅlicoptÇre militaire.TANAY Matthieu
24Revue de Presse nä9 fÄvrier 20<strong>10</strong>EDITOLe monde de l’aviation lÅgÇre est un formidablevivier pour le monde de l’aÅronautiqueprofessionnelle, qu’il soit celui d’unbureau d’Åtudes ou d’un cockpit d’avion, enpassant par un hangar de maintenance. Nombreuxsont les pays Åmergeants – si l’on peutles appeler ainsi – qui l’ont compris. Ainsi, <strong>la</strong>Chine, dans <strong>la</strong>quelle l’aviation privÅe Åtaitquasi inexistante s’est dÅveloppÅe ces derniÇresannÅes avec de projets novateurs et des technologiesd’avenir. Alors bien sér, notre modede fonctionnement est liÅ á <strong>la</strong> sociÅtÅ dans<strong>la</strong>quelle nous Åvoluons, et il serait Ñ combienrÅducteur de dire que <strong>la</strong> Chine est un paysplus libertaire en ce qui concerne l’aviationlÅgÇre. Cependant, ces derniÇres annÅes en Europe, le ciel s’est assombri. Entre les Ålus, poussÅs pardes promoteurs peu scrupuleux du patrimoine et de l’histoire, qui ne voient pas plus loin que leurbusiness p<strong>la</strong>n á cinq ans, et les directives sclÅrosantes imposÅes par une administration au fonctionnementparfois dÅpassÅ et Ñ combien bureaucratique, l’aviation lÅgÇre en France et en Europe esten danger. Les terrains ferment, les aÅroclubs ne peuvent plus assumer <strong>la</strong> charge que leur impose l’administration,confondant aviation de loisir et transport aÅrien. Dans mon aÅroclub de cœ ur, qu’est celui deBernay en Normandie, le mÅcanicien est fataliste quant á <strong>la</strong> surcharge administrative qui lui est imposÅe.Personne ne prendra <strong>la</strong> relÇve une fois parti de sa petite structure, car il faudrait alors repasser desPART XX version JAR EASA, inadaptÅes á notre activitÅ. Pourtant son activitÅ fait vivre le club en rÅduisantses coéts de dÅp<strong>la</strong>cements pour une rÅparation ou une visite. Les amÅricains ne fonctionnent pas de <strong>la</strong>mâme maniÇre, non pas que leur systÇme n’est pas rÅglementÅ, mais qu’il valorise l’apport Åconomiquede l’aviation, qu’elle soit lÅgÇre ou de transport aÅrien. Bernard Chabbert dans son Ådito de ce mois‐cidans Aviasport Åcrit É Une ville sans aÅrodrome ? óá s’appelle un trou Ö. Trouvons alors des moyenspour valoriser á long terme notre activitÅ, qui bien plus qu’un loisir, est aussi une source Åconomique formidableet un investissement pour l’avenir.ConstructeursAviasportAmateur chinoisLe jeune Mao Yiqing a construit une machine á motorisation muscu<strong>la</strong>ire de 27 mÇtres d’envergure, et dÅbutÅses tests en vol. L’Ånergie est transmise via un pÅdalier. L’ensemble construit en balsa et en fibres de carbonepÇse moins de 40 kg. Le constructeur amateur, qui a baptisÅ sa machine Mozi du nom de l’inventaire ducerf‐vo<strong>la</strong>nt, projetait le mois dernier un vol de 6 km prÇs de Shanghai.Info‐PiloteAprÇs le faux sac Vuitton, le TB20 chinois…[NDLR Le LE‐500 Little Eagle est <strong>la</strong> copie conforme du TB20.] Il est l’œ uvre de <strong>la</strong> Shijiazhuang Aircraft ManufacturingCompany. Difficile de savoir combien de ces appareils volent á l’heure actuelle en Chine, carle registre de l’Aviation civile de ce pays n’est pas public. Difficile Ågalement de savoir avec certitude quandce LE‐500 est apparu. En octobre 2003, <strong>la</strong> revue britannique Flight International annonÜait le premiervol du prototype pour <strong>la</strong> fin du mâme mois. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’en 1988, puis en1994, des TB20 ont ÅtÅ vendu en Chine par <strong>la</strong> Socata et qu’un centre de maintenance dÅdiÅ á ces appareilsavait ÅtÅ crÅÅ. En 2003‐2004, il aurait mâme ÅtÅ question que <strong>la</strong> Socata cÇde <strong>la</strong> licence du TB20pour <strong>la</strong> Chine. ConÜu initialement pour le marchÅ des Åcoles de pilotage chinoises, le LE‐500 nourriraitaujourd’hui des ambitions internationales.Subsonex : premier vol imminentLe mois dernier [avait ÅtÅ annoncÅ] que le constructeur d’avions en kit Sonex avait choisi de motoriserson minijet, le SubSonex, avec le rÅacteur thÇque TJ‐<strong>10</strong>0 signÅ PBS. Ce dernier fournit jusqu’á240 livres de poussÅe. (…) L’intÅgration de <strong>la</strong> motorisation á <strong>la</strong> cellule de l’avion est [aujourd’hui]
25achevÅe. Le premier vol est prÅsentÅ comme imminent. Des essais ont dÅjá ÅtÅ conduits au sol le18 dÅcembre. Ils avaient notamment pour objet de vÅrifier que le souffle du rÅacteur n’endommage pasl’empennage papillon. Seule <strong>la</strong> mÅtÅo totalement dÅfavorable retarde le premier vol. PBS travaillerait actuellementá <strong>la</strong> certification de son rÅacteur auprÇs de l’aviation civile tchÇque.Cessna rÅambaucheAprÇs une annÅe 2009 particuliÇrement difficile pour l’aviation gÅnÅrale amÅricaine, il semble que 20<strong>10</strong>dÅmarre sous de meilleurs auspices. Du moins pour Cessna, qui annonce son intention de rÅembaucher180 personnes sur les lignes de montage du Citation Sovereign, fermÅs depuis 6 mois. Il faut voir ici l’effetpositif d’un dol<strong>la</strong>r bas qui a permis de re<strong>la</strong>ncer les ventes internationales. NÅanmoins, Cessna s’attendá une annÅe 20<strong>10</strong> difficile. Selon les analystes, le marchÅ de l’aviation gÅnÅrale pourrait reprendre sil’Åconomie amÅricaine atteignait les 3% de croissance. Au troisiÇme trimestre 2009, l’indicateur s’Åtablissaitá 2.2%.PiloterRecord d’altitude pour l’AntaresLe p<strong>la</strong>neur Antares de Lange Aviation, modifiÅ par l’institut de recherche allemand DLR avec l’arrivÅe d’une pileá combustible (PAC) trouvant p<strong>la</strong>ce dans l’un des deux pods sous les voilures, a atteint l’altitude de 2558m fin novembre dernier. L’Antares DLR‐H2 est un monop<strong>la</strong>ce de recherche, le premier á avoir dÅjá rÅalisÅun vol complet, dÅcol<strong>la</strong>ge compris, sur l’Ånergie tirÅe d’une pile á combustible. Le Super Dimona,ÅquipÅ par Boeing d’une pile á combustible, aprÇs avoir utilisÅ cette derniÇre uniquement en croisiÇre, en palier.Le vol du DLR‐H2 a eu lieu á partir de Zweibrñcken (…). Sa durÅe a ÅtÅ de 1h09 avec une distance de 133 kmparcourue á 115 km/h de moyenne.MotorisationPiloterPotentiel Etendu pour les Rotax 912Mi‐dÅcembre, le motoriste Rotax a annoncÅ une extension possible du TBO (Time Before Overhaul) de songroupe 912, pouvant passer sous certaines conditions de 1500 h á 2000 h ou une durÅe d’opÅration Åtenduede 12 á 15 ans. Ceci s’applique (…) á compter de certains numÅros de sÅrie et sous conditions (visite <strong>10</strong>00h appliquÅe, BS pour les numÅros de sÅrie plus anciens). (…)AviasportGasoline forever…Ne parlez pas de KÅrosÇne chez Trace‐Engines : aprÇs avoir repris le programme du V‐8 Orenda et certifiÅle groupe OE‐600 de 600 ch, ce motoriste a augmentÅ sa puissance de 150 ch pour mieux concurrencer,selon lui, les turbines les plus rÅpandues, en l’occurrence <strong>la</strong> gamme des P&W‐Canada PT‐6… DotÅ d’uneinjection et d’un allumage Ålectroniques, le TE‐750 conserve <strong>la</strong> base de l’OE‐600 avec turbo et le refroidissementliquide, ce qui facilitera sa certification. Face aux turbines, son producteur met en avant demeilleures performances en altitude et des coéts de rÅfection infÅrieurs. Son nouveau V‐8 doit âtre opÅrationnelen 2011 (traceengines.com)Jet‐A1 onlyDeux pilotes d’un Diamond DA‐42NG ÅquipÅ de moteurs Austro‐Engines ont rÅalisÅ fin 2009 une <strong>la</strong>rgeboucle sur le Proche‐Orient et l’Afrique de l’Est au cours d’un aller‐retour de Wiener‐Neustadt á Kampa<strong>la</strong>. Autotal, 8000 nautiques ont ÅtÅ couverts et 80 heures de vols effectuÅes en comptant les dÅmonstrations. Lesnavigations ont ÅtÅ menÅes entre 135 et 160 nœ uds pour 50 á 70% de <strong>la</strong> puissance. L’avionneurvou<strong>la</strong>it ainsi prÅsenter son bimoteur dans des pays oä l’Avgas n’est pas distribuÅ, et oä 22 Diamond dieselsdoivent âtre livrÅs en 20<strong>10</strong>.DiversAviasportA quoi servent les altiports des PyrÅnÅes ?
26Jadis, <strong>la</strong> station de Peyresourde s’enorgueillissait de possÅder le seul altiport goudronnÅ des PyrÅnÅes.Les choses ont bien changÅ… Depuis plusieurs annÅes, <strong>la</strong> piste est fermÅe á <strong>la</strong> demande du gestionnairede <strong>la</strong> station de ski tous les week‐ends d’hiver et pendant les vacances sco<strong>la</strong>ires, pour servir de parking pourles camping‐cars, ou mâme de piste de luge alors que le domaine est á quelques dizaines de mÇtres! Mâme <strong>la</strong> crÅation d’un aÅroclub sur le site n’a pu, pour l’instant, empâcher cette situationubuesque. Les pilotes souhaitant maintenir leur entraãnement ou simplement utiliser l’avion pour veniraux sports d’hiver en sont rÅduits á attendre <strong>la</strong> fin de <strong>la</strong> saison de ski ou d’aller skier ailleurs. On imagineles rÅactions vÅhÅmentes si l’on agissait de mâme á MÅribel ou MegÇve.Salon de l’Aviation verteDu 18 au 20 juin, <strong>la</strong> seconde Ådition du salon Åcologique organisÅ par le musÅe de l’Air et de l’Espace prÅsenterales derniÇres innovations technologiques : avions Ålectriques, so<strong>la</strong>ires, nouveaux matÅriaux ou carburantsalternatifs. Des dÅmonstrations en vol d’ULM, paramoteurs et avions lÅgers É verts Ö ainsi que dedirigeables so<strong>la</strong>ires doivent composer le premier meeting aÅrien É zÅro Åmission Ö. (…)Canard de recordLa compÅtition d’Åconomie amÅricaine Fuelventure 400 se dÅroule sur un triangle de 400 miles. Ses trois catÅgories(500 kg ou moins, 501 á 750 kg et 751 á <strong>10</strong>00kg) sont ouvertes aux avions pouvant croiser á plus de120 nœ uds. L’Ådition de 2009 a eu lieu fin octobre entre Casa‐Grande, Yuma et Blythe. K<strong>la</strong>us Savier, lecrÅateur de Light Speed Engineering, a dominÅ l’Åpreuve, toutes catÅgories confondues, aux commandesde son Vari‐Eze modifiÅ dÅnommÅ De<strong>la</strong>minator en rÅussissant, avec un passager á bord, á parcourir le triangleá <strong>la</strong> moyenne de 333 km/h pour une consommation de 5,23 l aux <strong>10</strong>0 km. Lien : lightspeedengineering.com etfuelventure.orgGaffe slovaqueUn exercice de séretÅ aÅroportuaire organisÅ en Slovaquie tourne au gag quand l’avion dÅcolle avec les explosifsque <strong>la</strong> police aidÅe de chiens renifleurs n’a pas trouvÅs.Info‐PiloteAÅroport paralysÅ… pour un baiserUn Åtudiant a provoquÅ une belle panique á l’aÅroport de Newark (New Jersay) en franchissant un cordon desÅcuritÅ pour rejoindre sa petite amie et l’embrasser une derniÇre fois avant qu’elle n’embarque pourLos Angeles. PÅnÅtrant dans une zone interdite, l’intrus a ÅtÅ repÅrÅ par les camÅras de surveil<strong>la</strong>nce.RÅsultat : tout le trafic a ÅtÅ suspendu pendant six heures au terminal principal. Pour ce geste so romantic,le jeune homme risque trente jours de prison.TANAY Matthieu
27Revue de Presse nä<strong>10</strong> mars 20<strong>10</strong>EDITOLes beaux jours reviennent, et avec eux leur lot de sorties aÅronautiques. Il faut donc en profiter pour revoler,pour ceux qui le peuvent. Surtout qu’une petite rÅvolution est en train de s’organiser dans <strong>la</strong> rÅglementation,tant au niveau national qu’europÅen. La nouvelle version de <strong>la</strong> rÅglementation des CNSK – avions en kits –est arrivÅe et avec elle son lot debonnes nouvelles. De fait, Dyn’AÅropeut <strong>la</strong>ncer son projet de bimoteurlÅger sur une base de MCR‐4S. Deplus, <strong>la</strong> premiÇre version de l’ELA –l’Åquivalent du LSA amÅricain – esten phase de finalisation et l’EASA va<strong>la</strong>ncer <strong>la</strong> partie consultative. S’en suivraune rÅglementation moins lourde etmieux adaptÅe aux aÅronefs lÅgers etá l’aviation lÅgÇre. Par ailleurs, dessignes de re<strong>la</strong>nce pointent le bout deleur nez. Dyn’AÅro (toujours eux)Åtudie <strong>la</strong> certification du MCR‐4S et<strong>la</strong>nce parallÇlement une Åtude sur <strong>la</strong> faisabilitÅ d’un avion bois et toile, remp<strong>la</strong>Üant du DR400, ainsi quede <strong>la</strong> re<strong>la</strong>nce de l’activitÅ CAP, dont <strong>la</strong> voltige a tellement besoin. Ainsi de nombreuses initiatives sont<strong>la</strong>ncÅes pour redonner du souffle á ce pan de l’Åconomie qui manquait cruellement de moyens et d’innovationces derniÇres annÅes. L’innovation, lá est <strong>la</strong> clÅ du redÅmarrage de l’Åconomie, et sous toutes ces formes.L’innovation va nous permettre de rester compÅtitifs et attractifs, d’attirer des industriels sur les parts demarchÅ de l’aviation lÅgÇre <strong>la</strong>issÅ á l’abandon, faute de moyens, et surtout faute de passionnÅ assez fou(comme l’Åtait Auguste Mudry crÅateur de gÅnie de <strong>la</strong> GÅnÅration CAP) pour se <strong>la</strong>ncer dans une aventure dontle cadre lÅgal Åtait devenu plus sclÅrosant que passionnant. L’innovation est <strong>la</strong> clÅ de l’aviation lÅgÇre franÜaise,qui fait partie de notre patrimoine national.ConstructeursåAviasportLe PiperSport en FranceIci comme aux USA, le nouveau bip<strong>la</strong>ce LSA double le SkyCatcher par suprise. Alors que Cessna doit encorereconnaãtre des retards pour le programme de son LSA, Piper surfe sur l’avantage de reprendre unavion existant : le producteur de Vero‐Beech dÅbutera les livraisons le mois prochain gràce aux capacitÅsdes ateliers du groupe tchÇque S<strong>la</strong>via, d’oä sont dÅjá sortis 750 exemp<strong>la</strong>ires du bip<strong>la</strong>ce, pour <strong>la</strong> plupart sousforme de kits. L’importateur franÜais de l’ex‐Sport‐Cruiser a hissÅ les couleurs de l’avionneur entre Paris etOrlÅans. (…) Le PiperSport se dÅmarque du SkyCatcher par sa motorisation confiÅ au Rotax 912. L’avionneurhistorique rompt ainsi avec <strong>la</strong> tradition des moteurs amÅricains Ågalement historiques, mais dÅsormais perturbÅspar <strong>la</strong> fiabilitÅ avÅrÅe, <strong>la</strong> consommation et le gain de masse du Rotax, le Piper bip<strong>la</strong>ce profite d’une capacitÅd’emport donnÅe pour 272kg et d’un rayon d’action annoncÅ de 1<strong>10</strong>0km. (…)Kits : enfin un cadre adaptÅ. Le nouveau CNSK est paru le 25 janvierTrente ans aprÇs l’apparition d’ensembles permettant des constructions standardisÅes d’aÅronefs par desamateurs, <strong>la</strong> France dispose d’une rÅglementation cohÅrente. La France se singu<strong>la</strong>rise en sÅparant, ausein de <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse des appareils de constructions amateur, ceux originaux (prototypes et construits sur p<strong>la</strong>ns correspondantau CNRA) de ceux issus de kits. Cette seconde c<strong>la</strong>sse, apparue ici (des kits Åtaient proposÅsdepuis quelques annÅes au USA) au dÅbut des annÅes 1980 avec le programme de l’Orion, un ambitieuxpusher composite dont les kits ont commencÅ á âtre distribuÅs, s’est retrouvÅe dÅ<strong>la</strong>issÅe aprÇs lecrash du prototype en 1985. Les kits resteront juste tolÅrÅs (circu<strong>la</strong>tion sous <strong>la</strong>issez‐passer) jusqu’á <strong>la</strong>parution en 1998 du CNSK, un texte rÅglementaire accouchÅ difficilement au terme de nombreusesannÅes d’Åchanges difficiles entre de multiples acteurs. Amateurs, producteurs, importateurs, avionneurs etadministration avait fini par s’accorder sur ce compromis forcÅment bancal, qui n’a intÅgrÅ que d’extrâme justesseles avions quadrip<strong>la</strong>ces. Au fil des ans, nombre de problÇmes sont donc apparus, pour l’autoritÅ commepour l’utilisateur. Une refonte s’est donc imposÅe. (…) Ce 25 janvier, <strong>la</strong> DGAC a ainsi publiÅ le nouveauCNSK. (…) les possibilitÅs ont ÅtÅ Å<strong>la</strong>rgies pour les avions, avec des augmentations de p<strong>la</strong>ces (on passede 4 á 5 occupants), de masse (de <strong>10</strong>00 á 1200kg pour rejoindre les ELA‐1), de puissance (de 200 á 360ch)
28et de motorisation (du monomoteur aux É multi‐pistons Ö et au monoturboprop). (…) L’alignement de cette dÅfinitionavec celle de l’ELA permettra á un constructeur de passer du kit á l’avion certifiÅ plus facilement. (…) LesimprÅcisions concernant les modifications, les utilisations en aÅro‐clubs pour les formations et les vols á l’Åtrangersont levÅes. (…)Le Cirrus Vision SF‐50 s’essouffleCirrus‐Aircraft ne parvient toujours pas á rÅunir les fonds nÅcessaires au dÅveloppement de son monorÅacteurCirrus Vision SF‐50. Ce<strong>la</strong> fait maintenant deux ans que le programme avance á petits pas. Le constructeuradmet dÅsormais qu’il n’est plus en mesure de tenir les dÅ<strong>la</strong>is. L’entrÅe en service ne se fera pasen 20<strong>10</strong> comme prÅvu. Aucune date n’est avancÅe tant que de nouveaux fonds n’auront pas ÅtÅ levÅs. Le prototypetotalise 240 heures de vol et le moteur Williams‐International FJ‐33, 400 heures de fonctionnement.Le domaine de vol a ÅtÅ entiÇrement ouvert et les essais de vrilles ont ÅtÅ menÅs avec succÇs, affirme leconstructeur. Cirrus‐Aircraft fait Åtat de 482 rÅservations assorties d’un dÅpÑt de 50 000 dol<strong>la</strong>rs. Il affirmerecevoir une á deux nouvelles commandes par semaine. Le prix catalogue du SF‐50 est de $1,72M.Info‐PiloteLe Twin R, un bimoteur dans <strong>la</strong> gamme MCRChristophe et Pierre Robin travaillent en secret depuis 2004 sur un bimoteur á train fixe dÅrivÅ du MCR4S : le Twin R. (…) É Au dÅpart, c’Åtait un projet CNRA purement personnel. Et puis <strong>la</strong> lÅgis<strong>la</strong>tion rÅgissant leskits interdisait de vendre autre chose que des monomoteurs. Ö, explique Christophe. Ce n’est plus le cas depuisle 4 fÅvrier dernier et <strong>la</strong> publication au journal officiel d’un arrâtÅ modifiant plusieurs points de cette rÅglementation.Le Twin R sera donc vendu en kit, puis en ELA. Il sera motorisÅ par deux Rotax 912S (<strong>10</strong>0 hp).Performances annoncÅes : 300 km/h á 75% pour 30 l de consommation carburant (2x15 l). Jusqu’á septheures d’autonomie á 65% de <strong>la</strong> puissance. Masse á vide : 450kg. Masse max : 950kg. É Notre objectif estd’atteindre ces performances pour un coét semb<strong>la</strong>ble á celui d’un DR400‐160 Ö. Le Twin R sera prÅsentÅ áFriedrichshafen. L’amÅnagement de <strong>la</strong> cabine est achevÅ, il sera identique á celui du futur MCR 4S ELA.La date du premier vol n’est pas encore fixÅe.Le LH‐<strong>10</strong> Ellipse en finaleLe bip<strong>la</strong>ce tout composite imaginÅ par <strong>la</strong> sociÅtÅ LH Aviation devrait âtre commercialisÅ dÇs cet ÅtÅ. Pour l’heure,l’entreprise franÜaise (dorÅnavant basÅ á Melun‐Vil<strong>la</strong>roche‐LFPM) a dÅbutÅ <strong>la</strong> derniÇre phase d’essais del’appareil. Rappelons que ce bip<strong>la</strong>ce aux allures de BD‐5 est motorisÅ par un Rotax 912S associÅ á une hÅlicepropulsive. Les performances annoncÅes sont ambitieuses. CroisiÇre Åco : <strong>10</strong>0kt, croisiÇre max : 200kt, dÅcrochage: 53kt, dÅcol<strong>la</strong>ge en 250m, atterrissage en 450m, autonomie en croisiÇre Åco : <strong>10</strong>h. L’appareil sera d’abordproposÅ en kit. Une version É prât‐á‐voler Ö, vendu dans <strong>la</strong> catÅgorie ELA 1 est en projet. LH AviationprÅvoit d’honorer sa premiÇre commande (deux appareils) dÇs cet ÅtÅ. (…)Un Cri Cri en Iran…AprÇs le LE‐500, le quadrip<strong>la</strong>ce chinois inspirÅ du TB20, c’est au tour du Cri Cri de faire <strong>la</strong> une de l’actualitÅ.Le ministÇre iranien de <strong>la</strong> DÅfense et de l’entreprise Fajr Aviation ont prÅsentÅ le Faez, un monop<strong>la</strong>ceplus que ressemb<strong>la</strong>nt au Cri Cri signÅ Michel Colomban. Le Faez serait construit en composite, dotÅd’un parachute de cellule (!) et de deux moteurs d’une puissance É supÅrieure Ö á 25hp chacun. Masse á vide: 78kg. MTOW : 175kg. Il afficherait 220km/h de vitesse max et 1500km de distance franchissable. L’appareildevrait âtre commercialisÅ á un prix compris entre 40 000 et 50 000$.DiversAviasportL’aÅroport Tarbes – Lourdes mise sur l’aviation gÅnÅrale SpÅcialisÅ dans les charters de pÇlerins (70% del’acticitÅ passager), l’aÅroport Tarbes‐Lourdes‐ PyrÅnÅes mise dÅsormais sur l’aviation d’affaires et l’aviationgÅnÅrale pour dÅvelopper l’activitÅ de cette p<strong>la</strong>te‐forme. Cette nouvelle orientation correspond á <strong>la</strong> prise enmain de <strong>la</strong> gestion par <strong>la</strong> sociÅtÅ canadienne SNS‐Lavalin en 2009. (…)
29Projet de campus aÅronautique á Lyon‐Saint‐ExupÅryRegrouper sur un lieu unique tous les moyens nÅcessaires aux pilotes professionnels (centre mÅdical compris)pour se former et maintenir leurs compÅtences : tel est l’objectif de l’ambitieux projet Air‐ Campus‐Simulflight‐Center qui devrait voir le jour en 2011 sur l’aÅroport Lyon‐Saint‐ExupÅry. (…) A terme, tel que l’imagineLaurent Japhet, porteur du projet, l’Air‐Campus‐Simulflight‐Center de Lyon devrait regrouper huit simu<strong>la</strong>teurs fullflight(level D), des simu<strong>la</strong>teurs FNP‐T2, un hÑtel‐restaurant 4‐ Åtoiles, un centre d’expertise mÅdicale, uneÅcole de formation des personnels de cabine et une Åcole de pilotage (formation ab initio).PiloterProrogation SEP/TMG par internetLa DGAC n’Åchappe pas á <strong>la</strong> rÇgle actuelle de ne pas remp<strong>la</strong>cer un fonctionnaire sur deux partant en retraite,ses effectifs vont diminuer á l’avenir… Vers les usagers, Åvidemment, <strong>la</strong> communication n’utilise pas cetargumentaire, mais <strong>la</strong> volontÅ de rendre du service aux pilotes ! Ainsi <strong>la</strong> prorogation d’une qualif de c<strong>la</strong>sse devraitpouvoir se faire prochainement via Internet en Åvitant un dÅp<strong>la</strong>cement á <strong>la</strong> DSAC locale. Ceci aurait dé âtreactif depuis fin janvier mais <strong>la</strong> mise en ligne a ÅtÅ retardÅe… CÑtÅ modalitÅs pratiques, il faudra remplir á l’Åcranles heures effectuÅes dans les 12 derniers mois et indiquer <strong>la</strong> date du vol de 1h00 avec FI avantd’avoir en retour un numÅro d’enregistrement á reporter sur sa licence pour garder une trace. Pour <strong>la</strong>DGAC, il ne reste plus que <strong>la</strong> facette É contrÑle Ö a posteriori….TANAY Matthieu
30La Commission Jeunes <strong>Toulouse</strong>-<strong>Midi</strong>-PyrÄnÄesau MusÄe de l’Air et de l’EspaceCarole ROMBOLETTI, Thibaut MIQUELPar un froid g<strong>la</strong>cial, le 30 janvier 20<strong>10</strong>, 32 Åtudiants de <strong>la</strong> Commission Jeunes <strong>Toulouse</strong>-<strong>Midi</strong>-PyrÅnÅes sont allÅsvisiter le MusÅe de l’Air et de l’Espace du Bourget.Nous Åtions accompagnÅs par M. Gourinat, professeur de MÅcanique et de Techniques Spatiales á l’ISAE et membredu bureau rÅgional, qui nous a commentÅ <strong>la</strong> visite des diffÅrents halls du musÅe.Figure 1: EntrÄe du MusÄe du BourgetNous avons ÅtÅ accueillis par M. Pierre FranÜois Mouriaux, membre de <strong>la</strong> direction du musÅe et passionnÅ de technologiespatiale. Il nous a prÅsentÅ l’Åvolution du musÅe á travers l’acquisition de diffÅrents objets dont certains onteu une vie mouvementÅe al<strong>la</strong>nt de l’espace au septiÇme art á l’image du module de commande ÉOdyssey Ö, utilisÅpendant <strong>la</strong> mission Apollo 13 et le film du mâme nom.Figure 2 : PrÄsentation du hall Espace par M. MouriauxLa visite du hall Espace a continuÅ avec M. Gourinat. Il a ÅvoquÅ l’histoire de <strong>la</strong> conquâte spatiale et notammentl’histoire spatiale franÜaise de <strong>la</strong> sÅrie des Épierres prÅcieuses Ö qui ont fait de <strong>la</strong> France <strong>la</strong> troisiÇme puissance spatialemondiale, jusqu’á <strong>la</strong> coopÅration europÅenne avec <strong>la</strong> fusÅe Ariane.1Institut SupÅrieur de l’AÅronautique et de l’Espace
31Figure 3 : SÄrie des "Pierres prÄcieuses"Figure 4 : Ariane V et Ariane 1 en arriàrep<strong>la</strong>nLes exploits soviÅtiques n’ont pas ÅtÅ oubliÅs : du premier satellite envoyÅ dans l’espace aux capsules qui ontpermis aux hommes de faire le tour de <strong>la</strong> Terre en moins de 2 heures, M. Yves Gourinat a dÅcortiquÅ pour nousles ÅvÇnements politiques et scientifiques qui ont conduits á de telles prouesses, le tout ponctuÅ d’anecdotes etde souvenirs personnels rapportÅs de son sÅjour á <strong>la</strong> CitÅ des Åtoiles en 1994 oä il avait suivi les diffÅrentes phasesde <strong>la</strong> formation des cosmonautes.Figure 5 : Satellite SpoutnikDurant <strong>la</strong> visite, nous avons Ågalement ÅtÅ accompagnÅs par Anne-Catherine SOUCHON 2 , Åcrivain et journalistescientifique, chargÅe de couvrir des <strong>la</strong>ncements (parfois habitÅs) de fusÅe pour diffÅrentes revues spÅcialisÅes.Elle nous a fait partager ses souvenirs et ses connaissances sur <strong>la</strong> grande famille des spationautes qu’elle a cÑtoyÅdurant toute sa carriÇre.Les autres halls du musÅe sont consacrÅs aux aÅrodynes, á l’exception de <strong>la</strong> salle des ballons ; gràce á notreguide, nous ont eu un Åc<strong>la</strong>irage technique sur les diffÅrentes machines vo<strong>la</strong>ntes qui parsÇment le musÅe, quelquesoit leur àge ou leur origine.2 Auteur de Femmes de l’Espace aux Åditions Carnot
32Figure 6 : P<strong>la</strong>neur de Jean-Marie le BrisFigure 7 : Mauqette de l'aÄrostat des FràresLe hall contenant les machines des dÅbuts de l’aviation et de <strong>la</strong> PremiÇre Guerre Mondiale rÅsonne des difficultÅsrencontrÅes par les pionniers de l’aviation pour maãtriser les lois physiques du vol ainsi que du courage des hommesqui se sont <strong>la</strong>ncÅs et ont ensuite combattu dans les airs dans des engins trÇs peu fiables au niveau structureldurant <strong>la</strong> Guerre.Entre les deux guerres, beaucoup de progrÇs ont ÅtÅ fait et on a vu apparaitre une multitude de constructeursavec le dÅbut du tourisme aÅrien qui ont conduit á <strong>la</strong> construction de beaucoup de p<strong>la</strong>neurs comme le Fauvel.L’aviation commerciale n’a pas ÅtÅ en reste avec des avions comme les É BrÅguet Ö, mais s’est essoufflÅe avecl’arrivÅe de <strong>la</strong> DeuxiÇme Guerre Mondiale.Figure 8 : Fauvel avec un profil type “aile vo<strong>la</strong>nte”Deux autres halls renfermaient les avions militaires actuels et ceux de <strong>la</strong> seconde guerre mondiale. M. Yves Gourinatnous a fait une comparaison des appareils au niveau du rendement des moteurs, de leur puissance et plusgÅnÅralement de leurs performances.Figure 9 : Spitfire
33A cÑtÅ, diffÅrentes voilures tournantes Åtaient prÅsentÅes. Certaines Åtaient insolites á l’image de l’autogire ÉLaCierva Ö qui avait une petite voilure fixe et quatre pales auto rotatives, et d’autres plus popu<strong>la</strong>ires comme les deuxÉAlouettesÖ exposÅes, qui Åtaient trÇs utilisÅes par les forces armÅes comme <strong>la</strong> Gendarmerie. L’une des deuxÉ Alouette Ö exposÅes a servi á Jean Boulet pour le record d'altitude toutes catÅgories pour hÅlicoptÇres (12 440m) qu’il dÅtient depuis 1972.Figure <strong>10</strong> : Djinn Ü rÄaction en bout de paleFigure 11 : Alouette GendarmerieDans le Hall renfermant les prototypes, les particu<strong>la</strong>ritÅs de chaque appareil ont toutes ÅtÅ dÅtaillÅes, que ce<strong>la</strong>concerne une innovation structurelle (le profil, les matÅriaux utilisÅs) ou le mode de propulsion.Nous avons Ågalement eu un exposÅ technique sur les prouesses rÅalisÅes sur le Concorde ainsi que l’Åvolutiondes technologies au cours des 27 annÅes de service en comparaison des deux appareils exposÅs : le Concorde F-WTSS prototype 001 et le Concorde F-BTSD Sierra Delta, l'un des derniers Concorde Air France á avoir volÅ.Figure 12 : Le groupe devant le ConcordeC’est avec des Åtoiles plein les yeux que nous sommes repartis du musÅe.Cette expÅrience fut enrichissante pour tous les Åtudiants : en plus de les faire râver, elle leur a permis d’en apprendredavantage sur le monde aÅronautique et spatial, et pour certain de prÅciser leur projet professionnel.Nous souhaitons aussi remercier M. Yves Gourinat pour nous avoir guidÅs á travers ce vaste musÅe ainsi que M.Mouriaux et Mme Souchon pour nous avoir accompagnÅs durant <strong>la</strong> visite et enfin, nous espÅrons pouvoir pÅrennisercette activitÅ au sein de <strong>la</strong> <strong>3AF</strong> TMP et <strong>la</strong> voir s’Åtendre á d’autres groupes rÅgionaux ainsi que l’enrichir avecpar exemple, <strong>la</strong> visite des ateliers de restauration du MusÅe.
34Participation de <strong>la</strong> <strong>3AF</strong> au 3àme congràs nationalde protection du Ciel et de l’environnement nocturneMichel Bonavitaco<strong>la</strong>Le 3Çme congrÇs National sur <strong>la</strong> "Protection de l'Environnement Nocturne" s’est dÅroulÅ á Fleurence dansle Gers les 23 ,24 et 25 octobre.Cette manifestation > > <strong>la</strong>bellisÅ É AnnÅe Mondiale de l’astronomie 2009 É Åtait organisÅe par l’associationLICORNESS, > La Ferme des Åtoiles, l’A.N.P.C.E.N. <strong>la</strong> Ville de Fleurance avec le soutient de l’Observatoire<strong>Midi</strong> PyrÅnÅes et de Mr Martin Malvy prÅsident du conseil rÅgional de <strong>Midi</strong> PyrÅnÅes >É Il ne faut pas fermer <strong>la</strong> fenâtre vers l’infini Ö, dÅc<strong>la</strong>rait l’astrophysicienne Sylvie Vauc<strong>la</strong>ir de l’observatoire<strong>Midi</strong> PyrÅnÅes dans son discours d’ouverture du congrÇs.Pendant ces 3 jours se sont dÅroulÅs prÇs de 40 interventions,rÅunions de travail et d’assemblÅes spÅcifiques.Les thÇmes abordÅs trÇs variÅs ont permis de faire le point surles derniÇres technologies, processus et avancÅes dans lemonde, en Europe et en France sur l’Åc<strong>la</strong>irage artificiel et sesimpacts sur l’environnementLes commissions se rÅpartissaient comme suit :- Enjeux, droit et rÅglementation- Technologies, usages et normes- AmÅnagement du territoire- Impact de <strong>la</strong> lumiÇre artificielle sur l’environnement- Recherche et dÅveloppement- AÅronautique et astronautique- Patrimoine culturel- FormationLe 3Af a participÅ activement á ce congrÇs :- Au travers d’un stand .Beaucoup de discussions et d’informationsy ont ÅtÅ distribuÅes par les membres prÅsentsnotamment Philippe Mairet et Jean Luc Chanel. (voir photo1).- Au travers de prÅsentations dans le cadre des commissionsÉ AÅronautique et astronautique Ö et É recherche etdÅveloppement Ö.1 – trainÄes de condensation :Les astronomes ont exposÅ les difficultÅs qu’ils rencontraient dans leurs activÅs d’observation lors de <strong>la</strong>formation des trainÅes de condensations d’aÅronefs <strong>la</strong> nuit au dessus des sites astronomiques professionnels.L’intervention de Corine Marizy de <strong>la</strong> <strong>3AF</strong> sur le thÇme É TrainÅes de condensations est ce inÅvitables ? Öa ÅtÅ particuliÇrement apprÅciÅe.Certains observatoires astronomiques effectuent <strong>la</strong> nuit des monitorings de <strong>la</strong> voute cÅleste avec des camÅrasultra sensible grand champs (All sky camera,ALPI…. ). Cette surveil<strong>la</strong>nce est destinÅ á <strong>la</strong> dÅtectionde mÅtÅores, de phÅnomÇnes atmosphÅriques transitoires,surveil<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> pollution lumineuse ,…Cesmesures et images pourraient Åventuellement âtre mises á <strong>la</strong> disposition des spÅcialistes et chercheurs(cadre á dÅfinir) afin de mieux apprÅhender <strong>la</strong> formation et <strong>la</strong> durÅe des trainÅes de condensations <strong>la</strong> nuit.
352- Moyens de contrÅles depuis le sol ,et depuis des moyens aÄriens et spatiaux.Dans le cadre des politiques É environnement et de dÅveloppement durable Ö les autoritÅs locales, nationales etinternationales souhaitent s’engager dans des dÅmarches de É dÅpollution lumineuse Ö.En France ,depuis le vote de <strong>la</strong> loi Grenelle 1 de l’environnement <strong>la</strong> pollution lumineuse est officiellement reconnuecomme une nuisance .Loi Grenelle 1 Art 33- Les Ämissions de lumiÅre artificielle de nature Ç prÄsenter des dangers ou Ç causer un troubleexcessif aux personnes, Ç <strong>la</strong> faune, Ç <strong>la</strong> flore ou aux ÄcosystÅmes, entraÉnant un gaspil<strong>la</strong>ge ÄnergÄtique ouempÑchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prÄvention, de suppression ou de limitation.Le Grenelle 2 prÅcise le cadre rÅglementaire et les c<strong>la</strong>uses techniques.Les grandes agglomÅrations en Europe (et plus rÅcemment en France) Åtablissent dÅsormais des bi<strong>la</strong>ns approfondisdes Åc<strong>la</strong>irages des zones urbaines et pÅri urbaines. (exemple Lille , <strong>Toulouse</strong>,…). Les trames vertes et p<strong>la</strong>nsd’amÅnagements des territoires commencent á prendre en compte <strong>la</strong> problÅmatique de <strong>la</strong> protection de l’environnementnocturne.Le projet É Constel<strong>la</strong>tion Terre Ö que j’ai longuement abordÅ dans des articles prÅcÅdents et sur <strong>la</strong> revue Horizonde l’AIAA Houston consiste á observer <strong>la</strong> Terre <strong>la</strong> nuit soit depuis le sol , soit avec des moyens aÅriens ,soit depuisl’espace L’objectif est de rÅaliser un contrÑle permanent des sources lumineuses artificielles et d’en Åvaluer l’impactsur l’environnementLes observations et mesures effectuÅes doivent permettre de valider <strong>la</strong> conformitÅ des instal<strong>la</strong>tions rÅalisÅes auxrÇgles d’urbanisme et cahiers des charges .De nouveaux processus , mÅthodes d’analyse et traitement de donnÅesdoivent âtre dÅveloppÅs (localisation des sources lumineuses artificielles , photomÅtrie et rÅpartition des fluxdans l’espace ,spectroscopie,…).Ces sujets ont ÅtÅ abordÅs aux seins des commissions É Recherche et dÅveloppement et É astronautique et aÅronautiqueÖ. Plusieurs avancÅes notables ont ÅtÅ prÅsentÅes comme <strong>la</strong> crÅation de banque de donnÅes des imageset mesures (Earth Constel<strong>la</strong>tion Data Bank) , Åvolution des modÅlisation, banques de donnÅes des sourceslumineuses artificielles ,Åtudes d’impact sur les parcs nationaux et rÅserves naturelles, corridors de noir…3 – L’Ecole d’Aviation Civile prÄsente un projet utilisant des mini drones :Courant juin une premiÇre rÅunion á l’Åcole nationale d’aviation civile de <strong>Toulouse</strong> avait rÅuni des membres de Licorness,de <strong>la</strong> <strong>3AF</strong> <strong>Midi</strong> PyrÅnÅes et le <strong>la</strong>boratoire mini drone animÅ par Madame Catherine Ronfle-Nadaud, coordinatricede l’unitÅ de recherche et d’innovation sur les drones. Cette rÅunion avait permis d’explorer les multiplespossibilitÅs offertes par les mini drones pour effectuer des bi<strong>la</strong>ns pollutions lumineuses.Utiliser les mini drones est trÇs intÅressant du fait de leur faible cout et de leur souplesse d’utilisation.Durant le congrÇs Mme Catherine Ronfle-Nadaud,Michel Gorraz (ingÅnieur au DÅpartement Communication,Navigation, Surveil<strong>la</strong>nce de l'ENAC) ainsique Joris Scatolin (ÅlÇve IngÅnieur Enac en 2eannÅe et membre du Club Drones de L'ENAC) prÅsententle projet É Paparazi Ö qui a remportÅ leChallenge Minidrones 2007-2009 organisÅ par <strong>la</strong>direction GÅnÅrale de l’Armement et l’ONERA.Deux types de mini drones sont prÅsentÅs. Ils sonttous deux propulsÅs par des moteurs Ålectriques .La dÅmonstration en vol d’un mini drone quadrimoteurau dessus du stade de Fleurence (photo 2) apermis á chacun d’apprÅcier <strong>la</strong> manœuvrabilitÅ et<strong>la</strong> fiabilitÅ de ce systÇme. Ensuite un bimoteur estprÅsentÅ en statiqueIl s’agirait d’Åquiper des mini drones de camÅra et capteurs (photomÇtres) afin de rÅaliser des bi<strong>la</strong>ns É pollutionlumineuse Ö lors de vols de nuit. Suivant le drone et le matÅriel embarquÅ <strong>la</strong> technique consisterait á effectuer unquadril<strong>la</strong>ge trÇs prÅcis et mÅthodique á vitesse rÅduite et á diffÅrentes altitudes d’une zone de plus ou moins grandede <strong>la</strong> zone. á Åtudier. On pourrait ainsi pour certaines sources artificielle obtenir <strong>la</strong> rapidement <strong>la</strong> rÅpartition spatialedu flux lumineux Åmis.
364 – Exploitation des images de nuit prises depuis <strong>la</strong> station spatiale internationaleLaurent Tasserie , responsable du groupe de travail imagerie spatiale de Licorness prÅsente les derniers travauxeffectuÅs sur l’exploitation de image de nuit prisent depuis l’ISS. Ces travaux ont ÅtÅ initiÅs par Licorness il y a 2ans et approfondis lors d’un stage Åtudiant proposÅ par Licorness á l’universitÅ de Paul Sabatier . Ils sont aujourd’huile fruit d’une col<strong>la</strong>boration Åtroite entre Licorness, <strong>la</strong> commission É exploration humaine et robotique de<strong>la</strong> <strong>3AF</strong> <strong>Midi</strong> PyrÅnÅes et L’AIAA Houston.Les images sont rÅalisÅes par les astronautes lors du survol de nuit des zones urbaines. Depuis l’instal<strong>la</strong>tion d’unsystÇme de suivie (tracking) associÅ au systÇme de prise de vue, <strong>la</strong> qualitÅ des clichÅs s’est nettement amÅliorÅeen terme de rÅsolution spatiale , colorimÅtrie, et seuil photomÅtrique de dÅtection,Il est dÅsormais possible de les utiliser pour effectuer des bi<strong>la</strong>ns environnementaux. On peut ainsi analyserscientifiquement ces clichÅs .Le projet prÅsentÅ dans le cadre de É Constel<strong>la</strong>tion Terre Ö consiste á mettre aupoint des outils et processus pour identifier, repÅrer ,mesurer le flux lumineux ,et Åtablir le spectre des Åc<strong>la</strong>iragesartificiels . Ces mesures seront utilisÅs pour recaller des modÇles et des banques de donnÅes et á observer l’Åvolutionde <strong>la</strong> pollution lumineuse dans le temps.5 – ModÄlisations / bi<strong>la</strong>ns cartes 3DLe modÇle de pollution lumineuse (THOTPRO) et les basesde donnÅes associÅs dÅveloppÅs par Licorness est fiable.Ils permet de rÅaliser des cartes de pollution lumineuse etd’effectuer des bi<strong>la</strong>ns environnementaux .Ces cartes etbi<strong>la</strong>ns sont de plus en plus utilisÅs par les responsablesterritoriaux et les scientifiques.Nico<strong>la</strong>s Besso<strong>la</strong>z (vice prÅsident de Licorness et ingÅnieurau CEA Sac<strong>la</strong>y) prÅsente les derniÇres Åvolutions et optionsde modÅlisations, cartes et banques de donnÅes associÅes.Nico<strong>la</strong>s Vil<strong>la</strong> de <strong>la</strong> sociÅtÅ Vega Technologie á <strong>Toulouse</strong> aprojetÅ les cartes rÅalisÅes par Licorness sur des modÇles3D issu d’images satellitaires prises de jours (photo 3).Il estainsi possible d’effectuer un survol virtuel des zones á Åtudieret ainsi de repÅrer les zones polluÅes ou á protÅger .On peut faire des Åtudes paramÅtriques et les visualiserrapidement.Cette approche novatrice semble prometteuse . EspÅronsque les instances spatiales franÜaise et europÅennes soutiendrontconcrÇtement ces recherches.6 – Conclusions :Le 3 Çme congrÇs national s’inscrit dans <strong>la</strong> lignÅe des prÅcÅdents avec des Åchanges constructifs dans le cadremerveilleux <strong>la</strong> ferme des Åtoiles au coeur d’une des plus belle rÅgion de FranceLes sujets abordÅs ont ÅtÅ l’occasion d’Åchanges approfondis entre spÅcialistes venant de divers horizonsprofessionnels Des col<strong>la</strong>borations sur des travaux en cours ou nouveaux projets ont ÅtÅ initiÅs.L’aÅronautique et l’astronautique apportent incontestablement des techniques et moyens innovants et incontournablespour effectuer ces bi<strong>la</strong>ns ÅnergÅtiques et participer activement aux Åtudes d’impacts.Plusieurs rÅalisations et travaux ont fait l’objets de prÅsentations suivis de longues discussions techniques.Le compte rendu dÅtaillÅ est disponible á l’adresse suivante : http://astrosurf.com/licorness/
37Exploration spatiale : Coup d’arrèt ou renouveau ?Marc RieugnÄDans son budget NASA 2011, l’administration amÅricaine de B. Obama demandel’arrât du programme Constel<strong>la</strong>tion de retour á <strong>la</strong> Lune. Est-ce <strong>la</strong> fin del’exploration spatiale ? Les choses ne sont pas aussi simples qu’ont bien voulunous les prÅsenter les grands mÅdias.On nous a dit que le budget de <strong>la</strong> NASA Åtait É coupÅ Ö. La rÅalitÅ est touteautre : il augmente de 1,5% par rapport á celui de 20<strong>10</strong>, puis de 2,5% par anen moyenne les annÅes suivantes. On ne peut pas faire á l’administrationObama le procÇs de ne pas soutenir <strong>la</strong> NASA : <strong>la</strong> croissance proposÅe estsemb<strong>la</strong>ble aux projections budgÅtaires prÅ-crise de l’administration Bush, dansun nouveau contexte oä <strong>la</strong> volontÅ est de geler les dÅpenses de l’Etat fÅdÅral.Plus en dÅtail, l’exploration spatiale, spÅcifiquement destinÅe á <strong>la</strong> prÅparationde vols habitÅs au-delá de l’orbite basse, reÜoit 3,8 Md $ en 2011, passant á5,2 Md $ en 2015. Il faut aussi remarquer une ligne budgÅtaire de 500 M$ en2011 et de 1 Md $ les annÅes suivantes, hors exploration, intitulÅe É SpaceTechnologies Ö, inexistante les annÅes prÅcÅdentes. Par comparaison, le dernierbudget de l’administration Bush, celui de 2009, prÅvoyait 7 Md $ par anpour l’exploration spatiale á partir de 2011, dont seulement 500 M$ pour d’autresprogrammes que Constel<strong>la</strong>tion, en particulier <strong>la</strong> mÅdecine spatiale et tousles dÅveloppements technologiques nÅcessaires á l’instal<strong>la</strong>tion durable del’homme sur <strong>la</strong> Lune. Le budget de l’exploration spatiale est donc rÅduit certes,mais les montants engagÅs restent considÅrables. La rÅorientation fondamentaleest dans <strong>la</strong> mÅthode.DÅcol<strong>la</strong>ge de l’Ares I-X. Dernier actedu programme Constel<strong>la</strong>tion ?Image NASA/Tony Gray/Tom FarrarRevenons aux origines du programme d’exploration spatiale, <strong>la</strong> É Vision for Space Exploration Ö (VSE),telle que prÅsentÅe en 2004 par le prÅsident Bush. Il s’agissait de mettre en p<strong>la</strong>ce les conditions d’uneexploration spatiale durable au-delá de l’orbite basse et d’une expansion de l’Homme (AmÅricain) dans leSystÇme So<strong>la</strong>ire. Le document officiel dÅveloppant <strong>la</strong> VSE, datÅ de FÅvrier 2004 et disponible sur le sitede <strong>la</strong> NASA, <strong>la</strong> rÅsume ainsi :“The fundamental goal of this vision is to advance U.S. scientific, security, and economic interests througha robust space exploration program. In support of this goal, the United States will:• Implement a sustained and affordable human and robotic program to explore the so<strong>la</strong>r system andbeyond;• Extend human presence across the so<strong>la</strong>r system, starting with a human return to the Moon by the year2020, in preparation for human exploration of Mars and other destinations;• Develop the innovative technologies, knowledge, and infrastructures both to explore and to supportdecisions about the destinations for human exploration; and• Promote international and commercial participation in exploration to further U.S. scientific, security,and economic interests’’Il faut noter que les premiers budgets de <strong>la</strong> VSE, budgets 2005 et 2006, comportaient plus de 2000 M$par an pour <strong>la</strong> biologie spatiale, des prÅcurseurs robotiques, des dÅveloppements technologiques destinÅsá supporter l’exploration humaine.Or <strong>la</strong> plupart des dÅveloppements technologiques et des missions robotiques liÅes á l’exploration qui apparaissaientdans le budget de 2005 ont disparu en 2009 au profit d’un systÇme de <strong>la</strong>nceurs et de capsulesdÅveloppÅs au moindre risque technologique, sur <strong>la</strong> base des systÇmes des annÅes 1960-1970 maãtrisÅspar <strong>la</strong> NASA. L’exploration spatiale, sous <strong>la</strong> direction de M. Griffin, s’est concentrÅe peu á peu sur <strong>la</strong>rÅalisation de ce systÇme dans le but de se poser sur <strong>la</strong> Lune avant 2020. C’Åtait Constel<strong>la</strong>tion ou É Apolloon Steroids Ö. Mais ce programme ne procurait pas de retombÅes technologiques semb<strong>la</strong>bles á cellesd’Apollo puisqu’on utilisait des technologies ÅprouvÅes, et donnait une p<strong>la</strong>ce limitÅe á <strong>la</strong> prÅparation de <strong>la</strong>suite de l’exploration. C’est cette approche qui a ÅtÅ sÅvÇrement sanctionnÅe par l’administration Obama,qui reste fidÇle á l’esprit de <strong>la</strong> VSE exposÅe ci-dessus.
38Il s’agit donc d’engager une expansion durable dans le SystÇme So<strong>la</strong>iretel qu’on l’a dÅcouvert depuis 50 ans, avec les moyens qu’on a dÅveloppÅsdepuis, mais aussi avec d’autres moyens á dÅvelopper pour quel’exploration ne se rÅsume pas á un aller-retour lunaire sans lendemain.C’est pourquoi les dÅmonstrateurs technologiques reÜoivent de 600 á2000 M$ par an dans le dernier budget de <strong>la</strong> NASA.L’exploration du SystÇme So<strong>la</strong>ire ne se dÅroulera pas comme l’ont râvÅGoddard, Tsiolkovski, Oberth ou Esnault-Pelterie. A cette Åpoque, le SystÇmeSo<strong>la</strong>ire, c’Åtait les huit p<strong>la</strong>nÇtes, dont les plus proches pouvaient âtrehabitables ou au moins re<strong>la</strong>tivement hospitaliÇres. Les astÅroïdes Åtaient ceque leur nom dÅsigne : des É quasi-Åtoiles Ö, ponctuels, sans intÅrât. On nepouvait concevoir l’exploration du SystÇme So<strong>la</strong>ire que comme des voyagesentre une p<strong>la</strong>nÇte A et une p<strong>la</strong>nÇte B. Aujourd’hui, nous avons appris á travailleren microgravitÅ et nous savons que les p<strong>la</strong>nÇtes sont toutes inhospitaliÇres.Leur principal avantage, <strong>la</strong> gravitÅ qui permet aux astronautes deconserver leurs capacitÅs physiques, est aussi leur principal inconvÅnient,un puits gravitationnel dont il faut absolument sortir, et une gravitÅ de surfacequi impose une poussÅe minimale au systÇme propulsif. Le puits gravitationnelde <strong>la</strong> Terre est d’ailleurs le plus gros obstacle á l’exploration spatiale. Un <strong>la</strong>nceur lourd est nÅcessairepour n’importe quel programme d’exploration habitÅ.Dans le budget 2011, les Åtudes prÅparatoires au <strong>la</strong>nceur lourd reÜoivent de 600 á 750 M$ par an.Un objectif possible de l’exploration : cratÇreShackleton, au pole sud lunaire vu par <strong>la</strong>sonde SMART-1 – Image ESA/ Space-XPour une exploration spatiale durable, il s’agit aussi de dÅterminer d’abord quelles sont les tàches nÅcessitantune intervention humaine, quelles ressources facilement accessibles nous offre le SystÇme So<strong>la</strong>ire, ensuitecomment les exploiter pour minimiser <strong>la</strong> masse á enlever depuis <strong>la</strong> Terre, toutes les conditions á une explorationrationnelle. C’est le but des É prÅcurseurs robotiques Ö qui reÜoivent 500 á 900 M$ par an dans le budget de <strong>la</strong>NASA. Parmi les corps É facilement accessibles Ö depuis <strong>la</strong> Terre, il y a <strong>la</strong> Lune et les astÅroïdes gÅocroiseurs.Le delta-V nÅcessaire est voisin pour ces deux destinations, avec un avantage pour les derniers : leur gravitÅ estnÅgligeable, ce qui re<strong>la</strong>xe les contraintes sur le systÇme propulsif. Ils ont un intÅrât scientifique certain, peuventreceler des ressources utilisables, et aussi âtre des cibleset des re<strong>la</strong>is de plus en plus lointains sur notre cheminvers Mars et au-delá. C’est ce que suggÇre <strong>la</strong> commissionAugustine en prÅconisant un É flexible path Ö vers Mars.On a aussi montrÅ rÅcemment que <strong>la</strong> Lune pourrait recÅlerdes ressources en eau assez importantes. L’Åvaluation deces ressources est donc un objectif Åvident pour au moinsun prÅcurseur robotique. L’Åtude du rapport bÅnÅfice/coétdes diverses stratÅgies d’exploration est á faire, sur <strong>la</strong> basede dÅmonstrateurs spÅcifiques.Enfin l’exploitation de <strong>la</strong> Station Spatiale ISS est prolongÅeet soutenue. En effet, l’ISS est un <strong>la</strong>boratoire irremp<strong>la</strong>Üable,á <strong>la</strong> fois pour <strong>la</strong> coopÅration internationale dans l’Espace etpour l’Åtude de <strong>la</strong> biologie et des systÇmes en apesanteurSur <strong>la</strong> route de Mars ? : l’astÅroïde Eros vu par <strong>la</strong> sonde NEAR– image NASA/JPL/JHUAPLprolongÅe. Ces Åtudes sont une condition nÅcessaire á un programme d’exploration habitÅ au-delá de <strong>la</strong> Lune,cohÅrent avec <strong>la</strong> VSE. L’arrât de l’exploitation de l’ISS en 2016, dans les conditions de dÅveloppement de Constel<strong>la</strong>tiondepuis 2006, c’est-á-dire avec un investissement minimal dans son utilisation, aurait rendu infinimentplus difficile toute exploration spatiale au-delá de <strong>la</strong> Lune.Le budget 2011 tend donc á maximiser le retour technologique de l’exploration spatiale, tout en restant cohÅrentavec les objectifs gÅnÅraux de <strong>la</strong> VSE de G.W. Bush. L’inquiÅtude (et <strong>la</strong> dÅception) que l’on peut avoir est qu’ilne comprend plus aucun programme spÅcifique pour un <strong>la</strong>nceur habitÅ remp<strong>la</strong>Üant <strong>la</strong> Navette. L’administrationObama parie sur l’esprit d’entreprise amÅricain pour offrir au pays un accÇs á l’orbite basse au moindre coét.L’idÅe sous-jacente est que les technologies correspondantes sont maãtrisÅes et ne sont donc plus du ressort de<strong>la</strong> NASA, dont l’organisation bureaucratique deviendrait un frein. Le pari est risquÅ, malgrÅ <strong>la</strong> confiance qu’affichentles nouveaux venus sur ce marchÅ.Le pari est un peu forcÅ, aussi. La commission Augustine a montrÅ que le <strong>la</strong>nceur Ares I ne pouvait plus âtreprât dans un dÅ<strong>la</strong>i raisonnable pour desservir l’ISS, en raison du sous-financement de <strong>la</strong> NASA les annÅes prÅcÅdenteset des retards de dÅveloppement normaux d’un programme de ce type.
39Le programme du <strong>la</strong>nceur lourd n’est pas non plus <strong>la</strong>ncÅ, alors qu’il est bien c<strong>la</strong>ir qu’il reste du ressort de <strong>la</strong> NA-SA. Les raisons sont multiples : <strong>la</strong> NASA, en se concentrant sur les moyens du retour á <strong>la</strong> Lune pendant les cinqderniÇres annÅes, n’a pas montrÅ qu’elle avait un p<strong>la</strong>n d’exploration cohÅrent au-delá de <strong>la</strong> rÅpÅtition d’Apollo,donc <strong>la</strong> rÅalisation du <strong>la</strong>nceur et les coéts ÅlevÅs qui l’accompagnent peuvent attendre, dans le contexte financierdifficile d’aujourd’hui, d’autant plus que les retombÅes technologiques de sa rÅalisation sont douteuses. Finalement,on touche du doigt une fois de plus l’insuffisance du budget spatial par rapport aux ambitions affichÅesde l’exploration humaine. La NASA se trouve incapable de mener á <strong>la</strong> fois les dÅveloppements technologiquesnÅcessaires et les programmes qui doivent <strong>la</strong> matÅrialiser, et ceci depuis <strong>la</strong> fin des missions Apollo. Aujourd’hui,ce sont les technologies qui ont <strong>la</strong> prioritÅ parce qu’elles paraissent âtre le meilleur investissementpour l’Åconomie amÅricaine. On pense une fois de plus l’exploration par rapport aux retombÅes technologiquesvisibles qu’elle entraãne et non par rapport aux dÅcouvertes et bÅnÅfices potentiels qu’apporte l’acte d’explorerlui-mâme. Or, un vrai esprit pionnier considÇrera que ce sont ces derniers, par nature inconnus a priori, qui sontles plus importants.Dans ce contexte, l’Europe a sans doute des cartes á jouer.L’administration Obama a manifestÅ une volontÅ de coopÅrerdans l’espace. Il est plus facile de s’insÅrer dans un ensemblesouple de dÅveloppements technologiques et de soutien á unprogramme en coopÅration existant, l’ISS, que de se raccrocherá un nouveau programme structurÅ sous totale maãtriseamÅricaine. L’Europe peut faire valoir ses compÅtences entermes de <strong>la</strong>nceurs, de mÅdecine spatiale, de sondes et decargos automatiques. Encore faut-il nous en donner lesmoyens, nous aussi. Quand le budget de <strong>la</strong> NASA doit augmenterde 2,5% par an en moyenne, celui de l’ESA est gelÅ aumoins les deux prochaines annÅes. Quand le budget NASA del’exploration atteint 4 á 5 milliards de dol<strong>la</strong>rs, celui de l’ESA semonte á une grosse centaine de millions d’euros. Ces deuxchiffres donnent une mesure de <strong>la</strong> volontÅ politique qu’il y aderriÇre l’espace en Europe.C’est d’autant plus surprenant que les grandes nations Åmergentesparaissent traiter l’espace comme une prioritÅ technologiqueet un moteur de leur dÅveloppement plutÑt qu’une variable d’ajustement budgÅtaire. Les programmeschinois et maintenant indien paraissent mÅthodiques, avec une volontÅ de maãtriser progressivement toutes lesfacettes de l’accÇs á l’espace (satellites utilitaires, <strong>la</strong>nceurs, sondes scientifiques, vols habitÅs, retour d’Åchantillonslunaires,…), ambition qui semble abandonnÅe depuis plus de 15 ans en Europe. Leurs buts á long termesont flous, mais il est difficile de croire qu’ils se limiteront á l’accÇs á l’orbite basse. L’Åvolution rÅcente des programmesspatiaux de ces pays montre qu’ils se tournent de plus en plus vers l’exploration, sans nÅgliger lesapplications plus immÅdiates de l’espace.CoopÅration internationale dans l’espace : le module europÅenCupo<strong>la</strong> de l’ISS mis en p<strong>la</strong>ce par l’Åquipage de <strong>la</strong> NavetteSpatiale – image NASALes nouvelles orientations de <strong>la</strong> NASA sont certes dÅcevantes á court terme, mais au moins tendent-elles á jeterde nouvelles bases pour l’exploration, dans une approche globale rationnelle. Pourtant on ne peut que regretterle manque d’objectifs prÅcis, de volontÅ forte, de vision á long terme derriÇre ces orientations. Le dÅpart de notreport d’attache circumterrestre est une fois de plus reculÅ. Toutefois, des ÅlÅments se mettent en p<strong>la</strong>ce pour cedÅpart, d’un cotÅ et de l’autre du Pacifique.
40Le pàre de <strong>la</strong> mÄdecine spatiale franÖaisePhilippe Mairet et Laurent ManganeCTN <strong>3AF</strong> É Exploration et Observation Spatiales Ñavec une petite contribution de J.-M. DucLa prÅsentation á <strong>la</strong> presse, le 22 mars dernier des candidats á l’expÅrience Mars500 parmi lesquels lesdeux franÜais Romain Charles (Responsable QualitÅ á SOTIRA) et Arc’hanmael Gail<strong>la</strong>rd (IngÅnieur DÅveloppementchez Thomson R&D) nous amÇne á penser aux autres de nos compatriotes qui ont grandementcontribuÅ aux progrÇs des connaissances en mÅdecine spatiale parmi lesquels le regrettÅ Pr. Hubert P<strong>la</strong>nel.DÅjá, fin 2009, á l’occasion des 20 ans du MEDES, il nous semb<strong>la</strong> que son souvenir avait dÅjá ÅtÅ ÅclipsÅ etc’est justice de vouloir á nouveau lui rendre l’hommage qu’il mÅrite.Pour ainsi dire, notre ancien collÇgue <strong>3AF</strong>Hubert P<strong>la</strong>nel est le PÇre des recherchesspatiales franÜaises dans le domaine dessciences de <strong>la</strong> vie.En effet, c’est notamment gràce á lui que <strong>la</strong>France est devenue un partenaire privilÅgiÅde <strong>la</strong> Russie en matiÇre de mÅdecine spatiale.Hubert fut avant tout un grand Professeur demÅdecine. DÇs 1946, il entre comme Internedans le cadre hospitalier puis est nommÅChef de clinique des ma<strong>la</strong>dies cutanÅes etsyphilitiques. Docteur en mÅdecine et licenciÅÇs Sciences en 1951, il devient Assistantd'Anatomie pathologique au Centre RÅgiona<strong>la</strong>nti-cancÅreux de 1955 á 1961 et obtientson docteur d'Åtat Çs sciences en 1958. Lamâme annÅe, il est agrÅgÅ des UniversitÅsdans <strong>la</strong> section Histologie-Embryologie etCytogÅnÅtique. De 1971 á 1980, il a ÅtÅ membredu ComitÅ National Consultatif des UniversitÅset PrÅsident de <strong>la</strong> commission Histologie, Embryologie et CytogÅnÅtique.CrÅdit : CCSTI MPY (Science Animation) - Hubert P<strong>la</strong>nelChef de Service Cytologie-Histologie fractionnelles á l'hÑpital de Purpan de 1978 á 1990, il fonde en parallÇlele <strong>la</strong>boratoire de Radiobiologie et Biologie Spatiales qu’il dirigera de 1970 á 1992.Le Pr. P<strong>la</strong>nel fét aussi un grand pÅdagogue, ce qui lui valut le titre de Commandeur dans l’Ordre des PalmesAcadÅmiques : Professeur ÅmÅrite des UniversitÅs de 1992 á 2000 et prÅsident de Sciences Animation,Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de <strong>Midi</strong>-PyrÅnÅes de 1995 á 2005, ilconsacra une trÇs grande partie de sa vie et de son œuvre á <strong>la</strong> diffusion du savoir scientifique. Il fét aussimembre titu<strong>la</strong>ire, c<strong>la</strong>sse des Sciences, de l’AcadÅmie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de <strong>Toulouse</strong>dÇs 2007 aprÇs 3 ans en tant que membre correspondant et membre de l’IAA.C’est pendant cette pÅriode, le 31 mars 2003 pour âtre prÅcis, qu’il reÜut, des mains de son ami le ProfesseurHubert Curien, grand scientifique lui-mâme et ancien Ministre de <strong>la</strong> Recherche et de <strong>la</strong> Technologie,autre grand artisan de <strong>la</strong> coopÅration scientifique franco-soviÅtique, les insignes de Chevalier de <strong>la</strong> LÅgiond’Honneur á l’HÑtel d’Assezat (voir photo ci-dessous) en prÅsence d’une foule d’amis dont des reprÅsentantsde <strong>la</strong> <strong>3AF</strong>/TMP.Hubert P<strong>la</strong>nel a orientÅ ses travaux suivant deux grands axes : les effets biologiques des rayonnementsionisants et <strong>la</strong> Biologie Spatiale. Dans le premier cas, il a dÅmontrÅ que l’effet de faibles doses d’originenaturelle pouvait, á l’inverse des fortes doses, stimuler l’activitÅ prolifÅratrice au niveau cellu<strong>la</strong>ire ainsi que<strong>la</strong> synthÇse des constituants biologiques.Dans le domaine spatial, dÇs 1970, il propose au CNES plusieurs expÅriences embarquÅes qui ont permisde mettre au point des techniques de culture de cellules en haute altitude. Il poursuivra cette col<strong>la</strong>borationde 1971 á 1988 en tant que membre du comitÅ des Programmes Scientifiques. Il s’est en particulier intÅressÅá l’effet des ions lourds (rayonnement cosmique) pris en compte lors de <strong>la</strong> conception de vaisseauxspatiaux habitÅs.
41Il col<strong>la</strong>bora trÇs tÑt aux missions habitÅs vers <strong>la</strong> Lune (expÅriences Biostack dans Apollo 16 & 17) puis auxmissions russes de longue durÅe (Soyouz, Saliout et MIR). Les expÅriences Cytos á bord des vaisseaux russespuis á bord de <strong>la</strong> navette Columbia ont pu mettre en Åvidence l’influence directe de l’impesanteur sur <strong>la</strong>cellule.A l’origine d’une col<strong>la</strong>boration trÇs fructueuse avec <strong>la</strong> Russie (plus de 40 missions entre 1970 et 1984), ilcontribua dans le cadre de cette coopÅration á <strong>la</strong> prise en compte de <strong>la</strong> neurophysiologie, de <strong>la</strong> physiologiecardiovascu<strong>la</strong>ire, de <strong>la</strong> physiologie osseuse et de <strong>la</strong> biologie vÅgÅtale.Cependant, le Professeur P<strong>la</strong>nel ne fut pas seulement un grand serviteur des sciences, il mit son talent aussiá rÅduire <strong>la</strong> fracture entre sciences et arts au travers de l’association Sciences Animation dont il fut PrÅsidentd’Honneur, et un des instigateurs des DÅcouvrades, cycle de confÅrences associant depuis plus de <strong>10</strong> ansces deux domaines. Convaincu de l’intÅrât majeur de <strong>la</strong> dÅfinition d’une politique de diffusion de <strong>la</strong> culturescientifique, d’abord auprÇs des jeunes puis vers tous les publics, Il se rapprocha dÇs 1995 de cette Associationpour en amplifier les actions rÅgionales. Il en assuma <strong>la</strong> PrÅsidence jusqu’en 2005 en rÅaffirmant á maintesreprises qu’il n’y a pas de dÅmocratie sansle partage de <strong>la</strong> connaissance et que les frontiÇresentre les diffÅrentes formes de culturedoivent s’effacer, incluant ainsi, de fait, <strong>la</strong>culture scientifique au sein de <strong>la</strong> culture engÅnÅral. Ce n’est pas sans Åmotion que nousavons retrouvÅ <strong>la</strong> seconde photo ci-dessous,prise lors des cÅrÅmonies du <strong>10</strong> Çme anniversairedes DÅcouvrades, en juin 2008. Hubert P<strong>la</strong>nelest entourÅ, de gauche á droite sur <strong>la</strong> photo,de ValÅrie Portarrieu, journaliste, animatrice,A<strong>la</strong>in Costes, ancien Directeur du LAAS-CNRS, Pierre Auriol, PrÅsident de Science-Animation, Jean-C<strong>la</strong>ude F<strong>la</strong>mant, directeur de<strong>la</strong> mission d’animation des Agrobiosciences etenfin, de l’autre cÑtÅ, Olivier Moch, SecrÅtairepermanent du Conseil SupÅrieur de <strong>la</strong> MÅtÅorologie,hÑte de <strong>la</strong> manifestation. C’est, semble-t-il, <strong>la</strong> derniÇre apparition publique officielle du regrettÅ ProfesseurP<strong>la</strong>nel.Au Bureau de <strong>la</strong> <strong>3AF</strong>/TMP dont il fut un membre assidu pendant plusieurs annÅes, Hubert P<strong>la</strong>nel apporta d’unepart des conseils fort judicieux (comme l’idÅe , mise en œuvre par A<strong>la</strong>in Chevalier, de publier une gazetterÅgionale comme organe d’expression des membres et de liaison entre eux, etc.), introduisit des confÅrenciersd’exception comme le Professeur RenÅ Bosc pour nous parler des Recherches franÜaises en Antarctiqueá l’issue d’une AssemblÅe GÅnÅrale et d’autre part, gràce á son calme, sa gÅnÅrositÅ et sa grandeur d’àme,contribua <strong>la</strong>rgement á apaiser quelques tensions internes. La <strong>3AF</strong>/TMP lui en est trÇs reconnaissante.Il a soutenu Ågalement le projet de crÅation de <strong>la</strong> CitÅ de l’Espace dont il fut membre du ComitÅ Scientifiquepuis du ComitÅ d’orientation. Jusqu’á sa disparition fin 2008, il est restÅ membre de l’Association des Amis de<strong>la</strong> CitÅ de l’Espace.Son action aussi riche que fructueuse lui valut de nombreuses rÅcompensescomme le Prix Gaussail (mÅdaille d’or en 1942) comme <strong>la</strong>urÅatde <strong>la</strong> facultÅ de MÅdecine, le prix Lasserre (mÅdaille d’or en 1951) poursa thÇse sur le neuro ÅpithÅlium olfactif et <strong>la</strong> corticosurrÅnale, <strong>la</strong>urÅatdu prix Peyret de l’AcadÅmie des Sciences en 1971, mÅdaille d’argentdu CNES en 1982, team Achievement Award de l’ESA en 1983, MÅdailleTsiolkovski de l’URSS en 1987, Award de l’ELGRA (AssociationEuropÅenne de Recherche en MicrogravitÅ dont il fut membre fondateuret Vice-PrÅsident) en 1997. Il a trÇs logiquement reÜu l’insigne deChevalier dans l’ordre National du MÅrite puis dans l’Ordre National de<strong>la</strong> LÅgion d’Honneur comme rappelÅ prÅcÅdemment.Hubert P<strong>la</strong>nel nous lÇgue une œuvre considÅrable et incontournable de plus de 35 livres et recueils de publicationsdont de nombreux ouvrages de rÅfÅrence. Gràce á lui, nous avons au 21 Çme siÇcle une bien meilleureconnaissance de l’effet des faibles doses de rayonnement naturel sur <strong>la</strong> matiÇre vivante. Ceux qui, commenous, l’ont croisÅ au cours de confÅrences et rÅunions <strong>3AF</strong> gardent le souvenir d’un homme bril<strong>la</strong>nt, passionnÅet jovial, á l’esprit de synthÇse remarquable mais aussi humaniste et fidÇle en amitiÅ.EspÅrons que l’esprit qui caractÅrisait le Professeur P<strong>la</strong>nel saura inspirer Charles et Arc’hanmael dans leurrecherche des limites de <strong>la</strong> vie humaine en environnement confinÅ, prÅlude des grandes explorations spatialesdu systÇme so<strong>la</strong>ire.Le Professeur P<strong>la</strong>nel a ÅtÅ trop tÑt ravi á l’amour des siens et en particulier de son Åpouse qui l’accompagnaiten presque toute circonstance (tous deux ayant courageusement surmontÅ, unis plus que toujours, <strong>la</strong> cruelleÅpreuve de <strong>la</strong> perte d’un enfant) et á l’amitiÅ et l’affection de ses collÇgues de tous horizons. Plus d’un anaprÇs sa disparition, il est toujours dans nos cœurs á <strong>la</strong> <strong>3AF</strong> et nos pensÅes chaleureuses vont aussi versmadame P<strong>la</strong>nel et sa fille.
42Mise en page <strong>3AF</strong> TMP - Edition Airbus SASLe comitÅ de rÅdaction remercie toutes les personnes qui ont permis <strong>la</strong> publication de cette gazette.Pour nous contacter et nous faire parvenir vos idÅes d’articles et information :<strong>3AF</strong> TMP - campus SupaÅro - RÅsidence 2 – <strong>10</strong> avenue Edouard Belin - 31400 <strong>Toulouse</strong>—aaaftlse@aol.com