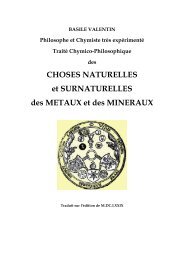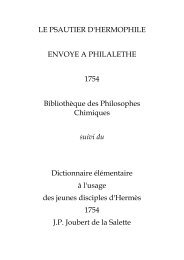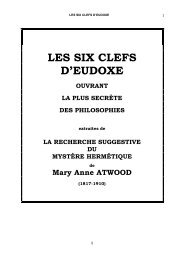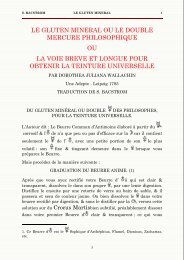Une Cheminée Alchimique en Avignon - Bibliothèque Numérique ...
Une Cheminée Alchimique en Avignon - Bibliothèque Numérique ...
Une Cheminée Alchimique en Avignon - Bibliothèque Numérique ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Une</strong> Cheminée <strong>Alchimique</strong> <strong>en</strong> <strong>Avignon</strong>Ceux qui auront la chance de visiter ces pages pourront remercier l'auteur de cesfabuleux clichés : Mr Alain Mauranne. Grâce à lui et à ceux qui se sont joints à cetravail commun, ce livre de pierre aura cédé, du moins nous l'espérons, une partiedu message <strong>Alchimique</strong> qu'il véhicule à travers le temps. A la fois émissaire dusacré et témoin de la réussite du grand œuvre par l'adepte qui aura ordonné saréalisation, cette cheminée r<strong>en</strong>aissance recèle <strong>en</strong>core des merveilles d'indicationspratiques sur la voie de la pierre philosophale. Ce qui est écrit n'ayant pu se fairequ'<strong>en</strong> fonction du niveau d'étude et aussi de l'intuition de chacun bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du.Ici, donc la fable mythologique ainsi que l'astuce de disposition sont utilisées defaçon que l'<strong>en</strong>treprise de décodage soit égalem<strong>en</strong>t un travail intellectuel dont lebut ess<strong>en</strong>tiel reste la transmission d'un savoir oublié de tous et ressuscité pourcertains.L'image de gauche prés<strong>en</strong>te des zones cliquables vers des agrandissem<strong>en</strong>tsdétaillés pour que le visiteur puisse facilem<strong>en</strong>t se r<strong>en</strong>dre compte de la qualitéartistique de ce monum<strong>en</strong>t élevé à la gloire de la sci<strong>en</strong>ce hermétique.Le forum est uniquem<strong>en</strong>t consacré à ce sujet et permettra à chacun d'ajouter unepierre à cette initiative.Aucune vérité ne pouvant s'imposer, les comm<strong>en</strong>taires et critiques seront lesbi<strong>en</strong>v<strong>en</strong>us.Très Cordialem<strong>en</strong>tAlkestMerci aux Archives de la Ville d'<strong>Avignon</strong>Cette cheminée R<strong>en</strong>aissance a bi<strong>en</strong> été donnée au musée Calvet d'<strong>Avignon</strong> <strong>en</strong> 1844 parle Dr Clém<strong>en</strong>t, propriétaire à <strong>Avignon</strong> d'un <strong>en</strong>semble de maisons situées place Saint-Pierre (face à l'église du même nom) et le long de l'impasse Saint-Pierre. <strong>Une</strong> noticedescriptive de cette cheminée est donnée dans le Catalogue des statues du musée (1881).Dans un manuscrit, Adri<strong>en</strong> Marcel son auteur dit que « la maison du Dr Clém<strong>en</strong>t avaitété rebâtie sur l¹emplacem<strong>en</strong>t d'une autre d'où prov<strong>en</strong>ait une cheminée monum<strong>en</strong>tale duXVIe siècle, blasonnée aux armes d¹Antoine Facchinetti, de Nuce » créé Cardinal <strong>en</strong>1591 et mort <strong>en</strong> 1606.
INTRODUCTIONTexte rédigé par Philippe Litzler<strong>Une</strong> cheminée alchimique <strong>en</strong> <strong>Avignon</strong><strong>Avignon</strong> est une petite ville prov<strong>en</strong>çale qui est célèbre pour son pont, que tous les bambins dela terre connaiss<strong>en</strong>t grâce à la chanson, et par son prestigieux festival. Au Moy<strong>en</strong>-âge la villeput égalem<strong>en</strong>t s'<strong>en</strong>orgueillir d'être le c<strong>en</strong>tre de la Chréti<strong>en</strong>té puisque les Papes y élur<strong>en</strong>tdomicile, un peu forcés, il est vrai. Parmi ces derniers on compta même un alchimiste notoire<strong>en</strong> la personne de Jean XXII, qui fut plus connu par sa bulle contre ses frères <strong>en</strong> Hermès.Aujourd'hui, lorsque les hordes de touristes déferl<strong>en</strong>t dans la cité fortifiée à la recherche despectacles populaires ou de boutiques aux marques internationales, qui donc irait <strong>en</strong>coreperdre son temps à la découverte d'anci<strong>en</strong>s idéogrammes tracés dans la pierre? Qui doncaurait <strong>en</strong>core le temps de prom<strong>en</strong>er son regard du côté du modeste musée lapidaire, sis dansune anci<strong>en</strong>ne église de Jésuites? Or c'est là, dans un monde figé où ne brill<strong>en</strong>t plus lespaillettes du monde, qu'Alain Mauranne a découvert une "nouvelle" cheminée alchimique.Comme le dit si bi<strong>en</strong> Hervé Delboy dans son introduction à la fontaine des Quatre Tias deFont<strong>en</strong>ay-Le-Comte (site internet de Hervé Delboy), les demeures philosophales sont surtoutprétextes à discourir sur l'Art. La cheminée alchimique, dont nous n'<strong>en</strong>visageons pas l'analysehermétique mais simplem<strong>en</strong>t une petite interprétation "<strong>en</strong> passant", a été offerte au musée parun certain Clém<strong>en</strong>t <strong>en</strong> 1844. Elle est assez imposante et ornait une maison de styler<strong>en</strong>aissance de l'impasse Saint-Pierre. La pierre utilisée provi<strong>en</strong>t vraisemblablem<strong>en</strong>t du Gardcomme celle de nombreuses cheminées contemporaines.Posons-nous d'abord la question suivante. Quelle est l'utilité d'un tel ust<strong>en</strong>sile? <strong>Une</strong> cheminéesert tout d'abord de foyer et, par la suite, à évacuer les fumées prov<strong>en</strong>ant de la combustion. Orl'Alchimie, aux dires de Marie La Juive, est l'art précieux des deux fumées. Le compost del'artiste, <strong>en</strong> effet, doit être am<strong>en</strong>é - dans la voie humide - à libérer les deux précieuses vapeurs.D'abord nous obt<strong>en</strong>ons la blanche, puis la rouge. Ces deux fleurs qui pass<strong>en</strong>t le col du ballonau travers d'un <strong>en</strong>chevêtrem<strong>en</strong>t d'épines, sont nos deux roses blanche et rouge. La lecture duconte de Grimm "Blanche Neige et Rose Rouge" pourra être d'une grande utilité (site internetChrysopée). Mais, et beaucoup d'auteurs ont "oublié" de le signaler, une troisième rose passeégalem<strong>en</strong>t par le col gracile de l'alambic. Cette fleur diaphane se joint au florilège alchimique.Or il faut un œil perçant pour la percevoir, ce qui explique peut-être la discrétion des auteurs.Dans le conte de Grimm précité, il s'agit peut-être de l'allusion à l'ange. Changeons d'air etquittons ces vapeurs toxiques pour le monum<strong>en</strong>t de pierre.Deux cariatides abîmées souti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t le caisson principal et <strong>en</strong>cadr<strong>en</strong>t le foyer. Atlas, Saturneou quelques autres Titans...? Qui sait, le temps a eu raison des détails. D'autres cariatides,féminines celles-là, partag<strong>en</strong>t deux scènes des plus intéressantes. Dans le premier espacecarré, à gauche, nous apercevons une femme dans un temple qui semble aux prises avec unétrange animal. Il nous vi<strong>en</strong>t tout de suite à l'esprit la lég<strong>en</strong>de de Léda fécondée par un cygnequi n'était autre que Zeus lui-même. A ses pieds deux petits <strong>en</strong>fants sembl<strong>en</strong>t être le résultatde cet accouplem<strong>en</strong>t, Castor et Pollux. Le temple prés<strong>en</strong>te deux robustes colonnes et son toittriangulaire se perd dans des volutes composées d'animaux étranges qui <strong>en</strong>tour<strong>en</strong>t tout lemotif, ceux du bas pouvant être des oiseaux. Le tout repose sur une tête chimérique <strong>en</strong>tourée
4th, 5th, 6th, 10th, 12th, 15th November.It is noted that ECOtas (2007) detected C. caudata in the Williams Creek catchm<strong>en</strong>ton 11 th and 30 th October, with both individuals in flower, suggesting that thepopulation fits within the concept of later flowering for the species in northernTasmania.Reservation statusC. caudata is known from several reserves although the status of some populations(with respect to the extant/extinct status and the abundance of plants pres<strong>en</strong>t) withinthese reserves is unknown. The species is known from the Arthur-PiemanConservation Area, Coles Bay Conservation Area, Coningham Nature Recreation Area,Freycinet National Park, Humbug Point Nature Recreation Area, Lime Bay StateReserve, Narawntapu National Park, Rocky Cape National Park, South Arm NatureRecreation Area, Tasman National Park, Waterhouse Conservation Area, WingarooConservation Area and the H<strong>en</strong>ry Somerset Orchid Private Sanctuary.This listing of reserves provides an impression of a well-reserved species. However, itis noted that while Tasmanian reserves are subject to a code of practice, theTasmanian Reserve Managem<strong>en</strong>t Code of Practice (PWS, FT & DPIWE 2003), there hasbe<strong>en</strong> little active managem<strong>en</strong>t of most reserves, at least in relation to themaint<strong>en</strong>ance of known sites and pot<strong>en</strong>tial habitat for C. caudata. Passive managem<strong>en</strong>t(i.e. no prescribed burns) may be quite inappropriate for a species such as C. caudatathat appears to b<strong>en</strong>efit from moderate to high fire frequ<strong>en</strong>cies (Jones et al. 1999). Thepopulation in the H<strong>en</strong>ry Somerset Orchid Conservation Area has be<strong>en</strong> subject to adeliberate ecological burn and the species appears to have b<strong>en</strong>efited from this ev<strong>en</strong>t(M. Wapstra pers. obs.). Similarly, low-scale fuel reduction burning in the WaverlyFlora Park has not appeared to deleteriously impacted on the species (M. Wapstrapers. obs.) and has probably <strong>en</strong>sured the continued flowering at the known site.Managem<strong>en</strong>t for the species at other sites has be<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tially passive to date. Othersites known to support the species (e.g. Coningham) have be<strong>en</strong> subject touncontrolled wildfires and this is likely to be of b<strong>en</strong>efit to the species.Curr<strong>en</strong>t conservation statusCalad<strong>en</strong>ia caudata is pres<strong>en</strong>tly listed as Vulnerable (schedule 4) of the TasmanianThreat<strong>en</strong>ed Species Protection Act 1995. A rec<strong>en</strong>t review of the conservation status ofthe species recomm<strong>en</strong>ded that its status be upgraded to vulnerable (schedule 4) fromrare (schedule 5), and this recomm<strong>en</strong>dation was accepted by the State minister. It isalso listed as Vulnerable on the Commonwealth Environm<strong>en</strong>t Protection andBiodiversity Conservation Act 1999.The main reason for the listing of C. caudata as vulnerable is the continueduncertainty of the status of many of the populations: many listed sites have not hadthe species recorded for many years (ev<strong>en</strong> decades) and many of the known extantsites support an unknown (although probably low) number of individuals. The speciesmeets the technical description of criterion 3b of the Commonwealth Environm<strong>en</strong>tProtection and Biodiversity Conservation Act 1999 in that “the estimated total numberof mature individuals is limited and the number is likely to decline and its geographicdistribution is precarious for its survival”. The corresponding IUCN 2000 guideline isC2 (a): Population size estimated to number fewer than 10 000 mature individuals anda continuing decline projected in the numbers of mature individuals and nosubpopulation estimated to contain more than 1000 mature individuals.
COMMENTAIREde Leo Ir<strong>en</strong>eusIl nous semble judicieux de nous arrêter d'abord sur la forme que pr<strong>en</strong>d ce magnifique livre de« Pierre » : cheminée. Etymologiquem<strong>en</strong>t, cheminé vi<strong>en</strong>t du latin caminus (four) qui seprononce de la même manière que caminus (chemin). Nous trouvons donc la double allusiondu fameux four à charbon alchimique, l'athanor classique, et celui de la voie conduisant, pourparaphraser Tollius, au ciel chymique. Or cette voie humide, à ce qui nous semble, est décriteavec de rares détails opératifs, des précisions à foison, dont certaines, pour ceux qui ont lasagacité nécessaire, seront d'un considérable apport dans l'élaboration de la pierre.L'ouvrage peut être subdivisé <strong>en</strong> trois parties, symbolisant les trois étapes ou œuvres, avec unpetit panneau <strong>en</strong>tre les moulures juste au-dessus de l'<strong>en</strong>trée de la cheminée, faisant p<strong>en</strong>dant àun autre tout <strong>en</strong> haut et qui se trouve <strong>en</strong>tre deux formes féminines. Nous revi<strong>en</strong>drons sur cesdeux petits panneaux. Dans la partie basse, que nous analyserons comme les phases del'œuvre premier, se trouve de part et d'autre de « la gueule du four » deux personnages,prés<strong>en</strong>tés <strong>en</strong> colonnes sout<strong>en</strong>ant l'édifice <strong>en</strong>tier, ce qui est révélateur de l'importance despremières opérations, dont dép<strong>en</strong>d <strong>en</strong> grande partie, une suite heureuse ou non de l'œuvre <strong>en</strong><strong>en</strong>tier.Il est tout à fait remarquable, et l'allusion est claire, que les deux personnages sus cités, ai<strong>en</strong>tles jambes <strong>en</strong>fouies jusqu'aux g<strong>en</strong>oux, dans un vase clos, préfigurant la fosse qu'il faut d'aprèsla tradition « fouïr jusqu'aux g<strong>en</strong>oux » pour accéder à l'Eau mercurielle, et l'extraire de sagangue minérale vive. Le personnage de gauche, les mains sur les cuisses est un vieillardbossu dont l'excroissance dorsale est l'un des souti<strong>en</strong>s de la voûte hiéroglyphique du haut.Représ<strong>en</strong>té dans sa nudité, il évoque la Prima matéria, la vénérable substance que l'on couvreaprès extraction, des vêtem<strong>en</strong>ts de la Saturnie pour <strong>en</strong>suite <strong>en</strong> extraire les élém<strong>en</strong>tsconstituants l'Elixir final. On pourrait beaucoup plus <strong>en</strong> dire sur ce vieillard, maisintéressons-nous au second personnage qui est tout aussi révélateur des processus premiers. Ilsouti<strong>en</strong>t l'architecture du haut avec ses deux mains. Il arbore une tête de lion, aux reins uneceinture serp<strong>en</strong>tine abouchée au-dessus de laquelle se trouve une coquille Saint-Jacques quisymbolise le nécessaire pèlerinage de «Compostella ». Le lion Verd, car c'est de lui qu'ils'agit, se tire de la matière non complètem<strong>en</strong>t sublimée, d'où un corps d'homme à tête animale.Il s'extrait donc de la matière crue ayant lui-même cette qualité qui permet la réincrudation dumétal mort. C'est grâce à lui que la matière s'auto dévore (le serp<strong>en</strong>t se mordant la queue) etque dans le processus de la cuisson, naît l'étoile, précurseur de la pierre blanche, sur lecompost noirâtre et boueux. La naissance de ce sel adamique dans la voie humide, grâce auvitriol qui ouvre le mâle philosophique est peut être représ<strong>en</strong>té par la protubérance ronde quise situe <strong>en</strong>tre les g<strong>en</strong>oux du second personnage.Passons à la partie médiane de la cheminée, la plus richem<strong>en</strong>t décorée de nombreux etminutieux détails montrant les délicates phases de sublimation dans le second œuvre. Nous<strong>en</strong> parlerons de manière quelque peu lapidaire, les comm<strong>en</strong>taires d'Alkest à ce sujet et qu<strong>en</strong>ous avons lu, étant très précis et d'une grande clarté.On notera que les allusions au coït chimique y sont nombreuses et partagées <strong>en</strong>tre deux grandspanneaux bordés de colonnettes toutes aussi explicites. L'opération capitale est d'unirjudicieusem<strong>en</strong>t et dans un li<strong>en</strong> indéfectible, les parties aqueuses et terrestres de la Pierre. <strong>Une</strong>colonnette représ<strong>en</strong>te d'ailleurs la vouivre <strong>en</strong>serrant de ses anneaux le principe mercuriel à
l'image du couple alchimique du porche latéral de l'église de Bodilis. Le but de cette unionest de fixer le principe volatil sublime et de volatiliser le principe fixe premier, dont la partiela plus légère, s'<strong>en</strong>vole et flotte à la surface du bain pour concrétiser le mariage. Et cette partiede l'ouvre, extrêmem<strong>en</strong>t délicate, se fait sous vide, ce qui permet l'extraction de la partie laplus fine de la pierre cubique. Toute l'opération se fait à l'athanor, figuré ici par les doublescolonnes coiffées de chapiteaux triangulaires, symboles émin<strong>en</strong>ts maçonniques. Ne trouvonsnous pas non plus dans les deux globes figurant l'œuf alchimique, l'équerre et le compas audessusde l'arbre lunaire et de l'arbre solaire, sur les deux sortes de tympans <strong>en</strong> haut del'ouverture de la cheminée et <strong>en</strong>tre les deux Naïades au sommet de la constructionarchitecturale ? Or ces symboles, l'équerre et le compas auxquels on ne semble accorder quedes valeurs spéculatives, sont <strong>en</strong> réalités des secrets opératifs touchant les degrés de chaleuret les temps moy<strong>en</strong>s de cuissons des Elixirs au blanc et au rouge. L'Elixir lunaire dontl'équerre est la représ<strong>en</strong>tation nécessite à peu près 90 jours de cuisson à une températureproche de 90°c. Or l'Equerre détermine un angle à 90°. Il <strong>en</strong> est de même de la confection del'Elixir solaire dont le compas, déterminant un angle de 360°, est le symbole, la températurestable dans ce cas, avoisinant les 360° avec un temps de cuisson voisin de 360 jours.D'ailleurs Paracelse recommande dans la génération de l'Hommoncule solaire, 40 jours et 40semaines de cuisson, ce qui fait très exactem<strong>en</strong>t 320 jours. La sagesse des anci<strong>en</strong>s étaitprofonde. Dans le globe figurant donc l'œuf sont <strong>en</strong>fermés l'embryon de la Pierre au blanc ouau rouge, ferm<strong>en</strong>tif, avec respectivem<strong>en</strong>t la Lune commune (arg<strong>en</strong>t commun) ou le Soleilcommun (métal commun d'or), ainsi que la proportion adéquate de Mercure philosophique.Dans le premier cas, on réalise l'opus minor, dans le second, le grand œuvre. De plus, sur lacheminée, ces globes sont <strong>en</strong>tourés de ce que nous crûmes être de prime abord des feuilles delauriers, alors que ce sont de toute évid<strong>en</strong>ce, ce sont des cornes. Cela nous fit p<strong>en</strong>ser à lafameuse corne d'Amalthée que Zeus brisa sur la tête de la chèvre qui le nourrit de son lait (leMercure philosophique) dans sa grotte où sa mère le cacha de la furie haineuse de Cronos. Lescomm<strong>en</strong>taires d'Alkest à propos de « la chèvre » sont tout à fait lumineux. C'est donc de cettecorne d'abondance que jailliss<strong>en</strong>t les fruits qui figur<strong>en</strong>t sur les frises cerclant la cheminée.On y remarque la gr<strong>en</strong>ade, dont la chair pulpeuse et les grains sont intimem<strong>en</strong>t unis, ce quir<strong>en</strong>voie <strong>en</strong>core à cette reconstitution indissoluble des élém<strong>en</strong>ts d'abord séparés pour êtrepurifiés, de la matière originelle.Ainsi ce beau passage sur ce fruit tiré de l'ouvrage magnifique de Maurice DRUON « lesMémoires de Zeus » (Tome In l'Aube des Dieux) page 185, 5e paragraphe : « Vous avezouvert une gr<strong>en</strong>ade ; vous avez vu comme le grain mâle y est mêlé à la rose pulpe femelle, etqu'on ne peut, pour s'<strong>en</strong> nourrir, détacher l'une de l'autre. C'est pourquoi la gr<strong>en</strong>ade est le fruitsacré des épousailles ; l'union qu'elle représ<strong>en</strong>te et sanctifie, ne peut être défaite ». Nousajouterons aussi à propos de la fameuse corne qu'elle révèle aussi le processus opératifpermettant de préparer le nécessaire « lit du phénix » de la coction m<strong>en</strong>ant à l'ouvre troisième.Nous terminerons cette passionnante étude de cette cheminée r<strong>en</strong>aissance <strong>en</strong> nous conc<strong>en</strong>trantsur les deux formes féminines <strong>en</strong> miroir, qui surplomb<strong>en</strong>t toute la construction. Ces Naïadesti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t chacune dans l'une de leurs mains, l'arbre d'Hermès avec son unique gland. Levigoureux chêne vert qui ne craint point les rigueurs hivernales et d'où jaillit l'eau viveparadisiaque, dont ces nymphes sont justem<strong>en</strong>t les divinités. <strong>Une</strong> juste compréh<strong>en</strong>sion decette représ<strong>en</strong>tation donne, et les mots ne sont pas forts, la clef principale de la chimie, et nousn'insistons même pas sur l'<strong>en</strong>roulem<strong>en</strong>t des bras, qui fait p<strong>en</strong>ser à la conversion des élém<strong>en</strong>ts,comme nous le faisait remarquer Alkest, conversion qui permet de générer le minéral secretde l'œuvre.
apercevoir simultaném<strong>en</strong>t les deux élém<strong>en</strong>ts du composé » (in Les Demeures Philosophales, tome II, page 57, chez Pauvert, edit de 1989).Il <strong>en</strong> est donc de même pour les frères Jumeaux de la Mythologie qui incarne chacun le souffre et lemercure uni au départ et séparer par la suite.Mais plus <strong>en</strong>core une indication rare nous est fournie par l’histoire de ces deux frères <strong>en</strong> effet le FrNoel nous dit (Dictionnaire de la Fable), « Cette fiction est fondée sur ce que les deux princes ayant,après leur mort, formé le signe des GEMEAUX, l’une des deux étoiles qui le compos<strong>en</strong>t se cachesous l’horizon, lorsque l’autre apparaît ». Concordance donc parfaite et utile <strong>en</strong>tre le macrocosme et lemicrocosme alchimique tant on sait que les auteurs usèr<strong>en</strong>t d’une int<strong>en</strong>se discrétion concernant lesmom<strong>en</strong>ts propices au labeur hermétique.Rev<strong>en</strong>ons à notre cheminée et finissons la description de cette scène <strong>en</strong> décrivant les quatrecréatures étranges qui l’<strong>en</strong>cadr<strong>en</strong>t. C’est le même type de « coccigrue » que nous r<strong>en</strong>controns dans lePalais l’Allemand au niveau du porche de la cour, là ils se font face et boiv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>semble aux jetsd’une fontaine. Ce sont nos deux principes mixés mâle et femelle précédemm<strong>en</strong>t décrits quis ‘abreuv<strong>en</strong>t de l’eau merveilleuse génératrice de vie et dont ils sont finalem<strong>en</strong>t les par<strong>en</strong>ts. Ils secompos<strong>en</strong>t de corps d’oiseaux à tête humaine qui sembl<strong>en</strong>t-être par alternance soit féminine soitmasculine. Entre les deux du bas un masque grimaçant aux longues moustaches et aux oreilleseffilées <strong>en</strong> forme de plumes ou de coquilles de crustacés semble porter sur son front la marque d’unjoyau taillé à la manière des meilleurs joailliers, nous y reconnaissons Lucifer et son Emeraudefrontale qui doit-être <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du comme « l’Emeraude des sages» lumineuse et tant recherchée. Entreles deux du haut une corne fructifère exprime le résultat de l’œuvre et son pouvoir hautem<strong>en</strong>tgénérateur de richesses.Sans perdre de vue le thème général de la composition que nous avions annoncé : « LANAISSANCE » remarquons que la cariatide directem<strong>en</strong>t à droite prés<strong>en</strong>te un v<strong>en</strong>tre dont le volum<strong>en</strong>e laisse pas douter de son état de fécondation avancé, prélude à la naissance de l'<strong>en</strong>fanthermétique. Laissons à la sagacité du chercheur d’<strong>en</strong>visager ce que chaque cariatides, de part saposition de bras et ses attributs peut appr<strong>en</strong>dre de neuf et passons à la scène de gauche.Cette composition, comme la précéd<strong>en</strong>te, est une merveille de conception et ce n’est pas peudire. A la partie inférieure une tête d’animal monstrueux qui semble être constitué de la faceet du m<strong>en</strong>ton d’une chèvre, et dont le crâne est munis de bois de cerf.Ce masque de chèvre (car possédant une barbiche) s'inscrit dans la suite logique de la lecture de cesemblèmes. C'est une sorte de chimère que nous prés<strong>en</strong>te l'auteur, la chèvre sur le point de mettrebas. Cette créature composite était soit représ<strong>en</strong>té avec un corps de chèvre soit avec sa tête.La chèvre autant que le bouc était, nous dit Pernety, dans son Dictionnaire Mytho-hermétique, adoréedes Egypti<strong>en</strong>s qui l’avai<strong>en</strong>t consacrée à Osiris et elle servait à désigner la partie que les alchimistesnomm<strong>en</strong>t leur soufre.Les bois s'élargiss<strong>en</strong>t pour sout<strong>en</strong>ir une couronne de feuillage qui <strong>en</strong>toure la scéne proprem<strong>en</strong>t diteet forme un ovale parfaitem<strong>en</strong>t fermé abritant deux personnages c<strong>en</strong>traux. C’est un couple <strong>en</strong>formation érotique que nous y voyons. Cette position de coït "minéral", souv<strong>en</strong>t reprise dans lesmanuscrits à emblèmes rejoint l'idée de fécondation exprimée dans le panneau de gauche. Ce sont lemâle et la femelle vive qui se conjoign<strong>en</strong>t <strong>en</strong> un acte unique et qui constitue "le miracle ontogénique"de l'œuvre comme l'a si bi<strong>en</strong> exprimé Mr Canseliet. Nous serions t<strong>en</strong>té de dire malgré la difficulté dediscernem<strong>en</strong>t des sexes que le personnage de gauche est la femme, c'est sa position un peu surélevéet au dessus du mâle qui étaye cette déduction, de façon à bi<strong>en</strong> montrer que la "femelle pr<strong>en</strong>d ledessus par plusieurs mois".
Un détail inatt<strong>en</strong>du et habilem<strong>en</strong>t dissimulé finit d’ori<strong>en</strong>ter cette analyse .Il s’agit du dessincaractéristique qui recouvre le linteau et les chapiteaux des colonnes qui constitu<strong>en</strong>t ce mini templeélevé à la gloire de la sci<strong>en</strong>ce hermétique et de la conjonction des contraires qui s’y déroule.Ceux qui aurons lu « le Mystère des Cathédrales » et visité le Palais L’Allemand à Bourges sesouvi<strong>en</strong>dront de la description de l’Adepte concernant la ceinture du géant OFFERUS : « La ceintured’Offerus est piquée de lignes <strong>en</strong>trecroisées semblables à celles que prés<strong>en</strong>te la surface du dissolvantlorsqu’il à été canoniquem<strong>en</strong>t préparé » (page 189 édition de 1990).Il <strong>en</strong> est de même pour nos élém<strong>en</strong>ts <strong>Avignon</strong>nais <strong>en</strong> cours de description, des lignes finess’<strong>en</strong>trecrois<strong>en</strong>t et form<strong>en</strong>t un assemblage de losanges à l’image du filet, du rets, qui dans l’œuvreservira à capturer le poisson dans la mer des sages.Regardons maint<strong>en</strong>ant le Cimiez du chapiteau qui domine les colonnes, nous y trouvons cette fois unmasque représ<strong>en</strong>tant une face féminine, sereine, ronde, joufflu et couronnée à laquelle il est difficilede ne pas attribuer un caractère Lunaire.Isis à perdu son léger voile qui est v<strong>en</strong>u choir sur les épaules du couple, liant ainsi les deux« époux ». C’est donc la nature à découvert, la nature ouverte et disposée, qui domine cettecomposition. Pour le profane <strong>en</strong> Alchimie c’est une merveille de réalisme symbolique, pour l’étudiantpratici<strong>en</strong> c’est la révélation d’une situation particulière des matériaux qui conduit par la répétition àl’obt<strong>en</strong>tion du « petit soleil minéral ».Le souffre qui part du bas (la tête de chèvre, le caput) s’élève, monte et traverse la partie mercurielle(notée par les bois de cerf, le serviteur, le mercure), à l’intérieur de laquelle les sem<strong>en</strong>ces ser<strong>en</strong>contre <strong>en</strong> un coït (le couple), p<strong>en</strong>dant que la nature (le masque lunaire) disp<strong>en</strong>se ses influ<strong>en</strong>cesdont le vitriol (le linteau) est chargé. L’<strong>en</strong>semble constitue un vaisseau fermé hermétiquem<strong>en</strong>t par unbouchon cristallin sur qui repose, finalem<strong>en</strong>t, l’opération toute <strong>en</strong>tière.Au vue de cette analyse nous serions t<strong>en</strong>tés de dire avec audace que ce coté droit du panneau de lacheminée est consacré à la voie sèche du creuset.Quatre griffons à tête de femme <strong>en</strong>tour<strong>en</strong>t ce tableau, nous laissons aux lecteurs le loisir d’undéveloppem<strong>en</strong>t futur et certainem<strong>en</strong>t très intéressant.La dernière partie que nous t<strong>en</strong>terons d’analyser dans cette courte étude concerne le panneauc<strong>en</strong>tral. Véritable Heaumerie ce panneau du milieu est consacré, d’après nous, au feu secret desphilosophes. Sans ce feu aucune voie ne se réalise, autant l’humide que la sèche. Absolum<strong>en</strong>t ri<strong>en</strong>,aucun phénomène, aucune réaction n’est possible sans la possession de cet arcane majeur etc<strong>en</strong>tral.Avant donc que d’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre le travail, l’artiste cherche l’arme unique qui lui permettra de vaincre etde tuer véritablem<strong>en</strong>t les matières mixées afin que de leur pourrissem<strong>en</strong>t naisse un être nouveau.C’est ce que nous voyons au travers des mystérieux symboles empruntés à l’art de la guerre quel’artiste a employés avec habileté. Dominant la composition, une tête de lion couronnée semble vomirla langue fourchue d’un serp<strong>en</strong>t. (Notons que deux ailes fines émerg<strong>en</strong>t de l’arrière de ce masque defélin, nous les devinons comme attachées aux épaules de son corps) Immédiatem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> dessous et àla droite de l’observateur une oriflamme laisse flotter son drapé qui vi<strong>en</strong>t s’<strong>en</strong>rouler autour de son mât.A gauche, l’habit de mercure et son casque, si l’on <strong>en</strong> croit la prés<strong>en</strong>ce d’une aile latérale, flott<strong>en</strong>tégalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> forme de bannière dont le pique croise <strong>en</strong> X l’ét<strong>en</strong>dard de droite précédemm<strong>en</strong>t décrit.Cette partie se rapportant à la voie longue que nous connaissons si peu, nous ne nous ét<strong>en</strong>drons passur le sujet. Signalons simplem<strong>en</strong>t que le mot ORIFLAMME d’origine obscure tire ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t soness<strong>en</strong>ce de l’anci<strong>en</strong> français ORIE FLAMBE, l’à peu près phonétique aidant, nous y découvrons l’ORY FLAMBE. Prud<strong>en</strong>ce donc, dans cette voie car si le feu s’y applique <strong>en</strong> excès, le composé trop nourrivire au rouge et l’or de l’œuvre, <strong>en</strong>core fragile, s’y perd, s’y brûle.
L’empilem<strong>en</strong>t du dessous correspond à la voie sèche et devrait se lire si l’on <strong>en</strong> croit notre expéri<strong>en</strong>ce<strong>en</strong> partant du bas. <strong>Une</strong> tête de guerrier, probablem<strong>en</strong>t Mars est coiffé d’un casque à éperon supérieur,long et effilé comme la lame d’une épée. Sur ce pique vertical, la tunique de mercure, transpercéevi<strong>en</strong>t s’y <strong>en</strong>filer. Juste au dessus et au ras de la partie abdominale de l’armure un gros nœud reti<strong>en</strong>t,lie et compresse l’<strong>en</strong>semble.Si nous doutions au début qu’une partie de la cheminée fût consacrée à la voie courte, face à cedessin les doutes se sont <strong>en</strong>volés et ont laissé place à des certitudes. Il est, <strong>en</strong> effet, plus difficile defaire mieux pour décrire le tour de main opératif prés<strong>en</strong>té ici. Là ou ordinairem<strong>en</strong>t nous aurions dutrouver une tête morte nous y voyons celle d’un guerrier jovial et bi<strong>en</strong> <strong>en</strong> vie. C’est le signe que laterre n’a pas <strong>en</strong>core subi la calcination initiale. Car l’on aurait tort d’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre le labeur décrit aprèsavoir ôté à la partie mâle ce qu’elle a de plus précieux et sans laquelle la répétition des opérationsdevi<strong>en</strong>drait impossible au delà de la troisième fois. On nous reprochera de ne pas être clair mais c’estici que comm<strong>en</strong>ce réellem<strong>en</strong>t le travail de découverte pour l’opérateur qui désire ouvrir la porte<strong>Alchimique</strong> et il serait absurde de priver un courageux de la joie que l’on ress<strong>en</strong>t à vaincre cettepremière clef <strong>en</strong> tranchant véritablem<strong>en</strong>t le nœud Gordi<strong>en</strong> si bi<strong>en</strong> représ<strong>en</strong>té ici.Pour compr<strong>en</strong>dre néanmoins le mode d’action de notre feu, il convi<strong>en</strong>dra de relire l’extraordinairecomm<strong>en</strong>taire que fît Eugène Canseliet au sujet d’un des cartouches du Monastère de Cimiez et dontla devise est la suivante « FULCIT NON OMBUBRAT », il souti<strong>en</strong>t mais n’ombrage pas. C’est cetuteur que nous retrouvons dans ces emblèmes, il est là se manifestant physiquem<strong>en</strong>t partant du baset sout<strong>en</strong>ant le mercure au dessus de lui <strong>en</strong> une situation que la chimie classique n’autorise pas euégard à la d<strong>en</strong>sité et à la pondérabilité des matériaux employés. Remarquons égalem<strong>en</strong>t que ladisposition du pourpoint mercuriel et surtout la cambrure qu’il arbore oblige la face supérieure à laconvexité qui caractérise, dans la voie du creuset, l’emploi de substance lourde à cristallisationparticulière.Au dessus du nœud « Gordi<strong>en</strong> » un bouclier nous prés<strong>en</strong>te <strong>en</strong> bosse c<strong>en</strong>trale la face d’un vieillard,Saturne probablem<strong>en</strong>t, transpercé au m<strong>en</strong>ton par la lame d’un cimeterre ( le Cimeterre est une épéeori<strong>en</strong>tale à un seul tranchant dont la lame courbe s’élargit vers son extrémité) qui croise lui même laflèche d ‘un arc.D’après Pernety l’épée est le feu des philosophes de même que la lance, le cimeterre, la hache...L’emploi dans cette symbolique d’une arme ori<strong>en</strong>tale comme le cimeterre n’est bi<strong>en</strong> sûr pasinnoc<strong>en</strong>te. Car ce mot ne trouve pas d’étymologie précise, cep<strong>en</strong>dant la décomposition phonétiqu<strong>en</strong>ous fournit <strong>en</strong>core une fois l’explication de son utilisation. CIME et TERRE, le ciel et la terre, le hautet le bas. « IL monte de la terre au ciel, et redesc<strong>en</strong>d du ciel à la terre, et reçoit ainsi la vertu deschoses supérieures et des choses inférieures. » D’autre part, Saturne était fils d’Uranus et de Gé oudu ciel et de la terre, il possédait <strong>en</strong>tre autres quatre ailes sur ses épaules, deux déployées, deuxautres immobiles. De cette façon, il paraissait à la fois fixe et volatile. Dans la phase que nousanalysons et qui est <strong>en</strong> rapport avec la manifestation physique du feu dans la conversion desélém<strong>en</strong>ts notre but est bi<strong>en</strong> celui proposé par la description de Saturne, fixer le volatile et volatiliser lefixe.Finalem<strong>en</strong>t nous <strong>en</strong> rev<strong>en</strong>ons <strong>en</strong>core au thème de la fécondation, car, même dans le règne minéral,les sem<strong>en</strong>ces pénètr<strong>en</strong>t la partie féminine par le biais de protubérance visible. C’est le pivot dont ilétait question dans notre introduction de comm<strong>en</strong>taire, autour de cet axe de cet essieu le premiermouvem<strong>en</strong>t de la vie minérale s’accomplit <strong>en</strong> une magnifique rotation multicolore que les auteurs ontnommé Feu de roue.Nous arrêterons là notre investigation, laissant à ceux plus courageux ou plus instruits le soind’expliquer le reste de la symbolique de cet œuvre.Alkest ©
CONCLUSIONMartial Suv<strong>en</strong> ©Alkest nous à chargé de conclure cette étude. Ce n'est évidemm<strong>en</strong>t pas la tâche la plus facileétant donné que cette approche reste incomplète et ouverte à ceux qui voudront s'y attarder.Un mot des six Cariatides dont il est regrettable que nous ne puissions voir les deux sises auxextrémités latérales de cette cheminée, porteuses certainem<strong>en</strong>t elles aussi d'une significationsecrète et utile.Plusieurs détails éveill<strong>en</strong>t l'att<strong>en</strong>tion à la vue de ces femmes esclaves dont la fable racontequ'elles eur<strong>en</strong>t conservé leurs robes du temps de leur service obligatoire et forcé. Et c'estjustem<strong>en</strong>t l'aspect de leurs t<strong>en</strong>ues vestim<strong>en</strong>taire qui change pour chacune d'<strong>en</strong>tre-elles. Un peuà la manière de C<strong>en</strong>drillon et de la dame à la Licorne, elles sont parées des robes les plusextraordinaires. On chercherait vainem<strong>en</strong>t ailleurs que dans le dictionnaire mytho-hermétiqueune meilleure définition hermétique de cet habit: « Robe est un des noms que les Philosophesont donné aux couleurs qui survi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à la matière p<strong>en</strong>dant les opérations. Ils ont dit <strong>en</strong>conséqu<strong>en</strong>ce que leur Roi, leur Reine chang<strong>en</strong>t de robes suivant les saisons. Ainsi ROBEBLANCHE est la couleur blanche, qui succède à la noire, appelée ROBE TENEBREUSEcelle qui paraît, ou du moins doit paraître dans le cours des opérations philosophiques; cardans la première préparation de la matière crue, on ne doit pas chercher ces couleurs.ROBE DE POURPRE est la couleur rouge du soufre parfaitem<strong>en</strong>t fixé. C'est pourquoi laFable dit qu'Apollon vêtit une robe de couleur de pourpre, pour chanter sur la lyre la victoireque Jupiter avait remporté sur les Géants. Les Philosophes appell<strong>en</strong>t aussi du nom de Robe lesparties terrestres et grossières dans lesquelles sont r<strong>en</strong>fermés l'or vif des Sages et leurmercure; ils dis<strong>en</strong>t <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce qu'il faut dépouiller les vêtem<strong>en</strong>ts et les robes de leurRoi et de leur Reine, et les bi<strong>en</strong> purifier avant de les mettre dans le lit nuptial, parcequ'ils doiv<strong>en</strong>t y <strong>en</strong>trer purs, nus, et tels qu'ils sont v<strong>en</strong>us au monde ». Basile Val<strong>en</strong>tin.C'est <strong>en</strong> vérité ce que nous compr<strong>en</strong>ons (<strong>en</strong> gras) égalem<strong>en</strong>t du tableau de gauche où l'on voitle roi et la reine de l'œuvre préparés pour l'union et dans la nudité la plus naturelle, c'est à direla où l'art les à conduis par la purification progressive. Des quatre cariatides visibles sur lesclichés, les deux c<strong>en</strong>trales port<strong>en</strong>t leurs bras vers leurs têtes. Leurs coiffes et leurs cheveuxaffect<strong>en</strong>t une forme bi<strong>en</strong> précise. Pour celle de droite deux mèches recourbées rappell<strong>en</strong>t lescornes d'un bélier, attribut prés<strong>en</strong>t sur sa robe. Pour celle de gauche la coiffure pr<strong>en</strong>d l'aspectd'un diadème muni de formes latérales rappelant les cornes d'un taureau. C'est une tête desinge à moustaches qui orne la robe de celle-ci. En suivant les moustaches de ce masque ons'aperçoit qu'elles crois<strong>en</strong>t une forme qui rappelle égalem<strong>en</strong>t une tête d’un taureau. Allusionsaux matières de l'œuvre ainsi qu'à la période propice du travail qui conduit au mercurephilosophique. Du bouclier et de l'épée c<strong>en</strong>trale nous pourrions égalem<strong>en</strong>t dire qu'ilsconstitu<strong>en</strong>t les armes de l'alchimiste ainsi que celle du soufre secret de l'œuvre. <strong>Une</strong> armed'attaque et une arme de déf<strong>en</strong>se dont Fulcanelli développa le s<strong>en</strong>s au tome deux des« Demeures Philosophales » à propos d'un des caissons du château de Dampierre.Ou se trouve aujourd'hui l'homme qui ordonna l'exécution de cette cheminée ? Probablem<strong>en</strong>tadepte avec le titre de Rose-croix et donc possesseur de la gemme hermétique sa vie continuesout<strong>en</strong>ue par l'incroyable pouvoir de cette médecine. Parfait connaisseur des deux voies lapierre lui assure égalem<strong>en</strong>t richesse et savoir si l'on <strong>en</strong> croit la lég<strong>en</strong>de, l'histoire et pourquoipas la réalité...
Martial Suv<strong>en</strong>.