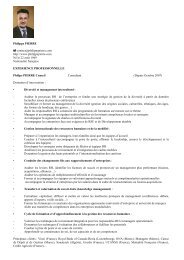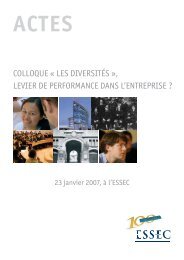le retour de mobilite internationale - Philippe Pierre
le retour de mobilite internationale - Philippe Pierre
le retour de mobilite internationale - Philippe Pierre
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
transfertPour compléter notre propos, nous pouvons citer <strong>le</strong>s points complémentaires suivants issus <strong>de</strong> lalittérature :- l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’organisation : cette <strong>de</strong>rnière – via <strong>le</strong>s collègues et <strong>le</strong> patron – considère comme <strong>le</strong>splus performants <strong>le</strong>s expatriés qui n’utilisent pas – ou ne montrent pas qu’ils utilisent –<strong>le</strong>scompétences acquises pendant la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> mobilité internationa<strong>le</strong>. Ad<strong>le</strong>r (1981, 1986) qualifie cecomportement <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> « xénophobe ».-l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s personnes au <strong>retour</strong> : dans la filia<strong>le</strong> loca<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s salariés s’atten<strong>de</strong>nt à ce que l’expatriése comporte différemment d’eux ; au moment du <strong>retour</strong>, <strong>le</strong>s collègues, <strong>le</strong> patron ne s’atten<strong>de</strong>nt pasà ce que l’expatrié se comporte <strong>de</strong> manière différente (Martin, 1984)-<strong>le</strong> manque <strong>de</strong> processus d’accompagnement (tutorat, compagnonnage) et <strong>de</strong> structures dédiées <strong>de</strong>la part <strong>de</strong> l’organisation constitue éga<strong>le</strong>ment un obstac<strong>le</strong> au transfert (Berthoin Antal 2001).- la gestion du processus <strong>de</strong> <strong>retour</strong> : en effet, l’expatrié est essentiel<strong>le</strong>ment en contact avec <strong>le</strong>smembres <strong>de</strong> la fonction « Ressources Humaines » - qui possè<strong>de</strong>nt rarement une expérienceinternationa<strong>le</strong> - et peu avec <strong>le</strong>s managers opérationnels (Berthoin Antal 2001) - <strong>le</strong> poste occupé au<strong>retour</strong> : manque <strong>de</strong> « visibilité externe, manque d’interaction avec <strong>le</strong>s autres salariés (BerthoinAntal 2001)Il est important <strong>de</strong> noter ici que <strong>le</strong>s organisations évoluent et peuvent passer d’un modè<strong>le</strong> à l’autre,par exemp<strong>le</strong> d’une approche ethnocentrique au départ à une approche polycentrique puisgéocentrique et que la référence dynamique au cyc<strong>le</strong> <strong>de</strong> vie et au temps est une dimension à prendreen compte. Cette dimension est éga<strong>le</strong>ment présente dans l’approche proposée ci-<strong>de</strong>ssous.Cel<strong>le</strong>-ci permet d’observer quel<strong>le</strong>s relations l’organisation tisse avec son personnel international,en fonction <strong>de</strong> son propre <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> maturité à l’international et <strong>de</strong> son cyc<strong>le</strong> <strong>de</strong> vie.De même que l’individu traverse <strong>de</strong>ux cyc<strong>le</strong>s successifs d’adaptation (la courbe en W),l’organisation connaît un cyc<strong>le</strong> <strong>de</strong> développement. Certains auteurs tel FRANKO (1973) évoquentla « courbe en U » lorsqu’ils décrivent <strong>le</strong>s moments-clés au cours <strong>de</strong>squels l’entreprise fait <strong>le</strong> plussouvent appel à la mobilité internationa<strong>le</strong>. Il s’avère que c’est généra<strong>le</strong>ment en début <strong>de</strong> cyc<strong>le</strong>(exportation, création <strong>de</strong> partenariats) et en fin <strong>de</strong> cyc<strong>le</strong> (création <strong>de</strong> filia<strong>le</strong>s à l’international,transfert <strong>de</strong> connaissances) lorsque l’entreprise possè<strong>de</strong> une vision <strong>de</strong> type global. La phaseintermédiaire – dite <strong>de</strong> maturité- correspond à l’embauche <strong>de</strong> personnel local et à une diminutiondu nombre d’expatriés.En fonction <strong>de</strong> son cyc<strong>le</strong> <strong>de</strong> vie à l’international, l’entreprise favorise ou non <strong>le</strong> transfert <strong>de</strong>connaissances au moment du <strong>retour</strong> ; ainsi, la phase 3 (globa<strong>le</strong>) nous semb<strong>le</strong> plus propice autransfert car, selon Franko (1973), el<strong>le</strong> a pour objectif <strong>le</strong> transfert <strong>de</strong> connaissances. Ainsi, <strong>le</strong>transfert <strong>de</strong> connaissances est un processus qui s’inscrit dans <strong>le</strong> temps et est relié au contexte <strong>de</strong>développement <strong>de</strong> l’organisation.Proposition N°10 : la phase <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l’entreprise à l’international appelée « globa<strong>le</strong> »influence positivement <strong>le</strong> transfert.9