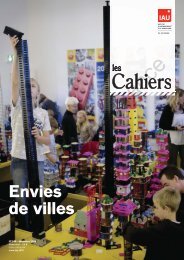L'aménagement des zones d'activités économiques : l'émergence ...
L'aménagement des zones d'activités économiques : l'émergence ...
L'aménagement des zones d'activités économiques : l'émergence ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Val de SeineDeveloping business parksor “economic activity <strong>zones</strong>”(ZAEs): the emergenceof inter-commune structuresis being confirmedIn 2006, 103 groups of localauthorities having their owntaxation account for 5.1 millionÎle-de-France residents. However,the inter-commune landscapeof the Region is far from stabilized.Since the year 2000, the numberof groups of local authoritieshas doubled, going from 47 to103, with an acceleration in 2003and 2004 but a downturn in 2005.New structures continue to be set upeven though inter-communegrowth, which has almost reachedmaturity at national level(90% of the communes), has beenstagnating for the last three years.This “peaceful revolution”is not without consequencesfor managing business parks (ZAEs)which are increasingly changinghands from commune levelto inter-commune level…L’aménagement <strong>des</strong> <strong>zones</strong>d’activités économiques :l’émergence<strong>des</strong> intercommunalitésse confirmeAgnès ParnaixIAURIFEn 2006, 103 groupements à fiscalité propre regroupent5,1 millions de Franciliens (1) . Pour autant, le paysageintercommunal francilien est loin d’être stabilisé. Depuis l’an 2000,le nombre de groupements a doublé, passant de 47 à 103,avec une accélération en 2003 et 2004 mais un fléchissementen 2005. La création de nouvelles structures se poursuitalors que la progression intercommunale, en passe d’être achevéeau niveau national (90 % <strong>des</strong> communes), marque le pasdepuis trois ans. Cette «révolution tranquille» n’est pas sansconséquence sur la gestion <strong>des</strong> <strong>zones</strong> d’activités économiques(ZAE) qui, de plus en plus, passent de l’escarcelle communaleà celle <strong>des</strong> groupements…(1) i.e. 58% of the population (excluding Paris itself)and 68% of the communes.(1) Soit 58 % de la population (hors Paris) et 68 % <strong>des</strong> communes.152CAHIERS DE L’IAURIF N°145
Répartition <strong>des</strong> groupementsd'Île-de-France selon la part <strong>des</strong> ZAEd'intérêt communautaire activessur leurs territoiresPas de ZAE IC58 %De 0 à 25 %3 %100 %18 %De 25 à 50 %7 %De 75 à 100 %11 %De 50 à 75 %3 %Une gestion exponentielle<strong>des</strong> ZAEpar les intercommunalitésPrès de la moitié <strong>des</strong> ZAE en cours decommercialisation sont gérées par lesintercommunalités, et le seront certainementplus encore dans les annéesà venir. Les intercommunalités d’Îlede-Franceaménagent actuellementprès de 5 500 ha de ZAE, dont 365 hadoivent être proposés à la vente dansles prochains mois. Il est probable queces surfaces augmenteront au cours<strong>des</strong> prochaines années, comme ellesont déjà progressé dernièrement. Eneffet, selon les données IAURIF, la part<strong>des</strong> surfaces brutes <strong>des</strong> ZAE d’intérêtcommunautaire (actives ou en projet)est passée de 44 % en 2003-2004 à47 % un an plus tard. Cette haussetient au basculement de certaines<strong>zones</strong> communales non entièrementcommercialisées dans le domaineintercommunal, ainsi qu’à l’ouverturede nouvelles ZAE par les intercommunalités.L’engouement intercommunalpour les ZAE s’explique aussi enpartie par la reprise très forte durythme de commercialisation dans lesZAE d’Île-de-France depuis la fin <strong>des</strong>années 1990, qui fait espérer un bonretour sur investissement (en termes detaxe professionnelle), mais fait passerà l’arrière plan les risques inhérents àl’aménagement…Source : IAURIF / 2005Répartition <strong>des</strong> groupementsd'Île-de-France selon la surface<strong>des</strong> ZAE actives d'intérêt communautaireDe 10 à 50 ha14 %Moins de 10 ha11 %De 50 à 200 ha11 %De 200 à 1 000 ha7 %Plus de 1 000 ha0 %Pas de ZAE d'intérêtintercommunal active57 %Près d’une vingtaine de groupementsassure l’intégralité de l’aménagement<strong>des</strong> ZAE en cours de leur ressort géographique.Une dizaine d’autres enassure la majorité mais cette proportionbaisse rapidement pour les autresintercommunalités. Plus de la moitié<strong>des</strong> structures intercommunales d’Îlede-France– la plupart sont <strong>des</strong> CC –n’assure pas actuellement d’aménagementde ZAE (7) . Pour de nombreusesstructures, certaines étapes incontournablessont longues et complexes,comme la définition de l’intérêt communautaire,puis le transfert effectif<strong>des</strong> <strong>zones</strong> (immeubles, terrains). Lessurfaces totales aménagées ou géréespar chaque intercommunalité varientconsidérablement. Pour une dizained’entre elles, cette superficie est inférieureà 10 ha alors que pour deuxstructures, le parc de ZAE dépasse500 ha.Sur leurs territoires, les groupementsse réservent les plus vastes aménagements.La proportion <strong>des</strong> ZAE d’intérêtcommunautaire augmente avec lataille <strong>des</strong> <strong>zones</strong> (8) . Sur le territoire <strong>des</strong>groupements, la surface moyenne <strong>des</strong>opérations communautaires (47 ha),dépasse donc celle <strong>des</strong> autres opérations(14 ha), alors que la moyennes’établit à 31 ha en dehors <strong>des</strong> intercommunalités.Cette supériorité entaille <strong>des</strong> <strong>zones</strong> aménagées par lesintercommunalités est récente. Les secteursà forts enjeux économiques, oùse déploient de vastes <strong>zones</strong> d’aménagementéconomique ou commercial,ne sont pas toujours couverts par uneintercommunalité. La perspective dupartage de la taxe professionnelle surun territoire élargi et/ou la concurrenceentre intercommunalités voisinespour l’annexion de secteursconvoités contribue sans doute à expliquerl’émergence difficile de groupementssur certains pôles d’activitéséconomiques (Gennevilliers, Orly-Rungis, Vélizy-Villacoublay, zone deCourtabœuf, Seine-amont, Bonneuilsur-Marne…).La préexistence deSIVU ou SIVOM (9) compétents pourla gestion de ZAE (à Mitry-Mory/Compans par exemple) peutégalement freiner la constitution <strong>des</strong>groupements à fiscalité propre.Néanmoins, les syndicats de ce typesont moins fréquents en Île-de-Francequ’en province.Quelles sont les ZAEd’intérêt communautaire ?Un découpagetout en nuances…Les intercommunalités sont compétentespour les ZAE d’intérêt communautaire,c’est-à-dire celles qui participentau «projet commun dedéveloppement» défini à l’échelle dugroupement, tandis que d’autres, pourlesquelles les enjeux s’expriment à uneéchelle plus locale, peuvent demeurerdans le giron communal.Les CA, comme les CC ont l’obligationde déclarer (10) , avant le 18 août2006, quelles sont les ZAE d’intérêtcommunautaire, c’est-à-dire celles relevantde leur responsabilité. Le minis-(7) Parmi celles-ci, huit ne sont pas dotées dela compétence.(8) 56 % <strong>des</strong> surfaces <strong>des</strong> ZAE actives dépassent50 ha, 23 % <strong>des</strong> <strong>zones</strong> ont moins de 10 ha.(9) Syndicat à vocation unique, syndicat à vocationmultiple.154CAHIERS DE L’IAURIF N°145
Surface <strong>des</strong> «ZAE actives» <strong>des</strong> territoires intercommunaux,population et année de création <strong>des</strong> groupementsPopulation <strong>des</strong> territoires intercommunaux350 000300 000250 000200 000150 000100 00050 00001960 1970dualisée <strong>des</strong> sites (un tiers <strong>des</strong> cas également).En revanche, le critère de lataille de la zone n’est qu’exceptionnellementretenu.S’y ajoutent d’autres éléments plusspécifiques aux agglomérations : lecaractère stratégique du secteur géographiqueconcerné, son lien avec certainesfilières économiques localementvalorisées (comme la filière santé,sciences du vivant et recherche pour leVal de Bièvre), l’exclusion de certaines<strong>zones</strong> (commerciales, centrevilles…),la notion de cohérence de lazone (homogénéité, continuité), le lienavec d’autres compétences communautaires(urbanisme, politique de laville), le nombre d’entreprises implantéessur la zone… Ceux-ci dénotentune recherche plus fouillée de cohérenceglobale <strong>des</strong> actions communautaires: d’un point de vue sectoriel (quelmodèle de développement économiqueprivilégier ?), géographique avecl’analyse spatiale <strong>des</strong> tissus urbains etenfin systémique par l’étude <strong>des</strong>interrelations stratégiques entrecompétences exercées au niveaucommunautaire et la recherche decomplémentarité à l’échelon communal.Toutefois, de telles définitions quireposent sur <strong>des</strong> critères généraux peuventsouffrir de l’imprécision de la terminologieutilisée. Qu’entend-on parexemple par «rôle stratégique» ou«unité cohérente» <strong>des</strong> ZAE ? Et, dèslors, quels sont in fine les sites classésd’intérêt communautaire ?Les SAN et anciens SAN,figures toujoursemblématiquesAu classement <strong>des</strong> aménageurs intercommunaux,rangés en fonction <strong>des</strong>surfaces en cours de commercialisation,figurent dans les 10 premiers tousles SAN et anciens SAN d’Île-de-France transformés en communautésd’agglomération (de 200 ha pourSénart-en-Essonne à plus de 1 000pour Cergy-Pontoise et Sénart villenouvelle). Les quatre SAN d’Île-de-France (Marne-la-Vallée-Val Maubuée,Val d’Europe, Sénart-en-Essonne etSénart ville nouvelle) aménagentaujourd’hui, avec l’appui <strong>des</strong> établissementspublics d’aménagement(EPA) présents sur leur territoire, plusdu tiers <strong>des</strong> surfaces <strong>des</strong> ZAE d’intérêtcommunautaire en cours de commercialisationdans notre région,(21 % du nombre d’opérations). En1980 1990 2000Année de création <strong>des</strong> groupementsSurface de l'ensemble <strong>des</strong> ZAE activesSurface <strong>des</strong> ZAE actives d'intérêt communautaireSource : IAURIF 2005Le Val d’Orge, privilégié par la proximitéde l’autoroute A6 et la Francilienne Sud,se classe en tête <strong>des</strong> agglomérationspour les superficies aménagées.Communauté d’agglomération du Val d’Orgereclassant les CA issues de SAN (14) dansleur catégorie d’origine, l’effort exceptionnelaccompli en Île-de-Francepour l’aménagement <strong>des</strong> ZAE dans lesvilles nouvelles est mieux restitué :73 % <strong>des</strong> surfaces intercommunalesen cours d’aménagement (51 % <strong>des</strong>opérations) sont attribuables à ces septstructures. De plus, la taille <strong>des</strong> surfacesaménagée par les SAN (82,1 ha enmoyenne pour les ZAE en cours decommercialisation) est deux fois supérieureà celles qui sont réalisées par lesCA (44,9 ha) et quatre fois à celle <strong>des</strong>CC (20,9 ha). Dans le même temps, lasurface moyenne <strong>des</strong> terrains aménagéspar les SAN passée dans le droitcommun diminue, en raison sansdoute de l’achèvement <strong>des</strong> plus grossesopérations. Évry-Centre Essonne etSaint-Quentin-en-Yvelines sont mêmeconfrontés à l’apparition d’une pénuriefoncière sur leur territoire.La production de surfaces aménagéespar les CA (plus de 2 500 ha en cours,soit la moitié du total intercommunal)demande, quant à elle, à être relativisée,puisqu’elle tient, pour 70 % laplace occupée par les trois anciens SAN(Cergy-Pontoise, Évry-Centre Essonneet Saint-Quentin-en-Yvelines). Si l’onexcepte ceux-ci, le Val d’Orge (235 ha(14) Les activités <strong>des</strong> établissements publicsd’aménagements leur ont été transférées.156CAHIERS DE L’IAURIF N°145
en cours d’aménagement), qui jouitd’une situation exceptionnelle avec laproximité de deux <strong>des</strong>sertes stratégiques,l’autoroute A6 et laFrancilienne Sud, se classe en tête <strong>des</strong>agglomérations pour les superficiesaménagées (opérations «MaisonNeuve», «Techniparc»…). Il est suivipar le Pays de Meaux (161 ha) quiréalise quelques grosses opérations(«Meaux Nord», zone franche urbaine«Allée <strong>des</strong> platanes») et par Marne-et-Gondoire (75 ha), qui, située sur lesecteur IV de Marne-la-Vallée, connaîtune phase d’urbanisation rapide.L’ampleur <strong>des</strong> travaux engagés par cestrois groupements, malgré leur jeuneâge, tient au transfert, au niveau intercommunal,d’aménagements quiétaient déjà programmés avant leurcréation (1999).Le poids global <strong>des</strong> CC s’avère a fortiorimo<strong>des</strong>te. Parmi les 20 CC qui aménagentquelques 550 ha, se distingue, enpremier lieu, la CC du Val Bréon. CetteCC est compétente depuis son origine,en 1995, pour aménager la «zone logistiquede Châtres» (140 ha), à proximitédu carrefour de la RN4 et de laRN36, en Seine-et-Marne. Cette opérationconstitue même un <strong>des</strong> motifsde la création de la CC. Se rangentensuite quatre autres CC (Dammartinen-Goële,Deux Fleuves, Orée de laBrie et Roissy-Porte de France) quiaménagent <strong>des</strong> espaces de 60 à 75 ha.Trois de ces communautés (15) ne prennenten charge que l’aménagementd’une proportion d’environ 30 % <strong>des</strong>surfaces de ZAE de leur territoire.Rappelons que Roissy-Porte de Franceconstitue l’un <strong>des</strong> principaux pôles dedéveloppement d’Île-de-France etbénéficie de forts investissementspublics (Aéroports de Paris) et privés.À la confluence de la Seine et del’Yonne, le territoire <strong>des</strong> Deux fleuves<strong>des</strong>servi par l’autoroute A5, comporteune zone portuaire gérée par le Portautonome de Paris.La communauté de communes Roissy-Porte de France constitue l’un <strong>des</strong> principauxpôles de développement d’Île-de-France et bénéficie de forts investissements publicset privés.N. OuartiUne concentration <strong>des</strong> ZAEintercommunalesdans la couronnepériurbaine francilienneLa localisation <strong>des</strong> ZAE franciliennesopérationnelles et achevées est fortementconcentrée sur la couronnepériurbaine de l’agglomération parisienne(16) . 63 % <strong>des</strong> superficies consacréesaux ZAE s’y trouvent. Cette polarisationest encore accentuée pour lesZAE d’intérêt communautaire (90 %<strong>des</strong> surfaces de ZAE intercommunales).Ce résultat tient, il est vrai, aupoids <strong>des</strong> SAN qui relèvent tous de cesecteur. Mais ce constat vaut pour lesCA, avec 93 % de leurs surfaces d’activité.On y dénombre plusieurs structures(17) qui développent d’importantessurfaces de ZAE opérationnellesou achevées (anciens SAN, Val d’Orge,Plateau de Saclay, Marne et Gondoire,Lacs de l’Essonne, Val de France…).Les ZAE <strong>des</strong> CC, par nature moinsurbaines et davantage dispersées surl’espace régional, sont surreprésentéesen couronne périurbaine (56 % deleurs surfaces de ZAE sur 21 % de leursterritoires). Citons l’Orée de la Brie,Marne et Chantereine, Roissy-Ported’Île-de-France et de l’ouest de laPlaine de France… Une grande majorité<strong>des</strong> espaces urbanisables ou partiellementurbanisables inscrits auschéma directeur de la région d’Îlede-France(SDRIF) de 1994 sont, eneffet, inclus dans ce secteur qui conjugue,il est vrai, plusieurs <strong>des</strong> qualitésspatiales prisées par les entreprises enquête de nouvelles implantations : pré-(15) La CC de Orée de la Brie n’en fait pas partie(87 % <strong>des</strong> ZAE d’intérêt communautaire).(16) Cette zone, dénommée la «ceinture verte»,est mentionnée dans le SDRIF de 1994. Situéeà une distance de 10 km à 30 km de la capitale,elle se localise entre l’agglomération centraleet la couronne rurale. Composé initialementde 359 communes, ce territoirecorrespond à <strong>des</strong> <strong>zones</strong> urbanisées imbriquéesdans <strong>des</strong> espaces non construits boisés et ruraux(cf. Note Rapide sur le Bilan du SDRIF n° 303,Iaurif, sept. 2002). Pour les besoins de l’article,la couronne périurbaine correspond à un secteurplus large (423 communes dont 30 communesde petite couronne, définition IAURIF,DUAT).(17) Les trois anciens SAN en font égalementpartie.Nouveaux enjeux : quels leviers d’actions ? 157
sence de disponibilités foncières, qualitéde la <strong>des</strong>serte (notamment routière),coûts raisonnables…Dans la couronne rurale, les ZAE d’intérêtcommunautaire sont à la foismoins représentées et, en moyenne,moins vastes (18) . On y trouve 26 <strong>des</strong>158 ZAE d’intérêt communautaire. LesCA étant presque absentes de ce secteurle plus éloigné de l’agglomérationcentrale (à l’exception du Pays deMeaux et de Mantes-en-Yvelines), lataille moyenne <strong>des</strong> ZAE (25 ha pour les<strong>zones</strong> actives) se rapproche de celle<strong>des</strong> CC. La moitié <strong>des</strong> sites développentune vocation artisanale ou partiellementartisanale, en particulier lesplus petits.Avec une quasi-absence de ZAE d’intérêtcommunautaire (1 % <strong>des</strong> surfacesactives, en projet ou achevées enÎle-de-France), le cas <strong>des</strong> territoiresintercommunaux de l’agglomérationcentrale contraste fortement avec ceuxde la couronne périurbaine. Parmi lesfacteurs explicatifs, figure en premierlieu la pénurie de terrains aménageablesqui rend problématique la réalisationde ZAE futures, l’une <strong>des</strong> «spécialités»<strong>des</strong> intercommunalités. Ainsi,quelques CC relevant de ce secteur nesont pas même dotées de la compétenceZAE (Charenton-le-Pont etSaint-Maurice, Châtillon-Montrouge).De même, les CA d’Île-de-France sansZAE sont presque toutes situées danscette zone (Arc-de-Seine, Hauts-de-Le territoire de Plaine Commune fait figure d’exception dans l’exercice de la compétenceZAE par la communauté d’agglomération.D. Mollier SobetBièvre, Cœur-de-Seine, Sud-de-Seine,Val de Seine, vallée de la Marne et Valde Bièvre). Parmi celles-ci figurent <strong>des</strong>structures de création très récente, quin’ont pas encore procédé à d’éventuelstransferts de <strong>zones</strong> d’activité, <strong>des</strong> secteursde tradition plutôt résidentielle(Sud <strong>des</strong> Hauts-de-Seine) et également<strong>des</strong> intercommunalités dont le périmètreétroit (deux ou trois communes)rend difficile l’articulation, à cetteéchelle, entre les <strong>zones</strong> résidentielleset les <strong>zones</strong> d’emploi. Dans ce cas,l’exercice de la compétence ZAE, obligatoirepour les CA, s’avère problématique.Le territoire de Plaine Commune, quis’inscrit dans le pôle majeur de redéveloppementéconomique de la«Plaine de France» où se côtoient lesinitiatives privées et publiques, faitfigure d’exception. Toutes les ZAEcommunales de ce territoire devraientprogressivement être intégrées dans ledomaine communautaire, même si lapriorité du groupement sembleaujourd’hui plutôt orientée versl’aménagement mixte (ZAC de centre-ville…).Quelques ZAE communautairessont toutefois en cours d’aménagement(ZAC de Villetaneuse,28 ha).Répartition <strong>des</strong> surfaces régionalesAgglomération Couronne Couronne Totalcentrale périurbaine ruraleSurfaces totales 5 % 26 % 69 % 100 %Surfaces <strong>des</strong> groupements 3 % 30 % 68 % 100 %Communautés de communes 0 % 21 % 79 % 100 %Syndicats d’agglomération nouvelle 0 % 100 % 0 % 100 %Communautés d’agglomération 16 % 63 % 21 % 100 %Surfaces <strong>des</strong> ZAE 22 % 63 % 15 % 100 %Surfaces <strong>des</strong> ZAE d'intérêt communautaire 1 % 90 % 9 % 100 %Communautés de communes 0 % 56 % 44 % 100 %Syndicats d’agglomération nouvelle 0 % 100 % 0 % 100 %Communautés d‘agglomération 1 % 93 % 6 % 100 %Source : Iaurif 2005L’intercommunalité,quelles perspectivespour la gestion <strong>des</strong> ZAE ?Les intercommunalités pourraientfavoriser, face à l’arrivée à maturité dumarché <strong>des</strong> ZAE sur les villes nouvelles,l’opportunité de créer, en dehors de(18) Quelques exceptions toutefois, comme la«zone logistique de Châtres» développée par leVal Bréon (140 ha).158CAHIERS DE L’IAURIF N°145
ces secteurs, parfois à leur périphérie,une offre renouvelée et plus structurée.Des promesses face aux attentes<strong>des</strong> acteurs économiquesC’est l’occasion de mettre sur le marchéune offre foncière et immobilièrede nouvelle génération, mais aussi, parle biais du transfert de ZAE déjà existantes,l’occasion d’entreprendre le toilettageen profondeur d’une générationde sites qui subit un certainvieillissement. Avec <strong>des</strong> services économiquesqui s’étoffent, les communautéssont dotées de moyens financiersaccrus et de personnel plusqualifié que les communes. Tout enréalisant <strong>des</strong> économies d’échelles(contrats d’entretien <strong>des</strong> ZAE parexemple), elles sont mieux en mesurede porter <strong>des</strong> réflexions à moyen termeet de mener <strong>des</strong> actions ambitieusespour le territoire (diagnostics territoriaux,état <strong>des</strong> lieux <strong>des</strong> ZAE, analyse<strong>des</strong> besoins <strong>des</strong> entreprises, investissementdans <strong>des</strong> outils de gestion performantscomme les systèmes d’informationsgéographiques…). Ellescontribuent, grâce à <strong>des</strong> efforts d’harmonisation,à une meilleure lisibilité del’offre sur <strong>des</strong> territoires moins éclatés(bourse <strong>des</strong> locaux, outils Internet…).Dans un souci de complémentarité <strong>des</strong>ervices, elles nouent <strong>des</strong> partenariatséconomiques divers (relations avec leschambres de commerce et d’industrie,les conseils généraux, les associationsou agences de développement…).Il semble, ainsi que certaines intercommunalités,dotées d’une bonnecapacité d’innovation, soient enmesure d’apporter une réponse à <strong>des</strong>enjeux régionaux qui touchent audéveloppement <strong>des</strong> ZAE : faire face àla pénurie de ZAE de grande taille,offrir <strong>des</strong> choix de localisation bienadaptés en termes d’accessibilité,répondre à la demande en services <strong>des</strong>entreprises et de leurs employés (hôtellerie,restauration, équipements de loi-Des projets diversifiés adaptés au contexte local,quelques illustrationsUn nouveau parc d’activités de 85 ha réservé aux entreprises à forte valeurajoutée pour la CC Plaines et Forêts d’Yvelines (35 906 habitants)En extension de la zone d’activités du «Bel-air-Cutesson», ce projet participera,conformément aux orientations du SDRIF de 1994 et au schéma d’aménagementpour un développement équilibré <strong>des</strong> Yvelines, à la polarisation accrue de l’activitéde la zone Rambouillet – Gazeran. Il s’agit d’accueillir, sur un site de haute qualitéenvironnementale, <strong>des</strong> entreprises spécialisées dans le secteur <strong>des</strong> technologies del’information ou <strong>des</strong> fonctions intellectuelles et informatiques <strong>des</strong> sièges sociaux. Leréseau de télécommunications sera aménagé en conséquence (dégroupage ADSL,accès au très haut débit en milieu rural).CA de Marne et Gondoire (51 223 habitants) : vers une charte de qualitéenvironnementale pour les ZAEUn développement économique fort au cœur du territoire de Marne-la-Vallée touten conciliant un environnement de grande qualité, tels sont les objectifs fixés parMarne-et-Gondoire. Le premier terrain d’application de ce principe devrait être lafuture zone d’activités de Lamirault à Collégien (26 ha). Ce site aujourd’hui agricoleinséré dans un écrin forestier, inclut la ferme de Lamirault, inscrite à l’inventairesupplémentaire <strong>des</strong> monuments historiques. Cette expérience serait étendueprogressivement aux autres <strong>zones</strong> gérées par l’agglomération (en 2005, 16 sitesdéclarés d’intérêt communautaire).L’accueil foncier et immobilier <strong>des</strong> entreprises locales, petites et moyennesentreprises et très petites entreprises, une priorité inscrite dans le cadrede l’adoption, en octobre 2005, de la stratégie économique de la CAde la vallée de Montmorency (101 862 habitants)L’objectif de l’agglomération est de maintenir et développer une offre de proximitéqualitative dans le commerce, l’artisanat et les services sur un territoire à fortedominante résidentielle. La CA assure aujourd’hui la gestion de sept parcs d’activitésde dimensions restreintes (< 5 ha pour la plupart). Cet objectif passe par la résorption<strong>des</strong> friches industrielles, dans le cadre d’une requalification de certaines <strong>zones</strong>,l’entretien, voire l’extension de parcs existants, mais également par la création denouvelles ZAE.Développer l’offre foncière et immobilière, requalifier les ZAE existantes et,enfin, réhabiliter les friches industrielles, tels sont les objectifs inscritsdans le projet de territoire CAP 2013 développé par la CA de MelunVal de Seine (103 382 habitants)Il s’agit à la fois d’accroître progressivement l’offre à vocation économique disponible(<strong>des</strong> potentialités de près de 200 ha) dans un souci de qualité urbanistique,environnementale et de cohérence avec l’environnement économique, de requalifierdeux ZAE (maîtrise du foncier, environnement, voirie et accessibilité…) et deréhabiliter deux friches industrielles, témoins du passé industriel de l’agglomération.Consolider les <strong>zones</strong> d’activités économiques, un objectif inscrit dans le projetde territoire (2004-2012) de la CA du Val d’Orge (119 877 habitants)À ce titre, l’agglomération prévoit diverses actions de requalification en vue depromouvoir le niveau d’équipement et de qualité environnementale de ses dix ZAE(plus de 200 ha), comme le traitement <strong>des</strong> espaces publics, l’amélioration de la<strong>des</strong>serte par les transports en commun, de la <strong>des</strong>serte marchandise multimodale,la qualité environnementale, la création de pôles de services à <strong>des</strong>tination <strong>des</strong>entreprises et <strong>des</strong> actifs, l’accès aux technologies numériques à haut débit.Nouveaux enjeux : quels leviers d’actions ? 159
sirs…), mettre sur le marché une offreorientée vers le haut de gamme, avecun environnement de qualité tout enremettant à niveau <strong>des</strong> secteurs plusanciens… Tout comme les entreprisesen quête de localisation, les intercommunalitéssont très sensibles àl’«image» que renvoient leurs <strong>zones</strong>d’activités. Ces structures récentes etencore méconnues du grand publicutilisent <strong>des</strong> projets visibles (grandséquipements, mais aussi ZAE…)comme outil de promotion au serviced’un «marketing territorial».De plus, <strong>des</strong> groupements ont la capacitéde développer, au croisement deleurs différentes compétences économiques,<strong>des</strong> services complémentaires(pépinières d’entreprises, ateliers relais,maisons de l’emploi, actions d’insertion,de formation…), comme <strong>des</strong> servicesaux salariés (équipements de loisirs…).Pour asseoir leursinterventions, elles s’appuient égalementsur d’autres leviers (compétencesen aménagement de l’espace eturbanisme, voirie, transports, environnement…).Ces outils participent,de façon plus générale, à l’attractivité<strong>des</strong> territoires.Des réponses encoreinsuffisantesMais les exemples présentés, tous trèsrécents, montrent aussi que lesréflexions <strong>des</strong> intercommunalités surles ZAE commencent, pour beaucoupd’entre elles, tout juste às’amorcer, particulièrement en petitecouronne. L’analyse ex-post <strong>des</strong> résultatsaprès la mise en place <strong>des</strong> projetss’écartera sans doute en partie del’énoncé <strong>des</strong> projets.De plus, l’étroitesse d’un bon nombrede périmètres intercommunaux estproblématique. Avec diverses conséquences…L’équilibre entre les <strong>zones</strong>d’activités et d’habitat est difficile àatteindre sur <strong>des</strong> territoires réduits àune faible portion de l’agglomérationparisienne et certains territoires intercommunauxsont dépourvus de ZAE.Des pôles d’activités sont scindés entreplusieurs entités de gestion, commec’est le cas pour la zone de Courtabœuf(Villebon-sur-Yvette, les Ulis et CC ducœur du Hurepoix) avec les disparitésfiscales et le manque de coordinationque cela peut engendrer. En milieurural, certains groupements n’ont pasla capacité dimensionnelle pour menerà bien dans <strong>des</strong> délais raisonnables lemontage juridique, financier et opérationnelde ZAE et plusieurs projetsanciens n’ont pas encore émergé fautede moyens. La richesse fiscale peut êtremal répartie, comme l’illustre l’exemple,souvent pointé, du secteur de l’aéroportde Roissy, marqué par de fortesdisparités de potentiel fiscal entregroupements voisins (Plaine de France,382 €/hab. en 2005 et Dammartin-en-Goële, 68 €/hab.). En outre, <strong>des</strong>concurrences persistent à l’échelonintercommunal, notamment enmatière fiscale. Les territoires <strong>des</strong> périphéries(CC <strong>des</strong> Portes de l’Île-de-France par exemple) qui, contrairementaux centres urbains (CA deMantes-en-Yvelines), ne supportentpas de charges liées à la centralité, pratiquentvolontiers <strong>des</strong> politiques detaux attractifs.D’autre part, <strong>des</strong> groupements affirmentleur volonté de consolider <strong>des</strong>filières économiques, sans en tirer lesconséquences sur le plan d’une spécialisation<strong>des</strong> ZAE, pourtant souhaitéepar certains acteurs économiques.En zone agglomérée, les stratégies <strong>des</strong>pécialisation (pôle audiovisuel pourPlaine Commune, filière santé, sciencesdu vivant et recherche pour le Valde Bièvre, filière image pour la Valléede la Marne à travers les actions del’ACTEP (19) ) se heurtent, il est vrai, àune quasi-absence de ZAE opérationnellesd’intérêt communautaire.Pourtant, comme il existe déjà <strong>des</strong>réseaux intercommunaux d’équipementssportifs ou culturels, <strong>des</strong> synergieséconomiques pourraient êtreorganisées autour de réseaux de ZAE,dépassant même les limites intercommunales(vallée scientifique de laBièvre…). Mais toutes les activités nesont pas logées à la même enseigne.Les élus intercommunaux qui sontprêts à accueillir les filières «high-tech»pour valoriser leur territoire, sontbeaucoup plus réticents vis-à-vis <strong>des</strong>activités nuisantes…Des difficultés à relativiserLe rapport particulier de la Cour <strong>des</strong>comptes sur l’intercommunalité publiéen novembre 2005 souligne que «s’ilest un domaine dans lequel les apportsde l’intercommunalité sont incontestables,c’est bien celui du développementéconomique» qui «consiste, principalement,à équiper et à gérer <strong>des</strong><strong>zones</strong> d’activités».Certaines préconisations du rapport,reprises dans une circulaire ministérielle(20) , prévoient la réalisation par lespréfets d’un schéma départementald’orientation de l’intercommunalité.Ce schéma constitue «un instrumentconcerté de proposition et de dialogues’inscrivant dans une perspectiveà moyen terme de la carte intercommunale».Il «propose les fusions et lesélargissements de périmètres nécessairesà un meilleur fonctionnement<strong>des</strong> EPCI (21) ». Si les préfets s’emparentdu pouvoir d’orientation qui leur estconféré, cette évolution sera sans doutebénéfique à l’aménagement et à la gestion<strong>des</strong> ZAE, comme d’ailleurs à biend’autres compétences intercommunales.(19) Association <strong>des</strong> collectivités territorialesde l’Est parisien.(20) La circulaire du ministre délégué auxCollectivités territoriales adressée aux préfets le25 novembre 2005.(21) Établissement public de coopération intercommunal.160CAHIERS DE L’IAURIF N°145