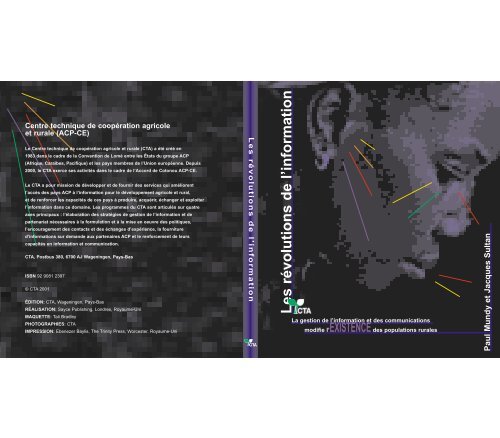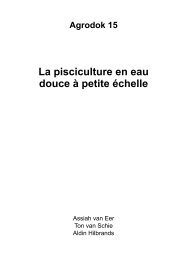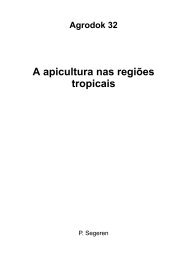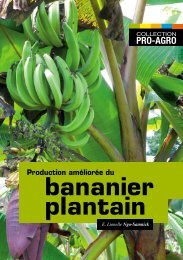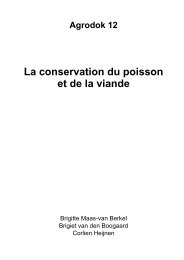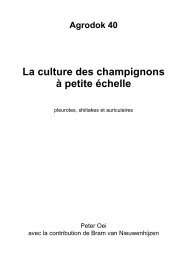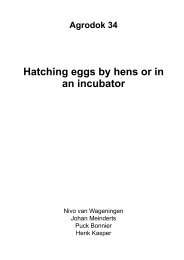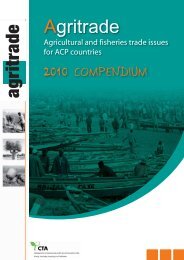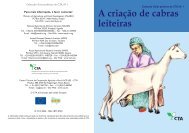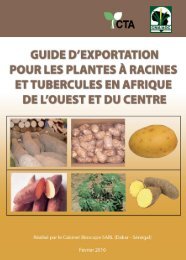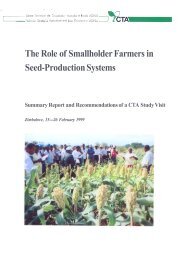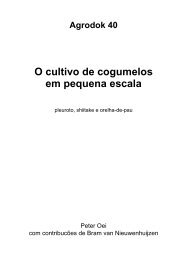Télécharger - Anancy
Télécharger - Anancy
Télécharger - Anancy
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Centre technique de coopération agricoleet rurale (ACP-CE)Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) a été créé en1983 dans le cadre de la Convention de Lomé entre les États du groupe ACP(Afrique, Caraïbes, Pacifique) et les pays membres de l’Union européenne. Depuis2000, le CTA exerce ses activités dans le cadre de l’Accord de Cotonou ACP-CE.Le CTA a pour mission de développer et de fournir des services qui améliorentl’accès des pays ACP à l’information pour le développement agricole et rural,et de renforcer les capacités de ces pays à produire, acquérir, échanger et exploiterl’information dans ce domaine. Les programmes du CTA sont articulés sur quatreaxes principaux : l’élaboration des stratégies de gestion de l’information et departenariat nécessaires à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques,l’encouragement des contacts et des échanges d’expérience, la fournitured’informations sur demande aux partenaires ACP et le renforcement de leurscapacités en information et communication.CTA, Postbus 380, 6700 AJ Wageningen, Pays-BasISBN 92 9081 2397© CTA 2001ÉDITION: CTA, Wageningen, Pays-BasRÉALISATION: Sayce Publishing, Londres, Royaume-UniMAQUETTE: Tali BradleyPHOTOGRAPHIES: CTAIMPRESSION: Ebenezer Baylis, The Trinity Press, Worcester, Royaume-UniLes révolutions de l’informationLes révolutions de l’informationLa gestion de l’information et des communicationsmodifie l’EXISTENCE des populations ruralesPaul Mundy et Jacques Sultan
Les révolutions de l’information
Les révolutions de l’informationLa gestion de l’information et des communicationsmodifie l’EXISTENCE des populations ruralesPaul Mundy et Jacques Sultan
Centre technique de coopération agricole et rurale (ACP-CE)Siège du CTAAgro Business Park 26708 PW WageningenPays-BasTél. (31) 317 467100 ; fax (31) 317 460067E-mail cta@cta.nlAdresse postalePostbus 3806700 AJ WageningenPays-BasAntenne de BruxellesRue Montoyer 391040 BruxellesBelgiqueTél. (32) 2 513 7436/2 502 2319 ; fax (32) 2 511 3868E-mail ctabxl@compuserve.comAntenne régionale des CaraïbesCaribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI)University CampusSt AugustineTrinidad WITél. (1) 868 645 1205 ; fax (1) 868 645 1208E-mail infocentre@cardi.orgAntenne régionale du PacifiqueInstitute for Research, Extension and Training in Agriculture (IRETA)University of the South PacificAlafua CampusPrivate Mail BagApiaSamoaTél. 685 22372/21882 ; fax 685 22933/22347 ; télex 251 usp sxE-mail uspireta@samoa.usp.ac.fjSite Web du CTA : www.cta.nl
Table des matièresRemerciements viAvant-propos viiIntroduction 1Radio et télévision 11Des feuilletons radiophoniques pour le développement 13 Apporter aux producteurs ruraux une information de proximité 21La culture au cœur du développement 27 Des radios locales pour répondre aux besoins des populations rurales 35La vidéo au service du développement 41Journaux et bulletins 47La Voix du Paysan, une tribune pour le monde rural 49 Une question de surviel 57 Sortir de la marginalité 63Panos, l’environnement et la démocratie 69 PANA, une agence de presse pour l’Afrique 73Alphabétisation et langues nationales 77Alphabétisation et moyens d’existence en Ouganda 79 En Ouganda, apprendre à la demande 85A quoi sert l’alphabétisation s’il n’y a rien à lire ? 89 Des paysans qui créent leurs réseaux d’information… 97Informatique et télécommunications 101Africa Online et l’initiative « e-touch » 103 Le télécentre communautaire de Nakaseke 107Il y a tellement de choses à dire… 113Les groupements paysans et les marchés 121Donner une voix aux paysans 123 FONGS – organiser les producteurs ruraux du Sénégal 129Pour une gestion transparente de l’argent des paysans 133 L’association PELUM 137 Le cas du KACE 143Savoirs paysans 147Experts traditionnels et vétérinaires aux pieds nus dans le nord du Kenya 149À la Trinité, des poulets sous surveillance 155 Forêts nourricières 159Liens entre la recherche et la vulgarisation 163Comment l’ENDA lie la recherche, la formation et la vulgarisation 165 Maîtriser la mosaïque du manioc en Ouganda 169Combattre la cochenille de l’hibiscus 173 Ateliers d’écriture 177 Des insectes nuisibles dans le Pacifique 183La Revue africaine de recherche agricole 187Réseaux de recherche 191Partager de maigres ressources 193 Au service du Pacifique 199Collaborer pour aller de l’avant 205 Relever des défis au paradis 211Bibliothèques 217Travailler à l’aveuglette 219 Le Centre de ressources de l’ITDG 225Lectures conseillées 228Sigles, abréviations et acronymes 232
REMERCIEMENTSDe nombreuses personnes ont apporté une contribution directe ou indirecte à cet ouvrage. Beaucoup d’entre elles ont été interviewées auBurkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Mali, au Sénégal et en Ouganda. Toutes ont généreusement accordé leur temps et se sontexprimées en toute liberté. Quelques-unes sont mentionnées dans l’ouvrage même, dans les textes ou dans les informations reprisesimmédiatement après les articles. D’autres informateurs, trop nombreux pour être mentionnés, devront rester anonymes. Nous avonségalement obtenu de nombreux renseignements en réponse à nos messages électroniques.Nous voudrions remercier Sam Matsangaise et ses collègues du CTA de l’opportunité qu’ils nous ont offerte d’écrire ce livre.Merci également aux personnes suivantes : Pascal Airault, Lucie Alexandre, Isaac and Prusie Bekalo, Pascal Berque, Guy Bessette, IsabelCarter, Agnès Collonge, Wayne Ganpat, Günter Heidrich, Christian Huet, Pascal Ichanjou, Jean Pierre Ilboudo,Tony Jansen, Annie Jogand,Deb Johnson, Jean Pierre Lamonde, Cheryl Lans, Benoit Lecomte, Kate Lloyd Morgan, Yachim Maïga, Jacques Da Matha, Evelyn Mathias,Gilles Mersadier, Mutizwa Mukute, Oliver Mundy, Olivia Naluyima, James and Beatrice Nguo, Stéphane de Noray, Clare O’Farrell, IbrahimOuedraogo, Denis Pesche, Ricardo Ramirez, John Rose, Joseph Seepersad, Fadjigui Sinaba, Senira Su’a, Linda Temprosa, Peter Thorpe,Rokia Bà Toure, Jean Paul Tuho, Bob Wagner, Peter Walton et John Wilson.Par ailleurs, nous adressons nos remerciements à Kay Sayce, Gerry Cambier et Tali Bradley, qui ont procédé à la révision des articles et à laconception de cet ouvrage.Paul MundyBergisch Gladbach (Allemagne)Jacques SultanParis (France)REMARQUE :Les prix et les taux de conversion repris dans cet ouvrage étaient en vigueur en janvier 1999.vi
AVANT-PROPOSJUSQU’À RÉCEMMENT, l’accès aux informations provenant des zones rurales géographiquement éloignées des pays en développement s’avéraità la fois coûteux et laborieux. De même, fournir des informations aux agriculteurs, aux vulgarisateurs et aux chercheurs qui vivent ettravaillent dans ces régions relevait de la gageure. La situation dans les grandes villes n’était guère plus brillante. La communication entrepays en développement exigeait une patience à toute épreuve : télex d’emploi fastidieux, téléphones peu fiables, publications onéreuses,services postaux délabrés et services de radiodiffusion rares et de piètre qualité. Comble de frustration, le phénomène de « l’explosion del’information » qu’avaient connu les autres parties du monde semblait ignorer les pays en développement. Peu de personnes nourrissaientencore l’espoir de combler les besoins d’informations des pays en développement et encore moins ceux du secteur agricole. Tout semblaitindiquer que la mine représentée par le savoir agricole international resterait aussi inaccessible que par le passé, pendant encore denombreuses années.L’explosion des nouveaux services virtuels d’information vient d’atteindre les pays en développement, où la gamme des dispositifs decommunication interpersonnelle pour particuliers s’est considérablement élargie. La fourniture de services meilleur marché et l’offre denouveaux produits et appareils divers ont créé de nouvelles opportunités, d’autant que les gouvernements ont adopté des mesures (ou enont été persuadés) visant à mettre en place des sociétés plus ouvertes et moins réglementées. Des personnes entreprenantes ont profitédu climat de changement pour concevoir les moyens d’exploiter les nouvelles possibilités de création de revenus. Après avoir concerné lescommunautés urbaines, les progrès en matière d’information et de communication commencent à toucher les populations rurales. Desentrepreneurs et des particuliers déterminés ont posé les premier jalons d’une utilisation plus efficace des technologies innovantes del’information et de la communication dans les secteurs agricole et rural et, dès lors, de la transformation de ces secteurs dans les années àvenir.Les problèmes inhérents à l’échange d’informations sont toujours perçus comme le principal obstacle au développement agricole et sont àl’origine des opinions désabusées quant à ses perspectives d’avenir. Pourtant, contre vents et marées, des personnes et des institutionsentreprenantes ont réalisé des accomplissements (parfois modestes et parfois audacieux) qui contribuent à révolutionner la gestion del’information à des fins de développement agricole. Ces réalisations méritent notre attention et justifient la décision du CTA de publier cetouvrage. Nous espérons que cette démarche favorisera le partage des expériences et sensibilisera nos lecteurs aux diverses réalisations etaux nouvelles possibilités. Nous souhaitons ardemment que ces entrepreneurs feront de nombreux émules dans leur contexte local.Carl B. GreenidgeDirecteur du CTAvii
IntroductionLES HOMMES SONT DES animaux grégaires. Pris isolément, chacun d’entre nous est plutôt vulnérable. Seuls, nous serions condamnés à errer,nus et affamés, en quête de nourriture et de quoi nous désaltérer. Mais lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous travaillons ensemble,nous pouvons faire des choses merveilleuses. Nous pouvons bâtir des cités, inventer de nouvelles façons de produire et de stocker de lanourriture, fabriquer des objets qui rendent notre vie plus confortable, édifier de grandes civilisations, construire des vaisseaux spatiauxpour conquérir la lune.Ce qui rend tout cela possible, c’est l’information et la communication. Deux personnes seront incapables de bâtir la plus modeste desmaisons si elles ne savent pas ce qu’elles vont construire et si elles ne peuvent pas communiquer entre elles. Et ne parlons même pas d’unecité ou d’un vaisseau spatial !L’information est un élément de base indispensable à toute activité de développement. Elle doit être disponible pour tous et accessible àtous, qu’il s’agisse d’information scientifique, technique, économique, sociale, institutionnelle, administrative, juridique, historique ouculturelle. Cette information n’est toutefois utile que si elle est disponible et accessible aux acteurs dans des formes et des langages adaptés,c’est-à-dire si elle est communiquée, si elle circule entre les différents niveaux d’utilisateurs avec des supports appropriés, si elle estéchangée.La communication, qui couvre à la fois les champs de l’information et de l’éducation, s’applique à une grande diversité de situations, allantde la simple conversation entre deux personnes jusqu’aux médias les plus sophistiqués, de la mère qui apprend quelque chose à son enfantaux plus grandes bibliothèques et universités. Si l’on entreprenait d’établir la liste des différentes formes de médias, en commençant par latélévision, les journaux, le courrier électronique, les tableaux d’affichage, le téléphone, les apprentissages, les écoles… il faudrait remplirplusieurs pages. On dit que l’argent fait tourner le monde, mais c’est la communication qui augmente la vitesse de rotation (l’argent, c’estd’ailleurs une forme d’information, une information sur la valeur des choses).Sans communication, il n’y a pas de progrès possible. Pourquoi alors est-elle tellement ignorée dans le monde du développement ? Degigantesques institutions de recherche, dont le principal objet est de mettre au point de nouvelles techniques agricoles (c’est-à-dire créerde l’information) et les communiquer aux producteurs ruraux, relèguent la communication dans la corbeille à papiers. Sanscommunication, leurs découvertes restent inexploitées et accumulent de la poussière dans des armoires au lieu de créer du progrès et dela richesse. Les agences de vulgarisation (jamais très efficaces) ont été redimensionnées ou fermées, pour être remplacées par…, par rien,au fait. Quelquefois, les institutions se préoccupent davantage de leur propre développement que d’apporter à leurs usagers les servicesqu’ils sont en droit d’attendre d’elles. Les ressources potentielles des médias, pourtant capables de toucher les populations des zonesrurales les plus reculées (grâce à la radio, aux commerçants, aux églises et aux mosquées) sont tout simplement ignorées.Des idées nouvelles…Heureusement, il semble que les choses soient en train de changer. Deux révolutions : la révolution démocratique des années 80 et 90 (etles vagues de restructuration et de décentralisation qui les ont suivies) et la révolution technologique qui est intervenue dans le domainede l’informatique et des télécommunications ont éveillé, dans le monde du développement, un intérêt nouveau pour tous les aspects del’information et de la communication.1
Les nouvelles libertés et les nouvelles technologies ont apporté des concepts neufs, qui poussent vers la sortie les vieilles théoriespoussiéreuses. Dans le secteur du développement, la communication a été maintenue pendant longtemps dans un schéma descendant,avec pour mission principale de véhiculer des messages techniques, de la recherche vers les producteurs ou des messages sociaux desdécideurs vers les groupes de citoyens.Les révolutions de l’informationCes messages, même s’ils étaient quelquefois élaborés en tenant compte des caractéristiques de ce que l’on appelle les « groupes cibles »(les paysans, les femmes, les éleveurs, etc.), voire en les associant à leur élaboration, restaient des messages dont la maîtrise appartenait àceux qui en contrôlaient l’élaboration et la diffusion. Ce sont, le plus souvent, les décideurs politiques et institutionnels, les experts desprojets de développement, les techniciens de diverses disciplines, les responsables des médias et presque jamais les producteurs ruraux oules organisations de citoyens qui restent des consommateurs de messages.Depuis une vingtaine d’années, ce concept a évolué. La communication se situe de moins en moins dans une logique de transmission demessages, même si c’est toujours un élément important. Elle est maintenant plus ouverte et s’appuie sur l’expression, l’interactivité, lanégociation, l’échange et (pourquoi pas ?) la confrontation des logiques économiques, sociales et culturelles des différents acteurs enprésence. On observe aussi une tendance à l’appropriation des outils d’information et de communication par les acteurs de base, lesassociations, les groupes de citoyens et les organisations non gouvernementales (ONG).Enfin, le rapport à l’information, au savoir, aux technologies se fait de plus en plus à travers des réseaux d’usagers qui se constituent, audelàdes clivages traditionnels, entre des acteurs qui jusque-là s’ignoraient : des paysans, des chercheurs, des universitaires, des opérateursprivés, peuvent s’associer pour résoudre leurs problèmes (voir l’article « L’association PELUM », p. 137). Ils définissent leurs besoins etcherchent ensemble des solutions en croisant leurs expériences ou en mobilisant des centres de ressources, des banques de savoirs.…et de nouveaux outilsLa révolution démocratique s’est accompagnée d’une révolution technologique. Les ordinateurs et les CD-ROM permettent de gérer et demettre facilement en mémoire de grandes quantités d’information. Le téléphone, le courrier électronique et l’Internet commencent àprendre leur place dans les zones rurales (voir la section « Informatique et télécommunications »).Toutefois, il ne s’agit pas seulement d’une révolution technologique. Les médias deviennent aussi plus proches des citoyens, plus interactifs.C’est le cas notamment des radios communautaires et de la presse dans les langues nationales, qui se développent rapidement en milieurural. Ces nouveaux médias se structurent et se constituent en réseaux pour permettre une information plus riche et plus accessible auxutilisateurs finaux (voir les sections « Radio et télévision », p. 11 et « Journaux et bulletins », p. 47).Des outils ou des dispositifs de communication de proximité se mettent en place au niveau de groupes d’utilisateurs, de communautésrurales (boîtes à images, audiocassettes, vidéos, centres de ressources locales, albums photos villageois, théâtre communautaire...). Lesprojets de recherche ou de développement intègrent de plus en plus souvent une phase initiale de « recherche participative » qui permetaux communautés concernées de formuler leurs propres diagnostics et de produire leurs propres outils d’information et de communicationou, au moins, de fournir des indications précises pour que les outils élaborés par les projets apportent des réponses à leurs besoins.2
IntroductionTrois grands axesLa communication pour le développement s’articule autour de trois grandes fonctions :• Apporter l’information utile aux usagers ;• Aider les usagers à accéder aux sources d’information ;• Faciliter l’instauration d’un dialogue entre les acteurs du développement.Apporter l’information utile aux usagersC’est le rôle traditionnel de la communication. Prenez, par exemple, un centre de recherche agricole. Il va identifier une nouvelle variétéde manioc résistante aux parasites (voir l’article « Maîtriser la mosaïque du manioc en Ouganda », p. 169). Comment cette information va-telleêtre transmise aux producteurs et aux commerçants ? Comment inciter les producteurs à adopter cette nouvelle variété ? Il ne suffirapas de faire en sorte que les boutures soient disponibles en quantités suffisantes. Il faudra aussi former les agents de vulgarisation pour leurdiffusion, assurer la promotion de la nouvelle variété à la radio, produire des fiches et des brochures d’information technique, mettre enplace des parcelles expérimentales pour que les producteurs puissent observer concrètement la nouvelle variété. Il faudra aussi – et ce nesera pas la tâche la plus simple – persuader les décideurs de donner la priorité à cette découverte et de consacrer des moyens à sa diffusionpour prévenir les pénuries et la famine.Naturellement, ces tâches n’incombent pas toutes aux seuls chercheurs. Des institutions spécialisées, des agences de vulgarisation, desimprimeurs, des stations de radio et bien d’autres acteurs vont intervenir dans le processus. Et c’est souvent là que se situent les lacunes :la principale est celle que l’on retrouve courammententre la recherche de pointe et une vulgarisation sansmoyens. Lorsque de tels décalages ne sont pascorrigés, les efforts de communication sont vains, lesnouvelles variétés ne sortent pas du centre derecherche et les producteurs ne peuvent pas enbénéficier. Il ne leur reste plus qu’à mourir de faim.Il existe une pléthore d’informations sur le développement.Hormis le fait qu’elles soient difficiles à trouver en Afrique,elles sont souvent rédigées par des auteurs originaires despays industrialisés. La librairie « Legacy » de Nairobi (Kenya)est l’un des rares endroits du continent où l’on peut seprocurer une vaste sélection d’ouvrages relatifs audéveloppement(Photo : Paul Mundy)3
Certains acteurs sont faciles à atteindre : les services officiels, les décideurs, les chercheurs. Ils sont peu nombreux et ils travaillent dans desinstitutions identifiées ; leurs noms et leurs adresses sont connus. Ils peuvent être invités à participer à des rencontres.C’est une autre paire de manches que de toucher les acteurs de base : vulgarisateurs, animateurs communautaires, paysans, éleveurs,artisans, femmes. Ils sont des millions, répartis dans des milliers de villages, impliqués dans toutes sortes d’activités et soumis à denombreuses contraintes.Les révolutions de l’informationPour atteindre ces acteurs, il faut développer des outils, des réseaux et des occasions d’échanges pour faire circuler l’information etencourager les apprentissages.Certains de ces outils sont déjà connus et leur efficacité est éprouvée : la radio rurale, les livrets de vulgarisation, les parcelles dedémonstration, les centres d’alphabétisation, les centres de jeunes, les organisations paysannes, les manifestations culturelles ou religieuses,les marchés.Les nouveaux médias sont moins connus mais semblent très prometteurs, particulièrement ceux qui permettent d’accéder aux bases dedonnées et aux centres de savoirs : les CD-ROM, le courrier électronique, l’Internet. Les télécentres communautaires et l’utilisation dessatellites pour les radios locales sont également des outils prometteurs pour atteindre les utilisateurs finaux.Aider les usagers à accéder aux sources d’informationL’accès à l’information constitue l’envers de la médaille. Une cultivatrice dont le champ de manioc est ravagé par des parasites n’a pas lesmoyens d’attendre que les chercheurs aient mis au point une nouvelle variété ou que le vulgarisateur vienne lui rendre sa visite mensuelle(ou plus généralement semestrielle). Elle a besoin d’une réponse rapide.Aider cette productrice à trouver une réponse au problème auquel elle est confrontée, ce n’est pas la même chose que lui fournir uneinformation à propos d’un problème qui a été identifié par un chercheur et qui ne la concerne peut-être pas. Et si cette paysanne n’étaitpas intéressée par les parasites du manioc, mais envisageait de produire des oranges et voulait tout savoir sur la question ? À qui devrait-elles’adresser pour avoir un conseil ?La recherche de l’information (la demande) et les gisements d’information existants (l’offre) se rencontrent de différentes façons : pendantles réunions avec les vulgarisateurs, au sein des centres d’information et dans les bibliothèques communautaires, pendant les visites que lesproducteurs rendent aux centres de recherche, sur les parcelles de démonstration et dans les sites consacrés à la recherche sur les systèmesd’exploitation agricole. Dans tous les cas, le système de communication doit être conçu de façon à faciliter le dialogue, le questionnementet l’expérimentation. Le vulgarisateur sentencieux, le chercheur enfermé dans sa tour d’ivoire, le bureaucrate suffisant, le bibliothécairedémuni doivent disparaître du paysage car ils tuent tout espoir des usagers de jamais obtenir les informations qu’ils recherchent.Les chercheurs ont besoin d’information eux aussi. Il leur est indispensable d’avoir accès à des informations sur les méthodes de rechercheet les découvertes scientifiques mais aussi sur les problèmes des paysans. Les réponses se trouvent dans des bibliothèques, les revues, les4
Introductionouvrages, les conférences ; cependant, ils peuvent de plus en plus y avoir accès par le courrier électronique, l’Internet et les CD-ROM. Lademande paysanne, quant à elle, peut être désormais identifiée grâce à toute une gamme de nouveaux outils : recherche et évaluationparticipatives, processus de développement technologique qui associent les producteurs à tous les stades. Ces outils de communicationsont essentiels pour que les chercheurs et les vulgarisateurs identifient les contraintes et les potentialités des agriculteurs et sachentcomment les associer à la résolution de leurs propres problèmes.Faciliter l’instauration d’un dialogueL’évolution démocratique qui est apparue dans de nombreuses régions du monde depuis les années 80 a entraîné un vaste mouvement dedécentralisation politique, économique et sociale. La population rurale, jusqu’alors anonyme et ignorée, a désormais un meilleur accès auxdécideurs. Les producteurs sont en train de trouver des formes d’organisation collective qui leur permettent de faire pression sur le pouvoirpour obtenir des réponses à leurs problèmes. Avec l’appui d’ONG et de médias comme les radios communautaires, la population rurale esten train d’apprendre à exploiter ces ouvertures nouvelles.Les médias jouent un rôle clé dans ce domaine. Une station de radio ou un journal peuvent être des outils de « répression ou d’expression ».Une presse contrôlée par le pouvoir peut étouffer toute forme de discussion et perdre rapidement sa crédibilité. Une presse libre rendpossible une expression plurielle et interactive. Elle peut favoriser la confrontation, le débat, la négociation entre les acteurs, identifier lesblocages, promouvoir les initiatives intéressantes, véhiculer les idées nouvelles, recueillir les opinions, sensibiliser. Elle peut donner laparole à ceux qui ne l’ont pas : les femmes, les jeunes, les pauvres. Au-delà des radios et des journaux, d’autres outils de communicationde proximité peuvent être mobilisés au niveau communautaire : les cassettes audio et vidéo, les boîtes à images, les outils traditionnels decommunication, le théâtre, la musique, les récits, les marionnettes, les animations au niveau des marchés villageois.À propos de cet ouvrageL’option de ce livre est de rendre compte d’expériences réussies, d’expliquer comment des individus ou des organisations sont parvenus às’approprier les outils de communication pour améliorer les conditions d’existence des communautés rurales. Nous avons identifié unequarantaine d’exemples de ce type, en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. Nous aurions pu en citer bien davantage si nous avionsdisposé de plus de temps et d’espace. Si votre organisation n’est pas mentionnée dans cet ouvrage, n’en soyez pas froissé.Il est facile de réussir quand on dispose de beaucoup d’argent mais ce n’est pas le cas le plus fréquent. Nous avons donc essayé d’éviter dementionner les grands projets, largement financés et appuyés par des équipes d’experts expatriés, les grandes ONG du Nord, les centres derecherche internationaux. Parmi ces organisations, beaucoup font un excellent travail de communication mais elles ne sont pasreprésentatives des pays en développement : elles représentent des îlots d’abondance dans un océan d’organismes sans ressources, sanssoutien, sans personnel qualifié et sans équipement de qualité. Nous avons choisi de mettre en valeur quelques-unes de ces initiativeslocales ou nationales qui parviennent à faire un bon travail de communication malgré leurs contraintes. Si elles y sont parvenues, pourquoipas les autres ?5
Les photos sont employées comme support àl’information lors d’une réunion dans un villagesénégalais(Photo : Jacques Sultan)Les révolutions de l’informationUn deuxième critère de choix était relatif à l’existence de résultats concrets obtenus par les institutions. En réponse à notre appeld’information (voir plus bas), nous avons reçu beaucoup d’informations sur des projets novateurs, s’agissant particulièrement de ceux quiutilisent l’Internet pour la promotion du développement rural. Mais le propre des idées nouvelles, c’est qu’elles n’ont pas encore fait leurspreuves. Nous avons choisi de mettre plutôt l’accent sur des approches qui ont démontré leur efficacité.Le troisième critère était la durabilité. Nous n’avons pas retenu les projets qui étaient trop dépendants de financements extérieurs. La findu financement marque souvent la fin du projet lui-même. Nous avons également exclu les institutions qui semblaient ne dépendre qued’un seul financement extérieur, mais dans lesquels plusieurs bailleurs s’étaient introduits par des interstices.Qu’est-il sorti de cette sélection ? Beaucoup de choses et une grande diversité de situations : des organismes gouvernementaux, desentreprises privées, des organisations paysannes, des ONG, des centres de recherche et de vulgarisation, des groupes d’opérateurséconomiques, des médias, des réseaux.Nous avons intégré des organismes qui avaient reçu le soutien de partenaires financiers après avoir fait la preuve de leur capacité à générerdes financements provenant d’autres sources. Nous avons également retenu des institutions comme l’IIRR (Institut international dereconstruction rurale – International Institute of Rural Reconstruction) et l’ITDG (Groupe de développement des technologiesintermédiaires – Intermediate Technology Development Group), qui sont des filiales d’ONG internationales dont les équipes sontconstituées dans les pays en développement, qui travaillent essentiellement avec des ressources générées localement (voir les articles« Experts traditionnels et vétérinaires aux pieds nus dans le nord du Kenya », p. 149, « Ateliers d’écriture », p. 177 et « Le Centre de ressourcesde l’ITDG », p. 225).Nos choix ont été guidés par l’information dont nous disposions sur les organisations qui pouvaient figurer dans cet ouvrage. Nous noussommes basés sur notre connaissance personnelle du sujet, sur des discussions avec des collègues et une consultation plus large, vial’Internet. Nous avons pu nous rendre dans six pays pour approfondir les premiers contacts : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Kenya, Mali,Sénégal et Ouganda. Evidemment, cela ne couvre qu’une petite partie de l’Afrique et n’inclut ni les Caraïbes ni le Pacifique. Nous avons doncdemandé à des collègues de nous relayer pour rédiger des articles ou nous fournir de l’information sur les pays non couverts par nosmissions sur le terrain.Et nous avons, bien sûr, passé l’Internet au peigne fin. Il convient toutefois de souligner que la plus grande partie des informationsrecueillies sur la Toile n’ont pas été retenues, malgré leur intérêt, tout simplement parce qu’elles décrivent le plus souvent les activités de6
Introductionpuissantes organisations internationales ou de projets financés par des bailleurs de fonds extérieurs que nous avions décidés d’exclure denotre choix.Tout au long de nos missions sur le terrain, nous avons été impressionnés et inspirés par l’enthousiasme des interlocuteurs que nous avonsrencontrés. Leur motivation et leur détermination sont remarquables, surtout si l’on considère qu’ils travaillent dans des conditionsdifficiles, avec des salaires plus qu’insuffisants et des moyens très limités. Malgré cela, ils sont à l’écoute de leurs publics, ils débordent decréativité, ils innovent en permanence, ils luttent pour la qualité.Naturellement, peu d’initiatives ont totalement atteint leurs objectifs. Les organisations que nous décrivons continuent à se battre contrede nombreuses contraintes : financements insuffisants, développements institutionnels incertains, manque d’équipements et decompétences. Les conditions économiques et sociales sont en mutation rapide et la technologie évolue encore plus vite. Pour certainesorganisations, il est encore trop tôt pour savoir si elles réussiront dans leurs entreprises. En fait, un des organismes qui nous impressionnaitle plus, le réseau d’information des terres arides (RITA ou ALIN en anglais – Arid Land Information Network), et qui avait accompli un travailremarquable de mise en réseau d’initiatives à travers toute l’Afrique sahélienne et l’Afrique de l’Est, faisait l’objet d’une restructurationprofonde lors de notre passage (elle est toujours dans cette situation difficile au moment où nous écrivons ces lignes). Il a donc fallurenoncer à rendre compte de ses activités.Un vaste paysage à explorerNous avons largement parcouru le paysage. Pour certaines des institutions, l’information et la communication constituent l’activitéprincipale : les bibliothèques, les agences de presse, les médias. D’autres ont une orientation différente mais considèrent que l’informationet la communication représentent une composante essentielle de leurs activités. Les organismes de recherche sont une bonne illustrationde cette catégorie d’institutions (voir l’article « Maîtriser la mosaïque du manioc en Ouganda », p. 169, et la section « Réseaux de recherche »,p. 191) et le cas de la bourse des matières premières agricoles du Kenya (voir l’article « Le cas du KACE », p. 143).Au début, nous avons sélectionné de façon prioritaire les institutions qui se consacraient exclusivement à l’agriculture. Mais nous noussommes rapidement rendu compte qu’il était impossible de se limiter à la seule agriculture. Il n’y a pratiquement pas de stations de radioou de journaux qui traitent exclusivement de sujets agricoles, bien qu’il s’agisse d’un thème essentiel en milieu rural. Les téléphones sontils« agricoles » ? Pendant notre périple, nous avons relevé des témoignages sur leur utilisation pour commander des engrais, des alimentspour le bétail, pour s’assurer de la disponibilité d’équipements, pour appeler des vétérinaires ou pour vendre des produits. S’il y a unetechnologie qui va transformer profondément le monde rural dans les dix ans à venir, c’est bien la téléphonie mobile (voir l’article « Il y atellement de choses à dire… », p. 113).Face à cette variété de médias et leurs multiples usages, il aurait été très limitatif de se cantonner aux seuls médias « purement agricoles »,comme les bulletins de vulgarisation, les revues et les réseaux de recherche agricole. Nous les avons couverts, bien sûr mais ils nereprésentent vraiment qu’une petite partie du formidable capital d’information de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler « les systèmesde savoir agricole ».7
Nous avons exploré les initiatives de la plupart des secteurs institutionnels : gouvernemental, non gouvernemental et universitaire. Nousavons cependant un peu négligé le secteur privé : nous y avons relevé quelques expériences mais nous aurions dû aller plus loin et nousintéresser aux fournisseurs de semences, aux acheteurs de produits agricoles, aux organismes de crédit, aux entreprises de transformationagroalimentaire, aux grandes associations d’agro-industriels, aux exportateurs. Désolés, ils manquent à l’appel.Les révolutions de l’informationD’autres thèmes non traités ? Les éditeurs privés, les librairies, la communication traditionnelle, le théâtre de rue, les évaluationsparticipatives, les écoles de terrain pour les agriculteurs, les organisations religieuses, les groupes de pression, les illustrateurs et éditeursde bandes dessinées, la télévision, les écoles, les universités… La liste est longue. Encore une fois, nous sommes désolés. Peut-être dans laprochaine édition.Des choix arbitrairesCet ouvrage comporte 9 sections, chacune d’entre elles comptant jusqu’à six articles consacrés à une institution ou un groupe d’institutions.Les sections s’articulent autour des thématiques suivantes : radio et télévision, journaux et bulletins, alphabétisation et langues nationales,informatique et télécommunications, organisation des producteurs ruraux face aux marchés, savoirs paysans, liens entre recherche etvulgarisation, réseaux de chercheurs, bibliothèques.Ces catégories sont arbitraires (nous l’admettons volontiers). Pourquoi pas une section sur les documents de vulgarisation ? Pourquoi pas,en effet ? L’article « À la Trinité, des poulets sous surveillance » (p. 155) pouvait-il être plus utilement intégré dans la section sur la rechercheet la vulgarisation plutôt que dans celle sur les savoirs paysans ? Eh bien, oui, c’est une hypothèse valable.Cet arbitraire est inévitable. Les organismes de communication ont tendance à s’investir dans plusieurs types d’activités : un service deproduction audiovisuelle dans un ministère peut publier un journal ou des livrets de vulgarisation, réaliser des programmes radio et vidéo,organiser des sessions de formation et exploiter une bibliothèque. Le même support peut être utilisé pour des buts différents : la plusgrande partie du temps d’antenne des radios est occupée par de la musique, pas par des programmes traitant de l’agriculture. Pour êtrerentable, un journal doit offrir une diversité de thèmes : l’agriculture y sera en compétition avec les informations générales, le sport,l’humour, la culture, l’éducation, les sujets féminins, la politique, les faits divers, l’économie. Comme dans les journaux des pays développés.De plus, les médias sont complémentaires : les stations de radio locales font la promotion de la lecture et de l’écriture. La radio et la vidéopeuvent se retrouver sur l’Internet. Une campagne d’information peut (et même doit, si elle veut réussir) combiner plusieurs médias : radio,télévision, matériel imprimé, communication interpersonnelle.La communication a un coûtIl faut admettre que les organisations que nous avons décrites reçoivent, pour la plupart, des soutiens financiers extérieurs. C’est sans douteinévitable. Les pays que nous avons couverts sont pauvres. Leurs gouvernements n’ont pas de liquidités et, contrairement, à ce qui se passedans les pays développés, il n’y a pas beaucoup de bienfaiteurs fortunés ou de personnes des classes moyennes qui alimentent des8
Introductionfondations et des organisations de solidarité ou de charité. Lespopulations rurales ne sont pas en mesure de payer certains services,même si elles les considèrent comme vitaux.Cette dépendance à l’égard des bailleurs de fonds est sans doute unindicateur de l’état de la communication dans les pays en développement.Oui, le soutien des bailleurs de fonds est nécessaire, et probablementpour longtemps encore. Mais il y a des risques de lassitude : certainspartenaires peuvent se poser la question de l’opportunité de soutenir unestation de radio ou une ONG pendant une année de plus.La réponse, c’est qu’il faut du temps. Pour réussir, les initiatives decommunication impliquent des années d’investissement. Mettre sur piedInterview de paysans pour une émission radio au Ghanaune radio ou un journal, cela demande du temps, de la patience, des(Photo : Jacques Sultan)efforts et du savoir-faire. Les fermer et en ouvrir d’autres n’est pas labonne solution, car il faudra recommencer à investir pour des durées peut-être encore plus longues. La difficulté consiste à parvenir à unsevrage progressif des dépendances extérieures tout en développant les capacités d’autofinancement ou en recherchant des solutions definancement alternatives durables.Une fois mis en place, les médias sont incroyablement polyvalents et peuvent être mobilisés sur toutes sortes de sujets. Prenez par exemplele programme radio du Kenya Tembea na Majira (voir l’article « Des feuilletons radiophoniques pour le développement », p. 13) : lorsquenous étions au Kenya, il abordait des thèmes comme les parasites des végétaux, la malaria et les femmes battues. Il passera ensuite à d’autresintrigues et à d’autres sujets.Pour survivre, les efforts de communication doivent s’inscrire dans la durée, créer, innover sans cesse. Diffuser le même programme vieillotsemaine après semaine ou continuer à publier un bulletin que personne ne lit, ne présente pas d’intérêt. Il appartient aux professionnelsde la communication de tendre l’oreille, d’analyser le contexte, d’assurer le suivi de leurs activités, d’être à l’écoute de leurs publics,d’encourager le feed-back, de s’adapter et d’innover. C’est la seule façon d’avoir un impact et de justifier le maintien des soutiensextérieurs.La communication rurale peut-elle être rentable et donc financièrement autonome ? La réponse est oui, au moins pour certains types demédias. Les exemples les plus éloquents sont les téléphones mobiles en Ouganda, les télécentres privés au Sénégal (voir l’article « Il y atellement de choses à dire », p. 113) ou les services de messageries électroniques (voir l’article « Africa Online et l’initiative e-touch »,p. 103). Certes, un investissement initial non négligeable est nécessaire (c’est vrai pour toute initiative de ce type) mais une fois que lesystème est sur pied et fonctionnel, il est hautement rentable et les ressources qu’il génère permettent de nouveaux investissements.Quelques journaux ruraux parviennent à couvrir une grande partie de leurs frais et pourraient parvenir à l’autosuffisance financière avec leproduit de leurs ventes et la publicité. Cela est également vrai pour la radio et la télévision : publicité, patronage, ventes de services commeles communiqués et produits dérivés comme les tee-shirts ou les casquettes peuvent procurer des revenus complémentaires significatifs.9
Pour les autres médias, comme les bulletins de vulgarisation ou les revues de recherche, il est plus difficile d’imaginer comment ilspourraient subvenir à leurs besoins sans soutien. Pourtant, même dans ce secteur, il existe des opportunités inexplorées. L’une d’entre ellesconsiste à encourager la collaboration entre les services gouvernementaux et le secteur privé. Un exemple : les agences de vulgarisation selimitent à publier quelques centaines d’exemplaires d’un livret, parce qu’elles ne peuvent pas financer davantage de copies. Les livrets sontdistribués gratuitement mais comme il n’y a pas d’argent pour assurer les frais de poste, ils restent dans les capitales, sont entreposés dansun coin et prennent la poussière.Les révolutions de l’informationUne solution ? Vendre les livrets, plutôt que de les distribuer gratuitement, et s’assurer que les ressources ainsi générées permettentd’imprimer d’autres exemplaires au lieu d’être reversées dans un budget général ou conclure un accord avec un éditeur privé, partager lescoûts de production et vendre le livre sur le marché, par l’intermédiaire des librairies, des vendeurs de journaux, des colporteurs, desboutiques d’intrants agricoles, etc. La vente des livres est un précieux indicateur : on sait immédiatement ceux qui ont du succès et ceuxqui sont des fiascos. Et l’argent peut être utilisé pour produire la prochaine édition du livre à succès.Une autre source possible de financement est la publicité. Mais c’est généralement perçu comme impensable par les gouvernements :« Nous ne pouvons pas introduire de publicité dans notre publication, car cela signifierait que nous soutenons tel ou tel produit ». Pourtant,si elle était gérée avec discernement, la publicité pourrait financer une partie de ce bulletin de vulgarisation. Par exemple, une agence devulgarisation pourrait produire des notices d’instructions de sécurité pour les pesticides et convenir avec le fabricant de les distribuer avecchaque bouteille de produit vendue. L’agence serait ainsi satisfaite : ses instructions seraient diffusées. La société agrochimique aussi : lescultivateurs seraient plus enclins à utiliser ses produits de façon plus efficace et sans danger. Les agriculteurs seraient également satisfaits :ils ne risqueraient pas de tomber malades en utilisant ces produits de façon non conforme et les parasites seraient détruits.Le seul élément qui fait obstacle à une telle collaboration sont les réglementations gouvernementales. Mais ces règles sont en train dechanger : des départements entiers sont en cours de privatisation, d’autres doivent désormais couvrir une partie de leurs coûts en générantdes ressources. Un contexte idéal est ainsi créé pour explorer les potentialités offertes par ces nouveaux partenariats.Ne voyez pas la communication comme une contrainte financièreTrop souvent la communication est perçue comme une charge financière. C’est particulièrement le cas des institutions de recherche. Lacommunication intervient tout à la fin du processus, alors qu’elle devrait l’accompagner à chaque étape, dès la planification desprogrammes de recherche. À cette époque de restrictions budgétaires, il est facile de décider de réduire le tirage d’un magazine de 5 000à 2 000 exemplaires ou de 1 000 à 500. De toute façon, ils étaient surtout destinés à satisfaire le directeur, n’est-ce pas ? Quelle importances’ils ne sont pas distribués aux producteurs ?Non. La communication doit être partie intégrante du processus de développement. Pour un chercheur, c’est aussi important que de réussirà multiplier une nouvelle variété végétale ou d’avoir accès à un microscope. Sans communication, les efforts de développement sontcondamnés à l’échec. Avec elle, ils ne courent que le risque de réussir.10
Informer en divertissant : des feuilletons radiophoniques pour le développementRadios communautaires : apporter aux producteurs ruraux une information de proximitéUne information citoyenne pour le monde rural… : la culture au cœur du développementDes réseaux de radios locales : des radios locales pour répondre aux besoins des populations rurales…Vidéo éducative : la vidéo au service du développementRadio et télévision
Elle a eu 80 ans en l’an 2000 et elle ne cesse de rajeunir. Qui est-ce ? La radio. La démocratie etl’abandon des monopoles de diffusion par la plupart des États ont permis l’éclosion de centainesde petites radios communautaires dans de nombreux pays en développement. Cette tendance a étéparticulièrement sensible en Afrique de l’Ouest où, malgré la faible portée des stationsindividuelles, une grande partie de la région reçoit maintenant leurs émissions. Elles proposent unegrande variété de programmes : divertissements, information, musique, avis et communiqués,messages de développement, débats, culture.Les révolutions de l’informationLes radios locales sont devenues des espaces de débat démocratique. Les émissions enregistréesdans les villages sont très appréciées, non seulement dans les communautés où elles ont étéproduites mais aussi dans tous les villages voisins. Ces émissions offrent aux communautésrurales des occasions de s’exprimer sur les ondes, quelquefois pour la première fois. Elles donnentla parole à ceux qui ne l’ont généralement pas : les femmes, les jeunes, les pauvres.Les échanges de programmes entre les stations sont une pratique très enrichissante et deviennentplus faciles avec l’Internet. Les stations locales se constituent de plus en plus souvent en réseauxpour échanger leurs programmes et partager leurs potentiels de production. Cela leur permet demieux produire en réduisant leurs coûts.La vidéo, dans ses deux formes principales d’exploitation (la télévision et les vidéocassettes), n’aplus le prestige dont elle jouissait voici encore quelques années, quand elle était le support à lamode (aujourd’hui, c’est l’Internet qui est sur le devant de la scène). Trop de caméras coûteusesprennent la poussière dans des armoires parce que personne n’a été formé pour produire desprogrammes intéressants ou qu’on ne s’est pas préoccupé du public que l’on vise et des conditionsde diffusion de ces programmes. Pourtant la vidéo reste un extraordinaire outil de sensibilisationet de formation pour le développement.12
Radio et télévisionInformer en divertissantDes feuilletons radiophoniques pour le développementPaul Mundy« Pourquoi laissez-vous vos chèvres aller dans mon champ ? »Les deux épouses de Wafula, Wanjiku et Nanjala, se disputent. Les chèvres de Wanjiku ont passé la barrière qui marque la limite du champde Nanjala et sont en train de manger son maïs. Wanjiku rétorque que Nanjala ne devrait pas tant se plaindre : son maïs est de toute façonimpropre à la consommation puisqu’il a été attaqué par le foreur.Nanjala l’accuse de comploter contre elle avec son mari Wanjula. Pendant ce temps, Sipe a abandonné son mari, Juma, le fils de Nanjalaparce qu’il la bat. Et le fils du Docteur Owino vient de mourir de la malaria.Cela ressemble à un feuilleton à « l’eau de rose » ? C’est vrai ! C’est exactement cela : l’épisode hebdomadaire du feuilleton Tembea naMajira (« Bougez avec votre temps » en kiswahili), l’un des programmes de divertissement les plus appréciés sur les ondes de la radiokenyane. Mais Tembea na Majira est un feuilleton à l’eau de rose différent des autres. Habituellement, dans les feuilletons de ce type, lespersonnages tombent amoureux, se quittent, se disputent, font des erreurs et accomplissent des exploits. Tembea na Majira a tous cesingrédients mais contient aussi des messages éducatifs intégrés dans chacun des épisodes. Ces messages sont si habilement inclus dans leshistoires que la plupart des auditeurs s’en imprègnent sans même sans rendre compte (voir encadré 1).Ces programmes visent un auditoire féminin mais les études d’audience ont montré que ce sont les hommes qui possèdent plus de 80 %des récepteurs de radio au Kenya. S’ils ne sont pas intéressés par une émission, ils peuvent changer de fréquence ou éteindre le poste. Pourqu’un programme ait du succès, il faut qu’il attire autant les femmes que les hommes.Tembea na Majira est produit par le centre d’information du ministère de l’agriculture (AIC – Agriculture Information Centre), à Nairobi,en partenariat avec Mediae Trust, une ONG britannique spécialisée dans la radio et la vidéo. Le service radiophonique de l’AIC choisit lesthèmes, bâtit la trame des histoires, écrit les scénarios et enregistre les émissions qui seront diffusées par la KBC, la station de radionationale. Cette émission, qui a démarré en 1996 est diffusée tous les lundis soir, après le bulletin d’informations de 20 h.L’intrigue se complique…Lorsque nous nous trouvions au Kenya, trois trames d’histoire étaient exploitées dans la série Tembea na Majira : la maîtrise biologiquedu foreur du maïs, la violence conjugale et la lutte contre la malaria.Prenez le foreur du maïs : un des plus dangereux insectes nuisibles des cultures du Kenya. Selon le Centre international pour la physiologiedes insectes et l’écologie (ICIPE), un institut de recherche de Nairobi, les dégâts causés aux cultures par cet insecte pourraient être13
Les révolutions de l’informationENCADRÉ 1Grace et Charles Owino discutent du foreur du maïs 1GRACE Voyez vous-même la façon dont ces foreurs du maïs ont détruit nos cultures de maïs.CHARLES Ces insectes sont vraiment dangereux. Ils attaquent en même temps les tiges et les épis dumaïs.GRACE Les agriculteurs ont des problèmes. Cheruto, l’assistante en santé animale est partie sanstrouver de solution.CHARLES C’est vrai, Cheruto est partie mais elle n’était pas une spécialiste de l’agriculture. Si j’ai biencompris, elle a été transférée à Mogitio.GRACE C’est plus qu’un transfert. Elle s’est mariée à Mogitio le mois dernier.CHARLES Malgré son départ, elle nous a laissé avec un peu d’espoir pour nos cultures de maïsGRACE Qu’est-ce que tu racontes ?CHARLES Elle a déjà organisé un voyage d’études pour les paysans pendant lequel ils apprendront toutsur le foreur du maïs et la façon de le maîtriser.GRACE Comment se fait-il que je ne sois pas au courant ? Où a lieu cette excursion ?CHARLES À Mbita Point.GRACE Mbita ?CHARLES Le Centre de recherche sur les insectes nuisibles et les ravageurs de Mbita, l’ICIPEGRACE Oh, mais c’est un événement très important. Qui doit y participer ?1 Traduit à partir de l’émission Tembea na Majira diffusée le 18 novembre 1999.Herène Simbowo (à gauche) etSuleiman Juma (à droite) préparentune vidéo de l’AIC(Photo : Paul Mundy)14
Radio et télévisionsensiblement réduits en plantant du napier autour des parcelles de maïs. Les foreurs du maïs sont attirés par cette herbe et y pondent leursœufs plutôt que sur le maïs. Et, lorsque ces derniers éclosent, ils sont pris dans un liquide gluant produit par le napier qui les retient jusqu’àce qu’ils meurent. Contrairement aux vaporisations de produits chimiques que de nombreux agriculteurs utilisent pour lutter contre leforeur du maïs, l’herbe de napier est peu coûteuse et respectueuse de l’environnement. De plus, elle constitue un excellent fourrage pourles bovins, les moutons et les chèvres.C’est une bonne solution, mais comment être sûr que les paysans en entendront parler ? L’ICIPE a convaincu la Fondation Gatsby, qui afinancé la recherche initiale, de soutenir la production d’une série de programmes radio sur le thème. L’AIC a écrit un scénario qui dit à peuprès ceci :• Les villageois de Tembea na Majira se plaignent que leur rendement de maïs est en chute, même lorsqu’ils pulvérisent les insecticidespréconisés. Ils en parlent à leurs conseillers agricoles qui font appel à des chercheurs de l’ICIPE.• Les chercheurs se rendent dans les champs des villageois et trouvent deux problèmes, le foreur du maïs et le striga, une sorte demauvaise herbe parasite. Les chercheurs organisent un voyage d’études pour Wanjiku et son amie Grace Owino à la station de l’ICIPEà Kisumu pour qu’ils voient les résultats des recherches de leurs propres yeux.• Les deux femmes reviennent avec plein d’idées nouvelles, mais les hommes du village sont sceptiques : ils disent qu’elles sont justeallées se promener.• Les femmes décident alors d’expérimenter la nouvelle méthode. Les villageois suivent l’essai attentivement et sont finalementconvaincus quand ils voient leurs pieds de maïs bien plus grands que ceux qui poussent dans des parcelles où l’on n’a pas semé denapier.Ce scénario s’étale sur une année entière, comme dans la réalité. Les émissions sont programmées de telle façon qu’elles épousent lecalendrier cultural : labourage, semailles, sarclage et récolte constituent des moments de l’histoire. Certains personnages, comme leschercheurs, sont des personnes réelles. Cela permet de donner une touche d’authenticité au feuilleton et de s’assurer qu’il va être au cœurde la vie des auditeurs.Et se complique encore…Les deux autres trames dramatiques du feuilleton concernent directement les auditeurs. La malaria est la principale cause de mortalité desenfants de moins de 5 ans au Kenya ; or, cette maladie devient résistante à la chloroquine, le remède le plus répandu. Tembea na Majiraencourage la destruction des endroits où les moustiques se reproduisent et montre comment faire : couper l’herbe, jeter les bouteilles etles boîtes de conserve qui peuvent conserver des eaux stagnantes où les moustiques pondent. Le programme incite les auditeurs à utiliserdes traitements préventifs contre la malaria et surtout à installer des moustiquaires à leurs lits.La violence familiale est le troisième grand thème qui alimente les émissions. Les femmes battues et les mauvais traitements infligés auxenfants sont des phénomènes courants (bien que dissimulés) au Kenya, comme dans bien d’autres pays. Les auditeurs apprennent15
La salle de régie son de l’AIC à Nairobi (Kenya)(Photo : Paul Mundy)Les révolutions de l’informationcomment Juma, un des personnages de Tembea na Majira, bat son épouse Sipe, après une dispute. Il déclare qu’il doit le faire pour êtrerespecté. Sipe le quitte et refuse de revenir au foyer, même si elle sait que cela signifie que Juma devra se soumettre à des « travaux defemmes » humiliants comme aller puiser de l’eau. Petit à petit, Tembea na Majira réussit à aborder au grand jour ce sujet particulièrementdélicat et controversé.Le pouvoir de la fictionLa fiction est un moyen de communication très puissant. Il évite d’avoir à dire aux gens ce qu’ils doivent et ce qu’ils ne doivent pas faire. Àl’inverse, il sensibilise les auditeurs en montrant les différentes facettes d’un problème et leur permet de se faire leur propre opinion. Lesmessages sont subtils : bien qu’ils soient éducatifs, les émissions ne ressemblent pas à des cours. Les personnages parlent et plaisantent deleurs propres problèmes comme ils le feraient dans la vie.L’introduction de personnages bien typés permet d’exprimer des opinions diversifiées, de débattre, de trouver des compromis comme dansla vie. Les personnages sont complexes et fascinants : Wanjiku est une jeune femme intelligente ; Nanjala est l’épouse plus âgée, plustraditionnelle, qui craint d’être supplantée par Wanjiku. Sipe est intrigante et vindicative ; Juma est coléreuse mais prend bien soin de sesenfants ; le chef Moseti est un vieux coureur de jupons qui poursuit de ses assiduités Cheruto, l’assistante en santé animale, et ainsi de suite.Par dessus tout, l’histoire est distrayante. Des intrigues bien construites tiennent les auditeurs en haleine : ils vont sûrement écouter leprochain épisode pour savoir ce qui s’est passé.Des financements assurésTembea na Majira est un programme autosuffisant, qui rembourse ses coûts de production. Cela signifie qu’il pourra continuer tant queles auditeurs n’en seront pas lassés.Comment cela est-il possible ? Le gouvernement prend en charge les salaires, mais l’AIC doit trouver des ressources pour financer les coûtsde production et de diffusion. L’AIC a un statut partiellement autonome : bien qu’il relève du ministère de l’agriculture, il est habilité àrecevoir des subsides provenant de sources non gouvernementales. L’AIC et le Mediae Trust ont trouvé des soutiens financiers auprès desinstitutions de recherche et des projets à financement externe pour payer les coûts de production (environ e600 par épisode). Ils ont16
Radio et télévisionégalement trouvé des annonceurs commerciaux (actuellement les sociétés Colgate et Catbury) pour financer les 1 050 e que la KBCdemande pour 15 minutes d’antenne.Aller de l’avantIl n’est pas possible de construire un programme radiophonique populaire et durable du jour au lendemain. Cela demande uneprogrammation attentive, du personnel compétent et des ressources financières suffisantes pour aller de l’avant. Pour Tembea na Majira,le financement initial a été assuré par le ministère du développement international de Grande-Bretagne (DFID), qui a fourni leséquipements, pris en charge la formation des équipes de l’AIC et soutenu les recherches initiales pour un programme pilote en langue kimeru.La formation et la coopération ont également joué un rôle essentiel. Des spécialistes en radio et en vidéo de Mediae Trust ont travaillé encollaboration étroite avec l’équipe de l’AIC pour programmer et concevoir les programmes, acquérir les équipements et les ordinateurs,démarcher les annonceurs et les mécènes pour couvrir les coûts de diffusion. Ils ont également négocié avec le gouvernement pour qu’ilconfère à l’AIC un statut semi-autonome qui l’autorise à collecter des ressources complémentaires auprès d’organismes nongouvernementaux. En 1996, lorsque la coopération britannique s’est retirée, l’AIC avait acquis les compétences et le capital d’expériencequi lui permettaient de voler de ses propres ailes. L’AIC produit maintenant l’ensemble de ses programmes en maintenant le partenariatavec Mediae Trust, qui continue à prospecter le marché des annonceurs et à trouver des mécènes.Études d’audienceLes études d’audience sont importantes pour le programme, à double titre. Elles sont essentielles pour s’assurer que le programme est suivipar un large auditoire, ce qui permet d’attirer les annonceurs. Mais elles sont aussi (et peut-être surtout) importantes pour s’assurer que lesthèmes traités correspondent bien aux préoccupations des gens et pour affiner leur programmation.Des études menées par des organismes indépendants ont montré que près de 5 millions de Kenyans adultes (environ 36 % de la population)écoutaient Tembea na Majira. Les chiffres peuvent être encore plus importants (6 millions d’auditeurs) lorsque le programme est diffuséjuste après le journal de 21h. Il est actuellement diffusé à 20h avec un auditoire quantitativement moins important. Le changement d’heurede diffusion a été fait pour des raisons de coûts, mais au prix d’une chute d’audience. Les producteurs de la série espèrent trouver d’autresannonceurs pour revenir à la tranche horaire initiale, plus favorable.Le nombre d’auditeurs peut aussi varier selon les zones. À Meru, 48 % des habitants ont déclaré que c’était leur programme préféré, alorsqu’ils sont 60 % à Kitale. À Nakuru, Tembea na Majira est en compétition avec une station locale très populaire. Ses performances ne sont« que de 20 % » de la population, chiffre qui ferait pâlir d’envie bien des producteurs ou annonceurs d’autres pays.La recherche a également joué un rôle essentiel pour bâtir le projet initial. En 1993, une équipe de l’AIC a conduit une étude sur lespratiques agricoles et les habitudes d’écoute de la radio dans quatre districts du sud du Kenya. Elle a découvert que 69 % des foyers17
possédaient un poste radio et que seulement 7 % n’avaient aucun accès à un récepteur. Cette étude a également permis d’identifier lesthèmes importants pour les auditeurs, les formats de programmes qu’ils préféraient et les heures d’écoute les plus favorables.Cette recherche a débouché sur la production d’un programme en langue ki-meru, appelé Ndinga Nacio (Intéresse-moi). Ce programmeest toujours programmé dans la grille de la KBC. Il a servi de pilote pour la programmation nationale de Tembea na Majira.VidéoLes révolutions de l’informationL’unité vidéo de l’AIC cherche également une forme d’autonomie financière. Elle produit des documentaires et des programmes deformation à la demande de clients comme les agences de développement ou les ONG. Les productions les plus récentes ont porté surl’embouche bovine, le stockage des cultures d’exportation après récolte, l’irrigation et les méthodes de recherche participative.Les vidéos sont exploitées de différentes façons. Quelques-unes sont destinées à appuyer la formation paysanne dans des centres deformation dans tout le pays et même dans d’autres pays africains. Certains programmes sont conçus pour déclencher une discussion parmiles participants à une formation. Ils proposent généralement des études de cas à partir de l’histoire d’un agriculteur ou l’exposé d’unesituation. Après la projection, l’animateur invite les participants à analyser ce qu’ils ont vu et entendu. Après ce débat, le téléviseur est ànouveau allumé pour voir un nouveau programme, qui cette fois, expose les aspects techniques du même problème.D’autres programmes vidéo sont diffusés sur des téléviseurs communautaires installés sur les marchés, partout dans le pays. Des études ontmontré que ces programmes avaient une forte capacité d’attraction : les gens qui se rendent au marché restent généralement pour regarderle programme vidéo.L’AIC et Mediae Trust ont également produit une série de programmes de formation sur les techniques de communication à l’intention desvulgarisateurs. Ces séries, produites en collaboration avec l’université de Reading et l’Open University en Grande-Bretagne, traitent tous lessujets relatifs à la communication : la communication interpersonnelle, l’organisation des visites sur le terrain, les démonstrationstechniques, la prise de parole en public, l’animation de groupe, l’utilisation des aides visuelles… Le kit de formation comprend 6 cassettesvidéo et un manuel. Il a été exploité pour la formation de milliers de vulgarisateurs, au Kenya et dans d’autres pays. Il est également utiliséà l’Université de Reading pour initier les formateurs à ces techniques.Du travail professionnelLes vidéos de l’AIC répondent aux normes professionnelles. Les images sont excellentes, avec des gros plans parfaitement cadrés, despanoramiques et des zooms très maîtrisés et un montage nerveux. L’AIC utilise du matériel professionnel, ce qui permet la diffusion desprogrammes sur les antennes des télévisions nationales, comme leur exploitation en vidéo pour des petits groupes.Certains clients savent exactement ce qu’ils veulent. Ils viennent alors avec un scénario et un découpage technique déjà prêts. D’autres ontbesoin de plus d’assistance. Les équipes de l’AIC ont une double qualification, en agriculture et en production audiovisuelle, ce qui leur18
Radio et télévisionpermet d’apporter une assistance à tous les stades : écriture du synopsis et du scénario, choix des lieux de tournage, conduite desinterviews…Le succès de ses productions vidéo incite l’AIC à envisager d’emboîter le pas de l’unité radio et à produire régulièrement un programmeagricole pour la télévision. Les coûts de diffusion sont beaucoup plus importants : environ 2 000 e pour 30 minutes. L’AIC espère produireun programme pilote qui permettra d’attirer des annonceurs potentiels pour couvrir ces coûts.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESAgricultural Information Centre (AIC), Waiyaki Way, PO Box 66730, Nairobi (Kenya). Tél. (254) 2 446464 ; fax (254) 2 446467David Campbell, Mediae Trust, PO Box 39486, Nairobi (Kenya). Tél. (254) 2 442487 ; tél./fax (254) 2 442660 ;e-mail mediae@africaonline.co.keLloyd Morgan, K. et Mukareba, J. 1998. Kenya : Experience with rural radio. The Rural Extension Bulletin, June 1998, pp. 31–3519
Radio et télévisionRadios communautairesApporter aux producteurs ruraux une informationde proximitéJacques Sultan« Radio Benso, c’est notre radio, c’est la radio des paysans… »« La radio a changé notre vie. Elle nous a permis de nous sentir un peu au Mali. Avant, nous écoutions les radios de Côte d’Ivoire. Maintenant,nous pouvons nous tenir au courant de ce qui se passe chez nous, avoir des informations techniques sur la culture du coton, diffuser noscommuniqués sur les antennes pour informer nos familles des événements importants, écouter la musique de nos villages. Radio Benso,c’est notre radio, c’est la radio qui parle des paysans ».Voilà ce que dit un auditeur de radio Benso, à Kolondieba, une des quatre localités de la région cotonnière, dans le sud du Mali, où uneradio rurale communautaire diffuse ses programmes depuis début 1999. Il faut dire que la situation de ces paysans, principalementproducteurs de coton, n’est pas toujours facile : leurs revenus sont très dépendants des variations des cours d’un marché mondial capricieuxet leurs activités de production sont contrôlées par un opérateur puissant et omniprésent, la Compagnie malienne de développement destextiles (CMDT).Pour ces producteurs, l’information et la communication sont des outils stratégiques pour s’organiser collectivement, gérer en commun lesfacteurs de production, échanger leurs expériences, accéder aux informations techniques et économiques dont ils ont besoin, faire les choixles plus appropriés et défendre leurs intérêts. Les obstacles liés à la diversitédes langues, à l’analphabétisme et à l’isolement de certaines associationsvillageoises rendaient l’accès à l’information et à la communicationdifficiles… jusqu’à l’arrivée des radios communautaires locales…Répondre aux besoins des auditeursQuatre radios sont ainsi nées à Kolondieba, Bougouni, Koutiala et Bla, avecl’appui financier de la coopération néerlandaise et le soutien technique de laEnregistrement d’une émission dans le studio de Radio Kafo Kan àBougouni (Mali)(Photo : Jacques Sultan)21
ENCADRÉ 2La recette du succèsLa mise en œuvre des radios a associé les communautés, les producteurs ruraux, les organisations paysannes etles partenaires locaux à toutes les étapes. Les projets ont été construits avec la population. Une campagned’information et de sensibilisation a été organisée dans la plupart des localités couvertes par le projet de radio,sous la forme de réunions publiques au cours desquelles toutes les questions relatives à la création de la radioétaient débattues avec la population. Les radios sont autonomes. Toutes les activités des radios (personnels,programmes, ressources) sont gérées par des comités élus par la communauté : comité de gestion, comité deprogrammes. Le personnel est recruté localement, sur la base de critères précis : ancrage solide dans le terroir,maîtrise des langues locales, motivation et niveau d’instruction.La participation des communautés aux coûts de construction de la radio est une garantie de leur implication. Lescommunautés ont construit elles-mêmes les locaux de la radio en faisant appel à leurs propres ressources et àl’appui des partenaires locaux. L’intérêt des communautés était si fort que 9 mois après le démarrage du projet,les locaux devant abriter les stations étaient construits.Les révolutions de l’informationTous les agents ont été formés. L’ensemble des personnels des stations (techniciens, animateurs et producteurs)ainsi que les membres des comités de gestion ont suivi une formation de base encadrée par le Centreinterafricain d’études en radio rurale de Ouagadougou (CIERRO) (voir p. 36). Le programme de formationcouvrait l’ensemble des aspects du fonctionnement de la station : techniques de production, animation d’antenne,techniques de prise de son, exploitation des équipements, gestion administrative et financière de la radio.Les conditions de durabilité sont réunies. Le coût de fonctionnement des radios a également fait l’objet d’uneétude afin de préparer la prise en charge économique autonome des radios par leurs seules ressources. Chaqueradio dispose de deux comptes séparés dont l’un est exclusivement réservé au renouvellement des matériels.Des instruments de durabilité ont été mis en place : création de clubs d’auditeurs et d’associations desressortissants des localités couvertes par la radio, contrats de prestations avec les partenaires locaux, publicité,avis et communiqués.Un mécanisme d’interactivité avec l’auditoire a été mis en place. Une étude sur les besoins en information desauditeurs a été entreprise dans chaque radio avec l’appui d’un consultant extérieur. Menée avec une approcheparticipative, cette étude, à la fois quantitative et qualitative, a permis d’identifier les différentes catégoriesd’auditeurs, de connaître les conditions d’écoute de la radio (accès aux récepteurs, heures d’écoute, langues),d’inventorier les thèmes et genres d’émissions préférées en rapport avec les problèmes des auditeurs. Elle aégalement identifié les partenaires potentiels des radios, leurs besoins et leur disponibilité de collaboration.Un système de suivi-évaluation est en cours de réalisation. Un système de contact avec les auditeurs et de suiviévaluationde l’impact des programmes est progressivement mis en place dans les radios pour stimuler l’écouteet les discussions sur les programmes, recueillir les critiques, besoins, souhaits, demandes et pour accroître laparticipation des auditeurs à la conception, l’élaboration, la production et le suivi des émissions.Une formation spécifique sur le suivi et l’évaluation de l’impact des programmes doit être prochainementorganisée par la FAO dans les quatre stations. Elle mettra en place des outils simples permettant aux radios deconnaître l’audience des programmes, d’évaluer les changements observés dans les pratiques des producteursaprès les émissions comportant des informations techniques et de mesurer les conséquences des programmessur l’environnement socio-économique des localités, au niveau de l’agriculture, de l’élevage, de la santé de lagestion des ressources naturelles.22
Radio et télévisionPréparation d’une émission à Radio Kafo Kan à Bougouni (Mali)(Photo : Jacques Sultan)FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). Chacune d’entre elle couvre une population de près de 500 000habitants et rayonne sur 100 km environ. Elles s’inscrivent dans le schéma directeur du développement de la radio du Mali.Après moins d’un an de fonctionnement au moment de notre visite, ces radios étaient déjà devenues un instrument très apprécié par lesproducteurs ruraux. Leurs grilles de programmes ont été élaborées en prenant en compte les besoins des auditeurs et les demandes desdifférents partenaires intervenant dans la vie de la radio (voir encadré 2).Qu’est-ce que les auditeurs ont envie d’entendre ?Les études préalables menées dans les villages couverts par les quatre radios ont montré que les thèmes les plus souvent demandés par lesvillageois sont les thèmes sociaux (éducation des enfants, délinquance juvénile, problèmes familiaux, relations hommes-femmes et parentsenfants,santé, grossesses non désirées), les thèmes portant sur les activités agricoles et pastorales (en particulier sur la culture du coton, dusemis jusqu’à la commercialisation), les thèmes relevant de la culture locale (histoire des villages, musiques des terroirs, tradition orale…).Les horaires préférés par les auditeurs sont le matin, avant 8 heures, et le soir après 18 heures. L’écoute est beaucoup plus faible dans lajournée, tout le monde étant occupé aux travaux des champs.Les auditeurs aiment leurs radios et manifestent une nette préférence pour les émissions enregistrées dans les villages avec leur participationdirecte et qui traitent de leurs problèmes immédiats ou qui mettent en valeur leur identité culturelle et musicale.« On aimerait que la radio parle de tout ce qui peut améliorer notre cadre de vie, la santé, l’éducation, ainsi que le développement de nosactivités », dit une auditrice de radio Benso à Kolondieba. « Il faut que les programmes tiennent compte de nos heures de repos pour diffuserles émissions destinées aux femmes, c’est-à-dire vers 20 heures ».« Les jours de marché », dit un des animateurs de radio Kafo Kan à Bougouni, « la station est envahie par les paysans de toutes les localitésdes alentours qui viennent voir les équipements de leur radio, rencontrer les animateurs et apporter les communiqués qu’ils veulent diffusersur l’antenne ».Qu’est-ce que les partenairers ont envie de dire ?Les principaux partenaires des radios (administrations locales, services publics, ONG) disposent de tranches d’antenne qui leur sontréservées, où ils traitent de thèmes éducatifs, sociaux ou récréatifs. La CMDT, qui est le principal partenaire des radios, a organisé sur le23
ENCADRÉ 3Un compagnon inséparable 1« À partir des émissions de la CMDT, qui sont diffusées régulièrement sur les antennes des radios Mali Sud, lespopulations apprennent les techniques culturales, notamment l’utilisation des engrais. La radio fait aussi office debureau de poste et de téléphone : grâce à elle, les populations communiquent entre elles à travers les avis etcommuniqués. Les populations utilisent la radio pour retrouver les choses perdues, volées, les animaux égarésou pour informer parents et amis d’un événement important. La radio a changé la manière de travailler descommunautés rurales. Elles se servent des informations de la météo diffusée sur les antennes pour préparer unvoyage, par exemple. L’intérêt pour la radio se fait de plus en plus sentir et prend de plus en plus d’envergure.Cela se traduit par une augmentation du nombre des propriétaires de postes radio et une fidélité par rapport auxémissions préférées. La quasi-totalité des personnes interrogées déclarent avoir acheté leur poste FM aprèsl’avènement des radios rurales de Mali Sud. Pour les populations, la radio est devenue un compagnoninséparable. »1 Extrait de l’étude des besoins des communautés rurales des zones de diffusion des radios Mali Sud.Les révolutions de l’informationterrain des groupes d’écoute de ses programmes (voir encadré 3), encadrés par les vulgarisateurs pour exploiter et approfondir le contenutechnique des émissions qui sont surtout axées sur les différents aspects de la culture du coton. L’élaboration de la grille de programmesest un exercice difficile d’équilibre car il faut donner la parole à tous ces partenaires, tout en préservant la mission d’intérêt général de laradio.Médiation sociale…« La radio est à l’écoute des auditeurs », dit Yaya Kone, directeur de Radio Kafo Kan à Bougouni ; « nous essayons d’aller au-devant despréoccupations de nos auditeurs. Nos animateurs ont des motos qui leur permettent d’aller sur le terrain et de dialoguer avec lesassociations villageoises, les femmes, les jeunes. Il arrive que les auditeurs contestent vivement la CMDT. Nous faisons alors écouter cesenregistrements à la CMDT en leur disant : voilà ce que les auditeurs pensent de vous. Qu’avez-vous à leur répondre ? »Aborder les problèmes des communautés…« Dans le village de Sido », dit encore Yaya Kone, « il y avait de gros problèmes liés à l’absence de maternité. Les gens attendaient qu’unemère soit décédée pour faire venir des partenaires de l’extérieur et obtenir une assistance ; ils ne savaient pas que la solution était entreleurs mains. Nous avons fait une émission publique sur la place du village, autour du thème, en organisant un jeu, des concours d’éloquenceet des débats. L’émission publique a été très vivante et tous les aspects de la question ont été évoqués. Le concours d’éloquence a étéremporté par un homme qui a dit un proverbe, dans un bambara formidable : si tu veux qu’on t’aide, tu dois commencer à t’aider toimême.Ce proverbe a ensuite servi pour faire un microprogramme diffusé par la radio. Maintenant, à Sido, les villageois ont commencé àcotiser pour bâtir leur propre maternité ».…et des associations villageoises« Un des problèmes sérieux, ici, c’est la vente illicite du coton », dit Fagotoma Sare, directeur de Radio Uyesu, à Koutiala. « Il y a beaucoupde conflits liés à cela. Des associations villageoises nous ont demandé d’aborder ce thème dans nos programmes pour dénoncer cespratiques injustes pour la collectivité. »24
Radio et télévisionCertains producteurs vendent directement une partie de leur récolte à un commerçant, souvent à des prix inférieurs au prix du marché,pour disposer d’argent immédiatement, avant la vente à la CMDT. Ces quantités ne sont donc pas comptabilisées dans la vente à la CMDT,qui retire pourtant du produit global de la vente les avances qui ont été faites pour l’achat des intrants pour l’ensemble de la production duvillage. La somme qui est finalement donnée aux associations villageoises pour être répartie parmi les producteurs est amputée du coûtglobal des intrants. Ce sont donc ceux qui n’ont pas vendu illicitement une partie de leur production qui doivent payer les dettes de ceuxqui ont été moins scrupuleux.« Ces émissions ont été très intéressantes », conclut Fagotoma Sare, « car elles ont permis une prise de conscience collective du problème.Nous avons diffusé des témoignages de producteurs qui ont reconnu avoir vendu illicitement une partie de leur coton et qui ont regrettéde l’avoir fait. Nous avons fait un microprogramme sur ce thème : vous qui vendez votre coton illicitement, non seulement vous n’obtenezpas le prix au kilo que vous donnerait la CMDT, mais vous obligez la collectivité à payer vos dettes en intrants et vous créez la mésententedans l’association villageoise ».Donner la parole aux femmes« Nous apprécions particulièrement la façon dont sont faites les émissions destinées aux femmes », dit la représentante d’une associationféminine à Kolondieba. « Elles posent bien nos problèmes. Même nos maris, qui sont les maris les plus bouchés, peuvent comprendre lesmessages qu’elles véhiculent ».Oumar Sangare, le coordonnateur du projet des radios du Sud Mali, dit que les femmes de Koutiala ne sont pas satisfaites de la place qu’ellesoccupent dans le comité de gestion de la radio. Elles ont l’intention de se présenter en force au moment du renouvellement de ce comité »,ajoute-t-il, « car elles veulent que les programmes de la radio prennent davantage en compte leurs problèmes ».Un laboratoire de démocratie localeUne année seulement après leur lancement, on peut dire que ces quatre radios communautaires sont devenues un véritable laboratoire dela démocratie locale au Mali.Cela n’est pas toujours très facile car les intérêts des différents partenaires en présence sont quelquefois divergents, voire contradictoires.Il faut éviter les tentatives de récupération politique, maintenir un équilibre dans les grilles de programmes entre les principaux thèmesdemandés par les auditeurs, donner la parole à chacun des groupes concernés (producteurs ruraux, CMDT, administration locale, servicespublics, ONG), encourager l’expression des jeunes et des femmes, jouer le rôle de médiateur dans les conflits et trouver des formatsd’émission adaptés aux modes d’expression des paysans.Les radios rurales locales du Mali Sud sont sur ce chemin et bâtissent jour après jour la démocratie locale…25
ENCADRÉ 4Un schéma directeur pour le développement de la radio au MaliLe Mali a connu d’importants changements au cours des dix dernières années : la vie politique s’estdémocratisée, le processus de décentralisation a été mis en place, l’État se désengage progressivement desactivités productives, les organisations paysannes se structurent.Les médias ont également beaucoup évolué : la « parole citoyenne », longtemps bridée par un régime politiqueautoritaire, a été libérée en 1991 avec la chute du régime autoritaire et la promulgation de nouvelles lois dansle secteur de la presse écrite et audiovisuelle. Depuis, on assiste à une véritable explosion des médias,notamment dans le domaine de la radio, qui est un outil de communication particulièrement apprécié par lesMaliens. Plus de cent radios locales de toutes sortes (associatives, communautaires, commerciales etconfessionnelles) ont ainsi vu le jour, dans tout le pays, en milieu urbain comme en zones rurales, dans ungrand bouillonnement d’initiatives mais dans un relatif vide juridique.Les révolutions de l’informationLe gouvernement, pour tirer le meilleur parti de ces initiatives et associer ces nouvelles radios à un servicepublic de radiodiffusion démocratique et homogène sur l’ensemble du territoire, a mis en place un schémadirecteur du développement de la radio au Mali portant sur la période 1995–2014.Ce schéma est basé sur une étude des besoins de couverture géographique et démographique du pays et surles disponibilités en fréquences de diffusion. Il vise l’implantation progressive d’environ quarante radios deproximité qui seront en mesure de proposer aux auditeurs des programmes qui répondent à leurs besoinsd’information, d’éducation et de divertissement, qui utilisent les langues parlées dans les zones concernées etqui reflètent les valeurs culturelles locales.Comme cette mission ne peut pas être assurée par la radio nationale, qui n’en a pas les moyens, legouvernement propose une délégation de service public aux promoteurs des radios associatives,communautaires et commerciales déjà existantes ou en projet, sur la base de l’acceptation de missionsd’intérêt général dans le cadre d’un cahier de charges précis.En contrepartie, les radios partenaires de ce schéma directeur bénéficient d’un certain nombre d’avantages, auniveau de la puissance autorisée des émetteurs, de l’assistance technique pour l’achat et l’entretien du matérielde production et des réseaux de diffusion, de la formation du personnel, de la fourniture et de l’échange deprogrammes.Les quatre radios de la zone Mali Sud s’inscrivent dans ce schéma et préfigurent ce qui pourrait devenir leréseau des radios locales communautaires du Mali, partenaires du schéma directeur du développement de laradio.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESJean Pierre Ilboudo, Responsable de projet, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),Via delle terme di Caracalla, 00100 Rome (Italie). Tél (39) 6 5705 6889 ; e-mail JeanPierre.Ilboudo@fao.orgOumar Sangare, Coordonnateur du projet radios Mali Sud, BP 1820, Bamako (Mali). Tél (223) 21 05 5026
Radio et télévisionUne information citoyenne pour le monde rural…La culture au cœur du développementJacques SultanL’aventure de la coopérative JamanaHamidou Konate, directeur de la coopérative Jamana, évoque le début de l’aventure éditoriale de ce groupe d’édition et de presse, en 1983 :« Au départ, nous étions un groupe d’universitaires, de chercheurs, de spécialistes de la tradition orale, d’artistes, d’artisans. Nous avionsfait le constat que les promoteurs des projets et programmes de développement avaient tendance à négliger, voire à ignorer les aspectsculturels de leurs activités, en concentrant leurs efforts sur la diffusion de « paquets techniques » de formation destinés à améliorer laproductivité de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche ».« C’est pourtant la culture qui constitue le principal facteur de cohésion des communautés rurales », souligne Hamidou Konate. « Lerenforcement du sentiment d’appartenance à un pays, à une région, à un terroir est un puissant levier des activités de production, deprotection des ressources naturelles, d’organisation collective, de participation citoyenne au développement du pays ».« Notre objectif, c’était de promouvoir la culture malienne et africaine » poursuit-il, « de donner aux citoyens la possibilité de lire, d’écrire,dans leurs langues maternelles et de connaître leurs droits et leurs devoirs ».C’est donc pour rendre à la culture sa place au cœur des activités de développement que ce groupe a fondé la coopérative Jamana et misen place une série d’initiatives destinées à préserver, à valoriser et à mobiliser les cultures maliennes et à permettre aux citoyens departiciper au débat sur les grands enjeux du pays.La coopérative Jamana a progressivement créé un ensemble d’outils d’information, de communication et d’animation en mesure derépondre aux besoins des différentes composantes de la société malienne, qu’il s’agisse des citadins francophones ou des populationsrurales dans les diverses zones culturelles et linguistiques du pays.Des outils d’information, de communication de d’animationLes premières initiatives ont visé un public urbain et francophone car, au démarrage des activités de la coopérative, l’alphabétisation enlangues nationales était encore peu développée. Citons parmi les initiatives principales :• La revue culturelle mensuelle Jamana, créée en 1983, a constitué le point de départ de la coopérative ; il s’agit du premier espaced’expression et de débat sur la culture et le développement ;27
• Le journal d’informations générales Les Echos, créé en 1989, est devenu le quotidien de référence au Mali ;• Le magazine Grin-Grin est un mensuel destiné au jeune public de 12 à 20 ans ;• Le journal Yeko est un premier mensuel de proximité décentralisé, publié à Ségou.Les révolutions de l’informationParallèlement, la coopérative Jamana a mis en place une série d’outils de production, de diffusion et d’animation : une maison d’édition,un atelier de composition et de publication assistée par ordinateur (PAO), une imprimerie, une librairie spécialisée dans les ouvrages enlangues nationales et sur l’Afrique, un centre de documentation comportant des données sur l’histoire, l’économie, la sociologie et laculture des sociétés maliennes et africaines, ainsi qu’un atelier d’arts plastiques et une galerie d’art animés par de jeunes artistesmaliens.La communication ne se limite pas à l’information agricoleLe Mali est un pays de forte tradition, au patrimoine culturel très riche, dont les principaux trésors se trouvent dans le monde rural, quiconstitue plus de 80 % de la population.La coopérative Jamana a développé ses activités dans le monde rural. Elle s’appuie sur les principales langues nationales parlées dans le pays,soutient les programmes d’alphabétisation mis en place dans ces langues et apporte une réponse aux besoins d’information, d’expressionet de dialogue formulés par les populations rurales.L’approche développée par Jamana est ouverte. Elle est basée sur trois axes stratégiques :• Les producteurs ne sont pas seulement à la recherche d’informations techniques sur l’agriculture, l’élevage ou la pêche mais ont aussides besoins d’information dans des domaines très divers comme la santé, l’éducation, la nutrition, la gestion des ressourcesnaturelles… ;• La population rurale est attachée à la valorisation de ses savoirs, de ses traditions et de ses richesses culturelles, musicales ouartisanales ;• Les communautés rurales veulent prendre part au débat politique et sont fortement demandeuses d’informations citoyennes sur lesenjeux de l’évolution de la société malienne, la décentralisation, la gestion des affaires publiques…Pour répondre au mieux à cette demande dans sa diversité et toucher à la fois les personnes alphabétisées dans les principales languesnationales et les analphabètes, qui représentent 70 % de la population, la stratégie de communication de la coopérative Jamana s’estappuyée sur une combinaison de supports écrits et sonores adaptés à la situation de la population rurale, en veillant à ce qu’ils soienttechniquement et économiquement maîtrisables.28
Radio et télévisionUn rossignol dans des cassettes audioSorofe signifie « rossignol », en bambara. C’est aussi le titre d’un journal distribué sur cassettes audio en plusieurs langues nationales, publiépar Jamana. C’est un support d’information original, particulièrement adapté aux populations non alphabétisées.Sorofe aborde, oralement, toutes les grandes questions qui intéressent le monde rural : activités agropastorales, environnement, santé,culture, développement durable, citoyenneté… de façon vivante et éducative, sous forme de témoignages, de comptes rendusd’expériences réussies, de jeux et de débats contradictoires. Sorofe traite en priorité des thèmes les plus demandés par la population rurale :des thèmes de société, comme le droit de propriété foncière des femmes ou l’excision, des thèmes culturels, comme l’origine desinstruments de musique, l’histoire des griots, la signification des prénoms, les musiques et les récits des terroirs du Mali, des thèmestouchant à la citoyenneté et à la vie politique du pays, comme la décentralisation, les élections, les droits et les devoirs des citoyens, ladémocratie…Sur chacun de ces thèmes, l’équipe de Sorofe s’attache à recueillir des opinions et des témoignages qui rendent compte de tous les pointsde vue sur le sujet traité. Les cassettes de Sorofe représentent ainsi un support vivant et pluraliste pour l’organisation de débats, au niveauvillageois. Elles ont aussi permis de diffuser et de populariser en langues nationales les textes de base sur la décentralisation, les chartes despartis politiques, la constitution…Sorofe a été très vite adopté par les populations rurales : de trimestriel il est devenumensuel et son tirage s’est multiplié par trois, passant de 500 à 1 500 exemplaires ; enréalité, sa diffusion est probablement beaucoup plus importante si l’on prend en compteles nombreuses reproductions « pirates » qui en sont faites.Actuellement, l’équipe de Jamana étudie les possibilités d’articulation entre Sorofe et lesradios de proximité qui ont été mises en place dans tout le pays.« Nous voulons savoir autre chose… »Jekabaara est un journal de post-alphabétisation. Il constitue un support d’information etde formation destiné spécifiquement aux paysans alphabétisés en langue nationalebambara. Il a été créé par Jamana en partenariat avec plusieurs opérateurs économiquesimportants, en particulier la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT),qui contrôle l’exploitation du coton, et l’Office du Niger qui s’étend dans la zone rizicole dupays.C’est un mensuel, tiré à 16 000 exemplaires, dont une grande partie (11 000) est diffuséepar la CMDT.Un numéro de Jekabaara, un journal en bambara29
Au départ, en vertu des accords passés avec les partenaires, Jekabaara devait surtout constituer un support de vulgarisation des techniquesculturales du coton et du riz pour accompagner l’action des opérateurs intervenant dans ces secteurs ; mais les lecteurs en ont jugéautrement : « Pourquoi est-ce que dans Jekabaara, vous nous parlez seulement de comment faire telle ou telle culture ? Vous pensez quenous ne vivons que de cela ? Nous voulons savoir autre chose. Nous vivons en démocratie, nous voulons comprendre ce qui se passe dansle pays et participer au débat ».Les révolutions de l’informationVoilà en quels termes s’exprimaient les lecteurs du journal rural Jekabaara en 1991, au moment de la libération du pays du régimedictatorial. Ils n’étaient pas satisfaits de la ligne éditoriale de la publication, trop axée sur la vulgarisation agricole. En somme, même sil’information technique leur était très utile, les lecteurs ne voulaient plus être seulement considérés comme des producteurs, mais commedes citoyens capables de participer au débat politique. Ils demandaient, au moment où un vent de démocratie nouvelle soufflait sur le pays,une information plus citoyenne sur les événements politiques, les grandes décisions intéressant le monde rural, l’environnement, la vie dupays…Le contenu du journal a donc évolué et, aujourd’hui, il consacre environ 70 % de son contenu aux aspects techniques (engrais, pesticides,vulgarisation de nouveaux matériels de culture, vente des produits, commercialisation, organisation collective des paysans et vie desassociations villageoises). Les 30 % restants sont consacrés à l’information générale, politique, aux échanges d’opinion entre lecteurs, auxmonographies villageoises.Un accord est en cours de signature avec l’Office du Niger pour la publication d’une version du journal adaptée aux lecteurs de la zone deculture du riz avec un contenu technique spécifique. Cela pourrait porter le tirage du journal à 30 ou 40 000 exemplaires, avec des encartsdans différentes langues, et notamment en fulfuldé et en soninké, pour aborder des questions sensibles comme la gestion des pâturages etla cohabitation entre les pasteurs peuls et les cultivateurs soninkés. Le journal pourrait ainsi jouer un rôle important dans la résolution desconflits entre ces deux communautés.Jekabaara est donc en pleine expansion et rencontre une demande croissante du monde rural car les personnes alphabétisées en languesnationales sont de plus en plus nombreuses et il existe peu de productions écrites en mesure de satisfaire les besoins des néo-alphabètes.Le principal facteur limitant reste cependant celui de la distribution. La diffusion par des dépositaires individuels est hasardeuse, notammenten raison des difficultés d’acheminement et de récupération de l’argent des ventes. Plusieurs solutions alternatives sont actuellementétudiées par la coopérative Jamana, notamment la conclusion de contrats avec des ONG pour qu’elles assurent la diffusion dans leurspropres circuits avec, en contrepartie, des facilités d’acquisition des autres produits de la coopérative Jamana ou le renforcement de pointsde diffusion spécifiques en liaison avec les correspondants de Jamana sur le terrain et les radios de proximité (voir encadré 5).Les radios de proximité offrent un support à l’expression populaireLa radio reste, bien entendu, l’outil de communication le mieux adapté au monde rural et les Maliens en sont très friands. Avec la libérationdes ondes intervenue en 1991, la coopérative Jamana, qui avait été membre fondateur de la première radio libre du Mali, Radio Bamakan,30
Radio et télévisionENCADRÉ 5Pour tous les journaux ruraux, la distribution reste le principal problèmeD’autres journaux ruraux existent au Mali. Leur création a été favorisée par l’essor spectaculairede l’alphabétisation en langues nationales dès le début des années 70 grâce au soutien del’Unesco. Certains opérateurs économiques, comme la CMDT, en organisant des campagnesmassives d’alphabétisation dans le cadre de la mise en place des associations villageoises dansla zone cotonnière, ont contribué au développement et à la pérennité de ces journaux.Les principaux journaux en langues nationales sont publiés par l’Agence malienne d’informationet de publicité (AMAP). Le plus ancien, Kibaru existe depuis 1972. Tiré à 16 000 exemplaires, ilest diffusé dans toute les zones du Mali où l’on pratique la langue bambara. Deux autresjournaux ont été créés par la suite. Il s’agit de Kabaaru, en langue fulfuldé, et Xibaare, en langueSoninké, tirés à 2 000 exemplaires. Ces journaux s’adressent surtout à un public rural et ils remplissent un rôleessentiel dans la diffusion des informations nationales et internationales pour des lecteurs qui disposent de trèspeu de sources d’information écrite dans leurs langues.Ils sont toutefois tous confrontés au même problème : comment atteindre leurs lecteurs ? Les lecteurs sont eneffet très dispersés sur le plan territorial et les modes de distribution classiques comme la poste sont rarementpossibles, peu fonctionnels et de toute façon très coûteux : les frais de poste sont la plupart du temps largementsupérieurs au coût du journal lui-même. Dans les zones encadrées par un opérateur économique comme laCMDT, la diffusion est assurée par le circuit de cet opérateur. Ainsi, la CMDT distribue aussi bien 10 000exemplaires de Kibaru que 10 000 exemplaires de Jekabaara dans sa zone d’encadrement.Dans les zones non encadrées, les journaux font appel à des dépositaires individuels qui reçoivent le journal pardifférentes voies (poste, commerçants ambulants, transporteurs…) et qui assurent la distribution au niveau localen prélevant un pourcentage sur le prix du journal. Ce mode de distribution ne concerne toutefois que de petitesquantités de journaux (il peut y avoir au maximum 20 lecteurs assidus dans un village) et le problème réside dansla récupération du produit de la vente, les dépositaires n’étant pas en mesure de faire l’avance du prix desjournaux.Tous les responsables de journaux ruraux cherchent à résoudre ce problème enassociant systématiquement les organisations structurées sur le terrain à ladistribution des journaux (opérateurs économiques associés au développementrural, comme la CMDT ou l’Office du Niger, ONG, organisations paysannes, projets,centres d’alphabétisation, centres de lecture publique…) ou en créant leurs propresréseaux autour de pôles de distribution comme Jamana essaie de le faire.Tous affirment que lorsque les problèmes de distribution seront résolus, ils pourrontdoubler, voire tripler leur tirage car la demande des lecteurs est très importante etles journaux en langues nationales pourraient avoir les plus forts tirages de lapresse nationale.En haut : un numéro de Kabaaru, un journal en fulfuldéÀ droite : numéros de Xibaare å la sortie des presses de l’AMAP à Bamako (Mali)(Photo : Jacques Sultan)31
a mis en place une série de radios locales avec l’objectif de prolonger et dedécentraliser son action sur le terrain. Dix stations ont déjà été créées, danstoutes les régions du pays. Elles sont toutes animées et gérées par des jeunessans emploi provenant de ces différentes localités ; elles ont un rayon d’actionde 70 km en moyenne et traitent de tous les sujets qui intéressent un auditoireprincipalement rural.Les révolutions de l’informationElles offrent à leurs auditeurs un espace d’information, d’expression et dedialogue, notamment sur les thèmes touchant aux droits de la femme et del’enfant en milieu rural. Elles accompagnent l’activité des partenaires locaux dudéveloppement et elles prolongent le travail de valorisation du patrimoineculturel local qui constitue un des objectifs principaux de la coopérative.Plus de 80 % des émissions des radios locales sont diffusées en languesnationales et 40 % des programmes sont consacrés aux activités agropastoraleset au développement rural. Les autres thèmes prioritaires sont la santé,l’hygiène, la citoyenneté, l’environnement, la musique, l’histoire et ledéveloppement durable. Une large place est réservée aux femmes et auxassociations de développement et les radios organisent des débats avec despersonnes ressources locales et donnent des conseils pratiques aux auditeurssur tous les thèmes abordés.Des accords de partenariat et des contrats de coproduction sont passés avec lesorganismes associés aux activités de développement rural dans les différenteslocalités concernées. Par exemple, la radio Jamana de Koutiala (Radio Kujakan)a passé des accords de coproduction avec la CMDT pour traiter de toutes lesquestions relatives à la culture du coton, mais aussi à la santé, l’alphabétisation, l’eau potable, la protection de la couverture végétale,l’aviculture… Elle a aussi conclu des accords de partenariat avec le SYCOV (Syndicat des producteurs cotonniers et vivriers), les servicespublics, les ONG nationales et internationales, les projets, les associations féminines, les opérateurs économiques et les artisans.Relever les défis du futurRadio Kené à Sikasso (Mali)(Photo : Jacques Sultan)Les outils d’information, de communication et d’animation de la coopérative Jamana couvrent toutes les régions et utilisent les principaleslangues parlées dans le pays. Ils abordent de façon interactive les principaux thèmes intéressant la population, tant dans le domaine dudéveloppement rural proprement dit, que dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’environnement. Ils sont particulièrementattentifs à encourager la citoyenneté, à valoriser le patrimoine culturel et à approfondir les questions intéressant les femmes et les jeunes.32
Radio et télévisionLes enjeux pour les années à venir sont importants car la miseen place de la décentralisation ouvre de larges perspectivesavec une forte demande en information et en communication.Pour relever ce défi, la coopérative Jamana a de nouveauxprojets :• Des espaces d’animation et de discussion vont être mis enplace autour des radios de proximité. Ils seront des lieux dedébat sur l’évolution de la société malienne et constituerontdes points de distribution des journaux en languesnationales et des autres productions de Jamana. Ilspermettront aussi de faire remonter l’information vers lastructure centrale pour améliorer le contenu éditorial desjournaux, des magazines et des revues ;• Le journal sonore Sorofe et les radios de proximité vontcollaborer plus étroitement. Les productions de Sorofeseront diffusées par les radios et les programmes des radiospourront nourrir la production du journal sonore ;Au Mali, les émissions de radio enregistrées dans les villages attirent lesfoules. Les villageois font la queue pour exprimer leur opinion sur desproblèmes locaux(Photo : Jacques Sultan)• Les radios vont fonctionner en réseau. Elles serontprogressivement dotées chacune d’un ordinateur afin de communiquer entre elles et avec la structure centrale par messagerieélectronique. Dans une deuxième étape, elles synchroniseront certains de leurs programmes en lien avec la radio Bamakan à Bamako.Ce réseau servira également à la production de bulletins d’information locaux ;• Le système de production des journaux et revues va être amélioré en multipliant les correspondants locaux ;• Des contrats de collaboration sont en cours de négociation avec des partenaires importants comme l’Office du Niger ou le Programmede gestion des ressources naturelles. Ces accords vont permettre l’amélioration de la production mais aussi de la diffusion des journauxet documents en langues nationales ;• Des bulletins locaux d’information seront progressivement réalisés en s’appuyant sur le dispositif mis en place autour des radios, desespaces d’animation et des correspondants locaux de la coopérative.33
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESDaniel Dembele, Directeur, Radio FM Jamana Kujakan, BP 61, Koutiala (Mali). Tél./fax (223) 64 01 34Hamidou Konaté, Directeur général, Coopérative Jamana, BP 2043, Bamako (Mali). Tél (223) 29 62 89 ; fax (223) 23 23 16 ;e-mail jamana@malinet.mlLes révolutions de l’informationNianzé Samake, Directeur de la presse communautaire, Agence malienne de presse et de publicité (AMAP), BP 24, Bamako (Mali).Tél. (223) 21 21 0434
Radio et télévisionDes réseaux de radios localesDes radios locales pour répondre aux besoinsdes populations rurales…Jacques Sultan« La radio nous a aidés à résoudre un problème sérieux dans ce village », dit un habitant du village de Seriwala, au Mali. « Quand unepersonne décédait, informer les parents qui résident dans les villages environnants, qui se situent à 30 ou 40 kilomètres, pour qu’ils viennentà temps aux obsèques, était presque impossible. Il fallait louer un vélo ou un cheval pour faire le déplacement. Si, par malheur, ces moyensmanquaient et qu’on n’arrivait pas à informer à temps les gens, ceci avait des conséquences graves sur les rapports entre les villages. Parfoisle divorce entre deux familles. Maintenant, avec la radio, il suffit de payer 500 francs (0,76 e) pour que tout le monde soit informé. Personnen’en veut à personne, Dieu merci. »« La radio a provoqué un véritable changement dans la vie quotidienne des villageois », dit encore une auditrice du village de Kodialanida,au Mali ; « elle nous a permis de comprendre l’importance de l’alphabétisation fonctionnelle dans nos activités économiques, ce qui nousa encouragés, nous les femmes, à nous investir davantage dans ce domaine. Au début, nous menions des activités séparément ; c’est enécoutant les émissions à la radio que nous avons eu l’idée de nous regrouper au sein d’une même association, parce que d’autres femmesl’ont fait ailleurs et qu’elles ont réussi en écoutant les conseils que donne la radio et en essayant d’être disponibles et ouvertes aux questionsque la radio pose ».Depuis le milieu des années 80, les radios rurales locales jouent un rôle inappréciable dans les pays africains. Partout où elles ont étéimplantées, elles ont permis à des communautés villageoises isolées, enclavées, souvent non couvertes par les radios du service public, dedisposer d’un instrument d’information de proximité, d’éducation, de dialogue, d’animation et d’expression populaire. Elles ont aussipermis de recueillir et de valoriser le patrimoine oral et musical des communautés rurales : histoire des villages, musique, récits, traditionsorales…Faciles à implanter, peu coûteuses, elles sont devenues un outil de communication familier en milieu rural et très apprécié par les acteurslocaux du développement : collectivités locales, associations paysannes, groupements de femmes et de jeunes, ONG, opérateurséconomiques.…qui rendent de nombreux services, mais restent isoléesLe développement de ces radios ne s’est toutefois pas fait sans difficultés et elles ont de nombreux problèmes à résoudre : la productiondes émissions sur le terrain est limitée en raison de l’absence de moyens de déplacement, de matériel de production mobile et de lafaiblesse des ressources financières. La maintenance et le renouvellement des équipements techniques constituent également un problèmeardu : à la moindre panne d’émetteur, il faut quelquefois attendre pendant plusieurs mois une pièce détachée venant d’Europe ou d’Asie.35
Le centre audionumérique du CIERRO àOuagadougou (Burkina Faso)(Photo : Jacques Sultan)Les révolutions de l’informationEnfin, ces radios ont peu d’occasions de communiquer entre elles pour confronter leurs expériences, échanger leurs programmes ouentreprendre des coproductions à coûts partagés, alors qu’elles abordent les mêmes thèmes, avec les mêmes approches et souvent dansles mêmes langues.Des rencontres, des sessions de formation, des colloques sont organisés régulièrement pour rompre cet isolement et favoriser les échangesentre ces radios locales rurales, notamment par l’Agence internationale de la francophonie, le Centre interafricain d’études en radio ruralede Ouagadougou (CIERRO), le CTA, la FAO, l’Institut Panos et d’autres partenaires. Mais ces rencontres restent rares car elles sont coûteuseset elles ne font pas toujours l’objet d’un suivi rigoureux.Les nouvelles technologiesC’est à partir de l’analyse de ces difficultés que l’Agence internationale de la francophonie, l’un des principaux promoteurs de ces radios, apris l’initiative de constituer un réseau des radios rurales locales d’Afrique. Ce réseau s’appuie sur les nouvelles technologies del’information et de la communication. Cette initiative est en train de modifier en profondeur la situation des radios rurales locales enapportant une nouvelle dimension à leur développement.Le centre audionumérique est opérationnel depuis avril 1999. Il est abrité par le CIERRO à Ouagadougou (Burkina Faso). Il constitue le cœurdu réseau des radios rurales locales. Il s’articule autour d’un site Internet, d’une banque de programmes, d’un centre de formation auxnouvelles technologies et d’une centrale d’achat de matériels de production et d’émission.Il est animé par trois personnes : un coordonnateur chargé de construire et d’animer un réseau de 48 radios rurales locales réparties dans10 pays, un technicien spécialisé dans la production numérique et la formation ainsi qu’un informaticien chargé de la construction d’un siteInternet, de la mise en place d’une banque de programmes informatisée et de la formation aux nouvelles technologies.L’objectif principal du centre est d’aider les radios rurales locales à enrichir et à diversifier leurs programmes. Des sessions de formation desanimateurs et des techniciens des radios rurales locales à la production numérique et à la maîtrise des nouvelles technologies del’information et de la communication sont régulièrement organisées. Des coproductions entre radios sur des thèmes d’intérêt communssont encouragées. Une centrale d’achat permet aux radios d’acheter du matériel et des consommables à des tarifs intéressants.36
Radio et télévisionUne banque de programmesLa banque de programmes est un des principaux éléments du dispositif. Elle a pour objectif de constituer une réserve de programmes dequalité pour aider les radios locales à diversifier et enrichir leurs grilles de programmes.La banque est alimentée par des programmes provenant des radios membres du réseau et répondant à un certain nombre de critèress’agissant des thèmes et des langues. Une typologie des thèmes des programmes a été établie (techniques agropastorales, environnement,santé, économie, éducation, société, culture…). Trois langues importantes de la sous-région sont principalement utilisées : le dioula, lepular et le malinké.À la fin de l’année 1999, après seulement quelques mois de fonctionnement, la banque de programmes disposait déjà de 150 émissions surces différents thèmes. Les émissions sont accompagnées d’un script en français pour permettre leur traduction dans d’autres langues. Uncatalogue des programmes a été établi et distribué aux radios. Il est également consultable sur le site.Les radios locales peuvent avoir accès à ces programmes de trois façons : accès direct par téléchargement à partir du site Internet(www.radios-rurales.net), copie des programmes sur CD-ROM, copie des programmes sur cassettes sonores.Le téléchargement est encore difficile pour la plupart des stations car elles ne sont pas équipées d’ordinateurs permettant ce typed’opérations. Cependant, un programme d’équipement des stations est en cours. Dans chaque pays concerné, au moins une station estéquipée et elle assure une coordination nationale.Un centre de formation aux nouvelles technologiesCe centre est destiné à assurer progressivement la formationde tous les responsables des radios locales aux nouvellestechnologies, au fur et à mesure de l’équipement de leursstations. Les formations portent sur l’initiation à la microinformatique,le courrier électronique, la recherched’informations sur l’Internet, le téléchargement de programmes,la production audionumérique… Elles se déroulentà Ouagadougou, dans le centre audionumérique lui-même,mais aussi sur le terrain, au sein des stations de radio quidisposent de l’équipement adéquat.Radio Palabre, une station de radio locale àKoudougou (Mali)(Photo : Jacques Sultan)37
Un programme de coproductionsLe centre encourage et soutient la coproduction de programmes entre plusieurs stations membres du réseau, en organisant des ateliers decoproduction sur des thèmes comme la tradition orale, l’éducation à la citoyenneté, le droit en milieu rural, les relations de « cousinage »entre ethnies, la lutte contre les feux de brousse… L’initiative peut également provenir des radios qui proposent des thèmes decoproduction. Le centre apporte un appui pour la mise en relation des radios coproductrices et pour la réalisation des programmes.Les révolutions de l’informationENCADRÉ 6Un atelier de coproduction débouche sur des campagnes radiophoniques dans 6 pays…Le droit en milieu rural est un thème crucial pour les producteurs ruraux, notamment sur les questions d’accèsdes femmes à la terre, d’héritage, de rapports entre cultivateurs et éleveurs…Un atelier de coproduction sur ce thème a été organisé au Sénégal en août 1999, dans le cadre du réseau desradios rurales locales d’Afrique, avec la participation de communicateurs, de juristes et de linguistes provenantde 6 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Sénégal).Diverses productions ont été réalisées au cours de l’atelier sous la forme de magazines et de microprogrammessur différents thèmes : les cartes d’identité, les actes de naissance et de mariage, les droits desfemmes dans le mariage et dans l’accès à la terre, l’état de droit… Leur diffusion, en plusieurs langues, dansles pays concernés a connu un succès considérable auprès des auditeurs qui ont découvert que les problèmesde droit se posaient dans les mêmes termes dans d’autres pays que le leur.Ces diffusions ont suscité un tel intérêt que, dans plusieurs pays, elles ont constitué le point de départ de touteune série d’autres productions qui vont maintenant enrichir le patrimoine commun de ces radios : des tablesrondes et des magazines sur le mariage (et notamment sur les mariages forcés et les mariages précoces), ledivorce, l’héritage, l’accès des femmes à la terre, les droits des femmes, l’accès à la justice, le règlement desconflits… Des organisations locales des droits de l’homme, des ONG et des magistrats se sont associés à cesinitiatives.Les émissions sont traduites dans de nouvelles langues locales et certaines stations ont institué un service dequestions/réponses en allant collecter dans les villages les questions que se posent les ruraux et en apportantdes réponses à l’antenne avec la contribution de juristes et de spécialistes du droit.Une nouvelle rubrique, « Le droit et nous » est apparue dans les grilles de programmes des stations. Tous cesprogrammes peuvent bien sûr être échangés entre les stations par le biais de la banque de programmes duréseau.38
Radio et télévisionTous les programmes ainsi coproduits sont mis à la disposition de l’ensemble des membres du réseau. Ils sont également exploités pard’autres partenaires du réseau tels que le programme Appui à l’instruction civique (APIC), qui produit des émissions éducatives, ou leprogramme Archivage de la tradition orale (ARTO) en lien avec le Centre d’études linguistiques et historiques par tradition orale (CELTHO),centre de l’OUA situé à Niamey (Niger).Une centrale d’achatElle a été mise en place pour aider les radios locales à acquérir du matériel de production, d’émission ou des pièces détachées. Elle aconstitué un stock des équipements les plus courants et des principales pièces détachées ou de leurs équivalents qui sont achetés par lecentre en gros, ce qui permet de le proposer à des prix compétitifs. Un système de fonds de roulement a été mis au point pour alimenterrégulièrement le stock : toutes les radios qui versent une contribution régulière au compte de la centrale d’achat bénéficient d’uneréduction de 50 % du prix du matériel et de la gratuité du coût du transport.Autres servicesLe site propose également à ses utilisateurs le carnet d’adresses de l’ensemble des membres du réseau et des partenaires, un calendrier desactivités du réseau (ateliers de formation, de coproduction, manifestations et rencontres), un répertoire des liens et des moteurs derecherche intéressant les radios qui veulent exploiter les ressources de l’Internet, des outils pour faciliter la navigation, des documentsd’intérêt général en ligne…De riches perspectivesLe réseau des radios rurales et les outils que constituent le centre audionumérique et la banque de programmes ouvrent des perspectivesextrêmement intéressantes pour les radios rurales locales d’Afrique.Les services déjà offerts s’enrichiront bientôt de liens avec d’autres réseaux comme les banques de programmes radiophoniques de l’InstitutPanos (voir p. 69), de Syfia, du CTA ou le réseau de femmes Anaïs. Des forums de discussion et d’échanges entre radios rurales sontégalement en perspective.Les coproductions constituent également un élément très riche du dispositif car elles permettent, sur chacun des thèmes abordés, laréalisation de véritables dossiers et la confrontation des expériences de chaque pays dans le domaine concerné.Avec ces nouveaux outils, les radios rurales locales africaines vont pouvoir sortir de l’isolement, accéder à une grande quantité deprogrammes en rapport avec les préoccupations de leurs auditoires, s’informer sur ce qui est fait dans d’autres contextes pour résoudre lesproblèmes quotidiens de la population, faire connaître leurs initiatives et leurs réussites à l’échelle de toute l’Afrique.39
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESCentre audionumérique francophonie, ACCT/CIERRO, BP 385 Ouagadougou 01 (Burkina Faso). Tél. (226) 31 68 64 ; fax (226) 31 28 66 ;e-mail bah@radios-rurales.net ; cierro@fasonet.bf ; Internet www.radios-rurales.netJean Pierre Lamonde, Agence internationale de la francophonie, Programme d’appui radios rurales locales, 13 Quai André Citroën,75015 Paris (France). Tél. (33) 1 44 37 33 00 ; fax (33) 1 44 37 32 42 ; e-mail Lamondej@francophonie.org ;Internet www.francophonie.orgLes révolutions de l’information40
Radio et télévisionVidéo éducativeLa vidéo au service du développementJacques Sultan« Comment populariser le crédit agricole ? »« C’est cette question que les responsables de la Banque nationale de développement agricole du Mali (BNDA) se posaient en 1993,lorsqu’ils sont venus nous voir », dit Cheikna Diarra, le directeur du Centre de services de production audiovisuelle (CESPA) de Bamako,au Mali.« La BNDA accorde des prêts aux producteurs ruraux pour l’achat de leurs équipements. Toutefois, les conflits sont fréquents car lesmécanismes de crédit ne sont généralement pas maîtrisés par les producteurs. Les recouvrements sont donc difficiles, un climat deméfiance s’établit et c’est toute la chaîne de financement de la production agricole qui s’en trouve finalement affectée. Pour trouver unesolution à ce problème, la BNDA a fait appel à nous car le CESPA avait déjà une longue expérience dans la production audiovisuelle pourle monde rural et dans la formation paysanne. Ensemble, nous avons entrepris de concevoir et de mettre en place une campagned’information et de formation paysanne sur le crédit agricole.« Les équipes du CESPA se sont mises au travail. Elles ont d’abord conduit une enquête approfondie auprès des producteurs ruraux viséspar la campagne, dans la zone cotonnière, pour identifier l’image qu’ils avaient de la banque, évaluer leur niveau de connaissances sur lesmécanismes de crédit et étudier leurs pratiques traditionnelles dans ce domaine.« Sur cette base, le CESPA a produit une série de modulesd’information et de formation basés sur des documents vidéo et deslivrets techniques. »Les paysans et la banque parlent enfin le mêmelangage« Les documents vidéo s’appuyaient sur des situations réellestournées dans les villages, avec des paysans et des banquiers jouantEnregistrement d’une interview avec un paysan au Mali(Photo : Jacques Sultan)41
leur propre rôle », souligne Cheikna Diarra. « Ils ont ainsi permis de mettre en évidence et d’analyser les défauts du système et de présenterune vision nouvelle des rapports entre les paysans et la banque. Les livrets techniques venaient compléter l’information et servaient desupport à des sessions de formation paysannes sur les mécanismes de crédit et les techniques bancaires, immédiatement après la projectiondes vidéos. »Les révolutions de l’informationUne étude d’évaluation de la campagne a été conduite. Voici quelques-unes de ses conclusions : « la première campagne, menée en languebambara dans la zone cotonnière, a eu un succès immédiat. Les paysans avaient intégré le rôle de la banque dans leurs activités deproduction et ils étaient devenus capables de calculer eux-mêmes les intérêts bancaires qui leur étaient dus. Les paysans et la banqueparlaient enfin le même langage. »Faire des bénéfices, est-ce un péché ?Impressionnée par cet impact, la BNDA a voulu étendre rapidement la diffusion de cette campagne vers les producteurs de riz de l’Officedu Niger ou les éleveurs du Nord.« Mais ils se sont rendu compte qu’il fallait adapter les campagnes à chaque contexte », ajoute Cheikna Diarra, « car les situations, les langues,les traditions ne sont pas les mêmes, et que les paysans n’adhèrent pas à un message qui ne leur est pas spécifiquement destiné. Parexemple, dans la langue songhaï, parlée dans le Nord et marquée par une culture arabophone, le mot « bénéfice » n’existe pas ; c’est mêmeconsidéré comme un péché.« Il a donc fallu que nous trouvions d’autres mots que le mot « bénéfice » pour expliquer aux paysans qu’ils allaient faire des plus-valuesavec les revenus de leur épargne. Le CESPA a ainsi été chargé de réaliser de nouvelles versions des modules d’information et de formation. »Aujourd’hui, plus de 2 000 paysans sont formés chaque année aux mécanismes du crédit rural et la banque est devenue un véritablepartenaire de leurs activités.Accompagner les mutations du monde ruralLe CESPA est né de la volonté du gouvernement du Mali de disposer d’un outil d’information et de formation capable d’accompagner lesrestructurations importantes en cours dans le monde rural, dans tous les secteurs du développement : production agricole et animale,maîtrise de l’eau, protection de l’environnement, lutte contre la désertification et les fléaux naturels, nutrition, hygiène et santé, maîtrisede l’accroissement démographique, éducation, conservation, valorisation du patrimoine culturel…Dans tous ces domaines, l’État souhaitait transférer aux producteurs une partie importante de sa capacité d’intervention. Pour cela, il avaitbesoin de concevoir une approche globale de la formation paysanne et d’expérimenter des outils d’information, de communication et deformation efficaces et adaptés aux caractéristiques du monde rural. C’est le mandat qui a été confié au CESPA.42
Radio et télévisionLa vidéo comme outil de communication éducativePour remplir ses missions, le CESPA s’appuie sur une infrastructure technique deproduction audiovisuelle (centre de production de documents vidéo et d’outils decommunication de proximité) et sur une équipe d’agents polyvalentsspécifiquement formés à la production audiovisuelle, à la formation et à l’animationpédagogique.L’originalité de la démarche du CESPA repose sur la capacité de ses « pédagoguesaudiovisuels » à intervenir à tous les stades de la chaîne de conception, productionet diffusion des modules de formation audiovisuelle : diagnostic des problèmesposés, définition de la stratégie de communication éducative en collaboration avecl’ensemble des acteurs concernés, élaboration des scénarios, réalisation desdocuments vidéo, rédaction des documents d’accompagnement, expérimentationdes séances de formation sur le terrain, formation des utilisateurs des modules.Un cadreur du CESPA lors d’un tournage en Une fois le thème défini, l’équipe du CESPA entreprend une enquête auprès desmilieu villageoiscommunautés rurales, des services techniques compétents, des organismes de(Photo: Jacques Sultan)recherche et des centres de documentation existants. Cette enquête permet decerner les différents éléments du problème posé, d’inventorier les connaissances etles pratiques existantes dans le milieu et d’identifier les caractéristiques culturelles, économiques et sociales de la population à former.Sur cette base, l’équipe élabore un « livret » qui représente la synthèse des connaissances paysannes et de celles des techniciens. Laconfrontation de ces deux éléments permet de formuler des objectifs de formation pertinents et d’en structurer le contenu de façonappropriée.Les scénarios des documents audiovisuels de formation sont alors rédigés. Les tournages se font systématiquement en milieu rural, lespaysans étant amenés à jouer eux-mêmes leur propre rôle dans les documents de formation. Après la postproduction, les documents vidéosont testés et, si nécessaire, modifiés.…avec des supports d’accompagnementPour renforcer la production vidéo, des supports complémentaires sont conçus et réalisés :• Le guide du participant : Ce document reprend et résume le contenu des programmes vidéo réalisés sur le thème, avec des illustrationset des textes courts en langues nationales. Ce document est remis aux participants après la formation. Il leur sert d’aide-mémoire et ilpeut aussi être utilisé pour démultiplier la formation auprès de ceux qui ne l’ont pas suivie ;43
• Le guide du formateur : Ce document rappelle les objectifs de la séance de formation, indique les principales étapes à suivre et orientele formateur dans le processus d’apprentissage : test initial, discussions après les projections, travaux pratiques d’application etévaluation finale.D’autres supports audiovisuels alternatifs sont également élaborés :• Une cassette audio qui reprend les principaux éléments de l’apprentissage sous forme d’éléments sonores. La cassette est remise auxparticipants après la formation. Elle en constitue la mémoire sonore ;Les révolutions de l’information• Une boîte à images qui synthétise avec une série d’images fixes de grand format les principaux éléments du contenu de la formation. Laboîte à images peut être utilisée comme support alternatif de la formation si la vidéo n’est pas disponible ;• Des affiches ou tableaux d’images, qui représentent des éléments visuels de sensibilisation et de discussion sur le thème et qui peuventégalement être utilisés en complément des boîtes à images si la vidéo ne peut pas être diffusée.Un deuxième test permet de validerl’ensemble du « paquet pédagogique deformation paysanne ».Les formations se déroulent exclusivementen milieu villageois, avec un calendrier, deshoraires, des modalités et une duréenégociés avec les communautés. Elless’organisent en plusieurs sessions pourpermettre à l’ensemble des villageoisintéressés d’y participer (hommes, femmes,enfants…), ce qui peut conduire leséquipes à séjourner plusieurs jours dans lemême village. Chaque formation estprécédée par un exercice de pré-évaluationqui permet au formateur de mesurer leniveau initial de connaissances desparticipants, en présence d’un technicienspécialiste du sujet traité.Une formation à la production audiovisuelle destinée aux villageois(Photo : CESPA)La formation se déroule en plusieursphases, alternant la projection des différents modules vidéo, des discussions avec le groupe et des exercices pratiques d’application desconnaissances apportées. Une évaluation finale permet de mesurer les apprentissages.44
Radio et télévisionDes productions diversifiéesLe CESPA a ainsi produit et expérimenté toute une série de « paquets pédagogiques de formation paysanne » sur une grande variété dethèmes : hygiène de l’eau, riziculture, fabrication du compost, maraîchage, arboriculture fruitière, pisciculture, lutte anti-érosive,production et conservation des semences, techniques de fixation des dunes, santé, nutrition, prévention du sida, épargne et crédit,techniques bancaires, code électoral…Ces productions sont réalisées en collaboration avec divers partenaires et institutions engagés dans le développement rural. Elles sonttestées sur le terrain, en grandeur réelle et sont ensuite confiées à des équipes de formateurs et d’animateurs, qui en assurent la diffusionen milieu rural, avec des équipements de projection vidéo mobiles disposant d’une alimentation autonome par batteries.Au-delà de ces productions éducatives, le CESPA réalise également, dans ses studios, des productions vidéo institutionnelles, des filmsdocumentaires, des spots publicitaires et des documents de fiction à la demande de partenaires extérieurs. Il produit aussi des programmesd’intérêt général en collaboration avec la télévision nationale.Une mission de service public, un contrat-plan avec l’ÉtatDepuis 1992, les partenaires de coopération ont progressivement réduit leur soutien technique et financier. Le CESPA, devenu unétablissement public à caractère industriel et commercial, a désormais acquis son autonomie financière et il génère les ressourcesnécessaires à son fonctionnement.Mais sa mission de service public dans le domaine de la communication pour le développement reste l’objectif prioritaire et cette missionn’est pas toujours compatible avec les contraintes de la rentabilité financière. L’État malien a donc conclu avec le CESPA, à la fin de l’année1999, un contrat-plan qui précise son rôle et ses attributions. Le CESPA a notamment la mission de coordonner les activités decommunication et de production audiovisuelle éducative, pour l’ensemble des partenaires publics du développement, particulièrementdans les secteurs du développement rural, de l’environnement, de la santé et de l’éducation.…et la recherche de partenariats avec les organisations paysannesAu-delà de cette mission de service public et de ce positionnement institutionnel de coordonnateur des activités de communication pourle développement, les responsables du CESPA savent qu’ils ne réussiront pleinement leur mission que s’ils parviennent à y associerdirectement les paysans.« Aujourd’hui, la mise en place de la politique de décentralisation crée une dynamique favorable aux initiatives locales, gérées par lesassociations villageoises, les organisations de producteurs, les collectivités territoriales décentralisées, les ONG », souligne Cheikna Diarra.« La télévision est encore peu diffusée en zones rurales et les communautés villageoises sont très demandeuses d’images et de documents45
audiovisuels. Les seules réponses qui leur sont actuellement proposées proviennent des projecteurs ambulants qui diffusent des cassettesde films pornographiques ou violents. Pour lutter contre ce phénomène et apporter une alternative plus conforme aux traditions rurales,le CESPA a le projet d’appuyer la mise en place, dans les villages, de centres communautaires d’animation socioculturelle équipés dedispositifs de projection vidéo ».Les révolutions de l’informationCe projet est entrepris en association avec des organisations paysannes et un réseau communautaire d’épargne et de crédit rural. Lescentres d’animation pourraient être gérés par les associations villageoises elles-mêmes. Les équipements vidéo des centres de projectionseraient financés par les prêts fournis par les caisses de crédit rural et la programmation des activités des centres serait faite à partir desproductions éducatives, culturelles ou distractives provenant du CESPA ou d’autres sources de programmes.Les radios de proximité de chaque zone pourraient être également associées au dispositif, en programmant sur leurs antennes desémissions consacrées aux mêmes thèmes que ceux qui sont diffusés par les centres de projection. Elles seraient chargées par ailleursd’organiser des émissions publiques villageoises sur ces thèmes pour recueillir les réactions et les propositions des villageois.Dans chaque village équipé, des animateurs communautaires seraient formés pour assurer le fonctionnement du centre, la programmationde ses activités et l’animation des séances de diffusion des programmes éducatifs.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESCentre de services de production audiovisuelle (CESPA), BP 1820, Bamako (Mali). Tél. (223) 22 04 50 ; fax (223) 22 80 70 ;e-mail cespa@datatech.toolnet.org46
Presse rurale : La Voix du Paysan, une tribune pour le monde ruralL’information face aux enjeux de la mondialisation : une question de survieQuand les paysannes africaines communiquent : sortir de la marginalitéRendre compte des questions environnementales en Afrique de l’Ouest : Panos, l’environnement et la démocratiePrivatisation des agences de presse : PANA, une agence de presse pour l’AfriqueJournaux et bulletins
Contrairement aux images éphémères de la télévision et aux sons fugitifs de la radio, lesdocuments imprimés laissent une trace plus durable. Même s’il n’est pas du jour, les lecteursouvriront toujours le journal, surtout quand ils n’ont pas d’autres sources d’information crédible.Les journaux (et les documents imprimés en général) sont confrontés depuis longtemps à undouble problème, dans les zones rurales : logistique et financier. Comment faire parvenir cespublications jusqu’à des villages si nombreux et si dispersés, alors que les systèmes dedistribution sont pratiquement inexistants dans le monde rural ? Et comment couvrir les coûts deproduction, d’impression et de distribution de ces publications ? Les paysans ne pourraient paspayer le coût de revient réel de ces documents. De plus, les annonceurs, qui apportent une partimportante des budgets des journaux et des revues dans les villes, ne considèrent pas les journauxruraux comme des supports intéressants car les paysans n’ont pas un pouvoir d’achat suffisant.Les révolutions de l’informationMalgré ces problèmes, les journaux et bulletins se développent dans les zones rurales.L’alphabétisation et les routes y sont pour quelque chose, de même que les partenaires de coopérationqui prennent en charge une part non négligeable des coûts de production et de distribution.Les journaux et les bulletins se développent dans des conditions et à des échelles très variables.D’un côté, des journaux à vocation nationale, qui disposent de systèmes sophistiqués de recueil del’information, sont abonnés aux grandes agences de presse et ont mis en place des circuits dedistribution. De l’autre, des bulletins locaux avec des tirages confidentiels et des lectorats trèsspécifiques. Malgré leurs différences, les gros quotidiens et les petits périodiques partagent descaractéristiques communes : ils ont besoin de sources d’information, d’une équipe de rédaction,d’un circuit de distribution …et de lecteurs. Et le pouvoir du journal se mesure toujours à l’aulne dumaillon le plus faible de cette chaîne. Comme la radio et la télévision, les journaux véhiculent unegrande diversité de thèmes : informations générales, faits divers, divertissement, culture. Pour leslecteurs ruraux (et pour les organismes de recherche et de vulgarisation engagés dans ledéveloppement), il est essentiel qu’ils contiennent aussi des rubriques consacrées à l’agriculture,à l’élevage et à l’environnement.Cela dit, force est de constater que les journaux sont des médias inexplicablement négligés par lesinstitutions de développement. Elles préfèrent éditer des livrets et des brochures (qu’elles ontégalement du mal à distribuer) et n’utilisent que très peu ce support, qui est pourtant ouvert tous lesmatins par de très nombreuses personnes : le journal. Les journaux ont pourtant beaucoup d’atouts :les lecteurs sont nombreux et avides d’information, les informations sont régulièrement actualisées,elles ont une forte crédibilité, chaque exemplaire d’un journal est généralement lu par plusieurspersonnes, etc. Et une fois que l’article a été rédigé, les agences de développement n’ont plus à sepréoccuper de sa diffusion : les services de commercialisation des journaux s’en occupent.N’est-il pas temps, pour les agences de développement, de s’intéresser aux potentialités offertespar la presse écrite ?48
Journaux et bulletinsPresse ruraleLa Voix du Paysan, une tribune pour le monde ruralPascal AiraultPrès de 25 000 numéros tirés chaque mois, trois éditions en français, anglais et arabe, une diffusion sous-régionale, le journal La Voix duPaysan est, sans nul doute, l’expérience de presse écrite agricole la plus accomplie d’Afrique francophone. En témoignent les cahiersspéciaux et les produits annexes générés par le journal et la sollicitation de ses responsables pour étendre l’expérience aux pays frontaliers.Qu’est-ce qui explique une telle réussite ?L’idée de créer un journal d’information à destination du monde rural a germé lors d’un voyage d’étude de paysans camerounais au BurkinaFaso en 1987. Les responsables de cette mission désiraient faire partager l’expérience des agriculteurs avec leurs confrères qui n’avaient paseu la chance d’effectuer le déplacement. Un bulletin d’information a donc été réalisé pour rendre compte de ce voyage d’étude. Devant lesuccès de cette première initiative et l’engouement des paysans à débattre et à participer à la production, l’entreprise a perduré, d’abordsous la forme d’un bulletin de liaison, puis par l’élaboration d’un véritable mensuel d’information à partir de 1991. La Voix du Paysan venaitde naître.Mensuel d’information, de formation et de débats, comme le souligne le sous-titre du journal, La Voix du Paysan est une véritable tribunedu monde rural, notamment à travers les trois ou quatre pages consacrées aux courriers des lecteurs. Il permet aussi aux techniciens, auxchercheurs et aux agents de vulgarisation de transmettre desconnaissances à travers les fiches techniques et les articles à caractèrescientifique sur les pratiques culturales, la protection des plantes contreles mauvaises herbes et les ravageurs ainsi que les conseils sur lesprocédés de stockage et les circuits de commercialisation des produits.« La collaboration des experts agricoles est très importante mais tous lesarticles sont retravaillés par des journalistes qui vulgarisent lesinformations techniques afin qu’elles soient accessibles par les paysans.Par exemple, les noms de plantes ou de maladies sont traduites dans leslangues locales », explique Martin Nzegang, rédacteur en chef du journal.Les journalistes de La Voix du Paysan travaillent au prochainnuméro du journal dans les bureaux de Douala (Cameroun)(Photo : Pascal Airault)49
Bernard Njonga, directeur de publication deLa Voix du Paysan, dans les bureaux de larédaction du journal à Douala (Cameroun)(Photo : Pascal Airault)Les révolutions de l’informationPrendre le pouls du paysLa Voix du Paysan sort de chez l’imprimeur le premier lundi de chaque mois. La direction du journal organise dans la foulée une conférencede rédaction au cours de laquelle sont programmées les missions de terrain des journalistes. Elles dureront d’une à deux semaines.Les reporters quittent Yaoundé par les transports en commun en direction des différentes régions du pays : forestière, côtière, sahélienneet hauts-plateaux.Cette descente au cœur des provinces leur permet de prendre le pouls du pays et de recueillir les doléances des villageois. « Très souvent,les journalistes se rendent en reportage sans thème préétabli et sans itinéraire précis. Ce sont leurs discussions avec les populations qui leurpermettent de cerner les sujets sur lesquels ils vont enquêter », explique Bernard Njonga, directeur de publication du journal.Les axes d’équilibrage du journalLa réalisation de chaque numéro du journal respecte néanmoins plusieurs axes d’équilibrage. Le premier concerne l’importance de la parolepaysanne dans le numéro à paraître : est-elle suffisante ?La répartition de la couverture de l’information au niveau des régions est également un souci majeur : est-ce que le lectorat de chaquegrande zone se retrouve dans le journal ? En effet, le paysan du Nord, en région cotonnière, n’a pas les mêmes préoccupations que celuidu Sud (zone des grandes cultures) ou que celui vivant en périphérie des agglomérations qui réalise une agriculture périurbaine.La direction de La Voix du Paysan décide donc quelquefois de réaliser deux « à la une » pour certains numéros afin de satisfaire les attentesd’un lectorat hétérogène. Par ailleurs, un cahier régional consacré aux cultures forestières (café, cacao…) est souvent incorporé dans lesexemplaires distribués dans les zones humides, du littoral jusqu’au Gabon. Un cahier « sahélien » est également inséré pour les populationsdu Nord du pays et du Sud tchadien.Le troisième axe d’équilibrage est relatif au contenu des rubriques. Les informations du mois doivent se répartir de manière assez équitableentre les articles d’information générale, de formation et de réflexion.50
Journaux et bulletinsEn outre, le journal doit être suffisamment illustré (en assurant un bon équilibre entre photos et dessins) pour satisfaire les différents goûtsdu lectorat.Enfin, la rédaction fait aussi le compterendu des manifestations officielles et traite de l’actualité juridique et économique qui interfère dansla vie des agriculteurs.Au retour de leurs missions, les journalistes sont conviés à une deuxième conférence de rédaction au cours de laquelle ils relatent leurspériples, les problèmes dont ils ont pris connaissance, les initiatives paysannes qu’ils ont découvertes et les témoignages qu’ils ont recueillis.L’équipe discute et entérine les sujets. « Si on constate qu’un axe d’équilibrage n’a pas été respecté, des missions complémentaires derecueil d’information peuvent être demandées pour finaliser le reportage ou le dossier », explique Martin Nzegang.Cette deuxième conférence de presse sert également à faire l’évaluation du journal surle terrain. Les journalistes ont pu apprécier l’impact du dernier numéro et font part deleurs commentaires au cours de cette rencontre avec la direction et leurs confrères.Ensuite, l’équipe se met à la rédaction des différents articles.Le courrier des lecteursOutre les missions de recueil d’information, la principale source d’inspiration du journalréside dans le courrier des lecteurs. Les demandes qui y sont exprimées interviennentdirectement dans l’élaboration des sujets et leur réalisation. Bernard Njonga se chargelui-même d’ouvrir les lettres provenant des quatre coins du pays. « Les lecteursévoquent leurs problèmes et posent des questions. La rédaction prend en compte leurconsidération et conçoit des réponses à travers différents outils », explique-t-il.Ils trouvent une première réponse à leurs questions dans la rubrique du courrier deslecteurs. Mais, la rédaction ne s’arrête pas à cette étape. Elle peut mener une enquêtes’il s’agit d’un problème juridique ou administratif. La réponse à une question techniquepeut également faire l’objet d’une fiche d’information sur un produit ou un procédé.Des lecteurs de La Voix du Paysan lors d’une pauseau travail(Photo : Pascal Airault)Pour répondre aux différentes demandes, La Voix du Paysan a également développé de nouveaux canaux de diffusion de l’information :deux recueils de fiches techniques ont été réalisés et tirés à environ 20 000 exemplaires ; des bandes dessinées ont, par ailleurs, été publiées(environ 5 000 épreuves) sur plusieurs cultures (café, cacao, tomate, palmier à huile, pastèque, etc.). « C’est un moyen de diffuser del’information technique par un canal ludique », souligne Bernard Njonga.Enfin, des journées d’information thématiques sont organisées par le centre de documentation du SAILD (Service d’appui aux initiativeslocales de développement), l’ONG qui sert de structure au journal. La dernière manifestation a porté sur la culture du champignon.51
L’identification des thèmes est réalisée avec les agriculteurs et les techniciens agricoles. Un public cible est constitué et convié à cettemanifestation.Plusieurs sources de financementLes révolutions de l’informationLe coût de production au numéro s’élève en moyenne à 610 francs CFA (0,93 e). Il comprend les salaires, les frais de reportages(déplacement, logement, alimentation, etc.), les frais généraux, les charges de personnel et les coûts d’impression. Les charges dedistribution représentent environ 80 FCFA (0,12 e) par numéro, soit un coût de revient total de 690 F CFA (1,05 e). Rappelons que le prixde vente en kiosque est de 300 F CFA l’exemplaire (0,46 e), ce qui représente moins de la moitié du coût de revient du journal.Le prix des abonnements est de 2 000 F CFA ou 3 000 F CFA (3,05 à 4,57 e) pour 12 numéros, selon le taux d’alphabétisation et lesconditions économiques de la zone : le tarif est par exemple au plus bas dans la région sahélienne où les conditions de vie sont les plusdifficiles.Le taux d’autofinancement du journal varie entre 25 % et 50 % selon les périodes. La publicité des annonceurs et les produits connexes(casquettes, tee-shirts, bandes dessinées, publi-reportages) complètent les ressources de la publication mais ce sont les subventions despartenaires qui permettent d’équilibrer le budget du journal. Rappelons quela coopération suisse (DDC, Direction du développement et de lacoopération), l’Union européenne et les ONG belge SOS faim et allemandeEZE apportent régulièrement un concours à La Voix du Paysan. Lapublication a, en outre, bénéficié en 1999 du fonds d’appui à la pressefrancophone du Sud de l’Agence de la francophonie pour 9 millions de F CFA(13 720 e).Concernant les annonceurs, « la pression des paysans est importante pourque l’espace du journal ne soit pas envahi par la publicité. Les bailleurs defonds ne voient pas, non plus, d’un très bon œil ce mode de financement.L’espace qui lui est réservé reste donc modeste », déclare Bernard Njonga. Parailleurs, seules les annonces concernant l’agriculture sont diffusées. « Devantle succès de notre journal, certains hommes politiques ont essayé d’acheterdes pages afin de diffuser des messages à caractère politique mais nous avonstoujours refusé ce type de ressource », explique Bernard Njonga qui souligneque La Voix du Paysan se veut apolitique et non tribal.La ligne éditoriale est néanmoins fortement engagée. En témoigne ce titred’article récent : « Importation des denrées alimentaires : une catastropheEn 1999, le prix du meilleur journal du Cameroun a étédécerné à La Voix du Paysan(Photo : Pascal Airault)52
Journaux et bulletinspour les paysans ? » ou cette lettre de doléances des paysans de Santchou adressée au Chef de la nation, Paul Biya et publiée par la rédaction.Retour sur les faits : en octobre 1997, les pouvoirs publics ont dissout la Soderim, une société de développement nationalisée de riziculturedans la région de Santchou. L’État voulait liquider la société d’un seul bloc mais les paysans désiraient acquérir les outils de production. Àla suite du passage de la lettre de doléances des agriculteurs de la région, les pouvoirs publics ont fait machine arrière et ont permis auxexploitants agricoles d’acheter le petit matériel agricole à l’occasion d’une vente aux enchères.La volonté de sensibiliser les décideurs est manifeste : « Aujourd’hui, la cible du journal n’est plus exclusivement paysanne. Partant duconstat que les décisions qui influencent la vie dans le monde rural sont prises en ville, le journal s’est ouvert aux citadins pour créer uncourant d’échanges dont nous espérons qu’il permettra de sensibiliser les décideurs », explique Bernard Njonga qui considère, en outre,que le manque d’information des décideurs sur ce qui se passe dans les campagnes est un frein important au développement.L’implantation progresse dans la sous-régionLe tirage actuel du journal est de 30 000 exemplaires, dont 20 000 pour la version française du Cameroun et 4 000 pour celle en anglais. Lesversions française et arabe tchadien destinées au Tchad sont tirées respectivement à 4 000 et 2 000 exemplaires : « notre objectif est deréaliser un tirage entre 100 000 et 150 000 exemplaires au Cameroun et au Tchad d’ici trois ans. Ce but est largement réalisable car nousestimons que le lectorat potentiel, rien qu’au Cameroun, s’élève à 2,5 millions de personnes », estiment les responsables du journal.Par ailleurs, une demande pressante se manifeste pour créer une édition en Centrafrique, au Gabon et au Congo Brazzaville. Certaines ONGont demandé la permission de diffuser le journal dans les pays limitrophes. Ainsi, 75 numéros sont envoyés chaque mois en Centrafrique,150 au Gabon et 50 au Congo.Les efforts de l’équipe du journal ont été récemment récompensés : le dernier sujet de l’examen probatoire (entre le BEPC et lebaccalauréat) a été tiré d’un article du mensuel concernant la production et la commercialisation du cacao.En fin d’année 1999, La Voix du Paysan a reçu, par ailleurs, la reconnaissance de ses pairs en étant désigné meilleur journal de l’année 1999par l’Association des journalistes de la presse écrite du Cameroun, à l’occasion de son assemblée générale de décembre à Douala.Le casse-tête de la diffusion du journalDiffuser un journal en milieu rural en Afrique s’apparente pour bien des éditeurs à un problème sans solution. Les messageries de presseprivées ne distribuent que dans les grandes villes, les voies de communication en milieu rural sont souvent chaotiques et les services postauxsont loin de donner satisfaction en terme de délais et de sécurité des envois. Fort de ce constat, qui s’applique au paysage camerounais, lesresponsables de La Voix du Paysan ont développé plusieurs stratégies.Le journal a d’abord été distribué par Messapresse, une structure privée qui organise la diffusion de tous les journaux au niveau dupays : « cette première expérience fut un échec car cette structure ne livre les publications que dans les grandes villes alors que la vocation53
de notre journal est de parvenir en milieu rural. D’autre part, cette société ne transmet aucune information sur l’évolution et les habitudesdu lectorat », souligne Bernard Njonga.Les responsables ont donc essayé de créer leur propre réseau de distribution en s’appuyant sur des correspondants identifiés en milieu ruralqui participaient à la production et à la diffusion du journal. Mais, ces deux métiers sont différents et les résultats n’ont pas été probants.Les révolutions de l’informationIls ont alors changé une nouvelle fois leur fusil d’épaule et ont décidé de professionnaliser la diffusion. Des diffuseurs ont été forméscommercialement dans les différentes régions du pays. Ils avaient vocation à distribuer tous les journaux de la place. Cette expérience s’estégalement traduite par un échec car les diffuseurs ont constaté que la commercialisation en milieu rural n’était pas assez rentable.Une nouvelle stratégie : passer par les écolesEn 1999, les responsables ont mis au point une nouvelle stratégie pour pénétrer le lectorat rural. Une cinquantaine d’écoles primaires ontété sélectionnées à travers le pays. La Voix du Paysan a signé un contrat d’éducation avec les directeurs de ces établissements. Par cetaccord, les écoles reçoivent chaque numéro du journal en plusieurs exemplaires. En contrepartie, les directeurs mettent en place des sallesou des temps de lecture de La Voix du Paysan durant les cours de la semaine. « Notre objectif est d’intéresser les jeunes au développementrural, les habituer à lire et les utiliser comme canaux pour toucher leurs parents », indique Bernard Njonga. Les premières retombées decette expérience montrent que le lectorat du journal a progressé dans les zones où a été instauré un partenariat au niveau scolaire.Parallèlement, les responsables de la publication ont passé des contrats de performance basés sur le rendement avec des diffuseurs danschacune des 17 zones de distribution du pays. Ces diffuseurs ont pour obligation de créer des kiosques dans chaque arrondissement deleur zone de travail. Ils ont des objectifs à réaliser et sont rémunérés en conséquence. Les journaux sont acheminés dans les kiosques partous les moyens (cars, taxi-brousse, motos, etc.), le seul objectif étant que le journal parvienne dans les lieux les plus enclavés. Le délaimaximum, de la sortie de la publication chez l’imprimeur jusqu’à son acheminement en brousse est de quinze jours. Dans les kiosques desgrandes villes, le journal est disponible en un ou deux jours. « Toutefois, les premiers servis sont les abonnés. Ils ne doivent pas apercevoirleur journal dans un point de vente avant qu’il ne soit parvenu à leur domicile », conclut Bernard Njonga.Répondre aux besoins des agriculteursEn mai 1999, les services des impôts ont décidé de mettre sous scellés l’usine de fabrication de provende de la société coopérative desaviculteurs de l’Ouest (Socao) à Bafoussam provoquant le jeûne forcé de 100 000 poules. Alerté par les coopérateurs, La Voix du Paysan amené son enquête et a démontré, preuve à l’appui, que les fonctionnaires de l’État demandaient aux coopérateurs un impôt abusif car laloi de finances n’en prévoyait pas pour les structures coopératives : « nous avons réalisé un reportage qui a fait disparaître le responsabledes finances de Bafoussam pendant un mois », explique Bernard Njonga, en arborant un large sourire. La provenderie a finalement étérouverte et les ministres de l’agriculture et des finances ont reçu les coopérateurs et reconnu la faute de leurs subordonnés.54
Journaux et bulletinsLa rédaction sensibilise aussi les pouvoirs sur les problèmes de flux de marchandises au niveau mondial et de sécurité alimentaire. Ainsi,lors de la crise de la dioxine en mars 99, La Voix du Paysan a publié un article sur le danger des produits congelés importés d’Europe. Lesdéputés ont sorti l’exemplaire du journal en session parlementaire et contraint le ministre de l’élevage à prendre des mesures adéquates.Journaliste à La Voix du Paysan, un mode de vieAujourd’hui, la rédaction est composée de 12 journalistes (quatre pour la version anglaise, quatre pour la version française du Cameroun,deux pour la version française tchadienne et deux pour celle en arabe). L’équipe compte également deux agents administratifs, untraducteur français-anglais, un chroniqueur pour la rubrique santé, trois personnes chargées de la diffusion, un coordonnateur desrédactions et un directeur de publication.Les pressions économiques qui pèsent sur les journaux confinent de plus en plus les journalistes à un travail de compilation d’information,de recherche sur l’Internet et de recueil d’information téléphonique. À La Voix du Paysan, rien de cela, les journalistes exercent leurspassions et reviennent à l’essence même de ce métier : faire du terrain pour recueillir des témoignages, donner des explications et ouvrirle débat.« Le matin, nous savons rarement où nous allons dormir le soir », dit Jean Armstrong, reporter à La Voix du Paysan. « Tu peux circuler enmoto, en taxi, à l’arrière d’un pick-up, peu importe, tu montes dans le moyen de transport qui te permet d’arriver à destination ».« Il m’est déjà arrivé de voyager dans la malle d’une voiture », ajoute Martin Nzegang.La vie du journaliste à La Voix du Paysan n’est donc pas de tout repos mais ce qui compte c’est la satisfaction tirée de l’expérience. « Malgréles fatigues du voyage, le soir, quand tu te retrouves en milieu rural ou en forêt, tu puises ton oxygène, c’est comme une renaissance »,souligne Jean Armstrong. « La discussion se poursuit tard dans la soirée, au coin du feu, avec les villageois et le lendemain tu repars pleind’images dans la tête ».Ce mode de production « in situ » implique une entière disponibilité de l’équipe. « Nous ne faisons pas de différence entre un dimanche etun lundi », témoigne Jean Armstrong. « Être journaliste à La Voix du Paysan, c’est un mode de vie ».« Plusieurs personnes se sont essayées à la rédaction mais elles ont compris que ce n’était pas leur voie. Certains journalistes peu scrupuleuxont également tenté d’imposer maladroitement des sujets ou des articles pour lesquels ils devaient se faire rémunérer. Nous les avons vitedécouverts et renvoyés », ajoute Bernard Njonga.55
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESLa Voix du Paysan, Bernard Njonga, Directeur (ou Martin Nzegang, Coordonnateur des rédactions), BP 11955, Yaoundé (Cameroun).Tél. (237) 22 46 82 ; fax (237) 22 51 62Les revolutions de l’information56
Journaux et bulletinsL’information, face aux enjeux de la mondialisationUne question de survieJacques SultanLa libéralisation des principales filières agricoles conduit à des changements profonds dans la vie des paysans de Côte d’Ivoire et dans leurfaçon de travailler. Les mécanismes de stabilisation des prix garantis par l’État seront bientôt un souvenir. Les producteurs devront vendreeux-mêmes leur cacao, leur café et leur riz dans un marché ouvert et compétitif. Ils devront également développer leurs propres circuitspour se procurer leurs semences, engrais et autres intrants sur le même marché et gérer eux-mêmes le stockage et le transport de leursproductions. La recherche et la vulgarisation sont également sur le chemin de la privatisation.Les producteurs ruraux, qui représentent la moitié de la population du pays, n’ont pas été préparés à ces changements. L’ANOPACI(Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d’Ivoire), structure faîtière qui regroupe les principalesorganisations paysannes dans toutes les filières de production, s’est donné comme objectif d’accompagner les paysans dans ces mutations.« Pour aider les producteurs à faire face à ces nouveaux défis », dit Sylvain Kouao, le responsable de la commission communication del’ANOPACI, nous avons compris que l’information et la communication sont des facteurs déterminants. Actuellement, dans notre plateformestratégique et dans notre plan d’action, nous sommes particulièrement attentifs à tout ce qui peut renforcer les capacités denégociation des producteurs, car nos adhérents doivent faire face à des situations nouvelles et mener des négociations difficiles avec tousles acteurs des filières. »« Qu’ils soient producteurs de coton, de café, de cacao, d’hévéa ou de produits vivriers, il leur est indispensable de disposer rapidement etrégulièrement d’informations sur les prix, sur l’évolution des filières, sur l’état des marchés, sur ce que font les autres. C’est une questionde survie… ».C’est cette réalité qui a conduit les responsables de l’ANOPACI à mettre en place un dispositif de communication capable de remplir troisfonctions principales :• Apporter aux responsables des organisations professionnelles de producteurs (groupements, union, coopératives…) des informationséconomiques, techniques et financières qui renforcent leurs capacités de négociation ;• Assurer une circulation de l’information entre les organisations de producteurs, les filières et les régions du pays ;• Faire connaître les positions de l’ANOPACI dans ses négociations avec l’État et les autres partenaires du secteur agricole sur lesprincipaux enjeux du développement agricole et notamment sur les questions foncières, le financement des activités agricoles, laformation, la recherche, l’organisation des marchés et des prix.57
Les révolutions de l’information58Devant les bureaux de l’ANOPACI à Abidjan(Côte d’Ivoire)(Photo : Jacques Sultan)Un journal pour les professionnels de l’agricultureLe Professionnel Agricole est le principal outil de communication de l’ANOPACI. Il a vu le jour au début de 1999. C’est un bulletin mensuel,de 24 pages, tiré à 5 000 exemplaires, avec le soutien de la coopération française.Il est publié en français car il est essentiellement destiné aux responsables des organisations professionnelles agricoles, généralementfrancophones, qui en assurent la distribution dans chacune des organisations.« Au début, nous avons principalement axé la ligne éditoriale sur des dossiers d’information générale, sur la présentation des structures etdes activités de l’ANOPACI, sur les nouvelles concernant l’état et l’évolution des différentes filières » dit Marie Josée Tafforeau, journalistechargée de coordonner la rédaction du journal. « Dans chaque numéro, nous mettions également en valeur une expérience, uneorganisation ou un « homme du mois ».« Ensuite nous nous sommes orientés vers des numéros spéciaux consacrés aux principales filières : café, cacao, hévéa, élevage, crédits,vivriers… pour traiter plus en profondeur, sur les plans technique et économique, les informations sur ces filières, à partir de la matièrepremière que nous collections auprès des organisations de terrain dans les différentes régions du pays. »Que dois-je faire pour installer un élevage de porcs ?« Mais très rapidement », ajoute Marie-Josée Tafforeau, « nous nous sommes trouvés confrontés à une forte demande de nos lecteurs quivoulaient des informations techniques sur toutes sortes de sujets : comment planter des caféiers, soigner un animal, utiliser les pesticides,installer un élevage de porcs, établir un compte d’exploitation ? Est-ce que la culture du tabac est plus rentable que celle du riz ? Commentlutter contre les maladies du maïs ? Comment constituer un dossier de crédit ? »Cet énorme besoin d’informations techniques et de conseils pratiques est évidemment lié au fait que les producteurs n’ont accès à aucunesource d’information pertinente et qu’ils ne trouvent pas de réponses à leurs questions auprès des services de l’État, de moins en moinsprésents sur le terrain.
Journaux et bulletinsLe Professionnel Agricole a donc dû s’adapter à cette demande et il s’est rapidement enrichi de fiches techniques concrètes, simples etillustrées pour que les lecteurs puissent les exploiter directement dans leurs activités.Ces fiches techniques sont très appréciées par les lecteurs. Pour une utilisation plus fonctionnelle, le bulletin envisage de les publier sousforme de fiches détachables et d’en faire, par la suite, des collections qui pourraient être éditées à part et commercialisées.Les pages consacrées au courrier des lecteurs et aux indicateurs économiques du mois ont également été enriches, au fil des numéros, pourrendre compte des réactions et du besoin d’expression des lecteurs et les tenir informés de l’évolution des marchés dans les principalesfilières de production.L’obstacle de la distribution« Aujourd’hui, nous avons gagné la première partie de notre pari », dit Séraphin Biatchon, le secrétaire général de l’ANOPACI. « En moinsd’un an, le journal a été lancé, il commence à gagner en crédibilité, les articles sont de plus en plus approfondis. Le courrier que nousrecevons de nos lecteurs nous encourage car ils nous disent que le journal est bien écrit et qu’il reflète fidèlement les préoccupations dumonde agricole ivoirien…. Mais nous ne devons pas nous endormir sur ces lauriers car il nous reste des obstacles importants à franchir… »Il y a d’abord la distribution. Elle est principalement assurée par les onze organisations membres de l’ANOPACI, mais les recettescorrespondantes ne remontent pas vers le journal, ce qui tend à indiquer qu’il n’est pas aussi bien distribué qu’il le devrait.« Si nous étions mieux distribués », ajoute Séraphin Biatchon, « nous pourrions tirer à 50 000 exemplaires : rien que dans le secteur du caféet du cacao, ce sont 500 000 personnes qui sont concernées, 200 000 dans le secteur cotonnier, 25 000 pour le palmier à huile, etc. Nousdevrions être le premier mensuel de Côte d’Ivoire ».Tous ces producteurs sont en effet des lecteurs potentiels du journal, directement ou indirectement, car il existe dans chaque village despersonnes francophones et lettrées capables de donner les informations et lire les articles pour les non francophones. Mais comment lesatteindre efficacement ? Des points de vente sont progressivement mis en place, à Abidjan et dans les principaux centres régionaux. Lesstructures du ministère de l’agriculture sur le terrain sont également des distributeurs potentiels, de même que certains opérateurséconomiques comme la société Nestlé, avec qui un accord a été conclu pour assurer la distribution du journal auprès des planteurs de caféet de cacao dans ses magasins et centres d’achat. En 2000, l’amélioration de la distribution sera le chantier principal de l’équipe du journal.Autonomie financièreElle sera plus difficile à atteindre. Actuellement, chaque numéro revient à 3 millions de F CFA (environ 4 600 e) ; seulement 20 % de cemontant est récupéré en recettes liées à la vente des journaux et à la publicité. Le journal est pour le moment subventionné par sonpartenaire de coopération mais ses promoteurs souhaitent s’émanciper de ce soutien pour garantir leur durabilité et leur autonomie.59
Pour cela, plusieurs mesures vont être prises : passer à un rythme bimestriel, attirer davantage d’annonceurs pour augmenter le prix devente du journal : passer de 300 à 500 F CFA (de 0,45 à 0, 70 e), améliorer la distribution et la vente et enfin, éditer et commercialiser lesfiches techniques paraissant dans le journal.Recueil de l’informationLa remontée de l’information provenant du terrain est encore peu satisfaisante.Les révolutions de l’information« C’est une question de motivation des organisations membres de notre association », dit Sylvain Kouao. « Il faut favoriser un circuit fluideet informel de remontée de l’information car nous n’avons qu’un seul journaliste et nous ne pouvons pas, pour le moment, nous offrir unréseau de correspondants sur le terrain.« Par exemple, en ce moment, les fêtes de la fin du ramadan s’approchent. Je viens d’apprendre que le mouton que j’aurais vendu hierà 20 000 F (30 e) en vaut maintenant 26 000 (39 e). C’est une information intéressante pour tous ceux qui élèvent des moutons.« Il faut que les responsables des organisations paysannes membres de l’ANOPACI se mobilisent davantage pour récolter l’informationauprès de leurs adhérents, au niveau local, et acquièrent le réflexe de transmettre rapidement les informations intéressantes, même de façoninformelle et de prendre systématiquement des photos. C’est une culture à acquérir… »Mettre en relation l’offre et la demande« Les producteurs ont besoin d’informations spécifiques et rapides », dit Séraphin Biatchon ; « dans l’est de la Côte d’Ivoire, ils peuvent êtreen train de crouler sous des tonnes de régimes de bananes, alors que dans le sud la récolte n’a pas été bonne pour des raisons de pluies.On doit pouvoir mettre en rapport cette demande avec cette offre. Le producteur qui a 1 000 tonnes d’ignames dans son champ a besoinde trouver rapidement une solution pour les évacuer et les vendre. Il a aussi besoin d’être mis en rapport avec d’autres acteurs de la filière.« Pour trouver des solutions à cela », ajoute Séraphin Biatchon, « il faut aller au-delà du journal lui-même et trouver des formescomplémentaires de communication, à travers une collaboration avec les radios ou les nouvelles technologies… »Pour vivre de votre production, vous avez besoin d’information« Le producteur de café qui a une tonne de son produit à vendre doit savoir combien le café vaut à Abidjan et quelle est la tendance ducours pour décider s’il doit vendre ou attendre », dit Sylvain Kouao. « Et le même producteur doit avoir la possibilité de mettre enconcurrence les producteurs de fertilisants pour obtenir le meilleur prix ou la meilleure qualité. Les éleveurs doivent pouvoir trouver uneliste de transformateurs locaux, de transporteurs, de fournisseurs d’emballages. C’est particulièrement important dans des filières commele porc où la concurrence est rude avec des produits subventionnés provenant de l’Union européenne ». « Aujourd’hui, pour vivre de saproduction, pour en faire un vrai métier, il faut avoir accès à l’information ».60
Journaux et bulletinsInternet à la ferme ?« L’information du Professionnel Agricole est ciblée », dit Séraphin Biatchon, « mais elle n’est pas rapide. Elle est donnée tous les mois. Sij’ai besoin d’une information pour demain, ce n’est pas dans le Professionnel que je vais la trouver. Il faut des circuits plus courts ; il fautqu’elle soit disponible plus près de chez nous, au niveau des coopératives, des villages. La radio pourrait être un vecteur intéressant, maisla radio rurale n’est pas suffisamment développée en Côte d’Ivoire et les petites radios qui ont été créées ici et là ont des rayons d’actiontrop limités ».« Beaucoup de villages sont enclavés », ajoute-t-il. « Les producteurs sont soumis à des pressions commerciales des « pisteurs », qui viennentleur acheter leur production au bord de leurs champs. Ces producteurs ne connaissent pas les prix du marché. Ils se font complètementavoir. Et puis, ils ont besoin aussi, car nous sommes dans un pays très administré, de photocopies de documents, de cartes d’identité, decorrespondances administratives, de devis, de factures…Toutes ces choses quotidiennes leur coûtent beaucoup d’argent car ils doiventaller dans une grande ville pour cela, payer le transport, le séjour, perdre du temps de production précieux et coûteux ».L’ANOPACI a décidé de s’attaquer à ce problème, en collaboration avec un cabinet-conseil sans but lucratif, Winrock, à travers le projetInternet à la ferme. Il s’agit, en fait, d’implanter un réseau de télécentres au niveau villageois pour offrir aux communautés, auxcoopératives, aux groupements et aux individus, toute une séries de services : saisie et mise en page de textes sur ordinateurs, photocopiede documents, envoi de fax, utilisation du courrier électronique.Les télécentres permettront également d’avoir accès à des informations économiques, techniques et financières, à partir d’une banque dedonnées constituée à Abidjan sur les principales filières de production, les circuits d’approvisionnement, de commercialisation, mais aussid’informations sur la santé, l’éducation, l’environnement et de bénéficier de formations à distance.Enfin, ces centres permettront de faire remonter plus facilement les informations des organisations locales vers la rédaction duProfessionnel Agricole qui pourrait en faire un traitement plus rapide.Le projet est encore au stade des études préalables. Les responsables de l’ANOPACI ne veulent pas brûler les étapes et étudient tous leséléments du problème, notamment les épineuses questions liées à l’absence d’énergie électrique dans de nombreuses zones rurales, àl’entretien et à la maintenance des équipements, ainsi qu’à la rentabilisation économique des investissements techniques.Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des organisations membres de l’ANOPACI pour déterminer leur intérêt pour ce dispositif.L’ANOPACI évaluera les résultats.Trois sites expérimentaux ont été identifiés dans des villages au nord, au centre et au sud du pays. La Banque africaine de développementa été approchée comme un partenaire potentiel du projet ; elle a marqué un intérêt certain car elle souhaite tester des sources d’énergiealternatives pour alimenter ce nouveau type de circuit de communication avec le monde rural.61
Quel est le cours du café, aujourd’hui ?Depuis 1998, la Banque mondiale a appuyé la mise en place d’un système d’information sur les prix du café et du cacao. Ce système estbasé sur un site Internet et une batterie d’ordinateurs permettant de relever, en temps réel, les variations des cours du café et du cacao etde les répercuter vers les producteurs à travers la presse quotidienne et la radio.Les révolutions de l’informationCe système s’appelle PRIMAC (Prix du marché du café et du cacao). Il est actuellement géré par la Caisse de stabilisation des prix (CAISTAB)en relation avec les structures publiques et certaines organisations de producteurs. Toutefois, cet outil n’est pas suffisamment performantet l’ANOPACI entend jouer un rôle actif pour l’enrichir et le valoriser. Celle-ci est en négociation avec la Banque mondiale pour récupérerles éléments techniques du dispositif existant et en élargir le champ en y associant les autres filières (et notamment le coton, le palmier àhuile, l’hévéa, la banane, l’ananas) dont les associations de producteurs sont membres de l’ANOPACI.Avec Le Professionnel Agricole, les télécentres et le système d’information sur les prix, les producteurs de Côte d’Ivoire disposeront bientôtd’outils d’information et de communication performants qui les aideront à mieux affronter les défis de la mondialisation.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESAssociation nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d’Ivoire (ANOPACI), BP 937, Abidjan 20 (Côte d’Ivoire).Tél. (225) 47 84 20/88 86 08Séraphin Biatchon, Le Professionnel Agricole, BP 383, Abidjan 01 (Côte d’Ivoire). Tél. (225) 21 30 19/ 21 40 99 ; fax (225) 21 30 1862
Journaux et bulletinsQuand les paysannes africaines communiquentSortir de la marginalitéJacques SultanEn Afrique, les femmes rurales sont socialement et économiquement marginalisées. Elles ont un accès difficile à la terre, au crédit, auxsemences et à l’encadrement agricole. Elles doivent surmonter de nombreux obstacles pour développer des activités autonomes et êtrereconnues comme des productrices rurales à part entière.Elles constituent pourtant 30 % des chefs de ménage et elles assurent un rôle essentiel dans la production vivrière, tant dans les travaux deschamps que dans les tâches de transformation et de commercialisation des produits. Sans compter leur travail de mères, d’éducatrices etde responsables de l’alimentation familiale.Mais, pour que leur place dans le développement soit reconnue, elles savent qu’elles doivent d’abord compter sur leurs propres forces ets’organisent de plus en plus souvent en groupements, associations et coopératives. Ces groupements et associations s’investissent dans tousles secteurs de l’activité économique et sociale : agriculture, artisanat, transformation, commercialisation, alphabétisation, nutrition, santé,éducation et culture. En voici trois témoignages, extraits de la revue Paysannes Africaines.• En Mauritanie, 40 femmes créent une coopérative de maraîchage. Au bout de quelques années, grâce à leur acharnement au travail et àleur force de conviction, leur petit lopin de 0,25 hectare est devenu un verger de 3 hectares et leur coopérative compte maintenant 130membres. Ces bons résultats leur ont permis d’obtenir des soutiens extérieurs et d’acquérir une motopompe, une décortiqueuse, troismachines à coudre et de bâtir une salle d’alphabétisation. Aujourd’hui, ces femmes savent lire et écrire et gèrent elles-mêmes leurcoopérative. Elles commercialisent leurs productions et ont acquis des foyers améliorés qui leur évitent d’aller chaque jour ramasser dubois.• Un groupement de femmes s’est organisé, au Bénin, pour transformer une partie de la production d’arachides en fabriquant desgalettes, du savon, de la pommade et du shampooing. La commercialisation de ces produits leur a permis de renforcer leur autonomieet d’améliorer leur vie quotidienne.• Les femmes d’un village tchadien ne veulent plus avoir quotidiennement à porter sur leur tête le bois de chauffe, les récoltes et lesdenrées destinées à être vendues sur le marché. Organisées en groupement, elles se sont cotisées et ont obtenu un prêt pour l’achatd’une charrette à bœufs. Pour rentabiliser leur achat, elles louent la charrette aux villageois non membres de leur groupement. En troisans, elles ont généré suffisamment de ressources pour rembourser leur crédit et subvenir à l’entretien de l’équipement qu’elles ontacquis.Ces initiatives illustrent bien la capacité d’initiative des femmes mais elles restent fragiles, souvent isolées et ne bénéficient pas en prioritédes appuis techniques et financiers des partenaires extérieurs.63
Il est important que les exemples de réussite de groupements féminins soientconnus et valorisés car même quand ils sont modestes, ils encouragent lesfemmes rurales et provoquent un effet d’entraînement pour toutes celles quicherchent à sortir de la marginalité et à conquérir leur rôle dans la société et leurplace dans le développement.Constituer un réseau d’échangesLes révolutions de l’informationC’est à partir de ce constat et du besoin d’information, de communication etd’échanges, maintes fois exprimé par les femmes rurales, qu’un réseau d’appuis’est constitué en 1991, à Paris, à l’initiative de quelques femmes et en liaisonavec des structures existantes sur le terrain.Le réseau s’appuie sur la publication d’un bulletin, Paysannes Africaines, quiparaît 3 fois par an et qui est distribué dans une quinzaine de pays francophonesd’Afrique, auprès d’environ 370 groupements de femmes. C’est un bulletin très simple,composé de deux feuillets format A4, recto verso, pliés en deux et agrafés. Les illustrations sontproposées par des dessinateurs africains.Ses objectifs sont de favoriser les échanges d’informations entre groupements féminins, devaloriser les connaissances, les savoirs et les expériences de ces femmes, d’aider à l’expressiondes potentialités des groupements et de faire entendre leur voix à l’extérieur. C’est une initiative d’auto-promotion. Bien que le bulletin soitédité à Paris, l’intégralité de son contenu provient de contributions de femmes rurales africaines, de responsables de groupements oud’animatrices rurales, qui rendent compte d’initiatives ou d’expériences concrètes réalisées dans les villages.Plusieurs rubriquesQuelques numéros du bulletinPaysannes AfricainesLa rubrique principale est constituée par des récits d’expériences. Les femmes expliquent concrètement comment elles se sont organiséespour faire face aux problèmes qu’elles rencontrent : champs collectifs, maraîchage, petites unités de transformation, banques de céréales,boutiques villageoises, coopératives artisanales, crédits solidaires…Une autre rubrique importante concerne les « technologies ». Il s’agit de décrire des procédés techniques mis au point ou améliorés dansles villages, des recettes ou des astuces utilisées par les groupements de femmes, des conseils pratiques pour résoudre des problèmesquotidiens : transformer le manioc, fabriquer du savon, sécher les fruits et légumes, conserver les tomates, fabriquer des bougies et despommades, teindre les tissus, faire du couscous d’igname ou de niébé, éloigner les termites, fabriquer un piège à rats, construire un foyeramélioré, faire du sirop contre la toux…64
Journaux et bulletinsLes lectrices sont invitées à envoyer au journal le récit de leurs propres expériences et à décrire les techniques qu’elles mettent en œuvre,pour en faire bénéficier les autres. Les technologies les plus intéressantes sont reprises dans des fiches techniques tirées à part et mises àla disposition des groupements de paysannes.La rubrique du courrier des lectrices est très abondante. Elle autorise l’expression de différents points de vue et permet également demesurer l’impact du bulletin et d’identifier les besoins des lectrices. On trouve aussi une rubrique consacrée aux questions/réponses : lesgroupements de femmes sont invités à formuler les questions qu’elles se posent et au numéro suivant, d’autres groupements de femmes yapportent les réponses qu’elles ont trouvées à leur niveau. Paysannes Africaines entretient ainsi un dialogue concret, fondé sur uneentraide mutuelle entre les femmes rurales. Enfin, d’autres rubriques apportent des informations sur les sessions de formation et lesrencontres qui intéressent les femmes rurales, dans les différents pays concernés, ainsi que sur des ouvrages ou des publications dont lalecture est conseillée et qui sont accessibles.Des résultats encourageantsAprès huit ans de fonctionnement, le bilan de Paysannes Africaines est largement positif, comme en témoignent la croissance continue dunombre d’abonnés et l’enthousiasme des lectrices. Le choix éditorial de favoriser un dialogue direct entre les femmes rurales donne à cebulletin un caractère concret et lui permet de coller à la réalité des problèmes rencontrés sur le terrain par les groupements féminins.Restent les problèmes de la langue : la revue est diffusée en français et nombre de femmes rurales ne parlent pas cette langue, ce qui obligela médiation de villageois scolarisés ou d’animatrices rurales pour traduire le contenu du bulletin et formuler en français les initiatives queles groupements de femmes veulent faire connaître.Le partenariat avec des acteurs locaux devrait orienter le bulletin vers la création d’éditionsen langues nationales et la publication de fiches dans ces différentes langues. Cetteapproche permettrait par ailleurs d’augmenter le tirage et la diffusion du bulletin et del’articuler plus étroitement avec des partenaires engagés, sur le terrain, dans la promotiondes initiatives des femmes rurales et l’alphabétisation des femmes en langues nationales.En janvier 2000, la rédaction de Paysannes Africaines quitte Paris pour s’installer en terreafricaine…La parole aux femmes ruralesDe nouvelles perspectives sont ouvertes pour Paysannes Africaines grâce au partenariatqui a été conclu avec le Centre d’études économiques et sociales d’Afrique de l’Ouest(CESAO), basé à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso (voir encadré 7). Dans le cadre de cesLe siège du CESAO à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso(Photo : Jacques Sultan)65
ENCADRÉ 7Le CESAO, pour l’auto-promotion du monde ruralLe Centre d’études économiques et sociales d’Afrique de l’Ouest (CESAO) est une organisation nongouvernementale internationale fondée en 1960 et basée à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Ses activités sontessentiellement centrées sur l’auto-promotion du monde rural et s’appuient sur la mise en œuvre de programmesd’échanges, de réflexion, de formation et d’action en partenariat avec les principaux acteurs engagés dans ledéveloppement rural : les organisations paysannes, les femmes et les jeunes ruraux, de même que les servicesd’appui sur le terrain. Avec chacun de ces groupes de partenaires, le CESAO développe une concertation étroitepour déterminer les types d’action qui répondent le mieux à leurs besoins : ateliers, rencontres d’échanges et deréflexion, sessions de formation, études et conseils, programmes d’appui sur le terrain, production de documentsécrits ou audiovisuels, lobbying…Sur cette base, le CESAO élabore, tous les trois ans, les grandes composantes de son programme d’action :Les révolutions de l’informationAteliers et échanges de réflexion• Pour les organisations paysannes, ils portent sur des thèmes d’actualité, comme la décentralisation, ledésengagement de l’État des activités productives, la réforme agraire et foncière, le cadre juridique etinstitutionnel de développement des organisations paysannes faîtières.• Pour les femmes, il s’agira essentiellement de la rencontre internationale des femmes rurales prévue en mars2000 et qui fera le bilan et la mise en commun des programmes d’action élaborés par les femmes de 6 paysde la sous-région.Sessions de formationUne dizaine de sessions de formation sont proposées chaque année au sein du centre de formation du CESAOen direction de deux types de publics : les responsables des organisations paysannes et les agents des servicesd’appui au monde rural.Programmes d’appui sur le terrainIls font l’objet de négociations particulières avec chaque partenaire et peuvent prendre plusieurs formes :sessions de formation spécifiques, conseils, évaluations, audits, organisation de voyages d’études ou d’échangesd’informations, mise en place de programmes de recherche-action…Documentation et publicationsLe CESAO dispose d’un des centres de documentation les plus importants de la sous-région, spécialisé dans lesthématiques du développement rural. Ce centre est abonné à de nombreuses revues nationales et internationaleset accueille des étudiants, des chercheurs, des paysans, des fonctionnaires…Le CESAO assure la publication de revues, périodiques et livrets :• Construire ensemble, revue trimestrielle qui analyse les grands dossiers du monde rural ;• Les nouvelles du CESAO, bulletin d’information destiné au monde rural publié en français et en deux languesnationales (mooré et dioula) ;• Échanges, dossiers d’information consacrés à la description et à la valorisation des expériences paysannespubliés en français fondamental avec une traduction prévue dans les principales langues nationales ;• Les cahiers ruraux, dossiers techniques, publiés en français et destinés à soutenir l’action des formateurs etanimateurs des organismes d’appui au monde rural.66
Journaux et bulletinsEn haut : la bibliothèque du CESAO est un lieu très fréquenté (Photo : Jacques Sultan)Á droite : le numéro des mois de juin/juillet de la revue du CESAO, Construire Ensembleactivités, le CESAO accorde une place particulière aux questions qui touchent à la condition des femmes rurales, la promotion de leursactivités, la valorisation de leur rôle dans le développement.En 1996, après le sommet mondial des femmes de Beijing, le CESAO a organisé à Bobo-Dioulasso une rencontre internationale intitulée« La parole aux femmes rurales » pour permettre aux femmes rurales de se rencontrer, de confronter leurs expériences et de s’exprimer.Plus de 150 femmes, provenant de 8 pays d’Afrique de l’Ouest, ont participé à cette rencontre. Elles ont pris l’engagement de lui donnerune suite en élaborant, au niveau de chacun de leurs pays, un plan d’action pour les femmes rurales.Des rencontres décentralisées ont été organisées dans 6 pays, avec l’appui du CESAO, pour réunir toutes les associations fémininesintéressées par la démarche et mettre en commun leurs contributions. Ces rencontres ont permis d’élaborer des plans d’action nationauxet mettre en place des comités de suivi. Une nouvelle rencontre internationale des femmes rurales s’est tenue en mars 2000 pour validerles initiatives prises au niveau de chaque pays, les traduire en un plan d’action régional et jeter les bases d’une structure de représentationsous-régionale des femmes rurales ouest-africaines.Paysannes Africaines devrait, à cette occasion, devenir l’outil de communication de ces réseaux de femmes rurales, en préservant l’espritqui a prévalu à sa création, basé sur l’échange d’informations, d’expériences et de savoirs entre paysannes de différents pays d’Afrique maisen adaptant la forme et le contenu du bulletin aux besoins et aux priorités définis par ces différents réseaux nationaux.67
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESMarie Thérèse Abela, Paysannes Africaines, 52 rue Liancourt, 75014 Paris (France). Tél. (33) 1 42 22 06 19Rosalie Ouoba, Directrice générale, Centre d’études économiques et sociales d’Afrique occidentale (CESAO), BP 305, Bobo-Dioulasso 01(Burkina Faso). Tél. (226) 97 10 17, 97 16 84, 97 16 85 ; fax (226) 97 08 02 ; e-mail cesao.bobo@fasonet.bfLes révolutions de l’information68
Journaux et bulletinsRendre compte des questions environnementales en Afrique de l’OuestPanos, l’environnement et la démocratiePaul MundyUne longue listeDes forêts dévastées ; des sols mis à nu ; une sécheresse persistante et une désertification rampante ; des végétaux et des animaux en voiede disparition ; des nappes de pétrole ; des villes paralysées par la circulation automobile ; des détritus qui rendent l’air fétide.La liste des problèmes environnementaux en Afrique de l’Ouest est longue. La population n’est pas suffisamment informée de cet état defait et sans une pression de l’opinion publique, les gouvernements ne prennent pas en compte les problèmes environnementaux. La listes’allonge jour après jour.Voilà quelle était la situation à la fin des années 80. Il était largement temps de sensibiliser l’opinion publique aux questionsenvironnementales et de les inscrire dans les priorités des décideurs et des gouvernements. Mais comment faire ?L’Institut Panos, une ONG spécialisée dans les médias, a analysé la situation et a identifié deux contraintes majeures : les journalistes, commele grand public, ne connaissent pas grand-chose aux questions environnementales ; ils ne peuvent donc pas en rendre compte de façonpertinente. Par ailleurs, les patrons des médias ne pensent pas que l’environnement soit un thème économiquement porteur pour leursentreprises car cela n’attire pas les lecteurs. Résultat ? Très peu d’articles sur l’environnement et donc très peu d’intérêt chez les lecteurs,et encore moins d’articles sur l’environnement…Semer la graineAlymana Bathily, coordonnateur de Panos pour l’Afrique de l’Ouest à Dakar (Sénégal) explique comment Panos a pris le problème à brasle-corps.En 1990, l’institut lançait un projet appelé « Afrique Envi ». Des accords étaient passés avec les responsables des journaux et desstations de radio à travers l’Afrique de l’Ouest pour renforcer l’information sur les questions environnementales. Les journaux acceptèrentde publier une page hebdomadaire consacrée à des articles sur l’environnement, tandis que les stations de radio s’engagèrent à produireune heure de programme par mois sur ce thème. Les accords initiaux portaient sur une année mais ils pouvaient être reconduits pour uneautre année, si nécessaire.En contrepartie, Panos fournissait aux radios et aux journaux des sources d’information, des équipements et des sessions de formation. Plusde 40 journalistes ont ainsi été formés sur les questions environnementales. Des guides environnementaux ont été produits en anglais eten français à l’attention des journalistes, pour les aider à rendre compte des problèmes de l’environnement.69
Quelques exemples de brochures de Panosconsacrées à l’environnement et à la communication(Photo : Paul Mundy)Les révolutions de l’informationPanos a également subventionné la production demanuels scolaires sur l’environnement dans plusieurspays et en particulier au Niger et au Tchad, deux Étatsparticulièrement affectés par la désertification. Panos afourni aux journalistes des équipements de reportageet a financé leurs frais de déplacement pour leurpermettre de se rendre dans les zones sensibles et yeffectuer des reportages ou y mener des enquêtes. Pour s’assurer que ces appuis iraient bien aux journalistes eux-mêmes, les subventionsfurent divisées en deux parties : l’une était destinée aux responsables des médias et l’autre aux journalistes qui devaient faire parvenir àPanos des copies de leurs articles ou de leurs émissions de radio pour prouver la réalité de leurs prestations.Résultat immédiat de ce programme : 12 heures d’émissions de radio, 48 articles et reportages dans la presse écrite dans chacun des paysconcernés au cours de la première année. Le résultat induit a été encore plus important. Les responsables des médias commencèrent àréaliser l’importance des enjeux environnementaux et l’intérêt qu’ils suscitaient chez les lecteurs et les auditeurs : ils se rendirent compteque les articles sur l’environnement augmentaient la vente des journaux et incitaient les auditeurs à écouter les programmes.Panos ne jugea pas nécessaire de reconduire le projet à la fin de la première année en 1995 : les journaux et les radios assuraient désormaisla couverture des problèmes environnementaux sans sollicitation extérieure. « Afrique Envi » avait semé la bonne graine et elle avait grandi.L’environnement était devenu un sujet important.Médias, démocratie et paixPanos utilise actuellement une approche similaire pour améliorer la couverture d’autres thématiques négligées : les droits de l’homme, ladémocratie et les femmes. Il assure la formation de journalistes, favorise leur accès aux informations relatives à ces sujets et subventionneleur couverture par les journaux et les stations de radio.De nombreux pays d’Afrique de l’Ouest sont déchirés par la guerre. Dans de telles situations, des dirigeants peu scrupuleux peuventétouffer les dissidences ou jeter de l’huile sur le feu. Panos cherche les moyens d’utiliser les médias pour résoudre pacifiquement lesconflits : en encourageant le dialogue, en renforçant l’éthique professionnelle, en militant pour l’indépendance des médias et en incitant àdes changements législatifs qui facilitent la création de nouveaux journaux et de nouvelles stations de radio.Échanger les programmes radioUne des façons d’améliorer le dialogue consiste à échanger les programmes entre les radios. Pour ce faire, Panos a mis en place une« banque de programmes » numérique au sein de son antenne de Bamako, au Mali. Pour l’utiliser, il faut disposer d’un ordinateur équipéd’un modem, une ligne téléphonique et un enregistreur de cassettes. Le producteur de radio se connecte sur la banque via l’Internet70
Journaux et bulletinsENCADRÉ 8Décentralisation et développement localDe nombreux gouvernements africains se sont engagés dans des processus de décentralisation, en donnant deplus en plus de pouvoir aux régions et aux communes. Les collectivités territoriales, assure-t-on, sont plusproches des citoyens que des ministères éloignés dans les capitales ; elles permettent un fonctionnement plussouple et plus attentif aux besoins de la population. Mais la décentralisation, pour être efficace, doit s’appuyer surun dialogue avec les populations locales. C’est une démarche difficile car la plupart des institutions locales nedisposent ni des moyens ni du savoir-faire pour faire circuler l’information et il n’existe que très peu de journauxlocaux.Au Sénégal, Panos essaie de surmonter ces difficultés à travers une initiative qui s’appelle RESIDEL (réseaud’informations Internet sur la décentralisation et le développement local). Démarré en 1999, le réseau est soutenupar le CTA.RESIDEL organise un partenariat inhabituel entre le secteur public, les associations, les ONG et les médias. Lesecteur public est essentiellement représenté par le ministère de l’agriculture, responsable de la sécuritéalimentaire et l’ISRA (Institut sénégalais de recherche agronomique). Ces deux partenaires se sont engagés àfournir au réseau des informations technique dans leurs domaines de compétences respectifs.Le deuxième groupe de partenaires est formé par les associations de présidents de communautés rurales, lesmaires et les dirigeants des communautés rurales. Le troisième groupe est constitué d’ONG comme la Fondationrurale pour l’Afrique de l’Ouest (FRAO) et le Centre national de concertation et de coopération des ruraux(CNCR). Ces organisations ont accepté d’alimenter le réseau en informations relatives à la vie et aux activitésdes communautés rurales.Les médias constituent le quatrième groupe. Plusieurs journaux et radios communautaires ont accepté de diffuserles informations provenant du réseau vers leurs lecteurs et auditeurs.RESIDEL soutient la production de programmes radios et d’articles de journaux sur la décentralisation et ledéveloppement local. L’information produite est numérisée et elle peut être consultée sur le site Internet de PanosDakar (http ://www.panos.sn) ou diffusée par e-mail.Après seulement quelques mois de fonctionnement, le réseau a récolté une quantité importante d’informations surune série de sujets comme la décentralisation, le développement local, le financement du développement, lecrédit, la transformation agroalimentaire, la protection des cultures, les feux de brousse, le reboisement, laconstruction des pistes rurales, la gestion des déchets, l’assainissement, le maraîchage périurbain, l’horticulturefruitière, la fertilité des sols, les banques de céréales, le code de la pêche, les petites entreprises, les impôtsruraux et le tourisme.Régulièrement alimenté par les acteurs du développement rural, le réseau constitue de plus en plus uneressource incontournable pour la décentralisation et le développement local au Sénégal.71
(www.oneworld.org/panos_audio). Quelques clics de souris plus tard, il peut choisir un programme parmi les centaines de propositionsexistantes et le télécharger pour le rediffuser. Quelques clics supplémentaires et le voilà à même de contribuer à alimenter la banque avecdes programmes produits par sa propre station.Le service est gratuit, de même que le logiciel, qui peut être téléchargé sur l’Internet. Les stations de radio font des économies de temps etd’argent : avant l’Internet, la seule façon de se procurer des programmes de l’extérieur était d’attendre qu’une cassette arrive par la poste.Les stations peuvent désormais également échanger leurs programmes avec ceux d’autres radios pour un coût nul.Les révolutions de l’informationLes lenteurs du courrier traditionnel ne sont toutefois pas supprimées : la banque de programmes l’utilise toujours pour recevoir denouveaux programmes provenant de correspondants dans 20 pays africains et pour envoyer des programmes à une centaine de stations deradio à travers l’Afrique et l’Europe.Indépendance financière = indépendance éditoriale« La diminution des coûts de production est un élément important pour les médias », explique Alymana Bathily. « De nombreux journauxet radios en Afrique de l’Ouest n’arrivent pas à boucler les fins de mois. Les médias indépendants sont un élément vital de la démocratiemais il n’y a pas d’indépendance sans viabilité économique ».Pour garantir l’indépendance des éditeurs au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Mali, Panos a appuyé la création d’une centraled’achat de papier pour les journaux. Panos conduit également des recherches sur le financement des médias et mène une réflexion sur lesactivités que les médias peuvent entreprendre pour générer des ressources financières à travers la vente de produits et de services.L’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) constitue une entité spécifique depuis qu’il est devenu indépendant de Panos Paris, en janvier2000. Basé à Dakar, l’IPAO dispose de bureaux à Bamako (où est implantée la banque de programmes) et à Accra. L’action de Panos pourrenforcer le rôle des médias pour la démocratie et le développement en Afrique de l’Ouest lui a permis d’obtenir des soutiens financiers deplusieurs bailleurs de fonds, dont le CTA, DANIDA, la DGIS (Pays-Bas), les fondations Ford et Rockefeller et le Centre de recherche pour ledéveloppement international (CRDI) au Canada.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESAlymana Bathily, Institut Panos, 20 rue Mohammed V, BP 21 132, Dakar-Ponty (Sénégal). Tél. (221) 822 1666 ; fax (221) 822 1761 ;e-mail panos@sonatel.senet.net ; Internet www.panos.sn; Internet Residel www.panos.sn/f/programmes.residel.html72
Journaux et bulletinsPrivatisation des agences de pressePANA, une agence de presse pour l’AfriquePaul MundyNelson Magombo corrige un article : il se trouve qu’il traite de la privatisation de l’Office chargé de la commercialisation des produitsagricoles dans son propre pays, le Malawi. Il ajoute quelques touches finales, puis appuie sur une touche de son ordinateur pour envoyerl’article à son rédacteur en chef.Gabu Amacha, le responsable ougandais du bureau en langue anglaise, lit l’article relatif au Malawi. Il se demande s’il est susceptibled’intéresser les lecteurs francophones et donc d’être traduit en français et finalement décide que non. Il se demande également s’il fautl’envoyer tout de suite ou attendre le bulletin économique du mardi ; il décide d’attendre jusqu’à mardi.Efficacité tranquilleBienvenue à la PANA, l’Agence de presse panafricaine. Le bureau de Dakar fonctionne avec une efficacité tranquille, passant au crible lesarticles, les corrigeant et les envoyant aux journaux, radios et télévisions.Les dix rédacteurs (six anglophones, quatre francophones)travaillent par équipe pour traiter les reportages provenant des48 correspondants répartis dans tout le continent. Les articlessont classés en trois grandes catégories : les informationsd’actualité, les informations sportives et les articles spécialisés.Cette dernière catégorie est répartie en bulletinshebdomadaires : environnement et développement (lundi),économie (mardi), sciences et santé (mercredi), genre (jeudi).Chaque bulletin comprend une douzaine d’articles et dereportages écrits par les correspondants ou les journalistes dusiège eux-mêmes.Peter Masebu, rédacteur, devant les bureaux de la PANAà Dakar (Sénégal)(Photo : Paul Mundy)73
Tous les articles sont envoyés par courrier électronique via l’Internet. Ils sont récupérés par les journaux et les médias audiovisuels danstoute l’Afrique mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Friands de nouvelles provenant d’Afrique, les journaux pour les Afroaméricainsdes États-Unis sont des utilisateurs assidus des articles de la PANA.Les révolutions de l’informationMalgré l’importance de l’agriculture en Afrique, il n’y a pas de bulletin réservé à ce domaine. Peter Masebu, un rédacteur venu de Tanzanie,explique que c’est dû au fait que les articles portant sur l’agriculture peuvent être intégrés dans les autres bulletins spécialisés. Uneinformation sur le gel des cultures de thé au Kenya peut trouver sa place dans le bulletin économique, une autre sur les réserves de DDTen Tanzanie finira dans le bulletin sur l’environnement. Globalement, la PANA traite environ 60 articles sur l’agriculture chaque semaine, surun total de 350 articles sur l’ensemble des sujets.S’adapter aux mutationsL’histoire de la PANA est en fait l’histoire de deux révolutions : politique et technologique. Fondée en 1979 par les États membres del’Organisation de l’unité africaine (OUA), la PANA a commencé à transmettre des informations en mai 1983. Au départ, les articles étaientfournis par les agences de presse nationales des pays membres. Elles étaient corrigées puis réexpédiées aux mêmes agences nationales.La première révolution intervint alors : la chute du communisme en Union soviétique et en Europe de l’Est, en 1989, engendra une maréedémocratique qui traversa toute l’Afrique. Les gouvernements autoritaires et le contrôle de la presse laissèrent petit à petit la place à desgouvernements démocratiques qui s’engagèrent dans la liberté de la presse. Pendant la même période, une vague d’ajustements structurelsbalaya tout le continent et, pour réduire les dépenses publiques comme on le leur demandait avec insistance, les gouvernementsprivatisèrent les monopoles d’État et supprimèrent les subventions.Ce phénomène se traduisit par la disparition de nombreuses agences nationales de presse qui constituaient la source d’informationprincipale de la PANA. Cela signifiait aussi que les gouvernements n’entendaient plus financer une agence de presse panafricaine. Il fallutdonc privatiser la PANA. Les articles ne parviendraient plus gratuitement à la PANA ; il faudrait les payer. La PANA ne pourrait plus comptersur les subventions des gouvernements pour assurer ses coûts de fonctionnement ; il faudrait que l’agence génère ses propres ressourcesen vendant ses services à ses clients.En 1993, l’Unesco commença à apporter un soutien à la PANA pour l’aider à s’adapter à cette nouvelle réalité et à se préparer à uneprivatisation progressive. En Octobre 1997, la PANA cessa d’être une institution intergouvernementale pour devenir une société privée,PANA Presse, dont les gouvernements devenaient actionnaires. Cette mesure devait permettre de vendre 75 % des actions à des groupesde presse, des banques, des sociétés de télécommunication, des ONG et des investisseurs privés. Les 25 % restants étaient transférés auxagences nationales de presse des pays membres.Pendant la même période, PANA Presse entreprit de professionnaliser ses activités opérationnelles, multipliant par vingt sa production,passant de 2 000 mots par jour en 1992 à 40 000 en 1996. Un réseau de correspondants permanents et de reporters locaux a été mis enplace dans la plupart des capitales du continent. Cinq bureaux régionaux ont été établis, à Addis-Abeba, Kinshasa, Lagos, Lusaka et Tripoli.L’ouverture d’autres bureaux est prévue en Afrique mais aussi à Bruxelles, Londres, Paris et New-York.74
Journaux et bulletinsLa deuxième révolutionElle est intervenue dans la même période dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications. En 1983, la PANA utilisaitessentiellement le télex pour envoyer et recevoir des nouvelles. L’utilisation des ordinateurs commença en 1990. Récemment, l’agence s’estdotée de nouveaux équipements informatiques et de logiciels de gestion de l’information sophistiqués. La mise en place d’un réseauspécifique par satellite était programmée mais entre-temps, l’arrivée d’Internet a offert des possibilités bien plus pratiques et bien moinscoûteuses.Les sites Internet de PANA Presse (http://allafrica.com/panaenglish/ en anglais et http://allafrica.com/panafranais/ en français) proposent desinformations actualisées tout au long de la journée.La PANA peut-elle être compétitive sur le marché de l’information ? Ses concurrents sont des agences très puissantes et sophistiquées enEurope et en Amérique. Mais la PANA a des arguments qui plaident en sa faveur : un engagement en Afrique, une connaissanceincomparable des pays qu’elle sert et le plus important réseau de correspondants du continent.La PANA doit creuser sa niche en fournissant des informations de qualité, fiables et indépendantes sur l’Afrique. Elle pourra ainsi gagner del’argent, attirer les investissements dont elle a besoin et devenir un élément incontournable du système d’information de ce continent vaste,complexe et en mutation rapide.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESPANA Presse, BP 4056, Dakar (Sénégal). Tél. (221) 241395/ 241410 ; fax (221) 241390 ; e-mail quoiset@sonatel.senet.net75
Alphabétiser : alphabétisation et moyens d’existence en OugandaUne association polyvalente pour la formation et l’emploi : en Ouganda, apprendre à la demandeDes publications en langues nationales pour les paysans : à quoi sert l’alphabétisation s’il n’y a rien à lire ?Au Burkina Faso, des paysans journalistes : des paysans qui créent leurs réseaux d’informationAlphabétisation et langues nationales
L’alphabétisation est une composante essentielle du développement : elle est aussiindispensable que l’eau potable et de la nourriture en quantité suffisante. Sans un niveausuffisant d’instruction de base, il est difficile d’imaginer qu’une société puisse trouverl’énergie nécessaire pour sortir de la pauvreté. Dans tous les pays, les personnesanalphabètes sont toujours plus pauvres que les personnes qui ont acquis un niveaud’instruction.Les révolutions de l’informationLes taux d’alphabétisation sont encore effroyablement bas dans de nombreux pays,notamment dans les zones rurales et surtout chez les femmes et les jeunes filles. Pendanttrop longtemps, les gouvernements, les écoles et les enseignants demandaient à lapopulation d’apprendre une langue étrangère (généralement l’anglais ou le français) enmême temps qu’ils apprenaient à lire et à écrire. Cela représente une double contrainteque peu de gens accepteraient dans les pays développés.La réponse consiste sans doute à aider la population (enfants et adultes) à apprendre à lireet à écrire dans leur propre langue. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu’ils puissentdisposer de journaux et de livres pour consolider leur apprentissage. Avec un peu d’aide,ils pourront même écrire leurs propres journaux. Ces supports imprimés en languesnationales doivent être intéressants, distrayants et utiles : pour cela, ils doivent être enphase avec le contexte de leurs lecteurs. Et ils devront également contribuer au processusde développement en véhiculant des messages sur la santé, l’agriculture, l’industrie etl’hygiène.78
Alphabétisation et langues nationalesAlphabétiserAlphabétisation et moyens d’existence en OugandaPaul MundySi vous vous promenez dans les rues du Caire, de Tokyo ou de Bangkok et si vous ne parlez pas l’arabe, le japonais ou le thaï, vous êtes àpeu près certain de vous perdre. Les enseignes des boutiques sont rédigés dans une langue étrangère dont vous ne pouvez même pasdéchiffrer les lettres. Il en va de même pour les journaux, la signalisation routière, les panneaux indicateurs des destinations d’autobus, lesinstructions d’emploi des cabines téléphoniques et les panneaux d’affichage.Si vous allez dans un supermarché pour acheter un paquet de soupe, le seul moyen que vous ayez pour savoir s’il s’agit d’une soupe aupoulet ou à la tomate est de vous fier à l’image dessinée sur le paquet. Vous allez sans doute attraper la migraine en essayant de déchiffrerle mode de cuisson sur la boîte ? Dans ce cas, prenez donc une aspirine mais attention de ne pas vous tromper et de prendre un somnifèreou un cachet contre la constipation.Voilà une description à peu près fidèle si on veut comprendre ce que l’on éprouve quand on est analphabète. Dans tout ce que l’on apprendà l’école, la chose la plus importante est de savoir lire et écrire. Cela vous donne un accès au monde. Cela vous permet d’apprendre, decommuniquer avec les autres. C’est un élément indispensable dans le monde actuel.Mais que se serait-il passé si nous n’avions pas appris à lire et à écrire ? Si nous n’étions jamais allés à l’école, parce que nos parents étaienttrop pauvres ou parce qu’il n’y avait pas d’école dans les environs ? Ou si les enseignants avaient été tués à la guerre ? Ou encore si tous leslivres et journaux étaient écrits dans une langue inconnue ? Voilà le quotidien de beaucoup de gens dans les pays en développement.L’instruction est une condition tellement élémentaire pour le développement qu’il est incroyable et triste de constater qu’elle occupe unesi petite place dans les programmes des gouvernements et des agences de développement. Dans le monde, on estime que 876 millionsde personnes, dont deux tiers de femmes, sont en état d’illettrisme. L’éducation ne représente qu’une petite fraction des dépensesmilitaires.Selon l’Unesco, le taux d’analphabétisme des adultes en Afrique subsaharienne varie entre moins de 10 % pour les hommes et environ 20 %pour les femmes au Zimbabwe et près de 80 % pour les hommes et 94 % pour les femmes au Niger.Aujourd’hui encore, la nécessité de promouvoir l’alphabétisation est d’une évidence accablante : les personnes alphabétisées trouvent plusfacilement du travail et vivent plus longtemps que celles qui ne savent ni lire ni écrire ; les femmes alphabétisées se marient souvent plustard et ont moins d’enfants mais ces derniers sont en meilleure santé ; les pays qui comptent une population alphabétisée sontgénéralement plus avancés que ceux où l’on trouve beaucoup de personnes sans éducation de base.79
Les révolutions de l’information80Un vulgarisateur agricoleexplique comment cultiver lapatate douce à desinstructeurs d’alphabétisationdu district de Makuli(Ouganda oriental)(Photo : LABE)Promouvoir l’alphabétisation en OugandaLa LABE (Literacy and basic education – alphabétisation et éducation de base) est une des organisations qui tente de changer la situationen Ouganda. Cette ONG, basée à Kampala, propose aux autres organisations des sessions de formation et un soutien à l’alphabétisation. LaLABE n’a pas de projets spécifiques mais se met à la disposition des autres organismes engagés dans la production agricole, lacommercialisation ou d’autres aspects du développement.La LABE articule son activité sur deux grands axes : la formation de formateurs en matière d’alphabétisation et l’appui à la production dedocuments de post-alphabétisation en langues nationales.Former des formateurs…On ne dispose pas de chiffres précis pour l’Ouganda, mais Patrick Kiirya, le directeur de la LABE, dit qu’environ 56 % des hommes adultessont alphabétisés et 38 % des femmes. Avec une petite équipe, la LABE utilise une méthodologie en trois étapes pour joindre la masseimportante de lecteurs potentiels. La première étape consiste à trouver des candidats pour devenir des « formateurs d’instructeursd’alphabétisation » ou LIT (Literacy-instructor trainers). La LABE travaille avec 15 associations d’ONG en Ouganda qui regroupent denombreuses organisations communautaires comme les groupements de femmes ou de jeunes (une de ces organisations est la MTEA,évoquée p. 85).Les groupements communautaires identifient les candidats aux fonctions de formateurs : un homme et une femme issus de chaquecommunauté. Les animateurs de la LABE se rendent dans l’association d’ONG pour dispenser à ces aspirants formateurs un cours d’unesemaine portant sur les mécanismes de l’apprentissage chez les adultes, la pédagogie, les documents de formation, la traduction desdocuments dans les langues locales et l’organisation communautaire. Le conseiller agricole du district et les personnels d’encadrement desautres services publics contribuent à cette formation, ce qui garantit leur intérêt et leur engagement dans le suivi des opérations.
Alphabétisation et langues nationales…pour former des formateursAprès cette formation, les nouveaux formateurs retournent dans leur communauté et la deuxième étape commence : il faut former d’autrespersonnes qui deviendront des instructeurs d’alphabétisation. Les communautés choisissent ces futurs instructeurs et les formateursfraîchement émoulus reproduisent le cours qu’ils viennent eux-mêmes de suivre, formant à leur tour de 20 à 25 instructeurs.Ce sont ces instructeurs qui prennent en charge la troisième étape :assurer la formation des villageois. Les cours sont délivrés deux soirspar semaine pendant deux heures, après les travaux des champs.Cette approche en cascade où la LABE forme des formateursd’instructeurs, qui forment des instructeurs qui, à leur tour, formentles villageois, permet de toucher beaucoup plus de personnesqu’une approche classique basée sur un seul niveau de formation.En décembre 1999, on comptait environ 413 formateursd’instructeurs (dont la moitié de femmes) et 1 296 instructeursintervenant dans 677 cours d’alphabétisation dans 46 districtsrépartis dans tout le pays. Ces cours étaient suivis par près de 15 000personnes (dont plus de 80 % de femmes).Problèmes d’apprentissageUne apprenante met en pratique ses nouvelles aptitudes à la lecture dansAu départ, les apprenants ont de grandes ambitions : lire lesle district de Kamuli (Ouganda oriental)journaux ou devenir chef de village. Après quelques cours, les(Photo : LABE)ambitions se redimensionnent. Les parents veulent être en mesure de lire les livres d’école de leurs enfants, comprendre ce qu’ils yapprennent et peut-être les aider à faire leurs devoirs. Les apprenants veulent pouvoir lire les affiches qui ont été disposées dans tout levillage, remplir des formulaires pour une demande de prêt ou une vaccination au centre de santé, voter ou tout simplement écrire leur nom.Les agriculteurs veulent être capables de lire les instructions sur les boîtes de pesticides (bien que la plupart du temps elles soient formuléesen anglais ou en kiswahili) ou calculer le bénéfice qu’il ont réalisé sur la vente de leurs récoltes. Les femmes veulent pouvoir écrire à leursmaris qui travaillent dans les villes. Les mamans veulent rester en contact avec leurs enfants, au pensionnat.Ce sont des objectifs ambitieux pour un cours bihebdomadaire. Naturellement, les progrès sont lents et pénibles. La motivation s’émousse.Les instructeurs, qui sont bénévoles et qui ont une formation très limitée et un soutien très faible, ont du mal à rester enthousiastes.Beaucoup de villageois abandonnent.Mais d’autres s’accrochent et cela encourage la LABE à poursuivre son entreprise. Ce n’est pas facile de résoudre à la fois des problèmes demotivation et de niveau de formation des instructeurs. Beaucoup d’apprenants sont suffisamment motivés pour envisager de payer leur81
formation ; cela permet de maintenir l’intérêt des instructeurs. Des comités locaux pourraient leur donner un modeste salaire. Lesgroupements communautaires fournissent les équipements de base comme les tableaux, les machines à sérigraphie et les consommablescomme le papier et l’encre. Les responsables de district financent la production des documents de post-alphabétisation.Les révolutions de l’informationLa LABE organise des journées de recyclage pour actualiser les compétences des instructeurs. Elle organise également des sessions de bilanavec les apprenants, les instructeurs et les formateurs pour évaluer les progrès accomplis et apporter des modifications au programme. Lesparticipants n’ont pas peur de s’exprimer franchement : « ce sont des réunions orageuses » dit Godfrey Sentumbwe, le responsable de laformation de la LABE. L’ONG édite également un bulletin semestriel proposant des informations, des conseils pédagogiques et des aidesvisuelles.Mais que liront-ils ?L’approche de la LABE tente de surmonter l’autre gros problème de l’alphabétisation en Ouganda : l’absence chronique de documentsimprimés dans les langues parlées par les populations rurales. La plupart des livres sont édités en anglais ou en kiswahili mais ces languesne sont pas bien parlées ni comprises dans beaucoup de zones rurales. Et demander aux villageois d’apprendre à lire et à écrire et, en mêmetemps, de s’initier à une langue étrangère n’est pas raisonnable.Il y a aussi un autre obstacle à franchir : l’essentiel des documents d’information utiles aux producteurs ruraux sont édités en anglais maisdans un anglais scientifique ou technique, de surcroît. Il est donc nécessaire de passer par une double traduction : de l’anglais aux langueslocales et du jargon technique à un langage accessible à tous.La LABE forme les formateurs d’instructeurs pour leur donner les moyens de faire ces traductions et de produire eux-mêmes les documentsdont ils se serviront pendant leurs cours. Certains de ces apprentissages sont dispensés à l’occasion de la première semaine de formation.Une deuxième session permet d’approfondir l’apprentissage. Cette deuxième session est adaptée aux besoins locaux : les formateursd’instructeurs et les associations d’ONG locales choisissent les thèmes de formation et inventorient les matériels et documents de formationexistants. À partir de cela, les animateurs de la LABE apprennent aux formateurs d’instructeurs à concevoir, rédiger et réaliser desdocuments écrits en langues locales.Beaucoup de matière à écritureLes participants trouvent beaucoup de thèmes qui justifient des documents écrits. Il existe une profusion d’informations locales, desévénements, des contes et des chansons populaires qui constituent autant de sources. Certains récits peuvent être reformulés pour leurdonner une valeur éducative sur une technique agricole ou un conseil de santé, par exemple. Les participants peuvent réaliser un calendrierqui met en valeur les moments clé de l’activité agricole, rédiger un bulletin ou concevoir un tableau mural. La LABE imprime les meilleursdocuments, les multiplie et les distribue aux classes d’alphabétisation. Ces documents sont intégrés à la « boîte à outils » qui est mise à ladisposition des instructeurs communautaires pour rendre la formation plus efficace et plus vivante.82
Alphabétisation et langues nationalesMais la formation va plus loin que la production de matériel didactique. Lesinstructeurs apprennent aussi à utiliser la radio, qui est un puissant outil éducatif. Lesclasses d’alphabétisation écoutent les programmes collectivement puis débattent surle thème proposé et le traduisent en textes ou en images. Les apprenants sontencouragés à écrire aux stations de radio. Cela constitue un excellent retourd’information pour les producteurs des programmes.De nombreux groupes communautaires partenaires de la LABE sont impliqués dansd’autres activités. Ces groupes constituent en effet des structures idéales pourexploiter les acquis de l’alphabétisation avec des exercices concrets sur des thèmescomme l’agriculture, la santé et l’emploi. L’association d’alphabétisation de Nakiseneest également impliquée dans des activités de production agricole et a monté ungroupe théâtral. Pendant les cours d’alphabétisation, les participants étudient denouvelles techniques culturales et préparent des images sur les points forts del’apprentissage sur des questions agricoles. Ils composent également des chansons etdes danses sur ces différents thèmes et en font des spectacles pour toute lacommunauté. Ils ont même été invités à se produire dans d’autres villages et en tirentun revenu.La boíte à outils des formateursLes formateurs ont besoin de matériel pour travailler. La LABE remet à chacun d’entreeux une boîte à idées et à outils pour faciliter leur activités de formation. Cette boîtecomprend un manuel pratique de pédagogie, des enveloppes contenant des fiches,des cartes, des tableaux, des photos et d’autres aides visuelles pour l’apprentissage,une horloge en carton pour apprendre à lire l’heure, un guide d’évaluation de laparticipation des apprenants, des images destinées à déclencher l’écriture de récits,des jeux et des fiches de suivi.Godfrey Sentumbwe, responsable de la formationde la LABE, montrant le contenu d’une boíte à outilspour formateur à Kampala (Ouganda)(Photo : Paul Mundy)L’ensemble de ce matériel représente un appui pour des douzaines de leçons et il est fonctionnellement rassemblé dans une boîte qui peutfacilement être transportée sur une bicyclette.Renforcer les potentialitésLes organisations au niveau des districts et au niveau local font appel à l’aide de la LABE dans les zones non couvertes par les campagnesd’alphabétisation. La LABE répond à ces demandes en organisant des sessions de formation et en fournissant du matériel et des supports83
logistiques pour améliorer leurs compétences en termes techniques et en termes de gestion ou d’organisation. Chaque fois que cela estpossible, la LABE identifie les partenaires potentiels qui peuvent apporter une assistance dans l’organisation de ces formations, ainsi quedans la recherche de financements, les évaluations participatives, la négociation et le plaidoyer.La formation est organisée de la même façon que les cours d’alphabétisation : la LABE forme des formateurs au niveau des districts, qui àleur tour forment des animateurs communautaires et des vulgarisateurs des services publics, qui poursuivent la chaîne en formant lesmembres des associations de base, les groupes traditionnels et les simples villageois.Les revolutions de l’informationLa LABE n’est qu’un des maillons de la lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme. En mobilisant uniquement ses moyens, cetteorganisation ne peut couvrir qu’une petite partie de la population de l’Ouganda. Mais son approche démultiplicatrice permet de toucherune population de paysans beaucoup plus importante que sa modeste équipe pourrait atteindre. La LABE constitue un exemple à suivrepour tous ceux qui veulent venir à bout du fléau de l’analphabétisme.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESLABE, Plot 18 Tagore Crescent, Kamwokya, PO Box 16176, Kampala (Ouganda). Tél. (256) 41 532116 ; fax (256) 41 534864 ;e-mail labe@swiftuganda.com84
Alphabétisation et langues nationalesUne association polyvalente pour la formation et l’emploiEn Ouganda, apprendre à la demandePaul MundyVous trouverez difficilement la MTEA si vous ne connaissez pas Iganga, une petite ville poussiéreuse, située à l’est de l’Ouganda. Suivez larue principale en arrivant de Kampala, tournez à droite au rond-point au centre de la ville, puis encore à droite, puis à gauche et continuezvotre route jusqu’à ce qu’elle devienne une piste sablonneuse. Tournez alors à nouveau à droite et vous y êtes : un panneau, face à unemodeste maison de plain-pied, annonce le « Multi-purpose Training and EmploymentAssociation » (Association polyvalente pour la formation et l’emploi).Fondée en 1986 comme une organisation de jeunes, cette ONG a pour mission l’améliorationdu niveau de vie des communautés autour d’Iganga. Elle intègre désormais des personnes detous les âges et elle est composée d’une soixantaine de groupes partenaires (groupes defemmes, clubs d’alphabétisation et organisations de paysans et d’artisans) provenant desvillages voisins. Chaque groupe compte environ 25 membres, ce qui fait environ 1 500adhérents.Comme son nom l’indique, la MTEA est engagée dans une gamme polyvalente d’activités quivont de l’agriculture et l’environnement à la commercialisation, l’organisation de réseaux et lelobbying. Ces activités comprennent un programme de nutrition et de santé maternelle etinfantile, des cours d’alphabétisation pour ceux qui veulent apprendre à lire et à écrire ainsiqu’un centre de ressources où les adhérents peuvent venir pour se documenter, lire ou étudier.Expérimentations agricoles contrôlées par les paysansLe programme de formation agricole est particulièrement actif. La MTEA organise desexpérimentations agricoles et des démonstrations de nouvelles techniques culturales. Lespaysans membres des associations partenaires de la MTEA fournissent les parcelles, décidentdes thèmes d’expérimentation et s’occupent de la préparation de la terre et de la gestion desparcelles.Bien sûr, ce n’est pas aussi simple que cela… Il faut être bien organisé et c’est là que la MTEAintervient : les responsables des associations commencent par discuter en détail avec lespaysans du problème qui se pose. Ils les aident à en identifier les causes et des solutionsLe personnel de la MTEA devant les bureraux del’association à Iganga(Photo : Paul Mundy)85
Les révolutions de l’informationUne journée agricole organisée parla MTEA à l’intention d’un groupede paysans de Nawampendo(Photo : Paul Mundy)possibles. Ensemble, ils bâtissent un « arbre à problème » (schéma qui décrit les différentes composantes des problèmes, leurs causes etleurs effets) pour les aider à comprendre comment le problème est apparu et quelles solutions peuvent être trouvées.Par exemple, les paysans disent que leur problème principal est le manque de nourriture. Ils peuvent attribuer cela au manque de terresou à la fertilité insuffisante des sols. Il est peut-être impossible d’augmenter la disponibilité en terres. La solution évidente est donc dechercher les moyens d’améliorer la fertilité des sols. Ceci peut conduire à une discussion sur les mérites et les prix comparés de différentstypes d’engrais et mener à l’idée de tester des composts et des engrais qui ne coûteraient rien aux paysans.La MTEA travaille en étroite collaboration avec les services de vulgarisation du district et le bureau de développement de la communautépour organiser des démonstrations sur les nouvelles techniques. « Les vulgarisateurs aiment bien travailler avec nous parce que nous savonscomment mobiliser les paysans », dit Ajab Waiswa, secrétaire de la MTEA. « Les vulgarisateurs ont des compétences techniques qu’ils ontacquises à l’université. Ils souhaitent travailler avec nous car nos groupes de paysans sont déjà constitués autour de thèmes précis et c’estplus facile pour les vulgarisateurs d’apporter leur savoir technique dans un tel cadre ».Les paysans sont très demandeurs de ces démonstrations techniques sur leurs propres parcelles. Ils peuvent même mettre plusieurshectares à disposition à cette fin. La MTEA établit les critères de l’expérimentation en précisant que les parcelles doivent être proches d’uneroute afin que tout le monde puisse voir les résultats en passant. Les paysans apportent une contribution importante, en terres, en argent,en travail et en gestion des parcelles. Le reliquat est demandé à des bailleurs de fonds. Comme les paysans ont choisi eux-mêmes les thèmesdes essais et ont demandé les démonstrations techniques, ils suivent les résultats avec beaucoup d’intérêt. La MTEA appuie environ 25 à 30essais de ce type chaque saison, pour des cultures comme le maïs, plus une cinquantaine de parcelles de cultures pérennes comme le café,la banane ou l’ananas. Les parcelles sont installées côte à côte, ce qui permet de comparer les résultats de différentes variétés de maïs oud’engrais vert préparé avec un fertilisant liquide à base de fumier.Les animateurs de la MTEA visitent chaque site au moins trois fois par saison : au moment des plantations, lorsque les cultures sont àhauteur de genou et pendant les récoltes. À ces occasions, ils aident les vulgarisateurs à organiser des journées sur le terrain avec lespaysans : ce sont des moments privilégiés, non seulement pour contrôler les parcelles mais aussi pour discuter des questions relatives aux86
Alphabétisation et langues nationalesinsectes nuisibles et aux maladies ou à tout autre question que les paysans ont à poser. En général, une quarantaine de paysans participentà ces journées : plus de femmes que d’hommes car ce sont les femmes qui assurent les travaux des champs, notamment la plantation et lesarclage. Comme le disait un animateur de la MTEA : « les femmes portent toute la responsabilité de nourrir la famille. Elles doivent travaillerdur pour assurer la sécurité alimentaire dans le foyer ».Former les formateursLa formation constitue une autre partie essentielle du travail de laMTEA. Elle intervient dans de nombreux domaines, de l’alphabétisationà la santé reproductive et des techniques agricoles à lagestion des entreprises. La MTEA propose environ cinq cours d’une àdeux semaines par an pour une trentaine de participants par cours.Les formateurs peuvent être des vulgarisateurs, des spécialistes desservices publics de santé, voire même des animateurs de la MTEA.Les formations se déroulent alternativement dans différentes localitéspour permettre aux paysans, surtout aux femmes, d’y participer. Lesassociations membres désignent les candidats à la formation. À l’issuede celle-ci, ils doivent à leur tour former les autres membres dugroupe. Quand ils ont acquis un certain niveau de compétence etd’expérience, ils peuvent être promus aux fonctions de formateurs àpart entière. Ils sont maintenant plus de 120 dans ce cas, spécialisésdans différentes disciplines. La MTEA leur propose périodiquementdes sessions de recyclage pour actualiser leur savoir et leurscompétences.La formation des formateurs, l’accompagnement des ONG locales et lacoordination des expérimentations et des démonstrations réalisées avecle concours des paysans figurent parmi les activités de la MTEA(Photo : Paul Mundy)La MTEA elle-même a développé les compétences de ses animateurs. La plupart d’entre eux sont polyvalents : ils peuvent répondre à denombreuses questions relatives à l’agriculture et au développement rural. Cela leur confère une grande crédibilité vis-à-vis des personnesavec lesquelles ils sont amenés à travailler.C’est n’est pas tous les jours dimancheLe succès de la MTEA s’explique largement par l’implication et la motivation de ses employés. En fait, le terme « employés » est impropre.Tous sont volontaires. Leurs frais sont pris en charge mais aucun d’entre eux ne perçoit de salaire. Ils ont tous leur propre occupation dansleurs champs ou ailleurs. « Certains groupes se forment du sommet à la base ; nous, c’est de la base au sommet que nous nous sommesconstitués ». C’est de cette façon imagée que l’approche de la MTEA est décrite par un de ses animateurs.87
Il y a toujours des problèmes et des défis à relever : « Ce n’est pas tous les jours dimanche », dit un animateur. L’équipe doit travailler durpour réaliser son programme. Le suivi et la supervision des associations partenaires est une tâche particulièrement ardue, qui prend dutemps et coûte de l’argent.Les révolutions de l’informationLes membres de la MTEA doivent payer une cotisation annuelle de 20 000 shillings ougandais (environ 13 e) pour un groupe ou 1 000shillings (0,67 e) pour un membre individuel. Les documents et les livrets de formation sont également payants : environ 100 shillings lafeuille. C’est une façon de valoriser ces documents et d’éviter qu’ils ne soient jetés. Ces ressources ne sont pas suffisantes pour permettreà l’organisation de fonctionner normalement. Les ressources complémentaires reposent sur les dons des amis et partisans de l’associationet le soutien de « Vredeseilanden Coopibo », une ONG belge.Plus qu’une bibliothèqueLe centre de ressources de la MTEA se trouve dans une petite pièce attenante, garnie d’étagères et pleine de tables de lecture et de chaises.Des livres, offerts par la LABE (voir p. 79) et BookAid (une ONG britannique) remplissent les étagères. Il y a des encyclopédies, des livresscolaires et universitaires, ainsi que des magazines comme Footsteps, un bulletin pratique sur le développement publié par « Tear Fund »,en Grande-Bretagne. Certains livres ne sont pas forcément adaptés au contexte : bizarrement, on trouve plusieurs exemplaires desPrincipes de l’Océanographie, qui ne sera probablement pas le livre le plus demandé dans un pays enclavé comme l’Ouganda. Cependant,la plupart des ouvrages semblent très utiles et souvent consultés.Michael Bazira, qui gère le centre de ressources, explique que cette pièce est plus qu’une bibliothèque. C’est aussi l’espace où la MTEAorganise une série de sessions de formation très animées sur des sujets pratiques comme la rédaction de lettres en anglais, la grammaire,la gestion des bibliothèques ou la gestion administrative. Michael espère obtenir la reconnaissance de ces sessions par le Bureau nationaldes examens, afin que les stagiaires puissent obtenir des diplômes reconnus. Il espère aussi proposer des cours d’informatique en utilisantl’unique ordinateur (un peu poussif) de la MTEA.Le “E” de MTEA signifie « emploi ». Plusieurs participants aux cours de formation ont pu créer leurs propres activités, une école ou unélevage de volaille…C’est un succès appréciable en hommage aux efforts de cette organisation de base pour le développement.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESMulti-Purpose Training and Employment Association, PO Box 93, Iganga (Ouganda). Tél. (256) 43 242204Carter, I. 1999. Locally Generated Printed Materials in Agriculture: Experience from Uganda and Ghana. DFID Education Papers 31.Department for International Development (DFID), Londres (Royaume-Uni)88
Alphabétisation et langues nationalesDes publications en langues nationales pour les paysansÀ quoi sert l’alphabétisation s’il n’y a rien à lire ?Jacques SultanMaintenir un environnement lettré dans les villagesIl est difficile de trouver des journaux à Tanghin Dassouri. Ce village ne se trouve pourtant qu’à une trentaine de kilomètres deOuagadougou, sur l’axe routier qui conduit à Bobo-Dioulasso.Mais il est encore plus difficile de les trouver dans les villages voisins, à l’écart de la route. Les sources d’information y sont presqueinexistantes ; seule la radio alimente un lien fragile de communication avec l’extérieur. Un lien fragile car tous les villages ne sont pas dansle champ d’émission des quelques radios de proximité de la région.Dans ces villages, des campagnes d’alphabétisation en langues nationales sont organisées depuis plusieurs années. Elles ont apporté à lapopulation l’espoir de disposer d’un moyen d’accès à l’information, à la culture, à la formation et à l’autonomie à travers la lecture etl’écriture. Mais bien souvent, ces campagnes ne sont pas d’une durée suffisante pour que les apprentissages soient acquis de façon durableet les villageois alphabétisés ne disposent en général d’aucun document leur permettant de lire régulièrement et de consolider ainsi leurapprentissage.Des dispositifs de post-alphabétisation basés sur des formations techniques spécifiques sont théoriquement prévus autour de projetsconcrets comme la gestion de moulins, la transformation du beurre de karité, le petit élevage mais ils ne sont pas organisés de façonrégulière.Les paysans alphabétisés n’ont rien à lire et ils se découragent car ils voient leur apprentissage initial se perdre.« Ceux qui ont la volonté d’arranger »Face à cette situation, un groupe d’alphabétiseurs de la région a décidé de réagir en créant une association qu’ils ont appelée« Ratamanegré » (ceux qui ont la volonté d’arranger) et un centre d’information et de formation communautaire, basé à Tanghin Dassouri,dans le but de maintenir un environnement lettré en milieu rural, à travers un dispositif de collecte et de diffusion de documents écrits enlangues nationales dans les villages.Ils ont ainsi constitué un fonds de documents écrits, en langues nationales : collection des principaux journaux en langue moore, livretstechniques sur l’agriculture villageoise, la gestion des petites unités économiques et les moulins, documents sur la santé, le planning familial,89
l’excision, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA,contes, récits, monographies de villages, recueils d’histoires humoristiquesécrits par les villageois eux-mêmes…Les révolutions de l’informationCes documents sont mis à la disposition des alphabétiseurs qui assurent leurvente dans les villages. Les bénéfices réalisés permettent de renouveler lefonds et les abonnements aux journaux. L’association tire également sesressources de kermesses et de bals populaires qu’elle organise dans lesvillages, à l’occasion des foires et des marchés villageois.Des bibliothèques itinérantes« Tous les documents que nous utilisons pour l’alphabétisation, pour laformation technique et pour la post-alphabétisation », dit Ablasse Zongo, le président de l’association, « nous pouvons maintenant les fairecirculer de village en village grâce à un appui que nous a récemment apporté une ONG européenne, le GRAD (Groupe de réalisationsaudiovisuelles pour le développement) ».Cet appui a permis à l’association d’enrichir et de consolider son fonds de documents et surtout de fabriquer des caissettes en bois quiconstituent de véritables bibliothèques itinérantes. Chargées sur des vélos, elles circulent de village en village.Cette initiative a été accueillie avec enthousiasme dans les villages car elle a permis de sortir de nombreux villageois néo-alphabétisés dudécouragement en leur fournissant un environnement lettré. Certains pouvaient faire plusieurs kilomètres pour ne pas manquer le passagede la bibliothèque itinérante.« Aujourd’hui, nous sommes mieux armés pour mettre des documents à la disposition des villageois », dit Ablasse Zongo. « Avec lesressources que nous avons obtenues, nous allons même construire notre propre local pour être plus indépendants et ne pas avoir à payerde loyer ».Les activités de l’association se développent. Le système d’échanges qu’elle a mis en place a également permis de recueillir plussystématiquement des textes produits par les villageois, en langues nationales (contes, récits, monographies villageoises…) et de lesproposer, pour publication, aux journaux en langues nationales existants.Les journaux ruraux jouent-ils leur rôle ?Les alphabétiseurs de Ratamanegré à Tanghin Dassouri(Burkina Faso) et quelques documents d’alphabétisationpréparés par leurs soins(Photo : Jacques Sultan)« L’association des alphabétiseurs de Tanghin Dassouri et le centre d’information et de formation communautaire sont une initiativeexemplaire qu’il faudrait faire connaître et multiplier dans tout le pays » dit Evariste Zongo, responsable de l’AEPJLN (Association deséditeurs et promoteurs des journaux et revues en langues nationales).90
Alphabétisation et langues nationales« Au Burkina Faso, les programmes d’alphabétisation en langues nationales ont créé un important lectorat potentiel en milieu rural », ajouteEvariste Zongo. « Le développement de ces campagnes d’alphabétisation, la nécessité d’entretenir un environnement lettré et ladémocratisation de la vie publique ont ouvert le champ à la parution de journaux et de revues en langues nationales, principalement diffusésen milieu rural ». En quelques années, en effet, plus de 20 journaux ont ainsi été créés dans le pays. Mensuels, bimensuels, trimestriels ousemestriels, ces journaux sont publiés dans 7 langues nationales du Burkina Faso. Ils couvrent les principales régions du pays, avec destirages de quelques centaines à 8 000 copies pour les titres les mieux diffusés.« Mais ces journaux assurent-ils vraiment mission d’information dans le milieu rural », s’interroge Evariste Zongo ? « Remplissent-ils le rôlede lien social que l’on attend d’un journal ? Ont-ils réuni des conditions de durabilité ? »Une étude menée en 1993 sur la presse en langues nationales a apporté quelques réponses à ces questions :• La plupart des journaux en langues nationales ont été créés par des ONG, desprojets, des associations locales dans le but de véhiculer des messagestechniques sur l’agriculture et l’élevage, ou de sensibiliser la population surles questions de santé, d’hygiène ou d’environnement. Ils ne jouent pas lerôle d’outil de communication interactive et de lien social que l’on attendgénéralement d’un journal ;• Ils sont animés par des bénévoles qui n’ont pas reçu de formation spécifiquepour collecter l’information, rédiger un article dans une langue accessible auxlecteurs, proposer un contenu et une mise en page attractive ;Evariste Zongo, responsable de l’AEPJLN,à Ouagadougou (Burkina Faso)(Photo : Jacques Sultan)• Ils sont dépendants des organismes qui les financent et paraissent de façonirrégulière car ils n’ont pas de stratégie de développement fondée sur unefidélisation du lectorat, la promotion des activités du journal et la recherchede partenariats durables ;• Ils rencontrent des problèmes de distribution, à l’exception de ceux qui sont soutenus par des organisations qui disposent d’un réseausur le terrain ;• Ils ne répondent pas vraiment à la demande des lecteurs, qui est d’abord une demande d’information générale, sociale, politique etculturelle qui leur apporte une ouverture sur le monde.Émanciper la presse en langues nationales« C’est ce constat que nous avons fait », ajoute Evariste Zongo « et notre objectif principal est d’émanciper cette presse en langues nationalespour qu’elle assure pleinement sa fonction d’information du monde rural. Nous nous sommes engagés dans cette entreprise avec une petite91
Quelques journaux en langues locales soutenus par l’AEPJLNLes révolutions de l’informationéquipe, des moyens techniques de publication assistée par ordinateur (PAO) et une capacité de formation. Nous avons obtenu un soutiende la coopération suisse et en qualité d’association représentant les journaux et revues en langues nationales, nous sommes attributairesd’une part de l’aide publique que l’État accorde à la presse privée ».L’AEPJLN a d’abord entrepris une campagne de sensibilisation des promoteurs des journaux en langues nationales pour leur montrer qu’ilspouvaient mieux répondre aux besoins d’information et d’expression du monde rural ; puis, elle leur a proposé une série de sessions deformation et de recyclage sur les techniques de collecte de l’information, de rédaction, de présentation et de mise en page, ainsi que sur lagestion des entreprises de presse. Ces formations ont eu pour effet une amélioration sensible du contenu éditorial et de la présentation desjournaux.La plupart de ces journaux ont constitué des comités de rédaction qui associent des producteurs ruraux alphabétisés à la collecte del’information, ce qui leur permet de se rapprocher de leurs lecteurs et de rendre compte des expériences locales et de la réalité desproblèmes du terrain.« Ces bases étant acquises, nous sommes devenus plus sélectifs dans le recrutement de nos membres », ajoute Evariste Zongo. « Désormais,pour adhérer à l’AEPJLN et bénéficier de son appui, les journaux doivent satisfaire à un certain nombre de critères garantissant leurprofessionnalisme : mise en place et animation d’un réseau de correspondants, gestion d’un circuit de distribution, développement d’outilsde gestion et d’administration du journal, régularité de publication… ».Mettre en place de véritables réseauxSur le long terme, l’AEPJLN a entrepris de consolider la professionnalisation du secteur de l’édition en langues nationales à travers trois axesd’intervention : la distribution, l’encouragement à la création d’entreprises de presse et le développement de partenariats.C’est le principal problème de la plupart des journaux. Pour améliorer la diffusion, il est essentiel de mobiliser systématiquement lesorganisations disposant de structures décentralisées sur le terrain, jusqu’au niveau villageois : organisations paysannes, ONG, partenaireséconomiques du monde rural (sociétés cotonnières, banques, organismes de crédit rural, commerçants…).Les circuits d’alphabétisation seront particulièrement mobilisés. En effet, il existe dans chaque village un ou deux alphabétiseurs, qui sontvolontaires, compétents et qui peuvent, comme à Tanghin Dassouri, assurer la distribution, jouer le rôle de correspondants locaux etdistribuer d’autres documents intéressant les producteurs (brochures, livrets techniques, manuels, contes, récits…).92
Alphabétisation et langues nationalesENCADRÉ 9Un service d’édition en langues nationales chez les frères missionnaires d’AfriqueÀ Koudougou, tout le monde connaît Maurice Oudet. Il appartient à la communauté des missionnaires d’Afriquedans cette petite ville située à 85 km à l’ouest de Ouagadougou. Engagé depuis des années dans l’action pourle développement local, il a toujours déploré la rareté des publications en langues nationales, qui limite l’accèsdes populations rurales alphabétisées à l’information.Produire des documents pour les paysans, en langues nationalesIl a donc entrepris de mettre sur pied, à partir des ressources de sa communauté, un service d’édition dedocuments en langues nationales. Il dispose pour cela d’un équipement de PAO (ordinateur, scanner, appareilde photo numérique) et d’un duplicateur numérique. Il travaille avec un réseau de collaborateurs pour recueilliret traduire les documents existants dans différentes langues nationales ou pour écrire des documents originauxà partir des expériences villageoises.Au départ, Maurice Oudet a créé une revue trimestrielle du monde rural en moore, Tengembiiga, et en dioula,dugulen (avec une version en français Les amis de la terre, destinée à assurer la promotion auprès despartenaires francophones). La revue est vendue 150 F CFA (0,22 e). Elle a beaucoup de succès et lademande des lecteurs ruraux est très importante mais la faiblesse du réseau de distribution limite le tirage à2 000 exemplaires en moore et 1 000 en dioula.Le service d’édition propose également des prestations de traduction, de mise en page et d’édition à tous lesorganismes qui souhaitent publier des documents en langues nationales. C’est le cas notamment pour les« cahiers ruraux », publication du CESAO, dont plusieurs numéros sont ainsi traduits et distribués en languesnationales, ou pour l’almanach du monde rural, édité en collaboration avec une ONG de Bobo-Dioulasso,l’Assistance écologique.Adapter l’informatique et l’Internet aux langues nationalesPassionné d’informatique, Maurice Oudet a mis au point un système qui permet d’adapter les lettres, lescaractères et les accents propres aux langues du Burkina aux claviers des ordinateurs, en saisie directe. Il estégalement membre d’un groupe d’internautes qui travaillent à l’introduction des langues africaines sur l’Internet.Aujourd’hui, ce service d’édition en pleine expansion propose une collection importante d’articles et d’ouvragessur des thèmes très divers : la lutte contre l’érosion, la fabrication du compost, l’utilisation des engrais,l’animation villageoise, la gestion des récoltes, les semences améliorées…(suite au verso)93
Les révolutions de l’informationEn haut : brochage des livrets édités par lesFrères missionnaires d’Afrique à Koudougou(Burkina Faso)(Photo : Jacques Sultan)En bas : Maurice Oudet, le prêtre internaute deKoudougou (Burkina Faso), prépare unepublication en langue locale(Photo : Jacques Sultan)Les jeunes de Koudougou et les responsables d’associations etd’ONG viennent au centre des missionnaires d’Afrique se formerà l’informatique, à la PAO et à la messagerie électronique.Un projet est en cours avec la radio locale de Koudougou pour lapublication d’un bulletin en langue nationale, destiné à prolongeret approfondir les programmes de la radio destinés au publicrural.Résoudre les problèmes de distributionPour rentabiliser ses équipements et systématiser son action,le service d’édition est à la recherche de partenariats avec lesorganisations paysannes et notamment avec la Fédérationnationale des organisations paysannes du Burkina (FENOP),qui a réalisé une importante étude des besoins des paysans enmatière d’information, de formation et de communication. Uncomité de rédaction commun avec cette organisation est encours de négociation. Il permettrait de programmer la publicationd’une série de bulletins, manuels et fiches techniquesd’information et de formationrépondant aux besoins desproducteurs.La fabrication des documentsse ferait à Koudougou avec leséquipements techniques duservice d’édition et la diffusionserait assurée à travers le réseaude cette organisation paysanne,qui couvre toutes les régions dupays.94
Alphabétisation et langues nationalesTransformer des journaux artisanaux en entreprises de presseIl s’agit de rendre les journaux capables de fonctionner de façon autonome et de s’autofinancer en recherchant des partenariats avec lesacteurs sociaux, économiques et culturels présents dans le milieu. Des accords sont actuellement en cours de négociation avec plusieursde ces partenaires, comme la société cotonnière SOFITEX, le réseau des caisses populaires de crédit agricole, les ONG, les organisationspaysannes et les projets présents sur le terrain.« Ces négociations sont quelquefois difficiles », dit Evariste Zongo, « car certains de ces partenaires ne sont pas disposés à voir se développerdes journaux indépendants avec une ligne éditoriale autonome, qui pourrait être contraire à leurs intérêts. Quand ils participentfinancièrement au développement du journal, ils entendent en contrôler le contenu et le limiter aux messages techniques qu’ils souhaitentdiffuser, en évitant tout débat sur leurs activités. C’est le cas notamment des grandes sociétés qui contrôlent les cultures industriellescomme le coton. »Tout le travail de l’AEPJLN consiste à persuader ces opérateurs que le débat démocratique constitue la base du respect mutuel entre lesacteurs de la vie économique et sociale du monde rural et que des journaux indépendants peuvent jouer ce rôle et apporter une garantied’équilibre et de transparence dans un débat qui est souhaitable et, de toute façon, incontournable.Pour jouer ce rôle, les journaux ruraux doivent devenir plus professionnels et savoir s’organiser en groupes de presse capables de travailleravec l’ensemble des partenaires présents dans le monde rural, en fournissant à chacun la capacité de s’exprimer, tout en maintenant uneligne éditoriale indépendante (voir encadré 9).Développer un partenariat avec les autres médiasC’est le troisième axe d’intervention de l’AEPJLN. Les radios de proximité sont de plus en plus présentes en milieu rural. Elles constituentle complément naturel des journaux. Ces deux médias peuvent se rendre des services mutuels importants. Les radios peuvent assurer lapromotion des journaux, informer sur leur contenu, indiquer les lieux de distribution, inciter les lecteurs à les acheter. Elles peuvent aussiproposer des revues de presse en langues nationales, organiser des émissions publiques, des tables rondes, des débats sur les thèmes desarticles de la presse écrite pour consolider leur impact et prolonger oralement les débats qu’ils suscitent.Les journaux, quant à eux, apportent une information plus permanente, plus durable. Ils peuvent proposer aux auditeurs des radios laréférence écrite des thèmes des émissions et vulgariser les grands textes sur la décentralisation, la réforme agraire, les lois foncières, lesrègles de fonctionnement des organisations paysannes…Les livrets techniques et ouvrages de vulgarisation sont également des supports qui doivent être conçus en complémentarité avec lesjournaux et les radios. Ils peuvent apporter des contenus plus complexes et plus techniques avec des formats adaptés à des activités deformation ou de vulgarisation.95
« Notre conviction », conclut Evariste Zongo, « c’est que les outils d’information écrits et sonores doivent se compléter pour donner auxpaysans, dans leurs langues, l’information à laquelle ils ont droit pour maîtriser leurs activités et prendre leurs décisions. Et c’est cela notrebut ».INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESLes révolutions de l’informationMaurice Oudet, BP 332, Koudougou (Burkina Faso). Tél. (226) 44 03 56 ; e-mail oudet.maurice@fasonet.bfAblasse Zongo, Centre d’information et de formation communautaire, Tanghin Dassouri (Burkina Faso)Evariste Zongo, Association des éditeurs et promoteurs de journaux et revues en langues nationales (AEPJLN), BP 1197,Ouagadougou 01 (Burkina Faso). Tél. (226) 31 80 75 ; e-mail Evazongo@hotmail.com96
Alphabétisation et langues nationalesAu Burkina Faso, des paysans journalistesDes paysans qui créent leurs réseaux d’information…Jacques Sultan« Est-ce vraiment honnête d’aller vers les paysans, de recueillir de l’information auprès d’eux, de la diffuser dans le monde entier et de lespriver de cette information ? » demande Souleymane Ouattara, le journaliste responsable de l’Agence Syfia, un réseau spécialisé dansl’information agricole au Burkina Faso.« Tout au long de l’année », ajoute-t-il, « nous sillonnons les villages pour faire des reportages, conduire des enquêtes, recueillir destémoignages, mener des interviews portant sur les activités des paysans, leurs problèmes, leurs interrogations, leurs initiatives… Cetteinformation, que nous recueillons souvent en langues nationales, nous la transcrivons en français et elle est répercutée, par notre agence,à une centaine de journaux qui la reprennent pour un lectorat généralement francophone.« Quelle est la part de cette information qui revient aux paysans, aux villageois, qui sont nos sources sur le terrain ? » Souleymane Ouattararépond à sa propre question : « elle est infime, parce qu’ils ne sont pas francophones et que les journaux qui reprennent cette informationne leur parviennent pas. Ce serait juste, pourtant, qu’ils sachent ce que l’on dit d’eux et comment d’autres paysans, ailleurs, trouvent dessolutions à des problèmes qui ressemblent aux leurs. Mais comment faire pour que ce retour d’information vers les paysans puisseréellement exister ? »Avec Souleymane Ouattara, un groupe de journalistes africains, tous correspondants de l’Agence Syfia, ont fondé l’association JADE(Journalistes africains pour le développement) en 1994, pour trouver une réponse à ces questions et pour réfléchir ensemble aux problèmesliés à leur métier et à leurs rapports avec les populations rurales qui sont leurs principales sources d’information.Au Burkina Faso, les journalistes qui se sont engagés dans cette association ont tenté d’explorer, avec les paysans et les producteurs ruraux,des voies nouvelles pour apporter l’information dans les villages, la débattre et promouvoir des échanges, de village à village, de région àrégion, de pays à pays.Des paysans qui deviennent les producteurs et les gestionnaires de leur propre information : est-ce une utopie ?Organiser des débats dans les villages…« Nous avons mené une première expérience à Tanghin Dassouri, un village situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Dans cevillage, un groupe d’alphabétiseurs a créé une association pour aider à la diffusion de l’information en langues nationales dans les villagesvoisins » (voir p. 89).97
Les révolutions de l’informationL’équipe de Jade a proposé aux alphabétiseurs de choisir,dans le menu de la production mensuelle de l’agence Syfia,les articles qui les intéressaient plus particulièrement. Lesthèmes ont été choisis en raison du retentissement qu’ilspouvaient avoir sur la vie quotidienne de la communauté,même si l’information avait été recueillie dans une autrerégion ou dans un autre pays, comme par exemple le droitde cuissage dans les écoles béninoises, les maladies porcinesau Tchad ou l’excision au Mali.Interview de paysans pour une émission radio au Burkina Faso(Photo : Souleymane Outtara, JADE)À partir de ces choix, les articles ont été traduits en langue nationale, en surveillant les contresens éventuels qu’une mauvaise traductionpeut engendrer ; c’est une première façon de s’approprier le contenu de l’article. Le sujet a été ensuite exposé à des groupes de paysans,en langue nationale.L’expérience a été concluante. Les discussions qui ont suivi la lecture des articles ont été souvent passionnées car les thèmes abordésrenvoyaient à des questions que les villageois se posaient, mais qu’ils n’avaient pas l’habitude de débattre directement en raison desblocages et les tabous sociaux ou culturels qu’il fallait surmonter. C’est plus facile quand le point de départ repose sur une réalité vécuedans un autre environnement ; c’est comme si on évoquait une réalité extérieure au village et le débat sur les problèmes concrets du villagedevient possible.…et en faire des programmes radiophoniques, diffusés par les radios localesLes discussions ont été enregistrées au magnétophone, puis diffusées sous forme de programmes par les radios locales. Les auditeurs ontaccueilli ces programmes avec enthousiasme. Ils demandent la diffusion régulière de telles émissions qu’ils jugent particulièrementintéressantes parce qu’ils en sont les protagonistes et qu’elles permettent de débattre de problèmes cruciaux en partant de la façon dontils sont vécus ailleurs.« Dans nos pays », ajoute Souleymane Ouattara, « il y a une véritable inflation de médias, surtout de radios en milieu rural. Malheureusement,cela ne va pas de pair avec une participation des gens, ni même avec la satisfaction de leurs besoins ».« Le tout n’est pas de créer des radio, ou des journaux », souligne-t-il. « Il faut aussi leur donner un contenu, et cet aspect est bien souventnégligé. Si nous avions sur place des gens capables de prendre en charge cette dimension, il est évident que nous aurions des radios quiparleraient aux gens et dans lesquelles ils pourraient se reconnaître ».« À Jade, c’est ce que nous voulons faire », conclut-il, « car nous sommes convaincus qu’on peut, avec des méthodes simples, former despaysans à faire de la bonne radio, de bons journaux. À partir du moment où ils sont alphabétisés dans leurs langues, ils ont déjà un acquisimportant. Il leur manque seulement des outils, une formation adaptée et un suivi. »98
Alphabétisation et langues nationalesDes comités de rédaction paysans pour les journaux rurauxUne autre initiative, entreprise par deux journaux ruraux, va dans le même sens. Il s’agit de Venegda publié en langue moore et Hakilifalenpublié en langue Dioula. Ces deux journaux existent depuis 7 ans et sont publiés avec le soutien de l’INADES Formation-Burkina Faso.Une évaluation du fonctionnement et de l’impact de ces publications a mis en évidence un décalage important entre la rédaction desjournaux et leurs lecteurs. Pour le corriger, les promoteurs de ces journaux ont décidé d’associer les lecteurs en organisant des comités derédaction paysans et en suscitant la production d’articles provenant des lecteurs eux-mêmes.Une quarantaine de comités ont été ainsi mis en place dans leszones de diffusion des journaux. Ces comités ont procédé à uneanalyse du contenu et de la forme des journaux et ils ont fait despropositions pour que la ligne éditoriale des journaux soit plusadaptée à leurs préoccupations et à leurs besoins. Les paysansmembres des comités de rédaction ont bénéficié d’une formation etd’un appui technique et ils ont commencé à fournir des articles àpartir d’une information recueillie à la base. Un processus de miseen réseau des différents comités de rédaction a été engagé à traversl’organisation d’ateliers de concertation.Vers une agence de presse paysanneCes deux expériences sont encourageantes car elles montrent quede réelles possibilités de développement de la presse et de la radioexistent en milieu rural, à condition d’y associer les lecteurs et lesauditeurs. La matière première est inépuisable car les initiativeslocales sont nombreuses et le milieu paysan est une sourced’information riche et vivante.Utilisation d’un micro girafe improvisé pour interviewer des agricultrices auBurkina Faso(Photo : Souleymane Outtara, JADE)Le projet de JADE repose sur cette capacité des paysans à devenir des « communicateurs endogènes » : avec une organisation et des moyensappropriés, des associations d’alphabétiseurs, des organisations paysannes ou d’autres groupes organisés en milieu rural peuvent seconstituer en comités de rédaction locaux, choisir des thèmes d’intérêt commun, aller recueillir l’information dans les villages sous formed’interviews, de débats ou d’enquêtes, traiter cette information et la faire remonter vers les médias ruraux à travers une structure centralede gestion de l’information.Ces groupes deviendraient ainsi des correspondants de presse en milieu rural et ce système pourrait constituer l’amorce d’une agence depresse paysanne qui redistribuerait cette information vers les journaux en langues nationales et les radios locales.99
Ces correspondants locaux pourraient devenir de véritables professionnels de l’information rurale, être rémunérés sur la base de leurproduction et rentabiliser leurs activités en assurant également la distribution des journaux et d’autres publications en langues nationales.Ils pourraient exploiter d’autres supports, comme la vidéo, les audiocassettes, les affiches pour valoriser les informations et les savoirspaysans.Les révolutions de l’informationPour les journaux et les radios en langues nationales, l’existence d’une agence de presse rurale, capable de faire remonter du terrain uneinformation authentique, en langues nationales, sous une forme exploitable par les rédactions, pourrait constituer un appui extrêmementprécieux. Elle leur permettrait d’améliorer leur audience en proposant à leurs lecteurs et leurs auditeurs un contenu plus riche, plusdirectement en rapport avec les problèmes rencontrés sur le terrain et plus interactif. Cette idée devient même l’élément de base desstratégies de communication de nombreuses organisations œuvrant au développement rural, comme la FENOP, la Fédération nationale desorganisations paysannes au Burkina Faso (voir encadré 9).Des communicateurs paysans ? Non, ce n’est pas une utopie… C’est une réalité en train de se construire.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESH. dè Millogo, INADES Formation–Burkina Faso, BP 1022, Ouagadougou (Burkina Faso). Tél. (226) 30 20 70 ; fax (226) 34 05 19 ;e-mail inadesb@fasonet.bfSouleymane Ouattara, Journalistes africains pour le développement (JADE), BP 6624, Ouagadougou (Burkina Faso). Tél. (226) 31 30 98 ;fax (226) 31 30 99 ; e-mail jade.jusol@fasonet.bf100
Introduire l’Internet en Afrique : Africa Online et l’initiative « e-touch »Information communautaire et nouvelles technologies : le télécentre communautaire de NakasekeTéléphonie mobile en Afrique rurale : il y a tellement de choses à dire…Informatique et télécommunications
Ce sont les nouvelles stars sur la scène de la communication. L’informatique bouleversela façon dont l’information est recueillie, produite, gérée et diffusée. Les auteurs descénarios et les rédacteurs de journaux n’ont plus besoin de travailler sur des manuscritsrédigés à la main, les secrétaires et les dactylos n’ont plus à taper et à retaper des pageset des pages de textes. La transition vers les nouvelles technologies n’est pas encoreachevée dans les pays en développement mais elle est engagée.Les révolutions de l’informationL’alliance de l’informatique et des télécommunications a produit le courrier électronique etl’Internet. Ces nouveaux médias sont en train de révolutionner la communication et l’accèsà l’information dans les pays développés. Comment se développeront-ils (et dans quelsdélais ?) dans les zones rurales reculées ? Cela demeure une inconnue mais il est clairqu’ils ont déjà un impact sur le développement que personne n’avait prévu.Une autre technologie se répand aussi vite que l’Internet (si c’était possible) : le téléphoneportable. C’est un outil idéal pour les zones rurales : la technologie est peu coûteuse àmettre en place, facile à utiliser et elle répond à un besoin essentiel. Nous ne sommespeut-être pas éloignés du moment où les boutiquiers, les agriculteurs, les chauffeurs detaxis de brousse auront un portable accroché à la ceinture.102
Informatique et télécommunicationsIntroduire l’Internet en AfriqueAfrica Online et l’initiative « e-touch »Paul MundyL’Afrique distancéeL’Afrique est distancée par rapport aux enjeux d’Internet. En dehors de l’Afrique du Sud, seulement un Africain sur 9 000 dispose d’un accèsà l’Internet (contre 1 personne sur 38 dans le reste du monde). Selon le CRDI (Centre de recherche pour le développement international),l’Afrique ne peut pas se permettre de manquer le rendez-vous de la révolution de l’information et ses implications en termes dedéveloppement économique et social.L’Afrique est dramatiquement sous-équipée en infrastructures de base. L’électricité et le téléphone sont rares dans les zones rurales. Peu degens peuvent se permettre l’achat d’un ordinateur ou savoir ce qu’ils permettent de réaliser. Dans les zones rurales, les niveaux d’éducationsont faibles et l’analphabétisme reste important. Pour la majorité des gens, les ordinateurs et l’Internet sont encore une perspective lointaine.Pourtant des progrès ont été réalisés. En 1996, seuls 19 pays disposaient d’un accès complet à l’Internet. En 1999, ils étaient 53 : toutel’Afrique sauf le Congo, la Somalie et l’Erythrée. Les chiffres varient mais on peut estimer qu’en 1999, les pourvoyeurs d’accès à l’Internetétaient au nombre de 339 à travers le continent et les abonnés de l’ordre de 500 000 (la moitié d’entre eux étant situés en Afrique du Sud).Plusieurs partenaires de coopération ont joué un rôle important pour aider à l’introduction d’Internet en Afrique. Il s’agit notamment del’Initiative Acacia du CDRI, de l’initiative Leland de l’Agence internationale pour le développement des États-Unis (USAID), de l’Institut derecherche pour le développement (IRD) en France et d’ONG comme Volonteers in Technical Assistance (VITA). Mais les ressources desbailleurs de fonds ne peuvent pas tout résoudre. Pour parvenir à une situation durable, il faut que la révolution de l’information prenne sadimension économique en Afrique. Les sociétés privées proposant un accès à l’Internet n’investiront en Afrique que si elles identifient desopportunités commerciales et des perspectives de rentabilité.L’Afrique en ligneAfrica Online semble avoir identifié une telle niche. Cette société, basée à Nairobi, couvre le Kenya mais aussi la Côte d’Ivoire, le Ghana, leSwaziland, la Tanzanie, l’Ouganda et le Zimbabwe. En janvier 2000, elle a acquis Net-2000, une autre grosse société kenyane de fournitured’accès à l’Internet, devenant ainsi la première société africaine dans ce domaine (en dehors de l’Afrique du Sud), avec 20 000 abonnés pourle seul Kenya. Elle a le projet de s’implanter dans au moins cinq nouveaux pays.Trois étudiants kenyans de l’Institut de technologie du Massachusetts ont créé Africa Online en 1994. Au départ, c’était une sociétéspécialisée dans le courrier électronique. À cette époque, tous les autres étudiants pensaient qu’ils étaient fous : les ordinateurs et le courrier103
électronique étaient des outils réservés à quelques fanatiques des nouvelles technologies.Seulement quelques-uns comprirent la place que ces médias allaient prendre et à quelleséchéances.Au Kenya, Africa Online propose les services d’Internet dans les grandes villes comme Nairobi etMombasa, naturellement. Toutefois, elle a aussi étendu son activité à de plus petits centres,comme Kisumu, Eldoret, Nakuru et Kitale. Environ 40 % des abonnés à cette compagnie se situent hors de Nairobi.Les révolutions de l’informationLes abonnés sont essentiellement des hommes et des femmes d’affaires, qui seuls sont en mesure de payer le service : en fait, ils se sontrendu compte qu’ils ne pourraient pas le faire sans l’Internet et le courrier électronique. « Nous avons besoin d’environ 300 abonnés dansune zone, pour justifier la mise en place d’un serveur » explique James Ochola, le responsable commercial de la société. Et il est nécessaire,bien sûr, que les services téléphoniques soient fonctionnels : Africa Online a besoin d’environ une ligne pour 10 abonnés pour s’assurer queles utilisateurs n’auront pas de problèmes de connexion.La messagerie électronique : un outil essentielLa messagerie électronique est rapidement devenue un outil vital pour les organisations de développement. Examinez un annuaire d’ONGet d’organismes gouvernementaux ; vous constaterez qu’ils disposent de plus en plus souvent d’adresses e-mail. Ils utilisent la messageriepour envoyer des messages à d’autres organismes ou dans leurs propres structures, pour demander de l’information, pour organiser desréunions, négocier des contrats, soumettre des rapports et maintenir des contacts avec leurs interlocuteurs, dans le pays comme àl’étranger.La messagerie électronique et les services d’Internet sont toujours coûteux au Kenya : environ 50 e par mois pour un abonnement, alorsque le coût est de l’ordre de 20 e, voire moins dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Et il faut y ajouter le coût du téléphonependant les temps de connexion. « C’est trop cher », dit James Ochola. « Si la messagerie électronique et Internet étaient devenus desmoyens de communication de masse, les gens devraient être en mesure d’en assurer le coût ».Les prix sont élevés en raison du coût du téléphone. Le monopole d’État en matière de téléphone fournit des services dérisoires et maintientdes prix élevés. James Ochola estime qu’Africa Online pourra diviser ses prix par deux dès que le coût du téléphone sera devenuraisonnable. Et ceci pourrait intervenir bientôt : Africa Online a passé des accords avec d’autres fournisseurs d’accès à l’Internet pour fairepression sur les pouvoirs publics. Le gouvernement est prêt à déréglementer le marché des télécommunications.« e-touch »L’idée la plus prometteuse pour les zones rurales est sans doute le service qu’Africa Online appelle « e-touch ». Vous n’avez plus besoind’avoir votre propre ordinateur ni votre propre téléphone. Il vous suffit d’aller dans un centre « e-touch » et vous pourrez naviguer surl’Internet, envoyer ou recevoir votre courrier électronique en utilisant votre propre adresse e-mail. Comparé au coût d’un fax (ou l’achat104
Informatique et télécommunicationsd’un ordinateur et l’installation d’une ligne téléphonique), les prixsont raisonnables : 60 shillings (moins de 1,00 e) pour envoyer une-mail et seulement 10 shillings (à peu près 0,15 e) pour recevoir unmessage.La navigation est plus coûteuse : 10 shillings la minute. « Si tout lemonde navigue en même temps, il y aura des embouteillages »explique James Ochola. Cela ralentira la navigation et interdira à denouveaux utilisateurs de se brancher. Il suffit de quelques graphiquesmoins gourmands en « mémoire » pour permettre à davantaged’usagers de se connecter en même temps. C’est pourquoi AfricaOnline propose une structure de prix plus incitatifs pour le courrierélectronique que pour la navigation sur la Toile.Une petite entreprise, avec seulement un ordinateur et une ligne detéléphone, peut signer un contrat avec Africa Online pour installer uncybercafé. Il y en a plus de 200 répartis dans tout le Kenya, y comprisdans de petites localités comme Machakos, au sud-est de Nairobi.Ailleurs, on trouve aussi des télécentres, un peu partout en Afrique,qui proposent des services comme le téléphone, le fax, quelquefois letraitement de texte. Les propriétaires de ces centres dédoublent leursbénéfices avec Africa Online qui fournit le logiciel, la connexion etassure le service commercial.Après un lancement réussi au Ghana, Africa Online a démarré sonservice « e-touch » au Kenya en juin 1999. Six mois plus tard, 30 000usagers étaient enregistrés. Et les trois quarts d’entre eux étaient ceque James Ochola appelle des « usagers actifs », c’est-à-dire despersonnes qui se branchent au moins une fois par semaine. Ce chiffreest en augmentation constante, à raison d’environ 1 000 personnespar semaine.Des telles enseignes, signalant la présence d’un centre « e-touch »,ont surgi aux quatre coins du Kenya(Photo : IIRR)Développement et profitAfrica Online n’est pas un bailleur de fonds, ni une agence de coopération ; c’est une société commerciale, à la recherche de profits.« L’Internet est crucial pour l’agriculture », dit James Ochola. « Le Kenya est un pays agricole et les problèmes de l’agriculture sont souvent105
des problèmes d’information. Une meilleure communication permet aux gens de mieux gérer leurs ressources. » Il pense qu’Africa Onlinejouera un rôle central en apportant aux gens l’information dont ils ont besoin dans une forme adaptée aux usagers.Ceci représenterait-il l’avenir d’Internet en Afrique rurale ? Dans les petits centres urbains où l’électricité et le téléphone sont de plus enplus souvent disponibles, de petits entrepreneurs installent des cybercafés qui apportent aux gens des services de communication trèsappréciés. Après tout, l’Amérique du Nord, l’Europe et les établissements touristiques à travers le monde sont passés par cette phase. Alorspourquoi pas l’Afrique rurale ?Les révolutions de l’informationINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESJames Ochola, Sales and Marketing Manager, Africa Online Inc., 2nd Floor, Union Towers, Moi Avenue, PO Box 63017, Nairobi (Kenya).Tél. (254) 2 243775 ; fax (254) 2 243762 ; e-mail jochola@africaonline.com ; Internet www.africaonline.co.keSite Web du Centre de recherche pour le développement international (CRDI) :www.idrc.ca/library/document/annual/ar9899/information_e.html106
Informatique et télécommunicationsInformation communautaire et nouvelles technologiesLe télécentre communautaire de NakasekePaul MundyEntrez et lisezComment des étrangers peuvent-ils aider la population des régions rurales d’Afrique à accéder à l’information ? Une réponse à cettequestion est fournie par les « télécentres d’information communautaires » comme celui de Nakaseke, une petite ville d’Ouganda, à environ60 km de Kampala.Mis en place en 1998, le télécentre de Nakaseke est installé dans une petite bâtisse de plain-pied, comprenant une bibliothèque et un espacede réunions, et équipé d’une photocopieuse et d’ordinateurs. La bibliothèque est bien achalandée, avec près de 4 000 ouvrages. Ellecomprend une section pour enfants avec des livres d’histoires aux couleurs vives et des manuels scolaires. La section consacrée aux adultespropose des romans, des ouvrages techniques et des manuels pour étudiants.« Trente ou quarante visiteurs viennent ici chaque jour, pendant les périodes de vacances », dit Amina Nassolo, la responsable de labibliothèque. Les jours de classe, plus de 60 élèves des écoles voisines viennent faire un petit tour pendant l’interclasse. La consultation desouvrages dans les locaux de la bibliothèque est gratuite mais si vous voulez emporter un livre chez vous, Amina Nassolo vous demandera2 000 shillings ougandais (environ 1,3 e), ce qui vous permettra de louer des livres pendant deux semaines, sur une période de trois mois.Pour atteindre les enfants qui ne peuvent pas venir jusqu’à elle, Amina Nassolo envisage de mettre sur pied un système de bibliothèqueitinérante. Les enseignants feront une sélection de livres pour leurs classes et elle les mettra dans une boîte qu’elle enverra à l’école.Ne parlez pas des ordinateurs…Ce sont les ordinateurs qui attirent le plus l’attention des visiteurs. Il y en a huit en tout : deux dans la bibliothèque, un dans le bureau dudirecteur, et les autres dans une salle de formation. Le centre propose des services de photocomposition, des formations élémentaires àl’utilisation des ordinateurs, des traitements de texte et des tableurs, ainsi que des services de messagerie électronique et d’Internet.L’équipe d’animation du centre a appris à ne pas trop insister avec les visiteurs sur le rôle des ordinateurs. Le terme ordinateur intimide.« Il contient trop de savoir », dit Augustin Bazaale, le directeur du centre. Par contre, les agents du centre vont aider les visiteurs à résoudreleurs problèmes : par exemple, un calcul commercial, une question agricole ou un devoir d’écolier. C’est seulement alors qu’il sera possiblede montrer comment l’ordinateur peut aider à trouver des solutions. C’est en excitant l’intérêt des utilisateurs qu’on les conduira à chercherà en savoir plus.107
Au service des communautésLes révolutions de l’informationLe centre est en train de devenir unimportant carrefour d’information pour lapopulation locale. Les agriculteurs viennents’y réunir pour discuter de techniquesculturales ou interroger les chercheurs depassage de la station nationale de rechercheagricole de Kawanda sur des problèmes deproduction de café ou de banane. Le centretravaille aussi avec les vulgarisateurs agricolespour promouvoir les nouvelles techniques etaider les paysans à mettre en place desparcelles expérimentales pour les tester et yfaire des démonstrations techniques.L’institut de formation continue des adultesde l’université de Makarere envisaged’utiliser le centre pour organiser des cours pour la préparation du certificat de fin d’études secondaires, ainsi que des cours d’anglais pourdébutants et des cours de planification et gestion des projets. Un centre de ressources sur le savoir local est en cours de constitution. Il aurapour tâche de recueillir et d’exploiter les connaissancestraditionnelles de la population. Des visites d’exploitationsagricoles, des cours gratuits d’informatique pour les jeunesles plus doués et des voyages d’études sont organisés ; unbulletin de liaison est également programmé par le centre.La communauté est étroitement associée à la gestion ducentre : des comités d’usagers ont été constitués poursuivre les activités des jeunes, des femmes, des paysans, descommerçants et traiter des questions d’éducation oud’organisation.Phase expérimentaleLe télécentre de Nakaseke a attiré de nombreux soutiensextérieurs : depuis le bureau des bibliothèques publiquesd’Ouganda en passant par un groupe de partenairesLes matches de football, tels ce match de la coupe africaine, font salle comble aucentre communautaire de Nakaseke(Photo : Paul Mundy)On se rend à la bibliothèque du centre communautaire de Nakasekepour y étudier, y emprunter des livres ou simplement y lire le journal(Photo : Paul Mundy)108
Informatique et télécommunicationsENCADRÉ 10Internet pour le développement ?Ouvrez un journal et vous verrez les gros titres sur les dernières concentrations dans le secteur des nouvellestechnologies. Une « start-up » née il y a seulement dix mois vient d’engloutir une énorme compagnie qui existaitdepuis toujours. Allumez votre poste de télévision et vous serez immédiatement sous le feu nourri d’uneinformation sur les nouvelles découvertes technologiques dans le domaine de l’information et de lacommunication à travers les progrès du numérique.Promenez-vous dans la rue et regardez les panneaux publicitaires : les adresses de sites Internet y trônentdésormais en bonne place. Souvent, elles constituent même le seul élément d’information de l’affiche, en dehorsdu nom et du logo de la compagnie. Nous sommes envahis tous les jours un peu plus par des informations surl’Internet. Il est difficile d’échapper à cette réalité : l’Internet est en train de changer les règles de l’économie, de lasociété, de la vie…Ceci n’a pas échappé à tous ceux qui sont engagés dans la mise en œuvre et le soutien des initiatives dedéveloppement rural. De nouveaux projets apparaissent tous les jours pour introduire l’Internet dans les villagesles plus reculés, créer des cybercafés sur les places des marchés, connecter vendeurs et acheteurs à travers lecommerce électronique, rendre l’information disponible sur l’Internet et fournir d’autres services encore.L’Internet en est encore à ses balbutiements : quelques-unes des tentatives actuelles pour le mettre au service dudéveloppement seront couronnées de succès mais d’autres connaîtront de cuisants échecs. Il est utile d’enexaminer les raisons :• Contenu : La plupart des sites Internet ne sont pas en rapport avec les problèmes des populations rurales.De toute façon, comment réussiraient-elles à y trouver les informations qui pourraient leur être utiles (sur lestechniques agricoles, les prix sur les marchés ou les contacts avec leurs partenaires, par exemple ) ? Parailleurs, la plupart des sites sont conçus en Europe ou aux États-Unis et pas dans les pays endéveloppement.• Langues : Même lorsqu’il est pertinent, le contenu de la plupart des sites Internet (et les menus desprogrammes d’ordinateurs) sont dans une langue (l’anglais, le plus souvent) que beaucoup de personnes nemaîtrisent pas bien ou ne comprennent pas du tout.• Lieux d’accès : Il n’y a pas assez d’espaces d’accès à l’Internet (comme les cybercafés ou les télécentrescommunautaires) où les gens pourraient se rendre pour utiliser un ordinateur. Ils sont très rares dans lesvillages d’Afrique, en raison de l’inexistence d’équipements de base comme l’électricité ou les routes.109
Les révolutions de l’informationA droite : ce télécentre de Koudougou (BurkinaFaso) vend du matériel de bureau et proposedivers services en informatique ettélécommunications(Photo : Jacques Sultan)En haut : les télécentres urbains les plus évoluésoffrent des services de photocopie, de traitementde texte, de télécopie, de numérisation parscanner et d’accès à l’Internet(Photo : Paul Mundy)• Masse critique : Même si vous avez une adresse e-mail, qui allez-vous appeler ? Comme pour le téléphone,il y a une masse critique d’usagers en deçà de laquelle il n’est pas rentable d’avoir une adresse e-mail.• Connexions : Les lignes téléphoniques sont lentes et peu fiables, bien que l’on observe des changementsdepuis que les gouvernements autorisent les investissements privés dans les systèmes nationaux detéléphonie.• Coûts : Les ordinateurs sont chers, hors de portée de la majorité des populations des pays endéveloppement. Il en va de même pour les tarifs d’abonnement et de consommation téléphonique. On peuttoujours trouver des soutiens matériels ou financiers pour équiper des télécentres mais les consommables etla maintenance demeurent des problèmes. Comment les ordinateurs seront-ils réparés lorsqu’ils tomberont enpanne ? Où trouvera-t-on des cartouches de rechange pour les imprimantes ? Et comme les ordinateurs sontcoûteux, ils nourrissent toujours la convoitise des voleurs.• Compétences : Les ordinateurs sont toujours complexes à utiliser. Il faut savoir maîtriser le clavier, utiliserune souris, se familiariser avec les commandes de l’écran, comprendre d’obscurs messages d’erreur et savoirce qu’il faudra faire après. Vous devez d’abord comprendre toutes les merveilleuses possibilités quel’ordinateur vous offre, avant d’être en mesure de lui apprendre comment travailler pour vous.110
Informatique et télécommunications• Gestion : Si vous voulez faire fonctionner un télécentre communautaire, vous devez non seulement maîtriserdes quantités de logiciels informatiques, mais aussi être capable de résoudre des problèmes techniques,sans compter les compétences en gestion sans lesquelles votre télécentre ne fonctionnera pas longtemps.Les gens qui disposent de toutes ces compétences sont rares et il est peu probable qu’ils seront volontairespour s’occuper d’un télécentre dans un village reculé. Ils ont sûrement déjà un emploi très lucratif dans unesociété informatique de la capitale.D’un autre côté, l’Internet et le courrier électronique, en particulier, sont une invention providentielle pour lesorganisations intermédiaires comme les ONG et, de plus en plus, pour les institutions publiques comme lesuniversités et les centres de recherche.De plus, il se pourrait bien que les petites entreprises du secteur privé exploitant l’Internet, qui ont l’obligation deréussir pour ne pas disparaître (comme les télécentres du Sénégal décrits en p. 118), soient plus adaptées aucontexte économique et plus durables que les initiatives conçues par des projets des bailleurs de fonds. Lesprojets des partenaires de coopération peuvent toutefois jouer un rôle important pour donner une impulsioninitiale, introduire les concepts et assurer la formation des premiers usagers et fournisseurs d’accès. Mais lesecteur privé doit prendre le relais car les partenaires ou le secteur public ne pourront pas financer le service advitam æternam.C’est peut-être la voie (provisoire) à suivre ? L’Internet peut-il être un outil directement utilisable par lescommunautés les plus démunies dans les zones rurales ? Peut-être à travers des télécentres comme celui deNakaseke ?La réponse est encore peu claire : les technologies sont nouvelles et elles changent très rapidement. Ce qui étaitimpossible hier, devient possible aujourd’hui et sera une banalité demain. Il est toutefois probable que toutes lesexpériences en cours nous fourniront bientôt la matière pour répondre à cette question, dans un sens ou dansl’autre.extérieurs comme l’initiative Acacia, du Centre international de recherche sur le développement (CRDI), l’Union internationale destélécommunications, le British Council et l’Unesco.Que se passera-t-il lorsque les financements extérieurs se tariront ? Le centre génère quelques ressources en fournissant divers servicescomme le téléphone, le fax, la messagerie électronique, la consultation d’Internet, le traitement de texte. Les sessions de formation et lesphotocopies peuvent également rapporter un peu d’argent, de même que l’accueil d’ateliers pour une clientèle extérieure. Il y a unedemande potentielle importante émanant des services publics locaux, des écoles, du centre de formation des maîtres situé non loin de làet de l’hôpital.111
Malgré cela, il est clair que les nombreuses activités du centre ne pourront pas continuer sans un soutien financier extérieur, qu’il proviennede l’État ou de partenaires de coopération. Le comité local suit les activités du centre avec enthousiasme et Augustin espère que cela setraduira par un soutien financier effectif.Qu’en est-il de l’impact du télécentre sur les zones rurales voisines ? Il est encore un peu tôt pour dire si l’objectif que s’est assigné le centrede lutter contre la pauvreté en renforçant les potentialités des communautés locales a été atteint. Il est indispensable qu’il y parvienne s’ilveut conserver ses soutiens extérieurs mais, dans tous les cas, l’expérience accumulée par le centre de Nakaseke constitue une référenceimportante pour toutes les initiatives futures destinées à permettre aux populations rurales d’avoir accès à l’information.Les révolutions de l’informationINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESAugustine Bazaale, Project Manager, Nakaseke Community Centre, Nakaseke (Ouganda). E-mail abazaale@avumuk.ac.ug112
Informatique et télécommunicationsTéléphonie mobile en Afrique ruraleIl y a tellement de choses à dire…Paul MundyRichard Seketa berce son téléphone portable dans sa main alors qu’il s’installe au bord de la foule qui regarde le match de football opposantle Togo à la Côte d’Ivoire sur l’écran de télévision installé à l’extérieur. Il sait qu’aucune sonnerie inopportune ne viendra interrompre lespectacle ce soir.Ici, au centre communautaire, on n’est pas dans une zone couverte par les relais de latéléphonie mobile. Malgré la mauvaise qualité de la réception, le téléphone est un outilde plus en plus important pour Richard Seketa, qui gère une affaire de fourniture dematériaux de construction et de matériel agricole à Nakaseke, une petite ville du centrede l’Ouganda. Il l’utilise pour commander son matériel chez ses fournisseurs à Kampala :ciment, plaques de tôle pour recouvrir les toitures et engrais chimiques.Les fournisseurs chargent les commandes dans un camion pour les livrer à la boutiquede Richard Seketa, lui épargnant le temps et la dépense d’un trajet de 120 km allerretourà Kampala. Il lui arrive aussi de louer son téléphone à des amis ou des voisins, cequi lui procure un petit supplément de ressources.Richard Seketa utilise son portable pourappeler ses fournisseurs de matériaux deconstruction et de produitsphytopharmaceutiques(Photo : Paul Mundy)Richard Seketa fait partie de ces personnes, de plus en plus nombreuses dans les zonesrurales d’Afrique, qui utilisent un téléphone portable pour faire fonctionner leursentreprises et rester en contact avec leurs familles. En Côte d’Ivoire, les planteurs de caféet de cacao se cotisent pour acheter un téléphone portable collectif qui leur permetd’être au courant du cours des marchés de Londres.En Ouganda, les motos sont considérées comme un moyen de transport vital. Les ateliers de réparation doivent pouvoir se procurer trèsrapidement les pièces détachées. Ils les commandent à leurs grossistes grâce aux téléphones portables, permettant ainsi aux motos derouler. Les agents des ONG utilisent leurs portables pour échanger leurs données et coordonner leurs activités. Au Rwanda, les téléphonesportables représentent 58 % du nombre total de téléphones (bien qu’on ne compte que 0,23 téléphone portable pour 100 habitants).Pas branchésDans les pays développés, le téléphone est considéré comme un acquis. Il n’en va pas de même dans les pays en développement : lesservices téléphoniques dans de nombreux pays d’Afrique sont épouvantables. Et de surcroît, les coûts, surtout pour les communications113
lointaines, sont astronomiques. En dehors des grandes villes, les téléphones sont rares et très dispersés. En 1998, on comptait environ untéléphone pour 99 personnes au Kenya ; au Tchad, un pour 833 personnes. Il est intéressant de comparer ces chiffres avec ceux d’Afriquedu Sud (un téléphone pour 5,37 personnes) ou de Finlande (plus d’un téléphone par personne).Un service téléphonique inexistant est plus qu’un petit inconvénient : sans téléphone pour joindre un client, conclure une transaction ouremporter un marché, les affaires stagnent, l’économie bégaie.Les révolutions de l’informationPrivés de téléphones, les gens ont malgré tout trouvé des moyens astucieux pour communiquer. Une méthode largement répandue consisteà payer un chauffeur de taxi collectif ou de camion pour qu’il transmette un message ou un petit colis. Un autre moyen courant est d’utiliserla radio. Contre une petite somme, les stations de radio annoncent un décès ou une maladie ou transmettent même des messages privés.Mais les choses changent, et très vite. Les téléphones portables proposent désormais une alternative. Les opérateurs de téléphonie portablen’ont pas besoin d’ériger des milliers de poteaux ou d’enfouir des kilomètres de câbles pour couvrir des zones éloignées où vivent despopulations dispersées. Ils installent un pylône de transmission et immédiatement toutes les personnes se trouvant dans un certain rayonpeuvent téléphoner. Cela permet aux opérateurs de téléphonie mobile d’établir des services beaucoup plus rapidement qu’une compagniede téléphones fixes et de s’implanter dans des zones où les clients potentiels sont moins nombreux. Des zones reculées, qui ne seraientprobablement jamais couvertes par un système de téléphones fixes, peuvent être couvertes par un opérateur de téléphonie mobile avec descritères de rentabilité beaucoup moins exigeants, compte tenu du faible investissement requis.Kenya 0, Ouganda 1La volonté politique des gouvernements constitue un élément clé, s’agissant du développement de la téléphonie mobile. Comparons leKenya et l’Ouganda en la matière. Dans tous les bureaux de Nairobi, on ne connaît que trop bien le signal sonore indiquant que la ligne estoccupée et des secrétaires exaspérées recomposent indéfiniment le mêmenuméro en espérant finalement obtenir une ligne. Et encore, il s’agit desprivilégiés qui disposent d’un téléphone. Au Kenya, obtenir un téléphone peutsignifier des années d’attente … à moins que vous ne soyez prêt à graisser lapatte à des personnes bien placées.Le gouvernement kenyan a longtemps hésité avant d’autoriser ladéréglementation du monopole téléphonique dans le pays. L’organisme publicde télécommunications entretient un coûteux service de téléphonie mobile quine compte que 10 000 abonnés et couvre un rayon d’environ 30 km autour dela capitale. De nombreux usagers n’ont pas d’autre choix que d’utiliser lesmédiocres services de téléphonie fixe de Telecom Kenya. Les Kenyansracontent avec jubilation comment un des ministres de leur propregouvernement a été contraint d’emprunter le téléphone portable de sonEn Ouganda, les routes principales sont bordées depanneaux publicitaires vantant les mérites destéléphones portables(Photo : Paul Mundy)114
Informatique et télécommunicationshomologue ougandais pour joindre le directeur de la compagnie nationale detéléphone. « Un bon service de téléphone serait comme une résurrection », dit unusager frustré.Si vous allez en Ouganda par avion, vous verrez à l’aéroport d’Entebbe les voyageurs sortir leur téléphone portable dès qu’ils ont mis le piedsur le tarmac. Tout au long de la route vers la ville, vous verrez des gens avec un téléphone portable à l’oreille. Des kiosques et des boutiquesvendent des cartes ou louent des portables un peu partout. De grands panneaux publicitaires sont investis par les slogans des deux grandsopérateurs de téléphonie mobile : Celtel (« Maintenant vous pouvez parler ») et MTN (« La meilleure connexion »).« Quel marché juteux ! »MTN est une société basée en Afrique du Sud qui offre une gamme de services de télécommunications et de téléphonie fixe et mobile. Endehors de l’Afrique du Sud, elle est implantée au Cameroun, au Rwanda, au Swaziland, en Ouganda et bientôt au Nigeria. « En 1997, nouscherchions des opportunités d’investissement et les marchés européens et asiatiques étaient complètement surchargés » dit Erik van Veen,directeur commercial de la compagnie pour l’Ouganda. « Alors nous nous sommes tournés vers l’Afrique et nous nous sommes dits : quelmarché juteux ! ! »« Les opérateurs en place ne faisaient pas un bon travail », dit-il. « Ils appliquaient des tarifs que les gens n’auraient pas acceptés de payeren Afrique du Sud ou en Europe. Nous, nous partons du principe qu’un client est un client, peu importe où il se situe », ajoute-t-il. « Ilsveulent le même service, au même prix ».MTN a démarré son activité dans le secteur de la téléphonie en Ouganda au début 1999. « Au début, nos investisseurs se moquaient de nous.Qui peut se permettre d’utiliser des téléphones portables ? », demandaient-ils, se souvient Erik van Veen. « Pourtant la demande a étéphénoménale. Nous avons vendu 10 000 connexions à Kampala dès le premier mois ». En janvier 2000, MTN comptait 70 000 abonnés. C’estle premier opérateur de téléphonie en Ouganda.Au-delà de Kampala, MTN propose ses services dans des douzaines de villes à l’intérieur du pays. La demande est toujours très forte. Lacompagnie est entrée dans une phase de « croissance contrôlée » et vend seulement 2 000 connexions par mois. C’est pour éviter lesinquiétudes du gouvernement sur la domination du marché par la compagnie et pour rassurer les Européens qui continuent à considérerl’Ouganda comme un pays à risque en matière d’investissement.Une bière ou un coup de fil ?Malgré son développement économique rapide, l’Ouganda reste un pays pauvre. Comment les Ougandais peuvent-ils s’offrir le « luxe » d’untéléphone portable ?115
Le dernière idée de MTN pour fournir des servicesde télécommunications : un conteneur équipé detéléphones publics. On peut se procurer des cartesprépayées au comptoir et avoir accès à desordinateurs et à l’Internet(Photo : Paul Mundy)Les révolutions de l’informationErik van Veen explique que l’Ouganda est un pays où l’on paye comptant. Contrairement aux pays développés où les revenus des gens sontprélevés à la source, dès le début du mois, pour payer un loyer ou des cotisations de retraite, ici tout se traite en liquide. « On trouvetoujours quelques billets pour les choses importantes », dit-il.De surcroît, les Ougandais sont des clients de rêve pour une entreprise de téléphone. Ils adorent se parler. À partir du moment où ilspossèdent un téléphone portable, ils l’utilisent dix fois plus que dans les pays développés. Les brasseries du Nil, un des principaux brasseursde bière du pays, constatent une corrélation entre la chute des ventes de bière et l’augmentation des dépenses de téléphone.Le système de MTN est basé sur des cartes jetables prépayées. Une fois que vous avez acheté un téléphone et une carte SIM (qui vousattribue un numéro d’appel), vous achetez une carte pour payer vos communications. Vous grattez une zone opaque de la carte pourdécouvrir un numéro de code que vous entrez dans votre téléphone ; cette opération lui attribue un certain nombre d’unités. Vous pouvezutiliser votre téléphone jusqu’à épuisement de ces unités et là, il vousfaut acheter une autre carte jetable.Ce système convient bien aux utilisateurs qui ne veulent payer qu’enfonction de leur consommation et non sur la base d’une facturemensuelle qui est bien souvent inexacte. Il convient aussi àl’opérateur de téléphonie car il évite les coûts d’inscription et defacturation et élimine le problème des mauvais payeurs.Le téléphone, outil de commerceLes télécommunications ne répondent pas simplement à un besoinsocial et ne sont pas seulement utiles dans les zones urbaines. Ellessont particulièrement importantes pour les opérateurs économiquesdans les petits centres urbains des zones agricoles. MonicaNamaganda est responsable d’une boutique d’articles vétérinaires engros, à Jinja, une petite ville proche du lac Victoria, célèbre pour êtreMonica Namaganda passe ses commandes à Kampaladepuis le magasin Butembe Agrovel de Jinja(Photo : Paul Mundy)116
Informatique et télécommunicationsla source du Nil. Elle utilise la nouvelle ligne téléphonique fixe de sa boutique pour passer ses commandes et recevoir les appels desdétaillants de la région.Dans la même rue, Aggrey Wettaka, un vétérinaire du magasin de luxe « Superchic » a donné le numéro de son portable à ses clients : deséleveurs de volaille installés dans les faubourgs de la ville. Ils l’appellent pour des conseils ou pour lui demander de venir contrôler la santéde leurs élevages.Erik van Veen raconte une histoire à propos de Busia et Menaba, deux villes de la frontière entre l’Ouganda et le Kenya : MTN a installé unrelais pour couvrir les besoins de la ville de Busia. Mais une trouée dans les collines voisines permet aux habitants de certains quartiers dela ville de Menaba d’accéder à un faible signal de téléphone. Il raconte que toutes les personnes de Menaba qui possédaient un portable seretrouvaient au sommet de la colline où le signal était plus puissant et proposaient des prestations téléphoniques payantes aux gens. QuandMTN a installé une station à Menaba, elle a vendu 300 abonnements dès le premier jour.Beaucoup de personnes, du côté kenyan de la frontière, ont acheté un téléphone portable pour profiter du signal des relais installés enOuganda.Une large clientèle« Les abonnés de MTN ont des origines très diversifiées », dit Erik van Veen. « Cela va des ministres aux commerçants, en passant par lespersonnes qui travaillent dans le secteur officiel ou informel, les grands-pères et les étudiants ». La plupart des appels sont de naturecommerciale, notamment dans le secteur informel très important. Environ 70 % des possesseurs de téléphone sont des hommes, même sion observe depuis peu une nouvelle mode du téléphone portable chez les jeunes femmes, en particulier les étudiantes.Dans les pays comme l’Afrique du Sud ou le Swaziland, les personnes qui n’ont pas les moyens de s’offrir un téléphone individuel seregroupent pour acheter un portable. « Mais cela n’existe pas en Ouganda », dit Erik van Veen. « C’est peut-être une séquelle de la guerrerécente : les gens ne se font pas confiance ».Certaines personnes tirent leurs revenus de la location de leur téléphone aux autres en monnayant les appels. Cependant, cela devient demoins en moins courant en Ouganda car il est facile d’acheter un portable d’occasion.Les téléphones restent trop coûteux pour les petits agriculteurs. Toutefois, il leur arrive d’en louer un pour une communicationparticulièrement importante.En règle générale, on peut dire que le téléphone stimule l’activité économique en milieu rural. Il est plus facile de trouver un débouchépour une production ; les réseaux de commercialisation deviennent plus transparents et plus rapides ; il est plus facile d’avoir accès auxintrants au moment voulu. Au bout du compte, tout cela pourrait avoir des retombées positives même pour les populations les plusdéfavorisées.117
ENCADRÉ 11Télécentres au SénégalL’enseigne multicolore au-dessus de la porte indique : « Télécentre Mame Diana Boussa » Soulevez le tissuaccroché à la porte d’entrée et glissez-vous dans la pièce obscure. Le fils de Mame Diana vous indique la cabinetéléphonique installée dans le coin. Vous passez votre coup de fil et vous donnez 300 F CFA (0,46 e) au garçonpour régler votre appel.Les révolutions de l’informationEn Europe, les cabinestéléphoniques sont deséquipements familiers tout aulong des rues et dans lescentres commerciaux. Ici, auSénégal, il n’y a pas beaucoupde cabines mais il y abeaucoup de gens qui, commeMame Diana, offrent ceservice.Le village de Niaga n’est pastrès éloigné de Dakar : environune heure de trajet qui revientà 300 F CFA dans un de cestaxis collectifs qui attendentl’arrivée des passagers dans lecentre du village. AvantDes milliers de télécentres comme celui du village de Niaga (Sénégal) permettent auxl’arrivée des téléphones, lespopulations rurales de rester en contact avec le monde extérieurgens qui voulaient envoyer un(Photo : Paul Mundy)message à Dakar auraientconfié une lettre (et unpourboire) au chauffeur d’un de ces taxis ou se seraient déplacés personnellement : 800 F CFA (1,22 e) allerretour.Maintenant, tout ce qu’ils ont à faire, c’est entrer dans la boutique de Mame Diana.Des milliers de télécentres ont poussé comme des champignons dans tout le Sénégal. La plupart d’entre eux, àl’instar de celui de Mame Diana, sont équipés d’un simple téléphone installé au domicile d’un particulier. D’autresproposent aussi un fax, une photocopieuse et une machine à écrire. Les plus sophistiqués offrent le traitement detexte, le scanner, le courrier électronique et l’accès à l’Internet.118
Informatique et télécommunicationsDe nombreux télécentres constituent une activité complémentaire pour des boutiques de fournitures agricoles oudes papeteries, de la même façon que les stations-services ou les cafés, en Europe, proposent des cabinestéléphoniques à leurs clients.De plus en plus de télécentres proposent des services de messagerie électronique et des connexions à l’Internet.C’est particulièrement le cas pour le nord du Sénégal, une zone pauvre avec une longue tradition d’émigration.Les villageois utilisent l’e-mail pour échanger des informations avec leurs parents installés en France ou auxÉtats-Unis. C’est beaucoup moins cher que le téléphone ou le fax.Le développement des télécentres privés au Sénégal est lié à la décision prise par la SONATEL, compagnienationale de télécommunications, de promouvoir la téléphonie rurale. Chaque aspirant propriétaire d’un télécentresigne un contrat avec la SONATEL et verse un dépôt de garantie. La SONATEL installe alors le téléphone et uncompteur, et adresse à l’opérateur une facture mensuelle correspondant au nombre de communicationseffectuées.Les télécentres privés sont intéressants pour la SONATEL à plusieurs titres : cela élimine le vandalisme et lesproblèmes de maintenance des cabines publiques ; il n’est pas nécessaire de mobiliser un employé de laSONATEL pour prélever les recettes dans les cabines ou pour vendre des télécartes ; leur installation estbeaucoup moins coûteuse qu’une cabine ; les usagers les apprécient : on y est installé plus confortablement quedebout dans des cabines aux parois de verre, étouffantes et surchauffées.Les 4 premiers télécentres ont été installés en 1992, à titre expérimental. Depuis, les chiffres n’ont cesséd’augmenter. Aujourd’hui, on compte plus de 4 500 télécentres, les deux tiers à Dakar, les autres répartis danstout le pays. Les télécentres sont créateurs d’emplois : il faut au moins deux personnes pour gérer un télécentredepuis tôt le matin jusque tard le soir. Et ils sont rentables : en 1994, ils représentaient 5,5 % du chiffre d’affairesde la SONATEL, alors qu’ils ne constituent que 2,5 % des lignes téléphoniques installées.Pour plus d’informationsObservatoire Économique des Télécommunications d’Afrique, www.telecom-plus.sn/observatoire/Obtcp.htmFaire la différenceIl y a de toute évidence un enjeu énorme pour le développement de ces services, en Ouganda comme ailleurs. Gulu, la plus grande ville dunord du pays « dispose d’environ 20 lignes de téléphone fixe, » dit Erik van Veen. Kisoro, à l’extrémité sud-est de l’Ouganda et à la frontièrede l’instable Rwanda (mais très consommateur de téléphone), dispose d’une seule ligne fixe, « qui marche de temps à autre ».119
Des moyens de communication corrects peuvent induire des changements importants dans les conditions de vie des producteurs rurauxen Afrique. Et il semble bien que le téléphone portable soit en train d’en faire la démonstration.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESLes révolutions de l’informationErik van Veen, Sales and Marketing Manager, MTN Uganda, UDB Towers, Plot 22, Hannington Road, Kampala (Ouganda).Tél. (256) 78 212 333; e-mail Vanveen@mtn.co.ugThe Economist. 9 October 1999. The world in your pocket: A survey of telecommunications. Special supplement120
L’association nationale des agriculteurs de l’Ouganda : donner une voix aux paysansOrganisation paysannes : FONGS – organiser les producteurs ruraux du SénégalRenforcer les capacités de gestion des producteurs ruraux : pour une gestion transparente de l’argent des paysansApprendre et échanger sur l’agriculture durable : l’association PELUMModerniser les marchés : le cas de la KACELes groupements paysanset les marchés
Les révolutions de l’informationDémocratisation, privatisations, restructurations, déréglementation et décentralisation. Aucours des dix dernières années, toutes ces vagues ont successivement déferlé sur lemonde en développement. Elles ont apporté de nouvelles libertés et de nouvellesresponsabilités. Elles ont ouvert des espaces politiques qui ont permis à la population des’organiser librement, quelquefois pour la première fois, et de faire pression sur lesgouvernements pour accélérer les changements. Elles ont libéré les producteurs rurauxde la tyrannie des tout puissants monopoles d’État qui disaient aux agriculteurs ce qu’ilsdevaient planter, leur fournissaient les intrants, contrôlaient toutes les étapes de la cultureet achetaient toute la récolte à des prix artificiellement bas, mais « garantis ».Mais, avec la liberté sont arrivées les responsabilités. Les agriculteurs doivent désormaisprendre des décisions auxquelles ils ne sont pas habitués, assurer la gestion commercialede leurs exploitations, trouver des marchés pour leurs productions, courir davantage derisques.Un nouveau type d’organisations est en train d’émerger pour les aider à faire face à cesnouveaux défis : des organisations de producteurs constituées en groupes de pression etqui prennent en charge la formation des agriculteurs, des ONG, des bourses de matièrespremières agricoles, des coopératives…Toutes ces nouvelles organisations appuient les producteurs ruraux plus efficacementque les services gouvernementaux et sont structurées de façon novatrice etdémocratique. Ici, les décisions ne se prennent plus au sommet mais sont négociées avecla base ; des fonctions jusque-là assurées par des services gouvernementaux sontreprises en compte par des organismes privés ou associatifs ; un nouveau type derapports s’établit avec les institutions existantes. Deux exemples : des ONG se constituenten réseaux avec des universités et des services gouvernementaux ; des organisationspaysannes décident de piloter des programmes de recherche pour ne plus être confinéesau rôle de « bénéficiaires passifs » des nouvelles techniques mises au point par lescentres de recherche.122
Les groupements paysans et les marchésL’association nationale des agriculteurs de l’OugandaDonner une voix aux paysansPaul MundyObservez l’organigramme d’un ministère de l’agriculture. Vous y trouverez le ministre au sommet de la pyramide puis les directeurs, lesdépartements, les services, les bureaux.Mais où sont les paysans ? Lorsqu’ils sont (rarement) mentionnés, ils apparaissent dans une petite case, en bas de l’organigramme avec touteune série de flèches qui pointent vers eux. Il n’y a jamais de flèches qui vont pointer vers le haut. Résultat : les responsablesgouvernementaux, les chercheurs, les vulgarisateurs disent aux paysans ce qu’ils doivent faire et ce n’est jamais l’inverse. Il n’est paspossible pour les agriculteurs, au moins par les voies officielles, de dire au ministre ce qu’ils veulent.Pointer les flèches vers le hautL’Association nationale des agriculteurs d’Ouganda (UNFA – Uganda National Farmers Association) s’emploie à changer tout cela. Cetteassociation compte 90 000 adhérents répartis dans tout le pays. Elle assure leur représentation, prend en charge la formation et lavulgarisation et informe le monde rural à travers son magazine, La Voix du Paysan (The Farmer’s Voice).L’association est elle-même structurée de façon à permettre que la voix des adhérents de la base soit entendue. Elle a été fondée en 1992comme une structure centrale avec des démembrements au niveau des districts. Ses responsables se sont rendu compte que, de la sorte,ils ne parviendraient pas à établir un contact avec les paysans au service desquels ils étaient supposés travailler. En conséquence, en 1997,avec l’aide de la coopération danoise (DANIDA), l’UNFA s’est transformée en une fédération de 60 organisations juridiquementindépendantes, constituées au niveau des districts. Une famille de paysans paie une cotisation de l’ordre de 1 500 shillings ougandais(environ 1 e) pour appartenir à une de ces organisations.Trois instances régissent désormais l’UNFA. Le conseil des paysans, composé de trois délégués de chaque organisation membre, est l’organede décision suprême. Pour assurer une représentation équilibrée, au moins un délégué de chaque organisation doit être une femme. Lesmembres du conseil n’hésitent pas à exprimer leurs points de vue : il leur arrive souvent de rejeter ou d’amender les propositions avancéespar le comité exécutif de l’UNFA ou par le secrétariat. Un comité exécutif national de 11 membres est élu par le conseil des agriculteurs etdirigé par un président. C’est le conseil d’administration de l’UNFA, en quelque sorte.Un secrétariat exécutif central, à Kampala, aide le comité à mettre en œuvre le programme. Il comporte 34 agents dont 13 techniciens etgestionnaires. Ils ont en charge l’administration, l’information, le service d’appui-conseil, la commercialisation, le genre, le crédit et lacomptabilité.123
La Voix du PaysanLes révolutions de l’information« Le magazine trimestriel de l’UNFA, La Voix du Paysan,est un important moyen de communication avec lesadhérents, les décideurs institutionnels et les autresorganisations », dit Jane Batte, rédactrice adjointe, un desdeux agents chargés du magazine.Chaque numéro comporte 32 pages et trois partiesprincipales. La première, « Nouvelles du secrétariatcentral », décrit les activités du siège de l’organisation :un compte rendu des récents conseils des agriculteurs,par exemple, ou un rapport sur un stage de formationdes vulgarisateurs organisé au Danemark par DANIDA.« Nouvelles de nos adhérents » est la deuxième partie : elle se composed’articles provenant des organisations membres de l’UNFA. L’articleprincipal de l’édition de décembre 1999, par exemple, relate l’histoired’un paysan qui a utilisé une simple pompe à pédale pour irriguer sonpotager de 1,2 ha. Dans le même numéro, on pouvait trouver desarticles sur une session de formation sur la culture attelée, l’histoired’un ex-prêtre de 87 ans qui gère une laiterie avec succès, des paysansqui exploitent le café ou la vanille, des projets initiés par desorganisations membres à Iganga et Bushenyi, et bien d’autres encore.La troisième partie, qui représente près de la moitié du magazine, estconsacrée à des informations techniques. Ainsi, le numéro dedécembre 1999 contenait des recommandations sur l’élevage porcin(en réponse à une lettre de lecteur), des informations sur l’analyseéconomique d’un élevage de volaille, des recettes pour le séchage desfruits et des légumes en vue de leur conservation, des conseils sur laculture du manioc et de l’arachide, une rubrique sur l’élevage deslapins, etc.Couverture du numéro de décembre 1999 de La Voix du PaysanLes bureaux de l’UNFA à Kampala (Ouganda)(Photo : Paul Mundy)124
Les groupements paysans et les marchésLes articles sont rédigés par les équipes de l’UNFA et un journaliste professionnel pigiste. Ils veillent à ce que la couverture géographiquedu pays soit assurée : chaque numéro met en valeur un district différent. L’équipe s’y rend pour recueillir des interviews et des témoignageset pour prendre des photos.Le magazine encourage les lecteurs à s’exprimer. « Les agriculteurs envoient des articles qu’ils ont écrits eux-mêmes. Lorsqu’ils contribuentà La Voix du Paysan, ils contribuent aussi à l’UNFA globalement », dit Jane, bien qu’elle ajoute que ces articles nécessitent souvent un grostravail de réécriture. Un choix de lettres des lecteurs est publié en page 3 et certains numéros comportent également un questionnaire queles lecteurs doivent remplir et renvoyer à la rédaction. « Le comité éditorial est très attentif à ce feed-back », dit Jane Batte. « Les lettrescontiennent souvent des demandes de reportage sur des thèmes spécifiques et l’équipe de rédaction fait tout ce qu’elle peut pour satisfaireces demandes ».Finie, la gratuitéLorsque La Voix du Paysan a été lancée, il y a neuf ans, elle était distribuée gratuitement aux membres de l’association. Le magazine étaittiré à 7 000 exemplaires et distribué à travers des comités dans chaque paroisse du pays. Ceci prit fin en même temps que l’assistancefinancière de DANIDA en 1998. Depuis, l’UNFA tente de donner une autonomie financière au magazine.Une source de revenus est constituée par les ventes. Le magazine est désormais vendu 700 shillings (0,46 e). Cela ne couvre quepartiellement les frais de production.L’obligation d’acheter le magazine a un inconvénient important : la diminution du nombre de lecteurs, qui a entraîné une chute du tiragede 7 000 à 3 000 exemplaires. Mais cela a aussi des avantages et notamment celui de contraindre l’équipe de rédaction à produire unmagazine plus attractif et plus en rapport avec la demande des lecteurs. « Quand nous trouvons un paysan qui est prêt à consacrer 700shillings à l’achat du magazine, cela nous encourage beaucoup car c’est la preuve de son utilité », dit Jane Batte.Une autre source de revenusLa publicité est une autre source de revenus. Un industriel spécialisé dans la fabrication de tuyaux en plastique est un annonceur habitueldu journal ; parmi les autres annonceurs, on trouve des fournisseurs d’équipements comme les pompes, les moulins, les glacières, une usined’égrenage de coton ou une société à la recherche de producteurs de piments pour l’exportation.La quantité d’annonces publicitaires est très variable. Certains numéros peuvent en contenir plusieurs pages et procurer des ressourceséquivalentes à des milliers d’euros, d’autres n’en contiennent presque pas. Le coût des annonces publicitaires est également très variable.Jane Batte explique que les rédacteurs pourraient trouver beaucoup d’annonceurs s’ils se déplaçaient personnellement pour allerprospecter les clients potentiels mais ça prend trop de temps. Ils ont essayé de passer par une agence spécialisée, qui a recommandé derelever les prix, mais qui n’a trouvé aucun client.125
Résoudre un casse-têteComme pour les autres publications destinées à des publics ruraux, la distribution est un véritable casse-tête. Vous ne pouvez pas (encoreaujourd’hui) acheter un exemplaire de La Voix du Paysan chez un vendeur de journaux : « courir après les vendeurs pour récupérer l’argentde la vente est très difficile », dit Jane Batte. Le magazine est un excellent outil de promotion ; l’UNFA en distribue un certain nombred’exemplaires gratuitement ; par ailleurs, quelques organisations ont souscrit un abonnement.Les révolutions de l’informationMais la plus grande partie du tirage est vendue à travers les organisations membres. Les coordonnateurs de districts viennent régulièrementà Kampala pour des réunions ou des sessions de formation. Ils prennent à cette occasion un paquet de journaux et les ramènent chez eux.Ils encouragent les organisations locales à vendre le magazine en les autorisant à prendre une commission de 200 shillings (0,13 e). Ilsdoivent remettre le reste du produit de la vente à l’UNFA.Qui achète La Voix du Paysan ? « Beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, sont encore analphabètes », dit Jane. « Ce sont en généralles hommes qui achètent le magazine ». Les paysans qui assurent des fonctions de formateurs sur le terrain reçoivent un exemplaire dumagazine ; cela leur permet de trouver des informations qu’ils pourront utiliser dans leur travail de formateur.Des bulletins locauxDe nombreuses organisations membres de l’UNFA éditent des bulletins en langues locales pour leurs adhérents. En général, il s’agit d’unbulletin ronéotypé et agrafé de trois ou quatre pages. On y retrouve quelquefois des articles provenant de La Voix du Paysan et traduitsdans les langues locales. L’information peut ainsi atteindre un public plus vaste que les seuls lecteurs de La Voix du Paysan.En avril 1999, le département de l’information de l’UNFA a organisé une session de formation sur la gestion de l’information et de ladiffusion pour 74 personnes provenant des organisations membres. Peu d’entre elles ont par la suite produit leur propre bulletin. Celamontre qu’il y a encore du chemin à parcourir pour que les 90 000 paysans de l’association aient un accès régulier à une sourced’information écrite.Des formations à la demandeQuel est l’intérêt des paysans à dépenser 1 500 shillings pour adhérer à l’UNFA ? Une des principales motivations est que cela leur ouvrel’accès aux conseils et à la formation. Les paysans peuvent demander aux formateurs de proximité sur le terrain, également appelés « relaisde vulgarisation paysan », des conseils pour résoudre tel ou tel problème. Si le « formateur-relais » domine le sujet, il peut le résoudredirectement, proposer une mini-session de formation ou organiser une démonstration ou une expérimentation, à laquelle les paysans nonmembres seront invités. Si le formateur-relais n’a pas suffisamment d’éléments pour répondre à la demande, il s’adresse au coordonnateurde district pour qu’il assure lui-même la formation ou le conseil.126
Les groupements paysans et les marchésSi la réponse n’existe toujours pas à ce niveau, le coordonnateur de district saisit le service « Suivi Conseil » de Kampala qui mettra àdisposition un spécialiste ou un chercheur pour effectuer la prestation de formation.Tous les ans, en juillet, l’UNFA organise une foire agricole à Jinja, dans le centre du pays. La foire de 1999 a regroupé plus de 30 exposantsreprésentant des sociétés commerciales, 23 organisations paysannes et 10 institutions gouvernementales. Elle a attiré plus de 80 000visiteurs. La foire a une excellente image : en 1998, le président Museveni l’a honorée de sa présence et il a remis un taureau au lauréat duconcours d’élevage bovin.Des groupes d’écouteL’UNFA produisait ses propres programmes radio mais elle les a interrompus car c’était trop coûteux et de nombreux paysans se plaignaientde la tranche horaire inadaptée. Une nouvelle approche est désormais privilégiée. Il s’agit d’encourager les paysans à se constituer engroupes d’écoute pour écouter collectivement les programmes de radio relatifs à l’agriculture et au développement rural. Après la diffusiondu programme, les auditeurs discutent de l’émission et envoient leurs observations écrites au siège de l’UNFA. La même approche peut êtreutilisée avec des audiocassettes produites par l’UNFA sur des sujets spécifiques comme la production du café ou de la banane. Les groupespeuvent emprunter les cassettes au bureau de l’association au niveau du district, les écouter collectivement et faire parvenir leurs réactionsà l’UNFA.LobbyingLe lobbying est une autre stratégie mise en œuvre par l’UNFA pour servir les intérêts de ses adhérents. C’était même, à l’origine, une desraisons qui a motivé la création de l’association. C’est le comité exécutif qui assure la responsabilité de cette activité. Les efforts entreprisdans ce domaine ont porté leurs fruits. En voici un exemple. La décision du gouvernement d’interdire l’importation de semence de taureauen raison de la maladie de la « vache folle » en Europe a fait l’objet d’interventions de l’UNFA. Depuis le début de 1999, le gouvernement apartiellement suspendu cette mesure, permettant ainsi aux éleveurs ougandais de continuer leurs efforts d’amélioration de leur filière.Les agriculteurs ont cependant encore beaucoup à apprendre en matière de lobbying ; ils ne sont pas encore aussi efficaces que l’associationdes transformateurs ou celle des exportateurs agricoles, qui représentent les grands propriétaires produisant pour l’exportation. Toutefois,l’UNFA est potentiellement très puissante car les petits paysans qu’elle représente sont beaucoup plus nombreux et constituent un élémentvital de l’économie du pays.FinancementLe financement de l’UNFA constitue sans doute son talon d’Achille : une grande partie de ses ressources proviennent encore dufinancement de DANIDA et son activité fait l’objet d’une assistance de conseillers danois. Il est indispensable pour l’UNFA, si elle veut resterune organisation forte et représentative des agriculteurs d’Ouganda, qu’elle trouve les moyens de se sevrer de cette dépendance extérieure.127
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESUganda National Farmers Association (UNFA), Farmers Centre, Plot 27 Nakasero Road, PO Box 6213, Kampala (Ouganda).Tél. (256) 41 230705/ 41 255250/ 41 255242 ; fax (256) 41 230748 ; e-mail unfa@starcom.co.ugLes révolutions de l’information128
Les groupements paysans et les marchésOrganisations paysannesFONGS – organiser les producteurs ruraux du SénégalPaul MundyAu Sénégal, l’équivalent de l’UNFA ougandaise s’appelle la FONGS, la Fédération nationale des organisations non gouvernementales duSénégal. Comme l’UNFA (voir p. 123), c’est une fédération d’organisations paysannes : 29 à travers tout le Sénégal regroupant 150 000adhérents dans environ 3 000 groupements villageois. Si l’on comptabilise les familles des adhérents, la FONGS peut dire qu’elle toucheenviron 900 000 personnes, soit 10 % de la population sénégalaise. Près des deux tiers des adhérents sont des femmes.Créée en 1976 et basée à Thiès, une ville vouée au commerce et un important nœud de communication à l’est de Dakar, la FONGS a unestructure similaire à celle de l’UNFA. Une assemblée générale est convoquée tous les trois ans, le conseil d’administration tous les deux moiset la commission exécutive chaque mois. L’équipe dirigeante de l’organisation est composée d’agents à temps partiel, élus par les adhérents.Les responsables ne reçoivent pas de salaire mais leurs frais sont pris en charge et ils perçoivent une indemnité pour chaque journée qu’ilsconsacrent à l’organisation. Une petite équipe de sept salariés est chargée de l’administration, des finances, des questions de genre et de laformation. Chaque fois que des compétences spécifiques sont requises, la FONGS fait appel à des consultants extérieurs.Les responsables de la FONGS sont eux-mêmes des exploitants agricoles : par exemple, Demba Keita, le responsable de l’équipe deformation en communication, est un paysan originaire du sud du Sénégal où il pratique l’arboriculture fruitière (mangues, oranges) et laculture de l’arachide, pour l’exportation et les patates douces ou le manioc pour la consommation familiale.Un changement salutaireLancé en 1996, Action Paysanne est le journal de la FONGS. Trois mille exemplaires de cette publication trimestrielle de 8 pages, en français,sont distribués dans tout le pays.Action Paysanne poursuit trois objectifs : informer les lecteurs sur la politique et les grands thèmes du développement rural, favoriser leséchanges entre les différents groupes d’adhérents de l’organisation et diffuser des techniques novatrices.« Informer les adhérents sur les sujets d’ordre politique est important », dit Demba Keita, « pour qu’ils disposent des éléments nécessairespour se forger leurs propres opinions. C’est un changement salutaire par rapport aux pratiques unilatérales et descendantes que l’onconnaît ». Action Paysanne propose des analyses et des articles sur les politiques et les programmes de développement, les politiquespubliques et les sources de financement pour les producteurs ruraux.Action Paysanne est un outil essentiel pour les échanges entre les organisations membres de la FONGS. « Le journal doit véhiculer desinformations sur nos membres, sinon ils ne s’y intéresseront pas », ajoute Demba Keita.129
Chacune des dix régions du Sénégal dispose d’un responsable de communication. Ils rédigent des articles sur les activités dans leurs régionset les envoient à la FONGS. Les articles sont ensuite mis en forme définitive par Demba Keita et un journaliste professionnel. La mise enpage et l’impression sont confiées à des prestataires extérieurs. Les représentants régionaux de la FONGS sont membres d’un comité degestion du journal, pour garantir son ancrage local.Les révolutions de l’informationLes représentants régionaux sont également responsables de la distribution. Le prix du journal est fixé à 200 F CFA (0,30 e) ; lesdistributeurs ajoutent de 50 à 100 F CFA à ce prix, les bénéfices réalisés étant réinvestis dans des activités locales. Ils sont aussi encouragésà traduire les articles dans les langues parlées dans les régions (sept langues principales sont parlées au Sénégal), mais ils ne le font passouvent, selon Demba Keita, car cela représente un travail trop lourd.La troisième grande fonction d’Action Paysanne est d’informer les lecteurs sur les innovations technologiques. Comme de nombreuxadhérents sont des adhérentes, des thèmes comme la transformation agroalimentaire, les recettes de cuisine et la nutrition sont souventabordés.Pas seulement des journauxLes activités de communication de la FONGS ne se limitent pas à Action Paysanne. Pourrenforcer les compétences des responsables locaux, le journal produit des manuelstechniques, d’une dizaine de pages, sur des sujets comme la gestion institutionnelle, lanégociation, le développement des organisations ou l’échange d’informations. Il produitégalement des livrets techniques de 2 à 4 pages sur des sujets comme le traitement dulait, l’utilisation du « neem » comme pesticide et la conservation des fruits et des légumes.La FONGS produit aussi des vidéos. Fin 1999, trois vidéos avaient déjà été réalisées : deuxsur la culture du riz et une sur les activités des organisations membres de la FONGS. Ellessont réalisées par des prestataires professionnels extérieurs et diffusées par la télévisionnationale.La formation est une composante importante des activités de la FONGS : de 1985 à 1990,elle a formé des centaines de formateurs dans chacune de ses organisations membres surdes sujets comme l’agriculture, l’élevage et la gestion des organisations. Mais uneévaluation, entreprise en 1991, a relevé que les formateurs n’étaient pas d’une grandeefficacité. En conséquence, la FONGS a modifié son approche pour s’appuyer davantagesur les potentialités de chacune de ses organisations membres. Un programmed’échanges de formation et d’appui (PFEA) a été mis en place pour permettre à chaqueorganisation de demander aux autres de mener des sessions de formation dans leurschamps de compétences respectifs.Un bulletin préparé par une organisationmembre de la FONGS130
Les groupements paysans et les marchésLes membres de la FONGS collaborent étroitement avec les vulgarisateurs des services de l’État. Comme dans le cas de l’UNFA en Ouganda,les équipes de la FONGS prennent en charge les moyens et la logistique et les vulgarisateurs apportent leurs compétences techniquesspécialisées.Pour améliorer la disponibilité de l’information dans tout le pays, la FONGS est en train de mettre en place 11 centres de documentation,un dans chaque région, plus un centre à vocation nationale. Elle développe également les échanges d’informations par messagerieélectronique en s’appuyant sur les nombreux télécentres équipés d’ordinateurs que l’on trouve maintenant un peu partout au Sénégal.Inverser le sens de la rechercheLa FONGS est partie prenante à un processus particulièrement intéressant et original de restructuration de la recherche agronomique auSénégal. Habituellement, ce sont les chercheurs ou les décideurs politiques qui choisissent les thèmes et arrêtent les modalités de larecherche. Les chercheurs conduisent leurs expérimentations, développent de nouvelles techniques et les transmettent aux agents de lavulgarisation qui, à leur tour, forment les paysans. Il arrive bien souvent que les chercheurs se concentrent sur des sujets qui présentent unintérêt scientifique pour eux mais qui n’ont aucune utilité pratique pour les producteurs.Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), une organisation faîtière regroupant la FONGS et 8 organisationspaysannes, a décidé de prendre cette question en mains pour inverser les choses. Les paysans, à travers le CNCR, décideront par eux-mêmesles thèmes prioritaires de recherche et commissionneront les chercheurs de l’Institut sénégalais de recherche agronomique (ISRA) pour lesmettre en œuvre. Ceci confère à la FONGS et aux autres organisations paysannes un rôle de poids : elles s’assurent que leurs intérêts sontpris en compte en maîtrisant, au moins en partie, les programmes de recherche.Ce système est proche de ce qui est développé en Europe ou aux États-Unis, où les organisations de producteurs agricoles sont relativementpuissantes. Dans l’État de l’Iowa, par exemple, l’association des producteurs de soja consacre une part des cotisations de ses adhérents aufinancement de recherches qui les concernent directement. Les chercheurs de l’université leur soumettent des projets de recherche pourfinancement.Le CNCR est en train de peaufiner cette approche et, si elle réussit, elle constituera un modèle pour la recherche agronomique dans d’autrespays africains.Quelle durabilité à long terme ?Comme l’UNFA en Ouganda, la FONGS est très dépendante d’une assistance technique extérieure. En termes de ressources propres, ellegénère environ 20 à 25 millions de francs CFA par an (30 à 40 000 e), à partir des cotisations des adhérents et d’autres revenus. Mais la plusgrande partie de ses ressources proviennent d’un consortium d’ONG européennes, coordonnées par SOS Faim.131
Pour atteindre une indépendance véritable et pérenniser ses activités, la FONGS doit progressivement réduire la part des ressources quiprovient de ses partenaires extérieurs, en développant des activités de services rémunérés, comme la formation, et en recrutant davantagede membres. Mais son indépendance financière à long terme ne sera acquise que lorsque ses membres deviendront plus solides. Et celadépend aussi de la capacité de la FONGS à dynamiser ses activités et à développer ses capacités d’autofinancement.Les révolutions de l’informationINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESFONGS, BP 269, Thiès (Sénégal). Tél. (221) 951 1237 ; fax (221) 951 2059 ; e-mail fongs@telecomplus.sn132
Les groupements paysans et les marchésRenforcer les capacités de gestion des producteurs rurauxPour une gestion transparente de l’argent des paysansJacques SultanDans les villages du Sud Mali, tous les ans, au mois de novembre, au moment des premières pesées du coton, le calcul de ce qui est dû àchaque producteur est établi, en retenant le montant des intrants que chacun a prélevés. Et c’est à ce moment qu’apparaissent les conflits :les quantités indiquées dans les cahiers des producteurs ne sont pas les mêmes que celles qui sont consignées dans le cahier du secrétairede l’association villageoise ; des intrants ont été comptabilisés mais n’ont pas été livrés ; certains producteurs n’ont pas noté les intrantsqu’ils ont reçus ou les sous-évaluent.Dans de nombreux villages de la zone cotonnière du Sud Mali, les paysans ont constitué des associations villageoises pour gérercollectivement la production de coton, s’approvisionner en intrants, accéder au crédit et commercialiser la récolte. Ces associations ont étécréées à l’initiative de la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT), l’organisme semi-public chargé de la productioncotonnière au Mali.Tous les ans, les intrants nécessaires à chaque producteur sont distribués par l’association villageoise. Les seuls outils de gestion dontl’association et les paysans disposent sont le cahier du secrétaire de l’association, qui indique les quantités livrées à chaque producteur, etle cahier du producteur où il reporte ces indications. Les conflits sont presque inévitables.Les autres ressources générées par les associations villageoises (rémunérations pour la collecte du coton, commercialisation et stockage descéréales, gestion du crédit) ne sont pas non plus gérées de façon efficace ni transparente, ce qui encourage les détournements et lesmalversations.Il arrive enfin bien souvent que les producteurs contractent des crédits auprès des banques, à travers les associations villageoises, pour desmontants importants, sans connaître leurs capacités réelles de remboursement et qu’ils se retrouvent dans l’impossibilité de payer leursdettes.L’insuffisance des outils de gestion des associations villageoises crée un climat de suspicion en leur sein, décourage les initiatives desproducteurs et conduit à des baisses de production quelquefois très importantes.À qui la faute ?La responsabilité de cette situation n’est pas à mettre systématiquement sur le compte des dirigeants des associations villageoises mais plutôtsur l’absence d’outils de gestion appropriés et un effort d’alphabétisation insuffisant pour permettre une véritable maîtrise de ces outils.133
ENCADRÉ 12« Ina cogo nyena » (en français « Tu es venu à temps ») 1 …C’est le nom que les villageois de la zone de Kignan ont donné à leur centre de gestion rurale. Il faut dire qu’en1994, lorsque le centre de gestion a été mis en place, la production avait chuté de plus de 50 %. Les producteursne percevaient plus leurs revenus du coton depuis 2 ans en raison du surendettement de l’association villageoisede Kignan et de son incapacité à faire face à ses dettes. Il en allait de même dans la plupart des autresassociations villageoises de la zone.Avec l’arrivée du centre de gestion et la reprise en main des comptes de 60 associations villageoises sur lacentaine que compte le secteur, la production a progressivement repris, les dettes ont été épongées et, en 1999,la production de coton atteignait le chiffre record de 973 tonnes. Le centre appuie maintenant la gestion de 60associations villageoises sur la centaine que compte le secteur ; il a bâti ses propres locaux et les a équipés avecun investissement de 5 millions de F CFA.Les révolutions de l’informationLa confiance est rétablie ; désormais les producteurs maîtrisent la gestion de leurs activités et sont capablesd’envisager des investissements éducatifs, sociaux et sanitaires.1 Témoignage extrait du journal des centres de gestion rurale N°1, octobre 1999.L’arrivée des centres de gestion rurale a changé beaucoup de choses dans le fonctionnement des associations villageoises et dans les modesde gestion communautaire.Des centres de gestion au service des associations villageoises…Les centres de gestion rurale ont été mis en place en 1992, à l’initiative d’une organisation populaire d’épargne et de crédit en milieu rural(Kafo Jiginew) et de la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT), avec le soutien de la coopération française.Il s’agissait de favoriser une plus grande autonomie des organisations paysannes par la maîtrise de leur gestion et d’obtenir une transparencedes comptes, base de la confiance entre les membres des associations villageoises. L’approche du projet a consisté à impliquer lesassociations villageoises dans la conception, la gestion et le suivi des centres, y compris dans leur financement, pour répondre à la demanderéelle des producteurs. Cette démarche visait à favoriser une appropriation du système par les paysans et une pérennisation du dispositif.L’autre originalité de l’approche mise en place réside dans le fait qu’il s’agit d’un service payant pour lequel l’association villageoise doit faireune démarche volontaire d’adhésion et satisfaire à des critères d’éligibilité.Des outils simples, transparents et appropriablesLes centres proposent aux associations villageoises qui le souhaitent, les services de conseillers en gestion qui les aident à mettre en place unsystème comptable adapté à leurs besoins et transparent. Les conseillers assurent également le suivi de la comptabilité de l’association etaident à la préparation d’un compte rural qui fait l’objet, chaque année, d’une restitution publique à travers une assemblée générale desproducteurs. Les secrétaires et les comptables des associations villageoises reçoivent une formation pour poursuivre l’activité de façon plusautonome.134
Les groupements paysans et les marchésIl existe un centre de gestion pour environ 40 associations villageoises, qui sont représentées dans le conseil d’administration des centres.L’adhésion des associations villageoises est volontaire. Elle est soumise à deux conditions : les associations candidates doivent accepter lavérification complète de leurs comptes et doivent payer une cotisation dont le montant est calculé en fonction du volume de cotoncommercialisé. La CMDT incite à l’adhésion à ces centres en remboursant une partie importante de la contribution par le biais d’une primedonnée aux associations adhérentes, pour chaque tonne de coton produit.Les cotisations sont destinées à rémunérer le conseiller et à financer les frais de fonctionnement du centre : déplacements du conseiller(une moto et du carburant), achat des documents de gestion.Surmonter la méfianceUne campagne d’information et de sensibilisation a été organisée et la mise en place des centres de gestion a été progressive. Il fallait eneffet surmonter la méfiance des producteurs, qui craignaient que cet outil ne soit un moyen de contrôler leurs activités. Par ailleurs, certainsresponsables d’associations villageoises, qui redoutaient de voir leurs comptes vérifiés par des personnes de l’extérieur, avaient tendance àfreiner la mise en place des centres de gestion.La transparence des comptes et l’amélioration de la gestion ont eu des effets importants : diminution des conflits et des suspicions,disparition des irrégularités comptables, réduction des mauvaises créances et meilleure gestion des crédits. Les associations peuventeffectuer leurs investissements en toute liberté et maîtriser leurs frais généraux. Le renforcement de leur situation financière leur procureune capacité de négociation accrue. Par ailleurs, la production de coton a augmenté, de même que les ressources des paysans.Vers la création d’une fédération nationale des centres de gestion…Les centres de gestion continent à se multiplier. À la fin de 1999, on comptait 23 centres, couvrant environ 1 000 des 4 500 associationsvillageoises recensées dans 5 régions CMDT. L’objectif est de couvrir 1 900 associations d’ici la fin 2001 et 2 500 en 2003.Plusieurs mesures sont programmées pour garantir la durabilité des centres de gestion. Des unions régionales de centres sont en voie deconstitution ; chacune de ces unions sera assistée par un centre régional d’appui. Une fédération de ces unions régionales aura pour tâchesde programmer l’implantation de nouveaux centres, d’assurer les relations avec les partenaires, de mobiliser les compétences externes etde mettre en place un système de suivi-évaluation. Les partenaires de la filière, comme la CMDT, les organisations paysannes, les chambresd’agriculture, les banques et les établissements de crédit, seront associés à toutes les étapes.Des outils d’information et de communicationDes outils d’information et de communication seront mis en place ou renforcés pour accompagner l’évolution des centres, organiser descampagnes de sensibilisation, rendre compte des expériences de terrain et donner la parole aux producteurs et à leurs associations. Les135
esponsables du projet de gestion rurale se sont rendu compte que si l’information parvenaitbien aux dirigeants des associations villageoises (présidents et secrétaires), elle n’était passystématiquement répercutée au niveau des producteurs dans les villages et quel’information dont disposaient les paysans sur le fonctionnement du système n’était passuffisante. Par ailleurs, le changement de rythme d’implantation de nouveaux centres et lesobjectifs quantitatifs du projet impliquent la mobilisation de moyens plus systématiquesd’information et de communication.Les révolutions de l’informationUn numéro de Yeelen, un journal localen bambaraDeux vecteurs principaux ont été identifiés : un support interne, le journal des centres degestion rurale et un support plus ouvert sur l’ensemble de la population rurale, les radios deproximité des différentes régions concernées.Intitulé Yeelen (la lumière, en bambara), le journal a vu le jour en octobre 1999 et paraît 4fois par an. Son tirage est de 3 000 exemplaires en bambara et de quelques centaines enfrançais. Il est distribué gratuitement aux associations villageoises membres du centre de gestion et servira également à sensibiliser lesvillages qui n’ont pas encore adhéré. Le contenu éditorial du journal est essentiellement fourni par les membres des centres de gestion dontla contribution est sollicitée. Le premier numéro apportait une information concrète sur la vie des centres de gestion : comment ils ont étécréés, quels ont été les principaux obstacles rencontrés pour leur mise en place et quels sont les premiers résultats. Les articles s’appuyaientessentiellement sur des témoignages des acteurs des centres (conseillers en gestion, responsables des centres régionaux d’appui) ou desresponsables d’associations villageoises. Une page était réservée aux activités du centre de formation. Le deuxième numéro traitait de lamise en place des nouveaux centres régionaux d’appui.Les radios de proximité sont nombreuses dans les différentes zones de production cotonnière et elles constituent le support idéal pourapporter une information directe à l’ensemble de la population rurale sur l’utilité et le fonctionnement des centres de gestion, en faisantappel à des techniques vivantes et interactives de production : émissions publiques villageoises, reportages sur l’impact des centres degestion sur la production et le revenu des paysans, témoignages, débats, information sur les mécanismes et techniques de fonctionnementdes centres. Le recours à la radio permettra à la fois d’informer et de sensibiliser les associations villageoises sur la démarche des centresde gestion et leur intérêt à y adhérer, et de mieux apprécier l’opinion des producteurs, utilisateurs finaux du système. Des contacts ont étépris avec l’ensemble des radios de proximité des différentes régions concernées pour négocier des accords de partenariats et le traitementrégulier des thèmes de la gestion rurale sur les antennes des radios de Mali Sud (voir l’article « Apporter aux producteurs ruraux uneinformation de proximité », p. 21).INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESFousseini Coulibaly, Centre régional de Sikasso, Sikasso (Mali). Tél. (223) 62 05 93Idrissa Sidibe, Directeur, Centres de gestion rurale, Bamako (Mali). Tél. (223) 24 18 02 ; fax (223) 21 27 52136
Les groupements paysans et les marchésApprendre et échanger sur l’agriculture durableL’association PELUMJohn WilsonMaintenir le foyer alluméJuin 1992. C’est l’hiver au Zimbabwe. L’air extérieur est glacé, le local modeste. Les 14 participants à l’atelier s’installent chacun à son tourprès du feu. Ils proviennent de cinq pays d’Afrique orientale et australe et sont réunis pour discuter des moyens d’améliorer la formationdes agents des ONG qui travaillent avec les communautés rurales dans le domaine de l’agriculture durable.C’est ainsi qu’a démarré PELUM, « l’Association pour une gestion écologique et participative de la terre » (Participatory Ecological Land-UseManagement Association). Bien qu’elle comprenne maintenant plus de 100 organisations membres provenant des pays d’Afrique orientaleet australe, l’association a conservé les mêmes modes de fonctionnement que lors de sa création. Le foyer est resté allumé.Les originesLe groupe installé autour du foyer était en train d’identifier les compétences, les connaissances et les comportements nécessaires à unanimateur communautaire amené à travailler avec des paysans sur la gestion de l’agriculture et des ressources naturelles. Il fallait connaîtreleur profil pour bâtir un programme de formation pour ces animateurs.Comment cette question a-t-elle émergé ? Pendant les années 70 et 80, l’approche classique du développement rural consistait à former leplus grand nombre de paysans aux techniques agricoles « modernes ». Ces méthodes préconisaient l’utilisation de semences améliorées,d’engrais et de pesticides pour maximiser les rendements. Ce système a relativement bien fonctionné tant que les intrants étaient fournisgratuitement ou subventionnés. Mais les politiques « d’ajustement structurel » furent mises en œuvre par les différents gouvernements etces incitations ont été supprimées. De nombreux paysans ont alors découvert qu’ils n’étaient plus en mesure de payer des intrants qui leurétaient pourtant devenus indispensables.Un autre problème dans l’approche classique du développement était son ignorance, voire même son mépris des compétences ou dessavoirs paysans. Ces agriculteurs avaient pourtant, pendant des années, accumulé une somme importante de connaissances sur les sols etles climats, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Ils possédaient des exploitations de tailles diverses et savaient calculer les risques parrapport à leurs objectifs de rendement et de niveau de vie. Ils avaient développé entre eux des relations d’affaires complexes et dessolidarités mutuelles fondées sur l’amitié.L’approche conventionnelle « descendante » ignorait tout cela. Les vulgarisateurs disaient aux paysans ce qu’ils avaient à faire et constataientavec amertume que ceux-ci ne suivaient pas leurs « conseils ». Dans le courant des années 80, de nombreux organismes de développement137
prirent conscience de la réalité et changèrent leurs méthodes de travail. D’abord, ils commencèrent à utiliser des approches « participatives »où les paysans (et non les organismes de développement) définissaient eux-mêmes leurs propres besoins et planifiaient les changementsde leurs pratiques agricoles en fonction de leurs compétences et de leur savoir. Les organismes de développement devaient jouer un rôled’animateur plutôt que de professeur : au lieu de dire aux paysans ce qu’ils devaient faire, ils les accompagnaient dans la recherche et lamise en œuvre des innovations qu’ils avaient eux-mêmes conçues. Toute une gamme de méthodes participatives ont été mises au pointpour aider les agriculteurs à identifier les problèmes, construire les solutions, assurer la mise en œuvre et le suivi de leurs activités.Les révolutions de l’informationEnsuite, les organismes de développement ont commencé à promouvoir le concept d’agriculture durable basée sur les ressources locales :variétés traditionnelles, compost et engrais disponibles localement et ainsi de suite. Cette approche avait de nombreux avantages : ellepermettait de réduire le niveau des intrants que les paysans avaient à payer et elle limitait les effets nocifs des pesticides et engraischimiques. Cependant, il existait peu d’animateurs communautaires capables de promouvoir cette nouvelle approche participative. Laplupart des vulgarisateurs provenaient des écoles d’agriculture où on leur avait appris les méthodes descendantes classiques. Il fallait doncà la fois conceptualiser toutes les nouvelles idées en matière de participation et d’agriculture durable et former les agents des ONG à leurmise en œuvre.Neuf mois après la première réunion, le groupe qui avait conçu le programme de formation originel se retrouva à nouveau. Le projet avaitcirculé, il avait été largement discuté et amendé. Il était temps de faire un pas supplémentaire. Le groupe examina une idée qui avait étéformulée pendant la réunion précédente : il fallait aller au-delà de la simple conception d’un programme de formation. Il fallait profiter decette opportunité pour mettre en commun les initiatives des différentes ONG locales en matière d’agriculture durable afin que lesexpériences des uns et des autres puissent être partagées et profiter à tous.Pourquoi échanger ?Les ONG travaillent souvent de façon isolée. Elles apprennent beaucoup en développant leurs propres activités mais elles n’ont pas souventl’occasion d’échanger leurs expériences. Cet état de choses est apparu comme une évidence pour les membres du groupe. Ils décidèrentdonc de lancer une association qui favoriserait les échanges entre toutes ces ONG. Un comité de pilotage a été désigné, comprenant unmembre provenant de chacun des pays représentés. Ce comité, appuyé par une équipe légère de coordination (une personne et demie)accompagna la création de l’association PELUM.La construction se poursuivit prudemment pendant deux années et en octobre 1995, 30 délégués représentant des ONG de la régionlancèrent l’association PELUM avec comme devise « faciliter la formation et bâtir un réseau pour une gestion participative et écologique dela terre en Afrique orientale et australe ».Le réseau qui précède le réseauLa force et le potentiel de l’association reposent sur les groupes de travail nationaux, composés de tous les membres de chaque pays. Leprésident de chacun de ces groupes représente le pays au sein du conseil d’administration de l’association. Les réunions du conseil,138
Les groupements paysans et les marchésl’assemblée générale semestrielle et le bulletin trimestriel de l’association permettent à tous les membres de s’informer sur les réalisationsdes uns et des autres. Les activités varient d’un pays à l’autre. Dans certains pays, le démarrage a été difficile. Au départ, les activités reposentsur une ou deux personnes. Petit à petit, la base s’élargit.L’association a compris qu’un réseau formel ne peut fonctionner que si l’information a d’abord été échangée de façon informelle entre lesmembres. Ce préalable du réseau informel constitue une garantie pour la mise en place du réseau formel et l’installation d’un secrétariatnational.Les ONG locales dépendent le plus souvent de financements extérieurs. Leurs conditions difficiles de survie ne les incitent pas à donnerune grande priorité à l’échange d’informations avec les autres. De plus, les jeunes organisations doivent d’abord se préoccuper de leurpropre gestion avant de chercher à échanger avec d’autres organisations. Cela signifieque ce sont souvent les organisations les plus anciennes et les plus solides qui ont letemps de contribuer aux activités d’un réseau.Une série d’ateliersLes ateliers sont une part importante des activités du réseau et ils sont très appréciéspar ses membres. Chaque année, l’association mène une enquête auprès de sesmembres pour identifier leurs besoins prioritaires. Sur cette base le programmed’ateliers est établi pour l’année. Quatre à sept ateliers sont organisés chaque année.Ils durent d’une à trois semaines. Ils se déroulent dans différents pays et sont engénéral accueillis par une organisation membre de l’association. À titre d’exemple, desateliers ont été organisés sur des thèmes comme le suivi participatif, la gestion del’information, les techniques d’animation, la production de matériel didactique et lagestion intégrée des terroirs.Les participants sont invités à venir à l’atelier avec leurs propres expériences sur lesujet pour les échanger avec les autres. Des intervenants extérieurs apportent lesconnaissances complémentaires nécessaires. Des exercices pratiques sont organiséspendant l’atelier lui-même pour permettre aux participants d’appliquer concrètementce qu’ils ont appris.Comme les ateliers sont organisés par les membres de l’association elle-même, il nes’agit pas d’activités limitées dans le temps. Au contraire, les ateliers contribuent à laconsolidation de l’association en construisant un réseau toujours plus cohérent, pierreaprès pierre. Le défi qui reste à relever est l’amélioration de la surveillance et du suividu réseau.Les participants à un atelier sur laconservatiion du sol et l’aménagement del’espace rural organisé par l’associationPELUM apprennent à employer un « cadre enA », un niveau de conception rudimentairedestiné à déterminer les courbes de niveau surune pente(Photo : PELUM)139
Élargir le marché de l’informationL’association PELUM distribue également des livres et du matériel didactique, notamment ceuxqui sont produits dans la sous-région. Au départ, l’association voulait produire son proprematériel de formation. Toutefois, ses responsables se sont rapidement rendu compte que cematériel existait déjà et que le problème à résoudre était davantage celui de la distribution.Les révolutions de l’informationL’objectif à long terme reste d’encourager la production de matériel pour satisfaire le marchépotentiel créé par l’association. Par exemple, quelqu’un qui produit un ouvrage sur le suivi Un numéro du magazine Ground Upparticipatif en Ouganda sera assuré de voir cette publication distribuée dans toute la sousrégionet pas seulement en Ouganda. Le magazine de l’association Ground Up était au départ un simple bulletin interne. Le premiernuméro a été publié en 1999. Il contient des articles sur l’agriculture durable, donne le calendrier des programmes de formation et informesur les nouveaux titres des publications.L’école PELUM du ZimbabweEn novembre 1995, les membres de l’association du Zimbabwe se sont réunis pour discuter des meilleures façons de mettre en œuvre leprogramme de formation mis au point par l’association. Des représentants de l’université ainsi que des services de vulgarisation dugouvernement ont été associés à cette rencontre.« Comment ce programme peut-il être enseigné par nos organisations de base ?», se demandait à haute voix un des participants. « Chacunede nos associations pourrait réaliser une partie du programme mais aucune d’entre elles n’a les compétences nécessaires pour le mettre enœuvre dans son intégralité ».« Vous avez trouvé ! » s’exclama un autre participant. « C’est exactement ça ! Si chacun d’entre nous en prend une part, la part qu’il maîtrise,alors, ensemble, nous pouvons assurer l’intégralité du programme de formation ».Et c’est ainsi que naquit l’idée de « l’école sans murs ». Comme pour l’association elle-même, l’idée du collège, basée sur un partage dessavoirs, fit l’objet d’un suivi méticuleux et de nombreux débats. Des responsables de formation provenant des organisations participantesaffinèrent le programme. Une mission se rendit dans toutes les organisations pour identifier leurs compétences respectives et décider quicouvrirait chacun des aspects du programme. La direction de l’organisation mit au point une stratégie de développement pour le collège etdiscuta de son organisation. Les aspects pratiques d’hébergement et de restauration furent également discutés dans un comité spécialisé.Au moment où elle fut lancée, l’école PELUM du Zimbabwe comprenait des ONG nationales et communautaires, des départements des deuxuniversités et des éléments des services nationaux de formation et de vulgarisation. Les premiers étudiants entamèrent un cycle de coursintercalaires en 1998. Un groupe provenant des organisations fondatrices vint aider à défricher le terrain et à aplanir les difficultés dedémarrage. La deuxième promotion démarra dès le début de l’an 2000.140
Les groupements paysans et les marchésLes étudiants avaient à leur programme des cours d’agro-écologie, de gestion des ressources naturelles, de gestion des organisations et detechniques d’animation. Les cours se déroulaient au sein des différentes organisations membres, ce qui leur permettait également de sefamiliariser avec leurs activités et leur fonctionnement. L’apprentissage, essentiellement pratique, se déroulait à partir de l’observation dela façon dont les organisations mettaient en œuvre leurs programmes, approchaient les questions en grandeur réelle, sur le terrain :l’organisation des communautés, l’animation, l’agro-écologie.Un autre avantage de cette approche résidait dans le fait que ces équipes, composées de spécialistes qui disposaient d’une inestimableexpérience dans le domaine du développement, pouvaient échanger leur savoir et leur expérience avec les nouvelles générations d’acteurs.Le plus souvent, ces connaissances et cette expérience sont perdues car rien n’est prévu pour qu’elles soient transmises de génération engénération. Les étudiants n’ont pas été les seuls bénéficiaires du système. Les organisations membres y ont trouvé l’opportunité d’échangerénormément d’informations dans leurs champs d’expériences respectifs. Par exemple, pendant la mise en place de l’école, toutes lesorganisations membres se sont rendu des visites d’étude mutuelles, ce qui a offert une opportunité unique d’apprendre les uns des autres.L’école du Zimbabwe peut être considérée comme une référence dans la sous-région. Toutes les étapes de sa mise en œuvre ont étéconsignées et échangées avec les membres de l’association dans les autres pays.Sécurité semencièreLes semences sont la base de la sécurité alimentaire. Les paysans doivent disposer des bonnes variétés, au bon moment et en quantitéssuffisantes. Si ce n’est pas le cas, ils risquent de semer trop tard par rapport à l’arrivée des pluies, d’exploiter des variétés susceptibles d’êtreravagées par les insectes et les rongeurs ou de récolter des produits que personne ne voudrait acheter.La sécurité en matière de semences se joue à différents niveaux : national, communautaire et familial. Au niveau national, un pays doitdisposer d’une réserve suffisante de semences pour satisfaire la demande. Mais ceci ne garantit pas la disponibilité des semences pour lesagriculteurs. En conséquence, la sécurité semencière doit être renforcée au niveau communautaire et familial, en s’assurant que lessemences pourront être multipliées et stockées au niveau local afin que les paysans puissent en disposer en temps utile pour les semis.La question de la sécurité semencière a constitué une préoccupation importante pour les membres de PELUM. Vers la moitié de l’année1997, un réseau d’ONG britanniques approcha l’association pour qu’elle héberge un programme consacré à la sécurité semencière. PELUMmanifesta son intérêt mais demanda à être associée à la conception du programme. Elle ne voulait pas être seulement l’hôte d’un programmeconçu ailleurs. Cette exigence retarda la mise en œuvre du programme mais cela n’avait pas d’importance pour l’association. Une enquêtesur les besoins des membres de PELUM fut entreprise et les organisations firent à leur tour une enquête sur les besoins de leurs adhérentspaysans. Les résultats furent exploités à l’occasion d’un atelier de programmation mené conjointement avec le réseau britannique.Pendant cette période, le bulletin du PELUM multiplia les articles sur ce programme et le conseil de l’association en discuta pendant sessessions. Le programme de sécurité semencière devint ainsi, grâce à cette approche prudente et progressive, un élément important du pland’action de l’association. Depuis, un programme de formation et un manuel de sécurité semencière ont été produits. En 1999, leprogramme a obtenu un prix pour la façon dont il a été mis en œuvre.141
Des perspectivesIl y a maintenant dix ans qu’une poignée de personnes firent les premiers pas dans la constitution de l’association PELUM. C’est encore uneorganisation très jeune mais elle a déjà fait beaucoup dans le domaine de l’échange de l’information. Désormais, la priorité consiste àrenforcer le réseau pour permettre à l’information de circuler plus facilement. Cette échéance permettra à l’association de jouer un plusgrand rôle de lobbying et de défense de ses membres. Beaucoup poussent l’association à adopter cette stratégie rapidement et notammentles partenaires de coopération. Toutefois, PELUM résiste à ces pressions et s’engagera dans cette voie seulement lorsqu’elle disposera detous les éléments pour le faire avec des chances de succès.Les révolutions de l’informationLes principaux enseignements tirésL’association PELUM a tiré un certain nombre de leçons, souvent douloureuses, de son expérience. En voici quelques exemples :• Avoir un programme conjoint comme objectif est une bonne façon de garantir le bon fonctionnement d’un réseau ;• Avancer avec prudence permet d’impliquer les membres au maximum. Mais il faut aussi que la réalisation du programme progresse.C’est une question d’équilibre entre la nécessité d’aller de l’avant et l’objectif à long terme, qui est de maintenir des liens forts entre lesmembres de l’association ;• Obtenir des résultats à court terme et les faire connaître est important car cela maintient l’intérêt des membres pour le réseau. C’estvrai, à la fois pour les nouveaux membres et pour les plus anciens. Les ateliers, les ouvrages publiés par l’association et le magazine sontles meilleurs supports pour cette valorisation ;• L’activité de réseau, même informelle, est un préalable indispensable à la mise en place d’une structure d’échange ;• L’existence d’un secrétariat est importante mais il doit demeurer léger. Le danger d’un secrétariat excessivement dominateur dans unréseau doit être pris en considération. Il peut s’avérer nécessaire de procéder à des changements dans l’équipe pour éviter ce danger.Dans le cas de PELUM, quand le premier coordonnateur quitta ses fonctions, son remplacement fut l’occasion de réduire la tendancedu secrétariat à être au centre de tout, à se mêler de tout ;• Les bonnes idées arrivent toujours quand la situation a suffisamment mûri. Il est indispensable de créer l’environnement favorable àleur éclosion. PELUM, par exemple, a commencé en créant un programme de formation et, grâce à ce processus, elle a évolué lemoment venu en une association.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESMutizwa Mukute, Coordinator, 6 Groombridge Road, PO Box MP 1059, Mount Pleasant, Harare (Zimbabwe). Tél. (263) 4 744 117 ;fax (263) 4 744 470 ; e-mail pelum@zimsurf.co.zwJohn Wilson, Flat 2, 6 West Street, Ashburton, Newton Abbot, Devon TQ13 7DU (Royaume-Uni). E-mail jwilson@spiritvaults.freeserve.co.uk142
Les groupements paysans et les marchésModerniser les marchésLe cas de la KACEPaul MundyLe rêve d’Adrian MukhebiC’était en 1976. Le jeune étudiant kenyan était inscrit en économie rurale à l’université de l’État du Kansas, aux États-Unis. Les étudiantssuivaient un cours sur la bourse de commerce de Chicago, un des plus importants marché des matières premières du monde. Ils devaientsimuler des investissements financiers sur le marché, acheter et vendre de la poitrine de porc et essayer de faire des bénéfices.Adrian Mukhebi était fasciné. Il parcourait chaque matin les pages du Wall Street Journal, décidait ce qu’il allait acheter, en quelles quantitéset, bien sûr, quand et où il allait revendre. À la fin du cours, il avait amassé un magot, malheureusement en « monnaie de singe ».« Cela devrait être possible au Kenya », pensait-il. Mais quand, à son retour au pays, il retrouva son poste au ministère de l’agriculture, il serendit compte que ce n’était pas le cas. Les offices de commercialisation des matières premières du gouvernement contrôlaient les prix : ilsdisaient aux agriculteurs ce qu’ils devaient cultiver, achetaient leur production au prix qu’ils avaient décidé et se chargeaient du transportet de l’entreposage. Pour les paysans, c’était généralement une mauvaise affaire mais ils n’avaient pas le choix. Ils ne pouvaient vendre àpersonne d’autre en dehors peut-être des marchés locaux.Attendre le passage du camionEn 1992, les choses commencèrent à changer. Le gouvernement commença à lever les restrictions et à libéraliser le marché des produitsagricoles. La plupart des offices de commercialisation furent abolis et les paysans, pour la première fois, avaient la liberté de négocier euxmêmesle prix de leur production.Mais à qui allaient-ils vendre ? La suppression des offices de commercialisation avait laissé un grand vide dans la filière des matièrespremières. Les producteurs pouvaient toujours proposer leur récolte aux marchés locaux, mais des centaines d’autres paysans qui avaientcultivé les mêmes produits étaient aussi en train d’essayer d’écouler leur production. La seule alternative était d’attendre l’arrivée du camionde l’entreprise de transformation locale qui chargeait leurs sacs et leur donnaient le prix qu’elle avait décidé de leur donner.Qui veut acheter du blé ?Adrian Mukhebi alla au Zimbabwe et vit comment fonctionnait le ZIMACE, une nouvelle bourse des matières premières agricoles. Il en revinttrès impressionné et convaincu que le moment de mettre en place de telles structures au Kenya était venu.143
Les révolutions de l’informationIl lança alors formellement la KACE (KenyaAgricultural Commodity Exchange), la bourse desmatières premières agricoles du Kenya, en 1997.C’est l’unique bourse de matières premières géréepar une société privée en Afrique de l’Est. Elletraite les transactions commerciales entre lesproducteurs et les négociants locaux d’un côté etles acheteurs de matières premières dans la régionet sur le marché mondial de l’autre. Ellefournissait aussi des informations fiables sur lescours des matières premières.Moyennant un coût de 500 shillings (environ 7 e), quiconque a quelque chose à vendre, par exemple 2 000 sacs de blé, peut utiliser legrand tableau de la salle des transactions de la KACE, située dans le centre des expositions internationales de Nairobi, au Parc Jamhuri, pourafficher les caractéristiques du produit à vendre (quantité, qualité, prix demandé, etc.). On y trouve également des espaces d’exposition, oùles vendeurs proposent des échantillons de leurs produits pour que les acheteurs puissent les voir et les comparer. La KACE apporte unappui aux acheteurs pour négocier une transaction. Ceux-ci peuvent également afficher leur offre sur le tableau, bien en vue des vendeurspotentiels.Les acheteurs et les vendeurs n’ont pas besoin d’être présents dans la salle des transactions. Ils peuvent faire leurs offres et leurs enchèrespar téléphone ou par fax. Les agents de la KACE s’occuperont de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. Ils peuvent théoriquementnégocier n’importe quel type de produit agricole, depuis le maïs, le blé, le bétail ou les noix de cajou, jusqu’aux intrants comme lessemences, les engrais et autres produits chimiques. La KACE peut également aider à trouver des sociétés prestataires pour l’enlèvement,l’expédition, le camionnage ou le transport. Elle peut enfin trouver des sociétés de crédit pour faciliter les transactions financières.Lorsque la bourse sera définitivement mise en place, les transactions entre acheteurs et vendeurs seront totalement transparentes, avec unsystème d’enchères publiques entre l’offre et la demande dans la salle des transactions. Au fur et à mesure de son développement, la bourseautorisera les contrats à terme.Les services de la bourse sont rémunérés par prélèvement d’un pourcentage sur la valeur de chaque marché conclu : au maximum 2 % pourles petits marchés et moins pour les plus gros. À cela, il faut ajouter les 500 shillings payés pour figurer sur le tableau des ventes. Cettesomme permet d’éviter les offres faites par des spéculateurs, qui en réalité, n’ont rien à vendre.Problèmes de croissanceAdrian Mukhebi explique le fonctionnement de la KACE, la bourse des matièrespremières agricoles(Photo : Paul Mundy)La KACE est encore une très jeune organisation. En 1999, le niveau des échanges était seulement de l’ordre de 1,5 millions de shillings(environ 20 000 e), ce qui correspond toutefois à un doublement des chiffres de 1998 et un triplement du volume de 1997. Adrian Mukhebi144
Les groupements paysans et les marchésne s’inquiète pas. Il sait que les premières années sont nécessairement dures et que les structures similaires en Zambie et au Zimbabwe ontmis 4 ou 5 ans à décoller. Il prévoit un niveau de transaction de l’ordre de 5 millions de shillings (70 000 e) pour 2000 et espère multiplierce chiffre par dix l’année suivante.Le principal problème est de trouver des vendeurs fiables. Contrairement au Zimbabwe et à l’Afrique du Sud, avec leurs gigantesquesexploitations agricoles, 80 % des céréales du Kenya sont produits par de petits exploitants peu compétents, chacun d’entre eux offrant deminuscules productions, de qualités très variables et à des périodes différentes. Cela rend difficile le regroupement des productions, lerespect des normes de qualité et la garantie des quotas.« Il faut être patient et confiant », dit Adrian Mukhebi. « Pour les producteurs, ce sont des modalités d’achat et de vente complètementnouvelles. Les gens avaient l’habitude des anciennes procédures. S’habituer à acheter ou à vendre à quelqu’un qui n’est pas physiquementprésent, ce n’est pas évident, ça demande un long apprentissage ».Se regrouperLa réponse de la KACE consiste à aider les petits exploitants à se regrouper en coopératives commerciales. Avec l’appui de la fondationallemande Hanns Seidel et l’organisation américaine ACDI/VOCA, la bourse essaie d’inciter les producteurs à se constituer en coopérativeset de les former à la gestion pour qu’ils améliorent leur pouvoir de négociation.Ce n’est pas facile : les coopératives ont mauvaise réputation au Kenya parce qu’elles ont longtemps été imposées par le gouvernementplutôt que d’être suscitées par les producteurs de base. De nombreux produits n’ont pas de cahier des charges définissant leurs normes dequalité. Les informations du gouvernement sur les prix ne sont pas fiables et il n’y a pas suffisamment d’entrepôts pour stocker les céréales.Malgré cela, les producteurs qui participent aux ateliers de la KACE sont enthousiastes. Deux coopératives ont déjà été constituées dans lesdistricts de Trans Nzoia et Bungoma ; deux autres, dans les districts de Uasin Gishu et Kiambu sont en cours d’établissement. Cescoopératives pourraient théoriquement regrouper des centaines de milliers de producteurs. La KACE espère travailler avec les coopérativespour bâtir des entrepôts où les différents produits pourront être regroupés, classés, labellisés et convenablement conservés.Disposer d’une production de meilleure qualité et en plus grande quantité signifie pour les producteurs avoir un plus grand pouvoir denégociation, trouver plus de clients et obtenir de meilleurs prix. La KACE travaille également à la mise en place d’un réseau national couvrantles principales régions de production du pays pour assurer un meilleur contrôle des prix et recueillir toutes les informations utiles sur l’étatdu marché.Une nouvelle impulsion pourrait être apportée si le gouvernement décidait de mettre fin au monopole de commercialisation qui s’appliqueencore aux deux principaux produits d’exportation, le thé et le café. Il s’agit de produits à haute valeur ajoutée, faciles à entreposer, quidisposent de normes de qualité bien établies et d’une clientèle traditionnelle. « Les producteurs se battent pour que les restrictionsimposées par l’État soient levées », dit Adrian Mukhebi. S’ils y parviennent, la KACE pourrait abriter les transactions sur ces produits.145
Du commerce, pas d’aideLa saison agricole 1996–97 a connu une sécheresse sévère, qui a gravement réduit la production de maïs. Pendant la même période,l’Ethiopie voisine produisait des surplus. En 1998–99, c’est le Kenya qui produisait des surplus, alors que la famine faisait rage dans le sudde la Tanzanie. « Un marché des matières premières bien organisé aurait pu permettre de prévenir ces crises », dit Adrian Mukhebi. Desinformations auraient dû circuler entre acheteurs et vendeurs sur les déficits et les surplus. Les céréales auraient dû être acheminées deszones excédentaires vers les zones déficitaires voisines, évitant un recours à l’aide alimentaire extérieure ».Les révolutions de l’informationAdrian Mukhebi est convaincu que le système sera favorable aux petits producteurs. « Un marché bien organisé est synonyme de meilleursprix pour eux », dit-il. « De meilleurs prix signifient des revenus plus élevés ; aujourd’hui, les producteurs ont un choix très limité : ils n’ontaccès qu’au marché local. La bourse des matières leur donne accès à un marché plus large et à de meilleurs prix ».« Si ça marche » ajoute-t-il, « cela va considérablement valoriser leurs productions et donc augmenter de façon significative leurs revenus.« C’est la meilleure façon de lutter durablement contre la pauvreté ».INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESDr Adrian Mukhebi, Executive Director, Kenya Agricultural Commodity Exchange (KACE), Brick Court Building, 4th Floor, Mpaka Road,Westlands, PO Box 59142, Nairobi (Kenya). Tél. (254) 2 441829/ 2 441830 ; fax (254) 2 441831/ 2 448486 ; e-mail kace@eafex.or.ke146
Valoriser la tradition : experts traditionnels et vétérinaires aux pieds nus dans le nord du KenyaPromouvoir les expérimentations paysannes : à la Trinité, des poulets sous surveillanceSauvegarder les savoirs locaux : forêts nourricièresSavoirs paysans
Au cours des 20 dernières années, une sorte de révolution est intervenue dans lesapproches du développement. Les décideurs, les chercheurs et les vulgarisateurs avaientpris l’habitude de considérer les paysans comme des ignorants. Ils s’employaient donc àmettre au point des techniques agricoles « améliorées » et à les faire adopter par lesagriculteurs, de gré ou de force.Les révolutions de l’informationMalheureusement pour eux, cette approche n’a pas donné de résultats très positifs car ellene prenait pas en compte des éléments essentiels. Les agriculteurs sont confrontés à toutessortes de contraintes biophysiques que les chercheurs ne connaissent pas ou ne veulentpas connaître : des précipitations irrégulières, des sols dégradés, des parasites, desmaladies... ; la liste est longue. La situation des producteurs varie d’une région à une autre,d’une exploitation à une autre. Il est impossible pour les chercheurs de mettre au point despaquets technologiques pour améliorer les rendements en couvrant tous ces cas d’espèces.Sans parler des particularités socioéconomiques : les agriculteurs ont des niveauxd’éducation très disparates, des cultures et des croyances multiples, des taillesd’exploitation et des ressources très variables. Les cours des produits subissent desfluctuations violentes, s’effondrant au moment des récoltes, quand les agriculteurs ont desproductions à écouler. Les prix des intrants connaissent aussi des fluctuations importantes(généralement orientées vers le haut). Bien souvent, les producteurs n’ont pas les moyensd’acheter les engrais ou les médicaments nécessaires pour améliorer leurs rendements oumaintenir leurs troupeaux en bonne santé.Aujourd’hui, on découvre que les paysans ont un « savoir propre » sur leur environnement,leurs cultures, leurs troupeaux et que ce savoir s’est construit au cours de sièclesd’observation et d’expérimentation. Ce savoir est vital ; s’ils ne l’avaient pas, ils mourraientde faim. Et ils continuent à expérimenter et à accumuler, jour après jour, de nouvellesconnaissances : pour un paysan, chaque champ, chaque animal, chaque saison est uneoccasion d’expérimenter.Ce savoir est un capital incomparable pour le développement. En l’exploitant, en identifiantles technologies prometteuses qu’il contient, en encourageant les agriculteurs àexpérimenter et à échanger les résultats de leurs recherches, on libérerait la créativité demillions de paysans au bénéfice de tous. C’est cette valorisation des savoirs paysans quicaractérise les approches novatrices en matière de recherche et de vulgarisation.148
Savoirs paysansValoriser la traditionExperts traditionnels et vétérinaires aux pieds nusdans le nord du KenyaPaul MundyVotre meilleure vache a un problème…Imaginez que vous êtes un éleveur nomade turkana dans les brousses arides du nord du Kenya. Une de vos meilleures vaches a mis bas unbeau et vigoureux veau. Mais le placenta ne veut pas sortir. Une partie pend de la vulve de la vache ; elle sent mauvais et semble pourrie.Douze heures plus tard, il est clair que la vache mourra si vous ne faites rien. Mais que faire ?Le vétérinaire le plus proche est à 200 kilomètres d’ici. Il vous est impossible d’y parvenir et, de toute façon, vous n’avez pas d’argent pourle payer, même s’il entrait dans votre case maintenant.Alors, qu’allez-vous faire ?Vous allez demander de l’aide à Alice Lorot. Cette vieille femme est très connue comme guérisseuse et elle est particulièrement réputéepour sa compétence dans les problèmes de vêlage. Elle possède elle-même 10 chameaux et 6 vaches et elle sait de quoi elle parle. Elles’occupe également des femmes enceintes : elle vous a assisté pour la naissance de votre propre fils, alors vous avez un respect particulierpour ses compétences.Alice Lorot prend une longue racine d’une plante qu’elle appelle sokotei, en racle la peau dans une calebasse d’eau et la laisse tremperpendant plusieurs heures. Quand le liquide est devenu jaune, elle oblige la vache à le boire. Après quelques heures, le placenta est enfinsorti et la vache rumine d’un air satisfait, tandis que le petit veau la tète.MobilitéPrès de 30 à 40 millions de personnes dans le monde sont des pasteurs nomades. La moitié d’entre eux, environ 20 millions de personnes,vivent en Afrique. Ils transhument en petits groupes avec leurs troupeaux de bœufs, de chèvres, de moutons ou de chameaux, à travers leszones desséchées du Sahel et de la corne de l’Afrique, à la recherche d’eau et de pâturages. D’un point de vue économique etenvironnemental, le nomadisme se justifie. Il n’y a pas assez d’eau pour cultiver. Si les troupeaux restent au même endroit, ils brouterontrapidement toute la végétation et piétineront les sols dans tout le voisinage. Ils accentueront ainsi l’érosion et, en l’absence d’arbres, la terredeviendra désertique.149
Les nomades qui se déplacent avec leurs troupeaux peuvent profiter despluies occasionnelles et se déplacer ailleurs en cas de sécheresse. Ilsjouent un rôle essentiel dans l’économie : ils vendent la viande et le lait deleurs bêtes aux citadins et les agriculteurs utilisent l’engrais naturelproduit par leurs troupeaux pour fertiliser leurs champs.Les révolutions de l’informationEntretien sur les herbes médicinales utilisées par lesguérisseurs(Photo : ITDG)Illettrée, mais experteLes gens qui vivent dans les villes et les villages trouvent certaines chosesnaturelles, comme envoyer leurs enfants dans une école voisine, se rendreau dispensaire pour soigner les maladies, consulter le vétérinaire pourtraiter les animaux. Ils peuvent même quelquefois se payer le luxe deroutes, d’électricité, de téléphones ou d’eau potable.Mais il est difficile, pour un gouvernement, de fournir de tels services auxpopulations nomades. Les zones où elles vivent sont très vastes et très peupeuplées. Elles se déplacent souvent, couvrant de longs parcours enfranchissant même quelquefois des frontières. Elles sont pauvres et n’ontpas les moyens de payer ces services. Enfin, les nomades sont endurcis,indépendants et se méfient des étrangers, quelquefois à juste titre.Les pasteurs comptent d’abord sur leurs troupeaux : ils n’ont pas d’autre choix pour ne pas mourir de faim. Au fil des siècles, ils ont acquisune mine de connaissances sur leurs bêtes : comment gérer les troupeaux, comment les nourrir, quelles sont leurs maladies et commentles soigner. Ce savoir a été transmis oralement, de génération en génération.Quelques-uns d’entre eux, comme Alice Lorot, ont acquis des compétences spécifiques pour traiter certains problèmes. Bien qu’elle nesache ni lire ni écrire, Alice Lorot est un véritable expert, au même titre qu’un médecin, un chercheur ou un juriste sont des experts dansleur propre domaine de compétences.Cependant, il y a certaines maladies qu’Alice Lorot convient ne pas savoir traiter. Face à une épidémie de trypanosomiase ou depleuropneumonie contagieuse, ses remèdes à base de plantes sont insuffisants. Sans médicaments modernes, les animaux mourront. Et s’ilsn’ont pas assez de bêtes pour survivre, les pasteurs deviendront dépendants de l’aide alimentaire et de la charité des bailleurs de fonds.Exploiter les savoirsITDG-Kenya est une ONG internationale basée à Nairobi. Elle valorise le savoir d’Alice Lorot et d’autres personnes comme elle, pourcombler un vide dans les services vétérinaires du gouvernement. ITDG est l’acronyme de « Intermediate Technology Development Group ».150
Savoirs paysansLes vétérinaires d l’ITDG forment les guérisseurs traditionnels aux principes de base de la médecine moderne : comment diagnostiquer unemaladie, comment choisir le bon remède et les bons dosages, comment faire une piqûre à un animal malade.Mais la formation ne s’arrête pas là. L’ITDG encourage Alice Lorot à partager son expérience avec d’autres guérisseurs. Comme sescollègues, elle est totalement disposée à transmettre son savoir et ses compétences : elle donne, sans aucune compensation, des conseilsaux autres sur la préparation des remèdes ou les traitements appropriés à chaque type de maladie.Avec l’aide des guérisseurs, l’ITDG a établi une liste des plantes qu’ils utilisent et analysé les ingrédients contenus dans chacune d’entreelles. Lorsque l’efficacité d’un traitement est mise en évidence, il est considéré comme validé et recommandé à tous les éleveurs. L’ITDGs’assure par ailleurs que la communauté qui a découvert les vertus de la plante s’en voie attribuer les mérites.Alice Lorot et plusieurs autres guérisseurs ont participé à un atelier et contribué à rédiger un manuel sur la médecine vétérinairetraditionnelle (l’atelier, organisé par l’ITDG et l’Institut international pour la reconstruction rurale est décrit p. 179). Des milliersd’exemplaires de ce manuel ont été vendus, permettant ainsi de diffuser largement, ailleurs en Afrique et dans le monde, les mérites dessavoirs locaux et traditionnels.Appuyer les services gouvernementauxLe travail de l’ITDG avec les pasteurs ne se limite pas aux guérisseurs traditionnels. L’ONG collabore aussi étroitement avec les vétérinairesdes services gouvernementaux dans les districts de Marsabit et Turkana, dans le nord du Kenya. Ces vétérinaires ont des budgets très limités,insuffisants pour couvrir leurs frais de transport, de médicaments et lesautres éléments nécessaires à l’accomplissement normal de leur mission.L’ITDG les soutient en leur fournissant des moyens de transport et enorganisant des campagnes de vaccination du bétail contre des maladiescomme la peste bovine.Les équipes de l’ITDG assurent également la formation des vétérinaires auxpieds nus, ou para-vétérinaires, connus en swahili sous le nom dewasaidizi. Ces personnes sont formées au diagnostic des maladies les pluscourantes et à la prescription des médicaments de base ; elles saventlorsqu’il convient de s’adresser à des vétérinaires qualifiés. Elles vivent ausein des communautés et perçoivent un petit salaire du gouvernement,qu’elles complètent en vendant des médicaments à leurs clients. Depuis1986, l’ITDG a formé plusieurs centaines de para-vétérinaires et depasteurs. D’autres organisations, comme le projet communautaire devaccination et de santé animale, proposent des formations de mêmenature.Une femme turkana traite un chameau contre la trypanosomiase(Photo : Alphonse Emuria, ITDG)151
« L’arbre des hommes »Quelques projets de développement organisent les communautés en groupements locaux, pour la formation ou l’obtention de crédits. Maisces groupes ne fonctionnent pas toujours très bien : lorsque les soutiens extérieurs se tarissent et que l’encadrement extérieur se retire, ilsse désagrègent rapidement et la plupart des acquis sont perdus.Les révolutions de l’informationPlutôt que de former de nouveaux groupes, l’ITDG préfère travailler en collaboration étroite avec les organisations traditionnelles, appeléesadakhars en Turkana et yaa en Marsabit. Ces groupes, constitués par les anciens et les notables, se réunissent sous un arbre sacré appelé« l’arbre des hommes » pour débattre des questions importantes et prendre des décisions qui engagent toute la communauté.Il y a plusieurs avantages à travailler avec ces responsables des communautés. Les adakhars et les yaa décident de l’opportunité d’unecollaboration avec les vétérinaires de l’ITDG. Ils désignent les participants aux sessions de formation proposées par l’ITDG et les membresdes comités de gestion des pharmacies communautaires. Comme ces activités ont obtenu l’aval du conseil des anciens, elles ont beaucoupplus de chances de se poursuivre après un éventuel retrait de l’assistance de l’ITDG.Les adakhars et les yaa sont exclusivement constitués d’hommes. Les femmes ne sont pas autorisées à s’asseoir sous « l’arbre deshommes » et leur point de vue n’est pas pris en compte. C’est un problème pour la santé du bétail car ce sont souvent les femmes quiassument la responsabilité des troupeauxde chèvres et de moutons et qui achètentles médicaments pour traiter les animauxmalades.Un guérisseur kamba montre les herbes à utiliser pour traiter les cas de rétentiondu placenta(Photo : ITDG)L’ITDG est en train d’essayer de changercela, en s’assurant que les femmes soientsystématiquement associées aux sessionsde formation et qu’elles soient présentesau niveau des instances de décision.En 1998–99, deux cinquièmes des 200personnes formées étaient des femmes etelles siègent désormais dans les comitésde gestion des pharmacies communautaires,au même titre que leshommes. Lentement, mais sûrement, lestatut des femmes s’améliore et elles sontde plus en plus souvent impliquées dansla gestion des activités des communautés.152
Savoirs paysansTenir sur ses quatre pattesLe suivi des projets de développement est important pour juger deleur efficacité et apporter les changements nécessaires en cours deroute. Mais comment assurer ce suivi lorsque les personnes avec quivous travaillez ne savent ni lire ni écrire ? L’ITDG a mis au point uneapproche innovante, toujours basée sur l’exploitation des savoirslocaux.Les Turkana ont quatre espèces d’animaux : les chameaux, les bœufs,les moutons et les chèvres. Lorsque tout va bien, ils disent qu’ils« tiennent sur leurs quatre pattes », chaque patte représentant uneespèce.Mais les choses ne vont pas toujours très bien : les Turkana disentalors qu’ils « tiennent sur trois pattes ». Si la situation est plus grave,en raison par exemple d’une sécheresse ou d’une épidémie, ilsdisent qu’ils « reposent sur deux pattes ». Enfin, s’ils traversent unecrise majeure ou que les gens meurent de faim ou de maladies, ilsdisent alors qu’ils « tiennent sur une seule patte » ou même sur« aucune patte ».À Marsabit, les Gabbra utilisent un système différent basé sur lescouleurs. Le blanc représente la situation la plus favorable,l’équivalent des « quatre pattes » des Turkana. Le bleu (ou le gris) estmoins satisfaisant, comme les « trois pattes ». Le rouge signifiel’imminence d’une crise (deux pattes) et le noir indique que la criseest bien là (une patte ou pas de patte).L’ITDG utilise les systèmes de mesure traditionnels pour assurer lesuivi des épidémies, des sécheresses ou de la sécurité (les vols deUtilisation de systèmes traditionnels de suivi pour évaluer le bien-êtrebétail sont fréquents). Les équipes de projets combinent le systèmedes communautés dans le nord du Kenyade « nombre de pattes » et de « couleurs » pour d’autres informationscomme le niveau des précipitations, les taux de malnutrition à partirdes données des centres de santé et les épidémies, afin de construire une image globale de la situation du district. Ces éléments sontessentiels pour prendre les bonnes décisions comme, par exemple, l’organisation d’une campagne de vaccination d’urgence ou pour gérerles conflits entre groupes rivaux.153
Adapter les lois aux réalitésLe Kenya a des lois très strictes sur la prescription de médicaments. Par exemple, seuls les vétérinaires qualifiés sont habilités à utiliser lesmédicaments du « tableau 1 », une catégorie de médicaments qui inclut les antibiotiques injectables. Mais il y a peu de vétérinaires sur leterrain et les médicaments se trouvent facilement : les frontières nord du Kenya sont perméables ; les hommes et les médicaments circulentlibrement entre le Soudan, l’Ethiopie, la Somalie et l’Ouganda. Les propriétaires des petites boutiques qui vendent les médicaments n’enconnaissent pas les propriétés. Ils peuvent vendre des médicaments inadaptés ou en quantités inappropriées, occasionnant des dépensesinutiles ou provoquant des sous-dosages qui conduisent au développement de souches de maladies résistantes aux antibiotiques.Les révolutions de l’informationQuinze années d’expérience ont montré que lorsqu’ils sont convenablement formés, les para-vétérinaires et les guérisseurs peuvent soignerle bétail de façon correcte et sûre. Les services vétérinaires du gouvernement et le ministère sont en train de réaliser qu’en autorisant cesacteurs à traiter les maladies animales et en les formant pour qu’ils le fassent correctement, ils apportent la seule réponse réaliste pourmaîtriser les maladies du bétail dans le nord du Kenya. Grâce au travail de l’ITDG et d’autres ONG, il y a maintenant une chance pour queles pasteurs de ces régions reculées aient enfin accès à des services de santé animale efficaces.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESIntermediate Technology Development Group (ITDG), 22 Chiromo Access Road, off Riverside Drive, PO Box 39493, Nairobi (Kenya).Tél. (254) 2 442108/ 2 446243/ 2 444887 ; fax (254) 2 445166 ; e-mail itkenya@itdg.or.ke ; Internet www.itdg.org.pe/h_kenya/154
Savoirs paysansPromouvoir les expérimentations paysannesÁ la Trinité, des poulets sous surveillanceCheryl LansEn 1988, les éleveurs de poulets de Trinité et Tobago étaient confrontés à un sérieux problème. L’ajustement structurel conduit sous lahoulette du FMI rendait les prix des produits importés imprévisibles : une vraie préoccupation pour un secteur où pratiquement tout, dusoja et du maïs servant à nourrir les volailles jusqu’aux équipements et aux médicaments (et même une partie des poussins) était importédes États-Unis.Certains éleveurs pensèrent alors à utiliser des plantes médicinales pour soigner leurs animaux. Ils pouvaient cultiver ces plantes (aloès,courge amère et citron) dans leurs exploitations et éviter d’avoir à acheter de coûteux médicaments. Des voisins, parents ou collègues leuravaient vanté les mérites de ces médecines traditionnelles.Mais étaient-elles efficaces ? Les éleveurs entreprirent des expérimentations informelles pour s’en assurer. Ils extrayaient le jus de ces planteset l’ajoutaient à l’eau que buvaient les poulets ou plaçaient les plantes directement dans les abreuvoirs. Ils enrayèrent ainsi des maladiescourantes chez les poulets : manque d’appétit, stress dû à la chaleur, rhumes et autres problèmes respiratoires, ce qui conduisit à unediminution de la mortalité.ENCADRÉ 13Remplir les assiettesComme dans beaucoup de pays en développement, les poulets sont une importante source de protéines pour lapopulation de Trinité et Tobago. Pour remplir les assiettes de la population, il y a deux grands types d’élevage. Enpremier lieu, il y a des éleveurs sous contrat, qui travaillent pour deux grandes usines de traitement des volailleset qui produisent entre 5 000 et 90 000 poulets de chair par an. Ces usines fournissent les institutionsgouvernementales, les supermarchés et les hôtels.Et puis, il y a de petits élevages indépendants qui fournissent des animaux vivants aux petites boutiquesinstallées au bord des routes. Là, les poulets sont gardés dans un hangar jusqu’à ce qu’ils soient abattus, pluméset préparés pour les clients.Et si vous avez envie de manger des œufs pour votre petit déjeuner ? Comme dans de nombreux pays, laproduction d’œufs est séparée de l’industrie de l’élevage. Il y a moins de producteurs d’œufs que d’éleveurs depoulets de chair.155
Faire passer le motLes conseillers en santé animale de l’unité de surveillance avicole du gouvernement (voir encadré 14) apprirent que les éleveurs menaientces expérimentations. Ils ont entrepris de les aider à conduire leurs tests, ont assuré le suivi des progrès accomplis et ont informé leurscollègues de l’unité de surveillance à l’occasion de leurs réunions hebdomadaires habituelles.Mais l’information circulait aussi dans l’autre sens, des conseillers vers les éleveurs. L’unité avicole diffusait auprès des éleveurs les résultatsdes recherches entreprises sur les plantes médicinales, hors de la zone Caraïbe, pour leur adoption éventuelle à la Trinité.Les révolutions de l’informationL’équipe de l’unité a diffusé l’information sur les expérimentations vers une centaine d’autres éleveurs de poulets. Trois critères de sélectionde l’information à diffuser ont été définis :• Est-ce que l’usage de la plante améliore la production ?• Est-ce qu’elle a des effets secondaires indésirables ?• Est-ce que les éleveurs qui ont expérimenté la plante continuent à l’utiliser ?Quel dosage des plantes médicinales devait être utilisé pour être introduit dans l’eau de boisson des volailles ? L’équipe de l’unité a définiun dosage type pour chaque plante mais il était donné à titre indicatif et non pas comme une norme obligatoire.La plupart des éleveurs utilisent des hangars grillagés avec des sols couverts de « bagasse » (le résidu d’extraction des cannes à sucre). Lesoiseaux disposent d’abreuvoirs automatiques alimentés par un réservoir placé au-dessus des hangars. Ce système permet de distribuer lesmédicaments à tout l’élevage en même temps : il n’y a qu’à les répandre dans l’eau du réservoir et chaque oiseau est traité en buvant.ENCADRÉ 14L’unité de surveillance avicoleL’unité de surveillance avicole est une structure spécifique au sein du ministère de l’agriculture et des ressourcesmaritimes et terrestres de Trinité et Tobago. Mise en place en 1981 pour assurer des services techniques etvétérinaires, cette unité comptait en 1995 huit assistants de santé, dont deux femmes, affectés dans les différentsdistricts de la Trinité. Le responsable de l’unité est un vétérinaire.Les résultats sont impressionnants : en 1994, l’unité a rendu 544 visites à 55 élevages qui produisaient plus de450 000 poules pondeuses, pour une production totale de 43 millions d’œufs par an. Ils ont également visité plusde 2 000 élevages de poulets de chair, qui ont produit près de 6 millions de poulets. En plus de cela, l’unités’occupe également de canards, de pintades et de dindes, en quantités moins importantes.156
Savoirs paysansComme tous les éleveurs utilisent le même système, ils sont en mesure de mettre en œuvre les recommandations faites par l’équipe del’unité avicole. D’autres facteurs facilitent cette adoption : les plantes sont robustes et faciles à cultiver ; les éleveurs y sont habitués ; lesmédicaments sont faciles à préparer. Des poulets en pleine santé et une diminution de la mortalité, c’est facile à observer, dans les hangarsd’élevage et indirectement dans les portefeuilles des éleveurs.Un autre service proposé par l’unité a également contribué à la diffusion des plantes médicinales traditionnelles. Le Dr Gabriel Brown,directeur de l’unité, avait la responsabilité d’autopsier les oiseaux malades pour identifier les raisons de leur mort. Il disposait doncd’informations spécifiques pour chaque élevage et pouvait donner des conseils appropriés. De leur côté, les éleveurs pouvaient saisir l’unitépour qu’elle trouve des solutions aux problèmes de leurs élevages. Des poulets en bonne santé réduisaient le nombre d’autopsies que leDr Brown aurait à faire : un vrai gage de réussite !Quelles leçons ?L’unité de surveillance avicole est très attentive à faire la distinction entre les connaissances utiles et celles qui ne servent à rien.Curieusement, de nombreuses agences de vulgarisation n’y parviennent pas et donnent aux paysans des conseils inapplicables ou font lapromotion de technologies qui ne peuvent pas fonctionner dans certains contextes spécifiques sur le terrain.L’unité a particulièrement soigné la qualité de ses relations avec les principaux éleveurs et les a aidés à mener leurs expérimentations. Ellea pris en compte les résultats positifs et les a diffusés auprès des autres éleveurs, qui disposaient ainsi de solutions locales et peu coûteusesà leurs problèmes.En définitive, plutôt que de chercher à promouvoir des technologies étrangères pour résoudre des problèmes clairement identifiés, il a aidéles éleveurs à mettre en œuvre des solutions d’éleveurs. Chacun des partenaires, éleveurs comme l’unité avicole y a apporté sa contribution.Le partage des savoirs est un facteur clé de la nouvelle approche de la vulgarisation qui commence à être mise en œuvre un peu partoutdans le monde en développement.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESDr Gabriel Brown, former Head, Poultry Surveillance Unit, c/o National Animal Disease Centre (NADC), Caroni North Bank Rd, Centeno(Trinité et Tobago). Tél. (1 868) 645 4673/ 645 2640 (ext 4315) ; fax (1 868) 645 7428 ; e-mail ghbrown@tstt.net.ttCheryl Lans, 17 Cadiz Road, Belmont, Port-of-Spain (Trinité et Tobago). E-mail cheryllans@netscape.net157
Savoirs paysansSauvegarder les savoirs locauxForêts nourricièresTony JansenLe bâtiment au toit de chaume au bord de la mer abrite l’unité de soins de santé primaires de l’hôpital de Sasamunga. À l’intérieur, un petitgroupe d’hommes et de femmes sont installés. Ils viennent des villages voisins, à Lauru, une île de l’archipel des Salomon. Ils discutent desdifférentes sortes d’igname sauvage que l’on peut trouver dans les zones de « Piara püu ». Les habitants de ces îles récoltent les ignames etd’autres plantes sauvages pour se nourrir. Piara püu est un des 14 types de végétation locale qui couvrent la forêt originelle et les forêts quirepoussent sur les sites abandonnés par les cultures itinérantes.Le groupe interroge la personne la plus âgée, Reggie Pitisopa, et les autres anciens. Après quelques débats, on parvient à une conclusion etun participant en prend soigneusement note en langue babatana.Gwendlyn Pitavavini, la coordonnatrice du projet anime les débats avec l’aide d’un villageois. Elle montre au groupe des dessins réalisés parun artiste du village voisin de Papara. Certains dessins illustrent des récits traditionnels à propos des plantes. Le groupe discute de leurpertinence et rédige une légende pour chacun d’entre eux.La pauvreté au cœur de l’abondanceLe babatana est une des sept langues parlées par les 16 000 habitants de Lauru. Appelée également Choiseul, Lauru est une grande îlemontagneuse, couverte de forêts au nord-est de l’archipel des îles Salomon., dans le sud-ouest du Pacifique. L’océan, qui est responsablede l’isolement des îles Salomon du monde extérieur et des autres îles de l’archipel, en a fait des espaces très diversifiés sur le planbiologique, linguistique et culturel.Mais cette richesse ne parvient pas à se traduire en prospérité économique. 80 % de la population de Lauru vivent dans des communautésrurales isolées, où chaque famille produit pratiquement sa propre nourriture. Les paysans dégagent une parcelle de forêt, y établissent leurscultures pendant quelques années, puis se déplacent vers une autre parcelle quand la fertilité des sols décline et que les mauvaises herbesdeviennent difficiles à maîtriser. Dans ces communautés, la malnutrition est courante, notamment chez les jeunes enfants.Confrontés à cet état de chose, les responsables de l’unité de soins de santé primaires de l’hôpital ont décidé d’étudier plus attentivementle type de nourriture que ces communautés cultivent et consomment. Cette étude est entreprise en collaboration avec une ONGaustralienne, Appropriate Technology for Community and Environment (APACE – Technologies appropriées pour les communautés etl’environnement). Cette dernière vise à promouvoir de petits jardins potagers attenants aux maisons des villageois. Mais l’intérêt s’estrapidement porté sur d’autres sources de nourritures, presque oubliées : les plantes comestibles de la forêt.159
Les nourritures de la forêtDans le passé, les forêts constituaient un espace de sécurité contre la sécheresse, la guerre, les troubles sociaux, les cyclones ou lesmauvaises récoltes. Elles sont aussi parties intégrantes de la culture de Lauru, où la terre et la forêt sont étroitement associées. Mais lesproduits alimentaires importés, comme la farine de blé, le riz blanc, les nouilles, ont été progressivement introduits dans les habitudesalimentaires de la population et les produits de la forêt ont disparu des cuisines de Lauru. Ces changements alimentaires ont conduit à desproblèmes de santé, comme le diabète, apparu récemment, ou certaines pathologies cardiaques. La connaissance des plantes de la forêt etde la façon de les accommoder est en train de disparaître.Les révolutions de l’informationLe groupe réuni dans la maison au toit de chaume est en train d’achever la sixième ébauche d’un ouvrage rédigé par la population babatana.Appelé Petanigaki ta siniqa ni Lauru ou Nourritures de la forêt de Lauru, ce livre a été rédigé par plus de 60 personnes de la communautégrâce à une série d’ateliers organisés sur une période de plus de trois ans. Le livre sera un outil éducatif sur les plantes comestibles de laforêt pour les jeunes de la région : où les trouver, comment les préserver et les récolter, comment les accommoder.Moins de la moitié de la population de Lauru est alphabétisée et pour beaucoup, l’anglais représente la deuxième, voire la troisième langue.Le livre est donc rédigé dans les langues locales et en anglais. Il comporte de nombreuses illustrations réalisées par un artiste local. Lesélèves des écoles ont décalqué les feuilles pour aider les lecteurs à identifier les plantes. Des légendes explicatives ont été produites àl’intention des lecteurs peu instruits. Le livre comporte différents chapitres sur les noix comestibles, les fruits, les ignames, les champignonset les légumes verts que l’on trouve dans la forêt. Il ne traite pas seulement des plantes comestibles : il inventorie aussi la végétation, lestypes de sols, les saisons et les variétés de plantes.Juste derrière les villages côtiers de Lauru, les arêtes escarpées de la forêt humide tropicale s’élèvent abruptement depuis la chaîne centralede l’île. C’est dans ces montagnes accidentées que travaille l’équipe du projet, sous la direction des villageois, pour prélever des échantillonsde plantes comestibles dans les arbustes et autres espèces utiles.Une fois revenus au village, on expose les spécimens recueillis afin que les villageois disposant de connaissances sur les plantes,généralement les vieux, les identifient et indiquent leurs noms. Les ateliers sont alors organisés pour montrer comment préparer et cuireles plantes. Le processus de production du livre a été aussi instructif et motivant que le sera le livre lui-même. Les élèves des écoles, lesnotables et les groupes de femmes ont été associés au travail de collecte, d’identification et de traitement. L’exercice a relancé l’intérêt dela population pour l’usage de ces plantes. Les villageois ont entrepris de les cultiver et les instituteurs ont introduit l’étude des plantes dansleurs programmes scolaires.Forêts et sécurité alimentaireÀ la fin de 1997 et au début de 1998, les effets du phénomène El Niño ont provoqué une sécheresse sévère dans les îles Salomon,habituellement humides. Des récoltes ont été perdues et des pénuries d’eau se sont produites dans des zones où les précipitations sonthabituellement de l’ordre 3 500 mm, réparties sur presque toute l’année.160
Savoirs paysansLe travail de réhabilitation de l’usage des plantes comestibles de la forêt a pris alors tout son sens pour la population. Quand les patatesdouces et le taro venaient à manquer, il y avait une réserve abondante de nourriture dans la forêt (plus de 80 espèces ont été identifiéesdans le manuel) qui ne demandaient qu’à être cueillies et qui pouvaient nourrir les gens, à condition, bien sûr qu’ils sachent les identifieret les utiliser correctement.La nourriture disponible dans la forêt fournissait par ailleurs un argument important pour inciter à une gestion « durable » de cetteressource. Il n’y a pas si longtemps, les forêts des îles Salomon avaient été décimées par des exploitations commerciales. Il fallait rappeleraux villageois que la forêt était utile à bien d’autres choses et qu’elle n’était pas seulement une source de bois-d’œuvre.CollaborationLe projet est le fruit d’une collaboration entre le conservatoire national des plantes des îles Salomon, l’APACE et le programmecommunautaire de soins de santé primaires de l’hôpital de Sasamunga.Myknee Sirikolo travaille pour le conservatoire national des plantes, à Honiara. Il inventorie et répertorie les spécimens de plantes collectésdans la lointaine Lauru. Il assure les fonctions de botaniste et d’animateur communautaire principal pour le projet. Il répertorie trèssoigneusement les plantes et contrôle la conformité de leur description en babatana, sa langue maternelle, par rapport à la documentationen anglais, disponible au niveau du conservatoire. Il note quelques questions qu’il posera aux anciens à l’occasion de sa prochaine visite àLauru.De l’autre côté de la ville, une petite maison au toit de chaume héberge le bureau de coordination de l’APACE. L’électricité, fournie par despanneaux solaires, alimente un ordinateur sur lequel Florence Nodoro, une jeune femme de Lauru recrutée par l’APACE, saisit les textes enbabatana et en anglais, scanne les illustrations et prépare la mise en page du manuel.L’APACE et le conservatoire national des plantes ont réuni leurs expertises respectives, en ethnobotanique et en développementcommunautaire, pour mettre en place le projet de « nourriture forestière de Lauru » qui pilote le travail de production du manuel avec lapopulation. Le projet est soutenu par l’initiative « Population et plantes » (une collaboration entre le WWF, l’Unesco, le Royal BotanicGardens de Kew et la coopération australienne).Le manuel sera distribué dans les communautés où il représentera la mémoire permanente du patrimoine des plantes comestibles de laforêt. Il pourra être utilisé pour des formations en nutrition destinées aux adultes et dans les écoles. Il sera à la fois une mémoire du passéet une base pour construire l’avenir.161
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESAppropriate Technology for Community and Environment (APACE), c/o UTS, PO Box 123, Broadway 2007 (Australie).Tél. (61) 02 9514 2554 ; fax (61) 02 9514 2611 ; e-mail apace@uts.edu.auKastom Garden Program, c/o Development Services Exchange, PO Box 556, Honiara (Îles Salomon)Les révolutions de l’information162
Rentabiliser la recherche agricole : comment l’ENDA lie la recherche, la formation et la vulgarisationVaincre la famine par la recherche et la vulgarisation : maîtriser la mosaïque du manioc en OugandaCampagnes d’information : combattre la cochenille de l’hibiscusVulgariser le langage scientifique : ateliers d’écritureLivrets de vulgarisation : des insectes nuisibles dans le PacifiqueTransmettre des informations scientifiques aux chercheurs : La Revue africaine de recherche agricoleLiens entre la rechercheet la vulgarisation
La recherche et la vulgarisation traditionnelles sont en train de changer. Les vieillesapproches, encore trop présentes dans le monde en développement, consistaient, pour leschercheurs, à se calfeutrer dans leurs laboratoires et leurs fermes expérimentales et à ensortir de temps à autre pour annoncer une nouvelle découverte. Et il appartenait alors auxvulgarisateurs de porter la bonne nouvelle aux paysans.Les révolutions de l’informationCe modèle a évidemment ses limites : comment s’assurer que les chercheurs sont en traind’étudier des choses utiles ? Bien souvent la recherche est tournée sur elle-même et leschercheurs sont plus motivés par la publication d’un nouvel article dans une revue scientifiqueou la participation à un séminaire, que par la résolution des problèmes des paysans.Et comment les vulgarisateurs peuvent-ils prendre connaissance des résultats de larecherche ? Ils ne lisent pas les revues scientifiques et s’ils le faisaient, ils n’encomprendraient probablement pas le jargon. Sans ce lien vital avec les autres acteurs, larecherche agricole gaspille du temps et de l’argent, tout simplement.Plusieurs institutions essaient de trouver des passerelles entre la recherche et lavulgarisation. Quelquefois, une crise, comme une épidémie ou l’apparition d’une nouvelleespèce de parasite peut être l’occasion qui oblige les chercheurs à repenser leursprocédures, leurs relations avec les autres et à adopter de nouvelles approches. Dansd’autres cas, c’est une organisation nouvelle, souvent une ONG, qui dispose de la libertéd’initiative nécessaire pour réunir les chercheurs, les vulgarisateurs et les agriculteurs et lesfaire travailler ensemble à la rédaction de documents qui ne pourraient pas être produitsautrement.N’oublions pas que les chercheurs eux-mêmes sont des usagers de l’information et de lacommunication. Ils doivent publier : une des rares récompenses pour un chercheur, quitrime dans son laboratoire, c’est la reconnaissance du monde scientifique, à travers lapublication d’articles. Mais publier, c’est beaucoup plus que cela : cela permet de montrerles avancées de la science, cela offre au chercheur des occasions d’apprendre des chosesnouvelles, en s’appuyant sur des découvertes faites de son laboratoire éloigné, mais surlesquelles il bâtit son propre travail. Sans revues scientifiques, conférences et publicationssur l’Internet (une dernière nouveauté), beaucoup d’avancées technologiques n’auraienttout simplement pas vu le jour.164
Liens entre la recherche et la vulgarisationRentabiliser la recherche agricoleComment l’ENDA lie la recherche, la formationet la vulgarisationPaul MundyUn ensemble de problèmes…Observons un ensemble de problèmes ruraux que l’on rencontre dans tous les pays en développement. Premier problème. Les producteursveulent connaître de meilleures techniques culturales pour améliorer leur production. Mais ils ont difficilement accès à l’information dontils ont besoin pour cela : les institutions de recherche sont inaccessibles et elles ne traitent pas souvent des sujets qui intéressent le plus lespaysans.Deuxième problème. Pour conduire leurs essais sur le terrain, les organismes de recherche ont besoin de champs expérimentaux et deproducteurs volontaires pour participer à la recherche. Mais les chercheurs sont généralement cloîtrés dans leurs laboratoires et ils ont peude contacts avec les paysans pour négocier cette collaboration.Troisième problème. Les organismes de vulgarisation ont la mission de diffuser les nouvelles techniques agricoles auprès des paysans. Maisce n’est pas facile. Les démonstrations nécessitent des parcelles et il faut les aménager ; tout cela prend du temps et de l’argent et il y en ade moins en moins.…et une solution ?L’ENDA est une ONG internationale basée au Sénégal. Ses responsables pensent qu’ils ont trouvé une solution à ces trois problèmes. Ellese fonde sur un accord entre l’ENDA (Environment, Development and Action) et les producteurs ruraux organisés au niveau villageois. Lespaysans fournissent une parcelle libre (de 5 à 10 hectares environ) et, en contrepartie, l’ONG y établit un centre de formation pour le village.L’équipe de vulgarisation de l’ENDA et quatre paysans en cours de formation vivent dans le centre. Ils travaillent la terre, récoltent et élèventle bétail, comme tous les autres paysans. Mais ils s’occupent aussi d’expérimenter de nouvelles techniques agricoles et d’organiser desséances de démonstration pour les autres producteurs du village. Par exemple, ils vont planter des rangées de nouvelles variétés de maïs àcôté d’une parcelle semée avec des variétés traditionnelles et ils invitent les villageois à venir comparer les résultats par eux-mêmes. 50 à 60visiteurs peuvent être ainsi reçus, chaque jour, dans ces parcelles expérimentales.« Le centre de formation communautaire constitue un site idéal pour les chercheurs », dit Chierro Bak Seck de l’équipe action-recherchede l’ENDA, « ils peuvent y conduire leurs expérimentations et comme les centres sont installés sur des terres appartenant au village, il est165
La bibliothèque de l’ENDA offre à ses lecteursune mine de renseignements sur la thématiquedu développement(Photo : Paul Mundy)Les révolutions de l’informationfacile de trouver de l’aide pour planter et désherber. Les résultats peuvent être directement observés par les paysans du village, qui peuventainsi se faire une idée par eux-mêmes et adopter les pratiques qui leur conviennent ». Les chercheurs de l’ISRA (Institut sénégalais derecherche agronomique) et de l’université de Dakar peuvent demander l’assistance de l’ENDA pour entreprendre des recherches au niveaudes centres. L’ENDA a signé un accord avec l’université du Minnesota pour permettre à des étudiants américains d’entreprendre desrecherches au Sénégal en bénéficiant des équipements des centres.« Et bien entendu, les producteurs ruraux des localités concernées peuvent eux-mêmes suggérer des thèmes de recherche », dit ChierroBak Seck.Citons, parmi les recherches conduites, la multiplication rapide des espèces végétales produites par bouturage comme les pommes de terre,le manioc et les fraises, l’expérimentation du contrôle des nématodes de la tomate et du gombo et l’optimisation des importantes quantitésde biomasse produites par le leucaena, un arbre très répandu, qui améliore la fertilité des sols en fixant l’azote.Quatre centres de ce type ont déjà été implantés à Sébikotane, près de Dakar, à Sandiara (dans l’ouest du pays), Merina Diop (centre est)et Nguénienne (centre ouest) avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Caisse française dedéveloppement. Créés en 1998–99, ces centres ont déjà accueilli des hauts responsables d’organisations comme la Banque mondiale etl’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).Le centre de Merina Diop est particulièrement intéressant. La partie centrale du Sénégal est une zone particulièrement pauvre, frappée parla désertification. Le chômage y est important et de nombreux jeunes partent vers Dakar ou émigrent vers les États-Unis, où quelques-unsse trouvent pris dans les circuits de la drogue ou de la prostitution. L’ENDA et le PNUD pensent que le centre de formation dont ilssoutiennent le fonctionnement contribuera à résoudre ces problèmes.L’implantation de dix autres centres du même type est programmée pour un avenir proche. Chierro Bak Seck affirme que s’ils donnentsatisfaction, l’ENDA espère installer 640 centres dans tout le pays, soit deux centres pour chaque communauté rurale du Sénégal.L’objectif de l’ENDA est de permettre à ces centres d’acquérir leur indépendance financière et de subvenir à leurs besoins en générant leurspropres ressources. Cela signifie qu’ils devront produire et vendre suffisamment pour assurer leurs coûts de fonctionnement, y compris lesalaire des agents et le coût de la formation. Jusqu’ici, les centres parviennent à assurer 70 % de leurs coûts en vendant leurs produits ; cepourcentage augmentera lorsque les activités d’élevage auront atteint un taux de production optimal. Les centres pourront égalementpasser des accords de production avec des commerçants locaux et des exportateurs.166
Liens entre la recherche et la vulgarisationÀ propos de l’ENDAL’ENDA est une ONG internationale qui s’est spécialisée dans les questions d’environnement et de développement dans le monde endéveloppement. Son siège social se trouve à Dakar (Sénégal). Il a ouvert des bureaux dans 21 pays en développement : 14 en Afrique, 5 enAmérique latine et 2 en Asie.L’ENDA a été créé en 1972, à l’issue d’une conférence internationale sur l’environnement, à Stockholm. Son activité s’articule autour de 24équipes semi-autonomes. Chacune d’entre elles investit un champ de travail spécifique dans le secteur du développement : santé, énergie,genre, problèmes urbains et édition. Les ressources de l’ENDA proviennent principalement d’agences bilatérales, d’ONG européennes etde l’Union européenne.« Ils ne se déplaceront pas seulement pour admirer vos choux… »« L’ENDA travaille en collaboration étroite avec les médias sénégalais pour assurer une large diffusion de ses travaux », dit Simon Meledge,responsable des relations publiques. « Il produit des communiqués, tient des conférences de presse et prépare des dossiers contenant deséléments d’information que les journalistes peuvent utiliser comme base pour rédiger leurs articles ».Chaque année, Simon Meledge organise plusieurs visites de journalistes dans des sites où l’ENDA travaille avec les communautésvillageoises. Il passe beaucoup de temps à identifier les sujets de reportage intéressants pour la presse. Il est important de choisir le bonmoment et le bon endroit : « Vous ne pouvez pas les déplacer seulement pour leur faire admirer les choux que vous avez plantés », dit-ilavec un sourire.Contrairement à ce qui se passe dans certains pays, il n’est pas nécessaire de payer les journalistes, au Sénégal, pour vous assurer qu’ilstraiteront d’un sujet. Si Simon Meledge organise une visite de presse, il assure le transport des journalistes mais c’est à eux qu’il appartientde décider s’ils vont écrire quelque chose. Les conférences et les cérémonies de lancement de livres constituent de bonnes occasions pourrencontrer les journalistes et les inciter à couvrir un sujet. Simon Meledge a une liste de journalistes qu’il invite systématiquement à cesmanifestations.L’ENDA mobilise également les radios. Il produit deux ou trois programmes par mois et paie les stations pour leur diffusion. De plus, SimonMeledge et ses collègues sont souvent invités à participer à des tables rondes à la radio.L’ENDA est un des pionniers de l’Internet au Sénégal. Il a construit un site très complet et très documenté (http ://www.enda.sn).900 000 livres en 25 ansUne des 24 équipes qui constituent l’ENDA s’occupe d’édition « ENDA éditions ». Cette unité publie environ 10 livres par an, en anglais eten français, sur tous les sujets couverts par l’ONG.167
De 1974 à 1997, l’ENDA a distribué près de 900 000 ouvrages. Environ 70 % ont été vendus en Afrique et 20 % en Europe. Le titre le pluspopulaire ? C’est la version française d’un guide de santé intitulé Là où il n’y a pas de docteur, par David Werner. 134 000 exemplaires decet ouvrage ont été vendus. Le tirage habituel des publications de l’ENDA oscille entre 1 500 et 6 000 exemplaires.L’ENDA coédite de nombreux titres en collaboration avec des agences des Nations unies, comme l’UNICEF ou d’autres organismesinternationaux, comme le CTA.Les révolutions de l’informationLes prix sont maintenus intentionnellement bas. Il s’agit davantage de couvrir les coûts d’édition et de publication que de faire des bénéfices.Les ouvrages sont vendus à deux niveaux de prix : Là où il n’y a pas de docteur est vendu 5 000 F CFA (7,62 e) dans les pays endéveloppement et trois fois plus cher (22,87 e) dans les pays du Nord.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESENDA, 4–5 Rue Kléber, BP 3370, Dakar (Sénégal). Tél. (221) 8 216027/8 224229 ; fax (221) 8 222695 ; e-mail enda@enda.sn ;Internet http ://www.enda.sn168
Liens entre la recherche et la vulgarisationVaincre la famine par la recherche et la vulgarisationMaîtriser la mosaïque du manioc en OugandaPaul MundyUne mystérieuse maladieLes paysans de Luwero, au nord de Kampala, ont été les premiers à remarquer cette mystérieuse maladie en 1988. Des taches jaunesapparaissaient sur les feuilles du manioc et stoppaient leur croissance. Les feuilles tombaient et quand les paysans retiraient les tuberculesde terre, ils ne trouvaient rien à manger.Les conseillers agricoles suspectèrent d’abord l’acarien vert du manioc mais les chercheurs trouvèrent le vrai coupable : la mosaïque dumanioc, une maladie transmise par un virus connu partout en Afrique, mais qui, jusque-là, n’avait pas provoqué de dégâts sérieux. Cettefois-ci pourtant la situation était grave. Près de 2 000 hectares de plantations de manioc étaient dévastés par la maladie en 1988. Transportépar les aleurodes, le virus se répandait de façon régulière vers le sud à raison de 20 km par an environ, décimant la deuxième culture vivrièredu pays. En 1999, le mal s’était répandu dans tout le pays et continuait sa progression vers les pays voisins.Juste après la bananeLe manioc représente environ 30 % de la nourriture consommée par les Ougandais, juste après la banane. Les paysans constatèrent qu’ilsne pouvaient rien contre le virus. Toutes les variétés locales étaient affectées. Ils abandonnèrent le manioc pour se tourner vers d’autrescultures comme la patate douce. Dans le district de Kumi, dans l’est du pays, les producteurs avaient planté plus de 30 000 hectares demanioc par an en 1986–88 ; en 1992, ils n’exploitaient plus que 5 000 hectares. Au point culminant de l’épidémie, en 1996, la productionde manioc de l’Ouganda avait chuté de 80 %, passant de 4 millions de tonnes à 500 000 tonnes par an.L’effondrement de la production de manioc entraîna la famine dans son sillage. En 1994, environ 3 000 personnes moururent de faim dansl’est et le nord de l’Ouganda. Des jeunes filles furent contraintes à des mariages précoces parce que leurs parents avaient besoin de la dotpour acheter de la nourriture. On rapporte même des cas d’échange de jeunes filles contre du manioc.L’union fait la forceL’organisation nationale ougandaise de recherche agricole (NARO – National Agricultural Research Organization) était sur la sellette. Il fallaittrouver une solution rapidement. Le Dr William Otim-Nape, un virologiste qui dirigeait l’équipe du NARO chargé du manioc et deschercheurs de l’Institut des ressources naturelles (NRI) en Grande-Bretagne se lancèrent dans un programme intensif de recherche. Ilsrassemblèrent des contributions financières provenant de plusieurs bailleurs de fonds dont le Centre de recherche pour le développement169
Plants de maniocsains et, en grosplan, plantsprésentant lessymptômes de lamosaïque dumanioc(Photo : CTA)international (CRDI) du Canada, la Fondation Gatsby, le ministère britannique du développement international (DFID), l’Agence américainede développement international (USAID) et la Banque mondiale. Petit à petit, ils réussirent à identifier précisément les caractéristiques dela maladie et trouvèrent les moyens d’y remédier.Les révolutions de l’informationLe gouvernement tenta d’abord d’enrayer la progression de la maladie en détruisant les plants infestés. Sans succès : dans une parcelleexpérimentale, 4 hectares de la variété principale ont été décimés par la maladie, malgré de strictes mesures sanitaires. Il était clair qu’uneautre réponse devait être recherchée, sur la base de variétés de manioc résistant à la maladie. Mais ces nouvelles variétés n’existaient pas enOuganda. Aussi, William Otim-Nape et son équipe s’adressèrent-ils à l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) au Nigeria. Ilsparvinrent à produire des variétés hybrides en croisant des variétés résistantes provenant de l’IITA avec des variétés locales. Ils testèrent ceshybrides dans des champs expérimentaux et constatèrent qu’elles résistaient bien à la maladie.En1996, William Otim-Nape et des chercheurs de l’Institut écossais de recherche sur les cultures (Scottish Crops Research Institute) firentune autre percée en étudiant la structure génétique du virus. Ils découvrirent qu’il s’agissait d’un hybride de deux virus connus qui avaientdéjà causé des dégâts auparavant : c’était la première fois que l’on mettait en évidence ce type d’hybridation dans cette famille de virus.Associer les producteurs ruraux à la rechercheHabituellement, la multiplication d’une nouvelle variété peut prendre jusqu’à 10 ans, en raison des précautions nécessaires en matière detest, de sélection et de contrôle. Mais face à la famine imminente, les chercheurs devaient faire des économies de temps. Ils invitèrent lespaysans à les aider à évaluer les nouvelles variétés. Les paysans testèrent avec soin chacune d’entre elles et firent cuire les tubercules pourles goûter. Ils prélevèrent des boutures des variétés qu’ils avaient préférées pour les planter dans leurs propres champs.À la fin de la saison, les chercheurs se rendirent dans les villages pour discuter des avantages et des inconvénients de chaque variété avecles paysans. En procédant ainsi, ils purent réduire de moitié le temps nécessaire pour mettre au point, multiplier et diffuser une nouvellevariété, c’est-à-dire quatre ou cinq ans au lieu des huit à dix ans habituellement nécessaires.Le manioc est une culture particulière dans le sens qu’elle n’est pas produite à partir de graines. À l’inverse, les paysans coupent la longuetige noueuse du manioc en petits tronçons, chacun contenant plusieurs nœuds et plantent ces boutures dans le sol. Les nœuds germent etforment des racines produisant ainsi de nouvelles plantes de manioc.Cette caractéristique a des avantages et des inconvénients. L’avantage principal est que chaque plant de manioc est génétiquementidentique au plant dont il est issu ; c’est un clone. Cela signifie que lorsque les chercheurs ont mis au point une variété résistante que lespaysans apprécient, ils n’ont plus à se préoccuper de sa pureté (comme cela est nécessaire dans le cas d’une reproduction sexuée comme170
Liens entre la recherche et la vulgarisationpour le riz ou le blé). L’inconvénient, c’est qu’une tige de manioc peut produire seulement environ six boutures, à l’inverse des centainesde semences produites par une plante de riz ou de blé. Cela signifie que multiplier les boutures nécessaires pour planter un champ demanioc prend beaucoup de temps.Heureusement, les chercheurs du Centre international d’agriculture tropicale (CIAT), en Colombie, ont mis au point une méthode deculture du manioc à partir d’une toute petite partie de la tige contenant un seul nœud au lieu des nombreux nœuds nécessaires pour unebouture standard. En utilisant un local avec un taux d’humidité appropriée, il a été possible de faire pousser plus de plantes à partir d’unesimple tige, ce qui a permis d’accélérer la multiplication des variétés résistantes.Associer les producteursLes recherches avaient fait clairement apparaître que les nouvelles variétés pouvaient être affectées par la maladie si elles étaient plantéesdans des petites parcelles isolées : le virus pouvait simplement se disperser à partir des variétés atteintes dans les environs, submergeantles plantes nouvelles malgré leur potentiel de résistance. Il était donc nécessaire de planter ces nouvelles variétés sur de grandes superficies.Mais pour cela il fallait organiser une vaste campagne d’information des producteurs et multiplier les boutures.Les chercheurs du NARO firent appel aux services de la vulgarisation pour apporter une assistance dans ce domaine. Les responsables del’agriculture de chaque district furent invités à coordonner le programme manioc. La Fondation Gatsby apporta un soutien financier pourpermettre la formation des vulgarisateurs par les chercheurs en fournissant les moyens de transport et les indemnités. C’est ainsi que futcréé le réseau national des producteurs de manioc (NANEC – National Network of Cassava Workers).Les animateurs du NANEC entamèrent alors un ambitieux programme de formation des producteurs. Ces sessions comprenaient desinformations sur la mosaïque du manioc (comment elle se répand et comment la maîtriser), les variétés résistantes, la nécessité de détruireles plantes affectées et d’utiliser uniquement des plantes saines et les façons d’utiliser des chambres humides à faibles coûts. Plus de 35 000agriculteurs ont ainsi été directement formés et la démultiplication de la formation par leur intermédiaire a permis d’atteindre le chiffre de200 000 paysans formés au total.Les animateurs du NANEC ont collaboré étroitement avec les organisations communautaires, comme les groupements féminins et lesassociations de jeunes producteurs. Ces groupes ont multiplié et distribué les boutures, conduit les essais des nouvelles variétés dans leschamps (environ 600 essais en six ans) et géré les parcelles de démonstration qui pouvaient être utilisées comme lieux de formation deleurs propres membres. Les terres appartenant à l’État et les fermes des prisons ont également été utilisées pour produire des boutures.Lorsqu’ils ont compris qu’il était important de se débarrasser de la source de la maladie, les paysans ont pris eux-mêmes l’initiative desanctionner ceux d’entre eux qui continuaient à cultiver des variétés suspectes. Ils instituèrent un système d’amende ou exercèrent unepression sociale sur les récalcitrants. Une « police communautaire » traditionnelle était chargée de détruire les cultures infestées. Lesgroupes communautaires déjà constitués en tant que tels ont été les plus efficaces ; il s’agissait de groupes de 20 ou 30 paysans qui avaientchoisi de s’unir pour labourer et désherber mutuellement leurs parcelles. Ils ajoutèrent la formation à la culture du manioc à leurs activités.Le NANEC a aidé à la création de nouveaux groupes mais, en général, ils n’ont pas été aussi durables que les groupes déjà constitués.171
Les médias ont également été mobilisés. Le NARO a fait appel à des journalistes pour rédiger des articles et produire des émissions de radiosur le manioc et a financé la diffusion de ces programmes.La rançon du succèsLes révolutions de l’informationLe succès de cette approche est clairement reflété par les statistiques. En 1998, la production de manioc avait retrouvé les niveaux précédantl’épidémie. En 1999, le rendement était supérieur de 16 % à celui de 1989, année record avant l’épidémie. Paradoxalement, le pays se trouvemaintenant confronté à une surabondance de manioc qui pousse les prix vers le bas. L’Ouganda a commencé à exporter des tubercules etdes cossettes de manioc vers les pays voisins. Des usines pour transformer les surplus des récoltes ont été construites.Les succès dans la lutte contre la mosaïque du manioc ont également conduit à des changements dans l’organisation du système derecherche et de vulgarisation agricole. Le NARO a été restructuré, des centres régionaux de recherche ont été implantés dans chacune des12 zones agro-écologiques du pays afin de rapprocher les chercheurs et les agriculteurs. Pour renforcer davantage ces liens, la responsabilitéde la diffusion des nouvelles techniques agricoles a été transférée du ministère de l’agriculture au NARO, qui dispose d’un statut semiautonome.La coordination avec les vulgarisateurs s’est améliorée et les chercheurs du NARO utilisent désormais une approcheparticipative. L’épidémie a également eu comme résultat indirect la décentralisation des services de vulgarisation, désormais placés sous laresponsabilité des autorités des districts. De nombreuses ONG engagées dans le développement rural ont adopté l’approche du NANECpour développer leurs propres activités.Le NARO est maintenant en train d’adapter « l’approche manioc » à d’autres cultures. William Otim-Nape, qui est désormais le directeurgénéral adjoint du NARO chargé des programmes extérieurs, dit que le prochain objectif est une maladie parasitaire du café. Comme lemanioc, le café est une culture très importante en Ouganda. Il se plante également par bouturage. La même approche pourrait donc êtreappliquée.La lutte contre l’épidémie de la mosaïque du manioc a laissé des traces durables : « cela a changé la façon de penser de tout le monde dansle domaine de la recherche et de la vulgarisation », dit le William Otim-Nape. Et cela montre également que les compétences scientifiques,une bonne organisation et de modestes ressources peuvent être mises à profit pour surmonter une crise en un temps relativement court.Voilà qui peut servir de leçon aux nombreux pays qui cultivent le manioc ou d’autres plantes similaires.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESDr G.W. Otim-Nape, Deputy Director-General (Outreach), National Agricultural Research Organization (NARO), PO Box 295, Entebbe(Ouganda). Tél. (256) 41 320178/41 320264 ; fax (256) 41 321070 ; e-mail narohq@imul.comMastering Mosaic: The Fight for Cassava Production in Uganda. Gatsby Occasional Paper, December 1997. Gatsby CharitableFoundation, 9 Red Lion Court, Londres EC4A 3EB (Royaume-Uni)172
Liens entre la recherche et la vulgarisationCampagnes d’informationCombattre la cochenille de l’hibiscusJoseph SeepersadWayne GanpatLe majestueux arbre « samaan », avec son gigantesque déploiement de branches, est un repère symbolique dans la ville de Port-of-Spaindepuis plus de 150 ans. Il avait résisté aux éléments pendant tout ce temps et semblait destiné à être encore là pour les futures générations.En réalité, il se meurt doucement. Il est devenu la proie de « la cochenille de l’hibiscus », un insecte parasite qui a fait une apparitionmalencontreuse dans l’île au milieu de l’année 1995.L’histoire a en fait commencé deux ou trois ans auparavant, quand le même insecte causa des dégâts considérables aux cultures et à d’autresplantes de l’île voisine de la Grenade. Mais ensuite, plus rien ne se produisit et tout le monde pensa que la menace était partie vers d’autreshorizons. Puis on observa quelques petites attaques à Port-of-Spain où se situait le port d’entrée dans le pays. Les autorités pensèrent quedes commerçants étaient responsables de l’introduction du parasite et elles prirent des mesures restrictives à leur encontre. Dans le mêmetemps, elles tentaient d’éradiquer le parasite dans les poches où il avait été localisé, en utilisant un système de « pulvérisation, coupe etbrûlage ». Malgré cela des rapports alarmants arrivaient : la cochenille se répandait rapidement.Elle semblait avoir une prédilection pour l’hibiscus, une jolie fleur que l’on trouve dans tous les jardins. Au fur et à mesure que l’insecte serépandait, la nécessité d’alerter la population en utilisant les médias devint évidente. Le ministère de l’agriculture entreprit donc de diffuserune campagne d’information pressante, pour inciter la population à « pulvériser, couper et brûler ». Sans une action rapide, la cochenillepouvait se répandre très rapidement. Le ministère recruta des équipes pour faire le nécessaire mais il fallait aussi se fier au civisme de lapopulation et lancer une offensive nationale.Aimez vos ennemisLes cochenilles ne semblèrent pas être affectées par tous ces efforts : elles continuèrent à se développer touchant désormais les cultures,les arbres et les autres plantes. L’oseille, utilisée pour fabriquer une boisson traditionnelle de Noël, fut également affectée. La cochenilleétait devenue une vedette des médias.Il était évident que le procédé de « pulvérisez, coupez et brûlez » ne fonctionnait pas. Il fallait trouver autre chose.La nouvelle approche s’appuyait sur une gestion intégrée des parasites, fondée sur la lutte biologique. Elle s’appuie sur les ennemisnaturels : araignées, libellules, hémérobes, guêpes parasites et autres insectes. Deux des ennemis naturels de la cochenille ont été introduitsà la Trinité et ils sont parvenus à la maîtriser.173
Anatomie d’une campagneComment la modeste cochenille est-elle devenue si largement connue par la population ?Les révolutions de l’informationCe n’est pas étonnant si on analyse le soin avec lequel la campagne a été planifiée. Deux comités ont été institués : un comité techniquescientifique consultatif et un groupe de travail opérationnel. Les deux comités étaient dirigés par la même personne, Cynthra Persad, duministère de l’agriculture. Le comité technique était composé de représentants de la division de la vulgarisation du ministère et desprincipales organisations de recherche agricole (locales, régionales et internationales) opérant à la Trinité. Il a formulé desrecommandations et des stratégies pour venir à bout du problème. Le comité opérationnel était constitué des représentants des principalesdivisions du ministère de l’agriculture. Son rôle principal consistait à coordonner la mise en œuvre des stratégies élaborées et de tenirinformé l’autre comité de l’avancement de la campagne.Les deux comités avaient compris que l’organisation d’un programme de sensibilisation et de vulgarisation sur la cochenille et les dégâtsqu’elle occasionne était essentielle. La division de la vulgarisation a mobilisé toutes sortes de médias, et plus particulièrement la radio et latélévision, pour informer la population et lui demander d’informer les autorités de la présence de la cochenille ici ou là. Plus tard, lorsquela stratégie est passée de l’approche « pulvérisez, coupez, brûlez » à la lutte biologique, il était toujours important de rester en contact avecla population pour savoir où les prédateurs devaient être répandus et pour suivre les progrès de l’opération d’éradication.Des programmes de trois et cinq minutes étaient diffusés par différentes stations de radio. Pour faciliter l’identification de l’insecte par lapopulation, des fiches descriptives et des photos ont été largement diffusées. Des affiches en couleurs et des tracts ont été distribués. Aupoint culminant de la campagne, de courtes émissions de télévision ont également été produites.Comme les messages devaient toucher le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible, le ministère se rendit comptequ’avec ses moyens limités en termes de production audiovisuelle, il ne pouvait pas assurer la réalisation des programmes. La télévision parENCADRÉ 15Microprogramme pour une cochenilleUn microprogramme radiophonique a été produit pour la campagne. Il disait ceci :Si vous voyez la cochenille,faites le savoir immédiatement,Ne tardez pas,Arrêtez sa destruction…174
Liens entre la recherche et la vulgarisationcâble avait rendu les téléspectateurs de la Trinité très exigeants et il était important que la production ait un caractère vraimentprofessionnel. L’équipe de la division de la vulgarisation conçut le contenu technique des programmes et les scénarios ; la production futconfiée à des organismes de production professionnels, à l’extérieur. De même, les affiches ont été étudiées pour montrer les symptômesde la manière la plus réaliste possible, l’impression étant également effectuée à l’extérieur. Par contre, les fiches descriptives et les tracts ontété élaborés et réalisés au sein du ministère.Une diffusion appropriée en temps opportun était essentielle. Habituellement, les radios et télévisions commerciales diffusent les émissionséducatives des services publics en dehors des heures de forte écoute. Mais des enquêtes d’audience ont montré qu’avec ces horaires lesmessages n’auraient pas d’impact. Les mêmes études indiquèrent quelles étaient les stations qui étaient les mieux à même de toucher despublics spécifiques. Par exemple, certains programmes de radio s’adressaient aux habitants des faubourgs et aux jeunes qui présentaientcertaines caractéristiques culturelles. Pour la télévision, les programmes sur la cochenille ont été diffusés aux heures de grande écoute ouau moins à des moments où l’on savait que de nombreux téléspectateurs seraient présents.De l’argent bien dépenséL’opération a été coûteuse : les stations privées n’ont pas assuré la diffusion des programmes gratuitement. Mais il s’avéra quel’investissement n’avait pas été inutile. Des enquêtes ont montré que beaucoup de gens avaient pu être informés sur la cochenille à traversles médias.Comment a-t-il été possible d’obtenir si rapidement de telles ressources du gouvernement ? Peut-être parce que les destructionsoccasionnées par ce parasite dans d’autres pays étaient impressionnantes et que la même chose pouvait se produire à la Trinité.La stratégie d’information et d’éducation ne s’est pas seulement appuyée sur les médias. Les vulgarisateurs de terrain ont également étémobilisés pour s’attaquer au parasite, particulièrement dans les zones touchées par l’épidémie. Ils se rendaient dans les familles, faisaientdes interventions dans les écoles, donnaient des conférences aux réunions du Rotary Club et au sein d’organisations communautaires. Ilsont distribué toutes sortes de documents d’information et de vulgarisation. Ils ont organisé des expositions dans les centres commerciauxet sur les marchés publics. Enfin, et ce n’est pas le moins important, ils ont assuré une permanence téléphonique pour répondre aux appelsde la population : les numéros de téléphone que les gens pouvaient appeler pour donner des informations sur la présence des cochenillesou pour poser des questions figuraient sur les documents distribués.Les raisons du succèsLe programme a été un franc succès : les dégâts ont été limités. L’arbre « Samaan » de Port-of-Spain a été sauvé et il fleurit à nouveauaujourd’hui. Les éditoriaux des journaux ont félicité le ministère de l’agriculture et son équipe. Grâce à un appui de la FAO, l’expérience apu être partagée largement dans les Caraïbes et au-delà.175
Les raisons du succès ? Le choix d’une technologie appropriée et la façon dont la campagne a été conduite ont été les deux facteursprincipaux de réussite. La méthode de lutte biologique a été introduite à temps et cela a été possible parce que les comités nationaux ontété mis en place dès que les autorités ont compris qu’ils avaient affaire à un problème sérieux. Le fait d’avoir un président unique pour lesdeux comités a contribué à maintenir un lien constant entre recherche et vulgarisation.Les révolutions de l’informationLa campagne de communication a également joué un rôle primordial en sensibilisant la population de différents horizons et en permettantla mobilisation de ressources financières. L’efficacité de cette campagne tient sans doute au fait que certains aspects de la production et dela diffusion ont été confiés à des professionnels de la communication. Mais il faut également en attribuer le mérite aux « fantassins de lavulgarisation », trop souvent brocardés mais qui ont su apporter le message jusqu’au cœur de la population.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESDr Wayne G. Ganpat, Extension Training and Information Division, Ministry of Agriculture, Land and Marine Resources, PO Box 389,Port-of-Spain (Trinité et Tobago). Tél: (868) 642 0167/646 1966; fax (868) 642 6747; e-mail waygan@trinidad.netDr Joseph Seepersad, Dept. of Agricultural Economics and Extension, Faculty of Agriculture and Natural Sciences, University of the WestIndies, Circular Rd, St Augustine (Trinité et Tobago). Tél: (868) 645 3232–5 ext 3204; e-mail seeps@tstt.net.tt176
Paul MundyLiens entre la recherche et la vulgarisationVulgariser le langage scientifiqueAteliers d’écritureTraduire la science en informationPartout dans le monde, des scientifiques travaillent à résoudre les problèmes des agriculteurs dans les centres de recherche agronomiqueet dans les universités. Ils mettent au point de nouvelles variétés végétales, testent différents types d’engrais sur tous les types de sols etcherchent des solutions pour lutter contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes qui peuvent réduire de façon importante lesrécoltes des agriculteurs. Généralement, lorsqu’ils ont mis au point une nouvelle technologie, les chercheurs rédigent un article décrivantleur expérimentation et le publient dans une revue scientifique. Mais traduire des concepts scientifiques dans un langage accessible auxagriculteurs (et aux vulgarisateurs) n’est pas facile. En voici un exemple :Les résultats de l’expérimentation ont mis en évidence un taux élevé de phénol dans les résidus organiques de différentesespèces. Cela a eu comme conséquence un taux de décomposition lent qui a inhibé la libération des nutriments.C’est difficile à comprendre pour un agriculteur ou même un conseiller agricole et encore plus à appliquer. Il faut le traduire en quelquechose comme cela :Si vous voulez savoir si une plante donnera un bon compost, vous devez en goûter une feuille. Si votre langue se contracte,c’est que ça ne fera pas un bon compost.Traduire la langue scientifique en un langage que tout le monde peut comprendre est un défi majeur. Il est difficile pour les chercheurs dele faire eux-mêmes : ils sont immergés dans leur domaine et bien souvent ils ne savent pas exprimer autrement leurs idées. En fait, ilsutilisent le langage scientifique à dessein car ils veulent s’assurer que leurs propositions sont formulées de manière rigoureuse avec toutesles précautions de langage nécessaires.Traduire des données scientifiques dans un langage et des concepts de tous les jours et les illustrer de manière concrète est difficile pourles vulgarisateurs et les producteurs agricoles ; peu d’entre eux possèdent un bagage scientifique suffisant pour le faire. Il en résulte queces données scientifiques ne sont souvent pas reformulées et prennent la poussière sur les rayonnages des bibliothèques des centres derecherche.Des ateliers participatifsComment faire cette traduction ? Une méthode intéressante est utilisée par l’Institut international de reconstruction rurale (IIRR) à Nairobi(Kenya). Elle consiste à organiser des ateliers qui regroupent des chercheurs, des vulgarisateurs, des animateurs d’ONG et des paysans, pour177
Les révolutions de l’informationEn haut: les participants à un atelier organisé par l’ITDG à Bogoria, au Kenya(dans le respect de la démarche de l’IIRR mais sans sa participation directe),étudient un manuscrit sur la médecine para-vétérinaire(Photo : Paul Mundy)À droite : le Dr Jacob Wanyama (debout), spécialiste en médecineethnovétérinaire, discute du format d’un manuscrit avec des employés duservice informatique lors d’un atelier à Bogoria (Kenya)(Photo : Paul Mundy)construire ensemble, à partir d’une matière première scientifique, des documents d’information adaptés. Un groupe d’animateurs, derédacteurs, d’artistes graphiques et de spécialistes de la mise en page apportent une assistance technique aux participants pour qu’ilsparviennent à rédiger et corriger leurs manuscrits, puis à les mettre en page et à les illustrer. Un atelier de deux semaines peut ainsidéboucher sur la production d’un ensemble de livrets de vulgarisation ou d’un manuel pratique de 200 pages.Les ateliers de l’IIRR n’ont rien à voir avec les conférences scientifiques auxquelles les chercheurs sont habitués (voir encadré 16). Il s’agitd’un processus très souple. Chaque manuscrit est présenté, critiqué et amendé au moins deux fois au cours de chaque atelier. Cetteprocédure permet aux participants de travailler de façon approfondie sur le contenu, d’écarter un manuscrit s’il n’est pas exploitable, de lediviser en plusieurs éléments si nécessaire ou de regrouper des informations provenant de deux sources différentes dans un même texte.Tous les participants à l’atelier, qu’il s’agisse d’agriculteurs ou de chercheurs de haut niveau, apportent une contribution à la formulationfinale du document. Les chercheurs garantissent la pertinence scientifique des informations ; les vulgarisateurs et animateurs d’ONGs’assurent qu’elle est formulée dans des termes qui permettent sa diffusion ; les agriculteurs veillent à ce que les textes et les illustrationssoient adaptés aux critères de compréhension des utilisateurs finaux et que le contenu corresponde bien à leurs besoins.Dès le début de l’atelier, une réflexion collective est organisée, afin de proposer des sujets à traiter (en plus de ceux qui sont déjà prévus)pour enrichir la publication. Des participants individuels ou des groupes de participants sont encouragés à rédiger de nouveaux manuscritsqui seront examinés et amendés pendant l’atelier.Le format de la publication fait lui-même l’objet d’une discussion et d’une décision collective pendant l’atelier. Pendant un atelier, parexemple, les participants ont eu à choisir entre trois options : une série de livrets, un manuel ou des fiches techniques sur feuilles volantes.Le choix final a porté sur le manuel parce que les participants ont pensé que ce serait le format le plus pratique pour les agents devulgarisation.178
Liens entre la recherche et la vulgarisationENCADRÉ 16Comment fonctionnent les ateliers ?PréparationAvant l’atelier, un comité de pilotage établit la liste des sujets possibles et invite les collaborateurs à préparer desbrouillons sur chaque thème, à partir d’un canevas commun à tous. Ces brouillons et d’autres éléments deréférence constituent la matière première de l’atelier.Première ébauchePendant l’atelier lui-même, chaque participant présente chaque page de son manuscrit, en utilisant unrétroprojecteur. Des copies de chaque manuscrit sont également distribuées à tous les autres participants quiapportent leurs critiques et suggèrent des amendements.Après cette présentation, un rédacteur aide l’auteur du manuscrit à reprendre et à amender sa première version.Un graphiste réalise des illustrations pour accompagner le texte. L’ensemble est alors mis en page et constitueune deuxième version. Pendant ce temps, les autres manuscrits font l’objet du même travail de présentation et decorrection avec l’appui technique des rédacteurs et des illustrateurs.Deuxième ébaucheChaque participant présente alors son manuscrit remanié une deuxième fois, toujours avec le rétroprojecteur. Denouveaux commentaires et amendements sont proposés par le groupe de travail. Sur cette base, le rédacteur etle graphiste sont à nouveau invités à apporter leur appui technique pour la mise au point d’une troisième version.Troisième ébauchePendant la dernière partie de l’atelier, la troisième version est proposée aux participants pour les ultimescommentaires et modifications.FinalisationLa version finale peut être achevée, imprimée et distribuée aux participants immédiatement après l’atelier.Rapide, efficaceProduire des documents d’information en utilisant des méthodes conventionnelles peut prendre beaucoup de temps : il faut écrire unepremière ébauche, la réviser, corriger le texte final, préparer les illustrations et procéder à la mise en page. Le prototype ainsi réalisé doitêtre examiné par des spécialistes du sujet traité avant que les corrections finales ne soient apportées. Il se peut que les correcteurs ne soientpas d’accord, que les collaborateurs ne soient pas disponibles… C’est un processus qui peut sembler interminable.179
Théoriquement, les documents d’information destinés aux producteurs agricoles doivent être pré-testés pour s’assurer de leur pertinenceet de leur adaptation au niveau de compréhension des lecteurs. Mais ce schéma idéal est rarement réalisé : les délais de publication sontsouvent trop rapprochés ou il n’y a pas suffisamment de ressources financières pour permettre le pré-test.L’approche par l’atelier d’écriture permet de surmonter ces problèmes car tout le monde travaille sur le manuscrit en même temps. Les unset les autres peuvent dialoguer, échanger des idées, confronter des points de vue, s’entraider, se contrôler mutuellement. Les agriculteurset les vulgarisateurs permettent d’intégrer le pré-test et la production. Toutes les phases d’écriture, de pré-test et de correction s’articulentdans le processus continu et intensif de l’atelier.Les révolutions de l’informationCombattre les pannes d’écritureDe nombreuses personnes éprouvent des difficultés à écrire. L’atelier les aide à coucher leur savoir sur le papier. Il aide les organismes dedéveloppement à rendre compte de leurs expériences, à en tirer les leçons et à les partager avec d’autres acteurs.Lorsque la production de l’ouvrage est terminée, chacun peut mesurer sa propre contribution. Il peut en assurer la promotion auprès deses collègues ou auprès d’autres organisations et participer à la plus large diffusion possible.Pendant l’atelier, tous les participants travaillent à la réalisation d’un produit commun. L’ouvrage est réalisé collectivement ; personne n’estpassif ; chacun apporte sa contribution. Ce processus crée le sentiment de poursuivre un objectif commun avec une vision partagée. C’estun bon indicateur du désir de poursuivre la collaboration après la fin de l’atelier.Les paysans sont des expertsLes paysans jouent un autre rôle essentiel. Les chercheurs et les vulgarisateurs oublient bien souvent que les paysans ont une connaissanceapprofondie et détaillée des cultures qu’ils font pousser, des animaux qu’ils élèvent et des sols qu’ils labourent. Les recommandationstechnologiques produites par les chercheurs ignorent ce « savoir local ». Impliquer les producteurs dans la production de matérield’information est un excellent moyen de s’assurer que leur voix est entendue : les chercheurs peuvent prendre en compte le point de vuedes paysans et ceux-ci peuvent apporter leur contribution à l’information contenue dans le livre.L’atelier qui a abouti à la production d’un livre sur la médecine vétérinaire traditionnelle au Kenya en est un parfait exemple. En 1966, l’IIRRorganisait cet atelier en collaboration avec l’ITDG (Intermediate Technology Development Group), une ONG qui coordonne un importantréseau de spécialistes de santé animale dans le nord et le centre du Kenya (voir p. 225). Les participants étaient des chercheurs del’université de Nairobi, des agents du ministère de l’élevage et des musées nationaux du Kenya, des vétérinaires de terrain, des paravétérinaireset des éleveurs ainsi que des guérisseurs provenant de 12 groupes ethniques répartis dans tout le pays. Ces guérisseurs utilisentdes plantes médicinales pour traiter les maladies du bétail et sont très respectés. Les éleveurs font souvent appel à eux. Dans beaucoup de180
Liens entre la recherche et la vulgarisationzones, là où l’accès aux vétérinaires modernes est très difficile, ces guérisseurs représentent le seulrecours pour prendre en charge la santé du bétail.Pendant l’atelier, les chercheurs ont présenté à tour de rôle des manuscrits sur les principalesmaladies. Durant les discussions qui ont suivi chaque présentation, les guérisseurs pouvaient décrireles maladies avec les symptômes qu’ils avaient eux-mêmes établis. Les symptômes employés par leschercheurs pour décrire une maladie ne sont pas toujours les mêmes que ceux retenus par lapopulation et cette situation conduit à de nombreux malentendus sur le terrain. Les guérisseurs ontété invités à décrire les méthodes qu’ils utilisent pour traiter les maladies. Les chercheurs ontégalement donné leur avis sur ces pratiques : par exemple, le tabac contient de la nicotine qui est trèstoxique pour les tiques et les mites. Ainsi, certains traitements utilisés par les guérisseurs ont étéretirés du manuel car l’ensemble des participants à l’atelier avaient des doutes sur leur efficacité.Toutefois, de nombreuses autres pratiques ont été validées. Le résultat constitue un manuel unique,qui combine de façon remarquable les données scientifiques et les savoirs locaux.Intitulé Ethnoveterinary medicine in Kenya: A field manual of traditional animal health carepractices et publié en 1996 par l’IIRR et l’ITDG, avec le soutien du CTA, il aborde plus de 60 maladiesordinaires des bovins, des chèvres, des chameaux et d’autres animaux d’élevage. Prenons par exemplele chapitre consacré à la gale : une maladie causée par des tiques qui s’introduisent sous la peau desanimaux en créant une démangeaison intense et des infections de la peau qui peuvent conduire à lamort. Le chapitre donne 11 noms locaux de la maladie, en 7 langues différentes, une liste dessymptômes et des causes de la maladie, décrit plusieurs méthodes de prévention et énumère unesérie de 11 traitements par les plantes médicinales qui peuvent être utilisés par les éleveurs qui n’ontpas accès aux médicaments de la médecine moderne.Profitant d’un moment de repos,Lokuriana Lopuwa (à gauche), uneresponsable turkana de l’IIRR, et AliceLorot (à droite), une « accoucheuse »traditionnelle et une guérisseused’animaux originaire de Samburu, posenten compagnie d’un garçon de l’hôtel deMachakos où se déroulait l’atelier demédecine ethnovétérinaire(Photo : IIRR)Une structure d’appuiL’équipe d’encadrement apporte une contribution essentielle au bon fonctionnement de l’atelier. L’IIRR travaille avec une équipecompétente composée de rédacteurs, d’artistes graphiques et de spécialistes de la mise en page pour que le matériau informatif soitrapidement traité et maquetté par des professionnels. Chaque manuscrit est confié à un rédacteur qui travaille avec l’auteur pour le corrigeret s’assurer qu’il est en conformité avec les directives éditoriales préétablies.De nombreux documents d’information et de vulgarisation dans les pays en développement sont constitués de simples textes. Pasd’illustrations. Ceci les rend rébarbatifs et difficiles d’accès. Il n’en va pas de même pour les publications de l’IIRR. Un groupe de trois ouquatre illustrateurs participent à l’atelier ; leurs dessins au trait constituent une des caractéristiques des publications de l’IIRR. Les auteurs,rédacteurs et graphistes conçoivent chaque image ensemble ; l’auteur ou le rédacteur fait une rapide esquisse tracée en quelques traits pourindiquer les éléments essentiels ; le dessinateur la transforme en une illustration professionnelle.181
Comme les artistes assistent à l’atelier, ils peuvent écouter et voir les présentations, discuter des projets d’illustrations avec les auteurs etles corriger si nécessaire. Les participants vérifient chaque dessin pour s’assurer de sa précision et de son intelligibilité. Chaque image peutêtre reprise trois ou quatre fois avant d’obtenir une validation finale. Les illustrateurs ont un sens de l’humour aiguisé. Ils font souvent descaricatures des participants et les affichent sur les murs, pour la joie de tous. C’est même devenu une sorte de tradition dans ces ateliers.L’équipe chargée de la mise en page met les textes et les images en forme finale. Ils disposent d’un équipement complet : ordinateurs,photocopieurs, scanners, imprimantes à laser, un groupe électrogène (indispensable dans les endroits où les coupures d’électricité sontfréquentes) et des disquettes de sauvegarde.Les révolutions de l’informationDes résultats tangiblesLe bureau de l’IIRR à Nairobi a produit de nombreux ouvrages en utilisant cette méthodologie depuis 1994, notamment le manuel pratiquede médecine vétérinaire traditionnelle évoqué plus haut, un manuel sur l’agriculture durable en Afrique orientale et australe (SustainableAgriculture Extension Manual for Eastern and Southern Africa, publié en 1998 avec le soutien du CTA) et un guide des méthodesd’agroforesterie au Ghana sous forme de tableaux à feuilles mobiles (Agroforestry in Ghana : A Technology Information Kit, publié en 1994conjointement avec le Ghana Rural Reconstruction Movement).Ces ouvrages ont été très appréciés. Les 2 000 exemplaires du manuel vétérinaire ont été vendus et une réédition est envisagée. Desexemplaires ont été distribués aux vétérinaires « aux pieds nus » par le réseau de l’ITDG et de nombreux organismes de développement ontacheté l’ouvrage « en gros » pour le distribuer à leurs équipes et leurs partenaires. Le manuel a également connu un succès inattendu auprèsdes vétérinaires professionnels qui commencent à reconnaître que les éleveurs nomades qui vivent de leurs animaux et en leur compagnieont acquis depuis des siècles une connaissance approfondie de leurs troupeaux et de leurs problèmes de santé. Le manuel a permis derelancer l’intérêt de l’université et de l’Institut de recherche agronomique du Kenya pour le savoir traditionnel, ce qui a renforcé leursprogrammes de recherche ethno-vétérinaire.Le livre sur l’agriculture durable s’est également très bien vendu : plus de 2 200 exemplaires en deux ans. L’université agricole Alemaya enEthiopie l’utilise comme livre de cours dans son cycle de formation des vulgarisateurs. L’ouvrage a été traduit en kiswahili, la languerégionale de l’Afrique de l’Est. Cette traduction est destinée à rendre le manuel plus accessible dans les zones où le personnel devulgarisation est souvent plus à l’aise en kiswahili qu’en anglais. L’IIRR a adapté plusieurs parties du livre pour en faire des audiocassettesdiffusables par les radios et utilisables par des groupes d’écoute paysans. Il est également en train de construire un site Internet afin quetous ceux qui disposent d’un accès à la Toile puissent télécharger l’information qui leur est utile.Le succès de ces publications a encouragé l’IIRR à planifier davantage d’ateliers d’écriture. Des ouvrages sont prévus sur les soins de santécommunautaires, l’agriculture sur les terres arides et la communication pour le développement.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESDr Isaac Bekalo, Director, Africa Regional Office, International Institute of Rural Reconstruction (IIRR), PO Box 66873, Westlands, Nairobi(Kenya). Tél. (254) 2 442610/ 2 446522 ; fax (254) 448148 ; e-mail iirraro@form-net.com182
Liens entre la recherche et la vulgarisationLivrets de vulgarisationDes insectes nuisibles dans le PacifiquePeter WaltonLes insectes nuisibles et les maladies ne menacent pas seulement les cultures mais également les vies humaines. Il ne s’agit pas de quelqueseuros mais d’épidémies qui peuvent affamer des paysans vivant de leurs récoltes. La section consacrée à la mosaïque du manioc montrecomment une maladie peut répandre la famine dans un pays comme l’Ouganda (voir p. 169).Lorsque leurs cultures sont attaquées, les agriculteurs ont besoin que leurs conseillers agricoles leur apportent les bons conseils, au bonmoment. Les conseillers doivent eux-mêmes obtenir ces informations pour pouvoir les répercuter auprès des paysans. Mais bien tropsouvent, cette information est difficile à trouver, n’est pas actualisée ou n’est pas pertinente.Dans le Pacifique, au cours des années 70, Ivor Firman, responsable de la protection des végétaux dans ce que l’on appelait la Commissiondu Pacifique Sud (devenue le Secrétariat pour le Pacifique Sud ou SPC), essaya d’apporter une solution à ce problème. Il produisit une sériede documents appelés Les fiches-conseils sur les insectes nuisibles (en fait, il les appela seulement Les fiches-conseils ; la mention « insectesnuisibles » fut ajoutée par la suite pour préciser la nature du conseil). Il est sans doute intéressant de voir comment ces fiches ont étéproduites et quelles leçons on peut en tirer après 25 années de publication.Qui bénéficie des conseils ?Les principaux utilisateurs des fiches-conseils sur les insectes nuisibles sont les spécialistes techniques des ministères de l’agriculture des22 pays de la région des îles du Pacifique. Qui sont ces spécialistes techniques ? Ils comprennent les agents de vulgarisation, lesfonctionnaires responsables des services de quarantaine, les chercheurs et les professeurs d’agriculture qui ont un certain niveau dequalification supérieure : grade universitaire, diplôme ou certificat d’agriculture.Il était en effet essentiel de bien identifier les destinataires des fiches. Sinon, cela revenait à « écrire dans le noir à une personne aveugle quine parle pas votre langue ». À l’inverse, connaître le niveau de connaissances et la situation géographique du public cible est un élémentdéterminant pour pouvoir lui adresser un message pertinent. À titre d’exemple, on savait que tous les responsables techniques pouvaientparler anglais ou français : les fiches étaient donc produites dans ces deux langues.« Ecrire pour un public spécifique » signifie veiller à utiliser des mots et des expressions compréhensibles. Les spécialistes visés avaient toussuivi des cours d’agriculture, ils étaient donc capables de comprendre des termes comme « résistance variétale » ou « infestation ». Mais sivous vouliez présenter la même information à des agriculteurs, vous ne pouviez pas utiliser les mêmes termes. Vous deviez plutôt direquelque chose comme : « certaines variétés sont moins touchées que les autres » ou « si on ne trouve qu’une petite quantité de charançonssur les plantes, ce n’est pas grave. Mais s’ils sont nombreux, vous devez agir ».183
Qui prodigue les conseils ?Les révolutions de l’informationToutes les fiches techniques sur les insectes nuisibles ont été rédigées par des experts. Le terme « expert » est souvent utilisé de façon unpeu abusive mais, dans ce cas précis, les auteurs des fiches étaient vraiment des experts dans leurs champs de compétences respectifs. Cetaspect est important car cela signifie qu’ils étaient capables de décider quelles informations devaient figurer dans les fiches et organiser leurprésentation. Ils n’avaient pas besoin de se référer à qui que ce soit pour rédiger les fiches (et pourtant ils le faisaient). Et ils savaient, depar leur propre expérience, quels étaient les points importants à développer. Les fiches ont été rapidement considérées comme desdocuments de référence : elles contenaient des informations actualisées sur toutes sortes d’insectes nuisibles et de maladies. Et elles étaientspécifiquement conçues pour une région particulière : les îles du Pacifique.Comme les auteurs étaient des experts, il s’agissait généralement de chercheurs, ce qui signifie qu’ils n’étaient pas habitués à écrire pourun public comme celui des agents de vulgarisation. Il était donc nécessaire, pendant le processus de production des fiches de faire appel àdes rédacteurs qui reformulaient le texte dans un langage adapté au public visé.Choix des thèmesQuels sujets, quels insectes et maladies étaient traités par les fiches ? Les sujets étaient choisis selon deux procédures : la première consistaità demander aux participants, à l’occasion des réunions régionales de protection des végétaux (qui se tenaient tous les deux ans),d’inventorier les insectes et les maladies qu’ils souhaitaient voir traiter, en les classant par ordre de priorité. De nouvelles fiches pouvaientalors être mises en chantier pour couvrir les problèmes jugés prioritaires. Mais cela n’était pas toujours possible. D’autres sourcesd’information étaient alors exploitées : par exemple, si un nouvel insecte nuisible commençait à menacer les cultures dans une région,certains agents de protection des végétaux pouvaient ne pas en être informés car leur zone n’était pas encore affectée.Et il y avait une troisième possibilité : même si elle n’est pas vraiment à recommander, elle mérite d’être mentionnée. C’est le cas où unexpert était volontaire pour rédiger une fiche sur son insecte nuisible ou sa maladie préférée. Cela ne se produisait que de temps en tempset les manuscrits n’étaient acceptés que lorsque les sujets qu’ils abordaient devenaient utiles. L’avantage d’un auteur proposant lui-mêmeson sujet est qu’il le connaît « sur le bout des doigts » et qu’il dispose en général d’un dossier photographique complet ce qui, on va le voir,est particulièrement utile.PrésentationLes documents de vulgarisation doivent être attractifs pour les vulgarisateurs comme pour les agriculteurs. Quel que soit le support choisi,une émission de radio, un programme vidéo ou une fiche technique, le mode de présentation doit chercher à favoriser la communication.En d’autres termes, la façon de présenter un message doit favoriser sa compréhension. Si ce n’est pas le cas, il n’attirera pas son utilisateurpotentiel. Les fiches-conseils sur les insectes nuisibles étaient très attractives, dans tous les sens du terme. Elles étaient très bien présentées ;chacune d’entre elles contenait des photos en couleurs et elles étaient imprimées sur du papier glacé, en format A5 (la moitié du format A4des machines à photocopier).184
Liens entre la recherche et la vulgarisationLe format des fiches était sans doute l’élément qui les rendait les plus attractives. Le format A5 correspond exactement à la bonnedimension : petit, mais pas trop. Maniable, en somme. Lorsque le format a été récemment modifié pour passer en A4, pour on ne sait quelleraison, les fiches ont perdu quelque chose. C’est difficile à expliquer mais le format A5 avait un plus grand impact.Un volume de quatre à six pages constituait par ailleurs la bonne taille. Elle imposait des contraintes incroyables aux auteurs (et auxconcepteurs !), mais c’était un facteur d’impact. Être capable de présenter l’information en quelques pages, avec des photos, signifiait quel’on s’était appliqué à dégager l’information essentielle. C’est très difficile d’écrire sous une telle contrainte. Mais c’est une règle efficace quidonne de bons résultats.Lorsque la production de la série démarra, un système de reliure par anneaux a été mis au point, de façon à ce que chaque utilisateur puisseconserver les fiches dans de bonnes conditions. Malheureusement, le nombre de fiches produites excéda bien vite la capacité de classementdes chemises de classement disponibles et beaucoup d’utilisateurs ne furent plus en mesure d’utiliser ce mode de classement.Les photos furent un autre facteur essentiel du succès des fiches. Chaque fiche comprenait au moins une photo avec une légende, sur lapremière page. Quelques-unes pouvaient compter jusqu’à trois photos, avec leurs légendes. Et à l’intérieur, il pouvait y avoir d’autresphotos, souvent des gros plans, ou des photos prises au microscope. La plupart des photos étaient d’excellente qualité. Une des pluscélèbres représentait un escargot africain géant avec une goutte d’eau qui glissait lentement le long de sa coquille. Superbe.Cependant, la nécessité de disposer de photos d’excellente qualité constituait aussi l’une des contraintes de la production : commenttrouver rapidement des photos de cette qualité ? Dans certains cas extrêmes, des photographes ont été engagés. Le manque de photospertinentes conduisait quelquefois à retarder de plusieurs mois, voire d’années entières, la publication d’une fiche. Alors, lorsqu’un auteurarrivait avec un texte et des photos, il était vraiment le bienvenu.Après 25 ans, quel est le bilan ?Le principal enseignement réside dans le constat que le public a toujours autant besoin des fiches-conseils sur les insectes nuisibles qu’il ya 25 ans. Les fiches sont toujours aussi appréciées et demandées que lors de la publication de la première d’entre elles.D’une certaine façon, c’est décevant. Pendant tout ce temps, on aurait pu espérer que les ministères de l’agriculture des pays concernésauraient produit des documents équivalents. Quelques-uns l’ont fait, mais c’est loin d’être le cas pour tous. Certaines fiches ont été traduitesdans les langues locales et publiées conjointement avec les ministères. Mais la traduction signifiait que l’on ne s’adressait plus auxvulgarisateurs (anglophones ou francophones) mais aux agriculteurs (qui ne maîtrisaient souvent que les langues locales) et ceschangements n’étaient pas toujours possibles, compte tenu du niveau de langue utilisé ou des mises en page, sauf dans un cas précis, pourune fiche destinée aux agriculteurs, sur la rouille des feuilles de taro. Par ailleurs, il est apparu que le mode de détermination des thèmesprioritaires et de mise à jour des fiches doit être plus efficace.Un bon exemple de cela est la fiche sur la rouille des feuilles de taro mentionnée plus haut. Elle a été publiée pour la première fois en 1977.Après sa publication, les signes d’identification et les modes de traitement de cette maladie ont évolué. En 1993, une épidémie de rouille185
atteint les îles Samoa, détruisant l’ensemble des cultures de taro, celles destinées à la consommation locale comme à l’exportation. C’étaitun coup dur. Il fallait rééditer la fiche sur la rouille de la feuille de taro mais les spécialistes ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur l’étatdes connaissances sur le sujet, ni sur les mesures appropriées pour maîtriser l’épidémie. La nouvelle version de la fiche n’a été publiée qu’en1999 : six ans après l’épidémie. Evidemment, c’était bien trop tard.Les révolutions de l’informationRestons sur le même exemple. La fiche destinée aux agriculteurs (qui était basée sur l’ancienne fiche avec quelques données nouvelles) étaitutilisée comme un élément d’une campagne d’information et de vulgarisation sur la rouille à destination des agriculteurs : comment lareconnaître, ce qu’elle représentait et comment lui faire face. La campagne a été massive, avec une combinaison de journées de formation,des émissions de radio et des émissions de télévision.Cette utilisation combinée de différents médias, pour offrir différents angles de présentation du même sujet, s’est avérée très efficace pourcommuniquer le message et renforcer son impact. Mais la réussite de telles campagnes implique une planification rigoureuse et unengagement de tous les acteurs concernés. La fiche destinée aux agriculteurs a été réalisée grâce à une collaboration entre les agents devulgarisation et les paysans et a fait l’objet d’un test préalable sur le terrain, avant d’être éditée (voir p. 177 où une démarche analogue aété adoptée lors des ateliers de l’IIRR).Et l’avenir ?Comme nous l’avons déjà mentionné, il y a toujours une forte demande pour ces fiches sous leur forme imprimée traditionnelle. Ellespourraient également être numérisées et exploitées sur l’Internet ou gravées sur CD-ROM mais ces nouveaux outils ne sauraient êtreconsidérés comme une alternative aux fiches imprimées : la plupart des utilisateurs ne disposent pas d’ordinateurs, sans parler d’Internet.Mais cela n’empêche pas d’explorer les ressources offertes par ces nouveaux médias.Il est évident que le transfert des fiches sur l’Internet réduirait de façon sensible les coûts d’actualisation de l’information. Cela ne pourratoutefois être fait que lorsque les procédures de révision des fiches actuelles et de production de nouvelles fiches auront été améliorées.Une suggestion intéressante consiste à s’inspirer de ce qui se fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée : une maquette de fiche est produite etdistribuée, avec les photos, mais sans les textes, fournis à part, afin qu’ils puissent être traduits dans différentes langues locales (on endénombre 770 pour la seule Papouasie-Nouvelle-Guinée). De cette façon, de nouvelles fiches peuvent être produites localement. La matièrepremière scientifique est valorisée et rentabilisée.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESPlant Protection Service, Secretariat for the Pacific Community (SPC), Private Mail Bag, Suva (Îles Fidji). Tél. (679) 370 733 ;fax (679) 370 021 ; e-mail pps@spc.int186
Liens entre la recherche et la vulgarisationTransmettre des informations scientifiques aux chercheursLa Revue africaine de recherche agricolePaul MundyNous nous frayons un chemin à travers la cour, croisons des groupes d’étudiants qui potassent leurs examens, montons les escaliers etpassons devant les laboratoires où des techniciens sont penchés sur leur microscope. Le petit bureau situé au deuxième étage dudépartement d’agriculture de l’université Makarere de Kampala déborde de dossiers et de papiers. Derrière une pile de manuscrits,Margaret Ssonko est installée devant un ordinateur, apportant des corrections à un document. Paul Nampala et Moses Osiru se grattent latête devant un autre manuscrit : mais qu’est-ce que l’auteur a-t-il voulu dire par là?Bienvenue au secrétariat de la revue africaine de recherche agricole. Margaret Ssonko et ses collègues travaillent dur sur le prochain numérode cette publication, une des rares revues scientifiques consacrées à l’agriculture en Afrique. Ils sont heureux de prendre quelques minutesde leur temps pour nous expliquer comment fonctionne le journal.Combler un videLa publication des travaux des chercheurs africains constitue un problème majeur. Les revues européennes et nord-américaines consacrentpeu d’espace à l’agriculture tropicale. Beaucoup de revues publiées en Afrique ne sont pas diffusées au-delà des frontières des pays ou desrégions où elles sont produites. Il n’y a donc pas de couverture globale du continent. En l’absence de supports appropriés, les travaux deschercheurs ne sont pas publiés et le travail acharné qu’ils consacrent à la recherche agricole au service du développement est gaspillé.La Revue africaine de recherche agricole cherche àcombler ce vide. Elle constitue une tribune pour lestravaux des chercheurs africains et des chercheursétrangers travaillant sur l’Afrique. Elle couvre tout lespectre de la recherche agricole, depuis l’agronomie et lagénétique jusqu’aux traitements après récolte et larecherche en matière de semences. La revue est publiéequatre fois par an. Chaque numéro (80 à 160 pages)comprend une douzaine d’articles.Margaret Ssonko prépare le dernier numéro de la Revue africainede recherche agricole(Photo : Paul Mundy)187
ENCADRÉ 17Pourquoi les revues scientifiques sont-elles importantes ?L’activité des chercheurs repose sur les revues scientifiques pour trois raisons principales. Premièrement, ellesconstituent le principal moyen pour consigner et communiquer les découvertes des autres chercheurs. Vous aveztrouvé une méthode pour lutter contre la mosaïque du manioc ? Vous avez découvert comment les paysans d’unezone aride parviennent à conserver l’eau ? Vous avez inventé une charrue améliorée ? Faites-en un article pourune revue scientifique et d’autres chercheurs pourront découvrir votre travail et exploiter vos découvertes.Deuxièmement, la revue contribue à la crédibilité des chercheurs. Un article qui décrit un protocole de recherchedoit fournir suffisamment d’informations pour permettre à d’autres chercheurs de reproduire l’expérience. Lerédacteur de la revue et les correcteurs vérifient attentivement chaque manuscrit pour s’assurer que laméthodologie est correcte, les résultats valides et que le texte ne contient pas d’erreurs. Cette vérificationrigoureuse garantit que les informations délivrées sont de la plus haute qualité.Les révolutions de l’informationTroisièmement, les revues sont aussi un système de valorisation pour les chercheurs. Hautement qualifiés maismal payés, travaillant avec des ressources limitées, isolés, les chercheurs doivent faire preuve d’une grandemotivation pour continuer à travailler avec enthousiasme. Un article publié dans une revue prestigieuse apporteaux chercheurs la réputation et la reconnaissance de leurs pairs dont ils ont besoin pour entretenir leurmotivation. De plus, le salaire et la promotion d’un chercheur sont souvent fonction du nombre et de la qualité desarticles publiés.Cela ne signifie pas que les revues sont « l’alpha et l’oméga » de la recherche agricole. Trop souvent, leschercheurs pensent qu’ils ont accompli leur tâche à partir du moment où les résultats de leurs recherchessont publiés dans les colonnes d’une revue. Mais il faut déployer beaucoup d’efforts pour atteindre l’étapesuivante : traduire le langage scientifique dans une forme qui peut être comprise par les vulgarisateurset les paysans. La section consacrée aux « ateliers d’ecriture » (voir pp. 177–182) décrit une approchede ce problème.La Revue africaine derecherche agricole est unmagazine de qualité préparéavec professionnalisme etdestiné à l’ensemble ducontinent africain(Photo : Paul Mundy)188
Liens entre la recherche et la vulgarisationQui écrit les articles pour la revue ? La plupart des auteurs sont basés en Afrique dans des universités, des institutions nationales derecherche et des centres internationaux de recherche comme l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA), établi au Nigeria etspécialisé dans le manioc et d’autres cultures, l’Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO) en Côted’Ivoire et le Conseil international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF), basé à Nairobi. Quelques auteurs travaillent hors d’Afriquemais possèdent des liens étroits avec le continent.Les articles provenant d’Afrique orientale sont les plus nombreux, peut-être parce que le secrétariat de la revue a été créé dans cette régionpour des raisons de facilité. La couverture des pays francophones d’Afrique est limitée bien que les articles en français soient acceptés aumême titre que les articles en anglais (et que tous les résumés soient publiés dans les deux langues).Des contrôles rigoureuxLa revue fait appel aux services d’un comité consultatif éditorial international, composé d’environ 40 chercheurs de haut niveau basés dansune vingtaine de pays, en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Chaque manuscrit est contrôlé par trois correcteursappartenant à ce comité ou à un groupe plus large de chercheurs répartis dans le monde entier. Les correcteurs peuvent rejeter un articleou proposer sa validation moyennant des corrections. Ils aident à maintenir l’objectivité et la conformité avec les pratiques des autres revuesscientifiques dans le monde. Les auteurs ne sont pas informés de l’identité des chercheurs qui ont corrigé leurs articles.Certains journaux tirent une certaine gloire du nombre d’articles qu’ils ont refusés : plus il y en a, plus la revue est prestigieuse, pensentils.Tel n’est pas l’état d’esprit à la Revue africaine de recherche agricole, où on ne perd pas de vue le fait que l’anglais ou le français nesont pas la langue maternelle des auteurs, mais leur deuxième, leur troisième, voire leur quatrième langue. Le comité éditorial consacredonc beaucoup d’efforts à les aider à améliorer le vocabulaire et la syntaxe des articles.Mais cela ne signifie pas que tous les articles proposés soient systématiquement publiés. Sur les 200 articles soumis à la revue chaque année,une cinquantaine sont rejetés en raison d’insuffisances techniques. Des données recueillies après une expérimentation portant sur uneseule saison ne sont pas pertinentes : des facteurs comme le climat ou la quantité d’insectes nuisibles peuvent varier d’une année à l’autre.Par ailleurs, l’accès limité des chercheurs aux sources d’information peut rendre leurs références dépassées. La revue renvoie ces articles àleurs auteurs en leur suggérant des solutions pour corriger ces imperfections.Attirer des lecteursCompte tenu de la haute qualité de la revue et de la variété des thèmes couverts, on pourrait s’attendre à ce qu’elle ait plus de 120 abonnés.Mais les budgets des bibliothèques pour acquérir des ouvrages sont en baisse, partout dans le monde, et très peu de chercheurs peuventse permettre de consacrer 80 $ de leurs propres ressources pour s’abonner à la revue. La revue réagit avec un effort de promotion pourattirer de nouveaux lecteurs : des exemplaires gratuits promotionnels sont envoyés ici et là (les pays francophones étant davantagesollicités) et des résumés d’articles sont diffusés par l’Internet. L’équipe de la revue génère des ressources en publiant des actes de189
Ces étudiants de la faculté d’agronomie del’université de Makerere représentent l’avenirde la recherche agricole en Afrique(Photo : Paul Mundy)Les révolutions de l’informationconférences et en proposant des services éditoriaux à des partenaires extérieurs. Le courrier électronique est de plus en plus utilisé à laplace des services postaux pour faire circuler les manuscrits et communiquer avec les auteurs et cela permet des économies substantielles.Les étudiants sont toujours très occupés dans la cour lorsque nous quittons les locaux de la revue. Pour obtenir leurs diplômes et contribuerau développement de leurs pays, ils doivent accéder aux travaux des chercheurs qui travaillent dans le domaine de l’agriculture. La Revueafricaine de recherche agricole y contribue.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESAdipala Ekwamu, Editor-in-Chief, African Crop Science Journal, Faculty of Agriculture and Forestry, Makarere University, PO Box 7062,Kampala (Ouganda). E-mail acss@starcom.co.ugTenywa, J.S., Adipala, E., Latigo, O.M., Joubert, G.D., Okuri, P. et Sseguya, H. (sous presse). African Crop Science Journal: A survival kitfor African scientists. African Crop Science JournalAfrican Crop Science Journal Internet www.bdt.org.br/bioline190
Des réseaux de recherche agricole : partager de maigres ressourcesTisser des liens entre les institutions : au service du PacifiqueUn réseau d’information agricole dans le Pacifique : collaborer pour aller de l’avantBâtir des réseaux d’information agricole dans les Caraïbes : relever des défis au paradisRéseaux de recherche
L’objectif d’un réseau, c’est d’échanger des informations et des ressources au bénéfice detous. C’est parfaitement adapté à la recherche, secteur où les ressources sont mincesmais où les avantages que procurent les échanges sont énormes.Les révolutions de l’informationLes institutions et les pays qui s’associent à un réseau peuvent résoudre leurs problèmesplus rapidement : mettre les compétences en commun allège le travail de chacun. Un payspeut exploiter les découvertes de la recherche des pays voisins : une nouvelle variété deriz ou une technique de lutte contre un parasite. Cela permet de réduire le volume globaldes investissements dans la recherche et crée des compétences globales sur lesquellesles pays les plus petits ou les plus pauvres peuvent s’appuyer.Un chercheur qui s’engage dans un réseau peut bénéficier de contacts formels etinformels avec des collègues lointains, trouver des occasions de collaboration sur desproblèmes communs, découvrir des occasions de voyager pour étudier ou présenter lesrésultats de ses propres recherches. Les partenaires de coopération apprécient lesréseaux car ils permettent de mieux valoriser les investissements qu’ils font dans lesecteur de la recherche.Il n’est donc pas étonnant de constater que les réseaux de recherche sont appréciés dansles pays en développement. Mais pour autant, leur mise sur pied et leur fonctionnementne sont pas toujours évidents : cela demande de la part de chaque membre unengagement fort et de la ténacité. Heureusement, le développement de l’informatique, dela messagerie électronique et de l’Internet offre de nouveaux outils de communicationpour mieux gérer et coordonner les réseaux.192
Réseaux de rechercheDes réseaux de recherche agricolePartager de maigres ressourcesPaul MundyLa plupart des pays en développement ont comme point commun leur dépendance vis-à-vis de l’agriculture. Un autre est la complexité desproblèmes que les producteurs ruraux ont à résoudre. Une véritable armée de maladies et de ravageurs prospèrent sous les climatstropicaux. Lorsque la sécheresse sévit et que les sols sont épuisés, peu de variétés végétales pourront augmenter leurs rendements ;l’élevage du bétail produit des résultats dérisoires en termes de lait et de viande. Sécheresses, inondations, érosion, déforestation etdésertification menacent la production agricole. La faiblesse des capitaux, de l’offre de crédits, des routes, des marchés n’incitent pas lesagriculteurs à investir dans leurs entreprises ni à commercialiser leurs productions.Cela signifie-t-il qu’il faille investir davantage dans la recherche agricole ? Oui, et d’autant plus que les études récentes ont montré quel’investissement dans la recherche produit des résultats spectaculaires, en termes de rendement donc d’augmentation de la production etdes revenus des producteurs.Mais cela ne signifie pas qu’il existe suffisamment de ressources financières à cette fin. La recherche agricole est une activité coûteuse qui,malheureusement, attire peu d’investisseurs dans la plupart des pays en développement. Les gouvernements ne peuvent pas (ou ne veulentpas) y consacrer leurs ressources.Mettre les ressources en communUne solution à ce problème consiste à mettre les ressources en commun. Malgré leurs différences, les pays des grandes régions présententde nombreuses similarités. Le groupe des pays du Sahel, de la Mauritanie au Tchad, cultivent les mêmes végétaux, élèvent les mêmes typesd’animaux, ont des écosystèmes comparables et sont affectés de la même façon par la sécheresse et la désertification. C’est également vraides pays d’Afrique orientale, australe, ainsi que pour les îles du Pacifique et des Caraïbes.Partager les ressources est particulièrement intéressant pour les petits pays insulaires des Caraïbes et du Pacifique. Un pays qui ne compteque quelques centaines de milliers d’habitants ne peut pas espérer disposer d’un institut de recherche totalement équipé avec deschercheurs de haut niveau ; mais en groupant leurs ressources, une douzaine de pays de ce type peuvent mettre en place une institutionde recherche de haut niveau.L’Institut pour la recherche, la vulgarisation et la formation en agriculture (IRETA) dans les Samoa est une institution au service de 12 paysdu Pacifique. Il a le statut d’un département de l’université du Pacifique Sud. Il organise des ateliers et des sessions de formation, conduitdes recherches, facilite les échanges d’informations et publie un bulletin, South Pacific Agricultural News (voir p. 200).193
Les révolutions de l’informationL’institution équivalente dans les Caraïbes anglophones est l’Institut caraïbe de recherches agricoles pour le développement (CARDI –Caribbean Agricultural Research and Development Institute). Situé à la Trinité, il a des correspondants dans les 13 pays associés à sesactivités. Il bénéficie de liens étroits avec une autre institution régionale, l’université des Indes Occidentales (the University of West Indies)et assure le secrétariat d’une autre organisation : le PROCICARIBE, un réseau de recherche agricole qui couvre pratiquement tous les payset territoires des Caraïbes (voir p. 213).Réseaux africainsParadoxalement, de nombreux pays africains doivent affronter les mêmes problèmes que les petitesnations des Caraïbes et du Pacifique. Bien que certains d’entre eux soient très étendus, leursinfrastructures de transport et de communication ont des difficultés à maîtriser les problèmes liésaux grandes distances à parcourir.Le bétail revêt une importance capitalepour l’économie sahélienne et occupeune place prépondérante dans lesactivités du CORAF(Photo : CORAF)La réponse africaine a consisté à créer des associations liant les institutions de recherche. Troisassociations de ce type couvrent le continent au sud du Sahara : l’association pour le renforcementde la recherche agricole en Afrique orientale et centrale (ASARECA – Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern andCentral Africa), basée en Ouganda, le conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF), basé auSénégal et couvrant 22 pays, le centre de coopération, de recherche et de formation pour l’agriculture et ressources naturelles en Afriqueaustrale (SACCAR – Southern African Center for Cooperation in Agricultural and Natural Resources Research and Training), basé auBotswana, au service des pays d’Afrique australe.Généralement, ces associations disposent d’un petit secrétariat basé au siège, chargé de coordonner le travail et de faciliter les échangesd’informations entre les pays. L’essentiel des travaux de recherche est mené dans les différents pays concernés à travers des réseaux dechercheurs. Ces réseaux associent les chercheurs (des institutions nationales de recherche, des universités ou des centres internationaux194
Réseaux de recherchede recherche) et des représentants d’organisationspaysannes et d’ONG. Le CORAF anime 11 réseaux de cetype : bananes et plantains, manioc, coton, lutte contre lasécheresse, forêts, ressources biogénétiques, arachide,horticulture, élevage, maïs et riz. Chaque réseaucoordonne le travail d’environ 200 chercheurs dans lesdifférentes institutions nationales de recherche.Les programmes de recherche peuvent être mis en œuvrepar des groupes d’institutions nationales, par desconsultants provenant d’organisations comme la GTZ oupar des centres internationaux de recherche. L’AVRDC(Asian Vegetable Research and Development Center) meten œuvre le programme de recherche du SACCAR sur lesvégétaux en Tanzanie, alors que l’IITA (Institutinternational d’agriculture tropicale) coordonne lestravaux des associations de recherche sur le manioc et lapatate douce au Malawi.Échanges d’informationsLes journées agricoles, comme celles organisées par le CORAF au Sénégal,permettent aux responsables et aux agriculteurs de s’informer sur les dernièrestechnologies agricoles(Photo : CORAF)Les mécanismes d’échange d’informations sont assurés pardes bulletins, comme l’Agriforum de l’ASARECA ou Coraf Action, des revues scientifiques comme le Zimbabwe Journal of AgriculturalResearch, soutenu par le SACCAR, des publications et des rapports.Depuis peu, des sites Internet ont fait leur apparition dans ce paysage. Le CORAF et le SACCAR ont les sites les plus complets, avec desinformations sur les associations, la consultation en ligne de leurs bulletins et les adresses des réseaux. Il est clair que les ressources del’Internet permettront d’aller beaucoup plus loin : listes de distribution aux membres des réseaux par courrier électronique, sites à accèslimité pour permettre l’analyse, l’exploitation et la publication de données réservées à des groupes de chercheurs, liens avec d’autres sitesintéressants, envoi de projets d’articles pour recueillir des commentaires avant leur publication, conférences électroniques pour débattredes grands problèmes. Le CORAF comme le SACCAR ont des projets pour développer ce type d’activités.L’échange est-il rentable ?Ces réseaux ne sont pas seulement destinés à coordonner les travaux des chercheurs. Ils couvrent également deux autres fonctionsessentielles : d’abord, ils permettent aux décideurs de débattre de problèmes communs et de partager leurs pratiques et leurs expériences ;195
196ENCADRÉ 18Couverture géographiqueLa plupart des pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique sont affiliés à au moins un des six réseaux régionaux de recherche.Régions Caraïbes Caraïbes Afrique orientale Afrique occidentale Afrique australe Pacifiqueet centraleet centraleInstitutions CARDI PROCICARIBE ASARECA CORAF SACCAR IRETAOrganismes Caribbean Ministères de Instituts nationaux Instituts nationaux Southern African University of theassociés Community (Caricom) l’agriculture des de recherche des de recherche des Development South Pacificpays membres pays membres pays membres Community (SADC)Siège St Augustine St Augustine Entebbe Dakar Gaborone Apia(Trinité et Tobago) (Trinité et Tobago) (Ouganda) (Sénégal) (Botswana) (Samoa)(CARDI)Nombre de 13 22 10 21 11 12pays membresPays Antigua et Barbuda Antigua et Barbuda Burundi Bénin Afrique du Sud Fidjimembres Barbades Bahamas Erythrée Burkina Faso Angola Íles CookBelize Barbades Ethiopie Cameroun Botswana Íles MarshallDominique Belize Kenya Cap Vert Lesotho Íles SolomonGrenade Cuba Madagascar Congo Malawi KiribatiGuyana Curaçao Rép. démocratique Côte d’Ivoire Maurice NauruÎles Vierges Dominique du Congo Gabon Mozambique NiueJamaïque Guyane française Rwanda Gambie Namibia TokelauMontserrat Grenade Soudan Ghana Swaziland TongaSt Christophe- Guadeloupe Tanzanie Guineé-Bissau Zambie Tuvaluet-Nevis Guyana Ouganda Guineé Zimbabwe VanuatuSt Lucie Haïti Mali SamoaSt Vincent et Îles Vierges Mauritanieles Grenadines Jamaique NigerTrinité et Tobago Martinique NigeriaMontserratRép. centrafricaineRép. dominicaineRép. démocratiqueSt Christophe-du Congoet-NevisSénégalSt LucieSierra LeoneSt Vincent etTchadles GrenadinesTogoSurinameTrinité et Tobago
Réseaux de rechercheensuite, ils peuvent fournir des conseils pour la réorganisation des systèmes de recherche, de gestion et de communication. Des expertsd’un pays donné peuvent demander une assistance à leurs collègues d’un autre pays, au-delà des barrières techniques et bureaucratiques.Les associations présentent aussi des avantages pour les bailleurs de fonds et les partenaires de coopération. Financer des recherchesidentiques dans des pays voisins est inefficace et coûteux. En mutualisant les ressources à travers des associations régionales de recherche,les bailleurs de fonds, les gouvernements et les institutions de recherche s’assurent que les savoirs et les moyens nécessaires pourront êtremis en œuvre pour résoudre les problèmes et que les résultats des recherches seront disponibles pour tous les membres. Les institutionspartenaires en matière de recherche (centres internationaux de recherche, agences des Nations unies, institutions de recherche dans lespays développés) trouvent également plus efficace de travailler avec des associations multinationales.Il ne faut pas croire pour autant que la coordination soit chose facile. Il est plutôt difficile de réunir des chercheurs dans un mêmelaboratoire pour les faire travailler ensemble, alors qu’ils se trouvent aux deux extrémités d’un continent ou de part et d’autre d’un océan.Les contraintes de priorités, de calendrier, les réticences à libérer des chercheurs surchargés ou à mobiliser de faibles ressources, desquerelles d’affectations de budgets, sont autant d’obstacles à surmonter. Quelques réseaux sont particulièrement efficaces et appréciés tantpar leurs membres que par l’extérieur. D’autres sont moins actifs.Malgré leurs limites, les associations de recherche représentent une voie d’avenir pour mieux exploiter des ressources limitées et les mettreau service de tous. Grâce à l’Internet, elles se renforcent et gagnent en efficacité et on peut miser sur un accroissement de leur potentieldans l’avenir.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESAssociation for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA), PO Box 765, Entebbe (Ouganda).Tél. (256) 42 20212, 42 20556/ 42 321389/ 42 321314 ; fax (256) 42 21126/ 42 21070 ; e-mail asareca@imul.comCaribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI), University of West Indies (UWI) Campus, St Augustine(Trinité et Tobago). Tél. (1 809) 645 1205 to 7 ; fax (1 809) 645 1208 ; e-mail infocentre@cardi.org ; Internet www.cardi.orgConférence des responsables de recherche agronomique africains (CORAF), BP 8237, Dakar-Yoff (Sénégal). Tél. (221) 825 9618 ;fax 825 5569 ; e-mail secoraf@telecomplus.sn ; Internet www.coraf.org197
Institute for Research, Extension and Training in Agriculture (IRETA), Alafua Campus, University of the South Pacific, Private Bag, Apia,(Samoa). Tél. (685) 21671 ; fax (685) 22933 ; e-mail uspireta@samoa.usp.ac.fjPROCICARIBE Secretariat, CARDI, UWI Campus, St Augustine, (Trinité et Tobago). Tél. (1 868) 645 1205 ; fax (1 868) 645 1208 ;e-mail procicaribe@cardi.org ;Internet www.procicaribe.orgSouthern African Centre for Cooperation in Agricultural and Natural Resources Research and Training (SACCAR), Private Bag 00108,Gaborone (Botswana). Tél. (267) 328847–8 ; fax (267) 328806 ; e-mail bndunguru@saccar.info.bw ; Internet www.ibis.bw~saccarLes révolutions de l’information198
Réseaux de rechercheTisser des liens entre les institutionsAu service du PacifiquePaul MundyLes pièces d’un puzzleUn système d’information agricole est comme un puzzle. Il se compose d’une grande quantité de pièces : institutions de recherche, agencesde vulgarisation, ministères de l’agriculture, ONG, organisations paysannes, universités, agences internationales de recherche, stations deradio…. Chacun de ces éléments joue un rôle particulier : conduire des recherches, produire des programmes radio et ainsi de suite. Pourque le tableau soit complet, chaque pièce doit se trouver à sa place et être reliée aux pièces voisines.Mais qu’est-ce qui maintient la cohérence d’ensemble du puzzle ? Comment les pièces sont-elles liées aux autres ? Comment un agent devulgarisation situé à un point précis est-il informé des résultats de recherches conduites ailleurs ? Comment le responsable d’un ministèrea-t-il accès à l’information mise en mémoire dans une base de données ou sur l’Internet ?Produire le ciment qui consolidera ces liens est le travail d’une petite équipe d’agents de liaison agricoles, les ALO (Agricultural liaisonofficers) répartis dans neuf pays du Pacifique Sud. Ces agents sont des fonctionnaires des ministères de l’agriculture de chaque pays et leurtravail consiste à être l’agent de liaison de l’Institut pour la recherche, la vulgarisation et la formation en agriculture (IRETA – Institute forResearch, Extension and Training in Agriculture) à l’université du Pacifique Sud, aux Samoa (voir encadré 19).Plusieurs casquettesLes ALO sont à eux seuls tout un service d’information. Vous voulez avoir de l’information sur les derniers résultats de la recherche sur larouille des feuilles de taro, une maladie qui affecte ce tubercule qui constitue la nourriture de base de presque tout le Pacifique ? Allez voirun ALO. Vous voulez participer à une session de formation proposée par l’unité de formation de l’IRETA à Alafua ? Demandez à votre ALO.Vous avez un projet de programme radio sur les récifs de corail ? Vous avez trouvé : c’est à l’ALO qu’il faut en parler.C’est le programme régional de développement agricole du Pacifique Sud de l’USAID, qui a mis en place le système des ALO en 1983. Lestâches des ALO étaient d’assurer la diffusion des nouvelles technologies agricoles mises au point par l’école d’agriculture de l’université duPacifique Sud. Ils ont rapidement joué un rôle de liaison entre l’école et l’IRETA d’une part, et les ministères nationaux de l’agricultured’autre part.Cette fonction s’est avérée très utile, si utile que lorsque le projet de l’USAID a pris fin après 10 ans, les ministères nationaux ont pris encharge les équipes et leur ont donné un statut permanent de fonctionnaires, chargés de l’information, de la vulgarisation et de l’animationd’émissions de radio ou de la formation.199
ENCADRÉ 19L’IRETALes révolutions de l’informationL’IRETA constitue un département de l’université du Pacifique Sud,une institution commune à 12 pays du Pacifique, des îles Salomonet du Vanuatu à l’ouest aux îles Cook à l’est, et des îles Marshallau nord au Tonga, au sud. Ses trois missions principales sont larecherche, la vulgarisation et la formation.RechercheL’IRETA conduit un programme de recherche agricole appliquéepour améliorer la production alimentaire et la productivité agricole.Ses principaux domaines de recherche couvrent la reproductiondes tubercules, la production de la soie, les agricultures d’atolls,l’agriculture polynésienne, l’utilisation des produits locaux pournourrir le cheptel, l’agroforesterie et les techniques post-récolte.VulgarisationLe programme de vulgarisation comprend le réseau ALO, les services des médias électroniques et la publication.Le service d’édition de documents imprimés dispose d’un équipement de publication assistée par ordinateur : ilproduit des manuels techniques, des livrets de vulgarisation et des brochures, le bulletin Les nouvelles del’agriculture dans le Sud Pacifique (South Pacific Agricultural News ), La revue agricole du Pacifique Sud (Journalof South Pacific Agriculture).FormationLe centre de formation de l’IRETA dispose d’une capacité d’accueil de sessions de formation non formelles decourte durée et d’ateliers. Ses équipements comprennent l’hébergement des participants, une salle de formation(un fale traditionnel samoan, d’une capacité de 50 personnes), des services de restauration et des bureaux.L’IRETA héberge également le bureau régional du CTA pour le Pacifique Sud.Un numéro du South Pacific Agricultural News,le bulletin de l’IRETALes ALO peuvent porter plusieurs casquettes et remplir les fonctions de documentalistes, d’agents d’information, de producteurs radio, derédacteurs du bulletin, de formateurs et de vulgarisateurs. Ils assurent la gestion des collections d’ouvrages d’information agricole et despublications. Ils collectent de l’information sur des CD-ROM et sur l’Internet. Ils conçoivent et réalisent des programmes de radio pour lesagriculteurs et rédigent des articles pour le bulletin de l’IRETA, Les nouvelles de l’agriculture dans le Pacifique Sud. Ils assurent laformation des vulgarisateurs et des agents gouvernementaux, et prodiguent des conseils sur les techniques culturales.200
Réseaux de rechercheDes hauts et des basIl y a eu des hauts et des bas, naturellement. Les financements extérieurs se sont réduits. Les ALO se réunissaient deux fois par an. Lapremière rencontre était consacrée à la formation et à l’actualisation des connaissances et se déroulait dans un pays différent à chaquesession pour que les ALO prennent connaissance des nouvelles idées et de la situation de l’agriculture. La deuxièmeréunion se tenait à Alafua et était consacrée aux questions administratives et financières. Désormais, il n’y a plusqu’une seule réunion par an et elle doit aborder à la fois les questions de formation et les problèmes administratifset financiers.Les changements intervenus dans les ministères nationaux ont également eu des répercussions sur les ALO. NooTokari, l’ALO des îles Cook, dit que l’équipe chargée de l’agriculture a été réduite de 100 à 26 personnes et que leservice de vulgarisation du ministère a été supprimé. Au Tonga, l’affectation de l’ALO Sione Hausia est passée deservice en service, perturbant la continuité de son travail et la production du bulletin que Sione produisait. Aux îlesSalomon, le seul poste occupé par le collègue de l’ALO Alfred Maesulia au ministère de l’agriculture a été aboli,laissant à Alfred l’ensemble de la charge de travail. Au Vanuatu, le poste d’ALO a été supprimé en 1999. Enfin, à Tuvalu,l’ALO Uatea Vave, comme les autres fonctionnaires de l’agriculture, a quitté la capitale Funafuti pour l’île isolée deVaiputu, où les difficultés de communication handicapent la qualité de son travail.Logo de l’université duPacifique SudUn avenir incertainLe réseau des ALO est actuellement l’objet d’un grand débat dans la région. Est-il efficace ? Remplit-il sa mission ? Des réformes importantesseraient sans doute nécessaires pour améliorer son fonctionnement. Pour cela, il est essentiel d’obtenir un soutien effectif desgouvernements nationaux. Un réseau ne peut fonctionner et rendre des services s’il ne dispose pas d’un tel soutien et si, dans le mêmetemps, il n’est pas capable de s’adapter au contexte dans lequel il s’inscrit.Le rôle des ALO est en train de changer, et pas seulement en raison des nouvelles technologies. Les ALO doivent acquérir de nouvellescompétences : mise en page assistée par ordinateur, messagerie électronique, navigation sur l’Internet, recherche d’informations surordinateur, etc. Les compétences existantes doivent par ailleurs être actualisées. La réunion annuelle de 1999 comprenait une formationpratique d’une semaine au cours de laquelle les ALO ont réalisé un programme vidéo, se sont entraînés à la rédaction et à la correction dedocuments de vulgarisation, se sont initiés à la mise en page des documents imprimés et à la recherche d’informations sur CD-ROM. Ils sesont également familiarisés à l’utilisation de la messagerie électronique et à la recherche d’informations sur l’Internet.Au fur et à mesure que les médias électroniques se développent (à travers des services comme l’USPnet, par exemple), d’autres évolutionsdu rôle des ALO sont prévisibles. Les ordinateurs et l’Internet deviennent des outils familiers et il sera bientôt facile, pour tout un chacun,d’accéder à l’information, au-delà des océans, sans avoir à passer par les ALO. Cela ne les éliminera pas mais conduira à une évolution deleurs activités : ils deviendront davantage des assistants que des intermédiaires pour accéder aux sources d’information.201
ENCADRÉ 20Un personnel polyvalentL’information et la communication sont des secteurs de plus en plus spécialisés. Un cadreur compétent n’aqu’une seule chose à faire : tourner des images vidéo. Il (ou elle) n’a pas à s’occuper d’écriture de scénario, demontage ou d’organisation de la production, sans parler de la construction de sites Internet ou de la réalisation deprogrammes radiophoniques. De la même façon, un bibliothécaire est un bibliothécaire : il (ou elle) n’est passupposé(e) rédiger un bulletin ou enseigner les techniques culturales à des paysans.Mais, dans les petites institutions, les lieux isolés et les petits pays, il n’y a pas assez de ressources pour payerde nombreux spécialistes. Les structures de communication ont bien souvent des moyens limités et des équipesréduites à une ou deux personnes.Les révolutions de l’informationUne solution à ce problème consiste à sous-traiter certains aspects qui peuvent nécessiter des équipementscoûteux à des organismes extérieurs, comme la production vidéo ou l’impression de documents écrits, parexemple. Cette solution est naturellement préconisée par les projets de développement de courte durée financéspar des partenaires extérieurs, qui bien souvent mobilisent des sommes importantes pour financer des servicesextérieurs, mais ne voient pas l’intérêt de bâtir une compétence technique interne pour les prendre en charge.Certaines institutions plus permanentes, comme les ministères de l’agriculture ou les agences de vulgarisation,doivent gérer avec précaution des budgets limités. Ils ont donc intérêt à disposer d’équipes de communicationtrès polyvalentes et capables de prendre en compte avec compétence toute une gamme de tâches.Cela signifie qu’il faut assurer leur formation en conséquence : production vidéo, mise en page de documents,recherche et gestion de l’information, informatique, etc. Cela signifie également qu’ils auront besoin del’assistance de spécialistes pour assurer leur formation, leur donner accès aux informations et les conseiller à lademande.Le système des ALO de l’IRETA est une référence dans ce domaine. Les ALO sont des généralistes : ils saventfaire un peu de tout. Mais ils devraient pouvoir faire appel à des équipes spécialisées comme celle du service desmédias électroniques de l’IRETA, par exemple. Et l’IRETA devrait être en mesure de leur offrir des formationsrégulières pour actualiser leurs compétences.Vidéo pour le PacifiqueLa vidéo est un média extrêmement efficace, s’il est exploité convenablement. Mais les institutions de recherche et de vulgarisation agricolequi souhaitent utiliser la vidéo ont un problème : les publics sont habitués aux programmes de télévision produits dans les pays développéset ils sont devenus très exigeants sur la qualité de l’image, de l’éclairage et du son.Ils exigent des mouvements de caméra irréprochables, des comédiens et des narrateurs professionnels, des montages habiles et beaucoupd’effets spéciaux. Comment une institution agricole peut-elle être compétitive dans ce domaine ? Une erreur courante consiste à acheterun équipement vidéo (caméras et banc de montage), de donner une formation minimale à l’équipe et, avec cela, d’espérer remporter desprix de réalisation. Bien trop souvent, certains « détails » sont ignorés :202
Réseaux de recherche• Combien cela coûtera-t-il ? Si l’on comptabilise les salaires, les transports, les équipements, la maintenance et les consommables, unsimple programme vidéo peut coûter des milliers d’euros.• Quels types de formation seront nécessaires ? Un équipement professionnel appelle une équipe professionnelle.• De quels types d’équipement a-t-on besoin ? Les stations de télévision sont exigeantes sur les formats vidéo qu’elles acceptent dediffuser.• Comment les vidéos seront-elles distribuées ? Il peut être nécessaire de payer les coûts de diffusion sur les antennes ou de mettre enplace un système de copie et de distribution de cassettes pour que les agriculteurs puissent visionner les programmes à l’occasion desessions de formation.Le résultat ? Des programmes de qualité médiocre ou simplement quelques images hésitantes de dignitaires visitant une station d’essais.De telles images ne peuvent pas être exploitées sur une antenne professionnelle (sauf peut-être dans le journal du soir) et ne présententaucun intérêt dans des programmes éducatifs.L’unité des médias électroniques de l’IRETAC’est évident, la production de vidéo de qualité professionnelle demande des investissements importants et une planification rigoureuse.C’est typiquement le genre de choses que l’on peut demander à une institution régionale comme l’IRETA. Il ne serait pas rentable de mettreen place une structure de production vidéo pour l’agriculture dans chaque pays du Pacifique : pour produire des programmes de la qualitévisée, ces structures auraient besoin d’équipements de prise de vue et de montage sophistiqués et de techniciens hautement spécialisés.Il se trouve que de nombreux programmes sont facilement « transposables ». Un programme sur les récifs de corail ou sur les maladies dubétail dans un pays du Pacifique peut probablement être utilisé tel quel ou moyennant une petite adaptation dans d’autres pays. Il seraitdonc plus sensé d’avoir une équipe centrale de production qui disposerait de tout le matériel nécessaire, qui pourrait mobiliser toutes lescompétences requises pour produire des programmes de premier ordre et envoyer des équipes mobiles ici et là pour tourner desséquences extérieures si nécessaire.L’unité des médias électroniques de l’IRETA présente ces caractéristiques. Elle peut apporter un appui aux activités de vulgarisation,d’éducation et de formation des ministères nationaux de l’agriculture dans le Pacifique, de même qu’à l’école d’agriculture de l’universitédu Pacifique Sud. Au-delà de la vidéo, l’unité dispose également d’équipements radio et peut assurer une diffusion par satellites.Services vidéoL’unité dispose d’excellents équipements qui peuvent produire des programmes de qualité professionnelle avec des effets spéciaux et desanimations graphiques. L’unité produit généralement des programmes éducatifs ou des programmes de formation de courte durée qui sont203
distribués à travers le réseau des ALO de l’IRETA dans les ministères nationaux de l’agriculture. L’unité actualise également les programmesvidéo existants, au fur et à mesure des nouvelles découvertes des chercheurs.Cette unité dispose d’un catalogue de plus de 400 titres sur l’agriculture, dont 80 produits localement. Ces vidéos sont prêtées aux payscouverts par l’IRETA. L’unité propose également d’autres prestations audiovisuelles, comme des systèmes de sonorisation ou de projectionpour les conférences, sessions de formation et expositions.Les révolutions de l’informationNouveaux équipements, nouveaux servicesL’équipement de l’unité de production radio a été récemment renouvelé. Les nouveaux équipements permettent désormais de produiredes programmes dignes de ce nom. En effet, pendant des années, cet aspect avait été négligé, en raison de contraintes budgétaires et demanque de personnels qualifiés.L’université du Pacifique Sud est en train de mettre en place un système de communications par satellites pour mettre en réseau sesdifférents sites dans les 12 pays concernés. Ce réseau propre à l’université, appelé USPnet, permettra de diffuser en direct des conférencesdonnées à partir des campus universitaires de Vanuatu, des Fidji et des Samoa, vers les centres USP des autres pays. Il permettra égalementd’organiser des vidéoconférences pour les responsables des universités et les chercheurs. Ce système offrira enfin des services detéléphone, fax et courrier électronique autonomes, indépendants des compagnies locales de télécommunication.Le réseau USPNet constituera un outil complémentaire qui facilitera la production des programmes vidéo de l’IRETA (à travers un meilleuraccès aux sources extérieures d’information) et leur diffusion. Il améliorera également la capacité de communication de l’IRETA avec lesALO et les autres partenaires extérieurs.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESInstitute for Research, Extension and Training in Agriculture (IRETA), Alafua Campus, University of the South Pacific, Private Bag,Apia (Samoa). Tél. (685) 21671 ; fax (685) 22933 ; e-mail uspireta@samoa.usp.ac.fj204
Réseaux de rechercheUn réseau d’information agricole dans le PacifiqueCollaborer pour aller de l’avantPeter WaltonÀ la fin des années 80, dans le Pacifique, plusieurs institutions et projets poursuivaient un même objectif : assurer le développement del’agriculture. Et toutes avaient en commun la même caractéristique : elles accordaient une place prépondérante aux activités et aux servicesd’information.Naturellement, cette situation a conduit à une certaine cacophonie car la plupart de ces institutions proposaient les mêmes services ou selançaient, chacune pour son propre compte, dans la production d’outils qu’elles auraient eu tout intérêt à réaliser ensemble.En 1987 et 1988, les directeurs de l’agriculture de la région se réunirent pour examiner la situation et décidèrent qu’il fallait y mettre unterme : les institutions concernées furent invitées à se rencontrer pour mettre à plat toutes leurs activités, chercher à établir des accords decollaboration et proposer la mise en œuvre de services communs dans le domaine de l’information.Cette réunion fut convoquée à la fin de 1988. Elle réunissait les deux principales institutions agricoles : l’université du Pacifique Sud (quicomprenait l’école d’agriculture et l’IRETA, l’Institut pour la recherche, la vulgarisation et la formation agricole) et la Commission duPacifique Sud (appelée à présent Secrétariat pour le Pacifique Sud). D’autres partenaires assistaient à cette réunion : l’université de Guam,le projet de développement agricole du pacifique américain (ADAP – Agricultural Development in the American Pacific Project) ainsi quedes participants provenant de Papouasie-Nouvelle-Guinée.La réunion décida la création du comité permanent des réseaux d’information agricole dans le Pacifique autrement dit SCAINIP (StandingCommittee on Agricultural Information Networking in the Pacific).Si vous cherchez un nom pour un nouveau réseau, pensez d’abord à l’impression que donnera l’acronyme ; sinon, il finira par faire penserau nom d’une maladie effrayante.Pourquoi le SCAINIP a-t-il été créé ?Comme cela avait été suggéré par les ministres, le SCAINIP a été institué pour collaborer et coopérer. Mais qu’est-ce que cela recouvre ? Estceque ça signifie que chacun retourne travailler de son côté, comme auparavant, mais qu’on se parle ? Ou cela implique-t-il deschangements plus fondamentaux ? La deuxième réponse est la bonne, bien sûr.« Collaborer » signifie travailler avec d’autres. « Coopérer » signifie travailler avec d’autres en partageant une approche conjointe, un objectifcommun. Cela signifie dépasser les rivalités existantes entre institutions et projets (qui sont plus courantes qu’on ne pourrait le penser) et205
ENCADRÉ 21L’index des revues agricoles du PacifiqueL’index des revues agricoles du Pacifique (PIAJ — the Pacific Index to Agricultural Journals), comprend plus de3 150 références à des articles qui ont été publiés dans 11 revues éditées dans le Pacifique, comme le FijiAgricultural Journal, publié depuis 1920 ou le Papua New Guinea Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries(depuis 1935), le Alafua Agricultural Bulletin et son successeur le Journal of South Pacific Agriculture (depuis 1976).Chaque référence propose une bibliographie complète et dans certains cas, les résumés originaux. L’indexations’accompagne de mots-clés et de descripteurs. Il y a quelques lacunes et pour certains titres, un ou deux numérosseulement ont été indexés jusqu’ici. Mais sans cet outil, les chercheurs en agriculture de cette région, déjà trèsisolés, le seraient encore davantage.Les révolutions de l’informationfonder son action sur les besoins des usagers et non pas sur les services que l’on est en mesure de rendre. Sur cette base il s’agissaitd’identifier quelle institution ou quel projet était le plus en mesure de répondre à chacun des besoins répertoriés. Cela signifie travaillerpour un objectif commun, avec une vision stratégique.Le démarrage n’a pas été facile. Tous les participants ont senti qu’avec cette démarche, ils avaient quelque chose à gagner et quelque choseà perdre. Chaque institution souhaitait être dans la position du pilote ; personne ne voulait être un passager anonyme. Mais après unesemaine, au cours de laquelle un état des lieux a été fait, sans masquer les renoncements que cela impliquait pour les uns ou les autres, despossibilités d’aménagements ont été explorées. Cette analyse a permis aux huit professionnels de l’information présents à l’atelier deproposer un schéma de fonctionnement pour une véritable collaboration entre les institutions et projets. Ce modèle de coopération arésisté à l’épreuve du temps.Qu’est-ce qui a été entrepris ?Au cours de la toute première réunion du SCAINIP, la décision fut prise de se consacrer à des tâches concrètes et utiles, seules garantes desuccès. La première priorité était de disposer d’une meilleure maîtrise bibliographique des documents relatifs à l’agriculture dans la régionPacifique. Il s’agissait, en fait, de savoir quels documents étaient disponibles, s’ils avaient été publiés, ou s’ils étaient demeurés sous formede « littérature grise » (comme les comptes rendus de séminaires ou les rapports de recherche), où ils pouvaient être trouvés et commenten obtenir une copie. C’est ça, la maîtrise bibliographique.Il fut également décidé de concentrer les premiers efforts sur les documents consacrés au Pacifique et en particulier d’indexer toutes lesrevues agricoles publiées dans la région. Cela semble une tâche immense, mais seulement huit titres furent initialement identifiés (voirencadré 21). Certains d’entre eux existaient depuis 1920 !Cette priorité se justifiait par le fait qu’il n’existait aucune indexation des articles de ces journaux. Cela signifiait qu’un chercheur dans unpays donné pouvait entreprendre une recherche longue et coûteuse, alors qu’elle avait déjà été conduite dans un autre pays et même faitl’objet d’une publication. Et tout cela, parce que le chercheur ne disposait d’aucun moyen de connaître l’existence de cet article.Ces revues traitaient exclusivement des problèmes du Pacifique ; elles étaient donc particulièrement utiles pour les chercheurs de la région,qui étaient vraiment lassés de devoir systématiquement passer en revue tous les numéros d’une publication, dans l’espoir de trouver unarticle sur le thème qui les intéressaient.206
Réseaux de rechercheConscient que ce travail serait trop lourd pour une seule personne, le groupe du SCAINIP désigna un responsable du chantier (en fait, uneinstitution) et répartit les revues entre les différents membres. Cette répartition se fit en faisant preuve de bon sens. Par exemple, uneinstitution qui publiait un journal avait naturellement la responsabilité de son indexation.Normes et compromisPour accomplir cette tâche commune, le groupe dut s’accorder sur des normes. Quel logiciel utiliser (à l’époque, les données ne pouvaientpas encore être facilement transférées d’un système à un autre ou d’un ordinateur à l’autre) ? Comment saisir les données : mettre lesprénoms en entier ou seulement les initiales ? Majuscules ou minuscules pour les titres ? Et, plus important encore, quel thésaurus de motsclésexploiter ?Ces questions pouvaient paraître mineures pour les responsables institutionnels mais pour les documentalistes et les usagers desbibliothèques, elles étaient essentielles. Imaginez ce qui se produirait si deux personnes, séparément, indexaient une série de documentsen utilisant des normes différentes. L’une d’entre elles classera un article sur le manioc (une importante culture dans plusieurs régions duPacifique) sous la rubrique « manioc », l’autre utilisera le nom « cassava ». Lorsque les résultats de ce travail seront mis en commun pourconstituer un index unique, un chercheur utilisant le mot clé « cassava » n’aura évidemment pas accès à tous les articles répertoriés sous lemot « manioc ».Ceci montre qu’appartenir à un réseau est aussi efficace que se réunir régulièrement. Une fois que des normes communes ont été établies,le travail peut facilement démarrer, même si la réalisation finale n’est pas toujours évidente.FormationL’autre secteur que tout le monde s’est accordé à trouver prioritaire, c’est la formation de professionnels de l’information. En fait, il étaitdifficile, à cette époque, de trouver des professionnels déjà formés. La plupart des agents qui travaillaient dans les bibliothèques agricoles,par exemple, étaient des étudiants de terminale. Il s’agit pourtant d’un métier qui requiert de nombreuses compétences et qui joue un rôleessentiel pour les chercheurs et les autres utilisateurs de l’information. Sans un bibliothécaire compétent, une bibliothèque est tout justeune collection de livres gardés par quelqu’un qui se pare du titre de « bibliothécaire ».En 1991, une série d’ateliers de formation furent organisés, avec un soutien financier du CTA. Quelques-uns avaient un caractère régionalmais la plupart étaient nationaux, ce qui leur permettait de mieux aborder les spécificités locales. Des documents de formation adaptés àla région ont été réalisés pour le premier atelier. Ils ont ensuite été exploités pendant tous les ateliers suivants, ce qui a permis une certaineharmonisation dans l’approche des questions d’accès à l’information agricole et de gestion des ressources dans ce domaine.Trois autres réunions régionales ont été organisées par le SCAINIP (en 1990, 1993 et 1996). Chacune d’entre elles a consolidé le dispositifet les efforts communs pour traiter les problèmes. De nouveaux chantiers ont été mis en route : une banque de données des recherches207
agricoles dans le Pacifique (Pacific CARIS), un répertoire des centres d’information agricole dans le Pacifique (publié en 1996) et un indexdes rapports annuels de recherche (toujours à l’état de projet). D’autres ateliers de formation ont également été réalisés.Le SCAINIP est-il une réussite ?Selon les critères de jugement qu’on utilise, on ne peut toujours affirmer que le SCAINIP soit une réussite… ou qu’il a échoué dans sonaction.Les révolutions de l’informationSi on se base sur les résultats obtenus (nombre de personnes formées, bases de données réalisées et mises à la disposition desutilisateurs…), on peut dire que le SCAINIP est une réussite. Pendant les 10 dernières années, 80 à 120 personnes ont été formées. L’indexdes revues agricoles (et d’autres bases de données de projets ou d’institutions) a été diffusé sur une trentaine de sites.Mais si le succès est mesuré en termes d’impact (personnes capables de rentabiliser la formation qu’ils ont reçue, bases de donnéesréellement utilisées pour améliorer la recherche et le développement rural), alors on peut conclure que le SCAINIP n’a pas atteint son but.Et ceci nous conduit au cœur de la question.Le SCAINIP a été mis en place sur recommandation des directeurs de l’agriculture. Des rapports ont ensuite été régulièrement soumis auxmêmes directeurs, à l’occasion de leurs réunions annuelles ou semestrielles. Mais, au-delà de cet aspect institutionnel, le SCAINIP étaitsurtout un groupe d’individus, provenant de toutes sortes d’institutions, avec leurs forces et leurs faiblesses, qui ont essayé de partager lamême approche et de se donner des objectifs communs. Le réseau en tant que tel n’a jamais été créé de façon formelle.Toutes les tentatives pour le formaliser ont rencontré les mêmes difficultés que celles qui sont apparues lors de sa création et que l’on peutattribuer aux « barrières institutionnelles ». Lorsqu’il s’est appuyé sur l’enthousiasme d’individus qui avaient choisi de partager leurscompétences et leurs moyens pour un objectif commun, le SCAINIP a bien fonctionné, comme une « proto-organisation de base ».Malheureusement, la plupart de ces individus ont aujourd’hui changé d’affectation.Quel avenir ?Le SCAINIP semble désormais dépassé et pourtant ce ne devrait pas être le cas. D’une façon ou d’une autre, un nouveau réseau devraitémerger, centré sur un meilleur accès aux nouvelles technologies de communication. Après tout, la réunion mensuelle du SCAINIP,organisée en mobilisant les ressources du système de communication par satellite « PEACESAT » de l’université de Hawaii, a parfaitementfonctionné. Nul doute que le nouveau réseau USPNet permettra d’aller plus loin (voir p. 204).Les problèmes rencontrés dans les années 80 sont toujours là : il y a toujours un besoin de formation de bibliothécaires et de professionnelsde l’information ; il y a toujours besoin de mettre en commun les outils d’information et de partager les sources d’information. Et surtout,la nécessité d’une collaboration entre les agences et les institutions est toujours présente. Un bon travail a déjà été fait. Mais il reste encorebeaucoup à faire.208
Réseaux de rechercheINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESInformations complémentaires sur les activités, les outils et les produits du SCAINIPDirector, Agricultural Development in the American Pacific (ADAP) Project, University of Hawaii at Manoa, 3050 Maile Way,Gilmore Hall 213, Honolulu, Hawaii 96022 (États-Unis). Tél. (1 808) 956 8140 ; fax (1 808) 956 6967 ; e-mail adap@hawaii.eduInformation Officer, Institute for Research, Extension and Training in Agriculture (IRETA), USP Alafua Campus, Private Bag, Apia (Samoa).Tél. (685) 21671 ; fax (685) 22933 ; e-mail uspireta@samoa.usp.ac.fjLibrarian, Secretariat for the Pacific Community (SPC), Private Mail Bag, Suva (Îles Fidji). Tél. (679) 370 733 ; fax (679) 370 021 ;e-mail library@spc.intInformations complémentaires sur le développement du SCAINIPPeter Walton, PO Box 16967, Suva (Îles Fidji). Tél./fax (679) 322 443 ; e-mail pwalton@is.com.fj209
Réseaux de rechercheBâtir des réseaux d’information agricole dans les CaraïbesRelever des défis au paradisPaul MundyLes Caraïbes. Ce nom évoque l’image de centaines d’îles baignées de soleil, avec leurs plages idylliques, leur musique entraînante, leurscocotiers et leur rhum. Mais ce que les touristes voient du pont de leur bateau n’est qu’une petite partie de la réalité. Derrière le rideau decocotiers, les Caraïbes sont aussi le pays de la pauvreté, de la destruction de l’environnement, de la sous-production agricole et desmonocultures aliénantes.Il s’agit pourtant d’une des régions les plus diversifiées et les plus intéressantes de la planète. Depuis l’arrivée des premiers Européens, il ya cinq siècles, les marées de l’histoire ont laissé leur marque ici : des vagues d’immigrants européens, africains, indiens et indonésiens ontproduit une fascinante combinaison ethnique. Quatre langues européennes (l’anglais, le français, l’espagnol et le néerlandais) ont donnénaissance à de nombreux dialectes créoles. Les îles et le continent voisin sont maintenant devenus des pays indépendants (plus d’unedouzaine) ou sont encore, pour certains, des territoires sous souveraineté extérieure.Les pays continentaux (Belize, Guyane française, Guyana, Suriname) sont étendus mais faiblement peuplés. Il y a quelques grandes îles :Cuba, Hispaniola (séparée en deux pays, Haïti et la république dominicaine) mais la plupart sont minuscules. Certaines îles sont plates,d’autres sont montagneuses, avec des champs qui s’accrochent aux flancs des collines. Des ouragans balaient les îles (sauf pendant la saisontouristique, bien entendu). Les paysans exploitent des centaines de cultures différentes, dont la canne à sucre, les bananes et le tabac quidemeurent des cultures d’exportation vitales.Pour la recherche agricole et les services d’information, le défi, c’est de parvenir à maintenir un lien entre toutes ces activités et tous cespays et d’informer régulièrement les paysans des résultats de la recherche. La plupart des pays de la région sont trop petits pour entretenirdes instituts de recherche ou des universités totalement équipés et sont donc incapables de couvrir la profusion de variétés végétales ouanimales, de maladies et de parasites existants.Ensemble, nous y arriveronsÀ l’instar du Pacifique (voir p. 199) et de la plus grande partie de l’Afrique (voir p. 193), la solution, ici, réside aussi dans le partage desressources. Les gouvernements des pays anglophones des Caraïbes l’avaient déjà compris lorsqu’ils ont créé, il y a 70 ans, ce qui estaujourd’hui devenu le Centre régional de recherche à l’université des Indes Occidentales. Ils ont confirmé cette volonté en transformant cecentre, en 1975, en Institut caraïbe de recherche agricole et de développement (CARDI – Caribbean Agricultural Research and DevelopmentInstitute).211
Le CARDI disposait de fondations solides car le centre régional de recherche avait fait un excellenttravail de recherche sur les cultures vivrières traditionnelles, comme le pois cajan, les tubercules et leslégumes et il était réputé pour la qualité de ses cartes de sols. Bien qu’il soit aujourd’hui uneinstitution autonome, le CARDI est toujours installé à l’université des Indes Occidentales, à StAugustine (Trinité et Tobago). Il a hérité des équipements du centre et d’une équipe de 25professionnels dont la plupart sont installés à Trinité et Tobago, alors que cinq autres sont en poste àla Jamaïque et un à la Barbade.Les révolutions de l’informationUn des premiers objectifs a été de se décentraliser pour mieux servir les usagers, les agriculteurs desdifférents pays. En 1981, une équipe scientifique avait été installée dans chacun des 12 pays concernéset le nombre de professionnels était passé à 57.En 25 années d’existence, le CARDI a dû faire face à une série de défis. Il s’agissait, entre autres, deparvenir à coordonner et à gérer une équipe de chercheurs éparpillés dans une douzaine de pays,d’améliorer les services rendus aux agriculteurs, de trouver les fonds nécessaires à la recherche et, en même temps, de poursuivre une sériede programmes de recherche qui apportent des réponses concrètes aux problèmes des producteurs ruraux.Priorité aux producteursL’organisation et la gestion du CARDI ont connu des modifications périodiques. Un virage important a été pris en 1987, lorsque le servicede formation et de conseil pour le développement agricole et rural des Caraïbes (Caribbean Agricultural Rural Development and AdvisoryTraining Service) a été intégré dans le CARDI. Ce service avait été créé en 1978 pour aider à résoudre quelques-uns des problèmeschroniques des petits exploitants agricoles dans la zone est des Caraïbes. Il s’était notamment donné comme objectif d’aider ces petitsfermiers, qui pratiquaient une agriculture de subsistance, à créer de véritables exploitations agricoles.Au lieu de cibler une zone géographique spécifique, le programme d’adaptation et de transfert du CARDI s’est concentré sur l’améliorationde cultures spécifiques. Des groupes de travail constitués par des chercheurs, des vulgarisateurs, des producteurs, des organismes de créditou de commercialisation et des consommateurs ont été mis en place pour garantir une production quantitativement et qualitativementfiable. Un de ces groupes de travail a permis d’organiser les agriculteurs de Niévès pour la production de fruits et de légumes destinés à unhôtel cinq étoiles. Une autre équipe a aidé les producteurs de Saint-Vincent à exporter des tubercules et du gingembre au Royaume-Uni.Tous ces groupes tiraient leur efficacité de leur capacité à maîtriser tous les stades de la production (plantation, récolte, commercialisation)pour satisfaire des demandes spécifiques.Le CARDI maintient le cap sur cette approche. Contrairement à de nombreux instituts de recherche à travers le monde, qui se focalisentsur les aspects scientifiques de leurs activités et ont tendance à oublier leurs « clients », le CARDI met l’accent sur les aspects commerciauxde l’agriculture et aide les agriculteurs à trouver des réponses adaptées pour vendre au mieux leurs productions dans un environnementéconomique en mutation rapide.212
Réseaux de rechercheS’ouvrir vers l’extérieurUn autre changement important, lié au précédent, concerne la planification et la gestion de la recherche. À la fin des années 80, un systèmede gestion des programmes a été mis au point pour permettre au CARDI d’améliorer la conduite de ses activités. Ce système associaitdavantage les partenaires du CARDI (vulgarisateurs,producteurs et organisations paysannes) dans laplanification de la recherche. Les chercheurs prirent alorsconscience du fait qu’une recherche ne pouvait êtreconsidérée comme achevée que lorsque ses résultatsétaient effectivement adoptés par les producteurs. Ils ontdonc commencé à travailler sur des programmes ouverts,associant les agriculteurs et leurs organisations ainsi que lesministères de l’agriculture. Ces efforts ont permis decombler le vide existant entre la recherche et lavulgarisation et de s’assurer que les programmes derecherche du CARDI étaient en conformité avec lespolitiques et les stratégies des ministères.ENCADRÉ 22Les champs de compétence du CARDI• Développement des activités commerciales et consultation• Production végétale, gestion intégrée des parasites et systèmesd’exploitation agricole• Gestion des sols et des ressources naturelles• Élevage et forages• Recherche sur les marchés et services de statistiques• Développement de projets• Services technologiquesL’environnement politique et économique continue à évoluer rapidement. Avec l’institution de l’OMC, la libéralisation des échangescommerciaux devient un phénomène mondial. Dans ce contexte, les principaux produits d’exportation des Caraïbes visent de façonprioritaire les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe. Cela appelle des changements profonds dans les agricultures des pays producteurset, par conséquent, dans les types de recherche que le CARDI conduit.Les liens entre le CARDI et le CTA permettent d’améliorer la diffusion, l’échange et l’exploitation de l’information agricole dans les Caraïbes.Depuis 1988, le CARDI héberge le bureau régional du CTA. Le CARDI collecte et diffuse l’information sur la recherche agricole et ledéveloppement dans les Caraïbes. Le CTA et le CARDI organisent ensemble des séminaires, des conférences et des ateliers qui apportentune contribution précieuse au développement de l’agriculture dans la région.Le réseau de recherche PROCICARIBELe CARDI est une organisation relativement petite :elle compte actuellement environ 30 spécialistes dedifférentes disciplines scientifiques, dispersés dansplusieurs pays. Pour atteindre la « masse critique »nécessaire pour être efficace, le CARDI doitcollaborer avec d’autres organisations.213
Le PROCICARIBE, système caraïbe de sciences et de technologies agricoles (Agricultural Science and Technology System of the Caribbean),est un bon exemple de cette collaboration. Le PROCICARIBE est un « réseau de réseaux », comme le CORAF, l’ASARECA et le SACCAR enAfrique (see p. 193). Cette organisation est soutenue conjointement par le CARDI et l’IICA (Institut interaméricain de coopération agricole)et elle couvre pratiquement tous les pays et territoires des Caraïbes, et pas seulement les pays anglophones, comme le CARDI. Cependant,le CARDI est l’agence d’exécution du PROCICARIBE et héberge les trois personnes qui gèrent son secrétariat.Les révolutions de l’informationQue fait le PROCICARIBE ? Il facilite le fonctionnement et la mise en relation de différents réseaux consacrés chacun à un produit ou à unsujet. Par exemple, le CARIFruit est consacré, comme son nom l’indique, aux fruits, alors que le CIPMNet s’occupe de gestion intégrée desparasites (un mode de lutte contre les parasites qui évite un usage abusif des produits chimiques).Il y a d’autres réseaux pour le riz, les bananes et les plantains, les ressources phytogénétiques et la biosystématique (description etclassification des espèces animales et végétales). De nouveaux réseaux, pour les ressources naturelles, les moutons et les chèvres, sont encours de constitution. Chaque réseau permet de tisser des liens entre les gouvernements, les chercheurs, les vulgarisateurs et les institutionsprivées pour affronter les problèmes avec le souci de l’intérêt collectif.Gérer tout cela s’avère quelquefois assez complexe. Dans chaque pays, des comités de suivi ont été constitués pour coordonner le travailau niveau de chaque réseau (fruits, riz…). Un coordonnateur régional s’assure que l’information circule bien entre les membres desgroupes nationaux dans chacun des domaines considérés. De plus, chaque pays compte un comité national de coordination, dont leprésident est membre de droit du comité exécutif du PROCICARIBE.Bulletins de liaison et tableaux d’affichage électroniquesCette complexité appelle une communication fluide si l’on veut que l’ensemble du dispositif fonctionne. Un des outils principaux pour celaest le bulletin du PROCICARIBE, que l’on peut également consulter sur l’Internet (www.procicaribe.org/news). Ce bulletin propose desdébats sur les enjeux politiques (le numéro de juin 1999, par exemple, abordait les effets de la réglementation de l’OMC sur la productionbananière des Caraïbes), des annonces, des articles sur les facteurs qui handicapent la recherche, des nouvelles des ateliers et séminaireset des sujets provenant des différents réseaux.Et pourquoi ne pas utiliser l’Internet pour communiquer ? Cela semble en effet le moyen idéal, et en fait, dans chaque réseau, de nombreuxchercheurs et responsables publics ont leur propre adresse électronique. Le secrétariat du PROCICARIBE a mis au point des « tableauxd’affichage électroniques » disponibles sur l’Internet, pour chaque réseau. Mais ils restent sous-utilisés. Plusieurs raisons peuvent êtreavancées pour l’expliquer : leur création est peut-être encore trop récente ? Peut-être que leurs membres n’ont pas encore beaucoupd’informations à échanger, compte tenu de cette jeunesse ? Peut-être sont-ils trop occupés par leurs propres travaux et n’ont-ils pas eu letemps de découvrir toutes les fonctionnalités du réseau ? Peut-être manquent-ils de familiarité avec les nouvelles technologies et desformations (ou des actions de promotion) sont-elles nécessaires ? Ou, enfin, ces tableaux d’affichage n’ont peut-être pas de raison d’êtrecar le courrier électronique et les rencontres régulières entre les chercheurs sont suffisants pour gérer les échanges d’informations ?214
Réseaux de rechercheQuelles que soient les explications, seule la durée permettra de savoir si ces réseaux vont vraiment fonctionner. Certains d’entre eux vontprobablement décoller vite, sous l’impulsion de quelques personnes énergiques ou poussées par des besoins de collaboration pressants.D’autres dépériront et disparaîtront pour faire place, peut-être, à des groupes plus solides.Une force et une faiblesseL’envergure du PROCICARIBE constitue à la fois sa force et sa faiblesse. La force réside dans la participation simultanée de représentantsdes gouvernements, des organismes de recherche et du secteur privé. Un autre atout important est qu’il établit un lien entre les troisprincipaux groupes linguistiques des Caraïbes : anglophones, francophones et hispanophones. Enfin, le but même de PROCICARIBEconstitue un atout car il attire les partenaires extérieurs et les institutions internationales de recherche qui le considèrent comme un espaced’investissement : leurs dollars, francs, livres ou florins y sont judicieusement utilisés.Mais, en même temps, la coordination de groupes si importants et si diversifiés est lourde et difficile. Le bulletin de liaison du PROCICARIBE,par exemple, est édité uniquement en anglais. Par ailleurs, il est difficile pour des coordonnateurs nationaux employés à temps partiel detrouver le temps nécessaire pour gérer efficacement le fonctionnement des réseaux.Le cas du CAISLe service d’information agricole des Caraïbes (CAIS – Caribbean Agricultural Information Service) est une initiativenouvelle qui se développe de façon autonome au sein du CARDI, bien qu’elle ait un rapport étroit avec les autres secteurs.De la même façon que le PROCICARIBE coordonne les réseaux de recherche, le CAIS prend en charge les aspectsd’information : il met à la disposition des chercheurs (et de beaucoup d’autres intervenants) les informations les plusrécentes sur les techniques agricoles, le marketing et d’autres sujets utiles pour l’amélioration de la productivité del’agriculture.Comme le PROCICARIBE, le CAIS est encore une institution balbutiante. Le service a l’ambition de tisser des liens entreles institutions agricoles des divers pays afin de permettre aux usagers d’avoir un meilleur accès à l’information utile, sousdifférentes formes : un service d’information, un dispositif de questions/réponses, des publications de vulgarisation et des fiches desynthèse, de la formation, des services spécialisés sur l’état des marchés, des études sur les tendances, des programmes vidéo et desémissions de radio. Certains de ces éléments seront produits par le CAIS lui-même ; d’autres exploiteront les documents ou lescompétences spécifiques existants chez différents membres du réseau et utiliseront le canal du CAIS pour les mettre à la disposition detous. Une part importante de cette information sera disponible via l’Internet.Le CAIS atteindra-t-il ces objectifs ? Cela dépend de deux facteurs : l’utilité réelle des services proposés et l’engagement des membres desdifférents réseaux et des partenaires de coopération pour un fonctionnement efficace. Le CAIS fait preuve d’une prudence justifiée en215
mettant en place des projets pilotes afin de tester différentes approches avant de lancer de grandes initiatives à l’échelle régionale. Cetteprécaution permettra d’aplanir les difficultés et d’abandonner les fausses pistes avant qu’elles n’engloutissent les ressources existantes.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESLes révolutions de l’informationClaudette de Freitas, CARDI Headquarters, University Campus, St Augustine (Trinité et Tobago). Tél. (1 868) 645 1205–7/645 3573/645 8120–1 ; fax (1 868) 645 1208 ; e-mail ic@cardi.org ; Internet www.cardi.orgCAIS Internet www.caisnet.orgPROCICARIBE Internet www.procicaribe.org216
Des bibliothèques pour les chercheurs : travailler à l’aveugletteL’information pour le développement au service des usagers : le Centre de ressources de l’ITDGBibliothèques
Entrez dans une bibliothèque typique dans un pays en développement et vous allez vouslamenter. Des piles de livres, des liasses de papiers poussiéreuses et rongées par lestermites, des armoires fermées (où sont passées les clés ?) où les livres les plus utilessont mis à l’abri. Un catalogue ? Vous plaisantez ?Les révolutions de l’informationC’est une véritable tragédie pour tous ceux qui ont besoin des bibliothèques et en seraientdes usagers réguliers si elles étaient convenablement financées et entretenues. C’estparticulièrement vrai pour les chercheurs et les acteurs du développement qui ont besoind’informations (relativement) actualisées pour mettre au point et diffuser de nouvellestechnologies.Heureusement, les technologies numériques arrivent à la rescousse. Avec l’Internet et lesCD-ROM, il devient de moins en moins indispensable de disposer physiquement d’un livresur les étagères d’une bibliothèque. À l’inverse, en quelques secondes, on peut en trouverla version électronique et en quelques minutes on peut imprimer les éléments qui nousintéressent.Les outils et les compétences requis par les bibliothécaires (qui apprécient qu’on lesappelle plutôt des « spécialistes de l’information ») sont en train de changer. Ordinateurs,bases de données, Internet sont désormais monnaie courante mais cela implique desfinancements, de la formation et la disponibilité de services comme la connexion àl’Internet, par exemple.Les compétences traditionnelles des bibliothécaires restent toutefois indispensables :acquérir les bons ouvrages, cataloguer et ranger sont toujours des services dont lesusagers ont besoin. Comme pour de nombreux autres aspects de la révolution numérique,les modalités de travail changent mais le but reste le même : répondre aux besoins desusagers.218
Paul MundyBibliothèquesDes bibliothèques pour les chercheursTravailler à l’aveugletteUn chercheur sans bibliothèque est un chercheur qui travaille à l’aveuglette. Privés des revues qui font état des dernières découvertes, deslivres qui décrivent les techniques les plus récentes, les chercheurs doivent réinventer la roue tous les jours en menant des expériences quiont déjà été réalisées par d’autres. C’est l’équivalent scientifique d’une condamnation à la relégation.Comme pour toute prison, la punition a un coût élevé et pas seulement pour le prisonnier. Toute la société doit également contribuer à cecoût : un chercheur isolé travaille plus lentement et avec moins d’efficacité qu’un chercheur qui a accès à l’information. Les progrèsscientifiques sont lents. Les investissements qu’il a fallu faire en termes d’éducation, de formation, d’équipements et de constructioninstitutionnelle sont gaspillés.Mais bâtir une bibliothèque de référence coûte cher. Il faut s’abonner à desdouzaines de revues, acheter des centaines d’ouvrages pour couvrir unediscipline comme la biologie maritime ou la sélection des végétaux. Si vouscomptabilisez toutes les disciplines que l’on trouve habituellement dans uncentre de recherche, un ministère ou une université, il faudrait consacrer descentaines de milliers d’euros à la seule littérature scientifique.Autre paradoxe : comme l’information scientifique est très spécialisée, denombreux ouvrages d’une bibliothèque et de nombreux articles d’une revueseront utiles à une quantité infime de chercheurs. La bibliothèque d’un institut derecherche devra s’abonner à une revue très chère en espérant qu’elle contiendraun article qui pourra éventuellement intéresser un chercheur ou un étudiant.Des prêts entre bibliothèquesLes méthodes utilisées par les bibliothèques pour surmonter ces difficultéss’appuient sur le principe des prêts mutuels. Lorsque l’usager d’une bibliothèquene trouve pas l’ouvrage qu’il cherche, il demande à la bibliothécaire del’emprunter ailleurs. La bibliothécaire consulte une base de données pouridentifier le livre convoité et envoie une demande de prêt à la bibliothèque qui lepossède. Quelques semaines plus tard, le livre arrive par la poste.L’absence de bibliothèques dignes de ce nom constitue laprincipale entrave à la recherche agricole. Sur cette photo,un bibliothécaire remet de l’ordre dans les rayonnages de labibliothèque du Forestry Research Institute en Ouganda(Photo : Paul Mundy)219
Mais les prêts entre les bibliothèques ont leurs limites. L’emprunteur virtuel peut quelquefois attendre des mois que le livre soit rendu à labibliothèque par un usager qui l’a déjà emprunté. Les délais postaux vont ajouter une ou deux semaines à ce temps d’attente. Les coûtsd’expédition à travers le monde sont élevés. Il arrive que les livres soient endommagés ou perdus pendant le transport.Internet : la solution ?Les révolutions de l’informationInternet semble être la solution évidente. Il devrait être possible de chercher un livre et de télécharger l’information dont on a besoin justeavec quelques clics de souris, n’est-ce pas ?C’est possible pour certains types d’informations : des bases de données spécialisées comme celles de WAICENT et de la FAO contiennentd’énormes quantités d’informations. Beaucoup de bibliothèques ont mis leurs catalogues « en ligne ». Mais dès qu’il s’agit d’une informationscientifique précise, Internet a deux handicaps majeurs : les droits d’auteurs et la connexion.Les éditeurs répugnent à mettre leurs ouvrages et leurs revues en ligne. Et on peut les comprendre. Cela équivaudrait à renoncer aux droitsd’auteurs. Les ventes des versions imprimées s’effondreraient. Et, sans revenus, les éditeurs ne publieraient plus rien.Les accès réservés aux seuls abonnés ne marchent pas vraiment non plus. Les cartes de crédit peuvent être utilisées pour des paiements enligne mais les usagers hésitent à payer pour des informations à télécharger. Ils sont par ailleurs inquiets sur la sécurisation des paiementspar cartes de crédit sur l’Internet. De plus, les cartes de crédit ne sont pas le moyen idéal pour payer les petits montants demandés pourjeter un coup d’œil à un article ou un tableau de données.De toutes façons, combien de chercheurs dans les pays en développement possèdent une carte de crédit ou sont disposés à utiliser leurcarte personnelle pour payer une information destinée à leur institution ?Le deuxième problème à résoudre est celui de la connectivité, ou plutôt de l’absence de connectivité. Même si un centre de recherchedispose d’ordinateurs, de modems, de logiciels et de personnels familiarisés à l’Internet (ce qui n’est pas courant), encore faut-il qu’ilspuissent s’appuyer sur un fournisseur d’accès fiable.Mais dans de nombreux pays, si vous essayez de vous connecter, vous vous condamnez à recomposer sans cesse le numéro d’accès, àpatienter pendant des durées de téléchargement interminables et à supporter de fréquentes déconnexions qui vous obligent à toutrecommencer. L’Internet peut promettre un avenir radieux aux chercheurs des pays en développement… mais ils n’en sont pas encore là.Des petits disques qui capturent des arcs-en-cielTout cela ne signifie pas que les nouvelles technologies de l’information et de la communication doivent être jetées aux orties. Deux d’entreelles sont particulièrement prometteuses : le courrier électronique et les CD-ROM.220
BibliothèquesContrairement à la Toile, le courrier électronique ne nécessite pas des connexions à haut débit. Il peut être véhiculé par des lignestéléphoniques de qualité médiocre et des modems lents parce que les données transmises sont moins importantes que celles qui sontvéhiculées par l’Internet, ses mises en page sophistiquées et ses graphismes. Naviguez sur l’Internet et vous en avez pour au moins uneheure, alors qu’il vous faudra tout au plus quelques minutes pour télécharger votre courrier électronique.Les CD-ROM, ces petits disques luisants qui reflètent des arcs-en-ciel, ont d’énormes avantages pour stocker et transmettre desinformations. Un seul CD-ROM peut emmagasiner des milliers d’images ou le texte de centaines de livres. Contrairement aux livres, lesCD-ROM sont légers, faciles à transporter et théoriquement incassables. Ils contiennent beaucoup plus d’informations qu’une disquette etils ne peuvent pas être effacés accidentellement. La poussière ou les moisissures qui rendent les disquettes illisibles peuvent facilement êtrenettoyées sur la surface des CD-ROM. La plupart des ordinateurs sont maintenant équipés de lecteurs de CD-ROM et les logiciels de lecturepeuvent être inclus dans le CD lui-même.Il faut noter par ailleurs que les CD-ROM ne coûtent pas cher à produire, ni à distribuer. Le chapitre de coût le plus important n’est pas,contrairement au livre, l’impression ou l’expédition mais le traitement et la saisie de l’information. Une fois cet investissement fait, descentaines ou des milliers de CD-ROM peuvent être reproduits à des coûts très faibles.Des réponses pour l’Afrique de l’EstLa combinaison du courrier électronique et du CD-ROM a permis au service d’information sur la recherche agricole (ARIS) de l’Organisationnationale de la recherche agricole en Ouganda (NARO) de mettre sur pied un service questions/réponses pour les usagers d’Ouganda, duKenya et de l’Ethiopie.Un de ces usagers demandait par courrier électronique à ARIS comment maîtriser la cochenille du manioc. Le bibliothécaire d’ARIS consulteles collections de la bibliothèque, qui comprend 130 revues scientifiques sur son CD-ROM TEEAL (voir encadré 23) et renvoie à l’usager,par e-mail, une liste d’articles ou d’ouvrages en rapport avec la question posée.Souvent la question est trop vague : le bibliothécaire doit demander à l’usager de la préciser pour la rendre plus spécifique. Cela prendraitdes lustres par la poste ou serait coûteux par téléphone. Par e-mail, c’est simple, peu coûteux et rapide.Lorsque l’usager sait que l’information est disponible, il peut se rendre personnellement à la bibliothèque pour la consulter ou demanderà la bibliothécaire de lui envoyer des photocopies de l’article recherché. Si l’article est déjà numérisé (par exemple s’il provient d’unCD-ROM), il est facile de l’envoyer au demandeur par e-mail.Ce service est encore peu utilisé : environ 10 demandes par semaine pendant les cinq derniers mois de 1999. Mais il s’agit d’un servicerécemment mis en place ; lorsqu’il sera largement connu, les spécialistes de l’information d’ARIS seront probablement submergés dedemandes.221
ENCADRÉ 23Une bibliothèque dans une boîteLa bibliothèque Mann de l’université de Cornell (une des plus grandes bibliothèques agricoles du monde) et lafondation Rockefeller ont cherché à résoudre le problème des droits d’auteurs. Les éditeurs scientifiquesreconnaissent qu’ils ne vendent pas beaucoup d’exemplaires de leurs revues dans les pays en développement.Donc, lorsque la bibliothèque Mann les a approchés, ils ont donné leur accord pour que leurs revues soienttranscrites sur des CD-ROM, à condition qu’ils ne soient pas distribués dans les pays développés.Le résultat est la « bibliothèque agronomique fondamentale virtuelle » (The Essential Electronic AgriculturalLibrary) ou TEEAL. Elle consiste en une série de 172 CD-ROM contenant le texte intégral de 130 revues depuis1993 : 730 000 pages en tout. Le prix : 10 000 $ (environ 10 000 e). Cela semble un prix élevé si vous ne lecomparez pas à ce que cela coûterait en version imprimée : 370 000 $ (370 000 e).Les révolutions de l’information10 000 $ est une petite somme pour la plupart des bailleurs de fonds. Les centres de recherche des pays endéveloppement peuvent facilement trouver un bailleur pour financer l’achat des CD, des ordinateurs nécessairespour les exploiter et pour assurer la formation du personnel. Parmi les partenaires susceptibles de financer l’achatde TEEAL on trouve le CTA (pour les pays ACP), l’Institut international pour l’alimentation, l’agriculture et ledéveloppement de l’université de Cornell, la Fondation Ford, le SIDA, l’Unesco, l’USAID et la Banque mondiale.Pour plus d’information, se référer à www.teeal.cornell.eduuInformation pour le PacifiqueLe PIMRIS (Pacific Islands Marine Resources Information System) offre, pour le Pacifique, les mêmes services que le système ARIS pourAfrique de l’Est. C’est un réseau d’information qui rassemble, stocke, traite et diffuse l’information disponible sur la pêche et les autresressources maritimes vivantes ou non vivantes des zones tropicales de l’océan Pacifique.La population des îles du Pacifique ne fait pas de distinction véritable entre les ressources de la mer et du sol, tant le Pacifique, vaste océanparsemé de petites îles, apparaît comme un immense continent aquatique. Le poisson, les crustacés et les coraux sont des moyensd’existence essentiels pour les populations de ces îles.Il est donc important de préserver ces ressources et de les exploiter avec discernement.Basée à l’université du Pacifique Sud, l’unité de coordination du PIMRIS travaille avec quatre partenaires régionaux principaux : le Forumdes agences de la pêche (Forum Fisheries Agency), le secrétariat de la Communauté du Pacifique (Secretariat of the Pacific Community), leProgramme environnemental régional du Pacifique Sud (South Pacific Regional Environment Programme) et la Commission des géosciencesappliquées du Pacifique Sud (South Pacific Applied Geoscience Commission).Bien que chacun de ces partenaires ait un mandat spécifique et dispose de ses ressources propres en matière d’information, le PIMRISconstitue un réseau formel entre eux, pour faciliter l’échange et la diffusion de l’information au bénéfice des pays du Pacifique. Appuyé parun comité de suivi, il est au service d’une large gamme d’usagers depuis les fonctionnaires des gouvernements et les chercheurs, jusqu’auxétudiants et aux agents des pêches. Il fournit des bibliographies à la demande, recherche des documents dans des bases de données222
BibliothèquesENCADRÉ 241 230 livres pour seulement 6 eLe projet de bibliothèques pour le développement humain est mis en œuvre par un organisme basé en Belgique,qui propose des CD-ROM contenant les textes intégraux de centaines d’ouvrages consacrés au développement.La « bibliothèque pour le développement humain durable » est un CD-ROM qui contient 1 230 publicationsreprésentant 160 000 pages de texte et 30 000 dessins, dans un format très facile à utiliser. Les publicationsoriginales mises ensemble pèseraient 340 kg et coûteraient 20 000 $ alors que le CD-ROM pèse seulement25g (étui compris). Son coût?? 6 e.D’autres CD-ROM sont édités par cet organisme, en anglais, sur différents thèmes comme la médecine, la santé,l’environnement, l’alimentation et la nutrition. En français, on notera la Bibliothèque pour le développementdurable et les besoins essentiels (600 publications) et une anthologie du développement dans le Sahel(Sahel point doc).La plupart des éditeurs de ces publications sont des ONG,des agences des Nations unies ou des organismes dedéveloppement qui veulent s’assurer que l’informationqu’ils produisent est largement diffusée et qui n’ont pasl’obligation de rentabiliser leurs investissements commec’est le cas des maisons d’édition commerciales. MichelLoots, qui gère le projet de bibliothèques pourl’humanité, leur demande l’autorisation decopier leurs documents qui sont numériséset indexés en Roumanie (où les coûtssont moins élevés). Ceci permet auprojet de produire et de vendre lesCD-ROM à des prix défiant touteconcurrence.Pour plus d’information,voir www.humanitycdrom.org223
informatisées et tient les chercheurs au courant des dernières parutions à travers son service d’information sur les nouveautés. Il prépareégalement des dossiers d’information sur des thèmes relatifs à la marine tropicale et assure un service d’échange entre bibliothèques.Pour pallier la pénurie de bibliothécaires compétents dans de nombreux pays du Pacifique, le PIMRIS offre un service de conseils, uneassistance technique et des sessions de formation au bénéfice du personnel des bibliothèques spécialisées dans la mer et la pêche.Les révolutions de l’informationINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESGaneshan Rao, Co-ordinator, Pacific Island Marine Resources Information System (PIMRIS), USP Library, Suva (Îles Fidji). Tél. (679)313900 ; fax (679) 301490 ; e-mail rao_g@usp.ac.fj or pimris@usp.ac.fjEria Simba, Assistant librarian, Agricultural Research Information Service (ARIS), National Agricultural Research Organization,Kawanda (Ouganda). E-mail aris@imul.comOrganisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, World Agricultural Information Centre.Internet www.fao.org/waicent/search/default.htm224
BibliothèquesL’information pour le développement au service des usagersLe Centre de ressources de l’ITDGPaul Mundy« Je voudrais des informations sur les briquettes combustibles »Les murs de la petite pièce sont garnis d’étagères croulant sous les livres, papiers et boîtes de classement, tous dûment étiquetés. Lesquelques centimètres carrés d’espace libre sont occupés par des tableaux d’affichage sur lesquels des brochures et des affiches sontépinglés. Magazines et journaux sont disposés sur deux tables, au centre de la pièce. Des lecteurs occupent trois des six chaises et lesvisiteurs arrivent par vagues par la porte.« Margaret, pouvez-vous aider ce monsieur ? Il cherche de l’information sur les briquettes combustibles. »« Bonjour, pouvez-vous m’aider ? Je cherche de l’information sur la transformation agroalimentaire. »« Margaret, qu’avons-nous sur les bicyclettes ? »Margaret Kenyaggia, la bibliothécaire, gère la situation avec aisance. Elle questionne chaque visiteur : « De quelle organisation venez-vous ?De quelle sorte de transformation agroalimentaire s’agit-il ? Pourquoi souhaitez-vous cette information ? » Quand elle a une idée plus précisede ce que le visiteur souhaite, elle extrait un livre d’une des étagères ou elle se tourne vers son ordinateur, dans un coin de la pièce, tapequelques mots-clés sur le clavier, identifie les livres traitant du sujet sur le catalogue et en extrait les plus utiles pour le visiteur.Centre nerveuxLes bibliothèques, dans les pays en développement, sont trop souvent mal gérées et sous-utilisées. Ce sont des cimetières de livrespoussiéreux. Mais ce n’est pas le cas du centre de ressources de l’ITDG à Nairobi. Il constitue le centre nerveux de cette ONG et il est connucomme une des meilleures bibliothèques de la ville.L’ITDG, ou « I.T. » pour Intermediate Technology Development Group, comme on l’appelle familièrement au Kenya, est une desnombreuses ONG qui travaille pour promouvoir le développement et lutter contre la pauvreté en Afrique de l’Est. C’est aussi une des raresqui entretienne une bibliothèque avec des ouvrages et d’autres supports d’information sur le développement. Elle a été constituée en 1994et dispose maintenant de 3 000 ouvrages et peut-être 2 500 bulletins, journaux et rapports, tous entassés dans une pièce de 4,5 m sur 6 m.Le Centre de ressources de l’ITDG a une autre caractéristique peu commune : il est ouvert au public. Les utilisateurs doivent s’acquitterd’une petite redevance : un usager qui veut seulement consulter un livre dans la bibliothèque paiera 30 shillings (environ 0,45 e) par jour.225
Margaret Kenyaggia (à droite) au Centre deressources de l’ITDG(Photo : Paul Mundy)Les révolutions de l’informationUn abonnement annuel coûte 500 shillings (un peu plus de 7 e) : il donne droit à l’emprunt de deux livres à la fois pour une périodemaximale de deux semaines. Margaret Kenyaggia propose aussi des inscriptions de groupe : 1 500 shillings (environ 22 e) pour un groupede 4 agents pour une année.« Avant, lorsque nous ne faisions pas payer, les gens se précipitaient ici », explique Margaret Kenyaggia. « Mais la principale raison de cechangement est que la bibliothèque ne pouvait pas prêter de livres ; s’il n’y avait rien à payer, les gens n’auraient pas pris soin des livres »dit elle. « Maintenant, nous sommes sûrs qu’ils en prennent soin et qu’ils les rapporteront ».Maintenir l’actualisationMargaret Kenyaggia travaille durement pour que la collection d’ouvrages de la bibliothèque soit actualisé en permanence. Elle passe sontemps à rechercher de nouveaux livres. Elle les trouve en feuilletant les catalogues des éditeurs, en lisant les comptes rendus de livres dansles bulletins et en assistant aux cérémonies de lancement de nouveaux ouvrages. Les spécialistes techniques de l’ITDG identifient les livresintéressants à acquérir. L’ordinateur de Margaret Kenyaggia n’est pas encore connecté à l’Internet mais elle en emprunte un autre, deux outrois fois par semaine, pour rechercher de l’information. Et elle est à l’écoute des besoins de ses visiteurs. Si on lui demande un livre quele centre ne possède pas, elle fait tout pour en trouver un exemplaire.« Vous trouverez ici des choses que vous ne trouverez pas dans les autres bibliothèques de Nairobi » dit-elle en souriant. La collection delivres du centre attire près de 2 000 visiteurs par an. Beaucoup d’entre eux ont entendu parler de la bibliothèque par le bouche-à-oreille.Et ces chiffres ne comptent pas le mouvement incessant des agents de l’ITDG qui viennent chercher de l’information ou tout simplementconsulter les nouvelles du jour dans un des journaux que l’on trouve sur la table. De nombreux visiteurs sont des chercheurs ou desétudiants provenant des universités locales. « L’université a sa propre bibliothèque, bien sûr », dit Margaret Kenyaggia « mais les étudiantsme disent que les livres que l’on y trouve ne sont pas actualisés ».Service payantLa contribution que la bibliothèque demande à ses utilisateurs couvre l’entretien mais n’est pas suffisante pour acheter de nouveauxouvrages. Alors, comment IT Kenya réussit-il à entretenir une bibliothèque alors que tant d’ONG doivent se serrer la ceinture ? La réponse226
Bibliothèquesest simple : l’ITDG gère une série de projets de développement : les coûts d’achat des livres et d’entretien de la bibliothèque sont intégrésau budget de chaque projet. Comme l’ITDG couvre une grande variété de thèmes (énergie, transports, construction, agriculture,élevage…), la bibliothèque en fait autant. Cela augmente son pouvoir d’attraction pour les usagers extérieurs.La bibliothèque reçoit gratuitement quelques exemplaires des ouvrages provenant de l’organisation sœur d’ITDG en Grande-Bretagne. « Ilsnous donnent gratuitement un exemplaire de quelques ouvrages mais si nous en voulons plus, nous devons les payer, comme tout lemonde », dit-elle.Margaret Kenyaggia reçoit une assistance pour le fonctionnement de la bibliothèque. Les étudiants du département des sciences del’information de l’université locale sont tenus de faire un stage qui leur donne une expérience pratique, pour obtenir leur diplôme. Elle lesmet au travail pendant trois mois. « C’est une bonne méthode de formation » dit-elle, « mais le problème est qu’au bout de trois mois,lorsqu’ils commencent à devenir vraiment efficaces, ils doivent s’en aller et je dois tout recommencer avec de nouvelles recrues ».Margaret Kenyaggia attend avec impatience le déménagement de l’ITDG, dans quelques mois, dans de nouveaux locaux plus spacieux. Maisen attendant, elle n’a plus de place du tout. Des cartons pleins de livres sont empilés contre le mur. Margaret s’apprête à les jeter. « Nousn’avons pas de place pour les garder », dit-elle. « Et à quoi bon garder des livres que personne ne peut lire ? »INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESIntermediate Technology Development Group (ITDG), 22 Chiromo Access Road, off Riverside Drive, PO Box 39493, Nairobi (Kenya).Tél. (254) 2 442108/ 2 446243/ 2 444887 ; fax (254) 445166 ; e-mail itkenya@itdg.or.ke ; Internet www.itdg.org.pe/h_kenya227
LECTURES CONSEILLÉESIl existe une large sélection d’ouvrages sur l’information et la communication agricoles dans les pays en développement et particulièrement dans lespays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Voici une liste des publications les plus récentes.Les coordonnées des organisations décrites dans cet ouvrage et des collaborateurs sont indiquées à la fin de chaque section. Elles ne figurent pas danscette bibliographie.FrançaisLes révolutions de l’informationBanque mondiale. 1996. Systèmes d’information sur l’environnement en Afrique subsaharienne : investir dans le futur. Findings 24.. Washington, DC,États-Unis.Beau, C. et Idoux, A.C. 1998. Savoirs paysans et savoirs scientifiques. Editions Charles Léopold Meyer, Paris, France.Berqué, P., Foy, E. et Girard, B. 1995. La passion radio. Editions Syros, Paris, France.Brosseau, J.M. et Soncin, J. 1999. Créer, gérer et animer une radio. Collection Guides Pratiques. Editions GRET, Paris, France.CRDI. 1995. La communication participative pour le développement : un agenda ouest-africain. Editions CRDI (Centre international de recherchespour le développement), Ottawa, Canada.CTA. 1994. Atelier sur les réseaux de documentation agricole en Afrique : rapport de synthèse. Centre technique de coopération agricole et rurale(CTA), Wageningen, Pays-Bas.CTA. 1995. La radio au service du monde rural des pays ACP. Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), Wageningen, Pays-Bas.CTA. 1995 et 1996. La vulgarisation agricole en Afrique. (2 vols). Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), Wageningen, Pays-Bas.CTA. 1996. Le rôle de l’information pour le développement rural des pays ACP : bilan et prospectives. Séminaire international. Montpellier, juin 1995.Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), Wageningen, Pays-Bas.FAO. 1991. Les mille et un mondes : manuel de radio rurale. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.FAO. 1994. La communication, pour un développement à dimension humaine. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture(FAO), Rome, Italie.FAO. 1996. Approche participative, communication et gestion des ressources forestières en Afrique sahélienne. Organisation des Nations unies pourl’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.FAO. 1996. Atelier international pour le développement de la radio rurale en Afrique. Organisation des Nations unies pour l’alimentation etl’agriculture (FAO), Rome, Italie.228
FAO. 1996. L’informatique et la foresterie. Revue Unasylva 189. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.FAO. 1998. Comment concevoir et réaliser des supports de communication de proximité. Organisation des Nations unies pour l’alimentationet l’agriculture (FAO), Rome, Italie.FAO. 1998. Internet et le développement agricole et rural : une approche intégrée. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture(FAO), Rome, Italie.FAO. 1999. La communication pour le développement : étude de cas N°. 16 : Centre de services de production audiovisuelle (CESPA) au Mali.Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.FAO. 1999. La vidéo : manuel à l’usage des responsables de la communication, de l’animation, de la formation et de la vulgarisation. Organisationdes Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.FAO, CESPA et PNUD. 1999. Manuel de communication pour le développement. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture(FAO), Rome, Italie.Fra, D. et Gérer, E.N. 1999. Créer et animer une publication. Collection Guides Pratiques. Editions GRET, Paris, France.INADES et Developing Countries Radio Network. 1998. Répertoire des radios et revues rurales d’Afrique francophone. INADES, Abidjan, Côte d’Ivoire.Jogand, A. et Berqué, P. 1994. L’audiocassette et ses usages : Un outil de communication au service du monde rural. Collection Guides Pratiques.GRET, Paris, France.Van den Ban, A.W., Hawkins, H.S., Brouwers, J.H.A.M. et Boon, C.A.M. 1994. La vulgarisation rurale en Afrique. Karthala/CTA, Paris, France.AnglaisAgricultural Research and Extension Newsletter, Agricultural Administration Unit, Overseas Development Institute, Londres, Royaume-Uni.Blackburn, D.J. (ed.). 1994. Extension Handbook : Processes and Practices, Thompson Educational Publishing, Toronto, Canada.Blum, A. 1996. Teaching and Learning in Agriculture. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.Boeren, A. et Epskamp, K. (eds). 1992. The Empowerment of Culture : Development Communication and Popular Media. CESO Paperback 17.Centre for the Study of Education in Developing Countries (CESO), La Haye, Pays-Bas.Bolliger, E., Reinhard, P. et Zellweger, T. 1994. Agricultural Extension : Guidelines for Extension Workers in Rural Areas. Swiss Centre forDevelopment Cooperation in Technology and Management (SKAT), St Gallen, Suisse.229
Burke, A. 1999. Communications and Development : A Practical Guide. Social Development Division, Department for International Development(DFID), Londres, Royaume-Uni.Calvert, P. (ed.). 1996. The Communicator’s Handbook : Tools, Techniques and Technology. (3rd edn) Maupin House, Gainesville, Floride, États-Unis.Christoplos, I. et Nitsch, U. 1996. Pluralism and the Extension agent : Changing Concepts and Approaches in Rural Extension. SIDA, Stockholm, Suède.CTA. 1995 et 1996. Agricultural Extension in Africa. (2 vols) Centre technique de coopération rurale et agricole (CTA), Wageningen, Pays-Bas.Les révolutions de l’informationCTA. 1995. Radio at the Service of the Rural World in ACP Countries. Centre technique de coopération rurale et agricole (CTA), Wageningen, Pays-Bas.Diagne, D. et Pesche, D. (eds). 1995. Peasant and Rural Organizations, Forces for the Development of Sub-Saharan Africa. Ministère français de lacoopération, Paris, France.Eponou, Th. 1993. Partners in Agricultural Technology : Linking Research and Technology Transfer to Serve Farmers, ISNAR, La Haye, Pays-Bas.FAO. 1994. Participatory Rapid Appraisal of Farmers’ Agricultural Knowledge and Communication Systems. Organisation des Nations unies pourl’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.FAO. Communication for Development. Case Studies. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.Fraser, C. et Restrepo-Estrada, S. 1998. Communicating for Development : Human Change and Survival. I B Tauris, Londres, Royaume-Uni.Hope, A. et Timmel, S. 1984. Training for Transformation : A Handbook for Community Workers. Mambo Press, Harare, Zimbabwe.IIRR. 1996. Recording and Using Indigenous Knowledge : A Manual. International Institute of Rural Reconstruction (IIRR), Silang, Cavite, Philippines.Journal of Agricultural Education and Extension, International Journal on Changes in Agricultural Knowledge and Action Systems, Wageningen,Pays-Bas.Kaimowitz, D. (ed.). 1990. Making the Link : Agricultural Research and Technology Transfer in Developing Countries. Westview, Boulder, Colorado,États-Unis.Leonard, D.K. 1977. Reaching the Peasant Farmer : Organization Theory and Practice in Kenya. University of Chicago Press, États-Unis.McKee, N. 1993. Social Mobilization and Social Marketing in Developing Countries : Lessons for Communicators. Southbound, Penang, Malaysie.Merrill-Sands, D. et Kaimowitz, D. 1990. The Technology Triangle : Linking Farmers, Technology Transfer Agents and Agricultural Researchers.ISNAR, La Haye, Pays-Bas.Montagnes, I. 1998. An Introduction to Publishing Management. Working Group on Books and Learning Materials of the Association for theDevelopment of Education in Africa, Londres, Royaume-Uni.230
Moris, J. 1991. Extension Alternatives in Tropical Africa. Occasional Paper 7. Agricultural Administration Unit, ODI, Londres, Royaume-Uni.Nelson, J. et Farrington, J. 1994. Information Exchange Networking for Agricultural Development : A Review of Concepts and Practices. Centretechnique de coopération rurale et agricole (CTA), Wageningen, Pays-Bas.Parada, C., avec Garriott, G. et Green, J. 1997. The Essential Internet : Basics for International NGOs. InterAction, Washington, DC, États-Unis.Powell, M. 1999. Information Management for Development Organisations. Oxfam, Oxford, Royaume-Uni.Pradervand, P. 1989. Listening to Africa : Developing Africa from the Grassroots. Praeger, New York, États-Unis.Pretty, J.N., Gujit, I., Thompson, J. et Scoones, I. 1995. Participatory Learning and Action : A Trainer’s Guide. IIED Participatory Methodology Series.International Institute for Environment and Development (IIED), Londres, Royaume-Uni.Richardson, D. et Paisley, L. (eds). 1998. The First Mile of Connectivity : Advancing Telecommunications for Rural Development through a ParticipatoryCommunication Approach. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.Richardson, D. 1997. The Internet and Rural and Agricultural Development : An Integrated Approach. Communication for Development. Organisationdes Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie.Rivera, W.M. et Daniel, J.G. 1991. Agricultural Extension : Worldwide Institutional Evolution and Forces for Change. Elsevier, Amsterdam, Pays-Bas.Rural Extension Bulletin, University of Reading, Reading, Royaume-Uni.Scarborough, V., Killough, S., Johnson, D.A. et Farrington. J. (eds). 1997. Farmer-led Extension : Concepts and Practices. Intermediate TechnologyPublications, Londres, Royaume-Uni.Starkey, P. 1997. Networking for Development. International Forum for Rural Transport and Development, Londres, Royaume-Uni.Umali, D.L. et Schwartz, L. 1994. Public and Private Extension. World Bank Discussion Paper 236. Washington, DC, États-Unis.Van den Ban, A.W. et Hawkins, H.S. 1996. Agricultural Extension. (2nd edn) Blackwell Science, Oxford, Royaume-Uni.Van Veldhuizen, L., Waters-Bayer, A. et de Zeeuw, H. 1997. Developing Technology with Farmers : A Trainer’s Guide for Participatory Learning.Zed Books, Londres, Royaume-Uni.Venketasan, V. et Kampen, J. 1998. Evolution of Agricultural Services in Sub-Saharan Africa : Trends and Prospects. World Bank Discussion Paper 390.Washington, DC, États-Unis.231
SIGLES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMESACCTAgence de coopération culturelle et technique (France)ADAPAgricultural Development in the American PacificADRAO Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’OuestAEPJLN Association des éditeurs et promoteurs des journaux et revues en langues nationales (Burkina Faso)AICAgricultural Information Centre (Kenya)ALOAgricultural Liaison Officer (Pacifique)AMAPAgence malienne de presse et de publicitéANOPACI Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d’IvoireAPACE Appropriate Technology for Community and Environment (Australie)APICAppui à l’instruction civique (Mali)ARTOArchivage de la tradition orale (Mali)ASARECA Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central AfricaAVRDC Asian Vegetable Research and Development CenterBNDABanque nationale de développement agricole (Mali)CARDICaribbean Agricultural Research and Development InstituteCARISCurrent Agricultural Research Information SystemCELTHO Centre d’études linguistiques et historiques par tradition orale (Mali)CESAO Centre d’études économiques et sociales d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso)CESOCentre for the Study of Education in Developing Countries (Pays-Bas)CESPACentre de services de production audiovisuelle (Mali)CIATCentre international d’agriculture tropicaleCIERRO Centre interafricain d’études en radio rurale de Ouagadougou (Burkina Faso)CMDTCompagnie malienne de développement des textiles (Côte d’Ivoire)CNCRConseil national de concertation et de coopération des ruraux (Sénégal)CORAF Conférence des responsables de recherche agronomique africainsCRDICentre de recherche pour le développement international (Canada)CTACentre technique de coopération agricole et ruraleDANIDA Danish International Development AssistanceDDCDirection du développement et de la coopération (Suisse)DFIDDepartment for International Development (Royaume-Uni)DGISDirectoraat-Generaal Internationale Samenwerking (Pays-Bas)ENDAEnvironment, Development and Action (Sénégal)EZEEvangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe (Allemagne)FAOOrganisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricultureFENOP Fédération nationale des organisations paysannes du BurkinaFMIFonds monétaire internationalFONGS Fédération des organisations non gouvernementales du SénégalFRAOFondation rurale pour l’Afrique de l’OuestGhRRM Ghana Rural Reconstruction MovementGRADGroupe de réalisations audiovisuelles pour le développementGRETGroupe de recherche et d’échanges technologiques (France)232
GTZDeutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Allemagne)ICIPEInternational Centre for Insect Physiology and EcologyICRAFInternational Centre for Research in AgroforestryIICAInter-American Institute for Cooperation on AgricultureIIEDInternational Institute for Environment and DevelopmentIIRRInternational Institute of Rural ReconstructionIITAInternational Institute of Tropical AgricultureINADES Institut africain pour le développement économique et social (Burkina Faso)IRETAInstitute for Research, Extension and Training in Agriculture (Pacifique)ISNARInternational Service for National Agricultural ResearchISRAInstitut sénégalais de recherches agricolesITDGIntermediate Technology Development Group (Royaume-Uni)JADEJournalistes africains pour le développement (Burkina Faso)KACEKenya Agricultural Commodity ExchangeLABELiteracy and Adult Basic Education (Ouganda)MTEAMulti-Purpose Training and Employment Association (Ouganda)MTNMobile Telephone Networks (Uganda)NANECNational Network of Cassava Workers (Ouganda)NARONational Agricultural Research Organization (Ouganda)NRINatural Resources Institute (Royaume-Uni)OMCOrganisation mondiale du commerceONGOrganisation non gouvernementaleOUAOrganisation de l’unité africainePANAPan-African News AgencyPEFAProgramme d’échange de formation et d’appui (Sénégal)PELUM Participatory Ecological Land-Use Management Association (Zimbabwe)PIAJPacific Index to Agricultural JournalsPIMRIS Pacific Islands Marine Resources Information SystemPNUDProgramme des Nations unies pour le développementPRIMAC Prix du marché du café et du cacao (Côte d’Ivoire)PROCICARIBE Agricultural Science and Technology System of the CaribbeanResidel Réseau d’informations internet sur la décentralisation et le développement local (Sénégal)RITARéseau d’information des terres aridesSACCAR Southern African Centre for Cooperation in Agricultural and Natural Resources Research and TrainingSAILDService d’appui aux initiatives locales de développement (Cameroun)SCAINIP Standing Committee on Agricultural Information Networking in the PacificSIDASwedish International Development AgencySKATSwiss Centre for Development Cooperation in Technology and ManagementSPCSecretariat for the South PacificSYCOV Syndicat des producteurs cotonniers et vivriers (Mali)SYFIASystème francophone d’information agricole233
TEEALUnescoUNFAUSAIDVITAWWFZIMACEThe Essential Electronic Agricultural LibraryUnited Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationUganda National Farmers’ AssociationUnited States Agency for International DevelopmentVolunteers in Technical Assistance (États-Unis)World Wide Fund for NatureZimbabwe Agricultural Commodity Exchange234