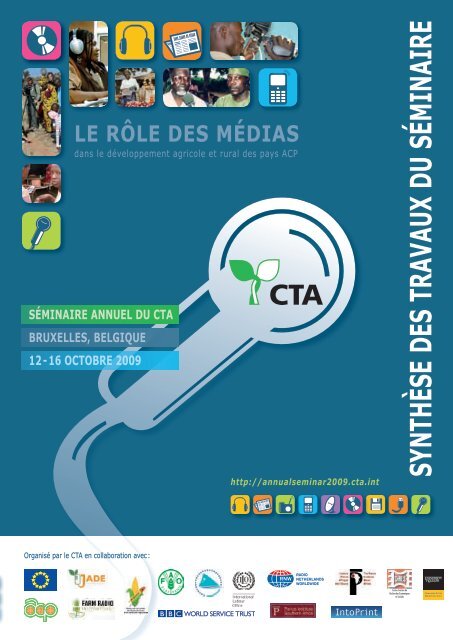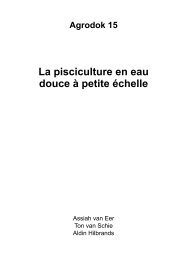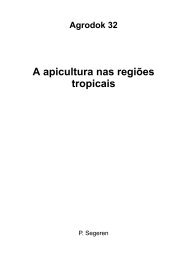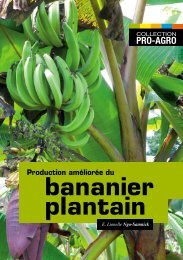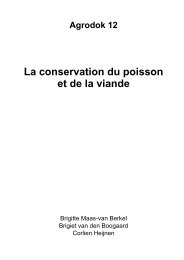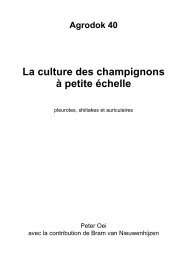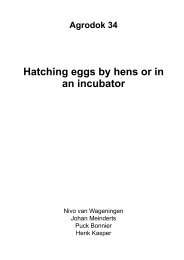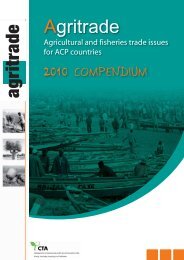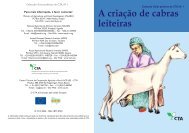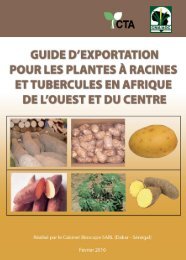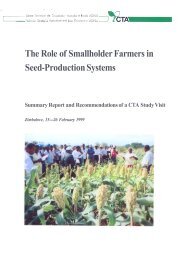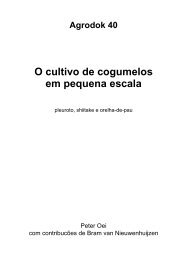Télécharger - Anancy
Télécharger - Anancy
Télécharger - Anancy
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2PhotosCouverture & p. 3 : K. Hackshaw,G. Rambaldi, GRETp. 7 : CTAp. 8 : K. Hackshawp. 12 : S. Ouattarap. 13 : K. Hackshawp. 14 : K. Hackshawp. 15 : R. H. Neun,p. 16 : S. Ouattara, T. Murrayp. 19 : B. Guisse, CMA/AOCp. 72 : K. Hackshawp. 73 : K. Hackshawp. 74 : K. Hackshawp. 75 : K. Hackshaw
Le rôle des médiasdans le développement agricole et rural des pays ACPSynthèse des travaux du séminaire3Publié parLe Centre technique de coopérationagricole et rurale ACP-UE (CTA)Postbus 380 - 6700 AJ WageningenPays-BasTél : (31) 317 467 100Fax : (31) 317 460 067E mail : cta@cta.int - Site web : www.cta.intCOMPILATIONCTAEditingJacques Bodichon,FranceGraphismewww.acg-bxl.beImpressionInformation, Press, Oxford, UK© CTA 2010ISBN : 978 92 9081 430 6
AttentesAude Ehlinger,responsable despartenariats auCameroun et auBurkina Faso del’ONG SOS faimAu début du séminaire, j’ai trouvéque les thèmes traités étaient untrop généraux, ce qui me laissaitsur ma faim. J’avais l’impressionqu’ont répétait encore ce qu’onavait l’habitude d’entendre dansd’autres séminaires. Heureusementqu’au fur et mesure qu’onavançait, on a pu rentrer dans desexemples plus concrets. Entre lesexpériences de terrain mettanten avance les limites rencontréesdans le travail qui vise à renforcerl’information sur l’agriculture etpar les agriculteurs. Je penseque le séminaire va déboucherà des propositions concrètes.Je pense que le document quisortira de cette rencontre serad’une grande qualité.Modeste Shabani BinSweni de la RDCJe suis pleinement satisfait dela façon dont cet atelier a étéorganisé et surtout de la qualitédes participants à ce séminaire.CTA a de bons critères pour sélectionnerles participants. Toutle monde, malgré le nombreimportant, a participé activement.Les gens avaient tendanceà partager systématiquementleurs connaissances. Il n’avaitpas comme on l’habitude de levoir dans certaines rencontres,des figurants. Tout le mondeEn plus de tout cela j’ai eu unprix dans la catégorie meilleurprojet communautaire ce quiest un grand plus d’abord pourmoi-même. Cela veut dire que ceque nous faisons comme travailest aussi important pour mériterun prix au niveau international.Je suis le seul congolais qui aparticipé à ce séminaire et voilàque je repars avec un prix. Jesuis donc très comblé.Le directeur généraldu CTA, Dr NeunC’était une rencontre formidable.Nous avons pu faire connaissanceavec des experts venant de tousles pays membre du CTA c’està-direde l’Afrique, des Caraïbeset du Pacifique. Le thème duséminaire sur le rôle des médiasdans l’agriculture était très passionnant.Les recommandationsmontrent qu’il y’a des attentesénormes que nous en tant quepetite institution ne pouvons pastout satisfaire. Nous avons unbudget modeste. Mais je croisqu’ensemble avec nos partenairesdans les pays ACP allonsessayer de nous partager les rôlespour pouvoir donner réponse àcertaines solutions préconisées.Comme nous l’avons déjà commencénous allons renforcer nosinterventions dans le domaine durenforcement des capacités desjournalistes. Par exemple nouspourrions appuyer les journalistesorganisés en réseau s’ilsnous soumettent des projets deformation pertinents.5
Table de matièresRemerciements 4Attentes 5Préface 7I Introduction 81.1 Contexte 81.2 Le séminaire en chiffres 9II Articles 112.1 Rapport de synthèse 112.2 Résumé du Briefing de Bruxelles 132.3 L’âge de la raison 14III Média 143.1 Couverture médiatique 143.2 Programme TV spécial sur les mediaset l’agriculture dans les pays ACP 153.3 Le Blog du Séminaire du CTA,un agrégateur de contenu 16IV Résultats 174.1 Résumé du blog pré-séminaire 174.2 Rapport de la discussionélèctronique pré-conférence 194.3 Déclaration de Bruxelles 20V Résumés 22Traitement des questions de développementagricole et rural par les médias 22Médias et vulgarisation etapprentissage agricoles 25Médias et changement climatique 28Médias et égalite des sexes 30Financement des médias dans le DAR 33Média et zones arides et semi-arides 34Communication entre les médias etles autres acteurs du dar 36Contribution des médias à la programmationde la politique agricole, et à la gestiondes connaissances 39Environnement institutionnel des médias :renforcer les capacités des médias dansle développement agricole et rural 41Médias, nouveau service média émergentet tic 43Recommandations des groupes de travail 45VI Annexes 476.1 Programme 476.2 Liste des participants 546.3 Programme du 25 ème anniversaire 716.4 Lauréats du prix médiatique 726.5 Plus d’information sur les lauréats 736.6 La route a été longue maiselle en valait la peine ! 766.7 Articles du blog pré-séminaire 777.1 Acronymes & Abbréviations 917.2 Commander des rapports desséminaires précédents 926
PréfaceLes médias peuvent-ils participer pleinement au développement agricole et rural ?Et, si oui, de quelle manière dans le contexte des pays ACP ?Telles sont les questions abordées par le CTA lors de son séminaire annuel, entrele 12 et le 16 Octobre 2009, à Bruxelles (Belgique).Les statistiques actuelles indiquent que l’agriculture ne contribue qu’à hauteur de4 à 6 % des PIB des pays ACP. Cela explique certainement la faiblesse des investissementspublics dans le secteur agricole dans la plupart des pays ACP. Mais dansde telles conditions, comment imaginer que les médias puissent s’intéresser à unaspect aussi “insignifiant” ? Mieux vaut regarder les chiffres d’un peu plus près.Selon une étude de l’Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture(IICA), les statistiques sont incomplètes et ne reflètent pas la contribution réellede l’agriculture. L’Argentine a d’ailleurs réévalué son estimation originelle de 4,6 % à 32,3 % pour y inclure toute lachaine marchande (transport, stockage, transformation, etc.) ; le Brésil a fait passer la sienne de 4,3 % à 26,2 % ;et aux Etats-Unis, où seulement 2 % de la population travaille dans l’agriculture, on sait bien qu’environ 25 % supplémentaireœuvre dans l’industrie alimentaire. Enfin la Banque Mondiale, dans une étude intitulée “Beyond the City:The Rural Contribution to Development in Latin America and the Caribbean” 1 a elle-même révisé son estimationpremière concernant la part moyenne du secteur rural dans les PIB pour la faire bondir de 26 % à 41 %.En d’autres mots, l’agriculture et le développement rural sont des affaires considérables. Il s’agit d’un secteur aussi“business” et aussi séduisant, qui mérite davantage de couverture médiatique.J’ai travaillé en Afrique durant 20 ans et je peux témoigner que les médias, bien souvent, ne se préoccupent del’agriculture qu’en cas de catastrophes naturelles, de pertes des récoltes, de crises alimentaires ou tout simplementlors des cérémonies de lancement de grands projets.Pourtant, l’agriculture est revenue en force sur l’agenda international du développement. J’en veux pour preuve lesétudes précédentes et la récente décision du G8 de mobiliser 20 milliards d’Euros sur 3 années afin de promouvoirla production agricole.Chaque jour, le CTA se mobilise pour convaincre les hommes politiques et leurs concitoyens. Il s’efforce de leur faireprendre conscience de l’importance du développement rural et du poids de l’agriculture. Mais il œuvre aussi sans cesseafin de sensibiliser les media, comme ce fut le cas lors d’un séminaire aux Bahamas, en octobre 2006, théâtre d’unmémorable échange de vues entre journalistes et représentants des ministères de l’Agriculture aux Caraïbes.Car il est temps que les médias, à leur tour, assument pleinement leur responsabilité et favorisent une nouvelleperception de l’agriculture. Sans eux, c’est un combat perdu d’avance.Le séminaire, organisé à l’occasion de la “Semaine du CTA” à Bruxelles, a réuni les différents acteurs des pays ACPpour promouvoir un vaste dialogue visant à mieux saisir la réalité des interactions entre média, décideurs politiqueset communautés rurales.Au cours de cette semaine, le CTA a également célébré son 25 ème Anniversaire. Belle occasion pour renforcer lesrelations de partenariat avec nos autorités de tutelle, en particulier la Commission de l’Union Européenne et leSecrétariat Général ACP. Et pour les remercier de nous avoir accompagnés au cours de ces 25 dernières années,favorisant la reconnaissance de notre savoir-faire et de notre efficacité par tous nos partenaires.J’adresse aussi mes sincères remerciements à tous ceux qui se sont dépensés sans compter pour que ce séminairesoit un réel succès. Je pense particulièrement aux différents membres du comité de pilotage, à toute notre équipe,y compris nos stagiaires, qui eux aussi ont travaillé très dur.Je remercie enfin tous les participants pour leurs contributions actives aux travaux et débats.Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à continuer de partager vos idées à travers la communautéMedia4Dev (…) que nous venons de mettre en place.Dr Hansjörg NeunDirecteur du CTA2005 - février 201071Guillermo E. Perry, William Foster, Daniel Lederman, Alberto Valdes,David M. De Ferranti. Beyond the city: The Rural Contribution toDevelopment. World bank, Washington, DC.
INTRODUCTION1.1 CONTEXTE8Les conséquences des crisesalimentaire, économique etfinancière sur l’agriculture etle développement rural ont fait l’objetde très nombreux débats dans lessphères politiques internationales aucours de ces dernières années.Le retour de l’agriculture au sommetde l’agenda du développement estune réalité.Parmi les études et rapports réaliséssur le sujet par d’importantes institutionsmultilatérales figurent :• Le rapport d’étape de 2003 sur leProgramme intégré pour le développementde l’agriculture en Afrique(CAADP) du Nouveau partenariatpour le développement de l’Afrique(NEPAD) ;• le Rapport 2008 de la Banque mondialesur le développement dans lemonde ;• le Rapport 2009 de la FAO sur l’étatde l’insécurité alimentaire et del’agriculture dans le monde ;• les analyses présentées aux différentesréunions des ministres del’Agriculture du G8.Dans les pays ACP, ces sujets sonttrop souvent ignorés par les médias oualors traités de manière superficielle.Pour y remédier, les médias doiventassurer une couverture plus fiable del’actualité sur le développement et unediffusion appropriée de l’informationauprès des décideurs politiques etdes communautés rurales très souventanalphabètes et qui sont les plusdurement affectées par ces crises.Malgré l’engagement pris lors de ladéclaration de Maputo (2003) de consacrer10% du PIB au secteur agricole,la contribution budgétaire à ce secteurreste encore très faible en particulierpar manque de sensibilisation sur l’importancede l’agriculture.Les médias ont un rôle à jouer surle front du financement et de l’investissementdu secteur agricole. Ilspeuvent par la sensibilisation, inciterles décideurs politiques à s’impliqueractivement dans des processus d’innovationsagricoles et rurales.C’est dans ce contexte que le CTA aorganisé le séminaire internationalsur le Rôle des médias pour le développementagricole et rural dans lespays ACP. Cette rencontre s’est tenueà Bruxelles (Belgique) du 12 au 16Octobre 2009 et s’était assigné commeobjectifs de :• contribuer à l’élaboration de stratégiesà même de renforcer la capacitédes médias à accéder et à diffuserl’information sur les questions clésconcernant l’agriculture ACP ;• améliorer la communication entreles médias et les autres acteursimpliqués dans le développementagricole et rural ;• contribuer à l’identification de programmesd’appui aux médias.Le Séminaire a réuni plus de 170experts représentant les principauxacteurs de l’interface médias/développementagricole et rural : journalistesde la presse écrite, de la radiorurale et de la télévision, chercheurs,représentants d’organes de presse,spécialistes de la communication dansles services publics et dans les projetsde développement, décideurs provenantdes six régions ACP (Afrique del’Ouest, du Centre, de l’Est et Australe,Caraïbes et Pacifique), d’institutionsnationales des pays de l’UE et d’organisationsrégionales et internationales.Les travaux du séminaire ont portésur les thèmes suivants :• Couverture médiatique des questionsde développement agricoleet rural• Communication entre les médias etles autres acteurs du développementagricole et rural• Médias et financement du développementagricole• Renforcement des capacités desmédias• Le rôle des nouvelles technologiesdans le développement desmédiasLe contenu du séminaire a été alimentépar des activités pré-séminaire,telles que la discussion électroniquedont les contributions de plus de 2000experts ont enrichi les travaux duBriefing de BruxellesPrix médiaRapports journaliersséminaire. Les expériences pratiquesdes médias dans les communautésdes différentes régions ACP ont étéaussi illustrées par les vidéos inséréesdans l’émission spéciale TV enregistréependant l’événement et diffuséedans plus de 30 pays ACP.
Le Brussels Briefing qui a eu lieu lepremier jour du séminaire a posé leton pour le séminaire en examinantla question avec la perspective à lafois des journalistes et des décideurspolitiques et acteurs. Il a examinéles rôles possibles pour les médiasdans le développement et a considérécomment ils pouvaient mieux servirles contraintes rurales : en examinantà la fois ce qui était nécessairepour les médias et les sources et lescontraintes des médias pour remplirces rôles.été publiée. De plus, un CD-ROMcontenant l’émission TV spéciale aaussi été produit. Tous les produitsdu séminaire sont disponibles sur leservice de publication du CTA. Lesversions électroniques des documentsainsi que les présentations qui ontété envoyés au CTA sont disponiblessur le site internet du séminaire àhttp://annualseminar2009.cta.int.Les exemplaires en format PDF destextes peuvent être aussi téléchargésà partir de la bibliothèque virtuelledu CTA, <strong>Anancy</strong>.1.2 Le séminaire en chiffresPour encourager les médias ACP àassurer une meilleure couverture desquestions de développement agricoleet rural dans les pays ACP et inciterles décideurs à appuyer le développementdu secteur, le CTA a organiséun concours pour récompenser desjournalistes professionnels et desmédias communautaires particulièrementengagés.Répartition desparticipantsfemmes 38%hommes 62%Les recommandations très pragmatiquesdes participants ont permis deretenir des stratégies pour le renforcementdu rôle de médias dansle développement agricole et ruraldes pays ACP. Quelques unes sontconsignées dans le Résumé Exécutifdes travaux du séminaire (voirpage 11).Participants parrégion ACPCes messages ont également servià la production de la Déclaration deBruxelles (voir page 20). La mise enœuvre de ces stratégies de manièreconcertée par différents acteurs ycompris les institutions nationales,régionales et internationales permettraaux médias de jouer pleinementleur rôle dans le développement agricoleet rural dans les pays ACP.Ce document de synthèse fait partied’une série de documents qui ontété réunis pour présenter la richessedes discussions lors de la semaine àBruxelles et les conclusions et recommandationsqui en résultent. Uneversion plus complète et individuelledu résumé exécutif (voir page 11pour une version plus concise) a aussi20% Afrique de l'Ouest12 % Afrique du Sud6 % Pacifique6 % International10 % Caraïbes3 % Afrique Centrale13 % Afrique de l'Est30 % Europe9
sentants de diverses organisations demédias pour le développement, desspécialistes en communication travaillantdans le secteur public et dansdes projets de développement, desdécideurs originaires de six régionsACP 2 , ainsi que des représentantsd’institutions nationales de rechercheet de développement des pays del’UE et d’organismes régionaux etinternationaux.PROCESSUSPrésentation pendant la session sur les médias etle changement climatique12L’appel à propositions a attiré plusde 225 soumissions de résumés pourle Séminaire. Au total, 57 exposés/présentations ont été sélectionnéspuis organisés dans le cadre de10 sessions plénières et parallèlesponctuées par des tables rondes etdes groupes de discussion thématique,mais aussi de plusieurs sessionsd’affiches interactives.THEMES ET SUJETS TRAITESLORS DES SESSIONS1. Médias et questions de dar2. Médias et vulgarisation/apprentissage agricoles3. Médias et changement climatique4. Médias et égalité des sexes5. Financement des médiasau service du dar6. Les médias dans les zones arideset semi-arides7. La communication entreles médias et les autresacteurs du dar8. Contribution des médias auxpolitiques, aux programmeset à la gestion desconnaissances agricoles9. Environnement institutionnel desmédias : renforcer les capacitésdes médias au service du dar10. Médias traditionnels, médiasémergents et nouvelles ticDiverses activités ont été menéespar le CTA afin de recueillir les avis,commentaires et observations deplusieurs acteurs internationaux.Ainsi, une discussion électronique(e-discussion) a été organisée avecplus de 2 000 participants et un blogpré-séminaire créé, puis remplacé parun blog animé en direct et en tempsréel (“live blogging”) tout au longdu Séminaire. De même, des misesà jour rapides et régulières étaientfaites de manière synchrone sur lesite Web dédié au Séminaire.Le déroulement du Séminaire a étéponctué d’événements qui ont suscitébeaucoup d’enthousiasme. Par exemple,les participants ont vécu, dès lepremier jour, l’expérience unique d’êtredans la même salle que des déléguésUE-ACP à la Commission européenne,à l’occasion d’un “Briefing de Bruxelles”sur le thème du Séminaire et lesdifférentes sessions plénières et tablesrondes (voir page 13). De plus, desgroupes de travail spécifiques ontcontribué à l’établissement d’une listed’actions à engager dans les différentsdomaines thématiques concernés,tout comme dans les secteurs de laradio, de la télévision, de la vidéo, dela presse écrite et des médias communautaires(voir page 45). Enfin, ledernier jour du Séminaire a été marquépar l’élaboration de la Déclarationde Bruxelles, qui résume les recommandationsissues des discussionsen ligne, des exposés et des travauxqui se sont déroulés tout au long dela semaine (voir page 20).2009 ET APRES ? VERSUN PLUS GRAND ROLEDES MEDIAS DANS LE DARA la lumière des nombreuses discussionset recommandations quele Séminaire a générées, le CTA feratout pour que, au moins, les recommandationssuivantes soient traduitesdans les faits et ce, dans le cadre deson Programme médias nouvellementmis en place :• D’ici septembre 2010, élaborer unestratégie de renforcement des capacitésdes médias, qui prenne encompte les suggestions en rapportavec la liste des actions proposées,ainsi que les divers points de vuerégionaux sur les questions jugéesessentielles pour le développementagricole des pays ACP ;• Prévoir dans le prochain Plan stratégiqueune collaboration avec lesinstitutions nationales et internationales,en vue d’impliquer plusétroitement les médias dans lespolitiques de développement ACP etles programmes de DAR, et de mettreen œuvre un plan d’action pourla tenue de conférences annuelles,l’octroi de microfinancements, l’attributionde prix et la reconnaissancedes efforts consentis à travers diverstypes de récompenses ;• Élaborer une série de guides pratiquessur le rôle des médias, leursmission et responsabilités, maisaussi leurs relations avec les institutionsnationales et internationalesde recherche, d’enseignement et devulgarisation ;• Mettre à profit l’ensemble de sesprogrammes existants pour mieuxsensibiliser les agences de financementà la nécessité de leur appuipour mener à bien les plans d’actionproposés en faveur de la radio, dela télévision, de la vidéo, du film etdes médias communautaires ACPtravaillant dans le secteur agricoleet rural ;• Accroître l’aide directe aux médias communautairesau service du DAR ;• Veiller autant que possible au respectde l’égalité des sexes dans lesprogrammes de renforcement descapacités ;• Promouvoir via les réseaux demédias généralistes (non axés surle DAR) les échanges d’informationssur les meilleures pratiques et lesexpériences réussies en matière decouverture par la presse de questionsimportantes pour le développementagricole et rural ACP, y compris lechangement climatique et la sécuritéalimentaire.2Régions d’Afrique centrale, orientale, australe et occidentale, des Caraïbes et du Pacifique.
2.2 Résumé du Briefing de BruxellesLe 14 ème Briefing sur le développement,organisé le 12 octobre 2009à Bruxelles sur le thème “Médiaset développement”, a permis d’aborderdes questions clés telles que le rôle quepeuvent jouer les médias des pays ACPet UE dans la sensibilisation et l’appui dupublic à la politique européenne de développement.Les participants sont convenusque les différents acteurs doiventfaire les efforts nécessaires pour inciterles médias à parler aussi des réussitesdu développement agricole et rural, etpas uniquement des échecs ou autresmauvaises nouvelles. Les médias doiventdonner plus de visibilité à l’agriculturesi l’on veut améliorer la productivité etrépondre, de manière durable et écologique,aux besoins des populations entermes de nourriture, d’emplois et derevenus. Mais cela ne peut se faire sansun investissement accru dans l’agricultureet les équipements d’information et decommunication.Tous les participants ont reconnu queles médias restent un partenaire essentielpour le secteur du développementagricole et rural et qu’ils font face àde réelles difficultés : infrastructuresmédiocres, manque d’équipementset de matériel, faibles rémunérations,manque de connaissances et de spécialisationen agriculture et, donc, mauvaisecompréhension des questions dedéveloppement. Il existe un décalageentre les attentes des médias et cellesde la communauté du développement.En effet, les médias considèrent généralementl’agriculture comme un secteurpeu digne d’intérêt et les partenaires audéveloppement ne font pas confianceaux médias pour rendre compte del’actualité avec précision et objectivité.Il est vrai que l’utilisation des TICvarie selon les régions ACP mais dansl’ensemble, les nouvelles technologiesoffrent plus de canaux d’informationet de supports de communication àmême de renforcer le rôle des médias.Par ailleurs, il nous faut partager lesbonnes pratiques - y compris celles encours dans d’autres secteurs tels quela santé et l’éducation. Nous devonspasser des moyens traditionnels de diffusionde l’information, à des méthodespermettant l’apprentissage interactif parplusieurs acteurs reliés au sein de vastesréseaux. De plus, il est indispensableque les médias soient soutenus à la foispar les gouvernements des pays ACPet la communauté internationale.Les journalistes manquent de formationspécialisée, donc des connaissancesnécessaires pour répondre aux questionsconcernant le développementagricole et rural. De plus, ils doiventaméliorer leurs compétences en matièrede recherche et collaborer davantageavec les scientifiques. Comme l’a suggéréViolet Otindo, lauréate du KBC-CNNAward, on pourrait récompenser lesscientifiques d’un prix pour leur collaborationavec des journalistes en vuede rendre plus positives et attrayantesles expériences dans l’agriculture. Pource faire, la formation aux nouvellestechnologies et le renforcement descapacités, en particulier pour les organisationsprofessionnelles de femmesjournalistes, sont indispensables. Dansnos sociétés, il est important que davantagede jeunes journalistes désireux dedéfendre le secteur du développementagricole et rural se voient accorder desbourses, des sessions de formation outout autre type de soutien, afin de lesencourager dans cette spécialisation.La bonne nouvelle est que le nombre despécialistes locaux “formés sur place”est en augmentation. Les médias locauxsont en mesure de répondre, dans leslangues locales, aux besoins des communautésen termes d’informations,d’actions et (éventuellement) d’influencesur le développement national,grâce à la mise en réseau et à la collaborationavec d’autres médias au-delàde l’échelon local. Certains types demédias peuvent créer et partager lepouvoir avec des structures ruralescomme la radio communautaire ; lavidéo participative - qui peut égalementêtre associée à la télévision et au filmdocumentaire ; les télécentres, quifonctionnent effectivement comme descentres de ressources communautaires ;la presse, qui relaie de nombreusesvoix/langues rurales différentes et quiaborde des questions d’importancepour les communautés rurales. Nousen voyons déjà les développementsfuturs, à travers le téléphone portable,par exemple, ou le Web 2.0, à l’originedu journalisme citoyen en milieu rural etqui permet à ces populations de mettreen ligne, sous forme de “podcasts”,leurs propres témoignages diffuséspar les stations de radio rurale.Participants au Briefing de BruxellesEntretien en ligne avec le directeur du CTADiffusion sur le webConférence de presse suivantle Briefing de Bruxelles (G-D) :Stephen Hazelman, CPS;Dr Wilson A Songa, président, CTA;Ian Barber, Commission européenne.13
2.3 L’âge de raisonUn anniversaire d’argent marque uneétape importante pour toute organisation.Et le CTA n’échappe pas à larègle. Le 14 octobre, le Palais desColonies, à Tervuren, haut et beaulieu chargé d’histoire, à Bruxelles,a servi de cadre pour la célébrationdu 25 e anniversaire du CTA. Le choixde la capitale belge n’est pas sanssignification pour célébrer cet événement.C’est en effet là que siègentle secrétariat ACP et la Commissioneuropéenne.En plus des 170 participants duséminaire, des représentants desACP et UE, les ambassades baséesà Bruxelles ont été invités à la cérémonie.L’ambassadeur de Jamaïque,Mme Yvette Gilbert-Roberts, s’estreconvertie, le temps d’une soirée,en maître de cérémonie, avec commepoints forts: les discours officiels, lestémoignages. Puis ce fut la proclamationdes prix dans deux catégories :celle du meilleur journaliste et celledu meilleur projet d’information etde communication communautaire.Une soirée riche en musique et ensurprises avec une prestation fourniepar le directeur du CTA, sa femme etson fils. Dans son exposé, au nomdu Conseil d’administration du CTA,le Dr Wilson Songa, présidentdu conseil, a félicité le Centrepour le dévouement de sonpersonnel, pour le niveau élevéd’activité. “Nous avons parfoisl’impression que le CTA emploieplus de 100 membres du personnelalors qu’en réalité, l’effectifest un peu plus de 40”, a-t-il indiqué.Toutefois, aussi motivé quesoit le personnel, le CTA doit faireface à une demande de plus en plusforte de produits et services de lapart de sa clientèle. La satisfactionde cette demande exponentiellepasse par l’accroissement des ressourcesdu Centre que le comité desambassadeurs défend constammentdans un contexte caractérisé par lararéfaction des ressources. Dr Songaa souligné que cette allocation deressources supplémentaire devraitaméliorer la pertinence et l’impactdu Centre, pour les 25 prochainesannées.Le directeur du CTA,Dr Hansjörg Neun, s’est félicité desréalisations sans omettre les nouveauxdéfis qui l’attendent. Les représentantsdes autorités de tutelle duCTA et les partenaires internationauxont également parlé de certains desprincipaux problèmes du développement:comment façonner l’actuelclimat mondial et régional et commentils percevaient les interventions duCTA dans ce contexte.III - MéDIA3.1 Couverture médiatique14Il est tout à fait normal qu’un séminairesur les médias profite de tousles supports médiatiques pertinentspour communiquer avec ses différentspublics. En l’occurrence, une variétéde médias traditionnels et nouveauxa été utilisée avant, pendant et aprèsle séminaire.Depuis quelques années, le CTA met àprofit la discussion électronique (e-discussion)pré-séminaire pour recueillirdes idées et opinions susceptibles decontribuer à façonner le thème de sonséminaire. Ces e-discussions permettentaussi à plus de gens, surtout ceuxqui n’ont pas la possibilité d’assisterau séminaire, de donner leurs pointsde vue sur les sujets débattus. Cetteannée, plus de 2 300 personnes se sontinscrites au forum de discussion, dontles résultats ont été présentés lors duSéminaire (voir page 19).La discussion électronique s’adressantparticulièrement aux professionnelsdans le domaine en question, le blogpré-séminaire introduit cette annéevisait à recueillir les points de vue desacteurs de base sur un certain nombrede sujets tels que le renforcement descapacités ou l’utilisation des nouveauxmédias et d’obtenir directement auprèsd’un large éventail de participants descommentaires à chaud sur les thèmesdu séminaire (voir page 17). Si leblog pré-séminaire voulait permettreaux participants de communiquer parce biais à l’aide de messages SMS,cette fonctionnalité n’a pas rencontréle succès escompté, probablementparce que la plupart des utilisateursqui lisaient le blog en ligne avaient lapossibilité de poster directement leurscommentaires (gratuitement), maisaussi parce que la brièveté des SMSne s’adaptait probablement pas à cetype de discussion.Le site Web dédié au séminaire proposaitdes informations relatives àl’organisation du séminaire, aux thèmeset au blog pré-séminaire. Lorsque leséminaire a débuté, le blog pré-séminairea été transformé en blog animéen direct et l’équipe du “live blogging”a démarré son travail.Les outils Web 2.0 y figuraient enbonne place. Le tag (balise) “media-4dev” a été inscrit sur Delicious. Uncompte Twitter a été créé. Une communautés’est formée sur Linked Inet un compte Flickr a été mis en place
pour le séminaire, en vue de faciliterle partage de photos et de vidéos. Dèsque le séminaire a débuté, les blogs,les tweets, les photos et les vidéos ontcommencé à affluer.Un webcast du Briefing de Bruxellesmis en ligne dès le 1 er jour du séminairea permis aux internautes depar le monde d’assister en direct auséminaire, et même de poser desquestions en ligne. Ainsi, plus de100 groupes de presse et organisationsse sont enregistrés pour les émissionset près de 200 utilisateurs ont pu suivrele Briefing en ligne.Outre les outils mis en ligne, le CTA aencore une fois collaboré avec PeopleTV pour produire un programmetélévisé spécial sur le thème du séminaire.Ce programme consistait en unetable ronde et cinq courts métragesvidéo réalisés en Afrique (Kenya,Mali, Sénégal et Zambie), dans lePacifique (Kiribati) et les Caraïbes(Trinité-et-Tobago). Toutes les sessionsont également été enregistréessur cassettes et un documentaire enDVD sur le séminaire sera égalementdisponible.La radio est toujours le média roi dansde nombreux pays ACP. Á ce titre, desémissions radiophoniques spécialesont été conçues à partir du programmetélévisé et les participants étaient désireuxd’y contribuer avec desinterviews en direct, toutau long de la semaine. Laradio figurait également enbonne place lors des deuxconférences de presse organiséesdurant le séminaire, lespremier et dernier jours. Lesémissions spéciales téléviséesseront également diffusées à laradio, pour permettre ainsi à unpublic plus large d’accéder auxprogrammes.Alors que certains soutiennentque l’avenir de la presse écrite estincertain, celle-ci occupe encoreune place enviable dans les paysACP. Des synthèses quotidiennes(“Daily Digest”) résumant les travauxet débats du séminaire ont ainsi étéproduites du mardi au vendredi. Descopies de ces synthèses en format PDFsont aussi disponibles en français et enanglais sur le site Web du séminaire.3.2 Programme TV spécial sur les mediaset l’agriculture dans les pays ACPDans le cadre de la politiquestratégie de communicationmise en place autour de l’organisationdu séminaire annuel sur “lerôle des médias dans le développementde l’agriculture des pays ACP” le CTA,en collaboration avec ses partenaires,a réalisé une émission télévisée surle thème “médias et agriculturedans les pays ACP”.L’objectif de cette édition spécialeest en premier lieu de permettre derenforcer et de démultiplier l’impact duséminaire auprès de tous les acteursimpliqués dans le développementagricole et rural des pays ACP (leaderspolitiques, acteurs du secteur desmédias, populations rurales et grandpublic) et de les sensibiliser sur le rôleque peuvent jouer les médias dans ledéveloppement de l’agriculture dansles pays ACP.Cinq thèmes généraux des différentsreportages ont été choisis au final :• médias et commercialisationdes produits agricoles• médias et genre• médias et changementsclimatiques• médias et renforcementdes capacités• le traitement de l’agriculturepar les médiasLes projets retenus des régions ACPont été sélectionnés pour la productionde reportages Ils ont été réalisés enfrançais et en anglais et ont été présentésà Bruxelles lors du tournaged’un plateau TV.• Dans les îles Caraïbes, nous avons puapprécier comment le secteur agricoleest (sous)traité dans les médias,avec l’exemple d’un quotidien nationalet d’une radio rurale.• Un voyage d’étude, organisé à l’initiativedu CTA, a emmené une dizaine dejournalistes de plusieurs pays d’Afriquede l’Ouest sur le trajet reliantDakar à Bamako. Les journalistesont été confrontés aux frontièresaux “tracasseries administratives”,qui entravent grandement le commercedes denrées agricoles dans lasous-région. Les articles parus dansla presse à ce sujet ont fait réagircertains gouvernements.• A l’Ouest du Kenya, dans une régiongravement touchée par le sida, descommunautés rurales, supportées par15
l’ONG KAIPPG, ont créé leurs propresmédias, enregistrant sur supports K7ou vidéos, des techniques agricoleset des conseils nutritionnels. Les K7et les vidéos s’échangent ensuite devillages en villages.• En Zambie, l’International Women’sMedia Foundation organise des sessionsde formation pour des femmesjournalistes. Ces sessions comprennentà la fois un apprentissage desproblématiques agricoles et desméthodologies pour traiter de l’actualitéagricole. Ces formations onteu un impact sur la couverture parles médias de l’agriculture, puisque,par exemple, le Times of Zambia amis en place une rubrique hebdomadaireconsacrée à l’agriculture.• Dans les îles Pacifique, la couverturepar des médias internationauxde l’actualité de Kiribati a grandementcontribué à la mobilisationinternationale pour faire face auxchangements climatiques.Des experts et des journalistes ontété invités à intervenir pour apporterdes compléments d’information surla situation. Un public de spectateursassistait aux débats.Les experts suivants sont intervenussur le plateau :En permanence sur le plateau :• Dr Hansjörg NEUN, Directeur duCTAEn alternance, selon les reportages :• M. Abdoulaye BARRY, journaliste àla RTS / Sénégal• Mme Nazima RAGHUBIR, journaliste /Guyana• Dr Obiero ONG’ANG’A, directeur duLake Victoria Center for Researchand Development / Kenya• M. James ONYANGO, directeur del’ONG KAIPPG / Kenya• M. Busani BAFANA, journaliste indépendant/ Zimbabwe• Mme Dorienne ROWAN-CAMPBELL,agricultrice biologique / Jamaïque• Mme Diana FRANCIS, experteen politique agricole et négociationscommerciales IICA / Trinitéet-Tobago• M. Samisoni PARETI, journalisteindépendant / Fidji• Mme Cece FADOPE, responsableAfrique, International Women’s MediaFoundation• Mme Fatouma Sophie OUATTARA,journaliste au quotidien Sidwaya /Burkina Faso• M. Blondeau TALATALA, Député àl’Assemblée Nationale / Cameroun• M. Larry THOMAS, responsable dudépartement média, Secrétariatde la Communauté du PacifiqueSud / FidjiIl est prévu que l’émission soit :• diffusée en deux parties de 30minutes, courant novembre 2009,sur une quarantaine de chaînes detélévisions, partenaires de la sociétéde production audiovisuelle PeopleTV et dans les régions des Caraïbeset du Pacifique• transférée sur K7 pour une diffusionpar les radios communautaires.• diffusée via le site internet du CTA.Enfin, le CTA distribuera des DVDs del’émission aux participants qui le souhaitent,ainsi qu’aux organisations partenairesqui en feraient la demande.3.3 Le Blog du Séminaire du CTA,un agrégateur de contenu16L’animation en temps réel d’unblog dédié au Séminaire du CTA(“Live Blogging”) par une équipede quatre personnes - dont 2 anglophoneset 2 francophones - est venuecompléter la panoplie de médias mis àprofit durant ce séminaire. Elle a permisd’agréger du contenu documentéen texte, audio, images et vidéo. Leblog du séminaire a été agrémentéde “tweets”, postés d’abord par lesmembres de l’équipe en charge desnouveaux médias, puis par les participantset d’autres personnes venues sejoindre à la conférence sur Twitter.Le “live blogging” a donné l’occasionà des gens qui n’ont pas pu assister àl’événement de poster leurs commentairessur les articles mis en ligne surle blog du Séminaire. Également reprispar d’autres utilisateurs, le contenudu blog a ainsi été considérablementenrichi, avant d’être intégré et partagépar encore plus de blogueurs.“Suivre le séminaire du CTA sur Twittera été pour moi une formidable expérience,car cela m’a permis non seulementd’être très bien informée de toutce qui passait mais encore de savoirce qu’en pensaient les autres participants.Autrement dit, il y a eu à la foisbeaucoup d’informations partagées, duréseautage et des plaidoyers sur lespolitiques des médias qui s’intéressentà l’agriculture”, s’est réjouie MaureenAgena, qui participé à la conférenceen “tweetant”.De même, c’est grâce au “live blogging”que l’équipe Nouveaux médias a puintégrer dans une seule et même plateforme- http://annualseminar2009.cta.
int/blog - le contenu de diverses autresplates-formes telles que Youtube, Twitter,Espace blogs et Flickr, ainsi que dutexte et des ressources audio. L’équipea ainsi réussi à impliquer différentesparties prenantes dans l’échange et ladiffusion d’informations sur les outils departage des connaissances au servicede la communauté agricole.L’équipe du blog du Séminaire s’estégalement servi de l’agrégateur ping.fmpour poster du contenu sur d’autresréseaux sociaux comme Facebook,Yahoo mail, Google mail, Flickr, Twitteret sur divers autres sites de mêmenature.Les blogueurs, tout comme les organisateurs,ont particulièrement apprécié,entre autres résultats du Séminaire,le fait que des journalistes géographiquementéloignés les uns des autrespuissent travailler ensemble et êtreen même temps sensibilisés, commeen témoigne la manière dont ils ontcontribué au blog, notamment à traversleurs commentaires sur Twitteret sur Facebook. Et le succès du “liveblogging” pourra se perpétuer mêmeaprès la conférence, grâce à la participationcontinue de la communauté.Le “Live Blogging”en chiffres• Micro blogging :plus de 700 tweets• Articles du blog sous formede vidéos, d’anecdotes etde témoignages : 80• Photos documentées :plus de 200• Commentaires postéssur le blog (comptenon tenu de ceux misen ligne sur d’autres sitesde réseaux sociaux telsque Facebook) : 51Pour que le “live blogging” soit pleinement efficace, plusieurs conditionsdoivent être réunies et, en particulier, la disponibilité d’une connexionsans fil dans la zone de conférence en question. A défaut, les blogueurspourraient tweeter hors ligne puis bloguer en ligne une fois revenus surInternet. Pour un maximum d’efficacité, les blogueurs doivent aussi utiliserdes ordinateurs portables capables de capter les signaux dans différentsenvironnements. Si elle veut fournir des services plus sophistiqués, l’équiped’animation du blog doit également avoir accès à des enregistreurs deconversations au format MP3, des caméras vidéo et des téléphonesportables équipés de caméras. Quoique n’étant pas indispensables, descassettes d’enregistrement et des batteries d’appoint garantiraient aussià l’équipe plus de flexibilité et d’efficacité dans son travail.IV - RésultatsAvant la conférence internationalesur le rôle des médias dans le développementagricole et rural dans lespays ACP, qui se tenait à Bruxelles enBelgique du 12 au 16 octobre 2009,le CTA a organisé un blog pré-séminaireet une discussion électroniquepour permettre à des experts de larégion ACP de partager leurs avis etexpériences dans ce domaine.Voir lesarticlesdu blog surpage 774.1 Résumé du blogpré-séminaireModerateurs: Marilyn Minderhout,Ibbo Daddy AbdoulayeLe blog avait pour objectif de soutenirle développement du Séminaire CTA2009 sur le rôle des médias dans ledéveloppement agricole et rural et dedonner aux professionnels des médiasdans les ACP l’occasion d’échangeret de partager des expériences. Lamajorité de ceux qui ont apportéleur contribution au blog étaient desjournalistes - beaucoup avaient travailléou travaillaient encore sur lesquestions de développement rural.Il y a également eu plusieurs contributionsdes membres des réseaux etdes associations de médias.Le blog a fonctionné pendant près de12 semaines et s’articulait autour dethèmes choisis. Ceux-ci avaient étéidentifiés dans un article d’introductionet ont été encore développés dans lesarticles courts postés chaque semaine.Ces articles situaient le contexte etdonnaient le point de départ de ladiscussion, encourageant les contributionsqui ont offert des commentairesétonnants sur le rapport entre lesmédias et le développement ruraldans les pays ACP. La majorité des17
18contributions venait d’Afrique mais lesblogueurs des Caraïbes et du Pacifiqueont exprimé des inquiétudes similaires.Les participants au blog ont réfléchiau cadre institutionnel dans lequel ilsfonctionnent en tant que journalistes.Le contexte politique avait un impactdécisif sur la liberté de pression. Plusgénéralement, même dans des régimesdémocratiques, un certain niveaude crainte et de méfiance à l’égard desmédias a empêché un reportage factuelet bien informé. Les fonctionnaires,conscients de leurs carrières et desconséquences de la désapprobation deleurs supérieurs, pourraient bloquerl’accès à l’information. L’inefficacitédes bureaux du gouvernement a égalementété évoquée : les documentsnon archivés, les statistiques nongardées et des retards tels à récupérerles informations, qu’une fois devenuesdisponibles, on pouvait douter de leurpertinence. Cependant, quand les fonctionnairesou les chercheurs avaientun rapport à faire sur quelque chosequi concernait leurs propres intérêts“ils savaient le clamer”, autrementils sont “allergiques à la presse”, ditun blogueur.Il a été indiqué que la culture politiqueet l’intérêt financier et l’intérêtdes entreprises qui la soutiennentavaient un impact également sérieuxsur la capacité des journalistes et desrédacteurs à choisir des histoires quifavoriseraient un journalisme plus“public” et qui pourraient bénéficierau développement rural. Plusieursparticipants ont soutenu l’observationdu Pacifique, à savoir que la privatisationet la corporatisation rapidesdes médias avaient créé une culturedans laquelle le “profit l’emportait surle bien public comme motif principaldes médias d’informations.”Ce type d’environnement n’a pasencouragé la transmission d’informationsdont les exploitants agricolesont besoin - en particulier les petitsexploitants. Un participant, qui avaitessayé de découvrir auprès des fermierspourquoi les médias n’avaientpas plus contribué au développement,s’est entendu répondre : Les “politiciensont de l’argent, les fermiersn’en ont pas. Ils ne veulent pas quele pays sache ce qui se passe ici. Ilsne se rendent dans les régions ruralesqu’au moment des élections pourdistribuer des cadeaux !”Les communautés agricoles étaientdisposées à consacrer de l’argent etdu temps pour les médias quand “ellesont vu que les journalistes représentaientleurs problèmes et leursinquiétudes”. Mais combler le fosséentre un lectorat rural potentiel etl’accès à des informations qui pourraientavoir un impact positif sur laproduction agricole et les moyensde subsistance rurale était difficile.Quelques participants ont indiqué quedavantage de professionnalisation, deformation, de spécialisation et dessalaires meilleurs pourraient aider àsurmonter ce problème. D’autres ontsouligné la nécessité pour la législationde faciliter le développementde nouvelles technologies capablesde combler la fracture entre l’urbainet le rural.Alors que les contraintes que connaissentles journalistes en activité - notammentles bas salaires et les budgetslimités - avaient découragé le journalismerural de terrain - il était importantde ne pas oublier que les médiasavaient la possibilité de stimuler ledéveloppement agricole et rural. Unconsensus général reconnaissait qu’enl’absence d’une bonne couverture desquestions agricoles par une radio publiqueou privée, les stations de radioscommunautaires constituaient unesource d’appui importante pour lesménages ruraux. Ici, les organisateursétaient également les auditeurs et lesstations de radios communautairesoffraient non seulement des informationssur les moyens de subsistance,mais faisaient également connaître aupublic les préoccupations des communautésrurales. Ce faisant, elles encourageaientl’échange d’expériences et deconnaissances entre les communautéstout en offrant aux journalistes unedocumentation utile. En outre, commel’a proposé un blogueur du Nigeria, lesradios communautaires - si elles sontbien coordonnées - pourraient être intégréesdans un réseau rural de médiasqui pourrait soutenir la vulgarisationagricole - un soutien bien nécessairedans les secteurs où les “vulgarisateursont été mal formés, mal payés et sontsouvent peu disposés à travailler dansles secteurs ruraux”.La durabilité financière a été identifiéecomme un problème sérieuxpour beaucoup d’initiatives ruralesde médias. Mais le blog a permis deconstater qu’il y avait des expériencespositives avec des stations de radioscommunautaires qui s’étaient crééune base commerciale régulière -parfois avec l’appui des personneslocales - ou avaient atteint la stabilitéen travaillant avec un éventail d’organisationspartenaires.Le thème de radio communautairea abouti à une discussion sur l’impactde nouvelles technologies surle développement agricole et rural.A ce niveau, plusieurs participantsont souligné l’importance de discuterd’abord avec les communautés localesdes technologies disponibles et de leursbesoins, de la pertinence et de leurscapacités à utiliser et à entretenir cesoutils efficacement.Il était nécessaire d’avoir des stratégiessensibles aux conditions spécifiques àchaque pays. Les nouvelles technologiesne génèrent pas le développementmais les messages qu’elles diffusentpeuvent influencer les politiques dedéveloppement. Les journalistesdes médias grand public ont besoind’informations à l’appui auxquellesils ont accès et ils doivent avoir lescompétences, l’expérience et la déterminationsuffisantes pour offrir unecouverture des affaires rurales biendocumentée et axée sur les enjeux.Les journalistes, les radiodiffuseurs etles gestionnaire Web peuvent jouerun rôle significatif pour transformerleur secteur en “média inclusif” - unmédia qui fait participer toutes lessections de la société au processusde développement.
4.2 RAPPORT DE LA DISCUSSION ELECTRONIQUEPRE-CONFERENCEModerateurs: Susanna Thorp etLaurence Lalanne-DevlinPlus de 2000 personnes ont été invitéesà participer notamment des journalistes,des spécialistes en communication,des chercheurs, des bibliothécaires,des organisations régionales et desagences de développement rural.La discussion de quatre semaines s’estdéroulée tenue simultanément enanglais et en français et était axée surquatre thèmes couvrant i) les contraintesque connaissent les médias ; ii)les attentes des médias et d’autres partiesprenantes du développement ; iii)le rôle potentiel des TIC ; iv) et lefinancement du renforcement descapacités. Ce rapport donne une brèvevue d’ensemble de certains des pointsprincipaux et des recommandationsrésultant de la discussion pour servirde base à d’autres discussions etactions à la conférence.ContraintesLes médias exhortant le changement en Afrique de l’OuestIl a été unanimement convenu queles médias constituent un partenaireimportant du développement agricole,mais des inquiétudes ont étéexprimées à propos des contraintesmultiples qui empêchent les médiasde réaliser pleinement leur potentieldans ce rôle. La réalité est que lesmédias, en particulier en Afrique, sontconfrontés aux problèmes d’une infrastructuremédiocre, de bas salaires, demanque d’équipement, d’absence despécialisation (et de formation pourl’agriculture) et donc d’une compréhensioninsuffisante des questionsde développement. Concernant lesthèmes discutés au cours de la premièresemaine (notamment le climat,la commercialisation, la vulgarisation),les contraintes spécifiques indiquaientque les journalistes ne disposaientpas en temps opportun de donnéesrégionales appropriées à communiquerà leurs lecteurs.Recommandation principale :offrir aux médias un renforcement plusimportant de leurs capacitésAttentesLes médias et les autres partenairesdu développement ont des attentesdifférentes (par exemple les chercheurs,les décideurs, etc.). Lesmédias ne considèrent pas l’agricultureintéressante, et il leur est difficiled’interpréter le jargon scientifiquepour leurs auditoires. Les chercheurset d’autres, font souvent preuve deméfiance envers les médias, quiveulent publier leurs histoires/leursémission gratuitement et n’ont pas lescompétences pour présenter l’informationde la manière adéquate.Recommandation principale :plus d’efforts pour “établir un lien”entre les médias et les partenaires dudéveloppement afin de mieux mettreen évidence l’importance de l’agricultureauprès des publics visés.Rôle des ticLes TIC et les nouveaux médias constituentde nouvelles voies et de nouveauxmoyens d’accroître le rôle desmédias, mais il a été reconnu que lesTIC ne sont pas la panacée.Recommandations principales :Reconnaître le potentiel des TIC impliqued’inclure les enseignements acquisdans d’autres secteurs et partager lesbonnes pratiques. Il est égalementnécessaire de disposer d’un modèleplus sophistiqué de l’apprentissageinteractif et itératif d’acteurs liés dansde larges réseaux plutôt que de s’entenir au modèle linéaire traditionnelde diffusion des informations.FinancementL’agriculture étant à nouveau à l’ordredu jour pour bénéficier d’un soutienau développement, on estime que lefinancement pour des initiatives decommunication agricole n’a pas suivile mouvement et qu’il faut de plusamples efforts aux niveaux national etinternational pour soutenir les médiasdans le développement agricole.Recommandation principale :La communication sur l’agriculturepour le développement doit devenirune priorité importante de l’investissementmais il faut une plus grandecoordination au niveau des effortsnationaux et des donateurs.19
204.3 DÉCLARATION DE BRUXELLESLe séminaire international annuel du Centre Techniquede Coopération Agricole et Rurale ACP-UE (CTA) tenu,cette année, à Bruxelles (Belgique) du 12 au16 octobre 2009 a porté sur le“Rôle des médias dans lerural des pays ACP”Le séminaire international annueldu Centre Technique de CoopérationAgricole et Rurale ACP-UE(CTA) tenu, cette année, à Bruxelles(Belgique) du 12 au 16 octobre2009 a porté sur “Rôle des médiasdans le développement agricoleet rural des pays ACP”.Le séminaire a réitéré le caractèreessentiel de l’Agriculture dans ledéveloppement des pays ACP, etsouligné que dans ces pays, plusdes 2/3 de la population pauvrehabitent encore en milieu rural et,sont largement tributaires de l’agriculturepour leur subsistance.Il a fait l’amer constat que d’unepart, le secteur agricole en généralet les populations vivant en milieurural ne font pas l’objet d’une expositionsuffisante dans les médiasdes pays ACP ; et, que d’autre part,les informations diffusées à leurattention ne sont pas toujours enadéquation avec leurs attentes.Le séminaire a donc relevé le rôleimportant des médias pour levertoutes les formes d’obstacles àl’innovation, l’augmentation de laproductivité du secteur agricole etdes exploitants, qu’ils soient grandsou petits, producteurs essentiellementpour leur consommationou pratiquants d’une agriculturecommerciale.DÉCLARATIONAussi le séminaire recommande t-il :Au plan général :• que le traitement des questions touchantau développement agricoleet rural, quelque soit le médiumutilisé, serve les attentes du terrain,désormais champ de validation desorientations politiques, des techniqueset des technologies ;• qu’un effort accru soit fait par lesmédias, mais aussi par tous lesautres acteurs du développementagricole et rurale dans les pays ACP,pour capitaliser les différentes formesde savoirs, de connaissances,d’expertises et d’expériences disponibles;Aux Médias :• D’accorder tout l’intérêt requis àl’Agriculture et aux évolutions dumonde rural en sachant décrypterles politiques, les innovations enmatière de développement agricoleet rural ; traduire les progrès, lesdifficultés, les préoccupations etaspirations, et les succès du secteuragricole et du monde rural ; et donnerdes informations utiles au secteuragricole ACP, lui permettant, touten améliorant sa productivité et sesproductions, de réduire la nuisanceà l’environnement ;• De considérer l’expérience de terraindes exploitants agricoles comme unecomposante pertinente de l’informationagricole et économique et,par conséquent, de donner la paroleaux acteurs de terrain que sont lesexploitants agricoles afin de leurpermettre de se parler, d’échangerleur expérience, de mutualiser leursconnaissances ;
développement agricole etDE BRUXELLES• De faire du développement de l’informationagricole une composantede leurs stratégies de long termeen favorisant la spécialisation et lerenforcement de capacité permanentde leurs équipes ;Aux opérateurs agricoles :• De prendre conscience d’une partde leur statut d’acteurs de validationde toute politique, techniqueet/ou technologie, d’autre part deleur qualité corrélative de producteurset de faiseurs d’information,et conséquemment de s’ouvrir aupartage de leurs expériences parvoie des médias ;• De créer les conditions d’optimisation,de diffusion et d’échange de toutesles formes de savoirs et connaissancesdont ils sont dépositaires ;Aux Chercheurs, Scientifiques& Universitaires :• D’orienter leurs travaux dans lesens, d’une part, de la satisfactiondes besoins et attentes du secteuragricole en général et des exploitantsagricoles en particulier et, d’autrepart, de la capitalisation des connaissancestraditionnelles ;• De traduire dans un langage accessibleau plus grand nombre, les fruitsde leurs travaux concernant le développementagricole et rural ;• De favoriser l’implication réelle etactive des médias et des différentesparties prenantes au développementagricole et rural, à tous les niveauxpertinents du cycle d’élaborationdes politiques ;• De créer les conditions institutionnelles,organiques et matérielles endogènesde développement des médias etde leur compréhension des questionsliés au développement agricole etrural dans les pays ACP ;A la Communauté des partenairesau développement despays ACP et le secteur privé :• De maintenir le développement agricoleet rural dans les pays ACP commeune priorité sur l’agenda internationalet d’agir en conséquence dans le cadrede leurs interventions diverses ;• D’œuvrer dans le sens du renforcementdu secteur agricole et du développementrural dans les pays ACP ;Le séminaire étant arrivé à la conclusionque la non perception de l’Agriculturecomme un secteur prioritaireméritant toutes les attentions, aussibien des gouvernements que des différentescatégories de partenaires audéveloppement, est l’une des raisonsfondamentales du faible intérêt queles médias ont longtemps accordé audéveloppement agricole et rural dansles pays ACP, appelle donc :• A intégrer dans son plan d’actionpour les années à venir, autant quefaire se peut, celles des recommandationsqui rentrent dans son champde compétences ;• A créer les conditions d’un suiviévaluationdes retombées du présentséminaire.Il prescrit à court terme :• La promotion de mécanismes departage d’expériences, d’informationet de mise en commun des connaissances;• Le renforcer des capacités intellectuelles,matérielles et techniques desdifférents groupes de médias ;• L’établissement d’interactions dynamiquesentre les différents groupesde médium et de partenariats fructueuxentre les différents groupesd’acteurs du développement agricoleet rural dans les pays ACP ;• L’ajustement des systèmes de renforcementde capacité aux fins de leuradaptation aux défis de l’interfaceMédias - Agriculture.Fait à Bruxelles le,15 octobre 2009Aux Etats & Organisationsrégionales :• De véritablement faire du développementagricole et rural, un objectiffondamental des stratégies, politiqueset autres plans de développementnational et régional des ACP ;Le Centre Technique deCoopération Agricole etRurale ACP-UE (CTA) :• A faire une large diffusion, auprèsdes autorités et des parties prenantesdes pays ACP, des recommandationsde ce séminaire ;21
V - RésumésTRAITEMENT DES QUESTIONS DE DEVELOPPEMENTAGRICOLE ET RURAL PAR LES MEDIAS22FILMS SUR LEDEVELOPPEMENT :LA VIDEO AU SERVICEDU CHANGEMENT ENMILIEU RURALMr Andreas Mandler etDr Rico LieUniversité de Wageningen,Pays-BasCet ouvrage porte sur l’utilisation de lavidéo dans les interventions en milieurural, au service du changement social.Il donne un aperçu de la diversité desusages de la vidéo et de son caractèrecréatif dans les activités de développementrural. Forts de leur expériencedans ce domaine, les auteurs du livreentendent encourager les professionnelsdu développement à explorer lespossibilités qu’ils ont de faire de lavidéo un outil de développement à lafois plus cohérent, mieux compris etplus adapté pour, en somme, réaliserdes films destinés à promouvoir lechangement social.Cela fait plus de 30 ans qu’on se sertde la vidéo pour promouvoir le développement,mais ce n’est qu’avec l’avènementde la vidéo numérique que lematériel de tournage et de montage defilms est devenu abordable et facile àutiliser. Mais malgré la forte montée enpuissance de l’usage de la vidéo dansles activités de développement, on nedispose que de très peu d’informationssur les modalités pratiques d’utilisation,allant de l’élaboration de stratégiesde développement, à la projection defilms, en passant par la préparation,le tournage et la distribution. On aconstaté dernièrement un vif intérêtpour la vidéo participative, notammenten ce qui concerne l’implication desagriculteurs mais, à titre comparatif, lesvidéos à vocation éducative ou didactiquesuscitent peu d’attention. Il existe,par exemple, très peu d’ouvrages quiexpliquent comment utiliser la vidéopour promouvoir l’apprentissage desadultes ou stimuler l’expérimentationchez les agriculteurs.On note une certaine confusion, parexemple, à propos du degré de professionnalismerequis pour concevoir,produire et utiliser la vidéo dans lesactivités de développement. Quelsprofessionnels faut-il impliquer ? A-t-onbesoin de différents types de professionnels- des cinéastes, des facilitateurs,des experts en gestion, desspécialistes de la communication oude personnes ayant des compétencestechniques particulières ? Il y a aussiconfusion sur les termes “participation”et “vidéo participative”. La participationest, certes, un concept clé maisnous devons être plus précis sur lesmodes de participation concrète à laréalisation des vidéos pour le développementet sur les étapes durantlesquelles cette participation doit êtrerecherchée (par exemple, l’écriture descénarios, la réalisation, le tournage,le montage, etc.).LES MEDIAS DU PACIFIQUEET LA RECHERCHED’INFORMATIONS SURLE DEVELOPPEMENTAGRICOLE ET RURALMme Viola UlakaiTonga Broadcasting &Television Corporation (TBC),Royaume de TongaDans la région Pacifique, trouver dessources d’informations sur le développementagricole et rural n’estpas chose aisée. Cet exposé tenterad’identifier les difficultés qu’éprouventles médias à traiter correctement cesquestions, avec à l’appui différentstémoignages de journalistes de larégion qui ont bien voulu partager leursexpériences en matière de recherched’informations pertinentes. Selon unerécente enquête en ligne réalisée dansle cadre d’une campagne de plaidoyer,ces difficultés s’expliquent essentiellementpar le manque de programmesde renforcement des capacités et le faitque les médias ne sont pas considéréspar les acteurs du secteur agricolecomme des interlocuteurs valables,des partenaires et des collaborateursfiables, capables et désireux de diffusercorrectement l’information, sansparti pris aucun et dans un Anglaisaisément compréhensible ou dans lalangue locale. L’étude souligne égalementla nécessité de partager lesressources et les sources d’informations,notamment lorsque les uns oules autres n’ont pas la possibilité dese rendre dans des zones éloignéesou isolées. Autres défis identifiés : lemanque de collaboration entre scientifiqueset journalistes en vue de simplifierl’information, de sensibiliser lesmédias de la région à l’importancedu développement agricole et rural,et de faciliter la compréhension desmédias par les parties prenantes dusecteur agricole.Différents scénarios et témoignagesseront présentés, dans lesquels cesdifficultés ont pu être surmontées,
avec des suggestions sur ce qu’il estpossible de faire pour relever les défisposés.L’exposé reviendra également sur lesprogrammes proposés pour que larecherche de l’information soit considérablementsimplifiée tant pour lesjournalistes que pour les sourceselles-mêmes.Enfin, des recommandations serontformulées, que le CTA pourra éventuellementmettre à profit pour faciliteraux médias de la région la recherchede l’information sur le développementagricole et rural.LA “VOIX” DU VISUEL :DES STRATEGIESD’APPRENTISSAGE VISUELPOUR AMELIORERL’ANALYSE DES PROBLEMES,LE DIALOGUE SOCIAL ETLA PARTICIPATION VIALA MEDIATIONDr Loes Witteveen, IRDTUniversité de Wageningen,Pays-BasL’évolution constante des besoins enstratégies d’apprentissage innovantesdans le domaine des sciencess’explique par la complexité grandissantedes enjeux de société. Áces questions complexes, égalementqualifiées de “méchants problèmes”,il n’existe guère de solution unique etuniforme, juste ou injuste, bonne oumauvaise, car elles ont toutes traitaux valeurs et systèmes de notresociété. En effet, ce sont des problèmesdans lesquels sont impliquésde nombreux acteurs qui en ont,chacun, une interprétation différente.En réfléchissant à l’évolution du rôledes scientifiques qui en découle, onse rend compte de la nécessité destratégies d’apprentissage, capablesd’améliorer l’analyse des problèmeset de favoriser le consensus entreindividus concernés.Ce document porte sur un projet derecherche et de conception de stratégiesd’apprentissage visuel adaptéesà l’analyse des problèmes et à la formulationdes politiques, avec commeprincipal axe le dialogue ainsi que laparticipation des acteurs sociaux,des (futurs) praticiens et des décideurspolitiques. Une orientation quiprivilégie l’appréciation visuelle desproblèmes (Visual Problem Appraisal- VPA) et le tournage en caméraembarquée (Embedded Filming) :deux méthodologies utilisées dans lecadre du projet de “Gestion intégréedes zones côtières du Kerala en Inde”et du programme sur le “SIDA et laprofessionnalisation du développementrural en Afrique subsaharienne”. Lesfilms réalisés ont été utilisés dansdiverses situations et vus par différentspublics. Preuve que des réalitéscomplexes et des parties prenantesd’horizons divers peuvent se retrouverdans un même espace d’apprentissage,de réflexion et de dialogue au servicedu changement.Les résultats de la recherche montrentla pertinence et l’utilité de concevoiret d’élaborer des stratégies d’apprentissagevisuel, dans un contexte oùle développement rural constitue unenjeu crucial et où le support visuel(film/vidéo) offre des possibilitéssérieuses d’améliorer la participationet l’apprentissage des acteursvulnérable et marginalisés.INSTAURER UNE RELATIOND’AMOUR ENTRE LESMEDIAS ET LE SECTEURAGRICOLE ET RURALDr Eugenia SpringerES Production, Trinité-et-TobagoDans l’île caribéenne de Trinité (Trinitéet-Tobago),impliquer les médias,c’est se faire de l’argent. Constituésen majorité d’hommes et de femmesd’âge moyen, les agriculteurs rurauxsavent qu’ils doivent donner du secteuragricole et de ses acteurs uneimage plus attrayante pour inciter lesmédias à s’investir dans la constructiond’une “relation d’amour” entre producteursalimentaires et consommateurs.Selon certains agriculteurs interviewésdepuis leurs districts ruraux, il estnécessaire que le gouvernement etles autres parties prenantes aident àaméliorer l’image et le rôle des agriculteursdans la société. L’idéal, pource faire, serait de créer une société deproduction consacrée exclusivementà la couverture médiatique des questionsagricoles, avec pour objectif defamiliariser le public avec la nouvelleimage que l’on veut donner au secteuragricole, au milieu rural et aux agriculteurs.Une telle initiative permettraitégalement d’attirer les jeunes rurauxqui, souvent, délaissent l’agriculturepour d’autres emplois mieux rémunéréset moins éreintants. De même,cette société de production médiatiquepourrait être un pôle nationalcentralisant l’ensemble des réseauxd’information de la communautérurale. Grâce à des programmes dequalité, les agriculteurs espèrent ainsiattirer l’attention du gouvernementet des autres parties prenantes dontl’intervention permettrait de résoudreles problèmes liés au régime foncier,à l’affectation des terres cultivables,à l’accès équitable au matériel depréparation des sols, au nettoyage descours d’eau obstrués et à la gestionglobale des ressources en eau, à laconstruction de voies d’accès et àune supervision responsable de l’utilisationdes produits agrochimiques.Une société de production dédiée àl’agriculture, avec des moyens financierssuffisants et la collaboration desinstitutions d’enseignement ainsi qued’autres organisations agricoles nationaleset internationales, pourra mêmeopérer au-delà de l’État insulaire deTrinité-et-Tobago et être ainsi l’artisand’une véritable histoire d’amourentre les agriculteurs et les médiasdes Caraïbes.TRAITEMENT DESQUESTIONS DEDEVELOPPEMENT AGRICOLEET RURAL PAR LES MEDIAS :ENJEUX ET PROBLEMESMme Matho Motsou AnneJade, CamerounLes enjeux pour les médias dans letraitement des questions de développementagricole et rural sont :• Contribuer à l’amélioration desconditions de vie des communautésrurales en diffusant des informationssusceptibles de permettre uneaugmentation de leurs productionsagricoles ou animales. Pour ce faire,les médias doivent consacrer desespaces aux vétérinaires, agronomesetc. afin qu’ils apportent leurs expertisesaux différentes problématiquesque rencontrent les paysans pourentretenir leurs cultures et leursbêtes. Compte tenu de la pauvretédes paysans africains, les journalistes23
24doivent vulgariser des techniques etpratiques moins coûteuses et efficaces.Des paysans seraient heureuxd’apprendre en lisant un journal, parexemple, qu’ils peuvent donner despépins de papayes aux poules pourlutter contre les vers.• Assurer la diffusion des informationsde proximité. Il s’agit pour le journalisted’effectuer constamment desdescentes sur le terrain pour discuteravec les différents acteurs du développementrural que sont les associationsvillageoises, les ONG et les GIC,question de trouver un sujet d’actualitépour en faire un reportage ;le défi à relever étant d’informersur les réalités du terrain.Les problèmes que rencontrent lesmédias sont de deux ordres :• le manque de ressources financièrespour se rendre dans les zoneséloignées des rédactions avec pourconséquence, la couverture desmêmes zones par les médias ;• la manipulation du journaliste parcertains acteurs de développement.Comme par exemple, des responsablesde projets qui grossissentles retombées de leurs projets, oudes populations qui sont de mauvaisefoi.SIM-INFO ANOPACIM. Kouao Sylvain et BiatchonSéraphin - ANOPACI, Côte d’IvoireLe secteur agricole ivoirien subitune bipolarisation croissante entreagriculture industrielle et agriculturede subsistance, caractérisée par unpotentiel de rentabilité limité, et celadans un paysage médiatique qui aconnu un bouleversement depuis unedécennie ; mais il n’en reste pas moinsencore des obstacles à franchir. Lesmedias ont un impact énorme dansle milieu agricole. Ils sont dans biendes cas l’unique lien entre le monderural et le monde extérieur à causede son enclavement. En Côte d’ivoire,l’image de l’agriculture renvoyée parles médias est restée négative. Lenombre restreint et la diversité limitéedes publications et émissions, lechoix des sujets ainsi que les formesjournalistiques adoptées révèlent,cependant, une certaine superficialitédans la manière dont les médiasabordent le thème du développementagricole et rural. Aujourd’hui, ilexiste dans nos pays une vraie crisedans le traitement des questions dedéveloppement agricole et rural parles médias. Il existe très peu de journalistesayant les capacités de fairedes analyses pertinentes et de lesconfronter aux réalités du terrain, pourpermettre aux différents acteurs deprendre de bonnes décisions. Dans laplupart de nos pays, le traitement desquestions de développement agricoleest biaisé, car le traitement est faitpar les institutions internationales etne permet pas de gain de productivitéet d’amélioration des conditions de viedes ruraux. Dans les médias ivoiriens,le traitement des questions de développementrural est particulièrementmal loti. Les rédactions estiment cessujets peu attrayants pour les lecteurset les relèguent au dernier plan del’actualité nationale. La rareté desrubriques ou des émissions spécialiséessur l’agriculture le montre bien. L’autreaspect du traitement des questionsde développement rural concerne lesinformations qui proviennent du milieurural à destination des décideurs et desautres citoyens. Si le traitement desinformations venant du milieu ruralétait bien fait, cela aurait bouleverséles liens sociaux et des solidaritésnouvelles seraient apparues.Investir dans le traitement de l’informationagricole pour le développementexige d’être visionnaire. Les actions dedéveloppement qui mettent en œuvreles medias perdent parfois de vue ladimension humaine du processus. Uneapproche intégrée visant à améliorerles services offerts par les medias etdestinés au développement agricoleet rural a pour objectif de permettreaux ruraux d’accroître les ressourcescollectives nécessaires pour améliorerleur vie. Le traitement des questionsde développement agricole ne répondpas à une telle vision car trop souventabstrait et théorique.Grâce à son partenariat avec le CTA àtravers le projet Sim, l’Anopaci a aidéplus de 25 radios rurales à créer desémissions agricoles, avec un traitementde l’information adapté aux besoinsdes ruraux. Le contenu des émissionsradiophoniques et du journal a étérendu accessible aux agriculteurs grâceau recours à un langage courant, ainsiqu’à une approche fondée sur l’expérienceréelle de celui à qui l’informationest destinée. Le traitement desquestions de développement agricolepour ce qui concerne les agriculteursdoit prendre en compte l’expérienceréelle de l’environnement des agriculteurs,leur mentalité et leur systèmede savoir. Dans ce contexte, le contenude l’information prend un sens concretcar les agriculteurs vont l’intégrerdans leurs activités et leurs prises dedécisions quotidiennes. Aujourd’hui,l’utilisation de la télévision et de lavidéo pour résoudre une partie du problèmedu traitement des questions dedéveloppement est la voie empruntéepar l’Anopaci. Les yeux n’ont pas debarrières. Les émeutes de la faim ontfait émerger des enjeux qui font quele traitement de l’information n’est pastoujours correct. C’est tout le traitementdes questions de développementpour rendre l’information disponibleface à la demande qui nécessite travailet réflexion.LES MEDIAS DANSL’AGRICULTURE :“NOUS NE JOUONS PASLES SECONDS ROLES”M. Phil Malone - CountrywiseCommunication, Royaume-UniAprès avoir travaillé dans la productionde matériels de formation dans lespays ACP pendant plus de 24 ans,nous estimons devoir aujourd’huirendre hommage au talent des professionnelsde la communicationagricole et encourager la productiond’informations et de matérielsde formation à la fois utiles, à faiblecoût et de qualité.Même si on trouve, aujourd’hui, descaméras vidéos numériques dans lescoins les plus reculés, il est nécessairemalgré tout d’investir dans la formation,afin d’aider les professionnels desmédias et les agents de développementagricole à produire des informationsintéressantes, qui permettent auxagriculteurs en manque de tempsd’améliorer leurs revenus.Pour venir à bout de certains problèmes,la tendance est de plus en plus àun usage multiforme de l’information- comme bande-son par les radioslocales, sous forme de vidéos par lestélévisions locales et nationales etstockée sur des DVD distribués auxagriculteurs. Nous montrons, à titred’exemple, des films vidéo destinés àrelancer la production rizicole, réalisés
au Bangladesh et en Afrique par deséquipes locales et traduits en plusieurslangues locales. La planification etla préparation des films sont tellesqu’il est facile de suivre le processusde production du début à la fin et cesont de vrais agriculteurs, donnantconseils et recommandations, qui ensont les acteurs.Le défi pour l’avenir consiste à impliquerceux qui souhaitent investir dansles zones rurales - opérateurs detéléphonie mobile, banques, ONG etagences Internationales - pour mettreà profit les technologies de communication,de sorte que les niveaux decompétences en milieu rural puissentêtre améliorés. Une fois disponiblesur le marché, le produit final feraalors l’objet d’une forte demande dela part de l’utilisateur final, et desprogrès majeurs seront réalisés àmesure que s’accélérera le processusde communication transfrontières.C’est pourquoi nous devons utiliser latechnologie appropriée, afin que nosagriculteurs-champions puissent eninspirer d’autres et apporter ainsi lapreuve que les médias ne jouent pasles seconds rôles dans l’agriculture.METTRE A PROFIT LEMULTIMEDIA POURPROMOUVOIR LEDEVELOPPEMENTAGRICOLE ET RURAL :LA “BOTTE SECRETE”DU CABIMme Janny VosCABI - Royaume-UniFort de plus de 90 ans d’expérience etde collaboration avec différentes partiesprenantes dont des chercheurs,agents de vulgarisation, décideurs,formateurs, fournisseurs d’intrants,négociants et producteurs agricoles,le CABI est parfaitement conscient durôle que jouent les différents médiasdans un bon plan de communication.En effet, dans de nombreux pays, leCABI mène “en coulisses” des activitésdans la radio, la vidéo, la télévision etle Web, afin de promouvoir le partageet la diffusion d’informations et detechnologies agricoles.La presse écrite et la presse électroniquesont complémentaires mais leurefficacité varie selon le public visé etl’objectif poursuivi. En effet, c’est enfonction de ses préférences que l’usageropte pour tel ou tel média et c’estce choix qui, à son tour, déterminel’adoption et l’impact dudit média. Laradio et la vidéo restent des moyensefficaces de communication entreagriculteurs. Les messages doiventêtre simples et les émissions fairel’objet d’une large publicité avantleur diffusion. Il est utile de recourirà divers supports de communication(affiches, dépliants, manuels,CD-ROM, radio et vidéo) pour, parexemple, faire connaître les résultatsde recherche, promouvoir la formationet sensibiliser davantage les différentsgroupes d’acteurs à des problèmescomplexes tels que les épidémies deravageurs.Une utilisation et une évaluation efficacesdes médias passent nécessairementpar un plan de communicationbien ficelé, qui apporte des réponsesclaires aux questions - “quoi ?”, “qui ?”,“quand ?” et “comment ?” - concernantle message diffusé. C’est dans ce sensque le CABI a mis au point et testédes stratégies de communication enAfrique, avec notamment pour objectifsde : a) sensibiliser l’opinion à l’impactdes espèces végétales envahissantes,à la lutte et à la prévention contre cephénomène (en Éthiopie, au Ghana, enOuganda et en Zambie) ; b) créer uneplate-forme de partage des connaissancesaux fins d’une campagne desensibilisation à la maladie de la marbruredu manioc (Région d’Afriqueorientale et centrale). On a pu ainsinoter une sensibilisation accrue despopulations dans les pays ciblés.En collaboration avec ses partenaires,le CABI gère actuellement un systèmemobile d’information agricole via Internet,qui met à profit les technologiesSMS, e-mail et sans fil pour promouvoirle partage et l’échange d’informationsentre usagers vivant dans les zonesreculées. Le rôle des agences intermédiairesest par conséquent essentielpour délivrer les messages et assurerla pérennité de l’information.MEDIAS ET VULGARISATION ETAPPRENTISSAGE AGRICOLES“LA VOIX DU PAYSAN” ETLA VULGARISATION DEL’INFORMATION AGRICOLEAU CAMEROUNMme Marie Pauline VoufoAude Ehlinger (Présentatrice)La Voix du Paysan, Cameroun“Je suis devenu entrepreneur agricoleen lisant vos fiches techniques” ;c’est le résumé des propos de M.Mba André Marie, fidèle lecteur dujournal La Voix Du Paysan, rencontréen janvier 2008 dans son exploitationde palmier à huile située non loinde la localité d’Edéa dans la régiondu littoral camerounais. Il n’est passeul à tenir un tel langage à l’endroitde La Voix Du Paysan, ce journal depériodicité mensuelle qui paraît àYaoundé au Cameroun depuis plusd’une vingtaine d’années. Un concourslancé par le journal en fin d’année2007 pour jauger l’intérêt et l’impactde la publication en milieu paysan a vula participation de plusieurs centainesde personnes qui n’ont pas tari detémoignages révélateurs sur leursréalisations agropastorales effectuéesjuste en lisant ce journal que certainesd’entre elles considèrent comme “lemiroir du paysan”.En fait, c’est à travers ses rubriquesfort bien élaborées et essentiellementà contenu technique et pratique, queLa Voix Du Paysan a conquis l’audience25
26des producteurs agricoles aspirantset avérés sur le territoire camerounais.Un sondage réalisé auprès dulectorat en décembre 2008 et janvier2009, a consacré la rubrique “Fichetechnique” comme la préférée deslecteurs. Espace consacré à l’apprentissagedes techniques culturales etpastorales, la “Fiche technique” estconçue pour vulgariser les informationspratiques et actuelles sur lesspéculations agropastorales qui ontcours au Cameroun. Désormais, elles’étend à la vulgarisation des informationssur la transformation desproduits agricoles et les circuits decommercialisation.ROLE DES MEDIAS :COMBLER LE “FOSSE”ENTRE LABORATOIRES ETEXPLOITATIONS AGRICOLESM. Sunil Kumar SingUniversité du Pacifique Sud, FidjiLes médias comme la radio, la télévision,les cassettes vidéo, les journauxet magazines peuvent jouerun rôle majeur dans la diffusion desrésultats de la recherche agricoleauprès des paysans. Les Îles Fidjicomptent au total 11 stations de radio,qui proposent des programmes en3 langues (anglais, fidjien et hindustani),cinq journaux (quotidiens)paraissant en 3 langues et deux sociétésde télévision dont la majorité desémissions sont diffusées en anglais.Si, aujourd’hui, la plupart des agriculteursfidjiens ont régulièrementaccès à la radio, à la télévision et auxjournaux, très peu de programmessont cependant consacrés à l’éducationet à l’information des paysansconcernant la lutte contre les nuisibles,l’utilisation des technologies etles bonnes pratiques agricoles. Lesrésultats de la recherche scientifiquesont souvent réservés aux revuesuniversitaires, guère accessibles auxagriculteurs et même lorsqu’elles lesont, la présentation desdits résultatsest trop technique pour qu’ils puissentles comprendre et les appliquer.Cet écart de connaissances entreagriculteurs et chercheurs agricolespeut être comblé grâce à l’interventiondes journalistes, qui vont ainsiconstituer un lien important entreles deux groupes d’acteurs. Pour cefaire, les chercheurs doivent fourniraux journalistes une interprétationclaire des résultats de recherche censésêtre utiles aux agriculteurs, pourqu’ils puissent être diffusés le pluslargement possible et mis à profitpar le maximum d’usagers. Au coursde l’exposé, une courte vidéo seraprojetée pour montrer comment lesrésultats de recherche peuvent servirà éduquer et former les agriculteursavec l’aide des médias.LA RADIO RURALE:UN MOYEN DE PROMOUVOIRDES SERVICES DEVULGARISATION AXES SURLA DEMANDE AU MALAWIM. Rex Chapota - African FarmRadio Research Initiative, MalawiAu Malawi, les émissions radiophoniquesont fait sensiblement progresserla demande en services de vulgarisationagricole. En effet, Farm RadioInternational a commencé à mettreen oeuvre l’Initiative de recherche surles radios rurales en Afrique (AFRRI),un programme participatif et multiacteursaxé sur la recherche et l’actionet destiné à identifier, documenter etdiffuser les meilleures pratiques enmatière de communication radiophonique,avec pour objectif de renforcerla sécurité alimentaire au Malawi,mais aussi dans quatre autres paysque sont le Ghana, le Mali, la Tanzanieet l’Ouganda. Dans le cadre de ceprocessus de mise en œuvre, l’AFRRItravaille en partenariat avec cinq stationsde radio publiques, privées etcommunautaires. Le département encharge des services de vulgarisationagricole du ministère de l’Agriculture etde la Sécurité alimentaire collabore, àtitre de partenaire, à la production decontenus et à des travaux de réflexiontant à l’échelle nationale que communautaire.Grâce aux programmes diffusésdans le cadre de cette campagnede communication radiophonique, lademande en services de vulgarisations’est accrue à tel point que les agentscommunautaires ont déclaré avoircommencé à lire beaucoup plus surles technologies agricoles qu’ils ne lefaisaient auparavant, car les paysansleur posent des questions relatives auxémissions. De même, les agriculteursont commencé à envoyer des requêtesaux responsables pour que desagents de vulgarisation se rendentdans certaines communautés pourfaire la démonstration de ce que lesauditeurs avaient entendu à la radio.Une attitude en droite ligne avec lapolitique nationale de promotion desservices de vulgarisation axée surune demande pluraliste et les agriculteurssont devenus “proactifs”.Les producteurs radio font égalementintervenir des agents de vulgarisationlors de leurs émissions, pour qu’ilsfournissent personnellement et endirect des informations aux auditeurs ;ce qui accroît leur responsabilitévis-à-vis des conseils qu’ils peuventprodiguer aux paysans et des activitésqu’ils sont censés mener sur leterrain. Les programmes radiophoniquesinterpellent aussi les services devulgarisation pour une normalisationde l’information agricole, puisque lespaysans ont tendance à comparer cequ’ils entendent à la radio à ce que leurdisent les autres parties prenantes.CONNAISSANCE,RESEAUTAGE ET DIVERSITE :DES OPPORTUNITES POURLE JOURNALISME AGRICOLEEN AFRIQUEM. David Mowbray - BBC WorldService Trust, Royaume-UniMême si l’on reconnaît que l’agricultureest peu traitée dans les médias enAfrique, le secteur ne fait toujours pasl’objet de reportages dignes de ce nom.L’International Food Policy ResearchInstitute (IFPRI) a donc demandé auBBC World Service Trust de mener uneétude pour tenter de comprendre lescauses sous-jacentes de cette insuffisancede couverture par les médias.Nous présentons ici les premiers résultatsde l’étude en question.DES APPROCHESINNOVANTES POURAMELIORER L’ACCES AL’INFORMATION AGRICOLE :ETUDES DE CAS PRATIQUESDr O. I. OladeleUniversité du BotswanaCe document propose des approchesnovatrices pour améliorer l’accès à
l’information agricole. En effet, dansde nombreux pays où l’agricultureconstitue le moteur de l’économie,diverses péripéties d’ordre social,économique, culturel, technologiqueet politique entravent particulièrementla diffusion de l’information.Plusieurs approches sont ainsi préconisées,parmi lesquelles : l’identificationdes besoins en informationsagricoles et non agricoles, la sensibilisationdes journalistes à l’actualitérelative au développement agricoleet rural ; la prise en compte effectivede l’équilibre homme-femme ;la stratégie d’une communicationmultimédia ; l’encouragement desusagers de l’information à faire partde leurs réactions ; le recours à dessources d’informations multilingues,l’usage de la vidéo et d’autres TICpour compléter la communicationen face à face avec les agents devulgarisation et le partenariat avecles fournisseurs de services d’information.L’auteur explique commentces approches ont permis d’améliorernotablement l’accès à l’information desdifférents acteurs du secteur agricole,en prenant en compte les besoins desclients en matière de vulgarisationet en instaurant une relation étroiteentre chercheurs, vulgarisateurs etagriculteurs, afin de faire de l’innovationagricole une réalité. Différentesapproches novatrices, qui ont déjà faitleurs preuves au Nigeria, au Botswanaet dans d’autres parties du monde,sont évoquées sous formes d’étudesde cas, avec des suggestions sur lespossibilités pour d’autres pays demettre à profit ces innovations.LES OBSTACLES AL’UTILISATION DES MEDIASPOUR PROMOUVOIRLA VULGARISATION ETL’APPRENTISSAGE ENMILIEU RURALM. Charles Oduor OgadaCentre de ressourcescommunautaires d’Ugunja (UCRC),Kenyaministère kenyan du Plan stratégiquepour l’agriculture 2006-2010).Malgré l’importance du secteur, laproduction agricole n’a pas enregistréde hausse notable au cours des 10dernières années. Toutefois, l’agriculturecontinue de jouer un rôle clédans la réalisation du potentiel querenferme l’Afrique et des Objectifsdu Millénaire pour le développement(OMD) et, en particulier, dans l’éradicationde l’extrême pauvreté et lafaim à l’horizon 2015.Le secteur agricole fait face à denombreux défis tels que la malgouvernance,le manque d’accès à l’information,la faiblesse des politiques devulgarisation, l’étroitesse des marchéset l’instabilité des conditions météorologiques.Les médias se révèlent êtreun outil puissant et très efficace detransformation du secteur. L’utilisationdes médias devient chose courante etnombreuses sont les études de cas oùles médias ont aidé, avec succès, àinformer les paysans, mobiliser l’opinionet éduquer la population. AuCentre de ressources communautairesd’Ugunja (UCRC), nous mettons àprofit divers supports de communicationtels que les enregistrementsaudio, la presse écrite et les médiastraditionnels, pour aider à la diffusionet à la présentation des technologiesagricoles de manière plus conviviale,aux fins de stockage et de partage del’information.Bien que le recours aux médias pourpromouvoir la vulgarisation agricoleet l’apprentissage se révèle efficace,il n’est pas toujours facile de s’attacherleurs services, et nombreuxsont les obstacles qui entravent leurmise à profit en milieu rural. Parmi lesdifficultés les plus notables figurent,notamment, la médiocrité des infrastructures,le manque de contenus, lafaiblesse des politiques de communicationet le coût des services.L’UCRC s’efforce d’y remédier en créantdes Centres de ressources communautairesd’apprentissage pour faciliter lafourniture et le partage d’informationsen milieu rural et pour promouvoir letravail en réseau.ROLE DES MEDIASDANS LA DIFFUSION DESPRATIQUES AGRICOLESDURABLES AUPRES DESPETITS EXPLOITANTSAGRICOLES AU KENYAM. John CheburetThe Organic Farmer, KenyaLe Kenya est un pays essentiellementagricole. Son développement économiquedépend du secteur de l’agriculturequi emploie plus de 70% de lapopulation active. Toutefois, comparéà ses voisins que sont la Tanzanie etl’Ouganda, le Kenya connaît une graveinsécurité alimentaire. Une situationdue à de nombreux facteurs dont lesplus importants sont le coût élevé desintrants, les conditions climatiqueschangeantes et des pratiques agricolespeu respectueuses de l’environnement.De plus, les services publics de vulgarisationne sont pas suffisammentéquipés pour aider les agriculteursà relever ces défis. Il est importantque des informations utiles, scientifiqueset pertinentes sur les pratiquesagricoles durables puissent parvenirà la communauté des agriculteurs entemps opportun.Ce document revient sur l’expériencedu magazine et du programme radiophoniqueThe Organic Farmer (TOF) auKenya dans l’établissement de partenariatavec des groupements paysans,dans le but d’améliorer l’accès à l’informationsur les pratiques agricolesdurables qui permettent d’accroître àla fois les revenus des agriculteurs etla sécurité alimentaire. L’auteur laisseentendre qu’une approche participativede la part des médias non seulementencourage davantage le partage del’information entre les différents agriculteurset groupes d’acteurs, maispermet également d’accélérer l’adoptionde technologies appropriées à mêmed’améliorer la production et de préserverl’environnement.27Dans les pays africains en développement,l’agriculture demeure lepilier de l’économie. Au Kenya, parexemple, le secteur agricole emploie80% de la population active, issue enmajorité des zones rurales (selon le
MEDIAS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE28LE CHANGEMENTCLIMATIQUE VU PARLES MEDIAS DANS LAREGION SADC :CAS DU MOZAMBIQUE,DU SWAZILAND ETDE LA ZAMBIEM. Parkie Mbozi - Institut PANOSAfrique australe - ZambieLa communication de masse, lorsqu’elleest bien planifiée et mise en œuvrede façon systématique, contribue nonseulement à l’élaboration et à la crédibilisationdu discours, qu’il soit politiqueou scientifique, mais égalementà une meilleure compréhension par lepublic du message véhiculé et, partant,à une réaction plus conséquente desdestinataires ciblés. En effet, le publicapprend énormément des messagesscientifiques transmis par les médiasde masse. Cependant, des questions seposent quant à l’efficacité et la capacitédes médias à susciter une véritableprise de conscience des problèmesliés au changement climatique. C’estpour tenter de lever ces interrogationsque l’Institut Panos Afrique australe acommandé une étude pour enquêtersur le traitement médiatique de laquestion, la sensibilisation des communautéset les réponses nationales auchangement climatique, ainsi que lesmesures d’adaptation mises en place.Cette étude a pour but d’examinercomment la question du changementclimatique est traitée dans les médiasen Afrique australe, et d’analyser lestendances lourdes du moment, lespoints forts et les points faibles notésaussi bien dans la presse papier quedans les médias électroniques.Selon les conclusions de l’étude, labase de connaissances des journalistestraitant du changement climatique etdes mesures d’adaptation reste limitée.Leur façon d’aborder le changementclimatique dans leurs médias respectifsn’est pas non plus très favorable, lesujet étant considéré par eux (rédactionset journalistes confondus) commepeu vendeur. De surcroît, les organesde presse ne disposent ni d’équipespécialisée dans le changement climatique,ni de journalistes couvrant exclusivementcette question. De même,ils ne bénéficient d’aucune mesured’incitation et de soutien pouvant lesencourager à traiter du sujet. D’oùla couverture limitée des questionsliées au changement climatique parles médias, sur lesquels, pourtant, lepublic compte pour être au courantde l’actualité et obtenir l’informationdont il a besoin. En outre, le public aune compréhension limitée du changementclimatique et des mesuresd’adaptation nécessaires. Enfin, lespolitiques et législations nationalesen la matière restent à finaliser, maisla coordination demeure insuffisantedans tous les trois pays étudiés.CHANGEMENT CLIMATIQUEET MEDIAS DANS LA REGIONPACIFIQUEM. Samisoni Pareti - IslandsBusiness International, Îles FidjiCe document donne un aperçu desefforts entrepris dans le Pacifiquepour mieux sensibiliser le public autravail des médias, ainsi qu’à à leursreportages et articles concernant lechangement climatique. Il met l’accentsur le phénomène unique qu’est lechangement climatique, en ce sensqu’il affecte tous les secteurs, quece soit le développement rural, laforesterie, la pêche ou la santé, avecdes incidences sur le développementsocioéconomique des populationsdu Pacifique. Il explique égalementpourquoi il est important d’impliquerles journalistes dans la lutte contrece phénomène exceptionnel.Il explique, dès le départ, les objectifsque les journalistes du Pacifique sesont fixés et qu’ils espèrent atteindreau sein de leurs groupes de médiasrespectifs, avec pour but de garantirune couverture médiatique continueet cohérente de ces questions et demettre en œuvre des programmes desensibilisation des communautés, desorte que le changement climatiquesoit au cœur des préoccupations et desstratégies de développement à l’échellelocale, nationale et régionale.Le document met ensuite l’accent surles difficultés des médias à traiter desquestions liées au changement climatique.Il s’agit notamment du manquede ressources, de financement et desubventions, mais aussi de l’absencede partenariat et de collaboration entremédias, gouvernement, partenaires audéveloppement et organismes techniqueset scientifiques régionaux. S’yajoutent le besoin de lignes directricesen matière de reportage, de partagede l’information avec les différentesparties prenantes et, plus importantencore, le besoin de sources d’informationscrédibles, basées sur des donnéeset statistiques fiables, d’autant plusque le changement climatique est denature scientifique.Il évoque aussi les difficultés duesà l’insuffisance des programmes derenforcement des capacités, commela formation et les ateliers à l’intentiondes médias et des différentes partiesprenantes - y compris les responsablesgouvernementaux, les scientifiques etles experts - sur le rôle et le travaildes uns et des autres.Il souligne, en outre, la nécessité depromouvoir le réseautage et le rôleimportant que jouent les médias,notamment en termes d’éducation,d’information et d’autonomisation despopulations par rapport au changementclimatique et aux enjeux qui ontdes incidences sur leurs moyens desubsistance, leur capacité de travail etsurtout la vie des habitants de cetterégion insulaire.Enfin, il évoque un programme encours d’élaboration dans le Pacifique,destiné à améliorer le travail de sensibilisation,grâce à la communication,aux questions environnementales tellesque le changement climatique.CONTRIBUTION DESRADIOS COMMUNAUTAIRESA LA COMPREHENSION DESIMPACTS DU CHANGEMENTCLIMATIQUE SUR L’AGRI-CULTURE A KOUTIALA, MALIM. Moctar Niantigui CoulibalyAlliance des radioscommunautaires du MaliLe changement climatique constituede nos jours un handicap majeur au
processus de développement durableen général, et au développementagricole en particulier. Selon les prévisions,le climat du Mali sera pluschaud, plus sec et plus variable, et lestempératures moyennes pourraientmonter jusqu’à 45°C d’ici à 2025.Ces modifications du climat menacentdangereusement les activitésagricoles et la sécurité alimentairedes populations maliennes. Or auMali, les populations dépendent absolumentde l’agriculture, et l’agriculturedépend absolument du climat ;cette dynamique de la vie devient deplus en plus précaire. Le changementclimatique affecte le droit des populationsau développement.Les nouvelles directives nationaleset internationales sur le sujet sontpeu connues des agriculteurs vivantdans les principales zones agricolescomme Koutiala. Ces communautésagricoles sont pourtant parmi les plusvulnérables et leur activité vitale estsoumise aux effets néfastes du changementclimatique.L’Alliance des radios communautairesdu Mali (ARCOM) a mis en œuvre, àtravers six (6) radios communautairesmembres, une campagne radiophoniquesur ce phénomène. Plusieurs émissionsinteractives ont été réalisées,permettant ainsi à chacun d’apportersa contribution à trois niveaux :1 l’intermédiation pour une mise enrelation et une synergie d’actionsdes différents acteurs ;2 l’investigation pour assurer la compréhensionde la vulnérabilité descommunautés locales ;3 le plaidoyer en faveur de la mise enœuvre concertée d’actions appropriéespour l’adaptation des communautéslocales au changementclimatique.L’objectif final de cette campagne étaitde permettre aux paysans d’avoir deséchanges avec les spécialistes maisaussi de pouvoir s’exprimer.CONCOURS D’ECRITURE DESCENARIOS RADIOS POURPROMOUVOIR L’APPREN-TISSAGE DES DIFFUSEURSAFRICAINS SUR LES THEMESD’INTERET POUR LESPETITS AGRICULTEURSMme Blythe McKayFarm Radio International, CanadaDepuis 2005, Farm Radio International,en collaboration avec d’autres partenaires,a organisé trois concours d’écriturede scénarios pour des radiodiffuseursde pays d’Afrique subsaharienne. Lepremier portait sur les Objectifs dumillénaire pour le développement, ledeuxième sur les stratégies d’adaptationdes petits exploitants agricoles etle dernier, en cours, met en vedettel’innovation dans l’agriculture familiale.Ces concours visent non seulementà renforcer la capacité des organisationset particuliers qui travaillentdans la radio à élaborer des scénarioset des programmes radiophoniquessur le thème en question, mais aussià accroître les émissions de qualitésur ce sujet dans toute l’Afrique subsaharienne.Selon les conclusions d’une étuded’évaluation du concours sur le changementclimatique :• Les ressources mises en place pouraider les scénaristes ont été bienaccueillies et appréciées commeétant d’une grande utilité.• Le concours a été une excellenteoccasion d’offrir un encadrement auxprofessionnels de la radio dans l’écriturede scénarios et la conceptiondes programmes de radio rurale.• Le concours a permis de multiplierle nombre de scénarios de qualitédisponibles sur le changement climatique.• Les parties prenantes, y compris lescandidats en compétition, considèrentque le potentiel d’apprentissagede ce type de concours serait mieuxmis à profit si l’événement étaitrécurrent.3“Sowing the Seeds” : un rapport de l’organisation International Women’s MediaFoundation sur le traitement de l’agriculture par les médias, 20084Expression utilisée dans le milieu des médias pour faire référence àl’augmentation ou non des ventes ou de l’intérêt du public.5Le verbe traiter/couvrir signifie ici réaliser des reportages et publier des articles(presse écrite ou en ligne) ou diffuser des programmes (télévision et radio).6Bureau ougandais des statistiques, chiffres issus du recensement de la populationougandaise (Uganda National Housing and Population Census), 2002.7Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique,Notes sur le budget national 2009/2010, avril 2009.8http://www.huffingtonpost.com/2009/02/24/profound-disconnectbetwe_n_169647.html• Les scénarios sont très largementutilisés et appréciés par les diffuseursqui les reçoivent.• Les programmes radiophoniquesproduits sur la base des scénariosont beaucoup de succès auprès dupublic.• Des témoignages anecdotiques laissentà penser que les programmesradiophoniques qui s’inspirent de cesscénarios ont changé les pratiquesagricoles locales.Le concours actuel porte, pour la premièrefois, sur la formation en lignepour aider les candidats à élaborer leursscénarios. La présentation du panel varéfléchir à la possibilité de faire évoluerce modèle de concours d’écriture descénarios en outil d’apprentissage.DEFIS ET OPPORTUNITESDU REPORTAGE ET DE LACOMMUNICATION SUR LESQUESTIONS AGRICOLES ETRURALESM. Gerald Businge - M. RisdelKasasira (Presentateur), OugandaLe traitement limité des questionsagricoles par les médias en Afrique afait l’objet d’une étude approfondie 3 .La pression qu’exercent sur les médiasles sujets censés attirer le public etl’idée selon laquelle “l’agriculture nese vend pas bien” 4 ont contribué àlimiter l’intérêt des journalistes etdes groupes de presse à traiter 5 desquestions de développement agricoleet rural. Pourtant, l’agriculture, qui faittravailler plus de 75% 6 des Ougandaiset contribue pour plus de 67% 7 auProduit intérieur brut du pays (PIB) estet devrait être un thème d’intérêt pourla majorité de la population. Au coursdes 10 dernières années, le journalThe New Vision www.newvision.co.uga publié tous les mercredis deux pagesentièrement consacrées à l’agriculture,avec l’actualité du secteur et lesmeilleures pratiques comme principalcontenu. En 2008, suite à une initiativeinterne, le journal a ajouté uneautre rubrique intitulée “HarvestingMoney” (récolter de l’argent) qui faitle portrait d’agriculteurs réalisant degros profits. Au début de cette année,le Daily Monitor www.monitor.co.ug acommencé à consacrer quatre à huitpages aux questions agricoles, uneinitiative née d’un partenariat avec29
l’organisation International Women’sMedia Foundation www.iwmf.org surla production d’articles axés sur l’agricultureet les femmes en Afrique 8 .Quels résultats les initiatives de cesgroupes de presse ont-elles produit,du point de vue de la qualité et de laquantité des reportages réalisés ? Quelsenseignements tirer des initiatives quipeuvent engendrer une couverturemédiatique plus importante et unemeilleure communication de l’actualitésur le développement agricole et rural ?Comment faire pour que cette meilleurecouverture des questions agricolespar les médias puisse bénéficier auxcommunautés de base, étant donnél’accessibilité limitée des journaux, de latélévision et d’Internet et de la radio ?Le document tente de répondre à cesquestions après une étude approfondiedes initiatives évoquées.MEDIAS ET EGALITE DES SEXES30PROMOUVOIR L’EGALITEDES SEXES DANS LEDEVELOPPEMENT AGRICOLEET RURAL GRACEAUX TECHNOLOGIES DEL’INFORMATION ET DELA COMMUNICATION :MYTHE OU REALITE AUBOTSWANA ?Dr Bantu L. MoroLongUniversité du Botswana,BotswanaEn 2007, les femmes occupaient autotal près de 41% des emplois dansl’agriculture, alors qu’elles réalisaienten Afrique 80% des travaux liés audéveloppement agricole et rural. Dansles Caraïbes comme en Afrique subsaharienne,les femmes produisentjusqu’à 80% des denrées alimentairesde base. Malgré ces chiffres et, surtout,l’importante contribution de la populationféminine à la sécurité alimentairede nombreux pays africains, l’accès desfemmes aux infrastructures et outilsdont elles ont besoin - notamment lesmédias - pour effectuer efficacementleurs travaux agricoles - n’est toujourspas égal à celui de leurs homologuesmâles. Ce document reconnaît, à l’èrede l’information, le rôle des Technologiesde l’information et de la communication(TIC) dans le développement agricolede l’Afrique. Il tente toutefois d’évaluerdans quelle mesure l’utilisation de cestechnologies dans le secteur agricoledans le but, notamment, d’améliorerla productivité, l’accès aux marchés,la qualité des produits et l’accès àl’information nécessaire à la prise dedécisions efficaces, contribue à l’égalitédes sexes en Afrique, en général, etau Botswana en particulier. L’auteur sefonde sur des faits bien documentéset sur l’expérience de terrain pourmontrer que les planificateurs desprogrammes agricoles en Afrique perçoiventtoujours l’agriculture commeune profession d’homme. Résultat :l’utilisation croissante des médias dansce secteur continue de concerner leshommes et dessert, par conséquent, laquestion de l’égalité des sexes. Cettesituation pénalisante pour les femmesest exacerbée par plusieurs facteurs,notamment, la sous-représentationpersistante des femmes dans les filièresscientifique et technologique à l’école,dans les médias, dans les sphères dedécisions techniques et dans les instancesdirigeantes. Tout en défendantcertaines incursions faites pour remédierà une telle situation, le documentlaisse entendre, en conclusion, quecette ère d’expansion des TIC est unmoment opportun pour intégrer systématiquementau débat sur l’égalité dessexes la question des technologies del’information et de la communicationcomme un des principaux véhiculesde l’équilibre homme-femme dans ledéveloppement agricole et rural.LE DEVELOPPEMENTAGRICOLE ET RURALDANS LE PACIFIQUE :RELIER LA QUESTION DEL’EGALITE HOMME-FEMMEA CELLE DES MEDIASMme Bernadette Masianini,Secrétariat général de laCommunauté du Pacifique (CPS)FidjiMis en œuvre dans 16 pays et territoiresinsulaires océaniens, le projetCPS-UE pour le Développement del’agriculture durable dans le Pacifique(DSAP) a pour but de créer et de promouvoirune agriculture durable, afind’améliorer la production alimentaireet, partant, la sécurité alimentaire etles revenus des populations. Le projetDSAP met à profit des méthodesparticipatives et prend en comptel’égalité des genres dans la mise enœuvre de ses activités.En effet, les femmes jouent différentsrôles dans tous les domaines d’activité,y compris la production agricole,et leur participation est égalementmise à profit pour planifier la miseen œuvre, le suivi et l’évaluation desactivités du projet dans les pays etterritoires insulaires du Pacifique quien sont bénéficiaires.La participation égale des hommes etdes femmes et la prise en compte dugenre que promeut le projet garantissentque les informations qui parviennentaux groupes cibles répondent bienà leurs besoins de production agricole.Grâce à son approche participative, leprojet fonctionne et s’intégre parfaitementau contexte culturel et traditionnelde la communauté des îles du Pacifique,offrant ainsi des conditions idéales pourrelier égalité des sexes et médias.AGRICULTURE BIOLOGI-QUE, CHANGEMENT CLIMA-TIQUE, ALPHABETISATIONET BESOINS ALIMENTAIRESLOCAUX : QUEL ROLE POURLES MEDIAS ?Mme Dorienne Rowan CampbellNetworked Intelligence, JamaicaAu cours de notre collaboration avecun réseau de femmes agricultrices(appelé “Knowing and Growing -K&G”/Connaissances et Croissance)dans la région des Caraïbes, il nous estapparu que de plus en plus de femmescherchent à réapprendre les techniquesculturales et à adopter les principes de
l’agriculture biologique dans le cadrede leurs activités agricoles, à traversleur façon de vivre et les moyens desubsistance qu’elles ont choisis.Cette approche, d’abord motivée pardes préoccupations liées à la santé maisaussi par les avantages de la polycultureen général et la conservation dela biodiversité, de la santé des sols etdes ressources en eau, est devenuepar la suite une nécessité, surtout dansle contexte actuel de changement climatique.En effet, la monoculture, àl’instar de la culture sur abattis-brûlis,va à l’encontre de la protection des sols.Contrairement aux idées reçues surl’agriculture biologique, une questionà l’origine secondaire par rapport àl’orientation principale du réseau maisdevenue importante au fil du temps, lesrendements des cultures intercalaireset de l’agriculture biologique peuventsubvenir aux besoins alimentaireslocaux, et contribuer au maximum àla sécurité alimentaire de la région. Cequi a débuté comme un réseau d’agriculteurscherchant à se convertir au bios’est maintenu élargi aux agriculteurssoucieux de contribuer à une économiealimentaire saine et solide, dans uncontexte de changement climatiqueet de stress environnemental. Le rôledes médias est essentiel dans la luttecontre les idées reçues, en l’occurrencesur ces questions à la fois complexeset interdépendantes.Cette présentation d’étude de cas montrecomment l’agriculture biologiquepeut être une réponse viable au changementclimatique, à la prévention, àl’atténuation de ses effets et à l’adaptation,avec des exemples de fermesbio exploitées aux Caraïbes et donnedes indications sur ce qu’il convient defaire pour encourager le développementde l’agriculture biologique dansla région. Forts de notre expériencedans l’organisation de cinq ateliers deformation à l’intention de 150 femmesde la région, nous plaidons ici pourque les médias traitent davantage despréoccupations des petits exploitantsagricoles et des intérêts stratégiquesparticuliers des femmes agricultrices.Á cet effet, les trois principales tâchesqui incombent aux médias doivent êtreles suivantes :1. Relayer les témoignages d’agriculteurset les réalités de leur vie quotidienne -“Que se passe-t-il à la ferme ?”.Cette présentation d’étude de cas met àprofit une diversité de médias, allant desprogrammes conçus pour les stationsde radio locales, à la production dereportages vidéo, en passant par l’utilisationde Facebook par les membresdu réseau K&G. Elle montre, preuvesà l’appui, le rôle important que jouentles médias dans la sensibilisation del’opinion, l’acquisition de connaissancessur les pratiques en matière deproduction et le partage de l’informationlocale et régionale. Compte tenudes difficultés liées à la couverture decertains sujets par les médias grandpublic, il faut adopter des approchesalternatives pour partager l’informationqui ne fait pas forcément “la une desjournaux”.L’adaptation au changement climatiquedoit être intégrée et prise en comptedans les budgets nationaux, tout commedans les politiques globales de développement.Mais on ne peut y parvenirque si l’on comprend suffisamment lesréalités et les conditions de vie despopulations locales, mais aussi la façondont celles-ci sont intimement liées auxvariations du climat local. D’où l’urgentenécessité de renforcer les capacités,en termes de médias, des femmesagricultrices des Caraïbes. Bien queles ateliers de K&G aient régulièrementencouragé les médias à interviewer lespaysans et à mieux relayer leurs pointsde vue, beaucoup reste néanmoins àfaire pour s’assurer que ces agriculteurssont bien en mesure de parler de leursproblèmes, dans le cadre d’une relationconviviale public-médias. Il nous fautfournir aux médias nationaux, régionauxet indépendants des témoignages deterrain aussi divers que variés, pourpromouvoir l’agriculture biologiquedans la région.2. Être un outil de plaidoyer pour influersur les décideurs politiques.L’élaboration d’outils audiovisuelslocaux, spécialement dédiés à la formationdes agriculteurs, et de matérielde campagne publique destiné à lapopulation en général, doit aller depair avec la politique de sensibilisationet d’information nécessaire à l’endroitdes décideurs et des défenseurs d’uneéconomie régionale robuste et pérenne.Avec le changement climatique, lesfemmes doivent pouvoir travailler avecceux qui, au sein des gouvernementset des institutions, comprennent etdéfendent les intérêts des petits exploitantsagricoles. En effet, ces institutionsn’interviennent souvent qu’au niveaudes décisions politiques et ne travaillentpas directement avec les communautésde base, ni avec les agriculteurs. Lespersonnes adéquates visées au seinde ces institutions sont notamment lesresponsables chargés de la gestion desdéchets solides, les forces de sécuriténationale, la commission nationale del’eau, l’office de gestion des forêts, lesservices météorologiques, les organismesd’assurance contre les risquesclimatiques, les services en charge dudéveloppement du tourisme, de la pêcheet de l’aquaculture, de la gestion desterres côtières et de la réglementationde l’environnement. Autrement dit,les politiques en place, même si ellescontinuent d’évoluer, doivent faire l’objetd’un plaidoyer énergique et dynamiquepar et pour les femmes, et les médiasont ici un important rôle à jouer.3. Les médias fonctionnant comme unoutil de sensibilisation au changementclimatique.Les journalistes spécialisés doivent êtresoutenus et formés aux questions sectoriellesliées au changement climatiqueet à l’agriculture. La sensibilisation auchangement climatique passera parune série d’activités soutenues dansles domaines suivants :• des séances d’initiation aux causeset effets du changement climatique,une campagne d’explicationdes enjeux mondiaux et locaux duchangement climatique et de sensibilisationauprès des agriculteurs etconsommateurs ;• la poursuite du développement desréseaux numériques et l’améliorationde l’accès électronique aux informationset réseaux sur le changementclimatique ;• un passage en revue et une confirmationdes mesures d’atténuation etd’adaptation déjà prises par les agriculteurs,mais aussi des conseils surce qui peut être fait dans les Caraïbesà l’échelon local, en veillant à ce queles femmes puissent également faireentendre leur voix ;• une large gamme de compétences etde savoir-faire techniques en permaculture,en agriculture biologique et“au-delà”, doit être disponible pourcontrer l’influence des produits agroindustrielsgrand public (la facilité aveclaquelle on accède aux OGM, engraischimiques et autres pesticides, parexemple) ;• des actions de sensibilisation auxenjeux dont les agriculteurs n’entendentpas souvent parler, commel’accès à l’information sur la consommationd’énergie et les possibilités31
32de traitement des déchets agricolesaux fins de production énergétique ;l’optimisation de la séquestrationdu carbone au niveau des exploitationsagricoles et la réduction auminimum des émissions de CO 2;l’évolution de la production des biocarburants; les actions pratiques àeffectuer pour recueillir des donnéesmétéorologiques ; les projets futursconcernant l’assurance contre lesrisques climatiques et leur réductiondans la région ;• une meilleure compréhension du rôledes agriculteurs dans la réduction desémissions de carbone et du rôle desfermes agricoles dans la séquestrationdu carbone ;• une meilleure compréhension desaspects essentiels de la gestion desressources en eau pour les exploitationsagricoles et au-delà ;• une meilleure compréhension desrelations avec les services chargésde la gestion des forêts et des partenariatspossibles dans ce secteur.Un abandon systémique du modèleactuel de monoculture (que ce soitpour l’agriculture, l’élevage, l’aquacultureou la foresterie), au profitd’un système intégré de polyculture ;et enfin,• le lancement d’une campagne visantà mieux faire comprendre aux agriculteursles moyens traditionnels deprotection des cultures contre lesouragans.PRINCIPES DE GENRE DANSLES MEDIAS EN GUINEEMme. Mama Adama KeitaRadio Nationale, GuinéeLe paysage médiatique en Guinéeconnaît une certaine mutation avec lalibéralisation des médias du pays quis’est matérialisée le 20 août, en 2005,par l’installation et l’opérationnalisationdes radios privées, au nombrede 20 actuellement. Auparavant, ilexistait dans le pays une gammede journaux de la presse écrite et laprolifération des sites d’informationen ligne, en plus des radios ruraleset communautaires qui servent derelais à la Radio Télévision Guinéenne(RTG). Outre ces deux médias desservices publics, il y a la Radio KaloumStéréo (RKS) et la chaîne 2 de laTélévision nationale.Ces médias publics, qui couvrent l’ensembledu territoire national, diffusentdans les différentes langues nationalesdu pays et dans les langues étrangèresdont le français, l’anglais et l’arabe.L’existence des structures de formationen journalisme en Guinée offre,aujourd’hui, la possibilité à plus d’und’embrasser ce métier, et les femmesne sont pas en reste, surtout les jeunesfilles. Dans un passé récent, la majoritédes jeunes filles ou garçons s’intéressaitau métier de journalisme, à défautd’avoir intégré la Fonction publiqueou d’être employé ailleurs après avoirachevé leurs cycles universitaires. L’intégrationau sein des médias s’expliqueaussi par la facilité de recrutement horsnormes dont se servent les fondateursdes stations privées pour embaucher cesjeunes sans aucune garantie juridique,de formation et de traitement adéquaten faveur des postulants.Le métier de journalisme ne cesse doncd’attirer des filles et garçons ; ces derniers,qui rêvent de faire du chemin, sontconfrontés malheureusement aux nombreusescontraintes liées à l’exercice dumétier, une fois sur le terrain. Elles sonttoujours reléguées au second plan enterme d’accès et de maintien à l’école.Une situation qui trouve son origine dansles stéréotypes discriminatoires dansles sociétés traditionnelles. Selon lesstatistiques du Rapport Pays Guinée“Global Advocacy Project 2004-2005”, dans les stations communautaires,29% des agents ont un diplômed’enseignement supérieur, contre 3%chez les femmes. Et 71% exerçant lemétier de journalisme ont un niveaumoyen correspondant à l’enseignementprofessionnel avec une forte majoritéde femmes estimée à 55%.En effet, dans la répartition des sujetsde reportages sur des thèmes politiques,économiques, scientifiques,juridiques et/ou de guerres, le choixtombe souvent sur leurs confrères etcela, sur instruction des responsablesde stations qui estiment avoirun bon traitement de l’actualité qu’auniveau des journalistes hommes. Lanon-maîtrise de l’outil informatiqueet le harcèlement sexuel sont autantde facteurs qui influent négativementsur l’évolution de la femme au sein decette corporation.C’est une problématique par rapport àl’émancipation de la femme à cause,surtout, de sa vulnérabilité au plansocial et administratif et parfois, àcause de l’insuffisance de formationconstatée au niveau de cette couche,cela fait d’elles généralement desvictimes potentielles surtout pourcelles qui ont la chance d’avoir unfoyer avec tous ces aléas.La conciliation des programmes deterrain et des travaux ménagerss’avère donc difficile pour la femmeau foyer, et celles qui n’ont pas departenaires sont généralement maljugées par leur entourage. En dépitdes problèmes cités plus haut, laGuinéenne se distingue positivementdans ce secteur par l’attribution dehauts postes de responsabilité, qu’ellesoit ministre, directrice, rédactrice enchef ou fondatrice de journaux ou deradios privées.LE “KIT” DE RESSOURCESMULTIMEDIAMme Sylvie Siyam, CamerounMme Melanie HughesPrésentatrice PROTEGE QV - ,CanadaLe kit de ressources multimédia(MMRK) rassemble en un seul lottoutes les informations nécessairespour créer et améliorer la gestion desmicro-entreprises au Cameroun. Il estdisponible sous forme de CD-ROM, desite Internet et d’ouvrage imprimé. LeMMRK est destiné aux professionnelsde la radio qui élaborent des programmesde formation à distance,visant à renforcer les capacités desfemmes micro-entrepreneurs. Il peutêtre utilisé comme base principale oucomplément de ressources pour laconception et la réalisation de programmesdiffusés à la radio.Partant d’une enquête de terrainmenée en 2005, intitulée Formationdes femmes à la micro-entreprise aumoyen de programmes radiophoniques,PROTEGE QV a identifié letype d’informations dont ont besoinles femmes micro-entrepreneurs,ainsi que leurs habitudes d’écoutedes émissions de radio. Les donnéesrecueillies ont permis d’élaborer etd’organiser le MMRK en sept grandsthèmes liés à la micro-entreprise :• Démarrage d’unemicro-entreprise ;• Financement ;• Impôts et taxes ;• Gestion de la micro-entreprise ;• Formation et information ;• Amélioration de la production ;• Ecoulement des produits.
Un première version du projet a étéélaborée puis testée auprès de deuxstations pilotes - la Radio Yemba et laRadio rurale FOTOUNI - dans la provinceoccidentale du Cameroun. Cettephase pilote a également impliqué 6Groupements d’initiative commune(GIC) essentiellement composés defemmes travaillant dans l’agriculture,qui ont attentivement suivi les émissionsradiodiffusés afin d’évaluer lapertinence des contenus. L’objectifétait d’identifier les sujets traités lorsdu montage des programmes à l’aidedu MMRK et de découvrir les effetsproduits sur le travail des femmes surle terrain. Les difficultés soulevées àce stade préliminaire ont été prisesen compte pour améliorer le MMRKet finaliser le projet.La version définitive a été présentée aupublic le 3 septembre 2007. PROTEGEQV a organisé, pour cet événement, unatelier d’une journée sur l’utilisation duMMRK, auquel ont participé près de 20stations de radio urbaine et rurale, ainsique plusieurs groupements de femmesmicro-entrepreneurs. Les travauxconsistaient essentiellement à créer uncompte en ligne pour les radios et àleur montrer comment utiliser cet outilsur Internet. Un ouvrage relié du MMRKa été distribué à chacune des radiosà l’issue de l’atelier. Une enquête deterrain a ensuite été menée, en novembre2007, avec les deux radios piloteset les 6 GIC impliqués dans le projet,avec pour objectifs : d’assurer le suivide l’utilisation du MMRK ; de recueillirles informations nécessaires pour créerdes pages Web rendant compte dutravail et des progrès accomplis parles femmes, ainsi que de l’impact duMMRK sur leurs activités ; et enfin derenforcer la capacité des radios et desGIC à exploiter efficacement cet outilsur le Web.Grâce au moyen de communicationcourant qu’est devenue la radio, leMMRK permet aujourd’hui aux femmesd’avoir accès à d’importantes informationsautrement difficiles à obtenir.Fortes d’une information à la fois valide,pratique et pertinente, les femmessont non seulement à même de gérerleur apprentissage parce que sachantprécisément le type d’information dontelles ont besoin, mais elles peuventaussi solliciter des informations complémentairesou une formation pouraméliorer leur travail.FINANCEMENT DES MEDIAS DANS LE DARUNE COOPERATION PLUSETROITE EST-ELLE LASOLUTION AUX PROBLEMESFINANCIERS DES ORGANESDE PRESSE ACP ?M. Hans DetermeyerFree Voice Programme,Pays-BasCe document analyse certains enjeuxmajeurs liés au financement, à l’octroide crédit et à l’investissement dansles médias. Il explique “l’environnementhostile” dans lequel évoluent lesorganes de presse, tout en soulignantl’appui technique souvent limité dontils bénéficient, ainsi que les difficultésdes médias ACP à retenir en leur seinle personnel formé et expérimenté.L’auteur se penche également sur leproblème que constitue le manque decapitaux et suggère, en conclusion,des solutions pour surmonter cesobstacles, avec à l’appui des exemplespris dans différentes régionsdu monde.FINANCEMENT DES MEDIASET DEVELOPPEMENTAGRICOLE ET RURALM. Michael WaigwaCooperative Insurance Company,KenyaLe renforcement du rôle des médiasdans le développement agricole etrural passe nécessairement par unfinancement conséquent des organesde presse. L’orateur explique l’enjeu dufinancement par rapport à l’importancedes médias “axés sur la demande” pourle secteur du développement agricoleet rural. Il rappelle, d’une part, quede nombreux organismes - groupesindustriels, banques et compagniesd’assurance, agences gouvernementaleset instituts de recherche - seraientprêts à financer substantiellement lesmédias au service du développementagricole et rural. Mais il n’en insistepas moins, d’autre part, sur le besoind’autofinancement des médias quis’adressent aux agriculteurs et quirépondent à leurs préoccupationsspécifiques, en citant comme exemplel’industrie laitière au Kenya.AGRICULTURE,FEMMES ET MEDIAS :LES INVESTISSEMENTSESSENTIELSMme Cece FadopeInternational Women’s MediaFoundation (IWMF), États-UnisCet exposé porte sur une initiative del’IWMF qui promeut l’investissementen faveur des femmes, des médias etdu développement agricole et rural.Il s’agit du projet “Reportages surles femmes et l’agriculture : le casde l’Afrique”, dont les objectifs sontles suivants : garantir une couverturemédiatique concise, cohérente et plusrigoureuse de l’actualité sur le développementagricole et rural ; prendreen compte le rôle, les témoignages, lesbesoins et les solutions des femmesdans le traitement par les médias del’information concernant l’économieagricole et rurale ; et promouvoirdavantage l’égalité entre les sexesdans les salles de rédaction. L’auteurcite quelques exemples en rapport avecle projet et conclut son exposé par uneliste d’indicateurs de succès.PRINCIPALES EVOLUTIONSDU FINANCEMENT ET DUROLE DES MEDIAS DANS LEDEVELOPPEMENT AGRICOLEET RURALDr Helen Hambly OdameUniversité de Guelph - CanadaOn observe différentes évolutionsmajeures dans le rôle que jouent lesmédias dans le développement agricoleet rural (DAR). L’affiche montreune courbe de financement hésitanteau cours de ces dernières décennies,qui affecte l’investissement au niveaudes médias pour le DAR dans les payset régions ACP.33
On constate également que certainsprojets clés de recherche et développementsous-tendent ce financement.Autres éléments importants à relever :la baisse du financement public despolitiques de vulgarisation agricole qui,à son tour, pèse sur le financement desmédias dans le DAR depuis le milieu desannées 80 ; les difficultés continuellesde la communauté des médias à financerses initiatives en matière d’imprimerie,de programmes radio et vidéoparticipatifs ; et enfin, l’importancegrandissante des fondations privéesaxées sur les médias pour le DAR aucours de ces cinq dernières années.De même, l’affiche recommande demeilleurs partenariats entre les organismesde financement, avec pour objectifsde partager des informations concernantleurs initiatives respectives, d’échangerà propos de leurs succès et problèmes,tout en veillant à harmoniser la qualitéet la quantité des médias au servicedu développement agricole et rural.MEDIA ET ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES34ÉTUDE ET ANALYSEDE L’IMPACT DESEXPLOITATIONS AGRICO-LES ET FERMES D’ELEVAGESITUEES AUTOUR DESAIRES PROTEGEES :CAS DU PARC NATIONALDU “W” EN REPUBLIQUEDU NIGERMme Teresa Fernandes Pereirada Veiga Tavares, Cap-vertLe Parc national du “W” subitaujourd’hui de fortes pressions anthropogéniques,dues non seulement àla croissance démographique maisaussi aux activités agricoles, pastoraleset de chasse. Une stratégie degestion efficace et durable nécessitede prendre en considération les problèmesque pose l’activité humaineà moyen et long terme, notammenten ce qui concerne l’utilisation desterres. Et pour mieux en comprendre/connaître les impacts, il faut étudierla dynamique des interactions entreles systèmes biophysiques et socioéconomiques.Cette compréhensionpermettra d’obtenir des indicateursfiables sur la dégradation des ressourceset d’élaborer des outils d’aide àla décision pour leur gestion durable.Car on considère que les usages etpratiques agropastoraux perturbentfortement l’environnement naturel.L’initiative a donc pour objectifs : 1)d’aider à la caractérisation biophysiquede la région afin de contribuer àla gestion concertée des ressourcesagropastorales et à la prévention desconflits autour du parc du “W” ; 2)d’étudier et d’analyser l’impact desactivités humaines sur l’environnement,à travers l’utilisation des terres à proximitédu Parc ; et 3) de déterminer unesurface utile et un mode de gestiondurable des ressources naturelles pourles activités agropastorales exercéespar les communautés vivant autourdes aires protégées.Le projet consiste en une étudecomplète de la littérature existante,l’exploitation et l’analyse des cartes,l’utilisation de la télédétection et desSIG, des enquêtes et interviews menéesauprès des autorités nigériennes du“Parc du W”, des services en chargede l’élevage et des populations villageoises(autorités locales, agriculteurs,éleveurs, représentants d’organisationspaysannes, d’associations agropastoraleset d’ONG). Pour ce faire, le zonagede la périphérie du Parc a été effectuésur la base des diverses pressionsanthropiques, et les activités socioéconomiques,tout comme l’utilisation desressources dans les villages riverainsdu Parc, ont été répertoriées.De même, les pressions sur les ressourceset l’impact environnementalrésultant des pratiques agropastoralesà l’intérieur et autour du Parc ont étéidentifiés, et une stratégie appropriée aété adoptée pour la gestion des terresautour du Parc et les améliorations àapporter. Des propositions pour unemeilleure gestion seront soumisesaux autorités puis mises à profit pourd’autres parcs nationaux.REHABILITATION DESSOLS DEGRADES DES ZONESSECHES SAHELIENNES(BURKINA FASO, MALI,NIGER) AVEC LATECHNIQUE DU ZAÏ :ETAT DES CONNAISSANCESMme Delphine Droux, FranceDans les zones sèches sahéliennes,la dégradation des sols est à l’originede la diminution des terres arableset du recul de la production agricole,entraînant ainsi les paysans dansl’insécurité alimentaire, la pauvretéet les migrations. Le zaï est une techniquemanuelle traditionnelle quipermet aux paysans non seulement decultiver et de produire sur des terresdégradées, mais aussi de restaurerefficacement leur fertilité. Toutefois,malgré l’efficacité prouvée de cettetechnique dans des pays du Sahel,sa propagation se heurte toujours àl’énorme quantité de travail requise(500 heures/personne/hectare) enpériode difficile de saison sèche. Lamécanisation du zaï (ou zaï mécanisé)réduit considérablement les besoinsen main-d’œuvre et la pénibilité dutravail, tout en améliorant les rendementsagricoles. Les perspectivesainsi ouvertes par le zaï mécaniséjustifient donc largement l’intérêtscientifique porté aujourd’hui à unetelle technique.Cette étude se propose de faire lebilan des résultats obtenus et desexpériences avec les deux versions -manuelle et mécanisée - de la techniquedu zaï, en vue de constituer uncorpus de connaissances scientifiqueset d’en faire une large diffusion. Ellese fonde sur un examen critique dela littérature existante et une enquêtemenée auprès de 60 agriculteursrépartis dans 12 villages disséminéssur 5 départements de la provincede Zondoma, au nord du BurkinaFaso. Dans cette zone semi-aride,la pluviométrie moyenne annuelleest estimée entre 500 et 700 mm ;les sols y sont ferrugineux (lixisols),d’une profondeur variant entre 50 et80 cm et les principales cultures sontles céréales (sorgho et mil). Tous lespaysans interrogés pratiquent le zaïmanuel, mais seuls peu d’entre euxont adopté le zaï mécanisé.
Aujourd’hui, le zaï mécanisé n’estpratiqué que dans le nord du BurkinaFaso, essentiellement dans le cadredes programmes de développement duFIDA, et la recherche axée sur cettetechnique reste limitée. Le zaï manuelest, en revanche, largement pratiquéau Mali, au Niger et au Burkina Faso,où il fait l’objet de nombreuses études,mais l’accès aux résultats desenquêtes réalisées tant au Mali qu’auNiger demeure difficile. Pratiqué dansles mêmes conditions, le zaï mécaniségarantit, dit-on, de meilleuresperformances que le zaï manuel etce, en raison de l’humidification plusélevée des sols que permet cette technique.L’enquête de terrain a montréune grande diversité dans l’utilisationdu zaï manuel par les paysans. Lesrésultats de recherche disponiblessont généralement assez dispersés ;ils se concentrent principalement surl’amélioration des rendements et sontmême contestables dans certainscas spécifiques. Le mode de fonctionnementdu zaï et ses impacts surl’humidité du sol, la matière organique,la biologie et les nutriments,tout comme les changements induitsau niveau des propriétés du sol (pH,complexe d’échange et texture) sontpeu explorés. Des preuves recueilliessur le terrain confirment l’existencede situations où le zaï permet effectivementde restaurer des sols initialementdégradés et non productifs(zippelés). Reste néanmoins à savoir :i) pour quels types de sols, de penteset de cultures le zaï est-il efficace ?ii) Quand peut-on considérer queles principales fonctions des sols ontété restaurées et quels en sont lesindicateurs ? Et iii) Quelles pratiquesagricoles ou quels systèmes de cultureconseiller pour un suivi efficace desperformances du zaï ? Les réponses àces questions permettront d’envisagerl’intégration du zaï dans des systèmesculturaux innovants, à mêmede favoriser des comportements plusrespectueux de l’environnement. Latechnique du zaï, qu’elle soit manuelleou mécanisée, mérite donc de fairel’objet d’investissements substantielsen matière de recherche.ANALYSE ECONOMIQUEDE L’IMPACT DES CARAC-TERISTIQUES VARIETALESSUR L’EXPLOITATION DEVARIETES DE POIS PIGEONAMELIOREES DANS LESZONES ARIDES DU KENYA :ETUDE DE CAS DU DISTRICTDE TAITAMme Zipora OtienoUniversité de Nairobi, KenyaPour un agriculteur, la production et laconsommation sont, en principe, desvariables déterminants dans la décisiond’adoption et dans le choix de l’intensitéd’utilisation des semences améliorées.Ce document propose une approcheholistique de la politique de sélectionvégétale dans les pays en développement.S’appuyant sur la théorie de ladualité, qui intègre explicitement lescaractéristiques variétales dans le processusd’optimisation des revenus desménages, cette étude tente d’identifieret d’analyser les facteurs de réussitedu projet AIDA dans le district de Taita.Plus précisément, le document passeen revue les résultats de recherchesur les facteurs contribuant à l’adoptionrapide des variétés améliorées depois de pigeon dans les zones aridesdu Kenya, en mettant l’accent sur lescaractéristiques variétales. L’analyseempirique se fonde sur un modèle dedouble obstacle, basé sur des donnéesrecueillies en 2009 auprès de200 ménages dans le district de Taita.Elle prend en compte une multitudede propriétés concernant la productionet la consommation évaluées par lesagriculteurs, de même que toute unegamme de variables socioéconomiquesliées aux ménages. Les résultats dumodèle Probit mais aussi du modèleProbit multivarié révèlent que cinqcaractéristiques variétales influencentde façon significative l’adoptionrapide de variétés améliorées de poisde pigeon : la tolérance à la sécheresse,la résistance aux parasites, lerendement, la facilité de cuisson, le goûtet le potentiel de surprix. La maturitéprécoce n’est guère un facteur déterminantdans la décision d’adoption desagriculteurs kenyans, contrairement àleurs homologues du Malawi, premierproducteur africain, où l’adoption rapidede la technologie dépend surtout de lacourte durée de maturité des variétésutilisées. Les conséquences à en tirersont de deux ordres : premièrement,la mise au point, la promotion et lechoix des variétés de semences doiventtenir compte des caractéristiques de laconsommation et du marché, en plusdes éléments propres à la production.Deuxièmement, les caractéristiques deproduction non liées au rendement,telles que le goût et la facilité de cuisson,jouent un rôle important dans laperception par les agriculteurs de lavaleur d’une nouvelle variété.ÉTUDE DE GROUPEMENTSPAYSANS PRATIQUANTL’AGRICULTURE DE CONSER-VATION DANS LES ZONESARIDES DU MALAWI :CAS DE LA ZPV (ZONEDE PLANIFICATION DE LAVULGARISATION) DE CHIN-GULUWE, DANS LE DISTRICTDE SALIMA, ET DU VILLAGEMODELE DE NKOMBA de LAZPV DE BAZALE, DANS LEDISTRICT DE BALAKA.M. Mavuto Mdulamizu, MalawiL’étude sur des groupements paysansface à la gestion des terres et de l’eaudans les zones arides du Malawi avaitpour but de mieux comprendre lesfacteurs sociaux essentiels à une miseen œuvre réussie de l’agriculture deconservation. Des données qualitativeset quantitatives ont ainsi été collectéesauprès de paysans pratiquant l’agriculturede conservation avant d’êtredûment analysées. Les résultats ontmontré que les bons résultats obtenusdans l’agriculture de conservationpar les groupements paysans étudiéss’expliquaient notamment par leurattachement à des facteurs sociaux telsque le leadership au sein du groupe,l’existence de structures, de systèmeset de réseaux sociaux bien établis, lescompétences et le savoir-faire, ainsi quele respect des valeurs, des croyanceset de l’identité. Les questions de ressourceset d’environnement de travailn’ont donc pas joué de rôle significatifdans le succès des groupementspaysans. D’autres résultats ont parailleurs révélé que la perception que lespaysans ont des différentes techniquesde conservation dépendait de l’effica-35
cité de ces techniques au regard del’environnement biophysique et socioéconomique.En conséquence, l’étuderecommande que ces facteurs sociauxsoient d’abord en place pour permettreainsi aux groupements paysans d’exploiterefficacement et avec succès lestechniques agricoles de conservation.Elle préconise également d’adopterune approche “bottom-up” (“de basen haut”) lors de la recommandationde ces techniques aux groupementsd’agriculteurs.Zones arides d’Afrique :“mieux vaux prévenirque guérir”Judith Ann Francis, CTA, Pays-Bas,partenaire de AIDAYodit Kebede, CTA, Pays-BasDanièle Clavel, CIRAD,Coordinatrice du projet AIDAEn Afrique, plusieurs grandes régionssont considérées comme des terressèches et plus de 40% de la population(268 millions de personnes) esttouchée. Le changement climatiquerisque d’ aggraver cette situation.Les habitants des zones arides sontrésilients ayant élaboré des stratégiesd’adaptation pour faire face auxconditions environnementales et climatiquestrès variables Cependant, lesterres arides sont souvent considéréescomme des terres non productives ;leur importance et leur contributionà la subsistance de millions de personnesne reçoivent pas une attentionsuffisante. On a l’impression que lespossibilités d’augmenter durablementla productivité des moyens de subsistancedes gens sont limitées. Toutefois,les terres arides d’Afrique ont unpotentiel de développement et peuventfournir des biens et services multiples.Dans le projet UE-INCO, InnovationsAgricoles en Zones Arides innovation(AIDA), 22 “initiatives réussies” ontété évalués et des enquêtes ont étémenées parmi des décideurs et deschercheurs pour identifier les facteursclés de succès et les options politiquessusceptibles de promouvoir lesinvestissements dans les zones aridesde l’Afrique. Les résultats montrentqu’il est nécessaire d’harmoniser lespolitiques et les interventions dans leszones arides, qui devrait : refléter lesréalités auxquelles les habitants deszones arides sont confrontés; assurerla compatibilité avec les questions derégime foncier, réduire les conflitsliés aux ressources et ouvrir la voie àdavantage d’échanges commerciaux.Les utilisateurs locaux et les propriétairesdes terres arides doivent êtreimpliqués davantage dans l’élaborationdes politiques, la planificationdes programmes, la définition desproblématiques de recherche et leprocessus de suivi et d’évaluation. Larecherche participative et appliquéedevrait appuyer l’agriculture des terresarides et refléter la diversité desstratégies locales d’adaptation et dedynamique. L’éducation, l’informationet la communication sont égalementessentiels pour le renforcement descapacités et la diffusion des pratiquespertinentes et les innovations ainsique l’amélioration des connaissancespour une agriculture durable et ledéveloppement humain.COMMUNICATION ENTRE LES MEDIAS ETLES AUTRES ACTEURS DU DAR36PARTENARIAT ENTRE LEPROGRAMME AGRICULTUREET GESTION DESRESSOURCES NATURELLESET LES RADIOS RURALESDANS LES REGIONS SUD ETSUD-EST DU SENEGALM. Madior FallUSAID WULA NAFAA-SénégalL’USAID/Sénégal encourage la couverturemédiatique des activités liées auxprogrammes de l’assistance américaineau Sénégal, afin de renforcer la compréhensionet l’adhésion à ses objectifset interventions. Elle demande aussià ses partenaires d’exécution de faireune bonne publicité de leurs activitésconjointes, à travers une planificationefficiente des événements et l’implicationdes médias, des bénéficiaires desactivités et programmes, ainsi que desofficiels du gouvernement américain etdu gouvernement du pays hôte.Cette volonté de l’USAID/ Sénégal estfortement exprimée dans la secondephase du Programme Agriculture etgestion des ressources naturelles avecla mise en place du volet Politiqueset communication.Dans le cadre de ce volet, la communicationa un double rôle : la diffusionde l’information et l’utilisationcomme outil politique pour éclairerle dialogue public. La communicationest un outil nécessaire pour la promotiond’un dialogue fructueux enfaveur d’un changement politiquepour la croissance économique etune meilleure gestion des ressourcesnaturelles.La communication doit ainsi être unoutil d’expression des acteurs à labase, pour exprimer les contraintesidentifiées dans la mise en œuvre despolitiques forestières et agricoles.Considérant la radio rurale comme :• une technologie extrêmement puissantepour la transmission du savoiret dont la portée est potentiellementénorme à l’échelle locale ;• un moyen pratique et créatif pourfaciliter la circulation de l’informationen milieu rural ;• un moyen pour atteindre toutesles catégories de la communauté,grâce à l’utilisation des langueslocales ;• un outil de développement localfavorisant l’échange d’informations,de connaissances et de compétencesau sein de la communauté grâce àl’effet de proximité, le ProgrammeAgriculture et gestion des ressourcesnaturelles développe un partenariatavec un réseau de radios ruralesinstallées dans sa zone d’intervention.Des émissions portant surdes thématiques et des activitésrelatives à l’agriculture (appui auxfilières agricoles et forestières) etla gestion des ressources naturelles(conventions locales de gestion desressources naturelles, plans d’aménagementforestiers, plans d’oc-
cupation et d’affectation des sols,cartographie, etc.) sont conçues etanimées par des agents de terrainappelés facilitateurs.Le Programme travaille en étroitecollaboration avec les présidents decommunautés rurales, qui approuventles outils de gestion sur la base d’unconsensus au sein de la communauté.La gestion de l’information revêt ainsiun caractère primordial dans les prisesde décisions. Le réseau de radios partenaireau Programme contribue ainsià une diffusion de l’information économiqueet commerciale (sur les marchésdes produits des filières appuyées) etde l’information technique (process,technologie et qualité des produits).ROLE DE LA RADIO DANS LEDEVELOPPEMENT AGRICOLEDE LA REGION PACIFIQUEMme Rita NarayanRegional Media Centre, CPS, FidjiLe présent document explique l’importancede la radio dans le développementagricole du Pacifique. Il met en lumièreles difficultés rencontrées dans la diffusiond’informations sur l’agricultureet la vulgarisation dans les pays etterritoires insulaires du Pacifique, et lanécessité de renforcer les capacités desparties prenantes, telles que les agentsde vulgarisation, les journalistes et lesresponsables de l’information agricole,dans le domaine de la production deprogrammes radiophoniques efficacessur l’agriculture.De même, le document met en évidencele manque de ressources etde financement pour soutenir la formationau métier de la radio dans lePacifique, le manque de partenariatet de collaboration entre radiodiffuseurs,gouvernements, partenairesau développement, chercheurs ettechniciens.Il souligne également la nécessitépour les réseaux du secteur agricolenon seulement de soutenir lesjournalistes et les producteurs deprogrammes radiophoniques, maisaussi de promouvoir la diffusion d’informationsen langues locales.Il faut également définir des normesminimales de qualité pour les émissionssur l’agriculture, pour permettreaux diffuseurs de communiquer efficacementà leurs publics cibles desinformations agricoles pertinentes etd’atteindre ainsi les objectifs qu’ilsse sont fixés.Enfin, le document insiste sur lanécessité de mettre à profit la radiocommunautaire pour véhiculer efficacementl’information auprès descommunautés rurales et des petitesîles reculées du Pacifique. Cela permettrade renforcer le travail d’informationdes stations radio de grandeécoute et d’améliorer notablement lacommunication au service du développementagricole et rural.EXPLOITER LES POINTSFORTS DU CONTENULOCAL GRACE A LACOMMUNICATIONPARTICIPATIVEM. Charles DhewaKnowledge Transfer Africa,ZimbabweEn Afrique australe, les médias traditionnelsne répondent pas aux besoinsdes populations rurales. Les préoccupationsdes agriculteurs, innovateurs,artisans, tradipraticiens et entreprisesen milieu rural sont rarement relayéespar les médias. Avec plus de 80 % deleurs populations gagnant péniblementleur vie dans les zones rurales, lespays en développement n’exploitentpas pleinement le potentiel des communautésrurales, dont les pratiquessont profondément enracinées dansles connaissances indigènes et lessavoirs locaux.Au Zimbabwe, la création de centresde connaissances communautaires(Community Knowledge Centres)produit déjà des résultats satisfaisants.En effet, grâce à ces centres dusavoir communautaire, les pratiquesde conservation agricole sont en voied’être intégrées dans le corpus de vastesconnaissances dont disposent lespopulations rurales, un savoir enracinédans la mémoire collective, hérité dupassé et des expériences personnellesacquises sur plusieurs générations.Ces centres permettent égalementde documenter l’information produitelocalement et d’être en liaison avecles principaux médias grand public.Beaucoup d’informations proviennentdes communautés rurales, mais seulsquelques membres sont au courantde cet état de fait.Les informations recueillies par lesagents de vulgarisation, les ONG etles chercheurs, sont souvent envoyéesaux hauts fonctionnaires des administrationscentrales, sans aucun retourou “feedback” auprès des structurescommunautaires, peut-être parce qu’iln’y a guère de structures pour stockeret évaluer en permanence ces informations.Les centres de connaissancescommunautaires veillent à ce quel’information locale serve de base àla sensibilisation des communautésrurales aux enjeux du développement.Ils démontrent ainsi que la communicationparticipative doit être prise encompte, car elle privilégie “l’écoute”par rapport à la communication grandpublic qu’elle met plutôt l’accent sur“le fait relaté”. Ce type d’effort peutenrichir le contenu de l’information,grâce à des indicateurs pris à la sourcesur le partage des connaissances et lechangement climatique. C’est pourquoiles défenseurs de la ruralité, les particulierset organisations qui respectentsincèrement les points de vue despopulations rurales, jouent un rôleessentiel dans la réussite de cette stratégieen faveur des médias au servicedu développement rural.SYSTEMES NOVATEURSDE CONSEIL AGRICOLEUTILISANT LES TICM. Francois StepmanFARA, GhanaL’inventaire des services de conseilagricole publié par le Forum pour larecherche agricole en Afrique (FARA) estle résultat d’une consultation en lignemenée, en octobre 2008, en collaborationavec le Système régional d’informationet d’apprentissage agricoles(RAILS) et d’une revue bibliographique,qui visent à documenter tous les servicesou systèmes novateurs de conseilconnus en Afrique, qu’ils soient encours de mise au point, opérationnelsou récemment élaborés. Cet inventaireporte sur les projets utilisant les TIC oumettant en œuvre des activités baséessur les TIC, les institutions/groupementsqui fournissent des services par le biaisdes TIC, ainsi que les fournisseurs desolutions logicielles TIC, opérant àl’échelle nationale et régionale. Si la37
plupart des projets concernés sontassociés à une date de début et de find’exécution concernant la fournitured’un ou de deux services, d’autresportent en revanche sur des systèmesnationaux ou régionaux d’informationfournissant de nombreux services agricolespar le biais des TIC.Selon les conclusions de notre étude,il n’y aura probablement jamais desystème “uniforme, applicable à toutesles situations”. Toutefois, l’inventairelaisse penser que les systèmes quiutilisent une plate-forme vocale ou desfichiers audio offrent des perspectivesnovatrices et prometteuses à l’informationagricole, alors que les autresplates-formes (SMS et plates-formesInternet) restent un outil essentiel pourfournir en arrière-plan des informationsplus détaillées. Pour pouvoir répondreà la question de savoir “comment assurerle suivi de l’impact ?”, il nous fautexaminer de plus près l’ensemble desopportunités d’innovations que nousoffrent les agriculteurs. Pour contrôlerl’impact de cet outil, nous devonsréfléchir : aux moyens les plus efficacesde fournir aux agriculteurs des informationset des connaissances (localeset en provenance de l’extérieur) entemps opportun ; aux mécanismesappropriés pour exploiter le potentieldes stations de radio FM et de la téléphonienumérique comme technologiesde communication de l’information agricole; aux possibilités de “reformater”la présentation de l’information et dusavoir agricoles pour les petits agriculteurs,ainsi qu’au rôle potentiel et à lacréation d’un répertoire électronique(des contenus agricoles locaux) enAfrique, à des fins de diffusion.COMBLER LE FOSSE :L’APPROCHE WRENMEDIAPOUR UNE MEILLEUREINFORMATIONSCIENTIFIQUE PARLES JOURNALISTES ETUN RENFORCEMENT DESPARTENARIATS ENTRELES MEDIAS ET LACOMMUNAUTE DE LARECHERCHE AGRICOLEMme Susanna ThorpWRENmedia, Royaume-UniUne initiative pilote de formation dejournalistes africains de la presseécrite et de la radio, conjuguée àla tenue d’importantes conférencesinternationales, permet aujourd’huide renforcer les liens entre les chercheurset les médias.Certains événements scientifiquesinternationaux fournissent aux journalistesdes sujets de reportageintéressants, tout en leur offrant lapossibilité de mieux comprendre lesenjeux en question. Pour améliorerleurs compétences techniques enmatière de reportage scientifique,des sessions de formation sont égalementorganisées sur la collecte decontenus, la photographie, l’écritureet la rédaction d’articles, ainsi que lapublication et l’édition numériques.De plus, l’équipe de WRENmedia, encollaboration avec les journalistes aanimé sur chaque site de conférence,une session sur le thème “Tirer desmédias le meilleur parti possible”,à l’intention des participants intéressésd’en apprendre davantagesur l’interaction avec la presse. Cetévénement interactif, fort apprécié audemeurant, a ainsi offert aux conférenciersl’occasion de discuter desenjeux et de l’importance de mettreà profit les médias, pour obtenir desconseils sur la façon d’être plus performantdans leur communication et defaire face aux difficultés que pourraitreprésenter l’intérêt des journalistes,mais aussi pour apprendre commentélaborer et faire passer des messagesclairs, pertinents et appropriés à unpublic particulier.Les différentes sessions ont nonseulement fourni aux chercheurs etscientifiques des conseils précieux,mais ont également permis de dynamisercet important processus qu’estla construction de partenariats entreles médias et le milieu de la rechercheagricole. De même, elles ont accrula confiance des journalistes quantà leur capacité à comprendre et partagerl’information scientifique, etcontribué à ce que le rôle des médiasdans la transmission des connaissancesscientifiques soit reconnu et prisdavantage au sérieux.Soutenue par le DFID, cette initiativeen faveur de la formation desjournalistes africains s’appuie surl’expérience précédente de WRENmediadans la collaboration avec desjournalistes pour communiquer desinformations sur la recherche agricoleau Kenya (au profit de l’industriehorticole) et en Ouganda (aux finsde sensibilisation à la maladie dusommeil).38
CONTRIBUTION DES MEDIAS A LAPROGRAMMATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE,ET A LA GESTION DES CONNAISSANCESL’OUTIL SIST ET ACCESA L’INFORMATION POURLES JOURNALISTES DUSECTEUR AGRICOLE ETRURALM. Helmer Thierry - CIRAD, FranceLe SIST (Système d’information scientifiqueet technique) est un projetpour l’Afrique financé par le ministèrefrançais des Affaires étrangères eteuropéennes et mis en œuvre parle CIRAD, le Centre internationalde recherche agronomique pour ledéveloppement.Le principal objectif du projet SISTest de sortir la recherche africainede l’isolement et, en même temps,de réduire la fracture numérique/scientifique entre le Nord et le Sud.Ce dispositif autonome et innovantd’information scientifique et techniquea été mis en place dans six paysd’Afrique.Avec les problèmes d’accès aux nouvellestechnologies de l’informationet de la communication (NTIC), lescommunautés africaines mettent plusde temps à sortir de leur isolement età jouir d’une visibilité sur les “autoroutesde l’information”. De plus, ladiversité et la complexité des outilsmodernes font qu’il est difficile de seles approprier et de les partager. Leprojet SIST se veut donc une plateformede travail complète, intuitiveet pragmatique.Ce projet ne s’adresse pas uniquementà la communauté scientifique et peutêtre mis à profit par toute autre catégorieprofessionnelle qui consommeou produit de l’information.Par exemple, les journalistes devraientavoir facilement accès à l’informationagricole et rurale, tant dans les paysdu Nord que du Sud. Les résultatsde recherche publiés sur Internet oustockés sur une base de données outout autre type de support constituent,pour les journalistes, une ressourceprécieuse à laquelle ils devraientpouvoir accéder.Pour répondre à ces besoins, le dispositifSIST a été conçu aux fins de :1. simplifier l’accès à l’informationscientifique disponible sur le Webou via les réseaux et ce, sous toutesses formes (utile à la créationde portails thématiques sur ledéveloppement agricole et rural,par exemple) ;2. vulgariser l’accès aux nouvellestechnologies de l’information etde la communication (NTIC) et,partant, permettre aux scientifiquesde produire, partager, échanger etdiffuser l’information (utile à la créationd’une plate-forme commune detravail pour les journalistes) ;3. aider à la publication sur Internetsans connaissances informatiquesparticulières (savoir créer rapidementet gérer un site Web sans être unexpert en informatique) ;4. faciliter la collecte, l’organisationet l’accessibilité de l’information(construction et gestion communesde différentes bases de donnéesentre journalistes).LE MAGAZINE RADIOPHO-NIQUE “MWANA ALIRENJI”(AUTOSUFFISANCE ALIMEN-TAIRE) TRANSFORME LESAGRICULTEURS MALAWITESEN CHERCHEURS, AUSERVICE DE L’INNOVATIONET DE L’AUTOSUFFISANCEALIMENTAIREM. Gladson Elemiya MakowaStory Workshop, MalawiCe document souligne l’impact deMwana Alirenji, un magazine radiophoniquedestiné aux agriculteurs,que je produis dans le cadre de StoryWorkshop, au Malawi. Mwana Alirenji,expression malawite courante, quisignifie littéralement que “un enfantne pleure pas si la nourriture est abondante”,vise à promouvoir l’autosuffisancealimentaire chez les petitsagriculteurs des zones rurales auMalawi. Le programme s’adresse àdeux catégories d’agriculteurs locaux :ceux qui luttent encore pour assurerleur autosuffisance alimentaire, et ceuxqui ont connu des difficultés similaires,mais qui ont réussi à les surmonteren adoptant des méthodes agricolesnovatrices. C’est de cette dernièrecatégorie que s’inspirent nos formatsde programmes. Nous utilisons notreméthodologie d’écoute radiophonique-baptisée Radio Research Gardens -pour encourager les membres de lacommunauté à “écouter, apprendreet essayer”, à partir des solutionset innovations diffusées dans le programme(le concept de “l’agriculteurqui parle à l’agriculteur”. Les essaiset expérimentations sont ensuiteconduits par un groupe d’agriculteurssur la base d’un modèle convenuet, chaque mois, les résultats et lesprogrès réalisés sont partagés, avecd’autres agriculteurs via la radio, lorsde la diffusion du programme. Lesexperts techniques n’interviennentalors que pour étayer et compléterles innovations et expériences desagriculteurs.Le projet, financé par l’Union européenne(UE), a déjà connu trois phasesd’exécution (1999-2000, 2000-2002et 2002-2006) et est entré dans saquatrième phase (2008-2011).Pour en évaluer l’impact, nous demandonsaux agriculteurs de nous écrirepour nous expliquer comment l’informationqu’ils reçoivent, au titredu programme, les aide dans leurtravail. Nous mettons également àprofit les interviews de journalistespour obtenir des informations pluscirconstanciées sur nos visites de suiviauprès des agriculteurs.Les résultats montrent que le programmeMwana Alirenji a inspiré etbénéficié à de nombreuses personnes,à travers la plate-forme d’échangeet de collaboration en réseau qu’elleoffre aux auditeurs. Bien que le programmesoit essentiellement axé surl’agriculture, ce forum a égalementpermis aux agriculteurs de discuterdes questions liées à la gestion de la39
40production alimentaire, la nutrition, lasanté et l’environnement. Ainsi, nousavons vu certains agriculteurs pratiquerla diversification alimentaire etd’autres essayer divers types d’engraisafin d’optimiser leurs rendements.Par ailleurs, Mwana Alirenji encourageles agriculteurs à devenir plusinnovants et à explorer de nouvellestechniques agricoles et de nouveauxintrants, tels que les engrais biologiques,plus respectueux de l’environnement.Mwana Alirenji s’est donc avéréêtre une source fiable de diffusion denouvelles technologies agricoles, à lafois pour les agents de terrain et lesagriculteurs malawites.Le défi majeur demeure, cependant, lemanque de sensibilisation aux résultatspositifs obtenus. Le taux d’adoptiondes innovations par le ministère del’Agriculture reste faible, en raisond’une déficience de communicationentre les médias et le ministère. Eneffet, on déplore une circulation limitéeet un manque de connaissance desinformations concernant les innovationset les résultats de recherche ausein des structures de vulgarisationagricole. Il est donc nécessaire derenforcer les relations entre les journalistes/producteursimpliqués dans ceprogramme et les décideurs politiques.Enfin, il est urgent que soient mis enplace des mécanismes spécifiques desuivi pour permettre une répartitionplus large des idées novatrices etque le gouvernement travaille à lamultiplication des meilleures pratiquesdans d’autres domaines.ÉVALUATION DES EMIS-SIONS RADIOPHONIQUESAU SERVICE DUDEVELOPPEMENT RURAL :UNE QUESTION DE COUTSDE TRANSACTIONM. Chris Yordy, Consultant auprèsde Community DevelopmentService en Egypte, CanadaCet exposé examine les facteurs quiempêchent les pêcheurs et négociantsde poissons d’accéder aux informationssur les prix dans deux communautésde pêche artisanale dans la région Ada,au Ghana. Des études antérieures ontmontré que les coûts de rechercheélevés sont à l’origine de la défaillancedu marché dans ce domaine, et à ladétérioration des produits ; un constatqui découle d’une analyse théoriqueapprofondie des coûts de transaction,permettant d’identifier les entraves- tant physiques qu’en termes d’informations- au développement del’économie rurale. Malgré les coûtsélevés de recherche d’informationssur le marché, dus à l’éloignementet au manque d’infrastructures decommunication dans les zones ruralesd’Afrique subsaharienne, nous avonsnéanmoins constaté au cours de cetteétude, que la radio communautaire sedistingue nettement parmi les technologiesd’information et de la communication(TIC), de par sa portée etson accessibilité, et qu’elle permet deréduire sensiblement les obstacles àl’information sur les prix, notammentchez les femmes poissonnières etnégociantes en poissons dans l’industriede la pêche ghanéenne. Ce typed’analyse du marché a des incidencesnon négligeables sur la façon dontla radio et les TIC sont appréciés etévalués, dans le cadre du processusde sécurisation des investissementsdans des projets de communicationau service du développement, ainsique dans l’agriculture et la pêche enAfrique subsaharienne en général.LES CAPACITESESSENTIELLES POUR LARADIO COMMUNAUTAIREM. Oumar Seck NdiayeAMARC Afrique - SénégalCette affiche présentée par le présidentd’AMARC Afrique attire l’attentionsur l’importance du renforcement descapacités de la radio communautaire.Elle met en évidence les défis auxquelssont aujourd’hui confrontéesles stations de radio communautaireen Afrique. Elle propose des solutionspour répondre à ces défis, y comprisles changements institutionnelsnécessaires au niveau des structuresorganisationnelles et du financement.L’affiche met également l’accent surles principaux thèmes, niveaux ettypes de formation indispensablespour renforcer les capacités des radioscommunautaires en Afrique.RENFORCER LES CAPACITESDES UNIVERSITES POUR LEBENEFICE DES MEDIAS ETDU DEVELOPPEMENT RURALM. Bénédict Mongula etMme Langa Sarakikya - Universitéde Dar es Salam, TanzanieLes médias sont un outil très importantpour le développement rural mais ilssont souvent occultés dans les discourset les initiatives axés sur le développement.En effet, les décideurs politiques,tout comme l’opinion publique,ignorent généralement les nombreusesdifficultés auquel le monde rural estconfronté. Des problèmes qui concernenttant la production alimentaire, lanutrition, l’accessibilité et la qualité desservices sociaux de base (santé, eau,énergie et éducation), que les moyensde subsistance et les conditions économiques,les droits de l’Homme,l’égalité des sexes, les relations depouvoir, les rapports de force au niveaulocal et les reculs culturels. Lors del’exécution d’un projet impliquant lacommunauté Massaï de quatre villagesdu district de Monduli et mis enœuvre par l’Université de Dar es Salam(Tanzanie) et le Collège universitaireHuron (Canada), les populations sesont montrées très soucieuses de faireconnaître la situation de leurs villagesà l’opinion publique et aux décideurstanzaniens. Elles ont ainsi manifestéle désir de porter à la connaissancede ces derniers leurs problèmes demoyens de subsistance, d’accès auxservices vétérinaires, aux marchésdes bovins et du lait, aux services desanté, à l’eau et au bois de chauffage.De même, les populations ont tenu àêtre informées des politiques gouvernementalesnationales et locales enrapport avec leur vie quotidienne, ycompris les opportunités offertes parles différents programmes.Même si la Tanzanie dispose de nombreuxjournaux, stations de radio ettélévision, la couverture des zonesrurales par les médias et leur accessibilitérestent néanmoins extrêmementlimitées. De plus, les médias tanzaniensfont face à de sérieux problèmesde capacités de recherche (collecte etanalyse de données), des difficultésà adapter - notamment en termesd’écriture créative et de présentation -l’information destinée au public enmilieu rural, un manque de formation
de base et spécialisée et, donc, deconnaissance approfondie des questions,sans oublier leur faible capacitéà identifier les sujets de reportage lesplus pertinents et les plus cruciaux.Autant de problèmes aggravés parles difficultés de transport, le faibleaccès aux technologies, le manque deculture médiatique au sein des populationsrurales et le peu d’intérêt que lesrédacteurs et les journalistes portentaux déplacements sur le terrain et auxreportages sur les questions rurales ;une désaffection intimement liée aumanque de financement des médias.La radio communautaire locale desMassaï ne fait guère exception.Alors que plusieurs établissementstanzaniens d’enseignement supérieurproposent des programmes de formationaux médias (par exemple, l’Institutde journalisme et de communicationde l’Université de Dar es Salam, l’UniversitéSaint-Augustin, l’Universitéde Tumaini et l’Ecole de journalismede Dar es Salam), ils n’en sont pasmoins confrontés à de graves problèmesde personnels. A titre d’exemple,il existe très peu de titulaires dedoctorat pour l’ouverture d’une filièrede formation post-universitaire auxmédias. Conséquences : les programmesexistants sont très récents et ontbesoin urgemment d’être renforcés.De même, la filière Sciences humainesnéglige souvent l’importance de lacommunication pour le développementrural dans ses programmes. En outre,l’actuel programme de formation auxmédias est trop général et trop théorique,car n’intégrant pas la validationdes acquis de l’expérience. Les stationsde radio et télévision basées dans lesuniversités, par exemple, ne peuventembaucher que quelques étudiants etont elles-mêmes besoin d’être équipéesde manière plus adéquate. Les initiativesexistantes, telles que le Tanzania MediaFund (Fonds tanzanien pour les médias),l’Institut des médias d’Afrique australe(MISA-TAN) et les tentatives d’introduiredes cours sur le développement et lacommunication dans les programmesactuels de sciences humaines constituentun pas dans la bonne direction,pour essayer de combler les lacunesdu système de formation au métierdes médias.Compte tenu de tout ce qui précède, ilest indispensable que le gouvernementet les partenaires au développementapportent leur concours en augmentantles ressources nécessaires, tantpour la formation de base que postuniversitaire,et en améliorant lescompétences du personnel dans lesinstitutions de formation.ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DES MEDIAS :RENFORCER LES CAPACITES DES MEDIAS DANSLE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURALL’INITIATIVE POUR LEDEVELOPPEMENT DESMEDIAS EN AFRIQUEM. David Mowbray - BBC WorldService Trust, Royaume-UniLes médias peuvent être un puissantagent du changement en Afrique. Orune vaste enquête menée dans 17 paysafricains, dans le cadre de l’Initiativepour le développement des médias enAfrique (AMDI), révèle un sérieux manquede capacités des organes de presseet ce, à tous les niveaux, du journalismede base aux compétences en matièrede gestion. Pour combler ces lacunes,le BBC World Service Trust a adoptéune nouvelle stratégie de renforcementdes capacités, qui parie sur l’encadrementdes journalistes locaux par des“mentors” (ou parrains) hautementqualifiés, appuyés par des formateurssenior internationaux. Cette stratégieentend également promouvoir, dans lemême temps, la nouvelle initiative enfaveur de la presse du continent (AMI),qui se veut une solution “africaine” auproblème de financement et de développementdes médias professionnelsen Afrique.LA FORMATION AUX MEDIASDANS LES CARAÏBESDr Maria Protz - CARIMAC,JamaïqueCette présentation propose uneapproche caribéenne du renforcementdes capacités des médias au servicede l’agriculture. Pour commencer,elle décrit le travail effectué par leCARIMAC, l’Institut des médias etde la communication des Caraïbes(Caribbean Institute for Media andCommunication) de l’Université desIndes occidentales (University of theWest Indies), situé sur le campus deMona, en Jamaïque. La formationaux médias pour l’agriculture et àla gestion des ressources naturellesa nécessité l’intervention du personneldu CARIMAC, en partenariatavec divers organismes, y comprisla FAO, dans le cadre du nouveauprojet de collaboration en CSDI(Communication pour une initiativede développement durable). Parmiles “éléments” propices au renforcementdurable des capacités enmatière de CSDI figurent la prisecompte de la dimension Communicationet Développement (ComDév)dans trois ministères de l’Agriculturede la région, en soutien aux organisationscommunautaires de base, etla formation en ComDév des agentsde vulgarisation pour l’agriculture.Les autres éléments comprennentles études de cas publiées, les nouvellesapplications TIC pour mettreen liaison agriculteurs et agents devulgarisation, la mise en place d’uneassociation professionnelle dédiée àla ComDév, de nouvelles offres deprogrammes d’enseignement, ainsiqu’une plate-forme Web sur l’adaptationau changement climatique.L’EXPERIENCE DURESEAU GAINS DANS LEDOMAINE DE LA RADIOCOMMUNAUTAIREM. Joel Sam - INST, GhanaCet exposé porte sur le GAINS, unréseau de bibliothèques et de centresd’information agricole au Ghana, crééen 1991 dans le cadre du Programmede recherche agronomique nationale41
(NARP) gouvernement du Ghana/Banquemondiale. Il explique les effortsdéployés par GAINS pour redynamiserle système des bibliothèques et d’informationdans le secteur agricole,rendre l’information facilement disponibleet accessible aux organismes derecherche et aux universités et fournirsur demande des informations auxscientifiques, chercheurs, professeurs,directeurs de recherche, décideurs etétudiants. Dans la deuxième phase deson action, GAINS s’est attaché à soutenirl’évaluation des besoins en informationsdes agents de vulgarisation età fournir l’information nécessaire via lesCentres d’information agricole. Dansses troisième et quatrième phases,le projet met l’accent sur les servicesd’information à destination des agriculteurs,des pêcheurs et des agentsde vulgarisation, y compris avec laparticipation des stations de radio FMcommunautaires et de leurs producteursde programmes agricoles, pourcréer des émissions radiophoniquesavec un service de questions-réponsesen langues locales. La présentationse termine par une réflexion sur lesdifficultés rencontrées par GAINS etl’importance de la collaboration avec lesradios communautaires au Ghana.RENFORCEMENT DESCAPACITES ET PARTAGE DESCONNAISSANCES GRACE ALA RADIO COMMUNAUTAIREDr Marcelo SolervincensAMARC - CanadaCette présentation décrit l’expérienced’AMARC dans le réseautage et letravail avec les stations de radiocommunautaire dans différents payset régions ACP du monde. Elle meten évidence plusieurs obstacles aurôle des médias dans le développementagricole et rural. Une des clésde l’amélioration de l’efficacité desradios communautaires consiste àadopter un modèle de partage desconnaissances et de renforcementdes capacités qui 1) renforce le sentimentd’appropriation des médiaspar les communautés locales et lesparticuliers ; et 2) améliore l’apprentissagedes techniques de la radio etde la production de contenus grâce àdes échanges entre dépositaires desavoirs locaux et experts.DEFIS DE L’AGRICULTUREET DU DEVELOPPEMENT :LES MEDIAS AU MALAWIM. Levi Zeleza MandaUniversity of Malawi, MalawiLe Malawi est une économie agricoledepuis des décennies. Malgré lespénuries alimentaires occasionnellesobservées au cours des années, leMalawi est généralement en mesurede se nourrir lui-même. Plus récemmentencore, le Malawi a éclipsé tousses voisins par ses rendements etses importants stocks de réserves,notamment en maïs, l’aliment debase du pays, en tabac et en coton.Le succès de sa politique de sécuritéalimentaire repose sur trois piliers : 1)une politique gouvernementale essentiellementaxée sur l’agriculture (subventionsdu secteur en intrants) ; 2)un leadership déterminé (le présidentMutharika est son propre ministre del’Agriculture) et 3) une classificationjudicieuse des priorités en matièrede ressources (le développement del’agriculture est la priorité n°1 dugouvernement).Outre ces 3 piliers, les médias jouentun rôle crucial dans la promotion del’agriculture et la sécurité alimentaireau Malawi. Toutefois, les médiasmalawites font face à des nombreuxdéfis. En effet, selon des études récentes,le Malawi n’a guère de politique endirection des médias ou de formationdans le domaine de l’information/de la communication agricole ; il n’yexiste pas d’opportunités de spécialisationdans le journalisme agriculture; le développement agricoleet rural n’est pas considéré commeun sujet d’actualité d’un grand intérêtpar les médias malawites, plutôttournés vers des valeurs élitistes eteurocentriques.Ce document se propose donc departager certains cas de réussite del’implication des médias dans l’agricultureau Malawi, et d’examiner lesdéfis auxquels ils (les médias) doiventfaire face.42
MEDIAS, NOUVEAU SERVICE MEDIA EMERGENT ET TICTIC ET COMMUNAUTEL’UTILISATION D’OUTILSWEB 2.0 AU SERVICE DEL’AGRICULTURE DURABLE :CAS DES PETITS AGRICUL-TEURS EN OUGANDAASSOCIER LA RADIO AUXTIC POUR UNE MEILLEUREINTERACTION ET UNERADIO “A LA DEMANDE”RURALE : DE L’ENGRAIS AUCOMPTE-GOUTTES POURL’AGRICULTURE AFRICAINEM. Souleymane OuattaraJADE, Burkina FasoDans la Sissili, Burkina Faso, MahamadiKorogo, conseiller agricole à laFédération des Professionnels Agricolesde la Sissili, la FEPPASI, incarne lechangement vers les TIC. Il rend visiteà Moumouni Nébié, un agriculteurmordu lui aussi de TICNébié doit beaucoup aux TIC. Sur leweb il a découvert en 2005 une organisationpaysanne béninoise, spécialiséeen technique production d’ignames etgrâce à une formation auprès d’elle,il produit lui-même ses semenceauxd’ignames. Autre figure marquante desTIC dans la Sissili, Joseph Dagano, lePrésident de la FEPPASI. Il a compristrès tôt l’énorme potentiel des TICpour mieux produire, conserver sesrécoltes et les commercialiser.Son organisation est affiliée au réseauTIC et Agriculture, une associationburkinabé de promotion des TIC. Leréseau sert de cadre de réflexion,d’échange et de partage d’expérienceset de ressources dans le domainedes TIC pour l’agriculture en vue del’épanouissement du monde rural.Une approche utilitaire des TIC orientéesur la production des modules de formation,la recherche de financementset d’appels d’offres, ou pour signaleraux instituts de recherche les maladiesdes plantes afin de leur trouver dessolutions. Les TICs sont égalementutilisés comme outils de transparencedans le choix des producteurs.Dotés de téléphones portables, lesenquêteurs suivent les prix sur lesmarchés qu’ils enregistrent et envoientinstantanément par sms sur des sitesweb voire pour diffusion à la radio età la TV nationale.Les exploitants agricoles affiliés à laFEPPASI peuvent s’écrier “agriculturenumérisée, agriculture boostée”. Maisleur réussite prouve paradoxalementque l’accès aux TIC restera encore pourlongtemps un rêve inaccessible pourdes milliers de paysans burkinabé.Mme Maureen AgenaWOUGNET, OugandaAvec les technologies modernes, lessecteurs public et privé doivent pleinementmettre à profit l’efficacitéet l’efficience des nouveaux médiastels que les outils du Web 2.0, pourtraiter, stocker et extraire l’informationagricole.En Afrique et plus particulièrementen Ouganda, les applications Web 2.0sont une nouveauté pour de nombreuxgens, notamment les petits agriculteurs.En effet, leur connaissance etleur usage des outils Web 2.0 dansl’exercice de leur métier reste insignifiant.Misant sur le journalisme citoyendans le projet Afrique, WOUGNET aformé certains de ses membres habituésà l’usage d’outils pour réseauxsociaux (les applications Web 2.0 tellesque les blogs, les wikis, les flux RSS,Flickr, Skype), ainsi qu’à la rédactiond’articles, à l’élaboration de témoignagesaudio, vidéo et numériqueset à l’édition en ligne).Cette initiative a permis à certainsagriculteurs en milieu rural d’utiliseret d’interagir avec les divers types demédias, afin de les aider à optimiserleur stratégie de communication surl’agriculture. Le journalisme citoyendans le projet Afrique vise à renforcerla capacité des organisations de lasociété civile à se servir des outils dece nouveau type de journalisme auxfins de publication, de lobbying, deplaidoyer, de réseautage et de partagedes connaissances, en mettant l’accenttant sur les médias traditionnels quenouveaux.La présentation met en évidence lepotentiel et les défis des outils Web2.0 appliqués à l’agriculture.Mme Margaret Nana KingamkonoAfrican Farm Radio ResearchInitiative, Farm Radio International,TanzanieLa radio est reconnue depuis longtempscomme un excellent outild’information à destination des populationsrurales faiblement alphabétisées.En effet, l’accès à la radio estbeaucoup plus important que l’accèsà tout autre moyen de communicationet, parce qu’elle diffuse des sons plutôtque des caractères imprimés, tousles auditeurs y trouvent leur compte.La radio a toutefois des points faiblestraditionnels : a) c’est généralementun support à sens unique et b) la radioest uniquement disponible à l’heureet le jour où ses programmes sontdiffusés. Son premier point faible enfait un outil imparfait pour le dialogue,la discussion, la rétroaction et l’interaction.Son deuxième inconvénientest que le public ciblé (notamment lesfemmes rurales) peut rater certains“épisodes clés” d’un programme,ou qu’il est impossible de réécouterplusieurs fois des informations quel’on estime complexes pour en avoirune meilleure compréhension. FarmRadio International, dans le cadre del’initiative de recherche en radio pourles agriculteurs africains, a beaucoupappris sur les multiples façonscréatives d’utiliser les TIC afin deremédier à ces deux inconvénients.L’interactivité avec les auditeurs peutêtre améliorée grâce à l’utilisationdes téléphones mobiles, des SMSet des appareils d’enregistrement àfaible coût. Les émissions interactivesbasées sur les appels téléphoniques,les logiciels de gestion des SMS etles lecteurs MP3 sont mis à profitpar les radios partenaires à l’AFRRIpour mieux faire entendre la voix desagriculteurs et promouvoir le dialogueentre et parmi les agriculteurs,les agents de vulgarisation et leschercheurs. Les lecteurs MP3 rembobinables,les systèmes interactifsd’enregistrement vocal, tout commed’autres TIC, offrent la possibilité de43
44fournir à davantage d’agriculteurs“des services radiophoniques à lademande”, que les auditeurs peuventréécouter à leur convenance.CONNECTAFRICA :METTRE EN RESEAU LESTELECENTRES EN AFRIQUEDU SUD ET EN ZAMBIEM. Dion Jerling - Connect AfricaService, Afrique du SudCet exposé porte sur un projet financépar le CTA et mis en œuvre dans larégion centre de la Zambie, qui met àprofit les TIC et les appareils mobilespour fournir divers services publicset privés aux communautés ruralesvivant dans les zones reculées.Le succès du téléphone portable enAfrique est universellement reconnu etbien documenté, mais il reste essentiellementune réussite urbaine. L’Afriquerurale n’a pas encore profité de cesprogrès, parfois spectaculaires, dansla communication mobile. Le projetConnectAfrica (Connecter l’Afrique)entend donc relever ce défi en alliantpour la première fois entreprise socialeet esprit d’entreprise, dans le but decréer un réseau de services rurauxqui coopère avec le gouvernement etle secteur privé pour fournir directementtoute une gamme de servicesaux communautés rurales.Avec toutes les solutions TIC disponiblesaujourd’hui, ConnectAfrica achoisi d’adopter une stratégie fondéesur la fourniture de technologies“adaptées aux besoins” des usagersruraux, pour mieux assurer la pérennitéet l’efficacité optimale de sesservices.L’exposé décrit les solutions technologiquesutilisées sur le terrain etcelles en phase d’expérimentation,ainsi que les difficultés concrètes etsouvent sous-estimées auxquellesfont face les fournisseurs de servicesen milieu rural. Il explique aussi lerôle que devraient jouer les différentsacteurs clés identifiés, afin degarantir un niveau optimal de serviceset préserver à tout prix la durabilitédu projet.Dion Jerling, directeur des projetsspéciaux de ConnectAfrica, a hâtede partager avec les participants auSéminaire du CTA certaines expériencesvécues sur le terrain, les défisà relever et les solutions mises enplace par son organisation.RESSOURCES DEL’INFORMATION,ENVIRONNEMENTMULTIDISCIPLINAIREET MEDIATIQUE POURLE DEVELOPPEMENTAGRICOLE EN TANZANIEM. Jabir Jabir - Sokoine NationalAgricultural library,TanzanieLes organes de presse en Tanzaniesouffrent d’un manque notable de ressourcestelles que les bibliothèques,la connexion Internet, les sourcesd’informations et un personnel bienformé au métier et à même de répondreà leurs besoins journalistiques. Cemanque de capacités s’étend égalementà la formation pluridisciplinaireau sein des médias, dans le domainede l’agriculture et de ses secteursconnexes. Avec la prise en compte dela composante pluridisciplinaire par lesprofessionnels des médias, l’objectiffixé par les décideurs en Tanzanie, enAfrique et dans le monde en général,de faire de l’agriculture une prioritéabsolue, pourrait bien être atteint àcondition que les médias y jouent unrôle majeur.Le processus de démocratisation enTanzanie continue d’encourager deplus en plus de groupes de presse àse lancer dans la diffusion de l’information.L’orientation actuelle indiqueque la plupart privilégient l’informationpolitique et la communication à butlucratif. Ils abordent et impliquentpeu le secteur agricole qui, pourtant,emploie près de 75% des Tanzaniens.Avec le manque de servicespublics de radiodiffusion, les médiasexistants, tant publics que privés, sepréoccupent davantage de subventionssusceptibles de favoriser et deprotéger leurs institutions, au lieu derelayer, d’analyser et d’évaluer lespolitiques à l’aune des perspectivesactuelles de développementPour une contribution efficace desmédias au développement agricoleet aux autres questions socioéconomiques,il est nécessaire d’opérer deschangements dans les programmeset d’introduire un volet Formation auxtechniques de l’information dans lesétudes de journalisme. Les organesde presse devraient surmonter cesdifficultés en enrichissant leurs sources,avec une connectivité fiable, unpersonnel qualifié pour gérer leursressources et centres d’information. Demême, ils devraient avoir une rubriquedédiée au traitement de l’informationsur l’agriculture et ne pas oublier dansleurs articles et émissions les autresacteurs du monde agricole, en nerapportant pas seulement des informationstechniques mais aussi destémoignages d’entreprises réussies.TELECENTRE DE NAKASEKEM. Peter Balaba,Télécentre de Nakaseke, OugandaCette affiche met en lumière le travaildu célèbre télécentre Nakaseke enOuganda. Il fait partie des cinq projetsde télécentres communautairespolyvalents soutenus par l’UNESCO,le CRDI et l’UIT, également lancésau Bénin, au Mali, au Mozambiqueet en Tanzanie. Ce télécentre fournitaux agriculteurs analphabètesdes services d’information dans desdomaines tels que les intrants agricoles,la manutention post-récolte,les prix du marché, la protection del’environnement, la gestion des sols,les produits de base à forte valeurajoutée, les systèmes de crédit etde microfinancement, les compétencesen agriculture commerciale,etc. Misant sur l’innovation depuisson ouverture en 1997, le télécentrepropose aujourd’hui une large gammede services divers et variés. Il a misen place une radio communautaire(FM 102.9) et ouvert une bibliothèque; il vend des services Internetet sans fil (téléphone interurbain,recharge de cartes téléphoniques…) ;il propose des cours de formation eninformatique, des services de réparationet d’entretien, des servicesde secrétariat, la couverture vidéode cérémonies et d’événements. Ilfournit également des informationssur le VIH/SIDA, ainsi que des programmesd’animation et un servicede collecte/distribution de livres dansles écoles les plus démunies.
RECOMMANDATIONS DES GROUPES DE TRAVAILRadio• faire le bilan de tout le travail déjàaccompli concernant le renforcementdes capacités par l’ensemble desacteurs concernés dans l’industriedes médias en Afrique; mise à jour,de réconciliation et d’optimiser ce quiexiste déjà plutôt que de la redondancedes efforts.• Permettre à chaque pays ou régionde déterminer comment la formationaura lieu tant en ce qui concernel’accréditation que le calendrier.• Encourager la demande sur le renforcementdes capacités qui impliquel’ensemble des parties prenantes,acteurs et institutions.• S’assurer que le renforcement descapacités pour la radio soit ancré auniveau local et réalisé en fonctiondes besoins.• Veiller à ce renforcement des capacitéssoit global mais aussi qu’il obéisseà des normes généralisées incluant latechnique, la production, la gestionde la station de radio et le développementde contenus.• Adapter le renforcement des capacitéspour les différents types destations de radio et de leur programmation.• Établir un programme de microfinancementaccordé sur concours, (parexemple d’environ 10.000-15.000Euros semblable à GENARDIS) pourse concentrer sur l’innovation desstations de radio et de l’apprentissage;Axer ce financement sur lacoopération des auditeurs et et leurreprésentation dans le développementagricole et rural.• Renforcer le suivi et l’évaluation dansles stations de radio et d’identifier àmesurer les contributions, les produits,les résultats et les impacts.• Fournir des possibilités de formationsur la planification, le suivi et l’évaluationpour les stations de radio.• Développer l’autoévaluation desstations de radio, autant que possible,tout en reconnaissant que, sila radio est financée par le gouvernementou doit conjoindre le suiviet l’évaluation avec les ministèresde l’agriculture ou de vulgarisation,il est important que le gouvernementfournisse des lignes directricessuffisantes pour effectuer le suiviet l’évaluation.• Encourager les stations de radiod’avoir un plan de travail de suiviet d’évaluation depuis le début dechaque programme / plan de travailannuel.• Encourager les stations de radio quiont débuté au titre de financementsextérieurs (par exemple l’UNESCO),demander à l’organisme donateurd’aider dans la conduite des processusde suivi et d’évaluation.• Aider les radios avec les compétencespour générer des fonds, effectuer desévaluations quantitatives et assurerune participation de l’auditeur.• Assurer la pérennité d’un plan stratégique/ d’un “businnes plan” dèssa création.• Plaider pour un environnement législatiffavorable aux radios communautaireset indépendantes.Télévision, videoet film• Identifier les besoins de formationexistants des études d’évaluationpour la vidéo et la télévision et àtraiter les priorités de renforcementdes capacités.• Produire un glossaire des termesagricoles pour les journalistes etprofessionnels des médias dans lespays ACP.• Fournir un de centre d’échange pourde (courtes) vidéos professionnellestraitant des questions agricoles etrurales dans les pays ACP.• Aider les gouvernements à élaborerdes politiques qui encouragentla communication visuelle sur lesquestions de développement agricoleet rural.• Mobiliser et soutenir les réseaux existants,les organisations régionales etles plateformes paysannes à diffuserdes programmes vidéo d’action développépar des sources multiples.• organiser des ateliers régionaux etnationaux avec de multiples intervenantset acteurs des médias pourformuler la demande pour de nouvellesproductions vidéo agricoles.• Donner la priorité pour la productionde film / vidéo dans le développementagricole et rural parce qu’ilest un outil puissant qui transcendeles frontières des distances, deslangues, des saisons et offre despossibilités nouvelles et pertinentespour l’analyse, l’apprentissage etde réflexion avec toutes les partiesprenantes.• Améliorer la qualité des film / vidéodans le développement agricole etrural en faisant une distinction entreles rôles de chacun des acteurs(même quand ils sont combinésen une ou quelques personnes):les commanditaires, producteurs,cinéastes, les facilitateurs de processuset spécialistes de la communication.• Elaborer des choix stratégiquesconcernant le niveau de professionnalismeexigé quant au résultatescompté, aux attentes des utilisateurset aux normes éthiques àrespecter.• Professionnaliser la production defilm / vidéo par un évènement vôtépar des semblabes (pairs) commeun festival de cinéma (conférence),les professionnels regardant, discutantet apprenant de semblables etd’améliorer la qualité et l’impact dela vidéo comme un produit et unprocessus.• Renforcer les capacités et informerles acteurs sur l’importancede définir des droits de propriétéintellectuelle et l’importance durespect mutuel entre les différentsacteurs de cinéma.Presse écrite(Journaux, magazineset suppléments)• Renforcer les capacités en octroyantdes bourses d’études pour les médiasimprimés, par des programmesd’échanges.• Fournir des renseignements sur lesorganismes de financement possiblespour les subventions de voyage et debourses dans les régions ACP.• Intégrer le développement agricole etrural dans la presse écrite à travers45
46des ateliers pour toutes les partiesprenantes du secteur.• Créer des subventions centralescompétitives pour les exercices deformation interne du développementagricole et rural, pour le renforcementinterne des capacités etd’assistance.• Organiser chaque année une conférencede presse écrite des paysACP.• Mettre en place un prix récompensantla presse écrite pour encourager l’excellencedans les reportages sur ledéveloppement agricole et rural.• Relater les réussites dans le domainedu développement agricole et ruraldans un portail à paraître chaqueannée et le rendre disponible dans leslangues parlées dans les pays ACP.• Fournir des conseils sur la collecte defonds et de distribuer la propositionde modèles.Autres types depresse écrite(Bulletins d’information,posters,brochures, bandesdessinées, affiches)• Fournir une formation sur le journalismecitoyen.• Identifier les outils d’évaluation etde suivi (ex. Sondages et questionnaires).• fournir des supports pédagogiquesconcernant les vérifications, lagestion financière, l’inventaire deséquipements, etc.• Soutenir des stages, les détachementset l’apprentissage pour laproduction d’impression.• Élaborer des politiques de sortiepour les actions de transfert auxrégions des pays ACP.• Poursuivre les discussions électroniqueset le portail des histoires deréussite sur le site Web du CTA.• Identifier des modèles possibles pourla création du Forum du réseau desmédias imprimés des ACP.Médiascommunautaires• Impliquer la communauté dans laplanification, la mise en oeuvre etl’évaluation des activités des médiascommunautaires.• Adopter une approche participativeet inclure tous les membres de lacommunauté.• Créer une plate-forme multiacteurspour soutenir les médias communitairesavec d’autres compétences/disciplines qui manquent à la communauté.• Arranger les contraintes institutionellescomme simplifier la procédured’octroi de licence pour les radioscommunautaires et la rendre abordablefinancièrement.• Élaborer et adopter des règles, desprincipes et un code éthique convenuspour les gérants des médiascommunautaires.• Documenter les politiques nécessaireset le cadre réglementaire pourles médias communautaires.• Élaborer des lignes directrices pourles décideurs engager et renforcerla visibilité des médias communautaires.• Soutenir le renforcement des capacitésdes médias communautairessur les questions de gestion.• Identifier les modèles de durabilitédans les médias communautaires• Inclure les femmes dans la gestionainsi que la production.• Identifier des moyens pour motiveret conserver des bénévoles.• Promouvoir le réseautage entre lesmédias communautaires au seindes pays locaux, nationaux et entrepays.• Développer le contenu en fonctiondes besoins locaux, la compréhensionet les langues.• Protéger (“copyright”) le contenulocal et respecter les droits de propriétéintellectuelle.• Encourager la documentation d’uncontenu local utilisant les TIC.• Promouvoir l’utilisation des TICappropriés et abordables et construireà partir des infrastructuresexistantes, de l’expérience, de ladisponibilité et du niveau communautaire.• Intégrer les TIC avec d’autres outilsde médias communautaires et desressources.• Offrir une formation continue sur lesTIC émergents selon la nécessité• Identifier les TIC et les exemplesde bonnes pratiques.• Planifier et financer le processus desuivi/évaluation dès le lancementdu média communautaire et la miseen place des stratégies de communication.• Utiliser les résultats d’évaluationpour affiner et réviser les pratiquessi nécessaire.• Etablir des partenariats avec d’autresmédias communautaires de paysACP pour favoriser l’échange demeilleures pratiques et le partaged’expériences.• Proposer une formation à la gestion,la production et programmer le suivi/évaluation.• Renforcer en permanence leurs capacitésinstitutionnelles pour qu’ilsrestent en phase avec les défis émergentsdu développement.• Encourager le renforcement des capacitésgrâce à un système de récompenseset de reconnaissance.
VI – Annexes6.1 Programmelundi 12 octobre 200909H00-12H0010H00-12H0012H00-13H00Enregistrement des participants (hôtel de Bedford)Réunion d’information avec les membres du comité directeur, les modérateurs, les intervenants,et les rapporteursDéjeuner (Hôtel Bedford)sessiON N° 14 DU BRIEFING DE BRUXELLES :develOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DES ACP :POURQUOI LES MEDIAS SONT-ILS IMPORTANTS ?13H10-13H3013H00-14h3014h30-15h00Départ de l’hôtel Bedford au Centre BorschetteEnregistrement au Briefing de BruxellesPropos liminaires : M. Ian Barber, Commission européenne,Sir John Kaputin, secrétariat des ACP, Dr. Hansjörg Neun, CTARapport sur les discussions électroniques du séminaire CTA 2009(Mme Susanna Thorp et Mme Laurence Lalanne, WREN Media, Royaume Uni)15H00-16H15 SESSION 1 : INTEGRER LES MEDIAS DANS LE DEVELOPPEMENT :QUELLE EST LA VOIE A SUIVRE ?Modérateur :Mme Tumi Makgabo, Africa Broadcasting and Media, Afrique du Sudmembres du jury• Son excellence Ndisale Brave, Ambassadrice du Malawi• Dr Ignatius Jean, IICA, Guyana• M. Jean-Philippe Rapp, directeur du forum international des médias nord-sud, Suisse• Dr Kris Rampersad, médias et consultant en matière d’instruction, Trinité-et-Tobago• Dr Hansjörg Neun, directeur de CTA, Pays-Bas16H15-16H45Pause café (Commission de l’UE)16H45-18H30 SESSION 2 : COMMENT LES MEDIAS PEUVENT-ILSmieux SERVIR LES COMMUNAUTES RURALES ?Modérateur :Dr Eugenia Springer, directeur Eugenia Springer Productions, Trinité-et-TobagoPrésentations et discussion• Les besoins et les enjeux du renforcement des capacités des médias dans les pays ACP(M. Sayouba Traoré (IFR) et Mme Violet Otindo, lauréate du prix KBC-CNN, Kenya)• Faire le lien entre les médias et les communautés locales(Dr Helen Hambly, Université de Guelph, Canada)• Médias dans les ACP et défis mondiaux : combler le fossé(Mme Tumi Makgabo, African Broadcasting and Media, Afrique du Sud)47Conclusions19H0020H15Réception (Commission de l’UE)Départ du Centre Borschette pour l’hôtel Bedford
Mardi 13 octobre 200909H00 - 09H20 Présentation de la structure et des objectifs du séminaire(Dr Helen Hambly, Université de Guelph, Canada; M. André Vugayabagabo, CTA, Pays-Bas)session 3 : LES MEDIAS ET LE DAR (SESSION PLENIERE)modérateur : Prof. Chris Kamlongera, Université du MalawiIntervenant : M. Kole Odutola, Université de Floride (USA)9H20-10H10Présentations orales• La vidéo dans le développement - le film au service du changement rural et lancement du livredu CTA (Dr Rico Lie et M. Andreas Mandler, Université de Wageningen, Pays-Bas)• La recherche d’informations par les médias du Pacifique sur le DAR(Mme Viola Ulakai, Tonga Broadcasting et Television Corporation, Tonga)• La voix du visuel. Stratégies d’apprentissage visuel pour l’analyse du problème,le dialogue social et la participation via la médiatisation(Dr Loes Witteveen, IRDT, Université de Wageningen, Pays-Bas)• Instaurer une relation d’amour entre l’agriculture rurale et les médias(Dr Eugenia Springer, Trinité-et-Tobago)Affiches• Traitement par les médias des questions de développement agricole et rural :enjeux et problèmes (Mme Matho Motsou Anne, Jade, Cameroun)• Sim-info ANOPACI (M. Kouao Sylvain, ANOPACI, Côte d’Ivoire)• Les médias dans l’agriculture : nous ne jouons pas les seconds rôles(M. Phil Malone, Countrywise Communications, Royaume Uni)• L’utilisation des multimédias pour favoriser le développement agricole etrural “Service secret du CABI” (Mme Janny Vos, CABI, Royaume Uni)10H10–10H4010H40–11H00Discussion en groupePause café11H00–11H30 Médias et vulgarisation agricole et apprentissageModérateur : Dr Kris Rampersad, médias et consultant en matière d’instruction,Trinité-et-TobagoIntervenant : M. Riccardo del Castello, FAO, ItaliePrésentations orales• La voix du paysan et la vulgarisation de l’information agricole au Cameroun(Mme Marie Pauline Voufo et Aude Ehlinger, Cameroun)• Rôle des médias pour combler le “fossé” entre les laboratoires et les exploitations agricoles(M. Sunil Kumar Singh, USP, Fidji)• La radio rurale : un moyen de promouvoir les services de vulgarisationaxés sur la demande au Malawi (M. Rex Chapota, AFRRI, Malawi)• La connaissance, la mise en réseau et la diversité : Opportunités pour le journalisme agricoleen Afrique (M. David Mowbray, BBC World Service Trust, Royaume Uni)Affiches48• Des approches innovantes pour améliorer l’accès aux informations agricoles :étude de cas pratiques (Dr O.I Oladele, Université, Botswana)• Obstacles à l’utilisation des médias pour promouvoir la vulgarisation et l’apprentissage en milieurural (M. Charles Oduor Ogada, Centre de ressources communautaires d’Ugunja, Kenya)• Le rôle des médias dans la diffusion des pratiques agricoles durables auprès des petits exploitantsagricoles au Kenya (M. John Cheburet, directeur de radio, The Organic Farmer, Kenya)11H30–12H3012H30–14H00Discussion de groupeDéjeuner
Session 3 : (CONTINUATION ET FIN) : LES MEDIAS ETLES QUESTIONS DE DAR (SESSIONS PARALLELES)ModérateurSession parallèle :1. Médias etchangementclimatiqueDr John Fitzsimons,UdG, Canada2. Médias etégalité dessexesMme Oumy Ndiaye,CTA, Pays Bas3. Financementdes médiasdans le DARMme JacquelineSluijs, KIT,Pays Bas4. Médias etzones aridesM. Rabah Lahmar,CIRAD,Burkina-Faso14H00–14H40 Présentations Présentations Présentations Présentations14H40–15H30 Discussion Discussion Discussion Discussion15H30–15H50 Pause café Pause café Pause café Pause caféSession parallèle 1 : MEDIAS ET CHANGEMENT CLIMATIQUEmodérateur : Dr John Fitzsimons (Université de Guelph [UdG], Canada)14H00-14H40Présentations orales• Le partenariat des médias dans le changement climatique (M. Parkie Mbozi, PANOS, Zambie)• Le changement climatique et les médias dans la région Pacifique(M. Samisoni Pareti, Islands Business International, Fidji)• La contribution des radios communautaires à la compréhension des impactsdu changement climatique sur l’agriculture à Koutiala au Mali(M. Moctar Niantigui Coulibaly, Alliance des Radios Communautaires, Mali)• Les concours d’écriture de scénarios radios pour promouvoir l’apprentissage desdiffuseurs africains sur les thèmes d’intérêt pour les petits agriculteurs(Mme Blythe McKay, Farm Radio International, Canada)Affiches• Défis et opportunités du reportage et de la communication sur les questions agricoles etrurales (M. Risdel Kasasira, Ouganda)14H40–15H3015H30–15H50Discussion de groupePause caféSession parallèle 2 : MEDIAS ET EGALITE DES SEXESModérateur : Mme Oumy Ndiaye, CTA, Pays-Bas14H00-14H40 Présentations orales• Promouvoir l’égalité des sexes dans le DAR grâce aux technologies del’information et de la communication : mythe ou réalité au Botswana ?(Dr Bantu Morolong, Université du Botswana, Botswana)• Développement agricole et rural dans le Pacifique - Faire le lien entre l’égalité des sexeset les médias (Mme Bernadette Masianini, Fidji)• Initiation à l’agriculture biologique, changement climatique et besoins alimentaires locaux :quel rôle pour les médias ? (Mme Dorienne Rowan Campbell, Network Intelligence, Jamaïque)Affiches49• Le genre dans les médias guinéens (Mme Mama Adama Keita, Radio Nationale, Guinée)• Le kit de ressources multimédias (Mme Melanie Hughes, Protégé QV, Cameroun)14H40–15H3015H30–15H50Discussion de groupePause café
Session parallèle 3 : FINANCEMENT DES MEDIAS DANS LE DARModérateur : Mme Jacqueline Sluijs, Institut tropical royal (KIT), Pays Bas14H00–14H40 Présentations orales• Une collaboration plus étroite est-elle la réponse aux problèmesfinanciers des entreprises de médias des ACP ?(M. Hans Determeyer, Free Voice Programme Manager Media Finance, Pays-Bas)• Le financement des médias dans le Pacifique (Mme Ruci Mafi, CPS, Fidji)• Le financement des médias et le DAR(M. Michael Waigwa, Cooperative Insurance Company, Kenya)• L’agriculture, les femmes et les médias - investissements essentiels(Mme Cece Fatope, International Women’s Media Foundation, Etats-Unis)Affiches• Principales tendances au niveau du financement du rôle des médias dans le développementagricole et rural (Dr Helen Hambly Odame, Université de Guelph, Canada)14H40–15H3015H30–15H50Discussion de groupePause caféSession parallèle 4 : MEDIAS ET ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDESModérateur : M. Rabah Lahmar, CIRAD, France14H00–14H50 Présentations orales(Note : Dans cette session les titres des présentations reflètent le domaine de recherche desscientifiques sur les cultures arides. La discussion de la table ronde de cette session sera axée surla façon de renforcer le rôle des médias dans la recherche sur les cultures arides.)• Étude et analyse des impacts des exploitations agricoles et des exploitations d’élevagesituées autour des secteurs protégés : Cas du parc “W” de la République du Niger(Mme Teresa Fernandes Pereira Veiga Tavares, Cap Vert)• Faire le bilan de la réhabilitation des sols dégradés dans les régions sèches du Sahel enutilisant la technologie zaï (Burkina-Faso, Mali, Niger) (Mme Delphine Droux, France)• Une analyse économique de l’effet des caractéristiques de la variété sur l’adoptionde variétés améliorées de pois cajan dans les terres sèches du Kenya :une étude de cas du district de Taita (Mme Zipora Otieno, Kenya)• Une analyse des groupes de fermier dans l’agriculture de conservation (CA) dans les régionsde terres sèches du Malawi : un cas à Chinguluwe EPA et dans le village modèle de Salima etde Nkomba à Bazale EPA dans la zone de Balaka (M. Mavuto Mdulamizu, Malawi)14H50–15H3015H30–15H50Discussion de groupePause caféSession 4 : COMMUNICATION ENTRE LES MEDIAS ETD’AUTRES ACTEURS DU DAR (SESSION PLENIERE)Modérateur : M. Phil Malone, Countrywise Communications, Royaume-UniIntervenant : Dr Kerry Albright, DFID, Royaume Uni5015H50–16H20 Présentation orale• Partenariat entre la formation à la gestion des ressources naturelles et agricoles etla radio rurale dans les régions méridionales et du sud-est du Sénégal(M. Madior Fall, USAID WULA NAFAA-Sénégal)• Rôle de la radio dans le développement agricole dans le Pacifique(Mme Rita Narayan, productrice radio, Regional Media Centre, CPS, Fidji)• Faire ressortir les forces du contenu local à travers la communication participative(M. Charles Dhewa, conseiller de gestion, Knowledge Transfer Africa, Zimbabwe)
Affiches• Services consultatifs de fermier innovateur en utilisant les TIC(M. Francois Stepman, FARA, Ghana)• Établir le lien - l’approche de WRENmedia pour appuyer une meilleure présentation par lesjournalistes des informations sur la science et créer des partenariats entre les médias etla communauté de recherches agricoles (Mme Susanna Thorp, WRENmedia, Royaume Uni)16H20–17H10Discussion de groupe17H10–18H00 SESSION DE PRESENTARION DES AFFICHES(TOUS LES PARTICIPANTS)Mercredi 14 octobre 2009Session 5 : CONTRIBUTION DES MEDIAS A LA POLITIQUE AGRICOLE,A LA PROGRAMMATION ET A LA GESTION DES CONNAISSANCES(SESSION PLENIERE)Modérateur : Mme Helene Michaud, BARN, Pays BasIntervenant : Dr Abibtou Diop-Boare, CIRES, Université Abidjan, Côte d’Ivoire9H00–09H4009H40–10H3010H30–11H0011H00–12H00Présentations orales• L’outil SIST et l’accès à l’information pour les journalistes du secteur agricole et rural(M. Helmer Thierry, CIRAD, France)• Le magazine radio Mwana Alirenji (autosuffisance alimentaire) transforme les fermiersmalawiens en chercheurs, innovateurs et les rend autonomes sur le plan alimentaire(M. Gladson Elemiya Makowa, Story Workshop, Malawi)• Highway Africa (Dr Chris Kabwato, Université de Rhodes, Afrique du Sud)Affiches• L’évaluation de l’émission radio dans le développement rural :une question de coût de transaction (M. Chris Yordy, Canada)• Capacités importantes pour la radio communautaire(M. Oumar Seck Ndiaye, AMARC-Africa, Sénégal)• Créer des capacités universitaires pour les médias et le développement rural(Prof. Benedict Mongula et Mme Langa Sarakikya,Université de Dar es Salaam, Tanzanie)Discussion de groupePause caféOrganisation de l’émission spéciale de TV(seulement pour les participants impliqués dans la session TV)Session 6 et 7Session 6 : Session d'affiches Session 7 : un programme TV“les médias et l’agriculture :un mariage de raison ?”12H00–13H30 Groupe francophone Groupe anglophone12H30–14H00Déjeuner14H00–15H45 Groupe anglophone Groupe francophone5116H30 Départ de l’hôtel Bedford au Palais des Colonies
Session 8 : CEREMONIE DU 25 E ANNIVERSAIRE DU CTA18H00–21H30Cérémonie du 25 e anniversaire du CTA et Prix des médias 2009 du CTAJeudi 15 octobre 2009Session 9 : ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DES MEDIAS :RENFORCER LES CAPACITES DES MEDIAS DANS LE DEVELOPPEMENTAGRICOLE ET RURAL (SESSION PLENIERE)Modérateur : M. Stephen Hazelman, CPS, FidjiIntervenant : Prof. Chris Kamlongera, Université du Malawi9H00–9H409H40–10H2010H20–10H40Présentations orales• L’initiative africaine de développement de médias(M. David Mowbray, BBC World Service Trust, Royaume Uni)• Formation des médias dans les Caraïbes (Dr. Maria Protz, CARIMAC, Jamaïque)• IAALD - Renforcement des capacités pour établir un lien entre les bibliothèques etles médias partenaires (M. Joel Sam, INSTI et IAALD, Ghana)• Renforcement des capacités dans les Caraïbes (Dr Arlington Chesney et Mme Diana Francis,Caribbean Agricultural Research and Development Institute et l’Inter-American Institute forCooperation on Agriculture, Trinité-et-Tobago)• Renforcement des capacités et partage des connaissances à travers la radio communautaire(Dr Marcelo Solervicens, AMARC, Canada)Affiches• Défis dans l’agriculture et le développement - reportage au Malawi(M. Levi Zeleza Manda, Université du Malawi, Malawi)Discussion de groupePause caféSession 10 : MEDIAS, NOUVEAU SERVICE MEDIA EMERGEANT ET TIC(SESSION PLENIERE)Modérateur : Dr Hansjörg Neun, directeur, CTA, Pays-BasIntervenant : Mme Oumy Ndiaye, CTA, Pays-Bas5210H40-11H2011H20–12H00Présentations orales• TIC et communautés rurales (M. Souleymane Ouattara, JADE, Burkina Faso)• L’utilisation des outils du web2.0 pour une agriculture durable :le cas de petits exploitants en Ouganda (Mme Maureen Agena, WOUGNET, Ouganda)• Etablir un lien entre la radio et les TIC pour une plus grande interaction etla “radio sur demande” (Mme Margaret Nana Kingamkono, African Farm RadioResearch Initiative, Tanzanie)• Connecter l’Afrique rurale à l’aide de dispositifs mobiles(M. Dion Jerling, Connect Africa Service, Afrique du Sud)• Nouvelle technologie de la communication et de l’information dansle secteur agricole en Haïti (M. Talot Bertrand, MICT, Haïti)Affiches• Ressources de l’information, environnement multidisciplinaire et médiatique pour ledéveloppement agricole en Tanzanie (M. Jabir Jabir, bibliothèque agricolenationale de Sokoine, Tanzanie)• Nakaseke Telecentre Ouganda (M. Peter Balaba, Nakaseke Telecentre, Ouganda)Discussion de groupe
Session 11 : GROUPES DE TRAVAIL SUR LES MEDIAS - TRAVAILLERENSEMBLE SUR UNE ACTION ET DES RECOMMANDATIONS12H00–13H0013H00–14H0014H00–15H3015H30–16H0016H00–18H00Radio (modérateur : Rex Chapota, AFRRI, Malawi)Télévision et vidéo (modérateur : Riccardo del Castello, FAO, l’Italie)médias imprimés (modérateur : Howard Williams, union des journalistes environnementaux,Sierra Leone)médias et communautés rurales (modérateur : Jose Felipe Fonseca, CTA, Pays-Bas)DéjeunerRadioTélévision et vidéomédias imprimésmédias et communautés ruralesPause caféRadioTélévision et vidéomédias imprimésmédias et communautés ruralesSession 12 : CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS -CEREMONIE DE CLOTURE ET CONFERENCE DE PRESSE18H00 -18H4518H45 -19H3019H00Conclusions et recommandationsCérémonie de clôtureConférence de presseRafraîchissementsVendredi 16 octobre 20099H00–10H30Départ des participantsVisites des institutions à Bruxelles (pour ceux qui partent le vendredi soirée ou le samedi)53
6.2 Liste des participants54Nom Prénom Fonction/Organisation / AdresseAbdoulaye Ibbo Daddy DirecteurLes Echos du SahelVilla 4012 - Cité 105Logements, Niamey - NigerAdolph Serge ComptableCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasAgena Maureen Chargée d’informationWOUGNETP.O BOX 4411Plot 55, Kenneth Dale,Kamwokya - OugandaDaniel Aghan Coordinateur nationalMedia for Environment,Science, Health andAgriculture (MESHA)P.O. Box 1285,0100 Nairobi,South Gate Centre,South B, Mukoma RoadKenyaAlbright Kerry Manager de recherchesen communicationResearch Uptake Team,DFID Research &Evidence Division,Department for InternationalDevelopment1 Palace Street,London SW1E 5HERoyaume-UniAmédé Louis Coordonnateur GénéralRéseau des Journalistes del’Afrique de l’Ouest et duCentre pour l’Agriculture(REJAOCA)01 BP 1807, AbidjanCôte d’IvoireAndriessen Wim Partenariat DGIS-Wageningen URWageningen URP.O.Box 88, 6700 AB,Wageningen - Pays-BasAudigier Ariane Consultantedéveloppement deprojet communication -coordination6, Rue Rampal,75109 Paris - FranceMaseseAzaelWinsley Journaliste /Correspondant / EcrivainG The standard groupKisumu - KenyaTéléphoneE-mail+22 720 743 217 ibbo_daddy@yahoo.com+31 317 467 123 adolph@cta.int+256 782 807 709+560 414 532 035info@wougnet.org+254 728 27 99 66 meshakenya@yahoo.comdaghan@handicap-international.or.ke+44 20 7023 0035 K-Albright@dfid.gov.uk+22 520 370 666 louisamede@yahoo.fr+31 317 486 810 wim.andriesse@wur.nl+33 6 60647756 aaudigier02@yahoo.fr+254 734 549 140 wmasese@eastandard.net
Bafana Busani Consultant en médiasFood, Agriculture andNatural Resources PolicyAnalysis Network64961 Tshabalala,BulawayoZimbabweBalaba Peter ManagerNakaseke TelecentreOugandaBaluku Rev. Nason PrésidentSATNET BoardP. O. Box 346, KaseseOugandaBarber Ian Chef de de celluleinformation etcommunicationCommission EuropéenneDG DEV/SC 153-39European Commission,1049 Brussels - BelgiqueBarro Albert Agromachiniste/Science du solINERA/SARIAProgramme GRNSPBP 10 KoudougouBurkina FasoBarry Abdoulaye JournalisteRTSBP 1765, TriangleSud Dakar - SénégalBel Sarah Chargée de communicationMicroinsuranceInnovation Facility,International LabourOrganization4, route des Morillons,CH-1211 Genève 22SuisseBengaly Oudou Financier-InformaticienKENETIC4DEVTIC pour ledéveloppement dans leKenedougou BP 215 - MaliBertrand Talot Chef de Service dePlanification et de Mobilisationdes RessourcesMinistère de l’Intérieuret des CollectivitésTerritoriales (MICT)310, Route De Bourdon,Port-Au-Prince - HaïtiShabanibin SweniModesteDirecteurRadio Sauti ya Mkaaji53, avenue LAMBA ,Kasongo - rdc+263 912 755 553 busani.bafana@gmail.combafana@netconnect.co.zw+256 782 902 991 balapet2001@yahoo.com+256 782 309 778 nasoncanon@yahoo.com+22 50 44 65 10 altbarro@yahoo.fr+221 33 849 12 21 bary_sn@yahoo.fr+41 22 799 82 97 bel@ilo.org+223 21 622 450 oudoubeny@yahoo.fr+50 937 335 953 talotbertrand@yahoo.fr+243 81 31 36 043 sautiyamkaaji@yahoo.fr oumodesteshabani@yahoo.fr55
56Blenman Rose Chargée de communicationet de projet SeniorCARICOM SecretariatP.O. Box 10-1089, Lot 18,Brickdam, Stabroek,Georgetown - GuyanaBoto Isolina Chef du bureauCTA de BruxellesRue Montoyer 39,Bruxelles - BelgiqueBoulc’h Stéphane Responsable publication -Chargé d’étudesCOTA7 rue de la révolutionB - 1000 BruxellesBelgiqueBoutin Jean Fritz Membre du conseild’administration du CTAFaire suivre au secrétariatpour le conseild’administration du CTAHaïtiBurguet Jean-Claude Chef de départementDépartementAdministration, Budget etRessources humainesCTA P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasChapota Rex Coordinateur derecherche nationalAFRRIP.O Box 30268Lilongwe 3. MalawiChesney Dr Arlington Directeur ExécutifCaribbean AgriculturalResearch andDevelopment InstituteP.O. bag 212, Universitycampus, St AugustineTrinité-et-TobagoChevouline Thilda StagiaireDépartement des servicesde communicationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasClarke Kevin Ecrivain/Producteur/PrésentateurJamaica InformationService - RadioDepartment.Jamaica InformationService, 58A Half-Way-TreeRoad, Kingston 10Jamaïque+592 222 0001/75 rblenman@caricom.org+32 2 513 74 36 boto@cta.int+32 2 250 38 36+32 2 218 18 96stephane.boulch@cota.be+5 092 463 202 jfritzb@hotmail.com+31 317 467 125 burguet@cta.int+265 09 99 899 489+265 01 771 823+1 868 6451205/7+1 868645-3573rex@wuscmw.orgexecutive@cardi.org+31 317 467 186 chevouline@cta.int+18 769 291 269+1 876 484 9721kclarke@jis.gov.jmkoclarke@gmail.com
Clavel Daniele Coordinatricedu projet AIDACIRAD-BIOS(Bat 1, bureau 34)TA A-08/01, Av Agropolis34398 Montpellier cédex 5FranceCoulibalyMoctarNiantiguiDirecteur ExécutifAlliance des RadiosCommunautaires du MaliDjelibougou DoumanzanaRue 251 Porte 370 BP E1539 Bamako - MaliDardagan Colleen JournalisteThe Mercury NewspaperP O Box 47549, Greyville4023, KwaZulu-NatalAfrique du Sudde SousaDelCastello+223 76 23 69 94 radioscommunautairesdumali@yahoo.frDetermeyerProfessorRaul BrunoRiccardoJ. E. J.(Hans)Membre du conseild’administration du CTAFaire suivre au secretariatpour le conseild’administration du CTA,PortugalChargé de communicationFAO, Research andExtension DivisionVia delle terme, RomeItalieManager de programmesur les finances desmédiasFree VoiceSumatralaan 45,Hilversum - Pays-BasDhewa Charles Knowledge Transfer Africa30 Shortson, DerbyshireWaterfalls, HarareZimbabweDiagne Falilou PrésidentUnion des GroupementsPaysans de Meckhe(UGPM)BP 43 Meckhe - SénégalTouréDialloHabyDirectrice et responsablede programmeRadio CommunautaireBèlèkanBP 133A Kati ImmeubleSériba Sidibé NoumorilaMaliDieye Papa Oumar Chef de communicationet informationCentre RegionalAGRHYMET. CILSS.P.O. Box 11011, NiameyNigerDiop-Boaré Abibatou Directrice AdjointeCIRES, Université Abidjan08 BP 1295, AbidjanCôte d’Ivoire+33 4 67 61 59 70 daniele.clavel@cirad.fr+27 31 08216 colleen.dardagan@inl.co.za+351 213 653 427 brunosousa@isa.utl.pt+39 657 054 051 riccardo.delcastello@fao.org+31 356 250 110 hans.determeyer@antenna.nl+263 4 759695 dhewac@yahoo.co.uk+221 33 955.51.13 ugpm@sentoo.sn+223 21 27 28 84+223 66 76 42 75+22 793 930 626+227 203 153 016habiba_dl@yahoo.frP.Dieye@agrhymet.neadmin@agrhymet.neadiopboare@yahoo.fr57
58Doudet Thierry Chef de départementDépartement Produitsd’information et dedisséminationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasDroux Delphine Projet AIDAUniversité de Paris 12,CIRAD /INERA01 square Boileau78150 Le Chesnay - FranceEbeda Xavier ConsultantGlasshouse25 rue Dauphine,75006 Paris - FranceEhlinger Aude Responsable despartenariats (Burkina Fasoet Cameroun)SOS Faim Luxembourg88, rue Victor Hugo,L-4141 Esch/AlzetteLuxembourgFadope Cece Manager duprogramme AfriqueInternational Women’sMedia Foundation1625 K Street, NW,Suite 1275Washington , D.C. 20006Etats-Unis d’AmériqueFall Madior Responsable dela CommunicationUSAID WULA NAFAA-SenegalBP-45 TambacoundaSénégalFayeIbrahimaLissaDirecteur de Publicationwww.pressafrik.comSicap Liberté 6 no. 8117Dakar BP 30018 - SénégalFitzsimons Dr John ProfesseurSchool of EnvironmentalDesign & RuralDevelopment, OntarioAgricultural CollegeUniversity of Guelph 1Stone Road, Guelph,Ontario, N1G 2W1CanadaFonseca José Filipe Coordinateur deprogramme seniorDépartement des servicesde communicationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-Bas+31 317 467 127 doudet@cta.int+33 1 67 97 34 20 delphine.droux@laposte.net+33 6 16960597+352 49 09 96 24 aude.ehlinger@sosfaim.org+1 202 567 2602 cfadope@iwmf.org+221 33 939 80 16 salabigue@hotmail.com+221 33 867 92 83 ilf@pressafrik.com+1 519 824 4120 jfitz@uoguelph.ca+31 317 467 133 fonseca@cta.int
Francis Judith Coordinatrice deprogramme seniorDépartement dePlanification etservices stratégiquesCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasFrancis Diana Spécialiste régionalIICA Policies and TradeProgram3 Herbert Street Newtown,Port of SpainTrinité-et-TobagoGoutier Hegel Chef ACP - Communicationde la presseLe Courrier45 rue de Trèves, 1040Bruxelles - BelgiqueHackshaw Karen Coordinatrice deprogrammeDépartement Produitsd’information etde diffusionCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasHailu Michael Chef des Servicesd’Information,de communication etpublicationCGIAR - EthiopieHamidou Djibo Projet AIDACentre RegionalAGRHYMET. CILSS.P.O Box 11011, NiameyNigerHanschke Oliver Public AwarenessNetworks and knowledgemanagement for ruraldevelopmentDivision 45 - Agriculture,fisheries and foodDeutsche Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit(GTZ) GmbHPO Box 518065726 EschbornAllemagneHazelman Stephen CoordinateurSecrétariat de lacommunauté du PacifiquePrivate Mail Bag, SuvaIles FidjiHelmer Thierry Chef du projet SISTCIRAD/DSITA 383/05Avenue Agropolis34398 Montpellier Cedex 5France+31 317 467 190 francis@cta.int+1 868 284 4403 diana.Francis@iica.int+3 222 374 392 hgoutier@acp-eucourier.info+31 317 467 157 hackshaw@cta.intM.Hailu@cgiar.orghdjibo@agrhymet.ne+49 6196 79 3293 Oliver.Hanschke@gtz.de+6 793 370 733 stephenh@spc.int+33 4 67 61 44 10 thierry.helmer@cirad.fr59
60Hughes Melanie BénévolePROTEGE QV7488 avenue de l’épéeMontréal, QuébecH3N 2E5 - CanadaJabir Jabir A. Assistant debibliothèque principalSokoine NationalAgricultural LibraryP. O. Box 3217Morogoro - TanzanieJama Charles Chargé de communicationCommon Fund forCommoditiesStadhouderskade 551072 AB AmsterdamPays-BasJean Ignatius Représentant de IICAInter-American Institutefor Cooperation onAgriculture (IICA)P.O. Box 10-089Lot 18, Brickdam,Strabroek - GeorgetownGuyanaJerling Dion CoordinateurConnect Africa ServicesPostnet Suite 96, PrivateBag X9, Melville, 2109JohannesburgAfrique du SudJohnrose Johnson Chargé de communicationCaribbean TourismOrganizationOne Financial Place,Collymore Rock,St. Michael - BarbadeKaah Aaron Yancho Producteur/ journalisteRadio OkuP.O. Box 214 BamendaCamerounKabwato Chris DirecteurHighway AfricaRhodes University,GrahamstownAfrique du SudKamlongeraChrisDirecteurSADC Centre forCommunication andDevelopmentMalawiKaramagi Ednah Directrice ExécutifBROSDIP.O. BOX 26970 KampalaOugandaKasasira Risdel EditeurUltimate media consultP.O. Box 36665Kampala - Ouganda+1 514 475 3394 melhugs@gmail.com+255 773 718 725 jjjbjaj@yahoo.com+31 20 575 49 56 Charles.Jama@common-fund.org+592 2 268 347+592 2 268 835+27 82 487 8354(South Africa)+260 97 686 0113(Zambia)+27 82 487 8354ignatius.jean@iica.intdion@connectafrica.netmelanie.malema@connectafrica.net+1 246 427 5242 jjohnrose@caribtourism.com+23 799 280 196 aaronkah@yahoo.co.uk+27 8 25829534 c.kabwato@ru.ac.za+256 772 506 227+256 392 963 527+25772627676+256 751 627 676+256 782 308 901comdev@fanr-sadc.co.zwednahkaramagi@brosdi.or.ugrisdel.kasasira@gmail.comkasasira@ultimatemediaconsult.com
Kayula Frank Directeur deprogramme régionalPANOS Southern AfricaPO Box 39163, LusakaZambieKazadi Carine Expert juniorCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasKebede Yodit Consultante JuniorDépartement dePlanification etservices stratégiquesCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasKeitaMamaAdamaJournalisteRadio NationaleBP 4334, Conakry - GuinéeKhadar Ibrahim Chef de départementDépartement dePlanification etservices stratégiquesCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasKindembe Kanza Tito Editeur responsableet rédacteurC retro magazine39 avenue Houbade Strooper1020 Bruxelles - BelgiqueKingamkonoKleinbussinkKoda-TraoréMargaretNanaDebbieAboubacarAfrican Farm RadioResearch InitiativeP.O.Box 105110Kiko Avenue, Mikocheni,Plot no. 247/248Dar es Salaam - TanzanieAssistanteadministrative seniorCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasCoordinateurde programmeDépartement des servicesde communicationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasKojane Mogogi Directeur de l’informationagricole et relationspubliquesMinistère de l’AgricultureP/Bag 003Gaborone - BotswanaKouao Sylvain Chef de projetANOPACI01 BP 8089 Abidjan 01Côte d’Ivoire+260 211 263 258 frank@panos.org.zmfmkayula@yahoo.co.uk+31 317 467 142 kazadi@cta.int+31 317 467 145 kebede@cta.int+224 60 28 14 12 /64 54 31 87ananconakry@yahoo.fr+31 317 467 159 khadar@cta.int+32 488 602 782 contact@c-retro-actuel.net+255 784 695 028+255 222 701 840margaret.kingamkono@afrri.net+31 317 467 150 kleinbussink@cta.int+31 317 467 138 koda@cta.int+2 673 689 475 mkojane@gov.bw+2 550 782 928 skouao@gmail.com61
62Lahmar Rabah Coordinateur duprojet KASSACIRAD, DépartmentCultures Annuelles,Programme Gestion desEcosystèmes CultivésAvenue Agropolis FR-34398 Monpellier Cedex 5FranceLalanne-DevlinLaurenceConsultanteWRENmedia99 High Street, Wheatley,Oxford OX33 1XPRoyaume-UniLie Rico Assistant professeurUniversité de WageningenDepartment ofCommunication Science -Communication andInnovation Studies GroupP.O. Box 8130, 6700 EWWageningen - Pays-BasMafi Ruci Journaliste au Pacific WayCentre de média régionalSécrétariat de lacommunauté du Pacique3Luke StreetNabua, Suva CityIles FidjiMakgabo Tumi Journaliste et ConsultanteAfrican Broadcastingand MediaP.O. Box 307,Bromhof, 2154Afrique du SudMakowaGladson ElemiyaManager Media etCommunicationsStory Workshop PrivateBag 266Blantyre - MalawiMalone Phil DirecteurCountrywiseCommunications103 Main Road, WilbyNorthants NN8 2UBRoyaume-UniManda Levi Zeleza Université du MalawiP/Bag 303 ChichiriBlantyre 3 - MalawiMandler Andreas Consultant50122 Florence - ItalieMasianini Bernadette Chargée d’informationagricoleSPC/EU Developmentof Sustainable Agriculturein the Pacific - Iles FidjiMbozi Parkie Directeur exécutifPANOS Southern AfricaP.O. Box 39163, LusakaZambie+33 4 6761 5641 rabah.lahmar@cirad.fr+44 18 65 87 40 03 laurence@lalanne.fsbusiness.co.uk+31 317 482 599 Rico.Lie@wur.nlrucim@spc.int+27 82 859 9190 ronniewhit@wol.co.za+265 888 208 130+265 1 821 335/657gladson@africa-online.net+441 933 272 400 media@countrywise.com+2 659 991 156 lmanda@poly.ac.mw+393 346 194 460 andreas.mandler@google-mail.com+31 20 5688259 berni@connect.com.fj+260 21 1 263258+260 978 506 945parkie@panos.org.zm
McKay Blythe CoordinatriceCommunication dedéveloppmentFarm Radio International1404 Scott Street, Ottawa,Ontario - CanadaMdulamizu Mavuto Projet AIDAUniversité du MalawiMalawiMichaud Hélène Productrice Senior AfricaBARN - P.O. Box 222,Hilversum - Pays-BasMikenga Samuel Coordinateurde programmeDépartement des servicesde communicationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasMinderhoudJonesMarilynConsultanteBenedendorpseweg 1267,6862 WH OosterbeekPays-BasMitchell Damion JournalisteJamaica GleanerNewspaper7 North Street, KingstonJamaïqueMongula Benedict ProfesseurInstitut des études dedévelopement, universitéde Dar es SalaamP.O. Box 35169 Dar esSalaam - TanzanieMorant Philippe Conseiller Techniquedu Directeur GénéralCentre RégionalAGRHYMETBP 11011 Niamey - NigerMorolong Dr Bantu University of BotswanaPrivate Bag UB 00707Gaborone - BotswanaMowbray David Directeur, AfriqueBBC World Service Trust301 NE Bush House, theStrand, London WC2B 4PHRoyaume-UniMurray Tony ConsultantRua DesignLaan van Nieuw Guinea 553531 JC Utrech - Pays-BasNarayan Rita Productrice radioCentre de média régionalSécrétariat de lacommunauté du PaciquePrivate Mail Bag, Suva, Fiji3 Luke St, Nabua, SuvaIles Fidji+16 137 613 652 bmckay@farmradio.orgmavutomdula@yahoo.com+31356724272 Helene.Michaud@rnw.nl+31 317 467 101 mikenga@cta.int+31263391126+31 652 053 495marilynminderhoud@yahoo.co.uk+1 876 773 7474 mitchell.damion@gmail.comFax:+255 22 2410078+227 20 31 53 16(poste 265)damion.mitchell@gleanerjm.commongula@uccmail.co.tzmorant@cirad.frmorolongbl@mopipi.ub.bw+442 075 572 702 david.mowbray@bbc.co.uk+31 30 2443005 tony@ruadesign.org+679 3370 733ext 358ritan@spc.int63
64Ndiaye Oumy Chef de départementDépartement des servicesde communicationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasN’diaye Oumar Seck Président AMARCAFRIQUE et Vice Présidentpour l’AFRIQUE deAmarc internationalAMARC-AfricaScat Urbam lot 68appartement B2 - DakarSénégalNeun Dr Hansjörg DirecteurCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasHamblyOdameProfesseurHelenProfesseur AdjointeSchool of EnvironmentalDesign & RuralDevelopmentCapacity Development andExtension, Universityof Guelph, Room 119Landscape Architecture,Ontario - CanadaOdutola Kole InstructeurYoruba, African &Asian languages andliterature dept.Université de Floride,Gainesville2601 NW 23rd Blvd. #173Gainesville, FL 32605Etats-Unis d’AmériqueOgadaOladeleCharlesOduorProfessorO.I.Coordinateurde programmeUgunja CommunityResource CentreP.O.Box 330 - 40606,Ugunja - KenyaProfesseurEducation and ExtensionBotswana College ofAgricultureUniversity of BotswanaP/Bag 0027 Gaborone.BotswanaOnana Paul StagiaireDépartement des servicesde communicationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-Bas+31 317 467 140 ndiaye@cta.int+221 77 6779090+221 77 5531978+31 317 467 131 neun@cta.intoumar_seckndiaye@yahoo.fr+1 519 824 41 20 hhambly@uoguelph.ca+13 522 732 959 Odutola@scils.rutgers.edu+225 22 41 65 4+225 22 41 54 83+26 774 658 247+2 673 928 753charlesogada@swift-mail.comoladele20002001@yahoo.com+31 317 467 185 onana@cta.int
Ong’an’a Dr Obiero DirecteurLake Victoria Centerfor Research andDevelopment (OSIENALAFriends of Lake Victoria)Dunga Beach - KisumuP.O. Box 4580 - 40103Kisumu - KenyaOnyango James Directeur ExécutifKAIPPGP. O. Box 2448 Kakamega50100 - KenyaOtiendo Zipora Awuor Projet AIDAUniversité de Nairobi,faculté d’ Agriculture,Départment de l’économieagricoleP.O.BOX 19301-40113Kisumu - KenyaOtindo Violet lauréate du prix KBC-CNNK24 television3rd Floor, Longonot Place,Kijabe Street Nairobi00100 - KenyaOuangraouaOuattaraBoukariFatoumaSophieJournaliste/Communicateur pourle développement /FormateurInades Formation Burkina01 BP 1022Avenue Conseil Del’Entente Secteur 9OuagadougouBurkina FasoJournalisteEdition Sidwaya01BP 5O7,Ouagadougou 01Burkina FasoOuattara Souleymane JournalisteJade Productions01 BP 6624OuagadougouBurkina FasoOuédraogo Roukiattou JournalisteBurkina - NTIC09 BP 1170,Ouagadougou 09Burkina FasoPareti Samisoni Rédacteur seniorIslands BusinessInternationalP.O Box 12718, SuvaIles FidjiPerkins Kevin Directeur ExécutifFarm Radio International1404 Scott Street, Ottawa,Ontario - Canada+254 572 023 487 goganda@yahoo.co.ke+254 56 641004 kaippg@africaonline.co.ke+254 721 848 785 ziplindah@yahoo.com+254 2124800/1/2 violet.otindo@K24.co.ke+226 50 38 28 29 ouaboukari@yahoo.fr+2 270 690 870 Sofifa2@yahoo.fr+226 76 64 97 42+226 50 38 82 74souattara@fasonet.bfroukiattou@yahoo.fr+6 799 930 873 paretis@gmail.com+16 137 613 652 kperkins@farmradio.org65
66Pompigne-MognardNicolasSecrétaire généralAfrican Press OrganizationMCM - 1, rue du GrandChêne - Case 574, 1001Lausanne - SuisseProtz Maria Coordinatrice de l’initiativepour le le développementdurable pour la communicationaux CaraïbesCARIMAC CaribbeanBox 291 St Anns BayJamaïqueRaghubir Nazima JournalisteTV/CTA Video, GuyanaPress Association,PRIME NEWS INC.302 church street,Queenstown, GeorgetownGuyanaRambaldi Giacomo Coordinateur deprogramme seniorDépartement des servicesde communicationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasRampersadDrKrishendayeConsultante media etinstruction20 Bedaissie Street,St. Augustine South,Trinité-et-TobagoRichards Peter JournalisteCMC – Caribbean,Radio TV Internet28 Turquoise Drive,Diamond Vale,Diego MartinTrinité-et-TobagoRodgers Josephine DirectriceCountrywiseCommunications103 Main Road, Wilby,Northants NN8 2UBRoyaume-UniRodriguez Merche AssistanteDépartement des servicesde communicationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasRowan-CampbellDorienne Consultante /Fermière biologiqueNetworked Intelligencefor Development552 Westminster Ave.,Ottawa, ON K2A 2V3Canada+41 22 534 96 97 sg@apo-opa.org+18 768 785 326 mariaprotz@cwjamaica.com+5 922 317 188+5 922 371 787nazimaraghubir@gmail.com+31 317 467 174 rambaldi@cta.int+18 683 909 367+18 687 525 067krislit2@gmail.comkriscivica@yahoo.com+1 868 764 5745 stlucian@tstt.net.tt+441 933 272 400 media@countrywise.com+31 317 467 163 rodriguez@cta.int+12 126 559 525+1610144dorienne.rowancampbell@gmail.com
Ruquet Robin ConsultantGlasshouse25 rue Dauphine,75006 Paris - FranceSalm Mundie Coordinatrice FarmingMatters et éditriceLEISA Magazine à ILEIAP.O. Box 2067, 3800 CBAmersfoort - Pays-BasSam Joel Coordinateur GAINSCSIR/INSTIP O Box M 32, Accra -GhanaSanou Issouf Coordonnateur desProgrammesFédération Nationale desOrganisations Paysannes(FENOP)09 BP 977 -Ouagadougou 09Burkina FasoSarakikya Langa ProfesseurInstitut des études dedévelopement, Universitéde Dar es SalaamP.O. Box 35169 Dar esSalaam - TanzanieSchaap Mirjam WebsupportedCommunication andLearningWageningen URP.O.Box 88, 6700 AB,Wageningen - Pays-BasSingh Ranbeer JournalisteFiji Television LimitedPO Box 5511, LautokaIles FidjiSingh Sunil Kumar Assistant de coursde dévelopmentThe University of theSouth PacificPrivate Mail BagLaucala Bay RoadSuva - Iles FidjiSluijs Jacqueline SociologueKITPostbus 950011090 HA AmsterdamPays-BasSolervicens Marcelo Secrétaire généralAMARC705 Bourget, suite 100,H4C 2M6 Montréal(Quebec) - Canadade Sousa Raul Bruno Membre du conseild’administration du CTAFaire suivre pour lesecrétariat du conseild’administration du CTAPortugal+33 6 16960597 robin@glasshouse.fr+31 33 467 3878 m.salm@ileia.nl+233 21 76 48 22 egy28@yahoo.co.uk+226 76 60 90 52 sissoufou1@yahoo.frFax:+255 22 2410078langasarakikya@googlemail.com+31 317 481 408 mirjam.schaap@wur.nl+6 796 665 444+6 799 990 233rsingh@fijitv.com.fjranbeer_singh@hotmail.com+6 799 045 758 singh_su@usp.ac.fj+31 20 5688259 j.sluijs@kit.nlsecgen@si.amarc.org+351 21365 3427 brunosousa@isa.utl.pt67
68Songa Dr Wilson A. Président du conseild’administration du CTAFaire suivre au secretariatpour le conseild’administration du CTAKenyaSpringer Dr Eugenia DirectriceES Productions98 Eastern Main Road,Suite #1, TunapunaTrinité-et-TobagoStepman François Spécialiste decommunications et prisede conscience publiqueFARAPMB CT 173 Cantonments,AccraForum for AgriculturalResearch in Africa, GhanaTadegnon Noel Kokou Journaliste etcorrespondantDe ReutersS/C Maison de la PresseTokoin Trésor, Lomé01 BP 2539 - TogoTalatalaTavaresHon.BlondeauTalatalaTeresaFernandesPereira daVeigaDéputé à l’assembléeNationale du Cameroun -Coordinateur del’UNGC-REPADERBP 3410 YaoundéCamerounProjet AIDACentre RegionalAGRHYMET. CILSS.P.O Box 11011, NiameyNigerTeyssier Laurent ConsultantGlasshouse25 rue Dauphine,75006 Paris - FranceThomas Larry CoordinateurCentre de média régionalSécrétariat de lacommunauté du Pacique3 Luke Street, Nabua,Suva City - Iles FidjiThorp Susanna DirectriceWRENmediaGulls Green, FressingfieldEye Suffolk, IP21 5SARoyaume-UniTollensProfessorEricMembre du conseild’administration du CTAFaire suivre au secretariatpour le conseild’administration du CTABelgique+254 202 718 870 wsonga@africaonline.co.ke+868 663 6009 dreugenia.springer@gmail.com+233 21 772823 fstepman@fara-africa.org+228 905 38 35+228 225 50 03+228 225 03 50tadenoe@yahoo.fr+237 994 84 48 btalatala@yahoo.com+33 6 16960597tavarest_1@yahoo.com.brlarryt@spc.int+441 379 586 787 s.thorp@wrenmedia.co.uk+32 16321616/ 1614 eric.tollens@biw.kuleuven.be
Treinen Sophie Chargée de gestiondes connaissancesFAO Knowledge Exchangeand Capacity BuildingDivisionViale delle Terme diCaracalla, 00153Rome, ItalyRoom A 111 int - ItalieUlakai Viola JournalisteTonga Broadcasting andTelevision CorporationPO Box 36Nuku’alofaKingdom of TongaVan Mele Dr Paul Chef de programme,système d’apprentissageet innovationAfrica Rice Center(AfricaRice)01 BP 2031, CotonouBéninVan Velden Annelies Chef de programmeVoices of Africa MediaFoundationJansweg 42-E, 1011 KNHaarlem - Pays-BasVos Edwin Vice président du conseild’administration du CTAFaire suivre pour lesecrétariat du conseild’administration du CTAPays-BasVos Dr Janny Chef de BusinessDevelopment EuropeCABI NederlandKastanjelaan 5 , 3833 ANLeusden - Pays-BasVugayabagaboAndréCoordinateur deprogramme seniorDépartement des servicesde communicationCTA - P.O. Box 3806700 AJ WageningenPays-BasWaigwa Michael Souscripteur agricoleThe Co-operativeInsurance Companyof Kenya LtdCIC Plaza, Mara Road,Upper Hill,P.O Box 59485-00200,Nairobi - KenyaWarnock Kitty Conseillère seniorCommunication forDevelopmentPANOS London9 White Lion Street,London N1 9PDRoyaume-Uni+39 06 5705 4297 Sophie.Treinen@fao.org+676 23 555 violavlaka@yahoo.com+229 21 35 01 88 p.vanmele@cgiar.org+31 235 428 366 annelies@voamf.org+33 603 321 808 edwin.a.vos@gmail.com+31 33 432 1031 j.vos@cabi.org+31 317 467 158 vuga@cta.int+254 202 823 106 michael.waigwa@cic.co.ke+44 20 7239 7603 kitty.warnock@panos.org.uk69
Werner Sandra JournalisteRadio Kankan41 Rue James Ensor, 1070Anderlecht, BruxellesBelgiqueWitteveen Loes ProfesseurVan Hall Larenstein,University Of AppliedSciencesP.O. Box 411, 6700 AkWageningen - Pays-BasYalalae-wa-BonkeleYodaFrançoiseBibianeJournalisteC retro magazine39 avenue Houba deStrooper1020 Bruxelles, BelgiquePrésidenteAssociation Pugwisenga09 BP : 359Ouagadougou 09Burkina FasoYordy Christopher ConsultantCommunity DevelopmentService (Egypt)Faire suivre à 1011Kenning PlaceElmira/ONTARIO/N3B2Z1CanadaZangrondFennyAdelineJournalisteSuriname NewspaperMalebatrumstraat 7-9,Paramaribo - SurinamZulu Brenda JournalisteC/O MISA ZambiaP.O. Box 32295,PLOT No. A343 Mandevu,Lusaka - Zambie+32 4 71192333 sandra.werner@vision-s.org+31 317 486 301 loes.witteveen@wur.nl+32 488 602 782 contact@c-retro-actuel.net+226 70 10 03 78 frbibiane@gmail.com+20 19 50 87 456 chris.yordy@gmail.com+597 472 823 fennyvd@yahoo.com+260 977 891 431 brendazulu2002@gmail.com70
6.3 25 ème anniversaireCérémonie d’ouverture officielleDiscoursProgramme du 25 ème anniversairePalais des Colonies à Tervuren, Bruxelles14 Octobre 200918h00 – 21h30ProgrammeMaître de Cérémonie:S.E. Mme Marcia Yvette Gilbert-Roberts, Ambassadeur de JamaïqueDr Wilson Songa, Président du Conseil d’Administration du CTAS.E. Dr Mme Brave R. Ndisale, Co-Présidente ACP du Comité des Ambassadeurs ACP-CE,Ambassadeur du Malawi auprès de l’UEIntermède musicalM. Ola Sohlström, Deuxième Secrétaire, au nom de S.E. M. C. Danielsson, Co-Président UE duComité des Ambassadeurs ACP-CE, Représentant Permanent du Royaume de Suède auprès de l’UEM. Luis Riera Figueras, Directeur, Commission Européenne DG Développement,Environnement et Développement RuralIntermède musicalS.E. Ambassador Olukorede Willoughby, au nom de Dr Ibrahim Assane Mayaki,Secrétaire Exécutif, NEPADDr Hansjörg Neun, Directeur du CTADînerTémoignagesIntroduction des CTA Media Awards 2009 par Mme Judith Francis, CTARemise des Media Awards pour le JournalismeRemise des Media Awards pour les Projets de communication communautaire71Mots de remerciements par Dr Hansjörg Neun
6.4 Lauréats du prix médiaPrix du meilleur journalismePrix de la meilleure communication communautaire72Et les gagnants sont…Après des mois de conception, aprèsle recrutement de consultants et lesappels à candidature pour les prix enjournalisme et en projets de médiascommunautaires, les gagnants desprix CTA en journalisme et en initiativesde médias communautaires ontété invités à recevoir leurs prix lorsdu 25 e anniversaire du CTA. Sur untotal de 105 présélectionnés réduitsà 14, les six derniers lauréats desprix sont :Catégorie A : JournalismeLes activités de journalisme publiéesou diffusées sous la forme d’articles oude programmes via la presse écrite,la radio, la télévision ou les médiasen ligne— 1 er prix —Gladson Makowa (Malawi)— 2 ème prix —Colleen Dardagan(Afrique du Sud)— 3 ème prix —Rambeer Singh (Iles Fidji)Catégorie B: Initiatives demédias communautairesLes projets de communication communautaire(tous médias confondus)— 1 er prix —Aaron Kaah (Cameroun)Plante un arbre, sauve une abeille— 2 ème prix —Rev. Nason Baluku (Ouganda)Banana Wilt Campaign— 3 ème prix —Modeste Shabani bin Sweni(République démocratique duCongo) Sauti ya mkaajiPlus d’informationssur le concoursRev. Nason Baluku, Aaron Kaah,Modeste Shabani bin SweniA l’arrière : (g-d) : Ranbeer Singh,Rev Nason Baluku, ColleenDardagan et Aaron KaahA l’avant (g-d) : Modeste Shabanibin Sweni, Gladson Makowanalistique ayant eu un impact positifpouvant être avéré au niveau national,local ou communautaire. Autrementdit, “un journalisme” qui contribueà sensibiliser l’opinion publique ouà stimuler le débat, à partager desinformations importantes ou à participerau changement social de manièreeffective. Les sujets traités pouvaientêtre en rapport avec l’agricultureou des questions connexes d’ordreenvironnemental, social, politique ouéconomique.S’agissant de la Catégorie B - Prixdu meilleur projet de communicationcommunautaire - le CTA entendaitdistinguer les initiatives qui mettent àprofit la communication participative(quel que soit le support utilisé, ycompris la communication interpersonnelle)pour contribuer au développementagricole et rural ou, parexemple, renforcer la capacité descommunautés à gérer les ressourcesnaturelles.Prix attribuésL’organisation et la gestion de ceconcours ont été confiées par le CTAà l’Institut Panos Londres (Royaume-Uni).Premier prix dans chaque catégorie :2 500 euros + deux semaines deformation, d’étude ou de recherche(lieu et conditions à convenir entrele CTA et le lauréat).72Lauréats du prix journalisme(g-d) : Rambeer Singh, GladsonMakowa et Colleen DardaganLe concours était ouvert à tous lesjournalistes (professionnels ou non),les groupes de presse ainsi qu’auxresponsables de projets de communicationcommunautaire participativedes pays ACP. Un jury, composé de représentantsde l’Afrique, de l’Europe,des Caraïbes et des îles du Pacifiquea été convoqué pour évaluer les candidaturesprésélectionnées.Concernant la Catégorie A - Prix dumeilleur journalisme - le CTA entendaitrécompenser toute activité jour-Deuxième prix dans chaque catégorie :1 500 euros + deux semaines deformation, d’étude ou de recherche,comme ci-dessus indiqué.Troisième prix dans chaque catégorie: 500 euros + deux semainesde formation, d’étude ou derecherche, comme ci-dessusindiqué. Tous les troislauréats de chaque catégorieont aussi participé auséminaire du CTA à Bruxelles(tous frais payés).Le prix qui a été spécialementconçu pour le CTA
6.5 Plus d’information sur les lauréatsLes Lauréats - Prix journalismeGladson MakowaJe suis né le 10 septembre 1974 àLilongwe, dans une famille de septenfants, dont deux garçons et cinqfilles, d’un père agent de vulgarisationagricole. Et c’est grâce à lui que j’aiassimilé nombre de techniques etcompétences dans le secteur agricole.Mais parce que je n’ai jamais aimél’agriculture, mon père m’a toujoursencouragé à travailler dur à l’école pourne pas devenir un jour paysan.Vu les places limitées dans les écolessecondaires publiques, je me suisinscrit au Centre d’enseignement parcorrespondance du Malawi (MCDE),avant de terminer mon cycle secondaireau Collège Dedza Night. J’aiensuite été sélectionné pour entrerau Chancellor College (Université duMalawi) - où j’ai pu préparer, de 1995à 1999, une Licence en Sciences humaines,mention Éducation.A partir de 1997, j’ai travaillé à mitempsau “Story Workshop” commechercheur et auteur de pièces de théâtreradiophonique, tout en poursuivantmes études à l’Université. M’étantspécialisé en Géographie (Étudesenvironnementales, Développementrural, Études urbaines) et fort des mesconnaissances en agriculture, je suisdevenu chercheur en production deprogrammes agricoles peu de tempsaprès avoir obtenu mon diplôme.Mme Pamela Brooke, de nationalitéaméricaine et unique propriétaire du“Story Workshop”, avait enregistré celui-cicomme Organisation non gouvernementale(ONG) axée sur les médias.Et c’est avec l’aide de Pamela que j’aiconçu le format du programme MwanaAlirenji (autosuffisance alimentaire),avec pour objectif de rendre le métierd’agriculteur plus facilement accessibleet davantage attractif.Colleen DardaganNée en 1958, dans une ferme agricolede la région orientale du Cap en Afriquedu Sud, j’ai toujours aimé écrireet ce, depuis l’école.Je me suis mariée jeune et étant mèrede deux filles, ce n’est que des annéesplus tard que j’ai pu réaliser mon rêvede devenir journaliste.Il y a dix ans, je travaillais commechroniqueur d’un journal industrielau format tabloïd spécialisé dans lesecteur manufacturier, dans la provincedu KwaZulu-Natal située sur la côteorientale sud-africaine.En 2004, je suis entrée comme journalisteéconomique au quotidien “TheMercury”, fondé il y a 157 ans et principaljournal du KwaZulu-Natal basédans la ville portuaire de Durban.Ces 4 quatre dernières années, je mesuis particulièrement occupée de larubrique consacrée aux politiques deréforme agraire de l’ère post-apartheid,ainsi que de leur impact surla sécurité alimentaire et l’économiede la région.Ranbeer SinghJe suis né en 1977 à Lautoka, deuxièmeville plus importante des îles Fidji.Ma mère était femme au foyer et monpère, aujourd’hui décédé, travaillaitcomme communicateur auprès del’Autorité de l’aviation civile de Fidji,à l’aéroport international de Nadi.Les parents de ma mère, tout commeceux de mon père, sont venus à Fidjidans les années 1930, en provenancedu Pendjab (Inde).Je suis le deuxième d’une famille decinq, dont deux frères, une sœur etmes parents.Mon frère aîné est journaliste sportifà “Fiji Times” et ma soeur, professeurde lycée.J’ai commencé à exercer mon métiercomme journaliste sportif cadet au“Fiji’s Daily Post” dès ma sortie dulycée, au début de l’année 1996. C’estlors d’un match de rugby à Nadi que leposte m’a été proposé, après ma rencontreavec le rédacteur en chef duditjournal, qui m’a alors demandé si celam’intéressait de couvrir les événementssportifs pendant les week-ends.Un poste à temps plein m’a ensuiteété offert, l’année suivante, au siègedu quotidien à Suva, capitale de Fidji.Affecté à Lautoka au milieu de l’année1998, j’ai continué à travailler pourcet organe de presse pendant quelquesmois encore, avant de me voirproposer un poste similaire par le “FijiTimes” où j’ai travaillé au Service dessports pendant 4 ans.73
Mon saut dans le milieu télévisuelest intervenu en mars 2003, lorsquej’ai accepté de collaborer avec la “FijiTelevision Limited”, à l’antenne régionalede Lautoka où je travaille depuis.Seul journaliste basé dans cette villeet assisté par deux cameramen, j’aipour mission de couvrir l’actualité etles activités économiques de toute lapartie occidentale (“division”) de laprincipale île fidjienne de Viti Levu,constituée d’une grande agglomérationurbaine, de cinq villes et de leursbanlieues, avec une population totalede 250 000 habitants.Je suis mariée et mes principaux loisirssont les voyages, les rencontres, lesémissions sportives, l’actualité localeet étrangère, les activités en plein airtelles que le jardinage et la plage.Lauréats du Prix du Meilleur média communautaire74“PLANTE UN ARBRE,SAUVE UNE ABEILLE”(AARON KAAH - CAMEROUN)“Plante un arbre, sauve une abeille”est un programme radiophonique quiencourage non seulement l’implantationde pépinières d’arbres fruitierset à miel, mais aussi le repiquage, laconservation et la protection de cesarbres. Il s’agit notamment des espècesforestières telles que le calliandra,l’acacia, l’Abyssiniccas schefflera, leCroton manni, ainsi que d’autres arbrestropicaux comme le Prunus africana etles arbustes qui fournissent du nectaraux abeilles - un moyen d’accroître laproduction de miel pour les 150 000habitants des hauts plateaux de la forêtde Kilum-Ijim, dans la province de Bui,au nord-ouest du Cameroun.Les programmes hebdomadaires - quiconsistent en des pièces de théâtre,des débats, des spots publicitaires,des tables rondes, des interviews surle terrain, des jeux radiophoniques etdes réunions mensuelles avec les groupementspaysans - visent à défendreet promouvoir l’élevage d’abeilles (ouapiculture), dans le but d’améliorerla pollinisation des cultures vivrières.En effet, les abeilles sont connuescomme étant des agents pollinisateurspour de nombreuses cultures vivrièrespratiquées dans la région.En intégrant efficacement l’apiculturedans les différents programmesd’agroforesterie mis en place dansla zone d’Oku, le projet est devenuune source de revenus pour les agriculteurs,en particulier les femmeset les jeunes qui se sont empresséseux-mêmes de se lancer dans lasylviculture, l’élevage d’abeilles, lasculpture sur bois, les techniques detransformation du miel, ainsi que laconservation et la protection de leurenvironnement. Cet engagement despopulations a eu pour conséquence unenette amélioration de la protection desforêts, de la production de miel et desrendements agricoles dans la régiond’Oku. Grâce aux recommandationsde stratégies durables diffusées parla radio et à l’érection des villages enzones forestières communautaires, lesefforts de certains leaders d’opinion,conjugués à l’expertise des agentslocaux de vulgarisation forestière etdes ONG étrangères, ont permis demaintenir le projet à flot. Á ce jour,le projet “Plante un arbre, sauve uneabeille” a produit plus de 126 bulletinsd’information, avec l’appui techniquede la Société coopérative de productionde miel d’Oku. Et comme plusde 60% des agriculteurs disposentde postes radio, l’avenir du projet,des populations d’Oku, de leur forêtet de leur environnement s’annonceRADIEUX.LE RÉSEAU DURABLEDES FORMATEURS del’agriculture (SATNET)ET SA STRATÉGIE DECAMPAGNE 2008 CONTRELE FLÉTRISSEMENTBACTÉRIEN DE LA BANANE(FBB) (Rév. NasonBaluku - Ouganda)Le SATNET est un réseau d’organisationscommunautaires, d’organisationsnon gouvernementales (ONG) et d’associationsconfessionnelles qui vise àpromouvoir la sécurité alimentaire desménages et leur autonomisation économiquepar la formation des paysansaux méthodes agricoles modernes.Située à l’ouest de l’Ouganda, la régionde Rwenzori est composée decinq districts : Bundibugyo, Kabarole,Kasese, Kamwengye et Kyenjojo.Elle porte le nom de la montagne deRwenzori, qui est la deuxième plushaute d’Afrique.Lutter contre les effets du flétrissementbactérien de la banane était devenupour les planteurs de la région de
Rwenzori d’une urgente nécessité. Uncolloque a donc été organisé en janvier2008 par le réseau SATNET afin demettre au point des méthodes de lutteefficaces contre cette maladie.Ce colloque a réuni des acteurs régionaux,nationaux et locaux avecpour objectif de recueillir auprès desinstitutions de recherche les informationsnécessaires sur le mode detransmission de la maladie et lesmesures de prévention à prendrepour empêcher sa propagation future.Ainsi, des groupes de travail ont étémis en place à tous les niveaux dedécision, différents supports didactiquesélaborés et traduits en plusieurslangues, et des cours de formationorganisés par les diverses autoritéslocales au profit des communautés etdes planteurs. L’utilisation de la radiopour communiquer avec les paysansa largement contribué au succès de lalutte contre la dissémination de la maladiedu flétrissement de la banane. Demême, les réunions communautaireset l’implication active des agriculteursdans le processus de sensibilisation àla maladie ont beaucoup contribué àl’éradication de celle-ci dans la plupartdes plantations de la région.Située à l’ouest de l’Ouganda, la régionde Rwenzori est la terre la plusfertile du pays et abrite l’essentiel desplantations de bananes touchées. L’applicationdes méthodes recommandéespar les chercheurs a permis de venirà bout du flétrissement bactérien dela banane et d’améliorer la production.Aujourd’hui, les hommes et lesfemmes de cette région sont parfaitementsensibilisés à la maladie, ettous les membres de la communautéredoublent d’efforts non seulementpour préserver l’environnement par laconservation des sol, mais aussi pourdétecter à temps tout parasite susceptibled’attaquer leurs cultures.Radio Sauti Ya Mkaaji(Modeste Shabanibin Sweni - Républiquedémocratique duCongo - RDC)Le projet de sensibilisation à l’autopromotionrurale couvre deux territoiresdu Sud Maniema, à savoir Kasongo etKabambare. Il a été conçu et mis enoeuvre par Radio SAUTI YA MKAAJI,une station de radio communautairebasée à Kasongo, sur financementde l’Unité “Reconstruction communautaire”du Programme des Nationsunies pour le développement (PNUD/COMREC). La région compte une populationde 900 000 habitants quivivent principalement de l’agriculture.A l’instar des autres régions de la RDC,le Sud Maniema a beaucoup souffertde la guerre et de ses multiplesconséquences préjudiciables qui ontplongé la population locale dans uneextrême pauvreté.L’objectif global du projet était desensibiliser davantage les populationsdu Sud Maniema à l’autopromotionrurale et, notamment, de contribuerà réduire la crise alimentaire en augmentantla production agricole dansla région. Il a misé, pour ce faire, surla formation d’animateurs de clubsd’écoute ou groupes d’auditeurs dela Radio SAUTI YA MKAAJI à l’autopromotionrurale par la pratique del’agriculture, l’acquisition des techniquesculturales, la création d’activitésrurales génératrices de revenus etl’assimilation des techniques de productionde microprogrammes.Un projet de 3 mois a donc été misen place. Au terme de cette période,c’était au tour de la radio de poursuivrele projet en produisant et en diffusantdes programmes conçus à partir destémoignages de réussite recueillisauprès des différents groupementspaysans impliqués ; la lutte contrela crise alimentaire est vite devenueun thème permanent et transversaldans les émissions de la Radio SAUTIYA MKAAJI.Quatre-vingt animateurs de clubsd’écoute ont ainsi été formés, dont27 femmes. Dans le cadre des effortscollectifs d’autopromotion, la formationde 225 animateurs (dont 87 femmes)a été prise en charge par les clubseux-mêmes.Outre les émissions radiophoniques, lesactivités de sensibilisation et de vulgarisationconsistaient égalemen, pourle réseau de clubs d’écoute, à mieuxfaire connaître les techniques culturalesauprès des populations villageoises parle biais du porte-à-porte.On compte aujourd’hui entre 1 et 10(et même davantage) groupements etcollectifs de paysans et de pêcheursdans chaque village qui travaillentdans les champs ou dans les étangspiscicoles, la construction de maisonsen briques, l’achat d’équipementsménagers, la scolarisation des orphelinsde guerre, contribuant ainsi, demanière efficace, à l’amélioration deleurs conditions de vie. Ce mouvementa également favorisé la créationd’une importante association dédiéeà l’autopromotion rurale.75
6.6 La route a été longue maiselle en valait la peine !76L’organisation et la gestion du concoursont été confiées, sur appel d’offres,à l’Institut Panos Londres basée auRoyaume-Uni. C’est en étroite consultationavec le personnel du CTA et lesmembres du Comité de pilotage duSéminaire que Panos a élaboré l’annonce,les modalités et les conditionsdu concours pour les deux catégoriessuivantes : la Catégorie A, qui concernele Journalisme et la Catégorie B, lesProjets de communication communautaire.Mise en ligne le 2 août 2009 sur le siteWeb dédié à l’Initiative Communication,l’annonce du concours a été, dèsle 10 août, l’article phare du numéro 54du magazine électronique Drumbeatlancé dans le cadre de ladite Initiative.De même, elle a été diffusée pare-mail au travers de tous les InstitutsPanos (y compris celui de Londres),tant dans les régions ACP qu’auprèsdes contacts du CTA. Panos a élaboréles critères de sélection pour le jury,les membres du Comité de pilotagedu Séminaire étant, pour leur part,chargés de suggérer les noms despossibles candidats.Á la date butoir du 1er septembre,105 dossiers de candidatures étaientreçus dans la Catégorie A - Journalisme,dont :Panos a élaboré les grilles de notationet examiné toutes les candidatures afind’établir une liste restreinte de huitprésélectionnés dans la Catégorie A etcinq dans la Catégorie B. L’ensembledes candidats retenus ont ensuite étéinvités à participer au Séminaire deBruxelles.Les candidatures présélectionnéesont été traduites puis envoyées auxmembres du jury principalement parvoie électronique, accompagnées desgrilles de notation retenues. Au coursd’une conférence téléphonique présidéepar le consultant, les cinq membresdu jury ont sélectionné, parmiles finalistes, les trois gagnants danschaque Catégorie, avant de communiquerleurs noms au CTA.Participation au prix média du meilleur journalisme(Total = 105 participants)Par mediaPar région ACPPar genrePar languemédias imprimésRadio ou MultimediaTélévisionAfriqueCaraïbesPacifiqueFemmesHommesAnglaisFrançaisPourcentage (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Participation au prix média pour la meilleure communicationcommunautaire (Total = 15 participations)Par languePar région ACPAnglaisFrançaisAfriquePacifique0Pourcentage (%)Les six lauréats ont été invités à participerau Séminaire. Leurs noms n’ontété rendus publics qu’à la remisedes prix, lors de la célébration du25ème anniversaire du CTA, le 14Octobre 2006.10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Le CTA profite de cette occasion pourremercier les coordonnateurs et lesmembres du jury, et féliciter les lauréatspour leur succès bien mérité.
6.7 Articles du blog pré-séminaire1. IntroductionLes médias contribuent-ilsau développement rural?Marilyn Minderhoud 2En général, la réponse à cette questionest évidemment non, tout simplement,du moins si l’on se fie auxconclusions des interminables rapportset articles pointant du doigt la médiocritéprofessionnelle et technique desmédias dans les pays ACP. Mais cesconclusions passent sous silence laréalité vécue par un certain nombrede journalistes et professionnels desmédias qui abandonnent leurs bureauxdu centre-ville, pour se lancerdans la production d’émissions etde reportages sur la vie agricole,depuis les bourgades rurales et lesstations de radio communautaire.Elles oublient également les effortsdéployés au sein de la société civile,des agences internationales et desorganismes publics, en vue de renforcerles capacités des médias dansles pays ACP.Pourtant, on ne peut le nier : dansla presse nationale, les colonnesconsacrées aux questions susceptiblesd’aider et d’orienter les agriculteursne sont en rien comparablesaux reportages et articles, sur despages entières, consacrés aux crimeset faits divers, aux célébrités et àl’actualité gouvernementale. Et cesémissions musicales interminables surles radios locales ? Eh bien, c’est toutsimplement parce que les concepteursde programmes n’ont rien d’autre àproposer aux auditeurs !Pannes de courant et délestagesfréquents, instabilité et précaritédu matériel, cherté des connexionsInternet, médiocrité des salaires,pressions de la part de comités derédaction et de sponsors commerciauxinsensibles…Tels sont, entre autres,les obstacles quotidiens que les professionnelsdes médias ACP doiventpouvoir surmonter pour contribuerefficacement au développement deleurs pays.Le CTA a parfaitement consciencede ces contraintes, tout comme deseffets désastreux que les conflits, laguerre civile et la dictature politiquepeuvent avoir sur la capacité des médiasà contribuer au développement.Un “lobbying” est indispensable pourdéfendre le droit des journalistes àformuler des commentaires et critiquessur les questions rurales. Lastratégie adoptée par le CTA consistenotamment à appuyer le renforcementdes capacités professionnelleset techniques des médias ACP, touten veillant à ce que les informationsessentielles au développement agricoleet rural parviennent aux décideurs,formateurs et professionnelsdu secteur agricole qui influent sur leprocessus du développement.L’existence de médias libres et accessiblesà tous passe nécessairementpar l’instauration d’une législation etd’un cadre réglementaire appropriés,permettant aux différentes partiesprenantes de contribuer au débat surle développement. Une condition nécessaire,certes, mais pas suffisante.Les professionnels des médias ontégalement besoin d’être formés àdes méthodes innovantes de collecteet de diffusion d’informations axéessur le développement, de manièreà pouvoir travailler avec les communautésrurales pour produire desidées et des contenus. Les groupesd’écoute, le journalisme citoyen, lesreportages vidéo sur l’agriculture, la2La première fois que j’ai été confrontée aux problèmes de développementagricole, je travaillais au Département d’histoire de l’Université de Lusaka enZambie. En effet, la plupart des programmes d’enseignement et de rechercheétaient axés sur les questions foncières et les moyens de subsistance enmilieu rural, des thèmes récurrents que j’ai eu à aborder tout au long de macarrière. En particulier, les années que j’ai passées à recueillir les témoignagesde petits agriculteurs aux fins de publication, en ma qualité de rédactriceen chef du magazine LEISA et de la revue Biotechnology Monitor, ont achevéde me convaincre que les journalistes spécialisés dans le développementdoivent faire face à d’énormes difficultés pour transmettre aux communautésrurales et aux agriculteurs les connaissances dont ils besoin pour améliorerleurs moyens de subsistance. J’espère de tout cœur que ce Séminaire du CTAcréera la synergie nécessaire entre les médias et les nombreux acteurs impliquésdans le développement rural.radio et la presse communautairessont, aujourd’hui, parmi les solutionspermettant aux communautés ruralesd’accéder de plus en plus à l’informationet de mieux faire entendreleur voix.Cette évolution, on la doit souvent,d’abord et avant tout, aux journalistesqui s’intéressent aux questions agricoleset environnementales. Mais onpourrait en faire davantage en donnantà ces journalistes la possibilitéde bénéficier de l’expérience d’autresprofessionnels des médias ayant lesmêmes centres d’intérêt. En favorisantle contact et l’échange de vuesréguliers par le biais d’associationsformelles, de sites Web, de blogs etautres types de réseaux numériques,on permet ainsi aux journalistes etradio/télédiffuseurs soucieux d’analyseret d’évaluer les impacts de lamondialisation, du changement climatiqueet de l’insécurité alimentaire,d’avoir accès à l’information et depouvoir la vérifier.Les opportunités et les défis auxquelsfont face les réseaux d’information etde communication sur le développementvarient d’un pays ACP à l’autre.Certes, des accords internationaux ontrécemment été conclus dans le butd’encourager le développement demédias indépendants et pluralistes,en mettant l’accent sur la nécessité degarantir la liberté d’expression. Maisde tels efforts restent peu visibles àl’échelle régionale et nationale. Seloncertaines critiques, les investissementsfaits par le passé dans desprojets ponctuels ou à petite échellepar les organismes donateurs ont eupeu d’impact en réalité. En effet, souventen déphasage avec les besoinslocaux, ces projets n’ont pas pu êtremaintenus lorsque les financementsont pris fin, et les efforts déployéspour en multiplier les volets potentiellementprometteurs ont été entravéspar le manque de collaboration entreles différents projets.Peut-on tirer des enseignements deces interventions ? Est-il possibleaujourd’hui de mieux comprendrecomment les nouveaux médias, parexemple, permettent-ils de changer lafaçon dont les communautés ruralespauvres “consomment” l’information ?77
78Existe-t-il des exemples d’approchesnovatrices censées faciliter l’usage dela radio, de la téléphonie mobile etd’Internet ? En quoi les TIC favorisent-ellesla collaboration à distance,le travail en réseau et la coopérationentre agriculteurs ?RésuméDans la région Pacifique, les obstaclesau financement, la formationinsuffisante et le manque d’infrastructuresfavorables aux TICconstituent une sérieuse entraveà l’échange d’informations entrechercheurs, spécialistes desmédias et agriculteurs. Dans bonnombre de pays d’Afrique, l’accèslimité aux médias et les difficultésauxquelles les journalistes et lesradiodiffuseurs se heurtent pouratteindre les populations vivant enmilieu rural ont conduit à une faiblecouverture des réalités locales.En regroupant les petites exploitationsrurales et les communautésde pêcheurs, les médias peuventstimuler la création et le flux d’informationset mettre en place unenvironnement propice aux effortsde développement rural. Les TICont un rôle stratégique à jouerdans ce processus pour responsabiliserles médias et encourager lescommunautés rurales à partagerleurs propres informations, pointsde vue et connaissances sur unespace numérique.L’approche et le point de vue decertains journalistes, radiodiffuseurset administrateurs de sitesont été contestés par un contributeurdes Caraïbes. Une formationest nécessaire pour permettre auxjournalistes d’aborder les questionsde développement rural de manièreholistique et veiller à ce qu’ils reconnaissentl’importance d’un examenglobal des pratiques agricolessusceptibles d’atténuer l’impactdes changements écologiques etdu changement climatique.2. Médias et nouvellestechnologiesIbbo Daddy Abdoulaye 3“Il ne s’agit point de donner du poissonou d’apprendre seulement à pêcher;il faut aussi commencer à se poserdes questions sur le résultat de lapêche…”L’information utile, en temps opportun,pour ceux qui en ont le plus besoin -c’est-à-dire les populations d’Afrique,d’Asie, d’Amérique Latine, des Caraïbes,du Pacifique et d’Océanie, majoritairementrurales, pauvres et qui viventdans des zones reculées, enclavées oupeu couvertes par les canaux traditionnelsde communication-a toujoursété un casse-tête pour ceux qui sonten charge du développement. Vent,soleil, satellite, cellulaire, ordinateur,radio, télé, pourtant le temps n’a étéautant propice qu’en cette ère defoisonnement de technologies et deressources. Des équipements toujoursplus performants, toujours très pratiqueset très souvent à moindre coût,et dont le mariage de raison, sur dessujets aussi cruciaux, pour des populationsdéfavorisées, que la sécuritairealimentaire et nutritionnelle, la santéhumaine et animale, la protection del’environnement et des ressourcesnaturelles, tout en modifiant considérablementle paysage des médias,engendre des résultats prodigieux.Notamment grâce à l’élaboration descontenus (accès à un réseau mondiald’information, vitesse de transmissiondes données…) que dans les modesde diffusion (chaînes numériques,diffusion par satellite, radios, télévisionset journaux en ligne, archivagedes données…).Jugez-en : En Inde, c’est l’utilisationde la visioconférence qui permet despaysans qui ne se connaissent pas,vivent à mille lieus les uns des autresmais qui endurent les mêmes affres,de se rencontrer, de confronter leurspoints de vues et d’exposer leurs mauxà la communauté des chercheursautrement incapables de toucher unaussi large éventail de préoccupations.Au-delà de répondre, de vive voix etde visu, à des problèmes pressantsdes paysans, ce cas est illustratif detoutes les possibilités qu’augurent lesnouvelles technologies pour fluidifierla communication et améliorer lesinteractions entre les experts agricolesgénéralement basés en ville etles paysans éparpillés aux antipodes.Cette expérience est enrichissante àtous points de vue. Non seulementelle offre une meilleure couverture etun meilleur impact, mais elle permetaussi aux experts de donner des diagnosticset des conseils plus appropriésen examinant de près les spécimensapportés par les paysans.Au Niger, c’est le judicieux mariage dela radio communautaire et de l’Internetqui permet à des communautés marginaliséesde sortir de leur isolement, detélécharger des données entreposéesdans un grenier commun sur orbiteet alimenté par la communauté dudéveloppement, de réaliser des programmes(sensibilisation et préventioncontre le SIDA notamment), ou encorede faire de la formation à distance(alphabétisation, agriculture...).En Indonésie et dans les zones deTsunami, c’est un simple portablequi permet de recevoir ou d’envoyer,en tous lieux, tous temps et danstoutes les conditions, des messagesd’alerte ou de risques ou toute autreinformation utile ou pratique.Ailleurs, c’est la lecture de la cartefourragère ou des ressources quipermettent à des populations d’allerdroit au but ou de savoir interpréterles événements à venir sur la based’une combinaison de connaissancesempiriques, d’outils scientifiques etde faits…Ces exemples ne sont bien sûr qu’illustratif.Sur toutes les latitudes, des3Professionnel accompli et fort de ses 18 ans de carrière dans le journalismeet la communication, Ibbo Daddy Abdoulaye jouit d’une vaste expérience encommunication stratégique pour le développement. Directeur d’une agencede communication, qui produit le magazine Les Échos du Sahel, il est à la têted’une petite équipe qui s’est fixé pour objectifs d’améliorer la visibilité descommunautés rurales sahéliennes, de mieux comprendre et faire connaîtreleurs besoins, leurs difficultés et l’importance prioritaire du développementagricole et rural. Journaliste d’investigation récompensé d’un prix, Ibbo DaddyAbdoulaye manifeste un intérêt particulier pour les histoires complexes oul’actualité délaissée par les médias grand public. Les problèmes de développementdans les pays du Sahel restent son domaine de prédilection, soucieuxqu’il est de fournir les informations essentielles à l’existence même des populationset susceptibles d’influer sur leur vie quotidienne.
initiatives intéressantes ou innovantessont en cours pour porter l’informationtoujours plus vite, toujours plus loinet toujours moins chère pour ceux quien ont grandement besoin.Incroyable. Si tant est-il que cettedébauche de moyens ouvre la voie àun élargissement des médias et unemeilleure circulation des informationset des idées et, de ce fait, servant decatalyseur pour un développementéconomique et social, pourquoi lamayonnaise tarde-t-elle tant à prendre? Pourquoi ce qui est vrai dans lesous continent indien peine-t-il à serépliquer en Afrique subsaharienne ?Pourquoi la pauvreté, loin de reculer,ne fait que s’amplifier davantage ?Si les uns sont prompts à dénoncerl’inaccessibilité ou même le manqued’information sur ces technologieséprouvées, gardons-nous toutefoisde jeter le bébé avec l’eau du bain.Mauvais artisan se plaint toujours deson outil. Combien sont-ils, en effet,les utilisateurs finaux à savoir manieret prendre soin des outils souventgracieusement mis à leur disposition ?Que dire de la pertinence des contenusqui, très souvent, ne sont pas élaboréspour un usage prêt-à-porter ? Cela nedédouane pas pour autant l’Etat, lesbailleurs de fonds ou les ONG qui trèssouvent implantent les technologiessans études préalables, ni renforcementdes capacités des populationsbénéficiaires. Et tournent les talons,sans un mot sur la maintenance oula fourniture des pièces de rechange.En matière de technologie comme dedéveloppement, cette antique sagessecourt toujours : “Il ne s’agit point dedonner du poisson ou même d’apprendreseulement à pêcher; maisil faut aussi commencer à se poserdes questions sur quoi faire avec lerésultat de la pêche.”RésuméCherchant à évaluer l’intérêt d’introduiredes technologies de communicationcoûteuses dans deszones largement dominées parde petites communautés paysannes,une contributrice travaillantpour une grande ONG kenyane asoulevé une question sérieuse.L’utilisation de telles technologiesdans des zones classées commenon prioritaires risque, selon elle,d’alourdir les dépenses et le poidsdes responsabilités, ce qui en réalitéconduirait à une paralysie progressivedes activités essentiellespar manque de moyens financierssuffisants et de main d’œuvre disponible.Dans quelle mesure cetteexpérience peut-elle être étendueà d’autres régions ACP et existe-t-ildes exemples positifs d’utilisationdurable et efficace des TIC qui puissentapporter son soutien jusqu’àla plus pauvre maison rurale ?3. L’impact du MédiaCapturer l’imagination :des programmes agricolesqui changent la vieMichael Waigwa 4Dans les années 90, au cours de mascolarité à l’école primaire et au collège,la radio nationale diffusait un programmeappelé “Tembea na Majira”, qui signifie engros “Vivre avec les saisons”. Tembea naMajira était une pièce de théâtre interactifjouée en swahili par des personnagesterre-à-terre et extrêmement drôles,relatant les histoires et les événementsde la vie quotidienne d’un village moyendu Kenya. Plusieurs thèmes y étaientabordés, dont la plupart portaient surles meilleures pratiques agricoles pouraccroître la production alimentaire ; lalutte contre le paludisme et le VIH/SIDA ;les pratiques culturelles rétrogradestelles que la part d’héritage revenantà l’épouse et les mutilations génitalesdes femmes. C’était un programmeque je ne pouvais me permettre derater, en particulier à cause de l’accentmis sur l’agriculture comme étant uneactivité rentable que les familles ruralespourraient mettre à profit pour sortirde la pauvreté.Le programme finit par susciter mon intérêtpour l’agriculture et souvent, nousmettions en pratique les conseils entendus,dans le cadre de notre exploitationfamiliale (par exemple, l’utilisation devariétés de maïs adaptées aux sols etclimat de notre région, l’espacementdes cultures, etc.). C’est cet intérêt quim’a conduit à étudier l’agriculture ducollège jusqu’à l’université.Avec le temps, le programme fut supprimécar étant un produit public, seulle gouvernement prenait en chargeson financement. L’effondrement desprogrammes publics de vulgarisationagricole dans les années 90 finit parsaper notre capacité à mettre sur lemarché des produits compétitifs, les4Michael Waigwa est né à Laikipia, village situé dans une des zones les plusarides du Kenya, et a grandi dans une famille pour qui la vie est un combatau quotidien. Voyant les moyens de subsistance décliner peu à peu, avecl’assèchement des cours d’eau, l’irrégularité des saisons et l’incertitude accruedu temps, il s’est vite rendu compte que ces changements climatiques etenvironnementaux avaient des répercussions plus profondes encore sur la viede son village. Déterminé à comprendre et à atténuer ces effets dévastateurs,Michael décide alors d’étudier l’agriculture à l’Université de Nairobi. C’est làqu’à titre de président de l’Association des étudiants en agronomie, il mettraen place un programme de sensibilisation et de vulgarisation pour permettreaux étudiants de partager leurs connaissances avec les agriculteurs. Ilparticipera également à plusieurs forums nationaux et internationaux visant àsusciter l’intérêt des jeunes pour l’agriculture. Aujourd’hui, il travaille commeassureur agricole pour la Co-operative Insurance Company of Kenya Ltd.79
80agriculteurs ne bénéficiant d’aucunenouvelle compétence pour compenserl’appui de l’État.Utiliser les médias pour diffuser l’informationagricole permet de supprimerles coûts administratifs élevés inhérentsaux programmes conventionnelsde vulgarisation. Pour la majorité despaysans, la radio reste le moyen decommunication le plus accessible, carplus abordable et ne nécessitant pasl’installation électrique qu’exige, parexemple, un poste de télévision. Deplus, la radio est portable et aujourd’huiaccessible sur le téléphone mobile.Le gouvernement kenyan, via la radionationale KBC, a lancé des programmesradiophoniques d’éducation enlangues vernaculaires à l’intention desagriculteurs. Ces programmes visentl’accroissement de la production dedenrées vivrières - principalement lemaïs - indispensable pour atteindre lasécurité alimentaire. Dans les différentesrégions, les agriculteurs sont ainsiconseillés sur quand, comment et quellesvariétés de culture semer. Par cet effort,le gouvernement tente de prévenir lescrises récurrentes engendrées par lespénuries d’eau et de nourriture.Fort heureusement, avec la proliférationdes stations de radio FM en langueslocales observée ces dernières années,la radio est aujourd’hui à la portée denombreux paysans et ce, à tous lesniveaux, même pour les populationsrurales analphabètes. Ces stations proposentdes programmes très efficaces quis’adressent directement aux agriculteurs.Les émissions sont très populaires etenregistrent de plus en plus d’auditeurs,à l’instar de “Mugambo wa Murimi”, quiveut dire en gros la “Voix du paysan”. Ceprogramme matinal réunit des spécialistesde l’agriculture qui sont interrogésen direct par les auditeurs dans le cadrede conversations téléphoniques. Coincédans les embouteillages sur le trajet quime mène à mon travail, je ne manquejamais de suivre l’émission au volantde ma voiture.Les experts sont invités à répondreaux demandes d’informations desauditeurs qui appellent à la station. Ilssont essentiellement issus de grandesentreprises agroalimentaires qui, encontrepartie, “sponsorisent” ou financentces programmes. Toutefois,ce type de parrainage étant motivépar le désir de stimuler les ventesde l’entreprise, il ne peut favoriser lepartage d’une plus grande quantitéd’informations agricoles dont a besoinla majorité des populations rurales.Dans l’ensemble, les médias ne sont pasencore bien impliqués dans la défensede l’entreprise agricole. Pourtant, ilspourraient contribuer efficacement àl’amélioration de la sécurité alimentaireet des revenus en milieu rural. Le parrainagepar les entreprises est nécessairepour multiplier les programmes dequalité à la radio et à la télévision. Legouvernement ne peut pas, à lui seul,prendre en charge tous les segmentsdu marché et nous avons urgemmentbesoin d’un partenariat public-privé.RésuméQuel est le rôle des médias dans la vulgarisation? Cette question a été soulevéepar un contributeur du Nigeriaayant souligné que les bas salaireset le manque de formation pesaientlourdement sur l’efficacité et la qualitédes services de vulgarisation agricoledans son pays. Il serait intéressantde demander à d’autres agents devulgarisation agricole dans les paysACP comment ils conçoivent le rôle desmédias dans l’appui aux activités dedéveloppement agricole et rural.D’autre part, un contributeur duNiger a confirmé l’impact positif quepeuvent avoir des programmes deradio agricole bien établis et cibléspour encourager les jeunes à s’investiret à œuvrer dans les diverssecteurs d’activités de l’agriculture.Son expérience est semblable à cellede Michael Waigwa et préconise àl’ensemble des acteurs impliquésdans le développement agricoled’avoir systématiquement recoursaux médias pour toucher les jeunesauditeurs et téléspectateurs.4. Les intérêts politiques etcommerciauxLa lutte pour la professionnalisationdes médias auKenya, un enjeu pour ledéveloppement ruralAghan Daniel 5Avec la médiocrité des salaires pratiquésdans le milieu des médias, il n’estguère étonnant que les journalistes,tout comme les rédacteurs en chef etles directeurs d’organes de presse,soient vulnérables à la corruption etaux pots-de-vin. D’où les reportagessouvent biaisés, réalisés au profit de(potentiels) sponsors, parrains, annonceurset investisseurs, manifestementplus intéressés par l’économie urbaineque par le développement rural, aumoment où dans nos campagnes, lecrime et la politique continuent defaire la “une” des journaux !Dans un grand quotidien kenyan, ungrand reportage (article vedette) estrémunéré 1 500 Ksh (14 €) la page.Certains journalistes gagnent à peine6 000 Ksh (56 €) par mois, sans couverturemaladie ni pension retraite.Pire encore, les organes de presse qui“paient bien” appliquent des normesd’évaluation du prix de chaque articleet il n’est pas rare qu’un sujet d’actualitésoit rémunéré 300 Ksh (3 €).D’où la difficulté pour les journalistesd’être impartiaux, justes et “équilibrés”dans leurs reportages ou articles et derefuser les 2 000 Ksh (19 €) offertspar les hommes politiques voulantbénéficier d’un traitement médiatiquefavorable. Ces journalistes sont peuincités à traiter des problèmes de pauvretéen milieu rural. Après tout, lespaysans pauvres n’ont pratiquementrien d’autre à leur “offrir”.Les médias sont sous le contrôle deschefs d’entreprises, hommes d’affaires5Aghan Daniel, coordinateur, Media for Environment, Science, Health and Agriculture(MESHA), KENYA. Journaliste et collaborateur d’un important médialocal et international spécialisé dans l’agriculture, la santé, l’environnement etle développement, Aghan jouit d’une riche et vaste expérience. Ses contributionssur les questions d’agriculture et de développement paraissent régulièrementdans les journaux de la Tanzanie voisine et du Kenya.C’est en qualité de correspondant qu’il a commencé à publier des articles scientifiques,il y a 12 ans déjà, dans la presse locale kenyane. Sa carrière se poursuivraà l’hebdomadaire régional The East African, une publication de Nation MediaGroup, et au quotidien The Daily Nation. Avant d’aider à la création au Kenya del’association de journalistes scientifiques, Media for Environment Science Healthand Agriculture (MESHA), Aghan occupera pendant 5 ans le poste de responsablede l’information au sein de l’ONG régionale Biotechnology Trust Africa. Ilcoordonne depuis 3 ans les activités de l’association MESHA, où il s’est spécialisédans la rédaction et l’édition des pages Web dédiées à l’agriculture. Il assureégalement des cours de formation au journalisme agricole.
et industriels basés dans les villes etbien que la plupart de leurs profitsdépendent du travail des populationspauvres, ce sont les affaires qui paientet non le développement rural. Lesdivers organes de presse et la publicitédans les médias sont devenus unfacteur essentiel de prospérité pourl’élite urbaine.Peut-on s’attendre à voir les journalistespréserver leur éthique et leurdéontologie si celles-ci sont royalementignorées dans les salles de rédaction ?Nombreux sont les organes de pressequi ne se préoccupent plus d’informeret d’éduquer leur public. Au contraire,ils sont devenus des vaches à lait dontle principal objectif est de générer duprofit pour leurs propriétaires. Les journalistesqui travaillent dans ces conditionsont de plus en plus de difficultésà garder leur objectivité et, sachantque leurs salaires sont assurés par lescommanditaires d’articles/d’émissionset les annonceurs des zones urbaines,ils ne s’attardent pas sur les problèmesdus à l’appauvrissement du milieu rural,à moins de recevoir des pots-de-vinpour ce faire.Avec la prolifération des organes depresse, le contrôle inefficace des instancesofficielles de régulation, lemanque d’intérêt à faire carrière dansle journalisme, conjugués à la cupidité,à l’appât du gain et au matérialisme,il est difficile pour les journalistes depréserver les normes déontologiqueset éthiques dans l’exercice de leurprofession. Ils sont d’ailleurs nombreuxà être à la solde des entreprises, gouvernementset autres groupes d’intérêtpolitique soucieux de voir la presserelayer leurs idées et de mettre lesmédias à leur service.Il n’est donc pas étonnant de voiraujourd’hui des journalistes se compromettrepour monnayer leurs talentscontre des espèces sonnantes et trébuchantes.Certains d’entre eux ignorenttout simplement les règles minimalesde conduite et de leur métier, et ontune compréhension insuffisante desproblèmes de développement rural.Mieux rémunérer les journalistesles rendrait certes moins exposésaux risques de corruption, mais celan’aiderait pas forcément à améliorerla couverture des questions ruralespar les médias. En effet, ceux-ci sontdavantage attirés par le profit et larentabilité, et se préoccupent plus desintérêts d’un public essentiellementurbain. Dès lors, il est peu probableque le fait de multiplier les articleset reportages sur le développementrural permette d’accroître le nombrede lecteurs, d’auditeurs ou detéléspectateurs. Comment remédierà une telle situation ? D’abord, nousdevons regarder de plus près le profil,la formation et les compétences deceux qui se disent journalistes. AuKenya, nous plaisantons souvent,avec un certain cynisme, sur le faitque peu de journalistes des centresurbains pensent au rôle crucial dujournalisme rural parce qu’ils n’ontaucune expérience de la vie rurale etqu’ils ont été formés exclusivementdans des instituts et organes de presseimplantés dans les villes.Ensuite, il faut mettre en place desprogrammes de sensibilisation desjournalistes au développement rural etaux méthodes efficaces de reportageconcernant les questions agricoles.Mais pour en garantir le succès, lesjournalistes doivent pouvoir publier etdiffuser leurs histoires. C’est pourquoiil est essentiel que les médias spécialiséssoient présents en milieu ruralpour pouvoir traiter des questionsd’agriculture et de développement.Cela faciliterait la collecte en tempsopportun et le “conditionnement” appropriéd’une information pertinente.Diffusée de manière efficiente, cetteinformation permettrait de renforcerles réseaux d’échange de données etd’associer plus étroitement les communautésrurales au processus d’identificationdes besoins et problèmeslocaux. Comme ce développement apeu de chance d’être financé par lesentreprises commerciales, un appuifinancier sera donc nécessaire de lapart des organismes de développementet d’autres institutions publiques.RésuméDans son article, Aghan Daniel lanceun débat sur la professionnalisationplus poussées des médias au Kenya,son pays d’origine. Selon lui, les bassalaires et les conditions de travailprécaires sapent la motivation etl’enthousiasme de nombreux journalisteset radiodiffuseurs, et lesempêchent également d’accéderà tous les faits concernant le développementdu monde rural. Tousces facteurs rendent égalementreporters et propriétaires de médiasvulnérables aux pots-de-vin etautres subventions opaques.Les contributeurs du blog ont largementsoutenu cette analyse.Selon eux, de nombreux journalistesne parviennent pas à traiterefficacement les questions liées àl’agriculture - notamment celles quiaffectent directement les petitesexploitations paysannes - étantdonné les conditions de travail extrêmementpénibles auxquelles ilssont confrontés.Dans la région Pacifique, toutefois,il semblerait que les journalistessoient moins vulnérables aux potsde-vin.Mais le problème des bassalaires reste plus que jamais d’actualitéet continue de miner la qualitéde l’information orientée versle développement. Huub Ruijgroka suggéré une voie possible poursortir de cette impasse. Selon lui,les instituts de recherche devraientprévoir dans leur budget annuelun crédit spécial représentant leurpart contributive aux dépenses decommunication et de collaborationavec les médias. De cette façon, unlien existerait entre les travaux derecherche et les résultats qui présententun intérêt particulier pourles ménages ruraux, les journalisteset les agriculteurs eux-mêmes.Quelles sont les options existantespermettant de mobiliser les fondsdisponibles pour faciliter l’accès àl’information agricole - notammentdes sujets d’articles portant sur lesbesoins d’information de l’agriculteur“paysan” au niveau local ? Vosidées sont les bienvenues.81
825. Trouver l’informationObtenir du gouvernementdes informations sur lesquestions rurales, c’estcomme essayer de percerdes secrets d’État !!!Ruci Mafi 6Lorsque j’ai commencé à rédiger cetarticle, je me suis simplement demandécombien de mes confrèresdes médias grand public seraientsuffisamment intéressés par le sujetpour répondre aux deux questionsposées, à savoir :“Quelle expérience avez-vous, en tantque journaliste ou radio/télédiffuseur,de la collecte d’informations sur leterrain et auprès des sources officielleset scientifiques dans le Pacifique? Quelles ressources mettez-vousd’ordinaire à profit pour obtenir desinformations sur l’agriculture et ledéveloppement ?”J’ai contacté deux réseaux de journalistes,ainsi que des reporters indépendants,afin de recueillir leurspoints de vue sur les difficultés qu’ilspouvaient rencontrer pour sourcerleurs informations sur l’agriculture.Au bout d’une semaine, je n’avaisreçu que 5 réponses, mais commela date limite de remise de l’articles’approchait, il me fallait commencerà l’écrire.J’ai été surprise par les propos d’unjournaliste chevronné, qui a passéplus de 35 ans dans les médias duPacifique. Selon lui, “les journalistessont paresseux. Ils n’ont pas lescapacités nécessaires pour cultiver,instaurer et entretenir la CONFIANCE.Ils sont pratiquement tous tributairesdes communiqués de presse émanantdu gouvernement, du secteur privé etde particuliers”. Mais ces accusationsont été catégoriquement démentiespar un autre journaliste tout aussichevronné. “Permettez-moi de nepas être de votre avis, et si un jourje deviens aussi cynique que vous,tuez-moi ! Je trouve vos propos insultants”,s’est-il indigné.Étant moi-même journaliste de formation,je me dois d’accorder à mesconfrères le bénéfice du doute. Peutêtreque les journalistes sont-ils tropoccupés à la diffusion quotidienne desnouvelles pour se soucier de l’agricultureet du développement rural ?Une chose est sûre cependant : lejournaliste a beaucoup de difficultésà rassembler toutes les informationsnécessaires pour un reportage équilibré,juste et exact sur l’agricultureet le développement rural.Pour Netani Rika, rédacteur en chef duplus grand journal du Pacifique Sud,obtenir des informations de sourcesofficielles et scientifiques pose unréel problème. “La plupart ne veulentpas donner d’informations et ilest extrêmement difficile d’en avoirauprès du gouvernement”, précise-til.Les scientifiques communiquent etdiffusent l’information plus librement.“Le problème avec eux, c’est le jargonet les termes techniques utilisés”, regretteRika. “Les scientifiques refusentsouvent de simplifier l’information, etcela pose problème au journaliste quia des délais de livraison mais qui doitclarifier, interpréter et expliquer à seslecteurs une information scientifiqueou technique”, ajoute-t-il.Samisoni Pareti, formateur au métierdes médias dans le Pacifique et correspondantétranger, partage l’avisde Rika. “Les services en charge del’agriculture veulent que je suive leurscanaux officiels de communication,mais cela revient à un jeu d’esquiveet finit généralement en queue depoisson”, se désole-t-il. Á l’instar dePareti, les journalistes de nombreuxpays insulaires du Pacifique ont lesentiment qu’obtenir des ministèresde l’Agriculture des informations surle développement agricole et ruralest presque aussi difficile qu’accéderà des secrets d’État !“J’ai voulu recueillir les commentairesdu responsable des opérations dedragage au ministère de l’Agriculture,à propos d’une ville qui risquede disparaître dans 20 ans à causede la montée du niveau de la mer”,explique Pareti. “J’ai appelé à sonbureau pour me faire entendre direque je devais interroger le service del’information du ministère. Je l’ai faitpar fax, comme on me l’a demandé.Trois jours plus tard, ils m’ont répondupour me dire que le responsable nepouvait pas me parler. Résultat : uneperte de temps et de ressources !Quant aux scientifiques, il leur arrived’être pédants. Ils demandentgénéralement à lire mon article avantpublication, mais je refuse à chaquefois. Moi, je ne demande jamais àvoir leurs rapports scientifiques avantpublication, alors pourquoi devraientilsvoir le mien ?”Une meilleure couverture par lesmédias des questions de développementrural passe nécessairement parune compréhension mutuelle, uneconfiance et un respect réciproques desparties concernées. Une coopérationefficace ne sera possible que lorsquedisparaîtra le climat de méfiance quipèse sur les journalistes et les médias.Les médias doivent pouvoir facilementaccéder à l’information, toutcomme leurs sources doivent avoirconfiance dans les résultats escomptés.L’agriculture joue un rôle moteurdans l’économie du Pacifique et lespopulations rurales ont besoin d’avoirfacilement accès à une informationpertinente et appropriée, dans unanglais simple ou, mieux encore, enlangues locales.6Ruci Mafi est née à Lautoka City, dans la République de Fidji. Deuxièmed’une famille de six enfants, elle ne savait pas quelle profession exercerjusqu’au jour où elle atterrit dans un Quotidien de la place comme reporterjunior. Après avoir travaillé pendant plus de dix ans comme journalistecouvrant les sujets politiques et autres rubriques, elle rejoint finalement leSecrétariat de la communauté Pacifique (CPS). Aujourd’hui formatrice enmédias et journaliste à la télévision, elle fait tout son possible pour aider sesconfrères et jeunes collègues journalistes à tirer le maximum de leur potentielet à apporter les changements nécessaires. Elle fait partie d’une équipequi produit une émission hebdomadaire de type “magazine”, diffusée dans19 îles et territoires du Pacifique. Elle adore écrire et s’intéresse beaucoup àl’environnement.
RésuméLes réactions à l’article de RuciMafi, émanant des régions Afriqueet Pacifique, ont confirmé la plupartdes idées avancées par l’auteur.Un journaliste agricole tanzaniena montré des exemples pratiquesmontrant que lorsqu’il cherchait àobtenir des informations auprès decertains fonctionnaires, il s’étaitheurté à des réticences, traduisantà la fois la crainte de ces derniers- “demandez à mes supérieurs” - età un refus inexplicable de répondreà des questions directes mêmelorsque celles-ci (notamment dansune situation terrible) concernaientla santé des communautés agricoleslocales.Jason Brown (du Pacifique) a démentifermement l’allégation selonlaquelle les problématiquesagricoles étaient ignorées sousprétexte que les journalistes sonttrop paresseux pour les aborder. Ila montré comment la privatisationet la corporatisation rapides desmedias ont affecté directement etnégativement les flux et le contenudes informations. Soulignant lefait que les médias sont de plusen plus dominés par des intérêtsqui veillent à ce que les messagesentrant dans le domaine publiquesoient contrôlés et expurgés, il aexaminé les conséquences pour lesjournalistes qui entretiennent desrelations directes avec les communautéslocales et ne disposentpas des ressources nécessairespour lutter contre cette tendance.N’ayant pas reçu de réactions denos collègues des Caraïbes, nousattendons avec impatience voscommentaires.6. FormationLa formation estessentielle pour fairefigurer les questionsagricoles dans les médiasJohnson Johnrose 7Je suis né et j’ai grandi sur une petiteîle des Caraïbes, où la couleur de l’orétait verte et où les “chercheurs d’or”portaient des bottes en caoutchouc,armés de fourches, de pioches, dehoues et de machettes.Sur cette petite île appelée Dominique,régnait alors la banane et, par extensionl’agriculture ; il n’y avait niprince, ni princesse attendant deporter à leur tour la couronne. Et lesdébats sur la vulgarisation n’avaientrien à voir avec la stratégie actuellede mise en valeur du pouvoir mâle :ils avaient lieu sur le terrain et dansles plantations, avec des agents devulgarisation prêts à aider les paysansà renforcer leurs compétences, développerleur savoir-faire et améliorerleur rendement. C’était l’agricultureet pratiquement rien d’autre !Mais les milliers de fermiers quivivaient de l’agriculture (l’or vert)ont tout fait pour empêcher leursenfants de devenir des “chercheursd’or”. Leur souhait était de voir leursenfants devenir médecins, avocats etexercer d’autres métiers de prestige.L’agriculture, c’était pour les gens nonéduqués et sans ambition. Puis, ce quidevait arriver… arriva, et la productionagricole se mit à décliner. Dans lemême temps, plusieurs autres paysdes Caraïbes se mirent à “chercherde l’or” ailleurs, en particulier dansle tourisme.Je ne peux m’empêcher de penser,avec le recul, que les médias aussiavaient laissé tomber le secteur. Jeme souviens vaguement d’une émissionradiophonique appelée “GreenGold” (l’or vert), où les personnagesutilisaient l’humour pour discuter desproblèmes que rencontrait l’industriede la banane, mais de rien d’autre.Les défis étaient, bien sûr, nombreuxet énormes. Dans la plupart des payscaribéens, la radio était sous le contrôledu gouvernement en place et peud’États disposaient alors de leur proprechaîne de télévision. Pour tout lemonde, il n’y avait que la station radio,laquelle devait satisfaire les désirs dechacun ; ce qui laissait peu de placeet de temps pour se concentrer surles questions clés.Et la prolifération des médias - enparticulier les stations de radio FM -constatée ces dernières années n’aété à l’origine d’aucun regain d’intérêtpour des sujets moins “sexy” commel’agriculture. Elle a, au contraire, rendudifficile la mise en commun des talents,déjà rares dans la profession. Et pouraggraver le problème, les patrons degroupes de presse, qui entendentinvestir de moins en moins en moinsdans l’embauche de journalistes dequalité, recrutent dans la rue des gensqui ne comprennent même pas le “ba.ba” du métier, tout comme ils rechignentà investir dans des programmes“dédiés au développement”.Aujourd’hui, le professionnel des médiassemble perdu et cherche à comprendreson véritable rôle. Qui plus est, le tauxde rotation des effectifs dans les médiasreste élevé, en raison des bas salairespratiqués dans ce secteur. Ce qui esttriste, c’est que peu de gens embrassent7Formé à la BBC, je suis à la fois journaliste, radiodiffuseur et formateur enmédias. Je suis également diplômé en gestion des médias auprès de l’Universitédes arts audiovisuels de Caracas (Venezuela) et titulaire d’un certificat dejournalisme d’affaires délivré par Reuters. J’exerce la profession de journalistedepuis plus de 25 ans et je jouis d’une solide expérience comme reporter dansles Caraïbes, sur des sujets divers et variés allant de l’économie à la politique,en passant par le tourisme et le secteur des services financiers, entre autres.J’ai couvert d’importants événements tels que les rencontres des chefs d’État etde gouvernement du Commonwealth, le Sommet des Amériques, les réunionsde l’OAE et de la CARICOM.J’ai été récompensé de plusieurs prix et distinctions pour mes articles et émissions,publiés et diffusées à l’intérieur et en dehors de la région ; de même,j’ai régulièrement contribué aux programmes de la BBC London Live (anciennementGreater London Radio). J’ai débuté ma carrière comme reporter à laDominique et dans les années qui suivirent, j’ai travaillé comme journaliste etdirecteur des programmes de la radio d’État DBS Radio. J’ai également collaboréavec la Caribbean News Agency (CANA) où j’ai servi comme producteuret présentateur de l’émission vedette, The Caribbean Today, avant de devenirjournaliste radio et télévision à la Caribbean Media Corporation (CMC). Je suisactuellement responsable de la communication à la Caribbean Tourism Organization(CTO) mais je continue à travailler comme journaliste indépendant.83
84ce métier avec l’intention de devenir devrais professionnels et d’y faire carrière.En effet, nombreux sont ceux qui l’utilisentcomme tremplin pour trouver dutravail dans les Relations publiques, uneactivité où les rémunérations sont nettementplus alléchantes et les avantagesfinanciers plus substantiels. En outre,les patrons de presse offrent à ceux quirestent dans le métier peu d’opportunitésou d’espace de formation. D’ailleurs, je nesuis pas sûr qu’ils comprennent vraimentque le journalisme est une profession,et ceux qui l’exercent devraient d’abordse considérer eux-mêmes comme desprofessionnels. Or, il ne peut y avoir deprofessionnels sans formation adéquate,ni code d’éthique et de conduite.Voilà, en substance, les difficultésauxquelles font face les médias et qui,logiquement, ont un impact négatif surleur capacité à influencer, façonner etorienter le débat sur le développementagricole et rural.Mais tout n’est pas perdu. En tant quecitoyens des Caraïbes, nos professionnelsdes médias ont une passion pour leurrégion et veulent contribuer activementà son développement. Ils se veulent desjournalistes responsables et progressistes.Mon organisation, la Caribbean TourismOrganization (CTO), en a pleinementconscience. Nous savons que les problèmesque rencontre l’agriculture en ce quiconcerne son traitement par les médiassont les mêmes que ceux dont souffrele tourisme. C’est pourquoi nous avonscommencé à proposer des programmesde formation aux jeunes journalistes professionnels.Car c’est par la formation, lasensibilisation et la mobilisation que nouspourrons influer sur les médias, y comprisles patrons de groupes de presse, et lesencourager à jouer un plus grand rôle dansle développement agricole et rural.Si j’en crois l’expérience que j’ai vécueauprès de journalistes et diffuseurs caribéens,il est évident qu’ils ont besoinde formation aux pratiques de base desmédias et du journalisme. Toutefois, pourrenforcer leur contribution au développementagricole et rural, ils ont aussibesoin de comprendre la complexitédes systèmes alimentaires mondiauxet comment simplifier et communiquerefficacement au public l’information surles enjeux de l’agriculture. Il leur manqueégalement la capacité de rechercher ladocumentation nécessaire sur l’agricultureet de discuter des questions agricolesde manière pertinente, tout commela capacité d’écrire dans un langageclair, simple, concis et structuré. Á cetégard, la mise en place de programmesde formation au journalisme et à lacommunication agricoles, y compris àl’utilisation d’Internet, et en particulierdes blogs comme celui-ci, pourrait,sans aucun doute, faire la différencede manière décisive.RésuméDans son article, Johnson Johnrosemet l’accent sur les nombreux facteursqui contribuent à reléguer lesquestions agricoles au second plandans les médias caribéens. Parmices facteurs, citons notamment lasituation critique de l’agriculture etle nombre restreint de journalistesformés et expérimentés.Les réponses émanant des communautésagricoles du sud de la Tanzanie(interviewées par Felix Mwakyembe)montrent peut-être comment cettetendance peut s’inverser. A la question“Qu’attendent exactement lesagriculteurs de la part des médias ?”,les personnes interrogées ont affirmécomprendre leurs préoccupations etque les problématiques étaient souventsystématiquement ignorées parles journalistes au profit des déclarationset les activités des hommespolitiques et des représentants dugouvernement. Elles ont égalementmontré, à l’aide d’exemples précis,comment certains journalistes sontparvenus à redresser la situation enpermettant de faire coïncider l’actionnationale avec un certain nombre depréoccupations sérieuses à l’échelonlocal. Les agriculteurs ont ainsi été enmesure de fournir des informationsprécises aux journalistes et les médiasont été de plus en plus perçus commeune source d’information éducative.7. Financement des médiaUne plus étroite coopérationest-elle la solution auxproblèmes financiers desorganes de presse ACP ?Hans Determeyer 8L’insécurité financière est une des caractéristiquesmajeures du secteur desmédias dans les économies émergenteset, en particulier, en milieu rural.En effet, de nombreuses organisationsde médias dépendent des bailleurs defonds ou du parrainage commercialpour assurer leur fonctionnement.L’expérience montre que le manquede coordination des projets et le financementà court terme - souventdictés par des raisons externes etnon par les besoins locaux - ont unimpact négatif sur la santé et la pérennitédes organes de presse. Dessubventions publiques permettraientcertes de mettre en place des initiativesau profit des médias mais ellesrisquent également, une fois arrivéesà échéance, de créer une dépendanceet une insécurité financière pour cesmédias. De même, les entreprisescommerciales pourraient aider à lacréation d’organes de presse en prenanten charge l’investissement nécessaireen termes d’équipement et dematériel, ainsi qu’une partie des fraisde fonctionnement, mais ces soutiensfinanciers sont, hélas, souvent assortisde conditions spécifiques.Pour permettre aux journalistes etradio/télédiffuseurs d’assurer unecouverture complète et critique desquestions de développement agricoleet rural, il faut leur garantir une libertétotale de programmation. Mais cetteindépendance se heurte au problèmede financement ci-dessus évoqué et,en particulier, dans les communautésà faible revenu. Surmonter un tel8En août 2008, Hans Determeyer s’est vu proposer la direction du Programmede financement des médias pour le compte de Free Voice, une organisationd’aide aux médias basée aux Pays-Bas. Ce programme a pour butde faciliter l’accès au financement des (réseaux d’) organes de presse dansles économies émergentes et les jeunes démocraties à travers le monde. Enqualité de directeur puis de consultant, il a passé plus de 10 ans en Afriqueà promouvoir l’engagement civique en faveur de la bonne gouvernance et dela transparence des processus politiques. Il a vécu et travaillé au Ghana, oùil a pu créer avec ses collaborateurs un fonds innovant multibailleurs pourfinancer des groupes de réflexion (thinktanks) et des réseaux d’organisationsde plaidoyer. Avec l’aide d’une équipe de spécialistes camerounais, il a mis enplace un mécanisme de financement et de renforcement des capacités pourles communautés vivant dans la forêt tropicale dense. Hans a également travailléau Tchad, à un moment où l’exploitation attendue des réserves du payssuscitait ça et là des tensions. Il y a dirigé un programme multisectoriel, axénotamment sur la gestion des conflits et des droits de l’Homme. De même, ila collaboré avec Médecins sans frontières et Amnesty International.
obstacle sans pour autant perdre lecontrôle sur le contenu des programmesnécessite de la part des médiasun esprit d’entreprise bien ancré etdes compétences appréciables enmatière de gestion. Or le problème,c’est que les journalistes qui créentune station radio/télévision ou unjournal ne sont pas toujours animéspar cet esprit d’entreprise.On constate que les petites et moyennesentreprises de médias sontconfrontées à des défis d’ordre professionneltels que le développementde leurs activités, la gestion financière,le marketing et la commercialisation deleurs produits. Elles doivent égalementrelever des défis d’ordre institutionnel :engagement actif dans le travail enréseau, échanges de programmes,collaboration avec des projets sur lesnouvelles TIC, initiatives communesen matière de marketing, etc. Deplus, lorsqu’un organe de presse faitappel à l’investissement commercialpour couvrir ses coûts, son contrôlesur les programmes et le contenu desémissions va dépendre non seulementde sa capacité de négociation avecl’investisseur en question, mais ausside son degré de popularité auprès deses lecteurs ou auditeurs/téléspectateurs.Après tout, l’investissementcommercial dans un média a plusde chance d’être rentable si celui-ciest bien ancré dans la communautélocale ciblée : un pari potentiellementgagnant-gagnant, tout compte fait.Comment aider les organes de presseà relever ces défis et, ainsi, améliorerleurs performances ? Certainementpas par des subventions uniquement,car elles ne font que les maintenir unpeu plus longtemps dans la mêmesituation de survie et de précarité.Dans d’autres secteurs pourtant, ilexiste un moyen efficace d’encouragerune PME à se développer etprospérer : c’est l’accès au crédit - viales établissements bancaires ou lesinstitutions de microfinance - aux finsd’investissement. Toutefois, n’oublionspas que pour établir une relation fructueuseavec sa banque, l’entrepreneurclient doit absolument disposer d’unbon “business plan” et faire preuved’une solide gestion financière. Deplus, la pression des intérêts à payersur l’emprunt contracté contribue àstimuler la vigilance et l’inventivité del’entrepreneur. Cette formule serait-elleapplicable au secteur des médias ?C’est un fait historique et de notoriétépublique que les banques et lesgroupes de presse n’entretiennent pasles meilleures relations. En effet, lesmédias ont des difficultés à présenterles garanties exigées par les banqueset autres investisseurs. De manièregénérale, la perception des organes depresse par le public est qu’ils ne sontpas particulièrement bien organisés, enplus d’être vulnérables politiquement.Enfin et surtout, les taux d’intérêtprohibitifs généralement pratiquéspar les banques dans les économiesémergentes (souvent supérieurs à30%) ne sont pas de nature à favoriserun mariage heureux et durable entreles deux entités.C’est précisément ce cercle vicieuxque veut briser l’organisation FreeVoice, basée aux Pays-Bas. Elle propose,pour ce faire, une combinaisonde garanties aux investisseurs (ceuxqui sont plus intéressés par un fortimpact auprès du public que par unesubstantielle rentabilité), ainsi qu’uneétroite collaboration en réseau avecle secteur financier et les servicespublics de développement d’entreprises,pour le compte d’organes depresse ciblés (réseaux des petiteset moyennes entreprises de médiasdes pays émergents). Ainsi, grâceau Fonds Media Development LoanFund et à d’autres partenaires, l’accèsau crédit est aujourd’hui une réalitédans la région SADC (Communautéde développement d’Afrique australe),en Indonésie et au Pérou. Des initiativessimilaires sont en cours delancement en Afrique de l’Ouest eten Amérique du Sud.C’est un marché considérable et enpleine expansion, notamment grâceaux réseaux mobiles. Son potentiel estplus que prometteur, également pour lesecteur agricole. Le défi à relever seradonc d’instaurer un dialogue fructueuxentre les institutions financières et lesorganes de presse, pour qu’ils explorentensemble les possibilités de simplifierles coûts de gestion des crédits. Ce nesera pas chose facile, étant donné queles petites entreprises de médias sontsouvent géographiquement dispersées.Une des solutions envisageables seraitune plus étroite collaboration enréseau entre les organes de presseimpliqués dans ce type de négociationsfinancières.RésuméLes contributeurs ont confirmé quela viabilité financière était un problèmeau sein du paysage médiatiqueet pour permettre des initiatives.Même en période de relative stabilitéfinancière, le souci du financementde la prochaine étape d’unprojet se pose. Si les fonds octroyéspar les donateurs sont importants,il semble toutefois qu’une approchepragmatique soit plus sécurisanteà long terme. Comme le montrel’expérience de certaines stationsde radio communautaire, si tantest que l’information ait été jugéepertinente par l’audience rurale cibléeet qu’elle contribue à améliorerleurs conditions de vie, les genssont prêts à payer pour souteniret participer aux activités de leurstation de radio locale.85
868. La législation et lescontraintes politiquesLes mauvaises lois portentatteinte au développementdes médiasParkie Mbozi 9Dans tout système démocratique, laliberté de la presse est un principeessentiel à respecter, si l’on veut queles populations urbaines et ruralescontribuent au développement enconnaissance de cause. Les médias,relais et porte-voix des populations,en particulier les communautés défavoriséeset marginalisées, jouentun rôle fondamental dans la démocratisationet le développement denos sociétés.Pour garantir la liberté des médias,il faut d’abord et avant tout un environnementjuridique et réglementairefavorable. En effet, les médias ont besoind’un cadre législatif propice pourmener à bien leur mission, tout commeles semences ont besoin d’une terrefertile pour pouvoir germer. Autant unenvironnement législatif favorable est àmême de garantir l’essor des médias,autant les mauvaises lois constituentune entrave à l’ensemble du processusde développement des organes depresse, de la création (immatriculation/enregistrement) à la diversification, enpassant par l’élaboration et la diffusiondes programmes. Malheureusement,peu de pays ACP jouissent d’un environnementjuridique et réglementairefavorable à la création et au développementdes médias.Les problèmes commencent avecles formalités d’enregistrement oude déclaration préalable à la créationd’un organe de presse. C’est, dansbeaucoup de pays, un processus long,fastidieux et bureaucratique, impliquantl’intervention de nombreuses etdifférentes autorités administratives etgouvernementales. De par notre expérienceen Afrique australe, ce processuspeut durer jusqu’à 24 mois. D’ailleurs,il arrive que de nombreux projets decréation de stations radiophoniquessoient abandonnés à mi-chemin, oumême que leurs instigateurs se voientfinalement refuser l’enregistrementpar les autorités compétentes. Maisces difficultés ne sont pas propres àla radio, le média le plus populaired’Afrique ; elles frappent égalementla presse écrite.En effet, outre la longueur excessivedu processus d’enregistrement, la législationen vigueur dans de nombreuxpays ACP permet au gouvernementde décider seul des organes de pressequi doivent bénéficier d’une licenceou d’une autorisation de publication.Pire, dans certains pays, la législationrégissant les médias donne au gouvernementle droit de radier les médiasou journalistes “égarés”, et exige quetous les journalistes soient accréditésauprès d’une Commission des médiaset de l’information, nommée par cemême gouvernement ! Au Zimbabwe,par exemple, l’application de cette loi avalu un retrait de licence au quotidienDaily News, le journal privé le plusdynamique que le pays ait jamais euet considéré par beaucoup comme lavéritable voix du peuple. En Zambie,certaines stations de radio communautairesont menacées d’une révocationde licence pour avoir diffusé, dansle cadre de leurs programmes, desréactions téléphoniques d’auditeursqualifiées d’incitation à la rébellion despopulations contre le gouvernement.En Angola, aucune nouvelle stationde radio n’a été autorisée à émettredepuis près de dix ans.Même si on constate quelques évolutionspositives sur le front desmédias dans certains pays ACP où,notamment, la diversité des organesde presse s’est renforcée grâce à laprolifération des stations de radioscommunautaires et commerciales, iln’en reste pas moins qu’il y a encoredu pain sur la planche.Vous vous demandez peut-être pourquoinous nous préoccupons des loiset cadres réglementaires qui régissentles médias, alors qu’il est question icidu rôle des médias dans le développementagricole et rural ? Eh bien, nousdevons nous en préoccuper parce quela pluralité des médias garantit à nosconcitoyens des zones rurales – quiconcentrent l’essentiel de notre activitéagricole – l’accès à des sources d’informationsà la fois plus diverses et pluspertinentes. Car jusqu’à récemmentencore, la plupart des groupes demédias et organes de presse avaienttendance à se concentrer dans leszones urbaines. Les signaux radio ettélévision, tout comme les journauxet autres supports de communication,étaient à peine accessibles auxpopulations vivant en milieu ruralet, si par chance, ces populations yavaient accès, leur contenu s’adressaitessentiellement aux urbains. Si on ytrouvait des reportages et articles au“contenu rural”, ils étaient essentiellementréalisés par une élite urbainede professionnels et “d’experts” desmédias, et destinés à être “consommés”passivement par un public rural“sans voix au chapitre”. D’où un manquede communication inévitable, quipourrait expliquer pourquoi l’agriculturefamiliale ou à petite échelle restesous-développée dans de nombreuxpays ACP et ce, malgré des annéesd’investissements massifs.C’est pourquoi nous devons travaillerà renforcer cet intérêt grandissantpour les médias communautaires.Pour ce faire, il nous faut identifieret combattre les mauvaises lois etréglementations, à travers nos nombreusesassociations professionnelles.Nous devons inciter nos gouvernantsà introduire les réformes nécessaireset nous assurer que des lois favorablesaux médias soient inscrites dansnos constitutions. Les populationslocales – à savoir les “sans voix” –doivent être au cœur de tous noscombats : elles doivent en être “lafin” et nous, journalistes, simplement“les moyens”. C’est de cette façonque nous gagnerons de plus en plusles cœurs, et ferons de notre combatpour la liberté de la presse celui dupeuple tout entier.9Expert en médias et communication pour le développement, Parkie Mbozia travaillé dans ce secteur à de nombreux postes, dans des organisations nationales,régionales et internationales opérant en Afrique australe. Parmi ellesfigurent la Participatory Ecological Land-Use Management (PELUM) Associationfor East and Southern Africa, le Centre mondial d’agroforesterie (ICRAF), laCommunauté de développement d’Afrique australe (SADC), la Direction de l’alimentation,de l’agriculture et des ressources naturelles, l’Université de Zambie,département Communication de masse, le ministère de l’Agriculture, et d’autresinstitutions. Titulaire d’une licence et d’une maîtrise en communication demasse, il s’est spécialisé dans la communication au service du développement.Parkie est actuellement directeur exécutif de l’Institut Panos Afrique australe(PSAf) basé à Lusaka, au bureau régional pour l’Afrique australe.
RésuméLa liberté des médias est une composanteessentielle de la démocratieet du développement. Ellepermet également de s’assurerque les ménages ruraux reçoiventles informations dont ils ont réellementbesoin pour jouer un rôleactif et responsable dans le développementde leurs communautés.Les contributeurs d’autres régionsd’Afrique ont insisté sur le fait quela presse devait rester vigilante etréagir fermement lorsque les forcespolitiques tentent d’embrigader etd’aliéner sa liberté, sous quelqueforme que ce soit. Ils ont en outresouligné la nécessité de proposerune législation en faveur des médiaspour diversifier et élargir lepaysage médiatique pour offrir àces communautés rurales - souventnégligées- l’opportunité des’exprimer.9. Technologies et médiasLes nouvelles technologiesmédiatiques ne peuventrésorber à elles seules lafracture numérique entrezones urbaines et rurales.Kevin Waldie 10Il y a quelques mois, je tenais uneréunion avec le directeur d’une ONGbien établie en Afrique australe lorsqueson téléphone portable s’est mis àsonner. Cela n’avait rien d’inhabituel :le directeur se déplaçait toujours avecses deux portables et la dernière foisque j’ai pu le vérifier, il détenait descartes SIM utilisables dans au moins10 pays africains. Je m’étais habituéau fait que nos entretiens étaient invariablementponctués d’interruptions,qui nécessitaient fréquemment qu’ilsorte de son bureau pour tenter detrouver un meilleur signal réseau.Cette fois-ci, le directeur, une fois sacommunication téléphonique terminée,me présente ses excuses habituelles,en me précisant que c’étaitsa mère, aujourd’hui âgée de 80 anspassés, qui l’appelait de son villagenatal, situé à quelques centaines dekilomètres d’ici. Elle lui téléphonaitpour lui demander de lui ramenerun sac d’engrais la prochaine foisqu’il viendrait lui rendre visite. “Elleaime rester active”, m’explique alorsle directeur, “…et s’enquérir de mesnouvelles”, ajoute-t-il en souriant.Je me rappelle encore très bien de lapremière fois que j’ai vu un téléphoneportable. C’était au milieu des années90, lorsque je vivais et travaillais enzone rurale en Afrique de l’Ouest. Ál’époque, les portables étaient tellementgrands qu’ils s’adaptaientparfaitement aux énormes véhicules4x4 dans lesquels se promenaient lesriches propriétaires. “Ce sont justedes jouets pour riches”, me disais-je,“ces téléphones n’auront jamais desuccès”. Eh bien j’avais tort !Avec la propagation rapide des technologiesnumériques et des nouveauxmédias, le monde apparaît aujourd’huicomme très différent et peut-êtremême plus démocratique. En effet,la diffusion de l’information dans lescoins les plus reculés de la planète aété, pendant des années, l’apanagede la BBC, de La voix de l’Amériqueet autre Radio Moscou. Aujourd’hui,ces mastodontes de l’informationpartagent les ondes avec les stationsde radios FM qui diffusent desnouvelles locales, pour les communautéslocales et dans les langueslocales. Les ordinateurs sont depuislongtemps sortis des bureaux desentrepreneurs, et les cafés Internetou “cybercafés” permettent à de plusen plus de personnes d’avoir accès àdes informations aussi diverses quevariées. Et que dire des centaines demilliers de vendeurs d’unités pourtéléphones portables et de cartestéléphoniques que l’on trouve à chaquecoin de rue, dans les grandesagglomérations urbaines et les villesde par le monde ! N’est-ce pas là unsigne que nous vivons désormais dansun monde en conversation profondeet continue avec lui-même ?Dans les précédents débats et discussionsautour du rôle des TIC dans leprocessus de développement, on avaitla ferme conviction que la “fracturenumérique” devait être au cœur dela coopération Nord-Sud. On préconisaitalors le transfert de technologiecomme la solution évidente au“problème”. Dans une large mesure,cette vision simpliste de la fracturenumérique persiste de nos jours. Maisc’est bien d’une fracture “urbainerurale”qu’il s’agit aujourd’hui.Malgré nos discours et engagementsen faveur d’un développement participatif,l’idée que “nous sommesmeilleur juge” semble néanmoinspersister dans les programmes axéssur le développement et les besoinsen informations des agriculteurs. Etcela se reflète dans les prétextesavancés pour justifier l’inefficacitédes services fournis. En effet, mêmesi ces prétextes mettent en avantl’analphabétisme et le faible niveaud’éducation, ils n’en rejettent pasmoins la responsabilité du transfertinsuffisant d’informations sur la com-8710Kevin Waldie a étudié l’anthropologie sociale et passé son doctorat enSierra Leone (1983-85), avant de rejoindre le Département britannique pourle développement international (UK Department for International Development)en qualité de conseiller au développement social. Il a travaillé pendantune dixaine d’années au Kenya, au Népal et au Ghana sur un ensemble deprojets de développement rural. Enseignant à l’Université de Reading de 1997à 2008, il s’est établi à son compte comme consultant indépendant (site Webpersonnel www.waldie.info).
88munauté rurale. En dépit de l’indéniablecapacité des TIC à insuffler unchangement radical, la persistancede cette approche “top-down” dudéveloppement risque bien de nuireà la pertinence et à l’efficacité de lapolitique de promotion des TIC enmilieu rural.Il nous faut faire preuve d’une extrêmeprudence dans les efforts que nousdéployons pour combler la fracturenumérique et éviter les approches dece type, toujours axées sur l’expertiseet l’offre de services, qui se sontrévélées inefficaces par le passé. Parexemple, les inquiétudes des gouvernementsconcernant le recul dela contribution du secteur agricoleau PIB sont probablement réelles etlégitimes, mais cela ne signifie pas quel’intérêt pour un agriculteur d’avoir untéléphone portable, c’est d’abord depouvoir accéder aux derniers cours dumarché. De même, on promeut lestélécentres ruraux sous prétexte qu’ilfaut introduire les nouvelles technologiesen milieu rural pour améliorer laproductivité et permettre aux paysansde se positionner sur de nouveauxmarchés. Mais dans la réalité, ces résultatssont rarement atteints. Les faitsmontrent, en effet, que de manièregénérale, la plupart des gens voientd’abord dans les TIC les avantagessociaux, et non économiques, que cesnouvelles technologies pourraient leuroffrir. Les initiatives qui sont les plussusceptibles de réussir sont donc cellesqui prennent en compte les besoinset les intérêts sociaux des gens dansleur ensemble et qui reconnaissentl’importance des TIC pour les populationsruralesHeureusement, de nouveaux médias,plus sensibles aux besoins des ruraux,sont en train de remettre en cause l’exclusionnumérique. Á titre d’exemple,les journalistes citoyens et les radioscommunautaires qui, aujourd’hui,permettent aux populations ruralesde “faire entendre leur voix”, ont finipar attirer l’attention sur l’importancefondamentale de l’autonomisation deces populations dans le processus dedéveloppement.RésuméLes approches descendantes actuellesdu développement communautairene traduisent pas véritablementla réalité de terrain,notamment en ce qui concernel’introduction des nouvelles technologies.Les décideurs doiventprendre en compte les réalités pratiquesquotidiennes des ménagesruraux. Pour cela, ils ont besoinde l’entendre des communautéselles-mêmes. L’utilisation des TICdans un but bien précis, telle quesuggérée par un contributeur, permettraitde soutenir les médias etde promouvoir l’échange d’informationsmais l’expérience a montréque les technologies ne peuventcontribuer à elles seules à façonneret à refaçonner le développement.Des exemples ont été fournis pardes stations de radio communautaireet des clubs d’auditeurs oùl’intervention des médias avait aidéles communautés à articuler leurspréoccupations dans l’attente d’uneréponse favorable de la part dugouvernement. Il a été suggéré quede telles expériences permettraientà d’autres communautés de mieuxcomprendre l’influence des médiassur les politiques agricoles et dedéveloppement dans la région.10. Stratégies derenforcement de laparticipation des médiasFormer les journalistes aumétier d’agrijournalistes :vers la restauration dela culture dans le secteuragricoleKris Rampersad 11Á Trinité-et-Tobago, contrairement à denombreux autres États des Caraïbeset du monde en développement, agricultureet développement sont deuxtermes intrinsèquement contradictoires.Profondément marqués parl’histoire de l’esclavage, du travail forcéet du servage qu’a connue la région,les enfants sont élevés loin de l’agriculture,avec des ambitions nourriespour des métiers dans l’industrie oule secteur des services aussi éloignésque possible du travail de la terre, etl’intime conviction que l’agriculturen’offre que peu de chances de réussiteprofessionnelle.Cette idée que l’agriculture reste uneactivité périphérique se traduit aussidans les politiques et pratiques despersonnes adultes. En effet, à Trinitéet-Tobago,le secteur des ressourcesénergétiques regorge d’opportunitésalternatives à l’agriculture et lespolitiques gouvernementales misesen place s’efforcent d’encouragersystématiquement le secteur privéà investir de plus en plus dans l’exploitationdes réserves de pétroleet de gaz. Dans le même temps, onreproche au secteur privé de ne pasinvestir dans l’agriculture, alors querien n’est pratiquement fait pour l’yinciter. Le soutien au monde paysanet à l’agriculture est considéré, de fait,comme un investissement non viableet non rentable économiquement. On11Je suis née dans une famille d’agriculteurs… mais j’ai grandi avec l’idéed’exercer un tout autre métier. Comme la plupart des gens autour de moi,je me préparais à devenir autre chose, tout, sauf agricultrice. En travaillantdans un comité de rédaction d’un journal plus préoccupé par son tirage, sesventes, ses délais et sa marge commerciale que par son rôle de garant et de“vigie” de la démocratie, j’ai pensé quand même des opportunités offerts parl’agriculture. J’ai travaillé avec des organisations internationales de développementtelles que la Fondation du Commonwealth, Le Réseau interaméricainpour la démocratie de l’Organisation des États américains, l’ONG CIVICUS– notamment l’Alliance mondiale pour la participation citoyenne – l’Institutinteraméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) et l’Institut caribéen derecherche et de développement (CARDI), dans le but d’améliorer la communicationentre ces différents acteurs. C’est ainsi que j’ai coordonné la Tableronde sur l’agriculture pour le compte de l’IICA/CARDI/CTA/CARICOM en2008. Je suis en même temps directrice des Relations internationales duRéseau des ONG de Trinité-et-Tobago pour la promotion des femmes, fondatricedu Trinidad Theatre Workshop Fund for Literature, Drama and Film,auteure, productrice, éditrice et assistante en littérature et en journalisme.
ne fait pas, non plus, réellement lelien entre produits issus de l’agricultureet moyens de subsistance despopulations, alors que le secteur del’énergie est souvent considéré commeessentiel à la survie économique. Leniveau de développement, croit-on,se mesure à l’aune de la quantité denourriture en provenance de l’extérieurque l’on a sur sa table. Pour leménage trinidadien – tout commepour ceux qui élaborent les politiquesnationales –, le fait de consommerdes produits importés conforte sonstatut de développé, et les famillesqui se nourrissent essentiellementde produits locaux sont considéréescomme étant au bas de l’échelle socialeet économique !Les médias nationaux, peut-être involontairementou par inadvertance,reproduisent et perpétuent cette perceptionde l’agriculture, renvoyantainsi à l’opinion une image négativedu secteur. En effet, il n’est pas rarede lire à la “une” des journaux et desmédias électroniques, ou d’entendre àla radio ou à la télévision, des titres dugenre “le village agricole autrefois ensommeil se réveille aujourd’hui pourtendre les bras au développement(entendez par là les industries nonliées à l’agriculture). En somme, laculture de l’agriculture n’existe pasà Trinité-et-Tobago.Or les médias constituent l’un desplus puissants outils modernes mis ànotre disposition pour créer, nourriret entretenir durablement les goûts,les perceptions, les habitudes et lescroyances. Reconnu comme un éminentcatalyseur de la créativité, unagent de transmission du savoir et dela culture, capable de stimuler et desensibiliser l’opinion publique, le médiaest le mieux placé pour inverser cestendances et faire évoluer ces idées quiportent préjudice au secteur. Mais lescontraintes qui pèsent sur les médias dela région ne sont pas bien différentesde celles dont souffre l’agriculture. Eneffet, le secteur des médias se senttout aussi impuissant et bénéficie decapacités, de ressources et d’investissementsinsuffisant pour assurerson développement professionnel.Peut-être devrions-nous braquer lesprojecteurs pas uniquement sur ceque peuvent faire les journalistes - unsujet qui a déjà focalisé une attentionconsidérable - mais également sur ceque peuvent faire les agriculteurs pours’autonomiser, en renforçant leur capacitéà se servir des médias pour mieuxfaire connaître leur profession.C’est un fait que les médias sont attiréspar le pouvoir et le succès, tout commele sont les insectes par une source delumière. Pour attirer leur attention surl’agriculture, il est indispensable dedonner au secteur agricole les moyensde mettre à profit la vaste gammed’outils et d’opportunités qu’offre lemilieu des médias. Le secteur agricoledoit non seulement établir et entretenirdes relations solides avec lesmédias conventionnels, mais aussiexplorer les possibilités d’étendreson rayonnement et son impact àl’aide des nouvelles technologies del’information et de la communication(Internet, par exemple) et des médiasalternatifs (les pièces de théâtre, parexemple). Il doit tendre la main ets’ouvrir davantage pour mieux se fairecomprendre et faire connaître le métieren cultivant une relation personnelle- agriculteur-journaliste - avec lesprofessionnels de la presse, au lieud’essayer de convertir l’ensemble desmédias. Il serait également bénéfiquepour le secteur agricole de développersa propre expertise en journalismeen fournissant aux différents médiasdes produits d’information, des articlesde réflexion et des témoignages,et partager cette expertise avec lesrédacteurs, producteurs, éditeurs,journalistes et leaders d’opinion. Deplus, les agriculteurs devraient exploiterau maximum les opportunitésoffertes par le journalisme citoyen etmettre à profit la communauté cibléepar les réseaux sociaux et professionnelsen ligne.Ce type d’approche “proactive” permettraitde projeter l’image positived’un secteur autonome, responsabiliséet de jeter aux orties les opinionsnégatives associées à l’agriculture. Lerecours aux nouvelles technologies,avec pour objectif de mieux maîtriserles contenus proposés et les messagesvéhiculées, permettrait au secteuragricole non seulement de cibler sonpublic et son lectorat de façon plussystématique, mais encore de sortirdu « ghetto » dans lequel l’ont confinéles médias conventionnels. Un desmoyens particulièrement efficacespour stimuler l’intérêt et la prise deconscience des médias reste les sortiesen plein air, c’est-à-dire, emmenerles journalistes sur le terrain, loin dutrain-train quotidien des salles derédaction. Dans le même temps, ilexiste de nombreuses possibilités deformation et de collaboration étroiteavec les agents de vulgarisationagricole - déjà connus pour être desexperts en transfert d’informationstechniques et scientifiques accessiblesaussi bien pour les profanes que pourles agriculteurs - que l’on pourraitefficacement exploiter pour transmettreune information appropriée etpertinente, travailler en liaison avecles médias, les exploitants de serreset les journalistes.Dans un monde idéal, les médiasformeraient ou rechercheraient desjournalistes spécialisés dans les reportagesagricoles. Mais compte tenude leurs ressources limitées et du faitque les patrons de médias n’en voientpas encore la nécessité, le secteuragricole pourrait bien tirer parti dece manque d’expertise en formantses propres journalistes aux fins demieux sensibiliser le public.89
9011. Journalistes publiquesCommunication et développementAgricole au SénégalAbdoulaye Barry 12Les pays africains dont fait partie leSénégal se sont libérés de la dominationabsolue de la communicationorale. Une communication qui comportedes limites car ayant une portéerestreinte et souffrant régulièrementde distorsions. La civilisation orales’est fissurée sous les coups de boutoirde la technologie qui a fini parétendre ses tentacules sur le continentafricain, transformant les modes deperception et de réactions de tous,y compris les ruraux qui constituentencore la majorité de la population. Laradio est écoutée partout, les postestéléviseurs éclairent le soir certainesconcessions, le téléphone portableélargit son champ d’utilisation dansnos campagnes et même l’internet estentrain de s’installer même si c’est defaçon encore timide.Ce changement de mode de communicationa fortement impacté surl’agriculture qui demeure encore laprincipale activité pratiquée dans lemonde rural. Elle représente plus de60% de la population et plus des deuxtiers d’opportunités d’emploi. Naguèremarginalisé et peu considéré par lesprofessionnels des média, le secteuragricole est aujourd’hui perçu commeune activité économique de premierplan qui mérite plus d’attention.Au Sénégal cette évolution s’est accéléréeau cours des dix dernièresannées. En effet à côté des questionspolitiques et de sport qui se taillentencore la plus grande place, l’agricultureréclame elle aussi sa part. Avecplus ou moins de succès. Maintenantil est devenu banal de voir des problématiquesliés à l’agriculture fairela une des journaux.En marge de l’évolution technologiquequi a permis l’utilisation de nouveauxsupports, il y a d’autres facteurs quifondent cette nouvelle réalité. Le principalétant la réorganisation du mondepaysan marquée par l’émergenced’organisations fortes comme le CNCR(Conseil National de Concertation desRuraux). Puissant outil de lobbying,le CNCR s’est beaucoup adossé à lapresse pour dénoncer les difficultésauxquelles sont régulièrement confrontésses membres et influencer lespositions du gouvernement. Chaqueannée elle organise des tournées dansle monde rural. Des tournées qui sontlargement médiatisées. Radios, téléset journaux en font leurs choux gras ettransforment le tout en véritable matraquagemédiatique qui dure plusieursjours. Même si le gouvernement accusesouvent le CNCR de manipulation del’opinion à travers cette opération, ily a un aspect bénéfique indéniable ence que la question du monde rural seretrouve au cœur du débat national,fut il pendant quelques semaines.L’effondrement de la filière arachidière,principale source de revenus des rurauxsénégalais, la crise alimentairemondiale qui n’a pas épargné le Sénégalet les programme ambitieuxlancés par le gouvernement (GOANA-Grande Offensive pour la Nourritureet l’Abondance- le Plan REVA-RetourVers l’Agriculture) sont également desfacteurs qui ont déclenché l’intérêt desmédia pour la question agricole.La concurrence favorisée par la libéralisationde l’audiovisuelle a euégalement son impact sur la nouvelledonne. La télévision nationale a jouéun rôle de précurseur et a rapidementfait des émules. Début 2004 nousavons crée une nouvelle rubrique dujournal télévisé dénommée “PleinChamp”. La rubrique qui dure cinqminutes était diffusée le vendredidans le JT du soir et rediffusée dansle JT de 13H le samedi. L’orientationéditoriale donnait à la rubrique un rôled’alerte en cas de problème commece fut le cas avec l’infestation desmouches des fruits dans le sud duSénégal. Elle donnait aussi un rôle devulgarisation des success story, car il yen a beaucoup dans nos campagnes,en donnant la parole aux producteurset aux techniciens de terrain. “PleinChamp” a permis de rompre avecune certaine manière de couvrir lesactivités du monde rural. Bravant lesdifficultés, nous avions délibérémentopté pour une couverture régulièreet non épisodique. Ce qui demandedes moyens logistiques importantsdont ne disposent pas toujours nosorganes de presse. Malgré ces limitesobjectives nous avons pu produire etdiffusé des centaines de numéros ennous appuyant sur une expérience deprès de vingt ans de pratique et enétroite collaboration avec des producteursmais également avec desstructures gouvernementales.La petite expérience de “Plein Champ“ constitue dans notre pays, juste unpetit frémissement. Pour maintenirla flamme, il faudra impérativementrendre les informations agricoles disponibles,donner l’opportunité auxjournalistes de se former, de rendreet de renforcer les organes de presseen moyens logistiques.12Je suis journaliste à la télévision Sénégalaise depuis 17 ans. Je suis chargéde coordonner le desk agriculture et environnement qui compte près d’unedizaine de journalistes. J’ai initié une rubrique hebdomadaire intitulé “PleinChamp” depuis 2004. J’ai également produits plusieurs documentairers quiévoquent les problématiques du monde rural. Je suis par ailleurs Président duGREP Groupe Environnement et Presse et Secrétaire Général du Réseau desjournalistes en Agriculture de l’Afrique de l’Ouest.
VII7.1 Acronymes & AbbréviationsACPAFRRIAIDAAMARCAMDIARCOMCAADPCANACARDICARIMACCIRADCIRESCMCCNCCRComDévCPSCRDICSDICTACTODARDFIDDSAPFAOFARAFBBFEPPASIGAINSGENARDISGICGOANAICRAFIFADIFPRIIICAINISTIWMFJADEK&GKAIPPGKITMESHAMICTMMRKNARPNEPADONGPELUMPIBPNUD /COMRECRAILSREVARKSRTGSADCSATNETSISTTICTOFUCRCUITUNESCOUSAIDUSPWOUGNETZPVAfrique, Caraïbes et PacifiqueAfrican Farm Radio Research InitiativeInnovation agricole en zones arides (Agricultural innovation in Dryland Africa)Association Mondiale des Radiodiffuseurs CommunautairesAfrican Media Development InitiativeAlliance des Radios communautaires du MaliProgramme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique(Comprehensive Africa Agriculture Development Programme of NEPAD)Caribbean News AgencyCaribbean Agricultural Research and Development InstituteCaribbean Institute for Media and Communication, JamaïqueCentre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développementCentre Ivoirien de recherches économiques et sociales, Côte d'IvoireCaribbean Media CorporationConseil national de concertation et de coopération des ruraux, SénégalCommunication et DéveloppementCommunauté du Pacifique (SPC)Le Centre de recherches pour le développement internationalCommunication for Sustainable Development Initiative (FAO et le Ministère italien de l'environnement et du territoire)Centre technique de coopération agricole et rural (ACP–UE)Caribbean Tourism OrganizationDéveloppement Agricole et Rurale (ARD)Departement for International Developpement(CPS/UE) Development of Sustainable Agriculture in the PacificL'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agricultureForum for Agricultural Research in AfricaFlétrissement Bactérien de la BananeFédération des professionnels agricoles de la Sissili, Burkina FasoGhana Agricultural Information Network SystemGenre, agriculture, développement rural et société de l'informationGroupement d'Initiative CommuneGrande offensive pour la nourriture et l’abondanceWorld Agroforestry CentreInternational Fund for Agricultural DevelopmentInternational Food Policy Research InstituteInter-American Institute for Cooperation on AgricultureInstitut de l’Information scientifique et techniqueInternational Women's Media FoundationJournalistes en Afrique pour le DéveloppementKnowing and Growing network, CaraïbesKenya Aids Intervention Prevention Project GroupRoyal Tropical Institute, Pays-BasMedia for Environment, Science, Health and Agriculture, KenyaMinistère de l’Intérieur et des Collectivités, HaïtiMulti Media Resource Kit, CamerounNational Agricultural Research Project, GhanaNew Partnership for Africa’s DevelopmentOrganisation non gouvernementaleParticipatory Ecological Land-Use Management Association for East and Southern AfricaProduit Intérieur BrutLe Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la reconstruction communautaireRegional Agricultural Information & Learning System (FARA)Retour Vers l’AgricultureRadio Kaloum stéréo, GuinéeRadio Télévision Guinéenne, GuinéeCommunauté de développement d’Afrique australeSustainable Agriculture Trainers Network, OugandaSystème d’Information Scientifique et TechniqueTechnologies d'information et communication (ICT)The Organic Farmer (Magazine et programme radio au Kenya)Ugunja Community Resource Centre, KenyaUnion internationale des télécommunicationsL'Organisation des Nations unies pour l'education, la science et la cultureUnited States Agency for International DevelopmentUniversité du Pacifique SudWomen of Uganda NetworkZone de Planification de la Vulgarisation91
7.2 COMMANDER DES RAPPORTSDES SEMINAIRES PRECEDENTSImplications du changementclimatique sur les systèmes deproduction agricole durablesdans les pays ACP. Quellesstratégies d’information etde communication ?Rapport de synthèse des travaux duséminaire de Ouagadougou 2008CTA, 2009, 106 p.ISBN 978-9081-418-4Comprendre et affronter lechangement climatique :Que peut-on faire ?Résumé exécutifCTA, 2009ISBN 978-9081-417-7Changements climatiquesdans les pays ACP /Climate changes in ACP nationsInitiatives Africa n° 137 et 138DVD bilingues anglais et françaisA. Lemoël et F. Baudry(producteurs)CTA, People TV, 2008Rôle de l’information et dela communication dans ledéveloppement des petiteset moyennes unités detransformation agroalimentaireen AfriqueRapport de synthèse de séminaire,Cotonou (Bénin), 2006CTA, 84pp, ISBN 978 92 9081 359 0Défis et perspectives pourl’industrie des plantesmédicinales des pays ACPPoints marquants des séminaires,Afrique du Sud, Vanuatu, Jamaïque,2000–2002CTA, 2007, 94pp, ISBN 978 929081 309 5Offrir une tribune aux jeunesPoints marquants d’unséminaire, Wageningen(Pays-Bas), 2004CTA, 2006, 98pp,ISBN 978 92 9081 336 1Rôle de l’information dansla gestion durable de lafertilité des sols (cédérom)Rapport de synthèse d’un séminaire,Arnhem (Pays-Bas), 2003CTA, 2005Pour une participationefficace des pays ACP auxnégociations sur le commercedes produits agricoles :le rôle de l’information etde la communicationRapport de synthèse d’un séminaire,Brussels (Belgique), 2002CTA, 2003, 82PP,ISBN 92 9081 278 8Pour une participation efficacedes pays ACP aux négociationssur le commerce des produitsagricoles : le rôle de la GIC(cédérom)Actes d’un séminaire du CTA,Bruxelles (Belgique), 2002CTA, Solagral. 2003The economic role ofwomen in agriculturaland rural development:revisiting the legal environment(uniquement disponibleen anglais)Rapport de synthèse d’un séminaire,Kampala, Ouganda, 2001CTA, 2002, 80pp,ISBN 92 9081 2621Stratégies de gestion del’information et de lacommunication au seindes organisationspaysannes faîtièresRapport de synthèse d’un séminaire,Douala (Cameroun), 2001CTA, 2002, 48pp,ISBN 92 9081 260 5Stratégies de gestion del’information et de la communicationau sein des organisationspaysannes faîtièresActes d’un séminaire, Douala(Cameroun), 2001CTA, 2002. 222pp.ISBN 92 9081 261 3L’information pour ledéveloppement agricole etrural des pays ACP : nouveauxacteurs, nouveaux médias etthèmes prioritairesActes d’un séminaire, Paris(France), 2000CTA, 2001. 322pp.ISBN 92 9081 248 6L’information pour ledéveloppement agricole etrural des pays ACP : nouveauxacteurs, nouveaux médias etthèmes prioritairesRapport de synthèse d’unséminaire, Paris (France), 2000CTA, 2001. 26pp.ISBN 92 9081 250 85 unités de crédit.CTA no. 1051. Code 4CTA, 1997. 116pp.ISBN 92 9081 166 892Pour plus d’informations sur les publications du CTA ou pour recevoir despublications du CTA, visitez le site web du CTA à www.cta.int/frVoir aussi la bibliothèque numérique du CTA,<strong>Anancy</strong> à http://anancy.cta.int et le catalogue électroniqueà e-catalogue à http://cta.esmarthosting.net/
Synthèse des travaux du séminaireCTAPostbus 3806700 AJ WageningenPays-Baswww.cta.intLe Centre technique de coopération agricole etrurale (CTA) a été créé en 1983 dans le cadrede la Convention de Lomé signée entre lesÉtats du groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique)et les États membres de l’Union européenne.Depuis 2000, le CTA opère dans le cadre del’Accord de Cotonou ACP-UE. Le CTA a pour missionde développer et de fournir des produits et desservices qui améliorent l’accès des pays ACP à l’informationpour le développement agricole et rural.Le CTA a également pour mission de renforcer lescapacités des pays ACP à acquérir, traiter, produireet diffuser de l’information pour le développementagricole et rural.CTA est financé par l’Union Européenne