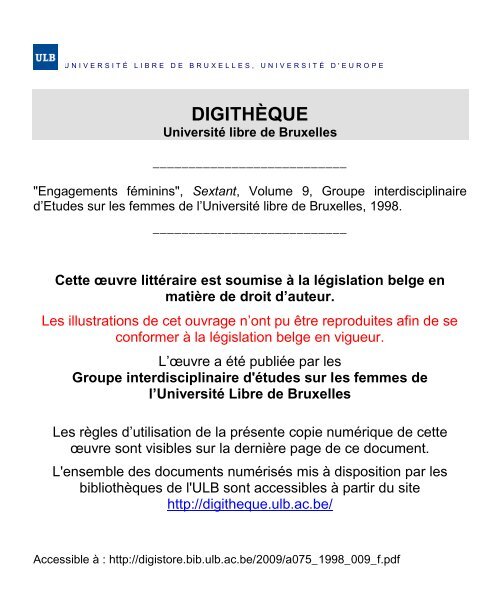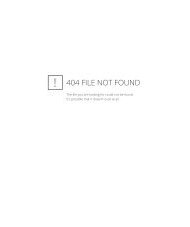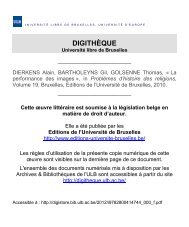Engagements féminins - Université Libre de Bruxelles
Engagements féminins - Université Libre de Bruxelles
Engagements féminins - Université Libre de Bruxelles
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
U N I V E R S I T É L I B R E D E B R U X E L L E S , U N I V E R S I T É D ' E U R O P EDIGITHÈQUE<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>___________________________"<strong>Engagements</strong> <strong>féminins</strong>", Sextant, Volume 9, Groupe interdisciplinaired’Etu<strong>de</strong>s sur les femmes <strong>de</strong> l’<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>, 1998.___________________________Cette œuvre littéraire est soumise à la législation belge enmatière <strong>de</strong> droit d’auteur.Les illustrations <strong>de</strong> cet ouvrage n’ont pu être reproduites afin <strong>de</strong> seconformer à la législation belge en vigueur.L’œuvre a été publiée par lesGroupe interdisciplinaire d'étu<strong>de</strong>s sur les femmes <strong>de</strong>l’<strong>Université</strong> <strong>Libre</strong> <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>Les règles d’utilisation <strong>de</strong> la présente copie numérique <strong>de</strong> cetteœuvre sont visibles sur la <strong>de</strong>rnière page <strong>de</strong> ce document.L'ensemble <strong>de</strong>s documents numérisés mis à disposition par lesbibliothèques <strong>de</strong> l'ULB sont accessibles à partir du sitehttp://digitheque.ulb.ac.be/Accessible à : http://digistore.bib.ulb.ac.be/2009/a075_1998_009_f.pdf
SEXTANTRevue bisannuelle publiéepar le Groupe interdisciplinaired'Etu<strong>de</strong>s sur les Femmesavec le concoursdu Fonds Suzanne Tassier (ULB)91998
Comité scientifiqueClaire Billen, Andrée Despy-Meyer, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat,Ma<strong>de</strong>leine Frédéric, Eliane Gubin, Serge Jaumain,Andrée Lévesque, Jean-Pierre Nandrin,Bérangère Marquès-Pereira, Anne Morelli,Jean Puissant, Eliane Richard, Anne Summers.Secrétariat <strong>de</strong> rédactionE. GubinGIEF-ULB50 avenue Franklin Roosevelt CP 175/01 1050 <strong>Bruxelles</strong>Télécopieur (2) 650 39 19CouvertureIsabelle GrosjeanIllustration: affiche du 7" Congrès international pourle Suffrage <strong>de</strong>s femmes. Budapest 15-20 juin 1913.Prix et abonnementAu n° 450FB (+ 50 FB frais <strong>de</strong> port)Abonnement 800 FB (+ 100 FB frais <strong>de</strong> port)Pour l'étranger: Majoration <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> port (80 FB au nO ;160 FB à l'abonnement)En vente:Presses <strong>de</strong> l'ULB 22 av. Paul Héger, 1050 <strong>Bruxelles</strong>Librairie Ferraton 162 chaussée <strong>de</strong> Charleroi 1060 <strong>Bruxelles</strong>Par correspondance: comman<strong>de</strong> avec chèque barré àGIEF-ULB50 av. Franklin Roosevelt CP 175/011050 <strong>Bruxelles</strong> (avec mention <strong>de</strong> l'ouvrage désiré)Dépôt légal D 1998/5999/1.
SOMMAIREDOSSIER9 Eliane RichardMilitantes marseillaises17 Beatrice BarbalatoEléonore <strong>de</strong> Fonseca Pimentel. Poète et révolutionnaire33 Maria José Lacalzada <strong>de</strong> MateoConcepci6n Arenal. Une humaniste espagnole5565Stina NicklassonUne pionnière suédoise, Lydia WahlstrômYvonne KnibiehlerGermaine Poinso-Chapuis. Pionnière et militante83 Viviane Di TillioLa Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes universitairesNaissance et essor115 Sophie MatkavaTrois générations <strong>de</strong> femmes contre l'alcool.L'engagement <strong>de</strong> la famille NyssensDÉBAT151 Sandrine DauphinFemmes au pouvoir. Les partis politiques et leursmilitantes
DOSSIER
Introduction 7IntroductionLe retour à l'histoire politique a réactivé le débat sur le militantisme.Après les dictionnaires et les prosopographles qui ont permis <strong>de</strong> mettre enlumière les • mllitants obscurs . - ceux <strong>de</strong> la base échappant le plussouvent aux biographies individuelles -désormais vers les fon<strong>de</strong>ments même <strong>de</strong> l'engagement.SI la plupart <strong>de</strong>s travauxles recherches s'oriententn'ignorent plus totalement le militantisme<strong>de</strong>s femmes. ils le réduisent néanmoins à la portion congrue. Quelquesmilitantes apparaissent certes au rang d'exceptions ou <strong>de</strong> pionnières donton souligne la singularité. mals la plupart d'entre elles <strong>de</strong>meurent dansune pénombre que l'absence <strong>de</strong> répertoires biographiques <strong>féminins</strong> nepermet encore <strong>de</strong> dissiper.En outre. les êtu<strong>de</strong>s privilégient les domaines qui furent les hauts lieuxdu militantisme masculin : la lutte politique et la lutte syndicale. Lesdébats sur la citoyenneté et sur le suffrage féminin y ont encore contribué.Ce sont bien les luttes pour le droit <strong>de</strong> vote et la représentation <strong>de</strong>sfe mmes. la défense <strong>de</strong> leur droit au travail. qui retiennent le plus souventl'attention <strong>de</strong>s historiens. <strong>de</strong>s politologues. <strong>de</strong>s sociologues.Pourtant. ces domaines - masculins . par essence • - sont-Ils ceux queles femmes ont investis prioritairement ? Ce n'est pas sous-estimerl'intérêt <strong>de</strong> ces combats (bien représentés d'ailleurs dans ce numéro) que<strong>de</strong> souligner d'autres allées <strong>de</strong> l'engagement fé minin. et <strong>de</strong> chercher àdégager leur spécificité,La perspective <strong>de</strong> genre est ici omniprésente. On ne peut nier en effetque l'engagement <strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong>s fe mmes ait revêtu (et revêt encore)<strong>de</strong>s formes et <strong>de</strong>s expressions particulières. découlant directement <strong>de</strong>s
8 Introductioncontraintes que la société bourgeoise imposa aux <strong>de</strong>ux sexes. Contraintes<strong>de</strong> lieux. <strong>de</strong> comportements. d'expression: longtemps pIivées <strong>de</strong> parolepublique, par quels moyens et sur queUes bases les femmes ont-eUes forgéleur conscience et leurs actions militantes?Si les trajectoires sont éminemment variables - aIIant <strong>de</strong> latransgression <strong>de</strong>s normes à leur intégration - toutes les femmes engagéesse sont heurtées aux contradictions profon<strong>de</strong>s d'une société qui veillaitjalousement à préserver en théorie les sphères séparées et à lesentreméler sans cesse en pratique. Alors que les discours et lesreprésentations consignaient les femmes au foyer. tout (ou presque) dansla vie quotidienne les incitait à en sortir. Le capitalisme industIiel enrôlaitmassivement les femmes <strong>de</strong>s classes populaires dans ses usines; l'Etatlibéral faisait largement l'économie d'un travail social qu'il confiait auxfemmes <strong>de</strong>s classes bourgeoises. embrigadées dans <strong>de</strong> vastes réseauxcaritatifs et philanthropiques. A la fin du siècle. l'Eglise eUe-méme mit unpoint d'orgue à ces messages contradictoires avec l'encyclique RerumNovarum. rappelant aux femmes leur rôle prioritaire <strong>de</strong> mère mais lesmobilisant dans la lutte contre le socialisme.Prises entre ces messages contradictoires, comment les femmes ontelles(ré)agi ? Quelles formes d'engagement ont-elles pu développer? Quelssuccès ont-eIIes engrangés dans les domaines laissés à leurscompétences? A contrario quel fut le prix à payer lorsqu'elles forcèrent lesinterdits ?Vaste domaine <strong>de</strong> recherche auquel les numéros 9 et 10 <strong>de</strong> la revueespèrent contIibuer par quelques biographies individuelles et quelquesengagements coIIectifs. Ces articles illustrent l'hétérogénéité dumilitantisme féminin. en rappeUent les conditions particulières. soulignentla dimension <strong>de</strong> genre qui le traverse et éclairent. une fois <strong>de</strong> plus, lanécessité d'abor<strong>de</strong>r l'histoire commune avec un double regard(E.G.)
Eliane Richard 9l\lilitantes marseillaisesEliane RichardLa réalisation. par une équipe <strong>de</strong> l'Association Les Femmes et laVille. du premier dictionnaire consacré aux Marseillaises pennet <strong>de</strong>mettre en évi<strong>de</strong>nce l'importance. largement méconnue jusqu'à ce jourpar les historiens - et a fortiori par le public- du militantisme fémininmarseillais 1 •Le phénomène est relativement récent: apparu vers le milieu duXIX· siècle. il se développe au XX" et connaît encore aujourd'hui unebelle vitalité. Auparavant. <strong>de</strong>s femmes exerçaient parfois d'importantesfonctions religieuses (comme abbesses ou fondatrices <strong>de</strong> couvents).économiques (dans le négoce. la fabrique. l'armement. l'édition... etc.). sociales et culturelles. plus rarement politiques (vicomtesses).Mals au siècle <strong>de</strong>rnier. alors que l'idéologie dominante valorisel'épouse. la mère. la maîtresse <strong>de</strong> maison. le co<strong>de</strong> civil napoléonienfait <strong>de</strong> la femme mariée une mineure et une. incapable '. La République.universelle. s'entête à priver . la moitié du genre humain (du1. L'association a publié en 1993, aux éditions Côté-femmes. Marseillaises, lesfemmes et la ville. Six ans plus tard, sous la direction <strong>de</strong> Renée DrayBensousan, Héléne Echinard. Régine Goutalier. Catherine Marand-Fouquet,Eliane Richard. Huguette Vidalou-Latreille. Marseillaises. vingt·six sièclesd'Histoire (Edisudl. est le premier dictionnaire <strong>de</strong>s Marseillaises. Il comporteune synthèse historique. 320 notices. <strong>de</strong>s répertoires et <strong>de</strong> nombreuses illustrations.Sa sortie en mars 1999 a coïncidé avec le lancement <strong>de</strong>s cérémoniesdu vingt-slx!ème centenaire <strong>de</strong> Marseille.
10 Militantes marseillaisesdroit) <strong>de</strong> concourir à la fonnation <strong>de</strong>s lois. en excluant les femmes dudroit <strong>de</strong> cité ".2Au même moment dans les milieux populaires. <strong>de</strong>s femmes entrenten masse dans les usines et les ateliers pour y travailler comme <strong>de</strong>shommes contre un salaire <strong>de</strong>ux fois moindre; d'autres. plusfavori sées. accè<strong>de</strong>nt à l'enseignement primaire supérieur ou secondaire.investissent les métiers du tertiaire (employées. enseignantes.<strong>de</strong>moiselles <strong>de</strong>s postes • ...) ; quelques unes. les . premières ".pénètrent les cita<strong>de</strong>lles masculines du droit. <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine. <strong>de</strong> l'enseignementsupérieur. Certaines d'entre elles prennent alorsconscience du décalage entre le rôle qu'elles tiennent dans la production<strong>de</strong>s biens ou <strong>de</strong>s services et la place qui leur est assignée dans lasociété. De ces contradictions naissent le désir et la possibilité <strong>de</strong>combattre la misère <strong>de</strong>s unes ou les injustices dont toutes sont victimes.Une soixantaine <strong>de</strong> militantes ont pu faire l'objet <strong>de</strong> notices. Biend'autres auraient cependant mérité <strong>de</strong> figurer à côté d'elles. mais ellessont restées dans l'ombre en raison du caractère trop fragmentaire<strong>de</strong>s sources. En dépit <strong>de</strong> ces lacunes il est cependant possible <strong>de</strong>brosser une typologie <strong>de</strong> ces Marseillaises et <strong>de</strong> dégager quelquesitinéraires exemplaires.Au cœur du socialConséquence <strong>de</strong> la révolution <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> production. <strong>de</strong> la pauvretéqu'elle engendre et <strong>de</strong>s premiêres tentatives d'organisation dansle mon<strong>de</strong> du travail. quelques pionnières s'engagent dans le syndicalisme3 • Ouvrières <strong>de</strong> la manufacture <strong>de</strong>s tabacs ou <strong>de</strong> l'imprimerie.tailleuses. couturières. lingères. puis sténodactylos et institutrices.elles représentent divers courants <strong>de</strong> pensée.Certaines. comme Caroline Amblard. participent au mouvementanarchiste. D'autres. telle Louise Tardif. interviennent commedéléguées à • l'immortel congrès . socialiste <strong>de</strong> Marseille (1879). où lemouvement ouvrier français définit son idéologie collectiviste et satactique <strong>de</strong> lutte <strong>de</strong>s classes. D'autres encore sont à l'origine au début2. CONDORCET • • Sur l'admission <strong>de</strong>s femmes au droit <strong>de</strong> cité '. 3.07. 1 790.3. Le travail sur les syndicalistes et sur plusieurs militantes politiques a étémené. au sein <strong>de</strong> l'équipe. par Huguette Vidalou-Latreille.
Eliane RichardIldu xxe siècle <strong>de</strong>s premiers syndicats chrétiens comme Claire Pouja<strong>de</strong>et Ma<strong>de</strong>leine Simon.Leur engagement au service <strong>de</strong> la condition ouvrière fait aussiprendre conscience à certaines <strong>de</strong> la double oppression dont lesfemmes sont l'objet : leurs interventions prennent alors un ton ouvertementfé ministe 4 • Dans un congrès <strong>de</strong> la CGT, Elisa Augier exposeque . la femme souffre plus que l'homme <strong>de</strong> l'exploitation capitaliste etqu'elle reste jusqu'au sein même <strong>de</strong>s syndicats un objet <strong>de</strong> préjugés ».En 1892, Marie Jay déclare à la tribune que . la femme ne doit pasêtre considérée comme une esclave ni une domestique et qu'il fautque par son travail, elle puisse avoir son indépendance». Quant àSuzanne Durand, une <strong>de</strong>s fo ndatrices <strong>de</strong> la Mutuelle Générale <strong>de</strong>l'Education Nationale (MGENJ, elle écrit en 1928 : • Nous ne voulonspas que la femme représentant une valeur sociale égale à celle <strong>de</strong> soncompagnon (... J, soit sa subordonnée et soit traitée en accessoire parles lois et par les mœurs ».Ouvriers et ouvrières, qui trouvent <strong>de</strong>s porte-parole au sein même<strong>de</strong> leur groupe, <strong>de</strong>viennent aussi un objet <strong>de</strong> préoccupations pour lesphilanthropes et. à la fin du siècle, pour les politiques municipale etétatique. Le milieu bourgeois et aristocratique, pépinière traditionnelle<strong>de</strong> dames patronnesses, constitue alors un réservoir <strong>de</strong> jeunesfemmes déjà expertes dans le domaine social et prêtes à s'investir.Elles sont trop nombreuses pour être citées toutes, il faut se limiteraux plus représentatives. Habituées <strong>de</strong> longue date à gérer leurs propresœuvres, les protestantes sont en première ligne. EugénieFraissinet et Ernestine Schloesing, comme beaucoup <strong>de</strong> leurs coréliglonnaires,s'engagent dans une vaste campagne <strong>de</strong> protection et <strong>de</strong>moralisation <strong>de</strong>s milieux défavorisés : animatrices <strong>de</strong> la Ligue française<strong>de</strong> Moralité publique, elles luttent contre l'alcoolisme (la CroiXbleueJ et la prostitution (Refuge CrittentonJ, encadrent les loisirs <strong>de</strong>sjeunes, envoient <strong>de</strong>s enfants à la montagne.Dans le sillage <strong>de</strong> l'Encyclique Rerum novarum, le catholicismesocial, soucieux . d'aller au peuple », fa it aussi <strong>de</strong>s a<strong>de</strong>ptes commeRose Debor<strong>de</strong>s ou Anne-Marie <strong>de</strong> Demandolx-Dedons. Issue <strong>de</strong> laplus haute société marseillaise, cette <strong>de</strong>rnière se lance à corps perdudans la reconquête <strong>de</strong> la classe ouvrière. Après avoir animé une4. Sur ces femmes et leur participation : E. RICHARD, • Femmes et politiquedans la France méditerranéenne ". Femmes et politique autour <strong>de</strong> laMédüerranée. L'Harmattan. 1980.
12 MUitantes marseUlaiseséquipe sociale dans la région parisienne, fo ndé en Nonnandie unemaison <strong>de</strong> repos pour les ouvrières <strong>de</strong> la couture, mis en place auniveau national le scoutisme féminin, elle revient à Marseille en 1934pour y diriger une Ecole nonnale sociale et. en 1937, l'Office central<strong>de</strong>s Œuvres <strong>de</strong> bienfaisance et d'entrai<strong>de</strong>. Puis, seule femme à siégerau Comité <strong>de</strong>s Œuvres <strong>de</strong> guerre, elle y organise le travail à domicilepour procurer <strong>de</strong>s ressources aux fe mmes seules et y met en place leservice du ravitaillement S .Les dames israélites ne sont pas en reste. L'Union <strong>de</strong>s femmes juives<strong>de</strong> France dès 1927, puis la Wlzo vers la fin <strong>de</strong>s années 1930, semobilisent dans <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s actions philanthropiques en faveur <strong>de</strong>simmigrées juives en Palestine, qui sont dans le besoin. Ce souci d'entrai<strong>de</strong>féminine et l'option résolument sioniste <strong>de</strong> ces mouvementsdonnent à leur militantisme social une connotation un peu particulièrequi les apparente à d'autres formes d'engagement.La cause <strong>de</strong>s femmesA l'avant-gar<strong>de</strong> du féminisme, la Marseillaise Olympe Audouard,épouse d'un notaire dont elle ne tar<strong>de</strong> pas à se séparer, fe mme <strong>de</strong>lettres, journaliste, conférencière, revendique dès les années 1860 lareconnaissance <strong>de</strong>s droits civils <strong>de</strong>s femmes. De méme, sous laCommune, Arman<strong>de</strong> Bessières et le petit groupe <strong>de</strong> journalistes duDevoir. appellent à la solidarité entre femmes et tentent <strong>de</strong> créer uneimprimerie <strong>de</strong>s dames: en vain. Sur leurs traces, les féministes s'organisentau début du XX· siècle et s'engagent dans une lutte quis'élargit aux domaines éducatif, économique et politique, Des travauxrécents ont permis <strong>de</strong> les repérer et <strong>de</strong> mettre en lumière l'importancedu mouvement à Marseille dans l'entre-<strong>de</strong>ux-guerres 6 •A l'origine et à la téte <strong>de</strong>s principales associations, <strong>de</strong>s bourgeoisescomme Eugénie Fraissinet et Agnès <strong>de</strong> Jessé-Charleval, respectivementpremières prési<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>s sections marseillaises <strong>de</strong> l'UnionFrançaise pour le Suffrage <strong>de</strong>s Femmes (UFSF) et <strong>de</strong> l'Union Nationalepour le Vote <strong>de</strong>s Femmes (UNVF) ou Edith Naegely, co-fondatrice etmilitante active <strong>de</strong> l'Entrai<strong>de</strong> féminine et Ernestine Schloesing,5. E, RICHARD • • Destins parallèles., Marseille. n° 166. 1993.6. A. MASSON, • Le fèminisme marseillais <strong>de</strong> 1913 à 1940·. Provencehistorique, nO 186. 1996.
Eliane Richard 13fondatrice <strong>de</strong> la section marseillaise du Conseil National <strong>de</strong>s FemmesFrançaises (CNFF) dont elle assume aussi la prési<strong>de</strong>nce nationale.Le barreau et renseignement fournissent également leur lot <strong>de</strong>femmes engagées. Parmi elles, on remarque les <strong>de</strong>ux premières avocatesmarseillaises, Marguerite Isnard puis sa sœur Marie-ThérèseBruel-Isnard, qui <strong>de</strong>vient secrétaire générale <strong>de</strong> la Ligue Françaisepour le Droit <strong>de</strong>s Femmes (LFDF) , ainsi que Germaine PoinsoChapuis 7 • Citons aussi Marguerite Angles-Peyrega, inspectricegénérale <strong>de</strong>s écoles maternelles, fondatrice à Marseille <strong>de</strong> l'Entrai<strong>de</strong>féminine et <strong>de</strong> l'Union Féminine pour la Société <strong>de</strong>s Nations, collaboratrice<strong>de</strong> La Française, membre du comité central <strong>de</strong> l'UFSF ; MarieAntoine, directrice <strong>de</strong> l'Ecole pratique <strong>de</strong> jeunes filles puis inspectricegénérale <strong>de</strong> l'enseignement technique, prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la section locale<strong>de</strong> la LFDF et du Comité d'entente suffragiste mis en place à Marseilleen 1928 ; Joséphine Collombel-Pagnol, directrice d'école primairesupérieure, très active dans <strong>de</strong> nombreuses associations féministes:Laure Jullien-Beddouckh, professeur <strong>de</strong> sténodactylographie dansdivers établissements privés ou publics, fondatIice <strong>de</strong> la section locale<strong>de</strong> l'UFSF, secrétaire générale <strong>de</strong> la Fédération Féministe du Midi(FFM), co-fondatrice, à l'initiative <strong>de</strong> Ripa <strong>de</strong> Roveredo, du SoroptimistClub <strong>de</strong> Marseille et qui signe régulièrement les. Feuillets féministes .du Petü Provençal B •Plus <strong>de</strong> 130 Marseillaises ont été ainsi répertoriées comme féministesactives dans l'entre-<strong>de</strong>ux-guerres, sur le terrain, dans les Instanceslocales et, pour quelques unes, au niveau national. Leur traces'étant souvent perdue, moins <strong>de</strong> 20% d'entre elles ont pu faire l'objet<strong>de</strong> notices dans le dictionnaire.Leurs biographies montrent qu'elles viennent d'horizons idéologiquestrès divers, du socialisme comme <strong>de</strong>s mouvances radicale,modérée ou conservatIice. Issues pour la plupart <strong>de</strong> mouvementsassociatifs, catholiques, protestantes, juives, laïques se retrouventautour <strong>de</strong> quelques thèmes fédérateurs, au premier rang <strong>de</strong>squels larevendication suffragiste. En 1935, le Comité d'entente suffragiste,regrou pant. entre autres, les trois gran<strong>de</strong>s associations féministesprésentes à Marseille, UFSF, LFDF, UNVF met sur pied . une gran<strong>de</strong>7. Germaine Polnso-Chapuis, personnalité <strong>de</strong> premier plan, fait l'objet d'unarticle dans ce même numéro <strong>de</strong> Sextant8. F. BERCEOT, • Laure Beddouckh et la naissance du Soroptimist-Club <strong>de</strong>Marseille ", Marseille, n° 166, 1993.
14 MUüantes marseillaisesconsultation populaire <strong>de</strong> femmes sous la forme d'un vote symbolique", en parallèle aux élections légales : 28,297 femmes déposentleur bulletin dans les urnes <strong>de</strong> plusieurs bureaux <strong>de</strong> vote,Ce résultat témoigne du travail accompli par les militantes <strong>de</strong>puisplus d'une décennie, Des actions d'éducation à la pratique du suffrageet <strong>de</strong> sensibilisation à l'enjeu que représente le bulletin <strong>de</strong> vote ont eneffet été menées par les féministes au sein <strong>de</strong> plusieurs associations,qu'il s'agisse <strong>de</strong> l'Entrai<strong>de</strong> Jémininifl animée surtout par <strong>de</strong>s protestantesou <strong>de</strong> l'Union Jéminine civique et sociale plus marquée par lecatholicisme. Les mouvements féministes ont donc, pour certaines,accompagné ou au moins préparé leur engagement dans la vie politique.Actions citoyennesAvant même d'accé<strong>de</strong>r au droit <strong>de</strong> vote, <strong>de</strong>s femmes se mobilisent,au cours <strong>de</strong>s années 1930, dans les comités contre la guerre oucontre le fascisme. dans l'ai<strong>de</strong> aux républicains espagnols et aussidans les partis politiques. comme Germaine Poinso-Chapuis au PDP,Benjamine Esdra aux Femmes socialistes. Simone Eynard au Particommuniste.Proches du terrain. elles militent à <strong>de</strong>s niveaux divers. encommençant par <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> quartier. Lors du Front populaire, lesgran<strong>de</strong>s grèves font sortir <strong>de</strong> l'ombre quelques figures féminines quiaffirment <strong>de</strong> fortes convictions politiques - mais la plupart retombentvite dans l'anonymat. Certaines. au contraire. <strong>de</strong>viennent emblématiques:la communiste Agnès Dumay. tuée à Madrid pendant la guerred'Espagne. est présentée comme la Passionaria marseillaise. Quelquesfutures responsables politiques font alors leur apprentissage.La guerre accélère le processus, Des Marseillaises font <strong>de</strong> laRésistance 10, Héberger. cacher. nourrir. secourir. fût-ce au péril <strong>de</strong> savie. voilà bien un travail <strong>de</strong> femmes. que beaucoup acceptent. parceque c'est normal 1.André Salomon et les Oséennes s'occupent <strong>de</strong>sinternés dans les camps. plus particulièrement <strong>de</strong>s enfants. et organisent<strong>de</strong>s filières d'évasion. Certaines sont agents <strong>de</strong> liaison: moins9, E. RICHARD • • Trente ans au service <strong>de</strong>s femmes : l'Entrai<strong>de</strong> féminine <strong>de</strong>Marseille, 11915-1945) ". Marseille, nO 166. 1993.10. E. RICHARD . • Elles aussi. .. ". Marseille. n0 172. 1994.
Eliane Richard. 15suspectes. moins contrôlées. elles font « ce que les hommes ne pouvaientpas faire -,D'autres s'organisent en comités <strong>de</strong> ménagères qui appellent àmanifester: le 1er juillet 1944. <strong>de</strong>ux d'entre elles tombent sous lesballes du PPF, Moins présentes que les hommes dans les actions <strong>de</strong>type m1l1taire. sans en être totalement absentes. beaucoup restentinconnues, Quelques unes pourtant sont investies <strong>de</strong> hautes responsabilités: Berthie Albrecht. co-fondatrice du mouvement Combat.Ma<strong>de</strong>leine Fourca<strong>de</strong>. organisatrice du réseau Alliance, Quelques victimesont laissé leurs noms sur les plaques <strong>de</strong>s rues. Mireille Lauze.Joséphine Roussel. Fifi Turin,La France libérée. les femmes <strong>de</strong>venues électrices et éligibles. plusieurs<strong>de</strong> ces m1l1tantes se retrouvent à la municipalité, Certainessont élues députées comme Yvonne Estachy et Irène Laure oumembre du Conseil <strong>de</strong> la République comme Mireille Dumont. En1947. la première Française ministre à part entière est une Marseillaise: Germaine Poinso-Chapuis,Ces femmes politiques sont-elles encore <strong>de</strong>s m!litantes ? Oui. sil'on considère que l'accès à « la cité interdite - nécessite <strong>de</strong> livrer unnouveau combat dont la dureté ne le cè<strong>de</strong> en rien aux luttes anciennes: les déboires <strong>de</strong> la première ministre <strong>de</strong> la Santé et <strong>de</strong> la Populationen sont un bon exemple, Aujourd'hui. la bataille n'est toujourspas gagnée,Tenues à l'écart <strong>de</strong>s sanctuaires masculins. les Marseillaisessoucieuses d'engagement citoyen se replient sur les mouvementsassociatifs. qui continuent d'être pour elles l'école <strong>de</strong> la vie publique.un moyen d'action. un contre-pouvoir, La vitalité. la diversité. l'efficacité<strong>de</strong>s associations féminines <strong>de</strong> Marseille ont été déjà mises enévi<strong>de</strong>nce Il ,Le dictionnaire s'en fait l'écho à travers quelques itinéraires<strong>de</strong> femmes remarquables dont les initiatives. reprises ensuite parles pouvoirs publics. ont un écho durable : celui <strong>de</strong> la journalisteMaguy Roubaud. à l'origine <strong>de</strong> la campagne du Blé <strong>de</strong> l'Espérance auprofit <strong>de</strong>s enfants hospitalisés ; celui <strong>de</strong> Monique Gallician. premièrefemme à prési<strong>de</strong>r la Confédération générale <strong>de</strong>s comités d'intérêts <strong>de</strong>quartiers. qui a mené - et en partie gagné - le combat contre les nuisancesd'une roca<strong>de</strong> urbaine; celui <strong>de</strong> Mam'Ega. Marseillaise d'origineantillaise. dont l'action sociale. culturelle. sportive dans un quartier11. LesJemmes et la l!Ule, W1 enjeu pour l'Europe, Labor. <strong>Bruxelles</strong>. 1993,
16 Militantes marseillaises« difficile. <strong>de</strong> la ville est emblématique <strong>de</strong> la façon dont s'exprime unecitoyenneté au féminin,De tels exemples ne sont pas isolés, De méme. les nouvelles féministes<strong>de</strong>s années 1970 assument. dans un style différent. le relais<strong>de</strong>s anciennes. Seul. le parti pris <strong>de</strong>s historiennes <strong>de</strong> n'introduiredans le dictionnaire que <strong>de</strong>s personnes décédées prive celui-ci <strong>de</strong> cettenouvelle génération <strong>de</strong> militantes. Mais la relève est assurée.Ainsi. <strong>de</strong>puis un siècle et <strong>de</strong>mi. <strong>de</strong>s Marseillaises <strong>de</strong> toutes origines.seules ou en groupe. s·engagent dans <strong>de</strong>s actions militantes auservice <strong>de</strong> tout ou partie <strong>de</strong> la collectivité. Elles le font bénévolement.quel que soit le milieu auquel elles appartiennent. qu'elles soientintégrées on non au mon<strong>de</strong> du travail.Pour toutes. c'est une ouverture sur l'extérieur; elles acquièrentpar là une dimension politique. De la masse <strong>de</strong>s m1l1tantes. seulesquelques unes échappent à l'anonymat. La plupart s'investissent.conjointement ou successivement. dans plusieurs domaines. Toutesles combinaisons sont possibles: syndicalisme ou action sociale etféminisme avec parfois <strong>de</strong>s prolongements dans la Résistance etméme dans la politique. De ce point <strong>de</strong> vue aussi. l'Itinéraire <strong>de</strong>Germaine Polnso-Chapuis est exemplaire. Comme elle. quelques personnalités<strong>de</strong> tout premier plan ont contribué autant que les hommes.par leurs actions ou leurs créations. à construire la cité.
Beatrice Barbalato 17Eléonore <strong>de</strong> Fonseca PimentelPoète et révolutionnaire1752-1799Beatrice BarbalatoNap1es, Ù1conscience et cou1eur,une vague d'antiquité, mais aussi<strong>de</strong> choses jeunes qui s'écou1ent.avec angoisse,au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> l'antiquité!Une figure actuelleEn se promenant aujourd'hui dans Naples, on voit partout <strong>de</strong>slivres, <strong>de</strong>s spectacles, <strong>de</strong>s conférences qui traitent d'Eleonora <strong>de</strong>Fonseca Pimentel. On a le sentiment qu'Eléonore est là dans la ville,on ressent son i<strong>de</strong>ntité forte et omniprésente: Naples, une ville où lesfemmes occupent une place tout à fait particulière, Un « matriarcat.qui, pour le meilleur ou pour le pire, n'aurait jamais cessé d'exister ...En Janvier 1999, le directeur du Conservatoire <strong>de</strong> Musique <strong>de</strong>Naples, l'ethnomusicologue réputé Roberto De Simone, met en scèneau théâtre <strong>de</strong> l'Opéra San Carlo une pièce, E1eonora, qui rappelle lesupplice d'Eléonore <strong>de</strong> Fonseca Pimente l, <strong>de</strong>ux cents ans plus tôt.l.A. M. ORTESE, Il mare non bagna Napoli, 1967.
Beatrice Barbalato 19Dans cette version contemporaine. l'actrice Vanessa Redgrave prêteson visage et son talent à celle qui fut considérée comme uneestrrulgeirada2 - et son accent anglais symbolise et accentue lecosmopolitisme qui caractérisa Eléonore <strong>de</strong> Fonseca,Roberto De Simone est surtout connu pour une œuvre La GattaCenerentola (1974 ) qui traduit en musique populaire napolitaine duXVIII" siècle une version méridionale <strong>de</strong> la fable d'une très méchanteCendrillon, Avec Eleonora. le Maestro a choisi <strong>de</strong> ne pas célébrer laRépublique napolitaine <strong>de</strong> 1799 en tant que telle mais plutôt <strong>de</strong> fairerevivre <strong>de</strong>s paroles déjà prononcées et une musique 1 déjà composéeà Naples au XVIII" siécle. à assumer exclusivement comme inertematière <strong>de</strong> langage. comme assertion méta-historique. à laquelle 11s'agit <strong>de</strong> donner une problématique et un style contemporains .3, C'estdans ce but que De Simone utilise la splendi<strong>de</strong> musique napolitainedu XVIIIe siécle et fait Intervenir une panoplie <strong>de</strong> volx <strong>de</strong> condamnés àmort <strong>de</strong> la résistance. <strong>de</strong> Pasolini. <strong>de</strong> Brecht. <strong>de</strong> Tolstoï. <strong>de</strong> Maïakovski- <strong>de</strong>s milliers <strong>de</strong> martyrs pour la liberté, Un chœur qui universalise labiographie d'Eléonore,Auparavant déjà. sa mémoire avait insplrè un roman. n resto diniente. <strong>de</strong> Enzo Striano. malheureusement décédé l'année même <strong>de</strong> lapublication. en 1987, Cet ouvrage retrace le parcours d'Eléonore. enrappelant grosso modo tous les événements historiques, De manièretout à fait inattendue. 11 remporta un vif succès et connut plusieurséditions, Eléonore y est présentée dans toute la complexité <strong>de</strong> sesrapports avec la Cour. dans la richesse <strong>de</strong> ses relations avec leshommes: elle apparaît avec toute la tendresse et la sensibilité d'unepersonnalité à facettes multiples. mais qui. toutes. sont fortementancrées au noyau dur d'un caractère incorruptible et surtoutindépendant. Elle ne s'est Jamais privée <strong>de</strong> critiquer toute sujétion.quelle qu'elle soit. qu'elle concerne la politique, la langue ou plus simplementles coutumes: 1 (..,) la température est douce et. malgréqu'on soit entré dans le mols <strong>de</strong> ventôse. dans la ville ne vole pas unsouffle: peut être qu'Ici 11 faudrait changer le calendrier républicain.2. L'expression est utilisée par Franco Venturi dans Settecento rifonnatore ,Einaudi, Torlno, 1976: lors <strong>de</strong> sa condamnation à mort Eleonora avait<strong>de</strong>mandé d'étre guillotinée en tant que noble. Le juge avait répondu qu'elle étaitnoble mais au Portugal. et qu'à Naples elle était étrangére.3. R DE SIMONE, 1 La mla marUre IIbera -Come per Pasolini: la morte unattro rivoluzlonarto " La repubblica. 23 décembre 1998.
20 Une poète et révolutionnaire napolüainequi est né en France, où le climat est différent .4 pense l'Eleonora <strong>de</strong>Striano à propos <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s françaises.Toute une myria<strong>de</strong> <strong>de</strong> figures mineures nous rapproche <strong>de</strong>l'époque. C'est un vrai roman populaire épique, un portrait <strong>de</strong> Naples- une ville qui ne cesse jamais <strong>de</strong> nous surprendre 5 •n y a <strong>de</strong>ux siècles : La République parthénopéenneLa République parthénopéenne naît officiellement avec l'entrée àNaples, le 23 janvier 1799, <strong>de</strong>s troupes françaises commandées par legénéral Charnpionnet6•Si le royaume avait connu quelques réfonnes <strong>de</strong> <strong>de</strong>spotisme éclairésous le ministère du Toscan Tanuccf, celui-ci avait été renvoyé parl'épouse du roi Ferdinand IV, l'énergique Marie Caroline d'Autriche,sœur <strong>de</strong> Marte Antoinette, qui avait pris <strong>de</strong> l'ascendant sur son épouxet dirigeait elle-même. Les adversaires <strong>de</strong> ces pratiques absolutistes -une élite <strong>de</strong> nobles et d'avocats - avaient fonné <strong>de</strong>puis longtemps uncercle <strong>de</strong> réfonnateurs opposés aux Bourbons. Ils se caractérisaientpar leur esprit idéaliste, leur tendance à l'emphase et aussi par uneextraordinaire confiance dans une plèbe qui, pourtant, à plusieursreprises, avait bel et bien montré son amour inconditionnel pour lesprinces. C'était surtout le fanatisme religieux du peuple qui pennettaità la monarchie <strong>de</strong> le manœuvrer selon son plaisir.4. E. STRIANO, Il resta di nlente, Avagliano. Napoli, 1987. p. 325.5 De nombreux hlsoriens. <strong>de</strong> J. Michelet à A. Gramsci. ont écrit sur cettepério<strong>de</strong> <strong>de</strong> "histoire <strong>de</strong> Naples. Des écrivains également. comme Goethe.Stendhal, Sa<strong>de</strong> ; <strong>de</strong>s protagonistes comme le général Championnet. Méme siles Bourbons ont ordonné <strong>de</strong> détruire tous les mémoires <strong>de</strong> patriotes. unImportant patrimoine bibliographique est resté Intact dans les actes <strong>de</strong>sprocès. ou <strong>de</strong>s témoignages d'exilés. Une vaste bibliographie existe égalementsur Eléonore <strong>de</strong> Fonseca Pimente!. Nous ne reprenons ici que les textes cités.6. Jean-Antoine-Etienne Championnet (1762-18001 républicain convaincu, quis'était déjà illustré dans l'armée <strong>de</strong> Jourdan à Fleurus. et qui mena victorieusementles campagnes <strong>de</strong> Hollan<strong>de</strong> et d'Italie. On pourra consulter sur cesévénements: E. PRECLIN et V.L. TAPIE . • Les états italiens . Le XVIIIe siècle.1ère partie. La France et le Mon<strong>de</strong>. Coll. Clio. PUF. Paris. pp. 233-234; R.BOUVIER et A. LAFFARGUE. La vie napolitaine du XVIIIe siècle. Paris. Hachette,1956. pp. 313-340 et surtout V. GLEIJESES. La Storia <strong>de</strong> Napoli dalleorigini ai giorni nostrt, Ed. Alfonso d'Aragona, vol. II, 1996 (notammentpp. 1144-11511.7. Telles que l'abolition <strong>de</strong> l'Ordre <strong>de</strong>s Jésuites (17671. la suppression <strong>de</strong>s privilèges<strong>de</strong>s membres napolitains <strong>de</strong>s congrégations romaines et rétablissementdu mariage civil (17701.
Beatrice Barbalato 21En revanche, les réformateurs, idéologiquement non violents etpétris <strong>de</strong> théories <strong>de</strong>s Lumières, furent victimes <strong>de</strong> leur espritd'abstraction en imaginant comme possibles un rapi<strong>de</strong> changement etune prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> cette plèbe, qui n'était ni une classe ni unpeuple, dans une ville où <strong>de</strong>puis toujours une classe moyenne faisaitdéfauLDans le chagrin <strong>de</strong> l'exil, l'un <strong>de</strong> ces patriotes, Vincenzo Cuoco adécrit fort luci<strong>de</strong>ment cette erreur: • On renversa l'ordre, et on voulutgagner les esprits <strong>de</strong> beaucoup <strong>de</strong> mon<strong>de</strong>, en présentant <strong>de</strong>s idéesqui étaient les idées <strong>de</strong> quelques-uns, Qu'espérer <strong>de</strong> ce langage tenudans toutes les proclamations adressées au peuple? 'Finalement vousêtes libres,.: Mais le peuple ne savait pas encore ce qu'était la liberté:la liberté est un sentiment et non une idée, on l'expérimente par <strong>de</strong>sactes, elle ne se démontre pas avec <strong>de</strong>s mots ... 'Votre Clau<strong>de</strong> s'estenfui, Messaline tremble .. .' Le peuple était-il obligé <strong>de</strong> connaîtrel'histoire romaine pour connaître son bonheur? L'homme reconquierttous ses droits. Mais lesquels? .8Vincenzo Cuoco ne pouvait qu'être pessimiste. Il avait vu sescamara<strong>de</strong>s exécutés ou exilés, avant <strong>de</strong> fuir lui-même à Marseille. Demémoire, il commença à écrire son Saggio storico sulla rivoluzione diNapoli <strong>de</strong>I 1799, une œuvre historique, importante tant par le fondque par la forme. Mais tout l'ouvrage est traversé du sentiment <strong>de</strong> ladéfaite. L'auteur souligne le côté théorique et abstrait <strong>de</strong> ces réformateurs.leur manque <strong>de</strong> connaissance concrète du peuple: • A propos<strong>de</strong> nos patriotes. qu'il nous soit permis une expression qui convient àtoutes les révolutions et qui n'offense pas les bons: beaucoup <strong>de</strong> personnesavaient la République sur les lèvres, Beaucoup dans la tête,quelques-uns seulement l'avaient dans le cœur .9.Goethe. qui avait séjourné à Naples entre 1786 et 1787 avait aussiévoqué ce cercle <strong>de</strong> Jeunes nobles idéalistes dans son Voyage en Italie,Bene<strong>de</strong>tto Croce a dédié plusieurs ouvrages à cette Républiqueparthénopéenne,Les Bourbons remontèrent sur le trône dès Juin 1799, avec l'ai<strong>de</strong><strong>de</strong>s Sanfédistes'o, Le roi Ferdinand IV laissa carte blanche à Nelson,8. V. CUOCO, Saggio stonco sulla Rivoluzione di NapoU <strong>de</strong>I 1799. (1801) GenerosoProcaccini edit .. Napoli 1995. p. 1409. Ibi<strong>de</strong>m. p. 128.10. Hommes du peuple qui pour défendre la • Santa Fe<strong>de</strong> • (Sainte Foil avaientlutté contre les Français et les Jacobins napolitains. Ils étaient organisés par
22 Une poète et révolutionnaire napolitaineson allié contre les Français, et la répression fut terrible. La vengeanceenvers les patriotes qui avaient soutenu les Français fut sans pitié, il Yeut plus <strong>de</strong> 300 exécutions. A ce propos, Bene<strong>de</strong>tto Croce écrit: Lamonarchie restaurée dit et redit, dans ses conciliabules avec sesfidèles, que seule la plèbe ne l'avait pas trahie ( ... ). Avec la classecultivée, la rupture était complète; et, du reste, durant les premierstemps <strong>de</strong> la restauration, à Naples, 11 n'y avait plus <strong>de</strong> classecultivée. Courier écrivit avec un humour macabre que le roi <strong>de</strong> Naplesavait Ja it pendre toute son Académie; ce qui survivait était dans lesprisons ou dispersé en Italie ou en France.lI•La reine Marte Caroline avait été en partie l'artisane <strong>de</strong> ce massacre:encore en 1805, eUe affirmait à Madame <strong>de</strong> Staël que les rapportsentre la monarchie et les Napolitains étaient pour toujours compromisl2•Après ces événements, seules les personnes les plus ignorantes oules plus aveugles avaient continué à fréquenter la monarchie . • A ungentilhomme qui se vantait <strong>de</strong> n'avoir eu aucune charge pendant lapério<strong>de</strong> française, Polichinelle, la marionnette napolitaine qui ne manquejamais d'asséner <strong>de</strong>s vérités, répondit 'ils avaient dû le reconnaîtrepour un grand àne 1 l' .13. Croce rappelle que c'est à partir <strong>de</strong>ce moment que Borbonico et ignorant sont <strong>de</strong>venus synonymes.Cette pério<strong>de</strong> néfaste fut suivie par une série <strong>de</strong> changementsculturels. Un théâtre plus policé fut encouragé, <strong>de</strong> même que <strong>de</strong>schansons plus anodines. Même la monarchie semblait redouter laférocité <strong>de</strong> la plèbe napolitaine. Les chansons romantiques napolitaineset le théâtre, <strong>de</strong> Scarpetta jusqu'à Eduardo <strong>de</strong> Filippo, sontl'expression à long terme <strong>de</strong> cette nouvelle ligne culturelle. 14Deux siècles ont passé. Pourquoi Eléonore et les autres militants<strong>de</strong> la République napolitaine continuent-ils à fasciner, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>sl"entourage du Roi qui avait été obligé d'abandonner Naples à l"arrlvée <strong>de</strong>sFrançais.Il. Lettre <strong>de</strong> Paul-Louis Courier (I772-1825) à M eUe Clavier. Lucerne, le 30août1809 (Œuvres. Paris. 1877) cité dans B.CROCE. Storia <strong>de</strong>I Regno di Napoli.Laterza. Bari. 1931. pp. 232-233. Passionné par l1talle et sa culture. PaulLouis Courrier les a largement décrites dans sa correspondance.12. B. CROCE. La signora di Stael e la regma Carolma di Napoli. dans 'Uomlnl ecose <strong>de</strong>lla vecchia Italla', Il. pp 182-92.13. B. CROCE. Storia <strong>de</strong>I regno ... . p. 233.14. Lire à ce propos la préface <strong>de</strong> V. Monaco Eduardo Scarpetta:un riformatore?dans Eduardo Scarpetta :Miseria e Nobiltà e altre commedie. GuidaEdltore. Napoll. 1980.
Beatrice Barbalato 23convictions politiques? 1 Lorsque la monarchie commença à décliner.les Jacobins. - ou plutôt les ·patrtotes·. comme on les appelait - quiavaient connu matériellement le pire et avaient vu leurs rangs sedécimer <strong>de</strong> manière épouvantable. grandirent en vigueur spirituelle eten maturité Intellectuelle. Ils avaient leur histoire. riche <strong>de</strong> gloires etdouleurs. et un martyrologe sinon <strong>de</strong> saints. au moins 'd'hommes <strong>de</strong>Plutarque' ... • 15.D'une manière générale. les femmes ont Joué un rôle Important lors<strong>de</strong>s événements: à coté d'Eléonore. on trouve une multitu<strong>de</strong>d'héroïnes importantes appartenant à différentes couches sociales. Lesplus connues sont Luisa Sanfelice une 1 martyre involontaire. tréscélèbre sur laquelle Alexandre Dumas a beaucoup écrie6; GiuliaCarafa. duchesse <strong>de</strong> Cassano; Mariantonia Carafa. duchesse <strong>de</strong>Popoli ; Margherita Nardinl. oratrtce <strong>de</strong> la Salle Patrtotique ; FranceschinaRenner; la femme du peuple Vittoria Pellegrini .... et beaucoupd'autres.Mais Eléonore <strong>de</strong>meure sans aucun doute la figure dominante.personnalité étonnante à qui Voltaire dédia un bref poème qui débutepar 1 Beau Rossignol <strong>de</strong> la belle Italie .... 17. Une personnalité hors ducommun à propos <strong>de</strong> qui Alexandre Dumas écrivait: 1 elle étaitpoétesse. musicienne et passionnée <strong>de</strong> politique; Il Y avait en ellequelque chose <strong>de</strong> la baronne <strong>de</strong> Staël. <strong>de</strong> Delphine Gay et <strong>de</strong> MadameRoland. En poésie elle était émule <strong>de</strong> Metastase. en musique <strong>de</strong>Cimarosa; en politique <strong>de</strong> Mario Pagano • 18.15, B, CROCE. Stora <strong>de</strong>l Regno .... p, 234,16. Luisa Sanfel!ce avait été condamnée à mort. Comme elle était enceinte, sonexécution fut retardée, Mais dès qu'elle eut mis son enfant au mon<strong>de</strong>. elle eutla tète tranchée, A. DUMAS père écrivit un feuilleton. Luisa SanJelice, <strong>de</strong> 1863à 1865 dans l'Indipen<strong>de</strong>nte, le journal que Giuseppe Garibaldi lui avait confié.La version française sera publiée dans La Presse en 1864- 1865. Voir aussi B.BATIAGLINI. Luisa SanJelice. Martire involontaria <strong>de</strong>lla rivoluzione napoletana.Procaccln1. Napol!. 1997.17. M.A. MACIOCCHI. Cara Eleonora. Passione e morte <strong>de</strong>lla Fonseca Pimentelnella rivoluzione napoletana. Rizzoll. Milano, 1993, p. 127; Œuvres complètes<strong>de</strong> Voltaire. Imprimerie <strong>de</strong> la société Littéraire typographique. t. XIV.Miscellanées voltair1ennes, CLXXXVI, 1785.18 Cité dans La SanJelice. Tulllo Plrontl Edltore, Napol!, 1998. p. 813.Métastase: Pierre-Bonaventure Trapassl. dit Metastase (1698- 1 782). poèteItalien né à Rome. Sa réputation fut Immense <strong>de</strong> son vivant. il était considérépar Rousseau comme le 1 poète du cœur ". Voltaire le comparait à Racine.Protégé <strong>de</strong> Marte-Thérèse. il termina ses jours à la Cour <strong>de</strong> Vienne (VOirJ. DELUMEAU. L'Italie <strong>de</strong> Boticelli à Bonaparte. Coll. U, A. Colin. Paris, 1974.pp. 310-311). Domenico Cimarosa 11749- 1801), maître <strong>de</strong> l'opéra bouffe napo-
24 Une poète et révolutionnaire napolUaineDans la révolution napolitaine. elle occupe une place à part. 1 Ilfaut être femme - écrit Marta Antonletta Maclocchl - pour comprendrecomme tout se tient en Eléonore . c'est à dire la poétesse. la Journaliste.la Jacobine. la martyre ... . 19.Eleonora <strong>de</strong> Fonseca Pimentel : une figure révolutionnaireEléonore naquit à Rome le 13 Janvier 1752. Son père. donClemente Henriquez <strong>de</strong> Fonseca Pimentel était <strong>de</strong> noblesse espagnole.sa mère. donna Caterina Lapez <strong>de</strong> Leon. d'origlne portugaise. Ellegrandit à Naples. Elle apprit très tôt le grec et le latin. et à seize ans.elle faisait partie <strong>de</strong> l'Acadamla <strong>de</strong> Filatett2° sous le nomgrandiloquent<strong>de</strong> Epolnlfenora Olcesamante. Son érudition est large: si salangue maternelle est le portugais et si ses écrits comportent <strong>de</strong> nombreusesréférences à la littérature portugaise. par exemple auxLusia<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Camoens. elle parlait et écrivait aussi bien en italienqu'en français. anglais et même en napolitain. Le poète Metastase.avec qui Eléonore entretint une correspondance très suivie <strong>de</strong> 1770 à1776. l'avait surnommée 1 la très aimable muse du Tage '.Elle se maria relativement tard. à vingt-cinq ans. en 1778. avec unhomme plus beaucoup plus âgé qu·elle. le tenent Pasquale Tria <strong>de</strong>Solis. Cette union. voulue par sa famille. la rendit malheureuse. Sonmari. dont elle se sépara. ne lui laissait aucune autonomie: ill'empêchait même <strong>de</strong> toucher à l'argent <strong>de</strong> sa dot. Pour acheterl'Encyclopédie <strong>de</strong> Di<strong>de</strong>rot elle fut obligée <strong>de</strong> Jouer au loto 1 Introduite àla Cour <strong>de</strong>s Bourbons. elle attire l'attention par sa beauté et son espritet <strong>de</strong>vient dame d'honneur <strong>de</strong> la reine. Mals elle embrasse dès 1789les principes <strong>de</strong> la révolution française. et avec enthousiasme tient unsalon qui <strong>de</strong>vient rapi<strong>de</strong>ment le lieu <strong>de</strong> ralliement <strong>de</strong> l'oppositionIitain. il jouit d'une réputation énorme dans toute l'Europe <strong>de</strong>s Lumières. fu tengagé pendant Il ans à la Cour <strong>de</strong> Russie. Rentré à Naples en 1793. il futcondamné à mort en 1799 pour avoir mis en musique un chant patriotique.Libéré à grâce à \'intervention <strong>de</strong> la Russie. il meurt peu après à Venise (J.DELUMEAU. op. ciL. pp. 266-268). Quant à Francesco Mario Pagano. il fut l'un<strong>de</strong>s plus grands juristes <strong>de</strong> son temps. également philosophe et homme <strong>de</strong>lettres. Il fu t exécuté avec les autres républicains.19. M.A MACIOCCHI. op. ciL. p. 132.20. A ce propos. voir V. GLIJESES. La. Storia. ... t. II. p. 1173. L'Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong>Filatel! (Amis <strong>de</strong> la Vérité) est un cercle culturel napolitain très proche <strong>de</strong>l'Arcadia (véritable réseau littéraire européen). Eléonore y est reçue commepoète.
Beatrice Barbalato 25libérale. Après la mort <strong>de</strong> son mari en 1795. elle se consacre à lapolitique.De son mariage naquit un fils. qu'elle perdit à l'âge <strong>de</strong> huit mois.Son chagrin fut encore accentué par les accusations <strong>de</strong> son mari quila rendait responsable <strong>de</strong> cette mort. à cause <strong>de</strong> ses idées mo<strong>de</strong>rnes etnotamment d'une hygiène qu'il estimait excessive. Ce <strong>de</strong>uil la plongeadans un chagrin qui ne la quitta jamais21:Souvent je reste assise. seuleEt les yeux lourds à pleurerJe me plonge dans mes pensées.Quand soudain proche <strong>de</strong> moiJe vois apparaître mon fils.Il plaisante. je le regar<strong>de</strong>.Et <strong>de</strong> lui je réve les habituelles caresses et le visage alabastrin.Mais comme je suis sûre <strong>de</strong> ton <strong>de</strong>stin.Je ne crois pas ce que je voisEt à la fois je tends la main et je la retire.Et je sens tout mon étre s'enflammer et tremblerJusqu'à ce qu'un sang agité reflue au cœur,La douce vision alors s'enfuit;Et sans que j'aie plaisir <strong>de</strong> l'erreur.Je déplore toujours ma vraie perte22,Le thème <strong>de</strong> l'enfant revient souvent dans ses compositions, Ainsielle écrivit une O<strong>de</strong> pour un avortement. - maternité ratée <strong>de</strong> sa vie ettoujours désirée:A l'espoir tant aiméque la cruelle Parque coupaet enfermée dans la prisontua le fruit tant attendu2321. Sola fra 1 miel pensier sovente i'segglol E gll occhl gravi lacrimarm'lnchlno/Quand'ecco ln mezzo al planto, a me vlclnol Improvvlso apparlr ilfiglio l'vegglol Egil scherza, 10 10 guato, e ln lui vaghegglol GU usatl vezzl e '1volto alabastrino :1 Ma come certa son <strong>de</strong>i tuo <strong>de</strong>stino.! Non credo agll occhl. epalpito. ed on<strong>de</strong>ggio./ Ed or la mana stendo, or la ritlro.! E accen<strong>de</strong>rsl e tremarml sento il petto/Finché Il sangue agitato al cor rifugge./ La dolce vlsloneallor sen fugge :1 E senza ch'abbia <strong>de</strong>ll'error dlletto.! La mia perdita vera ognorsospiro.22, M. BATIAGLINI. op. cit., p. 54.23. Ahl la speranza amablle parca cru<strong>de</strong>l recisel e <strong>de</strong>ntro Il chi usa carcereJ'attesa frutta ucclse) : M. BATIAGLINI. op. cil .• p. 56.
26 Une poète et réoolutionnaire napolitaineMalgré un certain maniérisme. typique <strong>de</strong> l'époque. les poésiesd'Eléonore communiquent un sentiment vrai. fort. personnel.Après la mort <strong>de</strong> son enfant. Eléonore se plongea dans <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<strong>de</strong> mathématiques et <strong>de</strong>vint l'élève du célèbre biologiste LazareSpallanzani24, Elle étudia aussi le droit et publia un traité d'économieet <strong>de</strong> droit publ1c. disparu aujourd'hui. Cependant. nous avons gardéla trace <strong>de</strong> ses réflexions dans la traduction et dans le commentaired'une œuvre du Caravita25 qui contient in nuce sa pensée juridique,1 Le pouvoir souverain n'est pas patronat. n'est pas primogéniture.n'est pas fldéicommis ni dot: le pouvoir souverain est administrationet défense <strong>de</strong>s droits publ1cs <strong>de</strong> la Nation. conservation et défense <strong>de</strong>sdroits privés <strong>de</strong> chaque citoyen ( .. ,) ,26,C'est au début <strong>de</strong> l'opposition pol1tique contre la monarchie. etprécisément après la conjuration <strong>de</strong> 1792- 1794 27 • qu'Eléonore futsuspectée par la Cour, Malgré les précautions qu'elle avait prises. ellefut arrêtée et conduite en prison en octobre 1798, Libérée en janvier1799 à l'arrivée <strong>de</strong>s troupes françaises. elle fut chargée <strong>de</strong> la rédactiondu Monitore. le journal officiel <strong>de</strong> la République,Rédactrice du MonitoreAvant d'examiner d'un peu plus <strong>de</strong> près son rôle au Monitore. quiparut du 2 févrter 1799 au 8 juin 1799, Il faut reconnaître que larévolution avait montré plus d'une faiblesse: un excessif amour pourles réunions et les discussions. une forte confiance dans l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>sFrançais et un certain narcissisme, Du reste. Eléonore traitait Ironiquement<strong>de</strong> métaphysiques, les interminables débats politiques <strong>de</strong> ses24. Lazare Spallanzanl (1729- 17991, physiologiste, un <strong>de</strong>s grands savants duXVIIle siècle, professeur à Pavie. Sa rèputatlon dans l'Europe <strong>de</strong>s Lumières futimmense, ses travaux traduits en français à Genève. 11 fu t l'un <strong>de</strong> ceux qui.avant Pasteur, contestèrent l'Idèe <strong>de</strong> la génèration spontanèe, dèmontrant clairementque les animalcules observés dans les Infusions végétales provenaient<strong>de</strong>s gennes ambiants (J. DELUMEAU, op. ciL, p. 322 et sv.).25. Niun diritto compete al Sommo PonteflCe sul Regno di NapolL Dissertazionestorico-legale <strong>de</strong>I consigliere Nicolô Caravüa. tradotta dal Latino ed illustratacon varie note (Aletopoll (Napolil 1790).26 M. BATIAGLINI, op, ciL, p. 12.27. Après l'avènement <strong>de</strong> la République française en 1792, on trouva <strong>de</strong>scopies <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong> l'homme et du citoyen lors d'une fète à laCour. Après que Roi ait reconnu le nouveau gouvernement français, les relationss'intensifiérent entre les Jacobins napolitains et les Français. Dès cemoment Eleonore se trouva SUT la liste <strong>de</strong>s suspects,
Beatrice Barbalato 27camara<strong>de</strong>s, Toutefois. Il faut souligner qu'aucun n'y défendaitd'intérét personnel.Ce qui distingua Eléonore dans la manière dont elle dirigea leMonitore fut la conception d'un genre nouveau d'Infonnation et <strong>de</strong>communication. qui répondait à la fois aux exigences du GouvernementProvisoire etévénements qui se succédaient rapi<strong>de</strong>ment.à la nécessité d'impliquer le peuple dans lesC'est ainsi qu'elle publiait une infonnation fidèlement basée sur lesactes officiels, Publier <strong>de</strong>s infonnatlons officielles sur les actes dugouvernement était obligatoire, Mals elle défendait les droits du peupleet ne se privait pas <strong>de</strong> dénoncer les faits qu'elle considérait comme <strong>de</strong>sabus. tel que le scandaleux comportement du général Rey qui voulaits'emparer <strong>de</strong>s colllers <strong>de</strong> la Toison d'or, appartenant au Trésor royal.Le général Rey menaça d'emprisonner le typographe qui avait Impriméle Journal et Eléonore infonna le Gouvernement Provisoire <strong>de</strong> soncomportement.De toute évi<strong>de</strong>nce. les révolutionnaires s'étaient bercés d'illusions:l'image <strong>de</strong> la France révolutionnaire et libératrice avait crédité lesFrançais d'une extréme confiance, Mais les patriotes napolitainsétaient mal au fait <strong>de</strong>s luttes internes qui déchiraient les révolutionnairesfrançaiS avant que Napoléon ne s'Impose,Quoi qu'Il en soit. la principale préoccupation d'Eléonore fut d'agirà chaque moment en faveur <strong>de</strong>s petites gens, et <strong>de</strong> les ai<strong>de</strong>r à découvrirleur dignité <strong>de</strong> peuple, Aussi l'information qu'elle publiait était-elleécrite dans un langage simple et d'accés facile, En tant qu'éditrice duMonitore. elle utilise déjà à la fin du XVIII" siécle une langue résolumentmo<strong>de</strong>rne et accessible à tous, alors que le XIxe slécle allait seperdre dans d'innombrables discussions pour fon<strong>de</strong>r « un italien pourtout le mon<strong>de</strong> 1 1Eléonore proposa méme <strong>de</strong> publier <strong>de</strong>s articles en dialecte napolitainafin <strong>de</strong> permettre une plus large diffusion du contenu duMonitore : «Je propose. donc, que soit fait chaque semaine. dans unelangue <strong>de</strong> la région dés lors que l'autre langue n'est pas comprise parle peuple, un petit journal qui contient la synthèse <strong>de</strong> toutes nosnouvelles et aussi <strong>de</strong>s nouvelles étrangères qui semblent Importantes;<strong>de</strong> méme que l'extrait <strong>de</strong>s lois et <strong>de</strong>s actions les plus intéressantes duGouvernement. avec toutes les explications nécessaires; que cette
Beatrice Barbalato 29Comme l'écrit Stendhal, après avoir mis à mort immédiatement legénéral Massa qui avait signé la capitulation, • on eut un plaisirparticulier à faire pendre la marquise Eleonora Fonseca Pimentel,femme remarquable par le génie et la beauté ( ... ) l'élévation <strong>de</strong> sonesprit ainsi que sa sérénité, qui ne se démentit pas <strong>de</strong>vant la mort aumilieu <strong>de</strong>s insultes obscènes <strong>de</strong>s lazzaroni, lui ont valu d'êtrecomparée à Madame Roland .31.La • mathématicienne folle . -comme l'appelait Speciale, leprési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Commission du Tribunal (très spécial !) - fut en effetrapi<strong>de</strong>ment jugée et condamnée à mort. Le 20 août 1799, au PalaisMercato, avant d'être conduite au gibet. Eleonora Fonseca Pimentel<strong>de</strong>manda un café32 et prononça ces <strong>de</strong>rnières paroles, inspirées <strong>de</strong>Virgile, le poète visionnaire à qui les Napolitains attribuent toute unesérie d'actes étonnants : .... Forsan et haec olim memlnlsse juvablt •(Peut- être qu'un jour il sera utile <strong>de</strong> se rappeler ces choses).Deux jours plus tôt, le 18 août 1799, elle était sortie <strong>de</strong> la prisonVicaria et avait été conduite à pied à travers la rue Maddalena et larue Lavinalo, entourée d'une plèbe qui l'injuriait, pour attendre lamort dans la Chapelle <strong>de</strong> l'église <strong>de</strong>s Carmes . • Elle était habillée enbrun, avec sa jupe serrée entre ses jambes.33 Le peuple à chaque exécutioncriait . Vive le roi !'. A la sortie <strong>de</strong> la Pimentel, il voulut criermals à un signe <strong>de</strong> la confrérie <strong>de</strong>s Bianchl34 il s'est tu ; lorsqu'elle esttombée, ses cris sont allés aux étoiles ( ... ) .35.La plèbe conservatrice chantait en napolitatn36 :Madame Eléonore, qui chantait sur la scène du théâtre,Danse maintenant au milieu du Marché.Vive, vive le Saint Père,31. Cité dans R BOUVIER et A. LAFF ARGUE, op. cil . . p. 336.32. En souvenir sans doute <strong>de</strong>s premiers moments où elle arriva à Naples. etoù elle découvrit un véritable rite : la préparation du café.33. Elle se tenait la Jupe entre les Jambes. car elle avait été déshabillée. et bienqu'elle ait <strong>de</strong>mandé une culotte pour ne pas ètre vue nue après sa pendaison ,on la lui avait refusée pour J'humilier.34. Les Blanchi étaient une confrérie qui accompagnait les condamnés à mort.Ils se dissimulaient sous une tunique blanche.35. D'après le journal <strong>de</strong> Dl NICOLA, Diario. I. 287, cité par M. BATTISTINI.Eleonora Fonseca Pimentel-njascino di una donna impegnata fra Ietteratura erivoluzione, Generoso Procaccinl ed., Napoli, 1998.36. A slgnora donna Uonoral Che cantava ncopp'o triato IMo abballa mmlezoo Mercato Vlva Ylva 0 papa santo/C"h mannato 1 cannunclnl/Pe scacclà liglacublnl 1/ Vlva a fo rca e Mastro Donato / San t'Antonio sia priato 1
30 Une poète et révolutionnaire napolitaineQui a envoyé <strong>de</strong>s petits canons.pour chasser les Jacobins.Vive le gibet <strong>de</strong> Mastro Donato :Que Saint Antoine soit loué ! 37D'autres martyrs subirent le même sort : c'était le <strong>de</strong>rnier acte <strong>de</strong>la glorieuse Rêpublique parthénopéenne <strong>de</strong> 1799, La famille Serra diCassano. par exemple. vit son fils Gennaro. <strong>de</strong> vingt- six ans. décapité,Gennaro Serra di Cassano. jeune aristocrate passé à la République.fut exécuté en présence d'Eleonora <strong>de</strong> Fonseca Pimentel. son amie. sapassion, • Elle regar<strong>de</strong> tendue. écrit le romancier contemporain EnzoStriano. contractée. elle fixe Gennaro qui est <strong>de</strong>bout. et ferme. mêmes'11 tremble un peu, 11 est pâle, Av ant <strong>de</strong> s'approcher du billot. 11 setourne. il la regar<strong>de</strong>. lui sourit. Elle lui envoie un baiser fort <strong>de</strong> toutson cœur : mon Gennaro. cher. cher amour toi aussi. ne souffre pas.je t'en prie, Ne souffre pas trop .38,En signe <strong>de</strong> <strong>de</strong>u11. la famille Serra di Cassano ferma pour toujoursrentrée <strong>de</strong> son palais 39. celle qui s'ouvre vers le Palais Royal. Valeursymbolique d'un geste qui traverse l'histoire puisque. aujourd'huiencore. cette porte est toujours close pour rappeler à jamais la justicesommaire <strong>de</strong>s Bourbons ou plutôt leur vengeance contre la Républiquenapolitaine,Dans sa chronique historique <strong>de</strong> la révolution napolitaine <strong>de</strong> 1799.Vincenzo Cuoco. écrit à propos d'Eléonore <strong>de</strong> Fonseca Pimentel. quecette femme osa concurrencer les hommes et qu'elle se plongea dansla révolution comme Camille l'avait fa it jadis dans la guerre: • Au<strong>de</strong>tviris concurrere virgo .. , .40 •Aussi les réactions fu rent terriblement fortes et rien ne lui fu tépargné, Noble <strong>de</strong> naissance (elle était marquise). mais simplecitoyenne par choix. elle fu t pendue et non décapitée. - ce qui était lapeine réservée aux nobles- et elle fu t obligée d'assister à l'exécution<strong>de</strong> son bien-aimé, Son supplice. le refus <strong>de</strong> lui ,donner <strong>de</strong>s vêtements37. dans M. BAITAGLINI .. op. ciL, p. IS.3S. E. STRIANO. op. ciL. p. 407.39. Aujourd'hui ce Palais Serra dl Cassano à Naples est le siège du prestigieuxIstituto dl Studi Filosolle! • dirlgè par Gerardo Marotta.40. V. CUOCO. op. ciL p. 273. Allusion à Camille. reine <strong>de</strong>s Volsques. quicommandait la cavalerie <strong>de</strong> Tumus et dont Virgile raconte la vie et la mort aucombat dans le XI" Chant <strong>de</strong> l'Enéi<strong>de</strong>.
Beatrice Barbalato 31décents le jour <strong>de</strong> sa mort, montrent combien la société conservatricevoulut non seulement réprimer mais aussi humilier une femme quiavait affirmé avec force son indépendance d'esprit.
Maria José Lacalzada <strong>de</strong> Mateo 33Concepciôn Arenal (1820-1893)L'engagement d'une humaniste espagnole'MaIia José Lacalzada <strong>de</strong> MateoLes profils <strong>de</strong> femmes le plus souvent représentés oscillent entre <strong>de</strong>uxextrêmes : <strong>de</strong> la femme soumise. obéissante et tendre. à l'inverse. lafemme intIigante et dangereuse. manipulant la volonté <strong>de</strong>s souverains.<strong>de</strong>s courtisans ou <strong>de</strong>s ministres. qui peut même atteindre une sorte <strong>de</strong>paroxysme en temps <strong>de</strong> guerre. sous les traits <strong>de</strong>s espionnes,Par ailleurs il est bien connu que seules <strong>de</strong>s fe mmes exceptionnelles -et encore. une minoIité d'entre elles - parviennent à entrer dansl'histoire, C'est ainsi que trop souvent. <strong>de</strong> bIillantes intelligences. <strong>de</strong>svolontés affirmées. <strong>de</strong> belles sensibilités ont été purement et simplementcondamnées à l'anonymat. car jugées incapables <strong>de</strong> susciter l'intérêt <strong>de</strong>sfoules ou <strong>de</strong> forcer le barrage <strong>de</strong> la prépondérance masculine,Ceux qui militent pour la justice. qu'ils soient hommes ou femmes,n'ont pas subi <strong>de</strong> meilleur sort. Ceux qui n'acceptent pas les conventions,qui persistent à être cIitiques fa ce aux différents pouvoirs. qui1. Texte traduit <strong>de</strong> l'espagnol. Nous remercions Ma<strong>de</strong>leine Frédéric, Anne Morelll,et surtout José Nobre-Correia pour leur ai<strong>de</strong>,
34 Une lumtaniste espagnoleenfreignent les normes, sont toujours incommo<strong>de</strong>s et finissent par êtrepersécutés ou marginalisés. Parmi eux on dénombre pourtant <strong>de</strong>spersonnalités <strong>de</strong> premier plan qui ont contribué à élever moralement legenre humain. Il est intéressant <strong>de</strong> les repérer, si l'on veut pouvoir écrireles pages <strong>de</strong> l'humanisme.Parmi ces personnalités qu'Il convient <strong>de</strong> sortir <strong>de</strong> l'ombre, Il fa udraits'intéresser tout spécialement à celles qui ont souffert d'une double marginalisationparce qu'elle sont nées femmes. Femmes : c'est-à-dire <strong>de</strong>sêtres humains cherchant à développer totalement leurs capacités,instruites sans être savantes, bonnes et dévouées sans être uniquementmères, vertueuses sans se conformer aux canons <strong>féminins</strong> dominants(généralement confondus avec la religiosité), sensibles sans être nécessairementartistes. C'est dans cette perspective que nous situerons latrajectoire <strong>de</strong> Concepcion ArenaI. une femme dotée d'un grand senshumaniste qui milita toute sa vie pour plus <strong>de</strong> vérité, <strong>de</strong> bonté et <strong>de</strong>Justice.Un personnage difficile à classer .•• et mal classéConcepclon Arenal naquit le 31 janvier 1820 dans une famille <strong>de</strong> lamoyenne bourgeOisie. Son père mourut alors qu'elle était encore enfantet la famille s'installe à Madrid. Après un premier amour impossible avecManuel <strong>de</strong> la Cuesta, elle épouse le 2 avril 1848 Fernando GarciaCarrasco, et forme avec lui un couple original où les rôles ne se distribuèrentjamais <strong>de</strong> manière conventionnelle. Trois enfants naquirent <strong>de</strong>cette union : une fille, Concepclôn, en 1849 (qui mourut jeune), et <strong>de</strong>uxfils, Fernando en 1850 et Ramôn en 1852. Ses tàches maternellesn'empêchèrent pourtant pas Concepcion Arenal <strong>de</strong> poursuivre sonpropre épanouissement. Vêtue d'un pantalon, elle fréquentait lesréunions intellectuelles, elle gérait elle-mème l'argent fa milial et sespropriétés, elle gagnait sa vie par la plume en écrivant <strong>de</strong>s articles pourle journal progressiste La Iberia. A la mort <strong>de</strong> son mari, en 1857, elle
Maria José Lacalzada <strong>de</strong> Mateo 35continua sur sa lancée et s'impliqua <strong>de</strong> plus en plus dans les questionssociales et la réforme pénitentiaire, Elle mourut en 1893 2 •Si elle ne fu t jamais à proprement parler une militante politique. celane signifie pas qu'elle se désintéressa <strong>de</strong> la politique. ni que sa condition<strong>de</strong> femme l'en aurait détournée. encore moins que sa foi catholique nelui ait fait craindre le libéralisme, Ce sont pourtant les principauxclichés. inventés <strong>de</strong> toutes pièces après sa mort. et qui lui ont étéaccolés,Concepciôn Arenal a adhéré. sans partage. aux valeurs humanistes :ouverte au dialogue et au pluralisme, elle se lia avec <strong>de</strong>s personnalitésengagées dans les différents courants politiques du moment. Mals ellemêmene prétendit pas . faire . <strong>de</strong> la politique au sein d'un parti. Luttantpour faire triompher les valeurs humanistes. elle se situait dans unesphère intellectuelle. au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s compromissions politiques, Parler etcritiquer les puissants. établir <strong>de</strong>s équilibres dans le but d'atténuer lesmalheurs ou d'empêcher qu'ils ne se produisent : son objectif était bien<strong>de</strong> favoriser l'égalité <strong>de</strong>s classes. c'est-à-dire la justice sociale,Aussi Concepciôn ArenaI fu t-elle une femme consciente et militante.toujours opposée au <strong>de</strong>spotisme. sous toutes ses fo rmes. qu'elles semanifestent au niveau général. dans l'Etat lul-méme. ou qu'elles soientle fa it d'oligarchies locales, C'est pour cette raison qu'elle soutint larévolution libérale. désirant contribuer à établir en Espagne un étatconstitutionnel. à étendre l'éducation. à éveiller l'opinion publique et àmobiliser la société civile - toutes conditions nécessaires pour arriver,avec le temps, à un régime démocratique, Elle fit <strong>de</strong> la presse une véritabletribune, elle écrivit aussi <strong>de</strong>s bulletins <strong>de</strong> vulgarisation, <strong>de</strong>s manuelset <strong>de</strong>s livres, et finit par occuper <strong>de</strong>s charges au sein <strong>de</strong> l'administrationpénitentiaire.Ce n'est pourtant pas l'image qui a été conservée d'elle en Espagne,Alors qu'elle a entretenu <strong>de</strong>s contacts politiques et maintenu une trajectoiretrès significative à l'intérieur du libéralisme (ce qui est patentquand on approche sa vie et son œuvre sans préjugés) . on peut2. Pour <strong>de</strong>s renseignements biographiques détaillés : J. M. lACALZADA <strong>de</strong>MATEO. Mentalidad y proyecciôn social <strong>de</strong> Concepciôn ArenaL Ed. Camera Official<strong>de</strong> Comercio, Industrta e Navigaclon ; Concello Ferrol. 1994.
36 Une humaniste espagnolelégitimement se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r comment il se fait qu'elle ne soit pas <strong>de</strong> cellesdont l'histoire a retenu le nom, Comment est-il possible que. hormisquelques souvenirs dans la tradition libérale - mais voilés - sa mémoireait été associée en gran<strong>de</strong> partie au catholicisme et au conservatisme ?Comment ses nombreuses critiques énergiques ont-elle pu été lénifiéesavec le temps ?C'est le prix élevé qu'elle paie pour ses conceptions sans partage. sondésir <strong>de</strong> dialogue humaniste, sa neutralité politique. son adhésion à lavérité, son sens moral au service <strong>de</strong> la justice. Les humanistes, on l'a dit.s'imposent difficilement dans les partis politiques. Ils apparaissentdavantage parmi les intellectuels critiques du pouvoir ou parmi les militants<strong>de</strong> base anonymes.Mais surtout on ne doit pas oublier le contexte dans lequel a vécuConcepci6n Arenal : l'Espagne du siècle <strong>de</strong>rnier. dominée parl'irrationnel et par les passions. Les partisans <strong>de</strong> l'humanisme libéral yfurent persécutés ou ignorés dans la structure <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong> l'Eglisecatholique espagnole qui affichait une attitu<strong>de</strong> politique antilibérale etthéocentriste face à la philosophie anthropocentriste véhiculée par larévolution libérale.L'humanisme comme militantismeOn trouve chez Concepci6n Arenal une cohérence fo rte entre sesconvictions théoriques et ses amitiés pratiques, entre sa vie et sesœuvres. Elle parvint à poursuivre. avec la même Intégrité, une activitésituée autant dans les <strong>de</strong>rniers recoins <strong>de</strong> la société civile que dans lescharges officielles.Son humanisme est intégral : il ne relève pas seulement du cœur ou<strong>de</strong> la sensibilité mais aussi <strong>de</strong> la raison, Son sens affiné <strong>de</strong> la révolutionla poussa à rechercher non seulement les changements fo rmels <strong>de</strong>structures mais aussi <strong>de</strong>s changements d'ordre moral. Elle pr6nait uneréforme morale qui concernait tous les secteurs sociaux, <strong>de</strong>s plus marginaux(les pauvres ou les délinquants) aux plus puissants (par la richesseou le pouvoir). Animée <strong>de</strong> ces convictions, elle <strong>de</strong>vint un personnageinconfortable pour son temps, comme elle le <strong>de</strong>meure aujourd'hui quand
Maria José Lacalzada <strong>de</strong> Mateo 37on veut la classer - et c'est sans doute une raison supplémentaire quiexplique que l'on ait ainsi simplifié. caricaturé. manipulé sa pensée,Les penchants humanitaires pour imposer la vérité. adoucir lesmœurs et développer le sentiment <strong>de</strong> justice. qui apparaissent dans sespremières œuvres. n'ont pas varié au cours <strong>de</strong> sa vie, C'est dire que sespostulats <strong>de</strong> base n'ont souffert aucune déviation, Mais ils ont eutendance à se préciser et à s'élargir au fu r et à mesure qu'ils étaientconfrontés aux réalités quotidiennes. au fu r et à mesure qu'elle-mêmeaccumulait <strong>de</strong>s expériences différentes et assimilait les changements <strong>de</strong>son environnement.Ses réflexions concernent <strong>de</strong>s domaines aussi variés que le systèmesocio-politique. l'opinion publique. la société civile. les progrès scientiflques3,Juger le système socio-politiqueConcepci6n Arenal a été fort préoccupée par l'idée <strong>de</strong> justice au coursd'une pério<strong>de</strong> particulièrement troublée. la secon<strong>de</strong> moitié du XIxe siécleespagnol. Elle fu t témoin <strong>de</strong> profonds bouleversements. comme la politique<strong>de</strong> l'Union libérale qui déboucha sur la révolution <strong>de</strong> 1868 et ladéchéance <strong>de</strong> la reine Isabelle 11. les tentatives <strong>de</strong>s années suivantes<strong>de</strong>puis le projet d'introniser une nouvelle dynastie jusqu'à la proclamation<strong>de</strong> la république en 1873. la restauration <strong>de</strong>s Bourbons et <strong>de</strong> l'Etatlibéral parlementaire à partir <strong>de</strong> 1875.Au milieu <strong>de</strong> ces turbulences politiques. sociales et religieuses. elleécrivit <strong>de</strong>s pages <strong>de</strong> valeur et d'une profon<strong>de</strong>ur peu courante. Si on les liten tenant compte à la fo is du contexte historique et du sens philosophique.les valeurs universelles apparaissent sous forme <strong>de</strong> critiques aiguëset profon<strong>de</strong>s.Ainsi par exemple. en 1859 et 1860. quand <strong>de</strong>s campagnes militairesafricaines servirent au gouvernement <strong>de</strong> O'Donnel pour ranimer unesprit national défaillant. Concepci6n Arenal participa à un concours3. Pour un aperçu <strong>de</strong> ses œuvres dans Maria José LACALZADA <strong>de</strong> MATEO. LaOtra Müad <strong>de</strong>I Género humano : La panordmica vista por Concepci6n Arenal 1820-1893. Atena. Universidad <strong>de</strong> Mâlaga 1994, pp.233-237.
38 Une humaniste espagnolelittéraire qui avait pour objet précisément <strong>de</strong> célébrer la victoire. Mais lepoéme d'Arenal contenait trop <strong>de</strong> vérités. En plus <strong>de</strong> démystifier cesvictoires, elle montrait combien l'Espagne était en train <strong>de</strong> s'éloigner duprogrès <strong>de</strong>puis le XVIe siècle à cause <strong>de</strong> son intransigeance et <strong>de</strong> sonobscuranUsme4• Elle ne remporta évi<strong>de</strong>mment aucun prix.Après la révolution <strong>de</strong> 1868. beaucoup ont cru qu'elle marquait l'ère<strong>de</strong> la liberté et du gouvernement représentatif. la fin <strong>de</strong>s coteries et du<strong>de</strong>spotisme. C'était là un jugement superficiel. engagé ou conformiste.Concepciôn Arenal était consciente. pour sa part. que les mesures arbitraires.les décisions précipitées. les revanches partisanes et personnellesn'étaient pas <strong>de</strong>s phénomènes politiques mais plutôt <strong>de</strong>s attitu<strong>de</strong>smorales et. comme telles. ne suivraient pas la Reine en exil. Ainsi ellepassa ces années à réclamer que les principes philosophiques quiavaient animé la révolution soient mis en pratique lorsque celle-ci avaittriomphé. Tàche inutile que <strong>de</strong> prôner la cohérence entre <strong>de</strong>s attitu<strong>de</strong>saffirmées dans l'opposition et les pratiques observées une fois aupouvoir 1A la même époque éclatèrent les premiers mouvements cantonaux etrépublicains. Concepciôn Arenal estima qu'ils n'allaient pas renforcer letriomphe <strong>de</strong>s libertés mais au contraire en compliquer l'établissement etmême favoriser la régression. Elle publia un texte dans le journal LasNovida<strong>de</strong>s. dirigé par ses amis progressistes Salustiano <strong>de</strong> Olôzaga etFernan<strong>de</strong>z <strong>de</strong> los Rios5• Elle estimait qu'une république fédérale n'étaltpas la meilleure fo rmule pour le pays.L'administration <strong>de</strong> la justice.l'instruction. le niveau scientifique baisseraient encore plus. Ellel'exprimait sans détours : « Nous ne serons pas en présence d'un hommequi se met à la tête <strong>de</strong> la nation mals <strong>de</strong> beaucoup qui prési<strong>de</strong>ront lesdifférents Etats ( ... ) Les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> ces Etats seront autant <strong>de</strong> petitsrois avec leur gouvernement et leur Cour. avec plus <strong>de</strong> compromis. <strong>de</strong>misère, <strong>de</strong> faiblesse. <strong>de</strong> rancœurs. <strong>de</strong> dis fonctionnement. <strong>de</strong> vengeance.4. C. ARENAL DE GARCIA CARRASCO, Apelacibn al pûblico <strong>de</strong> un Jallo <strong>de</strong> la realAca<strong>de</strong>mia espaflOla. Poema presentado a la misma en el ultimo certamenextraordinario. Madrid, Imp. De Anoz, 1961.5. C. ARENAL. A los vencedores ya los vencidos, Madrid, Las Noveda<strong>de</strong>s, 1869.
Maria José Lacalzada <strong>de</strong> Mateo 39<strong>de</strong> ruine, <strong>de</strong> protections non motivées et <strong>de</strong> gaspillages que le gouvernementcentral . 6 .Une <strong>de</strong>s mesures que le gouvernement provisoire s'était empressé <strong>de</strong>prendre avait été la suppression <strong>de</strong>s Conférences <strong>de</strong> Saint Vincent <strong>de</strong>Paul, sous prétexte qu'elles étaient infiltrées progressivement par <strong>de</strong>séléments carlistes. Mais on ne prit pas en compte le fait qu'il n'existaiten Espagne aucune œuvre d'assistance alternative. Sous une apparence<strong>de</strong> progrès, cette décision, étant donné le contexte, ne signifiait nullementun coup porté à l'intégrisme catholique mais détruisait en réalité leseul réseau <strong>de</strong> bienfaisance domiciliaire en voie d'être créé - et doncaggrava le problème du paupérisme.Dans <strong>de</strong>s articles publiés dans La Voz <strong>de</strong> la Caridad, Concepci6nArenal, tout en ne cachant pas ses sympathies pour l'idéal progressisteni les liens qu'elle avait eu avec l'oppOSition, soulignait ce qu'elleconsidérait être la voix <strong>de</strong> la raison et <strong>de</strong> la Justice et mettait en évi<strong>de</strong>nceles erreurs <strong>de</strong> forme commises et le manque <strong>de</strong> cohérence avec lesidéaux <strong>de</strong> rèférence. Le décret n'avait pas été pris par le ministère <strong>de</strong>l'Intérieur mais bien par le ministère <strong>de</strong> la Grâce et <strong>de</strong> la Justice, quiavait dans ses attributions les communautès religieuses. Or lesConférences étaient civiles, même si elles s'inspiraient d'un sentimentreligieux. En outre, le gouvernement n'avait fourni aucune explication,1 même pas un mot qui légitime au moins cette mesure si grave, si dureet ce silence-là, qui fait songer à une réminiscence du régime <strong>de</strong>spotique,est bien étrange et bien incompréhensible 1 .••) Imposer ainsi sa volontésans raison, c'est nous traiter comme on traite <strong>de</strong>s enfants ou <strong>de</strong>s fousou <strong>de</strong>s esclaves . 7 . De plus, cette mesure était maladroite puisqu'elleavait dépouillé les plus déshérités. Selon elle, 1 toute violence injusteouvre une brèche dans le pouvoir qui y recourt . : aussi le parti progressisteavait-il ouvert la voie à 1 <strong>de</strong> terribles conspirations à la tête<strong>de</strong>squelles se trouvaient <strong>de</strong>ux grands conspirateurs, la Raison et LaJustice .8.6. I<strong>de</strong>m. p. 16.7. Publié dans La Voz <strong>de</strong> la Caridad. 15.01. 1871. Nous citons d'après C. ARENAL,Obms Completas, t. XVIII, 1895. pp. 345-348.8. Ibi<strong>de</strong>m. p. 376.
40 Une hwnaniste espagnoleSans cacher ses liens avec ses anciens amis. elle les critiquait en cestermes : • Et vous êtes les amis <strong>de</strong>s pauvres 1 Vous êtes la cible <strong>de</strong> lacalomnie. vous qui en <strong>de</strong>s jours terribles avez cru dans l'abnégation et lacharité. que j'ai chantés avec enthousiasme. Je ne vous reconnais pas.Où est votre compassion ? Votre amour pour celui qui souffre ? Votrehumanité et votre justice ? Je ne vous reconnais pas. Le démon <strong>de</strong> lapolitique a aveuglé votre esprit et a endurci votre cœur. il a encouragévotre voix et donné vigueur à votre bras et vous avez renversé. aumauvais moment. l'asile où se réfugiaient tant <strong>de</strong> malheureux ! .9 Sarequête avait <strong>de</strong>s accents désespérés : • Laissez la charité en-<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>sluttes politiques. comme elle doit l'étre ! .10Concepci6n Arenal avait connu personnellement les manœuvres politiques.En 1863, elle avait été nommée . visiteuse <strong>de</strong>s prisons •. Une foisen charge. elle avait commencé à étudier et à envisager <strong>de</strong> nouvellesassociations pour les prisonniers et à proposer <strong>de</strong>s réformes. Peu yattachèrent <strong>de</strong> l'importance et à la mi- 1865, lors du changementpolitique. son poste fu t supprimé. Elle écrivit alors à son ami Jesus <strong>de</strong>Monasterio avec amertume : • Tout est dit en <strong>de</strong>ux mots. J'ai fait ce queje <strong>de</strong>vais et pour le reste ils l'ont voulu. J'étais un engrenage qui nes'insérait pas dans la machinerie pénitentiaire et je <strong>de</strong>vais donc disparaître.11 .Après la triomphe <strong>de</strong> la révolution <strong>de</strong> 1868. Concepci6n Arenal obtintà nouveau un poste officiel. Elle fu t nommée Inspectrice <strong>de</strong> la Maison <strong>de</strong>Correction pour Femmes. La charge fut supprimée en 1873. Cette mêmeannée, elle fit partie <strong>de</strong> la Commission pour la Réforme <strong>de</strong>s Prisons.Mais ses critiques <strong>de</strong>venaient <strong>de</strong> plus en plus acerbes et incommo<strong>de</strong>s,elles se sont encore accentuées sous la Restauration et le retourd'Alphonse XII sur le Trône. Elle dénonça le caractère étriqué <strong>de</strong> laréforme pénitentiaire. circonscrite à <strong>de</strong>s mesures extrémement limitées :on allait appliquer quelques directives techniques. très souvent sansl'opinion <strong>de</strong>s experts, mais surtout sans prendre en considération les9. Ibi<strong>de</strong>m. p. 359.10. Ibi<strong>de</strong>m. p. 365.Il. MONASTERIO. Cartas <strong>de</strong> Concepciôn Arenal a Monasterio. San Pedro <strong>de</strong> Nos.19 juillet 1865. p. 26.
Marta. José Lacalzada <strong>de</strong> Mateo 41besoins sociaux ni les caractéristiques spécifiques <strong>de</strong>s délinquants. c'està-diresans toucher à la fibre humaine, Sa voix acquit une renomméeinternationale dans le Bulletin <strong>de</strong> la Société générale <strong>de</strong>s Prisons. édité àParis à partir <strong>de</strong> 1877.Elle fut dès lors <strong>de</strong> plus en plus marginalisée. Jusqu'à la menace,Mais elle-même. très sûre d'elle. était prête à résister à tout type <strong>de</strong>pression, Ainsi en 1877. elle écrivait à Pedro Armengol y Cornet. unexcellent ami et une autorité en matière pénitentiaire : • C'est un signed'ignorance et une honte pour le pays que dans les hautes sphèresofficielles on trouve <strong>de</strong>s gens qui ne connaissent pas le castillan et quidonnent <strong>de</strong>s preuves <strong>de</strong> manquer totalement <strong>de</strong> sens commun '. Et ellepoursuivait : • Vous aurez déjà vu qu'on me menace <strong>de</strong> me traîner<strong>de</strong>vant les tribunaux si Je ne donne pas satisfaction, Et il faut que Je ladonne 1 Il faudra peut-être même les ai<strong>de</strong>r, cela fera un beau scandale sicela arrivait mais nous sommes dans le cas oû un scandale est nécessaire... Ni une lettre ni même un livre tout entier ne suffirait pourdénoncer les friponneries. les indignités et les malversations qui sepassent ici en général et dans les tribunaux en particulier .12.Alerter l'opinion publiqueConcepciôn Arenal croyait que les nouvelles structures du libéralismepouvaient apporter plus d'instruction. <strong>de</strong> richesse. <strong>de</strong> libertés ou <strong>de</strong> JUstice.Mais elle voyait aussi très clairement le risque <strong>de</strong> voir renaître lefavoritisme. l'arbitraire et l'obscurantisme une fois que les groupesseraient au pouvoir, Il était nécessaire <strong>de</strong> développer une éducation quiéveillerait l'intelligence et l'autonomie morale. Seul l'exercice <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirset <strong>de</strong>s droits inhérents à la citoyenneté pouvait maintenir la force <strong>de</strong>sidéaux libéraux et freiner les manœuvres intéressées <strong>de</strong>s plus puissants.Elle vit dans l'opinion publique et le rôle qu'elle pouvait Jouer un <strong>de</strong>schangements porteurs d'espoir, Elle accorda sa confiance au Journalisme.bien qu'elle soit consciente que l'opinion publique pouvait fortbien être manipulée. A diverses reprises. elle mit en lumière ces contra-12. M. CAMPO ALANGE, ConceIXiDn ArenaL juin 1877. pp. 233-234.
42 Une humaniste espagnoledictions et insista pour que la presse <strong>de</strong>vienne un instrument qui diffusela vérité et aiguise le sens critique,Ainsi par exemple en 1867. elle tenta d'éviter que ron utilise à <strong>de</strong>sfins politiques une crise - grève et mouvement <strong>de</strong> la faim - qui avaitéclaté en Galice et en Castille, Sous le titre très explicite <strong>de</strong> • La voix quiclame dans le désert '. elle publia un texte pour inciter toutes les forcessociales à donner la priorité au bien être social plutôt qu'aux intérêtsindividuels : • Ce serait patriotisme que <strong>de</strong> mourir pour tuer et ce ne leserait pas que <strong>de</strong> fa ire un sacrifice pécuniaire pour arrêter la marche <strong>de</strong>la mort ? • Elle rappelait ensuite le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> la presse en ces termes :• Investiguer. discuter. publier. donner à connaître le véritable état danslequel se trouve la moitié <strong>de</strong> rEspagne à rautre moitié qui l'ignore " Etelle soulignait plus loin : • Ne fût-ce qu'en ce moment et pour cettequestion. cessez d'étre la voix d'une coterie ou d'un parti pour être celle<strong>de</strong> la patrie et <strong>de</strong> rhumanité . 13 ,Elle parvint à mettre sur pied. avec le progressiste Salustiano <strong>de</strong>Olozaga. la comtesse <strong>de</strong> Espoz y Mina. veuve du regretté militaire libérai.et Fernando <strong>de</strong> Castro. un frère frappé d'anathème par les catholiquesintégristes et qui fu t recteur <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Madrid pendant la pério<strong>de</strong>révolutionnaire. La Voz <strong>de</strong> la Caridad, une revue fondée en 1870 qui aparu pendant quatorze ans avec une périodicité bimensuelle, Les rédacteursaffichaient <strong>de</strong>s tendances politiques distinctes, allant duconservateur Guerola à ranci en progressiste Fermin Caballero. ouGumersindo <strong>de</strong> Azcarate. le fo ndateur <strong>de</strong> l'InsUtuciôn <strong>Libre</strong> <strong>de</strong>Enseflanza qui parvint à se faire élire député du parti républicain bienaprès,Concepciôn Arenal manifestait ainsi son esprit pluraliste et sa volonté<strong>de</strong> démarquer la bienfaisance <strong>de</strong> la politique, pour la maintenir sur leterrain neutre <strong>de</strong> rhumanitaire, Dans le texte qui précéda le premiernuméro <strong>de</strong> la revue, elle écrivait : • Les malheureux sont <strong>de</strong>s créaturesqui souffrent. et non <strong>de</strong>s armes pour attaquer ou pour se défendre, Notrecœur n'est pas si dur, notre âme n'est pas si basse que, à la vue <strong>de</strong> ladouleur. au lieu du désir <strong>de</strong> la consoler, noU-s n'ayons celui <strong>de</strong> rexploiter13, C, ARENAL, La voz que clama en el <strong>de</strong>sierto, la Cortina, Tlp, Casa <strong>de</strong>Mlsertcordla, 1868, pp, 15-17,
Maria José Lacalzada <strong>de</strong> Mateo 43en faveur d'une idée ou d'un parti, Cette douleur n'appartient àpersonne, elle est le patrimoine <strong>de</strong> l'humanité et nous <strong>de</strong>vons parler enson nom et nullement au nom <strong>de</strong>s passions politiques .14.Cet effort pour réveiller une opinion et la doter d'un sentimentd'équité a amené Concepci6n Arenal à s'opposer à Castelar, le prestigieuxhomme politique. dont la trajectoire avait toujours invoqué laliberté. qui. dans sa jeunesse au cours <strong>de</strong>s années 1860- 1870 s'étaitaffirmé libre-penseur et animé d'une sensibilité sociale, Mais dans lesannées 1890. 11 appuyait les tendances les plus individualistes etmatérialistes du libéralisme, Et cela. dans le style oratoire chargé <strong>de</strong>poésie et <strong>de</strong> métaphores qui lui était propre et lui permettait d'influencersentimentalement l'opinion. Castelar écrivit en 1890 <strong>de</strong>s articles pourdiscréditer les tentatives d'interventionnisme étatique en faveur <strong>de</strong>s plusdémunis. dans lesquels il qualifia la Conférence <strong>de</strong> Berlin <strong>de</strong> • Concileéconomique <strong>de</strong>s idées socialistes '.Cette année-là. Concepci6n Arenal avait atteint ses 70 ans mals endépit d'une santé délicate. elle faisait toujours preuve <strong>de</strong> la même énergieque pendant sa jeunesse. Elle publia une réplique trés claire :• Aujourd'hui on taxe fréquemment <strong>de</strong> socialiste celui qui propose quel'état intervienne pour éviter les abus que lui seul peut corriger. ou quipropose que l'état facilite les améliorations qui ne se réaliseraient passans son intervention ou mettraient <strong>de</strong>s siècles à se réaliser. C'est engran<strong>de</strong> partie la conséquence <strong>de</strong> l'ignorance mais c'est une conséquenceinévitable parce que ni certains individualistes ni les autres necomprennent la logique <strong>de</strong> ceux qui ne le sont pas, Celle-ci. dans leuresprit. est contaminée par l'égoïsme <strong>de</strong> ceux qui comme Castelar pensentque l'Etat ne peut pas être le seul capitaliste ni le seul entrepreneur ni leseul rémunérateur équitable <strong>de</strong>s divers mérites, Il résulte que c'est dusocialisme que <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r que les mineurs restent quelques heures <strong>de</strong>moins ensevelis dans les entrailles <strong>de</strong> la terre. que c'est du socialismeque d'exiger que les industriels offrent <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> travail moinsdangereuses pour les ouvriers, En ce fleuve tourbillonnant d'idées. les14, La revue était créée sur le modèle <strong>de</strong>s Annales <strong>de</strong> la Chalité. publiée à Paris<strong>de</strong>puis 1845,
44Une humaniste espagnoleprofits sont pour les pécheurs mals ceux-ci ne sont pas ceux quis'abrutissent, qui se détruisent ou qui meurent en travaillant _15.Les arguments <strong>de</strong> Castelar se situaient dans la plus pure tradition <strong>de</strong>l'individualisme matérialiste et Concepclôn Arenal les contestait :« Monsieur Castelar, quand il combat le socialisme, utilise <strong>de</strong>s argumentsque l'on pourrait qualifier <strong>de</strong> classiques. mals à force <strong>de</strong> lesexagérer. il les transforme en erreurs évi<strong>de</strong>ntes, comme lorsqu'il prétend'qu'une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s pauvres sont tombés dans l'abîme <strong>de</strong> la misère<strong>de</strong>puis les sommets les plus hauts <strong>de</strong> l'aristocratie ... etc: Il est rare queceux qui tombent <strong>de</strong> si haut parviennent jusqu'au fond sans rencontrer<strong>de</strong> parachute, même s'Ils ne le méritent pas ; Il Y a peut-être unmiséreux qui fut naguère puissant mais la règle générale, très générale,c'est que l'on vit et que l'on meurt dans la condition sociale dans laquelleon est né et, pour en sortir, Il faut <strong>de</strong>s circonstances et <strong>de</strong>s conditionsexceptionnelles -. Selon Castelar. «la majeure partie <strong>de</strong>s banquierseuropéens ont débuté dans la pauvreté ; cela se peut mais dans laquestion sociale, Il ne s'agit pas <strong>de</strong> pauvres mals <strong>de</strong> miséreux. c'est-àdire<strong>de</strong> ceux qui n'ont ni le strict nécessaire physiologique oupsychologique et nous doutons que, <strong>de</strong> cette masse, soient sortis les plusopulents banquiers <strong>de</strong> l'Europe, exempts en tout cas <strong>de</strong> toute misère, sice n'est du point <strong>de</strong> vue moral -.Elle poursuivait : • Les individualistes, quand Ils disent au miséreuxque. s'Il est honnête. actif et économe, Il pourra <strong>de</strong>venir riche et quandils donnent l'exemple du pauvre N. et <strong>de</strong> l'ouvrier J. qui sont <strong>de</strong>venus<strong>de</strong>s capitalistes, ils oublient ce que l'on pourrait appeler l'impénétrabilitésociale. Même si dans une usine, 1.000 ouvriers seraient aptes à dirigerles travaux, il ne peut y avoir qu'un nombre limité <strong>de</strong> directeurs et <strong>de</strong>contremaîtres ; même s'il y a <strong>de</strong>s milliers et <strong>de</strong>s millions <strong>de</strong> pauvresdotés <strong>de</strong> l'aptitu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> la volonté <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s banquiers opulents, lecapital <strong>de</strong> la société ne suffit pas pour que tous soient millionnaires.mais seulement quelques uns .16.15. C. ARENAL, • La Cuestlôn social y la paz armada ., La Espaiia Mo<strong>de</strong>rne, t. xx.août 1890, pp. 133- 134.16. La Espaiia Mo<strong>de</strong>rne, t. XXI, septembre 1890, pp. 107-109.
Maria José Lacalzada <strong>de</strong> Mateo 45Castelar avait présenté la loi <strong>de</strong> l'offre et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> commeconsubstantielle et inévitable. Cela • ressemble à <strong>de</strong>s lois physiquesinexorables •. Ainsi il serait naturel et même esthétique que les espècesse dévorent entre elles. Concepciôn Arenal, qui n'ignorait pas les loiséconomiques, s'opposait <strong>de</strong> façon péremptoire à ces vues : • On ne peutdéduire du fait que la concurrence ne peut être supprimée qu'elle nepeut pas être modifiée ... .. Pour elle, le capital n'est pas représenté seulementpar les billets <strong>de</strong> banques ou les biens fonds, mais aussi par letravail et le talent. L'ouvrier n'est pas seulement un outil - encore que lesoutils fassent l'objet <strong>de</strong> soin - ce que l'on ne fa isait pas avec les personnesqui étaient enfermées et mouraient . <strong>de</strong> travail •. Dans ce contexte,elle écrivit quelques phrases clairvoyantes : • Ni haine ni idolâtrie ducapital mais bien la reconnaissance <strong>de</strong> son utilité et un frein à ses abus .Elle croyait que la société, et en <strong>de</strong>rnier ressort l'Etat qui la représente,avait pour <strong>de</strong>voir . <strong>de</strong> ne pas abandonner celui qui s'use en travaillant,ni la famille <strong>de</strong> celui qui meurt en travaillant .17.Une opinion publique bien informée pourrait aussi empêcher lesguerres. La guerre, pour Concepciôn ArenaI. avec ses oripeaux et sesjustifications, n'était que le fruit <strong>de</strong> la misère <strong>de</strong>s puissants. La cupidité,l'orgueil mal compris les submergeaient, entraînant â leur suite la ruine,la désolation, la mort, l'extermination <strong>de</strong> victimes, généralement innocentes.Ainsi elle en vint à affirmer en 1890 que : • Ces armées et cesgénéraux et ces empereurs sont <strong>de</strong>s produits pathologiques d'infirmitéssociales .. Et elle poursuivait : • Le grand pouvoir <strong>de</strong> faire du mals'appuie sur le fa it que les fo ules ne comprennent pas où est leur bien,on assiste ainsi à l'incroyable transformation du travailleur en soldat, <strong>de</strong>l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> son père en instrument <strong>de</strong> sa perte, du compagnon <strong>de</strong> ses amisen moyen <strong>de</strong> les réduire à l'obéissance indue, du coopérateur <strong>de</strong> laprospérité générale en auxiliaire <strong>de</strong> la ruine commune, et cette transformationne serait pas possible si le peuple était plus éduqué et s'il étaitmoins affamé. Toutes les tyrannies naissent <strong>de</strong> toutes les faiblesses ...Tandis que les peuples sont <strong>de</strong>s troupeaux, ses bergers seraient <strong>de</strong>sloups recouverts d'une peau <strong>de</strong> brebis [ ... ) La grève <strong>de</strong>s armées est-elleproche ? Ou est-elle lointaine ? Qui le sait ? Ce que l'on peut assurer17. Ibi<strong>de</strong>m, pp. 109-114.
46 Une humaniste espagnolec'est tant qu'il n'y en aura pas. les patrons s'enrichiront <strong>de</strong> la misère etvivront <strong>de</strong> la mort .18Mais les vainqueurs se font toujours pardonner les crimes et lesassassinats commis pendant les guerres. car ils savent transformerl'Ignominie en gloire, Concepciôn Arenal. qui ne croyait pas en cesmirages admis socialement. qualifiait les vainqueurs <strong>de</strong> monstres à la fin<strong>de</strong> la guerre franco-prussienne <strong>de</strong> 1870, et écrivait sans détours : • Onn'est pas féroce parce que on est Turc ou Grec. Gaulois ou Germain,mais tout simplement parce que l'on est VAINgUEUR. Dans toutes lesépoques, on suit les pas d'Attila et son épée est toujours l'épée <strong>de</strong> Breno.La <strong>de</strong>struction est la loi <strong>de</strong> la guerre comme <strong>de</strong> la tempête . 19.Elle ne voyait pas <strong>de</strong> meilleur moyen pour limiter les guerres que <strong>de</strong>faire appel â la conscience <strong>de</strong> l'humanité. Elle n'avait que peu confiancedans la diplomatie internationale qu'elle qualifiait même <strong>de</strong> vieille femmedécrépite <strong>de</strong> mauvais renom. Pour elle. plus on s'approchait du pouvoiret plus on perdait tout sens humanitaire et moral. â <strong>de</strong> rares exceptionsprès. Puisque les puissants . avaient seulement besoin <strong>de</strong> conscience, ilfallait selon elle que la conscience <strong>de</strong> l'humanité leur parle et leur parlefort et que l'on fa sse entendre la voix du <strong>de</strong>voir qui ne se levait pas dansleur cœur .20,Mobiliser la société civileL'exercice <strong>de</strong> la citoyenneté suppose la participation active â la viesociale. Cependant. au milieu du 19' siècle, mobiliser la société civile enEspagne. dans le sens <strong>de</strong>s responsabilités et <strong>de</strong> la conscience, en accordavec les institutions étatiques. était une tâche fort compliquée. Touteinitiative à caractère social était irrémédiablement aspirée par les luttespolitiques ou confessionnelles. Les possibilités <strong>de</strong> mobiliser la sociétécivile à l'image <strong>de</strong> l'Europe libérale passaient par <strong>de</strong> nombreuxintermédiaires.18. Ibi<strong>de</strong>m. pp. 119- 120.19. C. ARENAL, • Articulos sobre Beneficencla y Prlslone ", Obms Completas,t. XVIII, Madrid, 1900, pp. 406-407.20. Ibi<strong>de</strong>m. pp. 271-273.
Maria José L.aco1wda <strong>de</strong> Mateo 47Aux préjugés généraux s'ajoutait la difficulté <strong>de</strong> faire sortir les femmesdu foyer et <strong>de</strong>' les impliquer dans <strong>de</strong>s activités sociales. ConcepcionArenal a mené d'authentiques campagnes pour convaincre les hommes<strong>de</strong>s avantages qu'ils tireraient <strong>de</strong> vivre avec <strong>de</strong>s femmes plus instruiteset plus actives socialement. C'est l'une <strong>de</strong>s préoccupations dominantes<strong>de</strong> son premier livre La mujer <strong>de</strong>l poroenïr1• Elle y exprimait sa foi dansle changement.Cependant, quelques années plus tard, dans son ouvrage La mujer <strong>de</strong>su casa22 (1883). on décéle <strong>de</strong> très nets relents d'amertume et la convictionqu'il fa udra encore attendre longtemps avant que les choses nechangent.Le probléme se trouvait dans les fe mmes elles-mêmes. ConcepcionArenal, après <strong>de</strong> notables tentatives pour les amener à plus d'autonomieet les inciter à <strong>de</strong>s activités sociales, constatait avec tristesse, dans Lamujer <strong>de</strong> su casa : • Les associations pour combattre la misère,l'ignorance et l'immoralité ne peuvent compter sur leur coopération. Lesfe mmes peuvent certes donner quelque argent, mais leur travail, qui esttellement indispensable et irremplaçable, elles le refusent sous prétextequ'elles s'occupent suffisamment dans leur foyer.Les femmesn'admettent pas qu'elles ont <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs à remplir hors <strong>de</strong> la famille et necontestent pas que leur mari leur interdise <strong>de</strong> participer à unequelconque association, comme l'acceptent beaucoup qui ne sontpourtant pas si dociles à l'égard d'autres interdits maritaux [ . .. ) Il existeune manière déplorable et fréquente <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s excuses pour ne pasfaire le bien, et c'est <strong>de</strong> critiquer ceux qui le font. Il n'est pas rare que lafemme au foyer critique celle qui sort <strong>de</strong> la maison pour travailleractivement et efficacement dans une œuvre <strong>de</strong> bienfaisance '. Et, selonConcepcion Arenal, • De bien plus mauvaises leçons se donnent à la21. C. ARENAL, La mujer <strong>de</strong>I parvenir, Séville-Madrid, 1869. L'ouvrage avait étéécrit en 1861.22. C. ARENAL, La mtYer <strong>de</strong> su casa. Madrid, E. Rubliios. 1883. Contrairement àson titre, l'ouvrage n'était nullement un éloge <strong>de</strong>s vertus domestiques mais bienune critique <strong>de</strong> renfermement <strong>de</strong>s femmes dans leur foyer.
48 Une luananiste espagnoleCastellana,au Parc <strong>de</strong> Madrid ou au Théâtre Royal que dans la maison<strong>de</strong> T6came Roque ou dans les prisons <strong>de</strong> fe mmes .23.Ainsi, Concepci6n Arenal ne cherchait pas à former <strong>de</strong>s associationsexclusivement féminines ; elle voyait les avantages d'une participation<strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong>s femmes, <strong>de</strong>s adultes et <strong>de</strong>s enfants, <strong>de</strong>s riches et <strong>de</strong>spauvres. Elle tenait donc aux associations plurielles et • interclassistes •où chacun pouvait collaborer dans la mesure <strong>de</strong> ses moyens, <strong>de</strong> sesdisponibilités, <strong>de</strong> ses possibilités. Mais ces associations n'étaient pasnon plus confessionnelles, bien qu'elle ait incité les catholiques à seconformer au message évangélique, en se démarquant <strong>de</strong>s consignespolitiques et cléricales, ce que très peu étaient disposés à faire. D'autrepart, elle n'eut aucun préjugé à appuyer d'autres initiatives caritativesissues <strong>de</strong>s églises réformées (protestantes et anglicanes), parmilesquelles elle eut d'excellents amis.Des rapports et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s d'audience internationaleConcepci6n Arenal a entretenu <strong>de</strong>s liens significatifs dans les milieux<strong>de</strong> l'humanisme libéral international. Elle a cherché à fa ciliter lapénétration <strong>de</strong> ces idées en Espagne. Ces relations lui ont procuré unsoutien dans son travail, l'espoir <strong>de</strong> pouvoir exercer ailleurs une certaineinfluence et une confiance dans l'avenir et le progrès humain. Soit ditsans détours, elles ont été un réconfort pour les brima<strong>de</strong>s, les humiliationset le manque <strong>de</strong> compréhension qu'elle rencontra, comme lesautres humanistes espagnols, dans son propre pays.Les Congrès pénitentiaires <strong>de</strong> Stockholm (1878), <strong>de</strong> Rome (1885), <strong>de</strong>Saint-Pétersbourg (1890), d'Anvers (1892) fu rent <strong>de</strong> bonnes tribunes oùelle put faire connaître ses étu<strong>de</strong>s au plan international. C'est un autrepoint <strong>de</strong> vue, généralement admis en Espagne, que <strong>de</strong> fa ire croire queces contacts se limitaient uniquement aux questions pénales et pénitentiaires,c'est une manière <strong>de</strong> maintenir les apports <strong>de</strong> Concepci6n Arenaldans un champ relativement marginal , - autrement dit, <strong>de</strong> les laisser<strong>de</strong>rrière les barreaux <strong>de</strong> la prison.23. C, ARENAL. La emancipacibn <strong>de</strong> La m4ier en Espafla. Madrid, 1974. pp. 271-273.
Maria José Toca/zada <strong>de</strong> Mateo 49Ces congrès pènitentiaires s'inscrivaient au contraire dans le cadreplus large <strong>de</strong> la question sociale, une réforme que les libéraux étaient entrain <strong>de</strong> proposer dans une perspective humaniste pour mieuxcomprendre les marginaux et leur proposer <strong>de</strong>s moyens intellectuels,matériels et moraux leur permettant <strong>de</strong> trouver un espace digne dans lasociété, Ainsi les communications <strong>de</strong> Concepci6n Arenal à ces congrèsont-elles été valorisées par <strong>de</strong>s pénalistes comme Wines, mais aussi pard'autres qui manifestaient <strong>de</strong>s préoccupations sociales plus largescomme Tar<strong>de</strong> ou Guillaume,Concepci6n Arenal s'intéressa aux options à introduire dans lesprisons en matière d'éducation, Elles ne diffè raient guère <strong>de</strong> cellesqu'elle-même et ses amis <strong>de</strong> l'Institucion <strong>Libre</strong> <strong>de</strong> Enseilanza24 proposaientpour les autres citoyens, Les prisons ne <strong>de</strong>vaient pas être <strong>de</strong>slieux <strong>de</strong> répreSSion mais d'instruction où il fallait développer le sensmoral du délinquant. Comme Concepci6n Arenal l'exposa au Congrèspénitentiaire <strong>de</strong> Stockholm : • La rigueur excessive, loin d'être un moyen<strong>de</strong> corriger, est un moyen d'endurcir et <strong>de</strong> dépraver . . , La règle à suivreen matière <strong>de</strong> peines disciplinaires est qu'elles ne portent pas atteinte àla santé du corps ni <strong>de</strong> l'âme .., Dans une prison où les récompensesseraient bien étudiées et distribuées avec équité, nous croyons que lespeines seront rarement nécessaires .25,Concepci6n Arenal avait coutume d'insister sur la nécessité <strong>de</strong>respecter l'autonomie morale <strong>de</strong> l'individu : • L'homme n'est véritablementhomme que par l'exercice <strong>de</strong> sa volonté .., Chaque jour et à chaqueheure, on répète au prisonnier qu'il doit et jamais on ne lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'ilveut. Cela, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse. le rabaisse et il nes'élèvera à ses propres yeux ni ne se considèrera comme une personnevéritable s'il ne fait pas une fo is ce qu'il veut .26,Mais ne nous y trompons pas, Pour Concepci6n Arenal les problèmessociaux ne se résolvent pas par la seule éducation <strong>de</strong>s pauvres et <strong>de</strong>s24, Institution fo ndée sur le modèle <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> et sur lesmèmes principes, aspirant à la transformation Intellectuelle et morale du citoyenpour permettre l'avènement d'un règime libéral,25, C, ARENAL, • Informes penitenclaros ", Obras completas, t. XN, Madrid, 1895,pp, 11-17 et 28-30,26, Ibi<strong>de</strong>m. pp, 69-72,
50 Une humaniste espagnoledélinquants. C'est l'ensemble <strong>de</strong> la société qui est en cause. Bon nombre<strong>de</strong> riches et <strong>de</strong> puissants adoptent <strong>de</strong>s conduites encore plus préjudiciablesau bien-être général. Concepci6n Arenal insista à diverses reprisessur la nécessité <strong>de</strong> corriger également les classes supérieures et <strong>de</strong>réveiller leur conscience. Tel fut l'objectif <strong>de</strong> son livre, Cartas a un seftor(Lettres à un homme du mon<strong>de</strong>), écrit en 1871. non publiê pendant dixans à cause <strong>de</strong> la censure. avant qu'elle n'obtienne l'appui <strong>de</strong> TomasPerez Gonzalez. un bourgeois philanthrope bien introduit semble-t-ildans les milieux francs-maçons.Au Congrès <strong>de</strong> Saint-Pétersbourg. qui étudiait la question <strong>de</strong>sincorrigibles. Concepci6n Arenal en vint à dire ouvertement : • Lesdangers sociaux ne viennent pas <strong>de</strong> quelques centaines <strong>de</strong> coupablesque l'opinion condamne. que la loi châtie et que la fo rce publiquepoursuit et enferme. Non. les dangers viennent <strong>de</strong>s pervers quin'enfreignent pas les lois ou qui savent comment les enfreindre impunément.<strong>de</strong> ceux qui. lorsqu'ils s'emparent du bien d'autrui. ont la forcepublique <strong>de</strong> leur côté au lieu <strong>de</strong> ravoir contre eux : <strong>de</strong> ceux quitrafiquent avec les idées et les principes. <strong>de</strong> ceux qui achètent lesconsciences après avoir vendu la leur ... et <strong>de</strong> ceux qui s'irritentd'entendre prôner l'égalité et sa transcription dans les lois ... <strong>de</strong> ceux quine comprennent pas que le progrès matériel sans le progrès moralempêche les sociétés <strong>de</strong> progresser sans heurts ; <strong>de</strong> ceux qui voient unmal dans le fait d'attaquer la propriété mais non dans le caractère odieuxqu'elle revêt. ; <strong>de</strong> ceux qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt l'impossible et <strong>de</strong> ceux qui nientce qui est juste •. 27L'opinion et les activités sociales <strong>de</strong> Concepci6n Arenal trouvèrent unécho dans les milieux du réformisme social libéral dans lesquels étaientengagées les églises chrétiennes réformées. concrètement <strong>de</strong>sprotestantes françaises comme Isabelle Bogelot28et Caroline <strong>de</strong>27. Ibi<strong>de</strong>m. pp. 133- 134,28 Isabelle Bogelot 11838- 1923) féministe et directrice <strong>de</strong> l'Œuvre <strong>de</strong>s Libérées <strong>de</strong>Saint-Lazare à Paris, Son mari a traduit en français Le manuel du visüeur duprisonnier, <strong>de</strong> C, Arenal.
Maria. José Lacalzada <strong>de</strong> Mateo 51Barreau29 ou <strong>de</strong>s Anglicanes comme Joséphine Butler, Il s'agit là d'unaspect qui a été occulté jalousement en Espagne afin <strong>de</strong> pouvoir réduirela spiritualité indépendante <strong>de</strong> Concepcion Arenal aux ornières étroites<strong>de</strong> rintégrisme catholique espagnol.De ces relations hétérodoxes découle sa collaboration à rouvrage TIteWoman Question in Europe, qui réunissait différents rapports sur lasituation <strong>de</strong>s femmes en Europe et qui était coordonné par ThéodoreStanton, le fils d'Elisabeth Candy Stanton, Concepcion Arenal préparaun rapport minutieux dans lequel elle attirait rattention sur la condition<strong>de</strong> la femme espagnole, sur le mo<strong>de</strong> d'une dénonciation <strong>de</strong>vant ropinioninternationale,La racine <strong>de</strong> tous les maux se trouvait encore et toujours dans lemanque <strong>de</strong> formation et dans la sujétion morale : • Dans un pays où laforce brutale occupe encore le <strong>de</strong>vant <strong>de</strong> la scène, la faiblesse physiqueest considérée comme une gran<strong>de</strong> imperfection par le peuple inculte;c'est rorigine, si l'on y songe bien, <strong>de</strong> la supériorité que l'hommes'attribue en tout ( .. ,) Les hommes instruits sont en trop petit nombrepour pouvoir influencer efficacement cette opinion ( .. ,) Quand bien mèmeils connaissent certaines choses, ils sont très ignorants à propos dustatut <strong>de</strong>s femmes et fo nt preuve <strong>de</strong> tendances <strong>de</strong>spotiques, <strong>de</strong> rèminiscence<strong>de</strong> sauvage et <strong>de</strong> prétentions <strong>de</strong> prêtres, désireux d'être écoutéscomme <strong>de</strong>s oracles, obéis comme <strong>de</strong>s maîtres et aimés avec une fidélitéqu'ils ne croient pas <strong>de</strong>voir rendre : toutes choses dans lesquelles ilscroient la plupart du temps arriver à leurs fins, Bien qu'ils entretiennentavec soin leur corps et cultivent quelque peu leur esprit. ils <strong>de</strong>meurentpassablement grossiers dês lors qu'ils ne voient toujours en la femmeque la femelle, nourrissant rillusion qui frise la folie <strong>de</strong> prétendre qu'elleserait raisonnable sans qu'elle puisse exercer la raison . 3 1,29. Egalement directrice <strong>de</strong>s Libérées <strong>de</strong> Saint-Lazare à Paris.30. Joséphine Butler (1828- 19061, féministe anglaise, fondatlice <strong>de</strong> la FédérationAbolitionniste Internationale à Genève en 1875.31. The Woman Question in Europe. New York. 1884 replis dans C. ARENAL, Laemancipaciim <strong>de</strong> la mujer en Espafta. Madlid, 1974, p. 41.
52 Une humaniste espagnoleConclusionsMaintenir une attitu<strong>de</strong> critique constante, connaître la vérité sanspassion et chercher la justice, défendre les droits <strong>de</strong>s plus faibles ...autant <strong>de</strong> tracas qui s'ajoutent à ce que doit supporter tout nonconfonnlste.C'est le cas <strong>de</strong> Concepclôn ArenaI qui paya ses aspirationspar la marglnalisation durant sa vie et la manipulation <strong>de</strong> sa penséeaprés sa mort.Sa condition <strong>de</strong> femme n'a pas eu <strong>de</strong> répercussion négative sur sapensée théOrique, et probablement pas trop non plus dans ses activitéspratiques, car elle avait réussi à transgresser les normes imposées auxfemmes espagnoles et à s'entourer <strong>de</strong> relations nationales et internationales<strong>de</strong> pOids. Mals sa condition <strong>de</strong> femme a pesé aprés sa mort, dèsqu'elle ne fut plus là pour se défendre. Entre la galanterie, le silenceintéressé et l'interprétation fallacieuse d'une bonne partie <strong>de</strong> son œuvre,sa voix d'humaniste fu t véritablement étouffée. De nos jours encore, si lenom <strong>de</strong> Concepclôn Arenal est bien connu en Espagne, les traits fondamentaux<strong>de</strong> sa pensée <strong>de</strong>meurent biaisés.Ces observations ne se limitent pas à la sphère d'une biographiepersonnelle. Elles débouchent sur une perspective bien plus large, quis'inscrit dans la problématique générale à laquelle fut confrontél'humanisme libéral d'origine chrétienne dans un pays comme l'Espagne,où le catholicisme s'est maintenu durant tout le 19· et une bonne partdu 20· siècle dans la droite ligne <strong>de</strong> la Contre-Réfonne.Ces humanistes, qui défendaient une conception <strong>de</strong> l'être humainbasée sur sa perfectibilité et son autonomie morale, sa capacité <strong>de</strong>choisir et d'atteindre un contrôle personnel, croient dans une philosophieoù la vie morale s'achemine vers le bon et le juste, le bonheurindividuel. le partage <strong>de</strong>s richesses, la justice sociale, Cette philosophieest celle qui correspondait au fonctionnement <strong>de</strong>s états libéraux et à leurévolution vers la démocratie. De nos jours ces principes restent vali<strong>de</strong>set nécessaires, même s'Ils sont pris en tenaille - comme à toutes lesépoques - par les passions contraires et les tendances absolutistes quicorro<strong>de</strong>nt les efforts en faveur <strong>de</strong>s droits humains"
Maria José Laco1wda <strong>de</strong> Mateo 53La vie militante <strong>de</strong> Concepci6n Arenal, en quête <strong>de</strong> vérité et <strong>de</strong> Justice,laisse à ce titre un héritage important dans l'humanisme espagnol enparticulier, et dans la culture occi<strong>de</strong>ntale en général, même si cet héritagen'a pas encore été reconnu dans toute sa valeur.
Stina Nicklasson 55Une pionnière suédoiseLydia Wahlstrom 1869-19541Stina NicklassonLe mouvement féministe suédois trouve ses racines dans leschangements socio-économiques <strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière moitié du 1ge siècle.Mais la véritable avancée féministe survient aux alentours <strong>de</strong> 1900.C'est alors que les femmes ont véritablement commencé à agir ouvertementen public. Parmi elles se trouvent celles que l'on qualifiera plustard <strong>de</strong> féministes modérées. Modérées : cela signifie, dans le contextesuédois, qu'elle sont <strong>de</strong> droite mais sans pour autant être hostiles à ladémocratisation <strong>de</strong> la société ni aux réformes sociales progressives.Elles sont <strong>de</strong> droite parce qu'elles sont unies par la conviction qu'ilfaut renforcer la défense nationale, défendre la place <strong>de</strong> l'Eglise dansla société et combattre le socialisme.Or ces femmes <strong>de</strong> droite fu rent les premières à se doter d'uneorganisation indépendante, clairement politique et formelle d'un point<strong>de</strong> vue organisationnel. Il sera surtout question dans cet article <strong>de</strong>leur rôle dans le mouvement suffragiste.La conviction suffragisteDans ce domaine, la motivation <strong>de</strong> ces femmes modérées découlaitavant tout d'un fort sentiment d'injustice.En effet, les décisions qui1. Article traduit du suédois par Elisabeth Elgan, historienne <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong>d'Uppsala, que nous remercions Ici très vivement pour son aimablecollaboration.
56 Une pionnière suédoiseétaient prises pouvaient concerner les femmes, alors qu'elles n'avaientaucun moyen <strong>de</strong> s'exprimer à leur sujet, Elles ont donc pris à bras lecorps la réforme d'une obsolète constitution qui les empéchait <strong>de</strong>participer au processus <strong>de</strong> prise <strong>de</strong> décision, Le droit <strong>de</strong> vote pourtous les citoyens suédois, sans considération <strong>de</strong> sexe, <strong>de</strong>venait uneexigence indispensable et cette manière <strong>de</strong> voir s'est progressivementrépandue,Il ne manquait pas, dans la Suè<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'époque, <strong>de</strong> femmes quipossédaient à la fois une bonne formation, <strong>de</strong>s talents d'organisatriceset <strong>de</strong> nombreux contacts à l'étranger, et qui, <strong>de</strong> ce fait, étaient tout àfait capables <strong>de</strong> se jeter dans le combat pour la reconnaissance <strong>de</strong>sdroits <strong>de</strong>s femmes, Cette lutte ne se limita d'ailleurs pas au seul droit<strong>de</strong> vote, mais li engloba également le droit pour les femmes <strong>de</strong> <strong>de</strong>venirfonctionnaires <strong>de</strong> l'état, à tous les niveaux,Parmi ces pionnières, la docteure ès Lettres Lydia Wahlstrôm a vitedonné le ton, Outre le rôle qu'elle a joué au sein <strong>de</strong> la Fédération pourle Suffrage féminin suédois, elle s'est aussi fa it connaître et apprécierau sein du mouvement féministe européen, C'est donc à divers titresqu'elle mérite <strong>de</strong> retenir l'attention,Lydia Wahlstrom, une militante <strong>de</strong> droiteLydia Wahlstrôm était la fille d'un pasteur <strong>de</strong> l'Eglise <strong>de</strong> Suè<strong>de</strong>(c'est-à-dire l'église luthérienne d'Etat) et son père avait la charged'une paroisse <strong>de</strong> campagne au nord <strong>de</strong> Stockholm, Elle était douéepour les étu<strong>de</strong>s et les étu<strong>de</strong>s lui plaisaient. En retour, son entouragefa milial soutenait et méme encourageait son intérêt pour les livres,Mais en dépit <strong>de</strong> cet environnement favorable, li n'allait pas <strong>de</strong> soiqu'une jeune fille puisse poursuivre <strong>de</strong> longues étu<strong>de</strong>s à la fin du 1gesiècle en Suè<strong>de</strong> et le fait que Lydia Wahlstrôm ait pu présenter sonbaccalaurêat et s'inscrire l'<strong>Université</strong> d'Uppsala doit être considérécomme un fa it exceptionnel. Lorsqu'elle quitte cette université en1898, elle y a conquis son diplôme <strong>de</strong> docteure ès. Lettre (histoire) , Elleest alors âgée <strong>de</strong> 30 ans,Malgrê ses diplômes, son avenir ne s'annonce pas très prometteur,En tant que fe mme, elle n'est pas surprise <strong>de</strong> se heurter <strong>de</strong> toutesparts à l'attitu<strong>de</strong> négative <strong>de</strong> beaucoup d'hommes, En outre elle estbridée par la réglementation discriminatoire - qui prévoit notammentl'exclusion <strong>de</strong>s femmes <strong>de</strong>s chaires <strong>de</strong> renseignement public se-
Stina Niddasson 57condaire et supérieur pour garçons. Or il n'existait pas encore <strong>de</strong> lycéepublic pour jeunes filles à cette époque.Lydia Wahlstrôm tente alors sa chance à l'étranger, commed'autres femmes suédoises dans la même situation qu'elle. A l'extrêmenn du 19· siècle, nous la retrouvons en Angleterre. Elle avaitcommencé par y chercher du travail dans l'enseignement, mais sanssuccès. Elle crée alors sa propre école, mais cet essai se solda par unfiasco financier. Cet intermè<strong>de</strong> malheureux en Angleterre a pourtanteu probablement <strong>de</strong>s conséquences positives sur le cours <strong>de</strong> sa vie caril lui a permis d'entrer en contact avec le mouvement féministe anglaiset avec les luttes pour les droits <strong>de</strong>s femmes.Rentrée en Suè<strong>de</strong> en 1900, Lydia Wahlstrôm voit sa situation professionnelles'améliorer quelque peu puisqu'elle est nommée directriced'un lycée privé pour jeunes filles à Stockholm. Les lycées publicsn'étant pas accessibles aux jeunes filles, ce lycée non confessionnel etréputé les préparait au baccalauréat.Les débuts d'une action politiqueC'est à ce moment que débutent ses actions politiques, LydiaWahlstrôm fréquente à ce moment la Fédération Fredrika Bremer, uneassociation fo ndée en 1884 dont le nom est celui d'une gran<strong>de</strong> écrivainesuédoise du milieu du 1ge siècle et qui est ouverte à la fois auxhommes et aux femmes engagés dans la lutte pour les droits intellectuels,sociaux et économiques <strong>féminins</strong>, Elle y rencontre d'autresfemmes qui partagent avec elle <strong>de</strong>s opinions politiques <strong>de</strong> droite etmodérées. Parmi celles-ci, certaines ont participé au mouvementféministe international, comme Ebba von Eckermann, LizlnkaDryssen, Anna Wallenberg, Cecilia Milow et Valfrid Palmgren. Cesfemmes, ainsi que plusieurs autres, avalent déjà fa it l'expérience <strong>de</strong>l'engagement dans différentes organisations bénévoles ; elles étalentconvaincues que les femmes <strong>de</strong>vaient s'organiser pour fa ire pressionet faire reconnaître leurs exigences relatives au droit <strong>de</strong> vote et à laparticipation <strong>de</strong>s femmes aux prises <strong>de</strong> décision.C'est dans ce contexte que la Fédération Fredrika Bremer décidad'agir. Elle appela à une gran<strong>de</strong> réunion publique le 15 avril 1902alors que la première proposition pour le droit <strong>de</strong> vote féminin étaitprésentée au parlement par un élu libéral. C'est à ce meeting que,pour la première fois, Lydia Wahlstrôm prend la parole en public et serévèle être une oratrice hors pair et une « agitatrice • <strong>de</strong> qualité. Elle y
58 Une pionnière suédoiserencontre un net succès, ce qui rétrospectivement, la surprend car elleestime que son intervention était fort marquée • d'un esprit assezconservateur . 1 Cette intervention, dit-elle, s'inspirait <strong>de</strong> l'idée conservatriceque le vote était un <strong>de</strong>voir civique, et non un droit, et que ce<strong>de</strong>voir exigeait donc <strong>de</strong>s qualités <strong>de</strong> celle ou <strong>de</strong> celui qui <strong>de</strong>vaitl'exercer. Ses camara<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gauche dans la bataille pour le vote <strong>de</strong>sfe mmes défendaient au contraire l'idée que le vote était un droit.Mais si leurs conceptions politiques étaient différentes, leur obJectifétait néanmoins le mème : obtenir le suffrage pour les fe mmes. Unecollaboration pouvait s'établir entre elles sur cette base.Toutefois, cette première allocution publique classa définitivementLydia Wahlstrôm à droite, et c'est en tant que telle qu'elle <strong>de</strong>vientmembre <strong>de</strong> la direction <strong>de</strong> l'Association <strong>de</strong> Stockholm pour le Suffragepolitique fé minin, fondée en 1902 .A partir <strong>de</strong> ce moment, le mouvement pour le vote fé mininaccapare une part importante <strong>de</strong> son énergie. Lors <strong>de</strong> ses interventionspubliques, Lydia Wahlstrôm rassemblait un public nombreux,composé d'hommes aussi bien que <strong>de</strong> fe mmes. Son talent d'oratriceétait incontestable et elle savait capter l'attention <strong>de</strong> tous. Il arrivaitmême que le principal Journal social-démocrate du pays répercute etloue ses discours dynamiques.Ses activités au sein du mouvement suffragisteLe mouvement pour le suffrage <strong>de</strong>s fe mmes prit rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>l'importance. Dès l'année suivante, en 1903, une organisation àl'échelle nationale put être fo ndée: Landsfàreningen fàr Kvinnlig politiskrôstrôtt - la Fédération pour le Suffrage politique féminin. LydiaWahlstrôm accepta successivement différentes responsabilités au sein<strong>de</strong> cette fé dération.C'était une personnalité très indépendante dans ses options politiqueset, bien qu'elle se qualifie elle-même <strong>de</strong> droite, elle ne pouvaitêtre considérée comme sympathisante d'aucun parti politique précis.A l'époque <strong>de</strong> la fondation du mouvement suffragiste fé minin, il n'yavait d'ailleurs pas encore <strong>de</strong> véritable parti politique <strong>de</strong> droite unifié àl'échelle du pays. Ce n'est qu'en 1904 que l'embryon d'un tel parti vitle Jour (Allmânna valmansfàrbun<strong>de</strong>t).Ce regroupement n'était cependant pas ouvert aux fe mmes : ilfaudra attendre près <strong>de</strong> dix ans avant que ce parti ne les accepte
Stina Nicklasson. 59comme membres. Lydia Wahlstrôm a donc dû se tracer une voiepersonnelle tandis que sa propre famille idéologique excluait lesfemmes <strong>de</strong> son organisation.Son engagement dans le mouvement suffragiste a revêtu plusieursformes. Lydia Wahlstrôm a notamment représenté le mouvement suffragistesuédois dans les rencontres et les congrés internationaux. Lesexpériences et les arguments qu'elle a pu recueillir dans différentesmétropoles européennes ont sans aucun doute profité au mouvementsuédois.Au printemps 1906, Lydia Wahlstrôm accè<strong>de</strong> à la prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> lasection <strong>de</strong> Stockholm <strong>de</strong> la Fédération pour le Suffrage fé minin. Ellemet immédiatement sur pied un programme ambitieux <strong>de</strong> conférences,qui ne sont pas seulement limitées à Stockholm et à ses environs.Elle parvient ainsi à fon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> nouvelles sections locales dans lespetites villes environnantes.Mais elle exerce aussi avec bonheur <strong>de</strong>s talents <strong>de</strong> lobbying. Ilfallait en effet trouver <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s nouvelles pour pénétrer les lieuxmêmes <strong>de</strong> la résistance masculine. Un <strong>de</strong> ces lieux était évi<strong>de</strong>mmentle parlement. Lydia Wahlstrôm a donc pris l'habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> rencontrerréguliérement <strong>de</strong>s parlementaires, à titre individuel, pour leurprésenter les arguments <strong>de</strong> son organisation et pour essayer <strong>de</strong> lesconvaincre. L'information et les pressions sur les parlementaires etsur les personnes influentes constituaient une tactique importante dumouvement féministe pour changer les attitu<strong>de</strong>s et faire reculer <strong>de</strong>spréjugés tenaces. Même les membres du gouvernement n'échappaientpas aux assauts <strong>de</strong> Lydia Wahlstrôm.La même année, en 1906, un gouvernement <strong>de</strong> droite, dirigé parArvid Lindman, accè<strong>de</strong> au pouvoir. De ce fait, la situation change pourLydia Wahlstrôm et pour les autres fé ministes modérées. Théoriquement,elles sont plus proches du pouvoir, même si d'une manièregénérale les hommes <strong>de</strong> leur paru n'étaient pas prêts à leur fa ire <strong>de</strong>sconcessions et refusaient <strong>de</strong> comprendre la potentialité politiquereprésentée par les femmes,Lydia Wahlstrôm sentait bien que les fé ministes <strong>de</strong> gauche attendaientqu'elle fasse évoluer le gouvernement dans le sens d'unchangement d'attitu<strong>de</strong> favorable au vote fé minin, Elle-même pensaitqu'au sein du gouvernement, il serait possible <strong>de</strong> convaincre le ministre<strong>de</strong> la Marine, Wilhelm Dryssen, <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir • l'homme . favorable
60 Une pionnière suédoiseaux femmes. Son épouse. Lisinka. était en effet une sympathisante <strong>de</strong>Lydia Wahlstrôm.A elles <strong>de</strong>ux. elles ont essayé d'Influencer le ministre à plusieursreprises. Il semble les avoir écoutées. mals sans pour autant fa irechanger la position gouvernementale. On peut penser que les• lobbyistes • qu'étaient Lydia Wahlstrôm et ses acolytes ont probablementsurestimé le poids et l'Influence <strong>de</strong> Wilhelm Dryssen au seindu gouvernement.Lydia Wahlstrôm ne s'est pas contentée <strong>de</strong> se tourner vers les parlementaireset les hommes au pouvoir, elle a aussi participé à <strong>de</strong>smeetings à la Bourse du Travail - le bastion du mouvement ouvriersocial-démocrate suédois - où elle a attaqué, sans crainte, le granddirigeant social-démocrate Hj almar Branting et d'autres figures politiques,trop tiè<strong>de</strong>s. à son goùt. à l'égard du suffrage féminin. Malsmalgré toute l'énergie qu'elle déployait, la cause du vote <strong>de</strong>s femmesne semblait pas progresser auprès <strong>de</strong>s hommes politiques. D'autrespersonnes influentes au sein du mouvement, comme par exempleEbba von Eckerman, partageaient son désappointement. La lutte allaitêtre longue : il fallait durer et retrousser les manches.Les regards se tournêrent alors vers les femmes elles-mêmes. Eneffet, toutes ne partageaient pas les visées du mouvement <strong>de</strong> LydiaWahlstrôm. Les femmes <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> bourgeoisie, par exemple, n'yétalent pas favorables et jusque là, aucun effort n'avait êté entreprisdans leur direction. Llzinka Dryssen, l'êpouse du ministre <strong>de</strong> laMarine, pensait qu'il serait intéressant d'essayer <strong>de</strong> les réveiller et <strong>de</strong>les consclentlser. Elle estimait que l'on pouvait tisser ainsi <strong>de</strong>sréseaux <strong>de</strong> sympathisantes.Lizinka Dryssen était fort optimiste à ce propos et elle réussit àpersua<strong>de</strong>r Lydia Wahlstrôm <strong>de</strong> participer à un raoùt mondain où elleserait l'attraction principale. Peu convaincue <strong>de</strong> l'utilité <strong>de</strong> tellesactions. Lydia Wahlstrôm accepta à contre cœur. Durant la manifestaUon,elle s'efforça <strong>de</strong> jouer <strong>de</strong> tout son registre d'oratrice et <strong>de</strong> pédagogue.mais elle a avoué plus tard l'animosité que lui inspiraitpersonnellement ces dames <strong>de</strong> la haute société. Même l'instigatrice <strong>de</strong>cette nouvelle tactique dut reconnaître après quelques temps que lesrésultats obtenus avaient été fort maigres et que cette idée n'était pastrés fructueuse. L'épiso<strong>de</strong> est néanmoins révélateur <strong>de</strong> l'esprit <strong>de</strong>Lydia Wahlstrôm. qui acceptait <strong>de</strong> passer ou tre ses propresconvictions. pour ne négliger aucune vole susceptible d'aboutir aurésultat.
Stina Nicklasson 61Les premières élections municipalesL'année suivante, en 1907, le gouvernement <strong>de</strong> droite élargit ledroit <strong>de</strong> vote à pratiquement toute la population masculine, à <strong>de</strong> raresexception près, mais en repoussant à une date ultérieure le vote <strong>de</strong>sfe mmes. Les femmes obtinrent néanmoins l'éligibilité aux conseilsmunicipaux. Elles pouvaient donc se présenter comme candidates etêtre élues. Ly dia Wahlstrôm interpréta cette première percée commeun pas en avant significatif pour le suffrage féminin. A l'occasion <strong>de</strong> laréforme. en effet, le suffrage censitaire pratiqué aux élections municipalesavait été fortement élargi. actualisant le fait que les femmes quisatisfaisaient aux exigence <strong>de</strong>s conditions censitaires, pouvaient voteraux élections municipales.Aux élections municipales <strong>de</strong> 1910, <strong>de</strong>s candidates se sont doncprésentées sur les listes pour la première fois. L'année précé<strong>de</strong>nte,Lydia Wahlstrôm avait renforcé sa position suffragiste en accédant àla prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la Fédération nationale pour le Suffrage féminin. PourLydia Wahlstrôm, ces élections municipales <strong>de</strong> 1910 fu rent plusqu'excitantes, car les hommes politiques faisaient brusquementpreuve d'un véritable intérèt pour les électrices, pour leurs questionset pour leur représentation.L'ensemble <strong>de</strong>s partis essayèrent en effet <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s femmescandidates, issues du mouvement suffraglste. La campagne électoralefu t courte - comme toujours à cette époque. Lydia Wahlstrôm etd'autres s'y sont adonnées avec enthousiasme. Citons par exemple lemeeting organisé en commun par la Fédération pour le Suffrage fémininet la Fédération Fredrika Bremer, la plus vieille et la plus importanteorganisation féministe à cette époque.Ces <strong>de</strong>ux mouvements étant politiquement neutres et en <strong>de</strong>hors<strong>de</strong>s partis. le meeting réunit aussi bien <strong>de</strong>s fe mmes <strong>de</strong> droite que <strong>de</strong>gauche. La droite y était représentée, bien sûr, par Lydia Wahlstrômainsi que par la candidate <strong>de</strong> droite au conseil municipal <strong>de</strong>Stockholm. Valfrid Palmgren, docteure ès Lettres et conservatrice à laBibliothèque royale. De bouche à oreille, la nouvelle <strong>de</strong> ce meetings'était répandue dans tout Stockholm : le nombre <strong>de</strong> femmes présenteset motivées fut important et l'ambiance chaleureuse.Lydia Wahlstrôm était en pleine forme : elle aimait parler <strong>de</strong>vant <strong>de</strong>grands publics. Comme les autres oratrices, elle a centré son interventionsur <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> politique concrète, qui étaient discutées
62 Une pionnière suédoiseen ce moment: la situation du logement à Stockholm, le politique <strong>de</strong> lapetite enfance et <strong>de</strong>s jeunes, l'école, ... etc. Sur ces questions, lesfemmes <strong>de</strong>s différentes familles politiques avaient toutes <strong>de</strong>s points <strong>de</strong>vue très proches.Le but <strong>de</strong> Lydia Wahlstrôm était avant tout <strong>de</strong> convaincre lesfe mmes <strong>de</strong> se rendre en masse aux urnes le jour <strong>de</strong>s élections. Malsson espoir fu t déçu. Des 20.900 femmes qui avaient le droit <strong>de</strong> voter àStockholm, seulement 6.606, soit 28%, prirent part au scrutin.La fin d'une prési<strong>de</strong>nceImmédiatement après ces élections, Lydia Wahlstrôm s'est trouvéeconfrontée à une situation nouvelle qui s'avéra décisive pour elle. Ausein <strong>de</strong> la Fédération pour le Suffrage féminin, l'impatience <strong>de</strong>s féministes<strong>de</strong> gauche <strong>de</strong>venait <strong>de</strong> plus en plus forte. La droite, et dans unecertaine mesure Lydia Wahlstrôm qui la symbolisait, était <strong>de</strong> plus enplus perçue comme un véritable obstacle à la réalisation du droit <strong>de</strong>vote <strong>de</strong>s femmes.La Fédération décida alors d'abandonner la ligne politique neutre,qui avait prédominé jusque là, et les fé ministes <strong>de</strong> gauche, c'est-à-direles femmes libérales et social-démocrates, emportèrent la décisionselon laquelle la Fédération recomman<strong>de</strong>rait <strong>de</strong> voter pour <strong>de</strong>s candidats<strong>de</strong> gauche aux prochaines élections. Et ceci en dépit du fait queles gouvernements <strong>de</strong> gauche n'avaient pas, dans le passé, manifesté<strong>de</strong> position particulière en faveur du vote <strong>de</strong>s femmes.Dans ce contexte extrémement agité et dans une ambiancesurchauffée, Lydia Wahlstrôm décida, en 19 11, <strong>de</strong> quitter sa fonction<strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Fédération, en prétextant son état <strong>de</strong> santé. Sapério<strong>de</strong> d'organisatrice et <strong>de</strong> promotrice du mouvement féministe pritfin avec cette démission. Mais l'intérêt qu'elle portait à la place <strong>de</strong>sfemmes en politique et à la politique d'une manière générale, aperduré sous d'autres formes.Comment a-t-elle ressenti et analysé cette situation ? Nous nepouvons que poser la question. Avalt-t-elle mis trop en avant sessympathies politiques? S'est-elle sentie fru strée par l'étiquette <strong>de</strong>femme <strong>de</strong> droite que ses adversaires employaient parfois contre elle,comme un argument péjoratif ?Quoi qu'il en soit, il est clair que Lydia Wahlstrôm était tout à lafo ls une militante et une battante. Elle se plaisait sur les barrica<strong>de</strong>s.
Stina Nicklasson 63Elle a aussi par ailleurs souligné que le cUvage gauche-droite n'étaitpas très Important entre les féministes sufTraglstes pendant lespremières années <strong>de</strong> leur action, C'est probablement l'une <strong>de</strong>s raisonspour lesquelles elles ont pu travailler ensemble, Mais par la suite, <strong>de</strong>slignes <strong>de</strong> fracture sont apparues,Lydia Wahlstrôm fu t néanmoins une personnalité ouverte, quiessayait d'analyser ses expérience <strong>de</strong> manière rationnelle, La collaborationavec les féministes <strong>de</strong> gauche et l'attitu<strong>de</strong> méprisante <strong>de</strong>certains hommes <strong>de</strong> son parti ont ainsi fait évoluer Lydia Wahlstrômvers une position politique nettement plus ambiguë, Elle n'était pasloin <strong>de</strong> ressembler aux députés Indépendants <strong>de</strong> l'époque, présentéssous le nom <strong>de</strong> • sauvages ., Mals sur un point, elle n'a Jamaistransigé, affirmant ainsi clairement <strong>de</strong>s positions <strong>de</strong> droite : la nécessité<strong>de</strong> combattre le socialisme,D'autres moyens d'actionLe militantisme politique et organisationnel <strong>de</strong> Lydia Wahlstrôms'est bel et bien clôturé en 19 11, Mals son Intérêt pour la politique estcependant resté constant, comme nous l'avons déjà dit. Elle a continuéà Intervenir en public, à participer à <strong>de</strong>s débats et donner <strong>de</strong>sconférences. Mais d'autres préoccupations se sont progressivementsubstituées à l'action politique, Elle a assumé son poste <strong>de</strong> directrice<strong>de</strong> lycée et <strong>de</strong> professeure d'histoire à mi-temps pendant 34 ans et.comme docteure en histoire, elle a poursu1v1 <strong>de</strong>s recherches scientifiques,Ses travaux présentent encore un intérêt <strong>de</strong> nos jours, le plusimportant étant peut-être l'histoire du mouvement sufTragiste qu'ellea publié en 1933 et qui <strong>de</strong>meure toujours une <strong>de</strong>s références dans cedomaine,Femme cultivée, Ly dia Wahlstrôm a également publié <strong>de</strong>s œuvreslittêralres et, en tant que fille <strong>de</strong> pasteur, elle s'est aussi intéressée àla thêologie. C'est ainsi qu'elle a pris position et qu'elle a défendul'existence <strong>de</strong> femmes pasteurs déjà dans les années 1920, alors quecette réforme ne sera réalisée au sein <strong>de</strong> l'Eglise suédoise queplusieurs décennies plus tard.Une biographie complète <strong>de</strong> Lydia Wahlstrôm <strong>de</strong>vrait abor<strong>de</strong>rencore bien d'autres domaines, Ly dia Wahlstrôm a joué un rôleimportant en tant que conférenclêre pour grand public et aussi entant qu'intellectuelle engagée, En 1998, le centenaire <strong>de</strong> sa soutenance<strong>de</strong> thèse a été célébré par un colloque solennel à l'<strong>Université</strong>
64 Une pionnière suédoised'Uppsala. Dans l'histoire <strong>de</strong> cette université. dont l'origine remonteau moyen âge. Lydia Wahlstrom avait été la <strong>de</strong>uxième femme à avoirconquis le titre <strong>de</strong> docteur.Orientation bibliographiqueDru<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Fehr. Anna G. Jônasdôttir and Bente Rosenbeck (éd.). Is there aNord iefeminism ? London. 1998.Gunnel Gustafsson. Maud Eduards. Malin Ronnblom (éd.). Towards a NewDemocratie Or<strong>de</strong>r? Stockholm. 1997.Nlcklasson. Stina. Hogems kvinnor: Problem och res urs for AllmdnnaValmanfOrbun<strong>de</strong>t 1900-1936/37. Uppsala. 1992.Stina Nlcklasson . Kvinnors vag tUl fullvardigtmedborgarskap : pionjarer formo<strong>de</strong>rat polüik. Stockholm. 1997.SUna Nlcklasson. Sophiasystem som bleu polüiker : Bertha We llin : pioryar formo<strong>de</strong>rat Polüik. Stockholm. 1995.Ulla Manns. Den sana frigorelsen: Fredrika-Bremer-Forbun<strong>de</strong>t 1884-1921.Stockholm. 1997.
Yvonne Knibiehler 65Germaine Poinso-ChapuisPionnière et militante1901-19811Yvonne KnibiehlerQui s'en souvient? Germaine Poinso-Chapuis fut la premièreFrançaise ministre <strong>de</strong> plein exercice, en 1947- 1948: ministre <strong>de</strong> laSantè publique et <strong>de</strong> la Population dans le cabinet <strong>de</strong> RobertSchuman, Il y avait eu trois femmes dans le gouvernement du FrontPopulaire en 1936, mais elles n'étaient que sous-secrétaires d'Etat,elles ne disposaient pas d'un budget autonome, Et il faudra attendre27 ans avant que Simone Veil <strong>de</strong>vienne à son tour ministre - encorel'est-elle <strong>de</strong>venue par la volonté du prince puisqu'elle n'avait aucunmandat électoral. Alors que Gennaine Poinso-Chapuis a été l'élue dupeuple pendant dix ans, d'octobre 1945 à janvier 1956, et son activitéparlementaire a été exceptionnellement productive et novatrice.Cette femme d'Etat était militante dans l'âme, comme par vocation.Pourtant sa famille ne lui en avait pas donné l'exemple. Son père étaitun négociant en bonneterie dont les affaires n'ont pas très bien marché.Sa mère, <strong>de</strong> santé délicate, restait au foyer. Le couple eut septenfants, dont cinq moururent en bas âge. Autant qu'à ses parents,1. Cette biographie a été rédigée à partir <strong>de</strong>s actes du colloque GermainePoinso-Chapuis témoin <strong>de</strong> son temps. tenu à Marseille les 20-22 novembre1997, auquel nous renvoyons (voir l'orientation bibliographique).
66 Gennaine Poinso-ChapuisGermaine s'attacha fo rtement à sa sœur Eugénie, <strong>de</strong> sept ans sonaînée. qui <strong>de</strong>vint enseignante et dame d'œuvres_A défaut <strong>de</strong> modèles. son éducation lui donna les armes et lesmoyens du militantisme. D'abord. les Chapuis étaient <strong>de</strong> bons catholiques.Leur fille ca<strong>de</strong>tte a trouvé dans sa foi chrétienne, soli<strong>de</strong> maisnon bigote. une réserve <strong>de</strong> courage et un motif puissant d'agir partoutcontre l'injustice. Ensuite à une époque où les filles étaient surtout<strong>de</strong>stinées à la vie domestique ou à la vie religieuse, ses parents ont sureconnaître ses qualités intellectuelles et l'accompagner dans sesétu<strong>de</strong>s jusqu'au doctorat en droit ; gràce à quoi elle a pu s'inscrire àvingt ans au barreau <strong>de</strong> Marseille. où les femmes étaient rares.Autre facteur favorable:elle eut aussi la chance d'atteindre l'âgeadulte au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong> la Première Guerre mondiale. époque où lasociété française commençait â s'ouvrir aux femmes : elle a pudéployer ses talents. elle a pu consacrer ses fo rces aux causes qui luiétaient chères. Enfin son mari. Henri Poinso. un confrère épousé ennovembre 1936. a toujours partagé ses options et l'a soutenue fidèlementdans toutes ses entreprises. même s'il ne s'est jamais engagépersonnellement dans une action militante.Par souci <strong>de</strong> clarté. on présentera successivement les trois optionsessentielles : le fé minisme. rengagement politique dans la démocratiechrétienne. puis les combats en faveur <strong>de</strong>s enfants • inadaptés -,Dans la réalité. ces trois démarches ont été parallèles. non successives.Le féminismeAucune frustration personnelle n'explique l'engagement <strong>de</strong>Ma<strong>de</strong>moiselle Chapuis dans le fé minisme, Au contraire c'est laconscience aiguë et culpabilisante d'être une privilégiée qui ra incitées'occuper <strong>de</strong>s fe mmes, Le catholicisme social d'abord. la pratique dudroit ensuite lui ont révélé la subordination et l'exploitation <strong>de</strong> la plupart<strong>de</strong>s femmes, Son principe <strong>de</strong> base c'est que toute femme doitpouvoir être autonome en gagnant sa vie, même si elle a <strong>de</strong>s enfants.et participe autant qu'un homme à toutes les formes <strong>de</strong> la vie
Yvonne Knibiehler 67publique.Des préoccupations socialesA 17 ans, jeune bachelière, elle donne déjà <strong>de</strong>s cours du soir à <strong>de</strong>sjeunes filles catholiques <strong>de</strong> milieu populaire pour les ai<strong>de</strong>r à acquérirune qualification: un peu plus tard , étudiante en droit, elle enseignebénévolement le droit du travail et un peu d'économie à <strong>de</strong>s ouvrières,Rappelons que l'Eglise, après son ralliement à la République, avaitentrepris une campagne <strong>de</strong> rechristianisation en s'appuyant sur lesfemmes, dociles à son influence. Le syndicalisme chrétien s'étaitbeaucoup développé, notamment en milieu féminin, Lorsque laConfédération française <strong>de</strong>s travailleurs chrétiens (CITC) se constitueen 1919, elle compte un tiers <strong>de</strong> femmes. La non-mixité favorisait, à labase, la liberté d'expression <strong>de</strong>s femmes, et l'émergence <strong>de</strong> leursrevendications. Nul doute que la jeune juriste n'ait découvert avec leplus vif intérét ce milieu si bien structuré, si novateur,D'un autre côté, on l'ignore trop, Marseille. entre les <strong>de</strong>ux guerres.abritait <strong>de</strong>s associations fé ministes nombreuses et vivaces, Les unesétaient issues <strong>de</strong>s œuvres <strong>de</strong> charité. confessionnelles ou laïques :c'est là que les femmes ont inventé à leur manière le travail social.Mais elles y ont aussi pris conscience <strong>de</strong> leurs problèmes spécifiqueset <strong>de</strong> leurs intéréts communs. Un bon exemple : l'entrai<strong>de</strong> sociale(laïque) créée en 1915 comme œuvre <strong>de</strong> guerre. se transforme en 1919en centre <strong>de</strong> formation, De 1925 à 1932, Germaine Chapuis y donne<strong>de</strong> nombreux cours chaque année.Une conceptionJédératriceD'autres associations se sont constituées comme sections locales<strong>de</strong> fo ndations nationales : Union française pour le suffrage <strong>de</strong>sfe mmes (UFSF), Ligue fr ançaise du droit <strong>de</strong>s fe mmes (LFDFJ, Unionnationale pour le vote <strong>de</strong>s fe mmes (UNVF). Cette diversité traduisaitsurtout <strong>de</strong>s clivages idéologiques. Germaine Cha puis trouva là uneoccasion d'affirmer son indépendance d'esprit: elle s'inscrivit dans lestrois associations, Pour elle une mission essentielle du fé minisme
68 Germaine Poinso-Chapuisconsistait à transcen<strong>de</strong>r les oppositions idéologiques. à bousculerl'esprit <strong>de</strong> chapelle. pour avancer ensemble. Comme elle était déjà. auseuil <strong>de</strong>s années 30. une avocate connue. un • as du barreau ••aucune association n'a osé l'écarter. On la voit donc s'investir activementdans tous les réseaux : elle donne <strong>de</strong>s cours et <strong>de</strong>s conférences.tient <strong>de</strong>s permanences. participe aux congrès. En 1935. un comitéd'entente suffragiste met sur pied une consultation <strong>de</strong> femmes sousfo rme d'un vote symbolique (puisque les Françaises n'avaient pasencore droit au suffrage) : 28.297 Marseillaises déposèrent leur bulletindans les urnes. Germaine Cha puis tenait un bureau <strong>de</strong> vote sur laCanebière.Il faut pourtant mettre au premier plan son association préférée :les Soroptimistes. Cette communauté. d'origine anglo-saxonne etd'inspiration tout à fa it nouvelle. ne s'adressait qu'aux femmesexerçant une profession et dont la réussite était reconnue. L'objectifconsistait à pousser les femmes vers les activités qualifiées etrémunératrices. Chaque • Sorop . <strong>de</strong>vait être irréprochable dansl'exercice <strong>de</strong> son métier afin <strong>de</strong> faire estimer partout la qualité du travailfé minin. Chaque profession <strong>de</strong>vait préciser sa déontologie. sesprincipes éthiques, et les fa ire respecter rigoureusement. De pluschaque profession <strong>de</strong>vait mettre sa compétence au service <strong>de</strong>s autres<strong>de</strong> maniére à construire une réelle solidarité féminine. Les • Sorop •comptaient aussi améliorer le sort <strong>de</strong>s femmes en luttant contre ces• fléaux sociaux 1 que sont l'alcoolisme et la prostitution2•Un tel programme comblait les vœux <strong>de</strong> Germaine Chapuis.Cofondatrice du Club marseillais en 1929. elle <strong>de</strong>vient dès 1930 viceprési<strong>de</strong>ntenationale. Elle contribue ensuite à la création <strong>de</strong> nombreuxclubs en France. Prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> l'Union française <strong>de</strong> 1934 1938. ellefu t aussi le • Gouverneur 1 auprés <strong>de</strong> la Fédération européenne. Cemilieu si tonique l'a beaucoup inspirée. elle ne s'en est jamaisdétachée.2. Le premIer Club fu t fondé en Californie. à Oakland en 1921. Il regroupe <strong>de</strong>sfemmes <strong>de</strong> professIons dIfférentes, dans un but d·excellence. d'entrai<strong>de</strong>Internationale et <strong>de</strong> services. La fo rmule s'Impose rapi<strong>de</strong>ment : elle gagneJ'Angleterre en 1923. la France en 1924 où le premier Club est fondé àJ'inItiative <strong>de</strong> la docteure Suzanne Noël (1878-1 9541, fémInIste et pionnière enchirurgie esthétique.
Yvonne Knibieh1er 69Unféminisme <strong>de</strong> transitionDevenue députée, puis ministre sous la IV République3, elleincarne ce qu'on peut appeler un fé minisme <strong>de</strong> transition. Leshistoriennes distinguent <strong>de</strong>ux vagues dans l"histoire du féminisme :rune s'est enflée sous la Troisième République (ce sont lessuffragettes!. l'autre sous la Cinquième (les gauchistes). Entre les<strong>de</strong>ux n y aurait • le creux ., comme si l"acquisiUon <strong>de</strong>s droitspolitiques en 1944 avait démob1l1sé les Françaises qui les réclamaient<strong>de</strong>puis si longtemps. Il faut nuancer cette thèse. Germaine PoinsoChapuis entrant au Palais Bourbon en octobre 1945 se sentaitinvestie d'une double mission :- prouver que les femmes sont capables, autant que les hommes,d'exercer <strong>de</strong>s responsabilités politiques- ut1l1ser le pouvoir politique pour servir les causes qui lui tenaientcœur, entre autre la cause <strong>de</strong>s femmes.Elle a relevé ce double défi. L'originalité <strong>de</strong> sa démarche consiste àtravailler en étroite collaboration avec les . équipes féminines . <strong>de</strong> sonparti, au lieu <strong>de</strong> se mettre à récole <strong>de</strong>s hommes. Les équipesféminines multiplient les contacts avec les milieux <strong>féminins</strong> ets'efforcent <strong>de</strong> • faire remonter . <strong>de</strong>s revendications spécifiques vers lesinstances <strong>de</strong> décision. Ces femmes ont beaucoup, beaucoup travaillé.Grâce à elles, Germaine Poinso-Chapuis a pu faire avancer le travailparlementaire dans divers domaines : ouverture aux femmes <strong>de</strong>nouvelles professions (la magistrature), promotion <strong>de</strong>s métiers<strong>féminins</strong> encore mal reconnus (les assistantes SOCiales) , réforme <strong>de</strong>srégimes matrimoniaux (si défavorables aux épouses), amélioration dusort <strong>de</strong>s veuves, défense <strong>de</strong>s consommateurs et bien sûr lutte contrela prostitution et contre l"alcoolisme.Dans resprit <strong>de</strong> ces militantes, le domaine par excellence <strong>de</strong>l"action politique féminine, c'est le social : elles se veulent spécialistes,• techniciennes du social '. Ce mot désigne, selon elles, <strong>de</strong>s réalités3. Elle a été députée pendant <strong>de</strong>ux législatures. d'octobre 1945 à Janvier 1956 :elle a été ministre <strong>de</strong> la Santé et <strong>de</strong> la Population du 24 novembre 1947 au 19Juillet 1948.
70 Gennaine Poinso-Chapuisconcrètes et quotidiennes qui pèsent si lourd sur les femmes. En effetelles ne renient en aucune manière la différence <strong>de</strong>s sexes. mais ellesla pensent en termes d'égalité. non pas d'assimilation. C'est en cultivantleurs qualités propres que les femmes pourront transfigurer lapolitique. Leur sensibilité toute maternelle les dispose à résoudre lesproblèmes sociaux ; leur réalisme domestique peut simplifier lesproblèmes économiques. leur attachement à la paix pèsera utilementsur les négociations internationales.On le voit. Germaine Poinso-Chapuis et ses amies ne se laissentnullement confiner dans <strong>de</strong>s domaines réputés <strong>féminins</strong> : santé.éducation. affaires sociales. Les fe mmes politiques doivent toutrepenser. Elles doivent aussi imposer l'idée que l'action politique estun service. non pas un pouvoir. et qu'il faut substituer l'esprit <strong>de</strong>dévouement à l'esprit <strong>de</strong> compétition.La défe nse du travail fémininAprès la fin <strong>de</strong> sa carrière politique. Germaine Poinso-Chapuis a eud'autres occasions <strong>de</strong> manifester son féminisme. Ainsi elle fut invitée àprésenter. pendant la Semaine sociale4 <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux. en juillet 1957.une leçon d'une heure sur . la promotion <strong>de</strong> la femme et ses conséquencesfamiliales J. L'auditoire - 3.000 personnes venues <strong>de</strong> 25pays - s'apprétait à entendre une condamnation <strong>de</strong>s féministes,notamment du Deuxième sexe <strong>de</strong> Simone <strong>de</strong> Beauvoir. Mais l'oratricepréféra faire l'éloge du travail professionnel. méme pour les épouses etmères elle <strong>de</strong>manda la création <strong>de</strong> services domestiques collectifs etune meilleure implication <strong>de</strong>s hommes dans la vie domestique. Sespropos ont soulevé une émotion que le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s SemainesSociales eut beaucoup <strong>de</strong> peine à apaiser !...Quand. au début <strong>de</strong>s années 70. la secon<strong>de</strong> vague féministe prit <strong>de</strong>l'importance. Germaine Poinso-Chapuis la jugea d'abord sévèrement :plutôt que <strong>de</strong> manifester dans les rues. disait-elle. les femmes feraient4. Les semaines sociales, création du cathollélsme social. réunissaient <strong>de</strong>schrétiennes. prétres et laïcs, penseurs et hommes d'actlon, désireux <strong>de</strong>connaître la doctrine soclaie <strong>de</strong> l'Eglise. Elles avaient lieu chaque année dansune ville différente.
Yvonne Knibieh1er 71mieux <strong>de</strong> voter. d'élire <strong>de</strong>s femmes. d'élaborer elles-mémes lesréformes qu'elles réclament.Pourtant elle se trouva bientôt associée aux travaux <strong>de</strong> laDélégation régionales au Droit <strong>de</strong>s Femmes dans la section • travail etformation . : elle s'y efforça encore et toujours <strong>de</strong> mieux ouvrir auxfemmes les métiers dits masculins : mals elle s'Intéressa beaucoupaussi à la réduction du temps <strong>de</strong> travail pour tous.La démocratie chrétienne• J'étals étudiante quand j'al commencé à aller aux jeunes du partidémocrate populaire ... Je militais là <strong>de</strong>dans en même temps que jemilitais dans le fé minisme. Ça allait <strong>de</strong> pair .6.Les premiers pas au Parti démocrate populaireLe Parti démocrate populaire ne s'est officiellement constitué qu'en1924 mals la gestation était plus ancienne. Ce parti voulait réaliser levieux réve <strong>de</strong> la démocratie chrétienne7• C'est ce qui attira la jeuneChapuls, On la volt dès 1925 prèparer le premier congrès du parti oùelle organise <strong>de</strong>s sections féminines. Elle assume déjà <strong>de</strong>s responsabllItèsImportantes au bureau local et au bureau national. A chaqueélection elle se comporte en militante : en 1932, elle mobilise àMarseille. avec l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s syndicats chrétiens, <strong>de</strong>s orateurs et oratricesen vue d'une campagne : elle distribue <strong>de</strong>s tracts jusqu'aux portes <strong>de</strong>susines : elle parle elle-même pour soutenir un candidat.Pourtant elle n'a pas les coudèes franches : elle ne peut s'exprimerque sous le contrôle d'un état major masculin sourcilleux. A proposdu vote <strong>de</strong>s femmes, elle entre en conflit avec certains dirigeants trèsattachés au vote familial (une volx par enfant pour le père). Elledénonce le suffrage familial. conception organlciste qui effa cel'individu. Pour elle. seul le vote Individuel est démocratique. Elle5. Région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur.6. Entretien avec Michel Chauvière, 1980.7. P. LETAMENDlA, La démocratie chrétienne, PUF, Que sais-je, Parts, 1977.
72 Gennaine Poinso-Chapuispublie alors une brochure <strong>de</strong> 33 pages : Pourquoi nous sommespartisans du suffrage fé minin. modèle parfait d'argumentation suffragiste.Finalement le PDP s'est mal implanté dans les Bouches duRhône. Germaine Chapuis y a vécu une expérience personnellenullement exaltante mais très formatrice.L'engagement dans la résistWlceEn Juin 1940, elle fut <strong>de</strong> ceux et celles qui ont immédiatementrefusé l'armistice et le gouvernement <strong>de</strong> Vichy. Son engagement dansla Résistance n'a pourtant pas été immédiat. Elle avait mis au mon<strong>de</strong>en 1938 son premier fils, né infirme ; elle hésitait <strong>de</strong>vant d'autres responsabilités.C'est pour rendre service à divers amis qu'elle a bientôtcommencé à défendre en Justice <strong>de</strong>s • terroristes ", désignés commetels par le nouveau régime : communistes, gaullistes, étrangers réfugiésen zone libre. Elle a aussi, comme avocate, visité les prisons etfacilité <strong>de</strong>s évasions. Elle a caché <strong>de</strong>s Juifs, hébergé <strong>de</strong>s maquisards,et pris <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> plus en plus graves, • l'estomac tordu par lapeur ", refusant <strong>de</strong> connaître les noms <strong>de</strong>s responsables <strong>de</strong> réseauxpour ne pas risquer <strong>de</strong> les nommer sous la torture ...Aussi en 1944-45, le Comité départemental <strong>de</strong> Libération luiimposa-t-tl d'importantes responsabtlttés : elle fut notamment viceprési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Délégation municipale <strong>de</strong> Marseille du 30 août 1944au 24 avril 1945, soit pendant la durée <strong>de</strong> sa secon<strong>de</strong> grossesse (sonsecond fils est né le 10 mai 1945 : l'enfant <strong>de</strong> la victoire). Doublegestation si l'on peut dire, car pendant ces huit mois elle s'employasans relâche à restaurer la vie publique et à remettre en marchel'administration municipale.Au MRP : une indépendWlce d'esprit qui ne plaît pas à tousPendant ce temps un nouveau parti politique issu <strong>de</strong> la Résistance,le Mouvement Républicain Populaire (MRP), s'organisait pour releverle drapeau <strong>de</strong> la démocratie chrétienne. Germaine Poinso-Chapuis yadhéra au début <strong>de</strong> 1945. Si elle accepta d'être portée sur la listeélectorale locale (élections à l'Assemble Constituante 21 octobre 1945)- en secon<strong>de</strong> position - c'est parce qu'elle pensait n'avoir aucune
Yvonne Knibiehler 73chance d'ètre lue. la démocratie chrétienne n'ayant jamais eu <strong>de</strong>succès dans le Midi. Divine surprise : le MRP eut <strong>de</strong>ux sièges! Stupéfaiteet désemparée (elle ne voulait pas quitter sa famille). GermainePoinso-Chapuis dut cé<strong>de</strong>r à la pression <strong>de</strong> ses amis, Elle espérait n'enavoir que pour quelques mois - le temps <strong>de</strong> rédiger une constitution.Mais par suite <strong>de</strong> défaillances locales. elle dut en fait rester candidate.et elle représenta les électeurs <strong>de</strong>s Bouches du Rhône pendant dixans.Ses relations avec ses amis politiques ont toujours été étrangementambivalentes : proches et chaleureuses dans le domaine théorique.plus distantes et parfois difficiles dans la pratique. Le programme duMRP lui était infiniment sympathique. Les fondateurs. jeunes etar<strong>de</strong>nts. exprimaient un vif désir <strong>de</strong> renouveau dans l'euphorie <strong>de</strong> laLibération. au seuil d'un mon<strong>de</strong> à reconstruire. Dépasser enfin lesantagonismes ancestraux. éliminer le vieux conservatisme catholique.désarmer l'anticléricalisme. intégrer dans la République les principesdu catholicisme social avec l'espoir <strong>de</strong> régénérer <strong>de</strong> fond en comble lavie politique : tels étaient leurs objectifs. Autre mérite : le Mouvements'ouvrait largement aux fe mmes : il présenta presque 10% <strong>de</strong> fe mmesparmi les candidats aux élections du 21 octobre 1945.Mais <strong>de</strong>ux malentendus ont bientôt posé problème pour l'éluemarseillaise : les alliances politiques et la politique familiale, Pendantla Résistance. elle s'était attachée à l'idéal du • travaillisme français "• Nous en étions imbus. Pour nous. gouverner avec les socialistesc'était un point doctrinal... Non pas les marxistes. mais <strong>de</strong>s socialisteshumanistes .. Une alliance entre le parti socialiste et le MRPpermettrait. croyait-elle. <strong>de</strong> constituer une force <strong>de</strong> gouvernement quirésisterait à la droite gaulliste et aux communistes. Germaine PolnsoChapuis cultivait fidèlement ses amitiés socialistes. notamment avecGaston Defferre8• son confrère au barreau <strong>de</strong> Marseille. et surtouthéros <strong>de</strong> la Résistance. mals aussi avec bien d'autres ministrables <strong>de</strong>gauche.Cette alliance idéale butait sur <strong>de</strong>s oppositions insurmontables :les républicains populaires voyaient les dirigeants socialistes comme8. Gaston Deferre fu t maire <strong>de</strong> Marseille <strong>de</strong>puis 1953 jusqu'à sa mort en 1986.
74 Germaine Poinso-Chapuis<strong>de</strong>s politiciens corrompus, les socialistes voyaient les républicainspopulaires prisonniers du cléricalisme. Il est vrai que la querellescolaire sapait les rapprochements ; les dirigeants du MRP voulaientdéfendre 1 récole libre " c'est-à-dire privée et souvent confessionnelle.Certes, Germaine Polnso-Chapuis, qui n'avait fréquenté que <strong>de</strong>s1 écoles libres ", ne leur était nullement hostile. Mals pour elle letravaillisme passait d'abord, et elle voulait ménager les socialistes.C'est d'ailleurs la question scolaire qui a causé la chute duministère auquel elle participait. Le chef du gouvernement, RobertSchuman, voulait que son ministre <strong>de</strong> la Santé et <strong>de</strong> la Populationsigne un décret favorable aux familles clientes <strong>de</strong>s écoles catholiques,celle-cl résista. Robert Schuman signa le décret lui-même, l'opposition<strong>de</strong> la gauche provoqua un vote <strong>de</strong> défiance, et Robert Schuman dutdémissionner. Le comble, c'est que la responsabilité du décret futimputée à Germaine Poinso-Chapuis qui n'en avait pas voulu : lagauche la frappa d'ostracisme, elle ne fu t plus Jamais ministre.L'autre motif <strong>de</strong> querelle entre l'état-major du MRP et cette femmeopiniâtre fu t la politique familiale. Le MRP voulait être avant tout leparti <strong>de</strong> la famille et l'élue marseillaise disait partager tout à fait cetengagement. C'est d'ailleurs â elle que le parti confia en 1950 larédaction d'un Important rapport qui <strong>de</strong>vait servir <strong>de</strong> base â l'actionpolitique. Elle produisit un texte qualifié par ses amis <strong>de</strong> 1 magistral .et qui resta en effet une référence,Mais en méme temps, députée ou ministre, elle déposait <strong>de</strong>s propositionsou <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> lois visant â protéger les femmes divorcéeset les enfants naturels, â assurer l'indépendance économique <strong>de</strong> lafemme mariée (grâce au régime <strong>de</strong> séparation <strong>de</strong>s biens), â limiterdans certains cas la puissance paternelle, à favoriser le travail professionnel<strong>de</strong>s fe mmes, mères comprises. Beaucoup <strong>de</strong> républicainspopulaires, famillalistes à tous crins, restaient très attachés à l'idéal<strong>de</strong> la mère au foyer et comprenaient mal les mesures, à leurs yeuxdissi<strong>de</strong>ntes, proposées par la députée <strong>de</strong>s Bouches du Rhône, Lemilitantisme féministe <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière entrait en collision avec sonmilitantisme démocrate chrétien.Germaine Poinso-Chapuis fu t aussiune ar<strong>de</strong>nte militante
Yvonne Knibiehler 75européenne. Elle attaqua violemment. à la Chambre et dans la presse.Pierre Mendès-France qui avait renoncé à faire aboutir laCommunauté européenne <strong>de</strong> défense (CEE).Battue aux législatives en janvier 1956. elle dépensa ensuite sonénergie dans le cadre municipal (elle avait été élue conseillèremunicipale à Marseille en 1953 et le resta jusqu'en 1959). Plus tard.quand les institutions régionales commencèrent à prendre forme. ellefu t nommée par le préfet membre du Conseil économique et social <strong>de</strong>l'Etablissement public régional <strong>de</strong> Provence (1975). Elle y siégeaassidûment. multipliant les interventions. proposant <strong>de</strong>s idées pouractiver la lutte contre le chômage. toujours infatigable.La protection <strong>de</strong>s enfantsDès ses débuts au barreau <strong>de</strong> Marseille. ma<strong>de</strong>moiselle Chapuisavait rencontré un <strong>de</strong> ses aînés les plus respectés. Albert VidalNaquet. Ce grand pionnier s'était penché sur le sort <strong>de</strong>s enfants délinquants.on le considérait comme le « père - <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> 1912 qui avaitinstitué les tribunaux pour enfants. Au début <strong>de</strong>s années 20. découvrantau palais l'allant et l'efficacité <strong>de</strong> maître Cha puis. il sollicita sonconcours et l'obtint sans peine. Investie avec fougue au service <strong>de</strong>s« enfants <strong>de</strong> justice -. la jeune avocate ne tarda pas à constater queces malheureux étaient souvent <strong>de</strong>s victimes. mal nourris. mal traités.mal aimés. Elle eut d'ailleurs aussi à connaître. au tribunal. <strong>de</strong>senfants martyrs. Une <strong>de</strong> ses amies raconte l'avoir vue un jour sortir enlarmes du palais. bouleversée par la souffrance d'un enfant battu :1 Tant qu'il y aura un seul enfant malheureux comme celui-ci. il mesera impossible <strong>de</strong> m'arréter -. Elle ne s'est plus Jamais arrétée.Maître Vidal-Naquet avait créé un Comité <strong>de</strong> défense <strong>de</strong>s enfantstraduits en justice dont elle <strong>de</strong>vint « secrétaire -. Elle le transformabientôt en un Comité <strong>de</strong> protection au sein duquel elle sut réunir <strong>de</strong>spersonnalités très différentes par leurs origines et leurs convictions(un religieux dominicain y faisait équipe avec un franc-maçon agressif.un communiste travaillait avec un « action française - !J. Ce comitétenait <strong>de</strong>s permanences et menait <strong>de</strong>s enquètes sociales pour dépisterla maltraitance et les risques <strong>de</strong> délinquance.
Yvonne Knibïeh1er 77Germaine Chapuis a d'abord réalisé elle-même ces enquêtes : elle ya beaucoup appris sur les conditions <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s familles marginales,sur leur misêre et leur préCarité, sur les taudis, sur l'alcoolisme, surla brutalité <strong>de</strong>s mœurs, Leçons que l'on n'oublie pas, et qui ontensuite inspiré ses programmes,Un intérêt précoce pour l'erifance • inadaptée .Ces activités l'ont mise en relation non seulement avec le juge <strong>de</strong>senfants mais aussi avec <strong>de</strong>s psychiatres qui commençaient às'intéresser aux enfants . inadaptés -, Des équipes <strong>de</strong> réflexion se sontconstituées, En 1936, Germaine Poinso-Chapuis entra en contact avec<strong>de</strong>s membres du gouvernement du Front Populaire, Suzanne Lacoresous-secrétaire d'Etat à la protection <strong>de</strong> l'Enfance, Henri Sell1erministre <strong>de</strong> la Santé ; elle leur <strong>de</strong>mandait <strong>de</strong>s moyens pour améliorerle sort <strong>de</strong>s enfants en prison mais elle put aussi observer leurs effortspour réorganiser les services sociaux et coordonner l'action <strong>de</strong>s institutionspubliques et privées en vue <strong>de</strong> doter le pays d'un véritablearmement sanitaire,Pendant l'Occupation, le Comité <strong>de</strong> protection qu'elle pilotaitaccue1llit <strong>de</strong> nombreux enfan ts <strong>de</strong> parents • recherchés -, enfantsd'étrangers, <strong>de</strong> communistes, <strong>de</strong> Juifs, <strong>de</strong> Tsiganes, <strong>de</strong> résistants, Cesenfants furent envoyés à la campagne . pour raison <strong>de</strong> santé - ou biencachés ici et là,A la Libération, Germaine Poinso fu t élue prési<strong>de</strong>nte d'une institutionébauchée sous Vichy et réorganisée en 1945 : l'Association régionale<strong>de</strong> Sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enfance et <strong>de</strong> l'Adolescence (ARSEA) qui <strong>de</strong>vaitregrouper toutes les œuvres privées et publiques <strong>de</strong> ce secteur,D'autres régions se sont également dotées d'ARSEA. Après quatreannées <strong>de</strong> privations et d'épreuves, l'urgence <strong>de</strong>s besoins en particulierdu côté <strong>de</strong> l'enfance effrayait les responsables,Devenue députée puis ministre, Germaine Poinso-Chapuis nourritquelque temps le projet <strong>de</strong> créer un ministère <strong>de</strong> l'Enfance réunissant<strong>de</strong>s services <strong>de</strong> santé, <strong>de</strong> justice et d'éducation, Ce fu t impossible,chacun <strong>de</strong>s ministères concernés refusant <strong>de</strong> se dépouiller d'unepartie <strong>de</strong> ses attributions, A défaut d'une institution nouvelle, elle
78 Germaine Poinso-Chapuisessaya d'imposer partout le concept <strong>de</strong> prévention ; 11 n'était pasnouveau mais elle lui conféra une extension et une autorité inédites,Elle rêvait d'en faire l'étoile polaire <strong>de</strong>s travailleurs sociaux. <strong>de</strong>s jugeset <strong>de</strong>s enseignants, Sur la proposition d'un psychiatre <strong>de</strong> Montpellier.le professeur Lafon. elle organisa une fédération <strong>de</strong>s ARSEA. l'UnionNationale <strong>de</strong>s Associations régionales (UNAR) qui tint congrès chaqueannée dans une ville différentes pendant les années 60, Ces congrèsont été un creuset d'Information, La profession d'éducateur. parexemple. a trouvé ses structures et sa définition au cours <strong>de</strong> cesdébats,Le fils aîné <strong>de</strong>s Polnso était né infirme en 1938 et son infirmitén'avait fait que s'aggraver au fil <strong>de</strong>s ans, Aussi sa mère a-t-elleconcentré peu à peu l'essentiel <strong>de</strong> son attention sur ceux que l'onappellera désormais les • handicapés 1 pour les distinguer <strong>de</strong>s• inadaptés ". ce <strong>de</strong>rnier mot désignant plutôt les caractériels et lesdélinquants,Après la Libération, <strong>de</strong>s conditions tout à fait nouvelles permettaientd'imaginer une véritable croisa<strong>de</strong> au service <strong>de</strong> ces malheureux,L'Etat Provi<strong>de</strong>nce, en installant la Sécurité sociale, remet enquestion toutes les fo rmes traditionnelles d'assistance ; il oblige lesœuvres privées à repenser leurs objectifs. à réviser leur fonctionnement.Germaine Poinso-Chapuis. darne d'œuvres et femme d'Etat. afermement accompagné sinon dirigé cette mutation, La Sécuritésociale dégageait <strong>de</strong>s ressources qu'on pouvait croire illimitées. Enméme temps <strong>de</strong>s progrès rapi<strong>de</strong>s en neurologie et en psychiatriedonnaient <strong>de</strong>s armes nouvelles aux soignants.Tout était à faire et même à inventer. C'était le début d'une exploration,l'entrée dans un champ nouveau d'étu<strong>de</strong>s. <strong>de</strong> réflexions, <strong>de</strong> découvertes.Comment équiper <strong>de</strong>s établissements pour <strong>de</strong>s besoinsdivers. encore mal connus. mal évalués ? Comment recruter et former<strong>de</strong>s personnels compétents ? Comment inspirer confiance à <strong>de</strong>sfamilles meurtries. humiliées. habituées à cacher ce qui était encoreconsidéré comme une tare ?
Yvonne Knibiehler 79Les vertus <strong>de</strong> la voie associativeAprès 1956. dégagée <strong>de</strong> ses mandats politiques. madame Poinsos'est efforcée <strong>de</strong> rencontrer les parents d'enfants handicapés. Parexpérience. elle connaissait la torture morale parfois insoutenablequ'Us enduraient. Elle les a constamment encouragés à se rencontrer.à s'associer. à créer <strong>de</strong>s établissements d'accueil. Forte <strong>de</strong> sesrelations. elle les aidait à trouver <strong>de</strong> l'argent. <strong>de</strong>s locaux. <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cinsdécidés à s'investir. Bientôt les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s se sont faites nombreuseset pressantes. les ressources <strong>de</strong> la Sécurité sociale paraissant inépuisables.Les parents ont commencé à refuser l'irréparable ; ils ont crupossible sinon la guérison du moins l'amélioration du sort <strong>de</strong> leurenfant infirme.Peut-on appliquer le principe <strong>de</strong> prévention au handicap ? Oui. Onpeut prévenir l'isolement. le renoncement. le désespoir. On peut. ondoit considérer l'enfant déficient comme un humain à part entière etnon comme un déchet : le respecter et le fa ire respecter ; obtenir pourlui non seulement le soin <strong>de</strong> son corps mais aussi <strong>de</strong>s moyensd'Insertion sociale. le maximum d'autonomie. une parfaite dignité.Les ARSEA <strong>de</strong>vinrent en 1964 <strong>de</strong>s CREAI (Centres Régionaux <strong>de</strong>l'Enfance et <strong>de</strong> l'Adolescence inadaptées) avec <strong>de</strong>s moyens renforcés.Le CREAI <strong>de</strong> la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. présidé parGermaine Poinso-Chapuis. a fa it preuve d'un dynamisme exceptionnel.Il a créé une trentaine d'institutions entre 1956 et 1975.L'esprit d'initiative et la pugnacité <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>nte ont fait merveille.Elle a aussi infusé à 1 son " CREAI son intense curiosité. son goûtpour la recherche. les idées nouvelles. le débat permanent. Au cours<strong>de</strong>s années 50. elle a su entendre les spécialistes d'avant gar<strong>de</strong> quiremettaient en question les anciens principes <strong>de</strong> soin. Au début <strong>de</strong>sannées 70. elle a accueilli l'idée. alors révolutionnaire. d'intégration.qui consistait à tout fa ire pour que l'in firme puisse vivre dans lasociété dite 1 normale ". dans les écoles publiques. dans les centresd'apprentissage. dans les ateliers et autres lieux <strong>de</strong> travail.Grâce au progrès <strong>de</strong>s soins. l'espérance <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s handicapés necessait <strong>de</strong> croître. Madame Poinso songea donc à fo n<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s centresd'accueil pour adultes. L'un d'eux. qui accueillait son propre fils. lui
80 Germaine Poinso-Chapuisfut particulièrement cher. le Centre Bellevue. où s'est installéel'Association <strong>de</strong>s Foyers et Ateliers pour Handicapés (AFAH) ,Par décision <strong>de</strong> l'ONU. l'année 1981 <strong>de</strong>vait être l'année <strong>de</strong>s handicapés,Germaine Poinso-Chapuis se mit à préparer avec allégressel'inauguration du Centre Bellevue pour mars 1981. Afin <strong>de</strong> lui donnerle maximum d'importance et <strong>de</strong> visibilité. elle avait mobilisé unministre. le préfet <strong>de</strong> la région et le député maire <strong>de</strong> Marseille quis'étalent engagés à être présents, Elle n'a pas connu cette ultimesatisfaction : elle est morte subitement d'une crise cardiaque dans lenuit du 18 au 19 février 1981.Personnalité novatrice. généreuse. injustement oubliée. elle mérite<strong>de</strong> retrouver une place dans la mémoire collective,Orientation bibliographiqueY. KNIBIEHLER (dir.), Gennaine Poinso'Chapuis Femme d'Etat 1901-1981,Association Les femmes et la ville, Editions Edisud, 1999. L'ouvrage, publié surbase du colloque tenu à Marseille les 20-22 novembre 1997, • GermainePolnso-Chapuls, témoin <strong>de</strong> son temps ., comporte les titres <strong>de</strong>s différentescommunications (pp. 156- 1 57).S. ARNAUD, Gennaine Poinso-Chapuis, une MarseUlaise en politique, mémoire<strong>de</strong> maîtrise, Histoire, <strong>Université</strong> <strong>de</strong> Provence, 1995.F. BAZIN, Les députés MRP 1945-1 946. Itinéraire politique d'une générationcatholique, Presses <strong>de</strong> la fondation nationale <strong>de</strong>s Sciences politiques, 1981.J.-C. DELBREIL, Centrisme et démocratie chrétienne en France. Le Parti démocratepopulaire <strong>de</strong>s origines au MRP 1919-1944, Publications <strong>de</strong> la Sorbonne,Paris, 1990.P. GUIRAL et F. RAYNAUD (dlr.) Les MarseUlais dans l'histoire, Privat.Toulouse, 1988.
Yvonne Knibieh1er 81C. MARAND-FOUQUET, • La Résistance <strong>de</strong> Germaine Polnso-Chapuis ",Femmes InJo , Revue du CODIF, Marse1lle, n082, printemps 1998.P. QUINCY-LEFEBVRE, Une histoire <strong>de</strong> l'erifance dWicUe, 1800 à.fin <strong>de</strong>s années3D, Economlca, 1997.J. ROCA, De la ségrégation à l'intégration. L'éducation <strong>de</strong>s erifants inadaptés <strong>de</strong>1909 à 1975, Pub!. du Centre technique national d'étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> recherches surles handicaps et les inadaptations (CTNRHI) , PUF. Paris. s.d.
Viviane Di TIllio 83La Fédération belge<strong>de</strong>s Femmes universitairesNaissance et essor (1921-1940f•Viviane Di TillioLe souvenir <strong>de</strong> la guerre et l'influence internationaleEn 1918. après une guerre longue et atroce. où les pertes humaines.matèrielles et fmancières furent énormes. les peuples aspirent àla paix. Les fe mmes. qui ont largement participé à l'effort <strong>de</strong> guerre.enten<strong>de</strong>nt bénéficier <strong>de</strong>s importants changements qui se <strong>de</strong>ssinentdans une société traversée par un vaste mouvement <strong>de</strong> démocratisation2•Celles qui entreprennent <strong>de</strong>s ètu<strong>de</strong>s universitaires sont. toutesproportions gardées. <strong>de</strong> plus en plus nombreuses. Elles éprouventrapi<strong>de</strong>ment le besoin <strong>de</strong> se grouper en tant que fe mmes instruites etcultivées dans une socièté encore très fortement androcentrique. quin'admet que difficilement leur accès aux professions libérales. encoreplus difficilement leur affirmation dans la vie publique.L'influence anglo-saxonne. et tout particulièrement celle <strong>de</strong> l'InternationalFe<strong>de</strong>ration of University Women (IFUW) est dèterminante. Les1. Cet article s'Inspire en partie du mémoire <strong>de</strong> licence Inédit : V. DI TILLIO. LaFédération belge <strong>de</strong>s fe mmes diplômées <strong>de</strong>s Univers ités. Mém. Lie., Histoire.ULB. 1998.2. D. KEYMOLEN et M. -Th. COENEN. Pas à pas. L'histoire <strong>de</strong> l'émancipation <strong>de</strong>lafemme en Belgique. <strong>Bruxelles</strong>. 1991. p, 51.
84 La Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes Wliversitairesfemmes universitaires <strong>de</strong>s pays anglo-saxons s'étaient précocementorganisées : aux Etats-Unis. l'American Association of CollegiateAlumnae regroupant <strong>de</strong>s diplômées <strong>de</strong>s universités du Nord existe<strong>de</strong>puis 1882 tandis que l'Association of American College fait <strong>de</strong> mêmepour les diplômées <strong>de</strong>s universités du Sud. Autour <strong>de</strong> CarolineSpurgeon 3 et <strong>de</strong> Dean Virginia Gil<strong>de</strong>rsleeve 4 • <strong>de</strong>s déléguées <strong>de</strong>l'Association of Collegiate Alumnae. <strong>de</strong> la British Fe<strong>de</strong>ration of UniversityWomen et <strong>de</strong>s Associations canadiennes jettent les bases <strong>de</strong>l'IFUW en Angleterre le Il juillet 1919 5 • Les statuts et le programmesont arrêtés à Londres l'année suivante. en juillet 1920. par lesdéléguées <strong>de</strong>s six pays fondateurs : les Etats-Unis. la Gran<strong>de</strong>Bretagne. le Canada auxquels se sont joints la France. l'Espagne et les6Pays-Bas . La FBFU s'y affilie officiellement en 1922.Dès sa fondation. l'objectif principal <strong>de</strong> l'IFUW est double : d'unepart développer l'éducation <strong>de</strong>s femmes. faciliter les liens et la solidaritéentre les diplômées <strong>de</strong> différents pays par <strong>de</strong>s échanges <strong>de</strong> professeures.<strong>de</strong> conférencières et d'étudiantes. (notamment grâce à <strong>de</strong>sbourses internationales d'étu<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> voyage), permettre ainsi auxfemmes instruites. passées par l'enseignement supérieur. <strong>de</strong> s'exprimer.d'autre part <strong>de</strong> promouvoir un idéal <strong>de</strong> paix et <strong>de</strong> progrès. <strong>de</strong>travailler à la reconstruction <strong>de</strong> la civilisation occi<strong>de</strong>ntale et d'éviter à7tout priX une nouvelle guerre .Si l'idéal éducatif est prioritaire. l'aspect pacifiste. toujourssouligné 8 • suscitera <strong>de</strong> nombreuses affiliations. Mais seule la coopéra-3. Caroline Spurgeon : professeure <strong>de</strong> littérature anglaise à l'université <strong>de</strong>Londres. la premlére femme à avoir occupé une chaire d'université en Gran<strong>de</strong>Bretagne (Service <strong>de</strong>s Archives <strong>de</strong> l'ULB, 7 RR 38. D, PURVES, .919-1979: 60years slnce the Blrth of IFUW ., ln IFUW Newsletter, n° 39, July 1979, P 3), Elleprésida l'IFUW <strong>de</strong> 1920 à 1924. (Who was who? 194 1-1950, vol. 4, Londres,1952, p. 1089).4, Dean Vlrglnla Gil<strong>de</strong>rsleeve: professeure au Barnard College <strong>de</strong> la ColumbiaUniversity <strong>de</strong> New-York, prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> l'IFUW <strong>de</strong> 1924 à 1926 et <strong>de</strong> 1936 à1939. (Who was who? 1961-1970, vol. 6, Londres, 1972, p, 427),5. CEGES, Papiers G. Hannevart, PH 14, C, nO ' 28, archives <strong>de</strong> l'IFUW : W.TRYON, American Association of University women: 1881,1949, Washington,1950, p. 43.6. A. SCOUVART, Les fédérations <strong>de</strong> fe mmes universitaires, 2ème année,<strong>Bruxelles</strong>, 1924. p. 4.7. CEG ES, Papiers G. Hannevart, PH 14, C, n027, archives <strong>de</strong> l'IFUW:Fédération Internationale <strong>de</strong>s Femmes Diplômées <strong>de</strong>s <strong>Université</strong>s. Statuts etrèglements: révision adoptée par le 6ème congrès à Edimbourg, juillet 1932.8 . • Rapport sur l'activité du comité <strong>de</strong>s relations Internationales ., Bulletin <strong>de</strong>la FBFU, 1ère année, <strong>Bruxelles</strong>, 192 1-1923, p. 13 : Service <strong>de</strong>s Archives <strong>de</strong>
86 La Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes WliversitairesElle reçoit une éducation soignée etpoursuit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>sd'institutrice à Mons - 1 les seules qui s'offrissent à une femme en cestempslà .12,Avi<strong>de</strong> <strong>de</strong> connaissances. elle déci<strong>de</strong>. tout en enseignant. <strong>de</strong> préparerl'examen d'entrée à l'<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>, Elle s'inscrit en1881 à la Faculté <strong>de</strong>s Sciences et obtient son doctorat en 1885. Troisans plus tard. en 1888, elle entreprend <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine qu'elletermine en 1894 avec gran<strong>de</strong> distinction l 3 • Elle part ensuite se spécialiseren orthopédie à àl'étranger. Berlin. Paris. Vienne surtout.Rentrée à <strong>Bruxelles</strong>. classée première au Concours universitaire <strong>de</strong>1895. elle ouvre un cabinet privé··. Depuis peu en effet. les femmesavalent été admises à exercer la mé<strong>de</strong>cine (loi du 10 avril 1890). endépit <strong>de</strong> l'opposition d'un corps médical largement acquis à l'idée quela femme est inférieure et que l'exercice d'une profession est incompatibleavec sa mission d'épouse et <strong>de</strong> mère 1 5.Marie Derscheid. qui a entre-temps épousé un brillant confrère. ledocteur Albert Delcourt l6 mène une carrière exemplaire. Son cabinetprivé est rapi<strong>de</strong>ment réputé. mais elle exerce aussi à l'Hospice <strong>de</strong>sEnfants Assistés jusqu'en 1898 où une section <strong>de</strong> gymnastiqueorthopédique et <strong>de</strong> massage est fondée à son initiative. Puis <strong>de</strong> 190 1 à1911. elle exerce à l'Hospice <strong>de</strong>s Orphelines l7 • 1 L'orphelinat peupléexclusivement <strong>de</strong> jeunes filles. écrit-elle, offre un champ d'activité toutindiqué pour une femme mé<strong>de</strong>cin .18 ,12. Bulletin .... , • Rapport 193 1- 1932 et 1932- 1933 ", p. 4. AVB, InstructionPublique, Dossiers personnels, 176/7.13. Archives ULB, Registre <strong>de</strong>s Inscriptions, n057 10. Voir aussi D. KEYMOLEN,• Les premléres femmes mé<strong>de</strong>cins en Belgique 1873- 19 14) " dans CahiersMarxistes. aoüt septembre 1993, n0 191. pp. 127- 146,14. Ce qui est rare à J'époque. Avant 1920, sur 1079 mé<strong>de</strong>cins exerçant à<strong>Bruxelles</strong>, on ne dénombre que onze femmes (D. NOLTINCKX. Les femmesmé<strong>de</strong>cins à <strong>Bruxelles</strong>, Mémoire <strong>de</strong> licence, Histoire, ULB, 1994, annexes 6 et 7),15. A. DESPY, • Les femmes dans le mon<strong>de</strong> universitaire ", dans A. MORELLI etY. MENDES DA COSTA (éd.) Femmes, libertés, laïcité, Ed. ULB, <strong>Bruxelles</strong>,1989, p. 49.16. Albert Delcourt (1868- 1938), docteur en mé<strong>de</strong>cine en 1893, agrégé en 1898puis professeur à l'<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>. Il créa en 1922 la Société belge<strong>de</strong> Pédiatrie dont il fu t secrétaire général Jusqu'à sa mort (ULB. Rapport surl'année académique 1937-1938, <strong>Bruxelles</strong>, 1939. pp. 110- 1 12 : Le Scalpel. 24septembre 1938, pp. 625-626).17. Archives du CPAS <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>, Fonds ' Personnel médical ",Dossier M. Derscheld-Delcourt.18. Lettre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> nomination à l'Hospice <strong>de</strong>s Orphelines. 19 décembre1900, Archives du CPAS <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>, Ibi<strong>de</strong>m.
Viviane Di TIlliD 87Durant la Première Guerre, elle exerce également comme mè<strong>de</strong>cininspectrice <strong>de</strong>s Ecoles <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>, à titre temporaired'abord, définitif à partir <strong>de</strong> 1919, à une époque où les femmesaccédaient rarement à cette fonction 19 , Elle l'occupe jusqu'en 1928,date à laquelle elle démissionne pour raison <strong>de</strong> santé,En revanche, elle s'était abstenue <strong>de</strong> postuler un mandat <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin<strong>de</strong>s pauvres car selon elle « 11 est difficile pour une femme mé<strong>de</strong>cin<strong>de</strong> remplir ces fonctions ,']J), Membre <strong>de</strong> la Société belge <strong>de</strong> Chirurgie,vice-prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Société belge d'Orthopédie, elle fut l'une <strong>de</strong>schevilles ouvrières <strong>de</strong> l'Ecole supérieure <strong>de</strong> Kinésithérapie fondée en1926 21 ,Ses activités furent reconnues, en Belgique (elle est chevalier <strong>de</strong>l'Ordre <strong>de</strong> Léopold) mais aussi à l'étranger. C'est ainsi que, passantréguliérement l'hiver en Afrique du Nord pour <strong>de</strong>s raison <strong>de</strong> santé, ellesoigna les femmes du harem du Bey <strong>de</strong> Tunis, ce qui lui valut d'étrenommée Officier du Nicham IfUkar 22 ,Bien qu'elle n'aie pas souffert elle-méme <strong>de</strong>s préjugés que rencontraientla plupart <strong>de</strong>s femmes mé<strong>de</strong>cins 23 , elle est consciente <strong>de</strong>leur persistance. Féministe, elle combat . pour que la femme ait uneliberté plus gran<strong>de</strong>, une dignité plus consciente, une vie plus intelligenteet plus vaste ,24 et se dépense sans compter pour favoriser ledéveloppement intellectuel et moral <strong>de</strong>s femmes et hâter leur émancipation25 ,19, En 1925, sur 22 mé<strong>de</strong>cins inspecteurs à <strong>Bruxelles</strong>. on compte ... troisfemmes (D. NOLTINCKX. Les fe mmes mé<strong>de</strong>cins à <strong>Bruxelles</strong> . .. . p. 191).Pourtant, dès 1916, un candidat se plaint qu'il y a déjà . assez bien <strong>de</strong>nominations <strong>de</strong> dames mé<strong>de</strong>cins ... On est donc fondé à penser qu'il serait justeet équitable <strong>de</strong> nommer un mé<strong>de</strong>cin , (lettre du Dr Boisseau. juillet 1916 dansAVE. Dossiers personnels .... fonds cité).20. Lettre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> nomination ... 19. 12. 1900. document cité.21. Etablissement subventionné par la Ville <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> et la province <strong>de</strong>Brabant, organisé sur le modéle <strong>de</strong>s écoles suédoises et préparant à la carrière<strong>de</strong> kinésistes ou d'auxilalres médicales en <strong>de</strong>ux ans.22 Le Soir. 5 décembre 1932 . • Av:ts nécrologique " p. 6.23. Sur les difficultés rencontrées par les premières femmes mé<strong>de</strong>cins. voirD. NOLTlNCKX • • Les premières femmes mé<strong>de</strong>cins à <strong>Bruxelles</strong>. Aperçu <strong>de</strong> 1890à nos jours " Sextant. n03. 1994-95. pp. 159- 1 85.24. Bulletin. ... 193 1-32 et 1932-33. pp. 5-6.25. Nelly- Jean LAMEERE . • Le Docteur Marie Derscheld-Delcourt '. Bulletin ....193 1-32 et 1932-33. p. 5.
88 La Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes universitairesC'est dans <strong>de</strong> but qu'elle met sur pied, en octobre 1921, la Fédérationbelge <strong>de</strong>s Femmes universitaires 26 • dont la naissance est officiellementconsacrée l'année suivante par son affiliation à la FédérationInternationale,Une association spécifique qui répond à un besoin ?La FBFU. dont le siège est à <strong>Bruxelles</strong>, regroupe <strong>de</strong>s femmesdiplômées <strong>de</strong>s universités du pays, qu'elles soient candidates, licenciéesou docteures 27 , La plupart sont <strong>de</strong>s jeunes qui adhèrent à laFédération dès l'obtention <strong>de</strong> leur diplôme, mais on y trouve aussi lesaînées, qu'elles aient ou non exercé une profession,Dans l'entre-<strong>de</strong>ux-guerres, la Fédération répond sans nul doute àun besoin, du moins si l'on se réfère au succès qu'elle rencontre.Certes, la FBFU ne regroupe qu'une partie <strong>de</strong>s femmes universitairesbelges dont le nombre a fluctué au cours du temps en fonction <strong>de</strong>scirconstances. Mais <strong>de</strong> 1921 à 1940, le nombre <strong>de</strong> ses membres esttendanciellement à la hausse.Nombre <strong>de</strong> membres <strong>de</strong> la FBFU 1921-1940année membres année membres année membres192 1 119 1928 317 1935 4391922 119 1929 307 1936 4781923 119 1930 254 1937 50 11924 160 1931 366 1938 5701925 220 1932 388 1939 5571926 194 1933 388 1940 6421927 317 1934 415Sans point <strong>de</strong> comparaison, ces chiffres sont peu significatifs. Parrapport aux autres fédérations européennes, créées pratiquement à lamème époque (1920- 1922), la Belgique se situe dans une bonne26 . • Histoire <strong>de</strong> la FBFU " Bulletin. ... 50ème annèe 1972, 1. p. 5.27 Il s'agit là d'une distinction actue\1e. Dans l'entre-<strong>de</strong>ux·guerres, les étu<strong>de</strong>suniversitaires ne connaissent que <strong>de</strong>ux gra<strong>de</strong>s : les candidatures et le doctorat.La thèse <strong>de</strong> doctorat permet, elle, d'accé<strong>de</strong>r au titre d'agrégé <strong>de</strong> l'enseignementsupéIieur ou au titre <strong>de</strong> docteur spécial (droit et mé<strong>de</strong>cine).
Viviane Di Tillio 89moyenne. En 1925, en effet, on compte 290 membres actifs en France,150 aux Pays-Bas, 192 en Norvège, 200 en Suè<strong>de</strong>, 235 en Autriche,260 en Suisse 28 •Il est également intéressant <strong>de</strong> rapporter le nombre d'adhérentesau nombre total <strong>de</strong> femmes universitaires en Belgique. Nous avonstoutefois dissocié, dans le tableau qui suit, celles qui firent leurs étu<strong>de</strong>sà l'<strong>Université</strong> catholique <strong>de</strong> Louvain <strong>de</strong> celles qui obtinrent leurdiplôme dans les trois autres universités du pays, à <strong>Bruxelles</strong> 29 , àLiège JO et à Gand 31 • En effet, seul un nombre dèrisoire <strong>de</strong> membresproviennent <strong>de</strong> Louvain (oscillant selon les années entre <strong>de</strong>ux et sept),dans la mesure où une association concurrente est fo ndée en 1935,l'Association <strong>de</strong>s Femmes universitaires catholiques 32 • Celle-ci drainel'essentiel <strong>de</strong>s diplômées louvanistes. Notons aussi que le chiffre globalque nous avons établi comprend également les étudiantes encours d'étu<strong>de</strong>s, ce qui aboutit sans doute à une légère surestimation.Ce choix s'explique par le fait qu'elles pouvaient adhérer à la FBFUdès l'obtention du gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> candidates.Ainsi, méme si la FBFU est loin <strong>de</strong> rallier toutes les diplômées etles étudiantes, elle en réunit, si l'on s'en tient aux trois universités oùelle recrute <strong>de</strong>s membres, un pourcentage très significatif : 29.6% en192 1. 31.7% en 1925, 28,3% en 1930, 36. 1 % en 1935 et 38.5% à laveille <strong>de</strong> la Secon<strong>de</strong> Guerre, en 1939.28. Fédération Internationale <strong>de</strong>s Femmes diplômées <strong>de</strong>s universités. 1924-1926. pp. 11-17.29. A. DESPY-MEYER. • Les étudiantes dans les universités belges <strong>de</strong> 1880 à1941 " . in Perspectives universitaires. vol. III. 1986. n° 1 /2 . p. 33.30, M. CAPELLE . • Les jeunes filles à l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Liége et la carriére <strong>de</strong>sdiplômées. Enquéte relative aux étudiantes <strong>de</strong>s années 1920- 192 1 à 1947 ",Bulletin <strong>de</strong> l'association <strong>de</strong>s amis <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Liège. n° l, 1950, 22"'"année. p. 7.31. De 1921 à 1930 : A-M. SIMON-VAN DER MEERSCH. De eerste generatiesmeisjesstu<strong>de</strong>nten aan <strong>de</strong> Ryksuniversiteit te Gent (1882·1883 tot 1929·1930).Gent. 1982. p. 48. De 1930 à 1945. A VANDENBLICKE. Meisjesstu<strong>de</strong>nten aan<strong>de</strong> Ryksuniversiteit Gent (1930-31-1945/46). Gent. 1987. p. 62.32. Baronne P. BOL et Ch. DUCHESNE. Le féminisme en Belgique. CNFB.<strong>Bruxelles</strong>. 1952. p. 150, Pour l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Louvain. nous avons utilisél'ouvrage <strong>de</strong> L. COURTOIS. J. PIROTTE et F. ROSART. L'introduction <strong>de</strong>sétudiantes à l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Louvain. Tractations préliminaires (1890-1920).Etu<strong>de</strong> statistique (1920- 1940). Louvain-la-Neuve, 1987. p. 80.
90 La Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes WliversitairesNombre total <strong>de</strong> femmes universitaires(diplômées et en cours d'étu<strong>de</strong>s) 192 1-1940année<strong>Université</strong>s <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>,<strong>Université</strong> <strong>de</strong>Total <strong>de</strong>s diplôméesLiège et GandLouvain·et étudiantes192119251930193519394026948961214144541 443119 813224 1120303 1517430 1875• ouverte aux étudiantes <strong>de</strong>puis 1920Remarquons aussi que la progression du nombre d'adhérentes suiten réalité une tendance générale. En effet. jusqu'à la Deuxième GuerreMondiale. on constate une montée très nette <strong>de</strong>s effectifs <strong>féminins</strong>dans toutes les universités du pays due en partie au changement <strong>de</strong>mentalités 33 (Louvain rattrapant assez vite son « retard J), Mais il estIntéressant <strong>de</strong> souligner que le rapport entre le nombre d'adhésions etle nombre <strong>de</strong> femmes universitaires est nettement en hausse entre192 1 et 1939. passant <strong>de</strong> 29% à 38%,Une analyse plus précise <strong>de</strong> l'origine <strong>de</strong>s diplômes montre le poidsparticulièrement Important au sein <strong>de</strong> la FBFU <strong>de</strong>s diplômées <strong>de</strong>l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>, Au vu <strong>de</strong>s chiffres. la FBFU apparaît biencomme une pépinière <strong>de</strong> « Bruxelloises "Provenance <strong>de</strong>s diplômées membres <strong>de</strong> la FBUF 1921-1939année <strong>Bruxelles</strong> Liège Gand Louvain Etranger Indéter. 34192 1 101 7 10 0 01925 150 11 15 4 4 361930 206 15 18 4 11 01935 265 25 25 4 14 1061939 311 26 20 4 17 17933. A. DESPY-MEYER. • Les femmes dans le mon<strong>de</strong> universitaire J, Femmes,Ubertés, /aïcüé ... • p. 51.34. Vraisemblablement parmi ces femmes dont nous n'avons pas pu établiravec précision la provenance. une gran<strong>de</strong> partie est Issue <strong>de</strong> rULB. Ellesrési<strong>de</strong>nt quasi toutes dans la capitale. Cette catégorie. si on pouvait la ventiler.ne changerait probablement pas nos conclusions.
Viviane Di TIllio 91Cette prédominance <strong>de</strong> diplômées <strong>de</strong> l'ULB n'est pas anonnalepuisque la FBFU s'est implantée et s'est développée à <strong>Bruxelles</strong>, Deplus, c'est l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> qui a accue1l1i le plus d'étudianteset qui a décerné le plus <strong>de</strong> diplômes aux femmes pendant cettepérto<strong>de</strong> 35 , su1v1e par les universités <strong>de</strong> Liège et <strong>de</strong> Gand 36 •Cette prédominance se retrouve au sein <strong>de</strong> la Fédération, et plusencore au sein <strong>de</strong>s instances dirigeantes, Sur 66 femmes quicomposèrent le comité national, 60 ont étudié à <strong>Bruxelles</strong> et sont établiesdans la capitale. Seulement trois avalent fait leurs étu<strong>de</strong>s àl'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Gand et trois à l'université <strong>de</strong> Liège.Née à <strong>Bruxelles</strong>, la Fédération avait pourtant essaimé. Dès 1921.<strong>de</strong>s sections locales sont créées. Mals la section bruxelloise <strong>de</strong>meurela plus (la seule) importante dans l'entre-<strong>de</strong>ux-guerres, Elle estscindée en trois commissions : relations internationales, publications,conférences 37 • A Liège, si <strong>de</strong>ux personnalités d'envergure en font partiedès les années vingt, Marte Delcourt 38 et Marguertte Horton-Delchef 9 ,la section, comme celle <strong>de</strong> Gand d'a1lleurs, ne comprend qu'unnombre réduit <strong>de</strong> membres et n'aura <strong>de</strong> réelle activité qu'après laDeuxième Guerre mondiale.L'examen <strong>de</strong>s diplômes obtenus par les membres <strong>de</strong> la FBFU estégalement significatif <strong>de</strong> révolution générale <strong>de</strong> l'accès aux carrières.35. A. DESPY-MEYER . • Les femmes dans le mon<strong>de</strong> universitaire ... '. p. 50.36. I<strong>de</strong>m. p. 52.37 • Reports of national associations and fe<strong>de</strong>ratlons " I.F. U. W Reports of theyear 1922-1923. n° 5, London, 1923. p. 22.38. Marle Delcourt, épouse Curvers (1891-19791 : Docteure en philologieclassique <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Liège en 1919. chargée <strong>de</strong> cours en 1929 dans laméme université. professeure ordinaire en 1945 lA. DESPY-MEYER • • Lesétudiantes dans les universités belges <strong>de</strong> 1880 à 194 1 •. Perspectivesuniversitaires. vol. III. 1986. n° 1/2. p 44. : J. HOYOUX. • Marie Delcourt.1891- 1979 " La vie wallonne. t. 53. 1979. p. 46.39. Marguerite Horion-Delchef. docteure en philosophie et lettres (19121.fo ndatrice <strong>de</strong> la première société féministe en Wallonie : A. DESPY-MEYER.• Les étudiantes dans les universités belges <strong>de</strong> 1880 à 1941. .. '. P 45.
Viviane Di TIllio 93Diplômes obtenus par les membres <strong>de</strong> la FBFU 1921-1939*Facult 192 1 1925 1930 1935 1939Mé<strong>de</strong>cine 36 53 72 77 84Pharmacie 25 28 35Sciences 27 66 47 107 126Philo et Lettres 23 52 72 140 181Droit 4 10 20 29 60• pour les membres dont la formation est I<strong>de</strong>ntifiéeCe sont évi<strong>de</strong>mment les Facultés où les femmes sont admises àexercer la profession correspondante à leur diplôme qui sont d'abordfréquentées, soit les Facultés <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine, <strong>de</strong> Pharmacie et <strong>de</strong>Sciences, Le Droit se ressent <strong>de</strong> l'Interdiction faite aux femmes <strong>de</strong>s'inscrire au barreau (Interdiction levée seulement en 1922) et d'entrerdans la magistrature (accèS en 1948). Les Facultés <strong>de</strong> Philosophie etLettres connaissent un essor à partir <strong>de</strong> la création d'un réseaud'enseignement secondaire officiel pour filles, soit à partir <strong>de</strong> 1925 oùles lycèes fournissent <strong>de</strong>s perspectives <strong>de</strong> carrières professorales pourles diplômées. Les sciences politiques et sociales, les sciencescommerciales et les étu<strong>de</strong>s polytechniques <strong>de</strong>meurent parmi les étu-40<strong>de</strong>s les moins fréquentées par les filles avant la Secon<strong>de</strong> Guerre .Les effectifs représentés à la FBFU épousent effectivement cetteévolution et constituent à ce titre un échantillon <strong>de</strong> la situationgénérale <strong>de</strong>s fe mmes universitaires avant la Secon<strong>de</strong> Guerre. Dès1935, les membres diplômées en Philosophie et Lettres sont les plusnombreuses, suivies <strong>de</strong> près par celles en Sciences. Un nombre nonnégligeable <strong>de</strong> membres <strong>de</strong> la FBFU fo rmera ainsi <strong>de</strong>s générationsd'élèves, principalement dans les lycées <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> et <strong>de</strong>scommunes <strong>de</strong> l'agglomération. Les femmes universitaires ayant étudiéen sciences commerciales, en sciences appliquées (polytechnique), ensciences sociales, politiques et économiques ou en éducation physique<strong>de</strong>meurent nettement minoritaires : on en dénombre treize au total en1939. En revanche, les sciences pédagogiques en comptent déjà onze.A la veille <strong>de</strong> la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale, en 1939, une nouvelleavancée <strong>de</strong>s filles dans <strong>de</strong>s carrières moins traditionnelles se <strong>de</strong>ssine :373840. A. DESPY-MEYRER. • L'entre-<strong>de</strong>ux-guerres ou l'affirmation Intellectuelle<strong>de</strong>s fe mmes ", Sextant. n° 1. hiver 1993, p. 77,-
94 La Fé dération belge <strong>de</strong>s Ferrones universitairesainsi la Fédération compte déjà 17 Ingénleures et 29 docteures ensciences sociales.guol qu'U en soit, on voit très nettement que les fe mmes mé<strong>de</strong>cinset scientifiques ont été les plus nombreuses au cours <strong>de</strong>s premièresannées <strong>de</strong> la FBFU. Ce n'est pas un hasard si la fondatrice et premièreprési<strong>de</strong>nte était docteure en mé<strong>de</strong>cine (Maria Derscheld-Delcourt,jusqu'en 1931) et si la relève a été assurée jusqu'en 1950 parGermaine Hannevart, docteure en sciences naturelles et professeuredans un lycée réputé <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>,Ce poids <strong>de</strong>s fe mmes mé<strong>de</strong>cins s'est également traduit par la créationprécoce. dès 1929 41 • d'une section particulière au sein <strong>de</strong> laFBFU. présidée par Marte Derscheld-Delcourt et affiliée à l'AssociationInternationale <strong>de</strong>s Femmes Mé<strong>de</strong>cins. Cette section y est représentéepar une autre figure <strong>de</strong> proue <strong>de</strong>s Intellectuelles belges <strong>de</strong> l'époque. ladocteure Jeanne Beekman-Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong> 42 ,Une pépinière d'intellectuellesMals si l'étu<strong>de</strong> quantitative <strong>de</strong> la FBFU est Indispensable pourévaluer sa représentativité parmi les fe mmes universitaires. elle nesuffit pas pour donner la mesure <strong>de</strong> son poids moral. Dans ce cas-cl.ce n'est pas le nombre qui Importe. mals la qualité <strong>de</strong> ses membres,Or. parmi ses membres les plus actives. la FBFU a compté <strong>de</strong>sfemmes <strong>de</strong> grand format. Il n'est évi<strong>de</strong>mment pas possible <strong>de</strong> retracerl'existence <strong>de</strong> chacune d'elles. Nous nous bornerons à évoquerquelques caractéristiques <strong>de</strong>s membres les plus éminentes.Dans la pério<strong>de</strong> d'entre-<strong>de</strong>ux-guerres. les dirigeantes <strong>de</strong> la FBFU.(prési<strong>de</strong>ntes. vice-prési<strong>de</strong>ntes et vice-prési<strong>de</strong>ntes aux relations Internationales)ont exercé longtemps leur fo nction, Cela signifie qu'elles sesont Investies pendant <strong>de</strong>s années pour mener à bien la tàche qu'elless'étalent fI Xée: celle <strong>de</strong> défendre les droits <strong>de</strong>s femmes universitaires.mals cela signifie aussi qu'elles ont marqué la Fédération <strong>de</strong> leur empreinte.41 Bulleti.n. ••• 1929. p. 30.42. Jeanne Beeckman (1891-1963). Docteure en mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l'ULB en 1914,mé<strong>de</strong>cin rési<strong>de</strong>nt à l'hôpital Saint-Jean puis Saint-Pierre à <strong>Bruxelles</strong> <strong>de</strong> 1914 à1923. attachée au service d'Anthropologie pénitentiaire <strong>de</strong>s prisons. Epouse dulea<strong>de</strong>r socialiste Emile Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong>. (e ln Memoriam •• Bulletin <strong>de</strong> la Fédération<strong>de</strong>s Fe mmes diplômées <strong>de</strong>s universüés, janvier 1964. pp. 64-65
VÙJiane Di TIllio 95On y retrouve pratiquement toutes celles qui fu rent parmi 1 lespremières . dans leur domaine. On recense les premières femmesmé<strong>de</strong>cins. Marie Derscheid. on l'a vu. mais aussi Clémence Evrard.Jeanne-Emile Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong>. première femme mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>s prisons. enmême temps que secrétaire générale <strong>de</strong> la Ligue <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong>rHomme jusqu'en 1940 ; Christine Duchaine (épouse Hendrickx).mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> la Ligue contre la Tuberculose et première secrétairegénérale <strong>de</strong> l'Œuvre nationale <strong>de</strong> l'Enfance.On y retrouve aussi les premières avocates comme Paule Lamy. quifut conseillère juridique <strong>de</strong> la Fédération. ou Georgette Ciselet - quisera aussi la première femme à siéger au Conseil d·Etat (1962).Fernan<strong>de</strong> Baetens qui anima le Conseil National <strong>de</strong>s Femmes belges.La première fe mme actuaire : Paula Doms. première docteure ensciences physiques et mathématiques <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>en 1900. elle poursuivit une carrière d'actuaire pendant 43 ans à laCaisse générale d·Epargne et <strong>de</strong> Retraite. exerçant les fo nctions <strong>de</strong>chef <strong>de</strong> service sans en porter le titre 1 car il n·était pas octroyé auxfemmes 1 .43.Parmi elles aussi. la première cohorte <strong>de</strong> femmes à faire unecarrière dans la recherche scientifique. le plus souvent au sein <strong>de</strong>r<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>. Précocement en Faculté <strong>de</strong>s Sciences.où elles fu rent les premières assistantes <strong>de</strong> laboratoire : Marguerite(Daisy) Verhoogen en chimie. Andrée Marcelle en physique. HélèneMassart en botanique et à leur suite Germaine Gremling (sciencesnaturelles). Hortense Van Risseghem (chimie). Polin a Men<strong>de</strong>leef (zoologie).Françoise Dony (physique et mathématiques). Maria Braeckechef <strong>de</strong> travaux en pharmacie en 1932. qui avait conquis son diplômeà Paris en 1924. Hélène Antonopoulo. attachée pendant vingt ans àl"lnstitut <strong>de</strong> Sociologie Solvay et dont la réputation fut indiscutée. estchargée <strong>de</strong> cours en sciences sociales dès 1934. elle fu t la premièrefe mme à entrer dans le corps diplomatique comme attachée à la légation<strong>de</strong> Grèce à <strong>Bruxelles</strong> en 1939.Certaines passent le cap du corps scientifique et obtiennent <strong>de</strong>scharges <strong>de</strong> cours. C'est le cas <strong>de</strong> Lucia <strong>de</strong> Brouckère (chimie) et <strong>de</strong>Suzanne Tassier (histoire). premières agrégées <strong>de</strong> renseignementsupérieur <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> en 1933. La première obtient lecours <strong>de</strong> chimie générale en 1937. la secon<strong>de</strong> fut nommée chargée <strong>de</strong>43. L. SCHOUTERS-DECROLY • • Les Femmes et la franc-Maçonnerie ••Ferrunes. libertés. laïcüé .•.• op. ciL . p. 80.
Viviane Di Tillio 97cours en 1945. Marte Gevers-Dwelshauvers diplômée en Droit en1923. assistante en 1925 pour le cours <strong>de</strong> droit civil. réussit ce tour<strong>de</strong> force dans une Faculté très . machiste • d'être nommée professeureordinaire en 1933 et <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir. vingt ans plus tard. la premièrefemme doyen <strong>de</strong> Faculté (1953),D'autres. en grand nombre. se sont orientées vers l'enseignementsecondaire, Certaines sont <strong>de</strong>venues directrtces d'établissement.comme Alice Scouvart au lycée Emile Jacqmain. Mariette Lefer-VanMolle au Lycée <strong>de</strong> Schaerbeek (futur Lycée Emile Max) Louise Van <strong>de</strong>rNoot et Ma<strong>de</strong>leine Thonnart successivement au lycée d'Ixelles,D'autres encore se sont affirmées en politique, C'est le cas <strong>de</strong>Georgette Ciselet ou <strong>de</strong> Marguerite Jadot " au parti libéral : <strong>de</strong>Jeanne-Emile Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong> 4s au parU socialiste, <strong>de</strong> Ma<strong>de</strong>leineThonnart-Jacquemotte 46 dans les rangs communistes,Car si la FBFU est bien une association a-politique, cela n'impliquepas que ses membres se désintéressent <strong>de</strong> la politique, Elles se situentgénéralement à gauche, dans la mouvance libérale ou socialiste, Chezelles, les barrières politiques paraissent cependant moins rigi<strong>de</strong>s quechez les hommes, Peut-être parce qu'elles sont liées par une volontécommune <strong>de</strong> défendre les droits <strong>de</strong>s fe mmes. la paix, la démocratie etla tolérance,Toutefois le neutralisme originel reprend ses droits quand 11 s'agit<strong>de</strong> parler au nom <strong>de</strong> la Fédération elle-même, Alors que celle-cis'engagera à fond dans la défense du travail <strong>de</strong>s femmes, elle observeune plus gran<strong>de</strong> réserve à l'égard du suffrage fé minin entre 1921 et1930, C'est ainsi qu'elle décline l'offre d'envoyer <strong>de</strong>s déléguées auCongrès <strong>de</strong> l'Alliance Internationale pour le Suffrage <strong>de</strong>s Femmes à44, Georgette Ciselet (1900- 1983) fut sénatrice cooptée <strong>de</strong> 1946 à 1954 et <strong>de</strong>1954 à 1951, sénatrice élue <strong>de</strong> 1951 à 1954, Marguerite Jadot (1896- 1977)professeur au lycée <strong>de</strong> Schaerbeek, fu t attachée <strong>de</strong> cabinet en 1949-50,sénatrice provtnciale du Brabant <strong>de</strong> 1955 à 1958, secrétaire générale du partilibéral <strong>de</strong> 1946 à 1954 et vtce-présl<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> 1954 à 1961.45. Jeanne-Emile Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong> fu t sénatrice <strong>de</strong> 1949 à 1963 et prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> lasection <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> du ParU Socialiste belge.46. Ma<strong>de</strong>leine Thonnart, épouse Jacquemotte : née en 1907, elle étudie laphilologie germanique à Llége. Professeure au lycée d'Ixelles à partir <strong>de</strong> 1929,préfète en 1947, elle milite activement au Comité Mondlai <strong>de</strong>s Femmes, adhèreclan<strong>de</strong>stinement au parti communiste dès 1933 (J. GOTOVITCH, Du rouge autricolore, Labor, <strong>Bruxelles</strong>, 1992, p. 563).
98 La Fédératton belge <strong>de</strong>s Femmes universitairesRome en 1923 4 7 • Mais à partir <strong>de</strong>s années trente, elle se positionneavec plus <strong>de</strong> netteté. Voter <strong>de</strong>vient indispensable, il faut • que lesfemmes participent à tous les niveaux à la réorganisation du paysaprès la guerre. Et donc, ne pas voter est priver les fe mmes d'une48participation effective dans la vie publique du pays 1 • C'est ainsi quela FBFU appuiera à l'unanimité un mèmorandum du groupe Egalitéen faveur du suffrage fé minin, présenté par Georgette Ciselet en avril1932 49 • Il est vrai que le groupe Egalité est à ce moment animé par <strong>de</strong>smembres <strong>de</strong> la FBFU, Louise De Craene-Van Duuren, GeorgetteCiselet, Germaine Hannevart, entre autres.La réserve est <strong>de</strong> mise également lorsqu'il s'agit <strong>de</strong> s'engager ausein du Comité mondial <strong>de</strong>s Femmes contre la Guerre et le Fascisme.Germaine Hannevart et Lucia <strong>de</strong> Brouckère, figures <strong>de</strong> proue <strong>de</strong> laFédération, s'y engagent à fond mais à titre personnel, sans entraînerla Fédération 50.Certaines sont également fortement liées à la franc-maçonnerie.C'est le cas <strong>de</strong> Germaine Hannevart 51 • qui fu t Vénérable <strong>de</strong> la logeEgalitè, <strong>de</strong> Jeanne Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong>, <strong>de</strong> Louise De Craene-Van Duuren 52 •<strong>de</strong> Lucia <strong>de</strong> Brouckère, <strong>de</strong> Paula Doms, toutes au Droit Humain 5.'l . Lesliens avec le Comité Mondial <strong>de</strong>s Femmes et la maçonnerie serontd'ailleurs très forts.Durant la Secon<strong>de</strong> Guerre, l'idéal pacifiste clairement affirmé<strong>de</strong>puis la fo ndation et le combat antifasciste mené au cours <strong>de</strong>sannées trente (nous y reviendrons) pousseront un certain nombre <strong>de</strong>membres à œuvrer dans la Résistance : Germaine Hannevart, MarcelleLeroy, Rita BonJean, Marguerite Bervoets, Elsa Claes, Jeanne Cornet,Yvonne Delcourt, Ma<strong>de</strong>leine LeveI. Paule Mévisse, Ginette Pevtchln,Betty Schnei<strong>de</strong>r, Ma<strong>de</strong>leine Thonnart-Jacqmotte, Augusta Violon,Marthe André, Suzanne Sulzberger ... et d'autres encore. Certaines,47. A. SCOUVART. Les fé dérations <strong>de</strong> femmes universitaires. 2éme année.<strong>Bruxelles</strong>. 1924. p. 5.48. G. HANNEVART . • Allocution <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>nte ". BuUetin <strong>de</strong> la FBFU. 1940-1944. <strong>Bruxelles</strong>, 1945. p. 9.49. BuUetin <strong>de</strong> la FBFU, 1931-32 e 1932)33. p. 17.50 J. GOTOVITCH, Du rouge au tricolore ... . pp. 27-28.51. Sur Gennaine Hannevart, voir plus loin.52 Sur Louise Van Duuren : voir l'article dans Sextant nOl0. à paraître.53 Voir à ce propos : L. SCHOUTERS-DECROLY . • Les Femmes et la francMaçonnerie . .. '. op. ciL, et Histoire <strong>de</strong> la Fédération belge du Droit Humain.<strong>Bruxelles</strong>. t. 1, 1978.
Viviane Di Tillio 99comme Marguerite Bervoets, décapitée â l'âge <strong>de</strong> 30 ans â la prison <strong>de</strong>Wolfenbüttel en 1944, ne sont jamais rentrées <strong>de</strong> captivité.Le programme et les actions <strong>de</strong> la FBFUComposée exclusivement <strong>de</strong> femmes, la Fédération se présente54d'emblée comme une organisation féministe . Elle défend les droits<strong>de</strong>s femmes en général et, bien sür, tout particulièrement ceux <strong>de</strong>sfemmes universitaires. La FBFU est fe rmement convaincue que « c'estseulement en autorisant et en encourageant les fe mmes â prendreleur pleine activité et leur responsabilité dans la vie intellectuelle <strong>de</strong>leur pays que la civilisation et la prospérité <strong>de</strong>s générations futurespourront se développer sur les bases soli<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l'intelligence et <strong>de</strong>compréhension mutuelle .55.D'emblée aussi la vocation est internationale : il s'agit <strong>de</strong> nouer <strong>de</strong>sliens d'amitié et d'entrai<strong>de</strong> entre . toutes les femmes diplômées <strong>de</strong>suniversités sans distinction <strong>de</strong> race, <strong>de</strong> religion ou <strong>de</strong> politique . 56.Si la Fédération n'est pas la seule association â défendre â cemoment les intérêts moraux et matériels <strong>de</strong> ses membres, elle est bienla seule â cibler les fe mmes universitaires, Il y avait quarante ans queles universités leur avalent ouvert leurs portes (<strong>Bruxelles</strong> en 1880,Liège en 1881. Gand en 1882 - Louvain seulement en 1920) mals lesétudiantes étaient encore toujours victimes <strong>de</strong> nombreux préjugés.Certains persistaient â croire que <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s poussées nuiraient â leurféminité, â leur affectivité, entraveraient même un heureux êpanouissement57 • S'avançant dans <strong>de</strong>s domaines réservés aux hommes,n'allalent-elles pas se masculiniser ? 58La Fédération défend avec fo rce l'idée que . les fe mmes Instruitesdoivent prendre position et revendiquer les mêmes valeurs que leshommes diplômés .&J. Ses revendications s'organisent donc dans <strong>de</strong>ux54. Baronne P. BOËL et C. DUCHESNE, op cil, p. 5.55. M. JADOT-VERMElRE, • Relations Internationales ", Bulletin <strong>de</strong> la FBFU,12ème annèe, <strong>Bruxelles</strong>. 1934, p. 27.56. G. HANNEVART, • Rapport <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>nte ", Bulletin <strong>de</strong> la FBFU. année1946. <strong>Bruxelles</strong>. 1947, p. 7.57. L. COX, • Quelques aspects psychologiques <strong>de</strong>s problèmes posés parl'èvolutlon sociale <strong>de</strong> la femme ", ln XXVème semaine sociale. La conditionsociale <strong>de</strong> lafemme. <strong>Bruxelles</strong>. Ed. Institut <strong>de</strong> Sociologie, 1956, p. 323.58. Ibi<strong>de</strong>m. p. 330.59. R-L. KARVE'ITI, • Assemblée Générale du 28 févrler1988 ", in Bulletin <strong>de</strong> laF.B.F.U., 89éme année, <strong>Bruxelles</strong>, 1989. p. 14.
100La. Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes universitairesdirections : la défense <strong>de</strong>s emplois et <strong>de</strong>s carrières pour les femmesmais aussi, en amont, la défense <strong>de</strong> renseignement secondaire pourles filles, préalable indispensable à leur accès aux étu<strong>de</strong>s supérieures.L'accès aux professions et le droit au travailLa Fédération souligne les inégalités entre garçons et filles dès lasortie <strong>de</strong> l'université : 1 Quand les étudiantes sortent <strong>de</strong>s universités,elles sont un peu désemparées. Après avoir fourni le même travail queleur collêgues masculins, elles se heurtent à <strong>de</strong>s difficultés que ceuxciignorent .fI.). Il s'agit donc <strong>de</strong> tout faire pour les ai<strong>de</strong>r à trouver unemploi. à défendre leur droit au travail et aux promotions 6 1 • LaFédération réclame pour les femmes compétentes <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> direction,dans l'administration, dans <strong>de</strong>s sociétés publiques ou privées,dans <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> renseignement secondaire, avec bien sûrles mêmes conditions <strong>de</strong> rémunération que les hommes.Dès 1921. un comité d'entrai<strong>de</strong> est créé, dans le but d'étudier lescarrières accessibles aux fe mmes universitaires et <strong>de</strong> se chargerd'éventuelles démarches auprès <strong>de</strong>s autoritês publiques pour trouver<strong>de</strong>s emplois à <strong>de</strong> jeunes diplômées. Des groupes d'étu<strong>de</strong>s sont constituéspour analyser plus ponctuellement <strong>de</strong>s problèmes relatifs àcertains secteurs 62 et les Bulletins diffusent régulièrement toutes lesoffres d'emploi possibles auxquels les Jeunes diplômées peuventpostuler, en ne laissant passer aucune occasion - pas même au Congobelge.L'action <strong>de</strong> la Fédération a-t-elle été eu <strong>de</strong>s résultats dans cedomaine ? Il est malheureusement impossible <strong>de</strong> le déterminer.D'autant qu'elle fu t contrainte, dès les années trente, à un net replidéfensif.Les années trente sont en effet profondément marquées par la criseéconomique mondiale. Les difficultés économiques et les tensionsinternationales s'amplifient et freinent l'élan <strong>de</strong>s fe mmes à s'émanciper.Les hommes se sont vite rendus compte -que les fe mmes sont<strong>de</strong>venues <strong>de</strong>s concurrentes sérieuses. Sous la pression du particatholique, acquis à l'idée <strong>de</strong> la fe mme au foyer, <strong>de</strong>s mesures60. S. TASSIER . • Rapport général sur l'activité <strong>de</strong> la FBFU • Bulletin <strong>de</strong> laFBro, lére année. <strong>Bruxelles</strong>. 192 1-1923. p. 7.61. • Histoire <strong>de</strong> la FBFU " Bulletin <strong>de</strong> la FBFU. <strong>Bruxelles</strong>. 1972 (1). p. 5.62. Bulletin <strong>de</strong> la FBFU. année 1925. p. 6.
---Viviane Di TW.io 101iQ"'.> :'. ..: l ._: 3' "-'- BULLEi1N ANNUEL I'ZI.. -'-------------------------..' ..•...FÉDERA TION BELGEDESFemmes UniversitairesA. S. .. 1..Soa le H_t P.uoll dll Mllllatlre.d .. Scle_ ct du Artaet <strong>de</strong> ,. Folldatloll IJIII,..,.IWreRapport sur l'activité <strong>de</strong> la FédérationAlmée 1925F1IAMEIUES .. .auxu.u:sUNION DES IMPRIMERIES (Socitol A-y.o).0-.- , J. ,RUEllE,lUS.,.Collection prtvée
102 La. Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes universüaireslégislatives tentent <strong>de</strong> dissua<strong>de</strong>r les femmes mariées <strong>de</strong> trava1ller 63 ,Durant cette pério<strong>de</strong>. la FBFU se préoccupe plus <strong>de</strong> défendre le droitau travail <strong>de</strong>s femmes que leur droit à accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> responsab1l1té.<strong>de</strong> concert d'a1lleurs avec d'autres associations comme leConsell National <strong>de</strong>s Femmes belges. la Ligue <strong>de</strong> l'Enseignement. laPorte Ouverte,Cependant. la Fédération interviendra plus spécifiquement auprès<strong>de</strong>s échevins <strong>de</strong> l'Instruction publique pour que les femmes universitairespuissent enseigner dans <strong>de</strong>s sections d'athénées. à l'Ecolenormale. ou dans <strong>de</strong>s écoles moyennes. à un barème égal à celui <strong>de</strong>shommes, Elle s'indigne lorsque. en remplacement d'une professeureau lycée d'Ixelles, un enseignant masculin est nommé. alors qU'llcumule et que <strong>de</strong>s candidates ayant le diplôme requis s'étaientprésentées 64 • Elle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> aussi que les fe mmes soient autorisées àposer leurs candidatures dans <strong>de</strong>s services diplomatiques et consulaires.au même titre que les hommes. et puissent accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s postes<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins lnspecteurs 65 • En 1938 la Fédêration intervient auprèsdu Ministère <strong>de</strong> l'Instruction Publique pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r aux autoritésd'envisager la nomination <strong>de</strong> fe mmes dans les écoles mixtes 66 •Ces interventions portèrent. du moins en 1939. lorsque le pays.mis sur pied <strong>de</strong> paix renforcée en raison <strong>de</strong> la situation internationale.décrétait la mob1l1sation générale. Germaine Hannevart reçut unelettre du chef du cabinet du Ministère <strong>de</strong> l'Instruction Publique. VanGeyt. lui déclarant que <strong>de</strong>s fe mmes avaient été désignées à titreintermédiaire pour remplacer <strong>de</strong>s professeurs masculins dans <strong>de</strong>sétablissements mixtes mais aussi dans <strong>de</strong>s athénées et écolesmoyennes exclusivement réservées aux garçons. 57Se qualifiant elles-mêmes <strong>de</strong> • travailleuses intellectuelles .68.dirigeantes <strong>de</strong> la Fédération réagiront vivement lorsque le travail <strong>féminins</strong>era touché. <strong>de</strong> 1933 à 1935. par <strong>de</strong>s mesures franchementles63. Sur cet aspect : A.. DE VOS . • Défendre le travail féminin, Le GroupementBelge <strong>de</strong> la Porte Ouverte: 1930- 1940 ". Sextant. n05. <strong>Bruxelles</strong>. 1996. pp. 107-Ill.64 . Bulletin <strong>de</strong> la FBFU. 1931-32 et 1932-33. p. 41.65. H. TRANCHANT • • Rapport <strong>de</strong> la secrétaire générale ". Bulletin <strong>de</strong> la FBFU,1945. 24éme année. <strong>Bruxelles</strong>. 1946. P. 7.66. M. KERREMANS • • Rapport <strong>de</strong> la secrétaire générale pour 1938 ". Bulletin<strong>de</strong> la FBFU. 16éme année. <strong>Bruxelles</strong>. 1938. p. 8.67. G. HANNEVART • • Rapport général sur J'activité <strong>de</strong> la FBFU " Bulletin <strong>de</strong> laFBFU. 17éme année. <strong>Bruxelles</strong>. 1939. p. 7.68 . Bulletin <strong>de</strong> la FBFU. année 1925. p. 5
Viviane Di TIlliD 103diScrtm1natoires 69 • La mobilisation s'effectue surtout à propos <strong>de</strong> laproposition <strong>de</strong> loi déposée le 13 février 1934 par le sénateur catholiqueRutten 70 • Cette proposition <strong>de</strong> 101 visait à contingenter le travail <strong>de</strong>la fe mme mariée dans l'industrie et le commerce et était présentéeexplicitement comme une solution à la crise économique. Ruttenvoulait surtout créer un état d'esprit favorable au retour <strong>de</strong> la mère au71foyer .La Fédération s'y opposa vivement 72 • en accord avec d'autres associationsfé ministes qui, toutes, hormis les associations fémininescathol1ques, firent front 73 • Si la proposition ne fu t Jamais prise enconsidération au Parlement, en revanche le gouvernement enconcrétisa l'esprit dans un arrèté royal du 8 décembre 1934.Aussitôt un grand meeting <strong>de</strong> protestation fut organisé. Sous lahoulette <strong>de</strong> Germaine Hannevart, prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la FBFU, et à l'initiative<strong>de</strong> la Porte Ouverte. plus <strong>de</strong> 2.000 personnes appartenant à <strong>de</strong>sgroupements neutres, libéraux, socialistes, communistes, <strong>de</strong>s asso-74ciations socioprofessionnelles • pratiquement tous les groupes <strong>de</strong>fe mmes laïques 75 • se réunirent le 21 décembre 1934. Les interventionsauprès <strong>de</strong>s ministres et <strong>de</strong>s députés se multiplièrent.L'arrêté royal fu t abrogé, mals l'esprit qui l'avait guidé n'était pasmort : la proposition Rutten avait inspiré la circulaire ministérielle du12 avril 1934 qui bloquait tout recrutement d'agents fé minins dans lafonction publique. Elle trouvait un prolongement dans la circulaireministérielle du 25 Janvier 1935 qui diminua le traitement <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s69 . • Rapport <strong>de</strong> la secrétaire générale " Bulletin <strong>de</strong> la FBFU, <strong>Bruxelles</strong>, 1931-1932/ 1932-1933, p. 39.70. Cette proposition <strong>de</strong> loi développait l'idée que le travail ménager est mieuxadapté à l'organisme <strong>de</strong> la femme que le travail profeSSionnel. que la morbiditéet la mortalité sont plus élevées chez les travailleuses que chez les femmes aufoyer, que le travail <strong>de</strong>s femmes provoque l'avil!ssement <strong>de</strong>s salaires masculins.que la moralité <strong>de</strong>s travailleuses laisse à désirer. Voir H. PEEMANS·POULLET,Fe mmes en Belg ique (XIXème·XXème Siècles), <strong>Bruxelles</strong>, <strong>Université</strong> <strong>de</strong>sFemmes, 199 1. p. 107 et A. DE VOS, • Défendre le travail féminin ... . op. cit.,pp. 108- 109.71. A DE VOS, • Défendre le travail féminin ... " p. 109.72. G. HANNEVART, • Allocution <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>nte ., Bulletin <strong>de</strong> la FBFU,<strong>Bruxelles</strong>, 1934, p. 7.73. Centre d'Archives en Histoire <strong>de</strong>s Femmes (<strong>Bruxelles</strong>), Archives du C.F.F.B.,n013, point 5: Les carrières libérales ouvertes auxfemmes, 1948, p. 3.74. A DEVOS, op cit, p. 110.75. M-L. PIRO'ITE-BOURGEOIS, • Episo<strong>de</strong>s marquants <strong>de</strong> la lutte <strong>de</strong>s fe mmesbelges pour leur droit au travail ·, Femmes. Libertés, laïcité .... p. 131.
104La Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes Wliversitairesagents fé minins <strong>de</strong> l'Etat 76 • La Fédération réagit immédiatement : unedélégation fut reçue par le ministre <strong>de</strong> rInstruction publique JulesHiemaux 77 à qui elle transmit <strong>de</strong> vives protestations contre toutemesure modulant les rémunérations selon le sexe. Pour la FBFU. leschoses sont claires : • les traitements sont afférents à la fonction . .. Lafemme mariée ou non. a droit aux émoluments <strong>de</strong> remploi qu'elle7 8occupe • .La circulaire ministérielle du 5 février 1935 qui interdisait touteactivité rémunérée au conjoint d'un fonctionnaire ou d'un agent <strong>de</strong>l'Etat. menaçait. elle. explicitement les enseignants et enseignantes duréseau officiel. Protestations et meetings se succédèrent jusqu'à la fin<strong>de</strong> l'année 79 •Il faut souligner la vigueur avec laquelle la FBFU se lança dans ladéfense du droit au travail <strong>de</strong>s fe mmes. On ne peut nier que laFédération fu t énergique et que ce fut l'essence mème <strong>de</strong> sa force. Lenombre <strong>de</strong> ses membres s'accrut considérablement. surtout pendantles années <strong>de</strong> crise au cours <strong>de</strong>squelles les fe mmes (notamment dansl'enseignement) ont craint pour leur emploi et leur salaire.Réformer les étu<strong>de</strong>s secondaires pour fi llesL'organisation d'un enseignement secondaire supérieur pourjeunes filles a toujours été la condition d'une bonne préparation auxétu<strong>de</strong>s universltalres. 80 Or. la loi sur l'enseignement moyen du 1er Juin1850 ne prévoyait rien pour les jeunes filles. Il fallut attendre la loi du15 Juin 1881 pour que soient organisées 50 écoles moyennes pourfilles 8 • • C'était un premier pas mals qui ne constituait toujours pas <strong>de</strong>réponse suffisante. Les jeunes filles continuèrent à fréquenter <strong>de</strong>sInstitutions privées ou <strong>de</strong>s lycées subventionnés par quelques adml"76. P. BOËL et C. DUCHESNE, op cit, p. 144.77. Jules Hiemaux (1881-19441, ingénieur. extraparlementaire. fut ministre <strong>de</strong>l'Instruction publique du 20/ 11/ 1934 au 25/3/ 1935. (P. VAN MOLLE. LeParlement belge <strong>de</strong> 1894-1 969. Gand. 1969. p. 179178. De G. Hannevart au Premier Ministre Charles <strong>de</strong> Broqueville. 10.06. 1933.79. De concert avec les associations d·enseignants et la Ligue <strong>de</strong>rEnseignement : Egalité, n027. <strong>Bruxelles</strong>, 1935. p. 6.80. S. TASSIER. • Rapport général sur les activités <strong>de</strong> la FBFU • Bulletin <strong>de</strong> laFBFU. 1 ére année. <strong>Bruxelles</strong>. 1921-1923. p. 10.81. Histoire <strong>de</strong> l'enseignement en Belgique. sous la dir. <strong>de</strong> D. GROOTAERS.<strong>Bruxelles</strong>. CRISP. 1998. p. 233.
Viviane Di TiIlio 105nistrations communales (comme les Cours d'Education Gatti à<strong>Bruxelles</strong>, le lycée Warocqué à Morlanwelz, le lycée Marie-José àAnvers, l'Athénée pour Jeunes filles à Gand ... ), et. si elles désiraiententrer à l'université au terme <strong>de</strong> ces étu<strong>de</strong>s non officiellement reconnues,elles <strong>de</strong>vaient présenter un examen <strong>de</strong>vant le Jury central 82 •Ce n'est qu'en 1925 que. sur la proposition du député libéral AlbertDevèze. une loi est votée qui fon<strong>de</strong> enfin <strong>de</strong>s lycées officiels pourjeunes filles. Suzanne Tassier avait été l'inspiratrice du texte <strong>de</strong> lapropoSition 83 •Durant toute la pério<strong>de</strong> précédant le vote <strong>de</strong> cette loi. la Fédérations'était mobilisée pour dénoncer la discrimination qui pesait sur lesfilles. Germaine Hannevart avait réuni un gros dossier sur laquestion : selon elle. les établissements qui leur étaient accessiblesétaient <strong>de</strong> trois espèces: • les lycées où les travaux <strong>de</strong> ménagères sontà l'honneur. les écoles moyennes où l'on ne se préoccupe que <strong>de</strong> travauxdomestiques et les athénées royaux <strong>de</strong>s communes où la situation<strong>de</strong>s étudiantes est particulièrement lamentable .84.Pour cetteraison Germaine Hannevart estime nécessaire d'exiger du gouvernementun statut pour l'enseignement moyen supérieur fé minin 85 •Mais la Fédération ne voulait pas seulement développer l'enseignementsecondaire pour jeunes filles, elle désirait également leréformer en profon<strong>de</strong>ur. Dès le 5 mai 1924 Marie Delcourt 86 attirel'attention sur la nécessité d'accor<strong>de</strong>r. dès le <strong>de</strong>gré primaire et moyen.plus d'importance à la formation <strong>de</strong> l'intelligence qu'aux seules acquisitions<strong>de</strong> connaissances 87 •De plus. la FBFU <strong>de</strong>manda que la préparation aux étu<strong>de</strong>s universitairessoit étudiée au niveau international. La question fu t en effe tportée à l'ordre du jour au Congrès <strong>de</strong> l'IFUW à Christiana en 1924. 8882. M.-L. PIR01TE-BOURGEOIS, • Quelques aspects <strong>de</strong> renseignement fé mininhûque " Femmes. Ubertés, laïcité .... pp. 25-26.83. I<strong>de</strong>m. p. 26.84. CEGES, Papiers G. Hannevart, PH 14, D, nO 29, L'enselgnement secondairepour jeunes filles [dossier 1924].85. Ibi<strong>de</strong>m. p. 386. Elle exerça la fonction <strong>de</strong> vice-prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la section <strong>de</strong> Liège <strong>de</strong> 1924 à1928.87. M. DERSCHEID-DELCOURT, • Rapport gènéral sur l'activité <strong>de</strong> la FBFU·,Bulletin <strong>de</strong> la FBFU. 1 ère année. <strong>Bruxelles</strong>. 192 1-1923. p. 8.88. A SCOtNART . • Rapport du comité <strong>de</strong>s relations Internationales " Bulletin<strong>de</strong> la FBFU. 2ème année. <strong>Bruxelles</strong>. 1924. p. 24.
106 La Fédération belge <strong>de</strong>s Fenunes universitairesGermaine Hannevart 89 y proposa un enseignement secondaire basésur un premier cycle, général et concret, suivi d'une préparationsystématique en sections spécialisées, favorisant l'accès aux différentesfacultés. Elle réclamait d'urgence la révision et la concordance <strong>de</strong>sprogrammes ainsi qu'une meilleure formation <strong>de</strong>s maitres 90 • Devantl'importance <strong>de</strong> la question et son extension internationale, le Congrèsdécida la création d'une Commission spéciale dont la prési<strong>de</strong>nce futd'ailleurs confiée à Germaine Hannevart 91 • Cette Commission se réunità diverses reprises. A Londres, en avril 1930, un comité d'informationmit sur pied un projet d'enquête internationale confiée à AmélieAmato, professeure à Budapest 92 , Trois ans plus tard, un ouvrageL'Enseignement secondaire <strong>de</strong>s Jeunes filles en Europe, <strong>de</strong> la plumed'Amélie Amato, parut sous les auspices <strong>de</strong> la Fédération Internationale.Créer un réseau international d'entrai<strong>de</strong>Un autre objectif important fu t sans aucun doute <strong>de</strong> favoriser lesrelations internationales entre diplômées, sous forme d'échange d'étudiantes,<strong>de</strong> professeurs et par la création <strong>de</strong> bourses d'étu<strong>de</strong> ou <strong>de</strong>voyage 9 3 • Ce <strong>de</strong>rnier point constitue à la fois un attrait et un atoutpour la Fédération : 11 est clair que sans l'attribution <strong>de</strong> bourses, laFédération n'aurait jamais rencontré le même succès. Au sein <strong>de</strong> laFBFU, cette activité tenait particulièrement à cœur à Marie DerscheidDelcourt, qui estimait indispensable que les femmes puissent approfondirleurs connaissances à l'étranger 94 •Le système <strong>de</strong> bourses fu t créé dès 1919 au sein <strong>de</strong> l'IFuW 5 • Lamise en place d'un tel système réservé aux femmes, sans distinction<strong>de</strong> race, <strong>de</strong> nationalité et <strong>de</strong> religion était • révolutionnaire . pourl'époque: jusque là seuls les hommes pouvaient bénéficier <strong>de</strong> ce type<strong>de</strong> bourses. Le principe <strong>de</strong> la création d'un fonds international d'un89. Elle fu t vice-prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la FBFU <strong>de</strong> 1924 à 1931.90. CEGES, Papiers G. Hannevart, PH 14, B, n° 23, archives <strong>de</strong> la FBFU.91. IFVW. Report of the third conference of Christiana. n06, London, 1924, p. 42.92. Bulletin <strong>de</strong> IaFBFV, 1930-3 12, pp. 21 et 27.93 Ibi<strong>de</strong>m. p. 8.94. CEG ES, Papiers G. Hannevart, PH 14, B, n 022. archives <strong>de</strong> la FBFU,Correspondance diverse. Plus tard, en 1982, la FBFU créera d'ailleurs unebourse au nom <strong>de</strong> Marle Derscheld-Delcourt95. Archives <strong>de</strong> la section <strong>de</strong> Liége déposées chez C. Thlrion, dossier n° 1 sur lesbourses <strong>de</strong> la FBFDU (l954-1997).
Viviane Di rulio 107million <strong>de</strong> dollars fu t voté à l'unanimité au Congrès <strong>de</strong> Christiana en1924.Dès 1925. une première bourse étrangère 96 fut offerte à unemembre belge. un an avant que la FBFU n'établisse elle aussi sonpropre programme d'attribution <strong>de</strong> bourses. Entre 1925 et 1950. 31bourses fu rent ainsi octroyées à <strong>de</strong>s diplômées belges par <strong>de</strong>s fédérationsétrangères. 97 La gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s boursières sortaient <strong>de</strong>l'<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>.C'est en 1926 que. grâce aux fonds récoltés lors d'un concert le 1ermars 1926 98 • la Fédération belge put allouer la première bourse nationaleà l'une <strong>de</strong> ses membres dans le but <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> la recherche àl'étranger. Celles qui seront ainsi subventionnées et qui iront dans <strong>de</strong>spays étrangers seront un peu considérées comme les ambassadrices<strong>de</strong> la Fédération belge et auront par conséquent <strong>de</strong>s obligations moralesvis-à-vis <strong>de</strong> celle-ci.Afin <strong>de</strong> structurer le système. une Commission <strong>de</strong>s Bourses estcréée dès 1926 pour gérer ce fonds. alimenté par <strong>de</strong>s dons. <strong>de</strong>s legs etles bénéfices <strong>de</strong> manifestations culturelles. Cette Commission a aussipour tâche <strong>de</strong> sélectionner les candidates. tant pour les boursesoffertes <strong>de</strong> la FBFU et <strong>de</strong> l'IFUW que <strong>de</strong>s Fédérations <strong>de</strong> Femmes universitairesétrangères.Entre 1926 et 1950. 44 bourses. d'un montant variant entre 6.000et 10.000 francs. fu rent octroyées par la FBFU. le plus souvent poureffectuer un travail <strong>de</strong> recherche en Belgique ou à l'étranger. Certaineschercheuses éminentes. comme Marguerite Jadot. Claire Préaux ouPolina Men<strong>de</strong>léeff en bénéficièrent. respectivement en 1932. 1933 eten 1935 99 •Au total tout fu t mis en œuvre pour fa ciliter les contacts internationauxentre les diplômées : accès aux Maisons <strong>de</strong>s Etudiantes pourloger économiquement. hébergement chez <strong>de</strong>s collègues étrangères.hôtels fournissant <strong>de</strong>s prix spéciaux à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Fédérations ...96. Cette bourse fut offerte par la Fédération Britannique <strong>de</strong>s FemmesUniversitaires.97 . • Boursières <strong>de</strong> la FBFU " Bulletin <strong>de</strong> la FBFl.J • • septembre 1953. p. 42.98. 4.500 francs avaient été récoltés. dont 2.000 francs furent versés à rIFUW.99 . • Boursières <strong>de</strong> la F.B.F.U. ". Bulletin <strong>de</strong> la FBFl.J. 31ème année. septembre1953. p. 42.
108 La Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes universitairesC'est également dans ce but qu'un Club <strong>de</strong>s Femmes diplômées<strong>de</strong>s <strong>Université</strong>s fut créé à <strong>Bruxelles</strong>, à l'1n1tlatlve <strong>de</strong> Marguerite Jadot,sur le modèle du Crosby Hall en Angleterre et du Reid Hall en France,Il <strong>de</strong>vait faciliter l'accueil d'étrangères <strong>de</strong> passage à <strong>Bruxelles</strong> et lesmettre en contact avec <strong>de</strong>s diplômées belges, Freiné par la guerre, leprojet ne prit corps qu'en 1945100•A vantages offerts à nos membres lors<strong>de</strong> séjours à l'étranger,1. - Les membres <strong>de</strong> toutes les fédérations afIiliées à laFédération Internationale <strong>de</strong>s Femmes Universitaires sontadmises à séjourner :à Paris, à!'. American Urriwrsity Womm's CÙIb ., 4- rue<strong>de</strong> Chevreuse (VIe) (Chambre <strong>de</strong> IS à :zo frs).à la • Maistm <strong>de</strong>s EtJIdianus ., :ZI4- Boulevard Raspailex IVe) pendant les vacances (ch. avec petit déjeuner<strong>de</strong> IS à :zo frs.).à Rome, à l'Hôtel Esperi4, :z:z, Via Nazionale où la fédérationitalienne a obtenu <strong>de</strong>s conditions spéciales (pensiontaXes comprises, SI à S7 lires).et à Fiui (séjour <strong>de</strong> Montagne) à l'Hôtel Falconi, aw:mêmes conditions.:z. - Des lettres d'Înuoduction auprès <strong>de</strong>s collègues étrangèressont uès volontiers données à nœ membres.Publicité Indiquant les conditions <strong>de</strong> logement obtenues à l'étrangerpour les membres <strong>de</strong> la FBFU100. Bulletin <strong>de</strong> la FBro, 1940 à 1944, <strong>Bruxelles</strong>, 1945, p. 15.
Viviane Di TIl/io 109La défense <strong>de</strong> la paix et le combat antifascisteOn se souvient que le maintien <strong>de</strong> la paix constituait le secondobjectif <strong>de</strong> l'IFUW comme <strong>de</strong> la FBFU. Or. dans les années trente. lasauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la paix <strong>de</strong>vint une préoccupation particulièrement lancinante.La crtse économique mondiale <strong>de</strong> 1929. la montée du nazisme etdu fascisme. le stalinisme en URSS inquiètent les femmes universitaires.Depuis 1924. l'IFUW participe à la Commission <strong>de</strong> CoopérationIntellectuelle <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations et à <strong>de</strong>s rencontres internationalessur le maintien <strong>de</strong> la paix et le désarmement. Elle poussed'ailleurs les branches nationales à se préoccuper <strong>de</strong> problèmes internationauxet à se joindre à ce mouvement. d'autant que <strong>de</strong>s associationsnationales <strong>de</strong> femmes diplômées sont menacées dans les paystotalitaires.En Italie en effet. le gouvernement fa sciste avait invité. 1 parpersuasion J. l'association à se dissoudre car elle ne concordait pasavec l'idéal fasciste. Si celle-ci conserva son indépendance quelquestemps. elle fu t bientôt contrainte d'arrêter ses activités lO I , En janvier1936. l'IFUW retira l'affiliation <strong>de</strong> l'association alleman<strong>de</strong> qui. sous lapression du gouvernement. avait pris <strong>de</strong>s mesures d'exclusion vis-àvis<strong>de</strong> certains <strong>de</strong> ses membres. jugés indésirables lO2 •Lors du congrês <strong>de</strong> Budapest en 1934. la Fédération Internationaleavait révisé ses statuts. en spécifiant que 1 ne pourront <strong>de</strong>venirmembres <strong>de</strong> la Fédération Internationale que les féd érations ou associationsnationales <strong>de</strong> femmes diplômées <strong>de</strong>s universités dont les butssont en harmonie avec les objectifs <strong>de</strong> l'IFUW et qui sont agréées parle Conseil: une seule fédération ou association étant agréée pourchaque pays. Ainsi. les fe mmes diplômées appartenant à une fédérationou association qui exclut <strong>de</strong> son sein <strong>de</strong>s fe mmes dûmentdiplômées pour <strong>de</strong>s raisons touchant à leur race. à leur religion ou àleurs idées politiques. ne pourront être agréées ou retenues commemembresJ I03 •101. • Rapport <strong>de</strong> la secrétaire aux relations Internationales J. Bulletin <strong>de</strong> laFBro. 13éme année. 1935, p. 18,102 . • Rapport <strong>de</strong> la v1ce·présl<strong>de</strong>nte aux relations Internationales ., Bulletin <strong>de</strong>la FBro. 14éme année, 1936, p. 15.103, Relations Internationales · • BuUetin <strong>de</strong> la FBro. 1934, p. 26.
110 La Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes WliversitairesGermaine Hannevart. Wle militante pour la paixLa Fedération belge adopte la même attltu<strong>de</strong> lO4 • Dés 1932. le 25janvier. la FBFU organise une conférence sur le désarmement etintensifie sa propagan<strong>de</strong> dans les écoles en faveur <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>snations "15 • A ce moment elle est dominée par la forte personnalité <strong>de</strong>Germaine Hannevart lO6 • qui a succédé à Marte Derscheid-Delcourt.Docteur en biologie <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> <strong>Libre</strong> <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>. GermaineHannevart. qui enseignait au Ly cée Emile Jacqmain.est présentedans le comité national pendant 26 ans : vice-prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> 1924 à1931 et prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> 1932 à 1950. Elle assura également la prési<strong>de</strong>nce<strong>de</strong> la Commission culturelle <strong>de</strong> l'IFUW I07 • Active également aulOBGroupement Belge <strong>de</strong> la Porte Ouverte et chez les Soroptlmists • elleallait s'engager à fond au sein du Comité mondial <strong>de</strong>s Femmes contrela Guerre et le Fascisme lO9 aux côtés <strong>de</strong> Jeanne-Emile Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong> et<strong>de</strong> Lucia <strong>de</strong> Brouckére qui en sera prési<strong>de</strong>nte d·honneur.110• Militantes exceptionnelles pour le combat antifasciste . • cesfemmes. la plupart liées par leur adhésion maçonnique. se sont mustréespar leur solidartté en faveur <strong>de</strong> l'Espagne républicaine. Elles ontobtenu l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la FBFU. qui s'est traduite notamment dans l'accueil<strong>de</strong>s enfants espagnols et dans la distrtbution <strong>de</strong> vivres et <strong>de</strong> vétementsaux femmes universitaires espagnoles. victimes du franquisme.C'est dans ce combat surtout que Germaine Hannevart donneratoute la mesure <strong>de</strong> sa conviction. Prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la section belge <strong>de</strong>l'Office International pour l'Enfance III. elle assume la responsabilité104 . • Séances <strong>de</strong>s membres ., Compte rendu du 8ème Congrès. Stockholm (6-15 août 19391. n021, London. 1939, p. 33.105. Bulletin <strong>de</strong> la FBFU. 1931-32 et 1932-33, p. 16 et p. 23.106. Elle fut considérée comme une <strong>de</strong>s personnalités les plus marquantes <strong>de</strong>l'IFUW le Séances <strong>de</strong>s membres " ln Compte rendu du 8ème Congrès. Stockholm(6- 15 août 19391. n02 1, London. 1939, p. 33)107. M-E. PREAUX. e Rapport <strong>de</strong> la vice-prési<strong>de</strong>nte aux relationsinternationales '. Bulletin <strong>de</strong> la FBFU. 1947. 1948, p. 15.108. L. SCHOlJfERS-DECROLY. e La femme et la Frané-Maçonnerte ... '. op. ciLp. 79.109. CEGES, Papiers G. Hannevart. PH 14. B. n023. archives <strong>de</strong> la FBFU.Lettre du 26 mai 1934.110. J. GarOVITCH. Du rouge au tricolore .... pp. 27-28.Ill. CEG ES. Papiers G. Hannevart. PH 14. A. n° 13. archives <strong>de</strong> la sectionbelge <strong>de</strong> l'Office International pour l'Enfance (1939- 1947). Cet organismeaccueille. répartit et assure la tutelle <strong>de</strong> centaines d'enfants espagnols enBelgique.
Viviane Di 1i1lioIII<strong>de</strong> l'accueil et <strong>de</strong> l'hébergement <strong>de</strong> centaines d'enfants espagnols en1936 1 , 12 .Sous l'impulsion <strong>de</strong> ces militantes, le soutien <strong>de</strong> la FBFU pritdiverses formes. Au niveau international. elle apporta son ai<strong>de</strong> auxassociations nationales affiliées à l'lFUW dans le besoin, elles'intéressa au sort <strong>de</strong>s intellectuelles émigrées vtctimes <strong>de</strong> préjugésracistes ou politiques. Dès le début <strong>de</strong>s années trente, en accord avecun Comité fondé à cet effet à Genève, elle intercè<strong>de</strong> auprès <strong>de</strong>spouvoirs publics pour que soient créées dans les écoles <strong>de</strong>s chaires <strong>de</strong>langue permettant <strong>de</strong> fournir un emplOi aux intellectuelles réfugiées1 . 13 D'autre part, la FBFU récolta également <strong>de</strong>s sommes plus oumoins élevées pour le Fonds d'entrai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'IFUW.En Belgique, <strong>de</strong>s appels constants fu rent lancés aux membresbelges <strong>de</strong> la Fédération en décembre 1938 pour envoyer <strong>de</strong>s vtvres auxfemmes universitaires <strong>de</strong> Barcelone l14 • D'autres apportaient chaquemois <strong>de</strong>s fonds collectés pour soutenir le home d'Uccle où la sectionbelge <strong>de</strong> l'Office International pour l'Enfance avait accueilli <strong>de</strong>senfants espagnols en février 1939. Quelques femmes mé<strong>de</strong>cinsoffrirent <strong>de</strong> soigner <strong>de</strong>s enfants espagnols gratuitement, <strong>de</strong> participerbénévolement à la confection <strong>de</strong> vétements pour les réfugiés et <strong>de</strong>collaborer aux œuvres d'assistance <strong>de</strong> la Croix_Rouge I15 •En fait. <strong>de</strong>puis plus d'un <strong>de</strong>mi-siècle, les fe mmes belges onttoujours été présentes pour créer ou participer à <strong>de</strong>s associations ou<strong>de</strong>s actions paCifistes. La FBFU s'insère dans un courant très sensibleau sein <strong>de</strong>s associations féminines engagées.Le 5 septembre 1936, la FBFU participa au meeting du Heysel à<strong>Bruxelles</strong>, organisé par le Comité Mondial <strong>de</strong>s Femmes contre laGuerre et le Fascisme et par le Comité Belge contre la Guerre et leFascisme, De cette organisation sortira le Rassemblement Universel112. CEGES, Papiers G. Hannevart, PH 14, A, n°l, archives <strong>de</strong> la section belge<strong>de</strong> l'Office International pour l'Enfance (1939- 1947)). Et PH 14, A, 0° 1 . archives<strong>de</strong> la FBFU.113. N-J. LAMEERE • • Rapport <strong>de</strong> la secrétaire générale ", Bulletin <strong>de</strong> la FBro.1932- 1933, p. 38.114. M. KERREMANS, • Rapport <strong>de</strong> la secrétaire générale ", Bulletin <strong>de</strong> laFBFU, 1938, p. 8.115 . • Ai<strong>de</strong> aux réfugiés ", Bulletin <strong>de</strong> la FBro. 1939, p. 7.
112 La Fédération belge <strong>de</strong>s Femmes WliversUairespour la Paix où la FBFU sera représentée par <strong>de</strong>ux déléguées,Marguerite Jadot-Vemelre et Germaine Hannevart 1l6Germaine Hannevart fu t l'une <strong>de</strong> ces femmes qui milita toute savie, • Je continuerai à travailler pour le trtomphe <strong>de</strong> la paix et duféminisme non seulement dans les rangs <strong>de</strong> la FBFU mals aussi avectout organisme qui aurait dans son programme l'un ou l'autre <strong>de</strong> ces<strong>de</strong>ux obj ectifs . 1I7 affirmait-elle, Sans <strong>de</strong>s pionnières <strong>de</strong> cette stature,la Fédération n'aurait jamais eu l'Impact qu'elle a obtenu et c'est grâceà elles que la Fédération connut son apogée dans l'entre-<strong>de</strong>ux-guerres,ConclusionsFondée en 1921, juste après la Première Guerre, dans la mouvanced'un idéal <strong>de</strong> paix et d'échanges internationaux, la FBFU a constituéun noyau <strong>de</strong> femmes instruites, cultivées, dont beaucoup se sontengagées sur la scène nationale et internationale, ouvrant ainsi <strong>de</strong>nouvelles voies aux femmes, Méme si toutes n'eurent pasd'engagement aussi marqué, elles constituaient. par leur volonté <strong>de</strong>s'afficher ouvertement comme femmes universitaires, une associationféministe d'un type totalement nouveau, Elle se démarquait ainsi <strong>de</strong>sautres associations féministes en estimant que les Intellectuellesétalent mieux armées que quiconque pour dénoncer <strong>de</strong>s situationsIntolérables et formuler <strong>de</strong>s exigences d'égalité,La Fédération a aussi contribué, du moins dans les milieuxlaïques, à changer l'image <strong>de</strong> la femme universitaire, Avant la guerre,les étu<strong>de</strong>s supérieures pour les filles se concevaient surtout commeun enrichissement personnel. une mise à niveau Intellectuelle avec lefu tur époux et un bagage supplémentaire pour remplir les fonctions<strong>de</strong> mère et d'éducatrice, Cette image restera d'ailleurs celle <strong>de</strong> lafé dération concurrente, l'Association catholique <strong>de</strong>s fe mmes universitaireset, en amont, <strong>de</strong>s JUCF (Jeunesses Universitaires catholiquesféminines),La Fédération défendait au contraire l'Idée que le diplôme universitaireétait un moyen d'émancipation et que les femmes avaient droit<strong>de</strong> faire carrtère, méme mariées, L'exemple étranger, surtout celui <strong>de</strong>s116, H, PEEMANS-POULLET, Femmes en Belgique .... p, 115,117, G, HANNEVARr, • Allocution <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>nte " Bulletin <strong>de</strong> la FBflJ, 1952,p, 9,
Viviane Di T!llio 113Etats-Unis. est souvent invoqué, C'est ainsi que Germaine Hannevart.déléguée au Conseil <strong>de</strong> Wellesley en 1931 et reçue dans différentesuniversités (Harvard. Yale. l'université <strong>de</strong> Columbia) ainsi que par <strong>de</strong>sgroupes <strong>féminins</strong> (l'YWCA. la Business and Professonal Women.l'American Women .. ,). ne peut cacher son admiration, mème si elle estteintée d'une pointe d'ironie. pour ces • gran<strong>de</strong>s entreprises entièrementfinancées par <strong>de</strong>s femmes qui démontrent ce que peuventl'union. la volonté. le nombre .. , et l'argent ! .118La Fédération constitua sans nul doute un noyau élitiste. qui serévéla solidaire <strong>de</strong>s autres groupes fèministes et ne manqua jamais <strong>de</strong>participer aux luttes pour défendre les travailleuses en général.Ces femmes, qui fu rent <strong>de</strong> nouveaux modèles i<strong>de</strong>ntitaires pour lesjeunes filles. surtout pour celles fo rmées dans les lycées où ellesenseignèrent. ont trouvé dans la solidartté intellectuelle internationale<strong>de</strong>s éléments d'espoir et d'optimisme, Fréquentant les congrès internationaux,ceux <strong>de</strong> la Fédération Internationale mais aussi <strong>de</strong>scongrès scientifiques grâce aux bourses <strong>de</strong> voyage. elles visitèrent <strong>de</strong>spays plus avancés et les acquis <strong>féminins</strong> qu'elles y découvraient nourrissaientleur confiance dans l'émancipation future <strong>de</strong> leurs compatriotes,118. Bulletin <strong>de</strong> la FBro, 1930- 1931. p. 30.
Sophie Matkava 115Trois générations <strong>de</strong> fe mmes contre l'alcoolL'engagement <strong>de</strong> la famille Nyssens1899-1951 1 Sophie MatkavaLa philanthropie : un engagement ?L'Union <strong>de</strong>s Femmes belges contre l'alcoolisme, créée en 1899, est lapremiére société antialcoolique féminine en Belgique 2 , Bien que l'Unionait toujours souhaité la collaboration <strong>de</strong>s hommes. elle a été fo ndée etdirigée principalement par <strong>de</strong>s femmes. Société féminine. mais nonexclusive et ouverte à la mixité. l'Union a entretenu <strong>de</strong>s liens étroitsavec le féminisme et. par le biais <strong>de</strong> ses principales militantes, avec lepacifisme.L'Union <strong>de</strong>s femmes belges contre l'Alcoolisme fait ainsi partie <strong>de</strong>cette nébuleuse • philanthropique .. encore peu étudiée pour laBelgique. qui accompagne et soutient le féminisme au tournant du 19'siècle. Il s'agit d'un large mouvement où se retrouvent pèle-mèle <strong>de</strong>s1. Cet article est tiré du mémoire <strong>de</strong> licence : S. MATKAVA, L'Union <strong>de</strong>s jemmesbelges contre l'alcoolisme 1899-1951. De la lutte antialcoolique aux militantismesjé ministe et pacifIste. Mém. Llc. Histoire, UL8, 1996.2. Sur le mouvement antialcoolique antérieur. voir notamment : S_ DECLERCK,Genèse du discours antialcoolique en Belgique 1830- 1 870. mém. IIc .. Histoire,UL8, 1994 : F. PIERLOT, L'alcoolisme en Belgique 1930-1 950. Mythes et réalités,mém. lic .• Histoire, U. Llége, 1993.
Sophie Matkava 117libre ... Ce sera l'affranchissement <strong>de</strong> la fe mme au xx.e siècle .4. Mals cediscours n'est pas aussi radical qu'Il paraît. S'Il faut donner plusd'influence à la fe mme pour qu'elle restaure une société mise à mal parles hommes, cette nouvelle fonction ne la détournera pas <strong>de</strong> sa • vraie .mission : la famllle reste pour elle fondamentale. Il s'agit aussi <strong>de</strong>rassurer, d'atténuer le discours, dramatisé à l'extrême, sur lesconséquences <strong>de</strong> l'émancipation fé minine : • gue la fe mme ose se produire,parler en public, écrire dans <strong>de</strong>s journaux, prendre part auxluttes qui Intéressent les hommes. Elle n'en sera pas moins femme <strong>de</strong>ménage et fe mme au foyer .5.SI les liens avec le fé minisme sont évi<strong>de</strong>nts, ceux avec le pacifismesont plus diffus. Ils découlent surtout <strong>de</strong>s relations personnelles. Certainsthéoriciens féministes, comme l'avocat Louis Frank, Iront jusqu'àétablir un lien direct entre l'alcool et la guerre , les taxes sur la vented'alcool permettant d'acheter les armements nécessaires. Pour lui, laguerre est un produit d'hommes . dits civilisés [qui) s'empoisonnent parl'alcool afin <strong>de</strong> se procurer les ressources leur permettant <strong>de</strong> se détruirepar la guerre .6. Mals d'une manière générale, les fe mmes Justifierontplutôt leur engagement comme une aptitu<strong>de</strong> . naturelle . : c'est en tantque mères qu'elles revendiquent la paix.Entre les différents mouvements qui finissent par s'épauler, les rencontressont fréquentes. Le Conseil National <strong>de</strong>s Femmes belges(CNFB), fondé en 1905, est à l'Image <strong>de</strong> ce syncrétisme. Issu <strong>de</strong> troisassociations - la Ligue du Droit <strong>de</strong>s Femmes, la Société pourl'Amélioration du Sort <strong>de</strong> la Femme et l'Union <strong>de</strong>s Femmes belgescontre l'Alcoolisme - le CNFB compte dès la création quatre sociétéssupplémentaires, toutes à vocation philanthropique : l'Œuvre <strong>de</strong> laMaison <strong>de</strong>s Servantes et <strong>de</strong> la Bourse <strong>de</strong> Travail, l'Œuvre <strong>de</strong> la CroixVerte, l'Union <strong>de</strong>s Mères <strong>de</strong> Famille et la Mutuelle La Ruche 7 • D'entrée4. J. KEELHOFF, • Affranchissons-nous, mesdames, ., La Clairière, 16 août1903, p. 1.5. Ibi<strong>de</strong>m.6. L. FRANK, La fe mme contre l'alcool Etu<strong>de</strong> sociologique et <strong>de</strong> légis lation.<strong>Bruxelles</strong>, 1897, p. 115.7. Le temps <strong>de</strong>s fe mmes, CNFB, <strong>Bruxelles</strong>, 1988, pp. 21-22.
118 Trois générations <strong>de</strong>femmes contre l'alcool<strong>de</strong> Jeu. aux commissions . Lois ". • Presse " • Suffrage ". le CNFB aj outecelles <strong>de</strong> • Paix et arbitrage ". <strong>de</strong> • Moralité " et d·. Hygiène ".Ces mouvements ont souvent été portés à bout <strong>de</strong> bras parquelques personnalités. Certaines. brtllantes. sont connues. commeLéonie La Fontaine et son frère Henrt. D'autres. bien que présentes etactives. sont restées dans l'ombre. C'est le cas <strong>de</strong>s . dames " Nyssens :les <strong>de</strong>ux belles-sœurs Joséphine Keelhoff-Nyssens et Anne-LouiseNyssens-Guillaumot. les <strong>de</strong>ux nièces Marguerite Nyssens et AntoniaNyssens-Van Dreveldt. Maria Hettema-Nyssens. enfin. la fille d·Antonia.Nyssens <strong>de</strong> souche ou Nyssens par alliance, elles tissent un véritableréseau familial voué à la lutte antialcoolique puis pacifiste.Il ne s'agit pas ici <strong>de</strong> retracer en détail chaque biographie mais <strong>de</strong>brosser un aperçu <strong>de</strong> cet étonnant engagement familial. Gérant l'Union<strong>de</strong>s Femmes belges contre l'Alcoolisme comme une . affaire " familiale.ces femmes en ont conservé toutes les archives.Le Fonds Nyssens 8 , déposé aux Archives <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>,est impressionnant par son ampleur et sa continuité et permet <strong>de</strong> suivreun engagement militant sur trois générations. Engagement tardifchez les fondatrtces, précoce et • hértté " chez les suivantes. mené <strong>de</strong>front par certaines avec la gestion d'une famille nombreuse ou d'uneactivité professionnelle. ces femmes sont aussi représentatives d'unmilieu sociologique, Il s'agit d'un milieu très caractértstique. commerçantet industrtel. <strong>de</strong> moyenne bourgeoisie. instruit. féru <strong>de</strong> musique.préoccupé d'améliorations sociales et politiquement inscrit dans lelibéralisme progressiste <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>.8. Le Fonds Nyssens est un don fait aux Archives <strong>de</strong> la Ville <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> parMaria Hettema-Nyssens en 1982. Il ne comprend pas moins <strong>de</strong> 65 cartons etcontient non seulement les archives <strong>de</strong> l'Union <strong>de</strong>s Femmes belges contreJ'Alcoolisme, mais encore <strong>de</strong>s collections <strong>de</strong> publications antialcooliques et ungrand nombre <strong>de</strong> documents personnels (correspondance, agendas ... ). A cela ilfaut aj outer <strong>de</strong>s documents relatifs au pacifisme et au féminisme, et <strong>de</strong>sdocuments relatifs à J'entreprise familiale (manufacture <strong>de</strong> glaces Nyssens).
Sophie Matkava 119Généalogie sommaire<strong>de</strong> la branche bruxelloise <strong>de</strong> la famille Nyssens1. Gérard-ElIÙle Nyssens1815 -1906+ Jeanne Mas 1820-19018 enfantsdont ElIÙle Nyssens1856-1919+ Antonia VanDreveldt 1861-19497 enfantsdont Marta Nyssens 1888-1982+ Georges van Albada <strong>de</strong>Haan HeUema 1885- 19522 enfantsHenIi HettemaJohanna Hettema.épouse Dewerpe(1913 - )2. Gustave-Adolphe Nyssens1820- 1901+ en premières noces CécileMichaux (1832- 1862)5 enfantsdont MargueriteNyssens 1858- 1947+ en secon<strong>de</strong>s noces AnneLouise Guillaumot (1836-1907)4 enfants3. Joséphine Nyssens1833- 1917épouse François Keelhoff1820- 1893sans enfant
-Sop hie Matkaoo. 121d'engagement particulier, sauf peut-être pendant la guerre francoprussienneoù elle aurait été, selon la tradition orale familiale. infirmièrevolontaire auprès <strong>de</strong> la Croix-Rouge.En-tête <strong>de</strong> lettre du magasin Verleysen-Nyssens, rue Royale, où JoséphineKeelhoff travailla avant son mariage (AVB. Fonds Nyssens).Après son mariage, elle habite à Neerhaeren. en Hollan<strong>de</strong> où elledispense <strong>de</strong>s cours aux enfants pauvresI2• Veuve à 60 ans. restée sansenfant. cultivée. amie intime <strong>de</strong>s peintres Robbe13 et StrobbaersI4,exactement à quel titre. En effet, elle est dotée d'un livret <strong>de</strong> domestique ! (I<strong>de</strong>m.1866, T5. f"8 13).12. AVB. Fonds Nyssens. carton 17, lettre adressée à Antonia Nyssens-VanDreveld. 25 décembre 1942 par son neveu Raymond Van <strong>de</strong>r Burght. notaire àVllvor<strong>de</strong>. accompagnant une biographie <strong>de</strong> Joséphine Keelhoff (c la tanteJosse -). écrite par lui en 192113. Henri Robbe (1807- 1 899) peintre et aquarelliste romantique <strong>de</strong> fleurs et <strong>de</strong>fruits dont la carrtére avait débuté par la musique à Paris. Rentré en Belgique en
122 Trois générations <strong>de</strong>Jenunes contre l'alcoolJoséphine KeelhofT consacre les vingt <strong>de</strong>rnières années <strong>de</strong> sa vie à lalutte antialcoolique. sans qu'il soit possible <strong>de</strong> préciser ce qui l'y adétenninée,Après avoir vendu une partie <strong>de</strong> ses biens pour récolter <strong>de</strong>sressources pour la propagan<strong>de</strong> antialcoolique. elle quitte sa maison <strong>de</strong>Neerhaeren et s'installe à <strong>Bruxelles</strong>. rue <strong>de</strong>s Minimes. dans un <strong>de</strong>uxpiècessitué au premier étage <strong>de</strong> l'immeuble occupé par l'éditeur Larcler.à <strong>de</strong>ux pas <strong>de</strong> la Maison du Peuple15, C'est là que se tiendront lespremières séances du comité fondateur <strong>de</strong> l'Union. et que Joséphinerédigera Inlassablement <strong>de</strong>s articles pour les organes <strong>de</strong> la société :L'Action sociale d'abord, La Clairière et son pendant flamand, Het Geluk<strong>de</strong>s Huisgezins J6 ensuite. publications qu'elle finance elle-méme. dumoins au début.A son Initiative. quelques dames se réunissent le 15 mars 1899 . pourfon<strong>de</strong>r une union entre toutes les fe mmes <strong>de</strong> la Belgique afin <strong>de</strong> défendreles femmes du peuple contre leurs maris alcoolisés et <strong>de</strong> travailler partous les moyens à diminuer l'usage <strong>de</strong>s boissons alcoolisées .17,Dès la fondation, le ton est donné : II s'agit d'une association <strong>de</strong> femmesqui entend lutter contre l'alcoolisme <strong>de</strong>s hommes du peuple et surtoutprotéger les fe mmes <strong>de</strong>s violences <strong>de</strong> leurs maris. L'objectif estsexuellement et socialement ciblé : il sera peu question d'alcoolismefé minin - même si l'Union reconnaît qu'il existe et le déplore - toutcomme II sera peu question <strong>de</strong> l'alcoolisme <strong>de</strong>s classes aisées.1840. Il se tourne vers la peinture et se spécialise en décoration <strong>de</strong> porcelaines(Dictionnaire <strong>de</strong>s peintres belges du s. à nos jours .... t. II, p. 853).14. Jean-Baptiste Strobbaers (1838- 1914) peintre et graveur réaliste, évoluantvers un Impressionnisme très personnel. Membre fo ndateur <strong>de</strong> l'Art contemporain,(Dictionnaire <strong>de</strong>s peintres .... t. II, p. 935) et Nos contemporains, <strong>Bruxelles</strong>, 1904,pp. 22 1 -222.15. Papiers personnels <strong>de</strong> Mme Dewerpe, • Généalogie <strong>de</strong> la famille ... . , op. cit.16. Sur L'Action sociale, bi-mensuel créé en 1901. auquel succè<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1903 à 1914La Clairière : E. FLOUR. C. JACQUES et C. MARISSAL, Répertoire <strong>de</strong> la pressejé minine etjéministe en Belgique 1830-1 994, INBEL, <strong>Bruxelles</strong>, t. 1. pp. 2 et 87.Sur Het Gelule <strong>de</strong>s Huisgezins. publié en 1910 : E. FLOUR. C. JACQUES et C.MARISSAL, Repertorium van <strong>de</strong> jeministische en vrouwenpers 1830- 1 994, t. II.lNBEL, <strong>Bruxelles</strong>, 1994, pp. 76-77.17. AVB, Fonds Nyssens, carton 8, Procès-verbaux <strong>de</strong>s séances, p. 1.
&>phie Matkava 123L'Union estime qu'il est du <strong>de</strong>voir <strong>de</strong>s fe mmes <strong>de</strong> se préoccupersurtout <strong>de</strong> l'alcoolisme <strong>de</strong>s ouvriers parce que les fe mmes et les enfantsen sont les victimes directes. Dans ce but, elle s'affirme au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>tous les partis et proclame sa neutralité politique18•Secrtlulat ttHni : 41, PUGE DU GRAND SAILON, BRUXELLESu.Vil la promesse faite par _________ _fW1lS racceptcns cam _ _ bre <strong>de</strong> III Sediotl <strong>de</strong> Temperance.La SecrEtaire <strong>de</strong> la SectlOll,7it .j Promesse <strong>de</strong> Tempêrance* +.*.*.*. ••••• * . * ••• tîi _Je dic/u, prendr, l'eagement d'honneur <strong>de</strong>",'ahstenir <strong>de</strong> toute boisson tJkooliqzu distilU, : gl1lièvre,liqueurs, ilixirs, ahsintlu, aPiritifs , tU.C'"''':" (f,,") :'-=---.-90. _ . . . . . . . . . . . . . . --Carte <strong>de</strong> membre à l'Union <strong>de</strong>s Femmes contre l'Alcoolisme.portant au verso rengagement d'être abstinent (AVB , Fonds Nyssens)II:"Si le comité provisoire, présidé par Anna-Louise Nyssens-Guillaumot.est composé exclusivement <strong>de</strong> fe mmes, on note toutefois <strong>de</strong>s hommesparmi les membres fondateurs. Des hommes <strong>de</strong> la famille Nyssens,bien sûr : Gustave Nyssens, le frère <strong>de</strong> Joséphine Keelhoff, commer-18. AVB. Fonds Nyssens. carton 8. P.V.<strong>de</strong>s séances. 18 mai 1900 et 27décembre 1901.
124 Trois générations <strong>de</strong>ferrunes contre l'alcoolçant. administrateur <strong>de</strong> société et ancien conse1ller communal àAnvers. un <strong>de</strong> ses fils. Albert Nyssens. militaire <strong>de</strong> carrtèrel 9 • ErnestNyssens. docteur en mé<strong>de</strong>cine. neveu <strong>de</strong> Joséphine Keelhoff. D'autreségalement. dont plusieurs hommes politiques. le libéral GustaveJottrand. les catholiques Auguste Beernaert et Jules Le Jeune. le socialisteHenrt La Fontaine 20 •Parmi les fondatrices <strong>de</strong> l'Union. on remarque encore EuphrosineBeernaert 21 • vice-prési<strong>de</strong>nte d·honneur. Léonie La Fontaine 22 • sœurd·Henri. Lilly Elisabeth Cartei23. Marie Parent. féministe notoire quisera secrétaire <strong>de</strong> l'Union puis s'en détachera en 1905 pour fon<strong>de</strong>r unesociété concurrente. l'Alliance <strong>de</strong>s femmes contre l'abus <strong>de</strong> l'alcool 2 4 • Laprési<strong>de</strong>nce d'honneur est offerte à l'épouse du ministre Jules Le Jeune.19. A ne pas confondre avec son homonyme. l'homme politique catholique(1855- 19011 qui fu t ministre du travail et <strong>de</strong> l'Industrte en 1899.20. Gustave Jottrand (1830- 19061. avocat libéral. conseiller communal (1869-71) puis député <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> (1870- 18841. plusieurs fols prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Ligue <strong>de</strong>l'Enseignement. Auguste Beernaert (1829- 19121. représentant catholique (1874-19001. ministre <strong>de</strong>s Travaux Publics (1873- 18781. ministre <strong>de</strong> l'Agriculture. <strong>de</strong>l'Industrte et <strong>de</strong>s Travaux publics (1884). ministre <strong>de</strong>s Finances (1884-18941.ministre d'Etat (18941. prix Nobel <strong>de</strong> la Paix. 1909. Henri La Fontaine (1854-19431 sénateur provincial socialiste <strong>de</strong> 1895 à 19361. prix Nobel <strong>de</strong> la Paix en1913. Jules Le Jeune (1828-191 11. catholique. sénateur provincial 1894-1900.ministre <strong>de</strong> la Justice (1887-18941. ministre d'Etat (18941. Voir notamment N.LUBELSKI-BERNARD. Mouvements et idéologies pacifIStes en Belgique 1830-1914. Thése <strong>de</strong> doctorat. ULB. 1977.21. Euphroslne Beernaert (183 1-190 11. sœur d·Auguste. peintre réalistereconnue et réputée. Membre fondatrice du Cercle <strong>de</strong>s Aquarellistes et <strong>de</strong>sAquafortistes <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> en 1883 (Dictionnaire <strong>de</strong>s peintres ..•• t. 1. p. 60122. Sur Léonie La Fontaine. féministe et pacifiste notoire : M. BRUWIER. • HenriLa Fontaine et l'Ordre maçonnique mixte International •. Cent ans <strong>de</strong> l'OffIC eInternational <strong>de</strong> Bibliographie. Mons. Mundaneum. 1995. pp. 113- 135.23. Lilly Elisabeth Carter (1863-1 9371 d'orlglne anglaise. éléve et discipled'Isabelle Gatti <strong>de</strong> Gamond. maîtresse d'anglaîs au Cours d'Education jusqu'en1908. puis dlrectrtce du Cours d'Education C . Créatrtce <strong>de</strong>s bibliothèques pourenfants ' Les heures Joyeuses '. A sa retraite. en 1925. elle adhère au POB et• apôtre fervent <strong>de</strong> la paix. elle s'adonne entièrement à la propagan<strong>de</strong> pour laSDN . (La travailleuse traquée. janvier-mai 1938. pp. 14-16 : BiographieNationale. t. XXXII. col. 84-881.24. Le différend entre les <strong>de</strong>ux associations porte sur le choix entre l'abstinenceou la tempérance. L'Unlon ne prône pas l'abstinence totale. bien qu'elle ait unesection <strong>de</strong> ce type. Marte Parent quant à elle adoptera une attitu<strong>de</strong> pluspermissive. propageant ' seulement . la tempérance.
Sophie Matkava 125Très vite. l'Union se présente comme un «fief . <strong>de</strong> la familleNyssens. La prési<strong>de</strong>nce sera toujours aux mains d'une dame Nyssens.à une exception près.Les premières prési<strong>de</strong>ntesAnne-Louise Guillaumot (1836- 1907). la première prési<strong>de</strong>nte. avaitépousé en secon<strong>de</strong>s noces Gustave Nyssens. veuf <strong>de</strong> Claire Michaux (etdéjà père <strong>de</strong> cinq enfants. dont Marguerite Nyssensl. Elle est donc <strong>de</strong> lamème génération que Joséphine. sa belle-sœur s .Née en 1836 à Liège. elle est issue d'une famille <strong>de</strong> militaires. Sonpère. le lieutenant général Guillaumot est d'origlne française : sa mère.Fanny Chabert est elle-méme fille d'un chef <strong>de</strong> bataillon. promu chevalierd·Empire 26 • C'est véritablement dans le sillage <strong>de</strong> sa belle-sœurqu'elle se lance dans la lutte antialcoolique : elle prési<strong>de</strong> l'Union à safo ndation. Elle semble avoir eu une réelle activité et avoir suscité notammentla création d'une section locale. celle <strong>de</strong> Morialmé 27 • AnneLouise Nyssens-Guillaumot occupe la prési<strong>de</strong>nce jusqu'en 1903. puisla vice-prési<strong>de</strong>nce jusqu'en 1907. année <strong>de</strong> son décés.C'est Joséphine Keelhoff. qui. après avoir assumé la fonction <strong>de</strong>trésorière. reprend la prési<strong>de</strong>nce jusqu'à l'arrèt provisoire <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>la société en 1914. Retirée dans sa maison <strong>de</strong> Neerharen pendant laguerre. elle y décè<strong>de</strong> à l'âge <strong>de</strong> 84 ans. le 14 mars 191728•Dans l'immédiat après-guerre. l'Union est présidée par Laure LevozHauzeur' - seule prési<strong>de</strong>nte à ne pas appartenir à la famille Nyssens -qui assume une sorte d'Intérim entre 19 19 et 1923. Puis Marguerite25. Ce qui n'est pas évi<strong>de</strong>nt si l'on se rappelle que la famille Nyssens d'originecompte 15 enfants.26. Papiers privés <strong>de</strong> Mme Dewerpe. Généalogie <strong>de</strong> laJamil1e .. .. p. 4027. AVB Fonds Nyssens. PV <strong>de</strong>s séances ... . 9 octobre 1900.28. AVB. Fonds Nyssens. Faire-part <strong>de</strong> décès. boite 9.29. Laure Levoz-Hauzeur. d'abord secrétaire <strong>de</strong> la section <strong>de</strong> Verviers. ellesemble apparentée par alliance à la gran<strong>de</strong> famille industrielle lainière <strong>de</strong>sPeltzer <strong>de</strong> Clermont. Elle-même épousa Arthur Levoz. qui fu t notammentsecrétaire général <strong>de</strong> la Ligue <strong>de</strong> l'Enseignement <strong>de</strong> 1905 à 1910. Elle entre auComité bruxellois en 1904.
126 Trois générations <strong>de</strong>Jemmes contre l'alcoolNyssens, la nièce <strong>de</strong> Joséphine, remet en selle l'Union, avec rai<strong>de</strong> <strong>de</strong> sapetite cousine Maria Hettema-Nyssens. Cette <strong>de</strong>rnière en assume laprési<strong>de</strong>nce jusqu' en ... 1950 'Les prési<strong>de</strong>nces d'honneurs sont, elles, très habilement, proposées à<strong>de</strong>s femmes marquantes, catholiques, qui • cautionnent . ainsi laneutralité d'une Union dont le noyau actif est clairement libéral : àMme Jules Le Jeune succè<strong>de</strong>ra l'épouse d'un autre ministre catholique,Juliette Carton <strong>de</strong> WiarfO. Après la première guerre, l'association feral'économie <strong>de</strong> ces postes honorifiques.L'organisationDès 1900, l'Union obtient un subsi<strong>de</strong> du ministère <strong>de</strong> l'Agriculture 31et prend ainsi place aux côtés <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> tempérance plusanciennes, comme la Ligue Patriotique contre l'Alcoolisme, le Bien Etresocial ou la Croix Bleue 32 • En 1905, l'Union fait état <strong>de</strong> 2.000 membres,dont environ 500 membres payants et protecteurs 33 • Elle suscite lacréation <strong>de</strong> comités provinciaux dans les régions industrielles,principalement à Liège (1900). sous la prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Marguerite <strong>de</strong>Laveleye 34 , à Seraing, à Herstal. à Verviers, à Gand. Mais elle essaimeaussi ailleurs, au gré <strong>de</strong>s relations personnelles : à Morialmé, àNieuport, à Heyst-sur-mer.30. Sur Juliette Verhaegen voir E. GUBIN, • Juliette Verhaegen, une vie auservice <strong>de</strong> l'enfance •. dans Pierre-Théodore Verhaegen. L·homme. sa vie. salégen<strong>de</strong>. <strong>Bruxelles</strong>. ULB. 1996. pp. 217-226. Elle épousa Hemy Carton <strong>de</strong> Wlart.représentant catholique <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> <strong>de</strong> 1896 à 1950. ministre <strong>de</strong> la Justice(1911-1918). plusieurs fois ministre jusqu' en 1951. ministre d'Etat (1918).31. AVE. Fonds Nyssens. carton 8. L'Union <strong>de</strong>s femmes .... PV <strong>de</strong>s séances.séance du 298 Juin 1900 et G. MALHERBE. Les sociétés <strong>de</strong> tempérance. Binche<strong>Bruxelles</strong>. 1900. pp. 22-27.32. Sur ces associations : M. TIMMERMAN. De sociale emst van het alkoholismeen <strong>de</strong> mobUisatie vanaJ het laatste kwart van <strong>de</strong> negentien<strong>de</strong> eeuw. mém. lie .•U.Gent. 198 1. pp. 175-260.33. n existe en effet <strong>de</strong>s . membres sympathiques '. non payants. souvent issus<strong>de</strong> la classe ouvrière. et qui s'engagent à • porter la bonne ' parole . dans leurentourage.34. Marguerite-Louise-A<strong>de</strong>lai<strong>de</strong> <strong>de</strong> Laveleye. fille d'Emile <strong>de</strong> Laveleye et d'EstherPrisse. née le 21 juin 1859. Son père est un économiste connu et professeur àl'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Liège (La noblesse belge. 191 1. 2e partie. p. 38 1).
128 Trois générations <strong>de</strong>Jemmes contre l'alcoolPour aplanir certaines divergences entre les membres 3S , une sectiond'abstinence totale est fondée à <strong>Bruxelles</strong> en 190336, sous la prési<strong>de</strong>nce<strong>de</strong> Marie-Anne De Leener, veuve <strong>de</strong> l'échevin <strong>de</strong> l'instruction publiqueEmile Andre7 •Rapi<strong>de</strong>ment, il est question <strong>de</strong> fédérer toutes les forces éparses <strong>de</strong> lalutte antialcoolique pour revendiquer plus efficacement <strong>de</strong>s mesureslégislatives et l'intervention <strong>de</strong> l'Etat. Aprés un premier échec en 1901,l'idée d'une fédération est acceptée au Deuxiéme Congrès réuni par laLigue Patriotique contre l'Alcoolisme en 1905 et les bases d'un ComitéNational contre l'Alcoolisme sont jetées. Joséphine Keelhoff siègecomme membre au Conseil général.Propagan<strong>de</strong> et discoursLes moyens <strong>de</strong> propagan<strong>de</strong> sont classiques : organes, brochures,conférences. L'Union s'exprime d'abord par la voix du Journal <strong>de</strong>sMères3B, publié par Marie Parent mais elle possè<strong>de</strong> son organe propre,L'Action socin.le. dès 1901 auquel succè<strong>de</strong> en 1903 La Clairière. Vers lebeau et le vrai dont Joséphine Keelhoff est administratrice. Un pendantflamand, Het Geluk <strong>de</strong>s Huisgezins est également publié pendantquelques mois mais il fu sionne avec La Clairière en 1911. désormaisbllingue l9 •L'Union laisse le choix à ses membres entre l'abstinence et latempérance, méme si un grand nombre <strong>de</strong> membres du Comité sontplutôt favorables à l'abstinence compléte. Son message est relativementclassique : l'association dénonce les méfaits <strong>de</strong> l'alcool dans une35. Divergences qui aboutiront rappelons-le. au départ <strong>de</strong> Marle Parent et à lacréation en 1905 <strong>de</strong> l'Association <strong>de</strong>s femmes contre les abus <strong>de</strong> l'alcool.36. AVE. Fonds Nysssens. carton 8. Registre Union <strong>de</strong>s Femmes .... P.V. <strong>de</strong>sséances. séance du 23 janvier 1903.37. Marle-Anne <strong>de</strong> Leener. née à <strong>Bruxelles</strong> le 26 juillet 1850. fille <strong>de</strong> Jean DeLeener et <strong>de</strong> Jeanne Oor. avait épousé en 1874 l'avocat libéral bruxellois EmileAndré. qui fu t échevin <strong>de</strong> l'Instruction publique à <strong>Bruxelles</strong> (Biographienationale. 1. xxx. col. 50-511.38. Sur le Journal <strong>de</strong>s Mères qui parut <strong>de</strong> 1901 à 1934. E. FLOUR. C. JACQUES etC. MARISSAL, Répertoire <strong>de</strong> la presse féminine ..•• 1. I. pp. 289-29239. Voir précé<strong>de</strong>mment note 16.
Sophie Matkava 129perspective double, passant <strong>de</strong> l'intérét économique du pays à disposerd'une main d'œuvre saine et rentable, à la volonté d'améliorer lesconditions <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s ouvriers, tout en les contrôlant. Ses discours nes'éloignent guère <strong>de</strong>s discours antialcooliques généralement diffusés àcette époque en Belgique par les classes dirigeantes.Mais on y trouve néanmoins <strong>de</strong>s thèmes chers aux milieuxprogressistes libéraux : le statut <strong>de</strong> l'ouvrier, les droits <strong>de</strong> la femme,l'obligation scolaire. On y retrouve le désir d'aboutir à un mon<strong>de</strong>meilleur pour tous, sans pour autant bouleverser les rôlestraditionnels. On aspire à une amélioration du système social existantet non à un changement profond.Pour y arriver. les principaux moyens sont, eux aussi,• classiques . : fêtes <strong>de</strong> soutien (mals le mo<strong>de</strong>rnisme pointe son nezquand il s·agit. par exemple. <strong>de</strong> fêtes cinêmatographlques en 1909 et en1910 au Royal Nord à <strong>Bruxelles</strong>), brochures, tournées <strong>de</strong> conférences.L'œuvre <strong>de</strong> Joséphine KeelooIfDe toute évi<strong>de</strong>nce, l'Union a pris place dans le mouvement antialcoolique,au niveau national et à l'étranger. Elle participe aux gran<strong>de</strong>smanifestations <strong>de</strong> la lutte contre l'alcool : à Paris en 1900, à Genève en1903. à Budapest en 1905 où elle obtient un diplôme d'honneur, àMilan en 1907, où elle obtient . trois diplômes <strong>de</strong> médaille d'or .40.Mais la réalisation la plus importante <strong>de</strong> l'Union avant la guerre. quiest l'œuvre <strong>de</strong> Joséphine KeelhofT, reste sans aucun doute le Restauranthygiénique ouvert le 3 décembre 1901 à <strong>Bruxelles</strong>, en plein cœur<strong>de</strong> la ville, 40 place du Sablon. C'est avec ses fonds propres que Joséphineentreprend <strong>de</strong> louer le rez-<strong>de</strong>-chaussée4 1 : le Restaurant hygiéniqueabrite également une petite bibliothèque avec salle <strong>de</strong> lecture etune salle <strong>de</strong> conférences. • On y trouvait les œuvres <strong>de</strong> Tolstoï. <strong>de</strong>Ruskin, <strong>de</strong> l'abbé Lemire. du docteur Forel et <strong>de</strong> la bonne Suissesse,40. Plus <strong>de</strong> détails dans S. MATKAVA. L'Union <strong>de</strong>sfemmes belges ...• pp. 37-40.41. AVB. Fonds Nysssens. carton 8. Registre Union <strong>de</strong>s Femmes .... P.V. <strong>de</strong>sséances. 21 octobre 190 1.
130 Trois générations <strong>de</strong>Jemmes contre l'alcoolMme Combe42. Et U y avait le soir <strong>de</strong>s conférences où <strong>de</strong> vieUles damesâgées et <strong>de</strong>s jeunes hommes qui l'étaient moins (mais avaient le mérite<strong>de</strong> ne pas s'en vanter) prononçaient <strong>de</strong>s discours incendiaires sur leféminisme et la chasteté .43Des repas complets. à prix abordables sont servis dans la salle àmanger toute la journée ainsi que <strong>de</strong>s plats végétariens. régimealimentaire dont Joséphine KeelhofT est a<strong>de</strong>pte44• Comme le combatféministe s'inscrit pour elle dans le prolongement du combatantialcoolique. la salle <strong>de</strong> conférence du Restaurant hygiéniqueaccueille <strong>de</strong>s conférenciers et <strong>de</strong>s conférenciéres féministes. L'Unlonmènera plusieurs actions aux côtés du CNFB. <strong>de</strong>s réunions amicalessont convoquées au Restaurant hygiénique. qui s'inscrivent enquelques sorte dans la tradition <strong>de</strong>s Dîners féministes. tenus à lamême époque par la Ligue du Droit <strong>de</strong>s Femmes45 et auxquelsJoséphine Keelhoff participe <strong>de</strong> manière assidue. Elle y prononçanotamment un discours très féministe réclamant l'égalité à tous lesniveaux parce que 1 l'humanité est composée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux classes d·êtres.<strong>de</strong> sexe différent mais semblables par leur raison. par leurs besoins.par le but auxquels ils ten<strong>de</strong>nt .. et elle dénonçait vivementl'oppression masculine46•La réussite <strong>de</strong> ce premier restaurant suscite la création en 1904d'une société coopérative dans le but <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r et <strong>de</strong> gérer <strong>de</strong>sétablissements analogues dans le pays47. Parmi les fondateurs. onretrouve toujours les mêmes personnalités. auxquels s'aJoutent HectorDenis ou la fé ministe libérale Jane Brigo<strong>de</strong>48•42. Un article lui est consacré. <strong>de</strong> la plume <strong>de</strong> M. MAZBOURI et M. PAVILLONdans le n° 10 <strong>de</strong> Sextant. à paraître.43. Biographie <strong>de</strong> R van <strong>de</strong>r Gucht. citée précé<strong>de</strong>mment. p. 3.44 AVB. Fonds Nysssens. carton 8. Registre Union <strong>de</strong>s Femmes .... P.V. <strong>de</strong>sséances. 8 mal 19 11.45 AVB. Fonds Nysssens. carton 8. Registre Union <strong>de</strong>s Femmes .... P.V .• <strong>de</strong>sséances. 11 février 1907.46. La. Ligue. 1904. pp. 23-24.47. Annexes au Moniteur belge. Recuell. ... acte 3780. 15.07. 1904. 1904.pp. 245-247.48. Sur Jane Brigo<strong>de</strong> : I. GESQUIERE. C. JACQUES et C. MARISSAL. Dixfemmes en politique. <strong>Bruxelles</strong>. INBEL. 1994. pp. 69-88.
Sophie Matkava 131PRE?\EZ VOS REPASAU.Restau·rant HygiéniqueSANS ALCOOL40, Place du Grand Sablon(à proximité <strong>de</strong>s Musées, <strong>de</strong> la Place Royale, du Parc, <strong>de</strong>sMinistères, <strong>de</strong> l'Avenue Louise, <strong>de</strong> la Maison du Peuple,du Palais <strong>de</strong> Justice. <strong>de</strong> la Granu'Place, elc.)DINER :Un plat vian<strong>de</strong> et légumes, fr. 0.75DINER :Potage. vian<strong>de</strong>. légumes. <strong>de</strong>ssert, 1 franc:DINER :Fr. 1.75, 2 franc:s et à la carte1Café, Thé. Chocolat, PâtisserieVins et Cidre sans alcoolBUFFET FROIDPublicité pour le Restaurant hygiénique (avant 19 14) (AVE . Fonds Nyssens)
132 Trois générations d.efemmes contre l'alcoolAl'EXPOSITION<strong>de</strong>1 9 3 0àA N V E R Svisitez!l 1 fl . A L e 0Restaurant SdDS alcoolA. s. B. L.au cniD <strong>de</strong> ,'Avenue <strong>de</strong> ,'Art flamand et <strong>de</strong> l'Avenue Van Ryswyck·à proximité da - Rond Point . .TéléphonePlus mo<strong>de</strong>stement, lessections locales ouvriront<strong>de</strong>s cafés <strong>de</strong> tempérancedans <strong>de</strong>s quartiers ouvrters :trois à Liège, en 190 149,1903 et 1904, un à Gand.L'idée persiste, même aprèsla guerre, Encore en 1929,l'Union fon<strong>de</strong> le 27 juilletune ASBL chargée <strong>de</strong> gérerle restaurant SINALCO, restaur.anthygiénique ouvertsur le site <strong>de</strong> l'ExpositionInternationale d'Anvers en193050,SINALCO a été créé en 1929 par lemouvement anti-alcoolique belge tout entier.spécialement en vue <strong>de</strong> l'EXPOSITIONINTERNATIONALE <strong>de</strong> 1930.Buffit _lriœin Rtstaldant Du1ltrt toutt la journü rPlats NriIs fi à I#US les goûts Prix 1fIod&is i? Suppmsimtks pourfxJim w On park frlZ1lfals, flamand, anglais, al/munldDIRECTION :BELGO-SUISSELa MaiSOD <strong>de</strong> repos do Y. W. C. A.Ile troave à côté da Restaurant.Publicité pour le restaurant Sinalco (1930) (AVB Fonds Nyssens)49. n est même antérieur au restaurant <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> et semble ravoir inspirê.50. RecueU spécial <strong>de</strong>s actes .. . 1929, 5 septembre, n08 18-820, pp. 511-512 et.AVE, Fonds Nyssens, carton n039.
Sophie Matkava 133Seul le projet <strong>de</strong> créer un hospice pour alcooliques, caressé en 1911et soutenu par <strong>de</strong>s féministes comme Louise van <strong>de</strong>n Plas et MariePopel1n, n'a pas vu le jouiH•Par ailleurs, Joséphine Keelhoff fait preuve d'une fibre sociale évi<strong>de</strong>ntequi se traduit par une implication presque 1 naturelle • dansdiverses associations <strong>de</strong>stinées à améliorer la condition ouvrière. On laretrouve ainsi parmi les membres <strong>de</strong> la Mutualité pour Femmes LaRuche, dès sa création en 190252• Cette organisation <strong>de</strong> prévoyance (etnon <strong>de</strong> bienfaisance, la dlfTérence est révélatrice) est présidée par MmePaul Spaak, qui n'est autre que Marie Janson, fille du lea<strong>de</strong>r politiqueprogressiste Paul Janson, qui sera la première sénatrice cooptée enBelgique en 1921. On y retrouve à ses côtés Marie Parent, EmileVan<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong>, plusieurs membres <strong>de</strong> la famille Janson53•En 1905, elle fait partie <strong>de</strong> la Société coopérative <strong>de</strong>s Associations<strong>de</strong>s Cités-jardins <strong>de</strong> Belgique, dont elle <strong>de</strong>vient commissalre54• Elle yretrouve Henri La Fontaine et le docteur Van Ryn, secrétaire général <strong>de</strong>la Ligue Belge contre la Tuberculose55•Elle semble avoir adhéré au POB : du moins retrouve-t-on une carte<strong>de</strong> membre du parti, à son nom, pour l'année 190956• Cette participationpolitique peut paraître étonnante chez cette fe mme <strong>de</strong> 76 ans,Issue d'une famille cathol1que57• A ce propos, son neveu Raymond van<strong>de</strong>r Gucht note : IOn la disait originale, et certes elle l'ètait si c'est originalité(voire folle) quand on est chrétienne et laïque <strong>de</strong> ne pas relé-51. AVB. Fonds Nyssens, Registre Union <strong>de</strong>s femmes .... P.V. <strong>de</strong>s séances.séance du 26 juin 1911.52. Mutualité pour femmes La Ruche. Rapport généraL <strong>Bruxelles</strong>. 1908. p. 3.53. Ibi<strong>de</strong>m. p. 15-23.54. La Clairière. 9 avril 1905. n058. p. 4.55 Annexes au Moniteur Belge. Recueil spécial <strong>de</strong>s actes . ... n02223. acte du 21avril 1905. <strong>Bruxelles</strong>. 1905. pp. 409-4 10.56. AVB, Fonds Nyssens. carton n08.57. Son milieu familial d'origine était catholique. <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses sœurs sont entréesdans les ordres. Joséphine Nyssens elle-même se prétendait . chrétienne etlaïque . (A VB. carton 17. lettre <strong>de</strong> R. Van <strong>de</strong>r Burght à sa tante AntoniaNyssens-Van Dreveldt. 25 décembre 1942) : la branche Nyssens fixée à<strong>Bruxelles</strong> est. quant à elle, clairement libérale et anticléricale. Nous ne savonsrien <strong>de</strong>s convictions du mart <strong>de</strong> Joséphine Keelhoff-Nyssens.
134 Trois générations <strong>de</strong>Jemmes contre l'alcoolguer dans les cloîtres ces vertus dont on fait un bon marché facile ...Elle était chrétienne 1 • •• ) mals elle l'était à la manière <strong>de</strong> Tolstoï et je nejurerais que, par sympathie pour Louise Michel, elle n'avait été quelquepeu communar<strong>de</strong> • • 58.Notons, dans la même veine, qu'une femmecomme Joséphine Butler, fondatrice du mouvement abolitionnisteinternational, croyante et même mystique, se définissait aussi comme• une chrétienne socialiste avant la lettre .59.Joséphine Keelhoff semble donc faire partie <strong>de</strong> cette bourgeoisieprogressiste <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>, qui • flirte . avec quelques socialistes -comme Henri La Fontaine, Hector Denis, Marie Parent, Marie Popeltnou Emile Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong> - milieu interpelIé par la question sociale et dontsort également le féminisme dit bourgeois.Le contexte <strong>de</strong> l'après guerre : les . héritières .L'immédlat après-guerre change le contexte militant. La loi EmileVan<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong>, votée en 1919 et interdisant la vente d'alcool dans lesdébits <strong>de</strong> boissons freine le mouvement antialcoolique mais ne l'éteintpas. La vigilance reste <strong>de</strong> mise car la loi n'a pas rayé le fléau d'un coup<strong>de</strong> plume ni rendu les alcooliques sobres du jour au len<strong>de</strong>main. Para1l1eurs. <strong>de</strong>s tentatives sont fa ites à diverses reprises pour l'abrogerdans les années trente. notamment par la voix du sénateur catholiqueLéon Legrand 60 • qui propose en 1937 <strong>de</strong> la réviser sous prétexte qu'ellene peut empêcher les débits clan<strong>de</strong>stins et qu'elle pénalise les petitscafetiers par rapport aux cercles prtvéS 61 •L'Union subsiste mals en veilleuse. ElIe continue à participer auxmanifestations antialcooliques organisées dans les années 1920.poursuit sa propagan<strong>de</strong> dans les écoles et auprès <strong>de</strong> la jeunesse, maisla disparttion <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> province (à l'exception <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux). l'arrêt<strong>de</strong>s subventions et la diminution du nombre d'adhérents témoignent58. Biographie .... p. 3.59. A.M. KÂPELU. Sublime Croisa<strong>de</strong>. Ed. Zoé. Genève. p. 4960. Léon Legrand (1869- 1963) docteur en droit et magistrat. sénateur provincial<strong>de</strong> Namur <strong>de</strong> 1929 à 1946.61. Proposition repoussée par 91 volx contre 65 (SOCialistes + démocrateschrétiens) : Egalüé. 1937. n033. p. 12.
Sophie Matkava 135que la gran<strong>de</strong> pérto<strong>de</strong> est passée. L'Union survit grâce à la volonté <strong>de</strong>quelques femmes Oa <strong>de</strong>rnière mention <strong>de</strong> l'Union date <strong>de</strong> 1951). maiscelles-ci tout en restant attentives à la lutte contre l'alcool. se sontinvesties dans d'autres combats.Marguerite Nyssens 1858- 1947Née à Anvers en 1858. où son père. Gustave-Adolphe avait étéconseiller communal libéral. Marguertte resta célibataire et donnel'exemple presque parfait d'une vie consacrée à l'action philanthropique.Co-fondatrtce <strong>de</strong> l'Union. dont elle assure le secrétariat jusqu'en1914. elle réactive la société après la guerre. avec l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> MariaHettema-Nyssens. Mais son engagement dépasse <strong>de</strong> loin l'Union. Elleest aussi une <strong>de</strong>s fondatrtces <strong>de</strong> l'œuvre <strong>de</strong> la Croix-Verte. société <strong>de</strong>placement pour ouvrières créée en 1898 62 • Elle en <strong>de</strong>vient prési<strong>de</strong>nteaprès 1905. La Croix-Verte participe à son tour à la fondation <strong>de</strong>l'Office central <strong>de</strong> Documentation féminine en 1909 63 • Toujours en1898. Marguerite Nyssens crée aussi l'Œuvre du Drap <strong>de</strong> lit. qu'elleprési<strong>de</strong> 64 et qui. distrtbuant draps <strong>de</strong> lit et layette. s'illustre pendant laPremière Guerre mondiale 65 •Marguerite Nyssens adhère également au Lyceum Club dés sa fondationen 1908 66 • En 1914-1918. Marguerite Nyssens travaille dans lesrangs <strong>de</strong> l'Union Patrtotique <strong>de</strong>s Femmes belges 67 •62. La Clairière, n03. 1er févIier 1903. p. 3.63. Mundaneum, Fonds Féminisme, doc. Ill, 2008.64. AVB. Fonds Nyssens. n° 10, Œuvre du drap <strong>de</strong> lit. Rapport <strong>de</strong> 1904. p. 1.65. Papiers privés <strong>de</strong> Mme Dewerpe, • Généalogie <strong>de</strong> la famille ... ", p. 39.L'Œuvre survit à la guerre et participe activement aux 2' et 3' SalonsInternationaux <strong>de</strong> I"Enfance tenus à <strong>Bruxelles</strong> en 1929 et 1930 (AVB , FondsNyssens, cartons 8 et 21).66. J. <strong>de</strong> LEMOINE, Bilan du féminisme mondial. <strong>Bruxelles</strong>, 1914, p. 229. AVB.Fonds Nyssens, Rapport du Lyceum Club. 1925, carton 64.67. J. BRIGODE, Union patriotique <strong>de</strong>s femmes belges. Rapport présenté auComité National, <strong>de</strong> secours et d'Alimentation, 8 août 1914-24 février 1915.<strong>Bruxelles</strong> 1915 et La bierifaisance pendant l'occupation 1914·1918. Notes etUlustrations SUT quelques œuvres bruxelloises. <strong>Bruxelles</strong>, 1919. pp. 3- 16.
136 Trois générations <strong>de</strong>Jemmes contre l'alcoolEn 1925. elle est approchée par Eugénie Hamer pour relancerl'Alliance belge <strong>de</strong>s femmes pour la Paix par l'Education68 mais le projetn'aboutit pas, C'est véritablement à l'Union qu'elle consacre les<strong>de</strong>rnières années <strong>de</strong> sa vie. en tentant <strong>de</strong> maintenir la société enactivité après la guerre <strong>de</strong> 1914-18. et même au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la Secon<strong>de</strong>Guerre Mondiale. jusqu'à son décès. en 1947. à l'âge <strong>de</strong> 89 ans,Antonia Nyssens-VW1 Dreveldt (1861-1949)Enépousant Emile Nyssens. Antonia Van Dreveldt épouseégalement les causes chères à la famille, Son histoire personnelledébute comme un roman : ses parents. originaires <strong>de</strong>s régionsfrontalières <strong>de</strong> Hollan<strong>de</strong> et <strong>de</strong> Prusse avaient fu i l'Europe en raison <strong>de</strong>leurs convictions antimilitaristes pour s'installer aux Etats-Unis. à larecherche d'une terre d'accueil pacifique, La petite Antonia naît àPrairie du Long (USA) en 1861, Mais la Guerre <strong>de</strong> Sécession pousse lafamille au retour, Le père meurt à Saint-Louis. avant <strong>de</strong> s'embarquer.laissant une veuve et trois filles. qui regagnent la Hollan<strong>de</strong>. Installéedans la région <strong>de</strong> Noordwijk. la veuve se remarie avec un négociant entabac <strong>de</strong> Rotterdam. rencontré précé<strong>de</strong>mment aux Etats-Unis. Lecouple eut encore <strong>de</strong>ux enfants. Le 27 octobre 1887. <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>s troisfilles Van Dreveldt. Agathe et Antonia, épousent <strong>de</strong>ux frères Nyssens,Edouard et Emile, venus acheter <strong>de</strong>s tabacs pour la firme familialeanversoise69• Antonia s'installe à <strong>Bruxelles</strong> où Emile dirige. avec sonfrère Charles. une fabrique <strong>de</strong> miroirs, rue <strong>de</strong>s Palais. Le couple aurasept enfants. dont <strong>de</strong>ux meurent en bas âge.Les <strong>de</strong>ux filles, Maria et Johanna reçoivent une éducation soignéeau Cours d'Education pour Jeunes Filles d'Isabelle Gatti <strong>de</strong> Gamond70;les garçons à l'Ecole moyenne <strong>de</strong> l'Etat puis à l'Athénée communal <strong>de</strong>Schaerbeek. tandis que l'aîné. Bernard avait repris la direction <strong>de</strong> lamanufacture <strong>de</strong> glaces au décès du père71, Les <strong>de</strong>ux parents exercent68. AVB Fonds Nyssens, carton 49, Eugénie Hamer à Marguerite Nyssens,15 février 1925.69. Papiers privés Mme Dewerpe, • Généalogie ... " pp. 34-36. .70 Comme en témoignent <strong>de</strong>s cahiers <strong>de</strong> cours et <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> distributions<strong>de</strong> prix (1903- 191 1) conservés dans AVB, Fonds Nyssens, cartons 1 et 371 Papiers privés Mme Dewerpe. Généalogie .... p. 35.
Sophie Matkava 137une influence idéologique fo rte et concomitante. Le père d'Emile,Gérard Nyssens, était franc-maçon. Emile lui-même adhère très tôt auparti libéraln. En 1896, il s'affilie à l'Union libérale ouvrtère. Il afficheun antlclértcalisme très vif. Son épouse, Antonia Van Dreveldt partageses idées et <strong>de</strong>vient d'ailleurs membre <strong>de</strong> l'Union <strong>de</strong>s Femmes libérales<strong>de</strong> l'Arrondissement <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> après la première guerre mondiale73•Sa volonté <strong>de</strong> doter ses filles d'une instruction soli<strong>de</strong> dans unétablissement non confessionnel rencontre donc celle <strong>de</strong> son époux, etdécoule certainement <strong>de</strong> sa propre éducation. Quant à sonanticlértcallsme, il remonterait. selon une tradition familiale orale, à uninci<strong>de</strong>nt survenu en 1902 lors du baptême d'un <strong>de</strong> ses enfants. Auxprtses avec le prêtre sur <strong>de</strong>s questions électorales, Antonia se seraitjuré <strong>de</strong> ne plus remettre les pieds à l'église74•Ses activités philanthropiques s'inscrivent parfaitement dans lespréoccupations <strong>de</strong>s bourgeoises <strong>de</strong> son milieu : la lutte antialcooliquese conjugue avec une activité carttative en faveur <strong>de</strong>s jeunes mères <strong>de</strong>la classe ouvrtère et un souci pacifiste permanent. Elle participe à lafondation <strong>de</strong> la Consultation pour Nourrissons <strong>de</strong> Laeken en 190675,<strong>de</strong>vient vice-prési<strong>de</strong>nte. Elle adhère dès 1902 à l'Union belge <strong>de</strong>sFemmes contre l'Alcoolisme. Elevée par une mère antimilitariste, ellesuit <strong>de</strong> près les activités <strong>de</strong> l'Alliance belge <strong>de</strong>s Femmes pour la PaiXpar l'Education, fondée à Anvers en 1906 par Claire Baüer et Marie72 AVB . Fonds Nyssens. carton 57, Hommage rendu à Emile Nyssens â l'occasion<strong>de</strong> ses funérailles le 10 mai 1919 par le Dr Van <strong>de</strong> Meulebroeck, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>l'Association libérale <strong>de</strong> Laeken.73 AVB Fonds Nyssens. carton 23, diverses lettres <strong>de</strong> l'Association invitant sesmembres aux assemblées plénléres.74 Interview <strong>de</strong> sa petite-fille. Mme Dewerpe. Il mai 1996.75 Représentation <strong>de</strong> gala organisée au profit <strong>de</strong> l'œuvre <strong>de</strong> la Consultation pournourrissoins <strong>de</strong> Laeken au théâtre Royal Flamand le 9 décembre 1909.Programme. Ce programme a été conçu par Emile Nyssens. le carton 10 (AVE.Fonds Nyssens) contenant également ses esquisses. On y trouve. dans un beausyncrétisme, <strong>de</strong>s publicités pour la manufacture <strong>de</strong> glaces Aug. Nyssens, pour leRestaurant hygiénique, pour rUnion <strong>de</strong>s femmes belges contre l'Alcoolisme,pour la Société d'Arbitrage et <strong>de</strong> la paix-section belge, pour la sociétéhollandaise Vre<strong>de</strong> door Recht.
138 Trois générations <strong>de</strong>ferrunes contre l'alcoolAlliance Belge <strong>de</strong>s Femmespour la Paix par l'Education. • . ,1F,,,,datrÏt:es : 14-- CLAIRE BAUËa et MARIE ROSSEELS' ,11:.Prési<strong>de</strong>lll, tl' H o'lIteHr :Prési<strong>de</strong>"t J'fI om,mr : 'PrésitUllle :14- la Baronne <strong>de</strong> LA VELEYE ;Mr le StDateur VAN DE WALLE ;Mlle Marie ROSSEELS ;Stc,ailir.gülérale tI Vice-Prisidmu : Mlle E. HAM ER. 4s, rue Scbul.SIÈGE SOCBL : Cercle Artistique et Littéraire-- ._. . ----'-ANVERS, 30 mai 1912.ML'année 1911 a marqué une étape importante dans notreŒuvre. Dans notre Assemblée générale extraordinaire du21 juillet <strong>de</strong>rnier, il fu t décidé que l'Alliance <strong>de</strong>viendraitautonome sous le titre <strong>de</strong> : A lliance Belge <strong>de</strong>s Fn1U1Zes />ùurla Pai:r par fEdtlCi,UOII. L'Œuvre prenant une très gran<strong>de</strong>extension, le Bureau fut heureux <strong>de</strong> trouver une ai<strong>de</strong> nouvelleet ùévouée en la personne <strong>de</strong> Mlle A. Noest, qui voulutbien accepter le titre ùe Secrétaire-adj ointe, et en assumcrles fo nctions.L'Alliancc continue sa marche ascendante. La Branche(le <strong>Bruxelles</strong> est <strong>de</strong>s plus actives, grace au dévouement (le ladélélIlc Mme Emile Nvssens van Drcvehll. L'année <strong>de</strong>rnii:re,Les premières marques dlntèrèt <strong>de</strong> la famille Nyssens pour le pacifisme datent<strong>de</strong>s années 19 10. quand Antonia Nyssens-Van Dreveldt créa la branche bruxelloise<strong>de</strong> l'Alliance belge <strong>de</strong>s Femmes pour la Paix par l'Education. particulièrementactive à Anvers (AVB. Fonds NyssensJ
Sophie Matkava 139Rosseels 76 • et fon<strong>de</strong> à son tour avec la baronne <strong>de</strong> Laveleye 77 unesection bruxelloise en 1912.Parmi les membres <strong>de</strong> cette section. on retrouve toujours le mêmemilieu sociologique et philosophique : <strong>de</strong>s reprêsentants <strong>de</strong> la familleNyssens. Gabrielle Monod 78 • Lilly Carter. Louise De Craene79• Antoniaparticipe. en tant que déléguée <strong>de</strong> rAlliance. au Congrès Universel pourla Paix. organisé en août 1913 à La Haye par la société Vre<strong>de</strong> doorRecht BO • Elle participe également à la pétition universelle en faveur durèglement sans guerre <strong>de</strong>s conflits contre les états en 1914. adresséeaux gouvernements représentés à la troisième Conférence <strong>de</strong> la Paix <strong>de</strong>La Haye en 191581•Le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> son action <strong>de</strong>meure l'éducation : c'est l"Idée quidomine et se situe dans le droit fil <strong>de</strong>s convictions progressistes. Elleorganise <strong>de</strong>s Fêtes (locales) <strong>de</strong> la Paix. notamment en 1912 avec leconcours <strong>de</strong> rUnlverslté populaire <strong>de</strong> Laeken. Henri La Fontaine et A.Marinus prennent la parole. <strong>de</strong>s pièces musicales sont interprétées parJohanna et Carl Nyssens 82 • Cette propagan<strong>de</strong> pacifiste dans les écolesofficielles débouchera sur la reconnaissance d'un jour <strong>de</strong> célébration <strong>de</strong>la paix. le 18 mai. C'est également en tant que déléguée <strong>de</strong> la section76. Alliance <strong>de</strong>s femmes pour la Paix par l'Education. Rapport <strong>de</strong> 1912. Anvers.1913. Sur cette société : N. LUBELSKI-BERNARD, op. ciL. 413.77. Il s'aglt <strong>de</strong> Florence-Ethel-Warner Wheeler, née en Angleterre le 21 mars1858. Elle épousa le baron Edouard <strong>de</strong> Laveleye (flls d'Emile et frére <strong>de</strong>Marguertte. citée précé<strong>de</strong>mment), né à Gand le 22 octobre 1854 (La noblessebelge. 1911. 2e partie, p. 381).78. Eléve et disciple d'Isabelle Gatti <strong>de</strong> Gamond. directrice <strong>de</strong> l'Ecole Moyenne<strong>de</strong> l'Etat, rue Royale Sainte-Marte à <strong>Bruxelles</strong>.79. Sur louise Van Duuren (1875- 1938). épouse du docteur Ernest De Craene,éléve <strong>de</strong> Gatti <strong>de</strong> Gamond. docteure en philosophie et lettres <strong>de</strong> l'ULB. fondatricedu Groupement belge <strong>de</strong> la Porte Ouverte : voir article à paraître dans SextantnOl0.80. Comme en témoigne sa carte <strong>de</strong> déléguée. en date du 18 août 1913.conservée dans AVB. Fonds Nyssens. carton 58 (1).81. N. LUBELSKI-BERNARD. op. ciL, p. 120.82. <strong>Université</strong> populaire <strong>de</strong> Laeken. Fête <strong>de</strong> la paix organisée avec le gracieuxconcours <strong>de</strong> l'Alliance <strong>de</strong>s femmes pour la Paix par l'Education. Programme. 10février 1912 (AVB. Fonds Nyssens. carton 64). Johanna (1889- 1986) et Carl(1893- 1920) sont, parmi les enfants d'Antonia, les plus . musiciens '. Il n'estpas rare qu'Ils donnent <strong>de</strong>s concerts <strong>de</strong> bienfaisance. Carl était ingénieur.
140 Trois génémtions <strong>de</strong>Jemmes contre l'alcoolbruxelloise <strong>de</strong> l'Alliance belge <strong>de</strong>s Femmes pour la Paix par l'Educationqu'Antonia figure parmi les co-fondateurs <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong>s Sociétés<strong>de</strong> Culture morale <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> 83 , Elle y retrouve. outre la baronne <strong>de</strong>Laveleye, A. Marinus pour la Société belge <strong>de</strong> l'Arbitrage et <strong>de</strong> la Patx •Marie Parent pour l'Alliance <strong>de</strong>s Femmes contre l'abus d'alcool, LaureLevoz-Hauzeur déléguée <strong>de</strong> l'Union <strong>de</strong>s Femmes belges contrel'Alcoolisme 84 , Antonia continue à payer ses cotisations à la Fédérationau moins jusqu'en 192385• Quant à ses aspirations féministes. ellessont attestées par sa participation constante au Conseil National <strong>de</strong>sFemmes belges <strong>de</strong>puis sa création en 1905.Aprés la guerre. si Antonia maintient en vie une Union sur le déclinet la • transmettra 1 à l'une <strong>de</strong> ses filles. Marie Hettema-Nyssens. sonattention se porte presque naturellement vers d'autres associations<strong>de</strong>stinées à enrayer les fléaux sociaux. comme la Ligue belge contre lePéril vénérien ou la Ligue Nationale belge contre le Cancef"6.Mais l'essentiel <strong>de</strong> son engagement se concentre désormais sur lepacifisme et la lutte contre la guerre. Antonia Nyssens aurait participé.comme déléguée du Conseil National <strong>de</strong>s Femmes belges. au Congrèspacifiste <strong>de</strong> La Haye en 192287• Lorsque, la même année. l'Union belgepour la Société <strong>de</strong>s Nations est créée à <strong>Bruxelles</strong>, Antonia Nyssens-VanDreveldt est membre du Comité <strong>de</strong>s Dames. elle y est rejointe par safille Marie Hettema-Nyssens en 1930. A nouveau elle y côtoie Henri LaFontaine. Emile Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong>, Jane Brigo<strong>de</strong>, mais aussi Marguerite Van<strong>de</strong> Wiele, alors prési<strong>de</strong>nte du CNFB, Paul Hymans. Henri RoHn. La83. AVB. Fonds Nyssens. carton 65.84. AVB. Fonds Nyssens. carton 57 (Fédération <strong>de</strong>s Sociétés <strong>de</strong> culture morale.Organisation d'un cours <strong>de</strong> morale libre et gratuit pour la jeunesse. <strong>Bruxelles</strong>.1914).85. Note manuscrite d'Antonia Nyssens. faisant état <strong>de</strong> cotisations payéesjusqu'en 1923 ; • Essai <strong>de</strong> renaissance vers 1925 " IAVB, Fonds Nyssens. carton49).86. AVB , Fonds Nyssens. correspondance adressée à Antonia. lor Juin 1926(carton n° 52) ; 30 novembre 1945 (accusés <strong>de</strong> réception pour les cotisationsversées à la Ligue contre le Cancer <strong>de</strong> 1940 à 1945. carton 10 et Fonds Nyssens.carton 10. lettre <strong>de</strong> la Société nationale <strong>de</strong>s Compositeurs belges. 19 novembre1946).87. E. SOYER, • Historique du féminisme en Belgique " . Sextant. n06. 1996. p,146.
..Sophie Matkava 141famille Nyssens organise <strong>de</strong>s spectacles en faveur <strong>de</strong> l'Union belge pourla SDN : ainsi elle loue personnellement la salle du Théâtre du Parc. oucelle du Théâtre <strong>de</strong>s Galeries où Sacha Guitry vient se produire à soninitiative. Le militantisme était vraiment familial : Antonia mettait toutle mon<strong>de</strong> à contribution : autour <strong>de</strong> la table. enfants et petits-enfantsmettaient sous enveloppe les cartes <strong>de</strong> participation dont la vente sefaisait par correspondance 88 1Antonia organisait également chez elle. au 319 <strong>de</strong> la Rue <strong>de</strong>s Palais.<strong>de</strong>s conférences à propos <strong>de</strong> la SDN : Henri La Fontaine. A. Marinus etHenri Rolin venaient expliquer <strong>de</strong>vant un public féminin lefonctionnement et l'intérêt <strong>de</strong> cette société 89 • Parmi les habituées <strong>de</strong> cescauseries. Lllly Carter. qui semble être <strong>de</strong>venue três proche <strong>de</strong> lafamille 90 •De même. Antonia adhêre à la section belge <strong>de</strong> la LigueInternationale <strong>de</strong> la Paix et <strong>de</strong> la Liberté dirigée par son amie Léonie LaFontaine 91 • En 1937. elle <strong>de</strong>vient membre <strong>de</strong> l'Union Mondiale <strong>de</strong> laFemme pour la Concor<strong>de</strong> Internationale ainsi que <strong>de</strong> la section belgedu Comité mondial <strong>de</strong>s Femmes contre la Guerre. toujours aux côtés<strong>de</strong> Léonie La Fontaine mais aussi d'Isabelle Blume 92 • Sa fo i pacifiste.Antonia semble surtout ravoir transmise à <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses cinq enfants.Maria et Louis. Ce <strong>de</strong>rnier. encore étudiant à r<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong><strong>Bruxelles</strong>. avait participé à la création en 1924 du GroupementUniversitaire <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> pour la Société <strong>de</strong>s Nations. il fu t secrétaire.Egalement secrétaire du Ile Congrês <strong>de</strong> la Fêdêration Universitaire88. Entretien avec Madame Dewerpe, 11 mai 1996.89. Comme en témoignent les cartes d'invitations retrouvées dans le FondsNyssens. carton n049.90. comme en témoigne une correspondance avec Antonia. en 1925- 1926 (AVE.Fonds Nyssens carton 49).91. AVE. Fonds Nyssens. carton 49, diverses correspondances et cartonsd'Invltation datés <strong>de</strong> 1926. 1931, 1933.92. AVE, Fonds Nyssens, carton 64. correspondances datées <strong>de</strong>s 5 juillet 1937et du 30 mai 1939.
142 Trois générations <strong>de</strong>femmes contre l'alcoolInternationale pour la SDN en 1925. il est nommé prési<strong>de</strong>nt du groupebruxellois la même année93•Pour Antonia. ces engagements divers se conjuguent avec uneactivité professionnelle et ne résultent donc pas du désœuvrementd'une bourgeoise inoccupée. Son mari. Emile succombe à la grippe lagrippe espagnole à l'àge <strong>de</strong> 63 ans94; Antonia Nyssens-Van Dreveldt.énergique veuve <strong>de</strong> 58 ans. ne laisse pas les rênes <strong>de</strong> l'entreprise à sonfils aîné. Bernard. âgé <strong>de</strong> 27 ans. mais dirige avec lui la manufacture<strong>de</strong> glaces. Elle sera nommé prési<strong>de</strong>nte du Conseil d'Administration <strong>de</strong>s• Etablissements Aug. Nyssens et Cie. S.A . en 193595• Elle décê<strong>de</strong> en1949.Carte publicitaire <strong>de</strong> la finne Nyssens datant <strong>de</strong> l'entre-<strong>de</strong>ux-guerres(AVB. Fonds Nyssens)93. Voir AVB. Fonds Nyssens. carton 37 (1). Groupement Universitaire <strong>de</strong><strong>Bruxelles</strong> pour la Société <strong>de</strong>s Nations. Statuts. <strong>Bruxelles</strong>. 1924. et Ile Congrès <strong>de</strong>laJédération Universitaire Internationale pour la SDN. Rapport, Genève. 1925.)94. Interview <strong>de</strong> Mme Dewerpe. Il mal 1996.95. Interview <strong>de</strong> Mme Dewerpe. Il mal 1996 et Annexes au Moniteur belge.Recueil <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong>s sociétés commerciales ... . acte n0 1303. n0 1304 et n01305du 1« février 1935. pp. 1136-1141.
1Sophie Matkaoo. 143Une relève assurée : Maria Hettema-Nyssens (1888- 1982)Marta est l'aînée <strong>de</strong>s enfants d'Emile et d'Antonia, Elle est née en1888, Après avoir suivi les Cours d'Education pour Jeunes F1l1es <strong>de</strong>Gatti, elle termine la section moyenne en 1904 et obtient un diplôme <strong>de</strong>régente en langues mo<strong>de</strong>rnes en 190996,L'année suivante, elle épouse Georges van Albada <strong>de</strong> HaanHettema97• Il est le fils d'Henrt Hettema, qui représentait la fabrtque <strong>de</strong>conserves <strong>de</strong> légumes Marte Thumas96 et <strong>de</strong> Virginie Charles, ancienneprofesseure <strong>de</strong> maintien au Cours d'Education d'Isabelle Gatti, venuedonner <strong>de</strong>s cours privès <strong>de</strong> gymnastique aux enfants Nyssens. Al'instar <strong>de</strong> son père, Georges Hettema, après <strong>de</strong>s ètu<strong>de</strong>s à l'Ecole <strong>de</strong>sCa<strong>de</strong>ts, s'était engagè dans la conserverie <strong>de</strong> légumes, mais pour unefinne concurrente : • La Corbeille " <strong>de</strong> Wespelaer.Le couple eut <strong>de</strong>ux enfants, Henri, nè en 1912 et Johanna, née en1913. Marta n'enseigna jamais mais prtt le relais <strong>de</strong> son mart à laconserverte • La Corbeille ", par procuration d'abord en 191999, à titrepersonnel à partir <strong>de</strong> 1926, après avoir divorcé en 1925. En 1931 ellequitte la conserverie pour les • Etablissements Aug. Nyssens et Cie ", OÙelle travaille jusqu'en 1952, année où elle est nomméeadministrateurlCXl• Elle est retraitée en 1957 10 1 •Très tôt, dès 19 10, Marta suit les traces <strong>de</strong> sa mére en Intégrant lecomité <strong>de</strong> l'Union <strong>de</strong>s Femmes contre l'AlcoolismeI02• Avec MargueriteNyssens et Laure Levoz-Hauzeur, elle participe à la reprise en 1919103•Elle occupe successivement les fonctions <strong>de</strong> trésorière 0919-1922).96. AVB, Fonds Nyssens, carton 3 (Programme <strong>de</strong> distribution <strong>de</strong>s Prix etconseIVation <strong>de</strong>s diplômes)97 AVB, Fonds Nyssens, carton 45, Contrat <strong>de</strong> mariage passé à l'étu<strong>de</strong> du notaireH. Groensteen le Il juin 1910.98 AVB, Fonds Nyssens, carton 45, contrat passé le 1er janvier 1909 entreEdmond Thumas et Henri van Albada <strong>de</strong> Haan Hettema.99 Mobilisé en 1914, Georges ne revint qu'en 1919.100. AVB, Fonds Nyssens, carton 45.101. AVB. Fonds Nyssens, carton 20 (Far<strong>de</strong> Impôts et contributions 1928- 1958).102. AVB, Fonds Nyssens, Union <strong>de</strong>s Femmes ... PV <strong>de</strong>s séances, 19. 12. 1919.103. I<strong>de</strong>m. 21.05. 19 19.
144Trois générations <strong>de</strong>Jemmes contre l'alcoolpuis <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nte à partir <strong>de</strong> 1923, En dépit <strong>de</strong> la diversité <strong>de</strong> ses engagements,elle reste fidèle à la lutte antialcoolique, <strong>de</strong>vient membre en1932 du Comité National contre l'Alcoolisme, l'Union ayant d'ailleursprésidé à la naissance du Comité National 104 , Elle en <strong>de</strong>vient trésortèreen 1946, poste qu'elle occupe Jusqu'en 1971105, Le nombre impressionnant<strong>de</strong> brochures et d'articles conservés dans le Fonds Nyssensconcernant l'antialcoolisme - <strong>de</strong> l'entre-<strong>de</strong>ux-guerres au début <strong>de</strong>sannées 1980 - prouve l'intérêt soutenu <strong>de</strong> Marta Hettema dans cedomaine, Elle sera également membre du Conseil d'Administration duCentre Prtmavera, centre <strong>de</strong> désintoxication créé en 1961 sous les auspicesdu Comité National contre l'Alcoolisme, Elle assiste encore auxréunions du Conseil d'administration Jusqu'en décembre 1981106,Comme sa mère, elle est préoccupée d'éducation <strong>de</strong>s filles etd'émancipation féminine, Elle siêge au Conseil national <strong>de</strong>s Femmesbelges ; prési<strong>de</strong> les Anciennes Elèves <strong>de</strong> Gatti dès 1925, la PostScolaire Gatti en 1937, Sous sa prési<strong>de</strong>nce sont organisée les fêtes du75< anniversaire <strong>de</strong>s Cours d'Education pour Jeunes Fllles en 1939, En1964, lors du centenaire <strong>de</strong> l'Institution, Marta Hettema, viceprési<strong>de</strong>ntedu comité organisateur <strong>de</strong> la journée, est faite membre duComité d'honneur <strong>de</strong> la manifestation, aux côtés <strong>de</strong> John Bartier, professeurd'histoire à l'ULB, <strong>de</strong> Henri Rolin et <strong>de</strong> Georgette Ciseleeo7 ,Maria Hettema s'engage aussi dans la défense du travail <strong>de</strong>s femmes: la première mention <strong>de</strong> son adhésion au groupement belge <strong>de</strong> laPorte Ouverte date <strong>de</strong> 1937, Elle participe activement : elle est déléguéesuppléante au Congrès <strong>de</strong> l'Open Door International <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> en1948, représente l'association auprès du CNFB <strong>de</strong> 1952 à 1959, En1963, elle prend part au 12< Congrès <strong>de</strong> l'Open Door International,cette fo is en tant que déléguée <strong>de</strong> la Post-Scolaire Gatti, et se montre104, AVB, Fonds Nyssens, PV <strong>de</strong>s séances du Comité National contre l'Alcoolisme.9 février, 8 mars. 18 novembre et 29 décembre 1932,105, AVB . Fonds Nyssens. carton 6, dossiers Factures et comptabilité du ComitéNational contre l'Alcoolisme 1954- 1971 et carton 39. I<strong>de</strong>m, 1956- 1958,106, AVB, Fonds Nyssens. carton 5.107. 1864·1964. Man ifestation Isabelle Gatti <strong>de</strong> Gamond. Centenaire du Coursd'Education A actuellement Lycée RayaI Gatti <strong>de</strong> Gamond.. Programme, <strong>Bruxelles</strong>.3 octobre 1964.
Sophie Matkava 145particulièrement attentive à l'accès <strong>de</strong>s filles à l'enseignement. général.technique et professionnel. conçu comme un outil d'émancipation sociale,Maria Hettema semble avoir adhéré au parti libéral au début <strong>de</strong>sannées 1920, en même temps que sa mère, A partir <strong>de</strong> 1948, elle estmembre du Groupement Social féminin libéral Solidarité, Elle resteramembre du parti et <strong>de</strong> ses associations féminines jusqu'à la fin <strong>de</strong> savie,Toujours à l'exemple <strong>de</strong> sa mère, elle avait rejoint le Comité <strong>de</strong>sDames <strong>de</strong> l'Union belge pour la Société <strong>de</strong>s Nations, Elle assure lesecrétariat du comité organisateur en 1930, mais bien qu'elle restemembre jusqu'à la Secon<strong>de</strong> Guerre Mondiale, elle ne semble plus trèsactive, Elle adhère <strong>de</strong> 1936 à 1939 au Comité Mondial <strong>de</strong>s femmescontre la Guerre et le Fascisme, fait partie du Comité d'Honneur en1938 aux côtés d'Isabelle Blume, <strong>de</strong> Léonie La Fontaine et <strong>de</strong> JeanneEmile Van<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong>. Après la Secon<strong>de</strong> Guerre, elle adhère à l'Associationbelge pour la Coopération <strong>de</strong>s Nations Unies en 1948.Elle s'éteint en 1982, à l'âge <strong>de</strong> 94 ans, après avoir poursuivi sesactivités jusqu'à la fin et conservé un engagement intact.ConclusionsL'Union <strong>de</strong>s femmes belges contre l'Alcoolisme, née au tournant dusiècle dans un contexte social <strong>de</strong> crise, s'inscrit pleinement dans lacroisa<strong>de</strong> <strong>de</strong> remoralisation censée enrayer les dèsordres sociaux. C'estdans une perspective d'action publique, - et pas seulement caritative -que ces femmes se sont engagées.Emanation d'un milieu libéral et bourgeois, intellectuel et souventlibre-exaministe, l'Union prône le progrès moral par l'éducation <strong>de</strong>sclasses laborieuses, mais aussi par l'émancipation <strong>de</strong> la femme dont lerôle mfme reste déterminant. La position socio-géographique <strong>de</strong> l'Union,ses relations lui permettent <strong>de</strong> s'implanter et l'intérét diversifié <strong>de</strong> sesmembres créent <strong>de</strong>s liens avec d'autres associations philanthropiques,voire féministe et pacifiste.
146 Trois générations <strong>de</strong>femmes contre l'alcoolLa première guerre marque un temps d'arrêt, puis une rupture,Rupture <strong>de</strong> génération d'abord : les fondatrices, Anne-Marie Guillaumotet surtout Joséphine KeelhotT, ont disparu. Rupture aussi <strong>de</strong> contexte : lalutte antialcoolique semble perdre sa raison d'être avec le vote <strong>de</strong> la loiVan<strong>de</strong>rvel<strong>de</strong> (1919). Le discours moralisateur sur les classes ouvrières afa it place aux premières mesures <strong>de</strong> législation sociale. Tout en restantvigilantes, les dirigeantes <strong>de</strong> l'Union déploient désormais leurs effortsdans d'autres directions, principalement le féminisme et le pacifisme.Mais au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ces activités. que peut-on retirer <strong>de</strong> ce rapi<strong>de</strong> aperçupour l'histoire <strong>de</strong>s femmes ? Tout d'abord que <strong>de</strong>s femmes instruites,désireuses <strong>de</strong> s'investir dans un mouvement <strong>de</strong> réforme sociale. ont été àmême <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r et <strong>de</strong> gérer une association. y compris dans sesramifications internationales. Celle-ci montre clairement que <strong>de</strong>sbourgeoises ont répondu à l'incitation forte qui leur est fa ite à la fin dusiècle pour combattre les périls sociaux, qu'ils soient physiques etmoraux (péril vénérien, alcoolisme. prostitution) ou politiques (guerres) .SI elles ont trouvé auprés <strong>de</strong>s hommes <strong>de</strong> leur classe sociale les appuisnécessaires et indispensables, elles n'en ont pas moins été les chevillesouvrières du mouvement.Cette étu<strong>de</strong> soulève pourtant un problème d'ordre méthodologique.Elle repose entièrement sur l'usage d'un seul fonds. celui constitué par lafa mille elle-même . On pourrait à Juste titre se méfier d'une source à cepoint . endogène J. Mais ce fo nds est loin <strong>de</strong> ne réunir que <strong>de</strong>s papiersprivés. Il est. en substance, le lieu <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong> nombreux tracts,dépliants. cartes d'invitation, coupures <strong>de</strong> presse, cartes d'adhésions,brochures, PV <strong>de</strong> réunion ... etc. soit une multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> documents.extérieurs à la famille mais conservés par elle, et qui attestent l'activité etl'intérêt <strong>de</strong> ses membres.Ces femmes ont adhéré à un nombre étonnant d'œuvres, illustrantainsi ce que l'on sait par ailleurs mals qu'il est toujours si difficile <strong>de</strong>démontrer : le rôle <strong>de</strong>s bourgeoises dans la sphère du travail social et letemps réellement investi. Beaucoup d'entre elles sont restées <strong>de</strong>s• bénévoles <strong>de</strong> l'ombre J, comme les dames Nyssens, présentes presquepartout et pourtant si largement méconnues.
Sophie Matkava 147Ce fonds permet aussi d'assister à une véritable généalogie <strong>de</strong>l'engagement. On voit ainsi se transmettre le flambeau au sein d'unemême famille. et on assiste. presque en direct. à la reproduction sur plusieursgénérations <strong>de</strong>s valeurs bourgeoises qui leur sont chères, C'estprincipalement par l'exemple. par l'éducation et la vigueur <strong>de</strong> leursconvictions que ces femmes ont transmis leur militantisme.Le combat contre l'alcool. Jugè nuisible pour les classes laborieuses -dans le sillage <strong>de</strong> l'idée morale chère au libéralisme progressiste - puis lafo i féministe et pacifiste qui s'impose dans l'entre-<strong>de</strong>ux-guerres. se sontainsi perpétués Jusqu'au début <strong>de</strong>s années 1980, Si ces bourgeoisesfu rent. dans toute l'acceptation du terme. <strong>de</strong> véritables dames d'œuvres.elles n'en ont pas moins utilisé la philanthropie comme un tremplin versune activité publique. Ce faisant. elles contribuèrent à désenclaver lesactivités féminines du cercle étroit <strong>de</strong> la charité pour leur donner. surtoutavec le pacifisme. une dimension publique indéniable.
-DÉ BAT
Sandrine Dauphin 151Femmes au pouvoirLes partis politiques et leurs militantesSandrine DauphinAvec près <strong>de</strong> 10% <strong>de</strong> députées, la France occupe l'avant <strong>de</strong>rnierrang en Europe en ce qui concerne le nombre <strong>de</strong> femmes àl'Assemblée Nationale. Le Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, aaffiché sa volonté <strong>de</strong> permettre une meilleure participation <strong>de</strong>sfemmes à la prise <strong>de</strong> décision politique, répondant ainsi aux attentes<strong>de</strong>s associations pour la parité. Dans ce but, le 15 décembre <strong>de</strong>rnier,l'Assemblée Nationale a adopté la modification <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> laconstitution en lui ajoutant un alinéa : « La loi détermine les conditionsdans lesquelles est organisé l'égal accès <strong>de</strong>s femmes et <strong>de</strong>shommes aux mandats et aux fonctions •.L'idée parttaire, relayée par <strong>de</strong>s associations féminines, a pour butnon seulement <strong>de</strong> dénoncer une situation existante d'inégalité entrehommes et femmes mais également <strong>de</strong> favoriser et d'encourager lesfemmes à participer à la vie publique.Il est d'autant plus important <strong>de</strong> s'intéresser aux militantes que lesopposants ou les sceptiques à la parité arguent qu'il est bien difficile
152 Femmes au pouvoir<strong>de</strong> trouver dans les partis <strong>de</strong>s femmes capables <strong>de</strong> remplir les exigences<strong>de</strong>s hautes fonctions <strong>de</strong> l'Etat. Or cet apprentissage n'est-il pas durôle même <strong>de</strong>s partis? Nous mesurons ainsi la capacitê <strong>de</strong> ces<strong>de</strong>rniers à permettre aux militantes <strong>de</strong> participer à la prise <strong>de</strong> décision.Aussi avons-nous souhaité nous plonger au cœur <strong>de</strong>s partis afind'étudier la place allouée à leurs militantes.Les partis sont relativement discrets sur leurs fichiers d'adhérentset encore plus <strong>de</strong> militants. Nous sommes contrainte <strong>de</strong> baser notreanalyse sur <strong>de</strong>s évaluations. La moyenne. tous partis confondus.serait <strong>de</strong> 30% d'adhérentes (sauf au RPR, qui compte plus <strong>de</strong> 40%d·adhérentes). Il est bien plus difficile <strong>de</strong> chiffrer le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> militantisme: autour <strong>de</strong> 20% toutes tendances confondues. Un chiffre plutôtfaible qui se répercute en terme <strong>de</strong> pourcentage <strong>de</strong> femmes aux postes<strong>de</strong> direction.Rassemblement pour la républiqueSecrétaires nationaux27.5%Délégués nationaux à l'organisation28.5%Parti socialisteResponsables nationaux25.00AlMembres du bureau national30.9%C'est seulement du côté <strong>de</strong> l'extréme gauche, chez les Verts et àLutte Ouvrière, que nous trouvons <strong>de</strong>s fe mmes à la tête <strong>de</strong>s partisl•respectivement Dominique Voynet et Arlette Laguillier. Devons-nousen conclure pour autant que les fe mmes sont moins aptes à <strong>de</strong>venir<strong>de</strong>s lea<strong>de</strong>rs ? Les fe mmes sont-elles moins militantes que les hommes1. Dans les années 70. les mouvements <strong>de</strong> fe mmes étalent déjà proches <strong>de</strong>l'extréme gauche. Le Mouvement <strong>de</strong> Libération <strong>de</strong>s femmes (MLF) est Issu <strong>de</strong>mai 1968 dont Il adopte les métho<strong>de</strong>s et l'esprtt : dlstrtbution <strong>de</strong> tracts sur lesmarchés. manifestations. opérations commandos . ... etc. Le refus affiché d'étre• récupéré . et <strong>de</strong> participer au pouvoir politique a également cantonné lemouvement <strong>de</strong>s fe mmes à l'opposition systématique (stratégie <strong>de</strong> l'extrémegauche) . Ce <strong>de</strong>rnier appelait à une révolution culturelle et sexuelle <strong>de</strong>vantentraîner une révolution politique.
Sandrtne Daupmn 153ou se heurtent-elles au fonctionnement même <strong>de</strong>s partis politiquesfrançais? n conviendra avant <strong>de</strong> répondre à cette <strong>de</strong>rnière question <strong>de</strong>dégager ce qui différencie les militantes <strong>de</strong>s militants mais égalementles militantes entre elles.Qu'est-ce qu'un mUltant ?Qu'est-ce qu'un militant <strong>de</strong> parti politique? Comment le distinguerd'un simple adhérent? Le militantisme est un terme d'origine guerrière.Il vient du latin mUitare qui signifie être soldat. Au XV" siècle, onparlait d'Eglise militante mais le substantif apparaît à la Révolutionfrançaise dans le sens . d'agir pour une cause . et il s'impose surtoutaprès la Commune. Il est largement lié, au xxe siècle, au marxismeléninisme2,Selon la conception léniniste, le militant est un gui<strong>de</strong> etun modèle. Il doit exercer une influence,faire <strong>de</strong> la propagan<strong>de</strong> etargumenter pour persua<strong>de</strong>r. Il doit être apte à prendre <strong>de</strong>s fonctions<strong>de</strong> direction. C'est donc un lea<strong>de</strong>r en puissance.Plus largement, le m1l1tant est celui qui combat, qui lutte, quidéfend une cause. Il agit pour faire triompher ses idées, ses opinionsmais il n'a pas forcément <strong>de</strong> responsabilités <strong>de</strong> direction. Il se trouve àla frontière entre l'amateur (il s'initie à la politique) et le professionnel<strong>de</strong> la politique. Néanmoins le militant est celui qui peut détenir lepouvoir car le but affiché <strong>de</strong> tout parti politique est <strong>de</strong> gagner <strong>de</strong>sélections. 11 prétend détenir un vivier <strong>de</strong> personnes capablesd'assumer le gouvernement du pays.Une sélection s'effectue, parmi les militants, afin <strong>de</strong> distinguerceux qui remplissent les conditions pour <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s dirigeants. Aussile m1l1tant a certes le goût <strong>de</strong> défendre une cause collective, <strong>de</strong> ladévotion mais également une aptitu<strong>de</strong> au pouvoir. Si le militant nedétient pas l'autorité et n'est qu'un simple exécutant, 11 doit toutefoispossé<strong>de</strong>r cette capacité à détenir l'autorité. 11 se verra récompensé par<strong>de</strong>s mandats électoraux, la récompense suprême étant <strong>de</strong> représenterson parti et d'en être le dirigeant.2. Souligné par Henri REY et Françoise SUBILIEAU, Les Militants socialistes àl'épreuve du pouvoir, Presses <strong>de</strong> la Fondation Nationale <strong>de</strong> Sciences politiques,Paris, 1991.
154 Femmes au pouvoirDu militantisme au fé mininQuelle est la motivation d'une femme qui adhère à un parti politique,puis qui s'Investit dans l'acte mtlitant? La fe mme qui <strong>de</strong>vientmtlitante d'un parti politique affirme un engagement politique, ellemarque sa volonté <strong>de</strong> sortir <strong>de</strong> la sphère privée et <strong>de</strong> participer à lasphère publique, c'est-à-dire à la gestion <strong>de</strong> la société. Plusieursfacteurs conditionnent cet engagement :- le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> socialisation : les fe mmes travaillent. Elles constituent enFrance une part <strong>de</strong> plus en plus Importante <strong>de</strong> la population active(80% <strong>de</strong>s fe mmes en àge <strong>de</strong> travailler sont actives). A partir dumoment où elles obtiennent un rôle dans le fonctionnement <strong>de</strong> la société.elles se sentent davantage concernées par les affaires publiques.De nombreuses étu<strong>de</strong>s ont mis en relief la corrélation existante entrele travail <strong>de</strong>s femmes et l'engagement militant;3.- le niveau d·étu<strong>de</strong>s. Sur ce point également la chercheuse JanineMossuz-Lavau a su montrer la corrélation entre le niveau d'étu<strong>de</strong>s etrengagement politique. Pour plus <strong>de</strong> la moitié d'entre elles, les milttantessont diplômées <strong>de</strong> renseignement supérieur.- le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> syndicalisation : à gauche, les fe mmes sont souventvenues à la politique à partir <strong>de</strong> l'adhésion à un syndicat (particulièrementCFDT).- l'implication dans la vie sociale : les fe mmes font souvent partie <strong>de</strong>toutes sortes d'associations. Elles sont plus facilement sensibiliséesau bénévolat que les hommes. L'inscription à un parti politique peutêtre la suite logique d'une action associative (SOS Racisme, associationsparitaires, association <strong>de</strong> lutte contre l'exclusion, associations <strong>de</strong>parents d·élèves. associations religieuses, associations <strong>de</strong> femmes ....etc.). De leur côté. les hommes adhérent à un parti politique plutôtpar l'Intermédiaire <strong>de</strong>s clubs <strong>de</strong> loisirs : chasse, golf. ..- l'influence fa mtllale. Ce critère Joue plutôt dans les motivations <strong>de</strong>sfe mmes <strong>de</strong>s partis <strong>de</strong> droite où la cohésion <strong>de</strong> la cellule familtale est3. Janine MOSSUZ-LAVEAU et Mariette SINEAU. Enquête sur les Je mmes et lapolüique en France. PUF. Paris. 1983.
Sandrine Dauphin 155importante. L'influence <strong>de</strong> la famille a Joué pour certaines dirigeantes<strong>de</strong> droite et <strong>de</strong> gauche : le père d'Anne-Marie Idrac, <strong>de</strong> RoselyneBachelot. <strong>de</strong> Françoise <strong>de</strong> Panafieu. <strong>de</strong> Martine Aubry. Mais <strong>de</strong>schercheurs ont montré que l'orientation idéologique <strong>de</strong> la mère Joueun rôle aussi important que celle du père4• Il semble certes révolu letemps où la fe mme qui s'engageait en politique suivait le père ou lemari. La politique n'est plus une affaire <strong>de</strong> famille (hormis au FrontNational).Les fe mmes ont peu participé à la vie politique Jusqu'aux années90 car au plus fort <strong>de</strong> l'explosion féministe. dans les années 70, lesfe mmes se sont faites les agents <strong>de</strong> leur propre exclusion. La volonté<strong>de</strong> • politiser le privé - n'impliquait pas celle <strong>de</strong> s' investir dans le public.Or les fé ministes se sentaient heurtées par la nature même dupouvoir. Celui-ci était synonyme d'autoritarisme et <strong>de</strong> patriarcat.Comme il était lié à la masculinité, elles le refusaient. Dans les années70. le débat oscillait entre <strong>de</strong>ux tendances : nier le discours dominantou bien en créer un autre. Il fallait soit s'i<strong>de</strong>ntifier au pouvoir. soit leprendre.Militer dans un parti politique serait incompatible avec le militantismeféministe? Théoriquement oui, du moins pour les fé ministesradicales car être militante d'un parti politique, c'est accepter lesrègles d'un Jeu <strong>de</strong> pouvoir énoncées par <strong>de</strong>s hommes. La pensée <strong>de</strong>Simone <strong>de</strong> Beauvoir a largement œuvré en ce sens. Les fe mmes<strong>de</strong>vaient former un groupe politique avec pour adversaire l'homme ausens social du terme.Néanmoins le combat <strong>de</strong>s femmes est un combat politique. aussi,dans les années 70, il fallait se refuser à utiliser les armes traditionnelles:• C'est précisément parce qu'elles ne (sont) enfermées dansaucun parU. parce qu'aucune idéologie ne les aveugle, qu'elles (peuvent)apprécier la valeur subversive <strong>de</strong> rengagement fé ministeS -.4. Pierre BRECHON, Jacques DERVILLE, Patrick LECOMTE, Les Cadres duRPR. Ed Economlca, coll. Vie politique, Paris, 1987.5. Jacques ZEPHIR, Le Néo-jéminisme <strong>de</strong> Simone <strong>de</strong> Beauvoir. E dDenoêl/Gonthler, Paris, 1982, p. 115.
156 Femmes aupouooirLe revirement <strong>de</strong>s années 90 est concomitant à :- l'évolution <strong>de</strong> la revendication féministe. Il n'est plus <strong>de</strong> bon ton <strong>de</strong>se proclamer . fé ministe '. Dans les années 70 le combat consistait à<strong>de</strong> se réapproprier son corps et son i<strong>de</strong>ntité. Les grands combats ontété menés et leurs résultats acquis (avortement. repénalisation duvioL .). Actuellement le nouveau combat. délaissé dans les annéesultérieures. est <strong>de</strong> participer à la gestion <strong>de</strong> la société. Les associationspour la parité se montrent soucieuses <strong>de</strong> ne pas ranimer laguerre <strong>de</strong>s sexes et développent la notion <strong>de</strong> pouvoir partagé. Pourtantce sont les féministes d'hier qui sont les . paritaires . d·auJourd'huis.- la construction européenne a permis <strong>de</strong> relever les différences quantà la participation <strong>de</strong>s femmes à la vie publique selon les Etats. LaDéclaration d'Athènes du 3 novembre 1992. réunissant <strong>de</strong>s femmes<strong>de</strong> tous les Etats membres. dénonce le déficit démocratique et encourageles Etats à promouvoir la parité.- <strong>de</strong>puis 1992. <strong>de</strong> nombreuses associations pour la parité sont apparuesen France. Elles regroupent <strong>de</strong>s fe mmes ayant <strong>de</strong>s responsabilitéspolitiques et plus généralement <strong>de</strong>s militantes • déçues '. Cesassociations agissent en lobbying et assurent une pression <strong>de</strong>puis labase <strong>de</strong>s partis politiques.Une manière différente <strong>de</strong> militer ?Les femmes m1l1tent-elles différemment ? Certes elles ne collentpas <strong>de</strong>s affiches mais elles distribuent <strong>de</strong>s tracts. Elles participent auxdifférents groupes <strong>de</strong> réflexion mais elles prennent. semble-t-ll. plusdifficilement la parole. tant et si bien que dans certains partis (lesVerts) <strong>de</strong>s stages sont organisés pour leur apprendre à s'exprimer enpublic (ces stages ont existé au parti SOCialiste). Globalement. lesfe mmes sont moins stratégiques que les hommes. c'est-à-dire qu'ellesse mettent moins en avant afin <strong>de</strong> se proposer pour obtenir <strong>de</strong>s postes<strong>de</strong> dirigeants.6. Yvette Roudy, Françoise Gaspard, Gisèle Halimi, Antoinette Fouque ... toutesont eu ou ont encore <strong>de</strong>s mandats électoraux.
Sandrine Dauphin 157L'exemple est illustré par une anecdote racontée par EdithCresson. Au Congrès <strong>de</strong> Pau en 1975, François Mitterrand lui propose<strong>de</strong> prendre davantage <strong>de</strong> responsabilités : • J'al pensé que vouspourriez vous occuper du secrétartat -. Je répondis : • Oui, bien sûr. -J'avais compris qu'U s'agissait <strong>de</strong> tenir le secrétariat <strong>de</strong> cette premièreséance du comité dlrecteur7• - En fait. il lui donna le secrétariat nationalà la Jeunesse,De chaque côté <strong>de</strong> l'échiquier politique, les fe mmes ont le sentimentqu'elles abor<strong>de</strong>nt les problèmes d'une manière différenteS,S'intéresser au militantisme <strong>de</strong>s femmes, c'est s'Intéresser auxrapports qu'elles entretiennent avec le pouvoir,Les fe mmes ten<strong>de</strong>nt à l'action pour Simone Veil, ancienne ministre<strong>de</strong> la Santé : • Mais ce que je crois, c'est que les fe mmes font généralement<strong>de</strong> la politique d'une fa çon différente ( .. ,) leur façon d'être à lafois plus directe et plus abrupte,Comment l'expliquer ? D'abord, parce que les difficultés auxquellesse heurtent les femmes pour arriver sélectionnent les plus battantes,les plus acharnées, Ce n'est pas la seule raison, Il y aurait le fa it queles fe mmes, peu nombreuses, souvent contestées, se tiennent sur ladéfensive, ce qui les conduit à adopter un comportement qui paraîtentaché d'agressivité et d'autoritarisme, Enfin, la plupart <strong>de</strong>s fe mmespolitiques qui assurent en même temps leur rôle d'épouse et <strong>de</strong> mère<strong>de</strong> famille, sont confrontées aux problèmes <strong>de</strong> la vie quotidienne,• Elles ont ainsi une vue plus concrète <strong>de</strong>s choses, recherchant <strong>de</strong>srésultats préCIS ( ... ) Pour les fe mmes, le pouvoir c'est l'action9 -.Certaines caractéristiques différencient effectivement la militantedu militant :- les fe mmes sont moins ancrées dans l'idéologie, Leur goût duconcret rompt avec les théorisations masculines, Le débat sur la7, Edith CRESSON, Avec le soleil, Ed J.-C Lattès, 1976.8, Ce qui n'empèchent pas certaines <strong>de</strong> penser que les fe mmes ne fo nt pas <strong>de</strong>la politique autrement que les hommes : Anne-Marie Cou<strong>de</strong>rc, VèroniqueNeiertz. Elisabeth Hubert ...9. Le Débat. n040. sept. 1986 : Entretien avec Alain MINC, La France vued'Europe, p, 17.
158 Femmes au pouvoirparité permet, par exemple, <strong>de</strong> dépasser le clivage gauche / droitetradi tionnellO•- elles évoquent plus facilement les problèmes quotidiens : banlieues,RMI, insécurité .... etc. Les femmes appréhen<strong>de</strong>nt les décisions et lesproblèmes <strong>de</strong> manière moins technique et plus sociale. Les militantesn'aiment pas le langage administratif.- elles ont un discours qui évite les slogans, qui est explicatif et informatif.Le discours masculin est conçu pour frapper l'auditoire, celui<strong>de</strong>s femmes tient davantage <strong>de</strong> l'exposé.Certaines associations paritaires font prévaloir ces différences afind'assurer à terme une révolution culturelle, à savoir une autre manière<strong>de</strong> faire <strong>de</strong> la politique. Révolution que ces différences permettraientà court et moyen terme.Clivage droite/gauche : typologie <strong>de</strong>s milltante sllQui sont les müitantes ?Ce sont pour beaucoup <strong>de</strong>s fonctionnaires <strong>de</strong> renseignementsecondaire dans les partis <strong>de</strong> gauche et <strong>de</strong>s cadres moyens etsupérieurs dans ceux <strong>de</strong> droite. Les fe mmes au foyer, les agricultriceset les ouvrières sont fort peu représentées. Les militantes sont <strong>de</strong>sfemmes actives. On trouve plus <strong>de</strong> fe mmes inactives à droite qu'àgauche (3% le sont au Parti Socialiste contre 20% au RPR) . Les militantessocialistes sont moins soucieuses <strong>de</strong> leur apparence. Aucontraire, à droite, elles soulignent leurs attributs <strong>féminins</strong>. Elles sontplutôt syndiquées au Parti Socialiste (70%) mais pas au RPR D'aprèsl'enquête menée par Pierre Brechonl2 aux assises <strong>de</strong> Grenoble en10. Cf Le Manifeste <strong>de</strong>s 10 paru dans L'Express du 6 juin 1996. il fut signé par<strong>de</strong>s fe mmes <strong>de</strong> droite et <strong>de</strong> gauche et avait pour but <strong>de</strong> proposer <strong>de</strong>s solutionsà la parité politique.Il. Nous nous contentons <strong>de</strong> souligner les critères majoritaires, sachant qu'Ufaut les prendre comme <strong>de</strong>s types Idéaux. Nous nous sommes basée sur lesobservations faites lors <strong>de</strong> meeting <strong>de</strong>s partis et au contact d'une centaine <strong>de</strong>militantes <strong>de</strong> droite et <strong>de</strong> gauche.12. P. BRECHON. op ciL
Sandrine Dauphin 1591984, les femmes du RPR appartiennent à <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> parentsd'éléves, d'action sociale ou civique féminine. A gauche, elles se disentplus facilement fé ministes (Yvette Roudy, Elisabeth Guigou).caractéristiques Militante <strong>de</strong> gauche Militante <strong>de</strong> droiteApparence physique Allure dynamique, Tailleur, BCBGsportive, panGlionProfession Fonctionnaire (surtout Cadre supérieur, femmeenseignement)au foyer, retraitéeVie fam1l1ale Célibataire, divorcée, Mariée (trois enfants)mariée (<strong>de</strong>ux enfants)Activités associatives Associations <strong>de</strong> femmes, Parents d'éléves,lutte contre J'exclusion, associations catholiques,écologistes,action socialehumanitaires, contre lehumanitaireracismediversCatholique pratiquantePrès <strong>de</strong> 90% <strong>de</strong>s militantes du RPR se disent catholiques alors qu'àgauche les valeurs sont profondément laïques. Somme toute lesdifférences entre la militante <strong>de</strong> gauche et celle <strong>de</strong> droite sont lesmêmes que pour les militants masculins. Conservatisme et valeurstraditionnelles à droite, réformisme et esprit égalitaire à gauche. AnneMarle Idrac13 reconnaît avoir plus <strong>de</strong> points communs avec sescollègues masculins qu'avec certaines fe mmes <strong>de</strong> gauche. Aussi nousne pouvons pas parler <strong>de</strong> solidarité féminine qui pourrait dépasser lesclivages politiques. Auj ourd'hui la majOrité <strong>de</strong>s femmes ne compte pasrevenir sur certains acquis <strong>de</strong>s années 70 (avortement. contraception,égalité <strong>de</strong>s chances ...). Par exemple, l'idée sous-Jacente <strong>de</strong> salaire13. Secrétaire d'Etat aux transports sous les gouvernements d'Alain Juppé(1995-1 997).
160 Fenunes au pouooirmaternel proposée par Colette Codaccioni en 1993. dans son rapportsur la famtlle. sous le gouvernement d'Edouard Balladur. a mobiliséégalement <strong>de</strong>s femmes du RPR contre le projet. telle que RoselyneBachelot.Hormis les configurations sociales traditionnelles, le clivage politiquegauche/droite a <strong>de</strong>s répercussions sur l'idée <strong>de</strong> nature féminine etplus largement sur le rôle <strong>de</strong> la femme dans la société. La militante <strong>de</strong>droite pense que l'équilibre <strong>de</strong> la société repose sur la famille. Lacellule familiale est donc privilégiée. la femme est avant tout unemére : en tant que m1l1tante elle assure l'avenir <strong>de</strong> ses enfants. Lanécessité <strong>de</strong> conc1l1er la vie professionnelle et la vie familiale estconsidérée comme une priorité pour la militante <strong>de</strong> droite. Elle nedoute pas <strong>de</strong> l'existence d'une nature féminine. Elle la revendique. Ellefa it confiance aux nouvelles générations. élevées dans <strong>de</strong>s classesmixtes. pour assurer l'égalité homme/femme. De ce côté <strong>de</strong> l'échiquierpolitique. on est donc moins interventionniste qu'à gauche carl'évolution <strong>de</strong>s mentalités doit se faire sans heurts. <strong>de</strong> façon naturelle.On est certes plus volontaire à gauche mais aussi plus pessimistesur la parité et l'égalité hommes/femmes. Cette <strong>de</strong>rnière nécessite unelutte et une attention constantes afin <strong>de</strong> conserver les acquis (mobilisationcontre les commandos anti-IVG. par exemple). La militante <strong>de</strong>gauche a intégré les préceptes beauvoiriens : • On ne naît pas femme.on le <strong>de</strong>vient . et • Une féministe qu'elle se dise <strong>de</strong> gauche ou non.est <strong>de</strong> gauche par définition . • Elles ont tendance à vouloir faire oublierqu'elles sont <strong>de</strong>s femmes en évitant les attributs trop <strong>féminins</strong>(Elisabeth Guigou qui se coupe les cheveux. Edith Cresson qui se voitreprocher ses bijoux trop voyants).Ces nuances gauche/droite sur l'i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> la femme permettentd'interpréter les comportements <strong>de</strong>s partis. A droite. le parU les utiliseraen tant que femme (Simone Veil. Michèle Barzach ont été <strong>de</strong>sfemmes-alibi et le revendiquent). Les lea<strong>de</strong>rs choisiront <strong>de</strong> préférence<strong>de</strong> s'entourer <strong>de</strong> femmes séduisantes : Michèle Barzach. Anne-MarieIdrac. Anne-Marie Cou<strong>de</strong>rc. Françoise <strong>de</strong> Panafieu.Ainsi. le premier gouvernement d'Alain Juppé qui regroupait douzefemmes s'est vu amputé. moins <strong>de</strong> six mois plus tard. <strong>de</strong>s trois quarts
Sandrine Dauphin 161d'entre elles. Il se justifia en laissant sous-entendre leur incompétence,Les femmes du RPR essaient d'améliorer leur image nonseulement à l'extérieur du mouvement mais aussi à l'intérieur où ellesbataillent pour faire reconnaître leur capacité <strong>de</strong> gestion.A gauche, on les utilise également avec une certaine démagogie.Leurs compétences sont largement moins mises en doute mais ce sonttoujours les fidèles <strong>de</strong>s fidèles qui sont choisies. Seule la socialisteMartine Aubry est à l'égale <strong>de</strong> Simone Veil pour la droite, c'est-à-direune personnalité dotée d'une gran<strong>de</strong> autorité. Le Parti socialiste tendà se présenter comme le porte-flambeau <strong>de</strong> toutes les revendicationsféminines tout en les étouffant après les avoir absorbées l 4 • Nousn'avons pas quitté les vieux préjugés du XIxe siècle. A droite. on craintque l'arrivée <strong>de</strong>s femmes ne perturbe la cellule familiale; à gauche. lesfemmes sont une catégorie. aussi elles heurtent l'universalisme républicaincar elles ne sont pas <strong>de</strong>s éléments neutres. Catholicisme etlaïcité sont les <strong>de</strong>ux facteurs spécifiquement français qui expliquentles difficultés rencontrées par les femmes pour faire <strong>de</strong> la politique.Des compagnes <strong>de</strong> routeLes partis politiques reproduisent la ségrégation existante dans lasociété. Il existe un décalage entre le discours externe <strong>de</strong>s partis vis-àvis<strong>de</strong>s femmes (parité. quotas. droits <strong>de</strong>s femmes ...) et leur attitu<strong>de</strong>vis-à-vis <strong>de</strong> leurs militantes. Plus un parti est élitiste et moins il seféminise. C'est le cas. par exemple. du Parti Républicain où la règleest la cooptation et au Centre <strong>de</strong>s Démocrates Sociaux le monopole<strong>de</strong>s élus. Dans ce type <strong>de</strong> parti, il n'est pas possible d'assurer sa promotionInterne. Au sein du Parti Républicain. la situation <strong>de</strong>s militantesa été dénoncée par trois d'entre elles. Marie-Thérèse Bianchi.Christine Chauvet et Laurence Douvin : • Le comble du féminisme auParti Républicain ne peut ètre que <strong>de</strong> présenter sa femme sous sonnom <strong>de</strong> jeune fille aux élections cantonales lorsqu'on est atteint par le14. Deux exemples : sous le gouvernement <strong>de</strong> Pierre Mauroy <strong>de</strong> 1981 à 1984,le programme crèche n'a été honoré que du tiers, Sous l'actuel gouvernement.la mod1f1cation <strong>de</strong> la constitution n'Inclura pas finalement le terme ' parité .mais celui beaucoup plus neutre d', égalité <strong>de</strong>s chances .,
162 Femmes au pouvoircumul <strong>de</strong>s mandats15, • ( .. ,) • Quand après 20 ans <strong>de</strong> ces efforts(militants), on ne vous donne pas la moindre responsabilité politique,c'est qu'il y a un problème dans le fonctionnement <strong>de</strong> la machine politiqueavec laquelle vous vivez16, •Mais l'acte d'adhésion ne conditionne pas pour autant le passageau militantisme, L'organisation du parti ne le permet pas aisément.Les réunions ont lieu le soir ou le week-end, Militer c'est bien souventaccepter une troisième journée puisque la parité n'existe guère dansles foyers, Souvent les fe mmes qui font <strong>de</strong> la politique ne tarissent pasd'éloges sur leurs compagnons qui les ont encouragées et ont suprendre la relève dans le foyer (Martine Aubry, Elisabeth Guigou ... ) ,Mais leur situation financière ne peut être comparée à celle <strong>de</strong>smilitantes <strong>de</strong> base, En effet, lors <strong>de</strong>s réunions <strong>de</strong> section noustrouvons parmi les femmes une majorité <strong>de</strong> Jeunes filles et <strong>de</strong> femmes<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 45 ans, En revanche, la fe mme qui s'est généralementconstituée une famille, et qui se trouve dans la tranche d'âge 25-45ans, peut être adhérente mais beaucoup plus difficilement militante,Ce sont les jeunes mères <strong>de</strong> famille qui manquent le plus d'esprit militant.Un certain nombre <strong>de</strong> femmes se sont engagées en politiquelorsqu'elles étaient célibataires ou une fo is l'éducation <strong>de</strong>s enfantsassurée, Or c'est dans cette même tranche d'âge (25-45 ans) quel'homme militant commence à prendre <strong>de</strong>s responsabilités et àacquérir une expérience <strong>de</strong> terrain.Les femmes qui obtiennent <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> dirigeants sont :- les hauts fonctionnaires <strong>de</strong> l'Etat. Elles sont Issues <strong>de</strong> l'ENA et sontdonc formées à la gestion du pays. Dans le gouvernement <strong>de</strong> LionelJospin, les fe mmes qui ont les postes les plus Importants sont <strong>de</strong>sénarques : Martine Aubry, Elisabeth Guigou, Ségolène Royal. La viemilitante fait partie intégrante <strong>de</strong> leur plan <strong>de</strong> carrière professionnel.- les femmes qui ont su concilier au mieux vie familiale et vie militante.Parmi les anciennes ministres retenons Yvette Roudy, Michèle15. Lettre ouverte aux hommes qui ont peur <strong>de</strong>s femmes en polüique, 1990, p. Il16.1<strong>de</strong>m, p. 14
Sandrine Dauphin 163Barzach. Georgina Dufoix. Edwige Avice et Frédérique Bredin. Ces<strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières ont èté députées vers trente ans.Leur place dWlS les partisLa militante aspire aux mémes responsabilités que les hommes :responsables <strong>de</strong> commissions. secrétaires fé dérales. attachées parlementaires.députées .... etc.Qu'en est-il lorsque nous analysons l'organigramme <strong>de</strong>s partis?Mème si elles sont moins nombreuses que les hommes. les femmes nesont plus cantonnées aux questions relatives à la famille comme dansles années 60-70. Nous retrouvons également <strong>de</strong>s femmes aux affaireseuropéennes. à l'économie. aux entreprises. Seuls trois bastions leurrestent fe rmés : la défensel7• les affaires étrangères et les questions <strong>de</strong>sécurité intérieure. Tout ce qui relève du militaire. du combat estspécifiquement masculin.Cette remarque est éminemment symbolique car le patriarcat s'estfo ndé sur le prestige du chasseur-guerrier. Il n'y a pas si longtemps, laFrance était gouverné par un militaire. C'est une manière• inconsciente . <strong>de</strong> souligner que la fe mme est • par nature . étrangèreau pouvoir légitimé par la force et la domination. Il fallait dans lessociétés primitivesl8 protéger les fe mmes <strong>de</strong> la guerre pour préserverla cohésion sociale et s'assurer une <strong>de</strong>scendance. Ce serait donc une• déficience naturelle . qui empécherait les femmes <strong>de</strong> participer à lavie <strong>de</strong> la cité. En revanche. la supériorité physique <strong>de</strong> l'homme entraînetoute une série <strong>de</strong> vertus morales nécessaires à cette participation: courage. esprit stratégique. autorité. communication.Ces conceptions archaïques ont laissé <strong>de</strong>s traces encore visiblesdans le comportement <strong>de</strong>s partis à l'égard <strong>de</strong> leurs militantes. Le PartiSocialiste a voulu récupérer les revendications féministes <strong>de</strong>s années70. Il fa it <strong>de</strong> même dans les années 90 en se prononçant en faveur <strong>de</strong>17. Exception faite pour la socialiste Edwige Avice. secrétaire d'Etat auprès duministre <strong>de</strong> la défense (1984- 1986).18. Cf les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Levi-Strauss,
164Femmes au pouvoirla parité. Les partis politiques (le Parti socialiste en téte) ont œuvrépour améliorer le droit <strong>de</strong>s femmes.Au Parti socialiste, il existe même un Secrêtariat national auxDroits <strong>de</strong>s Femmes. Depuis novembre <strong>de</strong>rnier, au Congrès <strong>de</strong> Brest, laparité est Inscrite dans les statuts l9 • En fait, dès 1973, FrançoisMitterrand avait Imposé <strong>de</strong>s quotas <strong>de</strong> femmes sur les listes électoraleset dans les organes <strong>de</strong> direction. Théoriquement ils <strong>de</strong>vaient êtreproportionnels au nombre d'adhérentes, soit 10% en 1973, et augmenter<strong>de</strong> 5% à chaque congrès, Aux Congrès <strong>de</strong> Toulouse en 1985,ces quotas ont failli être supprimés par Lionel Jospin sous la pression<strong>de</strong>s fédérations. 150 femmes ont Immédiatement réagi.Pourtant au bureau politique, il n'y a pas <strong>de</strong> féministes. Elles fontpeur, comme le souligne Yvette RoudfO à propos <strong>de</strong>s quotas <strong>de</strong>femmes <strong>de</strong> 30% aux législatives <strong>de</strong> juin 1997 : • Il n'y a plus beaucoup<strong>de</strong> conquérants dans ce parti : 11 y a en revanche beaucoupd'héritiers, qui se disputent le patrimoine. Quand les petits chefs <strong>de</strong>sfédéraux se sont vus menacés par <strong>de</strong>s parachutages, et qu'lls ontcompris que Jospin ne plaisantait pas, ils ont très vite cherché <strong>de</strong>sfemmes qui ne les dérangeaient pas : celles que j'appelle <strong>de</strong>s auxiliaires21 ••Même si certaines femmes au Parti socialiste ont une activité à lafols <strong>de</strong> militante socialiste et <strong>de</strong> féministe (Yvette Roudy, Régine SaintCriq, Françoise Gaspard), les plus vindicatives sont écartées. Lesfemmes qui osent se proclamer « fé ministes . sont minoritaires.Pour les législatives, un « référendum . a eu lieu auprès <strong>de</strong>s militantsqui ont accepté dans leur gran<strong>de</strong> majorité les quotas. Ce n'estpas au niveau du militant <strong>de</strong> base que les problèmes surgissent maisau niveau <strong>de</strong>s • petits chefs '. Ce sont <strong>de</strong>s femmes qui ont étéenvoyées fa ce aux lea<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> la droite : Tlbéri, Balladur, Barre,Ma<strong>de</strong>lin ... Toutefois le parti socialiste est le groupe politique le plus19, Les Verts sont les premiers à avoir Inscrit la parité dans leur statuts.20, Ancienne ministre chargée <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>s femmes <strong>de</strong> 1981 à 1986.21. Le Mon<strong>de</strong> du 9- 10 mars 1997,
Sandrine Dauphin 165• féminisé . <strong>de</strong> l'Assemblée Nationale avec 17%. <strong>de</strong>vançant pour lapremiére fois le Parti communiste 22 (proportionnellement) .Le RPR avance 50.000 femmes adhérentes. ce qui fait <strong>de</strong> lui lemouvement politique le plus ouvert aux femmes. Il y a une déléguéepar circonscription. donc 577. Elles s'appellent • Femmes RPR •• cequi remplace l'ancienne dénomination <strong>de</strong> • secrétariat national àl'action féminine •. Il existe une sorte <strong>de</strong> quotas non officiels <strong>de</strong> 30%sur les scrutins <strong>de</strong> liste mais sur les autres scrutins la priorité ausortant et le cumul <strong>de</strong>s mandats posent probléme. Alors que le partiest plutôt hostile aux propositions <strong>de</strong> Lionel Jospin sur le cumul <strong>de</strong>smandats. les femmes du RPR sont moins partisanes. Elles envisagentle changement comme une possib1l1té permettant aux militantes <strong>de</strong> seprésenter à <strong>de</strong>s élections.Mais les lea<strong>de</strong>rs font assez peu cas <strong>de</strong> ces femmes. RoselyneBachelot raconte qu'aux élections législatives <strong>de</strong> 1993 : • Il Y avait untas <strong>de</strong> gens qui se succédaient à la tribune (...) et puis ce fu t le tour<strong>de</strong>s femmes candidats (...) Chirac et Balladur étaient au premier rang.Et tout d'un coup. ils se sont levés. Vous savez ce qu'ils font ? Ils vontdéJeuner ! ... 23 ••Au sein <strong>de</strong> l'autre grand parti <strong>de</strong> droite. à l'UDF. il existe un pactepour la participation <strong>de</strong>s femmes en politique. largement soutenu parFrançois Léotard. Dans ce parti <strong>de</strong> notables. habitués à <strong>de</strong>s querelles<strong>de</strong> lea<strong>de</strong>rship. le prési<strong>de</strong>nt se heurte au conservatisme <strong>de</strong> ses m1l1-tants. Les situations sont donc inversées entre le Parti Socialiste et leRPR. Ce <strong>de</strong>rnier est un parti très personnalisé dans lequel le lea<strong>de</strong>rpossè<strong>de</strong> un pouvoir et une autorité considérables. Ce sont ses mili-22. Dès 1922, le parti a une Commission féminine et après la Secon<strong>de</strong> GuerreMondiale. les résistantes prennent une part Importante à son activité. 11 adoptaune position conservatrice dans les années 70 face aux questions féministes.Souvent les femmes qui ont <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> dirigeant sont <strong>de</strong>s épouses <strong>de</strong>dirigeants (Jeannette Vermeersch, l'épouse <strong>de</strong> Thorez). A la mort <strong>de</strong> Thorez en1974 , sa femme n'appartient plus au bureau politique. Par la suite. le partisoutiendra toutes les revendications féminines et sera le parti qui présentera leplus <strong>de</strong> femmes députés et sénateurs.23. Elisabeth WEISSMANN. Les Filles on n'attend plus que vous f Gui<strong>de</strong>pratique et polémique à l'usage <strong>de</strong> celles qui s'interrogent sur leur engagementen polüique. Ed Textuel. Paris, 1995, p. 39.
166 Femmes au pouvoirtants qui tendraient à évincer les m1l1tantes souhaitant prendre davantage<strong>de</strong> responsabilités.Au sein du Parti socialiste qui fonctionne très démocratiquement.ce sont les dirigeants qui limitent les ambitions <strong>de</strong>s militantes.Malgré <strong>de</strong>s différences <strong>de</strong> fonctionnement. ces partis politiques reproduisentles mémes schémas d'exclusion <strong>de</strong>s femmes. Un hommequi crée un courant dans un parti est en position <strong>de</strong> force. 11 s'assurecomme . prési<strong>de</strong>ntiable . : Jospin. Balladur. Barre. Fabius. Ma<strong>de</strong>lin ...Au contraire. la femme est . chassée '. accusée <strong>de</strong> trahison.En 1978. le courant Femmes du Parti Socialiste soumet un texteau vote <strong>de</strong>s militants lors du congrès <strong>de</strong> 1979. Il n'obtient pas les voIXnécessaires pour être représenté au comité directeur. La presse avaitdénoncé ce courant et parlé <strong>de</strong> menaces <strong>de</strong> déstabilisation pourl'équilibre du parU. Autre exemple. Michèle Barzach 24 a soutenu leclan <strong>de</strong>s rénovateurs du RPR en 1989. La riposte <strong>de</strong> Chirac est violente: • C'est tout <strong>de</strong> même mol qui l'al fa ite ... Je l'al Imposée commedéputé. comme conseiller <strong>de</strong> Paris. puis comme adjoint. •Dans leur globalité. les partis politiques reproduisent les rapportspère/fils. Antoinette Fouque parle. à juste titre. <strong>de</strong> République <strong>de</strong>s fils.Les différents courants pennettent le meurtre symbolique du père parses fils afin <strong>de</strong> prendre le pouvoir. L·adversaire. pour cette anciennedu MLF. n'est pas le patriarcat mals le • filiarcat '. L'assemblée <strong>de</strong>s filset <strong>de</strong>s frères qui se réunit après le parrici<strong>de</strong> pour fon<strong>de</strong>r la démocratieexclut a priori les femmes : . La révolution démocratique. c'estl'instauration d'un fillarcat fra ternel et fra trici<strong>de</strong>. l'avènement d'unfatrlarcat ; elle (la République) reprend. sur un mo<strong>de</strong> laïque. la dissi<strong>de</strong>ncechrétienne qui fon<strong>de</strong> notre ère. Là où était la religion du Père.s'avance la République <strong>de</strong>s fils 25 • •Les militantes qui obtiennent <strong>de</strong> hautes fonctions sont toujoursvues comme proches d'un homme : les jupettes, les femmes <strong>de</strong> Jospin.24. Ministre déléguée auprés du mlnlstére <strong>de</strong>s Affaires Sociales et <strong>de</strong> rEmploi.chargé <strong>de</strong> la Santé et <strong>de</strong> la Famille (1986- 19881.25. Antoinette FOUQUE. Il y a <strong>de</strong>ux sexes. Essais <strong>de</strong> Jéminologie 1989-1995.Ed Gallimard. Le Débat. 1995, p. 92.
Sandrine Dauphin 167la Pompadour pour qualifier les rapports d'Edith Cresson et <strong>de</strong>François Mitterrand. Le fait du Prince leur a permis d'être ministresans passer par la légitimité <strong>de</strong>s urnes : Simone Veil, FrançoiseGiroud, Elisabeth Guigou, Martine Aubry, Ségolène Royal ...Sinon elles sont régulièrement envoyées au • casse-pipe 1. AnneMarie Dupuy a relaté dans ses mémoires ses déboires à la mairie <strong>de</strong>Cannes 26 : • Le secrétaire départemental du RPR <strong>de</strong>s Alpes Maritimes(,..) souhaitait que je porte les couleurs du RPR à Cannes! Parce qU'ilm'avait trouvée dynamique! En réalité, le RPR n'avait plus personnepour le représenter dans la cinquiéme circonscription <strong>de</strong>s AlpesMaritimes et le secrétaire départemental avait appris que j'avais unemaison à Cabris prés <strong>de</strong> Grasse . .. 1.Cet exemple illustre bien le fa it que les femmes militantes sontsouvent choisies lorsque aucun homme n'est intéressé par la place.L'acharnement <strong>de</strong> Catherine Trautmann à Strasbourg fu t finalementrécompensé. A la surprise générale, elle <strong>de</strong>vient en 1989 la premièrefemme maire d'une ville <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 100.000 habitants. Mais ce sontles élections au scrutin proportionnel qui favorisent les militantes carsur les listes la concurrence est moins ru<strong>de</strong>. D'ailleurs, les partis,toutes tendances confondues, sont favorables aux quotas sur lesscrutins <strong>de</strong> liste. En revanche, les têtes <strong>de</strong> listes confiées à <strong>de</strong>s femmessont beaucoup plus rares (20% aux <strong>de</strong>rnières élections régionales).Aux régionales <strong>de</strong> mars 1998, la plupart <strong>de</strong>s listes étaient paritaires,l'ensemble <strong>de</strong>s autres partis ayant suivi l'exemple du Parti Socialiste.Cependant la majorité <strong>de</strong>s militantes se plaignent <strong>de</strong> ne pas êtreécoutées même si l'absence <strong>de</strong> démocratie au sein <strong>de</strong>s partis estdénoncée par les militants <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux sexes.Aussi certaines n'hésitent pas à adopter la stratégie <strong>de</strong>s féministes<strong>de</strong> l'Europe du Nord. Treize listes <strong>de</strong> femmes se sont constituées pourles régionales du 15 mars <strong>de</strong>rnier, elles ont remportées entre 0.94% et5.87% <strong>de</strong>s suffrages. Au total seulement <strong>de</strong>ux élues. Ces listes26. Anne-Marle DUPUY, Le Destin et la volonté. mémoires, Ed La Table ron<strong>de</strong>,1996, p. 226.
168 Femmes au pouvoirn'obtiennent pas un nombre suffisant <strong>de</strong> voiX pour peser sur les élections.Elles n'ont d'effet ni sur les partis, ni sur les électeurs qui yvoient un • excès féministe J.Les militantes : <strong>de</strong>s figurantes ?Les femmes militantes sont-elles <strong>de</strong>s figurantes ? Elles ont souventle sentiment que les décisions se passent ailleurs, au sein <strong>de</strong> réunionsdont elles sont exclues : entre hommes dans <strong>de</strong>s parties <strong>de</strong> golf ou <strong>de</strong>chasse par exemple, dans les clubs dont ils faisaient partie avant leurmilitantisme politique.Le problème principal est donc l'échange d'information car leshommes font <strong>de</strong> la rétention. La fe mme, c'est l'Autre, l'intruse, ellen'est pas encore pleinement acceptée dans le système, elle ne fait pascorps avec le parti. Tout porte à croire d'ailleurs que les partis lesabsorbent, veulent les intégrer dans un même moule masculin maisn'acceptent pas leurs spécificités et leur éventuelle volonté <strong>de</strong> changerles règles du Jeu. Les femmes sont perçues comme <strong>de</strong> dangereusesconcurrentes qui cherchent. non pas à partager le pouvoir, mais àl'usurper, à le prendre dans sa totalité.Les problèmes rencontrés par ces femmes fo nt écho aux critiquesplus générales <strong>de</strong> la crise du militantisme politique en France : ledécalage entre la base et les dirigeants, le peu <strong>de</strong> démocratie dans lefonctionnement <strong>de</strong> certains partis. On assiste <strong>de</strong>puis la fm <strong>de</strong>s années80 environ à une crise politique en France qui toucha d'abord la gaucheau pouvoir et le Parti Communiste (effondrement du bloc soviétique)puis <strong>de</strong>rnièrement la droite.La crise du mon<strong>de</strong> politique gagnerait peut être à se • féminiser Jen offrant une image nouvelle <strong>de</strong>s partis politiques. C'est pourquoil'idée <strong>de</strong> parité est capitale afin d'offrir une assise à une sociétécogérée par <strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong>s femmes à égalité <strong>de</strong> représentation.
Pour répondre au vœu <strong>de</strong> Mme Pilar Peres Canto. la rédaction précise quela version du texte • • Citoyennes et politique : vers une démocratie sansexclusions . publiée dans Sextant 8 n'est pas une version définitive <strong>de</strong> larecherche menée,
NUMEROS PRECEDENTSn° 1 Féminismesn02 Sciences et culturesn03 Femmes et mé<strong>de</strong>cinen04 Travail (épuisé)n05 Métiersn06 Femmes en lettresn07 Citoyennetén09 Femmes dans la cité. Amérique latine et PortugalA paraître :nO ll <strong>Engagements</strong> fé minins (II) (septembre 1999)n° 12 Femmes artistes (printemps 2000)
Ont collaboré à ce numéro :Beatrice Barbalato est docteure ès Lettres romanes et donne <strong>de</strong>s coursd'histoire <strong>de</strong> l'Italie contemporaine à l'<strong>Université</strong> catholique <strong>de</strong> Louvain,Elle mène <strong>de</strong>s recherches en littérature Italienne et en sociologie <strong>de</strong> lacommunication,Sandrine Dauphin est docteure en science Politique <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong>Paris II, Elle prépare un ouvrage sur les fe mmes et la Ve République,Viviane Di Tillio est historienne, diplômée <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong><strong>Bruxelles</strong>, Elle a consacré son mémoire <strong>de</strong> licence à la Fédération <strong>de</strong>sfemmes diplômées <strong>de</strong>s universités,Yvonne Knibiehler est historienne, professeure émérite <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong><strong>de</strong> Provence, où elle a dirigé l'unité <strong>de</strong> l'Histoire <strong>de</strong> la Famille <strong>de</strong> 1970 à1985,Maria José Lacalzada <strong>de</strong> Mateo est docteure en histoire mo<strong>de</strong>rne etcontemporaine <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Saragosse. Ses recherches visent àrestaurer l'importance et l'influence <strong>de</strong> Concepclôn Arenal.Sophie Matltava est licenciée en histoire contemporaine <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong>libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>, Son mémoire a porté sur le militantismeantialcoolique et pacifiste d'une famille bruxelloise,Stina Niklasson est docteure en histoire <strong>de</strong> l'<strong>Université</strong> d'Uppsala,Après une carrière <strong>de</strong> haut fonctionnaire au ministère <strong>de</strong> l'Educationsuédois, elle est revenue à la recherche avec trois ouvrages sur lesfemmes dites modérées en Suè<strong>de</strong> dans la première moitié du XXe siècle.Eliane Richard est historienne, maître <strong>de</strong> conférences émérite àl'<strong>Université</strong> <strong>de</strong> Provence. Ses travaux portent sur le féminisme, lacitoyenneté, les élites marseillaises.
Règles d’utilisation <strong>de</strong> copies numériques d‘œuvres littérairespubliées par le Groupe interdisciplinaire d'étu<strong>de</strong>s sur lesfemmes <strong>de</strong> l’ULBet mises à disposition par les Bibliothèques <strong>de</strong> l’ULBL’usage <strong>de</strong>s copies numériques d’œuvres littéraires, ci-après dénommées « copiesnumériques », publiées par le Groupe interdisciplinaire d'étu<strong>de</strong>s sur les femmes <strong>de</strong>l’<strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong>, ci-après dénommé GIEF-ULB, et mises à disposition par lesBibliothèques <strong>de</strong> l’ULB, implique un certain nombre <strong>de</strong> règles <strong>de</strong> bonne conduite, préciséesici. Celles-ci sont reproduites sur la <strong>de</strong>rnière page <strong>de</strong> chaque copie numérique publiée parle GIEF-ULB et mises en ligne par les Bibliothèques. Elles s’articulent selon les trois axes :protection, utilisation et reproduction.Protection1. Droits d’auteurLa première page <strong>de</strong> chaque copie numérique indique les droits d’auteur d’application surl’œuvre littéraire. La mise à disposition par les Bibliothèques <strong>de</strong> l’ULB <strong>de</strong> la copie numériquea fait l’objet d’un accord avec le GIEF-ULB, notamment concernant les règles d’utilisationprécisées ici. Pour les œuvres soumises à la législation belge en matière <strong>de</strong> droit d’auteur, leGIEF-ULB aura pris le soin <strong>de</strong> conclure un accord avec leurs ayant droits afin <strong>de</strong> permettrela mise en ligne <strong>de</strong>s copies numériques.2. ResponsabilitéMalgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité <strong>de</strong>s copiesnumériques, certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, <strong>de</strong>sincomplétu<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s erreurs dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc.-. Le GIEF-ULB et les Bibliothèques <strong>de</strong> l’ULB déclinent toute responsabilité concernant lesdommages, coûts et dépenses, y compris <strong>de</strong>s honoraires légaux, entraînés par l’accès et/oul’utilisation <strong>de</strong>s copies numériques. De plus, le GIEF-ULB et les Bibliothèques <strong>de</strong> l’ULB nepourront être mis en cause dans l’exploitation subséquente <strong>de</strong>s copies numériques ; et ladénomination du GIEF-ULB et <strong>de</strong>s ‘Bibliothèques <strong>de</strong> l’ULB’, ne pourra être ni utilisée, niternie, au prétexte d’utiliser <strong>de</strong>s copies numériques mises à disposition par eux.3. LocalisationChaque copie numérique dispose d'un URL (uniform resource locator) stable <strong>de</strong> la forme qui permet d'accé<strong>de</strong>r audocument ; l’adresse physique ou logique <strong>de</strong>s fichiers étant elle sujette à modifications sanspréavis. Les bibliothèques <strong>de</strong> l’ULB encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ilssouhaitent faire référence à une copie numérique.1
Utilisation4. GratuitéLe GIEF-ULB et les Bibliothèques <strong>de</strong> l’ULB mettent gratuitement à la disposition du public lescopies numériques d’œuvres littéraires sélectionnées par le GIEF-ULB : aucunerémunération ne peut être réclamée par <strong>de</strong>s tiers ni pour leur consultation, ni au prétextedu droit d’auteur.5. Buts poursuivisLes copies numériques peuvent être utilisés à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> recherche, d’enseignement ou àusage privé. Quiconque souhaitant utiliser les copies numériques à d’autres fins et/ou lesdistribuer contre rémunération est tenu d’en <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’autorisation au GIEF-ULB, enjoignant à sa requête, l’auteur, le titre, et l’éditeur du (ou <strong>de</strong>s) document(s) concerné(s).Deman<strong>de</strong> à adresser au Groupe interdisciplinaire d'étu<strong>de</strong>s sur les femmes GIEF-ULB,Secrétariat <strong>de</strong> rédaction, 50 avenue F. Roosevelt CP175/01, 1050 <strong>Bruxelles</strong> ou par courrierélectronique à egubin@ulb.ac.be.6. CitationPour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, lesdocuments utilisés, par la mention « <strong>Université</strong> libre <strong>de</strong> <strong>Bruxelles</strong> – Groupeinterdisciplinaire d'étu<strong>de</strong>s sur les femmes et Bibliothèques » accompagnée <strong>de</strong>s précisionsindispensables à l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s documents (auteur, titre, date et lieu d’édition).7. Liens profondsLes liens profonds, donnant directement accès à une copie numérique particulière, sontautorisés si les conditions suivantes sont respectées :a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ilsy ont accès via le site web <strong>de</strong>s bibliothèques <strong>de</strong> l’ULB ;b) l’utilisateur, cliquant un <strong>de</strong> ces liens profonds, <strong>de</strong>vra voir le document s’ouvrir dans unenouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée <strong>de</strong> l’avertissement ‘Vous accé<strong>de</strong>z àun document du site web <strong>de</strong>s bibliothèques <strong>de</strong> l’ULB’.Reproduction8. Sous format électroniquePour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, lacopie et le stockage <strong>de</strong>s copies numériques sont permis ; à l’exception du dépôt dans uneautre base <strong>de</strong> données, qui est interdit.9. Sur support papierPour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement les fac-similésexacts, les impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document estau format texte) sont permis.10. RéférencesQuel que soit le support <strong>de</strong> reproduction, la suppression <strong>de</strong>s références au GIEF-ULB et auxBibliothèques <strong>de</strong> l’ULB dans les copies numériques est interdite.2