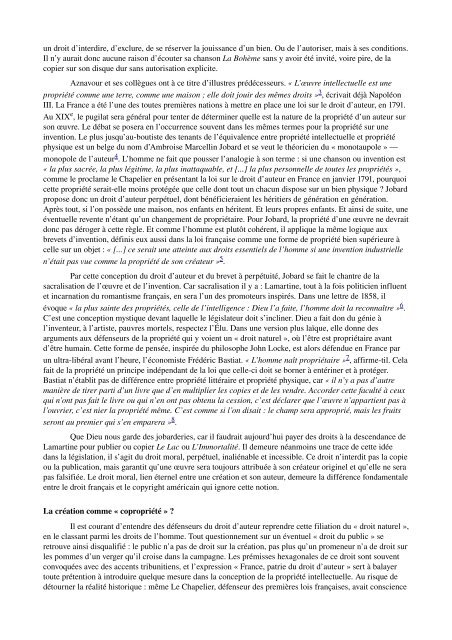un droit d’interdire, d’exclure, <strong>de</strong> se réserver <strong>la</strong> jouissance d’un bien. Ou <strong>de</strong> l’autoriser, mais à ses conditions.Il n’y aurait donc aucune raison d’écouter sa chanson La Bohème sans y avoir été invité, voire pire, <strong>de</strong> <strong>la</strong>copier sur son disque dur sans autorisation explicite.Aznavour et ses collègues ont à ce titre d’illustres prédécesseurs. « L’œuvre intellectuelle est unepropriété comme une terre, comme une maison ; elle doit jouir <strong>de</strong>s mêmes droits » 3 , écrivait déjà NapoléonIII. La France a été l’une <strong>de</strong>s toutes premières nations à mettre en p<strong>la</strong>ce une loi sur le droit d’auteur, en 1791.Au XIX e , le pugi<strong>la</strong>t sera général pour tenter <strong>de</strong> déterminer quelle est <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété d’un auteur surson œuvre. Le débat se posera en l’occurrence souvent dans les mêmes termes pour <strong>la</strong> propriété sur uneinvention. Le plus jusqu’auboutiste <strong>de</strong>s tenants <strong>de</strong> l’équivalence entre propriété intellectuelle et propriétéphysique est un belge du nom d’Ambroise Marcellin Jobard et se veut le théoricien du « monotaupole » —monopole <strong>de</strong> l’auteur 4 . L’homme ne fait que pousser l’analogie à son terme : si une chanson ou invention est« <strong>la</strong> plus sacrée, <strong>la</strong> plus légitime, <strong>la</strong> plus inattaquable, et [...] <strong>la</strong> plus personnelle <strong>de</strong> toutes les propriétés »,comme le proc<strong>la</strong>me le Chapelier en présentant <strong>la</strong> loi sur le droit d’auteur en France en janvier 1791, pourquoicette propriété seraitelle moins protégée que celle dont tout un chacun dispose sur un bien physique ? Jobardpropose donc un droit d’auteur perpétuel, dont bénéficieraient les héritiers <strong>de</strong> génération en génération.Après tout, si l’on possè<strong>de</strong> une maison, nos enfants en héritent. Et leurs propres enfants. Et ainsi <strong>de</strong> suite, uneéventuelle revente n’étant qu’un changement <strong>de</strong> propriétaire. Pour Jobard, <strong>la</strong> propriété d’une œuvre ne <strong>de</strong>vraitdonc pas déroger à cette règle. Et comme l’homme est plutôt cohérent, il applique <strong>la</strong> même logique auxbrevets d’invention, définis eux aussi dans <strong>la</strong> loi française comme une forme <strong>de</strong> propriété bien supérieure àcelle sur un objet : « [...] ce serait une atteinte aux droits essentiels <strong>de</strong> l’homme si une invention industriellen’était pas vue comme <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong> son créateur » 5 .Par cette conception du droit d’auteur et du brevet à perpétuité, Jobard se fait le chantre <strong>de</strong> <strong>la</strong>sacralisation <strong>de</strong> l’œuvre et <strong>de</strong> l’invention. Car sacralisation il y a : Lamartine, tout à <strong>la</strong> fois politicien influentet incarnation du romantisme français, en sera l’un <strong>de</strong>s promoteurs inspirés. Dans une lettre <strong>de</strong> 1858, ilévoque « <strong>la</strong> plus sainte <strong>de</strong>s propriétés, celle <strong>de</strong> l’intelligence : Dieu l’a faite, l’homme doit <strong>la</strong> reconnaître » 6 .C’est une conception mystique <strong>de</strong>vant <strong>la</strong>quelle le légis<strong>la</strong>teur doit s’incliner. Dieu a fait don du génie àl’inventeur, à l’artiste, pauvres mortels, respectez l’Élu. Dans une version plus <strong>la</strong>ïque, elle donne <strong>de</strong>sarguments aux défenseurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété qui y voient un « droit naturel », où l’être est propriétaire avantd’être humain. Cette forme <strong>de</strong> pensée, inspirée du philosophe John Locke, est alors défendue en France parun ultralibéral avant l’heure, l’économiste Frédéric Bastiat. « L’homme naît propriétaire » 7 , affirmetil. Ce<strong>la</strong>fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété un principe indépendant <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi que celleci doit se borner à entériner et à protéger.Bastiat n’établit pas <strong>de</strong> différence entre propriété littéraire et propriété physique, car « il n’y a pas d’autremanière <strong>de</strong> tirer parti d’un livre que d’en multiplier les copies et <strong>de</strong> les vendre. Accor<strong>de</strong>r cette faculté à ceuxqui n’ont pas fait le livre ou qui n’en ont pas obtenu <strong>la</strong> cession, c’est déc<strong>la</strong>rer que l’œuvre n’appartient pas àl’ouvrier, c’est nier <strong>la</strong> propriété même. C’est comme si l’on disait : le champ sera approprié, mais les fruitsseront au premier qui s’en emparera » 8 .Que Dieu nous gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s jobar<strong>de</strong>ries, car il faudrait aujourd’hui payer <strong>de</strong>s droits à <strong>la</strong> <strong>de</strong>scendance <strong>de</strong>Lamartine pour publier ou copier Le Lac ou L’Immortalité. Il <strong>de</strong>meure néanmoins une trace <strong>de</strong> cette idéedans <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion, il s’agit du droit moral, perpétuel, inaliénable et incessible. Ce droit n’interdit pas <strong>la</strong> copieou <strong>la</strong> publication, mais garantit qu’une œuvre sera toujours attribuée à son créateur originel et qu’elle ne serapas falsifiée. Le droit moral, lien éternel entre une création et son auteur, <strong>de</strong>meure <strong>la</strong> différence fondamentaleentre le droit français et le copyright américain qui ignore cette notion.La création comme « copropriété » ?Il est courant d’entendre <strong>de</strong>s défenseurs du droit d’auteur reprendre cette filiation du « droit naturel »,en le c<strong>la</strong>ssant parmi les droits <strong>de</strong> l’homme. Tout questionnement sur un éventuel « droit du public » seretrouve ainsi disqualifié : le public n’a pas <strong>de</strong> droit sur <strong>la</strong> création, pas plus qu’un promeneur n’a <strong>de</strong> droit surles pommes d’un verger qu’il croise dans <strong>la</strong> campagne. Les prémisses hexagonales <strong>de</strong> ce droit sont souventconvoquées avec <strong>de</strong>s accents tribunitiens, et l’expression « France, patrie du droit d’auteur » sert à ba<strong>la</strong>yertoute prétention à introduire quelque mesure dans <strong>la</strong> conception <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intellectuelle. Au risque <strong>de</strong>détourner <strong>la</strong> réalité historique : même Le Chapelier, défenseur <strong>de</strong>s premières lois françaises, avait conscience
du côté boiteux <strong>de</strong> l’analogie entre propriété intellectuelle et propriété physique. De ses déc<strong>la</strong>rations, onretient souvent sa formule sur « <strong>la</strong> plus sacrée, <strong>la</strong> plus légitime, <strong>la</strong> plus inattaquable <strong>de</strong>s propriétés », déjàévoquée plus haut. Mais il poursuivait ainsi : « C’est une propriété d’un genre tout différent <strong>de</strong>s autrespropriétés. Lorsqu’un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, quis’en empare quand ils sont <strong>bon</strong>s, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s’en pénètre et qui en fait sapropriété ». Pour Le Chapelier, un ouvrage publié est par nature une « propriété publique » 9 . Il s’appuiecomme d’autres sur l’une <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance : celleci n’existe réellement que lorsqu’elleest rendue publique. Pour Proudhon, l’auteur est un « échangiste » : « Avec qui échangetil ? Ce n’est, enparticulier, ni avec vous, ni avec moi, ni avec personne ; c’est EN GÉNÉRAL avec le public » 10 .Dès l’origine <strong>la</strong> « propriété intellectuelle » s’affirme ainsi comme une sorte <strong>de</strong> copropriété,appartenant tout à <strong>la</strong> fois à son créateur et au public auquel elle est <strong>de</strong>stinée, une dualité qui impose <strong>de</strong> penserd’une manière spécifique les droits qui y sont attachés. Si une chanson, un livre ou une inventionn’appartiennent qu’à leurs créateurs, nul besoin <strong>de</strong> garantir quelque droit que ce soit au public. Si <strong>la</strong> propriétéen est accordée tout à <strong>la</strong> fois au créateur et au public, nous voilà au cœur d’un équilibre, et il s’agit <strong>de</strong> définirune tension entre plusieurs droits complémentaires, ou concurrents.De fait, tout au long <strong>de</strong>s débats sur <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intellectuelle, on retrouve face auxdéfenseurs du « droit naturel » une autre interprétation, où <strong>la</strong> propriété accordée aux créateurs estsubordonnées à son utilité sociale : c’est <strong>la</strong> version « utilitariste » <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intellectuelle, en oppositionà <strong>la</strong> version « naturelle ». Les droits accordés au créateur et à l’auteur sont alors issus d’un contrat social.Cette logique est particulièrement c<strong>la</strong>ire aux ÉtatsUnis, où <strong>la</strong> Constitution fixe comme objectif à <strong>la</strong> propriétéintellectuelle <strong>de</strong> « promouvoir le progrès <strong>de</strong>s Sciences et <strong>de</strong>s Arts utiles ». Mais ce serait une erreur que <strong>de</strong>voir là une tradition purement américaine : nombre <strong>de</strong> Français défen<strong>de</strong>nt cette conception, en s’inspirantplus ou moins explicitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradition utilitariste. Victor Hugo luimême rappe<strong>la</strong>it que « le livre, commelivre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient — le mot n’est pas trop vaste — au genrehumain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux droits, le droit <strong>de</strong> l’écrivain et le droit <strong>de</strong> l’esprithumain, <strong>de</strong>vait être sacrifié, ce serait, certes, le droit <strong>de</strong> l’écrivain, car l’intérêt public est notrepréoccupation unique, et tous, je le déc<strong>la</strong>re, doivent passer avant nous » 11 .Biens publics : un phare, une chansonDepuis le XIX e , les lignes <strong>de</strong> front n’ont guère bougé. Les discours les plus conquérants sur le droitd’auteur ou les brevets puisent toujours leur inspiration dans <strong>la</strong> conception « naturelle » <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriétéintellectuelle, telle <strong>la</strong> lettre ouverte d’Aznavour et consorts. Celleci mène à une revendication toujours plusappuyée d’un « droit exclusif » du créateur, ne souffrant ni limite ni exception. En revanche, les discours plusnuancés, qui font appel à <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> propriété collective et soulignent <strong>la</strong> différence profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> nature entre<strong>la</strong> propriété physique et <strong>la</strong> propriété intellectuelle, ont bénéficié d’avancées théoriques autour <strong>de</strong> <strong>la</strong>distinction entre biens publics et biens privés. Une voiture est un bien privé : son <strong>usage</strong> est dit « excluable »et « rival ». Rival car <strong>la</strong> jouissance du bien par un tiers limite ma propre jouissance. Si tout un chacun peututiliser ma voiture, ma propre consommation en sera limitée. Pire : tous ces squatters risquent <strong>de</strong> l’abîmer àforce <strong>de</strong> l’utiliser. Heureusement, <strong>la</strong> nature du bien privé me vient en ai<strong>de</strong> : il est facilement rendu« excluable », autrement dit il m’est assez aisé d’empêcher autrui <strong>de</strong> l’utiliser. Je peux fermer ma voiture àclef, par exemple.Les biens publics, eux, sont « nonrivaux » et « nonexcluables ». La consommation d’un tel bien parune personne n’entrave en rien <strong>la</strong> consommation du même bien par d’autres. L’exemple le plus connu estcelui du phare : sa lumière profite à tous les bateaux, quel que soit leur nombre (nonrivalité). Le phare poseaussi une autre difficulté : comment réserver <strong>la</strong> lumière aux seuls bateaux ayant payé pour en bénéficier(nonexcluabilité) ?L’apport <strong>de</strong> cette distinction entre biens privés et publics est crucial à toute réflexion sur <strong>la</strong>« propriété » <strong>de</strong>s œuvres et <strong>de</strong>s inventions. Car si les objets physiques et matériels sont toujours <strong>de</strong>s biensprivés, les objets immatériels — les œuvres, les connaissances et nombre <strong>de</strong> services — sont en général <strong>de</strong>sbien publics. Certes, dans le domaine culturel, <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s biens est plus ambiguë. Une chanson en tant quetelle s’apparente à un bien public, on peut <strong>la</strong> fredonner <strong>de</strong> mémoire, mais elle se présente au public associée à
- Page 3: Pour la Liberté...Du bon usage de
- Page 7: Du bon usage de laPiraterieCulture
- Page 10 and 11: IntroductionTous piratesTout Hollyw
- Page 12 and 13: combler un « trou » dans la légi
- Page 14 and 15: Nous n’en sommes pas là. La logi
- Page 18 and 19: un bien privé : un CD. Tout comme
- Page 20 and 21: cas de nos chantonneurs et de nos s
- Page 22 and 23: Donnant un pouvoir très fort à so
- Page 24 and 25: très majoritaires à l’époque,
- Page 26 and 27: Chapitre 2Idées reçues« Pour app
- Page 28 and 29: des industries culturelles contre l
- Page 30 and 31: la stratégie adoptée, avec succè
- Page 32 and 33: suivi le procès de Prétoria les a
- Page 34 and 35: et ne doivent pas être brevetables
- Page 36 and 37: 21. Le mécanisme, très complexe e
- Page 38 and 39: propriété privée », écritil.
- Page 40 and 41: L’exemple de la soierie lyonnaise
- Page 42 and 43: propriétaire, mais plutôt que de
- Page 44 and 45: en ligne d’un dessin, d’un bill
- Page 46 and 47: connaissance où abusus est ignoré
- Page 48 and 49: Chapitre 4La connaissance, un lien
- Page 50 and 51: ébullition. Épaulés par les bibl
- Page 52 and 53: White Stripes, il est interdit de l
- Page 54 and 55: Face aux intermédiaires marchands
- Page 56 and 57: 6. Peter Szendy, Écoute..., op. ci
- Page 58 and 59: agressivité, s’inspire bien trop
- Page 60 and 61: différents de gratification des cr
- Page 62 and 63: qui nous la fournit avec le concept
- Page 64 and 65: Chapitre 6La rareté contre l’abo
- Page 66 and 67:
séisme pour les marchands de cultu
- Page 68 and 69:
logiciels, le vivant, mais aussi le
- Page 70 and 71:
des historiens, dont Robert Allen e
- Page 72:
« marché des droits de propriét
- Page 75 and 76:
ÉpilogueUne paire de chaussures Ai
- Page 77 and 78:
BibliographieLivres• BAETENS JAN,
- Page 79 and 80:
• MOGLEN EBEN, « L’anarchisme
- Page 81 and 82:
Annexe A Licence de documentatio
- Page 83 and 84:
Document indique la présence de Te
- Page 85 and 86:
6 REGROUPEMENTS DE DOCUMENTSVous
- Page 87 and 88:
Annexe B Texte original de la li
- Page 89 and 90:
You may also lend copies, under the
- Page 91:
documents in all other respects.You
- Page 94:
Pour la LibertéHackAngel©2009