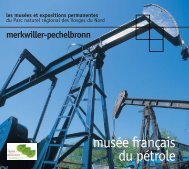Jean Baptiste BOUSSINGAULT 1802-1887 - Musée français du ...
Jean Baptiste BOUSSINGAULT 1802-1887 - Musée français du ...
Jean Baptiste BOUSSINGAULT 1802-1887 - Musée français du ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Les pionniers de l’or noir <strong>du</strong> Pechelbronn(11) JEAN-BAPTISTE <strong>BOUSSINGAULT</strong>(<strong>1802</strong>-<strong>1887</strong>)___________________________________________________________________________CHAPITRE IA Lobsann<strong>Jean</strong> <strong>Baptiste</strong> Joseph Dieudonné Boussingault jettera les bases de la chimie agricole à la ferme LeBel <strong>du</strong> Pechelbronn, dont il avait épousé l'héritière, Adèle. Mais c'est aux mines d'asphalte, de lignite,de vitriol et d'alun voisines de Lobsann, qu'il avait débuté sa prodigieuse carrière. Il trouva à s'yemployer en janvier 1821, dès sa sortie de l'Ecole des mines de Saint-Etienne. Il y cumulera lesfonctions de directeur des travaux et de chimiste, auparavant exercées par Georges ChrétienRosentritt et Charles Denis Lefèbre, tous deux renvoyés. En quelques mois, il redressa l'exploitationet y intro<strong>du</strong>isit les procédés de fabrication de mastic bitumineux de l'usine de Seyssel dans l'Ain.Tous ses « week-ends », il les passait au Pechelbronn, où le clan Le Bel le recevait avec beaucoupd'amitié. Mais devait-il s'enterrer à Lobsann ? Sans doute non. On se proposait de le prendre dansune forge des Vosges. On voulut l'entraîner dans une mission en Egypte, puis dans une autre enColombie, à laquelle il lui fut cependant impossible de résister. Il partit donc fin mai 1821, pour nereparaître que treize ans plus tard.Recherché par la Cie Perrier<strong>Jean</strong> <strong>Baptiste</strong> Joseph Dieudonné Boussingault a été l'un des premiers élèves de l'Ecole des minesde Saint-Etienne, dont Louis Antoine Beaunier (1779-1835), son directeur, avait obtenu la créationpour la rentrée de 1816. Le gouvernement voulait qu'elle se borne à être une école « pour jeunesgens destinés aux travaux des mines », placée sous la dépendance de l'Ecole de mines de Paris.Mais Beaunier, en soignant le recrutement, réussit néanmoins en faire une école d'ingénieurs. Il seraen même temps à l'origine de la première ligne de chemin de fer <strong>français</strong>e, entre Saint-Etienne etAndrézieux.Il veillait personnellement à placer ses jeunes diplômés. Chaque année, il écrivait à toutes lesmines <strong>du</strong> pays pour leur indiquer le nombre de jeunes ingénieurs disponibles. En 1820, la maisonPerrier et Cie, qui exploitait les Houillères de Blanzy (Montceau-les-Mines, Epinac et Decize - LaMachine), fut ainsi parmi les premières à répondre. Elle voulait faire choix d'un candidat qui seraitdisponible tout de suite pour prendre la direction des mines de Lobsann, en Basse-Alsace.Ces mines étaient certes « encore dans leur enfance », mais elles était « susceptibles d'acquérirbeaucoup d'accroissement ». La Compagnie Perrier se proposait d'y extraire le soufre, l'alun et lacouperose. Elle comptait y former un établissement « analogue à ceux de Bouxwiller et deSarrebruck ». Le candidat devait donc également avoir des connaissances en chimie.Le directeur Beaunier proposa <strong>Jean</strong> <strong>Baptiste</strong> Dieudonné Boussingault, jeune homme d'origineparisienne, dont la mère était une fille <strong>du</strong> bourgmestre de Wetzlar. Boussingault accepta, comptantprofiter de cette embauche pour aller visiter sa famille maternelle. « J'aimerai beaucoup aller dansce pays, écrit-il dans une lettre à son père datée <strong>du</strong> 3 juillet 1820. Lobsann est sur la frontière. Je neserai pas loin de Francfort et je pourrai faire un voyage en Wetzlar. Je me suis (déjà) mis àapprendre l'allemand ». Pour commencer, il demanda quinze cents à dix-huit cents francs
d'appointements annuels, ainsi qu'un intérêt fonction des résultats qu'il obtiendrait par la suite. M.Beaunier demanda en outre que lui soient alloués des frais de voyage, afin qu'avant de se rendre surplace il puisse visiter des établissements similaires dans l'Aisne et le Nord.Et si Lobsann ne se concrétisait pas, Boussingault se disposait à aller à Grenoble, à moins qu'il nereste à Saint-Etienne, attaché au laboratoire de l'Ecole ou dans une entreprise, dont M. Beaunier luiavait parlé. Le 25 juillet, toujours pas de confirmation... « Le retard est pour moi désagréable »,écrit encore Boussingault à son père. Ses préférences vont à Lobsann, mais tous ses professeursl'engagent à entrer dans l'entreprise de Saint-Etienne.Puis la confirmation arriva. Petite déception : contrairement à ce qu'avait indiqué le directeurBeaunier, Lobsann ne dépendait pas de la Compagnie Perrier et n'était pas même une houillère.C'était « tout simplement un gisement de lignite, chargé de pyrite, avec lesquels on voulaitfabriquer de l'alun et <strong>du</strong> sulfate de fer. On y exploitait aussi des couches de sables bitumineux, quel'on traitait pour extraire <strong>du</strong> brai minéral. La mine était de peu d'importance et ne donnait aucunprofit ». Boussingault n'aurait donc que des émoluments de douze cents francs, mais il serait logé,chauffé et éclairé. Et ses frais de déplacement et de tournée dans d'autres établissements lui seraientremboursés. Il accepta donc.M. Beaunier l'engagea, avant d'aller en Alsace, de faire un crochet par les mines de bitume deSeyssel dans le département de l'Ain et les vitrioleries des environs de Beauvais, « dans lesquelleson fabriqu(ait) <strong>du</strong> sulfate de fer et de l'alun avec les tourbes pyriteuses ». Louis Georges Gallois, leprofesseur de chimie de l'Ecole, lui remit en outre une lettre de recommandation pour M. Hecht,chimiste distingué et premier pharmacien de Strasbourg, et une deuxième pour M. Joly (en réalité, ilfallait lire : Voltz), ingénieur des mines en chef <strong>du</strong> département <strong>du</strong> Bas-Rhin, en lui promettant delui faire parvenir encore deux autres lettres de recommandation à l'adresse de ce M. Joly.Voyage à piedAinsi donc Boussingault quitta-t-il Saint-Etienne à pied, par la route de Lyon, aux alentours <strong>du</strong> 20août 1820, en compagnie de cinq autres élèves, « tous en uniforme sans broderies, un chapeaurond, le sac sur le dos et le marteau sur la poitrine ».Il fit effectivement un détour par la Picardie et visita les tourbières pyriteuses que lui avaitrecommandées M. Beaunier, puis il revint à Paris, où il resta encore quelques jours. C'est de là qu'ilprit enfin la diligence de Strasbourg, « sa » première diligence. Celle-ci versera et cassera un essieuà Château-Thierry, mais finit quand même par arriver à destination au soir <strong>du</strong> 18 décembre 1820.A Strasbourg, Boussingault fit aussitôt une visite à M. Dournay, « l'un des propriétaires desmines de Lobsann ». « Il m'a reçu avec l'amitié la plus vive et la plus franche, raconte-t-il dans unenouvelle lettre adressée à son père le surlendemain. Je passe mes journées à faire connaissanceavec toute la famille. Je me trouve tout étonné d'entendre parler à l'entour de moi un langage queje ne comprends pas. » Il loge provisoirement chez ses hôtes, derrière le quai St-Thomas, puisqu'ildonne leur adresse pour son courrier : « A M. Dournay, rue de la chaîne, à Strasbourg, pourremettre à M. Boussingault ».Dans ses Mémoires, il ajoute : « La famille Dournay était tout ce qu'il y a de plusstrasbourgeoise. De nombreuses réunions, des repas à n'en plus finir, des montagnes de saucisses,des oies... et une grosse gaieté. La conversation, un mélange d'allemand et de <strong>français</strong>. Leschansons après boire, et l'on buvait beaucoup. La vie large de province était la règle de con<strong>du</strong>ite.Mme Dournay était de Mayence, assez jolie, et, comme trait caractéristique, avait des yeux
perforants. »Boussingault ne connaissait évidemment pas tous les détails de la mine de Lobsann. Félix SébastienAlexandre Dournay était un ancien trésorier des armées napoléoniennes. A ce titre, il avait suivi la campagnede Russie, et dans tous les cas c'était un manieur d'argent. Le 24 novembre 1815, il avait fait un premier prêt de17 000 francs à Rosentritt, puis deux autres encore le 24 septembre 1816 et le 31 mars 1819, soit 21 557,95francs au total, pour permettre à son créanciers et à ses associés, les Srs Daudrez et Gouy, de reprendre lestravaux d'extraction, de construire de nouveaux bâtiments, de payer les salaires et d'acquitter les contributions<strong>du</strong>es à l'Etat.Mais voyant que ces avances avaient été faites en pure perte, il réclama leur remboursement. Le 31 octobre1819, il assigna ses créanciers (1). Ce qui aura pour résultat que le seul actif de Rosentritt et de ses associés, àsavoir la concession minière dite de Cleebourg <strong>du</strong> 28 novembre 1809 et celle dite de Lobsann <strong>du</strong> 30 octobre1815, fut attribué à Felix Dournay par adjudication forcée par le tribunal de Wissembourg le 28 janvier 1820 (2),à l'époque justement où Boussingault prenait son service.Félix Dournay était né à Strasbourg le 25 février 1781 et décèdera à Soultz-sous-Forêt le 8 septembre 1842.Quand il recruta Boussingault, il était dans sa 39e année. En 1811, il avait épousé Christine Koeler, qui était enréalité une native de Wörrstadt, localité de la Hesse rhénane situé à 22 km au sud de Mayence. Elle lui donnera13 enfants, dont six sont décédés en bas âge, mais dont les aînés lui succèderont à la mine.Boussingault alla également voir le pharmacien Hecht : « Je trouvai un gros homme fumant uneénorme pipe, pour s'inspirer, disait-il. » Il avait été préparateur de Vauquelin, et avant d'admettredes jeunes gens dans son laboratoire, il leur demandait pendant sept jours de suite de ré<strong>du</strong>ire unesubstance très <strong>du</strong>re en une poudre très fine dans un mortier d'agate. Jamais aucun candidat nerésistait évidemment à cette épreuve et renonçait pour toujours à l'étude de la chimie.L'ingénieur des mines Philippe Louis Voltz, lui, vivait avec des parents fort âgés, « types deStrasbourgeois protestants ». « Le père, ancien cafetier, était fort considéré. Je fus admis dans lafamille. Voltz était un travailleur infatigable. Rien de plus amusant que le dédain qu'il professaitpour les savants de Paris. Plus allemand que <strong>français</strong>, en parlant des Parisiens, il ne manquaitjamais de dire : c'est l'opinion de la boutique de Paris. C'était un républicain très avancé,intolérant, peu sociable, puritain en religion, au demeurant bon ami, homme sûr. Il avait été lecondisciple de M. Le Boulanger à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole des mines de Moûtiers. Ilobservait bien, rédigeait difficilement, publiait peu. Il serait entré à l'Académie (des sciences), si lamort ne l'eut enlevé prématurément. » Par la suite, Boussingault l'accompagnera dans sesexcursions. Voltz sera pour lui « un excellent maître de géologie ».Après les fêtes de NoëlLes Dournay ne voulurent emmener leur jeune recrue aux mines de Lobsann qu'après les fêtes deNoël, car celles-ci sont très isolées. Il y habiterait « la maison de direction » en compagnie <strong>du</strong>caissier Berger, « un homme très aimable, ancien commissaire de police à Cassel ». Il partageraitavec lui une cuisine, une cuisinière ainsi qu'un domestique. La nourriture lui serait en grande partieaccordée. M. Dournay n'y séjournait qu'en été « avec son aimable famille ». Tous vivraient alorsensemble sur les mines.On aménagerait également un laboratoire pour Boussingault, « de sorte que rien ne (lui)manquerait pour passer agréablement (son) temps ».En réalité, la précédente direction des mines de Lobsann avaient déjà recruté un « chimiste » <strong>du</strong> nom deCharles Denis Lefèbre, qui logeait sur place. Le 3 avril 1819, Marie Joseph Achille Le Bel lui avait même prêté216 francs. Mais s'impatientant d'être remboursé, il l'avait assigné devant le tribunal de Wissembourg. Celui-cine parut pas à l'audience <strong>du</strong> 19 novembre suivant, mais fut néanmoins condamné à payer ces 216 francs, avec lesintérêts de 5 % ainsi qu'une amende de 10 francs pour non-comparution au bureau de conciliation (1). Puis, le 19
ouetteurs terrifiés ». Et l'on entendait bien un bruit sec régulier. Boussingault s'avança vers lataille, mais ne vit rien et n'entendit plus rien. Quand il revint en arrière, le bruit se fit à nouveauentendre. Les quatre mineurs coururent alors à l'échelle pour se sauver. Mais Boussingault attrapaUbinger par le collet et le força à avancer avec lui. Ils découvrirent alors « le petit mineur » : c'étaitdes gouttes d'eau tombant sur une planche portant à faux sur le sol. Si leur bruit avait cesséauparavant, c'est parce qu'elles tombaient sur Boussingault, quand il se tenait sur la planche.La présence de Daniel Ubinger à la mine de Lobsann, comme contre-maître, est déjà attestée en 1819. Il avaitalors été nommé gardien des objets de l'établissement, dont le notaire Petri de Soultz devait dresser l'inventaire.Ubinger a pu arriver à Lobsann dès avant 1816, car à l'occasion de cet inventaire <strong>du</strong> 25 septembre 1819 il donneune indication remontant à 1816 (6).Le 31 août 1821, le tribunal de Wissembourg lui attribuera encore, sur le pro<strong>du</strong>it de l'adjudication forcée <strong>du</strong> 28janvier 1820, une somme de 151,82 francs pour ses 111 jours d'arriérés de salaires. Un ouvrier mineur <strong>du</strong> nomJacques Ubinger (sans doute son plus jeune frère) eut alors un arriéré de 29,52 francs (4).Week-ends de rêve au PechelbronnBerger, le caissier, avait organisé le ménage. Avec lui, Boussingault dépensait peu, tout en vivantbien. Il trompait l'isolement en allant à Soultz et en passant la plupart sinon la totalité de ses «week-ends » aux mines d'asphalte voisines de Pechelbronn.« Leur propriétaire, M. Le Bel, raconte-t-il dans ses Mémoires, me prit en grande amitié. Lafamille était nombreuse. Je passai à Pechelbronn tout le temps dont je pouvais disposer, mesdimanches sans exception. On faisait la partie le soir, j'y couchai souvent.« Le directeur de Pechelbronn, M. Mabru, neveu et beau-frère par alliance, de M. Le Bel, était del'Auvergne, instruit. Il possédait une collection de minerais très intéressante et connaissait bien lagéologie de l'Auvergne. Nous parlions souvent cratères. Une des soeurs de Mme Le Bel, deWissembourg, Mme Piché, jeune et jolie veuve, blonde, courtaude, venait fréquemment. En somme,on menait une vie très agréable au Pechelbronn.« Il y avait deux enfants : Achille, alors en pension à Strasbourg, et une petite fille demi-sauvage,vivant en plein air, Adèle, alors âgée de cinq à six ans. On la laissait courir comme on l'eût faitpour un garçon. Hâlée, cheveux jaunes, jupons d'étoffe grossière, pas élevée <strong>du</strong> tout, ne sachantpas un mot de <strong>français</strong>, telle était alors la jeune personne que j'épousai treize ou quatorze ans plustard et qui est devenue la femme la plus gracieuse, la plus aimable que l'on puisse imaginer. »Boussingault fit également la connaissance à Soultz de Nicolas Marie Tirant de Bury, le maire dela localité, « ancien officier d'artillerie de l'armée d'Italie », de son épouse Sophie DorothéeRoesch-Hohlenfeld, « une caricature » (elle était la fille <strong>du</strong> premier adjoint de Strasbourg GustaveAdolphe Hohlenfeld et la veuve <strong>du</strong> marchand de cuirs <strong>Jean</strong> Roesch), d'un de ses neveux, l'abbéBarrois, qui habitait avec eux au château Geiger et « qui faisait la cour à toutes les femmes », ainsique d'un garde <strong>du</strong> corps qui agissait « dans la même direction ».« Vivent les Alsaciens ! »Boussingault se satisfaisait de son sort. Le 9 février 1821, il écrit à son père pour lui dire qu'iltrouve sa situation « heureuse ». Lobsann et ses alentours sont « un des plus beaux sites del'Alsace ». Les travaux de la mine sont autres qu'il ne le pensait. Ils sont en réalité « immenses » etles galeries « très belles ». Il en a levé le plan général, qui comprenait 34 années de travaux (depuis1788).
Pour son ménage, il avait un jeune domestique et M. Dournay avait placé une cuisinière sur lesmines. A Paris, on lui avait dit qu'il boirait beaucoup de bière. Eh bien, cela ne s'est pas vérifié. Iln'en pas encore goûté. « Je fais usage, dit-il, d'un excellent vin blanc <strong>du</strong> pays. Pour leKirschwasser, j'en bois d'excellent. Je fume <strong>du</strong> tabac qui n'est pas mauvais, à 16 sols la livre. Mesoccupations sont très multiples, car j'ai affaire aux charpentiers, aux serruriers, au ministère de lamarine et aux... brigands. »En revenant de Soultz, avec les dépêches de Strasbourg, son commissionnaire avait en effet étéarrêté la veille à deux lieues de Lobsann par deux hommes qui le fouillèrent. Heureusement, ce soirlà,il n'avait sur lui que deux lettres et <strong>du</strong> pain, alors que le jour d'avant il était porteur de 600 francs.Ils le relâchèrent donc. Boussingault mit néanmoins sa mine en état de siège. De ce jour, il nedormit plus sans avoir mis deux paires de pistolets sur sa table de nuit.Dans la nuit, il fut réveillé par l'ouverture subite de son volet. Ce qui le fit bondir de son lit lespistolets à la main, mais il ne vit rien. Ce n'était qu'un courant d'air. Le lendemain, il apprit que lagendarmerie s'était saisie de 9 brigands, des bohémiens et des déserteurs badois. Elle recherchait lereste de la bande. Mais à la mine, quoique entouré de forêts, Boussingault n'avait finalement rien àcraindre : « il suffirait d'une alerte pour voir sortir mon armée souterraine, qui, à coups de pics etde masses, aurait bientôt détruit la Bohème entière. »Au demeurant, « vivent les Alsaciens ! ». « Je ne donnerais pas un bon Alsacien, écrit encoreBoussingault à son père, pour tous les habitants <strong>du</strong> Midi. Quand je compare les deux pays que j'aisuccessivement habités, quelle différence ! Où me montrera-t-on des villages aussi jolis qu'enAlsace, et cette aisance qui règne chez les paysans ? Chez eux, tout, jusqu'à leur costume, estrecherché. Nos paysans de l'intérieur sont des brutes en comparaison des paysans alsaciens. C'estsurtout dans les villages protestants qu'il faut voir cette propreté extraordinaire et cette instructiongénéralement répan<strong>du</strong>e. »« Je n'ai pas un seul mineur qui ne sache lire et écrire en allemand, et à peine, dans le nombreconsidérable de mineurs existant dans le département de la Loire, en trouverait-on dix qui lisent etqui écrivent leur langue. Même dans la bourgeoisie, les Alsaciens l'emportent sur les Français, etj'ai vu plus d'une fois, dans de riches maisons, la dame occupée à filer. Oserait-on parler à uneParisienne d'une chose semblable, et à plus forte raison à une de nos provinciales ? »Autres réalisationsA la mine, Boussingault aura l'occasion de faire une observation curieuse, qu'il mentionne dansson Economie rurale de 1851. « En 1822, écrit-il, alors que j'exécutais un sondage dans le terraintertiaire, j'eus l'occasion de remarquer que les argiles ramenées par la sonde, de blanches qu'ellesétaient, devenaient très promptement bleues par l'exposition à l'air et qu'en se colorant ainsi, ellescondensaient de l'oxygène » (7).Dans le puits Daudré (il fallait écrire Daudrez, <strong>du</strong> nom de l'ancien associé de Rosentritt), ildécouvrit en outre, au milieu de l'argile une mâchoire fossile, que Cuvier avait décrite. Mâchoirequ'il déposa dans la collection <strong>du</strong> musée de Strasbourg. Il rencontra également beaucoup demorceaux de succin (ambre) dans le lignite et a pu détacher des bois de palmier, transformés enlignite dans <strong>du</strong> calcaire.Plus inatten<strong>du</strong> : c'est lui, qui après des essais, orientera les mines de Lobsann vers la pro<strong>du</strong>ctionde mastic bitumineux, « telle qu'il l'avait trouvée établie à Seyssel » (Mémoires).
Mais la mine de Lobsann était pauvre en livres. Elle n'avait que quelques ouvrages, dontl'Architecture hydraulique de Belidor, « livre excellent, que les notes ajoutées par Navier, dans unenouvelle édition, n'ont pas amélioré ». Heureusement, Boussingault put se rabattre sur labibliothèque de Marie Joseph Achille Le Bel au Pechelbronn. C'était sa « grande ressource » et sonfutur beau-père la mit entièrement à sa disposition. « J'ai lu autant que j'ai pu, raconte-t-il,beaucoup d'ouvrages littéraires, voyages, histoires. Je lisais la nuit, dans mon lit. J'ai conservélongtemps cette funeste habitude » (Mémoires).L'ingénieur militaire <strong>français</strong> Bernard Forest de Bélidor (1698-1761) avait commencé sa carrière commeprofesseur à l'école d'artillerie de La Fère (Aisne) avant de devenir inspecteur général des mines de France. Son« Architecture hydraulique, ou l'art de con<strong>du</strong>ire, d'élever et de ménager les eaux pour les différents besoins dela vie » parut en 1737. Elle utilise pour la première fois le calcul intégral dans la résolution de problèmestechniques. Elle a été pendant longtemps l'ouvrage de référence des élèves de l'Ecole des Ponts et Chaussées.De Bélidor publia également un traité de balistique en 1731, « Le Bombardier <strong>français</strong> », ainsi qu'un« Dictionnaire portatif de l'ingénieur », mais qui n'est qu'une compilation <strong>du</strong> « Dictionnaire d'architecture »d'Augustin Charles d'Aviler. Il a par ailleurs laissé son nom à un système de pont-levis à relevage parcontrepoids-boulets de son invention.Le rapport de l'ingénieur des minesLe rapport d'inspection annuelle <strong>du</strong> 8 août 1821 de l'ingénieur des mines <strong>du</strong> département <strong>du</strong> Bas-Rhin Voltz confirme en tous points les dires de Boussingault. Il relève ainsi que le concessionnairedes mines de Lobsann avait « placé à la tête de cette exploitation un élève de l'Ecole de Saint-Etienne, très instruit et très intelligent ».L'établissement se composait alors de deux mines : celle de lignite avec trois puits (La Paix, LaComète et Daudrez) et celle de malthe (avec un seul puits situé au bout de la galerie principale, quipartait de la galerie d'écoulement de la mine de lignite).Voltz note également l'existence, dans la maison des ouvriers, d'un « laboratoire pour fabriquerle brai minéral » et d'« un four à reverbère pour dessécher le calcaire bitumineux destiné à lafabrication <strong>du</strong> mastic ».« Dans les deux établissements, ajoute-t-il, les procédés et les appareils vont recevoir desperfectionnements notables. Le bitume de Lobsann est plus épais et plus noir que celui dePechelbronn. C'est <strong>du</strong> malthe. Son débit n'est point établi encore, mais il est très probable qu'ils'établira peu à peu. Le concessionnaire veut le verser dans le commerce, principalement à l'étatpur et à l'état de mastic. »« Le bitume pur, mélangé à <strong>du</strong> goudron végétal, sera excellent pour le goudronnage desvaisseaux et des câbles et trouvera probablement un grand débit dans la Hollande, où il pourraarriver par le Rhin, sans frais de transport considérable. Le mastic est d'un excellent usage pourpréserver les murs de l'humidité, joindre et calfater les canaux des usines, rendre les terrassesimperméables à l'eau, faire des tuyaux pour con<strong>du</strong>ire l'eau ou le vent, etc. Ce mastic se fait enmélangeant au malthe un calcaire très bitumineux, qui se trouve entre les bandes de lignite, dans lamine de Lobsann. A cet effet, on dessèche d'abord le calcaire dans un four à reverbère. Celafacilite beaucoup la pulvérisation, que l'on effectue ensuite. Cette dernière opération se fait encoreà la main, mais le concessionnaire va construire un moulin pour la faire plus économiquement. »Enfin, dernière précision : pendant l'année 1820, les mines de Lobsann n'avaient travaillé qu'avec4 à 6 ouvriers (contre 31 en 1817). On n'y avait fait « aucun nouvel ouvrage d'exploitation
proprement dit, si ce n'est pendant les deux derniers mois de l'année ». Mais dès 1823, les mines deLobsann emploieront 43 ouvriers et M. Dournay remportera cette année-là à l'Exposition despro<strong>du</strong>its de l'in<strong>du</strong>strie à Paris une médaille de bronze pour ses fabrications de mastic (8).Boussingault avait donc doté l'exploitation de bases solides, qui la sortirent de l'ornière.Vie uniformeIl n'adressera une nouvelle lettre à son père que le 28 mai 1821. S'il ne lui écrivait pas plussouvent, ce n'était pas par excès d'occupation, bien au contraire. Il a « amplement le temps d'écrire,de lire et de (se) promener ». Sa vie est maintenant « uniforme ». « Chaque jour se passe commecelui qui l'a précédé. »On se proposait de le prendre avec de meilleurs appointements dans une forge dans les Vosgesappartenant à « l'un de nos députés ». Mais il se satisfaisait de son sort à Lobsann. Il a renvoyé laservante-maîtresse des premiers jours. En effet, « comme elle était catholique romaine, elle allaitsouvent soit à la confesse, soit à la messe, de sorte que le service de ma cuisine souffrait. » Il l'aremplacée par une jeune protestante, qui lui fait sa cuisine, raccommode son linge, fait la lessive etlui tricote des bas.« J'ai une maison toute montée, ajoute-t-il. Je suis chauffé, éclairé. J'ai un linge de lit et de table.Je dîne à quatre heures et j'ai toujours trois plats. Par exemple hier, j'ai mangé à mon dîner <strong>du</strong>boeuf, <strong>du</strong> rôti de mouton et de la choucroute avec <strong>du</strong> cochon. Aujourd'hui, le mouton et lachoucroute seront remplacés par <strong>du</strong> veau et des nouilles. Je mange tous les jours un ragoutallemand, mais le plus souvent possible de la choucroute, dont je suis fou. Je bois <strong>du</strong> vin blanc,mais j'ai le projet de faire venir de la bière de Strasbourg. Ensuite, quand M. Dournay vient avecsa petite famille, mon ménage cesse, et je n'en suis pas plus mal. Ma caisse d'épargne est déjàgrosse de 400 francs. »Il comptait alors s'acheter des livres ainsi que de la toile pour se faire des chemises. A la fin del'année, sa cagnotte devrait donc quand même se monter à 600 francs. Mais la mine n'avait toujourspas fait de bénéfices. Ses appointements restaient donc au minimum. Il s'affligeait également de sadifficulté à parler allemand. Sa servante parlait bien <strong>français</strong>, mais lui ne pouvait dire vingt mots desuite. Il se promettait néanmoins d'y travailler. Il n'irait à Wetzlar que lorsqu'il saura l'allemand. Ilécrirait alors à sa mère pour l'inviter à faire le voyage avec lui.Boussingault formule enfin un souhait, mais qu'il ne réalisera jamais : « Je voudrai bien, si,comme il est très probable, je me fixe ici, que maman vînt demeurer avec moi. Elle serait on ne peutmieux pour sa santé, car la forêt est si belle que je n'en puis donner une idée. Les oiseaux font leursnids jusque dans se ateliers. En outre, maman me serait bien utile pour interpréter mes ordres.Ensuite, elle serait près de Wetzlar, car de Wissembourg, il n'y a que 48 lieues. »Boussingault écrira sa quatrième lettre d'Alsace à son père le 25 juin 1821. M. Dournay était alorsvenu s'installer à la mine « avec sa femme et sa petite et très nombreuse famille ». Mais lui-même,« après avoir tant de fois promis de ne pas quitter les bons Alsaciens », commençait à rêver àd'autres horizons. Le vice-roi d'Egypte venait en effet de demander au gouvernement <strong>français</strong> de luifournir « deux hommes instruits dans l'art des mines et la fusion des métaux ». Thibaud, son ancienprofesseur à Saint-Etienne, était partant et avait demandé à Boussingault s'il serait disposé à être soncollaborateur et à sous quelles conditions.S'il s'était trouvé à Saint-Etienne, Boussingault aurait accepté sur le champ. Mais à Lobsann, ilhésitait. « Nulle part, écrit-il, je ne peux mieux me trouver qu'ici. Maman viendrait y passer tous les
étés, et l'hiver à Paris. De Lobsann, nous irions à Wetzlar, etc. Enfin, ici, je puis m'assurer un sorthonorable et avantageux. D'ailleurs, comment quitter M. Dournay ? Je vois bien qu'il y aurait dema part une bien grande ingratitude. » Et cependant, il avait envie de partir. « Il se livrecontinuellement dans ma tête un combat entre l'envie d'aller en Egypte et celle de rester sur lesmines. »La tentation de l'EgypteNouvelle lettre à son père le 24 juillet, pour le rassurer. Il n'irait pas en Egypte en aventurier, maisenvoyé par le gouvernement <strong>français</strong>. Il aurait un traitement de 6 000 francs par an et un grade enrapport avec ses fonctions. Il serait libre à l'expiration de son engagement. Mais il n'arrive toujourspas à se décider : « je suis bien ici (à Lobsann), si heureux, mais si heureux que je me traite de fou,quand je pense à quitter cette bonne Alsace ».« Depuis le beau temps, je ne fais que bien m'amuser. Nous sommes allés aux eaux deNiederbronn. Depuis plusieurs jours, je suis à Strasbourg, où je puis dire que j'ai passé les plusbeaux moments de ma vie. Demain, à cinq heures <strong>du</strong> matin, je pars faire une course dans le pays deBade. J'y resterai plusieurs jours pour voir différents établissements. Je vais faire cette course avecMessieurs Voltz et Hecht, auxquels j'ai été recommandé. »« A mon retour, je séjournerai encore quelques temps à Strasbourg, recon<strong>du</strong>irai quelquespersonnes à la mine et partirai ensuite pour faire une petite tournée sur les frontières de la Bavière.Enfin, après ce voyage, je viendrai me constituer prisonnier à Lobsann pour tout l'hiver, ou bien jeme mettrai en route pour l'Egypte, où selon l'avis que je viens de recevoir il y a des recherchesimportantes à faire de mines de charbon vers les sources <strong>du</strong> Nil. Si j'avais trente ans, si j'avaisseulement vingt-cinq ans, je n'hésiterai pas un seul instant à rester ici. Mais j'ai seulement vingtans. Je suis fort et capable de supporter bien des fatigues. Je pourrai revenir après avoir beaucoupvu. »Mais le projet fit long feu, la mère de Boussingault ayant écrit à tous ses amis d'Alsace pour qu'ilsle dissuadent de se mettre au service <strong>du</strong> pacha d'Egypte. Une seconde opportunité se présentanéanmoins. Par l'intermédiaire de Voltz, Pierre Berthier, le directeur de l'Ecole des mines de Paris,lui proposa d'entrer au service de la Colombie. Il enseignerait à la nouvelle Ecole des mines deBogota avec un traitement de 7 000 francs et « un grade dans les ingénieurs ». Il s'y rendrait à bordd'un navire de guerre, mais à condition de souscrire un engagement de quatre ans. La Colombie lefaisait moins balancer que l'Egypte. « Il y avait des volcans actifs dans les Andes, écrit-il dans sesMémoires. Je ne connaissais que les volcans éteints de l'Auvergne. Je n'hésitais pas à tenterl'aventure. »Il partit donc pour Paris, pour préparer son expédition. La veille, cependant, il coucha encore auPechelbronn. « Papa Le Bel était bien ému, quand il me serra dans ses bras. Mabru m'accompagnajusqu'à Lobsann. » Il fit encore une courte étape à Strasbourg, chez Voltz, qui lui montra quelqueséchantillons de roches, dont des trachytes, qu'il allait rencontrer dans le Nouveau monde. A Paris,où il arriva début juin 1821, il logea chez sa soeur <strong>Jean</strong>nette, rue <strong>du</strong> Roi doré, dans le quartier <strong>du</strong>Marais. Il vit ses parents presque tous les jours. « Mon arrivée était un bonheur pour la famille. Mamère comprenait ma résolution. Elle ne doutait pas <strong>du</strong> succès. »L'expédition partit <strong>du</strong> port d'Anvers le 22 septembre 1821. Sa préparation, entre-temps, avait étéprise en mains par l'explorateur et naturaliste allemand Alexander von Humbolt. Celui-ci voulait enprofiter pour monter sur place un centre scientifique, collectant des données météorologiques etmagnétiques et accueillant les jeunes chercheurs (9).
Aux mines de Lobsann, Félix Dournay remplaça Boussingault par un autre « mineur » de Saint-Etienne, Pierre Joseph Girard. Il put le garder jusqu'en 1832. ©<strong>Jean</strong>-Claude Streicher (septembre 2008)NOTES :(1) ABR : U606.(2) AN : F14 7853.(3) ABR : 7E56.1/105.(4) ABR : U608.(5) AN : F14 4050.(6) ABR : 7E56.2/24.(7) Economie rurale..., 1851, t. 1, p. 611.(8) AN : F14 4050.(9) Friedrich Willian James McCosh : « Boussingault, Chemist and Agriculturist », D. Reidel Publishing Co, Dordrecht,Holland, 1984.
Les parents d'Adèle, de leur côté, avaient constitué en dot pour leur fille, en avancement deleurs successions, un trousseau composé de lits, linge, argenterie, meubles meublants et autreseffets mobiliers, le tout d'une valeur de 25 000 francs. Ils lui firent également donation entrevifs, à titre de préciput et hors part, d'une rente annuelle de 5 000 francs, qu'ils s'engageaient àlui payer à son nouveau domicile, à Lyon ou à Paris, de six mois en six mois, <strong>du</strong> jour de lacélébration de son mariage jusqu'au décès <strong>du</strong> premier mourant des nouveaux mariés.Boussingault n'avait fourni pour ce mariage aucun témoin. Adèle, elle, en amena trois :− Antoine Mabru, 55 ans, toujours « directeur des mines de Bechelbronn ». C'était son onclepaternel et avait déjà été témoin à son baptême ;− son frère « Joseph Achille Le Bel fils, minéralogiste », alors âgé de 28 ans et toujourscélibataire ;− et Hippolyte Nansé, le notaire de Hatten, qui était son cousin germain par alliance (1).Le couple aura trois enfants, dont les deux premiers sont nés au Pechelbronn : BertheGabrielle, née le 9 octobre 1836 ; Joseph, né le 17 juillet 1842 ; et Alice. Marie Joseph AchilleLe Bel et son fils Louis Frédéric Achille ont été témoins pour la première naissance ; LouisFrédéric Achille, pour la deuxième.A l'époque de son mariage, Boussingault ne savait donc toujours pas s'il allait se fixer àLyon ou à Paris. Mais de ce jour, il allait revenir chaque été au Pechelbronn, ce qui le ferabifurquer non pas vers le pétrole, mais vers l’agronomie. L'Ecole des mines de Saint-Etiennel'avait formé à la chimie de Lavoisier et au principe suivant lequel, dans la nature, rien ne seperd, ni ne se crée. Fort cet enseignement, il se piqua de vouloir résoudre les problèmes derendement posés par le vaste domaine agricole des Le Bel, d'identifier les éléments chimiquesdont les plantes et le bétail avaient besoin pour se développer, et les meilleurs moyens de lesleur procurer. Il fonda ainsi une science nouvelle, la chimie agricole, en opposition auxpratiques empiriques qui ne cherchaient pas à comprendre les phénomènes chimiques àl'origine de la croissance ou <strong>du</strong> dépérissement des cultures et <strong>du</strong> bétail.Boussingault suivit cette voie avec d'autant plus de conviction que son beau-frère LouisFrédéric Achille avait eu à l'Ecole des mines de Saint-Etienne la même formation que lui.C'était son cadet de six ans. Il se passionnera autant que lui pour les expérimentations dechimie agricole.Aussi, Boussingault démissionna-t-il en 1837 de la Faculté des sciences de Lyon pourprendre à celle de la Sorbonne la suppléance <strong>du</strong> baron Louis Jacques Thénard (1777-1857),l’inventeur de l’eau oxygénée. En 1839, il entrait à l’Académie des Sciences, dans la sectionEconomie rurale, avant d’être nommé en 1845 à l’une des chaires d’agriculture, dited’Economie rurale (de l’allemand Landwirtschaft), <strong>du</strong> Conservatoire (national) des arts etmétiers à Paris, chaire qui sera changée en chaire de chimie agricole en 1852 et qu'ilconservera jusqu’à sa mort.Mauvaises localisationsMais une assez grande confusion a régné jusqu’à maintenant quant à la nature et surtout lalocalisation des expérimentations menées par <strong>Jean</strong> <strong>Baptiste</strong> Dieudonné Boussingault autour<strong>du</strong> Pechelbronn. Ainsi, Robert Schmitt (par ailleurs historien de la vallée de Munster) écrit-ildans sa notice sur Boussingault <strong>du</strong> Nouveau Dictionnaire de Biographie Alsacienne, que le2
père de la chimie agricole a installé « une ferme modèle » au Liebfrauenberg, dont son épouseavait hérité, alors qu’en réalité cet ancien ermitage des bénédictines de Biblisheim, puis desfranciscains de Haguenau, situé à l’extrémité sud <strong>du</strong> horst <strong>du</strong> Hochwald, n’avait pu mettre àsa disposition qu’un jardin potager et un clos de vigne d'une vingtaine d'ares. Pour RolandSchmitt, le Liebfrauenberg aurait d’autre part été le seul lieu d’expérimentation <strong>du</strong> savant enAlsace, ce qui constitue une seconde erreur.Il commet une troisième confusion en affirmant que les expérimentations faites parBoussingault au Liebfrauenberg ont « abouti à l’œuvre de sa vie, Economie rurale », alorsqu’en réalité cet ouvrage ne synthétise que des travaux menés à la ferme Le Bel <strong>du</strong>Pechelbronn, avant son installation au Liebfrauenberg.Stéphane Jonas, ancien professeur à l’Université Marc Bloch de Strasbourg, historien etsociologue des cités ouvrières alsaciennes et ancien vice-président de l’Association des amis<strong>du</strong> musée <strong>du</strong> pétrole de Merkwiller-Pechelbronn, commet plusieurs autres bévues (2). Il situeles expérimentations de Boussingault (dont celles qui ont prouvé la fixation de l’azoteatmosphérique par les végétaux) dans sa ferme expérimentale de Merkwiller, que de surcroîtil appelle ferme de Pechelbronn. En réalité, la ferme Boussingault de Merkwiller n’a été toutau plus qu’une ferme modèle, que <strong>Jean</strong> <strong>Baptiste</strong> Boussingault avait baillée à un paysan <strong>du</strong> cru.Elle n’a accueilli qu'une seule expérimentation, en 1857, contre des dizaines au Pechelbronnd’abord, puis au Liebfrauenberg.Ces confusions viennent, pour l’essentiel, de Paul de Chambrier. Dans son « Historique dePéchelbronn », celui-ci a en effet couché, page 31, ces lignes qui ont trompé tous seslecteurs : « Ceux qui connaissent Péchelbronn savent qu’à quelques centaines de mètres delà, à la sortie <strong>du</strong> village de Merkwiller sur la route de Woerth, se trouve la fermeBoussingault, où furent faites tant d’expériences restées célèbres dans les annales de lachimie agricole » (3).Bien qu’il n’ignorait rien des puissants penchants agricoles des Le Bel (de Marie JosephAchille, puis de son fils Louis Frédéric Achille), de Chambrier s’était refusé à imaginer qu’ilsaient pu faire de leur domaine <strong>du</strong> Pechelbronn tout à la fois une mine et usine de graissesminérales, une ferme modèle et une ferme expérimentale.Tirons donc au clair (une bonne fois pour toutes ?), le rôle exact joué par chacun des sites<strong>du</strong> triptyque boussingaldien : Pechelbronn, Liebfrauenberg et Merkwiller .L'énigme des vignes <strong>du</strong> SchmalzbergAu Pechelbronn, le premier problème de rendement sur lequel se pencha Boussingault étaitcelui posé par les vignes <strong>du</strong> Schmalzberg à Lampertsloch. Problème d'autant plus rageant queMarie Joseph Achille les avait replantées en 1822 « de plants de France et des bords <strong>du</strong>Rhin » (pinot rouge, noirin rouge, morillon rouge, sauvignon blanc, tokay, raslinger blanc etdoré, traminer et rüländer).Le Schmalzberg est la colline qui enveloppe par le nord-est la cuvette (Loch) de Lampertsloch.D’après son étymologie, il pourrait avoir été le siège d’une très ancienne activité métallurgique, surtoutqu’il se prolonge en amont, en direction des anciennes minières de fer de Lampertsloch, d’un cantonboisé dit Schmaltzrotwald (mot à mot : la forêt défrichée pour la fonderie), et un peu plus loin, à la limitedes bans de Drachenbronn et de Birlenbach, d'un canton dit Schmalzgrub (4). A 3,5 km au nord, de3
l’autre côté de la crête <strong>du</strong> Hochwald, se trouve encore le Schmelzbach, ruisseau descendant de laPfaffenschlick vers Lembach. Ruisseau qui fait pendant au Schmalzbach de Mertzwiller, où le hautfourneauinstallé en 1836 était d'ailleurs appelé d'Schmelz.Le toponyme est évidemment assez fréquent dans l’espace germanique. Il y a un Schmalzberg de 406 md’altitude près de Nuremberg, un autre au sud-ouest de Heilbronn. Celui de Ruckersdorf en Bavière (409m) a été rebaptisé Ludwigshöhe en 1864 en l’honneur <strong>du</strong> roi Louis II de Bavière. On trouve un autreSchmalzberg près de Niedersulz dans le Weinviertel autrichien. Et celui <strong>du</strong> Vorarlberg culmine à 2 345 md’altitude. Dans les légendes germaniques, les Schmalzberg sont généralement habités par des nains,mineurs d’or et de fer. Ce serait le cas notamment dans le Hannoversches Wendland. C'est donc dans lesprofondeurs d’un autre Schmaltzberg que l’écrivain à succès britannique Terry Pratchett (40 millionsd’exemplaires ven<strong>du</strong>s dans le monde) a situé sa cité de nains Uberwald.Avec le temps, le Schmalzberg de Lampertsloch s’était mué en vignoble, puisqu'il est bien exposé etd’un terrain propice. En 1737, la commune y avait érigé un abri pour son garde-vignes (s’Rebhiesel),véritable tour de guet, qui subsiste toujours. Elégamment croquée par Théophile Schuler et Henri Bacher,elle a été restaurée récemment, mais en supprimant la cheminée de briques extérieure.Selon toute probabilité, deux des trois vignes d'un arpent dont Antoine Le Bel avait fait l'acquisition àLampertsloch et Kutzenhausen, se trouvaient au Schmalzberg (5). Son fils Marie Joseph Achille acontinué les acquisitions. Le 16 octobre 1819, il avait ainsi racheté trois parcelles au Schmalzberg :- la première, de 3,75 ares, encore à l’état de terre, pour 60 francs, de Georges Schaeffer,cultivateur à Lamperstloch ;- la deuxième, de 10,5 ares, elle aussi encore à l’état de terre, pour 240 francs, de PierreStephan, laboureur à Lampertsloch et de son épouse Dorothée Claus ;- et la troisième, de 3,5 ares, encore à l’état de verger, pour 40 francs, de Georges Motz levieux, cultivateur à Lampertsloch, toutes parcelles dont il était d’ailleurs déjà limitrophe (6).Au début de 1828, il eut même avec Jacques Jucker, l’un de ses voisins <strong>du</strong> Schmalzberg, une petitequerelle de bornage, au point de devoir demander l’arbitrage <strong>du</strong> juge de paix de Woerth. Ce dernierproposa de faire intervenir Frison, le géomètre de Riedseltz, ce que les deux parties acceptèrent le 5 mars1828 (7).A son décès le 10 mai 1842, Marie Joseph Achille possédait ainsi à Lampertsloch 212,90 ares devignes, pratiquement d'un seul tenant, que ses deux enfants se partageront à parts égales. En comparaison,les villageois ne détenaient que des mouchoirs de poche. En août 1818, au décès de son épouse CatherineSalomé Fettig, <strong>Jean</strong> Georges Bauer n'était ainsi titulaire au Schmalzberg que de 4,2 ares de vignesenviron, coincés entre les parcelles de Georges Reesch, Jacques Schaffner et Georges Stieg (8).Trois ans plus tard, à son propre son décès, le 13 octobre 1821, <strong>Jean</strong> Martin Motz ne possédait pas plusde 2,15 ares de vignes canton Hüttenreben et 4,5 ares canton Weinbühl. A son décès le 5 décembre 1821,le journalier Georges Aprill n’avait qu’un are de vignes canton Schmalzberg. Quant à CatherineThomann, la femme de Michel Jücker, elle ne possédait que 4,21 ares canton Heiligen, qu’elle échangeale 16 mars 1822 contre un pré de même valeur de Georges Michel Claus, autre cultivateur <strong>du</strong> village (9)...Ces vignes donnaient cependant un vin rouge assez fameux, le Lampertslocher Roter, qui ne l’auraitcédé en rien aux Bourgogne. Au 17 e siècle, le comte palatin Christian de Birkenfeld en achetait doncpresque annuellement pour sa table <strong>du</strong> château de Bischwiller. Une chronique rapporte qu’en 1791 cerouge était consommé jusque dans un estaminet de Leutenheim, sur les bords <strong>du</strong> Rhin (11). Encore enoctobre 1884, le Lampertslocher Roter a remporté une médaille d’argent lors d’une exposition agricole àWissembourg. Un dicton le classait parmi les quatre crus les plus réputés de la province : « bei Thanngedeiht der Rangenwein, bei Gebweiler der Kitterle, zu Heiligenstein der Klävener, bei Lampertslochgibt’s guten Schelen » (10).Selon les calculs de <strong>Jean</strong>-Marie Klipfel, le vignoble de Lampertsloch s'étendait sur 20,75 ha en 1719,12,47 ha en 1760, puis 14,57 ha en 1825 et en 1873 (13). En 1899, il était remonté à 16 ha. Mais en 1945,il n’en comptait plus que cinq. De nos jours, il se limite à quelques dizaines d’ares, principalement en vinrouge (11).4
Les vins les plus dissemblablesA en croire Boussingault, la vigne Le Bel <strong>du</strong> Schmalzberg était « bien située ». « Sa cultureest faite avec un grand soin et les procédés de vinification ont toujours été exécutés de lamême manière. Le sol est argilo-calcaire, assez meuble. Il contient de l’argile, <strong>du</strong> sable rougeferrugineux et <strong>du</strong> calcaire, qui s’y rencontre sous la forme de très petits galets. » Les piedsétaient cultivés « en espaliers » (donc en berceau ou Kammerbau), avec des treilles de 1,30 mde hauteur, et avaient commencé à donner <strong>du</strong> vin en 1825.Ils profitaient de 54 quintaux de fumier de ferme par hectare tous les trois ans, soit 9chariots pleins, tirés par quatre chevaux et chargeant 18 quintaux chacun. Et pourtant, lerendement a toujours été des plus imprévisibles : 7,5 hl/ha en 1825 ; 21,8 en 1826 ; 0 en1827 ; 6,1 en 1829 ; 0 en 1830 ; 16,7 en 1831 ; 22,9 en 1832 ; 34 en 1833 ; 45,1 en 1834 ;68,3 en 1835 ; 59,4 en 1836 ; 20,1 en 1837. Le taux d’alcool absolu par hectare était tout aussiinstable : 1,5 en 1833, 4,55 en 1834, 5,60 en 1835 et 4,90 en 1836… Et bien sûr, il en était demême pour la qualité des vins blancs et rouges qui en provenaient. « La vigne <strong>du</strong>Schmalzberg près de Lampertsloch, complète Boussingault, donne successivement les vins lesplus dissemblables » (12).A cause <strong>du</strong> sol ? Du mauvais temps ? Du manque d’eau ? N’était-il donc pas possibled’obtenir des récoltes plus constantes, <strong>du</strong>t demander Le Bel père à son gendre, qui s’était déjàsoucié de rendements agricoles lors de son périple sud-américain ? Ce fut donc, selon touteapparence, en Alsace, le premier problème agronomique sur lequel il eut à se pencher. Apartir des mesures météorologiques de <strong>Jean</strong> Louis Alexandre Herrenschneider, professeur dephysique à la faculté des sciences de Strasbourg (1770-1843), il établit les variations dequatorze paramètres sur quatre années successives (de 1833 à 1836) : époque à laquelle lavégétation a commencé, époque de la vendange, <strong>du</strong>rée de la culture, température moyennependant la culture, température moyenne de l’été, température moyenne <strong>du</strong> commencement del’automne, hygrométrie de Saussure, pluie tombée pendant la culture, pluie tombée avant lafloraison, pluie tombée au commencement de l’automne, vin pro<strong>du</strong>it par la vigne, richesse enalcool, alcool contenu dans le vin et alcool absolu par hectare.Il en dressa un tableau comparatif et dé<strong>du</strong>isit les conclusions suivantes : de toutes lescirconstances, c’est la température moyenne des jours de culture qui influe le plus sur laqualité <strong>du</strong> vin. Elle a ainsi été de 17,3°C en 1834, qui a donné le vin le plus riche en esprit. Etn’a été que de 14,7°C en 1833, qui a pro<strong>du</strong>it le vin le plus médiocre. Quant à la quantité desvins, elle est inversement proportionnelle au volume de pluie tombé pendant la <strong>du</strong>rée de laculture : « la culture, qui a reçu le moins d’eau a donné plus de vin que celle qui a étéexposée à des pluies plus abondantes » (12).Boussingault communiquera ces conclusions à l’Académie des Sciences. Puis l’hebdomadaireL’Institut, journal général des sociétés et travaux scientifiques, qui paraissait tous lesmercredis à Paris depuis 1833, les résuma dans son édition <strong>du</strong> 8 mars 1837. C’est, à notreconnaissance, le premier compte ren<strong>du</strong> publié sur une expérimentation agricole menée parBoussingault dans le Karichschmierländel.Calcul <strong>du</strong> coût annuel d’un hectare de vigne5
Le pli était pris. Le vin et la viticulture ne cesseront d’être son beau souci. En 1847,Boussingault cherchera ainsi à évaluer le coût annuel, tout compris, d’un hectare de vigne surle Schmalzberg de Lampertsloch. Comptabilité, qu’il dévoile dans la seconde édition de 1851de son Economie rurale, dans un chapitre intitulé « Force dépensée dans la culture de lavigne <strong>du</strong> Schmalzberg ».Selon ses calculs, il fallait ainsi prévoir, jusqu’à l’époque des vendanges, 90 jours-hommede travaux : 24 jours de travail à la houe, 12 jours de sarclage, 15 jours de taille etd’enlèvement des sarments, 5 jours de repiquage des échalas ou raccommodage des treilles, 7jours de ligature et d’enlèvement des scions aux échalas, 5 jours de ligature et d’enlèvementdes gourmands, 10 jours de fumure, et 12 jours de plantation de ceps manquants, deprovignage et de travaux accidentels.Pour les vendanges proprement dites, Boussingault a ensuite comptabilisé 22 jours-homme/ha, en une année (1847) où la récolte a été « un peu au-dessous d’un rendement complet ». Ilfallait y ajouter 6 jours pour les transports et 9 jours pour le foulage, la fermentation et lepressurage. En payant un jour d’homme 1 franc, un jour de femme 0,80 franc et un jour decheval 2,50 francs, on arrivait à une dépense de 90 francs/ha pour la culture générale, de27,80 francs pour la vendange, de 15 francs pour le transport sur une distance de 3 km, et de13,05 francs pour la nourriture (pain, fromage, vin et eau-de-vie), soit un total de 154,85francs par hectare.Mais il fallait encore y inclure 31,70 francs pour les supports, les traverses, les échalas etles osiers de ligature ; 4,15 francs de paille ; 90 francs pour 9 voitures de fumier ; 150francs/ha pour l’intérêt à 3 % ; 6,95 francs/ha pour l’intérêt des avances à six mois ; 78,80francs pour l’intérêt à 6 % sur les trois années nécessaires à la fabrication <strong>du</strong> vin ; et 15 francspour l’impôt <strong>du</strong> sol et les frais de surveillance. Soit une dépense totale par hectare de 531,45francs. Avec une pro<strong>du</strong>ction moyenne de 20 hl/ha, le prix de revient d’un hectolitre <strong>du</strong>Schmalzberg était donc de 26,57 francs ! Ce calcul était nouveau pour l’époque, mais ne faitsans doute que transposer à la viticulture la comptabilité minière enseignée à Saint-Etienne.Notons qu’en 1856, Louis Frédéric Achille Le Bel, le fils de Marie Joseph Achille, marquera plus desatisfaction pour ses vignes <strong>du</strong> Schmalzberg. « Elles fournissent des vins rouges et blancs très estimés »,écrit-il dans sa brochure sur les « Rendements moyens des pro<strong>du</strong>its agricoles de la ferme dePechelbronn ». Appréciation, qu’il renouvela en 1866, dans la seconde édition revue et augmentée de cemême fascicule, et cela bien que le vin fut « médiocre » en 1853, de « mauvaise qualité » et de peu dequantité en 1854, comme aussi en 1856 et en 1860. En 1859, par contre, Louis Frédéric Achille avaitenregistré un rendement de 1 482 litres « de bon vin » par hectare, puis de 1 478 litres en 1861. Mais il nementionne que deux cépages : le pinot rouge d’Arbois et le tokay (13).Louis Frédéric Achille Le Bel exposera ses vins blancs et rouges de Lampertsloch au concours régionaldes Comices agricoles de Strasbourg, <strong>du</strong> 26 au 29 mai 1859, avec ses semences de céréales, ses fourrages,ses pommes de terre, son cidre et son eau-de-vie de quetsches (14). Dans « Klein-Gretel », MagdalenaMeyer raconte que vers 1880 les jeunes fils d’Adèle Le Bel, épouse Herrenschmidt, marquaient eux ausside l’intérêt pour les vignes <strong>du</strong> Schmalzberg. Ils y montaient souvent dans une carriole tirée par un âne ouun poney (15).Charles Henri Schattenmann (1785-1869), le directeur des mines de lignite et d’alun de Bouxwiller,était lui aussi viticulteur, mais d’un naturel encore plus hardi. Comme il était natif de Landau, il possédaitdes vignes à Rhodt et Edenkoben, au pied <strong>du</strong> château de Hambach, que Boussingault dit avoir visitées.Schattenmann eut cependant des doutes sur les avantages <strong>du</strong> Kammerbau (vignes en berceau), qui étaitalors pratiqué dans tout le Palatinat, jusque dans le pays de Wissembourg. En 1858, il fit donc arracher sesvignes de Rhodt pour les remplacer par « une culture en lignes et sur souche basse avec palissage en fer6
et fil de fer », de sa conception, moins fatigante pour le vigneron, plus pro<strong>du</strong>ctive et plus économique quele palissage en bois.Mieux ensoleillées, plus proches <strong>du</strong> sol, ces vignes donnaient en effet, un mois plus tôt, deux fois plusde raisins que les vignes voisines restées en Kammerbau. Schattenman les fit visiter à toutes les sociétésd’agriculture des deux rives <strong>du</strong> Rhin. Sur le même mode, il planta au printemps de 1863 à Bouxwillerdeux autres pièces de vignes, qui eurent les mêmes rendements. Il fut ainsi à l’origine, comme il l’écritlui-même, « d’une véritable révolution dans la culture de la vigne » (16).Autres expérimentations viniquesA partir de 1845, Boussingault poursuivit ses expérimentations viniques au Liebfrauenberg.Propriétaire désormais de ses propres vignes au Schmalzberg comme au Liebfrauenberg, ilcommença par faire l’analyse chimique <strong>du</strong> vin rouge de Lampertsloch récolté en 1846 (17).Puis il observa le comportement au gel nocturne <strong>du</strong> vin blanc de son clos <strong>du</strong> Liebfrauenberg(18).En 1848, il voulut ensuite vérifier si la vigne enlève au sol une très forte proportion depotasse, comme semblait l’indiquer la présence constante de crème de tartre dans le vin. Pource faire, il pesa et brûla un échantillon de sarments de ses vignes <strong>du</strong> Schmalzberg. Il en fitensuite analyser les cendres dans son laboratoire (parisien ?) par M. Houzeau. Il analysaégalement la teneur en potasse, soude, chaux, magnésie, acide phosphorique et acidesulfurique <strong>du</strong> marc de raisin de ces mêmes vignes. Conclusion : « la culture de la vignen’exige pas plus de potasse que les autres cultures » (19).Aux vendanges d'octobre 1857, on vint ensuite l'avertir que la fermentation <strong>du</strong> riesling fouléétait montée à une température « extraordinaire » dans une cuve <strong>du</strong> cellier. Y ayant intro<strong>du</strong>itle bras, il ressentit effectivement une chaleur qu'il évalua à 40 ou 45°, alors qu'en réalitépendant six jours le thermomètre ne donnait jamais plus de 26,5°, pour un maximum de 14,8°dans le cellier. Il en fit un article pour le Journal d'agriculture pratique, qui parut le 20 février1858, mais sans oser avancer la moindre explication.En 1868, dans le quatrième volume d’Agronomie, chimie agricole et physiologie, il rendensuite compte d’expériences faites en 1854 sur la fermentation <strong>du</strong> vin rouge de Lampertsloch(p. 50-52), ainsi que de ses observations sur « la fermentation <strong>du</strong> moût de raisin rouge àLampertsloch » (p. 213-214).En septembre 1868, il se pencha également sur la fermentation <strong>du</strong> vin blanc des vignes deLampertsloch. Il avait alors gardé dans la cave, pendant le foulage <strong>du</strong> raisin, 9 litres de moûttrouble, dont il avait séparé les rafles, les pellicules et les pépins « en faisant passer le liquideà travers un panier d'osier ». Mais le 2 octobre suivant, quand la fermentation était achevée, iln'a plus trouvé qu'une quantité impondérable de sucre. Le vin était devenu inactif. C'est doncsur le glucose que le ferment agit d'abord. L'étude cependant ne paraîtra dans Agronomie,chimie agricole et physiologie qu'en 1874 (p. 85-94), dans le cadre d'une étude plus large deson fils Joseph sur la fermentation des fruits, où était également examinée la fermentation <strong>du</strong>miel et des myrtilles.Enfin, pour déterminer la composition de l’air « confiné dans la terre végétale »,Boussingault analysa également (parmi bien d’autres échantillons) le sol extrêmementsablonneux de sa vigne <strong>du</strong> Liebfrauenberg (20). ©7
<strong>Jean</strong>-Claude Streicher (septembre 2008)NOTES :(1) ABR : 7E69.1/63.(2) Stéphane Jonas : « <strong>Jean</strong>-<strong>Baptiste</strong> Boussingault et l’Alsace », Revue des Sciences Sociales de l’Université deStrasbourg, 2004, n° 32.(3) Paul de Chambrier : «Historique de Péchelbronn, 1498-1918», Paris-Neuchâtel, Attinger frères, 1919, 329 p.(4) ABR : 7E56.1/220, acte <strong>du</strong> 17 août 1844, et 7E56.1/253, acte <strong>du</strong> 15 novembre 1852.(5) ABR : 6E40.2/115.(6) ABR : 7E69.1/41.(7) ABR : U2212.(8) ABR : 7E69.2/24.(9) ABR : 7E69.1/45.(10) Georg Weick (Paschali) : « Heimatkunde von Elsass-Lothringen », 5. Auflage, Zabern-i.-Elsass, 1913, p.16.(11) Alfred Sturm : « Un vignoble renommé, un Rebhiesel apprécié », L’Outre-Forêt n° 110, 2 e trim. 2000, p.55-56, d’après Médard Barth : « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebiete seiner Weine », Ed. Le Roux,Strasbourg, 1958, t. 2, p. 84.(12) <strong>Jean</strong> <strong>Baptiste</strong> Boussingault : « Economie rurale considérée dans ses rapports avec la chimie, la physique etla météorologie », 1 ère édition, 1843, t. 1, p. 543.(13) « Rendement moyen des pro<strong>du</strong>its agricoles de la ferme de Pechelbronn », par L. F. A. Le Bel, éditions de1856 et 1864, Wissembourg.(14) Neue Ackerbau Zeitung der Ackerbaugesellschaft und der vier Bezirks-Comitien des Niederrheins, n° 8-9,juin-juillet 1859.(15) Magdalena Meyer : « Klein-Gretel, Bilder aus dem elsässischen Dofrleben », Constance, s.d.,renseignement très aimablement signalé par René Schellmanns, Lampertsloch.(16) Charles Henri Schattenmann : « Mémoire sur la culture de la vigne dans les départements <strong>du</strong> Haut et <strong>du</strong>Bas-Rhin et la Bavière rhénane », 2 e édition, Strasbourg, 1864, 36 p.(17) <strong>Jean</strong> <strong>Baptiste</strong> Boussingault : «Economie rurale... », 1851, t. 2, p. 540).(18) « Observations sur la congélation <strong>du</strong> vin et des mélanges d’eau et d’alcool », Annales de chimie et dephysique, 1849.(19) « Observations sur la quantité de potasse enlevée au sol par la culture <strong>du</strong> vin », Annales de chimie et dephysique, 1850.(20) « Mémoires de chimie agricole et de physiologie », Paris, 1854, p. 325-370.8
Les pionniers de l’or noir <strong>du</strong> Pechelbronn(11) JEAN-BAPTISTE <strong>BOUSSINGAULT</strong>(<strong>1802</strong>-<strong>1887</strong>)CHAPITRE IIIBechelbronn, berceau de la chimie agricoleAprès l'étude des rendements <strong>du</strong> vignoble <strong>du</strong> Schmalzberg, Boussingault s'est attaqué à celle desfumures répan<strong>du</strong>es sur les terres <strong>du</strong> domaine agricole <strong>du</strong> Pechelbronn. En déterminant lacomposition chimique des plantes avant et après ces fumures et celle des fumures dont elles ontprofité, il vit que ces plantes contenaient généralement plus d'azote que ces fumures ne leur avaientapporté. Il en dé<strong>du</strong>it que ce surplus d'azote ne pouvait provenir que de la fixation de l'azoteatmosphérique. Mais sans réussir à expliquer ce phénomène, qu'il a été le premier à identifier. Aprèsces premières analyses, il lancera au Pechelbronn de nombreuses autres expérimentations. Il a ainsiété le premier à établir un laboratoire de chimie expérimentale dans une ferme et doit être considérécomme le père de la chimie agricole. Science nouvelle, dont l'agronome soviétique Prjanischnikow asitué la date de naissance en 1836. De nombreux avis autorisés ont confirmé que le berceau en estbien la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn, et non pas le Liebfrauenberg, où Boussingault a travaillé à partir de1845, ni la ferme modèle de Merkwiller, qu'il avait créée à la même époque.Découverte par hasardCe ne sont évidemment pas ses travaux sur le vignoble <strong>du</strong> Schmalzberg qui ont établi la célébritéde Boussingault, mais les grandes expérimentations qu'il lança ensuite, non pas dans sa ferme deMerkwiller (qui d’ailleurs n’existait pas encore à cette date), mais bien à la ferme Le Bel <strong>du</strong>Pechelbonn, qui, soit dit en passant, s’écrivait encore Bechelbronn (déformation de Baechel-bronn)et que Boussingault désigne par conséquent systématiquement dans cette orthographe. Cesexpérimentations sont à l’origine d’une découverte essentielle : les végétaux (surtout le trèfle, etdans une moindre mesure le froment) fixent également l’azote atmosphérique, et non seulementl'azote apporté par les fumures et les engrais.Cette découverte, Boussingault la fit pour ainsi dire par hasard, à la suite de ses réflexions surl’appauvrissement des sols par les cultures. Le domaine agricole, que les Le Bel avaient constituéautour de leur mine de sables bitumineux, n’était effectivement pas des mieux lotis. Avec ses solsfortement argileux, provenant d’anciennes friches communales, il jugea qu’il constituait « unétablissement très ordinaire ». Mais à force d’y appliquer « depuis de longues années un systèmeinvariable de culture », celui-ci avait tout de même fini par donner des résultats honorables. On ypratiquait depuis 1800 un assolement de cinq ans, de pommes de terre, betteraves, froment, trèfle,navets et avoine, mais qu’il ne fallait pas omettre de soutenir au fumier de ferme. Ces terres,diagnostiquait Boussingault, ne sont « pas foncièrement riches ». «Leur qualité décroîtraitrapidement si l’on cessait de leur rendre périodiquement la dose nécessaire » en fumier.En fidèle disciple de Lavoisier et de son théorème (dans la nature, rien ne se perd, rien ne secrée), il voulut alors déterminer ce que la fumure apportait à chaque culture de l’assolement.S’armant comme Lavoisier de la balance de précision, il commença par analyser trèsméthodiquement la composition chimique de l’engrais répan<strong>du</strong> dans les champs. Il s’agissait d’unfumier de ferme fermenté en tas, rejeté par le bétail des étables <strong>du</strong> Bechelbronn (alors constituéd'une trentaine de chevaux, d'une trentaine de bêtes à cornes et d'une vingtaine de porcs) et mêlé à
de la paille de litière, de la fiente de poule, de la colombine et des balayures de cour.Boussingault analysa tout aussi méthodiquement la composition en carbone, hydrogène, oxygèneet azote des végétaux avant et après les fumures. Puis il compara les trois grilles de résultats.L’exercice, par son ampleur, n’avait pas manqué de l’effrayer. « J’avoue qu’avant de me livrer àces recherches, écrit-il dans l'édition de 1851 de son Economie rurale, j’ai été arrêté un instant parle travail matériel assez rebutant que j’avais à exécuter. Mais je n’ai pas hésité, lorsque j’aicompris qu’indépendamment de la question importante que j’avais en vue, mes analysesprésenteraient encore la composition élémentaire des aliments végétaux les plus usités. »Boussingault ne précise pas le temps qu’il <strong>du</strong>t y consacrer. A l’arrivée, en tout cas, il était clair,que toutes les récoltes de l’assolement contenaient, à des degrés divers, plus d’azote que lesfumures ne leur avaient apporté. Cet azote « en excès » ne pouvait provenir <strong>du</strong> sol. En toute logique,Boussingault supposa qu’il « provient de l’atmosphère ». Mais il ne saura jamais se l’expliquer, caril était impossible que cet azote soit absorbé directement. Pour le comprendre, il aurait fallu qu’ilsoit biochimiste et adepte <strong>du</strong> microscope, et non pas de la seule balance de précision, puisquel'azote est en réalité transformé par des bactéries vivant en symbiose avec les racines des plantes.Boussingault put présenter ses observations à l’Académie des Sciences dès décembre 1838. « Enparcourant (m)es différents tableaux d'analyse, expose-t-il, on reconnaît que constamment l'azotedes récoltes excède l'azote des engrais. J'admets d'une manière générale que cet azote en excèsprovient de l'atmosphère. Quant au mode particulier par lequel ce principe est assimilé, je nesaurai le préciser ». Les Annales de chimie et de physique s’en feront encore l’écho dans leurédition de 1838 (t. 69, p. 366), avant d'y revenir de manière plus exhaustive dans leur volume dejanvier-avril 1841 (p. 208-246), mais sous le titre parfaitement anodin « De la discussion de lavaleur relative des assolements par les résultats de l’analyse élémentaire ».Curieusement, Boussingault n’en parle pas dans la première édition de 1844 de son Economie rurale. Mais ilprésente longuement les résultats de sa campagne de mesures sur la composition chimique des cultures <strong>du</strong>Bechelbronn dans le second tome (p. 163-235) de sa seconde édition de 1851, revue et augmentée, et cela dans lecadre d’un chapitre consacré aux assolements et à l’épuisement des sols, mais sans insister sur la fixation del’azote atmosphérique. Sans doute s'oblige-t-il à la plus grande discrétion sur ce phénomène, n'étant toujours pasen mesure de l'expliquer.Il hésitait finalement entre trois hypothèses, sans pouvoir en démontrer aucune. Il s'en expliquera le 5 février1851, lors d'une séance de la Société centrale d'agriculture de France : « (j'ai) constaté le fait qu'il y a de l'azotefixé dans les végétaux, mais en laissant indécise la question de l'origine de l'azote, si elle tient à l'azote libre, àl'azote de l'air contenu dans l'eau ou bien au carbonate d'ammoniaque contenu dans l'atmosphère » (1). Laplupart des expérimentations qu'il mènera ensuite au Liebfrauenberg viseront à tirer ce problème au clair, maissans succès probant, d'où sans doute son retour à la fin de sa vie aux recherches métallurgiques.Naissance de la chimie agricoleOutre la découverte de la fixation de l’azote atmosphérique par les plantes, ces expérimentations<strong>du</strong> Bechelbronn eurent, devant l’Histoire, un autre immense mérite. Elles ont ouvert la scienceagronomique à l’étude des phénomènes chimiques se trouvant à l'origine de la croissance desplantes comme de la prise de poids et de l'engraissement des animaux de ferme, de la qualité de leurlait et de leur viande, marquant ainsi la naissance de la chimie agricole, de la chimie végétale, de labiochimie, de la chimie des engrais et de la pédologie (science des sols), pour lesquelles sepassionneront ensuite d'innombrables générations de chercheurs, et cela à une époque justement oùles campagnes surpeuplées et routinières ne parvenaient plus à pro<strong>du</strong>ire les nourritures ensuffisance.
Boussingault « a intro<strong>du</strong>it la balance dans l’étude des questions fondamentales de l’agriculture »,souligne ainsi <strong>Jean</strong> Jacques Théophile Schloesing, qui lui avait succédé à la chaire de chimieagricole <strong>du</strong> Conservatoire des arts et métiers (2). Boussingault a créé « le premier laboratoire dechimie dans une ferme », insiste pour sa part l’agronome soviétique, le Pr N. Prjanischnikow (3).Boussingault est « le créateur de la première station agronomique », proclament en 1877 lesdirecteurs des stations agronomiques allemandes à l’occasion de leur congrès de Möckern en Saxe,dans une motion qu’ils ont télégraphiée à leur père spirituel, alors en séjour au Liebfrauenberg (4).Et cette première station agronomique a été Pechelbronn. « Pechelbronn fut la première stationagronomique, dont devait sortir tout l’édifice de l’enseignement et de la recherche agronomique enFrance », confirme le Pr Ernest Kahane (5).L'oeuvre de Boussingault, ajoute Pierre Paul Dehérain, membre de l'Académie des sciences,professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris et à l'Ecole nationale supérieure agronomique deGrignon, est « impérissable ». « En appliquant les procédés rigoureux de la Chimie analytique àl'étude des questions agricoles, il a posé sur un sol solide, inébranlable, les bases d'une Sciencenouvelle : la Chimie agricole date de lui. Quand il commença, elle en était encore auxtâtonnements des débuts. A la fin de sa longue vie, M. Boussingault a pu voir les procédés derecherches qu'il a imaginés partout employés ; ses idées contrôlées par des milliers d'expériences,enseignées dans tous les cours ; la Science agricole enfin assez sûre d'elle pour guider lespraticiens et les con<strong>du</strong>ire au succès. »Son « influence a été immense. En appliquant d'abord les procédés de l'analyse élémentaire àl'étude des fourrages, puis en comparant leur composition à celle des pro<strong>du</strong>its rejetés, il a pu, pourla première fois établir sur des bases précises les phénomènes de nutrition. En analysant de mêmeles engrais intro<strong>du</strong>its dans le sol et les végétaux recueillis, il a encore posé l'équation que nousnous efforçons toujours de résoudre entre l'azote intro<strong>du</strong>it et l'azote recueilli » (6).Mais Boussingault, ainsi qu'il l'indique lui-même, n'aurait pu tenir ce rôle, si la ferme <strong>du</strong>Bechelbronn n'avait pas été tenue avec rigueur et régularité. Sans ce socle de stabilité, créé parMarie Joseph Achille Le Bel et continué par son fils Louis Frédéric Achille, aucun résultatscientifique crédible n'aurait sans doute pu être établi. La ferme, que Boussingault créa ensuite àMerkwiller, n'eut jamais cette rigueur ni cette régularité, d'autant que lui-même n'y résidait jamais.A la différence de la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn, il était donc impossible qu'elle devienne une fermeexpérimentale.Datation soviétiquePendant longtemps, cependant, les innovations <strong>du</strong> père de la chimie agricole n’avaient pas étédatées, à la seule exception de <strong>Jean</strong>-Jacques Théophile Schloesing, son successeur au Cnam, qui lesa situées dans une séquence temporelle finalement assez courte. « L’espace de trois années de 1836à 1839 avaient suffi (à Boussingault) pour accomplir sa tâche », avait-il déclaré dans le discoursqu’il prononça au Cnam le 7 juillet 1895 pour l’inauguration de son monument (2).C’est seulement pour le centenaire, que l’agronome soviétique Prjanischnikow proposa de retenirl'année 1836, comme date de naissance de la chimie agricole et cela dans un long article qu’il fitparaître le 30 mai 1936 dans le quotidien moscovite Les Izvestia (3). Celui-ci eut d’autant plus deretentissement qu’à Paris personne n’y avait songé.Aussitôt, l’Association <strong>français</strong>e pour l’étude <strong>du</strong> sol décida d’en publier la tra<strong>du</strong>ction <strong>français</strong>edans le numéro d’octobre 1936 de son propre bulletin. A la hâte, elle organisa également une
« Commémoration <strong>du</strong> centenaire de la chimie agricole ». Celle-ci eut lieu à Paris le 30 octobre1936. Elle commença par un déjeuner amical au restaurant Félix Potin. Puis l’on parcourut en car,avec plusieurs de ses anciens élèves (dont Achille Müntz, le fils <strong>du</strong> notaire de Soultz-sous-Forêts),les lieux que Boussingault avait naguère fréquentés : le 49 de la rue d’Anjou où il s’était éteint ; le22 de la rue de la Parcheminerie, où il avait grandi ; le 8 de la rue <strong>du</strong> Pas de la Mule, entre la placedes Vosges et le boulevard Beaumarchais, où il avait habité ; le cimetière <strong>du</strong> Père Lachaise, où il aété enterré ; et le Conservatoire des arts et métiers enfin, où il avait enseigné et mené une partie deses recherches, et où Désiré Doyen, le président de l’association, prononça un discours solennel (7).Sur place, au Pechelbronn, il n’y eut rien. Deux ans plus tôt, toutefois, le 7 juillet 1934, lespédologues de l’Association internationale de la science <strong>du</strong> sol, fondée à Rome en 1924, s’étaientdéjà ren<strong>du</strong>s solennellement à la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn, et non pas à la ferme Boussingault deMerkwiller, pour honorer la mémoire <strong>du</strong> père de la chimie agricole. Leur rencontre avait réuni 37personnes, épouses comprises, ainsi que permet de l’établir la photo souvenir prise devant lechâteau Le Bel (8).Cette date de 1836 est établie de manière irréfutable par la seconde édition d’Economie rurale,l'ouvrage phare de Boussingault, qui fait en effet démarrer à cette date ses analyses chimiques surl'apport des fumures dans les assolements. Elle n'est devancée par aucun autre établissement dans lemonde, ainsi que le confirme F. W. J. McCosh, le biographe américain <strong>du</strong> père de la chimieagricole. « In the case of Bechelbronn, écrit-il, there is no doubt that it started in 1836 as anexperimental station in the modern sense of the term, having priority in time over Rothamsted inEngland, opened in 1843, and Moeckern in Germany in 1852 » (8).Autres témoignagesNous pourrions évidemment multiplier les citations d'auteurs autorisés, qui confirment la placeéminente, sinon la première, occupée par la ferme Le Bel <strong>du</strong> Pechelbronn, et non pas leLiebfrauenberg ou la ferme Boussingault de Merkwiller, dans la science agronomique.Mentionnons tout de même l'agronome Auguste Chevalier (1809-1868), qui écrit : « Nul autreétablissement (que la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn) n'aura fourni un plus grand nombre d'éléments, ni deséléments plus importants à la science, qui préparent en ce moment l'avenir de l'agriculture<strong>français</strong>e. Là, tout est étudié par des méthodes précises. Tout se pèse, tout s'analyse, tout setransforme en résultats numériques, précis et comparables » (9).Léonce Lavergne, qui a été professeur d'économie rurale à l'Institut agronomique de Versailles de1850 à 1852, ajoute : « Le nom de la ferme de Bechelbronn marquera au moins autant que Roville(la ferme modèle créée par Mathieu de Dombasle au sud de Nancy) dans l'histoire de l'agriculture<strong>français</strong>e. Boussingault y a fait des expériences célèbres qui sont devenues le point de départ de lanouvelle science agricole. Ses découvertes chimiques et physiologiques sur la composition desvégétaux, leur mode de nutrition, l'action des engrais, la formation de la viande ont donné enfin desbases positives à ce qui n'était avant lui qu'un douteux empirisme » (10).Dans son Cours d'agriculture, le comte de Gasparin avance pour sa part : « M. Boussingaultvoulut compléter la démonstration par les résultats de la pratique en grand. Tous les pro<strong>du</strong>itsagricoles d'une ferme (Bechelbronn) furent, pendant plusieurs années, soumis à l'analyse, ainsi queles engrais fournis aux terrains, et c'est de cette grande expérience que l'on peut véritablementdater l'époque de l'établissement définitif de la théorie agricole » (11).Plus récemment, Nathalie Jas, maître de conférences à l’Université d’Orsay et historienne des
echerches agronomiques franco-allemandes, a écrit : « Quand Boussingault commence à travaillerdans le domaine de la chimie agricole en 1836, on ne savait même pas que le foin contient del’azote. En 1876, quand il s’arrête, les connaissances sur le cycle de l’azote et sur les réactionschimiques peuvent apparaître comme gigantesques face au point de départ » (12).D'ailleurs Boussingault ne disait-il pas lui-même à son élève Dehérain, que lorsqu'il commençases recherches agronomiques au Pechelbronn « il n'existait pas une seule analyse d'engrais » (13).Les agronomes allemands en convenaient eux-mêmes. En 1877, à l'occasion de leur congrès annuelà la station agricole de Möckern, près de Leipzig, ils expédièrent à Boussingault le télégrammesuivant : « au premier chimiste agricole, ses continuateurs adressent un chaleureux vivat ».Autres calculs des rendementsEn 1839, Boussingault avait également intro<strong>du</strong>it au Bechelbronn la culture en continu <strong>du</strong>topinambour, donc hors assolement et en le fumant au marc de pommes à cidre ou au fumier deferme. Il en calcula le rendement. Dans un terrain « peu profond », celui-ci pouvait atteindre 26 440kg de tubercules et 1 410 kg de tiges sèches par hectare. Il en analysa la composition chimique et enrecommandait la culture, car le topinambour pouvait suppléer à bon compte les pénuries, encoreassez fréquentes, de fourrages et de pommes de terre.« Habilement secondé » par Louis Frédéric Achille, le père de la chimie agricole calculafinalement le rendement à l’hectare de toutes les céréales (blé, froment, avoine, seigle, maïs…)cultivées au Bechelbronn, de même que celui des pommes de terre, des betteraves champêtres et despois jaunes, jusqu’à celui des pruniers de Kutzenhausen. Curieusement, à 12 800 kg en moyennepar ha, celui des pommes de terre était inférieur à celui généralement donné alors pour l’Alsace (de19 à 20 000 kg/ha). Boussingault vit aussi que le rendement <strong>du</strong> froment variait en fonction de lasole qui le précédait : 17 hl/ha après la pomme de terre ; 15 hl/ha après la betterave ; et 21 hl/haaprès le trèfle rompu… Il alla jusqu’à faire compter le nombre d’épis par m² : 380, cantonEbersbronn à Lampertsloch, contre 410, canton Reitling à Kutzenhausen !En 1841 et 1842, il analysa la composition chimique des cendres <strong>du</strong> foin provenant des prairiesdes rives de la Sauer, que les Le Bel possédaient à Durrenbach. En 1842 et 1843, il chercha àévaluer l'action <strong>du</strong> plâtrage sur le froment, le seigle, l'avoine et les betteraves, avec chaque fois deuxlots, l'un plâtré, l'autre non plâtré, concluant que le plâtre ne pro<strong>du</strong>it aucun effet appréciable,contrairement aux théories de l'allemand Justus Liebig, qui prétendait que le plâtre fixaitl'ammoniaque de la pluie.Il analysa les cendres de trèfle non plâtré et plâtré, constatant pour le sulfate de chaux une petitedifférence de teneur : 6 % dans le trèfle non plâtré et 5,7 % dans le trèfle plâtré. Il fit aussi l’analysechimique exhaustive des fumiers ainsi que des substances salines apportées aux cultures par l’eaupotable donnée aux animaux. Il calcula que les fumiers <strong>du</strong> Bechelbronn accumulaient plus de 100kg de sels alcalins. Pour abreuver les animaux ou pour irriguer les prés, on gagnait donc à préférerl’eau qui sera « la plus riche en sels alcalins, sans cesser d’être potable ».Il calcula qu’un chariot attelé de quatre chevaux, utilisé pour épandre le fumier de ferme <strong>du</strong>Bechelbronn contenait 1 818 kg de matière humide ou 376,33 kg d’engrais complètement sec. Lapremière sole en recevait 27 voitures par hectare, soit 49 086 kg de matières humides ou 10 161 kgd’engrais sec. Les champs de topinambour, par contre, n’en recevaient que 25 voitures/ha tous lesdeux ans, soit 45 450 kg de matière humide.Le fumier de ferme était parfois complété d’« une forte dose de cendres de tourbe et de plâtre ».
La sole de trèfle de première année recevait ainsi 5 m³ de cendres de tourbe. La sole de deuxièmeannée en recevait autant au commencement <strong>du</strong> printemps, soit au total 10 m 3 pesant 5 000 kg. Letrèfle de deuxième année recevait également <strong>du</strong> plâtre, mais Boussingault le trouvait « parfaitementinutile ».Toutes ces mesures lui permirent d’établir à Paris, avec son collègue Payen, un tableau deséquivalences des engrais selon leur dosage en azote et en acide phosphorique (où le fumier deBechelbronn est d'ailleurs mentionné en premier), de même qu’un tableau des équivalents nutritifsdes aliments <strong>du</strong> bétail, premiers <strong>du</strong> genre (14).Le sablage <strong>du</strong> RummelDans son Economie rurale de 1851, Boussingault rend également compte de son expérience desablage d'un terrain de 2,29 hectares <strong>du</strong> Rummel, donc de l'ancien communal de Kutzenhausen, deplus de 7 ha de superficie, qui flanquait le domaine <strong>du</strong> Bechelbronn au sud-est. Le père de la chimieagricole voulut par là en rehausser la nature assez ingrate. « Nos terres de Bechelbronn, explique-til,sont généralement fortes. Nos sols tenaces restent impraticables aux attelages pendant une tropgrande partie <strong>du</strong> printemps, quand ils n’ont pas été suffisamment séchés en mars et en avril par unvent impétueux venant de l’Est. »Précédemment, il avait déjà pu « considérablement améliorer » les jardins <strong>du</strong> domaine en yrépandant des sables lavés provenant de l’usine de graisse minérale. Il en fit donc de même pour leRummel sur une hauteur de 5 cm. Pendant la saison d’hiver, il en fit porter, selon ses calculs, 1 010m 3 . La distance à parcourir, heureusement, était courte (environ 200 m). Neuf cent quinzechargements, très exactement, <strong>du</strong>rent y être consacrés. Il en coûta 214 journées de chevaux (soit 321francs) et 161 journées d’ouvriers (soit 148,94 francs). La dépense totale était donc de 469,94francs, soit 213,60 francs par hectare.Elle n’a pas été inutile, puisque l’année suivante le trèfle <strong>du</strong> Rummel fut le seul à résister àl’extrême sécheresse de 1840. Mais l’opération aurait évidemment été moins avantageuse, admetBoussingault, s’il avait fallu amener le sable sur une plus grande distance.Charles Henri Schattenmann, le directeur des mines de Bouxwiller, réemployait lui aussi son minerailessivé. Celui-ci avait même l’avantage de contenir <strong>du</strong> sulfate de fer, qui ajouté au purin en arrêtait lafermentation et en changeait le carbonate d'ammoniaque, sel volatile, en un sel fixe et stable, le sulfated'ammoniaque, très fertilisant pour les prairies. Il était donc très apprécié des cultivateurs, à qui Schattenmannl’offrait gratuitement. Des cultivateurs lorrains venaient en prendre jusque dans un rayon de 30 à 40 km. Et biensûr, Schattenmann épandait lui-même <strong>du</strong> purin ainsi traité sur ses prairies, ce qui avait pour effet de doublerquasiment son rendement de foin à 66,5 kg/are, pour une dépense de 125 litres de rési<strong>du</strong>, soit 60 centimes par areseulement (15).C'est donc auprès de Schattenmann que Boussingault se procura les sels minéraux que réclamaient sesexpérimentations. En 1845, il lui commanda « une quantité considérable de phosphate de chaux, déjà dissousdans l'acide phosphorique », et qui était un sous-pro<strong>du</strong>it de sa fabrique de colle d'os. Il comptait en extraire del'acide phosphorique, « phosphate double, plus avantageux que les autres sels ammoniacaux comme engrais ».C'était pour continuer une première expérimentation, où il avait planté <strong>du</strong> maïs hâtif dans deux séries de vases degrès, mais dont la deuxième était ajoutée de phosphate ammoniaco-magnésien, et qui de ce fait avait donné auquatrième mois <strong>du</strong> maïs une fois et demi plus haut et deux épis complets deux fois plus gros au lieu d'un (16).Recherches sur l’alimentation <strong>du</strong> bétailLa pénurie de fourrage, qui suivit la grande sécheresse de 1840, avait obligé les Le Bel àremplacer, dans leurs écuries <strong>du</strong> Bechelbronn, une grande partie <strong>du</strong> foin par des pommes de terre.
Aussi, Boussingault décida-t-il de relancer ses recherches sur les équivalences des aliments pour lebétail. Il établit que pour être en bonne condition les chevaux d’attelage <strong>du</strong> Bechelbronnréclamaient chaque jour 10 kg de foin, 2,50 kg de paille et 3,29 kg d’avoine. Puis il voulut connaîtreles effets de modifications dans ces rations. Il remplaça la moitié de la ration de foin par despommes de terre légèrement cuites à la vapeur. Puis il remplaça 5 kg de leur ration de foin par 14kg de tubercules de topinambours coupés en tranches ; puis par 14 kg de pommes de terre, pendantqu’un attelage témoin de quatre chevaux continuait d’être nourri normalement.Il remplaça également l’avoine et la paille de la ration ordinaire par 7,1 kg de foin. Puis, il yintro<strong>du</strong>isit successivement des betteraves, <strong>du</strong> rutabaga, des carottes et <strong>du</strong> seigle cuit, enremplacement de l’avoine. Cette expérimentation <strong>du</strong>ra onze jours, au terme desquels il pesa lesdeux attelages pour déterminer si leur masse avait divergé. Il répéta ensuite ces essais, dans lesécuries de l’Ecole militaire à Paris. A partir de 1875, et à la demande <strong>du</strong> ministère de la guerre, sonélève Achille Müntz les reprendra, à plus grande échelle encore, dans les écuries de la Compagniedes omnibus de Paris (17).En 1847, en tout cas, Boussingault en vint à la conclusion que « dans le cas où le trèfle viendraità manquer, on pourrait utiliser le topinambour comme sole de fourrage vert ». Il démontra que letopinambour renferme la même quantité nutritive que la pomme de terre.Cherchant également à améliorer le rendement des bêtes à cornes, il calcula la matière grassequ’une vache consommait et pro<strong>du</strong>isait dans son lait pendant quatre jours. Il conclut que « la vacheextrait de ses aliments (betteraves, foin, paille) presque toute la matière grasse qu’ils renferment etqu’elle convertit cette matière grasse en beurre ». En changeant les rations trèfle/foin, il admit que« le trèfle vert n’augmente pas sensiblement la pro<strong>du</strong>ction de lait chez les vaches », « que la naturedes aliments consommés n’exerce pas une influence bien marquée sur la quantité et la constitutionchimique <strong>du</strong> lait (je ne dis pas sur la qualité), si les vaches reçoivent les équivalents nutritifs de cesdifférents aliments ».Boussingault mesura aussi le poids d’un veau nourri au lait à sa naissance, à 13 jours, puis à 46jours. Il calcula qu’au Bechelbronn les veaux consommaient environ 300 litres de lait au pis de leurmère pendant leurs 42 jours d’allaitement. Il a cherché à savoir si la nature des aliments consomméspar les vaches avait une influence sur la quantité et la constitution chimique de leur lait. En1840-1841, puis de nouveau en 1843-1844, il calcula le rapport entre fourrages consommés etfumier extrait de la fosse <strong>du</strong> Bechelbronn.Dans le courant de l’hiver 1849, et en son absence, Louis Frédéric Achille Le Bel se chargea dedonner à ses vaches <strong>du</strong> foin non fermenté, puis <strong>du</strong> foin fermenté, à la suite de quoi il compara leurgain en poids ainsi que leur pro<strong>du</strong>it en lait comme en fumier humide. Comme on pense, cettedernière expérimentation n’a guère plaidé en faveur des fourrages fermentés.A la ferme <strong>du</strong> Bechelbronn, Boussingault voulut également élucider les mécanismes <strong>du</strong>développement de la graisse chez les animaux. Pour cette étude, par contre, il prit la dizaine deporcs de la porcherie, située au fond de l'arrière-cour, pour cobayes. En 1841-1842, il quantifia lanourriture qu'ils prenaient depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur croissance et aboutit à laconclusion, nouvelle pour l'époque, que « les animaux n'engraissent pas par assimilation directe dela graisse des aliments ». Une seconde expérimentation en 1844 lui permit de « rejeterdéfinitivement l'opinion de l'assimilation directe de la graisse des aliments » (18).Recherches sur l’influence <strong>du</strong> sel
Boussingault, enfin, a été le premier au monde à vouloir « déterminer l’influence que le sel,ajouté à la ration, exerce sur le développement <strong>du</strong> bétail ». Il en présenta les résultats à l’Académiedes sciences le 25 octobre 1847, puis les publia dans trois volumes des Annales de chimie et dephysique (t. 19, 20 et 22) des années 1847 et 1848.Dans une première expérience, il rationna deux lots de trois jeunes taureaux <strong>du</strong> Bechelbronn àraison de 3 kg de foin par jour pour 100 kg de poids vivant. Les animaux furent ensuite nourris àdiscrétion, avec une partie de leur ration donnée en betteraves. Le premier lot continua de recevoir102 g de sel par jour, mais le second lot aucun. A la fin, le lot des trois jeunes taureaux qui avaitreçu <strong>du</strong> sel pesait 480 kg, et celui qui n’en avait pas reçu : 452 kg.En l’absence de Boussingault, Louis Frédéric Achille Le Bel dirigea ensuite seul la seconde partiede l’expérimentation. Celle-ci consistait à calculer les consommations en eau, foin, regain etbetteraves des deux mêmes lots de taureaux, <strong>du</strong> 13 novembre 1846 jusqu’au matin <strong>du</strong> 11 mars1847, soit pendant 117 jours, l’un recevant <strong>du</strong> sel à discrétion (il en consomma 12 kg), l’autre enétant entièrement privé. Résultat : le lot qui avait eu <strong>du</strong> sel avait absorbé plus d’eau, de foin, deregain et de betteraves que le lot qui n’en avait pas reçu. Mais les deux lots avaient fait le mêmegain en poids (138 kg).Conclusion : « le sel ajouté à la ration administrée à discrétion n’a pas eu d’effet appréciable surle développement des jeunes taureaux » (20). Mais Alix, l’un des trois taureaux <strong>du</strong> lot sans sel futsaisi d’une grave affection intestinale. On <strong>du</strong>t le mettre à la diète, lui faire des injections émollientesà base de gingembre et lui donner des boissons mucilagineuses. Ce qui lui fit perdre rapidement 40kg.Le troisième volet de l’expérimentation, toujours sous la responsabilité de Louis Frédéric AchilleLe Bel consista à évaluer « l’influence que le sel ajouté à la ration des vaches peut exercer sur lapro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> lait ». Mais il n’y eut cette fois qu’un seul cobaye : la vache n° 18 de l’étable <strong>du</strong>Bechelbronn, appelée Juno et « appartenant à la race de Schwitz ». Considérée comme « une bonnelaitière », elle avait fait deux veaux le 1 er mars 1847. Pendant 21 jours, <strong>du</strong> 29 avril au 19 mai 1847,elle ne reçut pas de sel. Son poids se maintint à 493 kg et elle donna 7,9 litres de lait par jour, soit40,39 litres pour 100 kg de foin consommé. Puis, <strong>du</strong> 20 mai au 15 juin 1847, elle put consommer <strong>du</strong>foin à discrétion, ajouté de 60 g de sel marin par jour. A l’issue de ces 27 jours, elle pesa 498 kg.Elle avait donné 7,93 litres de lait par jour, soit 40,04 litres pour 100 kg de foin de consommé.Conclusion de Boussingault : « dans cette expérience, l’influence <strong>du</strong> sel a été nulle, tant sur lapro<strong>du</strong>ction de lait que sur la consommation de fourrage ». « Ces recherches, enchaîne le père de lachimie agricole, montrent que le sel est loin d’exercer sur le développement <strong>du</strong> bétail, sur lapro<strong>du</strong>ction de la chair, l’influence qu’on est généralement porté à lui attribuer (…). Si le sel ajoutéà la ration a eu un effet peu prononcé sur la croissance <strong>du</strong> bétail, il paraît avoir exercé une actionfavorable sur l’aspect et les qualités des animaux » (20).Ces expérimentations sur l'alimentation des herbivores sont sans conteste les premières <strong>du</strong> genre.M. de Béhague, en effet, ne lancera les siennes à Dampierre qu'à partir de février 1847 (21).Premières analyses des bitumesBoussingault analysa également la composition chimique <strong>du</strong> bitume <strong>du</strong> Bechelbronn. C’est uneautre première, car l’absence d’analyse chimique avait empêché les minéralogistes d’établirjusqu’ici une classification claire des pro<strong>du</strong>its pétroliers.
Sa première analyse remonte à 1836. Il put la présenter à l’Académie des sciences à la séance <strong>du</strong>19 septembre, quelques mois avant d’y exposer ses premiers travaux sur la vigne <strong>du</strong> Schmalzberg.Pour cette analyse, Boussingault compara le bitume <strong>du</strong> Bechelbronn à l’asphalte de Coxitambo auPérou. Il donna le nom de « pétrolène » au carbure d’hydrogène qu’il a obtenu en distillant notrebitume avec de l’eau. Ce pétrolène contenait 0,885 de carbone pour 0,115 d’hydrogène. Il conclutqu'il « est par conséquent isomérique avec les huiles essentielles de térébenthine, de citron et decopahu ». Il en calcula également la composition atomique : 80 atomes de carbone pour 64 atomesd’hydrogène.Il vit que le bitume <strong>du</strong> Bechelbronn contenait en outre « une substance noire solide, absolumentinsoluble dans l’alcool et soluble de l’éther ». Il lui donna le nom de « asphaltène », parce que cettesubstance colorante forme « la base de l’espèce minérale que les minéralogistes décrivent sous lenom d’asphalte ». Cet asphaltène était composé de 0,753 de carbone, de 0,099 d’hydrogène et de0,148 d’oxygène, composition qu’il représenta par la formule C 80 H 64 O 6 . Purifié par l’éther, lebitume de Bechelbronn ne paraît donc être selon lui qu’un mélange de pétrolène et d’asphaltène. Ilcontient 0,870 de carbone, 0,112 d’hydrogène et 0,018 d’oxygène (22).En 1836, toujours, Boussingault testa un autre procédé de séparation des matières bitumineusesd’avec le sable qu’elles imprégnaient. Il consistait à « les traiter dans un tonneau tournant sur unaxe, par de l’eau froide et de l’eau chaude ». Mais il ne permit pas d’obtenir une séparation aussicomplète que le procédé traditionnel, consistant à soumettre le minerai à une forte ébullition tout enle remuant fréquemment (23).Cinq ans plus tard, en 1841, Boussingault reprit ses analyses de composition chimique. Il soumitle bitume visqueux <strong>du</strong> Bechelbronn à une distillation ménagée à 230°C et obtint une huile jauneprésentant toutes les propriétés <strong>du</strong> pétrolène. Il trouva qu’elle contenait de 0,882 à 0,886 de carboneet de 0,123 à 0,127 d’hydrogène.Il analysa ensuite le bitume vierge, qui surgissait alors « à la surface d’une prairie dans levoisinage de la fabrique » (donc à la source primitive <strong>du</strong> Baechel-Brunn). Ce bitume était brun,aromatique, mais d’une consistance beaucoup moins ferme que le bitume provenant <strong>du</strong> sable bouillià la fabrique. De composition assez voisine, il contenait 0,883 de carbone, 0,111 d’hydrogène,0,011 d’azote et probablement aussi une petite quantité d’oxygène.En 1841 toujours, Boussingault a également analysé le bitume liquide ou huile de pétrole, quiétait monté au jour dans les environs de Hatten (de Schwabwiller en réalité), à la suite de quelquescoups de sonde dans le terrain tertiaire. Ce bitume très fluide, d’un brun assez foncé et d’une odeuragréable rappelait celle <strong>du</strong> pétrolène. Il contenait 0,887 de carbone, 0,126 d’hydrogène et 0,004d’azote. Ces trois analyses parurent d’abord dans les Annales des mines de 1841 (t. 19, p. 609), puisdans les Annales de chimie de la même année (t. 73, p. 442).Puis Boussingault s'impliqua dans l'organisation à Strasbourg, en septembre et octobre 1842, et àl'initiative de la municipalité, <strong>du</strong> 11e Congrès scientifique (international) de France. AvecDuvernoy, professeur au Collège de France, il a même été le premier membre de l'Académie dessciences à s'investir aussi activement dans un tel événement. Il en fut l'un des quatre vice-présidents,alors que le règlement n'en avait prévu que trois, mais comme il y avait onze candidats...Boussingault fut en outre le président de la deuxième section (sur huit) de ce congrès, celle dessciences physiques et mathématiques.On y parla <strong>du</strong> Pechelbronn et de la mine de Lobsann. Mais c'était à la sixième séance de lapremière section (histoire naturelle), le 4 octobre, lors d'une discussion lancée par l'ingénieur enchef des mines <strong>du</strong> Bas-Rhin de Billy sur l'origine <strong>du</strong> bitume. Celui-ci se fonda sur les analyses <strong>du</strong>
pétrolène et de l'asphaltène de Boussingault pour affirmer que le pétrole ne pouvait pas résulter del'action réciproque <strong>du</strong> lignite, <strong>du</strong> sel gemme et <strong>du</strong> bitume (24).Joseph Achille Le Bel (le fils de Louis Frédéric Achille Le Bel) et Achille Müntz (le préparateur deBoussingault) referont trente ans plus tard d’autres analyses, plus poussées, de l’asphaltène <strong>du</strong> bitume <strong>du</strong>Pechelbronn ainsi que de bitumes rapportés de Chine et d'Egypte. Ils purent en présenter les résultats à la séance<strong>du</strong> 1 er mars 1872 de la Société chimique de Paris et dé<strong>du</strong>isirent de la présence de cette matière que les bitumesnaturels n'ont point subi de distillation, ni même l'action de fortes chaleurs et qu'ils dérivent par conséquentdirectement des houilles et <strong>du</strong> lignite.Par la suite, Joseph Achille Le Bel publiera encore dans le Bulletin de la Société chimique de Paris de 1897 (t.17, p. 136) des « Recherches sur les asphaltènes ». Les deux vocables de pétrolène et d’asphaltène, inventés parBoussingault au Pechelbronn, se sont donc imposés dans le jargon pétrolier international. Dès 1844, JustusLiebig, l'alter ego allemand de Boussingault, les avait d'ailleurs validés dans son « Traité de chimie organique »(t. 3, p. 192-193).Dispute sur l’éclairage électrique des minesCurieux de tout, Boussingault s’intéressa aussi à l’électricité. A la séance de l’Académie dessciences <strong>du</strong> 12 janvier 1846, on en était ainsi venu à commenter un article de presse attribuant augenevois de la Rive l’idée d’employer la lumière électrique dans les mines. François Arago fit alorsremarquer que cette primeur revenait en réalité à Boussingault, qui aurait même été le premier àl’appliquer réellement dans les mines (<strong>du</strong> Bechelbronn bien sûr). Ce qui fut évidemment consigné etpublié dans les Comptes ren<strong>du</strong>s hebdomadaires des séances de l’Académie.L’y ayant lu, Louyet, professeur de chimie à Bruxelles, écrivit aussitôt à l’Académie pourindiquer qu’en réalité c’est lui qui avait eu le premier l'idée d'employer des piles voltaïques dans lesmines, comme le prouvait un article de presse <strong>du</strong> 26 octobre 1836. A la séance suivante <strong>du</strong> 2 février1846, Boussingault fit donc cette mise au point : ce n’est qu’au lendemain de l’explosion <strong>du</strong> 15 juin1845, qui avait fait cinq morts et deux blessés au puits Madeleine des mines <strong>du</strong> Bechelbronn, qu’ilpensa « appliquer la lumière de la pile à l’éclairage des travaux souterrains. Il ne s’est cependantpas borné à proposer ce moyen. Il l’a employé pour éclairer, sans danger, une atmosphère des plusexplosives » (25). C’est donc à lui que revenait effectivement la primeur de l’application.En réalité, Bechelbronn resta fidèle à la lampe à huile <strong>du</strong> britannique Davy, déjà en usage lors del’explosion <strong>du</strong> 15 juin 1845. Cette lampe ne déclenchait en effet aucune explosion grâce au treillismétallique qui coiffait sa flamme.Jamais à court d’idées, Boussingault imagina alors un procédé « très simple », permettant devérifier toutes les semaines la sécurité de cette lampe, procédé que l’ingénieur des mines <strong>du</strong> Bas-Rhin Auguste Daubrée mentionne pour la première fois le 18 juin 1855, à l’occasion de soninspection annuelle. On verse d’abord un peu d’éther dans un vase de fer blanc de formecylindrique, muni vers le bas d’une petite ouverture. Cet éther se répand en vapeur dans le vase,puis on y plonge la lampe Davy allumée. « A l’instant, on voit (alors) si la toile arrête bienl’inflammation intérieure ». Selon Daubrée, l’administration devait recommander ce procédé danstoutes les mines où l’on faisait usage de lampes à toiles métalliques (26).Observations sur la foudreElectricité toujours : le 27 mai 1842, Boussingault écrivit à François Arago, président del’Académie des Sciences, pour lui raconter comment il avait manqué de peu d'être frappé par lafoudre dans l'après-midi <strong>du</strong> dimanche 22 mai précédent, au château Le Bel <strong>du</strong> Bechelbronn.
« A mesure que l’orage approchait, explique-t-il, l’intensité <strong>du</strong> vent diminuait. La pluie tombaitverticalement, lorsque sur les deux heures et demie de l’après-midi, on entendit un violent coup detonnerre, et au même instant il sortit d’un tuyau de poêle placé dans mon appartement deux jets defeu électrique qui se dirigèrent l’un sur le mur, l’autre sur un fauteuil, dans lequel fortheureusement je ne me trouvais pas. Dans une pièce située au-dessus de l’étage que j’occupe, unedomestique vit la lumière électrique jaillir de toutes parts. Cette femme affirme avoir senti uneodeur sulfureuse très prononcée. Moi, je n’ai remarqué aucune odeur. Une personne de ma famille,qui se trouvait alors dans le rez-de-chaussée d’une habitation voisine, a vu au moment del’explosion, la toiture <strong>du</strong> Bechelbronn complètement illuminée. Il n’est arrivé aucun accident, lafoudre n’a pas même laissé de trace de son passage, <strong>du</strong> moins dans les parties <strong>du</strong> bâtiment que j’aipu visiter. »Boussingault ajoute qu’au cours de ce même orage la foudre était également tombée sur un poiriersauvage (Spachbirn) situé à la limite d’un champ de blé, à une trentaine de mètres de la tuilerie deLampertsloch. La foudre l’avait frappé un peu avant l’arrivée de la pluie. Il y eut une explosion quijeta des éclats de bois dans toutes les directions jusqu’à une douzaine de mètres, tout en dégageantune épaisse colonne de vapeur, comparable, selon le tuilier, à la fumée qui sort d’une cheminéequand on charge un foyer avec de la houille. Après la dissipation de cette vapeur, le tronc <strong>du</strong> poirierse montra d’une blancheur surprenante. La foudre l’avait totalement dépouillé de son écorce depuisla naissance des branches principales jusqu’au collet des racines. Trois de ses cinq grosses branchesavaient été rompues. Leurs rameaux touchaient à terre, mais elles adhéraient encore à l’arbre. A unmètre, une racine était sortie de terre, également privée de son enveloppe. L’arbre était fen<strong>du</strong> surtoute sa longueur en deux parties inégales, chacune de ces parties présentant plusieurs fissures.A deux reprises, Boussingault était allé l’examiner longuement. « Je n’ai pu découvrir aucunindice de combustion, pas la moindre apparence de carbonisation, précise-t-il. C’est bien de lavapeur aqueuse qui s’est dégagée de l’arbre au moment de l’explosion et c’est probablement par ledéveloppement subit de cette vapeur entre l’aubier et l’écorce que cette dernière a été brisée etlancée au loin. Si l’on n’avait pas vu le tonnerre tomber sur le poirier de Lampertsloch, on pourraitcroire que cet arbre a été brisé par un ouragan et que son écorce a été enlevée par la main del’homme » (27).Et comme Arago ne demandait qu’à recevoir d’autres témoignages sur les effets de la foudre etleur odeur, Boussingault lui décrira quatre ans plus tard le cas d’un autre poirier foudroyé dans lanuit <strong>du</strong> 4 au 5 mai 1846 dans un champ en bor<strong>du</strong>re de la route de Woerth à Reichshoffen. Il étaitégalement allé l’examiner. Un témoin assurait que l’arbre exhalait « une odeur insupportable desoufre », ce qu’ont également reconnu d’autres curieux.Mais Boussingault prétend le contraire. « Cette odeur n’était aucunement sulfureuse, écrit-il. Ellerappelle celle que l’on perçoit dans les usines où l’on fait <strong>du</strong> vinaigre en distillant <strong>du</strong> bois. Je croisqu’on est trop généralement porté à prendre pour des vapeurs sulfureuses toutes les vapeurspénétrantes, nauséabondes, qui se développent nécessairement toutes les fois qu’un corpsorganique est soumis à la chaleur intense que peut occasionner le passage de l’électricité » (28). ©<strong>Jean</strong>-Claude Streicher (septembre 2008)NOTES :
premier de ces termes n'était à verser qu'un an après, et les deux autres « à pareil jour desdeux années suivantes » (6). Ces facilités de paiement seraient-elles le signe d'une décisionprise dans l'urgence ?Les Boussingault, qui à cette date logeaient toujours au Pechelbronn, purent prendrepossession <strong>du</strong> Liebfrauenberg quatre mois plus tard, le 1er octobre 1845. Mais en épluchantl'inventaire d'août-septembre 1842 de la succession laissée par Marie Joseph Achille Le Bel,on s'aperçoit que <strong>Jean</strong> <strong>Baptiste</strong> Boussingault y avait dès cette époque sa chambre à coucher.Le mobilier en avait été fourni par le beau-père. Il consistait alors en deux bas buffets, uneglace, une table de nuit, quatre tableaux, deux draperies, un poêle en faïence avec tuyau etpierre, un lavoir, un bois de lit, une paillasse, un matelas, un traversin, un oreiller, un plumon,une couverture en indienne piquée, un rideau de lit en percale avec accessoires et deux chaisesà siège de paille (2).Les Boussingault firent <strong>du</strong> Liebfrauenberg leur résidence d'été et leur résidence favorite. Ilsy séjourneront chaque année pendant près de six mois an, sans attendre l'achèvement en juillet1852 de la ligne ferroviaire Paris-Strasbourg. Le père de la chimie agricole, qui en avaitmanifestement été privé au Pechelbronn, en profita pour y aménager un laboratoire de chimieainsi qu’une riche collection minéralogique dans l'abside de l’ancienne chapelle (5) (7).Laboratoire, qu’il sépara par un mur <strong>du</strong> reste de la nef, qu'il aménagea pour sa part en réserve(« store », selon McCosh) (7).Ces installations seront qualifiées d’« admirable laboratoire de physiologie végétale », le 14mai <strong>1887</strong>, aux obsèques de Boussingault à Paris, par le colonel Laussedat, directeur <strong>du</strong> Cnam(Centre national des Arts et Métiers), qui ajoutait : « Partout où il s’installait, toujours aumilieu de ses enfants, Boussingault organisait un laboratoire, souvent avec des ustensiles enapparence peu appropriés aux recherches délicates qu’il poursuivait, mais dont il tiraitcependant un parti merveilleux » (8).Dans ce laboratoire, il cherchera plus spécialement à percer les mystères de l'absorption del'azote par les plantes, alors que ses expérimentations à la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn avaientsurtout portées sur la fertilisation des sols ainsi que sur l'alimentation et l'engraissement <strong>du</strong>bétail.Au Liebfrauenberg, Boussingault fit également abattre les cloisons séparant les anciennescellules des ermites pour les transformer en un vaste salon et bibliothèque. Mais il ne modifiapas le domaine proprement dit. Celui-ci comportait un jardin potager, à la terre légère et bienfumée, un verger, un tilleul ainsi qu'une petite vigne de 25,21 ares « dans un terrain de sablequartzeux dérivant <strong>du</strong> grès des Vosges et <strong>du</strong> grès bigarré ».Un vrai bonheur ! « La terre si éminemment fertile <strong>du</strong> Liebfrauenberg » allait donc pouvoirlui procurer la grande diversité de végétaux que réclameront ses expérimentations debiochimie végétale. Dans le potager, il fera même pousser un carré d'asperges et sa vignedonnera en 1846 un petit vin blanc de 12,5° !Une croyance locale veut qu'il planta également derrière l'église <strong>du</strong> Liebfrauenberg un cèdre<strong>du</strong> Liban, qu'il aurait rapporté d'Orient. Vers 1957, le tronc de ce cèdre avait atteint uncirconférence de 4,85 m. Mais est-ce vraiment possible au bout d'une centaine d'annéesseulement ? Il nous paraît donc douteux que cet arbre ait été planté par le père de la chimieagricole, d'autant que celui-ci n'a jamais été en Orient. Ce cèdre magnifique sera hélas abattu3
pour les Pâques de 1977 par les responsables de l'Association des amis de la maison del'Eglise (de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine), nouveau propriétaire deslieux depuis 1954 (9).Un centre de la vie familialeLe Liebfrauenberg sera aussi, pour les Boussingault, un centre de la vie familiale. C'est là, àl'issue d'une longue méditation solitaire semblerait-il, que le père de la chimie agricoledécidera des études supérieures que suivrait son fils Joseph. Il en fit part à son épouse (qu'ilsurnommait alors « Mémère » !) dans une lettre qu'il lui adressa le 8 octobre 1857, à leurdomicile parisien <strong>du</strong> 6 rue <strong>du</strong> Pas de la mule, près de la Place des Vosges. Il voulait queJoseph entrât comme externe dans une institution préparatoire, « car en le laissant encoretrainer une année au lycée, il perdrait un an ».Dans cette institution, il suivrait des études dirigées vers un but spécial et pourrait ensuite sedestiner à une école spéciale, pour peu qu'il montrât quelque aptitude dans les mathématiques.C'était la voie la plus raisonnable, car Joseph est « extrêmement laborieux » et « apprend trèslentement. « J'ai souvent souffert, reconnaît son père, de le voir tant travailler pour aboutir àun aussi mince résultat. »Boussingault tenait d'autre part à ce que son fils prenne alors au moins le dîner à la maisonpour ne pas pâtir à vie de la malnutrition des pensionnats. « Je veux continuer à favoriserl'estomac aux dépens de l'esprit, insiste le père de la chimie agricole. Il n'y a que les hommesbien constitués qui peuvent fournir une longue et laborieuse carrière. C'est une bonneconstitution qui fait que, à 87 ans, Humbolt travaille encore avec l'ardeur d'un homme jeune,et je ne passerai pas, comme je le fais maintenant, dix heures par jour à la pluie si j'étaisfaible de corps. »Boussingault se proposait ensuite de prendre son fils dans son laboratoire pendant qu'il sepréparerait pour la licence (10).Enfin, c'est également au Liebfrauenberg que sera conclu le 4 septembre 1861 le contrat demariage de Berthe Gabrielle, 25 ans, la fille <strong>du</strong> père de la chimie agricole, avec Jules GustaveHoltzer, l'héritier de la fabrique d'aciers fondée à Unieux, près de Saint-Etienne, par son pèreJacob Holtzer, un natif de Klingenthal, près d'Ottrott. L'événement réunit les quatre parentsdes conjoints et eut pour témoins Louis Frédéric Achille Le Bel, son épouse Madeleine, leurfille aînée Emma ainsi que Louis Sadoul père et fils, médecins à Woerth.Ce fut un riche mariage, car le futur époux apportait en dot 1 231 760 francs en immeubles,valeurs mobilières, in<strong>du</strong>strielles, marchandises, argent comptant et créances. Et lesBoussingault, en avance d'hoirie : un trousseau d'une valeur de 6 000 francs ainsi qu'unesomme de 100 000 francs (11).Hôtes célèbresAuprès de leurs amis et connaissances, les Boussingault se vantera bien évidemmentd’habiter une ancienne abbaye franciscaine, remontant à 1384 au moins, puisque ce millésimeest « inscrit sur la tour <strong>du</strong> vieux monastère ». Le Liebfrauenberg, en réalité, n’avait jamais été4
qu’un lieu de pèlerinage, doublé à partir <strong>du</strong> 18 e siècle d’un ermitage. Lorsque Marie JosephAchille Le Bel l’avait racheté en 1825, il n’était occupé que par deux « ermites », qui depuis1823, et avec l'appui <strong>du</strong> curé Piblinger de Soultz-sous-Forêts, avaient vainement tenté derétablir les anciennes dévotions.Bien enten<strong>du</strong>, le couple Boussingault y accueillit ses invités. A l'été 1857, il y reçut uncertain Monsieur Gay, que nous n'avons malheureusement pas réussi à identifier, mais quiavait ses entrées à l'Institut de France, où il fréquentait le père de la chimie agricole ainsi queBenoît Fourneyron, l'inventeur de la turbine hydraulique à pression universelle. Gay futenchanté de son séjour. Le 15 septembre, rentré à Paris, il adressa donc à la maîtresse demaison une lettre débordant de reconnaissance, lui reprochant même de l'avoir « un peu tropgâté ».Mais il ne demandait après tout qu'à devenir « le plus assi<strong>du</strong> et le plus fervent des pèlerins »de cet « heureux séjour, si aimé de M. Boussingault », et qui « respire le parfum d'une sincèreamitié ». Il s'impatientait de voir ce que donneraient les travaux entrepris à la chapelle. Al'occasion de ce séjour, Gay avait également pu faire la connaissance de Louis FrédéricAchille Le Bel et de sa « gentille famille » (10).A l'été 1859, Boussingault reçut ensuite au Liebfrauenberg son alter ego allemand et cadetde deux ans, le Dr Julius Adolph Stöckhardt (1809-1886). Il était conseiller aulique de Saxe ettitulaire depuis 1847 de la première chaire de chimie agricole en Allemagne, à l'Académieroyale agronomique et forestière de Tharand, près de Dresde. A partir de 1855, son actionavait ensuite contribué à multiplier outre-Rhin des stations agricoles, vouées à la fois à larecherche expérimentale et au contrôle des semences et des engrais. Il « n'avait pas voulutraverser la France sans visiter Bechelbronn et le Liebfrauenberg, où ont été exécutés lesnombreux travaux qui ont contribué si puissamment aux progrès de la science agricole ».Le Dr Stöckhardt était l'auteur d'un ouvrage à succès, L'école de chimie, qui en était déjà àsa onzième édition. On convint alors que Frédéric Brüstlein, l'un des élèves alsaciens deBoussingault, lui aussi présent au Liebfrauenberg, le tra<strong>du</strong>irait en <strong>français</strong>. Cette tra<strong>du</strong>ctionparut en 1861, en 524 pages, avec 225 gravures et sous un titre modifié par Brüstlein : « Lachimie usuelle appliquée à l'agriculture et aux arts ». Et c'est au Liebfrauenberg que Brüstleinen avait rédigé la préface, le 8 octobre 1860. Il en était donc devenu lui aussi un habitué.Dans son laboratoire <strong>du</strong> Liebfrauenberg, Boussingault formera également, à la veille de laguerre de 1870, celui qui sera son authentique fils spirituel, le jeune Achille Müntz, fils <strong>du</strong>notaire de Soultz-sous-forêts, alors âgé de 23 ans. Celui-ci y paracheva en effet son mémoirede fin d'études, portant « Sur la composition de la peau, sur les modifications que le tannagelui fait subir, et sur la fermentation <strong>du</strong> tannin dans les choses », recherche qu'il avait amorcéechez ses oncles maternels, tanneurs à Woerth (12).Il y mena aussi des expérimentations de germination de graines de radis, de pavot et decolza à la lumière diffuse et à l'obscurité (13) et y analysa la composition chimique de jeunesplants de houblon dans le cadre de son étude sur la statique de la culture <strong>du</strong> houblon (14). Aulendemain de la défaite de 1870, il recueillit enfin « un grand nombre » de champignons dansles forêts <strong>du</strong> Liebfrauenberg pour analyser ensuite leurs fonctions au laboratoire « <strong>du</strong> point devue <strong>du</strong> sucre » (15).5
Tout cela lui vaudra évidemment de devenir pour quelques années le préparateur <strong>du</strong> père dela chimie agricole au Conservatoire des arts et métiers à Paris.Enfin, comme il l'avait souhaité dès octobre 1857, Boussingault accueillit aussi à sonlaboratoire <strong>du</strong> Liebfrauenberg son propre fils Joseph. Celui-ci y fera des observations et desexpérimentation sur la fermentation des myrtilles, <strong>du</strong> moût de vin blanc de Lampertsloch et lemiel (16). A la même époque, Joseph publiera aussi dans la revue scientifique de son père lesobservations qu'il avait faites sur une miellée survenue lors de la canicule de la fin <strong>du</strong> mois dejuillet 1869 sur un tilleul <strong>du</strong> jardin <strong>du</strong> Liebfrauenberg (17).Le Liebfrauenberg dans les Annales de chimie et de physiqueQuant à Boussingault père, il a axé ses premiers travaux au Liebfrauenberg « sur lacomposition de l’air confiné dans la terre végétale », étude assez ambitieuse qu’il a menée encollaboration avec un certain Lewy (ou Levy) et qu’il publia en novembre 1852 dans leJournal d'agriculture pratique d'abord, puis en 1853 dans les Annales de chimie et physiquede 1853 (t. 37, p. 5-50), revue qu’il animait avec ses collègues Chevreul, Dumas, Pelouze etRegnault.Pour les besoins de cette étude, il a analysé la plus grande variété possible de terrains desenvirons <strong>du</strong> Liebfrauenberg : un sol léger et sablonneux provenant de la désagrégation <strong>du</strong> grèsbigarré, un champ récemment fumé, un champ de carottes, la terre végétale de la vigne <strong>du</strong>Liebfrauenberg, le sol des montagnes arénacées des Vosges, un gisement de sable situé sur laroute de Liebfrauenberg à Lembach, dans la forêt de Lembach, un carré d’asperges <strong>du</strong> potager<strong>du</strong> Liebfrauenberg, un champ fumé en automne de la vallée de la Sauer, une prairie dans lefond de la vallée de la Sauer ; et pour terminer, le sol de la serre des palmiers <strong>du</strong> Jardin desplantes à Paris.Il conclut que « l’air enfermé dans un hectare de terre arable de 35 cm d'épaisseur varie de300 à 1 500 m³ et qu'il peut contenir de 0,8 à 53 m³ d'acide carbonique, soit jusqu'à 14 % envolume, selon que le sol est plus ou moins riche en humus ». Mais, s'empresse-t-il d'ajouter,« la présence de l’acide carbonique dans une couche sous-jacente à la terre végétale méritecertainement une étude particulière, car quelque soit son origine le gaz acide carbonique nepeut manquer d’exercer une certaine influence sur la fertilité <strong>du</strong> sol (...). Il provientévidemment en grande partie de la combustion lente <strong>du</strong> carbone des matières organiques(humus, débris de plantes, engrais) ».Puis Boussingault a cherché à déterminer la part d’ammoniaque non pas seulement dans lespuits de Paris et des cours d’eau franciliens, mais aussi dans le Rhin près de Lauterbourg,dans la Moder à Haguenau, dans le Seltzbach à Merkwiller, dans la Sauer, dans la Lauter àWissembourg et à Lauterbourg, aux sources de Niederbronn, dans un puits de la ferme Hüffelprès de Haguenau, dans celui de sa ferme de Merkwiller, dans un puits de la ferme Le Bel <strong>du</strong>Pechelbronn ainsi que dans un puits de la mine de bitume, à 60 m de profondeur.Résultat : il y avait 0,00000078 d’ammoniaque dans les eaux pluviales, 0,00000018 dans lesrivières et 0,00000009 dans les sources. Boussingault présenta ce « Mémoire sur le dosage del’ammoniaque contenue dans les eaux » à la séance <strong>du</strong> 9 mai 1853 de l’Académie dessciences et put le faire paraître la même année encore dans les Annales de chimie et dephysique (t. 39, p. 257-291).6
Là-dessus, le père de la chimie agricole chercha à mesurer « la quantité d’ammoniaquecontenue dans la pluie, la rosée et le brouillard recueillis loin des villes ». C’est ainsi qu’ilanalysa la totalité des 77 pluies, rosées et brouillards qui tombèrent sur le Liebfrauenberg <strong>du</strong>26 mai au 8 novembre 1853. Il les recueillit d’abord dans des vases en fer blanc ou enporcelaine.Mais le procédé était impropre pour les faibles précipitations. Il usa donc « d’une toile trèsfine, fixée à des pieux enfoncés en terre », qu’il ne déployait qu’avant l’arrivée de la pluie. Autotal, il recueillit 1 755,75 litres d’eau, qui contenaient 909,25 mg d’ammoniaque, soit unedose sensiblement plus élevée que celle mesurée dans les rivières et les eaux de source. Autredécouverte : « la fin d’une pluie contient moins d’ammoniaque que le commencement de lapluie qui lui succède, quelque court d’ailleurs que soit l’intervalle pendant lequel la pluie aété interrompue ». L’explication ? Cet ammoniaque est formé par l’électricité des nuages àpartir d’un carbonate volatil (18).Sur la fixation de l’azote par les plantesPendant les étés 1851, 1852 et 1853, Boussingault tenta également de vérifier auLiebfrauenberg la réalité de la fixation de l’azote atmosphérique par les plantes. Ce qui nousvaut une autre étude, publiée en trois parties dans les Annales de chimie et de physique,intitulée « Recherches sur la végétation, entreprises dans le but d’examiner si les plantesfixent dans leur organisme l’azote qui est à l’état gazeux dans l’atmosphère ».Dans la première partie (t. 41, année 1854), il détaille les expérimentations menées avec unappareillage de sa conception sur plusieurs végétaux (haricots, avoine, cresson et lupin) deson jardin potager <strong>du</strong> Liebfrauenberg. Il en conclut « que le gaz azote de l’air n’a pas étéassimilé pendant leur végétation ». Il se promet cependant de rechercher dans un autremémoire « les conditions dans lesquelles a lieu l’assimilation de l'azote, lorsque les plantesplacées dans un sol stérile sont cultivées à l’air libre, c’est-à-dire lorsqu’elles se développentsous la double influence des vapeurs ammoniacales et des corpuscules organiques querenferme l’atmosphère » (p. 60).La seconde partie de sa recherche paraît l’année suivante (t. 43, p. 149-223) et se fonde surdes expérimentations menées de mai à août des années 1852, 1853 et 1854. Cesexpérimentations ne sont pas localisées. Mais vu la saison à laquelle elles se sont déroulées etle type de plantes qu'elles ont impliqué, on peut raisonnablement supposer qu’elles ont eu lieuau Liebfrauenberg. Pour varier les plaisirs, Boussingault a cette fois analysé des cendres (defoin, de pois, de gerbe de blé, de graines et de feuilles d’avoine, de feuilles de topinambour),de la végétation (lupin, haricots nains, cresson alénois, haricot flageolet et avoine) ainsi quedes graines (lupin, cresson, avoine et froment).Il estime le gain en azote « faible » et ne pense pas « qu’on puisse en voir l’origine dansl’azote atmosphérique ». Il en dé<strong>du</strong>it donc des conclusions inverses de sa grande découvertede 1836 : « l’azote, quand il est à l’état gazeux, n’est pas assimilé pendant la végétation ».C’est sans doute la plus grosse bévue de sa carrière. En 1987, <strong>Jean</strong> Labollay l’expliquera parl’emploi d’un procédé empêchant tout contact avec les impuretés de l’air, donc égalementavec les micro-organismes <strong>du</strong> sol, qui permettent justement aux plantes d’absorber l’azote7
atmosphérique, car il vrai, précise <strong>Jean</strong> Labollay, que « les plantes ne peuvent par ellesmêmesutiliser l’azote » (19).Au même moment, Georges Ville, professeur de physique végétale au Muséum d’histoirenaturelle de Paris (1824-1897), sut au contraire prouver la fixation de l’azote par les végétauxà l’aide d’un appareillage sous cloche d’une autre conception. Une commission del’Académie des sciences, composée des six plus éminents chimistes <strong>du</strong> moment, <strong>du</strong>t alorsdépartager les deux démonstrations. Elle donnera raison à Georges Ville lors de la séance <strong>du</strong> 5novembre 1855 (20) (21). Belle revanche pour cet ancien préparateur de Boussingault, audemeurant demi-frère de Napoléon III ! Dans un premier temps, en effet, Georges Ville avaitété nommé le 29 novembre 1851, à la veille <strong>du</strong> coup d’Etat, à la chaire d’Economie rurale <strong>du</strong>Cnam (alors changée en chaire de chimie agricole), à la place de Boussingault, toujoursConseiller d’Etat. Mais il avait dû y renoncer dès le 24 décembre suivant, suite auxprotestations <strong>du</strong> monde savant, et restituer cette chaire à Boussingault, qui la garda jusqu’à saretraite (22) (23).La fixation de l’azote atmosphérique par les plantes ne sera expliquée qu’en 1886 par l’allemandHerrmann Hellriegel (1831-1895). En concentrant ses recherches sur les légumineuses, qui en fixent desquantités importantes (à la différence des graminées qui n’en fixent pratiquement pas), il vit que lephénomène est <strong>du</strong> à la présence sur les racines de nodosités et de micro-organismes vivant en symbioseavec elles. Par la suite, le néerlandais Martinus Beijerinck (1851-1931) parvint à isoler ces bactéries : leRhizobium, l’Azotobacter et le Clostridium pasteurianum. Ce que confirmèrent les expériences menéesen France en 1890 par Schloesing (le fils <strong>du</strong> successeur de Boussingault au Cnam) et Laurent.Auparavant, en 1876, Marcelin Berthelot avait déjà attribué la fixation de l’azote à l’influence del’effluve électrique ou décharge silencieuse sur les plantes, puis à partir de 1883 à un second phénomène :l’influence de micro-organismes présents dans le sol. « Presque tous les savants contestaient (alors)l’absorption de l’azote atmosphérique et son intervention dans la végétation », rappelle Emile Jungfleischdans son hommage à Marcelin Berthelot (24).Au passage, Boussingault avait tout de même établi une certitude : « La matière azotée nesemble pas subir de modifications bien prononcées dans le cours de la végétation, puisqu’onla retrouve dans les divers organes à peu près avec les mêmes propriétés qu’elle possédaitdans la semence. » En d’autres termes, la proportion d’azote dans n’importe quelle partied’une plante n’est jamais différente de celle qu’elle possédait à l’état de graine.L’année suivante, en 1856, Boussingault publie dans les Annales de chimie et de physique (t.46, p. 5-41) un troisième mémoire sur la végétation, consacré cette fois à l’action <strong>du</strong> salpêtreet <strong>du</strong> nitrate de potasse sur le développement des plantes. Les expérimentations, nonlocalisées, ont portées en août 1855 sur le cresson et le topinambour, déjà utilisés dansd’autres expérimentations <strong>du</strong> Liebfrauenberg.Quatre ans plus tard, et pendant trois étés consécutifs (1859 à 1861), Boussingault reprendla même recherche, mais avec un appareillage de laboratoire à ballons étanches entièrementremanié. Il en publie les résultats en 1862 dans les mêmes Annales de chimie et de physique (t.66, p. 295-429) sous le titre « Expériences entreprises pour rechercher s’il y a émission degaz azote pendant la décomposition de l’acide carbonique par les feuilles. Rapport existantentre le volume d’acide décomposé et celui de l’oxygène mis en liberté ».Ces expérimentations, au nombre de 61, ne sont pas non plus localisées. Mais comme à troisreprises elles ont porté sur des végétaux prélevés dans la Sauer (le Potamogeton crispum, le8
Ceratophyllum Submersum et des feuilles submergées), on peut à nouveau raisonnablementsupposer qu’elles ont eu lieu, elles aussi, au Liebfrauenberg.Le premier été, Boussingault testa ainsi neuf plantes : feuilles de pécher, feuilles et tiges dePotamogeton crispum de la Sauer, feuilles de menthe aquatique, feuilles de chêne, aiguilles depin weymouth, feuilles de saule, feuilles de houx, algues des ruisseaux et feuilles deBoussingaultia bazaloïdes. L’année suivante, il en testa dix au cours de treizeexpérimentations : aiguilles de pin weymouth, feuilles de pervenche, de sassafras, de carottes,de lierre, de haricots, d’ortie, d’avoine et de laurier rose.La troisième année, enfin, il testa 14, puis 11 feuilles de laurier rose ; deux fois 17 feuillesde pêcher ; 38, puis 43 feuilles de saule ; 11, puis 10 feuilles de lilas ; 42, puis une autrequantité non précisée d’aiguilles de pin maritime ; des feuilles de carotte ; 11 feuilles delaurier rose ; <strong>du</strong> Ceratophyllum submersum de la Sauer ; une anémone d’eau douce ; desfeuilles de thym et 9 feuilles de vigne, les unes prises à l’ombre, les autres au soleil, commel’année précédente d’ailleurs. Sentence finale, sans doute elle aussi erronée : « on peut, jecrois, conclure avec une entière certitude que pendant la décomposition de l’acidecarbonique par les parties vertes des végétaux, il n’y a ni absorption, ni émission d’azote ».Empoisonner les campagnols à l'arsenic ?Une seule étude fait exception à cette thématique : « Sur l’opportunité de faire intervenirdans quelques circonstances l’arsenic dans le chaulage des grains » (25). Boussingaultl’avait entreprise suite aux ravages causés par les campagnols en Alsace en 1854, et quis’étaient soldés dans le seul arrondissement de Wissembourg par des pertes de plus de800 000 francs. Craignant une reprise <strong>du</strong> fléau lors des semailles suivantes, on l’avait en effetconsulté sur l’intérêt d’un chaulage des grains mêlé d’arsenic.Pour le vérifier, il procéda à onze expériences (a priori à Paris) et qui consistèrent à nourrirsous cloche des souris et des campagnols d’aliments contenant de l’arsenic ou <strong>du</strong> sulfate decuivre. Il conclut que l’arsenic est un poison efficace, mais qu’il fallait prendre dans sonmaniement un minimum de précautions, car l’arsenic pouvait être confon<strong>du</strong> avec <strong>du</strong> sucre. Ilrecommanda donc de le commercialiser au détail, mélangé avec <strong>du</strong> sulfate de fer ou deprussiate, pour que, versé dans <strong>du</strong> lait, il le teinte d’un bleu suspect. Cette étude parutégalement dans le Bulletin des séances de la Société impériale et centrale d’agriculture deFrance (t. 11, 1855-1856, p. 198-212) ainsi que dans le Journal d'agriculture pratique (1ersem. 1856, p. 140-145).Boussingault reviendra sur les ravages des campagnols à la séance <strong>du</strong> 29 janvier 1873 de laSociété centrale d’agriculture. Il dit alors qu’« un des meilleurs moyens employés (en Alsace)pour leur destruction consistait à faire marcher des chiens ratiers derrière la charrue dansles sillons que celle-ci creusait ». Selon lui, le nombre de ces rongeurs au m 2 pouvait être detrente dans la région de Wissembourg ! Mais le trempage <strong>du</strong> grain dans une dissolutiond’arsénite de soude manquait d’efficacité, car les campagnols décortiquaient le grain avant dele manger. Pour avoir de l’effet, le poison devait pénétrer dans l’intérieur <strong>du</strong> grain au moyend’un trempage de longue <strong>du</strong>rée (26).9
Dans la revue « Agronomie, chimie agricole et physiologie »En 1854, Boussingault rassemble dans des « Mémoires de chimie agricole et dephysiologie » ses travaux les plus significatifs qu’il avait déjà publiés dans son Economierurale et les Annales de chimie et de physique. Ces mémoires mêlent par conséquent desexpérimentations menées à la ferme Le Bel <strong>du</strong> Pechelbronn et au Liebfrauenberg, mais sansapporter à première vue d’éléments nouveaux. Ils sont en quelque sorte son best of de micarrière.Puis, entre 1860 et 1874, pour « entrer dans les détails les plus minutieux », il fait paraîtrecinq volumes d’une nouvelle série d’ouvrages intitulée « Agronomie, chimie agricole etphysiologie ». C’est la réédition « revue et considérablement augmentée » des travaux qu’ilavait précédemment publiés dans les Annales de chimie et de physique. Mais il y joignitégalement des travaux inédits « sur des sujets analogues » de lui-même, ou réalisés, commelui l'explique dans la préface, « par des jeunes attachés à mon laboratoire et des étrangers,dont quelques-uns et des plus éminents me font l'honneur de se considérer comme mesélèves ». Au total, on y dénombre une dizaine de recherches menées explicitement auLiebfrauenberg. Mais dans la réalité, Agronomie, chimie agricole et physiologie n'est pas autrechose que la chronique des travaux menés au Liebfrauenberg.Sont explicitement localisées au Liebfrauenberg :- « De la terre végétale considérée dans ses effets sur la végétation » (t. 1, 1860). Cettecontribution se fonde notamment sur des expériences faites en 1858 et 1859 sur la terre prisedans le potager <strong>du</strong> Liebfrauenberg ;- « Des nitrates dans le sol et dans les eaux » (t. 2, 1861). Pour cette étude menée en 1856,Boussingault a analysé des échantillons prélevés :* autour <strong>du</strong> Liebfrauenberg (au sommet <strong>du</strong> Liebfrauenberg, dans la forêt de Hatten, sur lesbords de la Sauer, dans les vignes <strong>du</strong> Liebfrauenberg, dans une houblonnière de la valléede la Sauer, dans une vigne de Lampertsloch, dans un champ de maïs près de Hatten) ;* en Haute-Alsace (dans une forêt de charmes et de hêtres de la Hardt, près de Mulhouse,dans une forêt de sapins des Vosges entre Thann et Masevaux, dans une autre près deFerrette ; sur une chaume des Vosges, entre la ferme des Neuf-Bois et celle des Rouges-Gazons ; dans des prairies en pâturage près de Roedersdorf ; dans un champ de navetsprès de Sewen ; dans un champ de topinambours près de Roedersdorf) ;* en vieille France (dans la forêt de Fontainebleau, aux abords de la Caverne des 40voleurs près de Barbizon ; dans des terres arables des environs de Reims, de La Chaise(Loiret) et de Tours) ; ainsi qu’une terre noire de Russie ; aux sources <strong>du</strong> Liebfrauenberget <strong>du</strong> château de Fleckenstein, ainsi qu’à la source de l’Ebersbronn, près de Lampertsloch;- « Sur la composition de l’air confiné dans la terre végétale », en collaboration avec Lewy (t.2, 1861, p. 76-131) ;- « Sur le dosage de l’ammoniaque dans les eaux » (t. 2, 1861, p. 170-210). Pour cettenouvelle recherche, menée en 1856 et 1857, Boussingault a notamment mesuré la teneur enacide nitrique dans les pluies, neiges et rosées tombées au Liebfrauenberg ;- « Chaulage de la terre végétale <strong>du</strong> Liebfrauenberg » (t. 3, 1864). Pour cette étude, il aanalysé de la terre végétale chaulée <strong>du</strong> Liebfrauenberg et de la terre végétale non chaulée deMerkwiller ;1
Suivent alors des recherches « pasteuriennes » de Boussingualt fils :- « Sur la fermentation des fruits à noyau » (t. 4, 1868). Cette étude établit la perte en alcool« quelquefois considérable », qu’éprouve la fabrication <strong>du</strong> Kirchenwasser et <strong>du</strong>Zwetschenwasser au Liebfrauenberg, soit dans la fermentation des fruits, soit pendant ladistillation des fruits fermentés. Mais toutes les tentatives de remplacer l’alambic primitif pardes appareils de distillation perfectionnés ont échoué. En effet, si leur emploi atténue la perteen alcool, il contribue toujours à faire perdre aux eaux-de-vie leur arôme caractéristique ;- « Expériences faites en 1854 sur le vin rouge de Lampertsloch » (t. 4, 1868) ;- « Fermentation <strong>du</strong> moût de raisin rouge à Lampertsloch » (t. 4, 1868) ;- « Fermentation des cerises ayant conservé leurs noyaux » (t. 4, 1868). Cette étude s’estbasée notamment sur une cueillette faite au Liebfrauenberg ;- « Fermentation <strong>du</strong> vin blanc des vignes de Lampertsloch » (t. 5, 1875).Agronomie, chimie agricole et physiologie, nouvelle sérieBoussingault relança la publication d’Agronomie, chimie agricole et physiologie en 1886, àla veille de sa mort, pour en faire par conséquent la 3 e édition « revue et considérablementaugmentée » de ses travaux et les ériger ainsi en corps de doctrine. Cette nouvelle sériecomprendra huit volumes, dont le dernier parut en 1891.Dans le premier volume de 1886, on retrouve l’étude intitulée « De la terre végétaleconsidérée dans ses effets sur la végétation », et qui se fondait sur des expériences faites auLiebfrauenberg, vingt-huit ans auparavant, en 1858. Il concluait cette fois « qu’une terreextrêmement fertile, riche en humus, en débris organiques, en phosphate n’a pasnécessairement sur la végétation un effet en rapport avec sa teneur en azote ; que par lanitrification il s’y développe et même il s’y intro<strong>du</strong>it des composés assez assimilables par lesplantes ».Dans le second volume, également paru en 1886, Boussingault publie une étude intitulée« Du terreau et de la terre végétale ». Il y indique qu’il trouva, à des degrés divers, <strong>du</strong>salpêtre (ou nitrate de potasse) dans le terreau de la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn (1,51 g/kg), dansun terreau de feuilles <strong>du</strong> Pechelbronn (5,51 g), dans le terreau de la ferme de Neunreuthershof(l'actuelle Ferme des Anabaptistes) au nord de Haguenau (0,83 g), dans celui d’un jardin deVerrières, au sud de Paris, chez le pépiniériste Louis Vilmorin (0,94 g), ainsi que dans leterreau des maraîchers de Paris (1,07 g).Il mesura également la part d’azote, d’ammoniaque, d’acide phosphorique, de chaux et decarbone appartenant à des matières organiques dans le terreau des maraîchers de Paris, leterreau neuf de Verrières, la terre légère de Bischwiller, la terre légère <strong>du</strong> potager <strong>du</strong>Liebfrauenberg, la terre forte <strong>du</strong> Pechelbronn et la terre d’un herbage d’Argenton (Creuse).Il calcula ensuite les quantités d’ammoniaque contenues dans un hectare, d’après l’azotedosé, et les compara aux quantités d’ammoniaque dé<strong>du</strong>ites de l’ammoniaque réellementdéterminé par l’analyse pour le terreau de Bischwiller, <strong>du</strong> Liebfrauenberg, <strong>du</strong> Pechelbronn,l’herbage d’Argenton et plusieurs lieux d’Amérique latine.Toujours dans le second volume de 1886, il reprend l’étude menée avec Lewy « Sur lacomposition de l’air confiné dans la terre végétale ». Il publie enfin « Sur la quantité1
d’ammoniaque contenue dans la pluie, la neige, la rosée et le brouillard », où sont analysées90 pluies reçues au Liebfrauenberg dans le courant de l’été et de l’automne des années 1856et 1857 (et non plus 77 pluies comme en 1853). Il constata la présence de nitrates. « On nerencontre l’acide nitrique pas seulement dans les pluies d’orage, conclut-il, mais encore dansles pluies recueillies à toutes les époques de l’année ». A la fin de sa vie, Boussingault sebornait donc à confirmer des recherches déjà anciennes de trente années.Le Liebfrauenberg délaissé au profit d’UnieuxEn réalité, depuis 1867, et à l’âge de 65 ans, Boussingault était revenu progressivement àses premières amours : la chimie des métaux. Et cela suite au mariage de sa fille BertheGabrielle avec Jules Gabriel Holtzer, qui était l’héritier de Jacob Holtzer, le fondateur desaciéries d’Unieux, près de Firminy (Loire), entreprise de 500 ouvriers alors, qui participera en1970 à la constitution <strong>du</strong> groupe Creusot-Loire, dont est issu l'actuel Schneider Electric.Boussingault avait <strong>du</strong> éprouver beaucoup d’estime pour Jacob Holtzer. Dans ses jeunesannées, cet orphelin d’un simple forgeur de la manufacture d’armes blanches de Klingenthal,près d’Obernai, avait en effet fait comme lui la route de St-Etienne à pied. Il avait développéson entreprise à la force <strong>du</strong> poignet et était décédé le 9 janvier 1862, à l’âge de soixante ans(25). Pour aider son gendre à pro<strong>du</strong>ire de meilleurs aciers, Boussingault accepta alors de setransporter à Unieux, où un autre laboratoire fut mis à sa disposition.Toutes ses nouvelles trouvailles, il les communiquera à l’Académie des sciences. LesAnnales de chimie et de physique, puis le Bulletin de la Société chimique de Paris nemanquèrent jamais d’en rendre compte. Son nom s’affichait donc désormais dans lesrubriques « Chimie technologique » ou « Chimie minérale », et non plus dans les chroniquesde « Chimie agricole ».Sa première recherche porte sur « le dosage <strong>du</strong> carbone dans la fonte, le fer et l’acier »(26). Boussingault se penche ensuite sur la constitution de « l’acier poule », qui recouvre lefer sortant des caisses à cémentation (27). Puis il s’intéresse à « la limite de la carburation <strong>du</strong>fer » et rend compte d’une expérience visant à « observer la transformation de la fonteblanche en fonte grise » (28). Reprenant des expériences anciennes, le père de la chimieagricole se penche ensuite sur « la siliciuration <strong>du</strong> platine et de quelques autres métaux »(l’iridium, le palladium et le ruthénium) (29).Sujet suivant : « les cristaux d’oxyde de fer magnétique formés pendant le grillage d’unminerai spathique » (30). Le même tome <strong>du</strong> Bulletin de la Société chimique de Paris (p.359-360) rend par ailleurs compte d’une communication de Boussingault sur « ladécomposition <strong>du</strong> bioxyde de baryum dans le vide à la température <strong>du</strong> rouge sombre ». Aprèsquoi, Boussingault commente l’analyse d’un fer, sans doute d’origine météorique, trouvé auBrésil et contenant 34 % de nickel (31).Le père de la chimie agricole, enfin, remet un important mémoire en six parties sur « lapro<strong>du</strong>ction et la constitution des aciers chromés » (32). La dernière partie décrit les procédésqu’il a suivis au Centre des arts et métiers pour doser le chrome et le carbone dans les acierschromés et les ferro-chromes.1
Il faut évidemment admirer l'aisance avec laquelle Boussingault, à 70 ans, a basculé de lachimie agricole vers la chimie métallurgique, exercice sans doute sans précédent dansl’histoire des sciences. Son dernier effort n’a pas été vain, puisque les aciéries d’Unieux selanceront effectivement à partir de 1878 dans la fabrication d’aciers chromés, plus <strong>du</strong>rs etinoxydables, pour la coutellerie et l’artillerie notamment.Jules Holtzer décéda en 1876, à l’âge de 42 ans. L’année suivante, en 1877, Adèle Le Bel,l’épouse de <strong>Jean</strong> <strong>Baptiste</strong> Boussingault, le suivit dans la tombe. Sa fille Berthe Gabrielle,veuve Holtzer, décida alors de s’installer à Paris, et Boussingault, après avoir tenté un retourau Liebfrauenberg, se résolut à l’y rejoindre jusqu’à son propre décès le 11 mai <strong>1887</strong>.Son infidélité à la chimie agricole avait bien sûr fini par agacer certains de ses collègues <strong>du</strong>Cnam. En 1869, Moll trouvait qu’il délaissait par trop sa chaire d’économie rurale et Deligotparlait carrément de transférer les cours d’agriculture <strong>du</strong> Cnam à l’Ecole de Grignon, près deVersailles (33). Au Pechelbronn comme à Unieux, en tout cas, Boussingault aura donnél’exemple d’une synergie des plus intimes entre la recherche scientifique publique et lesentreprises privées… familiales.La dispersionEn 1907, son fils Joseph fera transférer les dépouilles de Marie Joseph Achille Le Bel et deson épouse <strong>du</strong> Liebfrauenberg dans ce qui deviendra le carré Le Bel <strong>du</strong> cimetière deLampertsloch. Le Liebfrauenberg lui-même sera cédé en 1955 par les héritiers Boussingault àl’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, qui en fera un centre derencontres (5). Mais sa précieuse bibliothèque scientifique périt, pendant la dernière guerre,on ne sait par quels détours, dans les décombres de l’ancienne auberge « A l’Ours » deWissembourg (34). ©<strong>Jean</strong>-Claude Streicher (septembre 2008)NOTES :(1) Extrait de l’état civil de Lampertsloch, conservé aux archives <strong>du</strong> <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> pétrole de Merkwiller-Pechelbronn.(2) ABR : 7E56.1/210, référence très aimablement communiquée par M. <strong>Jean</strong> Vogt, Strasbourg.(3) ABR : 7E67.2/71.(4) ABR : 7 E67.2/72.(5) Paul Birkel : « Liebfrauenberg, Ursprung, Werdeganb, Umgebung », Ed. Oberlin, Strasbourg, 1985.(6) ABR : 7E67.3/54.(7) Frederik William James McCosh : « Boussingault », Dordrecht, Holland, 1984.(8) « Discours prononcé le 14 mai <strong>1887</strong> aux obsèques de <strong>Jean</strong>-<strong>Baptiste</strong> Joseph Dieudonné Boussingault,membre de l’Académie des Sciences, professeur pendant 42 ans au Conservateur national des Arts et Métiers,par M. le Colonel Laussedat, directeur de l’établissement », Paris, Impr. Nationale, <strong>1887</strong>, Bibl. Mazarine :50.608, 6 e pièce.(9) Fr. Scheiger et R. Gerst : « Le Liebfrauenberg », dans la brochure intitulée « Cinquantenaire de la section <strong>du</strong>Club Vosgien Soultz-sous-Forêts - Merkwiller, 1924-1974 », Impr. de Wissembourg, 1974, p. 29.(10) Lettre acquise sur eBay par l'Ass. des amis <strong>du</strong> <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> pétrole de Merkwiller-Pechelbronn.(11) ABR : 7E67.2/139.(12) Comptes ren<strong>du</strong>s des séances hebdomadaires de l'Académie des sciences de l'année 1869, t. 69, p.1309-1311, et Annales de chimie et de physique de 1870, t. 20, p. 309-340.1
(13) « Sur la germination des graines oléagineuses, par A. Müntz », Agronomie, Chimie agricole et Physiologie,1874, t. 5.(14) « Statique des cultures in<strong>du</strong>strielles, par A. Müntz : le houblon », Agronomie, Chimie agricole etPhysiologie, 1874, t. 5.(15) Comptes-ren<strong>du</strong>s hebdomadaires de l'Académie des Sciences, 1875, t. 80, p. 178-181, et Agronomie, chimieagricole et physiologie, 1878).(16) « Sur la fermentation des fruits, par Joseph Boussingault », Agronomie, Chimie agricole et Physiologie,1874, t. 5.(17) « Sur une matière sucrée apparue sur les feuilles d'un tilleul », Agronomie, Chimie agricole et Physiologie,1874, t. 5.(18) Annales de chimie et de physique, 1854, t. 40, p. 129-155.(19) <strong>Jean</strong> Labollay : « Le fondateur de la chimie agricole moderne », Comptes ren<strong>du</strong>s de l’Académied’agriculture de France, t. 73, n° 6, 1987.(20) « Rapport sur un travail de M. Georges Ville, dont l’objet est de prouver que le gaz azote de l’air s’assimileaux végétaux », Comptes ren<strong>du</strong>s hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 2e sem. 1855, t. 41, p.757-778.(21) Georges Ville : « Recherche sur la végétation », L’Année scientifique et in<strong>du</strong>strielle, 1858, p. 78-97.(22) Ernest Kahane : « Les attaches alsaciennes de <strong>Jean</strong>-<strong>Baptiste</strong> Boussingault (<strong>1802</strong>-<strong>1887</strong>) », L’Outre-Forêt, n°63, 3e trim. 1988, p. 50-55.(23) Comptes ren<strong>du</strong>s de l’Académie d’agriculture de France, t. 73, n° 6, 1987 ; et <strong>Jean</strong>-Paul Legros : « GeorgesVille (1824-1897) : le chantre des engrais chimiques », dans « D'Olivier de Serres à René Dumont, 26 portraitsd'agronomes », publié avec <strong>Jean</strong> Boulaine chez Lavoisier, Paris, 1998, 317 p.(24) Emile Jungfleisch : « Notice sur Marcellin Berthelot », Bull. de la Société chimique de France, 1913, t. 13.(25) Le Courrier <strong>du</strong> Bas-Rhin, 18 janvier 1862.(26) Annales de chimie et de physique, 1870, t. 19, p. 3-43.(27) Bulletin de la Société chimique de Paris, 1874, t. 22, p. 223-225.(28) Ibid., 1875, t. 24, p. 231-233.(29) Ibid., 1876, t. 26, p. 265-266.(30) Ibid., 1877, t. 28, p. 75-76.(31) Ibid., 1877, t. 28, p. 420.(32) Ibid., 1879, t. 32, p. 667.(33) Ernest Kahane : « Boussingault entre Lavoisier et Pasteur », Jonas Editeur, 78780 Argueil, 1988(34) <strong>Jean</strong> Vogt : « En marge de l’exposition de Wissembourg », L’Outre-Forêt, n° 34, 2e trim. 1981, p. 47.1
Les pionniers de l’or noir <strong>du</strong> Pechelbronn(11) JEAN-BAPTISTE <strong>BOUSSINGAULT</strong>(<strong>1802</strong>-<strong>1887</strong>)___________________________________________________________________________CHAPITRE VLa ferme de MerkwillerD'innombrables auteurs ont situé les expérimentations fondatrices de Boussingault dans la fermeque celui-ci s'était fait construire à la sortie <strong>du</strong> village de Merkwiller, sur le côté gauche de la route deWoerth, en contradiction absolue avec ce que lui-même en avait écrit dans son Economie rurale. Laplupart des biographes <strong>du</strong> père de la chimie agricole se sont donc permis d'écrire sur lui sans sedonner la peine de consulter ses publications ! Par la falsification la plus grossière, ils ont donc faitde cette ferme Boussingault de Merkwiller-Pechelbronn la première ferme modèle et la premièreferme expérimentale au monde. Dans la réalité, celle-ci n'a été modèle que pour sa fosse à fumier,conçue par Boussingault lui-même. Et concernant les expérimentations, elle n'a fourni que quelqueséchantillons d'analyses et n'a accueilli qu'un seul essai en vraie grandeur, de culture intensive <strong>du</strong>tabac. Et cela en 1857 seulement, donc plus de vingt ans après les premières expérimentations dechimie agricole lancées par Boussingault à la ferme Le Bel <strong>du</strong> Pechelbronn.Pendant quatre ans, de 1842 à 1846, et en dépit de leur partage <strong>du</strong> 9 mars 1843, Louis FrédéricAchille Le Bel et Adèle Boussingault firent encore une quinzaine d'acquisitions en commun deterres et de prés dans les villages des alentours <strong>du</strong> Pechelbronn. Puis subitement, le 28 septembre1849, ils décidèrent de mettre fin à cette indivision. Ils se partagèrent alors ces terres acquises encommun depuis 1842 ainsi qu'un reliquat oublié de la succession de leurs parents. C'est ainsi que ledomaine agricole <strong>du</strong> couple Boussingault s'accrut encore de 440,61 ares de prés et de 116,64 ares deterres dans les bans de Biblisheim, Gunstett, Kutzenhausen, Lampertsloch, Surbourg etSchwabwiller.Ce second partage s'explique sans doute par le fait qu'entre temps Boussingault avait décidé defonder sa propre exploitation agricole à la sortie ouest de Merkwiller, en bor<strong>du</strong>re sud de la route deWoerth, donc au centre géographique de la moitié qui lui était échue. « Les terres de Bechelbronnayant été divisées par suite d'une succession, raconte-t-il, je me suis trouvé dans la nécessitéd'élever des bâtiments d'exploitation. Tout était à créer. » Il fit construire cette ferme de toutespièces en grès rose des carrières voisines de Mitschdorf, et non pas en torchis et colombage. Elleprit le nom de ferme Boussingault, qu’il bailla à un natif de la localité, un dénommé Hirlemann,suivant un acte notarié qu'il reste à découvrir (peut-être dans le notariat de Woerth ?).C'est à cette ferme qu'Adèle Le Bel, épouse Boussingault, convoquera le 30 mai 1853 le notairede Soultz Frédéric Petri pour conclure le rachat à Louise Roessel, femme sans état de Charles Wüstle jeune, charron à Lobsann, un pré de 16 ares, canton im Bruch, ban de Kutzenhausen, pour 450francs (1). Mais c'est à notre connaissance le seul acte conclu par le couple « à la ferme de M.Boussingault à Merkwiller ».Fosse à fumier modèleLe père de la chimie agricole aura évidemment le souci d'en faire une exploitation modèle. Elle lesera non pas seulement par la disposition très espacée de ses bâtiments, mais aussi et surtout par la
fosse à fumier, que Boussingault y fit aménager en 1848. Il conçut celle-ci « d’après les principesqui (lui avaient) semblé les plus rationnels ». C’était donc une fosse « complètement étanche,munie d’une purinière et traversée par une chaussée de trois mètres de large, construite en pavésréunis par <strong>du</strong> ciment (pour le) passage des voitures ».Large de 7 m, longue de 11 m, elle avait une superficie de 77 m 2 . Les urines de l’étable et del’écurie y aboutissaient par des caniveaux souterrains. Le sol de ces étable et écurie avait lui-mêmeété ren<strong>du</strong> imperméable au moyen d’une couche de béton. Quant à la capacité <strong>du</strong> puits à purin, elleavait été calculée d’après la pluviométrie locale. Le purin en était élevé au moyen d’une pompeaspirante, comme c’était déjà l’usage dans le pays, et déversé sur le fumier à l’aide d’un vieux tuyaude pompe à incendie en cuir. La cour de ferme avait été macadamisée, « à l’exception des abordsde la fosse, qui (étaient) entourés de quatre bandes de pavés parallèles de chacun des deux côtés ».Ainsi, Boussingault voulait-il éviter la perte de la moindre goutte de liquide fertilisant et « quetoutes les matières utiles que fournissent les étables (soient) intégralement réunies et conservées ».Il était si fier de sa réalisation qu’en 1858 il y consacra une de ses leçons au Conservatoireimpérial des arts et métiers (le Cnam actuel) à Paris. Leçon qu’il put faire imprimer la même année,illustrée de trois schémas, et qu’il dédicaça au directeur <strong>du</strong> Cnam, le général et mathématicienArthur Jules Morin (2)Boussingault ne manqua évidemment pas d’analyser un échantillon moyen de son fumier hachéde Merkwiller et d’en comparer la composition chimique (à l’état normal, puis supposé sec) aveccelle <strong>du</strong> fumier de la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn et celle <strong>du</strong> fumier à demi consommé <strong>du</strong> Liebfrauenberg(taux de matières organiques, d’acide phosphorique, d’acide sulfurique, de chlore, de potasse etsoude, de chaux, de magnésie, d’oxyde de fer et de manganèse, de silice, sable et argile, et d’eau).Parallèlement au bitume, le père de la chimie agricole avait donc le souci de valoriser, à la goutteprès, un second or noir : le purin !Dans son article « Des soins à donner aux fumiers », paru en 1852 dans les Annales agricoles etlittéraires de la Dordogne (t. 3, p. 10-12), par contre, il avait pris exemple sur les fermes de laFlandre <strong>français</strong>e et recommandé de tasser assez fortement le fumier, comme au Pechelbronn,« pour qu’un chariot chargé, attelé de quatre chevaux, puisse passer à sa surface sans trop dedifficultés ».Il n'en reste pas moins que dans cette partie il a été devancé par Charles Henri Schattenmann, le directeurdes mines de lignite et d'alun de Bouxwiller. Dès 1847, celui-ci avait en effet présenté son propre concept defosse à fumier au concours d'idées de la Société des sciences, agriculture et arts <strong>du</strong> département <strong>du</strong> Bas-Rhin. Cequi lui valut de remporter la médaille d’or. Car sa fosse pro<strong>du</strong>isait simultanément <strong>du</strong> purin filtré (pour l’épandagedes prairies à la manière suisse) et <strong>du</strong> fumier. Avec ses 24 m X 12 m, elle était deux fois plus grande que celle deBoussingault, puisque constituée de deux bassins de faible profondeur, s’inclinant vers un collecteur central depurin. Un mur de revêtement en béton, couvert de dalles, la bordait sur trois côtés. Son fond était pareillementbétonné.Quant au réservoir à purin, il était « garni d’une pompe et d’un cuveau de filtration ». Conçue pour les grandesexploitations, cette fosse avait un coût de construction de l’ordre de 1 600 francs. Mais en employant des pavés,de la pierraille et de la terre glaise à la place <strong>du</strong> béton, et en prenant une vieille cuve enterrée comme réservoir àpurin, le petit cultivateur pouvait ré<strong>du</strong>ire cette dépense à 100-200 francs.Charles Henri Schattenmann a par ailleurs pu récupérer le fumier de 200 à 300 chevaux d’artillerie encantonnement à Bouxwiller. Il le plaçait alors dans une fosse à deux compartiments de 400 m², jusque sur unehauteur de trois à quatre mètres. Il y ajoutait <strong>du</strong> sulfate de fer, de l’acide sulfurique ou de l’acide muriatique, cequi convertissait l’ammoniaque <strong>du</strong> fumier en sulfate ou muriate d’ammoniaque, et en augmentait par conséquentla <strong>du</strong>rée et la richesse.Toutes les semaines, Schattenmann faisait en outre verser dans cette fosse les matières fécales des latrines desécoles de Bouxwiller, que fréquentait alors un millier d’enfants. Il les prenait au moyen de cuves mobiles, dans
lesquelles il faisait mettre d’avance, pareillement, une dissolution de sulfate de fer. Cette substance désinfectaitles matières fécales, empêchait toute émanation nuisible ou incommode, tout en convertissant l’ammoniaque ensulfate d’ammoniaque (3).Boussingault n’ignorait rien des inventions de Schattenmann. Il les évoque dans « Economie rurale » (p.692-693, 701 et 779-780 <strong>du</strong> premier tome de la seconde édition) et sans la moindre jalousie, puisque page 701 ilqualifie Schattenmann « d’habile directeur de l’usine de Bouxwiller » (et non pas de sa ferme modèle ?).Une expérimentation sur le tabacAutour de sa ferme de Merkwiller, Boussingault a cultivé des topinambours, des betteraves et despommes de terre. Mais à notre connaissance, il n'y mena qu'une grande expérimentation. C'était en1857 pour évaluer les besoins en fumier de ferme d'une culture intensive de tabac sur une parcellede 18,45 ares. Il prit évidemment ce fumier dans sa fosse modèle. Ramené à la superficie d'unhectare, cette plantation aurait été constituée de 31 111 plants et aurait consommé 106 244 kg defumier normal. Il conclua qu'à condition de disposer de fumier en abondance (les eaux usées desgrandes villes par exemple), il devait être possible de faire deux récoltes de tabac (une récolte et unregain) dans l'année.Il prévoyait ensuite de faire la même expérimentation pour chacune des autres grandes culturesin<strong>du</strong>strielles alors pratiquées en Alsace (le houblon, le chanvre, le lin et la garance) (4). Mais il n'eneut plus la possibilité. A la veille de la guerre de 1870, par contre, il put confier la « statique » <strong>du</strong>houblon à son élève Achille Müntz, qui la réalisa pendant ses vacances d'été dans une houblonnièrede 38 ares de Woerth (de ses oncles maternels, les Trautmann ?) et en profitant des instruments delaboratoire dont le père de la chimie agricole s'était dotés au Liebfrauenberg (5).Accessoirement, la ferme de Merkwiller fournit également à Boussingault différents échantillonspour des analyses comparatives plus larges. Le 7 octobre 1856, puis de nouveau le 12 août 1857, lepère de la chimie agricole calcula ainsi la part de nitrate de potasse contenue dans un kilogramme,un litre ainsi qu'un mètre cube de terre desséchée provenant d'une de ses pièces de topinambour deMerkwiller (6). A la même époque, il mesura également le taux d'ammoniaque contenu dans un litred'eau <strong>du</strong> puits de sa ferme de Merkwiller pour le comparer à celui d'un grand nombre d'autres puits,dont celui de la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn ainsi qu'à celui d'un puits de 60 m de profondeur de la minede bitume (7).En 1858, enfin, Boussingault utilisa également des échantillons de sa terre de Merkwiller, avecdes prélèvements de nombreuses autres provenances (dont le Liebfrauenberg), pour analyser lesapports chimiques <strong>du</strong> chaulage (8). Il parvint ainsi à mettre en évidence une double phénomènechimique extrêmement important, qui justifiait entièrement le chaulage, phénomène qu'AchilleMüntz, son continuateur, signale encore en 1891 dans le 3e tome de son propre ouvrage, « Lesengrais ».Ce double phénomène, le voici : en désagrégeant la matière organique végétale ou animale, lachaux vive en dégage l'azote à l'état d'ammoniaque. Sous cette forme, l'azote peut être directementutilisé par les plantes et se prête mieux à la nitrification. Mais cette nitrification ne peut reprendreque lorsque la chaux est complètement transformée en carbonate et lorsqu'elle cesse de pro<strong>du</strong>ire del'ammoniaque. Müntz en avait refait la démonstration en se fondant sur les tableaux des résultatsque Boussingault avait obtenus sur les terres <strong>du</strong> Liebfrauenberg et de Merkwiller (9).
Fin de la ferme BoussingaultLa ferme Boussingault de Merkwiller ne tardera pas hélas à être rattrapée par l'extensionincessante des exploitations pétrolières. En 1873, on ouvrit ainsi dans ses proches parages le puitsHenry pour donner de l'aération aux galeries <strong>du</strong> puits Georges, dont l'entrée se trouvait pour sa partdans l'angle sud-ouest <strong>du</strong> domaine <strong>du</strong> Pechelbronn. Ce nouveau puits retrouva les nappes <strong>du</strong> puitsGeorges. Mais il y eut fin 1873, début 1874, des irruptions d'huile, de sable mouvant, d'eau et degaz si violentes que les travaux dans les galeries <strong>du</strong>rent y être interrompus. Le 15 janvier 1877, denouvelles irruptions de sable et d'huile s'y pro<strong>du</strong>isirent. On décida alors d'ouvrir un nouveau puits,dit André, à 250 m de distance en direction <strong>du</strong> sud-est, qui communiqua avec le puits Henry le 10mars 1879.A la veille de la première guerre mondiale, le fermier de la ferme Boussingault eut ensuitel’honneur d’héberger pendant les vacances d’été, un petit neveu natif de Lembach, le jeune CharlesAltorffer, futur pasteur, futur député de Wissembourg et futur maire de Strasbourg (10). Puis en1912, l'exploitation devint le siège d’une compagnie de voiturage de pro<strong>du</strong>its pétroliers. En 1923, laSAEM Pechelbronn la racheta pour la démolir et déployer sur ses 173,07 ares de dépendances unecité ouvrière d’une quarantaine de logements, alors appelée « Kolonie » ou Cité Boussingault. Ceslogements sont à présent propriété de leurs habitants (11).Paul de Chambrier s'était donc trompé lorsque dans son « Historique de Péchelbronn » il écrivit,page 31, les lignes suivantes : « Ceux qui connaissent Péchelbronn savent qu’à quelques centainesde mètres de là, à la sortie <strong>du</strong> village de Merkwiller sur la route de Woerth, se trouve la fermeBoussingault, où furent faites tant d’expériences restées célèbres dans les annales de la chimieagricole » (12).D'innombrables auteurs se fondèrent ensuite sur cette affirmation pour prétendre, en oppositionabsolue à ce que Boussingault avait écrit dans ses ouvrages, que cette ferme avait été la premièreauthentique station agronomique <strong>du</strong> territoire <strong>français</strong>. Le panneau commémoratif, qui a étéinauguré en décembre 2002, en présence de la population et des élus locaux, pour le bicentenaire dela naissance de Boussingault, devant l’emplacement de sa ferme de Merkwiller, est donc lui-mêmeerroné, lorsqu’il proclame celle-ci « première ferme expérimentale <strong>du</strong> monde ». ©<strong>Jean</strong>-Claude Streicher (septembre 2008)NOTES :(1) ABR : 7E56.2/92.(2) « La fosse à fumier, par M. Boussingault, de l’Académie des sciences. Leçon professée au Conservatoire impérialdes arts et métiers », Paris, Béchet Jeune, libraire-éditeur, 1858, 64 pages (Bibl. <strong>du</strong> Cnam, Paris) (BNF : S-23811).(3) Charles Henri Schattenmann : « Mémoire sur la construction des fosses à fumier, sur le traitement des fumiers et surl’emploi des engrais liquides, présenté à la Société des sciences, agriculture et arts <strong>du</strong> département <strong>du</strong> Bas-Rhin, etcouronné par cette société le 27 décembre 1846 », 1ère édition de 1847 et 2e édition de 1862, Strasbourg.(4) « Statique des cultures in<strong>du</strong>strielles de l'Alsace, Premier mémoire : 1858, t. 46, le tabac, par M. Boussingault »,Comptes ren<strong>du</strong>s des séances de l'Académie des sciences, séance <strong>du</strong> 31 mai 1858, p. 1007-1019, et « Statique descultures in<strong>du</strong>strielles de l'Alsace : le tabac, par M. Boussingault », Journal d'agriculture pratique, 1er semestre 1858, p.539-544).(5) Achille Müntz : « Statique des cultures in<strong>du</strong>strielles : le houblon », Agronomie, chimie agricole et physiologie,1874, t. 5, p. 64-80.(6) Agronomie, chimie agricole et physiologie, 1886, t. 2, p. 47 et 62.(7) « Sur le dosage de l'ammoniaque, par M. Boussingault », Agronomie, chimie agricole et physiologie, 1886, t. 2, p.172.(8) « Etude sur le chaulage des terres arables, par M. Boussingault », Annales <strong>du</strong> conservatoire impérial des arts et
métiers publiées par les professeurs, t. 2, 1862, p. 21-256.(9) « Les engrais », par A. Müntz et A.-Ch. Girard, respectivement professeur et chef des travaux chimiques à l'Institutnational agronomique, Paris, 1891, t. 3, p. 220-225.(11) Charles Weick : « Un homme de chez nous : Charles Altorffer. Mémoires de jeunesse, 2e partie », L’Outre-Forêt, n°63, 3e trim. 1988, p. 4-11.(11) J.M. Scheydecker : « Une cité ouvrière à Merkwiller-Pechelbronn : la cité Boussingault », Cahiers de l’Institutd’urbanisme et d’aménagement régional, Univ. des sciences sociales de Strasbourg, 1981-82, n° 3-4, p. 122-135. Trèsaimablement communiqué par M. Daniel Rodier, vice-président des Amis <strong>du</strong> <strong>Musée</strong> de Merkwiller-Pechelbronn.(12) Paul de Chambrier : «Historique de Péchelbronn, 1498-1918», Paris-Neuchâtel, Attinger frères, 1919, 329 p.
Les pionniers de l’or noir <strong>du</strong> Pechelbronn(11) JEAN-BAPTISTE <strong>BOUSSINGAULT</strong>(<strong>1802</strong>-<strong>1887</strong>)___________________________________________________________________________CHAPITRE VIDisciples et émules alsaciensLouis Frédéric Achille Le BelLouis Frédéric Achille Le Bel prendra goût à ces recherches agronomiques. Formé à l’école <strong>du</strong>père de la chimie agricole, il transmettra par la suite à la Société d’agriculture de France à Paris desrapports sur le pralinage <strong>du</strong> blé (en 1849), les fourrages cuits (en 1852), le calcul <strong>du</strong> prix de revientdes vaches (en 1852), l’emploi <strong>du</strong> tourteau de pavot dans l’alimentation <strong>du</strong> cheval (en 1853), le prixde revient <strong>du</strong> porc (en 1858), et, pour finir, sur celui <strong>du</strong> mouton (en 1864) (32).Il eut l’idée d’alterner le topinambour avec la luzerne et cherchera des remèdes à la terriblemaladie des pommes de terre de la fin des années 1840. Membre de la Chambre d’agriculture <strong>du</strong>Bas-Rhin, il exposera les plus beaux échantillons de ses cultures aux comices agricoles annuels del’arrondissement de Wissembourg et publiera le tableau des rendements annuels de ses différentescultures de 1845 à 1864. Toutes choses qui lui vaudront de remporter en mai 1859 la deuxièmemédaille d’or <strong>du</strong> Concours régional agricole de Strasbourg (Le Courrier <strong>du</strong> Bas-Rhin, samedi 28mai 1859).Eugène Adolphe OppermannBoussingault sut également communiquer le virus <strong>du</strong> perfectionnement agronomique à EugèneAdolphe Oppermann. Né à Strasbourg le 19 mai 1816, celui-ci avait épousé Louise Kraus, née poursa part à Wissembourg le 20 janvier 1825. Elle pourrait donc être une fille des frères Kraus,marchands de draps à Wissembourg, dont une sœur, Louise Salomé, avait épousé Marie JosephAchille Le Bel, et l’autre, Rosine Barbe, Auguste Mabru, neveu de Marie Joseph Achille etdirecteur des travaux souterrains au Pechelbronn.Eugène Adolphe Oppermann, indique Boussingault, était venu s’exercer la ferme <strong>du</strong> Bechelbronn« à la pratique de l’agriculture ». Le père de la chimie agricole en profita pour lui confier au moinsdeux expérimentations : l’une sur l’intérêt de donner aux génisses <strong>du</strong> fourrage sec préalablementtrempé dans l’eau (« Economie rurale… », 1851, t. 2, p. 333-335), l’autre sur l’emploi de chaux, decendres et de sulfate d’ammoniaque comme engrais contre la maladie des pommes de terre. Uneexpérimentation, dont Oppermann rendra compte à la Société d’agriculture <strong>du</strong> Bas-Rhin en mars1848 (Dr D. Goldschmidt : « Historique de la Société des sciences, agriculture et arts <strong>du</strong> Bas-Rhindepuis sa création jusqu’en 1870 », Strasbourg 1899, 36 p.).Oppermann prit ensuite à bail le Neunreuthershof, aujourd'hui appelé Ferme des Anabaptistes, aunord de Haguenau, à la lisière de la Forêt Sainte, où les recensements de population de 1851 et 1856signalent sa présence, en compagnie de son épouse et de plusieurs domestiques et servantes
originaires des environs <strong>du</strong> Pechelbronn (Lembach, Dürrenbach, Cleebourg, Lampertsloch,Oberkutzenhausen…) (Renseignements très aimablement communiqués par M. Michel Traband,conservateur des archives municipales de Haguenau).Boussingault convainquit Oppermann d’y intro<strong>du</strong>ire le topinambour. En 1851, l’élève eut ainsi àcœur de vérifier par l’expérimentation une hypothèse chère au père de la chimie agricole, à savoirque le rendement des tubercules de topinambour diminuait à mesure qu’on en coupait les feuilles etles tiges pour le fourrage. Il rendit compte de la première partie de cette expérimentation dans leBulletin de la Société des sciences, agriculture et arts <strong>du</strong> département <strong>du</strong> Bas-Rhin <strong>du</strong> début del'année 1852, en n'omettant pas de citer l'« Economie rurale » que Boussingault venait de faireparaître à Paris (« Quelques observations sur les topinambours », p. 421-423). Boussingault enpersonne tint ensuite à présenter cette expérimentation en son entier devant la Société impériale etcentrale d’agriculture de France, à la séance <strong>du</strong> 20 avril 1853 à Paris, en citant Eugène AdolpheOppermann comme un modèle d’« agriculteur instruit » (Bulletin des séances de la Sociétéimpériale et centrale d’agriculture, t. 8, 1852-1853, p. 266-269).Oppermann, cependant, était membre correspondant de cette Société des sciences, agriculture etarts <strong>du</strong> département <strong>du</strong> Bas-Rhin dès 1846. Dès le second semestre 1846, il avait donc pu publierdeux études dans le bulletin de cette société savante :− « Notice sur les sociétés d'agriculture <strong>du</strong> grand <strong>du</strong>ché de Hesse-Darmstadt » (p. 101-120). Il yrelève que grâce aux efforts de ces sociétés il se bâtissait au moins 45 nouvelles fosses à fumierpar an dans cette principauté ;− « Rapport à la société sur la question de l'utilité des chevaux comparée avec celle des bêtes àcornes » (p. 120-127). Il s'y élève en des termes très vigoureux contre la stupidité d'une décision<strong>du</strong> conseil général <strong>du</strong> Bas-Rhin, qui avait institué des primes en faveur des cultivateurs quiremplaceraient leurs chevaux par des boeufs. « Il n'y a rien d'absolu en agriculture, proteste-t-il.Ce n'est pas au moyen de petites primes qu'on détruira certaines vanités à propos de lapossession des chevaux. Nos cultivateurs ne sont pas routiniers au point de résister auxarguments de cette dernière catégorie. D'ailleurs, on trouvera en Alsace plus d'un district oùl'usage d'employer des boeufs est parfaitement établi, mais toujours là où il y a intérêt véritableà s'en servir. »Et pour prouver que bovins et chevaux ne s'excluaient pas l'un l'autre, Eugène AdolpheOppermann cite une expérimentation suivie en octobre 1845 à la ferme de Bechelbronn« d'après les indications de M. Boussingault ». Celle-ci a consisté à mesurer le temps mis par unattelage de chevaux et un autre composé d'un boeuf et d'une vache de forte taille marchant bienensemble pour labourer un hectare de terrain de qualité variable (assez meuble, en bon état delabour et très meuble). Elle a montré que l'attelage de chevaux n'a été le plus rapide que pour leterrain très meuble (Bulletin de la Société des sciences, agriculture et arts <strong>du</strong> département <strong>du</strong>Bas-Rhin, 3e et 4e trimestres 1846).Au début de 1852, en même temps que « Quelques observations sur les topinambours », EugèneAdolphe Oppermann avait également publié des « Observations sur la maladie des pommes deterre », elles aussi rédigées au Neunreuthershof le 22 mars 1852. Il y rappelle l'observation qu'ilavait faite à la ferme <strong>du</strong> Bechelbronn, à l'occasion de l'expérimentation qu'il avait présentée en mars1848. A savoir qu'il a eu comparativement moins de pommes de terre malades dans unemplacement plus exposé à l'humidité qu'un autre. Il refit cette même observation en 1851 à saferme <strong>du</strong> Neunreuthershof, « d'une manière frappante ».« Toutes mes plantations de pommes de terre, raconte-t-il, se sont trouvées dans un terrainhumide à sous-sol imperméable et les pluies continuelles ont encore augmenté ces conditionsdéfavorables au point qu'il a fallu à plusieurs reprises ouvrir des sillons pour laisser écouler le
trop plein d'eau. La végétation s'est soutenue fort belle pendant quelque temps, puis l'excèsd'humidité a fait passer en putréfaction une partie des tubercules, toutefois sans aucun des signesparticuliers à la maladie. Enfin, les tiges se sont fanées subitement, cette fois avec toutel'apparence d'un invasion <strong>du</strong> mal, et malgré cela on n'a trouvé qu'une quantité tout à faitinappréciable de pommes de terre malades. L'humidité qui a particulièrement empêché ledéveloppement des tubercules a provoqué cette pourriture molle, connue depuis longtemps, et aainsi beaucoup ré<strong>du</strong>it la récolte, mais il n'y a eu presque pas de traces de la maladie. Ce n'est doncpas de ce côté qu'il faudrait en chercher la source, et j'ai acquis la conviction qu'elle estindépendante d'un excès d'eau » (Bulletin de la Société des sciences, agriculture et arts <strong>du</strong>département <strong>du</strong> Bas-Rhin, 1er et 2e trim. 1852, p. 423-424.)En 1853, Auguste Mabru, l'ancien directeur des travaux <strong>du</strong> Pechelbronn, qui s'était installé rueEntenlach à Haguenau, se proposa de fabriquer de la résine de pin en association avec EugèneAdolphe Oppermann, et alla jusqu'à demander à la municipalité de Haguenau de leur réserver à ceteffet un canton de la forêt de Haguenau à titre d'essai (Arch. mun. de Haguenau : Df1, réf. <strong>Jean</strong>Vogt, Strasbourg). Mais le projet n'eut pas le temps de se concrétiser, Mabru étant décédé le 7novembre 1853.Oppermann ne paraît pas être resté longtemps au Neunreuthershof. En 1859, en effet, il est citécomme propriétaire à Oberhausbergen, puis en 1869 comme « propriétaire agronome » àSchiltigheim.Il s'affirme ensuite comme auteur assez prolixe de rapports et de synthèses. En 1859, il publie lerésultat de ses essais comparatifs d'engrais pour la fumure de ses prairies <strong>du</strong> Neunreuthershof. Ilrédige un mémoire sur la question mise au concours en 1858 par la Société des sciences, agricultureet arts <strong>du</strong> Bas-Rhin, et qui portait sur la réalité des progrès de l'agriculture en Alsace depuis 1789.En 1861, avec Félix de Dartein, il publie une « Description agricole <strong>du</strong> département <strong>du</strong> Bas-Rhin »,premier ouvrage <strong>du</strong> genre depuis l'enquête commandée par le préfet <strong>du</strong> Bas-Rhin Lezay Marnésiaen 1811 à l'agronome allemand <strong>Jean</strong> Népomucène Schwerz. La même année, il rédige encore unrapport sur la ferme modèle de Charles Henri Schattenmann à Bouxwiller. Ces deux travaux serontpubliés par le Bulletin agricole de la Société d’agriculture et des 4 comices <strong>du</strong> Bas-Rhin etlargement repris par le Courrier <strong>du</strong> Bas-Rhin.Oppermann est ensuite chargé par la Société des sciences, agriculture et arts d'évaluer la valeurd'un « engrais artificiel », dit « guano artificiel », élaboré par l'un de ses membres, M. Jacquemin,professeur adjoint à l'Ecole supérieure de pharmacie de Strasbourg et directeur <strong>du</strong> Laboratoirepublic de chimie agricole <strong>du</strong> Bas-Rhin. Fabriqué à la Montagne Verte, au sud de Strasbourg, cetengrais reconvertissait le caillot des abattoirs strasbourgeois, pendant que le sang servait à pro<strong>du</strong>irel'albumine utilisé pour l'impression des tissus. Une dizaine de propriétaires adhérents voulurent bientester ce nouveau pro<strong>du</strong>it, dont Louis Frédéric Achille Le Bel. Mais les résultats furent mitigés, et lafabrication rapidement arrêtée.Bien qu'il était devenu l'un des deux secrétaires adjoints de la Société des sciences, agriculture etarts <strong>du</strong> Bas-Rhin, Oppermann en démissionna en 1866 pour un motif non précisé. Il se lance alorsdans la rédaction d'un nouveau rapport sur la situation agricole <strong>du</strong> département <strong>du</strong> Bas-Rhin. C'estun volume de 216 pages, intitulé « Etat de l'agriculture <strong>du</strong> département <strong>du</strong> Bas-Rhin et moyens del'améliorer », que la Société des sciences, agriculture et arts couronna dans sa séance <strong>du</strong> 2 décembre1868 et aidera à publier et diffuser. Oppermann y cite abondamment l'Economie rurale deBoussingault, « (s)on éminent maître », ainsi que les rendements de la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn, maiscurieusement ne dit aucun mot des rendements annuels publiés par Louis Frédéric Achille Le Bel. Ily démontre également que l'agriculture bas-rhinoise était alors en déficit de 7 millions de quintauxmétriques de fumier de ferme par an.
Oppermann est réadmis dans la Société, par vote, à la séance <strong>du</strong> 2 juin 1869. La Société le chargealors, avec cinq autres membres, de rédiger l'enquête agricole pour le département <strong>du</strong> Bas-Rhindemandée par le ministre de l'agriculture. Sa dernière intervention connue a consisté, à la séance <strong>du</strong>4 août 1869, à recommander un engrais mélangeant aux matières fécales le tan des tanneriesHerrenschmidt <strong>du</strong> Wacken à Strasbourg (d'après les Nouveaux mémoires de la Société des sciences,agriculture et arts <strong>du</strong> Bas-Rhin, 1859-1870).Eugène Adolphe Oppermann ne doit pas être confon<strong>du</strong> avec Charles Frédéric Oppermann(1805-1872), professeur de toxicologie et de physique, puis de pharmacie à l'Ecole de pharmacie deStrasbourg à partir de 1835, puis directeur de cette école à partir de 1852, membre puis président dela Société d'histoire naturelle de Strasbourg, conseiller municipal de Strabsourg, nommé par lepréfet en janvier 1854, et auteur notamment d'une thèse de doctorat sur les poisons végétaux (1845),d'une “Analyse de l'eau minérale de Soultzbach” (1853) et d'une “Notice sur les eaux minérales <strong>du</strong>département <strong>du</strong> Bas-Rhin” (1851).Cette confusion a notamment été faite par François Igersheim dans “Politique et administrationdans le Bas-Rhin, 1848-1870” (Presses universitaires de Strasbourg, 1993, 832 pages).Frédéric Alphonse MusculusLa Ferme des Anabaptistes au nord de Haguenau (photo JCS, août 2007).Frédéric Alphonse Musculus (1829-1888). C'est le fils <strong>du</strong> pharmacien de Soultz-sous-Forêts. Pouréchapper à la routine de l'officine paternelle, il s'était orienté vers la pharmacie militaire. Il profitaensuite d'une affectation au fort de Vincennes pour fréquenter le laboratoire de Boussingault à Paris.Celui-ci lui dit alors que s'il « pouvait travailler d'une façon plus suivie, il ferait une carrièrescientifique considérable ». Musculus concentra ses travaux sur l'amidon et inventa un alcoolomètrefondé sur la capillarité.Après avoir participé à la campagne militaire de 1870 en Basse-Alsace même, il reprit en 1872 lasuccession de son père, décédé. Puis il est nommé pharmacien en chef à l'hôpital de Strasbourg, où
il étudie la décomposition de l'urée. Ses recherches sur l'amidon l'amènent à s'intéresser à lafabrication de la bière, donc à collaborer avec Gruber, le fondateur de la brasserie deKoenigshoffen. Frédéric Alphonse Musculus présidait également la Société des sciences,agriculture et arts de la Basse-Alsace et siégeait au Conseil d'hygiène de la ville de Strasbourg(Edouard Sitzmann : “Dictionnaire de biographie des hommes célèbres d’Alsace », t. II).C'est également via le Pechelbronn que Frédéric Alphonse Musculus put garder le contact avec leschimistes parisiens, après le désastre de 1870-1871. A la séance <strong>du</strong> 5 juillet 1872 de la Sociétéchimique de Paris, alors présidée par M. Schützenberger, Joseph Achille Le Bel, qui n'avait que 25ans, se chargea ainsi de présenter une note <strong>du</strong> pharmacien strasbourgeois sur ses derniers travauxconcernant « la transformation <strong>du</strong> glucose en une matière analogue à la dextrine ». Cette note seraencore publiée la même année par le Bulletin de la Société chimique de Paris (« Note de M.Musculus sur la transformation <strong>du</strong> glucose en une matière analogue à la dextrine », Bulletin de laSociété chimique de Paris, 2 e semestre 1872, p. 49 et 66-67).Frédéric BrustleinIl est a priori originaire de Mittelhausbergen, près de Strasbourg. Nous ignorons comment ils sesont rencontrés. Boussingault en tout cas lui confia vers 1857-1858 une importante étude consistantà trouver enfin une explication chimique à l'absorption de l'ammoniaque (agent fertilisant parexcellence) par le sol. De nombreux savants (Way, Henneberg, Stohmann...) s'étaient déjà penchéssur la question. Question qui avait commencé à se poser en 1848, lorsque Huxtable et Thompsons'étonnerèrent que le purin filtré par la terre donnait « un liquide incolore dépourvu de mauvaiseodeur ».Frédéric Brustlein mena cette étude au laboratoire de Boussingault au Conservatoire des arts etmétiers et se servit de l'appareil à doser rapidement et avec exactitude l'amoniaque que le père de lachimique agricole avait imaginé. En bon Alsacien et disciple dévoué, il prit ses échantillons enAlsace :− le premier à Bechelbronn (sic) dans une sole de topinalbours. C'était « une argile ténue,compacte, assez riche en carbonate de chaux, pouvant retenir une forte quanité d'eau etacquérant par la dessiccation une grande <strong>du</strong>reté » ;− le second dans le potager <strong>du</strong> Liebfrauenberg. C'était « un sable quartzeux très riche en débrisorganiques, restes d'anciennes et fortes fumures » ;− et le troisième sur les coteaux de Mittelhausbergen. C'était un lehm très riche en carbonate dechaux, peu plastique, mais de constitution très homogène.Il prit également <strong>du</strong> terreau retiré d'un chêne creux de la forêt de Goersdorf, de la tourbe, <strong>du</strong> noiranimal en grains, <strong>du</strong> noir animal calciné au-dessous <strong>du</strong> rouge, et <strong>du</strong> noir animal lavé à l'acide etlavé. Comme Thomson et Way, il conclut de ses expériences « qu'une eau très chargéed'ammoniaque ne traverse pas la terre comme si elle traversait un filtre. L'alcali est retenu, qu'ilsoit à l'état libre ou à l'état de sel ».Mais Brustlein alla plus loin que ses prédécesseurs en affirmant que « la propriété de la terrearable d'absorber l'ammoniaque dépend presque exclusivement de la constitution physique dessubstances minérales et même des matières organiques dont elle est formée. L'existence d'uncarbonate dans le sol est indispensable pour que la terre décompose un sel ammoniacal en enretenant la base » (Frédéric Brustlein : « Sur les propriétés absorbantes de la terre arable »,Annales de chimie et physique, 1859, t. 56, p. 157-10).Frédéric Brustlein fut récompensé de son zèle en devenant le préparateur <strong>du</strong> cours de chimie
agricole de Boussingault au Conservatoire des arts et métiers. En d'autres termes, il se chargeait degérer les expérimentations décidées par le grand maître. Il devint même son intime. FrédéricBrustlein se trouva ainsi au Liebfrauenberg à l'été 1859, lorsque Boussingault y reçut la visite del'un de ses alter ego allemands, le Dr C. Stöckhardt, conseiller aulique de Saxe et professeur dechimie à l'Académie royale agrononique et forestière de Tharand, près de Dresde. Celui-ci, écritBrustlein, « n'avait pas voulu traverser la France sans visiter Bechelbronn et le Liebfrrauenberg,où ont été exécutés les nombreux travaux qui ont contribué si puissamment aux progrès de lascience agricole ».Le Dr Stöckhardt était l'auteur d'un ouvrage à succès, L'école de chimie, qui en était déjà à saonzième édition. Brustlein se proposait depuis un moment de le tra<strong>du</strong>ire en <strong>français</strong>. C'est donc aucours de ce séjour au Liebfrauenberg, que Stöckhardt lui donna son accord pour cette tra<strong>du</strong>tion.Celle-ci parut en 1861, en 524 pages, avec 225 gravures et sous un titre modifié par Brustlein : « Lachimie usuelle appliquée à l'agriculture et aux arts ». Brustlein en avait signé la préface auLiebfrauenberg même, le 8 octobre 1860. C'est dire qu'il accompagnait son maître dans toutes sesvacances d'été, afin de le seconder efficacement dans toutes ses expérimentations.Au moyen de solvants appropriés, Frédéric Brustlein réussira également à isoler dans le bitume <strong>du</strong>Pechelbronn une paraffine, résine incolore et solide, à l'occasion de travaux con<strong>du</strong>its semblerait-ilpar Joseph Achille Le Bel au laboratoire <strong>du</strong> Pr Würtz à la Faculté de médecine de Paris (“Sur lespétroles <strong>du</strong> Bas-Rhin, Note de M. Le Bel, présentée par M. Wurtz”, Comptes ren<strong>du</strong>s hébdomadairesdes sances de l'Académie des sciences, 1871, t. 73, p. 499-501, séance <strong>du</strong> 21 aoput 1871). Nousignorons ce que Brustlein devint ensuite. C'est en tout cas un autre Alsacien, Achille Müntz, le fils<strong>du</strong> notaire de Soultz-sous-Forêts, lui succéda comme préparateur au Cnam.Le comte Paul de LeusseA force, le père de la chimie agricole créa une telle émulation en Alsace <strong>du</strong> nord que le comtePaul de Leusse à Reichshoffen se piqua lui aussi d’être un cultivateur de progrès. Comme MarieJoseph Achille Le Bel, en revenant de ses campagnes dans les armées de la République, il s'étaitvoué à l'agriculture en quittant la marine en 1856. Il n'y connaissait rien, mais lut comme soncollègue <strong>du</strong> Pechelbronn « cent ou deux cents ouvrages d'agriculture ».Le domaine de Reichshoffen, dont il avait hérité en épousant en 1856 l'héritière Renouard deBussière, était plus éten<strong>du</strong> que le Pechelbronn. Il comprenait 50 hectares de prés et 65 hectares deterres. Par achats et échanges, il sut se constituer de grandes pièces, sans enclaves. Il suivaitl'assolement quadriennal dit de Norfolk. Il développa les drainages et créa une fromagerie ainsiqu'une grande distillerie de pommes de terre, de seigle, de malt, de betteraves à sucre et detopinambours, dotée d'une machine à vapeur de cinq chevaux. L'idée lui en était venue en visitantun parent en Normandie. Mais après avoir comparé tous les procédés alors disponibles(Champonnois, Leplay et Kesler), il avait adopté une vieille méthode de distillation allemande, quiavait « résisté à toutes les innovations ». Il croyait faire oeuvre de pionnier, persuadé que lapro<strong>du</strong>ction d'eaux-de-vie allait redynamiser les campagnes en procurant des revenussupplémentaires aux agriculteurs. Il faisait même d'une pierre deux coups. En distillant six jours parsemaine, il pro<strong>du</strong>isait assez de rési<strong>du</strong>s pour nourrir, moyennant l'adjonction de 15 quintauxmétriques de foin coupé, 16 boeufs de travail, 44 vaches, 35 porcs anglais et 7 chevaux de ferme.En 1862, une commission de quatre membres de la Société des sciences, agriculture et arts <strong>du</strong>Bas-Rhin accepta de visiter ses installations. Restait à obtenir la même faveur de la Sociétéimpériale et centrale d’agriculture de France. A la séance <strong>du</strong> 9 avril 1862, celle-ci décida de confiercette visite à ses trois dirigeants les plus prestigieux : Boussingault, le secrétaire perpétuel Payen et
Barral, qui en sera le secrétaire perpétuel après la défaite de 1870 (38). Mais nous n’avons puretrouver le compte-ren<strong>du</strong> qu’ils en rapportèrent.Sans avoir été en rapport direct avec Boussingault, le comte de Leusse connaissait ses principauxécrits. Dans son fascicule “Distillation agricole de la pomme de terre, des topinambours et desgrains” (Paris, 1863, 153 p.), il repro<strong>du</strong>it ainsi la composition chimique <strong>du</strong> froment, <strong>du</strong> seigle, del'orge, de l'avoine, <strong>du</strong> maïs, <strong>du</strong> riz et <strong>du</strong> topinabour que le père de la chimie agricole avaitdéterminée à la ferme <strong>du</strong> Pechelbronn et publiée dans “Economie rurale”.Ardent militant <strong>du</strong> parti catholique, le comte Paul de Leusse (1835-1906) a été maire deReichshoffen de 1865 à 1871 et député des arrondissements de Haguenau et Wissembourg à partirde 1869. Son château servit de quartier général au maréchal Mac-Mahon pendant la bataille deWoerth-Froeschwiller <strong>du</strong> 6 août 1870.Achille Müntz (à rédiger)