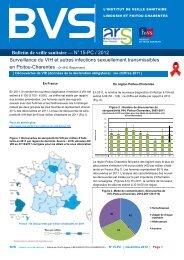Compte rendu CLAN 07 mai 2010 - ARS Poitou-Charentes
Compte rendu CLAN 07 mai 2010 - ARS Poitou-Charentes
Compte rendu CLAN 07 mai 2010 - ARS Poitou-Charentes
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mme GABOUT Catherine, Diététicienne, CSSR Les Glamots ROUILLET ST ESTEPHE (16)Mr GAUDIN Philippe, Président <strong>CLAN</strong>, CH LA ROCHELLE (17)Mme GATINEAU Chantal, Diététicienne, CH NIORT (79)Mme GORNARD Dominique, Aide Soignante, SSR Mornay SAINT PIERRE DE L’ILE (17)Mme GRUEL Marie, Présidente <strong>CLAN</strong>, Hôpitaux Sud Charente BARBEZIEUX (16)Mme GUILLAUD Mireille, Aide Soignante, Capio Clinique du <strong>mai</strong>l LA ROCHELLE (17)Mme HILLAIRET CAU Jeanne, Gériatre, CH ROYAN (17)Mme HORACK Anne Elisabeth, Présidente <strong>CLAN</strong>, Clinique Orégon CIVRAY (86)Mme HUC Marie Claude, Endocrinologue, CH CHATELLERAULT (86)Mme JACQUES Laurence, IDE, HL SAINT PIERRE D’OLERON (17)Mme JEAN Chantal, Chargé de missions, <strong>ARS</strong> (86)Mr KARABETSOS Alexandre , Gériatre, CH NORD DEUX SEVRES (79)Mme LABORDE Florence, Médecin, SSR Mornay SAINT PIERRE DE L’ILE (17)Mme LABRUNE Nadine, Cadre diététicien, CH NIORT (79)Mme LANDRY Roselyne, Aide Soignante, CH ROYAN (17)Mme LANGLAIS Dominique, Cadre de santé, CH CHATELLERAULT (86)Mme LAUTIN Pascale, Cadre de santé, CH Henri Laborit POITIERS (86)Mme LECLERC Annie, Cadre de santé, Hôpital de LOUDUN (86)Mme LEFRANCOIS Laura, Stagiaire diététicienne, CH JONZAC (17)Mme LEGER Catherine, IDE, CH BOSCAMNANT (17)Mr LEGRAND Philippe, PDG/Directeur, Centre alcoologique alpha ROYAN (17)Mme LIOT Virginie, Cadre de santé, CH ROCHEFORT (17)Mme LOGER Florence, Cadre de santé, CH MONTMORILLON (86)Mme LUIZY Joëlle, Praticien Hospitalier, CH ROCHEFORT (17)Mme MARCHIVE Martine, Présidente <strong>CLAN</strong>, Clinique St Joseph ANGOULEME (16)Mme MARCHEIX Cécile, Chargé de projets, <strong>ARS</strong> (86)Mr MARECHAUD Richard, Professeur, CHU POITIERS (86)Mme MAUVISSEAU Guillemette, Stagiaire diététicienne, Clinique St Charles POITIERS (86)Mme MIRANDE Martine, Cadre diététicienne, CH SAINTES (17)Mr MORAS Jean Baptiste, Gériatre, CH Jonzac (17)Mme MOREAU Angélique, auxiliaire de vie, Clinique St Charles POITIERS (86)Mme MORTON Chantal, Gériatre, CH ROYAN (17)Mme MOULLIN Catherine, Diététicienne, Clinique Pasteur ROYAN (17)Mme MUSSEAU Nathalie, Diététicienne, CH SAINTES (17)Mr NOBILI Steeve, Chirurgien digestif, Clinique Pasteur ROYAN (17)Mme NOURISSON Peggy, Diététicienne, CH NORD DEUX SEVRES (79)Mme OLRY Florence, IDE, Clinique Richelieu SAINTES (17)Mme OLIVIER Anaïs, Diététicienne, CH CONFOLENS (16)Mme PAITRE Pascale, DDSSI, Clinique St Charles POITIERS (86)Mme PASTRY Catherine, Diététicienne, CRF Grand Feu NIORT (79)Mme PERRIN Joëlle, Directrice de l'offre, <strong>ARS</strong> (86)Mme PERROCHAIN Jessica, Diététicienne, Centre alcoologique alpha ROYAN (17)Mr PICHON Bruno, Directeur Adjoint, CH LA ROCHELLE (17)Mme PIERRE Catherine, Diététicienne, CH NORD DEUX SEVRES (79)Mme PINEAU Delphine, Diététicienne, HL LA ROCHEFOUCAULD (16)Mme POTET Rachel, Aide Soignante, Clinique Richelieu SAINTES (17)Mme RAZANAKOTO Nora, Diététicienne, Clinique Inkermann NIORT (79)Mr REITBERGER Arnaud, Médecin, CRF Grand Feu NIORT (79)Mme RETOIN Stéphanie, Diététicienne, CH ROCHEFORT (17)Mr RAYNAUD Jean, Chef de Service, CH NIORT (79)Mme RICHARD Marie Ange, Présidente <strong>CLAN</strong>, Hôpital de LOUDUN (86)Mme RIOU Mireille, Aide Soignante, CH ANGOULEME (16)Mme ROBIN Nathalie, Diététicienne, CH BOSCAMNANT (17)Mme ROCHET Sonia, Diététicienne, HL Melle, St Maixent (79)Mme ROSE Lise, IDE, CH ROCHEFORT (17)Mme ROUSSEAU Monique, Cadre de santé, CH COGNAC (16)Mme SIVADIER Amandine, IDE, Château de Marlonges CHAMBON (17)Mme SCHEUR Françoise, IDE hygiéniste, Capio Clinique du <strong>mai</strong>l LA ROCHELLE (17)Mme SERGENT Aurélie, Chargé de missions, <strong>ARS</strong> (86)Mme TESSON Elisabeth, Diététicienne, Centre Hélio Marin SAINT TROJAN (17)2
Mme THIBAUD Geneviève, Responsable soins infirmiers, Centre Hélio Marin SAINT TROJAN (17)Mme TOREAU Déborah, Diététicienne, CH LA ROCHELLE (17)Mr TOURON Frédérique, Directrice, Clinique Orégon CIVRAY (86)Mmr TOUZET Florence, Diététicienne, CH ST JEAN D'ANGELY (17)Mme UTHURRIAGUE Agnès, Responsable hôtelière, Capio Clinique du <strong>mai</strong>l LA ROCHELLE (17)Mme VAN CAPPEL Florence, Diététicienne, CH ROYAN (17)Mr VEGIANTI, Chef restauration, Hôpitaux Sud Charente BARBEZIEUX (16)Mme VIGIER Alexandra, IDE, CH CONFOLENS (16)Mme VIROULAUD Marie Christine, Cadre diététicienne, CH ANGOULEME (16)Mme VISENTIN Cécile, Présidente <strong>CLAN</strong>, Centre Richelieu Croix Rouge, LA ROCHELLE (17)Mme WURTZ Odile, Présidente <strong>CLAN</strong>, Clinique de l'atlantique, PUILBOREAU (17)Personnes excusées ou ayant oubliée d’émarger l’après midi :Mme BERTHET Marie Annick, Diététicienne, CH ROCHEFORT (17)Mme CAZENAVE Brigitte, Cadre de santé diététicienne, CH de JONZAC (17)Mr COQUILLEAU Olivier, Adjoint de direction, La gandillonerie PAYROUX (86)Mr DECOEUR Daniel, Directeur Santé service Charente SOYAUX (16)Mr DEWITTE, CHU POITIERS, représenté par Mr PICHON Bruno, Directeur Adjoint, CH LAROCHELLE (17)Mme RAVART Catherine, Aide Soignante, Capio Clinique du <strong>mai</strong>l LA ROCHELLE (17)1°) IntroductionLa séance est ouverte par Monsieur MARECHAUD, chef de projets PNNS de la région <strong>Poitou</strong>-<strong>Charentes</strong>.Monsieur MARECHAUD remercie la Mairie de La ROCHELLE pour son aide financière accordée àla location de la salle, le laboratoire Nutricia pour son aide financière accordée au financement de larestauration. Il remercie également l’IUT de LA ROCHELLE et le CROUS pour l’accueil fait à la 6 èmeédition des rencontres régionales des <strong>CLAN</strong>.2°) Les ateliersAtelier 1 : Formation dans le cadre des <strong>CLAN</strong>Formation sur le dépistage et la prise en charge de la dénutrition :Présenté par : Dr Philippe GAUDIN, président du <strong>CLAN</strong>, Dr. Frédérique DUENGLER,diabétologue, Mme Maryse BOURGERETTE, cadre diététicienne, CH La RochelleFormation des soignants à l’accompagnement du repas en tant que soin :Présenté par : Mme Florence VAN CAPPEL, diététicienne et Mme Roselyne LANDRY, aidesoignante, CH RoyanL’objectif de l’atelier : Echanger sur les pratiques professionnellesLes présentations power-point sont consultables sur le site : www.ars.poitou-charentes.sante.frQuelques points échangés suite aux interventions :Indicateurs de la dénutrition :o Concernant la mesure de la taille des patients pour le calcul de l’IMC, les toises sont àprivilégier. La taille déclarée peut être utilisée si la mesure ne peut être effectuéeautrement.o La perte de poids est un bon indicateur de la dénutrition et est beaucoup plus simple àrecueillir (déclaration des patients). Il faut privilégier le dépistage de masse par desméthodes simples et utilisables par tous les services, car selon les chiffres, ladénutrition concerne un patient sur deux.3
ooIl n’y a pas de critère unique et absolu pour dépister la dénutrition. Il est important,dans un premier temps, de sensibiliser le maximum de personnes pour ensuite affinerles méthodes de dépistage.Pour plusieurs, il est difficile de sensibiliser les médecins à l’importance du dépistagede la dénutrition, la nutrition n’occupant pas une place importante dans leur formation.Limitation du jeûne alimentaire aux strictes indications nécessaires :o Le CH de La Rochelle aborde ce point dans une plaquette d’information sur ladénutrition diffusée à tous les médecins et cadres de l’établissement. Un groupe detravail a été dédié à cette thématique.o Tous les services sont concernés par ce sujet, les médecins, les radiologues et lesbiologistes exigent souvent un jeûne trop prolongé et/ou rigoureux par rapport à ce quiest nécessaire.o Pour une grande partie des interventions chirurgicales et parfois médicales (prise desang), un jeûne solide de 6h est nécessaire, <strong>mai</strong>s les liquides clairs peuvent êtreautorisés jusqu’à 2h avant l’intervention (cf. diaporama).Fiches de surveillance alimentaireo Suite à un audit sur l’utilisation de la fiche de surveillance, le CH de La Rochelle achoisi de cibler les patients pour lesquels ces fiches seraient mises en place (sousprescriptions, sous avis de la diététicienne ou à l’initiative des A.S…). Cette fiche desurveillance recueille les informations de tous les repas pour une période de 3 jours.Les fiches sont mises dans un classeur à portée de <strong>mai</strong>n, afin de faciliter leuraccessibilité.o Pour certains établissements, les fiches sont remplies systématiquement pour tous lespatients <strong>mai</strong>s ne sont pas toujours bien renseignées.o Un établissement utilise une feuille de contrôle des ingestas, élaborée par les servicesinformatiques. Celle-ci est mieux renseignée et plus utilisée par les services.o Le rangement des fiches (dossier médical, classeur spécifique, fichier informatique)varie d’un établissement à l’autre.o La qualité du remplissage des fiches dépend souvent de l’implication des médecinsdans l’analyse : les soignants sont plus valorisés et motivés lorsque les médecinsaccordent de l’importance aux données recueillies.o Plusieurs établissements ont modifié la fiche PNNS pour mieux répondre aux besoinsdes services. La fiche utilisée par le CH de La Rochelle intègre une colonnesupplémentaire par rapport à la fiche PNNS, à la demande des aides soignantes. Unétablissement y a intégré la variable des rations adaptées (demi- part versus partnormale).Accompagnement du repas par les soignants :o Les soignants déclarent manquer de temps pour bien accompagner les patients lors durepas.o Certains déclarent que les examens médicaux interrompent souvent le repas, celui-ciétant traité comme un élément purement logistique, et non comme un soin.o Dans un établissement, les personnes globalement autonomes, <strong>mai</strong>s qui ont parfoisbesoin d’accompagnement pour manger, sont regroupées dans une salle à mangerspéciale avec une aide soignante, ce qui permet un gain de temps considérable.o Il est parfois difficile de juger s’il faut chercher à « rendre autonome » ou à « aider »les patients lors des repas.Codage de la dénutrition (TAA) :o Des difficultés sont signalées par rapport au codage de la prise en charge de ladénutrition. Les indices utilisés dans le cadre du dépistage de la dénutrition nesemblent pas correspondre à ceux du codage de la T2A.o Le CH de La Rochelle a mis en place un fichier commun DIM-DIET afin d’améliorerla déclaration des dénutritions.o La déclaration de la dénutrition est une responsabilité commune, même si l’acte ducodage revient au médecin.4
Quelques points échangés suite aux interventions :Le recensement du delta pondéralo Le recensement du delta pondéral est l’information la plus compliquée à recueillir.C’est cette information qui manque en général pour établir le diagnostic de dénutritiondu patient.o Le delta pondéral à partir des déclarations du patient ne compte pas pour lavalorisation. Il faut que ce renseignement soit issu d’un dossier antérieur. Dans lecadre de la certification il faut une trace écrite ; sans trace écrite on considère que celan’a pas été fait.o Le relevé du poids, par le médecin traitant dans le cas d’une décisiond’hospitalisation, peut être pris en compte. Mais celui-ci doit avoir été réalisé lorsd’une visite médicale au cabinet et non à domicile.o De plus certaines personnes âgées ne sont pesées qu’une fois par an et n’ont pasd’outil de pesée à leur domicile.o Il est important d’avoir et de noter le poids du patient à son entrée et à sa sortied’hospitalisation.Démarche d’évaluation :o La démarche d’évaluation des pratiques professionnelles en matière de nutrition a ététrès bien perçue par les professionnels.o Un groupe de travail de la clinique va se réunir pour améliorer les conditions de sortiedu patient et notamment les documents de liaison avec les partenaires de la ville.Informatisation du dossier patient :o Actuellement, la Clinique Saint Charles dispose de dossiers papiers. Un service piloteest en cours d’informatisation à la Polyclinique MCO du même groupeSur le site de l’Agence Régionale de Santé, seront repris les documents relatifs aux <strong>CLAN</strong> dansl’objectif de favoriser les échanges des documents et outils déjà effectués et testés par lesétablissements.Atelier 3 : Alimentation entérale et dénutritionLes recommandations actuelles en matière de nutrition entérale et parentérale :Présenté par Mr Alexandre KARABETSOS, président du <strong>CLAN</strong>, CH Nord Deux Sèvres (79) etCatherine PIERRE DiététicienneExpériences pratiques :Présenté par Monsieur Philippe BEAU, CHU Poitiers (86)La présentation power-point est consultable sur le site : www.ars.poitou-charentes.sante.frL’objectif de l’atelier : Echanger sur les pratiques professionnellesComplément d’informations apportées par Mr KARBETSOS et Mme PIERRE:Les indications présentées par Monsieur Karabetsos sont les recommandations actuelles enFrance pour la gérontologie.Conseils d’utilisation :o Il est important de faire attention au débit des nutripompes : 180 à 240 ml / h. Lapompe permet une vitesse de passage plus régulière.o Le rinçage des tubulures est important car il assure la vacuité <strong>mai</strong>s aussi permetd’apporter une hydratation suffisante. Il est important de faire attention à la prisemédicamenteuse qui ne doit pas boucher la sonde.o En pratique, la voie veineuse centrale ne doit pas être forcément changée au bout de 3se<strong>mai</strong>nes.6
Points importants :o Les infirmières ont une réelle peur de déplacement de la sonde.o Il est important de respecter le désir des familles ou du patient.Quelques points échangés suite aux interventions :ooEn fin de vie ou soins palliatifs, la NE et NPE ne sont pas recommandées, <strong>mai</strong>s enpratique, il y a liberté de prescription.Il faut sortir de l’idée reçue que la NE donne de la diarrhée, en effet ce n’est passystématique. C’est souvent la reprise alimentaire qui engendre la diarrhée et nonl’alimentation entérale.Complément d’informations apportés par Mr BEAU :Monsieur Philippe BEAU est gastro-entérologue au CHU de Poitiers, spécialisé dans lespathologies du grêle.Informations complémentaires sur le profil du cas présenté :o Mesure de la diurèse correcte, débit urinaire au moins 1 litre. l est important de suivreles pertes urinaires.o Natriurèse nulle. La patiente aurait pu se déshydrater. Il est en effet important demesurer les pertes en sodium.Surveillance médicale :o Le plus important est de veiller à l’équilibre hydrosodé, principal risque dedéshydratation, cela peut avoir des répercussions sur les reins.o On rencontre l’hyperphagie compensatrice quand malabsorption.o Pour les personnes ayant des problèmes d’absorption intestinale, il y a un besoin accruen Zn et Mg. Il est donc important de surveiller cet apport, il est recommandé desupplémenter par voie orale. Le produit DECAN est bien accepté en général.o A domicile, il est important de veiller à l’apport énergétique, il y a peu de situationsoù il est recommandé d’avoir un apport énergétique > 1500 kcal, car risqued’inconfort digestif. Il faut privilégier les traitements qui peuvent être acceptés sur dulong terme ;Conseils d’utilisation :o Les compléments oraux peuvent être un substitut de la nutrition entérale.o Ce qui est important est le délai d’infusion : s’il est bien mené, cela permetl’augmentation de l’absorption.o Il est conseillé de ne pas raisonner uniquement en débit de stomie. En effet, onconstate une augmentation des pertes pour un apport > 2 litres. Cela se passebeaucoup mieux si l’apport est < 2 litres.o Pour qu’une alimentation entérale réussisse, ce n’est pas le choix du produit en petitspeptides qui compte <strong>mai</strong>s essentiellement sa teneur en sodium. Donner des solutionsriches en sodium.o Quand la nutrition entérale ne fonctionne pas bien, il est important de s’interroger surl’utilité du traitement.o Dans le cas d’intervention sur le grêle court, la nutrition entérale avec fibres (enévitant les fibres dures) peu avoir un intérêt non négligeable en terme de gainénergétique: 50 % absorbées. Pour le traitement de la constipation, l’intérêt des fibresest anecdotique.o L’alimentation entérale est rarement exclusive.Quelques points échangés suite aux interventions :o Les fonctions du tube digestif reprennent dans les 3 heures qui suivent même après unjeun prolongé.o Il n’existe actuellement pas de preuves de supériorité par rapport à une renutritionclassique des compléments alimentaires oraux dans la prise en charge des escarres. En7
effet, l’escarre est une maladie physique, ischémique et non une maladie dedénutrition.o En gériatrie, deux courants de pratiques peuvent être employés, chacun est discutable :− l’alimentation entérale nocturne : débit très lent évitant ainsi les diarrhées− l’alimentation entérale fractionnée qui respecte les prises alimentaires habituelles.o En cas de démence, il est recommandé de ne pas poser une sonde gastrique, car aucunbénéfice sur la durée de vie du patient n’a été mesuré. Il est important de faire labalance entre les bénéfices éventuels et les complications pouvant survenir.o Le débit nutritionnel intervient peu dans le bonus nutritionnel. Le débit joueessentiellement sur la tolérance digestive, les troubles digestifs induits.o Quel que soit le cas du patient la décision de mise en place d’une alimentation entéraledoit tenir compte de l’avis de la famille.3°) Les interventions plénières<strong>CLAN</strong> et HPSTPrésenté par Mme le Dr Joëlle PERRIN, Directrice Générale Adjointe de l’<strong>ARS</strong> <strong>Poitou</strong>-<strong>Charentes</strong>, directrice de l’offre sanitaire et médico-sociale, <strong>ARS</strong> <strong>Poitou</strong>-<strong>Charentes</strong>Madame PERRIN exprime son plaisir de participer à cette rencontre. Elle souligne le rôle important des<strong>CLAN</strong> depuis leur création. En effet, ceux-ci ont su trouver un chemin, faire leur place et apporter del’amélioration dans la prise en charge alimentaire et nutritionnelle des patients.En <strong>2010</strong>, 90 % des établissements de la région ont mis en place un <strong>CLAN</strong>. Ceux-ci fonctionnent et ont sucréer une dynamique qui est en marche.Madame PERRIN aborde la place des <strong>CLAN</strong> dans le nouveau monde de la santé suite à la promulgation dela loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009.En effet, cette grande réforme souhaite agir sur un certain nombre de champs sanitaires : La modernisation des établissements de santé : recrutement, nouvelle gouvernance,possibilité de coopération en lien avec la communauté hospitalière de territoire L’accès de tous à des soins de qualité−−Efficience,Soins de premiers recours : redéfinition des missions du généraliste avec un désir deredonner la place au généraliste : exercice rénové, coopération professionnelle,télémédecine La prévention : loi sur l’éducation thérapeutique, lutte contre les troubles du comportementalimentaire. La lutte contre l’obésité et le surpoids est une priorité en matière de santé publique. La création des Agences Régionales de Santé (<strong>ARS</strong>) : regroupement en un seul pouvoirrégional de l’offre de soins publics, privés, du secteur médico-social (personnes âgées etpersonnes handicapées), de la médecine ambulatoire (médecins de ville), de la santé publique,(la prévention, la gestion des risques et la sécurité sanitaire).L’<strong>ARS</strong> est un établissement public qui intègre les agents (plus de 280), des services desDRASS, DDASS, URCAM, ARH, et un certain nombre des caisses d’assurance maladie.L’<strong>ARS</strong> a un do<strong>mai</strong>ne de compétence étendu, depuis la prévention jusqu’au médico-social enpassant par l’offre de soins.Les objectifs : Travailler sur l’offre des soins dans un territoire donné. Aider à la construction de projets. Mettre en place la Conférence Régionale de Santé et Autonomie (CRSA): constituée d’unecentaine de personnes regroupant des experts <strong>mai</strong>s aussi des représentants des usagers etdes patients. Cette CRSA aura pour mission d’émettre des avis pour étayer les décisionsprises par le Directeur Général de l’<strong>ARS</strong>. Elaborer des documents de planification à travers l’écriture du Programme Régional deSanté(PRS) pour la mise en œuvre de programmes d’actions pour la santé de la population.On y retrouve le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS), le schéma régionaldu secteur médico-social, le schéma régional de prévention.8
Madame Françoise COTTEN s’interroge sur le constat fait en Deux Sèvres au sujet de laprise en charge de l’obésité réalisée par des diététiciennes libérales plus que dans lesautres départements de la région ?Madame le Docteur ARENOU indique que dans les Deux Sèvres il n’y a pas dediététicienne en nombre suffisant dans les Centres Hospitaliers.Le professeur CARRETIER indique que les personnes qui consultent directement lesdiététiciennes libérales ont les moyens de payer les consultations.Il existe dans les Deux Sèvres une expérience avec une mutuelle qui rembourse lesconsultations chez les diététiciennes libérales.Mme LABRUNE indique qu’au centre hospitalier Nord Deux Sèvres, les consultationsdes diététiciennes sont payantes. Beaucoup de suivis de chirurgie bariatrique des patientsvenant d’Angers sont réalisés.Le rôle du médecin traitant est fondamental. Il est souhaitable de favoriser l’informationdes médecins de la région sur la problématique de l’obésité et de sa prise en charge.Les chirurgiens restent, pour la majorité des malades, le point d’appel ; beaucoup depatients passent par eux en première intention alors que la plupart des cas ne relèvent pasde la chirurgie. Il est nécessaire d’avoir un réseau sur le territoire pour une prise en chargemédicalisée des patients.Le cloisonnement entre le secteur public et privé est obsolète pour la prise en charge despatients obèses.Le professeur MARECHAUD informe que le problème n’est pas un manqued’endocrinologues sur la région, <strong>mai</strong>s plutôt que les endocrinologues ne souhaitent pass’investir dans un do<strong>mai</strong>ne où les conditions de bonnes pratiques, notammentpluridisciplinaires, en accord avec les recommandations, ne sont pas réunies faute demoyen.Le professeur CARRETIER indique que le manque d’endocrinologue a été exprimé lorsde leur état des lieux.Monsieur MARECHAUD s’interroge également sur le fait, qu’en Charente, alors qu’il y aun réseau qui fonctionne bien, la chirurgie est un point faible.Le professeur CARRETIER indique que le chirurgien impliqué dans la création du réseaune réalise que la pose d’anneaux, et qu’il y a en effet, un déficit en chirurgiens pour deschirurgies lourdes (By-pass notamment). Pour ce type d’interventions, le réseau a concluune convention avec la clinique du <strong>mai</strong>l à La Rochelle.Il a été évoqué de mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion régionale des <strong>CLAN</strong>,le SROS obésité.Dénutrition et T2 APrésenté par le Professeur Richard MARECHAUD, Service de Médecine Interne, endocrinologie,CHU Poitiers.Docteur Julien GUIGNET, DIM, Santé publiquePoints importants à relever :Afin que la perte de poids puisse être valorisée lors de la codification, il faut que le relevéantérieur du poids ait été effectué à partir du dossier médical. Le déclaratif n’a aucunevaleur.Il n’y a pas de critère de codage pour la dénutrition sévère chez les sujets âgés < 70 ans, nipour les dénutritions légères < 70 ans ou > 70 ans.Lors de broncho-pneumopathie sans précision, le codage de la dénutrition diffère enfonction de l’âge < 70 ans ou > 70 ans.La présence d’escarre annule la valorisation du codage de la dénutrition.Lors de cirrhose décompensée, lors de diabète chez sujet âgés > 35 ans ou lors degastroentérites ou maladies diverses du tube digestif chez sujets âgés > 17 ans, le codagede la dénutrition change en fonction de la qualification de la dénutrition entre légère etmodérée.Le codage de la dénutrition diffère en fonction de l’acte opératoire.Lors d’anorexie mentale, le codage de la dénutrition n’est valorisante que si la dénutritionest qualifiée de « sévère ». Si la dénutrition est qualifiée légère ou modérée, il n’y a pas dedifférence en terme de valorisation.10
La qualification de nutrition légère, modérée ou sévère ne sert à rien dans les cas dedysphagie (car est un symptôme et non une pathologie), c’est de même dans les cas desurveillance de tumeur d’hypophyse.Dans le cas de surveillance du Diabète de type II avec complications vasculaires, laqualification de nutrition légère, modérée ou sévère ne change rien si la duréed’hospitalisation est < 3 nuitéesSi le patient est hospitalisé pour cause de dénutrition, c’est le seul cas où l’on peut coder ladénutrition car la dénutrition est la cause de l’hospitalisation. S’il y a découverte d’uncancer, il vaut mieux prendre en compte le cancer en premier. Si le patient a déjà uncancer, il est possible de le faire valoir.Points échangés :Le poids antérieur inscrit dans le dossier du médecin traitant peut être pris en compte pourdéfinir la perte de poids, et ainsi être valorisé lors de la codification.Monsieur MARECHAUD remercie l’assemblée et clôture la séance à 16h00.11