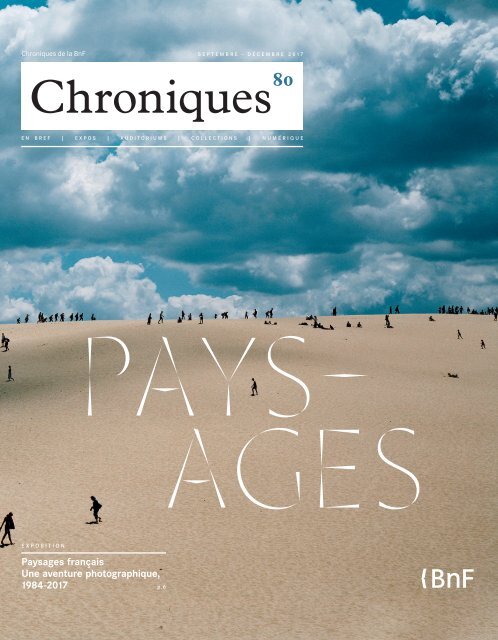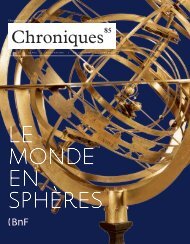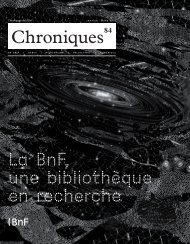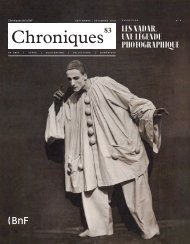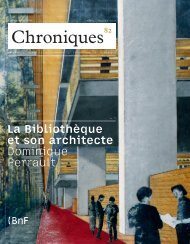BnF Chroniques 80
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Chroniques</strong> de la <strong>BnF</strong> SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2017<br />
<strong>Chroniques</strong> <strong>80</strong><br />
EN BREF | EXPOS | AUDITORIUMS | COLLECTIONS | NUMÉRIQUE<br />
PAYS-<br />
AGES<br />
EXPOSITION<br />
Paysages français<br />
Une aventure photographique,<br />
1984-2017 p. 6
ÉDITORIAL<br />
SOMMAIRE<br />
4<br />
6<br />
12<br />
13<br />
14<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
EXPOSITIONS<br />
Jean Rouch<br />
Paysages français<br />
Patrice Chéreau<br />
Bourse du Talent / Hors les murs<br />
AUDITORIUMS<br />
Hackathon<br />
Prix Phonurgia Nova<br />
Cycle Einstein<br />
Littérature jeunesse<br />
Léon Bloy<br />
Cycle relations franco-italiennes<br />
Colloque droit(s) et gastronomie<br />
Master classes<br />
VIE DE LA <strong>BnF</strong><br />
Jean-Claude Meyer<br />
Prix de la <strong>BnF</strong><br />
COLLECTIONS<br />
Artaud<br />
Écrans à main du XVIII e siècle<br />
Gérard Macé<br />
Prix Niépce<br />
ACTUS DU NUMÉRIQUE<br />
Bibliothèque francophone numérique<br />
INTERNATIONAL<br />
Portail des bibliothèques d’Orient<br />
LIVRE <strong>BnF</strong><br />
Une nouvelle collection<br />
« Les Orpailleurs »<br />
Le Grand Armorial équestre<br />
de la Toison d’or<br />
Dans les territoires<br />
de la création<br />
Laurence Engel<br />
Présidente de la<br />
Bibliothèque nationale<br />
de France<br />
Ce numéro d’automne de <strong>Chroniques</strong> consacre son<br />
dossier à un événement exceptionnel de la programmation<br />
culturelle de la Bibliothèque : l’exposition<br />
Paysages français. Une aventure photographique,<br />
1984-2017. Pour la première fois sont réunis, en<br />
quelque 1 000 tirages, les travaux de 160 photographes,<br />
intervenus au cours des quarante dernières<br />
années dans le cadre de grandes commandes<br />
photographiques, publiques et privées, pour porter<br />
leur regard sur les territoires de la France. C’est<br />
à un véritable voyage photographique que le public<br />
est convié, à un voyage dans le temps aussi, inauguré en 1984 par la<br />
Mission photographique de la DATAR, qui choisit, pour documenter<br />
le territoire, de faire appel à des artistes. Ces travaux donnent à<br />
voir la beauté des paysages naturels et leurs mutations, le désarroi des<br />
grands ensembles, la portée, sociale et poétique, de lieux dédiés au<br />
travail. Ils révèlent également la force sensible et la richesse du discours<br />
que tient la photographie sur notre histoire, sur notre société,<br />
sur notre humanité.<br />
Deux autres expositions célèbrent des créateurs d’images et d’émotions<br />
exceptionnels : à la Bibliothèque-musée de l’Opéra, c’est le parcours<br />
de Patrice Chéreau sur les scènes lyriques qui est présenté ; site<br />
François-Mitterrand, celui de Jean Rouch, l’Homme-Cinéma. Coproduite<br />
avec le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC),<br />
cette dernière exposition invite à redécouvrir, à l’occasion du centenaire<br />
de sa naissance, l’œuvre d’un créateur qui a inventé une manière<br />
nouvelle de raconter les hommes et le monde.<br />
Cette année, la <strong>BnF</strong> célèbre par ailleurs les vingt ans de sa bibliothèque<br />
numérique Gallica et ouvrira les festivités avec le 2 e Hackathon de la<br />
<strong>BnF</strong>. Nous convierons les gallicanautes et les explorateurs du net à<br />
inventer de nouveaux usages ou de nouveaux services, et donnerons<br />
aussi à tous l’occasion de plonger dans les profondeurs et les imaginaires<br />
ouverts par nos collections et nos applications.<br />
Enfin, autre temps fort de ce tour d’horizon de l’actualité de la Bibliothèque,<br />
une deuxième saison de master classes d’écrivains prolongera<br />
le plaisir, partagé lors des huit premières séances, d’approfondir avec<br />
des auteurs contemporains la fabrique intime de leur écriture.<br />
Un nouveau caractère<br />
à chaque numéro<br />
de <strong>Chroniques</strong><br />
La <strong>BnF</strong> soutient et valorise<br />
la création typographique<br />
française en invitant dans<br />
ses colonnes un caractère<br />
de titrage original,<br />
nova t eur, émergent,<br />
témoin de la vigueur<br />
actuelle de la discipline.<br />
Dans ce numéro<br />
Minérale est un caractère<br />
dessiné autour de fûts<br />
inhabituels, dont les côtés<br />
se croisent. Son dessin<br />
est pensé comme une exagération<br />
géométrique de<br />
la structure des incises, où<br />
les parties centrales de fûts<br />
verticaux sont amaigries.<br />
Ce phénomène est ici<br />
poussé à l’extrême : le fût<br />
se résume à deux triangles<br />
qui se rejoignent par leurs<br />
pointes, créant une zone<br />
claire, presque lumineuse,<br />
au centre du caractère.<br />
Sobre dans ses versions<br />
maigres, il devient plus<br />
exubérant dans ses versions<br />
grasses. Il est distribué<br />
depuis mai 2017 par<br />
la fonderie 205.TF.<br />
Le créateur<br />
Thomas Huot-Marchand<br />
est graphiste et typographe,<br />
il vit et travaille à Besançon,<br />
et dirige à Nancy l’Atelier<br />
national de recherche<br />
typographique.<br />
En couverture<br />
Jérôme Brézillon<br />
France(s) territoire liquide<br />
Série « Paysages français »,<br />
2010
EN BREF<br />
3<br />
Jeux vidéo<br />
Paris Games Week<br />
8 e édition<br />
Événement incontournable pour la<br />
communauté des « gamers » et les<br />
passionnés de jeux vidéo, la Paris Games<br />
Week offre la possibilité de découvrir<br />
en avant-première les futures sorties<br />
et les exclusivités de fin d’année. Chargée<br />
du dépôt légal de tous les documents<br />
sonores, vidéo et multimédias, la <strong>BnF</strong><br />
reçoit donc des jeux, des consoles et<br />
des accessoires, qui sont ensuite<br />
répertoriés et archivés dans les collections<br />
du département de l’Audiovisuel.<br />
La Bibliothèque présentera sur son stand<br />
des jeux que chacun pourra expérimenter.<br />
Art numérique<br />
Donner à voir<br />
l’art numérique<br />
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art numérique ?<br />
Comment cet art s’est-il construit ces vingt<br />
dernières années ? Comment cet objet<br />
d’étude aussi riche que complexe est-il<br />
abordé par la critique d’art ? Autant de<br />
questions qui seront posées lors de la<br />
Biennale d’art numérique qui aura lieu le<br />
6 décembre sur le site François-Mitterrand.<br />
À cette occasion, plusieurs œuvres seront<br />
exposées ce même jour dans les deux salles<br />
de commission. Le colloque de clôture<br />
du projet de recherche Labex Arts-H2H<br />
aura pour thème la conservation de<br />
l’œuvre d’art numérique.<br />
Biennale d’art numérique de la <strong>BnF</strong>,<br />
le 6 décembre (Petit auditorium),<br />
présentation d’œuvres dans les salles<br />
de commission<br />
Journée de clôture du projet de<br />
recherche Labex Arts-H2H (salle 70),<br />
le 7 décembre de 9 h à 19 h<br />
(auditorium de l’INHA)<br />
Chu-Yin Chen, Vitamorph 2, 2012<br />
Du 1 er au 5 novembre 2017<br />
Parc des expositions,<br />
porte de Versailles, Paris<br />
De 8 h 30 à 18 h 30,<br />
fermeture à 18 h le dimanche<br />
Anniversaire<br />
Gallica a vingt ans !<br />
Numérisation<br />
Adoptez un livre !<br />
Vous souhaitez participer à la numérisation<br />
du patrimoine écrit de la <strong>BnF</strong> ? C’est possible !<br />
En adoptant un livre qui sera ensuite<br />
accessible dans Gallica, dont le titre sera<br />
associé à votre nom pendant dix ans.<br />
Et si vous avez des difficultés à faire votre<br />
choix, des listes d’ouvrages à adopter<br />
vous sont proposées, parrainées par<br />
des personnalités de la vie culturelle :<br />
par exemple Benoît Peeters, pour une liste<br />
dédiée à la bande dessinée. Lancé par<br />
les Amis de la <strong>BnF</strong> en mars 2011,<br />
ce programme a permis la numérisation<br />
de plus de 300 titres.<br />
Publics<br />
Journées portes<br />
ouvertes étudiants<br />
Les vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017,<br />
le site François-Mitterrand ouvre<br />
grand ses portes aux étudiants pour<br />
faire mieux connaître ses espaces<br />
de travail et de lecture du Haut-de-jardin<br />
ainsi que ses activités culturelles.<br />
Plus d’infos sur bnf.fr<br />
Leonetto Cappiello, La Folie des bonbons Jacquin, affiche, 1926, <strong>BnF</strong>, Estampes et photographie<br />
À sa création en octobre 1997, la bibliothèque<br />
numérique de la <strong>BnF</strong> comptait 2 600 volumes<br />
et 7 000 images fixes. En 2017, Gallica donne<br />
accès à ses collections et aux ressources de<br />
nombreux partenaires en France et à l’étranger :<br />
un fonds représentant près de 5 millions de<br />
documents, allant des manuscrits aux vidéos<br />
en passant par des affiches, estampes, photographies,<br />
cartes, globes en 3D et livres au<br />
format EPUB, consultables sur tablettes et<br />
smartphones. Pour célébrer les vingt ans de<br />
Gallica, la <strong>BnF</strong> organise une série de manifestations<br />
tout au long d’une année. Rendez-vous<br />
dès cet automne pour le premier temps fort<br />
de ces festivités : la 2 e édition du Hackathon<br />
de la <strong>BnF</strong> (lire p. 14). Un dossier spécial<br />
sera consacré aux vingt ans de Gallica<br />
dans le prochain numéro de <strong>Chroniques</strong>.
4 EXPOSITIONS JEAN ROUCH CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
1 2<br />
JEAN ROUCH<br />
L’HOMME–CINÉMA<br />
+ À VOIR<br />
Jean Rouch,<br />
l’Homme-Cinéma<br />
Du 26 septembre<br />
au 26 novembre 2017<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Galerie des donateurs<br />
et allée Julien Cain<br />
Commissariat<br />
Alain Carou, <strong>BnF</strong><br />
Béatrice de Pastre, CNC<br />
Andrea Paganini,<br />
Centenaire et Fondation<br />
Jean Rouch 2017<br />
Exposition réalisée en<br />
coproduction avec le<br />
CNC dans le cadre du<br />
Centenaire Jean Rouch<br />
2017, avec le concours<br />
de la Fondation Jean<br />
Rouch et du Comité du<br />
film ethnographique.<br />
Dans le cadre de Paris<br />
Photo 2017<br />
En partenariat avec<br />
ARTE, Jeune Afrique<br />
Media Group, France<br />
Médias Monde, Sofilm<br />
Après-midi d’étude<br />
autour des enjeux<br />
contemporains du<br />
cinéma de Jean Rouch<br />
14 octobre 2017<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Grand auditorium<br />
Programmation<br />
de La Cinémathèque<br />
Jean Rouch aurait eu cent ans<br />
en 2017. Une exposition à la <strong>BnF</strong><br />
permet de redécouvrir un homme<br />
d’images qui a inventé une façon<br />
inédite de raconter les hommes<br />
et le monde.<br />
En 2004, il s’est éteint au Niger, pays<br />
où il a eu la révélation de sa vocation<br />
d’ethnographe en 1941 et tourné une<br />
grande partie de ses films. Toute sa vie,<br />
il a lié les sciences de l’homme et le<br />
cinéma d’une manière singulière.<br />
Quand, en 1957, il filme Oumarou<br />
Ganda à Abidjan, dans sa vie de tous<br />
les jours, puis lui montre les images en<br />
lui demandant de les commenter à sa<br />
place, Jean Rouch accomplit un geste<br />
révolutionnaire. Pour la première fois,<br />
le sujet de l’ethnographe a longuement<br />
la parole et devient par la force des mots<br />
un véritable personnage de cinéma. Le<br />
film Moi, un Noir apparaît notamment<br />
ainsi, comme l’une des prémisses de la<br />
Nouvelle Vague. À son tour, Oumarou<br />
Ganda deviendra cinéaste.<br />
Au-delà de cette œuvre, c’est une série<br />
de films, chacun porteur d’une proposition<br />
originale, qui a fait de Jean Rouch<br />
l’une des figures essentielles du cinéma<br />
moderne. Dans Les Maîtres fous<br />
(1954-57), La Pyramide humaine (1959-<br />
61), Chronique d’un été (1960-61), Jaguar<br />
(1954-68), Jean Rouch se moque des<br />
prétentions à l’observation neutre et<br />
« objective » des faits sociaux. Il assume<br />
pleinement la subjectivité, le jeu et le<br />
partage dans les relations avec ceux<br />
qu’il filme. Une partie de ses films sont<br />
Publication<br />
Découvrir les films<br />
de Jean Rouch<br />
Sous la direction<br />
de Béatrice de Pastre<br />
CNC / <strong>BnF</strong> / Somogy<br />
30
EXPOSITIONS JEAN ROUCH 5<br />
4<br />
3 5<br />
des réalisations collectives avec ses<br />
complices Damouré Zika, Lam Ibrahim<br />
Dia, Tallou Mouzourane et Moussa<br />
Hamidou. L’improvisation y est reine<br />
– une improvisation qui comme dans le<br />
jazz doit se préparer longuement pour<br />
donner d’heureux résultats. Avant tout<br />
le monde et toute sa vie durant, Jean<br />
Rouch est resté attaché à un cinéma<br />
léger, à des caméras mobiles et autonomes.<br />
En tout cela, il préfigure et interroge<br />
des pratiques de l’image qui sont<br />
les nôtres aujourd’hui.<br />
Les archives papier, photographiques<br />
et sonores de Jean Rouch sont conservées<br />
à la <strong>BnF</strong>. La plupart des quelques<br />
1<strong>80</strong> films à ce jour identifiés sont conservés<br />
au CNC, qui les a restaurés et<br />
numérisés. L’exposition Jean Rouch,<br />
l’Homme-Cinéma présente les richesses<br />
des deux fonds pour la première fois<br />
rassemblés, dans deux espaces d’exposition<br />
en accès libre. Allée Julien Cain,<br />
le visiteur est invité à découvrir la trajectoire<br />
de Jean Rouch – de l’influence<br />
des surréalistes aux rituels de possession,<br />
de la cosmologie des Dogons aux<br />
pulsations des métropoles –, à travers<br />
200 images de grand format et de nombreux<br />
extraits de films. On y découvre<br />
entre autres l’œuvre photographique<br />
de Jean Rouch, commencée dès l’adolescence<br />
mais beaucoup moins connue<br />
que son cinéma. En Galerie des donateurs,<br />
le visiteur pénètre dans l’atelier<br />
des films de Jean Rouch. Le croisement<br />
de ses carnets de terrain, de sa correspondance,<br />
d’extraits de films et d’archives<br />
audiovisuelles permet de saisir<br />
de manière très concrète l’originalité<br />
de sa pratique du cinéma et de l’anthropologie<br />
visuelle.<br />
Dans le cadre du centenaire de la naissance<br />
de Jean Rouch, des événements<br />
seront proposés pendant tout l’automne<br />
2017 par plusieurs institutions parisiennes<br />
: la <strong>BnF</strong> (voir agenda), la Cinémathèque<br />
du documentaire nouvellement<br />
créée et installée à la BPI / Centre<br />
Georges-Pompidou, le Musée du quai<br />
Branly, le Musée de l’Homme et le<br />
Comité du film ethnographique, la<br />
Cinémathèque française, etc.<br />
Alain Carou, département de l’Audiovisuel<br />
1 Jean Rouch posant<br />
avec ses amis<br />
et collaborateurs<br />
Niger, 1951, photographie<br />
<strong>BnF</strong>, Manuscrits<br />
2 Jean Rouch,<br />
Enfant dogon aux lunettes<br />
Mali, 1969, diapositive<br />
<strong>BnF</strong>, Manuscrits<br />
3 Jean Rouch,<br />
Damouré Zika endormi<br />
Ghana, 1954, photographie<br />
<strong>BnF</strong>, Manuscrits<br />
4 Jean Rouch<br />
et Germaine Dieterlen,<br />
Le Dama d’Ambara.<br />
Enchanter la mort,<br />
Mali, 1974-19<strong>80</strong>,<br />
photogramme<br />
CNC<br />
5 Jean Rouch,<br />
Bataille sur<br />
le grand fleuve,<br />
Niger, 1951, photogramme<br />
CNC<br />
6 Jean Rouch,<br />
Safi Faye posant<br />
sur une plage,<br />
Sénégal, vers 1968<br />
<strong>BnF</strong>, Manuscrits<br />
6
DOSSIER EXPOSITIONS RICHELIEU PAYSAGES FRANÇAIS 7<br />
L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT<br />
PAYSAGES<br />
FRANÇAIS<br />
Paysages français.<br />
Une aventure<br />
photographique,<br />
1984-2017<br />
Du 24 octobre 2017<br />
au 4 février 2018<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Exposition virtuelle<br />
expositions.bnf.fr/<br />
paysages-francais<br />
À noter aussi<br />
Cycle de conférences<br />
autour de l’exposition<br />
Commissariat<br />
Raphaële Bertho,<br />
université de Tours<br />
Héloïse Conésa, <strong>BnF</strong><br />
Exposition réalisée<br />
avec le soutien de Picto<br />
Foundation, fonds de<br />
dotation du laboratoire<br />
Picto<br />
En partenariat avec<br />
Le Monde, Le Point,<br />
L’Œil, France 3<br />
et France Culture<br />
Avec le concours<br />
exceptionnel de la RATP<br />
En partenariat avec l’INA<br />
Dans le cadre de Paris<br />
Photo 2017<br />
+ À VOIR<br />
Cette exposition exceptionnelle,<br />
qui rassemble pour la première<br />
fois plus de 160 auteurs et quelque<br />
1 000 tirages issus de quarante<br />
années de travail collectif autour<br />
des paysages français, est l’occasion<br />
d’une réflexion sur les<br />
mutations de la France, de son<br />
identité, de son territoire, au<br />
prisme des plus grands photographes<br />
contemporains : Basilico,<br />
Brotherus, Couturier, Depardon,<br />
Doisneau, Plossu, Ristelhueber,<br />
Weiner… Ces derniers bousculent<br />
la représentation traditionnelle<br />
du paysage et explorent des<br />
esthétiques ouvrant à de nouvelles<br />
thématiques.<br />
Une histoire des missions<br />
photographiques en France<br />
À partir des années 19<strong>80</strong>, alors que la<br />
France changeait de physionomie, le<br />
regard des photographes sur le paysage<br />
français a été convoqué à l’initiative de<br />
quelques grands commanditaires, pour<br />
rendre compte de ces métamorphoses.<br />
Ainsi, dès 1984, la Mission photographique<br />
de la DATAR (Délégation à<br />
l’aménagement du territoire et à l’action<br />
régionale) a dépêché partout en<br />
France, pendant quatre ans, des photographes<br />
encore inconnus ou déjà<br />
célèbres pour représenter le paysage<br />
français. La <strong>BnF</strong> conserve, depuis la fin<br />
de cette décennie, le fonds de la Mission<br />
photographique (planches-contact<br />
et tirages). Il semblait donc légitime que<br />
cet ensemble devenu mythique soit présenté<br />
ici à sa juste valeur.<br />
La mission de la DATAR a été la première<br />
d’une longue série de commandes<br />
financées par l’État ou les collectivités<br />
locales et toutes conservées à<br />
la <strong>BnF</strong>. Également portées parfois par<br />
des groupes de photographes comme<br />
France(s) territoire liquide, ces commandes<br />
se sont succédé jusqu’à<br />
aujourd’hui pour livrer une multitude<br />
d’images de la France.<br />
À gauche<br />
Sophie Ristelhueber,<br />
Mission<br />
photographique<br />
de la DATAR,<br />
série « Ouvrages d’art<br />
et paysage dans les<br />
montagnes du Centre<br />
et des Alpes »,<br />
N 202, entre Barrême<br />
et Digne (Alpesde-Haute-Provence),<br />
1986<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes<br />
et photographie<br />
1. Hölderlin, 1823<br />
Un reflet des évolutions<br />
de la photographie<br />
Les photographies exposées questionnent<br />
des territoires aux frontières de<br />
plus en plus labiles : celles du genre paysager<br />
qui bascule vers le portrait ; celles<br />
d’un pays pris dans le flux des échanges<br />
contemporains ; celles du champ photographique<br />
lui-même, en constante<br />
réinvention. Argentiques ou numériques,<br />
fixes ou mouvantes, les images présentées<br />
sont plurielles, à l’instar du paysage<br />
kaléidoscopique qu’elles captent.<br />
Les écritures photographiques parlent<br />
du patrimoine comme du quotidien,<br />
s’invitent dans le débat pour proposer<br />
de nouvelles manières d’« habiter poétiquement<br />
¹ » le monde. Le goût pour le<br />
pittoresque semble s’effacer au profit<br />
d’une esthétique sensible à d’autres<br />
thèmes : transfiguration du banal,<br />
nature modifiée par l’homme...<br />
Le photographe est, quant à lui, tour<br />
à tour chercheur dans un paysagelaboratoire<br />
ou arpenteur recensant les<br />
mutations du paysage en territoire ; il<br />
est aussi auteur quand il imprime son<br />
style aux lieux. Il est enfin l’architecte<br />
capable de donner une vision autre de<br />
son pays.
8 EXPOSITIONS PAYSAGES FRANÇAIS CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
Une traversée photographique<br />
de quatre décennies<br />
Le visiteur suit d’abord « L’expérience<br />
du paysage » menée dans les années<br />
19<strong>80</strong> par les vingt-neuf photographes<br />
de la Mission photographique de la<br />
DATAR (1984-1988), de Robert<br />
Doisneau à Raymond Depardon en<br />
passant par l’Américain Lewis Baltz<br />
ou l’Italien Gabriele Basilico. Du<br />
Mont-Saint-Michel à Marseille, ces<br />
photographes s’affranchissent de la<br />
nécessité d’un regard illustratif sur les<br />
paysages urbains et naturels, au profit<br />
d’une véritable liberté dans les choix<br />
esthétiques et documentaires.<br />
Les années 1990 permettent d’entrer<br />
dans « Le temps du paysage » : devenu<br />
« patrimoine », celui-ci est mis à l’honneur<br />
dans les travaux d’Harry Gruyaert<br />
ou de John Batho, réalisés pour le<br />
Conservatoire du littoral. Le paysage<br />
est aussi montré comme mobile et<br />
changeant, marqué par le cycle des saisons,<br />
le passage des années ou les transformations<br />
structurelles. On suit ses<br />
évolutions avec les travaux d’Anne-<br />
Marie Filaire et Thierry Girard pour<br />
l’Observatoire photographique national<br />
du paysage ou ceux de Bernard<br />
Plossu dans le cadre du chantier du<br />
tunnel sous la Manche.<br />
Avec ses caractéristiques et ses limites<br />
naturelles ou administratives, le territoire<br />
devient ensuite, dans les années<br />
2000, un élément fondateur des dispositifs<br />
photographiques ; il donne lieu au<br />
développement d’un imaginaire topographique<br />
où « Le paysage devient style ».<br />
À travers des séries spécifiques ou des<br />
travaux au long cours qui embrassent<br />
la totalité du territoire français, le style<br />
aisément identifiable de photographes<br />
reconnus tels que Thibaut Cuisset,<br />
Gilles Leimdorfer, Jürgen Nefzger, participe<br />
en effet à la valorisation des lieux.<br />
Enfin, depuis le début des années 2010,<br />
le paysage n’est plus seulement photographié<br />
comme un espace à décrire<br />
mais aussi comme un lieu à habiter.<br />
L’homme s’y installe, s’immisce dans<br />
le cadre de l’image ; le récit des liens<br />
qui unissent « L’être au paysage » se fait<br />
plus intime et circonstancié, selon une<br />
relation fusionnelle et utopique,<br />
comme le montrent par exemple les<br />
travaux d’Elina Brotherus et de Thibault<br />
Brunet, membres de France(s)<br />
territoire liquide.<br />
Raphaële Bertho, université de Tours<br />
Héloïse Conésa, département<br />
des Estampes et de la photographie<br />
Ci-dessous<br />
Jürgen Nefzger,<br />
série « Fluffy Clouds »,<br />
Centrale nucléaire<br />
de Nogent-sur-Seine<br />
(Aube), 2003<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes<br />
et photographie<br />
Catalogue<br />
Paysages français.<br />
Une aventure<br />
photographique,<br />
1984-2017<br />
Sous la direction<br />
de Raphaële Bertho<br />
et Héloïse Conésa,<br />
commissaires<br />
de l’exposition<br />
Avec les contributions<br />
de François Bon,<br />
écrivain, Bruce Bégout,<br />
philosophe et écrivain<br />
Éditions de la <strong>BnF</strong><br />
304 pages<br />
270 illustrations<br />
49,90
DOSSIER EXPOSITIONS RICHELIEU PAYSAGES FRANÇAIS<br />
9<br />
1 Patrick Tourneboeuf,<br />
série « Nulle part »,<br />
Sans titre,<br />
1999-2005<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes<br />
et photographie<br />
2 Marion Gambin,<br />
France(s)<br />
territoire liquide,<br />
série « Entre-deux<br />
lieux », [Aire<br />
d’autoroute, France],<br />
2013<br />
3 Fred Delangle,<br />
France(s) territoire liquide,<br />
série « Paris-Delhi »<br />
Porte Saint-Denis, Paris, 10 e<br />
arrondissement, colorisé<br />
par Ashesh Josh, 2010<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes<br />
et photographie<br />
Le paysage<br />
comme<br />
laboratoire<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Michel Poivert est historien de la<br />
photographie¹. Raphaële Bertho<br />
et Héloïse Conésa, commissaires<br />
de l’exposition, l’ont rencontré.<br />
<strong>Chroniques</strong> : L’essor du genre paysager<br />
a-t-il permis aux photographes des<br />
années 19<strong>80</strong> de « s’émanciper », notamment<br />
vis-à-vis du photojournalisme ?<br />
M. P. : Le paysage urbain, périurbain<br />
ou rural a constitué une sorte de laboratoire.<br />
Le genre a même concurrencé<br />
voire éclipsé le documentaire social à<br />
la française des années 1970 et 19<strong>80</strong>.<br />
Or, il s’agissait de propositions fortes<br />
qu’il est urgent de redécouvrir – je<br />
pense notamment à celles de l’agence<br />
Faut voir. Le paysage était peut-être<br />
plus consensuel et surtout plus éloigné<br />
du photoreportage ; il a ainsi permis à<br />
la photographie d’intégrer plus aisément<br />
le domaine de l’art contemporain.<br />
C : Quel a été selon vous l’impact de la<br />
Mission photographique de la DATAR<br />
sur les photographes contemporains ?<br />
M. P. : Cette mission a fait date et, dans<br />
une certaine mesure, elle a fait école.<br />
Car le projet incluait un cahier des<br />
charges et posait en même temps la<br />
question du statut du photographe<br />
comme artiste. D’où une double problématique,<br />
définir le paysage en photographie,<br />
et réaliser une sorte de paysage<br />
de la photographie contemporaine.<br />
L’impact de la DATAR a donc dépassé<br />
le genre du paysage, si bien que cette<br />
mission constitue aujourd’hui un véritable<br />
repère dans l’histoire contemporaine.<br />
J’aime à penser qu’il s’y est même<br />
inventé un certain vernaculaire européen,<br />
en réponse à ce qui venait des<br />
États-Unis, notamment avec le grand<br />
référent que constituait l’exposition New<br />
Topographics (1975) qui mariait photographie<br />
de paysage et art conceptuel.<br />
C : Le rapport au paysage a évolué dans<br />
nos sociétés actuelles. De quelle façon<br />
ces évolutions ont-elles conditionné de<br />
nouvelles pratiques photographiques ?<br />
M. P. : Il me semble que nous vivons de<br />
plus en plus le paysage à travers la<br />
notion de site et la photographie a sa<br />
part dans l’artialisation des paysages.<br />
Dans sa diversité, la photographie<br />
contemporaine a inventé de nouveaux<br />
critères de beauté du paysage. Les<br />
espaces périurbains qui avaient au<br />
départ une connotation péjorative associée<br />
au terme de « no man’s land » sont<br />
devenus des lieux de mystère et de<br />
charme. La photographie rejoint ici ce<br />
que le cinéma avait déjà largement développé<br />
en faisant de la banlieue un paysage<br />
: repensons aux films de Pasolini !<br />
1. Michel Poivert enseigne à l’université Paris 1<br />
Panthéon–Sorbonne où il dirige le département<br />
d’histoire de l’art
10 DOSSIER EXPOSITIONS RICHELIEU PAYSAGES FRANÇAIS CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
REGARDS<br />
Trois des photographes présents<br />
dans l’exposition parlent de leur travail<br />
Elina Brotherus<br />
Série « 12 ans après », 1999<br />
« Cette série a été réalisée douze ans<br />
après une résidence d’artiste que j’ai<br />
faite à Chalon-sur-Saône, au musée Niépce,<br />
en 1999. Depuis cette époque, je<br />
suis la moitié du temps en France et<br />
l’autre moitié en Finlande, mon pays<br />
d’origine. En 2012, le musée m’a<br />
recontactée pour mener des ateliers avec<br />
des classes et j’ai accepté à la condition<br />
d’être logée au même endroit qu’auparavant,<br />
un carmel du XV e siècle rénové<br />
dans les années 1970. Ce qui m’intéressait,<br />
c’était de rentrer dans cette<br />
machine à remonter le temps pour faire<br />
une sorte d’expérimentation animale<br />
sur moi-même. Je me suis mise à faire<br />
des diptyques où l’on voit parfois exactement<br />
le même espace à douze ans d’intervalle.<br />
C’est ce qui m’a intéressée dans<br />
cette série : montrer l’écoulement du<br />
temps. Le paysage, c’est aussi la contemplation<br />
sur place, attendre le bon<br />
moment, la bonne lumière, souvent très<br />
tôt le matin.<br />
Je ne souhaite pas m’exprimer sur cette<br />
photo, L’Étang (2012), qui correspond<br />
à une période particulière de ma vie. En<br />
tout cas, la figure vue de dos est une thématique<br />
de prédilection ; c’est comme<br />
une invitation pour le spectateur à se<br />
joindre au personnage de la photo.<br />
J’aime aussi beaucoup les surfaces qui<br />
se reflètent, les miroirs, les lacs, les paysages<br />
épurés, la simplicité de construction.<br />
Le paysage le plus simple, c’est<br />
une ligne et deux champs, au-dessus et<br />
en-dessous. Sur cette photo, le fil que<br />
l’on voit à la surface, c’est le déclencheur<br />
pneumatique qui permet de<br />
prendre une photo sans retardateur avec<br />
un appareil argentique mécanique. Il<br />
montre que l’auteur de la photo est aussi<br />
le modèle. Souvent, je considère le paysage<br />
comme un décor ou comme une<br />
scène où se déroule une action. Dans<br />
certaines phases de mon travail, les photos<br />
sont très autobiographiques – souvent<br />
des autoportraits ou un paysage à<br />
l’intérieur duquel je me prends en<br />
photo ; dans d’autres, elles font plutôt<br />
référence à l’histoire de l’art. »<br />
Propos recueillis par Corine Koch<br />
Délégation à la communication<br />
1<br />
+ D’INTERVIEWS<br />
1 Elina Brotherus,<br />
France(s)<br />
territoire liquide,<br />
série « 12 ans après »,<br />
L’Étang, 2012<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes<br />
et photographie<br />
2 Sabine Delcour,<br />
Mission<br />
photographique<br />
du Conservatoire<br />
du littoral,<br />
série « Delta<br />
de la Leyre »,<br />
2006-2007<br />
2
DOSSIER EXPOSITIONS RICHELIEU PAYSAGES FRANÇAIS<br />
11<br />
Sabine Delcour<br />
Série « Delta de la Leyre », 2006-2007<br />
« Depuis vingt-cinq ans, je travaille sur<br />
le paysage et sur les rapports de l’homme<br />
à l’environnement, qu’il soit urbain ou<br />
rural. Je photographie des villes, des<br />
forêts, des espaces montagneux ou des<br />
îles au rythme des saisons et je manipule<br />
les codes de la photographie de<br />
paysage, pour faire apparaître la puissance<br />
d’évocation du territoire, sa capacité<br />
à susciter un imaginaire. Ce qui<br />
m’intéresse, ce sont les liens entre un<br />
paysage et la mémoire des êtres humains<br />
qui l’habitent, les liens entre un territoire<br />
intime et un territoire paysager. Je<br />
fais parler les gens, je collecte leurs récits<br />
sur les lieux que j’investis pour nourrir<br />
une réflexion sur la façon dont le paysage<br />
est perçu. Je me demande aussi :<br />
d’où nous vient le rapport que nous<br />
entretenons avec le paysage ? Est-ce qu’il<br />
existe en nous une matrice de ce rapport<br />
? C’est dans ce cadre que j’ai également<br />
travaillé sur des sites géologiques<br />
; c’est aussi un travail sur le temps.<br />
Quand le Conservatoire du littoral m’a<br />
proposé de photographier le delta de la<br />
Leyre, j’étais en train de réaliser un travail<br />
sur le cheminement et sur les parcours<br />
individuels. J’étais très imprégnée<br />
par ce projet et par sa dimension symbolique.<br />
Il a été très présent dans la relation<br />
que j’ai eue avec ce territoire. J’ai<br />
insisté pour photographier le domaine<br />
de Certes, dans le fond du bassin d’Arcachon,<br />
qui était un lieu de mon enfance.<br />
Quand j’ai commencé, les relations avec<br />
les gardes du littoral qui entretiennent<br />
le domaine étaient assez froides. Je leur<br />
ai montré les images que je faisais et<br />
leur regard m’a beaucoup apporté.<br />
Ensuite ils m’ont emmenée dans des<br />
endroits auxquels je n’aurais jamais pu<br />
accéder sans eux ! Je réalise mes images<br />
à la chambre en laissant apparent le bord<br />
du négatif. Cela donne à voir que c’est<br />
la vision de l’auteur qui permet au spectateur<br />
de rentrer dans le paysage. L’œil<br />
du spectateur chemine dans l’image où<br />
se noue une complexe relation entre flou<br />
et net. »<br />
Propos recueillis par Sylvie Lisiecki<br />
Délégation à la communication<br />
3 Laurent Kronental,<br />
série « Souvenir<br />
d’un futur »<br />
Joseph, 88 ans,<br />
Les Espaces d’Abraxas,<br />
Noisy-le-Grand, 2014<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes<br />
et photographie<br />
3<br />
Laurent Kronental<br />
Série « Souvenir d’un futur », 2011-2015<br />
« Il s’agit de mon premier projet. Depuis<br />
plusieurs années, je voulais m’engager<br />
sur un sujet à propos des personnes<br />
âgées mais je ne savais pas comment.<br />
Ce qui était sûr, c’est que je voulais les<br />
montrer de manière insolite, dans un<br />
cadre où on ne s’attend pas à les voir.<br />
Je souhaitais aussi déconstruire l’image<br />
un peu péjorative de la personne âgée<br />
qu’on a tendance à se représenter<br />
comme fatiguée.<br />
À Courbevoie, il y a une ruelle de terre<br />
qui mène à la Défense. Un jour, j’ai rencontré<br />
là un couple de seniors avec<br />
lequel j’ai sympathisé. En les voyant<br />
dans leur jardin avec le linge qui séchait<br />
et les tours derrière, je me suis dit que<br />
le sujet était là, dans cette superposition.<br />
Ce qui me donne des émotions,<br />
c’est de parler des époques qui se juxtaposent<br />
en un même endroit.<br />
En parallèle, j’ai développé une attirance<br />
pour les grands ensembles qui<br />
évoquent quelque chose de toujours<br />
futuriste. Rassembler les deux sujets<br />
permettait de parler à la fois de la marginalisation<br />
de ces quartiers et de celle<br />
du grand âge.<br />
Dans le cas de Joseph, 88 ans, il s’agit<br />
d’une scène que j’ai photographiée dans<br />
le quartier des Espaces d’Abraxas,<br />
construit dans les années 1970 par<br />
Ricardo Bofill, à Noisy-le-Grand. Ce<br />
vieux monsieur m’a tout de suite interpellé<br />
par son allure à la fois élégante et<br />
décalée. Dans sa posture, il y a de la<br />
dignité, de la mélancolie et de la force.<br />
Cette image est l’une de mes préférées.<br />
Elle évoque un monde parallèle presque<br />
apocalyptique, où les derniers témoins<br />
seraient les personnes âgées qui se<br />
tiennent encore droites face à ces<br />
colonnes de béton. D’ailleurs, j’ai choisi<br />
des gens qui avaient une certaine jeunesse<br />
dans leur vieillesse. “ Mon corps<br />
vieillit mais mon esprit semble ne pas<br />
avoir vieilli ” , m’a dit l’un d’eux. »<br />
Propos recueillis par Corine Koch<br />
Délégation à la communication
12 DOSSIER EXPOSITIONS RICHELIEU PATRICE CHÉREAU CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
Patrice<br />
Chéreau<br />
Du théâtre<br />
à l’opéra<br />
Patrice Chéreau.<br />
Mettre en scène<br />
l’opéra<br />
Du 18 novembre 2017<br />
au 3 mars 2018<br />
<strong>BnF</strong> I Bibliothèque-musée<br />
de l’Opéra<br />
Commissariat<br />
Sarah Barbedette,<br />
Opéra national de Paris,<br />
Pénélope Driant, <strong>BnF</strong><br />
À l’occasion de la reprise de<br />
De la maison des morts de Leoš<br />
Janáček, l’une des dernières<br />
productions mises en scène par<br />
Patrice Chéreau, la <strong>BnF</strong> s’associe<br />
à l’Opéra national de Paris<br />
pour célébrer son parcours sur<br />
les scènes lyriques.<br />
Parallèlement au travail théâtral entamé<br />
dès ses années d’études au lycée Louisle-Grand,<br />
Patrice Chéreau (1944-2013)<br />
se lance à vingt-cinq ans dans la mise<br />
en scène d’opéra, avec L’Italienne à Alger<br />
de Rossini présentée au Festival de Spolète,<br />
puis Les Contes d’Hoffmann<br />
d’Offenbach, à l’Opéra de Paris. Lors<br />
du centenaire du Festival de Bayreuth<br />
en 1976, il est choisi pour monter les<br />
quatre opéras de L’Anneau du Nibelung<br />
de Wagner aux côtés de Pierre Boulez :<br />
provoquant d’abord un scandale retentissant,<br />
sa mise en scène finit par conquérir<br />
le public et lui vaudra une renommée<br />
internationale. Toujours avec Boulez,<br />
Chéreau dirigera la création mondiale<br />
de Lulu de Berg dans sa version intégrale,<br />
avant d’entamer de fructueuses<br />
collaborations avec de nombreux chefs<br />
d’orchestre : Sylvain Cambreling pour<br />
Lucio Silla ; Daniel Barenboim pour<br />
Wozzeck, Don Giovanni et Tristan et Isolde ;<br />
Daniel Harding pour Così fan tutte ; et<br />
enfin Esa-Pekka Salonen, aux côtés<br />
duquel il signera sa dernière mise en<br />
scène lyrique, Elektra de Strauss, lors du<br />
Festival d’Aix-en-Provence en 2013.<br />
Ci-dessus<br />
Lulu, musique<br />
d’Alban Berg, mise<br />
en scène de Patrice<br />
Chéreau, Opéra<br />
de Paris, 1979,<br />
avec Yvonne Minton<br />
et Teresa Stratas<br />
Photographie<br />
de Daniel Cande<br />
<strong>BnF</strong>, Arts du spectacle<br />
Catalogue<br />
Sous la direction<br />
de Sarah Barbedette<br />
et Pénélope Driant<br />
Éditions Actes Sud<br />
1. Patrice Chéreau,<br />
note de travail pour<br />
L’Anneau du Nibelung<br />
de Richard Wagner<br />
IMEC, Fonds<br />
Patrice Chéreau<br />
Avec ces onze productions, Patrice<br />
Chéreau a profondément renouvelé la<br />
fabrique de l’opéra, mettant ses talents<br />
de directeur d’acteurs au service d’une<br />
conception toujours plus incarnée des<br />
rôles chantés, soutenu dans sa démarche<br />
par le scénographe Richard Peduzzi,<br />
dont les décors, d’une grande inventivité,<br />
contribuaient pleinement à l’action<br />
sur le plateau. Ces décors entraient<br />
souvent en résonance avec un univers<br />
pictural très riche, dans lequel le metteur<br />
en scène avait baigné dès son<br />
enfance, marquée par l’activité d’un<br />
père peintre et de nombreuses visites<br />
de musées. Constamment sollicité<br />
par les directeurs de maisons d’opéra,<br />
Chéreau a rencontré d’éclatants succès,<br />
même si l’histoire de ses relations avec<br />
le genre lyrique est teintée d’une ambivalence<br />
irréductible : à plusieurs reprises,<br />
Chéreau a déclaré tourner définitivement<br />
le dos à l’opéra, déplorant la trop<br />
grande lourdeur administrative et les<br />
difficultés inhérentes à un calendrier<br />
de répétitions bien plus restreint qu’au<br />
théâtre.<br />
L’exposition présentée dans les espaces<br />
de la Bibliothèque-musée de l’Opéra<br />
au Palais Garnier rassemble plus d’une<br />
centaine de documents, issus des collections<br />
de la <strong>BnF</strong>, de prêts privés et du<br />
fonds Patrice Chéreau déposé à l’Institut<br />
Mémoires de l’édition contemporaine<br />
: notes de travail, livrets annotés,<br />
correspondance, esquisses, maquettes<br />
de décors, photographies, archives<br />
audiovisuelles… Elle invite à découvrir<br />
les divers enjeux, formels ou conceptuels,<br />
qui sous-tendent chacune des<br />
onze productions lyriques du metteur<br />
en scène, puis propose un second parcours<br />
plus thématique, qui permet au<br />
visiteur d’explorer les différents processus<br />
de création mis en œuvre par<br />
Chéreau à l’opéra : comment diriger les<br />
chanteurs comme de véritables comédiens,<br />
comment œuvrer en concertation<br />
étroite avec les chefs d’orchestre,<br />
quelles relations établir entre l’action<br />
dramatique et la musique ? L’exposition<br />
dresse ainsi un portrait du metteur<br />
en scène au travail, cherchant en permanence<br />
à donner à l’opéra la puissance<br />
d’un « théâtre grandi, porté à l’incandescence<br />
par la musique, comme<br />
l’épée de Siegfried¹ ».<br />
Sarah Barbedette, Opéra national de Paris<br />
Pénélope Driant, <strong>BnF</strong>, département de la Musique
EXPOSITIONS BOURSE DU TALENT / HORS LES MURS 13<br />
Photographes<br />
émergents<br />
Depuis dix ans, la <strong>BnF</strong><br />
présente les photographies<br />
lauréates de la Bourse du Talent,<br />
qui récompense de jeunes<br />
photographes. Organisée par<br />
Photographie.com et Picto,<br />
cette manifestation, qui a pour<br />
thèmes le paysage, le reportage,<br />
le portrait et la mode,<br />
est aujourd’hui un indicateur<br />
des talents émergents.<br />
Lauréate 2017 dans la catégorie Reportage,<br />
Chloé Jafé, née en 1984, s’intéresse<br />
aux femmes dans la mafia japonaise,<br />
depuis son installation à Tokyo<br />
en 2014. Son projet, intitulé Inochi<br />
Azukemasu, expression qui signifie le<br />
« don de sa vie » et ainsi l’engagement<br />
au sein d’un clan, est une sorte de carnet<br />
de voyage dans le monde des yakusas.<br />
La jeune photographe a tenté d’intégrer<br />
un clan de la mafia pour<br />
comprendre la place des femmes dans<br />
cette organisation méconnue. Elle a pu<br />
photographier en se faisant progressivement<br />
accepter. Dans cet univers<br />
dominé par les hommes, les femmes<br />
n’existent que comme maîtresses,<br />
épouses ou filles, même si leur rôle dans<br />
le fonctionnement de l’organisation est<br />
important.<br />
Afin de contribuer à sauvegarder la<br />
mémoire de la création, qui deviendra<br />
patrimoine au fil du temps, organisateurs<br />
et photographes font don à la <strong>BnF</strong><br />
d’un ensemble de tirages qui viennent<br />
enrichir la collection de photographie<br />
contemporaine du département des<br />
Estampes et de la photographie.<br />
Sylvie Lisiecki<br />
Délégation à la communication<br />
1<br />
À noter<br />
Jeunes photographes<br />
de la Bourse du<br />
Talent 2017<br />
Du 15 décembre 2017<br />
au 4 mars 2018<br />
Allée Julien Cain<br />
Avec le soutien<br />
de la Fondation Roederer<br />
1 Bourse du Talent<br />
# 69 Reportage :<br />
Chloé Jafé, lauréate,<br />
série « Inochi<br />
Azukemasu », 2014<br />
2 Astérix chez les<br />
Belges, planche<br />
originale, dessins<br />
d’Albert Uderzo, texte<br />
de René Goscinny,<br />
Paris, 1977<br />
<strong>BnF</strong>, Réserve<br />
des livres rares<br />
3 Jean-Benjamin<br />
de La Borde<br />
(1734-1794), d’après<br />
les observations<br />
de François Levaillant<br />
(1753-1824),<br />
Partie Méridionale<br />
de l’Afrique depuis<br />
le Tropique du<br />
Capricorne jusqu’au<br />
Cap de Bonne-<br />
Espérance contenant<br />
les Pays des<br />
Hottentots, des<br />
Cafres et de quelques<br />
autres Nations<br />
Carte manuscrite<br />
au lavis et à la plume<br />
<strong>BnF</strong>, Cartes et plans<br />
2<br />
Hors les murs<br />
Dans les collections<br />
de la <strong>BnF</strong><br />
Afin de faire mieux connaître<br />
ses trésors, la <strong>BnF</strong> ouvre ses<br />
collections à des musées des<br />
régions de France. Dans chacun<br />
de ces musées, une sélection<br />
de chefs-d’œuvre – gravures,<br />
photographies, cartes, manuscrits<br />
ou monnaies et médailles – est<br />
présentée autour d’une thématique<br />
ou d’un artiste en résonance<br />
avec l’histoire et les collections<br />
du lieu où elles sont accueillies.<br />
Ces présentations sont également<br />
l’occasion de numériser un<br />
ensemble d’œuvres qui sont mis<br />
en ligne dans Gallica.<br />
Festival international de géographie<br />
de Saint-Dié-des-Vosges<br />
Du 29 septembre<br />
au 1 er octobre 2017<br />
À l’occasion du Festival international<br />
de géographie de Saint-Dié-des-Vosges,<br />
qui met à l’honneur l’Afrique du Sud<br />
autour du thème « Territoires humains,<br />
mondes animaux », la <strong>BnF</strong> présente une<br />
carte de l’Afrique australe établie par<br />
l’explorateur et ornithologue François<br />
Levaillant (1753-1824).<br />
3<br />
Musée du Louvre, Paris<br />
D’or et d’ivoire : reliures<br />
du Moyen Âge<br />
Cinq reliures d’orfèvrerie et d’ivoire<br />
sont présentées dans les salles<br />
du département des Objets d’art du<br />
musée du Louvre, du 31 octobre 2017<br />
au 2 juillet 2018.<br />
Prêts de la <strong>BnF</strong><br />
Musée d’art et d’histoire<br />
du judaïsme, Paris<br />
Du 27 septembre 2017<br />
au 4 mars 2018<br />
René Goscinny, au-delà du rire<br />
À l’occasion du quarantième anniversaire<br />
de la disparition de René Goscinny,<br />
l’exposition, René Goscinny, au-delà du<br />
rire, rend hommage au célèbre scénariste.<br />
Dans ce cadre, la <strong>BnF</strong> prête<br />
quarante-quatre planches originales<br />
d’Astérix issues d’Astérix le Gaulois,<br />
La Serpe d’or et Astérix chez les Belges,<br />
trois albums donnés par Albert Uderzo<br />
en 2011.
14 AUDITORIUMS HACKATHON CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
HACKATHON<br />
2e ÉDITION !<br />
Hackathon de la <strong>BnF</strong> Samedi 25<br />
et dimanche 26<br />
novembre 2017<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Programmation<br />
culturelle<br />
Plus d’infos sur bnf.fr<br />
Samedi 25 novembre<br />
14 h : lancement<br />
du Hackathon et<br />
conférence inaugurale :<br />
« Le numérique dans<br />
nos vies »<br />
15 h – 18 h :<br />
conférences et ateliers :<br />
« Le citoyen et les<br />
données numériques »<br />
20 h - minuit : <strong>BnF</strong>’s<br />
afterwork : remixes<br />
d’extraits des collections<br />
de la <strong>BnF</strong> par un collectif<br />
de DJs<br />
Dimanche 26<br />
novembre<br />
14 h – 16 h : scène<br />
ouverte aux musiciens<br />
du web sous la houlette<br />
de PV Nova<br />
12 h – 17 h : installation<br />
sonore sur le thème<br />
du paysage avec Arnaud<br />
Sallé, compositeur<br />
Dans le cadre de la Semaine<br />
de l’innovation publique,<br />
la <strong>BnF</strong> organise son 2e Hackathon.<br />
Thème de cette édition : la musique.<br />
Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un hackathon<br />
? Réponse : un marathon de<br />
vingt-quatre heures non-stop destiné à<br />
inventer de nouveaux services ou usages<br />
à partir d’images et de données, en l’occurrence<br />
celles de la <strong>BnF</strong>. Cet événement<br />
ne s’adresse pas qu’à des mordus<br />
de la technique ! Tous ceux qui souhaitent<br />
contribuer à l’effort de l’État en<br />
matière de données ouvertes sont aussi<br />
invités à partager leurs idées auprès de<br />
développeurs (informaticiens, designers,<br />
graphistes) qui leur donneront corps<br />
sous forme de prototypes. Car si la<br />
richesse d’un hackathon est bien de rassembler<br />
une communauté éphémère aux<br />
compétences variées, à la <strong>BnF</strong>, elle représente<br />
aussi la volonté collective et désintéressée<br />
de faire avancer la connaissance<br />
plus vite et de manière plus connectée<br />
aux besoins des usagers.<br />
Mais le Hackathon de la <strong>BnF</strong> est aussi<br />
une fête du numérique : l’occasion pour<br />
tout un chacun de découvrir les données<br />
de ses collections sur le son et la<br />
musique, d’assister à des conférences et<br />
à des ateliers afin de mieux comprendre<br />
l’importance de ces données et les<br />
usages que tout citoyen peut en faire,<br />
d’assister à des concerts et des performances<br />
sonores : le samedi, un collectif<br />
Musique Conférences Making Concerts<br />
de DJs et musiciens électro vous invitera<br />
à danser sur des remixes constitués<br />
à partir des fonds sonores de la <strong>BnF</strong>, et<br />
le dimanche après-midi, la scène sera<br />
ouverte aux musiciens du web sous la<br />
houlette de PV Nova.<br />
Quelles données la <strong>BnF</strong> met-elle<br />
à disposition ?<br />
La <strong>BnF</strong> met gratuitement à la disposition<br />
du public l’ensemble des données<br />
descriptives qu’elle produit dans le cadre<br />
de la constitution et de la valorisation<br />
de ses collections. Outre les catalogues<br />
en ligne grâce auxquels chacun peut<br />
faire une recherche, consulter et sauvegarder<br />
ses résultats sous diverses formes,<br />
sont apparues les APIs, ces fameuses<br />
Application Programming Interfaces destinées<br />
à récupérer automatiquement des<br />
données à partir d’un programme informatique<br />
distant qui communique avec<br />
les serveurs de la <strong>BnF</strong>. Concrètement,<br />
on vous donne le mode d’emploi et c’est<br />
vous qui pilotez directement, sans passer<br />
par l’interface homme-machine (ou<br />
IHM) que constituent les sites web des<br />
catalogues ou de Gallica.<br />
Les utilisateurs de la <strong>BnF</strong> ont accès en<br />
permanence aux réservoirs de données<br />
et aux APIs correspondantes qui seront<br />
accessibles durant le Hackathon.<br />
Parmi ceux-ci, le catalogue général rassemble<br />
14 millions de notices et décrit<br />
les livres et journaux imprimés, les collections<br />
iconographiques, les partitions<br />
manuscrites et imprimées, les documents<br />
audiovisuels (son, image animée,<br />
jeux vidéo et logiciels). Le catalogue<br />
<strong>BnF</strong> Archives et manuscrits décrit les<br />
collections d’ouvrages écrits à la main<br />
des origines à nos jours et les fonds d’archives<br />
littéraires, dramaturgiques, historiques<br />
ou scientifiques.
AUDITORIUMS HACKATHON 15<br />
Avec plus de 4 millions de documents,<br />
Gallica, la bibliothèque numérique de<br />
la <strong>BnF</strong>, est l’une des plus importantes<br />
du monde.<br />
Enfin, Data, la plateforme de données<br />
ouvertes de la <strong>BnF</strong>, regroupe sur une<br />
même page web toutes les informations<br />
dont elle dispose sur un titre, un auteur<br />
ou un thème en exploitant les principes<br />
du web de données. Un utilisateur physique<br />
ou un ordinateur distant peuvent<br />
ainsi récupérer des synthèses ou des<br />
fichiers structurés leur permettant<br />
ensuite de mieux se repérer dans les<br />
autres ressources de la Bibliothèque.<br />
Gallicarte<br />
Le Hackathon de la <strong>BnF</strong>,<br />
comment ça marche ?<br />
La participation est libre et gratuite pour<br />
les hackathoniens qui se rassembleront<br />
dans le hall des Globes. L’inscription<br />
au Hackathon se fait en ligne à partir<br />
du 15 septembre 2017. Les participants<br />
s’engagent à passer vingt-quatre heures<br />
non-stop à la <strong>BnF</strong> (un espace de repos,<br />
de restauration et des douches seront<br />
mis à disposition !). À trois reprises<br />
durant ces vingt-quatre heures, les<br />
équipes (dix au total) présenteront leur<br />
projet devant un jury pour un temps<br />
d’échange. À l’issue des restitutions sera<br />
remis le prix du Hackathon <strong>BnF</strong>, récompense<br />
qui marque l’engagement de la<br />
Bibliothèque à développer le projet lauréat<br />
pour en faire un service permanent<br />
offert aux usagers.<br />
Autour de cet événement et durant tout<br />
le week-end, une programmation culturelle<br />
ouverte à tous sera proposée dans<br />
le hall d’entrée : conférences et ateliers<br />
autour du numérique, mais aussi<br />
remixes, performances musicales et jeux<br />
vidéo. Vous êtes les bienvenus !<br />
Matthieu Bonicel, Direction générale<br />
En haut<br />
Hackathon 2016<br />
À droite<br />
Une illustration<br />
du projet Gallicarte<br />
Le premier prix du Hackathon<br />
2016 a été décerné au projet<br />
Gallicarte. Conformément à<br />
l’engagement pris par la <strong>BnF</strong>, il<br />
a été développé de façon à apporter<br />
de nouvelles fonctionnalités<br />
aux utilisateurs de Gallica.<br />
Cet outil permet d’afficher sur une carte<br />
les résultats d’une recherche effectuée<br />
dans Gallica. La nouvelle fonctionnalité<br />
permet de visualiser, par exemple,<br />
l’ensemble d’un fonds photographique<br />
géolocalisé sur une carte interactive en<br />
présentant les documents et leurs métadonnées<br />
issues du catalogue. Pour le<br />
grand public, la carte comme mode<br />
d’affichage est d’utilisation simple. Pour<br />
les utilisateurs plus avertis, la carte<br />
comme mode de visualisation peut faire<br />
émerger des hypothèses de recherches.<br />
Le prototype, développé en vingt-quatre<br />
heures pendant le concours, proposait<br />
des fonctions simples sur un corpus<br />
documentaire relativement réduit.<br />
L’engagement pris par la <strong>BnF</strong> était de<br />
proposer ce mode de présentation des<br />
résultats pour un grand nombre de<br />
documents dans Gallica. Dans un premier<br />
temps, des cartes thématiques<br />
(gastronomie, événements sportifs,<br />
monuments historiques, villes françaises…)<br />
ont fait leur apparition dans<br />
l’interface de la bibliothèque numérique.<br />
Par la suite, de nouvelles fonctionnalités<br />
comme la visualisation des<br />
entités nommées (noms de personnes,<br />
de lieux, d’organisations, dates) sur des<br />
fonds de cartes récents ou anciens<br />
seront accessibles depuis les pages de<br />
résultats de requête. Enfin, des opérations<br />
collaboratives avec les Gallicanautes<br />
seront organisées pour améliorer<br />
la précision des données présentées :<br />
les utilisateurs pourraient aider à identifier<br />
précisément le lieu de certaines<br />
prises de vues ou retracer le parcours<br />
d’un héros de roman. Gallica pourra<br />
aussi proposer des services géolocalisés<br />
comme des recueils d’affiches ou<br />
de photos anciennes en fonction de l’endroit<br />
de consultation. Ces nouveautés<br />
seront disponibles dans Gallica à partir<br />
de la fin de l’année.<br />
Matthieu Gioux<br />
Chef de produit Gallica
16 AUDITORIUMS HACKATHON<br />
CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
Gallica Studio<br />
Un filon à creuser<br />
Avec plus de 4 millions de documents,<br />
Gallica est une véritable mine pour<br />
les hackathoniens. Certains pionniers<br />
ne s’y sont d’ailleurs pas trompés<br />
et s’approprient quotidiennement<br />
ces fonds pour créer des réalisations<br />
innovantes. Gallica Studio, nouveau<br />
site de la <strong>BnF</strong>, a pour but de mettre<br />
en valeur ces réalisations.<br />
Inspiré par le développement des<br />
démarches participatives et créatives<br />
sur le web telles que le Rijsks Studio du<br />
Rijsksmuseum Amsterdam, Gallica Studio<br />
s’inscrit dans la continuité des premières<br />
initiatives de la <strong>BnF</strong> en la<br />
matière et offre une plateforme d’expression<br />
inédite, qui rassemble et met<br />
en contact la communauté des Gallicanautes.<br />
Pour cela, le site se décline<br />
en quatre rubriques aux objectifs complémentaires.<br />
La boîte à outils<br />
Elle accueille des outils de développement<br />
de projet (écriture collaborative,<br />
sondage, partage de documents…) et<br />
fournit une documentation complète<br />
sur les services en ligne de la <strong>BnF</strong>,<br />
concernant par exemple data.bnf.fr ou<br />
le meilleur moyen de réaliser une Gallicabox.<br />
Les projets collaboratifs<br />
Véritable cœur du site, cet espace souhaite<br />
promouvoir les projets liés à Gallica.<br />
Un article est consacré à chacun<br />
de ces projets, tous accompagnés par<br />
la <strong>BnF</strong>. Il revient sur leurs objectifs,<br />
leurs besoins et les possibilités de participation<br />
pour les autres Gallicanautes.<br />
Les projets Gallicarte et « Que dirait<br />
Diderot ? » de l’édition 2016 du Hackathon<br />
de la <strong>BnF</strong> ont d’ailleurs vocation<br />
à y figurer. Ils seront rapidement<br />
rejoints par d’autres projets que les Gallicanautes<br />
pourront soumettre.<br />
La veille<br />
Complémentaire de la démarche « Du<br />
côté des Gallicanautes », rubrique du<br />
blog Gallica, la veille contient différents<br />
tutoriels de réutilisation de Gallica. Elle<br />
illustre ainsi la créativité des Gallicanautes<br />
en permettant aux utilisateurs<br />
de suivre pas à pas leurs démarches de<br />
création. De la confection de costumes<br />
d’époque à la réalisation de maquettes<br />
de la tour Eiffel, en passant par des tutoriels<br />
plus techniques, cette rubrique sera,<br />
à l’image des Gallicanautes, aussi variée<br />
qu’enthousiasmante.<br />
La résidence d’artiste<br />
Cette dernière rubrique présente la<br />
création d’un artiste à partir de l’univers<br />
de Gallica. Elle permet également<br />
des rencontres entre l’artiste et les Gallicanautes.<br />
De ces regards croisés<br />
autour de Gallica pourront ainsi naître<br />
de nouvelles collaborations proposées<br />
à l’ensemble des Gallicanautes.<br />
Gallica Studio, c’est aussi et surtout un<br />
espace ouvert et convivial qui n’attend<br />
plus que vos projets pour prendre toute<br />
son ampleur. Nous sommes donc impatients<br />
de découvrir vos idées, à déposer<br />
dans la rubrique « Proposer un projet<br />
». Les orpailleurs, c’est vous !<br />
Anne-Laure Michel<br />
Département de la Coopération<br />
À gauche<br />
Pierre Van Rompaey,<br />
Se faire chercheur<br />
d'or ? Achetez plutôt<br />
un billet de la Loterie<br />
nationale,<br />
affiche en couleur,<br />
années 1950,<br />
Le Bélier, Paris<br />
Bibliothèque Forney<br />
Prix<br />
Phonurg<br />
Prix Phonurgia Nova<br />
Les samedi 23<br />
et dimanche 24<br />
septembre 2017<br />
Samedi de 10 h à 20 h<br />
Dimanche de 11 h à 20 h<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Petit auditorium<br />
Rendez-vous annuel très attendu<br />
des créateurs radiophoniques et<br />
sonores, les prix Phonurgia Nova<br />
sont nés à Arles en 1986, d’après<br />
une idée de Pierre Schaeffer.<br />
Ils célèbrent la « radio de création »<br />
et la liberté de raconter le monde<br />
avec et par les sons. L’édition<br />
2017 met à l’honneur les auteurs<br />
de fictions, de documentaires,<br />
de captations ou de pièces<br />
purement sonores.<br />
Les prix Phonurgia Nova ont une<br />
double vocation : d’une part, réaffirmer<br />
sans cesse que le son est un médium<br />
d’expression singulier du réel et de<br />
l’imaginaire, et donc révéler la création<br />
sonore et radiophonique la plus<br />
contemporaine ; d’autre part, sensibi-
AUDITORIUMS PRIX PHONURGIA NOVA / CYCLE EINSTEIN<br />
17<br />
LA COSMOLOGIE<br />
EST UN SPORT<br />
DE COMBAT<br />
Dans le cadre de<br />
« Tous les savoirs »<br />
L’université populaire<br />
de la <strong>BnF</strong><br />
SCIENCES<br />
Cycle de quatre<br />
conférences<br />
« Un siècle<br />
de cosmologie :<br />
d’Einstein<br />
au Big Bang »<br />
Les mardis 3<br />
et 10 octobre, 7<br />
et 14 novembre 2017<br />
De 18 h 30 à 20 h<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Petit auditorium<br />
ia Nova<br />
liser les responsables culturels de tous<br />
les pays à un domaine de la création<br />
qui mérite d’être considéré, préservé et<br />
valorisé, au même titre que l’écrit ou<br />
d’autres arts de support comme le cinéma<br />
ou la photographie.<br />
Ingénieur, homme de radio et compositeur<br />
français considéré comme le père<br />
de la musique concrète, Pierre Schaeffer<br />
a œuvré tout au long de sa carrière<br />
pour la reconnaissance de cette « littérature<br />
radiophonique ». Il serait heureux<br />
de constater que son ambition est<br />
partagée par une institution telle que<br />
la <strong>BnF</strong>. En accueillant ce concours<br />
international, la Bibliothèque a également<br />
créé le prix Archives de la parole<br />
pour récompenser les auteurs qui<br />
s’aventurent sur les chemins tortueux<br />
de la captation de la parole. Enregistrer<br />
les voix et les silences du monde<br />
est tout un art. Les 23 et 24 septembre,<br />
cet art sera à la fête !<br />
Marc Jacquin<br />
Directeur de Phonurgia Nova<br />
Toute l’actu des prix<br />
www.phonurgianova.blog.<br />
lemonde.fr<br />
Facebook I Phonurgia<br />
Nova Awards<br />
www.phonurgia.org<br />
Consultez les<br />
archives sonores<br />
de la <strong>BnF</strong> sur Gallica<br />
gallica.bnf.fr ><br />
enregistrements sonores<br />
Archives sonores<br />
www.sonosphere.org<br />
Ci-dessus<br />
Concert par T.S.F.,<br />
Press photo,<br />
Agence Rol, 1923<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes<br />
et photographie<br />
À droite<br />
Adrien Barrère,<br />
Herr Professor<br />
Einstein ou<br />
le Kolossal Relatif,<br />
dessin, 1930<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes<br />
et photographie<br />
En 1917, Einstein étend à l’univers<br />
sa théorie de la relativité générale<br />
qui n’a alors que deux ans ; une<br />
application qui semble aller de soi<br />
mais pose nombre de problèmes<br />
fondamentaux. Un nouveau<br />
cycle de conférences décrypte cent<br />
ans de cosmologie relativiste.<br />
« J’ai encore commis quant à la gravitation<br />
quelque chose qui m’expose au<br />
danger d’être enfermé dans un asile<br />
d’aliénés. » Cette phrase qu’écrit Einstein<br />
à un ami en 1917 révèle déjà à quel<br />
point la relativité générale, trop complexe,<br />
sera peu appréciée. Car ce n’est<br />
plus sur la scène newtonienne, cet<br />
espace absolu, euclidien, que se joue<br />
désormais notre destin matériel ; l’univers<br />
lui-même devient partie du destin<br />
universel. L’univers est à inventer !<br />
Mais dans l’ombre de la théorie, la cosmologie<br />
séduit assez largement les<br />
experts car elle permet de mieux comprendre<br />
la structure de la relativité, de<br />
tester, de jouer avec des espaces-temps<br />
très divers. Ainsi, on s’instruit, on entre<br />
progressivement dans cette théorie<br />
étrange, on en repère les structures possibles,<br />
les limites, les questions.<br />
Dès les années 1920 apparaissent aussi<br />
les premières observations cosmologiques,<br />
en particulier le décalage spectral<br />
vers le rouge qui permettra de prouver<br />
l’expansion de l’univers. Au plan<br />
théorique, ce n’est encore qu’un sport,<br />
mais un sport de combat auquel<br />
s’adonnent de nombreux cosmologistes<br />
tels que Willem de Sitter, Alexandre<br />
Friedmann, Georges Lemaître, Howard<br />
Percy Robertson. Néanmoins, les observations<br />
s’imposent peu à peu ; la loi d’expansion<br />
de Hubble est acceptée au tournant<br />
des années 1930 et le fond diffus<br />
cosmologique, ce rayonnement qui remplit<br />
l’univers, prédit en 1948, est détecté<br />
en 1965. Grâce à de nombreuses<br />
observations, on contraindra la géométrie,<br />
la composition de l’univers, on<br />
comprendra l’origine des galaxies... Peu<br />
à peu, la cosmologie va incorporer, mais<br />
aussi permettre de tester, l’ensemble de<br />
la physique atomique, nucléaire, quantique,<br />
sans oublier la gravitation.<br />
Jean Eisenstaedt<br />
Directeur de recherche émérite au CNRS,<br />
à l’Observatoire de Paris<br />
Jean-Philippe Uzan<br />
Directeur de recherche au CNRS,<br />
à l’Institut d’astrophysique de Paris
18 AUDITORIUMS LITTÉRATURE JEUNESSE CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
Un grand rendez-vous<br />
pour l’édition jeunesse<br />
COUV 295_RLPE_COUVERTURE 07/06/17 11:10 Page1<br />
Les 1 res Assises<br />
de la littérature<br />
jeunesse<br />
Organisées par le<br />
Syndicat national de<br />
l’édition en partenariat<br />
avec la la <strong>BnF</strong> - Centre<br />
national de la littérature<br />
pour la jeunesse (CNLJ)<br />
Deuxième secteur économique<br />
de l’édition française, la<br />
littérature pour la jeunesse<br />
est un domaine clé de la vie<br />
littéraire. Ces 1 res Assises réunissent<br />
professionnels de<br />
l’édition, auteurs et bibliothécaires<br />
; l’occasion d’un temps de<br />
réflexion et d’échanges.<br />
L’édition pour la jeunesse française est<br />
l’une des plus dynamiques qui soient,<br />
ce que le monde entier s’accorde à<br />
reconnaître. Depuis quelques années<br />
pourtant, ses auteurs souffrent d’une<br />
réelle précarité, exacerbée par la « bestsellerisation<br />
» et le rythme soutenu de<br />
production. Si le développement du<br />
marché numérique semble moins<br />
menaçant que ce que l’on avait craint,<br />
la fragilité de notre exceptionnel tissu<br />
de librairies n’en est pas moins réelle.<br />
Lundi 2 octobre 2017<br />
De 9 h 30 à 18 h<br />
Afin de documenter ces Assises, le<br />
numéro de juillet de La Revue des livres<br />
pour enfants a choisi de donner la parole<br />
aux métiers de la littérature jeunesse.<br />
Treize acteurs de la chaîne du livre<br />
dressent donc un portrait de groupe de<br />
l’édition jeunesse telle qu’elle s’invente,<br />
se fabrique, se vend et se diffuse en<br />
France.<br />
La matinée de ces 1 res Assises sera<br />
consacrée aux politiques éditoriales<br />
avec plusieurs tables rondes. Les débats<br />
se poursuivront l’après-midi autour des<br />
problématiques de diffusion et de<br />
médiation. Un rendez-vous nécessaire<br />
et attendu.<br />
Marie Lallouet<br />
Département Littérature et art<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Grand auditorium<br />
Ci-contre<br />
Revue des livres pour enfants,<br />
numéro 295, juillet 2017<br />
<strong>BnF</strong>, Centre national de la littérature pour la jeunesse<br />
JUIN 2017<br />
295<br />
Made in France<br />
Centre national de la littérature<br />
pour la jeunesse<br />
Made in France<br />
LA REVUE<br />
DES LIVRES<br />
Actualités<br />
et nouveautés<br />
du livre<br />
POUR pour la jeunesse<br />
ENFANTS<br />
295<br />
avril<br />
2017<br />
12 euros<br />
Gallicadabra<br />
La première application<br />
de lecture sur tablette<br />
à destination des enfants !<br />
Ateliers enfants<br />
de 0 à 13 ans<br />
Cartes pop-up, gravure,<br />
écritures médiévales...<br />
Un univers de découvertes.<br />
bnf.fr > Visites et ateliers<br />
Fabricabrac<br />
Une nouvelle application<br />
pour jouer et créer<br />
avec les collections !<br />
Coin lecture<br />
pour les enfants<br />
Albums, contes, poésie,<br />
théâtre, romans, bandes<br />
dessinées… tout est en salle I<br />
et accessible gratuitement !<br />
cnlj.bnf.fr<br />
Éditions<br />
jeunesse<br />
Des rééditions de livres<br />
pour enfants, issus<br />
des collections de la <strong>BnF</strong>.<br />
editions.bnf.fr
AUDITORIUMS LÉON BLOY<br />
19<br />
LÉON BLOY<br />
PARIA CÉLESTE<br />
Table ronde Léon Bloy<br />
Animée par<br />
François Angelier<br />
Avec Pierre Glaudes,<br />
François L’Yvonnet,<br />
Caroline de Mulder<br />
Le centenaire de la mort de<br />
Léon Bloy (1846-1917) est<br />
l’occasion de (re)découvrir<br />
un écrivain assoiffé d’absolu,<br />
en guerre contre la médiocrité<br />
bourgeoise de son époque,<br />
porteur d’une langue puissante<br />
et novatrice. François Angelier,<br />
producteur de l’émission<br />
Mauvais Genres à France Culture,<br />
animera une table ronde qui<br />
lui est consacrée.<br />
<strong>Chroniques</strong> : Grand imprécateur,<br />
catholique halluciné, Léon Bloy<br />
est un peu un écrivain maudit ?<br />
François Angelier : Oui. Il est affublé<br />
d’une réputation totalement fausse et<br />
nocive de vitupérateur anarchisant, antisémite,<br />
ordurier, haineux… Léon Bloy<br />
est généralement associé à des écrivains<br />
dits « décadents » comme Hugues Rebell<br />
ou Georges Darien. Il est grand temps<br />
de revenir sur cette légende noire !<br />
Jeudi 30 novembre<br />
2017<br />
De 18 h 30 à 20 h<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Petit auditorium<br />
Ci-dessous<br />
Léon Bloy,<br />
1890<br />
« On ne peut pas<br />
être et avoir été.<br />
– Vous vous trompez,<br />
cher employé des Pompes<br />
funèbres, et la preuve,<br />
c’est qu’on peut<br />
avoir été un imbécile,<br />
et l’être encore. »<br />
Léon Bloy,<br />
Exégèse des lieux communs,<br />
1902, p. 182<br />
C. : Qu’est-ce qui parle à un lecteur<br />
d’aujourd’hui dans ses textes ?<br />
F. A. : D’abord sa langue ! Une langue<br />
fin de siècle, orfévrée, riche, dense et<br />
qui charrie toutes sortes de néologismes,<br />
de formules acrobatiques. C’est un des<br />
grands écrivains français, dans la lignée<br />
à la fois de Joseph de Maistre et de<br />
Rabelais. C’est surtout un des auteurs<br />
les plus drôles qui soient ! Certains passages<br />
du Désespéré ou de son Journal,<br />
dans lesquels il évoque la banlieue, les<br />
propriétaires et les curés, sont à mourir<br />
de rire. Mais c’est aussi un théologien<br />
de l’histoire, en tant que catholique<br />
formé par Barbey d’Aurevilly et<br />
le père Tardif de Moidrey à une interprétation<br />
symbolique des événements<br />
historiques. Pour lui, l’homme est dans<br />
une nuit totale, il ignore absolument ce<br />
qu’il en est de la vérité des faits, de la<br />
valeur des êtres et de la nature de ce<br />
qu’il vit. Et c’est la souffrance qui est<br />
illuminatrice et révélatrice.<br />
C. : Il y a une dimension sociale<br />
très forte dans son œuvre…<br />
F. A. : Au cœur de la méditation de Bloy,<br />
il y a la figure du pauvre, qui est le<br />
Christ, et les pauvres qui en sont les<br />
reflets diffractés dans le monde. Il a eu<br />
sous les yeux le spectacle d’une société<br />
bourgeoise opulente dont il pointe<br />
les gaspillages scandaleux : il est l’un<br />
des rares écrivains avec Charles Péguy<br />
à avoir pensé l’argent. C’est un homme<br />
qui a vécu en marge, dans un grand<br />
dénuement matériel, dans une sorte<br />
d’exil bien qu’il ait toujours vécu à Paris<br />
ou en banlieue. Il a été très tôt considéré<br />
comme un personnage douteux,<br />
marginalisé par le milieu littéraire et<br />
contraint à vivre d’expédients dans la<br />
précarité et la misère. C’était un paria,<br />
mais un paria revendiqué puisqu’il se<br />
voulait un « témoin de l’absolu », c’està-dire<br />
de la vérité chrétienne et catholique.<br />
Dans son Journal, il donne de la<br />
Troisième République une vision hallucinée<br />
de fosse aux monstres, de jungle<br />
étrange et protéiforme, entre Jérôme<br />
Bosch et Félicien Rops. Et c’est d’une<br />
drôlerie renversante.<br />
Propos recueillis par Sylvie Lisiecki<br />
Délégation à la communication<br />
À lire<br />
Sueur de sang (1893)<br />
Histoires<br />
désobligeantes (1894)<br />
Le Désespéré (1887)<br />
La Femme pauvre<br />
(1897)<br />
Journal,1892-1917<br />
(1999)<br />
Dans les ténèbres<br />
(1918) [posthume]
20 AUDITORIUMS CYCLE RELATIONS FRANCO-ITALIENNES / COLLOQUE DROIT(S) ET GASTRONOMIE<br />
CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
Droit(s) & gastronomie<br />
Colloque « Droit(s) et gastronomie »<br />
sœurs<br />
& rivales<br />
France & Italie<br />
Dans le cadre de<br />
« Tous les savoirs »<br />
L’université populaire<br />
de la <strong>BnF</strong><br />
HISTOIRE<br />
Cycle de conférences<br />
« Les relations francoitaliennes<br />
aux XIX e<br />
et XX e siècles »<br />
Un cycle de conférences sur les<br />
relations entre la France et l’Italie<br />
aux xixe et xxe siècles analyse<br />
les rapports étroits qu’entretiennent<br />
les deux pays à l’époque<br />
moderne et contemporaine.<br />
Les interactions entre ces voisines que<br />
sont la France et l’Italie sont à la fois<br />
tissées d’amitié et agitées par une forte<br />
rivalité depuis une époque lointaine.<br />
Elles ont pourtant nourri la vie artistique<br />
et culturelle aussi bien que la<br />
sphère politique et économique. Au fil<br />
des siècles, ces multiples échanges ont<br />
favorisé la constitution d’un fonds patrimonial<br />
extrêmement riche qui concerne<br />
toutes les disciplines académiques. Ce<br />
cycle de conférences est l'occasion de<br />
présenter le fonds, relativement peu<br />
connu du grand public, tout en faisant<br />
le point sur les événements clés qui se<br />
sont produits aux xix e et xx e siècles et<br />
ont façonné les relations franco-italiennes<br />
de l'époque moderne.<br />
Emanuela Prosdotti<br />
Département Histoire,<br />
philosophie, sciences de l’homme<br />
Les vendredis<br />
13 octobre,<br />
17 novembre,<br />
15 décembre 2017<br />
<strong>BnF</strong> François-Mitterrand<br />
Salle 70<br />
De 18 h 30 à 20 h<br />
Plus d’infos<br />
dans l’agenda<br />
Organisateurs<br />
<strong>BnF</strong>, Institut de recherche<br />
pour un droit attractif<br />
(IRDA - université Paris<br />
13), Centre de recherche<br />
juridique Pothier (CRFJP –<br />
université d’Orléans)<br />
Vendredi 17 novembre<br />
2017<br />
De 9 h 30 à 18 h<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Petit auditorium<br />
Après une première collaboration<br />
très réussie entre la <strong>BnF</strong> et l’IRDA,<br />
les organisateurs ont souhaité<br />
continuer à confronter l’idée du<br />
droit à celle de son environnement<br />
social. Fédérateur par excellence,<br />
le thème de la gastronomie<br />
alimente les débats de cette année<br />
en prenant appui sur les riches<br />
collections de la <strong>BnF</strong>.<br />
Comment définir la gastronomie ? Peutêtre<br />
l’art de jouir, de manière raffinée,<br />
de la fonction qui consiste à s’alimenter<br />
; l’hédonisme de la bonne chère, en<br />
quelque sorte. Confrontons-la au droit<br />
et elle se présente d’abord comme un<br />
élément du patrimoine, voire un art,<br />
avant d’être un enjeu économique et<br />
sociétal. En tant qu’art (même mineur),<br />
en tant qu’élément du patrimoine culturel,<br />
la gastronomie mérite-t-elle une<br />
protection juridique ? Partie prenante<br />
des échanges humains et des repas d’affaires,<br />
dans quelle mesure est-elle prise<br />
en compte par les droits de la distribution,<br />
de la consommation, du travail ou<br />
de la santé, et par les accords internationaux<br />
encadrant la liberté du commerce<br />
? Voici quelques-unes des interrogations<br />
auxquelles ce colloque<br />
tentera de répondre.<br />
Géraldine Goffaux-Callebaut<br />
Professeur de droit privé, université d’Orléans<br />
Ci-dessous<br />
Abraham Bosse, Les Cinq sens,<br />
recueil, collection Michel Hennin,<br />
estampes relatives à l’Histoire de France,<br />
Paris, 1635<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes et photographie<br />
Ci-contre<br />
Tract de la Ligue des droits<br />
de l’Homme et du citoyen, 1934<br />
Archives départementales de l’Isère, Grenoble
AUDITORIUMS MASTER CLASSES / SOUSCRIPTION RICHELIEU<br />
21<br />
Bibliothèque nationale de France<br />
Devenez mécène !<br />
© Jean-Christophe Ballot / <strong>BnF</strong> / Oppic<br />
+ À ÉCOUTER<br />
EN LISANT,<br />
EN ÉCRIVANT ¹<br />
Dans le cadre<br />
de « En scène »,<br />
cycle de master<br />
classes littéraires<br />
<strong>BnF</strong> I François-Mitterrand<br />
Petit auditorium<br />
Mardi 26 septembre<br />
2017<br />
Amélie Nothomb<br />
Mardi 17 octobre<br />
2017<br />
Geneviève Brisac<br />
De 18 h 30 à 20 h<br />
Lors d’une première série de master<br />
classes, huit écrivains contemporains<br />
sont venus évoquer, en 2017, leur relation<br />
intime à l’écriture. Comment naît<br />
un projet de roman ? Quel est le moteur<br />
de l’écriture ? Pour qui écrit-on ? Telles<br />
sont les questions qui ont été posées à<br />
Yasmina Reza, Jean Echenoz, Maylis de<br />
Kerangal ou Pierre Michon au cours<br />
d’un entretien à bâtons rompus avec un<br />
producteur de France Culture, différent<br />
à chaque séance. Chacun s’est ainsi<br />
confronté à la « fabrique » de son écriture.<br />
En partenariat avec<br />
France Culture et le<br />
Centre national du livre<br />
Plus de dates<br />
dans l’agenda<br />
Ci-dessus<br />
Amélie Nothomb,<br />
2016<br />
1. Recueil de fragments<br />
et de notes de Julien<br />
Gracq, publié en 19<strong>80</strong>.<br />
Editions José Corti<br />
Ces entretiens, qui tentent de mettre au<br />
jour le processus de création, sont<br />
aujourd’hui disponibles sur bnf.fr/événements<br />
et culture/conférences en ligne.<br />
À l’occasion d’une nouvelle saison de<br />
master classes, cet automne et au cours<br />
du premier trimestre 2018, on pourra<br />
découvrir les voix d’autres auteur(e)s ;<br />
les premières invitées seront Amélie<br />
Nothomb, Geneviève Brisac, Virginie<br />
Despentes, Hélène Cixous et, dans le<br />
cadre de la Foire du livre de Francfort,<br />
Marie NDiaye et Atiq Rahimi.<br />
Participez<br />
à la restauration<br />
du Cabinet du roi<br />
à Richelieu<br />
Chef - d’œuvre du XVIII e<br />
FAITES UN DON<br />
sur www.bnf.fr ou par chèque<br />
e<br />
Délégation au mécénat<br />
58 rue de Richelieu<br />
75002 Paris<br />
01 53 79 48 51<br />
richelieu@bnf.fr<br />
partenaire de la souscription
22 VIE DE LA BNF JEAN-CLAUDE MEYER<br />
CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
Ci-contre<br />
Dîner des mécènes,<br />
salle Labrouste<br />
(site Richelieu),<br />
juin 2017<br />
Dîner des mécènes<br />
Le mardi 6 juin, la <strong>BnF</strong> a tenu son<br />
traditionnel dîner des mécènes dont le<br />
bénéfice doit contribuer à financer cette<br />
année la rénovation de la salle Ovale<br />
(site Richelieu). Cette soirée, donnée en<br />
présence de Françoise Nyssen, ministre<br />
de la Culture, a rassemblé environ<br />
250 couverts.<br />
Depuis sa création, le dîner des<br />
mécènes a permis l’entrée<br />
de quelques pièces exceptionnelles<br />
dans les collections de la <strong>BnF</strong> ; parmi<br />
elles, on compte les Mémoires de<br />
Casanova ou la partition pour chant<br />
et piano des Troyens d’Hector Berlioz.<br />
JEAN-CLAUDE MEYER<br />
BIBLIOPHILE & MÉCÈNE<br />
Depuis plus de quinze ans,<br />
le Cercle de la <strong>BnF</strong> contribue<br />
à l’acquisition d’œuvres patrimoniales<br />
majeures. À l’occasion<br />
du dîner annuel des mécènes<br />
de la <strong>BnF</strong>, nous avons rencontré<br />
son président, Jean-Claude Meyer,<br />
banquier, bibliophile passionné,<br />
amoureux d’Apollinaire et<br />
des surréalistes.<br />
<strong>Chroniques</strong> : Comment est née l’idée<br />
d’un Cercle de mécènes ?<br />
Jean-Claude Meyer : C’est Jean-Pierre<br />
Angremy, alors président de la <strong>BnF</strong>, qui<br />
a décidé de créer ce Cercle en 2000 à<br />
l’occasion de l’acquisition des Mémoires<br />
d’outre-tombe. Son intention était de rassembler<br />
de grands mécènes – entreprises<br />
ou personnes privées – qui<br />
puissent contribuer aux acquisitions de<br />
la <strong>BnF</strong>, que la loi Aillagon sur les trésors<br />
nationaux a par ailleurs favorisées.<br />
Les derniers à avoir rejoint notre conseil<br />
d’administration sont Cédric de Bailliencourt,<br />
vice-président du groupe<br />
Bolloré, et Louis Gallois, aujourd’hui<br />
président du conseil de surveillance de<br />
PSA. Il est important d’avoir, dans ce<br />
Cercle, des grands patrons de l’industrie<br />
qui s’intéressent aux livres, et donc<br />
à la <strong>BnF</strong>. Le cheminement passe d’ailleurs<br />
souvent par la bibliophilie.<br />
C. : Comme cela a été le cas pour vous ?<br />
J.-C. M. : En effet, mes grands-parents<br />
étaient membres des 100 bibliophiles<br />
de la NRF et de nombreuses sociétés<br />
de bibliophiles qui fleurissaient alors ;<br />
je le suis moi-même un peu puisque j’ai<br />
créé une société d’édition à but non<br />
lucratif qui a pour vocation de marier<br />
des artistes et des auteurs contemporains<br />
de grande qualité (Lichtenstein,<br />
Baselitz, Penone, Buren). Et puis, les<br />
artistes rêvent d’argent et les banquiers<br />
rêvent d’art…<br />
C. : Quels sont vos goûts littéraires ?<br />
J.-C. M. : J’aime autant Villon, Charles<br />
d’Orléans que Barbey d’Aurevilly,<br />
Proust, Camus ou Houellebecq. J’ai<br />
aussi une prédilection pour les écrivains<br />
surréalistes, probablement pour<br />
ce qu’ils apportent de fantaisie et<br />
d’imaginaire en contraste avec les<br />
chiffres auxquels je suis confronté tous<br />
les jours.<br />
Lors du dîner des<br />
mécènes, juin 2017<br />
Laurence Engel,<br />
présidente de la <strong>BnF</strong>,<br />
Françoise Nyssen,<br />
ministre de la Culture,<br />
et Jean-Claude Meyer<br />
C. : Parmi les œuvres dont vous avez<br />
soutenu l’acquisition, en est-il une<br />
pour laquelle vous avez une tendresse<br />
particulière ?<br />
J.-C. M. : L’acquisition du manuscrit de<br />
Nadja d’André Breton, en 2016, est<br />
dans le droit fil de mon goût pour le<br />
surréalisme.<br />
C. : Pourquoi un dîner annuel des mécènes ?<br />
J.-C. M. : Nous avons eu l’idée de ce<br />
dîner pour récolter des fonds et contribuer<br />
au rayonnement de la <strong>BnF</strong>. Ensuite,<br />
j’ai créé le prix de la <strong>BnF</strong> sur le modèle<br />
des prix littéraires américains décernés<br />
à la New York Public Library. Ce prix<br />
récompense un auteur vivant de langue<br />
française pour l’ensemble de son œuvre.<br />
Le dîner des mécènes est très apprécié<br />
par de grands lecteurs, des bibliophiles,<br />
des galeristes (Thaddaeus Ropac,<br />
Sébastien Petibon, Daniel Templon,<br />
Jean-Gabriel Mitterrand…), des industriels<br />
tels que Roederer, Lagardère ou<br />
Hermès, des sociétés d’édition comme<br />
Editis ou Hachette, Albin Michel,<br />
Grasset.<br />
Propos recueillis par Corine Koch<br />
Délégation à la communication
VIE DE LA BNF PRIX DE LA BNF<br />
23<br />
« Mon seul but, c’est de mourir<br />
en sachant encore le grec » Paul Veyne<br />
Pour sa 9e édition, le prix<br />
de la <strong>BnF</strong> a été décerné à<br />
Paul Veyne, né en 1930, grand<br />
historien de l’Antiquité<br />
romaine, spécialiste des langues<br />
anciennes et auteur d’une<br />
œuvre considérable.<br />
<strong>Chroniques</strong> : Quelles lectures<br />
ont marqué votre formation<br />
intellectuelle ?<br />
P. V. : D’abord la lecture de la revue<br />
de l’école des Annales¹ et puis le milieu<br />
des historiens du Moyen Âge et des<br />
Temps Modernes, qui, lui, était entré<br />
dans la modernité. Et la lecture des<br />
ethnographes : le fameux livre de Marcel<br />
Mauss sur le don 2 a été déterminant<br />
pour moi, pour comprendre tout<br />
un pan de l’Antiquité, en particulier<br />
le rôle des dons. Je me souviens que je<br />
ne parlais que du potlach3 et mes professeurs<br />
en Sorbonne me demandaient<br />
en riant : « Mais enfin, qu’est-ce que<br />
c’est le potlach ? »<br />
C : Comment trouvez-vous vos sujets ?<br />
P. V. : Quand je tombe sur un phénomène<br />
où je me dis : « Tiens, ça ressemble…<br />
La clef de ça, c’est probablement<br />
cette chose que les sociologues<br />
appellent… » Ou bien : « C’est un trait<br />
original, il faudrait souligner que ça<br />
existe. » C’est le sentiment d’une bizarrerie.<br />
Pour reprendre le mot de Florence<br />
Dupont, latiniste et helléniste : il<br />
y a là un « écart ».<br />
C : Existe-t-il un sujet pour lequel<br />
vous avez éprouvé plus d’intérêt ?<br />
P. V. : Celui que j’ai décrit pour ma<br />
thèse sur le don dans la vie publique de<br />
l’Antiquité romaine 4 ce que j’ai appelé<br />
« le pain et le cirque » – ce sont des<br />
dons faits au peuple. C’est aussi important,<br />
et moralement plus important que<br />
l’impôt. Imaginez que la France vive<br />
plus du mécénat que de l’impôt sur le<br />
revenu ! Il y avait là une masse de faits<br />
qui étaient des exemples de dons, mais<br />
nulle part on n’avait fait la théorie de<br />
À lire<br />
Et dans l’éternité<br />
je ne m’ennuierai pas :<br />
souvenirs, Paris,<br />
Albin Michel, 2014<br />
Palmyre, l’irremplaçable<br />
trésor, Paris,<br />
Albin Michel, 2015<br />
La Villa des Mystères<br />
à Pompéi, Paris,<br />
Gallimard, 2016<br />
Ci-contre<br />
Paul Veyne, 2012<br />
1. Annales. Économies,<br />
sociétés, civilisations.<br />
Paris, École des hautes<br />
études en sciences<br />
sociales, devenue<br />
depuis Annales. Histoire,<br />
sciences sociales<br />
2. Essai sur le don.<br />
Forme et raison<br />
de l'échange dans les<br />
sociétés archaïques,<br />
paru en 1923 -1924<br />
dans L'Année<br />
sociologique, disponible<br />
sur Gallica<br />
gallica.bnf.fr/<br />
3. Comportement<br />
culturel fondé sur<br />
un système de dons /<br />
contre-dons dans<br />
le cadre de partages<br />
symboliques<br />
4. Le Pain et le cirque :<br />
sociologie historique d'un<br />
pluralisme politique,<br />
Paris, éd. du Seuil, 1976<br />
l’ensemble. J’ai pu mettre ces petits faits<br />
distincts sous un concept, celui du don<br />
chez Marcel Mauss.<br />
C. : Comment travaillez-vous<br />
en général ?<br />
P. V. : Comment je travaillais autrefois !<br />
Depuis deux, trois ans, je ne peux plus,<br />
j’ai quatre-vingt six ans. Actuellement,<br />
mon seul but, c’est de mourir en<br />
sachant encore le grec. Mais dans ma<br />
façon de travailler, il y avait trois choses :<br />
j’ai beaucoup de livres et j’ai presque<br />
tous les textes, alors c’est le point de<br />
départ. Ensuite, je possède tous les<br />
manuels de base, essentiellement allemands<br />
et anglais d’ailleurs, donc le travail<br />
peut très bien être avancé. Quand<br />
il fallait finir l’article ou le livre, je faisais<br />
un séjour de quinze jours à Rome<br />
parce qu’on y trouve la bibliothèque de<br />
l’Institut archéologique allemand qui<br />
possède, bien classés, tous les livres<br />
d’Antiquité. C’est la plus belle bibliothèque<br />
d’histoire ancienne et d’archéologie<br />
du monde 5 .<br />
C : L’Antiquité est pour vous un monde<br />
« autre » ; qu’est-ce qui vous a paru<br />
motivant au point de vouloir vous<br />
y consacrer ?<br />
P. V. : C’est ce que dit Florence Dupont,<br />
le monde des « écarts », dans les deux<br />
sens du mot. C’est un monde qui est<br />
ailleurs ; aussi bien que les cultures primitives,<br />
c’est un monde autre. Cette<br />
altérité n’est pas seulement dans l’espace,<br />
ce qui nous sépare dans l’espace<br />
d’une tribu amazonienne actuelle ; c’est<br />
cet écart total, métaphysique, angoissant<br />
: le temps. Il y a peut-être l’idée de<br />
la mort là-dedans, c’est un monde<br />
mort ; pire, un monde aboli, une espèce<br />
de sentiment métaphysique de ce qui<br />
n’est plus. Ce monde autre fait des<br />
écarts, à un autre sens du mot : il fait<br />
des écarts de conduite avec nous. Il n’a<br />
pas la même morale, pas la même religion.<br />
Le grand effort est alors de « comprendre<br />
», ce qui signifie ici non pas<br />
« admettre », mais arriver à « exprimer<br />
quelle est la différence ».<br />
5. Le Deutsches<br />
Archäologisches Institut<br />
Propos recueillis par Vanessa Desclaux<br />
Dpt. Philosophie, histoire, sciences de l’homme
24 VIE DE LA BNF BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON JEAN VILAR CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº79
COLLECTIONS ARTAUD<br />
25<br />
Quand Artaud<br />
jetait un sort à Hitler<br />
Souvent exposés, publiés,<br />
commentés, les sorts d’Antonin<br />
Artaud sont bien connus.<br />
Ils conservent toutefois une part<br />
de mystère, qui tient autant à leur<br />
nature souvent jugée délirante<br />
qu’à leur forme inouïe. Acquis<br />
lors de la vente organisée par<br />
la famille d’Artaud en janvier 2017,<br />
le plus emblématique d’entre<br />
eux, le « Sort à Hitler », a rejoint<br />
les collections du département<br />
des Manuscrits.<br />
Artaud écrit ses premiers sorts épistolaires<br />
depuis l’Irlande, en 1937. Tantôt<br />
protecteurs tantôt mortifères, ils<br />
conjuguent les effets graphiques de<br />
l’écriture (majuscules, soulignement,<br />
couleurs), le soin apporté à la mise en<br />
page, la violence imprécatoire et la perforation<br />
du papier. De cette période<br />
datent les sorts à Lise Deharme<br />
(romancière, poétesse et muse du surréalisme)<br />
et à Jacqueline Breton<br />
(peintre et plasticienne), aujourd’hui<br />
conservés à la Bibliothèque littéraire<br />
Jacques Doucet. Les sorts composés<br />
par Artaud depuis l’hôpital de Ville-<br />
Evrard se caractérisent, quant à eux,<br />
par une gradation de la violence par<br />
rapport aux précédents. Témoins de la<br />
révolte artistique, métaphysique et existentielle<br />
du poète, ils constituent une<br />
force d’agression généralisée, dont<br />
Artaud expliquera la signification en<br />
février 1947 : « Le but de toutes ces<br />
figures dessinées et coloriées était un<br />
exorcisme de malédiction, une vitupération<br />
corporelle contre l’obligation de<br />
la forme spatiale, de la perspective, de<br />
la mesure, de l’équilibre, de la dimension,<br />
et à travers cette vitupération<br />
revendicatrice, une condamnation du<br />
monde psychique incrusté comme un<br />
morpion sur le physique qu’il incube<br />
ou succube en prétendant l’avoir formé.<br />
J’en étais en 1939 à ma deuxième année<br />
d’internement, et bien que parfaitement<br />
sain d’esprit je me voyais maintenu<br />
à vie dans les asiles d’aliénés français<br />
[…] Et les figures donc que je<br />
faisais étaient des sorts – que je brûlais<br />
avec une allumette après les avoir<br />
aussi méticuleusement dessinés. »<br />
Après la série des sorts au docteur Léon<br />
Fouks, médecin à Ville-Evrard, à Sonia<br />
Mossé (<strong>BnF</strong>, Manuscrits) et à Roger<br />
Blin (<strong>BnF</strong>, Manuscrits), datés de mai<br />
1939, Artaud jette un sort à Hitler, au<br />
mois de septembre. Jamais envoyé, il<br />
se compose d’une lettre, accompagnée<br />
de son enveloppe, dans laquelle il est<br />
fait référence à une prétendue rencontre<br />
à Berlin, en 1932, au moment<br />
À gauche<br />
Antonin Artaud,<br />
« Sort à Hitler »,<br />
septembre 1939<br />
<strong>BnF</strong>, Manuscrits<br />
Ci-dessus<br />
Antonin Artaud,<br />
par Man Ray,<br />
1926<br />
où Artaud y tourne Coup de feu à l’aube<br />
de Serge de Poligny : « Cher Monsieur,<br />
Je vous avais montré en 1932 au Café<br />
de l’Ider à Berlin, l’un des soirs où nous<br />
avons fait connaissance et peu avant<br />
que vous ne preniez le pouvoir, les barrages<br />
[que j’avais] établis sur une carte<br />
qui n’était pas qu’une carte de géographie,<br />
contre une action de force dirigée<br />
dans un certain nombre de sens<br />
que vous me désigniez. Je lève<br />
aujourd’hui Hitler les barrages que<br />
j’avais mis ! Les Parisiens ont besoin<br />
de gaz. Je suis vôtre, Antonin Artaud. »<br />
Le verso porte le post-scriptum et les<br />
éléments graphiques du sort : « P.S. :<br />
Bien entendu cher Monsieur, ceci est<br />
à peine une invitation : c’est surtout un<br />
avertissement. S’il vous plaît, comme<br />
à tout Initié, de ne pas en tenir compte,<br />
à votre aise. Je me garde. Gardez-vous !<br />
La purulence des Initiés Français a<br />
atteint au paroxysme du spasme, d’ailleurs,<br />
vous le savez. »<br />
Avec les Avis aux masses et aux initiés,<br />
également acquis lors de la même vente,<br />
les trois sorts conservés au département<br />
des Manuscrits constituent le plus<br />
important ensemble d’écrits magiques<br />
d’Artaud conservés dans une collection<br />
publique.<br />
Guillaume Fau<br />
Département des Manuscrits
26 COLLECTIONS ÉCRANS À MAIN DU XVIII E SIÈCLE<br />
CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
Insolites écrans<br />
1. Des estampes non<br />
découpées des XVII e<br />
et XVIII e siècles destinées<br />
à être collées sur ces<br />
écrans sont conservées<br />
au département<br />
des Estampes et de<br />
la photographie<br />
Ni livre, ni estampe, ni médaille,<br />
cet objet tient un peu de ces<br />
trois catégories à la fois.<br />
La <strong>BnF</strong> en a acquis plusieurs<br />
récemment et en conserve<br />
une vingtaine en tout.<br />
En Europe, à partir du XVII e siècle, cet<br />
accessoire servait à protéger de la chaleur<br />
du feu le visage de celui ou celle<br />
qui était assis(e) auprès d’une cheminée.<br />
Au XVIIIe siècle, on en comptait<br />
plusieurs douzaines réparties dans les<br />
pièces à vivre des palais, des demeures<br />
aristocratiques et des appartements<br />
bourgeois. Sa feuille de carton fixée sur<br />
un bâton, que l’on tenait à hauteur des<br />
yeux, portait souvent à l’avers et au<br />
revers des textes et des images imprimés<br />
destinés à instruire ou à divertir<br />
son usager. Hier, objet utilitaire et<br />
« jetable » de la vie courante ; aujourd’hui,<br />
objet d’art de la plus grande rareté.<br />
Son nom ? « Écran à main » ou « petit<br />
écran », par opposition à l’écran sur pied<br />
qui se dresse devant la cheminée.<br />
Les écrans exceptionnels du XVIIIe siècle<br />
conservés à la <strong>BnF</strong> – aux départements<br />
des Arts du spectacle, des Cartes et<br />
plans, des Estampes et de la photographie<br />
ainsi qu’à la Bibliothèque-musée<br />
de l’Opéra –, attestent que cet objet<br />
mérite d’être appréhendé comme un<br />
document historique de premier plan¹,<br />
un médiateur original de la transmission<br />
du savoir et un accessoire primordial<br />
de la sociabilité des classes aisées.<br />
La diversité des domaines traités sur<br />
ses deux faces (souvent organisés en<br />
séries encyclopédiques de plusieurs<br />
écrans sur un même sujet) reflète la<br />
variété des centres d’intérêt de ses utilisateurs<br />
: géographie, histoire, littérature,<br />
théâtre, musique... Enfin,<br />
des artistes tels que Watteau, La Joue,<br />
Boucher, Le Prince, Peyrotte, ainsi que<br />
des ornemanistes et des illustrateurs<br />
contemporains comme Huquier, Gravelot<br />
ou Eisen ont exercé leur talent sur<br />
des estampes conçues pour ces écrans,<br />
dont la poésie demeure intacte et puissante<br />
par delà les siècles.<br />
Nathalie Rizzoni<br />
Université Paris-Sorbonne<br />
N. Rizzoni prépare une monographie sur<br />
ces écrans méconnus et projette d’organiser<br />
une exposition pour les faire découvrir<br />
Ci-dessus<br />
Écran à main, décoré<br />
d’une scène de la<br />
comédie en trois actes<br />
Les Moissonneurs<br />
de Charles-Simon<br />
Favart et C.-H. de<br />
Fusée de Voisenon<br />
(musique d’Egidio<br />
Duni), représentée<br />
pour la première fois<br />
le 27 janvier 1768 par<br />
les Comédiens Italiens<br />
ordinaires du Roi<br />
Avers : fond à décor<br />
gouaché et gravure<br />
en taille-douce<br />
rehaussée en couleurs<br />
Revers : fond à décor<br />
gouaché représentant<br />
des ornements avec<br />
un extrait du livret<br />
Paris, entre 1768<br />
et 1789<br />
<strong>BnF</strong>, Arts du spectacle
COLLECTIONS GÉRARD MACÉ<br />
27<br />
Un poète voyageur<br />
En 2016 et 2017, Gérard Macé a<br />
fait don au département des<br />
Manuscrits de la correspondance<br />
qu’il a reçue et des carnets tenus<br />
entre 1978 et 1993, seuls brouillons<br />
subsistant de son œuvre littéraire.<br />
Depuis 1974, il compose une œuvre<br />
poétique, écrit des essais et des traductions.<br />
Récemment, il a également publié<br />
trois volumes de Pensées simples chez<br />
Gallimard (2011-2016). De l’élaboration<br />
de cette œuvre ne subsistent que<br />
peu de traces, l’utilisation de l’ordinateur<br />
ayant, à partir de 1997, effacé les<br />
avant-textes et autres brouillons chers<br />
aux généticiens. Des livres des vingt premières<br />
années cependant, Gérard Macé<br />
a conservé des carnets qui mettent en<br />
évidence sa méthode de rédaction, souvent<br />
fluide, d’un seul jet, comportant<br />
malgré tout quelques repentirs ou<br />
poèmes inédits.<br />
Ses carnets témoignent de centres d’intérêt<br />
variés. Leçon de chinois (1981), Le<br />
Dernier des Égyptiens (1989), ou encore<br />
Choses rapportées du Japon (1993) disent<br />
bien sa fascination pour d’autres<br />
cultures, d’autres écritures, tandis que<br />
L’Autre Hémisphère du temps (1995)<br />
transporte le lecteur dans l’Amérique<br />
de Magellan et Vasco de Gama. Son<br />
intérêt pour les signes, notamment,<br />
transparaît dans sa façon d’aborder ces<br />
cultures à travers leurs langues – vocabulaire<br />
japonais, hiéroglyphes égyptiens<br />
accompagnés de leur signification...<br />
Ci-dessus<br />
Gérard Macé,<br />
2016<br />
Ci-contre<br />
Gérard Macé,<br />
Où grandissent<br />
les pierres,<br />
kanji, 1985<br />
<strong>BnF</strong>, Manuscrits<br />
daut), de traducteurs, d’éditeurs (Bruno<br />
Roy, Jean-Jacques Pauvert, Pierre<br />
Seghers) et de photographes (Henri<br />
Cartier-Bresson, Willy Ronis) est représenté<br />
ici, dessinant le paysage en creux<br />
des activités éclectiques de Gérard<br />
Macé ainsi que de ses amitiés. La correspondance<br />
avec Serge Boucheron, qui<br />
fut son professeur de philosophie avant<br />
de devenir un ami cher, est particulièrement<br />
abondante.<br />
Par sa diversité et son ampleur, cet<br />
ensemble offre ainsi à l’étude tout un<br />
pan de la création littéraire et artistique<br />
du XX e siècle.<br />
Anne Verdure-Mary<br />
Département des Manuscrits<br />
Depuis 1997, Gérard Macé est également<br />
photographe, même si cet aspect<br />
de son œuvre n’apparaît pas dans le<br />
fonds. En revanche, sa correspondance<br />
rend compte de l’ensemble de ses activités<br />
littéraires et artistiques : tout un<br />
réseau d’écrivains (Louis Aragon, François<br />
Cheng, Jacques Réda, Jean Rou-
28 COLLECTIONS PRIX NIÉPCE<br />
CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
OLIVIER CULMANN<br />
L’EXOTISME DU REGARD<br />
Le 18 mai dernier, Nathalie<br />
Bocher-Lenoir, présidente<br />
de l’association Gens d’images,<br />
a remis le prestigieux prix Niépce<br />
au photographe Olivier Culmann<br />
sur le site Richelieu de la <strong>BnF</strong>.<br />
Olivier Culmann, né en 1970, est<br />
membre du collectif de photographes<br />
Tendance Floue depuis 1996. En une<br />
vingtaine d’années, il a accompli une<br />
trajectoire exemplaire où se lit l’exigence<br />
à la fois éthique, esthétique et<br />
politique inhérente à tout travail documentaire<br />
au long cours. Ce parcours se<br />
caractérise également par une attention<br />
aiguë portée au pouvoir subversif de<br />
l’image.<br />
Le travail d’Olivier Culmann révèle<br />
avant tout un « exotisme du regard ». En<br />
effet, son œuvre s’articule autour d’une<br />
exploration de l’espace photographique,<br />
où les notions de champ, contre-champ<br />
et hors-champ peuvent servir de grille<br />
de lecture, et d’une recherche sur la<br />
figure de l’autre. Par sa démarche, il<br />
interroge sans cesse la liberté et le<br />
conditionnement du regard, ainsi que<br />
notre réception des images.<br />
Dans les années 1990, il renouvelle la<br />
vision documentaire avec Une vie de poulet,<br />
mise en regard de deux reportages<br />
engagés ; l’un sur une chaîne industrielle<br />
de volailles, l’autre sur les derniers<br />
appelés du contingent.<br />
Au lendemain du 11 septembre 2001,<br />
la série « Autour, New York » souligne<br />
son intérêt pour le contrepoint critique<br />
vis-à-vis d’une actualité brûlante : il<br />
délaisse en effet le spectaculaire des<br />
ruines du World Trade Center pour les<br />
expressions de sidération qu’elles provoquent<br />
sur les visages des Américains<br />
et des touristes.<br />
Ci-dessus<br />
Olivier Culmann,<br />
« The Others »,<br />
2009-2014<br />
C’est à la faveur de « Hors sol », série<br />
réalisée à l’ambassade de France de<br />
New Delhi et exposée à la <strong>BnF</strong> en 2010,<br />
qu’Olivier Culmann réfléchit à la porosité<br />
des lieux comme des identités. Ainsi,<br />
avec « The Others », c’est son corps<br />
d’Occidental grimé selon les codes vestimentaires<br />
indiens qui devient le terrain<br />
d’une réflexion plus large sur les<br />
fantasmes sociaux et l’altérité.<br />
Il y a fort à parier que le photographe<br />
saura nous surprendre encore dans le<br />
cadre de sa collaboration avec le laboratoire<br />
Picto, partenaire du Prix Niépce,<br />
qui lui propose de concevoir un objet<br />
photographique inédit, destiné entre<br />
autres à enrichir la collection de photographie<br />
contemporaine de la <strong>BnF</strong>.<br />
Héloïse Conésa<br />
Département des Estampes<br />
et de la photographie
ACTUS DU NUMÉRIQUE BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE NUMÉRIQUE 29<br />
Une bibliothèque pour<br />
274 millions de francophones ¹<br />
Au fil d’une lente expansion<br />
qui a gagné toutes les régions<br />
du monde, la langue française<br />
a rapproché les peuples, lesquels<br />
ont tissé des relations aussi riches<br />
de convergences que de tensions.<br />
Entrer dans la Bibliothèque<br />
francophone numérique, c’est<br />
tourner les pages de cette histoire<br />
et feuilleter l’album de famille<br />
de la francophonie.<br />
Grâce à cette bibliothèque numérique,<br />
que l’on pourrait qualifier de « Gallica<br />
des Francophones », l’internaute accède<br />
à des milliers de pages, de photographies,<br />
d’affiches, de cartes et de journaux<br />
physiquement dispersés dans les<br />
1 : chiffre OIF<br />
Site de la Bibliothèque<br />
numérique<br />
francophone<br />
http :// rfnumbibliotheque.org<br />
Site du Réseau<br />
francophone<br />
numérique<br />
www.rfnum.org<br />
bibliothèques de différents pays francophones.<br />
Les fonctionnalités de cette<br />
bibliothèque reposent sur le savoir-faire<br />
technologique (numérisation, indexation,<br />
mise en ligne) acquis depuis vingt<br />
ans grâce à Gallica et partagé par la<br />
<strong>BnF</strong> avec les membres du Réseau francophone<br />
numérique (RFN).<br />
Ce portail, qui a reçu le soutien de l’Organisation<br />
internationale de la Francophonie<br />
(OIF), a été dévoilé lors de son<br />
lancement officiel à Bruxelles en avril<br />
dernier. Si cet outil est encore en phase<br />
de développement, il réunit déjà un millier<br />
de documents issus de nombreuses<br />
bibliothèques nationales (Belgique,<br />
Canada, France, Luxembourg, Maroc,<br />
Québec, Suisse) mais aussi de bibliothèques<br />
patrimoniales en Haïti (Bibliothèque<br />
haïtienne du Saint-Esprit), à<br />
Madagascar (Bibliothèque et archives<br />
universitaires d’Antananarivo) et au<br />
Sénégal (Institut fondamental d’Afrique<br />
noire de l’université Cheikh Anta Diop).<br />
Une sélection de corpus géographiques<br />
et thématiques est présentée par des<br />
personnalités du monde de la recherche<br />
francophone, telles que le linguiste français<br />
Alain Rey. Cette collection a vocation<br />
à s’enrichir progressivement et à<br />
illustrer l’histoire polyphonique, souvent<br />
heurtée mais toujours féconde,<br />
d’une communauté linguistique en<br />
pleine expansion.<br />
Franck Hurinville<br />
Délégation aux relations internationales
30 INTERNATIONAL PORTAIL DES BIBLIOTHÈQUES D'ORIENT<br />
CHRONIQUES DE LA <strong>BnF</strong> Nº<strong>80</strong><br />
LE PATRIMOINE<br />
DOCUMENTAIRE<br />
UN TRAIT D’UNION<br />
ENTRE ORIENT & OCCIDENT<br />
Bibliothèques d’Orient<br />
Huit institutions partenaires<br />
à l’ouverture du site<br />
Bibliothèque nationale de France<br />
(Paris), Institut français d’archéologie<br />
orientale et Institut dominicain d’études<br />
orientales (Le Caire), Centre d’études<br />
alexandrines (Alexandrie), Institut<br />
français du Proche-Orient et<br />
Bibliothèque orientale de l’université<br />
Saint-Joseph (Beyrouth), École biblique<br />
et archéologique française (Jérusalem),<br />
Institut français d’études anatoliennes<br />
(Istanbul).<br />
Un site trilingue<br />
(français, arabe, anglais)<br />
Près de 7 000 documents exceptionnels<br />
en ligne et beaucoup d’autres à venir.<br />
Cent textes rédigés par des<br />
universitaires, scientifiques<br />
et conservateurs pour éclairer<br />
les thématiques et contextualiser<br />
les documents.<br />
Réalisé grâce au soutien de la Fondation<br />
d’entreprise Total et du groupe Plastic<br />
Omnium.<br />
Fruit d’une collaboration de<br />
la <strong>BnF</strong> avec sept bibliothèques<br />
patrimoniales et de recherche<br />
implantées au Proche-Orient,<br />
le site Bibliothèques d’Orient<br />
a pour ambition de sauvegarder,<br />
réunir et valoriser un patrimoine<br />
documentaire aussi exceptionnel<br />
et menacé que le patrimoine<br />
architectural. Il rassemble des<br />
collections uniques et encore<br />
peu connues qui témoignent<br />
de la richesse des interactions<br />
entre l’Orient et l’Occident<br />
depuis plusieurs siècles.<br />
Destiné aussi bien à la communauté<br />
scientifique qu’au grand public, le site<br />
Bibliothèques d’Orient s’intéresse principalement<br />
aux pays qui bordent la côte<br />
orientale de la mer Méditerranée, avec<br />
un corpus couvrant la période des<br />
années 1<strong>80</strong>0 à 1945. Son contenu est<br />
encadré par un conseil scientifique qui<br />
réunit, aux côtés de Laurence Engel,<br />
présidente de la <strong>BnF</strong>, des universitaires<br />
et chercheurs de renommée internationale,<br />
parmi lesquels Henry Laurens<br />
(professeur au Collège de France, titulaire<br />
de la chaire d’histoire contemporaine<br />
du monde arabe), Sophie Basch<br />
(professeur de littérature française à<br />
l’université Paris-Sorbonne), Sylvie<br />
Aubenas (directrice du département des<br />
Estampes et de la photographie, <strong>BnF</strong>)<br />
et Françoise Hours (chef du service des<br />
Littératures du monde, responsable<br />
scientifique, <strong>BnF</strong>). L’internaute découvrira<br />
ainsi, grâce à six rubriques thématiques,<br />
un vaste fonds de documents<br />
remarquables mais encore confidentiels,<br />
car dispersés dans différents pays et institutions.<br />
Parmi eux, on trouve des archives<br />
diverses : de précieux manuscrits<br />
hébreux ; deux recueils de livres liturgiques<br />
syriaques des XIe et XVIIe siècles,<br />
restaurés dans le cadre du projet ; des<br />
cartes ouvrant de nouvelles perspectives<br />
quant à l’histoire sociale et économique<br />
de la Turquie. À découvrir aussi, les<br />
ancêtres des Guides Bleus ou les dessins<br />
préparatoires de la Description de l’Égypte,<br />
un recueil dont <strong>80</strong>0 planches inédites<br />
sont conservées uniquement par la <strong>BnF</strong>,<br />
ou encore des albums photographiques<br />
originaux. Autant de documents qui<br />
invitent d’un simple clic à la connaissance<br />
et à l’imaginaire.<br />
Ci-dessus<br />
Nicolas-Jacques Conté,<br />
Le Caire, vue de la<br />
mosquée du sultan<br />
Hassan, 1798-1<strong>80</strong>9,<br />
aquarelle et crayon<br />
<strong>BnF</strong>, Estampes<br />
et photographie<br />
Site Bibliothèques<br />
d’Orient<br />
heritage.bnf.fr/<br />
bibliothequesorient/<br />
homepage<br />
Bibliothèques d’Orient est amené à<br />
s’enrichir dans les mois à venir grâce à<br />
de nouvelles contributions en France<br />
et à l’étranger. Mais la vaste collection<br />
documentaire du site offre déjà de nouvelles<br />
opportunités de recherches. En<br />
comparant quatre traductions du Coran<br />
par Albert Kazimirski, lexicographe et<br />
traducteur du XIXe siècle, on vient par<br />
exemple de découvrir que le verset 19<br />
de la sourate 87 de l’édition de 1840<br />
remplace curieusement par « Jésus »<br />
l’« Abraham » du texte arabe, ce que corrige<br />
la traduction révisée de 1841.<br />
En contribuant à préserver et valoriser<br />
ce patrimoine culturel plurimillénaire,<br />
la <strong>BnF</strong> s’inscrit pleinement dans ses<br />
missions de coopération, de conservation<br />
et de recherche, en accord avec les<br />
conclusions de la Conférence internationale<br />
sur la protection du patrimoine<br />
en péril (Abou Dhabi, 2016 ) et de sa<br />
déclaration : « Miroir de notre humanité,<br />
gardien de notre mémoire collective<br />
et témoin de l’extraordinaire esprit de<br />
création de l’humanité, le patrimoine<br />
culturel mondial porte en lui notre avenir<br />
commun. »<br />
Stéphane Chouin<br />
Délégation aux relations internationales
LIVRE <strong>BnF</strong><br />
31<br />
Une nouvelle collection<br />
« Les Orpailleurs »<br />
Les pépites littéraires<br />
de la Bibliothèque<br />
nationale de France<br />
Les éditions de la <strong>BnF</strong> lancent<br />
une collection littéraire issue<br />
des fonds de la Bibliothèque.<br />
Des textes d'anticipation<br />
visionnaires, aux confins<br />
de la littérature de genre,<br />
qui suscitent le double plaisir<br />
de la découverte et de la lecture.<br />
L’Énigme de Givreuse,<br />
suivi de La Haine surnaturelle,<br />
J.-H. Rosny aîné<br />
Présentation de Roger Musnik<br />
160 pages, 12,50<br />
Parution : 19 octobre 2017<br />
Réédition d’un roman de 1917<br />
Un chalet dans les airs,<br />
Albert Robida<br />
Présentation de Roger Musnik<br />
192 pages, 13<br />
Parution : 19 octobre 2017<br />
Réédition d’un roman de 1925<br />
La Grande Panne,<br />
Théo Varlet<br />
Présentation de Roger Musnik<br />
224 pages, 13<br />
Parution : 19 octobre 2017<br />
Réédition d’un roman de 1930<br />
Le Grand Armorial équestre<br />
de la Toison d’or,<br />
Michel Pastoureau<br />
et Jean-Charles de Castelbajac<br />
24 x 32 cm, 256 pages,<br />
1<strong>80</strong> illustrations, 49<br />
Parution : 2 novembre 2017<br />
Coédition <strong>BnF</strong> et Seuil<br />
Cet ouvrage est une réédition à l’identique<br />
d’un manuscrit médiéval peint<br />
à la gouache sur papier, au milieu du<br />
XVe siècle, représentant les membres<br />
de l’ordre de chevalerie de la Toison<br />
d’or. Il est précieusement conservé à<br />
la Bibliothèque de l’Arsenal au titre<br />
de trésor national depuis le XVIIIe siècle.<br />
L’expressivité des figures équestres, la<br />
fougue des cavaliers, l’audace des<br />
cimiers, la somptuosité des couleurs, la<br />
beauté flamboyante de l’ensemble : tout<br />
invite à ouvrir la réflexion sur un univers<br />
artistique. Ce fac-similé est enrichi<br />
du double regard que portent sur cette<br />
pièce exceptionnelle Michel Pastoureau,<br />
historien de l’art, spécialiste des<br />
emblèmes et auteur de nombreux<br />
ouvrages sur la couleur, et Jean-Charles<br />
de Castelbajac, prestigieux créateur de<br />
mode, passionné par l’art héraldique.<br />
chroniques.bnf.fr<br />
<strong>Chroniques</strong> de la Bibliothèque nationale de France<br />
est une publication trimestrielle<br />
Présidente de la Bibliothèque nationale de France<br />
Laurence Engel<br />
Directrice générale<br />
Sylviane Tarsot-Gillery<br />
Délégué à la communication<br />
Patrick Belaubre<br />
Responsable éditoriale<br />
Sylvie Lisiecki<br />
Comité éditorial<br />
Jean-Marie Compte, Joël Huthwohl, Olivier Jacquot,<br />
Anne Pasquignon, Anne Manouvrier, François Nida,<br />
Bruno Sagna<br />
Rédaction, suivi éditorial<br />
Corine Koch<br />
Rédaction, coordination agenda<br />
Sandrine Le Dallic<br />
Coordination graphique<br />
Jérôme Le Scanff<br />
Iconographie<br />
Sylvie Soulignac<br />
Réalisation Atelier Marge Design<br />
Mathieu Chévara (direction artistique),<br />
Jean-Charles Bassenne, Louise Comiran (mise en page),<br />
Juliette Paquereau (coordination éditoriale)<br />
Impression<br />
Stipa ISSN : 1283-8683<br />
Abonnez-vous !<br />
Pour recevoir gratuitement <strong>Chroniques</strong> à domicile,<br />
abonnez vous en écrivant à Marie-Pierre Besnard :<br />
marie-pierre.besnard@bnf.fr<br />
Ont collaboré à ce numéro<br />
François Angelier, Alain Carou, Héloïse Conésa,<br />
Sarah Barbedette, Raphaële Bertho, Elina Brotherus,<br />
Stéphane Chouin, Sabine Delcour, Vanessa Desclaux,<br />
Pénélope Driant, Jean Eisenstaedt, Guillaume Fau,<br />
Géraldine Goffaux-Callebaut, Franck Hurinville, Laurent<br />
Kronental, Marc Jacquin, Marie Lallouet, Michel Poivert,<br />
Emanuela Prosdotti, Nathalie Rizzoni, Jean-Philippe Uzan,<br />
Anne Verdure-Mary<br />
Votre avis nous intéresse N’hésitez pas à nous écrire<br />
pour nous faire part de vos remarques et suggestions :<br />
sylvie.lisiecki@bnf.fr<br />
Crédits iconographiques<br />
Couverture : © J. Brézillon, Paris – p. 2, 15, 22 en haut et en<br />
bas : © D. P. Carr / <strong>BnF</strong> – p.3 en haut © D.R. – p. 4 : n° 1, 2, 3<br />
et 6 : © J. Rouch, n° 4 et 5 : © CNRS/CFE/J. Rouch –<br />
p. 6 : S. Ristelhueber © ADAGP, Paris 2017 – p. 8 : © J.<br />
Nefzger, Courtesy Galerie Françoise Paviot, Paris –<br />
p. 9 : 1.© P. Tourneboeuf – 2. © M. Gambin, Courtesy Label<br />
Expositions - D. Charon, Paris – 3. © F. Delangle © ADAGP,<br />
Paris 2017, Courtesy Galerie Binôme, Paris – p.10 :<br />
1. E. Brotherus © ADAGP, Paris 2017- Galery Gb Agency,<br />
Paris 2. © S. Delcour / Cliché Mission photographique<br />
du Conservatoire du littoral, fonds géré par l’association<br />
À travers le paysage, Arles – p. 11 : © L. Kronental – p. 13<br />
en bas à gauche : © C. Jafé – À droite, en haut : ASTÉRIX® -<br />
OBÉLIX® / © 2017 Les Éditions Albert René / Goscinny –<br />
Uderzo – p. 16 : © Parisienne de Photographie / Roger-<br />
Viollet – p. 19 : © adoc-photos – p. 21 : © B. Levy /<br />
divergence-images pour Le Monde – p. 23 : © B. Charoy/<br />
Pasco – p. 24-25 : A. Artaud © ADAGP, Paris, 2017 –<br />
p. 25 : © Man Ray Trust / ADAGP / Telimage – 2017 –<br />
p. 27 : © Mantovani / Opale © Gallimard via Leemage –<br />
p. 28 : © O. Culmann / Tendance Floue