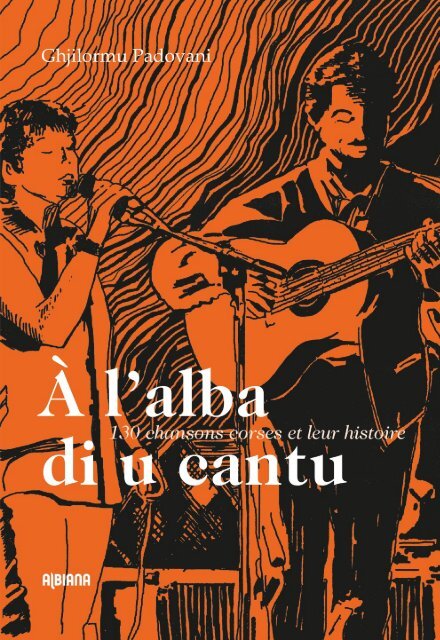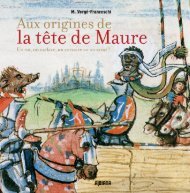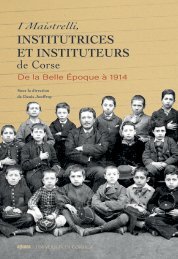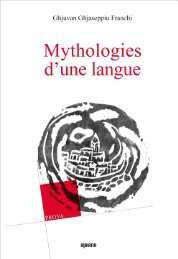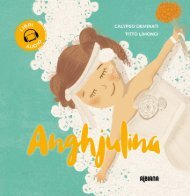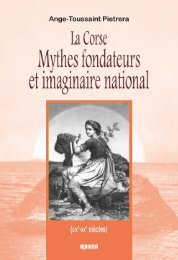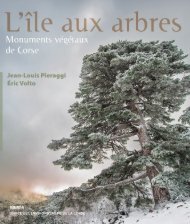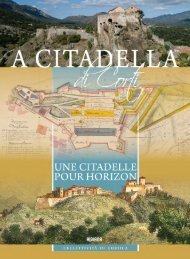AlbaDiUCantu_extrait
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
• d a n s l a c o l l e c t i o n •<br />
pueti<br />
è cantadori<br />
Cantu nustrale,<br />
Ghjermana de Zerbi, 2009<br />
Ghjuvan Andria Culioli, U Barbutu di Chera<br />
Mathée Giacomo-Marcellesi, 2012<br />
Chants populaires de Corse<br />
Jean-Baptiste Marcaggi, (1926) 2013<br />
Estru Spriritosu.<br />
Humour et satire dans la poésie corse du xviii e au xx e siècle<br />
Ghjermana de Zerbi, Èlena Bonerandi, 2014
• •<br />
i n t r o d u c t i o n<br />
Comment est née cette chanson ? Quelles sont les circonstances qui ont poussé son<br />
auteur à l’écrire ? D’où vient cette mélodie ? Quelles sont surtout son histoire intime,<br />
ses anecdotes ignorées du grand nombre, son sens caché ? Nous nous sommes tous<br />
posé ces questions en écoutant nos titres préférés. Obtenir ces réponses pour les<br />
grandes chansons françaises et internationales se trouve souvent à portée d’un clic sur<br />
Internet. Mais pas pour la chanson corse. Ainsi a débuté le chemin.<br />
Lorsqu’il s’est agi de réfléchir à une idée de rubrique autour de la musique<br />
insulaire, lors de la création de l’hebdomadaire Settimana de Corse-Matin, j’ai souhaité<br />
explorer ces histoires méconnues au rythme d’une chanson par semaine. Du 24 juillet<br />
2015 au 15 juin 2018, 130 chansons ont ainsi été dévoilées. Pour chacune d’elles,<br />
hormis les titres traditionnels, leurs auteurs m’ont confié leurs secrets. Comme toute<br />
œuvre d’art, la chanson souffre parfois d’être commentée. Elle perd de son mystère<br />
et de sa portée universelle. Il a fallu donc convaincre, expliquer la démarche exclusivement<br />
motivée par la passion de la musique et des grands textes corses qui ne<br />
m’ont jamais quitté. Bénéficier de l’oreille attentive des auteurs, de leur confiance,<br />
de leur temps aussi, a été autant de privilèges qui m’ont permis de mener à bien<br />
l’écriture de ces chroniques. Rien n’aurait été possible sans eux. Qu’ils en soient tous<br />
chaleureusement remerciés.<br />
Le répertoire insulaire est vaste, incroyablement prolifique, notamment entre les<br />
quatre décennies qui s’étendent des années soixante à quatre-vingt-dix. Il a donc fallu<br />
faire un choix extrêmement difficile. Il fut d’abord très personnel. L’ensemble des 130<br />
chansons de ce recueil de chroniques constitue, selon moi, une belle partie des textes<br />
majeurs de la chanson corse. Ils ont accompagné tant de moments, de destins, dit tant<br />
de choses des joies et des peines, de l’amour et des révoltes de ce pays. Le mystère d’une<br />
Citadella da fà, la puissance de Mal’Cunciliu, le long cours du Golu qui charrie l’histoire.<br />
L’alto stile toscan des terzetti, l’étreinte de Ti tengu cara, le cœur brisé d’un Ritrattu ou<br />
d’un Chemin des Dames. Le cri d’È puru simu quì, d’À voce rivolta ou le vrombissement de<br />
Quandi a terra move. Tous me bouleversent. Chance incroyable, chacun de ces textes a une<br />
7
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
petite histoire passionnante qui se confond souvent avec la grande. Ce furent à la fois la<br />
condition sine qua non de cette chronique et sa difficulté : ne pas raconter l’évidence mais<br />
tenter, sans prétention, d’apporter l’éclairage, le détail méconnu tout en rappelant le<br />
contexte qui influence toujours la plume. Parce que leurs auteurs ont disparu et que leur<br />
entourage n’avait pas la mémoire ou les connaissances nécessaires pour raconter, parce<br />
que le temps manque toujours, certaines chansons n’ont pu être étudiées. D’autres, plus<br />
rares, qui ne devaient pas justifier l’écriture d’une chronique, a priori, m’ont finalement<br />
été confiées, comme autant de malles à souvenirs que l’on ouvre fébrilement. D’autres,<br />
enfin, n’avaient pas d’histoire particulière à raconter, malgré leur beauté et leur importance<br />
dans le répertoire.<br />
Le choix a été fait de ne pas classer ces chroniques par date de parution dans<br />
Settimana mais de respecter leur chronologie qui dit tant de choses de l’évolution<br />
du chant corse à travers les décennies. Cette chronologie respecte les époques ou les<br />
dates précises d’écriture de ces textes, non leurs mise en musique et enregistrement<br />
qui sont intervenus parfois bien des années plus tard. Un autre classement, personnel<br />
également, propose six grands thèmes intimement liés aux œuvres : l’histoire, les<br />
hommages et portraits, la revendication, l’amour, le traditionnel et le lien à la nature.<br />
Enfin, il fallait bien trouver un titre à cette chronique hebdomadaire.<br />
Clin d’œil à ma fille, il dit humblement ce que j’ai essayé de transmettre<br />
des trésors qui m’ont été confiés : l’histoire et les secrets qui les ont fait naître, avant<br />
qu’ils ne deviennent de grands classiques. Una spassighjata à l’alba di u cantu.
• •<br />
Terzetti di u piuvanu<br />
Traditionnel – Canta u Populu corsu<br />
Carissimu cucinu fidu è amatu<br />
Questo picculu fogliu leggerai<br />
È senterai il mio miseru statu<br />
Si passa malamente la ghjurnata<br />
Moltu più quandu vene la sera<br />
Ch’è la luce del sole vene oscurata<br />
Si passa la notta oscurata è nera<br />
Senza lume perchè non hè concessu<br />
Come se fosse una selvaggia fera<br />
Sono stato ridotto in così bassa stima<br />
Ch’eo mi vergogno dei miei propri panni<br />
Come quell’animale chiamato scimia<br />
In ogni muraglia si forma una spiscina<br />
Ogni parte produce un largu fiume<br />
Per mio tormento la mio maggior ruvina.<br />
•<br />
Répression<br />
À l’image de tant de récits de guerres<br />
et de rébellions matées, l’histoire est<br />
tragique. À travers le sort réservé à<br />
Marcu Ghjuvanni Turchini, prêtre de<br />
Sermanu jeté dans les geôles de Toulon<br />
après la défaite de Ponte Novu, à travers<br />
surtout son précieux témoignage, si<br />
rare pour l’époque, c’est une lumière<br />
crue qui est braquée sur la répression<br />
militaire française pour pacifier l’île.<br />
Et sur les conditions de détention des<br />
prisonniers en cette fin de xviii e siècle<br />
où le seul droit de ces derniers était de<br />
tenter de survivre.<br />
1769. La Corse paoliste indépendante<br />
tombe à Ponte Novu. Forte d’un<br />
corps expéditionnaire de 30 000 hommes,<br />
la France a vaincu la jeune nation. Durant<br />
une petite dizaine d’années après la défaite,<br />
les foyers de rébellion demeureront<br />
vifs dans le centre de l’île. De la révolte<br />
d’A crucetta à celle, tristement célèbre, du<br />
Niolu, la résistance s’organise du Nebbiu<br />
à la Cinarca. Elle sera pourtant brisée<br />
avec méthode et détermination. Comme<br />
dans toute guerre de conquête, ceux qui<br />
parviennent à échapper aux exactions<br />
sont déportés, essentiellement dans les<br />
prisons de Toulon, réputées pour leurs<br />
conditions de vie inhumaines. En 1774,<br />
Marcu Ghjuvanni Turchini, originaire de<br />
Sermanu et prêtre du Boziu, est envoyé<br />
dans l’une d’elles avec son neveu Paulu<br />
Matteu pour rébellion et « banditisme ».<br />
Nous n’aurions jamais pu savoir dans<br />
quelles conditions étaient incarcérés les<br />
prisonniers corses s’il n’avait pu envoyer<br />
des terzetti à sa famille. Forme considérée<br />
9
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
d’altu stile, héritée des poètes italiens<br />
des xii e et xiii e siècles, les terzetti sont des<br />
strophes de trois alexandrins (tercets) et se<br />
différencient de la paghjella écrite en trois<br />
paires (paghji) d’octosyllabes. Les terzetti<br />
étaient généralement écrits en toscan,<br />
langue de la littérature, se mariant au<br />
corse au fil des ans. Raison pour laquelle,<br />
ceux du piuvanu nous sont parvenus dans<br />
cette langue mêlée, notamment lors des<br />
diverses interprétations de l’œuvre. Dans<br />
ces terzetti, bouleversants de réalisme,<br />
l’enfant de Sermanu décrit son « état de<br />
misère », privé de lumière, comparable<br />
à « cet animal que l’on appelle le singe »,<br />
dans un dénuement total. Surtout, il<br />
donne un détail terrible : sa petite cellule<br />
est inondée. Comme le précise parfaitement<br />
Ghjermana de Zerbi qui a retracé<br />
l’histoire de ce chant dans sa « bible »<br />
du genre, Cantu nustrale, parue en 1981<br />
et rééditée en 2009 chez Albiana, ces<br />
geôles remplies d’eau, dans lesquelles<br />
les corps pourrissaient, sont à l’origine<br />
du mot français « bagne 1 » que nous<br />
connaissons aujourd’hui. Nous ignorons<br />
combien de temps Marcu Ghjuvanni<br />
Turchini est demeuré prisonnier à Toulon<br />
mais, grâce à son âge avancé, il a pu<br />
retrouver les siens, à Sermanu. Son neveu,<br />
comme tant d’autres, n’a pas eu cette<br />
chance. Comme l’écrit encore Ghjermana<br />
de Zerbi, ces terzetti, qui étaient bien<br />
plus longs à l’origine, auraient pu être<br />
définitivement perdus s’ils n’avaient<br />
pas été retrouvés à l’été 1966 par Petru<br />
Guelfucci et Ghjorghju de Zerbi. Ce<br />
dernier, descendant du piuvanu par sa<br />
nièce, Divita Turchini, les a donc recueillis<br />
pour le groupe A Mannella. Douze ans<br />
plus tard, en 1978, les terzetti, baptisés<br />
« di u piuvanu », seront immortalisés sur<br />
l’album de Canta, A Strada di l’avvene, cinq<br />
ans après la création du groupe. Pour ne<br />
pas oublier Marcu Ghjuvanni Turchini<br />
qui a su, divin paradoxe, raconter en vers<br />
l’enfer des condamnés pour insurrection.<br />
1. De l’italien bagno, bain.
• •<br />
Terzetti di Filenu (Nun ti scurdà di mè)<br />
Traditionnel<br />
Leggi il foglio dulente, anima mia<br />
Scritta dal to Filenu, di propia manu<br />
Chì l’hà scritta apposta, è ti l’invia<br />
Nun ti scurdà di mè, benchè luntanu<br />
Abbie cumpassione d’un infelice<br />
Ch’eo vocu piengendu, dal collu al pianu<br />
Chì à parlà ci à bocca più nun lice<br />
Per spiecà ti tutti li mei dulori<br />
Leggi il fogliu dulente, quel’ch’è dice :<br />
Induve sì, duve stai, duve dumori ?<br />
Il dulu del mio core, nice sì bella<br />
À tante pene, perchè nun succorri<br />
Son’persuasu ch’è tù ùn serai più quella<br />
Averai forse cambiatu di novu amore<br />
À la fonte d’amore, Diana Stella<br />
Quì ripongu la penna nel calamaghju.<br />
•<br />
Amour polyphonique<br />
Il s’agit des vers les plus connus du genre.<br />
Et une commune s’en est fait la spécialité.<br />
Rusiu, petit village du Boziu, a<br />
donné à l’art polyphonique quelquesuns<br />
de ses plus beaux textes et surtout de<br />
ses plus beaux versi. Les Terzetti di Filenu<br />
en font incontestablement partie. Ils sont<br />
l’un des plus remarquables exemples<br />
de terzetti. Écrits en toscan ancien car<br />
considérés comme étant d’altu stile,<br />
comme le souligne l’ouvrage 21 pièces<br />
pour découvrir la musique corse traditionnelle<br />
édité en 2011 par l’ex-CRDP, les<br />
terzetti sont directement inspirés des<br />
formes d’écriture soutenues des auteurs<br />
florentins du xiii e siècle, dont Dante était<br />
le plus illustre représentant. Son poème,<br />
L’Enfer, n’était-il pas connu par nombre<br />
de bergers et improvisateurs comme le<br />
rapportent des voyageurs de passage<br />
dans l’île au xix e siècle ? Leur nom,<br />
terzetti, est issu de leur versification<br />
dite en « tierce rime », contrairement<br />
à la paghjella qui utilise la racine paghju<br />
(paire) pour définir un groupement de<br />
vers par deux.<br />
Appelés plus communément<br />
Terzetti di Rusiu, au risque de les confondre<br />
avec les célèbres Terzetti di u piuvanu,<br />
originaires également de ce village, les<br />
Terzetti di Filenu sont toujours l’objet d’un<br />
malentendu.<br />
La plupart des interprètes déb -<br />
utent toujours par le deuxième « couplet »,<br />
de loin le plus connu, « Nun ti scurdà di<br />
mè benche luntanu », passant de fait à la<br />
11
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
trappe le nom (ou surnom) de son auteur,<br />
un certain Filenu, cont enu dans les trois<br />
premiers vers. Un raccourci qui a relégué<br />
au second plan ce Filenu de Rusiu dont<br />
les habitants du Boziu pensent encore<br />
aujourd’hui qu’il était l’un des leurs.<br />
Une chose est certaine, la qualité du texte<br />
témoigne d’une grande culture.<br />
Les auteurs du CRDP voient<br />
même un « clin d’œil » à Dante lorsque<br />
Filenu termine son texte par le prénom<br />
de sa bien-aimée, Diana Stella.<br />
L’auteur florentin « termina<br />
les trois parties de l’œuvre La Divina<br />
Commedia (L’inferno / Il purgatorio / Il<br />
paradiso) par le mot stelle. Remarquons<br />
également que Diana Stella, en Corse,<br />
est le nom donné à l’étoile du berger<br />
[…] d’une grande importance dans les<br />
différentes mythologies […] ». Comme<br />
dans tant d’autres textes remarquables,<br />
l’amour perdu donne à la tradition orale<br />
l’un des plus beaux modèles du genre.<br />
Nun ti scurdà di mè a traversé les<br />
décennies et peut-être les siècles pour<br />
être chanté de nos jours dans une version<br />
paghjella, à trois voix. Rien ne dit qu’il<br />
en fut toujours ainsi. Régulièrement<br />
interprétés, sur un coin de comptoir ou<br />
sur scène, les Terzetti di Filenu n’ont pas<br />
eu les honneurs réservés aux Terzetti<br />
di u piuvanu, enregistrés sur A Strada<br />
di l’avvene de Canta u Populu corsu ou<br />
le premier album de Voce di Corsica.<br />
Filenu, baptisé Ùn ti scurdà di mè pour<br />
l’occasion, a cependant été immortalisé<br />
dans une version rusinca sur l’album<br />
Corse – réunissant des enregistrements<br />
réalisés entre 1916 et 2009 – de la série<br />
« France : une anthologie des musiques<br />
traditionnelles ».
• •<br />
Barbara Furtuna<br />
Traditionnel<br />
O Barbara furtuna, sorte ingrata<br />
À tutti ci ammollisce il cor’in pettu<br />
Pensendu à quella libertà passata.<br />
Hè pur ghjuntu quellu ghjornu, di funestu,<br />
D’abbandunà piacè per li turmenti,<br />
O Diu ! Chì tristu ghjornu hè per mè questu !<br />
Addiu Corsica, madre tantu amanta,<br />
Nel separar di tè senza ritornu,<br />
O chì dulor nell’anima scunsulata.<br />
•<br />
Exil, amour déçu ou hymne à Garibaldi ?<br />
Symbole de la souffrance du déraciné,<br />
Barbara Furtuna est un étendard depuis<br />
la renaissance de la revendication corse.<br />
Son sens premier, qui semble être un pur<br />
lamentu de celui qui quitte l’île contraint<br />
et forcé, ne permet pas de percer tous ses<br />
secrets. D’abord parce que son origine<br />
est très obscure. Ensuite parce que le<br />
véritable sens de ce texte n’est peut-être<br />
pas celui que l’on croit.<br />
C’est Ghjermana de Zerbi, dans<br />
sa bible Cantu nustrale, qui l’explique le<br />
mieux.<br />
Le groupe A Paghjella, dirigé<br />
par Isabelle Casanova, fut le premier à<br />
faire connaître ce chant, en 1936. L’auteur<br />
explique qu’il aurait été transmis à Natale<br />
Giacometti, de Grussetu è Prugna, par<br />
son père, au xix e siècle. Le sens d’alors est<br />
celui que nous connaissons aujourd’hui,<br />
un lamentu de ceux qui quittent l’île.<br />
C’est Matteu Ambrosi, auteur de<br />
l’ouvrage intitulé Le Chant corse, qui en<br />
donne une version tout à fait différente<br />
en 1936. Ce dernier assure que ce chant<br />
a été composé par un prêtre de la pieve de<br />
Casacconi, pour un jeune homme amoureux<br />
qui le chantait sous la fenêtre de sa<br />
bien-aimée qui l’avait trahi, le soir même<br />
de leur mariage. Matteu Ambrosi va<br />
jusqu’à affirmer que la chanson a fini de<br />
convaincre la jeune femme de retourner<br />
avec son premier amour… Ghjermana<br />
de Zerbi a retranscrit un des cinq paragraphes<br />
dévoilés par Ambrosi et qui<br />
aurait été oublié : « O Barbara in amor !<br />
Nice spietata / Perchè nun ti amollisce il cor<br />
in pettu / Pensendu à quella libertà passata ? »<br />
13
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
C’est sans doute la troisième<br />
origine supposée du texte qui est la plus<br />
surprenante. Ghjacumu Luciani, guitariste<br />
et chanteur cortenais qui a débuté<br />
dans A Mannella, a toujours entendu<br />
son père et son oncle assurer que Barbara<br />
Furtuna était un hymne à la gloire de<br />
Garibaldi, père de la patrie italienne et<br />
fer de lance de la réunification du pays !<br />
Connaissant les liens entre la Corse et<br />
le continent – entendons par là l’Italie,<br />
considérée ainsi durant des siècles<br />
par les Corses avant que la France ne<br />
la remplace –, l’hypothèse est parfaitement<br />
envisageable. Elle appuierait<br />
également la thèse d’un chant italien qui<br />
a été adapté à la situation corse (l’exil),<br />
très personnel parfois (lamentu d’amore),<br />
que la tradition locale ou ce fameux<br />
prêtre de Casacconi aurait transformé.<br />
Le chant d’exil demeurant<br />
aujour d’hui l’explication privilégiée, on<br />
ne compte plus les reprises de Barbara<br />
Furtuna par les grands groupes du<br />
Riacquistu. Jusqu’à ce que l’un d’eux<br />
l’adopte comme nom. Maxime Merlandi<br />
et ses amis de Barbara Furtuna forment<br />
aujourd’hui sans doute l’ensemble<br />
polyphonique le plus talentueux de la<br />
scène corse, avec A Filetta et le Chœur<br />
de Sartène.<br />
Pour l’explication de ce chant,<br />
c’est Ghjermana de Zerbi qui a sans doute<br />
la meilleure conclusion : « À i lettori megliu<br />
ducumentati di stabbilisce a verità ! »
• •<br />
Baddata d’una Talavesa<br />
Traditionnel – Dopu Cena<br />
Fù la piaghja la so morti<br />
Duva stani li currachji<br />
O crudelli, iniqua sorti<br />
Par Francescu di li vacchi<br />
La corcia comu faraghju<br />
À stà sola in quisti machji ?<br />
Isfurcà vogliu lu palu<br />
Quiddu di i setti furconi<br />
Ch’ùn ci s’appendi più zanu<br />
Nè cappucciu nè piloni<br />
È taglià vogliu la coda<br />
À Cimoscu ed à Falconi<br />
Quand’eddu u posini in bara<br />
U cuddoni à li Pruneddi<br />
Piensini par dolia amara<br />
Li pecuri cù l’agneddi<br />
È l’eghji di lu Sarconu<br />
Bè bè bè faciani anch’eddi<br />
La corcia da mè pinsaia<br />
Chì ni farani avà d’eddu ?<br />
Dentru l’arca a mi pinsaia<br />
Ci fussi qualchì purteddu<br />
Ma vidi ch’eddi u lamponi<br />
In un tafunacciu nieddu.<br />
•<br />
Voce di morte<br />
Derrière cette voix brisée par le chagrin<br />
se cache souvent un timbre d’exception.<br />
Tandis qu’elle chante sa douleur sur un<br />
air lancinant, la tête couverte par le voile<br />
du deuil, les pleureuses près d’elle font<br />
leur œuvre, se balancent, se griffent,<br />
tirent leurs cheveux. Prennent le relais<br />
aussi d’une interprète submergée par<br />
l’émotion, rongée par la peine. La voix<br />
chante les louanges d’une vie fauchée<br />
par le destin ou la main de l’homme. Elle<br />
pleure sur ce sort qui a frappé. Mais trouve<br />
aussi la force de réclamer vengeance,<br />
suffisamment fort pour que les hommes<br />
de la maison entendent et accomplissent<br />
leur devoir. Dans certaines régions,<br />
comme à Fozzà, la chemise ensanglantée<br />
de celui que l’on venait d’assassiner était<br />
exposée sur la cheminée de la maison afin<br />
que nul n’ignore les raisons du drame.<br />
Et que les hommes de la famille en âge<br />
de tenir les armes sachent ce qu’il leur<br />
restait à faire. Ce tableau, tristement bien<br />
connu, est celui d’un voceru ou baddata,<br />
dans le Sud. Ce chant, qui a disparu<br />
aujourd’hui des veillées funèbres, était<br />
systématiquement interprété jusque dans<br />
les années soixante. Il s’est fait beau coup<br />
plus rare ensuite, avant de s’étein dre<br />
aujourd’hui. Comme à chaque étape de<br />
15
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
la vie des Corses, ce chant disait beaucoup<br />
de leur génie dans le domaine de<br />
l’improvisation, de la poésie. Qu’elle ait<br />
été violente ou naturelle, la mort était<br />
toujours accompagnée par ces rimes et<br />
la Baddata d’una Talavesa pà a morti di u<br />
maritu, dans son titre intégral, en est un<br />
exemple bouleversant.<br />
Très peu de choses demeurent de<br />
son histoire. On sait que l’interprète est<br />
une femme de Palleca, dans le Taravu,<br />
qui vient de perdre son mari, vacher de<br />
son état. Preuve que la baddata n’était pas<br />
interprétée uniquement en cas de mort<br />
violente, aucun appel à la vengeance<br />
n’apparaît dans le texte. Dans 21 pièces<br />
pour découvrir la musique corse traditionnelle,<br />
l’auteur Jean-Michel Weber perçoit<br />
dans la fin du chant les doutes de l’improvisatrice<br />
sur l’au-delà, cette vie après la<br />
mort que les croyants évoquent. Plutôt<br />
que des ouvertures à travers lesquelles<br />
passerait la lumière, le défunt ne trouve<br />
dans la fosse commune (arca) qu’un « vulgaire<br />
trou sombre ». La traduction d’illusions<br />
perdues ? D’une foi qui ne console<br />
plus ? Ce qu’elle interprète également,<br />
c’est son angoisse face à un avenir incertain,<br />
seule désormais avec, peut-être, un<br />
foyer à tenir ou des enfants à élever. Ce<br />
chant fut publié pour la première fois<br />
en 1855 dans le livre de Salvatore Viale,<br />
Canti popolari corsi, réédité en 1984 par<br />
Arnaldo Forni Editore, en Italie. Jamais<br />
enregistré sur l’album d’un groupe insulaire,<br />
il fut pourtant immortalisé sur le<br />
CD pédagogique accompagnant le livre<br />
de Jean-Michel Weber. Même si ce chant<br />
est dépouillé de l’émotion dramatique<br />
qui naît de l’improvisation sur le lit d’un<br />
mort, son interprétation cristalline par<br />
la jeune Léa Antona, alors membre du<br />
groupe Dopu Cena et qui s’est notamment<br />
illustrée sur le dernier album de<br />
Voce Ventu, Ci serà sempre un cantu, est<br />
bouleversante.
• •<br />
Ciucciarella<br />
Traditionnel – Tino Rossi<br />
O ciucciarella<br />
Nun sai quantu t’adoru<br />
Le to bellezze<br />
Le to cullane d’oru<br />
Ciucciarella inzuccarata<br />
Quantu hè longa sta nuttata<br />
Fà la ninna fà la nanna<br />
U to babbu hè à la campagna<br />
Cullà ne vogliu<br />
Quassù per’sse cullette<br />
Ci sò le capre<br />
Le muvre è le cervette<br />
Quassù sò li trè cuniglii<br />
Corri tù, sè tù li piglii<br />
Fà la ninna fà la nanna<br />
U to babbu hè à la campagna<br />
Trovu aghju un nidu<br />
Nentru c’era duie ove<br />
Sò statu à vede<br />
L’acellu chì le cova<br />
Era un nidu di culomba<br />
È trè volte l’aghju trova<br />
O culomba cullerata<br />
Cusì longa sta nuttata<br />
Sò statu à l’ortu<br />
Stamane di bon’ora<br />
Ciucciu nun c’era<br />
Chì era andatu à la scola<br />
Tuttu era per vede à tene<br />
O mazzulu di viole<br />
Fà la ninna fà la nanna<br />
U to babbu hè à la campagna<br />
Zifulà puru<br />
È mughja o tramuntana<br />
Filgu lu linu<br />
È carmingu la lana<br />
Fattu t’aghju lu mantellu<br />
È guarnitu la suttana<br />
Lu to mantellu fatatu<br />
Tutt’intornu riccamatu<br />
•<br />
Genèse<br />
Est-elle l’œuvre d’un homme ? D’une<br />
femme ? Pour quel enfant a-t-elle été<br />
composée ? Comme pour tous les chants<br />
d’essence traditionnelle, les réponses<br />
manquent quant à ses origines et les<br />
circonstances exactes de sa naissance.<br />
La chanson corse la plus connue<br />
est une berceuse du nom de Ciucciarella,<br />
Ciucciaredda pour les sudistes. Pas un<br />
foyer avec un enfant sans qu’elle soit<br />
fredonnée, et ce depuis le xix e siècle. On<br />
retrouve le texte partout, de la Balagne<br />
où elle aurait vu le jour, sans certitude,<br />
à Porto-Vecchio en passant par le Niolu.<br />
Le livre 21 pièces pour découvrir la musique<br />
corse traditionnelle éclaire sur ses origines<br />
sans pour autant révéler les secrets que<br />
gardera sans doute à jamais le texte. Ce<br />
17
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
dernier serait fortement inspiré d’un<br />
écrit de 49 strophes de Paul-Mathieu de<br />
La Foata (1817-1899), évêque de Corse,<br />
natif d’Azilone dans l’Ornanu, intitulé<br />
A Nanna di u bambinu, publié dans<br />
Poesie giocose, dans lequel se retrouvent<br />
de nombreux <strong>extrait</strong>s et thèmes. La<br />
première version écrite de Ciucciarella<br />
est donnée par Saveriu Tomasi en 1932<br />
dans l’ouvrage Les Chansons de Cyrnos.<br />
Elle lui aurait été confiée par un certain<br />
Santini de Corte qui affirme, le premier,<br />
que le texte serait originaire de Balagne.<br />
L’auteur de la chanson connaissait-il<br />
Paul-Mathieu de La Foata ? Nous ne<br />
ferons pas l’offense de poser la question<br />
à propos de l’un des plus grands<br />
auteurs en langue corse. Des variantes<br />
de ce texte ont été retrouvées dès<br />
1924 à Calacuccia, Chiatra di Verde,<br />
Portivechju ou Zicavu, dans les parlers<br />
respectifs. Simplification populaire<br />
du texte complexe de de La Foata,<br />
Ciucciarella n’est pourtant pas basée<br />
sur un texte simpliste. Des questions<br />
demeureront sans doute sans réponse.<br />
Certains codes de lecture ne sont pas<br />
parvenus jusqu’à nous. Quelle est cette<br />
histoire des trois lapins dont parle le<br />
texte ? Si l’œuf de colombe ou le chiffre 3<br />
sont bien liés à un ancien conte, quelle<br />
en est la signification ? Pour restituer<br />
l’intimité touchante et protectrice de<br />
la berceuse, elle est exclusivement<br />
interprétée en monodie, même si, rarement,<br />
elle se révèle brillante d’harmonies<br />
sous sa forme polyphonique. C’est<br />
bien sous sa forme originale, sous son<br />
versu traditionnel débarrassé de ses<br />
fragilités, que Ciucciarella se dévoile au<br />
monde grâce à Tino Rossi, notamment<br />
dans un disque intitulé C’est Paris. Dans<br />
cet « exotisme » qui a tant servi l’Ajaccien<br />
à se faire connaître, à rendre la<br />
signature vocale de ce latin lover inoubliable,<br />
Ciucciarella a joué un rôle essentiel.<br />
Et c’est cette voix parfaite qui a fait<br />
de Ciucciarella la plus célèbre de toutes<br />
les berceuses mais aussi de toutes<br />
les chansons corses. On ne compte<br />
plus les reprises, par Maryse Nicolaï,<br />
Antoine Ciosi. Mais l’on retiendra la<br />
version cristalline de Frédéric Sini,<br />
dont la voix manque tant à la chanson<br />
corse, enregistrée avec Voce Ventu sur<br />
le deux-titres Dormi en 2007, aux côtés<br />
d’une autre berceuse, Tessi Tesi. Pour<br />
continuer bien au-delà de la nuit.
• •<br />
Lamentu di u castagnu à u corsu<br />
Traditionnel – Barbara Furtuna<br />
Or chì l’averaghju fattu<br />
À lu Corsu cusì ingratu,<br />
Chì m’hà fattu la sentenza<br />
È à morte cundannatu<br />
Senza sente testimonii<br />
Nè cunsultà lu giuratu.<br />
M’hà dichjaratu la guerra<br />
Cum’è à un veru malfattore,<br />
M’hà messu li sbirri appressu<br />
Chì m’attaccanu terrore.<br />
O Corsu, rifletti un pocu,<br />
Versu mè sì senza core<br />
Ti vindii li mio frutti<br />
È impattavi li to affari,<br />
Vistii li to figlioli,<br />
Rigulavi li scarpari,<br />
Ingrassavi lu purcellu,<br />
Tutti l’anni avii danari.<br />
Facii porte è purtelli,<br />
Sulaghji, casce è cascioni,<br />
Intempiavi la to casa<br />
Tù cù travi e cantilloni<br />
Grazia, o Corsu, eppur’la sai,<br />
À li mio gran figliuloni.<br />
Quandu la guerra hè finita<br />
Chì sarà di tè, mischinu ?<br />
Zappa puru lu to fornu<br />
È chjodi lu to mulinu.<br />
Parterai per lu mondu<br />
Errante, senza un quattrinu.<br />
•<br />
Les racines du mal<br />
Bien plus que simple chanson, certains<br />
textes portent le poids de l’histoire de<br />
ce pays. La tradition des lamenti, pilier<br />
de la culture musicale, est allée plus<br />
loin cette fois. Lorsque Anton’Battista<br />
Paoli écrit Lamentu di u castagnu à u<br />
corsu au début du xx e siècle, il témoigne<br />
de sa peine, voyant des forêts entières<br />
de châtaigniers abattues pour alimenter<br />
les usines de tanins. Il ne se doute pas<br />
que son texte sera élevé au rang de<br />
monument culturel, disant bien plus<br />
que ce qui est écrit.<br />
Anton’Battista Paoli est né<br />
à Tagliu en 1858. Témoin d’une<br />
castanéiculture florissante et vivrière,<br />
son regard n’en a que plus de prix. Sa<br />
région est recouverte de châtaigniers<br />
à perte de vue, chaque foyer subsiste<br />
grâce au fameux « arbre à pain ».<br />
Jusqu’à ce choix économique, culturellement<br />
si contestable, d’engager des<br />
armées de bûcherons italiens afin de<br />
raser les forêts. Du châtaignier broyé,<br />
on tirait le tanin indispensable pour<br />
le travail des peaux. Dernière roue<br />
19
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
du carrosse économique, la Corse<br />
n’échappait pas à une bien curieuse<br />
conception de la révolution industrielle<br />
non suivie d’effets. Les fantômes<br />
de ces usines aux grandes cheminées<br />
sont toujours visibles, notamment du<br />
côté de Barchetta. Elles ont parfois<br />
été transformées en locaux flambant<br />
neufs comme à Folelli. On ne sait pas<br />
précisément quand Anton’Battista<br />
Paoli a écrit son poème mais il a finalement<br />
été publié dans A Muvra en<br />
1926, comme d’autres textes qui ont eu<br />
l’honneur d’A Tramuntana, L’Altagna<br />
ou La Nouvelle Corse. Le texte colossal,<br />
tant par sa qualité poétique que par<br />
son volume (27 couplets), marque<br />
les esprits dans l’entre-deux-guerres,<br />
au moment où les châtaigniers sont<br />
abandonnés et livrés aux broyeuses. Le<br />
poète choisit alors la personnification,<br />
donne la parole à l’arbre autrefois nourricier<br />
pour interpeller « stu Corsu cusì<br />
ingratu », oublieux de ce que la nature<br />
lui a apporté. Cri d’alarme, plaidoyer, le<br />
lamentu secoue la conscience des Corses<br />
qui laissent détruire bien plus qu’un<br />
patrimoine, le symbole de ce qu’ils sont.<br />
On estime que les trois quarts des pieds<br />
de châtaigniers ont été détruits entre la<br />
fin du xix e et le début du xx e siècle.<br />
Le chant, traditionnellement inter -<br />
prété en monodie, comme la plupart des<br />
lamenti, devient rapidement un étendard.<br />
Hormis le contexte autour du thème<br />
abordé, la poésie aurait été écrite au<br />
cours du Riacquistu que cela n’aurait<br />
choqué personne. Elle fait partie des<br />
textes de référence du chant revendicatif,<br />
lié aux Corses par une poésie qui<br />
touche à l’intime.<br />
Le Lamentu di u castagnu, comme<br />
on le raccourcit souvent, figure sur le<br />
dernier album de Barbara Furtuna,<br />
D’Anima, qui a su si bien s’approprier le<br />
chant pour en faire une polyphonie aux<br />
arrangements pertinents.<br />
L’ouvrage 21 pièces pour découvrir<br />
la musique corse traditionnelle cite Petru<br />
Rocca, créateur d’A Muvra, qui parle<br />
si bien d’Anton’Battista Paoli et de son<br />
œuvre : « Trà i numerosi pueti di Corsica,<br />
Paoli di Tagliu hè unu di i più venerati. Da<br />
quasi un mezu seculu, a so penna d’altagna<br />
tavagninca li canta in manu cù a finezza<br />
d’un flavitu niulincu è a bundenza d’un<br />
antica carramusa. »
• •<br />
Vociaru di Ghjuvan’Cameddu<br />
Traditionnel – Canta u Populu corsu<br />
Dal mio palazzu<br />
Cupertu à verdi fronde<br />
Sù la Tasciana<br />
Niente si nasconde<br />
Vedo Carbini è Livia<br />
Vedo Portivechju è l’onde<br />
Meditandu il caso mio<br />
La memoria si cunfonde<br />
Cusì pensosu<br />
Privu d’ogni cuntentu<br />
Sfugare mi vogliu<br />
Con lacrimosu accentu<br />
Poveru Ghjuvan’Camellu<br />
Dà principiu al tuo lamentu<br />
Prego voi che m’ascoltate<br />
Compatire al mio talentu<br />
Io sò banditu<br />
Nel più bel’fior degli anni<br />
Per mio fratellu<br />
Mortu cun tanti affanni<br />
Dopu di avellu ammazzatu<br />
Fù brusgiatu in i so panni<br />
Ma speru ch’ognunu dica<br />
Ch’o sò natu cù li sanni<br />
Napoleone<br />
Fratellu svinturatu<br />
D’una donzella<br />
Si n’era innamoratu<br />
Poi partì per la Bastia<br />
Con l’oggettu tantu amatu<br />
Non hè questu un gran delittu<br />
Quandu l’omu hè seguitatu<br />
Quì cessu il moi cantu<br />
Addiu miei genitori<br />
Addiu parenti<br />
Sustegnu del mio core<br />
Nella mia trista sventura<br />
Mi ricumandu al Signore<br />
Lu vostru Ghjuvan Camellu<br />
Nùn vi farà disonore.<br />
•<br />
Onore<br />
Les bandits ne furent pas tous d’honneur,<br />
loin de là. Ceux qui pouvaient<br />
revendiquer ce prestigieux adjectif ont<br />
été contraints, par les pratiques d’une<br />
époque, à prendre les armes pour laver<br />
le sang de l’un des leurs. Et cela n’avait<br />
rien de romantique. Ghjuvan’Cameddu<br />
Nicolai n’aurait jamais dû se retrouver<br />
embarqué dans un destin tragique. Beau<br />
garçon, intelligent, issu d’une famille très<br />
modeste de l’Alta Rocca, il fut poussé au<br />
meurtre pour venger son frère dont le<br />
péché mortel fut d’avoir aimé une sgiò.<br />
L’histoire, si sombre soit-elle, n’est pas<br />
celle d’un roman. Elle s’est déroulée à la<br />
fin du xix e siècle et nous en gardons la<br />
21
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
mémoire grâce à Ghjambattista Simoni,<br />
dit Picconu, qui a écrit un lamentu pour<br />
son ami Ghjuvan’Cameddu. Voici son<br />
histoire.<br />
Nous sommes dans les années<br />
1880. Napulionu Nicolai, frère de<br />
Ghjuvan’Cameddu, tombe amoureux<br />
de Catalina Lanfranchi, issue d’une<br />
riche famille de Levie. Le père de celleci,<br />
Lisandronu, s’opposant à cette union,<br />
pousse les jeunes amoureux à fà i scappaticci,<br />
à fuir, pour imposer l’évidence.<br />
Dans la plupart des cas, le mariage était<br />
accepté à leur retour, ne serait-ce que<br />
pour laver l’affront du départ. Pour<br />
Napulionu, le scénario fut tout autre.<br />
Revenus de Bastia où ils avaient fui, les<br />
jeunes amants sont victimes de la colère<br />
de Lisandronu. Il séquestre sa fille et<br />
tue Napulionu. Comme si cela ne suffisait<br />
pas, il brûle son corps dans un bois,<br />
à l’endroit même où il l’a abattu. Il faut<br />
dire que Lisandronu est sûr de ne pas<br />
être inquiété, ses relations lui évitent<br />
d’être condamné lors d’une parodie<br />
de procès. Il est acquitté. Le jeune frère<br />
de Napulionu, Ghjuvan’Cameddu, n’a<br />
que vingt ans à l’époque. Furieux de cet<br />
épilogue judiciaire, il abat Lisandronu<br />
Lanfranchi pour venger son frère.<br />
Et scelle son destin. Devenu banditu,<br />
littéralement mis au ban d’une société<br />
qui le condamne, Ghjuvan’Cameddu<br />
n’en perd pas pour autant la sympathie<br />
des habitants de l’Alta Rocca où il<br />
conserve de nombreux soutiens. Aidé<br />
dans le maquis qui l’abrite désormais<br />
– notamment, pour la petite histoire,<br />
par une Américaine qui est tombée<br />
amoureuse du beau jeune homme –, il<br />
passe de longs mois loin des siens. C’est<br />
finalement au cours d’un mariage, où il<br />
s’était rendu déguisé en femme afin de<br />
passer inaperçu, qu’il sera trahi. Épié<br />
par des Corses achetés par la justice<br />
française, il est abattu par les voltigeurs<br />
au cours de la fête, en 1888. C’est la<br />
même année que son ami Ghjambattista<br />
Simoni de Figari écrit son lamentu où<br />
il raconte son histoire tragique. Dans<br />
un mélange de corse sudiste et de<br />
toscan, langue de l’écrit à l’époque, le<br />
texte suttanacciu est devenu un grand<br />
classique de la musique traditionnelle,<br />
repris et immortalisé par Micheli Paoli<br />
sur le premier album de Canta u Populu<br />
corsu, Eri, oghje, dumane, en 1975. Sur<br />
cet opus, il porte le nom de Vociaru di<br />
Ghjuvan’Cameddu, bien que les vociarii<br />
(ou voceri) ne soient réservés qu’au<br />
chant improvisé sur le lit de mort.<br />
L’histoire tragique, où la réalité dépasse<br />
largement la fiction, a forgé ce succès,<br />
tout comme la figure appréciée de<br />
Ghjuvan’Cameddu Nicolai, victime et<br />
assassin à son tour.
• •<br />
I Mulatteri d’Ulmetu<br />
Traditionnel<br />
Si senti chjuccà la frusta<br />
È batta li sunaglieri<br />
Rientrinu da furesta<br />
Muli rossi bianchi è neri<br />
Sò Sicondi è Ghjuvanbattista<br />
D’Ulmetu li mulatteri<br />
La prima fala Falchetta<br />
Soca la mula di guida<br />
Appressu veni Culombu<br />
Siguitatu da Pulina,<br />
Rusetta, Corsa cun Bimba,<br />
È pò Zeffiru incù Ninna<br />
Falchetta si poni in piazza<br />
Tempu arrivata in furesta<br />
Insumata à l’istanti<br />
Èppo ripidda la testa,<br />
Aspittendu li cumpagni<br />
Sì qualchid’unu s’arresta<br />
È li bravi mulatteri<br />
Ni ripartinu à l’affretta<br />
Sena mancu troppu tempu<br />
D’accenda la sigaretta<br />
Parchì ci hè lu scarrichinu<br />
In marina chì l’aspetta<br />
Ghjuvanbattista per istrada<br />
Surveglia sempri li muli<br />
Sè li so somi sò pari<br />
S’eddi sò strinti li funi<br />
Sicondi da lu so cantu<br />
Ni faci anch’eddu altru è tantu<br />
À vedaci o cari amichi<br />
Cantanu li mulatteri<br />
Chì malgratu la fatica<br />
Partimu mal vulintieri<br />
Parchì seti brava ghjenti<br />
Corsi fidi è po sinceri<br />
Passaremu par Maratu<br />
È la bocca di Cilaccia<br />
Ma rientrendu in Ulmetu<br />
Emu da fistà l’arrivata !<br />
Muli com’è mulatteri<br />
L’emu troppu disbitata !<br />
•<br />
Talavesu pà sempri<br />
Le Riacquistu a réhabilité la polyphonie,<br />
les polyphonies. La monodie pratiquée<br />
dans le Sud n’a pourtant pas été oubliée,<br />
notamment dans les premiers albums de<br />
Canta u Populu corsu. Un chant, plus que<br />
tout autre, symbolise parfaitement cet<br />
art, intimement lié à la région du Taravu :<br />
I Mulatteri d’Ulmetu. Avant qu’il ne soit<br />
brillamment inter prété par Micheli Paoli<br />
sur l’album Canti di a terra è di l’omi en<br />
1977, le texte était connu depuis la fin du<br />
xix e siècle pour raconter le quotidien des<br />
23
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
muletiers. Plus qu’un chant, une œuvre<br />
anthropologique qui dit tant de choses de<br />
la vie des anciens.<br />
Le texte est l’œuvre de Paulu<br />
Battistu Peretti, de Campu. Issu d’une<br />
famille de poètes, il est le frère de Petru<br />
Paulu, auteur de Campo, mon village et le<br />
fils de Maria Peretti Nivaggioni, originaire<br />
de Bastelica, célèbre improvisatrice.<br />
À travers des rimes simples mais<br />
dans la structure traditionnelle des<br />
sistini d’uttunarii 1 , I Mulatteri d’Ulmetu,<br />
appelé parfois I Mulatteri di l’Ulmetu,<br />
raconte les temps révolus des muletiers,<br />
d’une vie passée sur les chemins aux<br />
quatre coins de la Corse, de la Balagne à<br />
l’Orezza, de l’Alta Rocca à la Cinarca, du<br />
Boziu au Nebbiu. Un quotidien simple<br />
et dur, permettant de subsister à l’aide<br />
d’un commerce traditionnel incertain.<br />
Pour les habitants de Campu et du<br />
Taravu, ce chant est devenu le leur. Par<br />
son versu unique, proche des versi tradi-<br />
tionnels de certains sirinati et chjam’è<br />
rispondi, il est devenu très populaire et<br />
a traversé les décennies. Jusqu’à ce que<br />
Canta décide de l’enregistrer. À l’image<br />
du travail de sauvegarde et de mémoire<br />
entrepris pour le fonds Quilici, il<br />
s’agissait, par militantisme culturel, de<br />
garder une trace, la plus fidèle possible,<br />
de ce que « chantait le peuple corse »,<br />
dans toutes ses composantes.<br />
I Mulatteri d’Ulmetu se devait<br />
donc de figurer sur le troisième album<br />
de Canta. Et pour l’interpréter, il fallait<br />
la mémoire musicale vivante du Taravu,<br />
l’héritier du versu originel. Micheli Paoli,<br />
dont nous saluons l’œuvre, fut ce témoin<br />
privilégié. Sa voix si caractéristique<br />
demeurera à jamais celle d’un Taravu<br />
que nous ne connaissons plus mais dont<br />
l’empreinte subsiste encore, à travers<br />
le son des clochettes et sur les pas<br />
d’I Mulatteri d’Ulmetu.<br />
1. Sizains d’octosyllabes.
• •<br />
A Palatina<br />
Traditionnel – Canta u Populu corsu<br />
Cinta è bella la carchera<br />
I battaglioni maiori,<br />
Sò falati à corri corri,<br />
Lu cuntrastu scuppierà,<br />
Da l’imbrogliu furesteru,<br />
Oghje o mai s’escerà,<br />
Da l’imbrogliu furesteru,<br />
Oghje o mai s’escerà.<br />
Or fate sventulà sta chjoma,<br />
Chì tantu sott’à la soma,<br />
Per cent’anni ùn ci hà da stà,<br />
Da lu pughjale à la marina<br />
Cantate la palatina,<br />
È lu piombu salterà.<br />
Da li furdani in Bastia<br />
Li trema la curadella<br />
Si sò chjosi in citadella<br />
Ma l’avemu da caccià<br />
Ste vulpacce coddi mozze<br />
Ùn la si ponu francà,<br />
Ste vulpacce coddi mozze<br />
Ùn la si ponu francà.<br />
Or fate sventulà sta chjoma,<br />
Chì tantu sott’à la soma,<br />
Per cent’anni ùn ci hà da stà,<br />
Da lu pughjale à la marina<br />
Cantate la palatina,<br />
È lu piombu salterà.<br />
Per lu Capu naziunale<br />
Appruntate li truffei<br />
I furdani à sei à sei,<br />
Anderanu à tumbulà<br />
È dumane à lu cunventu<br />
U vulemu incurunà,<br />
È dumane à lu cunventu<br />
U vulemu incurunà.<br />
Or fate sventulà sta chjoma,<br />
Chì tantu sott’à la soma,<br />
Per cent’anni ùn ci hà da stà,<br />
Da lu pughjale à la marina<br />
Cantate la palatina,<br />
È lu piombu salterà.<br />
Avanti la nostra ghjente<br />
Spunta è l’alba s’avvicina,<br />
À la Corsica Regina,<br />
Gloria per l’eternità,<br />
À la Corsica Regina,<br />
Gloria per l’eternità.<br />
Or fate sventulà sta chjoma,<br />
Chì tantu sott’à la soma,<br />
Per cent’anni ùn ci hà da stà,<br />
Da lu pughjale à la marina<br />
Cantate la palatina,<br />
È lu piombu salterà.<br />
Da lu pughjale à la marina<br />
Cantate la palatina,<br />
È lu piombu salterà.<br />
25
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
•<br />
À u Babbu<br />
Son nom n’a eu de cesse de revenir dans<br />
de nombreuses chansons du Riacquistu.<br />
Comment pourrait-il en être autrement<br />
pour celui qui représente la figure<br />
tutélaire de l’île et de tout un mouvement<br />
politique et culturel, le renouveau<br />
de cette « nation conquise qui va<br />
renaître » ? Pasquale Paoli figure dans<br />
de nombreuses chansons mais très peu<br />
lui sont entièrement dédiées. L’air de la<br />
plus célèbre est repris en boucle dans<br />
tous les rassemblements nationalistes<br />
qui se respectent. A Palatina est chantée<br />
pour ce qu’elle est : un hommage au<br />
Babbu di a patria et une exhortation à<br />
la résistance. Le registre parfait pour<br />
Canta u Populu corsu qui a popularisé<br />
le titre en 1976 et dont l’origine demeure,<br />
encore aujourd’hui, inconnue.<br />
Ses accords majeurs lui donnent<br />
un air joyeux sur une rythmique<br />
martiale. Ce sont les bataillons des<br />
Naziunali de Paoli qui entonnent le<br />
chant en allant au combat pour défendre<br />
la jeune nation corse qui lutte, contre le<br />
Génois et le Français, pour subsister.<br />
C’est en tout cas le ton romantique<br />
et exalté que l’auteur anonyme d’A<br />
Palatina a souhaité donner. Une envolée<br />
patriotique que l’on retrouve dans<br />
d’autres hymnes, comme La Marseillaise,<br />
lorsqu’en 1792 l’armée du Rhin allait<br />
affronter les soldats autrichiens pour<br />
défendre l’idéal révol utionnaire français,<br />
contre les monarchies européennes.<br />
« Un imbrogliu furesteru » (menace ou<br />
intrigue étrangère) dont doit s’extirper<br />
la Corse, assure A Palatina.<br />
C’est au Capu naziunale, Pasquale<br />
Paoli, que l’on tresse des louanges et<br />
pour lui que l’on prépare les trophées<br />
de la victoire, en assurant que les<br />
ennemis seront chassés hors des terres,<br />
où qu’ils se cachent. Y compris au cœur<br />
d’une citadelle comme celle de Bastia…<br />
Ce n’est pas pour rien que le titre est<br />
également appelé A Pasqualina. On ne<br />
sait quasiment rien sur son origine.<br />
En son temps, Ghjermana de Zerbi<br />
s’était bien penchée sur la question,<br />
sans plus de succès. La célèbre musicologue<br />
pense néanmoins que, contrairement<br />
à ce que le texte pourrait laisser<br />
imaginer, il n’est pas d’époque et ne<br />
daterait donc pas de l’âge d’or paoliste.<br />
Sa véritable source remonterait au xix e<br />
ou au xx e siècle. Popularisé par Canta<br />
sur son album Libertà, en 1976, puis sur<br />
le live du Théâtre de la Ville en 1981, le<br />
titre avait pourtant été enregistré pour<br />
la première fois par les Macchjaghjoli<br />
en 1961. Immortalisant l’un des chants<br />
patriotiques les plus populaires du<br />
répertoire dont on ignore, pourtant,<br />
presque tout.
• •<br />
Lamentu di Petrucciu<br />
Petru Guelfucci<br />
Ch’ell’ùn fussi mai spuntatu<br />
L’albore d’issa matina<br />
A nutizia chì hà purtatu<br />
O la mio trista ruina<br />
U mio figliolu anu tombu<br />
À Petrucciu u mio culombu<br />
U mio Petrucciu era un fiore<br />
Prufumatu di bellezza<br />
Giuvanottu di valore<br />
Senza alcuna gattivezza<br />
U so core era un mulinu<br />
D’amore per u vicinu<br />
Quant’hè crudu lu dulore<br />
Chì m’affanna è mi stringhje lu core<br />
Quant’hè dura la mio sorte<br />
A mio pena hè troppu forte<br />
Brutta sterpa maladetta<br />
Diu ferà a to vindetta.<br />
•<br />
Déchirure<br />
La mort qui frappe au hasard est tou -<br />
jours moins bien acceptée lorsqu’il s’agit<br />
d’un jeune homme. Elle marque les<br />
générations d’une empreinte maudite.<br />
Surtout lorsque les récits de ces drames<br />
sont transmis à travers le temps. Lamenti<br />
et voceri permettent de conserver cette<br />
mémoire douloureuse et témoignent<br />
depuis toujours de ce rapport si particulier<br />
à la mort. Le Lamentu di Petrucciu<br />
en est un parfait exemple. Rendu célèbre<br />
grâce à Petru Guelfucci sur son premier<br />
album Isula, il garde malheureusement<br />
encore bon nombre de secrets sur son<br />
origine. Il est pourtant l’un des plus<br />
bouleversants.<br />
Fin des années soixante-dix.<br />
En plein Riacquistu, on continue de<br />
collecter des chants traditionnels, des<br />
versi, aux quatre coins de la Corse. Petru<br />
Guelfucci, alors pilier de Canta u Populu<br />
corsu, reçoit un texte de son ami Dumè<br />
Leschi. Ce dernier – grand interprète qui<br />
demeure l’inoubliable terza de Voce di<br />
Corsica, primé, aux côtés de Guelfucci,<br />
par une victoire de la musique en 1995 –<br />
a recueilli un lamentu dans la région de<br />
la Serra. « Ma belle-sœur, originaire de<br />
Zalana mais mariée à Moïta, le chantait<br />
souvent. Je l’ai trouvé très beau », confiet-il.<br />
Le texte, d’une charge émotionnelle<br />
très forte, est l’œuvre d’une mère qui<br />
pleure son fils assassiné.<br />
27
à l’alba di u cantu<br />
•<br />
D’où vient ce chant ? Qui ét ait<br />
ce Petrucciu ? « Impossible de le savoir,<br />
son histoire n’est pas connue », souligne<br />
Dumè Leschi. Chose rare dans un<br />
répertoire qui se distingue par une<br />
mémoire exceptionnelle.<br />
Plusieurs scenarii ont été imaginés<br />
à propos de ce lamentu. Le plus connu<br />
étant celui d’un chant issu directement de<br />
la famille Guelfucci. Il a même été raconté<br />
que le Petrucciu en question était un<br />
adolescent qui avait été accidentellement<br />
abattu par un tir de fusil lors d’une fête<br />
à Sermanu. Et que Petru Guelfucci avait<br />
ainsi souhaité chanter la mémoire d’un<br />
de ses aïeux. « C’est faux, il n’a jamais été<br />
question de quelqu’un de ma famille. Le<br />
texte m’a été amené par Dumè Leschi »,<br />
confirme le chanteur.<br />
Dans une poésie simple mais<br />
poignante, une mère chante la valeur<br />
de son garçon perdu. On apprend<br />
qu’il a été assassiné (« u mo figliolu anu<br />
tombu »), sans jamais en savoir plus<br />
sur les circonstances. On imagine qu’il<br />
n’était pas avancé dans l’âge (« ghjuvanottu<br />
di valore »). Et tout en louant<br />
les qualités d’un fils, la mère, comme<br />
bien souvent en cas de mort violente,<br />
appelle à la justice, divine en l’occurrence<br />
(« Diu ferà la to vindetta »).<br />
Il aura fallu attendre que Petru<br />
Guelfucci quitte Canta en enregistrant<br />
son premier album en 1986, Isula, pour<br />
voir le Lamentu di Petrucciu figurer sur<br />
un opus. La version enregistrée est<br />
celle que Dumè Leschi avait imaginée<br />
lorsqu’il a donné le texte à Petru : un<br />
versu « quasi identique à l’original »,<br />
précise-t-il.<br />
Si l’on ne sait toujours pas<br />
qui était ce fameux Petrucciu pleuré<br />
par sa mère et d’où vient exactement<br />
ce lamentu, l’émotion qu’il dégage<br />
demeure intacte pour celui qui l’écoute,<br />
qu’il ait vécu un drame similaire ou<br />
pas. Une référence.