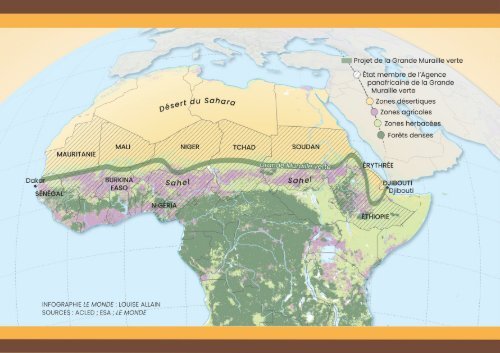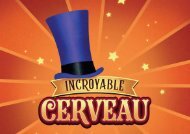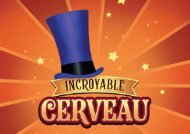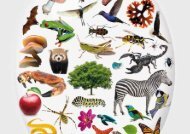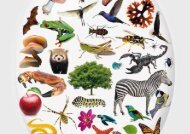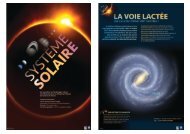GMVT-yumpu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DJIBOUTI<br />
institut<br />
Balanitès<br />
LA GRANDE MURAILLE<br />
VERTE ET LES SCIENCES<br />
Un projet de lutte contre la désertification et la pauvreté,<br />
soutenu par la communauté scientifique.<br />
Projet de la Grande Muraille verte<br />
État membre de l’Agence<br />
panafricaine de la Grande<br />
Muraille verte<br />
Désert du Sahara<br />
Zones désertiques<br />
Zones agricoles<br />
Zones herbacées<br />
Forêts denses<br />
MAURITANIE<br />
MALI<br />
NIGER<br />
TCHAD<br />
SOUDAN<br />
Grande Muraille verte<br />
ÉRYTHRÉE<br />
Dakar<br />
SÉNÉGAL<br />
BURKINA<br />
FASO<br />
S ah e l<br />
S ah e l<br />
Djibouti<br />
NIGÉRIA<br />
ÉTHIOPIE<br />
Priscilla Duboz<br />
INFOGRAPHIE LE MONDE : LOUISE ALLAIN<br />
SOURCES : ACLED ; ESA ; LE MONDE<br />
L’OHMI : UN OBSERVATOIRE<br />
SCIENTIFIQUE<br />
La Grande Muraille verte (GMV)<br />
est un projet initié en 2007 par<br />
11 pays du Sahel qui vise à créer<br />
une bande végétale de 15 km<br />
de large sur 7 600 km de long,<br />
du Sénégal à Djibouti.<br />
Pour pallier les échecs précédents<br />
concernant la lutte contre la<br />
désertification (Algérie, Égypte,<br />
Chine…), la recherche scientifique<br />
est un atout majeur, en témoigne<br />
l’expérience sénégalaise<br />
où l’observatoire Hommes-<br />
Milieux international Téssékéré<br />
pluridisciplinaire a été mis en<br />
place en 2009 par l’UCAD et<br />
le CNRS. Depuis la première<br />
parcelle en 2008, ces plantations<br />
remplissent en partie leur objectif<br />
de restauration des écosystèmes,<br />
de développement économique<br />
durable, et d’amélioration de<br />
la santé et du bien-être des<br />
populations locales, pour une<br />
superficie plantée égale à celle<br />
de la Belgique sur l’ensemble du<br />
tracé de la GMV. La contribution<br />
des scientifiques va de l’écologie<br />
végétale et animale, de l’hydrologie,<br />
des sciences de la santé aux<br />
sciences humaines et sociales<br />
(anthropologie, sociologie,<br />
économie…). La centaine de<br />
chercheurs qui accompagnent le<br />
projet au Sénégal a créé des liens<br />
de coopération scientifique avec<br />
le Burkina Faso, le Tchad, le Niger<br />
et l’Éthiopie.<br />
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE<br />
COMME MOTEUR<br />
En 2023 l’INEE (institut écologie et<br />
environnement du CNRS) crée<br />
un IRN (International Research<br />
Network) de la GMV, “Les sciences<br />
et la Grande Muraille verte”, dont le<br />
but est de fédérer les recherches<br />
menées dans les 11 pays concernés<br />
et créer une dynamique et une<br />
synergie entre tous les acteurs,<br />
afin de renforcer la GMV<br />
et pérenniser ses actions.<br />
Le CNRS et l’UCAD, grâce à l’Observatoire Hommes-Milieux<br />
International Téssékéré s’engagent avec l’Institut Balanitès<br />
afin de valoriser les savoirs scientifiques concernant<br />
la Grande Muraille verte et leur diffusion auprès de tous<br />
les publics.<br />
Conception : Institut Balanitès<br />
Rédaction : Gilles Boëtsch, Priscilla Duboz, Agathe Euzen,<br />
Aliou Guisse, Papa Ibnou Ndiaye, Roger Zerbo<br />
L’Observatoire Hommes-Milieux<br />
international Téssékéré (OHMi) a<br />
été créé en juin 2009, par le CNRS<br />
et l’Université Cheikh Anta Diop<br />
de Dakar (UCAD) qui en assurent<br />
conjointement la gestion.<br />
Selon les critères du CNRS, un<br />
observatoire hommes-milieux<br />
est défini par un cadre socioécologique<br />
(la désertification) et<br />
un événement fondateur (la mise<br />
en place de la Grande Muraille<br />
verte). Les scientifiques étudient<br />
de quelle manière cet ambitieux<br />
projet de reboisement impacte<br />
les environnements naturels et<br />
humains (le socio-écosystème).<br />
Au sein de l’OHMi, le travail<br />
interdisciplinaire est permanent,<br />
faisant dialoguer anthropologie,<br />
médecine, écologie, biologie,<br />
chimie, sociologie, économie,<br />
physiologie, parasitologie, etc.<br />
Depuis 2010, 112 projets de<br />
chercheurs ont été financés,<br />
30 thèses et 28 mémoires de<br />
masters 2, ainsi que 120 publications<br />
scientifiques et 3 ouvrages depuis<br />
2011. 80 % des scientifiques de<br />
l’observatoire sont des chercheurs<br />
africains. Afin d’étendre les travaux<br />
de l’OHMi dans les autres pays du<br />
Sahel, le CNRS a décidé de créer<br />
un IRN qui associera les chercheurs<br />
de tous les pays concernés et les<br />
agences nationales de la GMV.<br />
Des coopérations scientifiques ont<br />
été créées avec les acteurs de la<br />
Grande Muraille verte au Burkina<br />
Faso, au Tchad, en Mauritanie,<br />
au Mali, au Niger et en Éthiopie.<br />
L’IRN, International Research Network,<br />
a pour objectif la mise en place<br />
de points focaux scientifiques<br />
et techniques dans chaque<br />
pays concerné par la GMV avec<br />
l’implication des scientifiques,<br />
des agences et techniciens en<br />
charge de sa mise en place et des<br />
populations locales.<br />
L’observatoire est organisé<br />
en quatre axes de recherche :<br />
• biodiversité végétale<br />
et animale,<br />
• eau / sol / air,<br />
• santé humaine,<br />
• systèmes sociaux.<br />
NB : toutes les photos ont été prises par des chercheurs de l’OHMi Téssékéré qui travaillent sur la GMV depuis plus de 12 ans.
Anne-Gaëlle Beurier<br />
Anne-Gaëlle Beurier<br />
RENFORCER<br />
LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE<br />
SUIVRE LA BIODIVERSITÉ<br />
ANIMALE<br />
La diversité végétale se construit<br />
selon deux axes :<br />
<br />
<br />
Les scientifiques ont choisi les<br />
espèces en concertation avec<br />
les populations locales, selon<br />
leurs usages traditionnels et leurs<br />
besoins. Les espèces retenues<br />
sont adaptées aux conditions<br />
climatiques : susceptibles de<br />
survivre entre 200 et 600 mm<br />
d’eau par an et résist durant<br />
plusieurs mois au stress hydrique.<br />
Les six espèces plantées au<br />
Sénégal sont : Balanites<br />
aegyptiaca, Acacia senegalensis,<br />
Acacia raddiana, Acacia seyal,<br />
Acacia nilotica et Ziziphus<br />
mauritania. Les plantations sont<br />
plurispécifiques afin d’assurer une<br />
diversité écologique et permettre<br />
des usages variés.<br />
DES BIENFAITS EN CASCADE<br />
Une fois adultes, ces arbres vont<br />
modifier l’écosystème. Les ligneux<br />
apportent de l’ombre et de<br />
l’humidité relative, ce qui permet<br />
aux herbacées de se développer<br />
et d’augmenter dans un premier<br />
temps la diversité végétale puis<br />
dans un second temps la diversité<br />
animale, en fournissant une<br />
diversité alimentaire et un habitat<br />
plus riches. Au sein de l’OHMi<br />
Téssékéré, les recherches portent<br />
entre autres sur la séquestration<br />
du carbone, les outils de mesure<br />
de la biodiversité végétale<br />
(herbacées et ligneux), l’interface<br />
animal/végétal, par exemple<br />
le comportement des insectes<br />
pollinisateurs, le retour des oiseaux<br />
migrateurs avec transformation<br />
de l’habitat dûe à la reforestation<br />
et à la mise en défens de grandes<br />
parcelles, ou encore la présence<br />
de nouvelles espèces (insectes,<br />
rongeurs…).<br />
Le balanitès, ou dattier<br />
du désert, a été choisi avec<br />
les habitants car il est adapté<br />
aux conditions climatiques et<br />
il offre de nombreux usages :<br />
huile, infusions,<br />
bois de chauffage...<br />
Anna Niang, doctorante en<br />
“Écologie animale et gestion<br />
des écosystèmes” à l’Université<br />
Cheikh Anta Diop de Dakar<br />
(UCAD), place des pièges<br />
photographiques, afin de<br />
constituer une base de données<br />
inventoriant les espèces animales<br />
présentes sur cette parcelle<br />
de la Grande Muraille verte, en<br />
particulier les mammifères de<br />
taille moyenne (porc-épics,<br />
chats sauvages, zorilles, lièvres,<br />
mangoustes, renards, chacals,<br />
ratels…) et les grands mammifères<br />
(oryx, singes rouges). Les clichés<br />
ainsi obtenus viennent enrichir la<br />
base de données inventoriant les<br />
espèces animales.<br />
Ses études comprennent une<br />
approche qualitative (présence/<br />
absence des espèces) et une<br />
approche quantitative (nombre<br />
d’individus) permettant le calcul<br />
d’indices de biodiversité pour<br />
suivre l’évolution des espèces et<br />
leur comportement. La finalité de<br />
son travail est non seulement de<br />
mettre en exergue la biodiversité<br />
animale dans cette zone mais<br />
aussi de confirmer la potentialité<br />
de réintroduction d’espèces<br />
animales ayant disparu du Ferlo<br />
sous l’effet des aléas climatiques,<br />
comme la sécheresse des années<br />
1970 et la pression anthropique.<br />
DES RECHERCHES VARIÉES<br />
L’observatoire étudie aussi d’autres<br />
taxons zoologiques : les insectes,<br />
les reptiles, les batraciens, les<br />
oiseaux, les chiroptères et les<br />
rongeurs. L’OHMi a mis en place<br />
un cadre de collaboration entre<br />
chercheurs d’horizons divers et<br />
généré une production scientifique<br />
interdisciplinaire sur la biodiversité<br />
et les services écosystémiques.<br />
Les taxons zoologiques<br />
étudiés sont autant<br />
d’indicateurs biologiques<br />
permettant de suivre<br />
l’évolution de la biodiversité<br />
tout au long de la GMV.
USAGES<br />
DES MARIGOTS<br />
Gilles Boëtsch<br />
INDISPENSABLES<br />
FORAGES<br />
Agathe Euzen<br />
Les marigots, ou mares<br />
temporaires, se forment durant<br />
la mousson (août et septembre<br />
seulement).<br />
Ils fournissent des ressources<br />
en eau importantes, tant pour<br />
les animaux (bétail et animaux<br />
sauvages) que pour les humains.<br />
Pour ces derniers, cette eau,<br />
gratuite par rapport à celle du<br />
forage, sert à tous les usages de la<br />
vie domestique : eau de boisson,<br />
lavage des vêtements et du corps,<br />
cuisine…<br />
CES MARIGOTS SONT DE DEUX<br />
NATURES : remplissage de cuvette<br />
de manière naturelle, par les eaux<br />
de pluie, au sein d’une dépression<br />
du sol ou bien trou creusé par les<br />
hommes (quelques mètres de<br />
profondeur).<br />
L’évolution des mares temporaires,<br />
tant d’un point de vue<br />
hydrologique que des usages, vient<br />
révéler de nouvelles dynamiques<br />
hydrologiques, écologiques,<br />
sociales, sanitaires, économiques,<br />
politiques culturelles… spécifiques<br />
à chaque territoire.<br />
Les travaux de recherche de l’OHMi<br />
portent sur la question de l’accès<br />
à l’eau et des valeurs qu’elle<br />
véhicule dans ce territoire,<br />
à travers la question de sa qualité<br />
mesurée et perçue, les usages<br />
qui en sont faits et l’organisation<br />
sociale associée. L’évolution des<br />
pratiques autour de ces mares<br />
est questionnée dans un contexte<br />
nouveau où le développement<br />
de petits forages (nouveaux puits)<br />
dans la zone vient modifier<br />
le système hydrographique.<br />
Mais transforme aussi les<br />
pratiques pastorales, le rapport<br />
aux ressources (fourrages et eau<br />
pour le bétail), l’aménagement<br />
et l’occupation du territoire.<br />
L’OHMi forme de jeunes<br />
chercheurs des pays du Sahel<br />
et d’horizons divers, faisant<br />
de la GMV un véritable<br />
‘’laboratoire à ciel ouvert’’.<br />
Au Sénégal, les forages ont<br />
été construits dès 1954 par<br />
l’administration coloniale<br />
française. Dans la zone du<br />
Ferlo, 51 forages étaient en<br />
fonctionnement début 1957.<br />
Cette politique visait par le<br />
développement d’un accès continu<br />
à l’eau, à stabiliser les populations<br />
d’éleveurs nomades. Par exemple,<br />
le forage de Widou Thiengoly puise<br />
l’eau à 246 mètres pour rencontrer<br />
la nappe phréatique. Initialement,<br />
les villages se répartissaient autour<br />
des forages, distants de 30 km.<br />
Mais depuis quelques années,<br />
les forages se multiplient, et les<br />
réseaux d’adduction permettant<br />
de réduire la distance aux points<br />
d’eau sont mis en œuvre. Il y a<br />
une première zone de campement<br />
située à 8 kilomètres du forage et<br />
une seconde zone à 16 kilomètres,<br />
c’est-à-dire à mi-chemin entre<br />
deux forages.<br />
DÉCRIRE LES USAGES<br />
Aujourd’hui l’accès à l’eau du<br />
forage est payant, par le comité<br />
de gestion Asufor (association<br />
des usagers des forages ruraux).<br />
Lorsque la motopompe du forage<br />
est en panne, les troupeaux et<br />
les gens doivent se déplacer sur<br />
un autre forage. Les travaux des<br />
anthropologues et des sociologues<br />
ont montré que le plus souvent la<br />
recherche de l’eau se fait par les<br />
femmes qui viennent en charrettes<br />
tirées par des ânes et qui stockent<br />
l’eau dans des chambres à air de<br />
200 litres ou dans des cubes en<br />
plastique grillagés de 1 000 litres.<br />
Ce sont ces femmes qui<br />
répartissent l’eau en fonction<br />
des différents usages, incluant<br />
l’alimentation des petits ruminants<br />
(chèvres et moutons). Les bovins<br />
sont gérés par les pasteurs qui<br />
les emmènent boire dans les<br />
abreuvoirs associés aux forages.<br />
Venir chercher l’eau<br />
est une activité le plus souvent<br />
réalisée par les femmes<br />
qui parcourent plusieurs<br />
dizaines de kilomètres chaque<br />
jour afin d’y parvenir.
LA SANTÉ<br />
DANS LA GRANDE<br />
MURAILLE VERTE<br />
Les maladies transmissibles et<br />
les maladies chroniques non<br />
transmissibles, la santé buccodentaire,<br />
l’ethnopharmacologie<br />
sont des thèmes d’étude majeurs<br />
de l’OHMi Téssékéré : depuis 2009,<br />
de nombreuses recherches se<br />
sont intéressées à la santé des<br />
populations de la Grande Muraille<br />
verte au Sénégal et au Burkina<br />
Faso. Les projets scientifiques<br />
menés sur ces thématiques<br />
ont par exemple permis de<br />
démontrer que la prévalence de<br />
l’hypertension artérielle est très<br />
élevée dans la population peule,<br />
et même comparable à celle du<br />
milieu urbain sénégalais. Cette<br />
hypertension élevée est associée<br />
à une teneur élevée en sel de l’eau<br />
de boisson (issue du forage) et à<br />
une consommation importante<br />
de sodium dans l’alimentation<br />
(bouillons cube par exemple).<br />
COMPRENDRE LES MALADIES<br />
Actuellement les projets de<br />
recherche adoptent l’approche<br />
One Health, pour traiter notamment<br />
des causes et conséquences des<br />
maladies chroniques (hypertension<br />
artérielle, diabète…) : ainsi, l’influence<br />
de l’ouverture géographique de la<br />
zone sur les systèmes alimentaires<br />
(apports plus importants en sel, en<br />
sucre, en gras), les transformations<br />
de l’activité physique (qui était<br />
importante dans les populations<br />
peules transhumantes), les<br />
dynamiques sociales et culturelles<br />
et les caractéristiques de<br />
l’environnement sont convoquées<br />
pour comprendre quels sont les<br />
changements de comportements<br />
qui régissent la santé des<br />
populations de la Grande Muraille<br />
verte actuellement.<br />
La présence des spécialistes<br />
de chaque discipline sur un<br />
seul et même lieu fait de<br />
l’observation de la Grande<br />
Muraille verte un terrain fertile<br />
de l’écologie de la santé.<br />
Priscilla Duboz<br />
AU CŒUR<br />
DES PÉPINIÈRES<br />
On nomme pépinière l’espace<br />
réservé aux semis et aux jeunes<br />
pousses qui, une fois devenus<br />
plants, prendront leur place<br />
définitive dans les parcelles de<br />
reboisement de la GMV.<br />
Les graines sont récoltées dans<br />
toutes les régions du Sénégal par<br />
des services des eaux et forêts. Ces<br />
graines sont ensuite acheminées<br />
au PRONASEF (Programme National<br />
des Semences Forestières) qui se<br />
charge de faire le tri et les tests<br />
de germination. Dans les pots, le<br />
substrat est un mélange de terreau<br />
et terre végétale (2/3) et de sable<br />
(1/3). Selon les espèces, environ 4 à<br />
5 mois d’arrosages réguliers sont<br />
nécessaires afin que les plants<br />
atteignent 40 à 50 cm de hauteur.<br />
Ils sont ensuite mis en pleine terre.<br />
Cette phase de plantation débute<br />
généralement à l’apparition des<br />
premières pluies saisonnières.<br />
Pour optimiser la réussite des<br />
plantations, le sol est préparé,<br />
afin de canaliser et économiser<br />
l’eau qui constitue la ressource la<br />
plus importante dans le plan de<br />
reboisement.<br />
On creuse alors des sillons simples<br />
ou en demi-lune, capables<br />
d’emmagasiner temporairement<br />
l’eau dans le sol. Une fois les plants<br />
mis en terre, un suivi régulier doit<br />
être réalisé pour évaluer les taux<br />
de survie, de reprise et de réussite.<br />
Parmi les facteurs qui influent sur<br />
la survie, on relève l’espèce, le site,<br />
la configuration, l’espacement, les<br />
conditions atmosphériques, les<br />
techniques de plantation… Ce taux<br />
est calculé au bout de quelques<br />
années d’existence des parcelles,<br />
et il donne le pourcentage<br />
définitif de la réussite du projet de<br />
reboisement (en moyenne un plant<br />
sur deux sera pérenne).<br />
L’emplacement idéal pour<br />
une pépinière de plantes<br />
est orienté au sud :<br />
la chaleur y est emmagasinée,<br />
l’ensoleillement y est<br />
maximal.<br />
Audrey Bergouignan
Priscilla Duboz<br />
Roger Zerbo<br />
LE RÔLE<br />
DES LOUMA<br />
LES RISQUES : EXEMPLE<br />
DU BURKINA FASO<br />
Au Ferlo sénégalais, rares sont les<br />
villages qui disposent de marchés<br />
quotidiens. Les transactions<br />
marchandes se font dans les<br />
marchés hebdomadaires (louma)<br />
qui se tiennent presque dans tous<br />
les bourgs de la zone.<br />
À travers ces marchés, se crée<br />
une économie de district avec<br />
des circuits horizontaux entre les<br />
villages relativement enclavés.<br />
Les commerçants “professionnels”<br />
du marché hebdomadaire sont<br />
généralement des hommes. Ils se<br />
déplacent de marché en marché<br />
(distants d’environ 30 kilomètres)<br />
avec un système de transport<br />
collectif par les Wopuyah, sorte de<br />
4x4 permettant l’acheminement<br />
des hommes, des marchandises et<br />
du petit bétail.<br />
DES PRATIQUES REMARQUÉES<br />
Des études menées par les socioanthropologues<br />
ont montré que<br />
les femmes étaient de plus en plus<br />
impliquées voire même proactives<br />
dans les marchés pour y exercer<br />
des activités génératrices de<br />
revenus.<br />
Elles s’impliquent dans la<br />
vente en prenant à crédit la<br />
marchandise auprès de grossistes,<br />
eux-mêmes vendeurs. Elles<br />
vendent essentiellement à leurs<br />
connaissances (famille, amis)<br />
puis paient en fin de journée<br />
le grossiste et lui restituent les<br />
produits invendus.<br />
Ces revenus permettent aux<br />
femmes de participer aux besoins<br />
de consommation de leurs<br />
familles ; ils viennent souvent en<br />
renforcement des revenus générés<br />
par la Grande Muraille verte lors<br />
des campagnes de reboisement<br />
et à travers leur activité au sein<br />
des pépinières ou des jardins<br />
maraîchers.<br />
Les pratiques sont<br />
susceptibles de modifier<br />
la place des femmes au sein<br />
de la famille et de la société.<br />
Plusieurs risques peuvent<br />
constituer un frein à la mise en<br />
œuvre de la Grande Muraille<br />
verte :<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
(inondations, sécheresses,<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ressources financières.<br />
Développer les stratégies<br />
de maîtrise de l’eau et la<br />
diversification des productions<br />
à travers la recherche-innovation<br />
adaptative permettrait de faire<br />
face aux aléas climatiques et<br />
assurer la sécurité alimentaire<br />
des populations locales.<br />
DES RÉACTIONS EN CHAINE<br />
À l’instar des autres pays du<br />
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,<br />
le Burkina Faso est actuellement<br />
sous la menace permanente<br />
de mouvements terroristes dont<br />
les activités peuvent fragiliser la<br />
confiance des investisseurs,<br />
le moral des populations,<br />
la motivation des travailleurs<br />
et porter atteinte à la mise en<br />
œuvre des programmes et actions<br />
de développement durable<br />
des agences nationales de la<br />
Grande Muraille verte.<br />
Pour faire face à ce risque<br />
de dégradation de la sécurité<br />
et de migration de populations<br />
(ici, un groupe de personnes<br />
déplacées), il importe de lutter<br />
contre les causes profondes de<br />
l’insécurité parmi lesquelles la<br />
dégradation des sols, la précarité,<br />
le manque d’emplois et la<br />
pauvreté.<br />
Davantage<br />
de communication et de<br />
transparence pourraient<br />
contribuer à améliorer la<br />
gouvernance et la gestion<br />
financière de la Grande<br />
Muraille verte.