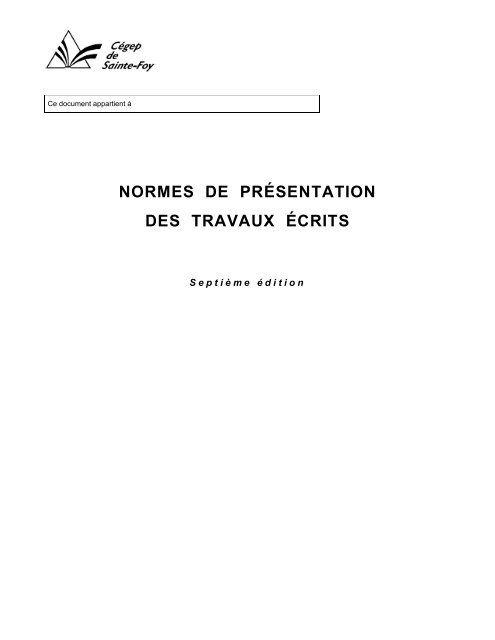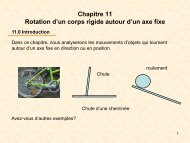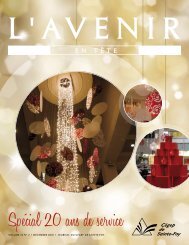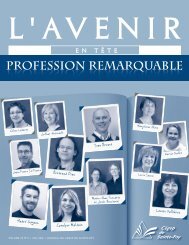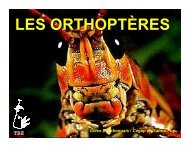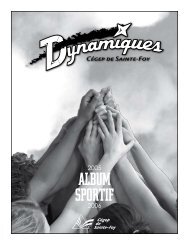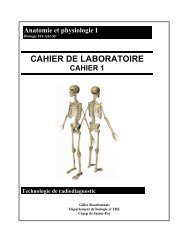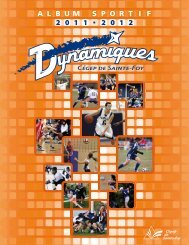Normes de présentation des travaux écrits - Cégep de Sainte-Foy
Normes de présentation des travaux écrits - Cégep de Sainte-Foy
Normes de présentation des travaux écrits - Cégep de Sainte-Foy
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ce document appartient à<br />
NORMES DE PRÉSENTATION<br />
DES TRAVAUX ÉCRITS<br />
S e p t i è m e é d i t i o n
© 2008 <strong>Cégep</strong> <strong>de</strong> <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong><br />
2410, chemin <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong><br />
Québec Qc G1V 1T3 Canada<br />
Dépôt légal, 3 e<br />
trimestre 2008<br />
Bibliothèque nationale du Québec<br />
Bibliothèque nationale du Canada<br />
Septième édition<br />
ISBN 978–2–921299–61–9
Remerciements<br />
Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leurs commentaires et suggestions, ont contribué<br />
à la réalisation <strong>de</strong> la première édition (1995) <strong>de</strong>s <strong>Normes</strong> <strong>de</strong> <strong>présentation</strong>. Merci à Gérald ALLARD,<br />
Clau<strong>de</strong> BÉLANGER, Pierre BÉRUBÉ, Louis DESCHAMBAULT, Gaétan DIONNE, Hélène DUGUAY,<br />
Paule HÉBERT, Jean-Marie LANDRY, Marc LEBEL, Christian MORIN, Jocelyne PETIT et Gabriel RIOUX.<br />
Pour leurs commentaires appréciés sur les <strong>de</strong>uxième (1996) et troisième (1997) éditions, je remercie<br />
également Charles-Henri AUDET, Jean BEAUDOIN, Doris BERTRAND, Denis CROTEAU, Alain GAGNON,<br />
Richard HAINCE, Dany HUDON, François LAFRENIÈRE, Josée MARCHAND, Louis PAINCHAUD,<br />
Louis PILOTE, Pierre RENAUD, Ron STANKO et Jean-François VALLÉE.<br />
Jean BEAUDOIN, Denis CROTEAU, Sylvie DROUIN, Dany HUDON et Danielle JOBIN m’ont apporté une<br />
ai<strong>de</strong> précieuse pour la préparation <strong>de</strong> la quatrième (1999) et <strong>de</strong> la cinquième édition (2003). Je leur en suis<br />
très reconnaissant.<br />
Pour la sixième édition (2007), j’ai pu compter sur les très utiles commentaires et suggestions <strong>de</strong><br />
Steeve BAKER, Emmanuel BOUCHARD, Frédéric BOURGAULT, Denis CROTEAU, Richard HAINCE, Paule<br />
HÉBERT, Philippe HOULE-LEROY, Dany HUDON, Lucie MORIN, Katia PERRON et Viviane SAINT-YVES.<br />
Grand merci à Denis CROTEAU, Richard HAINCE, Julie MORRISSETTE, Serge PERRON, Sylvie SAVARD<br />
et Yolaine TREMBLAY pour leur collaboration très appréciée à cette septième édition.<br />
Jules Fontaine<br />
jfontaine@cegep-ste-foy.qc.ca<br />
NOTE<br />
Ce gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>présentation</strong> <strong>de</strong>s <strong>travaux</strong> <strong>écrits</strong> a été réalisé pour répondre à l’une <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong> la Politique<br />
d’évaluation <strong>de</strong>s apprentissages du <strong>Cégep</strong> <strong>de</strong> <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong>, soit l’article 6.1.10 intitulé Évaluation <strong>de</strong> la<br />
<strong>présentation</strong> et <strong>de</strong> la composition <strong>de</strong>s <strong>travaux</strong>. Cet article se lit ainsi : « Les étudiants doivent présenter leurs<br />
<strong>travaux</strong> <strong>écrits</strong> en conformité avec les normes <strong>de</strong> <strong>présentation</strong> adoptées par le <strong>Cégep</strong> et les règles départementales<br />
qui viennent les préciser et les compléter. Les étudiants en sont informés au moyen du plan <strong>de</strong> cours ∗ . »<br />
∗ CÉGEP DE SAINTE-FOY (2003), Politique d’évaluation <strong>de</strong>s apprentissages, p. 13.<br />
i
ii NORMES DE PRÉSENTATION<br />
TABLE DES MATIÈRES<br />
AVANT DE COMMENCER VOTRE TRAVAIL ........................................................................................................... iv<br />
INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 1<br />
Les catégories <strong>de</strong> <strong>travaux</strong>..........................................................................................................................1<br />
1. Les éléments <strong>de</strong> base....................................................................................................................... 1<br />
1.1 Le format <strong>de</strong> papier ........................................................................................................................1<br />
1.2 Les marges .....................................................................................................................................1<br />
1.3 La pagination ..................................................................................................................................1<br />
1.4 Le caractère....................................................................................................................................1<br />
1.5 Les paragraphes ............................................................................................................................3<br />
1.6 L’interligne.......................................................................................................................................3<br />
2. La <strong>présentation</strong> générale ................................................................................................................. 4<br />
2.1 La page <strong>de</strong> titre...............................................................................................................................4<br />
2.2 La table <strong>de</strong>s matières.....................................................................................................................4<br />
2.3 Les titres et les intertitres...............................................................................................................4<br />
2.4 Les figures et les tableaux .............................................................................................................4<br />
2.5 Les notes infrapaginales................................................................................................................6<br />
2.6 Les formules et équations..............................................................................................................6<br />
3. Les citations....................................................................................................................................... 7<br />
3.1 Les citations courtes ......................................................................................................................7<br />
3.2 Les citations longues......................................................................................................................7<br />
3.3 La double référence .......................................................................................................................8<br />
3.4 Le plagiat ........................................................................................................................................8<br />
4. Les références ...................................................................................................................................10<br />
4.1 Travaux généralement associés aux disciplines sciences <strong>de</strong> la nature et psychologie .........10<br />
4.2 Travaux généralement associés aux autres disciplines............................................................11<br />
5. La bibliographie et les notices bibliographiques ........................................................................14<br />
5.1 Métho<strong>de</strong> auteur-année.................................................................................................................15<br />
5.2 Métho<strong>de</strong> auteur-titre.....................................................................................................................18<br />
6. La <strong>présentation</strong> <strong>de</strong> la bibliographie ...............................................................................................21<br />
6.1 Regroupement par ordre alphabétique.......................................................................................21<br />
6.2 Regroupement par catégories <strong>de</strong> références.............................................................................22<br />
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................36
NORMES DE PRÉSENTATION iii<br />
LISTE DES ANNEXES<br />
Annexe A Figures citées en exemples ..............................................................................................23<br />
Annexe B La fiche technique ..............................................................................................................26<br />
A. Les peintures, estampes et affiches .............................................................................26<br />
B. Les sculptures ................................................................................................................26<br />
C. Les œuvres architecturales...........................................................................................27<br />
D. Les objets .......................................................................................................................27<br />
Annexe C Modèle <strong>de</strong> <strong>présentation</strong> d’un travail écrit.......................................................................28<br />
Annexe D Exemples <strong>de</strong> composition <strong>de</strong> différents niveaux <strong>de</strong> titre ............................................31<br />
Annexe E Quelques règles <strong>de</strong> typographie......................................................................................32<br />
A. Les accents et signes diacritiques ................................................................................32<br />
B. L’apostrophe...................................................................................................................32<br />
C. L’appel <strong>de</strong> note...............................................................................................................32<br />
D. Les dates ........................................................................................................................32<br />
E. Les espaces ...................................................................................................................32<br />
F. Les exposants courants.................................................................................................34<br />
G. Les guillemets ................................................................................................................34<br />
H. Les ligatures ...................................................................................................................34<br />
I. Les numéros...................................................................................................................34<br />
J. Les points <strong>de</strong> suspension..............................................................................................34<br />
K. Les parenthèses ( ), crochets [ ] et accola<strong>de</strong>s { } ........................................................34<br />
L. Le souligné .....................................................................................................................34<br />
M. Les règles <strong>de</strong> capitalisation <strong>de</strong>s titres d’œuvres..........................................................35<br />
N. Les sigles et acronymes : O.N.U., ONU ou Onu ? ......................................................35<br />
LISTE DES FIGURES<br />
Figure 2.1 Les principales formes observées chez les bactéries..........................................................5<br />
Figure 2.2 Vitesse d’une bille en chute libre en fonction du temps.......................................................5<br />
Figure 4.3 Arbre <strong>de</strong> décision..................................................................................................................13<br />
Figure A.4 Les marges à respecter dans un tapuscrit..........................................................................23<br />
Figure A.5 Présentation <strong>de</strong>s paragraphes (espacement interparagraphe significatif).......................23<br />
Figure A.6 Présentation <strong>de</strong>s paragraphes (espacement interparagraphe non significatif)................23<br />
Figure A.7 Page <strong>de</strong> titre..........................................................................................................................24<br />
Figure A.8 Table <strong>de</strong>s matières selon le modèle numérique.................................................................24<br />
Figure A.9 Table <strong>de</strong>s matières selon le modèle classique...................................................................24<br />
Figure A.10 Numérotation <strong>de</strong>s titres et intertitres selon le modèle numérique.....................................25<br />
Figure A.11 Numérotation <strong>de</strong>s titres et intertitres selon le modèle classique.......................................25<br />
Figure A.12 Suppression <strong>de</strong>s jalons <strong>de</strong>s intertitres <strong>de</strong> quatrième niveau .............................................25<br />
Figure B.13 Le café, le soir.......................................................................................................................26<br />
Figure B.14 L’oiseau dans l’espace .........................................................................................................26<br />
Figure B.15 L’Hôtel Lambert.....................................................................................................................27<br />
Figure B.16 Vase <strong>de</strong> Tiffany .....................................................................................................................27<br />
LISTE DES TABLEAUX<br />
Tableau 2.1 Les principaux changements associés à la métamorphose chez la grenouille .................6<br />
Tableau 4.2 Abréviations dans les notes infrapaginales ........................................................................12<br />
Tableau E.3 Les espaces avant et après les signes typographiques ....................................................33<br />
Tableau E.4 Exemples <strong>de</strong> composition <strong>de</strong> quelques exposants courants.............................................34
iv NORMES DE PRÉSENTATION<br />
AVANT DE COMMENCER VOTRE TRAVAIL<br />
SAVEZ-VOUS…<br />
1. Quelle est la largeur <strong>de</strong>s marges gauche et droite que vous <strong>de</strong>vez respecter ? p. 1 et 24<br />
2. Quelle police <strong>de</strong> caractères utiliser ? Quelle taille <strong>de</strong> police utiliser ? p. 1 et 2<br />
3. Quelle justification donner aux paragraphes ? p. 3<br />
4. Où écrire le numéro <strong>de</strong>s pages ? Comment paginer votre travail ? p. 1 et 24<br />
5. Comment composer la page <strong>de</strong> titre ? Où y écrire votre nom ? p. 4, 25 et 29<br />
et ceux <strong>de</strong>s membres d’une équipe, s’il y a lieu<br />
6. Comment numéroter les titres et intertitres ? p. 4 et 26<br />
7. Quel interligne appliquer aux paragraphes ? p. 3<br />
8. Si votre travail entre dans la catégorie <strong>de</strong>s <strong>travaux</strong><br />
a) généralement associés aux disciplines <strong>de</strong> sciences <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> psychologie p. 10 et 15<br />
b) généralement associés aux disciplines autres que celles <strong>de</strong> sciences <strong>de</strong> la nature<br />
et <strong>de</strong> psychologie ? p. 11 et 18<br />
9. Comment composer une fiche technique ? p. 27 et 28<br />
10. Si vous <strong>de</strong>vez écrire les références directement dans le texte ou dans les notes p. 10 et 11<br />
infrapaginales ?<br />
11. Comment citer correctement sans plagier ? p. 8 et 9<br />
12. Si le titre d’une figure s’écrit au-<strong>de</strong>ssus ou en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> celle-ci ? p. 5<br />
13. Si le titre d’un tableau s’écrit au-<strong>de</strong>ssus ou en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> celui-ci ? p. 6<br />
14. Où écrire l’année ou la date <strong>de</strong> publication dans une notice bibliographique ? p. 14<br />
15. Comment écrire la référence d’un article provenant d’un livre, d’un périodique<br />
ou d’un site Web ? p. 15-17 ou 18-20<br />
16. Comment présenter la bibliographie ? p. 21 et 22<br />
Si vous n’êtes pas certain <strong>de</strong>s réponses à donner à toutes ces questions, vous n’êtes pas encore tout à fait prêt à<br />
rédiger votre travail dans le respect <strong>de</strong>s présentes normes. Assurez-vous donc <strong>de</strong> connaître les exigences <strong>de</strong><br />
votre professeur concernant la <strong>présentation</strong> <strong>de</strong> votre travail écrit avant <strong>de</strong> l’entreprendre.
NORMES DE PRÉSENTATION LES ÉLÉMENTS DE BASE 1<br />
INTRODUCTION<br />
Au cours <strong>de</strong> l’élaboration d’un travail écrit, <strong>de</strong>ux aspects généraux sont à retenir, soit le fond et la <strong>présentation</strong>.<br />
Le fond, c’est le travail lui-même, c’est-à-dire son contenu, qu’il s’agisse d’une dissertation, d’un<br />
exposé, d’un travail long ou d’un rapport <strong>de</strong> laboratoire par exemple.<br />
La <strong>présentation</strong>, qui fait l’objet du présent document, constitue un élément essentiel. En effet, c’est ce qui<br />
rendra votre travail plus facile à lire et à comprendre et qui permettra à votre professeur <strong>de</strong> suivre votre<br />
cheminement avec plus <strong>de</strong> facilité.<br />
LES CATÉGORIES DE TRAVAUX<br />
Nous reconnaissons ici <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s catégories <strong>de</strong> <strong>travaux</strong>, à savoir les manuscrits et les tapuscrits. Les<br />
manuscrits sont les <strong>travaux</strong> rédigés à la main, tandis que les tapuscrits sont effectués à l’ordinateur, à<br />
l’ai<strong>de</strong> d’un logiciel <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> texte.<br />
Sauf indication contraire, vous <strong>de</strong>vez appliquer les mêmes normes à ces <strong>de</strong>ux catégories <strong>de</strong> <strong>travaux</strong>.<br />
1. LES ÉLÉMENTS DE BASE<br />
1.1 Le format <strong>de</strong> papier Les <strong>travaux</strong> standards doivent être présentés sur du papier <strong>de</strong> format<br />
lettre ou lettre américaine (8,5 X 11 po). On n’écrit ou n’imprime<br />
généralement que d’un seul côté <strong>de</strong> la feuille 1 .<br />
1.2 Les marges<br />
Dans les manuscrits<br />
Dans les tapuscrits<br />
Respectez la marge <strong>de</strong> gauche déjà présente sur le papier ligné standard.<br />
Si le papier n’en comporte pas, il faudra en tracer une d’environ 3 cm <strong>de</strong><br />
largeur. Le papier ligné standard n’a généralement pas <strong>de</strong> marge du côté<br />
droit ; tracez-en une ou cessez d’écrire à environ 2 cm du bord <strong>de</strong> la<br />
page.<br />
Respectez une marge d’environ 2,5 cm dans le haut et le bas <strong>de</strong> la page,<br />
ainsi qu’une marge d’environ 3 cm à gauche et à droite (fig. 1, p. 24).<br />
1.3 La pagination Le numéro <strong>de</strong> la page se situe dans le coin supérieur droit, à environ<br />
2 cm du haut <strong>de</strong> la page, en respectant la marge <strong>de</strong> droite.<br />
1.4 Le caractère<br />
La police<br />
À l’exception <strong>de</strong> la page <strong>de</strong> titre, toutes les pages sont numérotées. La<br />
pagination <strong>de</strong> la table <strong>de</strong>s matières, <strong>de</strong> la liste <strong>de</strong>s abréviations ainsi que<br />
la liste <strong>de</strong>s annexes, figures et tableaux se fait en chiffres romains<br />
minuscules (i, ii, iii, iv, etc.).<br />
Toutes les autres pages sont numérotées en chiffres arabes, à partir <strong>de</strong> 1.<br />
Adoptez une police <strong>de</strong> caractères comme Times, Times New Roman,<br />
Palatino ou Garamond, par exemple. Ce sont <strong>de</strong>s polices dont toutes les<br />
lettres (sauf le o) présentent <strong>de</strong>s empattements 2 , c’est-à-dire <strong>de</strong>s traits à<br />
leurs extrémités. Conservez la même police pour l’ensemble du travail.<br />
Les polices sans empattements (comme Arial ou Helvetica) ont un<br />
aspect dépouillé. Pour cette raison, on les utilise souvent pour les titres et<br />
intertitres (comme dans le présent document).<br />
Exemples 3<br />
Times New Roman Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche 4 .<br />
Palatino Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.<br />
Arial Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.<br />
1. Faites la vérification dans Word : menu Fichier, Mise en page. Si c’est le format A4 qui s’affiche, il faut le changer<br />
pour le format Lettre. Le format A4 est le format européen : le papier est un peu plus long et un peu moins large.<br />
2. Ces empattements n’ont pas qu’une fonction esthétique : ils servent en effet à gui<strong>de</strong>r l’œil le long d’une ligne<br />
imaginaire <strong>de</strong> lecture et contribuent ainsi à améliorer la lisibilité du texte.<br />
3. Chacun <strong>de</strong> ces exemples est composé en 10 points.<br />
4. Charles BAUDELAIRE, Les fleurs du mal, p. 207.
2 LES ÉLÉMENTS DE BASE NORMES DE PRÉSENTATION<br />
La taille La taille <strong>de</strong> caractères recommandée pour le corps du texte est le 12<br />
points. Les notes infrapaginales sont composées en 10 points 5 .<br />
Les styles<br />
Romain, italique<br />
et gras<br />
Les trois styles <strong>de</strong> caractères les plus courants sont le romain (c’est-àdire<br />
droit, comme le texte <strong>de</strong> cette phrase), l’italique et le gras.<br />
Le caractère italique est utilisé pour faire ressortir un mot, une<br />
expression ou une phrase, <strong>de</strong> même que dans les situations décrites ci<strong>de</strong>ssous.<br />
Dans les manuscrits, on utilise le souligné à la place <strong>de</strong><br />
l’italique.<br />
On emploie le caractère gras pour faire ressortir plus fortement un mot<br />
ou une phrase. En outre, on l’utilise couramment dans les titres. Utilisez<br />
ce style avec parcimonie pour ne pas alourdir la lecture : en attirant<br />
l’attention sur trop d’éléments à la fois, vous risquez <strong>de</strong> produire l’effet<br />
contraire, c’est-à-dire une perte d’intérêt <strong>de</strong> la part du lecteur.<br />
Certaines situations où l’emploi <strong>de</strong> l’italique est préconisé 6 .<br />
• Pour faire ressortir un mot ou une expression, ainsi que dans les <strong>de</strong>vises, maximes et proverbes<br />
La <strong>de</strong>vise <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Québec est Don <strong>de</strong> Dieu feray valoir.<br />
Notre professeur n’arrête pas <strong>de</strong> nous répéter que c’est en forgeant qu’on <strong>de</strong>vient forgeron.<br />
• Dans les titres d’ouvrages, d’œuvres et pour les noms <strong>de</strong> journaux et <strong>de</strong> périodiques, peu importe où<br />
ils sont placés dans le travail (texte principal, référence, notice bibliographique, etc.)<br />
Je viens <strong>de</strong> lire Le dictateur et le hamac <strong>de</strong> Daniel PENNAC.<br />
J’ai trouvé ce vélo dans les petites annonces du Soleil.<br />
Les revues Actualité et Québec Science sont éditées au Québec.<br />
J’ai admiré La <strong>de</strong>rnière cène <strong>de</strong> Salvador DALI dans l’un <strong>de</strong>s musées <strong>de</strong> Washington.<br />
Aurel RAMAT (2005), Le Ramat <strong>de</strong> la typographie, p. 114–122.<br />
• Dans les locutions ou abréviations latines non francisées<br />
a posteriori, ad hoc, ibid., loc. cit., op. cit., sic, etc.<br />
• Pour les langues étrangères<br />
Il y a d’admirables œuvres <strong>de</strong> REMBRANDT à la National Galery of Art <strong>de</strong> Washington.<br />
• Les notes <strong>de</strong> musique<br />
La clef <strong>de</strong> sol se place sur la <strong>de</strong>uxième ligne.<br />
• Les noms scientifiques <strong>de</strong>s genres et <strong>de</strong>s espèces d’êtres vivants<br />
Canis latrans est le nom scientifique du coyote et Acer saccharum, celui <strong>de</strong> l’érable à sucre.<br />
Le loup, le chien et le coyote appartiennent au genre Canis, le renard, au genre Vulpes.<br />
5. Si vous utilisez une police sans empattements comme Arial ou Helvetica pour les titres et intertitres, composez ceux-ci<br />
en 11 points.<br />
6. Adapté d’Aurel RAMAT, Le Ramat <strong>de</strong> la typographie, p. 114–122 et <strong>de</strong> Marie MALO, Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> la communication<br />
écrite, p. 173–175.
NORMES DE PRÉSENTATION LES ÉLÉMENTS DE BASE 3<br />
1.5 Les paragraphes<br />
Le début <strong>de</strong> la<br />
première ligne<br />
L’espacement<br />
interparagraphe<br />
Tous les paragraphes, y compris les titres, débutent contre la marge <strong>de</strong><br />
gauche, les principales exceptions étant les citations longues et les titres<br />
<strong>de</strong>s figures et <strong>de</strong>s tableaux. (Les titres Table <strong>de</strong>s matières, Résumé,<br />
Introduction, Discussion, Conclusion et Bibliographie) peuvent être<br />
centrés sur la page 7 .)<br />
Il est conseillé <strong>de</strong> laisser un espacement significatif entre les<br />
paragraphes.<br />
L’alinéa En l’absence d’un espacement interparagraphe significatif, la première<br />
ligne <strong>de</strong> chaque paragraphe, sauf celui immédiatement sous un titre, doit<br />
être renfoncée vers l’intérieur : c’est ce qu’on appelle communément un<br />
alinéa 8 .<br />
On donne ainsi à l’alinéa son utilité première, c’est-à-dire <strong>de</strong> marquer<br />
le début <strong>de</strong>s paragraphes lorsque ceux-ci sont très proches les uns <strong>de</strong>s<br />
autres. (Comparer les figures A.5 et A.6 <strong>de</strong> l’annexe A, p. 23.)<br />
La justification Grâce aux logiciels <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> texte, il est facile d’imposer une<br />
pleine justification (le texte est aligné à gauche et à droite) ou d’aligner<br />
le texte à gauche uniquement 9 . L’un ou l’autre <strong>de</strong> ces types d’alignement<br />
peut être utilisé au choix.<br />
Paragraphe avec<br />
pleine justification<br />
Paragraphe aligné<br />
à gauche<br />
1.6 L’interligne<br />
Exemples<br />
« Chaque année, en mai et en juin, dans la vallée du Saint-Laurent,<br />
comme ailleurs en Amérique, on se prépare à la chasse aux tourtes, ces<br />
gros pigeons migrateurs, au plumage cendré, à la queue longue et<br />
pointue, vivant en colonies. […] Petit à petit, on les voit apparaître par<br />
ban<strong>de</strong>s, en quête <strong>de</strong> nourriture. […] Ils ne sont jamais si nombreux qu’en<br />
juillet 10 . »<br />
« Chaque année, en mai et en juin, dans la vallée du Saint-Laurent,<br />
comme ailleurs en Amérique, on se prépare à la chasse aux tourtes, ces<br />
gros pigeons migrateurs, au plumage cendré, à la queue longue et<br />
pointue, vivant en colonies. […] Petit à petit, on les voit apparaître par<br />
ban<strong>de</strong>s, en quête <strong>de</strong> nourriture. […] Ils ne sont jamais si nombreux qu’en<br />
juillet 11 . »<br />
Dans les manuscrits Le texte courant, c’est-à-dire le texte principal, est composé en simple ou<br />
en double interligne, selon les consignes données par votre professeur.<br />
Dans les tapuscrits Le texte courant est composé en interligne et <strong>de</strong>mi ou en double<br />
interligne, selon les consignes données par votre professeur.<br />
Exceptions<br />
La table <strong>de</strong>s matières, les citations longues, les notes infrapaginales, les titres<br />
<strong>de</strong>s figures et <strong>de</strong>s tableaux, les références <strong>de</strong>s figures et tableaux, ainsi que la<br />
bibliographie sont toujours composés en simple interligne.<br />
7. Voir l’annexe C, p. 28-30.<br />
8. A. RAMAT, ibid., p. 15, recomman<strong>de</strong> un retrait positif (vers l’intérieur) d’environ 4 mm. Le maximum <strong>de</strong>vrait être<br />
<strong>de</strong> 1 cm.<br />
9. On dit alors que les paragraphes sont disposés en drapeau à droite. D’après RICHAUDEAU (1979, p. 120), il n’y a pas,<br />
chez <strong>de</strong>s lecteurs adultes, <strong>de</strong> différence dans la vitesse <strong>de</strong> lecture, selon que le texte est justifié ou aligné à gauche.<br />
10. Jean PROVENCHER, C’était l’été : La vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent, p. 176.<br />
11. Ibid., p. 176.
4 LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE NORMES DE PRÉSENTATION<br />
2. LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE<br />
2.1 La page <strong>de</strong> titre Le nom et le numéro <strong>de</strong> groupe doivent être inscrits dans le coin supérieur<br />
gauche <strong>de</strong> la page <strong>de</strong> titre. S’il y a plusieurs auteurs, nommez-les dans<br />
l’ordre alphabétique <strong>de</strong>s noms <strong>de</strong> famille [figure A.7 (p. 24) et p. 28].<br />
2.2 La table<br />
<strong>de</strong>s matières<br />
2.3 Les titres<br />
et les intertitres 13<br />
2.4 Les figures<br />
et les tableaux<br />
Viennent ensuite, à peu près au centre <strong>de</strong> la page, 1) le titre du travail (en<br />
caractère gras), 2) le nom du professeur à qui il est remis ainsi que 3) le<br />
nom et le numéro <strong>de</strong> cours, chacun <strong>de</strong> ces éléments étant sur une ligne<br />
différente.<br />
Dans le bas <strong>de</strong> la page, on retrouvera le nom du département et le nom<br />
du programme 12 dont fait partie le professeur à qui le travail est remis,<br />
ainsi que le nom du cégep et la date <strong>de</strong> remise du travail.<br />
La table <strong>de</strong>s matières se compose en simple interligne. Le numéro <strong>de</strong> la<br />
page est indiqué en chiffres romains minuscules. Il n’est pas obligatoire<br />
<strong>de</strong> mettre <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> conduite comme dans les exemples <strong>de</strong>s figures<br />
A.8 et A.9, p. 24.<br />
Votre table <strong>de</strong>s matières doit refléter le modèle <strong>de</strong> numérotation <strong>de</strong>s<br />
titres et intertitres dans le texte. Les exemples présentés à la page 24<br />
illustrent le modèle numérique et le modèle classique.<br />
À l’exception du titre principal d’une section, qui peut être centré, les<br />
titres et intertitres sont appuyés contre la marge <strong>de</strong> gauche.<br />
Si les titres et intertitres sont nombreux, il est conseillé d’utiliser l’un<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux modèles (numérique ou classique) à votre choix ou selon les<br />
consignes données par votre professeur (figures A.10 et A.11, p. 25).<br />
Les figures et les tableaux sont <strong>de</strong>s éléments qui accompagnent et complètent<br />
les <strong>travaux</strong>. Ils sont importants, car ils constituent une façon<br />
différente <strong>de</strong> présenter <strong>de</strong>s données ou <strong>de</strong>s idées qui viennent appuyer,<br />
éclaircir ou enrichir le texte.<br />
Lorsque vous utilisez <strong>de</strong>s figures et <strong>de</strong>s tableaux dans vos <strong>travaux</strong>, vous<br />
<strong>de</strong>vez y faire référence et les commenter, <strong>de</strong> façon à montrer leur<br />
importance ou leur utilité.<br />
La numérotation <strong>de</strong>s figures et <strong>de</strong>s tableaux est séquentielle et suit<br />
l’ordre dans lequel chacun <strong>de</strong> ces éléments apparaît.<br />
Par exemple :<br />
Tableau 1<br />
Figure 1<br />
Figure 2<br />
Tableau 2<br />
Tableau 3<br />
Figure 3<br />
Tableau 4<br />
Etc.<br />
12. Si les noms du département et du programme sont i<strong>de</strong>ntiques, n’indiquez que le nom du programme.<br />
13. Un intertitre est un titre d’une section d’un texte secondaire qui sépare et annonce les différentes parties d’un texte.<br />
Ne pas confondre avec sous-titre, qui désigne le plus souvent un titre d’une partie <strong>de</strong> livre ou un titre secondaire placé<br />
après le titre principal d’un ouvrage, d’un journal, d’une revue, d’un article <strong>de</strong> presse. Par exemple :<br />
La forêt <strong>de</strong>rrière les arbres : Initiation au milieu forestier québécois.
NORMES DE PRÉSENTATION LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE 5<br />
Les figures Les figures comprennent tous les éléments iconographiques tels les<br />
graphiques, les illustrations, les <strong>de</strong>ssins, les schémas, les cartes, les<br />
photographies, les cheminements critiques, etc. Ces différents éléments<br />
doivent être i<strong>de</strong>ntifiés en tant que figures.<br />
Les figures sont toujours numérotées en chiffres arabes et accompagnées<br />
d’un titre en caractères gras situé en <strong>de</strong>ssous, en position centrée par<br />
rapport à la figure. La référence, s’il y a lieu, est également indiquée au<br />
bas <strong>de</strong> la figure, entre celle-ci et le titre, et elle est en 9 points. Le titre et<br />
la référence sont composés en simple interligne.<br />
Exemples<br />
Sphérique En bâtonnet Hélicoïdale<br />
Source : Michael J. Pelczar et E. C. S CHAN, Éléments <strong>de</strong> microbiologie, p. 22.<br />
Figure 2.1 Les principales formes observées chez les bactéries<br />
Figure 2.2 Vitesse d’une bille en chute libre en fonction du temps<br />
Remarque Dans les rapports <strong>de</strong> laboratoire, le type <strong>de</strong> papier utilisé pour tracer les<br />
graphiques laisse habituellement peu <strong>de</strong> place pour écrire le titre <strong>de</strong> la<br />
figure au bas du graphique. Il faudra donc tracer celui-ci plus haut sur la<br />
page afin <strong>de</strong> laisser <strong>de</strong> la place au bas pour le titre. Sinon, mettre le titre<br />
bien en évi<strong>de</strong>nce dans la partie supérieure du graphique.<br />
À noter que le titre doit porter le nom <strong>de</strong> figure.
6 LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE NORMES DE PRÉSENTATION<br />
Les tableaux Les tableaux regroupent plusieurs séries <strong>de</strong> renseignements disposés <strong>de</strong><br />
façon ordonnée en rangées et en colonnes.<br />
Exemple<br />
Les tableaux sont toujours numérotés en chiffres arabes et accompagnés<br />
d’un titre en caractères gras situé au-<strong>de</strong>ssus. La référence, s’il y a lieu,<br />
est écrite en 9 points en <strong>de</strong>ssous du tableau. Le titre et la référence sont<br />
composés en simple interligne.<br />
Tableau 2.1 Les principaux changements associés à la métamorphose chez la grenouille<br />
Fonction Larve Adulte<br />
Milieu <strong>de</strong> vie Aquatique Terrestre<br />
Locomotion Queue [servant <strong>de</strong>] nageoire Pattes ; absence <strong>de</strong> queue<br />
Respiration Branchies externes Poumons et peau<br />
Nutrition Végétarienne Carnivore<br />
Digestion Tube digestif long Tube digestif court<br />
Source : Karen ARMS et Pamela S. CAMP, Biologie générale, p. 230.<br />
2.5 Les notes<br />
infrapaginales<br />
2.6 Les formules<br />
et équations<br />
Les notes infrapaginales, dites aussi notes <strong>de</strong> bas <strong>de</strong> page, ont <strong>de</strong>ux<br />
fonctions principales. Ce sont d’abord <strong>de</strong>s commentaires ou <strong>de</strong>s notes<br />
explicatives apportées au texte (on parle alors <strong>de</strong> notes <strong>de</strong> contenu 14 ) ;<br />
dans certaines catégories <strong>de</strong> <strong>travaux</strong>, on les utilise également pour<br />
indiquer les références à <strong>de</strong>s citations 15 (notes <strong>de</strong> référence). Le présent<br />
document contient <strong>de</strong> nombreux exemples illustrant ces <strong>de</strong>ux fonctions.<br />
Notez que les logiciels <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> texte permettent <strong>de</strong> créer<br />
facilement <strong>de</strong>s notes infrapaginales 16 .<br />
Une note infrapaginale correspond à un appel <strong>de</strong> note placé dans le<br />
texte. Cet appel <strong>de</strong> note est un chiffre en exposant placé à l’endroit où on<br />
veut attirer l’attention sur un commentaire ou une explication. Le point<br />
C <strong>de</strong> l’annexe E (p. 32) présente certaines règles qui précisent où placer<br />
un appel <strong>de</strong> note.<br />
Lorsqu’elles sont isolées, les formules et équations sont placées au<br />
centre <strong>de</strong> la ligne. Si elles sont numérotées, le numéro est à droite <strong>de</strong> la<br />
formule ou <strong>de</strong> l’équation, entre <strong>de</strong>s parenthèses et appuyé contre la<br />
marge <strong>de</strong> droite.<br />
Exemple<br />
L’équation suivante représente la dissociation incomplète d’une substance<br />
aci<strong>de</strong> :<br />
Elle permet d’écrire :<br />
où K est la constante <strong>de</strong> dissociation.<br />
!<br />
AH ! A – + H +<br />
A – [ ] H + [ ]<br />
= K (1)<br />
[ AH]<br />
14. Marie MALO, Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> la communication écrite, p. 177.<br />
15. C’est généralement le cas <strong>de</strong>s disciplines autres que celles <strong>de</strong> sciences <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> psychologie.<br />
16. Chaque note apparaît en bas <strong>de</strong> la page et est surmontée d’une ligne horizontale. Leur numérotation se fait <strong>de</strong> façon<br />
continue et vous ne <strong>de</strong>vez pas les recommencer à 1 à chaque nouvelle page ou à chaque nouvelle section.
NORMES DE PRÉSENTATION LES CITATIONS 7<br />
LES CITATIONS<br />
Chaque fois que vous utilisez une citation ou une information qui ne fait pas partie du bagage commun<br />
<strong>de</strong>s connaissances et dont vous n’êtes pas l’auteur, vous <strong>de</strong>vez l’indiquer et en donner la référence. Le<br />
plagiat consiste en un non-respect <strong>de</strong> cette consigne. Il est essentiel, ne serait-ce que sur le plan éthique, que<br />
le lecteur sache en tout temps si ce qu’il lit est original ou si cela a été emprunté ailleurs.<br />
3.1 Les citations courtes<br />
Les citations courtes (<strong>de</strong> trois lignes ou moins) sont insérées dans le texte et<br />
encadrées par <strong>de</strong>s guillemets. En français, les guillemets sont <strong>de</strong>s chevrons (« ») ;<br />
ils doivent être utilisés <strong>de</strong> préférence aux guillemets américains (" " ou “ ”).<br />
Les citations <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ou trois vers peuvent être placées sur une même ligne et<br />
séparées par une barre oblique.<br />
Exemples<br />
L’un <strong>de</strong>s plus beaux exemples <strong>de</strong> courage, en même temps que <strong>de</strong> pu<strong>de</strong>ur, nous<br />
est donné par Guillaumet qui s’était écrasé en avion dans la cordillère <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s<br />
et qui, après trois, quatre jours <strong>de</strong> marche, ne souhaitait plus que le sommeil.<br />
Mais il se disait : « Ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les<br />
camara<strong>de</strong>s croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi. Et je suis un<br />
salaud si je ne marche pas 17 . »<br />
Voici la leçon d’orthographe <strong>de</strong> Jacques PRÉVERT : « C’est ma faute/C’est ma<br />
faute/C’est ma très gran<strong>de</strong> faute d’orthographe 18 . »<br />
Remarque Si une citation débute par une minuscule, la ponctuation finale est à<br />
l’extérieur du guillemet fermant. Si la citation débute par une capitale, la<br />
ponctuation finale est à l’intérieur du guillemet fermant.<br />
Exemple<br />
Vous me dites qu’il est dommage que « les roses aient <strong>de</strong>s épines ».<br />
Je vous réponds : « Heureusement, les épines ont <strong>de</strong>s roses 19 . »<br />
3.2 Les citations longues Les citations longues (<strong>de</strong> quatre lignes et plus) <strong>de</strong> même que les citations en<br />
vers (<strong>de</strong> quatre vers et plus) sont mises en retrait d’environ 1 cm par rapport<br />
aux marges gauche et droite. Elles sont composées en simple interligne et ne<br />
sont pas guillemetées.<br />
Comme le montre l’exemple ci-<strong>de</strong>ssous, le texte qui introduit une citation doit<br />
toujours se terminer par un <strong>de</strong>ux-points.<br />
Exemples<br />
Dans son <strong>de</strong>uxième livre <strong>de</strong> bord, Jacques Cartier raconte que, durant l’hiver<br />
1535-1536, vingt-cinq membres <strong>de</strong> son équipage sont morts <strong>de</strong>s suites du<br />
scorbut. On connaît maintenant la cause <strong>de</strong> cette maladie :<br />
Le scorbut est causé par une carence en aci<strong>de</strong> ascorbique,<br />
appelé aussi vitamine C, que la majorité <strong>de</strong>s vertébrés, à<br />
l’exception <strong>de</strong>s singes et <strong>de</strong>s humains, peuvent synthétiser<br />
eux-mêmes. […] Sans vitamine C, les tissus conjonctifs se<br />
décomposent lentement. […] Les gens atteints meurent<br />
généralement <strong>de</strong>s suites d’hémorragies dues à <strong>de</strong>s vaisseaux<br />
sanguins endommagés 20 .<br />
17. Antoine <strong>de</strong> SAINT-EXUPÉRY, Œuvres d’Antoine <strong>de</strong> Saint-Exupéry, p. 164.<br />
18. Jacques PRÉVERT, Histoires, p. 88.<br />
19. A. RAMAT, op. cit., p. 177.<br />
20. K. ARMS et P. S. CAMP, op. cit., p. 660.
8 LES CITATIONS NORMES DE PRÉSENTATION<br />
3.3 La double référence<br />
3.4 Le plagiat<br />
Suite <strong>de</strong> la leçon d’orthographe <strong>de</strong> Jacques PRÉVERT :<br />
C’est ma faute<br />
C’est ma très gran<strong>de</strong> faute<br />
C’est ma très gran<strong>de</strong> faute d’orthographe<br />
Voilà comment j’écris<br />
Giraffe 21<br />
On pourrait parler aussi d’une citation à l’intérieur d’une citation. Il s’agit en<br />
réalité d’une source citée dans une source principale. Dans l’exemple ci<strong>de</strong>ssous,<br />
J. LECLERC utilise une donnée provenant <strong>de</strong> P. GUIRAUD.<br />
Exemple<br />
Lorsqu’on évalue les emprunts du français aux langues étrangères,<br />
J. LECLERC nous apprend que le français a emprunté au néerlandais aux<br />
environs <strong>de</strong> 200 mots 22 et à l’allemand quelque 170 mots 23 .<br />
Remarque Dans la bibliographie, on ne doit retrouver que la notice <strong>de</strong> l’ouvrage<br />
premier, soit Qu’est-ce que la langue ?<br />
PIQUER, C’EST VOLER — PLAGIER, C’EST TRICHER 24<br />
Les six cas suivants illustrent <strong>de</strong>s situations <strong>de</strong> plagiat 25<br />
:<br />
1. Copier textuellement un passage d’un livre, d’une revue ou d’une page Web sans<br />
le mettre entre guillemets ou sans en mentionner la source ;<br />
2. Insérer dans un travail <strong>de</strong>s images, <strong>de</strong>s graphiques, <strong>de</strong>s données, etc. provenant <strong>de</strong><br />
sources externes sans en indiquer la provenance ;<br />
3. Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en<br />
omettant d’en indiquer la source ;<br />
4. Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance ;<br />
5. Utiliser le travail d’une autre personne et le présenter comme le sien, et ce, même si<br />
cette personne a donné son accord ;<br />
6. Acheter un travail sur le Web.<br />
Des exemples <strong>de</strong> plagiat et <strong>de</strong> citations énoncées correctement sont illustrés à la page suivante.<br />
21. J. PRÉVERT, op. cit., p. 88.<br />
22. Jacques LECLERC, Qu’est-ce que la langue ?, p. 345<br />
23. Pierre GUIRAUD, Les mots étrangers, PUF, coll. Que sais-je ?, 1965, p. 30, cité dans J. LECLERC, ibid., p. 345.<br />
24. L’article 6.1.13 <strong>de</strong> la Politique d’évaluation <strong>de</strong>s apprentissages est très sévère à cet égard. On y précise tout ce qui est<br />
considéré comme un plagiat ou une frau<strong>de</strong>, ainsi que la sanction : « En cas <strong>de</strong> plagiat, <strong>de</strong> coopération à un plagiat ou <strong>de</strong><br />
frau<strong>de</strong> lors d’un examen ou d’un travail, l’étudiant obtient la note « 0 » pour cet examen ou ce travail, sans exclure la<br />
possibilité d’autres sanctions compte tenu <strong>de</strong> la gravité <strong>de</strong> la faute. »<br />
25. Johanne LAVOIE, « Exemples <strong>de</strong> plagiat », Web.
NORMES DE PRÉSENTATION LES CITATIONS 9<br />
TEXTE D’ORIGINE<br />
Les caucasiens au phototype clair et en bonne santé sont peu à risque <strong>de</strong><br />
développer <strong>de</strong>s déficits en vitamine D, car ils sont en mesure d’en obtenir<br />
facilement <strong>de</strong> bonnes doses lors <strong>de</strong> courtes expositions (<strong>de</strong> 10 à 15 minutes<br />
quelques fois par semaine en découvrant <strong>de</strong> petites surfaces cutanée (sic) durant<br />
les mois d’avril à octobre). […] Un autre avantage <strong>de</strong>s caucasiens est leur<br />
capacité à digérer plus facilement les produits laitiers riches en calcium […]<br />
dont la présence est essentielle pour une activité normale <strong>de</strong> la vitamine D 26 .<br />
Exemples <strong>de</strong> plagiat<br />
On observe chez les individus <strong>de</strong> race blanche bien portants une disposition<br />
naturelle à combler leurs besoins en vitamine D. Ils n’ont qu’à exposer à<br />
quelques reprises chaque semaine <strong>de</strong> petites parties <strong>de</strong> peau nue au soleil<br />
pendant <strong>de</strong> courtes pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> temps. Les pério<strong>de</strong>s favorables vont du mois<br />
d’avril au mois d’octobre. Ces mêmes individus ont aussi la chance <strong>de</strong> pouvoir<br />
digérer plus facilement le lait. Celui-ci, riche en calcium, est nécessaire au bon<br />
fonctionnement <strong>de</strong> la vitamine D.<br />
On observe chez les individus <strong>de</strong> race blanche bien portants une disposition<br />
naturelle à combler leurs besoins en vitamine D. Ils sont en effet en mesure<br />
d’en obtenir facilement <strong>de</strong> bonnes doses lors <strong>de</strong> courtes expositions au soleil<br />
durant les mois d’avril à octobre. Un autre avantage est leur capacité à<br />
digérer plus facilement les produits laitiers riches en calcium dont la présence<br />
est essentielle pour une activité normale <strong>de</strong> la vitamine D.<br />
Exemples <strong>de</strong> citations énoncées correctement<br />
Selon DROUIN (2007, p. 5), on observe chez les individus <strong>de</strong> race blanche bien<br />
portants une disposition naturelle à combler leurs besoins en vitamine D. Ils<br />
n’ont qu’à exposer à quelques reprises chaque semaine <strong>de</strong> petites parties <strong>de</strong><br />
peau nue au soleil pendant <strong>de</strong> courtes pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> temps. Les pério<strong>de</strong>s<br />
favorables vont du mois d’avril au mois d’octobre. Ces mêmes individus ont<br />
aussi la chance <strong>de</strong> pouvoir digérer plus facilement le lait. Celui-ci, riche en<br />
calcium, est nécessaire au bon fonctionnement <strong>de</strong> la vitamine D.<br />
DROUIN (2007, p. 5) mentionne qu’on observe chez les individus <strong>de</strong> race<br />
blanche bien portants une disposition naturelle à combler leurs besoins en<br />
vitamine D. « Ils sont en mesure d’en obtenir facilement <strong>de</strong> bonnes doses lors<br />
<strong>de</strong> courtes expositions au soleil durant les mois d’avril à octobre. » […] Ils ont<br />
aussi « un autre avantage », soit celui <strong>de</strong> « digérer plus facilement les produits<br />
laitiers riches en calcium […] dont la présence est essentielle pour une activité<br />
normale <strong>de</strong> la vitamine D. »<br />
Les crochets indiquent que l’auteur du<br />
travail a supprimé […], modifié ou<br />
ajouté <strong>de</strong>s éléments.<br />
Lorsqu’une citation comprend une erreur<br />
ou un terme qui surprend, on ne le<br />
modifie pas, mais on le greffe d’un<br />
(sic) 27 .<br />
L’auteur du travail a complètement<br />
reformulé le texte d’origine, non<br />
seulement en utilisant <strong>de</strong>s synonymes,<br />
mais aussi en modifiant la structure.<br />
C’est ce qu’on appelle une paraphrase.<br />
Aucun guillemet, aucune référence :<br />
c’est du plagiat.<br />
Le texte en gras est le texte d’origine.<br />
L’auteur du travail a paraphrasé une<br />
partie <strong>de</strong> la citation et a aussi supprimé<br />
du texte sans le signaler.<br />
Aucun guillemet, aucune référence :<br />
c’est du plagiat.<br />
L’auteur du texte a complètement<br />
reformulé le texte original et a indiqué<br />
la source au début.<br />
Ce texte est bien cité :<br />
il n’y a pas <strong>de</strong> plagiat.<br />
L’auteur du texte a partiellement<br />
reformulé le texte original et en a<br />
conservé <strong>de</strong>s éléments qu’il a<br />
guillemetés 28 .<br />
Ce texte est bien cité :<br />
il n’y a pas <strong>de</strong> plagiat.<br />
26. Christian A. DROUIN, « Encore plus sur la vitamine D », p. 5.<br />
27. Sic est un mot latin qui signifie ainsi. On l’écrit entre parenthèses.<br />
28. Comme on peut le constater dans cet exemple, une citation qui renferme <strong>de</strong> nombreux éléments guillemetés ne se lit<br />
pas aisément, en plus d’être plus difficile à transcrire. Il vaut mieux faire <strong>de</strong>s paraphrases, c’est-à-dire reformuler en<br />
vos propres mots le texte d’origine.
10 LES RÉFÉRENCES NORMES DE PRÉSENTATION<br />
4. LES RÉFÉRENCES<br />
Selon les disciplines, les types <strong>de</strong> <strong>travaux</strong> ou les directives données par votre professeur, vous pourrez<br />
indiquer les références <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux façons, soit directement dans le texte, soit à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> notes infrapaginales.<br />
Mais quelle qu’elle soit, la métho<strong>de</strong> doit <strong>de</strong>meurer uniforme dans l’ensemble du travail.<br />
4.1 TRAVAUX GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS AUX DISCIPLINES DE SCIENCES DE LA NATURE ET DE<br />
PSYCHOLOGIE<br />
Consignes Les références sont données directement dans le texte.<br />
La référence précè<strong>de</strong><br />
la citation.<br />
La citation précè<strong>de</strong><br />
la référence.<br />
Le premier élément <strong>de</strong> la référence est le NOM du ou <strong>de</strong>s auteurs 29 . Si<br />
l’auteur est un organisme ayant un nom très long 30 , n’en donnez que les<br />
<strong>de</strong>ux ou trois premiers termes suivis <strong>de</strong> points <strong>de</strong> suspension.<br />
S’il n’y a pas d’auteur, donnez le titre <strong>de</strong> l’ouvrage, <strong>de</strong> l’article ou <strong>de</strong><br />
l’extrait (si le titre est trop long, suivez la consigne ci-<strong>de</strong>ssus).<br />
Les <strong>de</strong>uxième et troisième éléments sont toujours l’année <strong>de</strong> publication<br />
et la ou les pages d’où provient l’information. Ces éléments sont entre<br />
parenthèses.<br />
Exemples<br />
Selon BAGNÈRES et coll. (2002, p. 26), « dès l’apparition <strong>de</strong>s premiers<br />
êtres vivants […], la communication chimique, sous la forme d’échange<br />
<strong>de</strong> molécules, a été le système <strong>de</strong> communication le plus universellement<br />
utilisé. »<br />
D’après LA RÉGIONALE DE… (1990, p. 20), « la concentration <strong>de</strong> BPC<br />
est <strong>de</strong> 5 à 10 fois inférieure dans le placenta que dans le sang. »<br />
« On définit les thérapies douces comme un ensemble <strong>de</strong> thérapies<br />
alternatives […] qui ne requièrent jamais plus qu’une technologie<br />
légère. » ROUSSEAU et coll., (1987, p. 17).<br />
Reformulation SARRAZIN (1999, p. 12) explique que les émergences d’évents d’eau<br />
chau<strong>de</strong> sur le plancher <strong>de</strong>s océans sont à l’origine <strong>de</strong>s cheminées<br />
hydrothermales.<br />
Remarques<br />
S’il s’agit d’une communication personnelle ou d’éléments acquis lors<br />
d’une conférence, écrire le NOM <strong>de</strong> l’auteur, (la date ou le mois <strong>de</strong><br />
consultation et comm. pers. ou conférence).<br />
Exemple<br />
TREMBLAY (mars 2008, comm. pers.) mentionne qu’on peut observer,<br />
au cours <strong>de</strong> la division cellulaire, l’événement suivant :…<br />
S’il y a plusieurs références pour un même auteur ayant <strong>de</strong>s ouvrages ou <strong>de</strong>s<br />
articles différents au cours d’une même année d’édition, écrivez les lettres<br />
a, b, c… après l’année.<br />
Exemple<br />
POTHIER (1998a, p. 70–71)<br />
POTHIER (1998b, p. 80)<br />
POTHIER (1998c, p. 100)<br />
29. Le nom <strong>de</strong> l’auteur se compose en majuscules ou, <strong>de</strong> préférence, en petites majuscules. (Voir la note 35.)<br />
Lorsqu’il y a <strong>de</strong>ux auteurs ou plus, n’indiquez que le premier suivi <strong>de</strong> « et coll. », pour collègues, collaborateurs.<br />
(Par exemple, BAGNÈRES et coll.) Cependant, dans la bibliographie, il faut retrouver le nom <strong>de</strong> chaque auteur.<br />
30. LA RÉGIONALE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC, par exemple.
NORMES DE PRÉSENTATION LES RÉFÉRENCES 11<br />
4.2 TRAVAUX GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS AUX DISCIPLINES AUTRES QUE SCIENCES DE LA NATURE<br />
ET PSYCHOLOGIE<br />
Les références sont indiquées dans les notes infrapaginales 31 .<br />
La première fois que vous citez une référence dans une note infrapaginale, indiquez :<br />
A. Pour les imprimés (livres, ouvrages <strong>de</strong> référence, articles <strong>de</strong> presse, périodiques, etc.) 32<br />
1) le prénom et le NOM du principal auteur 33 ,<br />
2) le titre <strong>de</strong> l’ouvrage, <strong>de</strong> « l’article » ou <strong>de</strong> « l’extrait »,<br />
3) le numéro <strong>de</strong> la page d’où provient la citation.<br />
Exemples<br />
Livre Pierre MAGNAN, Les courriers <strong>de</strong> la mort, p. 11.<br />
Ouvrage <strong>de</strong> référence Raymond BLOCH, « Étrusques », p. 505.<br />
Article <strong>de</strong> presse Michel VASTEL, « Ici, Radio-Ghana… », p. A15.<br />
Périodique Robert P. ERICKSON, « La saga <strong>de</strong>s spermatozoï<strong>de</strong>s », p. 1006.<br />
Publication LA RÉGIONALE DE…, Les polluants dans la nature, p. 20.<br />
B.1 Pour les références du Web avec auteur connu<br />
1) Le prénom et le NOM du principal auteur,<br />
2) le « titre » <strong>de</strong> l’article,<br />
3) Web.<br />
B.2 Pour les références du Web avec auteur inconnu 34<br />
1) Le titre du site,<br />
2) le nom du site,<br />
3) Web.<br />
Exemples<br />
Web (avec auteur) Anne CRISINEL, « Des montres… », Web.<br />
Web (sans auteur) L’anglais, nouvelle langue, Le Temps, Web.<br />
C. Pour les sources audiovisuelles et électroniques<br />
Comme pour les imprimés, mais avec, en troisième lieu, le type <strong>de</strong> source (CD, DVD, vidéocassette,<br />
film) au lieu d’un numéro <strong>de</strong> page.<br />
Exemples<br />
CD Luc BROUILLET et coll., Comment faire un herbier, CD.<br />
Document audiovisuel José FOREST, La victime cachée, vidéocassette.<br />
D. Pour les œuvres anciennes<br />
Les références doivent être présentées en respectant le découpage interne du texte original.<br />
Deux situations peuvent être rencontrées :<br />
Exemples<br />
Œuvres en prose NOM <strong>de</strong> l’auteur, Titre <strong>de</strong> l’ouvrage, référence au livre en chiffres<br />
romains, et les références au chapitre et au paragraphe en chiffres arabes.<br />
HÉRODOTE, Histoires, V, 105.<br />
PLUTARQUE, Périclès, 13, 3.<br />
Œuvres en vers NOM <strong>de</strong> l’auteur, Titre <strong>de</strong> l’ouvrage, référence au livre ou au chant en<br />
chiffres romains, et les références au poème et au vers en chiffres arabes.<br />
HOMÈRE, L’Ilia<strong>de</strong>, III, 12–17.<br />
SOPHOCLE, Antigone, 675–680.<br />
31. En l’absence d’une bibliographie, il faudra bien sûr indiquer la référence au complet dans la note infrapaginale.<br />
32. Si l’un <strong>de</strong> ces éléments est trop long, n’écrire que les <strong>de</strong>ux ou trois premiers termes, suivis <strong>de</strong> points <strong>de</strong> suspension.<br />
33. Le nom <strong>de</strong> l’auteur se compose en majuscules ou, <strong>de</strong> préférence, en petites majuscules. (Voir aussi la note 35.)<br />
Lorsqu’il y a <strong>de</strong>ux auteurs ou plus, n’indiquez que le premier suivi <strong>de</strong> « et coll. », pour collègues, collaborateurs.<br />
(Par exemple, Anne BAGNÈRES et coll.) Cependant, dans la bibliographie, il faut retrouver le nom <strong>de</strong> chaque auteur.<br />
34. Le nom <strong>de</strong> l’auteur peut ne pas être affiché sur la page, même s’il y en a un. Vous pouvez le vérifier en cliquant sur le<br />
bouton droit <strong>de</strong> la souris et en activant la comman<strong>de</strong> Co<strong>de</strong> source ou Afficher la source. S’il y a un auteur, son nom<br />
sera indiqué dans les premières lignes <strong>de</strong> la fenêtre qui s’ouvrira, vis-à-vis <strong>de</strong> Author.
12 LES RÉFÉRENCES NORMES DE PRÉSENTATION<br />
E. Pour les communications personnelles ou conférences<br />
Écrire le prénom et le NOM <strong>de</strong> la personne rencontrée, le sujet traité et comm. pers. ou conférence.<br />
Exemple<br />
Pierre CHASTENAY, Le centre <strong>de</strong> l’univers, conférence.<br />
Jean TREMBLAY, La division cellulaire, comm. pers.<br />
Remarque<br />
Remarque S’il y a plusieurs références pour un même auteur ayant <strong>de</strong>s ouvrages ou <strong>de</strong>s<br />
articles différents au cours d’une même année d’édition, écrivez les lettres a,<br />
b, c… après le NOM <strong>de</strong> l’auteur.<br />
Exemple<br />
François POTHIER (a), « Des animaux… », p. 70.<br />
François POTHIER (b), « La voie lactée… », p. 80.<br />
François POTHIER (c), « Plus écologique que ça… », p. 100–101.<br />
Afin d’éviter les répétitions du nom <strong>de</strong>s auteurs et <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong>s références, surtout lorsque les références<br />
sont abondamment utilisées, utilisez l’une ou l’autre <strong>de</strong>s abréviations du tableau ci-<strong>de</strong>ssous, selon les cas.<br />
Tableau 4.2 Les abréviations dans les notes infrapaginales<br />
Abréviation Signification Utilisation<br />
Ibid. pour ibi<strong>de</strong>m<br />
(au même endroit)<br />
Id. pour i<strong>de</strong>m<br />
(le même)<br />
Op. cit. pour opere citato<br />
(ouvrage cité)<br />
Loc. cit. pour loco citato<br />
(article cité)<br />
Dans le cas <strong>de</strong> citations consécutives<br />
d’une même source.<br />
Dans le cas <strong>de</strong> citations consécutives<br />
du même auteur, dans <strong>de</strong>s ouvrages différents.<br />
Dans le cas <strong>de</strong> citations non consécutives<br />
d’un même auteur.<br />
Comme op. cit., mais pour <strong>de</strong>s citations<br />
provenant d’un périodique, d’un quotidien,<br />
d’un dictionnaire, d’une encyclopédie<br />
ou d’un site Web par exemple.
NORMES DE PRÉSENTATION LES RÉFÉRENCES 13<br />
Exemples d’utilisation <strong>de</strong>s règles d’abréviations dans les notes infrapaginales<br />
1. Pierre MAGNAN, La naine, p. 15. Première citation <strong>de</strong> cet auteur.<br />
2. Ibid., p. 27. La citation est consécutive, provenant <strong>de</strong><br />
l’auteur et <strong>de</strong> l’ouvrage cités en 1.<br />
3. Id., Le mystère <strong>de</strong> Séraphin Monge, p. 50. La citation est consécutive du même auteur,<br />
mais provient d’un autre ouvrage.<br />
4. Boris VIAN, L’herbe rouge, p. 21. Première citation <strong>de</strong> cet auteur.<br />
5. Id., L’automne à Pékin, p. 236. La citation provient <strong>de</strong> VIAN, cité en 4.<br />
6. Robert P. ERICKSON, « La saga <strong>de</strong>s<br />
spermatozoï<strong>de</strong>s », p. 1006.<br />
La citation provient d’une revue scientifique.<br />
7. P. MAGNAN, op. cit., p. 58. La citation provient du <strong>de</strong>rnier ouvrage <strong>de</strong><br />
MAGNAN cité dans les notes infrapaginales,<br />
soit Le mystère <strong>de</strong> Séraphin Monge, cité en 3.<br />
8. R. P. ERICKSON, loc. cit., p. 1008. La citation provient <strong>de</strong> l’auteur et <strong>de</strong> l’ouvrage<br />
cités en 6, mais la page est différente.<br />
9. Ibid., p. 1009. La citation provient <strong>de</strong> l’auteur et <strong>de</strong> l’article<br />
cités en 8.<br />
10. P. MAGNAN, op. cit., p. 53. La citation provient <strong>de</strong> l’auteur et <strong>de</strong> l’ouvrage<br />
cités en 7.<br />
11. Id., La naine, p. 13. La citation provient <strong>de</strong> l’auteur cité en 10, mais<br />
d’un ouvrage différent.<br />
Avez-vous déjà cité le<br />
même auteur dans ce<br />
travail ?<br />
OUI<br />
Donc, dans la note :<br />
Ibid., et page.<br />
Exemple<br />
Ibid., p. 27.<br />
OUI<br />
Cette citation vient-elle du<br />
même ouvrage que la<br />
citation précé<strong>de</strong>nte ?<br />
N<br />
O<br />
N<br />
O<br />
U<br />
I<br />
NON<br />
Donc, dans la note :<br />
Id., titre et page.<br />
Exemple<br />
Id., Le mystère <strong>de</strong> Séraphin<br />
Monge, p. 50.<br />
Indiquez la référence<br />
selon les <strong>Normes</strong>.<br />
Cette citation est-elle<br />
consécutive<br />
à une autre citation<br />
du même auteur ?<br />
OUI<br />
NON<br />
La citation est-elle tirée<br />
d’un livre ?<br />
Initiale et NOM <strong>de</strong> l’auteur,<br />
suivi <strong>de</strong> op. cit.,<br />
et <strong>de</strong> la page.<br />
Exemple<br />
P. MAGNAN, op. cit., p. 58.<br />
Figure 4.3 Arbre <strong>de</strong> décision<br />
NON<br />
Initiale et NOM <strong>de</strong> l’auteur,<br />
suivi <strong>de</strong> loc. cit.,<br />
et <strong>de</strong> la page.<br />
Exemple<br />
R. P. ERICKSON, loc. cit.,<br />
p. 1008.
14 PRÉSENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE NORMES DE PRÉSENTATION<br />
5. LA BIBLIOGRAPHIE ET LES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
Ce qui doit figurer dans la bibliographie, ce sont uniquement les sources utilisées qui apportent une<br />
véritable contribution à la réflexion et à la rédaction. Chaque référence dans votre travail doit correspondre<br />
à une notice dans la bibliographie et chaque notice bibliographique doit correspondre à<br />
une référence.<br />
La façon <strong>de</strong> rédiger les notices bibliographiques doit tenir compte <strong>de</strong> la façon dont vous avez indiqué les<br />
références dans votre travail.<br />
• Si les références sont dans le texte, la bibliographie sera composée selon la métho<strong>de</strong> auteur-année :<br />
l’année d’édition suit immédiatement le premier élément <strong>de</strong> la notice.<br />
• Si les références sont dans les notes infrapaginales, la bibliographie sera composée selon la<br />
métho<strong>de</strong> auteur-titre : l’année d’édition se trouve généralement à la fin <strong>de</strong> la notice bibliographique,<br />
mais précè<strong>de</strong> les pages citées.<br />
Chaque notice bibliographique doit comprendre les éléments suivants, lorsqu’ils sont présents dans<br />
l’ouvrage consulté :<br />
a) le NOM <strong>de</strong> l’auteur (en majuscules ou, mieux encore, en petites majuscules 35 ) et le prénom suivis<br />
d’une virgule ;<br />
b) « le titre <strong>de</strong> l’extrait » ou « le titre <strong>de</strong> l’article » entre guillemets, suivi d’une virgule ;<br />
c) le titre en italique <strong>de</strong> l’ouvrage, du périodique ou du quotidien, ou le nom du site consulté sur le<br />
Web ;<br />
d) les compléments bibliographiques, dans l’ordre suivant : l’adresse Web, le volume, le lieu d’édition,<br />
la maison d’édition, l’édition 36 , la collection, le tome, le numéro du volume, tous ces éléments étant<br />
séparés par une virgule ;<br />
e) d’autres compléments supplémentaires propres à <strong>de</strong>s notices bibliographiques particulières comme<br />
les documents audiovisuels, les CD et les références Web ;<br />
f) l’année ou la date d’édition. L’endroit où cette information sera placée dépend <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong><br />
utilisée : auteur-année (p. 15) ou auteur-titre (p. 18).<br />
Consignes générales<br />
Remarque Chacun <strong>de</strong> ces éléments est séparé par une virgule, le point final<br />
se trouvant à la fin <strong>de</strong> la notice seulement.<br />
• Dans une bibliographie, on indique le NOM et le prénom <strong>de</strong> chaque auteur. Notez qu’un auteur peut<br />
également être un organisme officiel 37 .<br />
• Lorsqu’il n’y a pas d’auteur, débutez par le titre (non guillemeté) 38 <strong>de</strong> l’extrait ou <strong>de</strong> l’article.<br />
• S’il y a un sous-titre, celui-ci est séparé du titre par un <strong>de</strong>ux-points.<br />
• Les notices bibliographiques doivent être présentées en ordre alphabétique. Si le premier élément <strong>de</strong> la<br />
notice est un titre d’article ou d’extrait, ne guillemetez pas le titre.<br />
• Certaines catégories <strong>de</strong> <strong>travaux</strong> exigent d’indiquer le nombre <strong>de</strong> pages <strong>de</strong> chaque ouvrage cité. Suivez<br />
alors les consignes <strong>de</strong> votre professeur à ce sujet.<br />
35. Pour écrire en petites majuscules, écrivez le nom avec majuscule et minuscules (Balzac, par exemple), sélectionnez<br />
le tout et, dans la comman<strong>de</strong> Format – Police <strong>de</strong> Word, vali<strong>de</strong>z l’option Petites majuscules.<br />
36. Seulement lorsqu’il s’agit d’une secon<strong>de</strong> édition ou d’une édition subséquente.<br />
37. Gouvernements ou organismes gouvernementaux, <strong>de</strong> quelque ordre qu’ils soient : pays, province, municipalité,<br />
université, cégep, etc.<br />
38. Lorsqu’on utilise la comman<strong>de</strong> <strong>de</strong> tri <strong>de</strong> Word, les éléments guillemetés viennent se placer en haut <strong>de</strong> la liste :<br />
ce n’est pas ce qui est souhaité.
NORMES DE PRÉSENTATION NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 15<br />
5.1 MÉTHODE AUTEUR–ANNÉE<br />
Pour les <strong>travaux</strong> généralement associés aux disciplines <strong>de</strong> sciences <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> psychologie.<br />
5.1.1 Livres et extraits <strong>de</strong> recueils<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
2. (Année d’édition),<br />
3. « Titre <strong>de</strong> l’extrait »,<br />
4. Titre <strong>de</strong> l’ouvrage : Sous-titre<br />
s’il y a lieu,<br />
5. Volume,<br />
6. Lieu d’édition,<br />
7. Maison d’édition,<br />
8. Édition,<br />
9. Collection,<br />
10. Tome ou numéro,<br />
11. Nombre <strong>de</strong> pages <strong>de</strong> l’ouvrage (facultatif 39 ).<br />
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHE DU CANADA (1980), Programme d’énergie éolienne, Ottawa, CNR.<br />
FONTAINE Jules (2007), <strong>Normes</strong> <strong>de</strong> <strong>présentation</strong> <strong>de</strong>s <strong>travaux</strong> <strong>écrits</strong>, Québec, <strong>Cégep</strong> <strong>de</strong> <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong>, 6 e éd.<br />
HUOT Richard et Gérard-Yvon ROY (1996), Chimie organique : Notions fondamentales : Exercices résolus,<br />
L’Ancienne-Lorette, Éditions Carcajou.<br />
KREISLER Léon (1976), L’enfant psychosomatique, Paris, Presses universitaires <strong>de</strong> France, coll. Que sais-je ?,<br />
n o 1669.<br />
Les cavernes les plus profon<strong>de</strong>s (1990), Le grand livre du mon<strong>de</strong>, Montréal, Sélection du Rea<strong>de</strong>r’s Digest, 3 e<br />
éd.<br />
SAINT-EXUPÉRY Antoine <strong>de</strong> (1959), « Lettre à un otage », Œuvres d’Antoine <strong>de</strong> Saint-Exupéry, Paris,<br />
Gallimard, Bibliothèque <strong>de</strong> la Pléia<strong>de</strong>.<br />
5.1.2 Articles <strong>de</strong> périodiques et <strong>de</strong> quotidiens 40<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
et/ou <strong>de</strong> l’agence <strong>de</strong> presse 41<br />
2. (Date d’édition),<br />
3. « Titre <strong>de</strong> l’article »,<br />
4. Titre du périodique ou du quotidien,<br />
5. Volume,<br />
6. Tome ou numéro,<br />
7. Pages couvertes par l’article.<br />
ARSENEAULT Michel (juil. 2003), « L’exception malgache », L’Actualité, vol. 28, n o 11, p. 42-46.<br />
BAGNÈRES Anne Geneviève, Marc OHRESSER, Alain LENOIR et Christine ERRARD (jan.–avril 2000),<br />
« La communication chimique », Pour la Science — Dossier Hors-Série, p. 26-32.<br />
FIORE Francine (juil.-août 2003), « Les infirmières au cœur du changement », L’Infirmière, vol. 10, n o 6,<br />
p. 23-25.<br />
PC (2 avril 2008), « Rappel d’aliments : l’Agence canadienne d’inspection admet les carences », Le Soleil, p. 10.<br />
POTHIER François (sept. 1998a), « Des animaux modifiés sur mesure », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs, vol. 81,<br />
n o 9, p. 67-79.<br />
POTHIER François (sept. 1998b), « La voie lactée <strong>de</strong> l’an 2000 », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs, vol. 81, n o 9,<br />
p. 80-81.<br />
SAFIRE William (9 avril 1994), « Don’t Worry, Just Be Peppy », Times Colonist (Victoria, BC), p. A5.<br />
TUN Aung (17 mai 2008), Reuters, « Birmanie : la pluie s’abat sur les rescapés », Le Devoir, p. A9, A11.<br />
VASTEL Michel (15 nov. 1995), « Ici, Radio-Ghana… », Le Soleil, p. A15.<br />
39. Deman<strong>de</strong>z à votre professeur s’il tient à ce que vous mettiez cette information.<br />
40. Dans le cas <strong>de</strong>s quotidiens, indiquez la ville d’origine du quotidien entre parenthèses, à moins que le titre ne le<br />
mentionne ou que ce ne soit vraiment évi<strong>de</strong>nt comme pour les journaux locaux (Le Soleil, La Presse, Le Devoir par<br />
exemple).<br />
41. Par exemple, AFP (Agence France-Presse), AP (Associated Press), CP (Canadian Press), PC (Presse canadienne),<br />
UPI (United Press International), Reuters, etc.
16 PRÉSENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE NORMES DE PRÉSENTATION<br />
5.1.3 Ouvrages <strong>de</strong> référence (atlas, dictionnaires, encyclopédies, etc.)<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
2. (Année d’édition),<br />
3. « Titre <strong>de</strong> l’article »,<br />
4. Titre <strong>de</strong> l’ouvrage,<br />
5. Volume,<br />
6. Lieu d’édition,<br />
7. Maison d’édition,<br />
8. Pages couvertes par l’article.<br />
BLOCH Raymond (1985), « Étrusques », Encyclopædia Universalis, Corpus 7, Paris, Encyclopædia Universalis,<br />
p. 503–509.<br />
EISNER J. D. et Victor W. SEIDEL (2001), « Folk medicine », The Encyclopedia Americana, vol. 11, Danburry<br />
(Conn.), Grolier, p. 498h-498i.<br />
Verne Jules 42 (1993), Axis : L’univers documentaire Hachette : dossiers, vol. 10, Paris, Hachette, p. 366–367.<br />
5.1.4 Web<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
2. (Date <strong>de</strong> consultation 43 ),<br />
3. « Titre <strong>de</strong> l’article »,<br />
4. Nom du site 44 ,<br />
5. Adresse du site 45 ,<br />
6. Le nombre <strong>de</strong> pages dans la référence.<br />
BROWN John C. (14 juin 1999), « What the Heck is a Virus ? », Bugs in the News, http://falcon.cc.ukans.<br />
edu/~jbrown/virus.html, 3 p.<br />
CRISINEL Anne (8 juin 1999), « Des montres dans toutes les cellules, du cerveau jusqu’au bout <strong>de</strong>s doigts »,<br />
Le Temps (Genève), http://letemps.ch/soc_3.htm, 2 p.<br />
GAUTHIER Philippe (23 juil. 1999), « Les Québécois, champions <strong>de</strong> la pollution lumineuse », Québec Science,<br />
http://QuebecScience.qc.ca/ Cyber/ 0.0/0_0_0.asp, 1 p.<br />
Le virus <strong>de</strong> Marburg, cousin <strong>de</strong> l’Ébola, refait surface (8 juin 1999), Le Temps (Genève), http://letemps.ch/<br />
soc_2.htm, 3 p.<br />
Ponctuation (1 er nov. 2007), Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Ponctuation, 4 p.<br />
The New Anglo (2 juil. 1999), The Montreal Gazette, www.montrealgazette.com, 1 p.<br />
5.1.5 Articles en ligne<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
et/ou <strong>de</strong> l’agence <strong>de</strong> presse 46<br />
2. (Date <strong>de</strong> publication <strong>de</strong> l’article),<br />
3. « Titre <strong>de</strong> l’article »,<br />
4. Nom du périodique,<br />
5. Base <strong>de</strong> données,<br />
6. Pages couvertes par l’article.<br />
COTTER John (5 mai 2008), « Hundreds of birds <strong>de</strong>ad in wasterwater, tip of iceberg », Winnipeg Free Press,<br />
dans Canadian Free Press, p. A13.<br />
PC (7 août 2006), « La lutte favorise la violence chez les jeunes », Le Soleil, dans Eureka, p. 12.<br />
42. Cet article traite <strong>de</strong> Jules Verne, qui n’est pas ici considéré comme l’auteur <strong>de</strong> l’article. Sans quoi son nom aurait été<br />
composé en petites majuscules.<br />
43. Indiquez soit la date <strong>de</strong> l’information que vous citez (le site Web d’un quotidien, par exemple), soit la date <strong>de</strong><br />
consultation du site, étant donné que les références électroniques sur un même site peuvent souvent être modifiées.<br />
44. Le nom d’un site Web est considéré sur le même plan que le titre d’un périodique ou d’un quotidien : on le met donc<br />
en italique. Si vous imprimez ces références pour une lecture future, indiquez le nombre <strong>de</strong> pages du document<br />
imprimé. Notez que Google et Yahoo ne sont pas <strong>de</strong>s noms <strong>de</strong> site, mais <strong>de</strong>s engins <strong>de</strong> recherche.<br />
45. Si l’adresse renferme les lettres www, il est inutile <strong>de</strong> faire précé<strong>de</strong>r l’adresse par http://. Pour supprimer le<br />
soulignement dans l’adresse, sélectionnez et soulignez l’adresse du site en même temps que du texte adjacent jusqu’à<br />
ce que le soulignement disparaisse. L’adresse ne doit pas être imprimée en couleur.<br />
46. Par exemple, AFP (Agence France-Presse, AP (Associated Press), CP (Canadian Press), PC (Presse canadienne),<br />
UPI (United Press International), Reuters, etc.
NORMES DE PRÉSENTATION NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 17<br />
5.1.6 CD, DVD et documents audiovisuels<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
2. (Année <strong>de</strong> production),<br />
3. « Titre <strong>de</strong> l’extrait »,<br />
4. Titre <strong>de</strong> l’ouvrage,<br />
Pour les documents audiovisuels<br />
9. Durée,<br />
10. Couleur ou n & b.<br />
Exemples<br />
5. Lieu d’édition,<br />
6. Maison d’édition,<br />
7. Collection,<br />
8. Type <strong>de</strong> document.<br />
BROUILLET Louis, Andrée LEMIEUX et Frédéric AMYOT (1994), « Comment faire un herbier », L’Herbier<br />
Marie-Victorin, Montréal, Micro-Intel et les Amis du Jardin botanique <strong>de</strong> Montréal, CD.<br />
DRISSEN Laurent (2008), « L’univers extragalactique : Le zoo cosmique », Cours d’astronomie, Québec,<br />
Université Laval, DVD 47 .<br />
FOREST José (1992), La victime cachée, Montréal, Projet Image/Recherche Alzheimer, vidéocassette VHS,<br />
38 min, couleur.<br />
FORTIER Louis (1997), Andromè<strong>de</strong>, le ciel profond, Saint-Laurent, Éditions du Renouveau pédagogique, CD.<br />
OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA (1971), Propos sur l’immunité, Ottawa, ONF, film<br />
cinématographique 16 mm, 13 min, couleur.<br />
5.1.7 Œuvres anciennes<br />
Les consignes sont les mêmes que pour les livres et recueils, sauf que l’on doit ajouter le nom <strong>de</strong> celui qui a<br />
établi et traduit le texte original.<br />
Exemples<br />
EURIPIDE (1923), Héraclès, texte établi et traduit par L. Parmentier et H. Grégoire, Paris, Les Belles Lettres.<br />
HÉSIODE (1928), Théogonie, texte établi et traduit par P. Mazon, Paris, Les Belles Lettres.<br />
SÉNÈQUE (2004), La vie heureuse, traduction, introduction et notes <strong>de</strong> Martial Bouchard, Québec,<br />
Éditions Carpe Diem.<br />
5.1.8 Fiches techniques : Peintures, estampes et affiches ; Sculptures ;<br />
Œuvres architecturales ; Objets<br />
Consultez l’annexe B (p. 26–27).<br />
5.1.9 Communications personnelles et conférences<br />
Exemple<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> la personne<br />
ressource<br />
2. (Date <strong>de</strong> la rencontre),<br />
3. « Objet <strong>de</strong> la rencontre »,<br />
4. Statut <strong>de</strong> la personne ou <strong>de</strong>s personnes,<br />
5. Appartenance,<br />
6. Communication personnelle ou conférence.<br />
CHASTENAY Pierre (1 er mai 2008), « Le centre <strong>de</strong> l’univers », Université Laval, conférence.<br />
TREMBLAY Jean (6 mars 2008), « La division cellulaire », chercheur au département <strong>de</strong> biologie,<br />
Université Laval, communication personnelle.<br />
47. Il s’agit ici d’un DVD <strong>de</strong> données. Il n’y a donc pas <strong>de</strong> durée à signaler.
18 PRÉSENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE NORMES DE PRÉSENTATION<br />
5.2 MÉTHODE AUTEUR–TITRE<br />
Pour les <strong>travaux</strong> généralement associés aux disciplines autres que celles <strong>de</strong> sciences <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong><br />
psychologie.<br />
5.2.1 Livres et extraits <strong>de</strong> recueil<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur,<br />
2. « Titre <strong>de</strong> l’extrait »,<br />
3. Titre <strong>de</strong> l’ouvrage : Sous-titre<br />
s’il y a lieu,<br />
4. Volume,<br />
5. Lieu d’édition,<br />
6. Maison d’édition,<br />
7. Édition<br />
8. Collection,<br />
9. Tome ou numéro,<br />
10. Année d’édition,<br />
11. Nombre <strong>de</strong> pages <strong>de</strong> l’ouvrage (facultatif 48 ).<br />
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHE DU CANADA, Programme d’énergie éolienne, Ottawa, CNR, 1980.<br />
FONTAINE Jules, <strong>Normes</strong> <strong>de</strong> <strong>présentation</strong> <strong>de</strong>s <strong>travaux</strong> <strong>écrits</strong>, Québec, <strong>Cégep</strong> <strong>de</strong> <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong>, 6 e éd., 2007.<br />
HUOT Richard et Gérard-Yvon ROY, Chimie organique : Notions fondamentales : Exercices résolus,<br />
L’Ancienne-Lorette, Éditions Carcajou, 1996.<br />
KREISLER Léon, L’enfant psychosomatique, Paris, Presses universitaires <strong>de</strong> France, coll. Que sais-je ?, n o 1669,<br />
1976.<br />
Les cavernes les plus profon<strong>de</strong>s, Le grand livre du mon<strong>de</strong>, Montréal, Sélection du Rea<strong>de</strong>r’s Digest, 3 e<br />
éd., 1990.<br />
SAINT-EXUPÉRY Antoine <strong>de</strong>, « Lettre à un otage », Œuvres d’Antoine <strong>de</strong> Saint-Exupéry, Paris, Gallimard,<br />
Bibliothèque <strong>de</strong> la Pléia<strong>de</strong>, 1959.<br />
5.2.2 Articles <strong>de</strong> périodiques ou <strong>de</strong> quotidiens 49<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur,<br />
et/ou <strong>de</strong> l’agence <strong>de</strong> presse 50 ,<br />
2. « Titre <strong>de</strong> l’article »,<br />
3. Titre du périodique ou du quotidien,<br />
4. Volume,<br />
5. Numéro,<br />
6. Date d’édition,<br />
7. Pages couvertes par l’article.<br />
ARSENEAULT Michel, « L’exception malgache », L’Actualité, vol. 28, n o 11, juil. 2003, p. 42-46.<br />
BAGNÈRES Anne Geneviève, Marc OHRESSER, Alain LENOIR et Christine ERRARD, « La communication<br />
chimique », Pour la Science — Dossier Hors-Série, jan.–avril 2000, p. 26-32.<br />
FIORE Francine, « Les infirmières au cœur du changement », L’Infirmière, vol. 10, n o 6, juil./août 2003,<br />
p. 23–25.<br />
PC, « Rappel d’aliments : l’Agence canadienne d’inspection admet les carences », Le Soleil, 2 avril 2008, p. 10.<br />
POTHIER François (a), « Des animaux modifiés sur mesure », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs, vol. 81, n o 9,<br />
sept. 1998, p. 67-79.<br />
POTHIER François (b), « La voie lactée <strong>de</strong> l’an 2000 », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs, vol. 81, n o 9, sept. 1998,<br />
p. 80-81.<br />
SAFIRE William, « Don’t Worry, Just Be Peppy », Times Colonist, (Victoria, BC), 9 avr. 1994, p. A5.<br />
TUN Aung, Reuters, « Birmanie : la pluie s’abat sur les rescapés », Le Devoir, 17 mai 2008, p. A9, A11.<br />
VASTEL Michel, « Ici, Radio-Ghana… », Le Soleil, 15 nov. 1995, p. A15.<br />
48. Deman<strong>de</strong>z à votre professeur s’il souhaite avoir cette information.<br />
49. Dans le cas <strong>de</strong>s quotidiens, indiquez la ville d’origine du quotidien entre parenthèses, à moins que le titre ne le<br />
mentionne ou que ce ne soit vraiment évi<strong>de</strong>nt comme pour les journaux locaux (Le Soleil, La Presse, Le Devoir par<br />
exemple.)<br />
50. Par exemple, AFP (Agence France-Presse), AP (Associated Press), CP (Canadian Press), PC (Presse canadienne),<br />
UPI (United Press International), Reuters, etc.
NORMES DE PRÉSENTATION NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 19<br />
5.2.3 Ouvrages <strong>de</strong> référence (atlas, dictionnaires, encyclopédies, etc.)<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur,<br />
2. « Titre <strong>de</strong> l’article »,<br />
3. Titre <strong>de</strong> l’ouvrage,<br />
4. Volume,<br />
5. Lieu d’édition,<br />
6. Maison d’édition,<br />
7. Année d’édition,<br />
8. Pages couvertes par l’article.<br />
BLOCH Raymond, « Étrusques », Encyclopædia Universalis, Corpus 7, Paris, Encyclopædia Universalis, 1985,<br />
p. 503–509.<br />
EISNER J. D. et Victor W. SEIDEL, « Folk medicine », The Encyclopedia Americana, vol. 11, Danburry<br />
(Conn.), Grolier, p. 498h-498i.<br />
SANDEEN Eric J., « Ellis Island », Encyclopedia of American Studies, vol. 2, New York, Grolier Educational,<br />
2001, p. 79-82.<br />
Verne Jules 51 , Axis : L’univers documentaire Hachette : dossiers, vol. 10, Paris, Hachette, p. 366–367.<br />
5.2.4 Web<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur,<br />
2. « Titre <strong>de</strong> l’article »,<br />
3. Nom du site 52 ,<br />
4. Adresse du site,<br />
5. Date <strong>de</strong> consultation 53 ,<br />
6. Le nombre <strong>de</strong> pages dans la référence.<br />
BROWN John C., « What the Heck is a Virus ? », Bugs in the News, http://falcon.cc.ukans.<br />
edu/~jbrown/virus.html, 14 juin 1999, 3 p.<br />
CRISINEL Anne, « Des montres dans toutes les cellules, du cerveau jusqu’au bout <strong>de</strong>s doigts »,<br />
Le Temps (Genève), http://letemps.ch/soc_3.htm, 8 juin 1999, 2 p.<br />
GAUTHIER Philippe, « Les Québécois, champions <strong>de</strong> la pollution lumineuse », Québec Science,<br />
http://QuebecScience.qc.ca/Cyber/0.0/0_0_0.asp, 23 juil. 1999, 1 p.<br />
Le virus <strong>de</strong> Marburg, cousin <strong>de</strong> l’Ébola, refait surface, Le Temps (Genève), http://letemps. ch/soc_2.htm,<br />
8 juin 1999, 3 p.<br />
Ponctuation, Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Ponctuation, 1 er nov. 2007, 4 p.<br />
The New Anglo, The Montreal Gazette, www.montrealgazette.com/, 2 juil. 1999, 1 p.<br />
5.2.5 Articles en ligne<br />
Exemples<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
et/ou <strong>de</strong> l’agence <strong>de</strong> presse,<br />
2. « Titre <strong>de</strong> l’article »,<br />
3. Nom du périodique,<br />
4. Base <strong>de</strong> données,<br />
5. Date <strong>de</strong> publication <strong>de</strong> l’article,<br />
6. Pages couvertes par l’article.<br />
COTTER John, « Hundreds of birds <strong>de</strong>ad in wasterwater, tip of iceberg », Winnipeg Free Press, dans Canadian<br />
Free Press, 5 mai 2008, p. A13.<br />
PC, « La lutte favorise la violence chez les jeunes », Le Soleil, dans Eureka, 7 août 2006, p. 12.<br />
51. Cet article traite <strong>de</strong> Jules Verne, qui n’est pas ici considéré comme l’auteur <strong>de</strong> l’article. Sans quoi son nom aurait été<br />
composé en petites majuscules.<br />
52. Le nom d’un site Web est considéré sur le même plan que le titre d’un périodique ou d’un quotidien : on le met donc<br />
en italique. Si vous imprimez ces références pour une lecture future, indiquez le nombre <strong>de</strong> pages du document<br />
imprimé. Notez que Google et Yahoo ne sont pas <strong>de</strong>s noms <strong>de</strong> site, mais <strong>de</strong>s engins <strong>de</strong> recherche.<br />
53. Indiquez soit la date <strong>de</strong> l’information que vous citez (le site Web d’un quotidien, par exemple), soit la date <strong>de</strong><br />
consultation du site, étant donné que les références électroniques sur un même site peuvent souvent être modifiées.
20 PRÉSENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE NORMES DE PRÉSENTATION<br />
5.2.6 CD, DVD et documents audiovisuels<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur,<br />
2. « Titre <strong>de</strong> l’extrait »,<br />
3. Titre <strong>de</strong> l’ouvrage,<br />
4. Lieu d’édition,<br />
Pour les documents audiovisuels<br />
9. Durée,<br />
10. Couleur ou n & b.<br />
Exemples<br />
5. Maison d’édition,<br />
6. Collection,<br />
7. Année <strong>de</strong> production<br />
8. Type <strong>de</strong> document.<br />
BROUILLET Louis, Andrée LEMIEUX et Frédéric AMYOT, « Comment faire un herbier », L’Herbier Marie-<br />
Victorin, Montréal, Micro-Intel et les Amis du Jardin botanique <strong>de</strong> Montréal, 1994, CD.<br />
DRISSEN Laurent, « L’univers extragalactique : Le zoo cosmique », Cours d’astronomie, Québec, Université<br />
Laval, 2008, DVD 54 .<br />
FOREST José, La victime cachée, Montréal, Projet Image/Recherche Alzheimer, 1992, vidéocassette VHS,<br />
38 min, couleur.<br />
FORTIER Louis, Andromè<strong>de</strong>, le ciel profond, Saint-Laurent, Éditions du Renouveau pédagogique,1997, CD.<br />
OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA, Propos sur l’immunité, Ottawa, ONF, 1971, film cinématographique<br />
16 mm, 13 min, couleur.<br />
5.2.7 Œuvres anciennes<br />
Les consignes sont les mêmes que pour les livres et recueils, sauf que l’on doit ajouter le nom <strong>de</strong> celui qui a<br />
établi et traduit le texte original.<br />
Exemples<br />
EURIPIDE, Héraclès, texte établi et traduit par L. Parmentier et H. Grégoire, Paris, Les Belles Lettres, 1923.<br />
HÉSIODE, Théogonie, texte établi et traduit par P. Mazon, Paris, Les Belles Lettres, 1928.<br />
SÉNÈQUE, La vie heureuse, traduction, introduction et notes <strong>de</strong> Martial Bouchard, Québec, Éditions Carpe<br />
Diem, 2004.<br />
5.2.8 Fiches techniques : Peintures, estampes et affiches ; Sculptures ;<br />
Œuvres architecturales ; Objets<br />
Consultez l’annexe B (p. 26–27).<br />
5.2.9 Communications personnelles et conférences<br />
Exemple<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> la personne ressource<br />
2. « Objet <strong>de</strong> la rencontre »,<br />
3. Statut <strong>de</strong> la personne ressource,<br />
4. Appartenance,<br />
5. Date <strong>de</strong> la rencontre,<br />
6. Communication personnelle ou conférence.<br />
CHASTENAY Pierre, « Le centre <strong>de</strong> l’univers », Université Laval, 1 er mai 2008, conférence.<br />
TREMBLAY Jean, « La division cellulaire », chercheur au département <strong>de</strong> biologie, Université Laval,<br />
6 mars 2008, communication personnelle.<br />
54. Il s’agit ici d’un DVD <strong>de</strong> données. Il n’y a donc pas <strong>de</strong> durée à signaler.
NORMES DE PRÉSENTATION PRÉSENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE 21<br />
6. LA PRÉSENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE<br />
Deux possibilités s’offrent à vous 55 :<br />
1. regrouper toutes les références ensemble, par ordre alphabétique d’auteurs, comme ci-<strong>de</strong>ssous ;<br />
2. présenter la bibliographie en tenant compte <strong>de</strong>s catégories <strong>de</strong> références (livres, périodiques,<br />
Web, etc.), comme à la page suivante.<br />
6.1 REGROUPEMENT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE<br />
6.1.1 Selon la métho<strong>de</strong> auteur-année<br />
(lorsque les références sont indiquées directement dans le texte)<br />
BAGNÈRES Anne Geneviève, Marc OHRESSER, Alain LENOIR et Christine ERRARD (jan.–avril<br />
2000), « La communication chimique », Pour la Science — Dossier Hors-Série, p. 26-32.<br />
BROUILLET Louis, Andrée LEMIEUX et Frédéric AMYOT (1994), « Comment faire un herbier »,<br />
L’Herbier Marie-Victorin, Montréal, Micro-Intel et les Amis du Jardin botanique <strong>de</strong> Montréal,<br />
CD.<br />
FORTIER Louis (1997), Andromè<strong>de</strong>, le ciel profond, Saint-Laurent, Éditions du Renouveau pédagogique,<br />
CD.<br />
Le virus <strong>de</strong> Marburg, cousin <strong>de</strong> l’Ébola, refait surface (8 juin 1999), Le Temps (Genève),<br />
http://letemps.ch/soc_2.htm, 3 p.<br />
POTHIER François (sept. 1998a), « Des animaux modifiés sur mesure », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs,<br />
vol. 81, n o 9, p. 67-79.<br />
POTHIER François (sept. 1998b), « La voie lactée <strong>de</strong> l’an 2000 », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs, vol. 81,<br />
n o 9, p. 80-81.<br />
SAINT-EXUPÉRY Antoine <strong>de</strong> (1959), Œuvres d’Antoine <strong>de</strong> Saint-Exupéry, Paris, Gallimard,<br />
Bibliothèque <strong>de</strong> la Pléia<strong>de</strong>.<br />
SANDEEN Eric J. (2001), « Ellis Island », Encyclopedia of American Studies, vol. 2, New York,<br />
Grolier Educational, p. 79–82.<br />
SÉNÈQUE (2004), La vie heureuse, traduction, introduction et notes <strong>de</strong> Martial Bouchard, Québec,<br />
Éditions Carpe Diem.<br />
6.1.2 Selon la métho<strong>de</strong> auteur-titre<br />
(lorsque les références sont données dans les notes infrapaginales)<br />
BAGNÈRES Anne Geneviève, Marc OHRESSER, Alain LENOIR et Christine ERRARD, « La<br />
communication chimique », Pour la Science — Dossier Hors-Série, jan.–avril 2000, p. 26-32.<br />
BROUILLET Louis, Andrée LEMIEUX et Frédéric AMYOT, « Comment faire un herbier », L’Herbier<br />
Marie-Victorin, Montréal, Micro-Intel et les Amis du Jardin botanique <strong>de</strong> Montréal, 1994, CD.<br />
FORTIER Louis, Andromè<strong>de</strong>, le ciel profond, Saint-Laurent, Éditions du Renouveau pédagogique,<br />
1997, CD.<br />
Le virus <strong>de</strong> Marburg, cousin <strong>de</strong> l’Ébola, refait surface, Le Temps (Genève),<br />
http://letemps.ch/soc_2.htm, 8 juin 1999, 3 p.<br />
POTHIER François, « Des animaux modifiés sur mesure », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs, vol. 81, n o 9,<br />
sept. 1998a, p. 67-79.<br />
POTHIER François, « La voie lactée <strong>de</strong> l’an 2000 », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs, vol. 81, n o 9,<br />
sept. 1998b, p. 80-81.<br />
SAINT-EXUPÉRY Antoine <strong>de</strong>, « Lettre à un otage », Œuvres d’Antoine <strong>de</strong> Saint-Exupéry, Paris,<br />
Gallimard, Bibliothèque <strong>de</strong> la Pléia<strong>de</strong>, 1959, p. 389–405.<br />
SANDEEN Eric J., « Ellis Island », Encyclopedia of American Studies, vol. 2, New York, Grolier<br />
Educational, 2001, p. 79-82.<br />
SÉNÈQUE, La vie heureuse, traduction, introduction et notes <strong>de</strong> Martial Bouchard, Québec, Éditions<br />
Carpe Diem, 2004.<br />
55. Informez-vous auprès <strong>de</strong> votre professeur pour connaître ses exigences.
22 PRÉSENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE NORMES DE PRÉSENTATION<br />
6.2 REGROUPEMENT PAR CATÉGORIES DE RÉFÉRENCES 56<br />
A. Les imprimés<br />
• Livres<br />
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHE DU CANADA, Programme d’énergie éolienne, Ottawa, CNR, 1980.<br />
PRÉVERT Jacques, Histoires, Paris, Éditions Gallimard, coll. Le livre <strong>de</strong> poche, n o 1525, 1963.<br />
• Articles <strong>de</strong> périodiques<br />
POTHIER François, « Des animaux modifiés sur mesure », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs, vol. 81, n o 9,<br />
sept. 1998a, p. 67-79.<br />
POTHIER François, « La voie lactée <strong>de</strong> l’an 2000 », Le bulletin <strong>de</strong>s agriculteurs, vol. 81, n o 9, sept. 1998b,<br />
p. 80-81.<br />
• Articles <strong>de</strong> presse<br />
SAFIRE William, « Don’t Worry, Just Be Peppy », Times Colonist (Victoria, BC), 9 avril 1994, p. A5.<br />
VASTEL Michel, « Ici, Radio-Ghana… », Le Soleil, 15 nov. 1995, p. A15.<br />
• Œuvres anciennes<br />
SÉNÈQUE, La vie heureuse, traduction, introduction et notes <strong>de</strong> Martial Bouchard, Québec, Éditions Carpe<br />
Diem, 2004.<br />
• Ouvrages <strong>de</strong> référence<br />
BLOCH Raymond, « Étrusques », Encyclopædia Universalis, Corpus 7, Paris, Encyclopædia Universalis, 1985,<br />
p. 503–509.<br />
SANDEEN Eric J., « Ellis Island », Encyclopedia of American Studies, vol. 2, New York, Grolier Educational,<br />
2001, p. 79-82.<br />
B. Les documents audiovisuels, électroniques et en ligne<br />
• CD, DVD<br />
BROUILLET Louis, Andrée LEMIEUX et Frédéric AMYOT, « Comment faire un herbier », L’Herbier Marie-<br />
Victorin, Montréal, Micro-Intel et les Amis du Jardin botanique <strong>de</strong> Montréal, 1994, CD.<br />
DRISSEN Laurent, « L’univers extra-galactique : Le zoo cosmique », Cours d’astronomie, Québec, Université<br />
Laval, 2008, DVD.<br />
C. Web<br />
Les meilleurs endroits pour observer les oiseaux au Québec, Les oiseaux du Québec, http://ntic.qc.ca/<br />
~nellus/sitefran.html., 20 juin 1996, 5 p.<br />
• Articles en ligne<br />
COTTER John, « Hundreds of birds <strong>de</strong>ad in wasterwater, tip of iceberg », Winnipeg Free Press, dans Canadian<br />
Free Press, 5 mai 2008, p. A13.<br />
D. Fiches techniques<br />
• Objets<br />
TIFFANY Louis Comfort (1848-1933), Vase, vers 1900, verre irisé, hauteur 45 cm, Munich, Bayerisches<br />
Nationalmuseum, tiré <strong>de</strong> SEMBACH Klaus-Jürgen, L’art nouveau : L’utopie <strong>de</strong> la réconciliation, Cologne,<br />
Taschen, 1999, p. 14.<br />
• Sculptures<br />
BRANCUSI Constantin (1876-1957), L'oiseau dans l'espace, 1928, bronze, 137,2 cm, New York, MoMA, tiré <strong>de</strong><br />
MoMA, The Museum of Mo<strong>de</strong>rn Art, www.moma.org/collection/browse_results.php? object_id=81033,<br />
27 juin 2007.<br />
56. À l’exception <strong>de</strong>s fiches techniques qui se composent toujours selon la métho<strong>de</strong> décrite dans l’annexe B, tous les<br />
exemples ci-<strong>de</strong>ssus suivent la métho<strong>de</strong> auteur-titre. Si vous avez appliqué la métho<strong>de</strong> auteur-année, il faudra<br />
composer votre bibliographie en tenant compte <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> présentée dans la section 5.1, p. 15–17.
NORMES DE PRÉSENTATION 23<br />
La réfutation <strong>de</strong> la théorie <strong>de</strong> la génération spontanée<br />
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam<br />
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam<br />
erat volutpat.<br />
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation<br />
ullamcorper suscipit loborti. At vero eros et accumsan et iusto odio<br />
dignissim.<br />
Nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure<br />
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.<br />
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse<br />
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero<br />
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum<br />
zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<br />
Nam liber tempor. Cum soluta nobis eleifend option congue nihil<br />
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.<br />
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper<br />
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.<br />
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse<br />
molestie consequat, vel illum dolore.<br />
Eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio<br />
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore<br />
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer<br />
adipiscing.<br />
Elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore<br />
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis<br />
nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex<br />
ea commodo consequat.<br />
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse<br />
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero<br />
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent<br />
luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<br />
Figure A.5<br />
Présentation <strong>de</strong>s paragraphes dans un tapuscrit<br />
(espacement interparagraphe significatif)<br />
ANNEXE A<br />
FIGURES CITÉES EN EXEMPLES<br />
2,5 cm<br />
2,5 cm<br />
2 cm<br />
3 cm 3 cm<br />
Figure A.4<br />
Les marges à respecter dans un tapuscrit<br />
7<br />
1<br />
La réfutation <strong>de</strong> la théorie <strong>de</strong> la génération spontanée<br />
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam<br />
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam<br />
erat volutpat.<br />
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation<br />
ullamcorper suscipit loborti. At vero eros et accumsan et iusto odio<br />
dignissim.<br />
Nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum<br />
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.<br />
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit<br />
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at<br />
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent<br />
luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<br />
Nam liber tempor. Cum soluta nobis eleifend option congue nihil<br />
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.<br />
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper<br />
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.<br />
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse<br />
molestie consequat, vel illum dolore.<br />
Eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio<br />
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore<br />
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer<br />
adipiscing.<br />
Elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore<br />
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis<br />
nostrud exerci tation ullam corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex<br />
ea commodo consequat.<br />
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit<br />
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at<br />
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent<br />
luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<br />
Figure A.6<br />
Présentation <strong>de</strong>s paragraphes dans un tapuscrit<br />
(espacement interparagraphe non significatif)<br />
7
24 ANNEXE A NORMES DE PRÉSENTATION<br />
Heidi BAUMAN<br />
Florence BOUCHARD<br />
Adora MARCHAND<br />
Jean ROSTAND<br />
Groupe 0012<br />
TABLE DES MATIÈRES<br />
INTRODUCTION-------------------------------------------------------- 1<br />
1. Description <strong>de</strong> la situation actuelle--------------------------- 2<br />
1.1 Importance relative du phénomène <strong>de</strong>s thérapies douces 3<br />
1.1.1 Dans la pratique privée----------------------------------------- 3<br />
1.1.2. Dans les CLSC--------------------------------------------------- 4<br />
1.1.3 Dans le milieu hospitalier-------------------------------------- 5<br />
2. Cadre juridique <strong>de</strong>s approches alternatives dans la<br />
pratique infirmière----------------------------------------------- 6<br />
3. Impacts sur la profession--------------------------------------- 8<br />
3.1 Aspects positifs -------------------------------------------------- 8<br />
3.2 Aspects négatifs ------------------------------------------------- 9<br />
4. Position <strong>de</strong>s infirmières comme groupe--------------------- 11<br />
4.1 Position <strong>de</strong> l’Ordre <strong>de</strong>s infirmiers et infirmières<br />
du Québec (OIIQ) ----------------------------------------------- 12<br />
4.2 Position <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong>s infirmiers<br />
et infirmières du Québec (FIIQ) ------------------------------ 12<br />
CONCLUSION ----------------------------------------------------------- 15<br />
BIBLIOGRAPHIE ------------------------------------------------------- 15<br />
LISTE DES ABRÉVIATIONS ---------------------------------------- ii<br />
LISTE DES ANNEXES<br />
Annexe I Article 43 <strong>de</strong> la Loi médicale ----------------------------- 18<br />
Annexe II Article 47 <strong>de</strong> la Loi sur les infirmières ------------------ 19<br />
LISTE DES FIGURES<br />
Figure 1 Nombre d’infirmières utilisant <strong>de</strong>s thérapies<br />
douces dans les hôpitaux du Québec--------------------- 5<br />
LISTE DES TABLEAUX<br />
Tableau 1 Participation <strong>de</strong>s différentes professions dans le<br />
mouvement <strong>de</strong>s thérapies douces------------------------- 3<br />
Tableau 2 Nombre d’infirmières percevant <strong>de</strong>s obstacles à<br />
l’intégration <strong>de</strong>s thérapies douces------------------------ 10<br />
Figure A.8<br />
Table <strong>de</strong>s matières selon le modèle numérique<br />
i<br />
Les propriétés cancérigènes du tabac<br />
chez l’être humain<br />
Travail présenté à madame Rita VALLÉE<br />
Structure et fonctions <strong>de</strong>s pluricellulaires<br />
101–FYA–04<br />
Département <strong>de</strong> biologie<br />
Programme <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> la nature<br />
<strong>Cégep</strong> <strong>de</strong> <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong><br />
29 février 2008<br />
Figure A.7<br />
Page <strong>de</strong> titre<br />
TABLE DES MATIÈRES<br />
INTRODUCTION ------------------------------------------------------- 1<br />
I. Description <strong>de</strong> la situation actuelle ---------------------------- 2<br />
A. Importance relative du phénomène <strong>de</strong>s thérapies douces-- 3<br />
1. Dans la pratique privée------------------------------------------- 3<br />
2. Dans les CLSC----------------------------------------------------- 4<br />
3. Dans le milieu hospitalier---------------------------------------- 5<br />
II. Cadre juridique <strong>de</strong>s approches alternatives dans la<br />
pratique infirmière ------------------------------------------------ 6<br />
III. Impacts sur la profession ---------------------------------------- 8<br />
A. Aspects positifs---------------------------------------------------- 8<br />
B. Aspects négatifs --------------------------------------------------- 9<br />
IV. Position <strong>de</strong>s infirmières comme groupe----------------------- 11<br />
A. Position <strong>de</strong> l’Ordre <strong>de</strong>s infirmiers et infirmières<br />
du Québec (OIIQ) ------------------------------------------------- 12<br />
B. Position <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong>s infirmiers et infirmières du<br />
Québec (FIIQ) ----------------------------------------------------- 12<br />
CONCLUSION----------------------------------------------------------- 15<br />
BIBLIOGRAPHIE ------------------------------------------------------- 15<br />
LISTE DES ABRÉVIATIONS ---------------------------------------- ii<br />
LISTE DES ANNEXES<br />
Annexe I Article 43 <strong>de</strong> la Loi médicale ----------------------------- 18<br />
Annexe II Article 47 <strong>de</strong> la Loi sur les infirmières et infirmiers-- 19<br />
LISTE DES FIGURES<br />
Figure 1 Nombre d’infirmières utilisant <strong>de</strong>s thérapies<br />
douces dans les hôpitaux du Québec -------------------- 5<br />
LISTE DES TABLEAUX<br />
Tableau 1 Participation <strong>de</strong>s différentes professions dans le<br />
mouvement <strong>de</strong>s thérapies douces ------------------------ 3<br />
Tableau 2 Nombre d’infirmières percevant <strong>de</strong>s obstacles à<br />
l’intégration <strong>de</strong>s thérapies douces------------------------ 10<br />
<strong>de</strong>s thérapies douces dans les centres hospitaliers ---- 10<br />
Figure A.9<br />
Table <strong>de</strong>s matières selon le modèle classique<br />
i
NORMES DE PRÉSENTATION ANNEXE A 25<br />
1. LA PHYSIOLOGIE BACTÉRIENNE<br />
1.1 LES BESOINS NUTRITIFS DES BACTÉRIES<br />
1.1.1 LES ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES<br />
1.1.2 LES ALIMENTS CONSTITUTIFS<br />
1.1.3 LES ALIMENTS SPÉCIFIQUES<br />
1.1.3.1 Les vitamines<br />
1.1.3.2 Les aci<strong>de</strong>s aminés<br />
1.2 LES BESOINS PHYSICO-CHIMIQUES<br />
1.2.1 LA TEMPÉRATURE<br />
1.2.2 L’OXYGÈNE<br />
1.2.2.1 Les bactéries aérobies<br />
1.2.2.2 Les bactéries anaérobies<br />
2. REPRODUCTION ET CROISSANCE<br />
2.1 LA REPRODUCTION BACTÉRIENNE<br />
2.1.1 LA DIVISION CELLULAIRE<br />
2.2 LA COURBE DE CROISSANCE<br />
2.2.1 LE CONCEPT DE CROISSANCE<br />
2.2.2 LE CYCLE NORMAL DE CROISSANCE<br />
2.2.2.1 Phase <strong>de</strong> latence<br />
2.2.2.2 Phase exponentielle<br />
2.2.2.3 Phase stationnaire<br />
2.2.2.4 Phase <strong>de</strong> déclin<br />
I. LA PHYSIOLOGIE BACTÉRIENNE<br />
A. LES BESOINS NUTRITIFS DES BACTÉRIES<br />
1. LES ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES<br />
2. LES ALIMENTS CONSTITUTIFS<br />
3. LES ALIMENTS SPÉCIFIQUES<br />
a. Les vitamines<br />
b. Les aci<strong>de</strong>s aminés<br />
B. LES BESOINS PHYSICO-CHIMIQUES<br />
1. LA TEMPÉRATURE<br />
2. L’OXYGÈNE<br />
a. Les bactéries aérobies<br />
b. Les bactéries anaérobies<br />
II. REPRODUCTION ET CROISSANCE<br />
A. LA REPRODUCTION BACTÉRIENNE<br />
1. LA DIVISION CELLULAIRE<br />
B. LA COURBE DE CROISSANCE<br />
1. LE CONCEPT DE CROISSANCE<br />
2. LE CYCLE NORMAL DE CROISSANCE<br />
a. Phase <strong>de</strong> latence<br />
b. Phase exponentielle<br />
c. Phase stationnaire<br />
d. Phase <strong>de</strong> déclin<br />
Figure A.10 Figure A.11<br />
Numérotation <strong>de</strong>s titres et intertitres Numérotation <strong>de</strong>s titres et intertitres<br />
selon le modèle numérique selon le modèle classique<br />
Note : On constate, dans le modèle numérique surtout, que les jalons énumératifs <strong>de</strong>s intertitres <strong>de</strong> quatrième niveau alourdissent<br />
la <strong>présentation</strong>. Il est permis <strong>de</strong> ne pas mettre ces énumérations. C’est ce qu’illustre la figure ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
1. LA PHYSIOLOGIE BACTÉRIENNE<br />
1.1 LES BESOINS NUTRITIFS DES BACTÉRIES<br />
1.1.1 LES ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES<br />
1.1.2 LES ALIMENTS CONSTITUTIFS<br />
1.1.3 LES ALIMENTS SPÉCIFIQUES<br />
Les vitamines<br />
Les aci<strong>de</strong>s aminés<br />
1.2 LES BESOINS PHYSICO-CHIMIQUES<br />
1.2.1 LA TEMPÉRATURE<br />
1.2.2 L’OXYGÈNE<br />
Les bactéries aérobies<br />
Les bactéries anaérobies<br />
2. REPRODUCTION ET CROISSANCE<br />
2.1 LA REPRODUCTION BACTÉRIENNE<br />
2.1.1 LA DIVISION CELLULAIRE<br />
2.2 LA COURBE DE CROISSANCE<br />
2.2.1 LE CONCEPT DE CROISSANCE<br />
2.2.2 LE CYCLE NORMAL DE CROISSANCE<br />
Phase <strong>de</strong> latence<br />
Phase exponentielle<br />
Phase stationnaire<br />
Phase <strong>de</strong> déclin<br />
Figure A.12<br />
Suppression <strong>de</strong>s jalons <strong>de</strong>s intertitres<br />
<strong>de</strong> quatrième niveau
26 NORMES DE PRÉSENTATION<br />
ANNEXE B<br />
LA FICHE TECHNIQUE<br />
Certaines catégories <strong>de</strong> <strong>travaux</strong>, principalement ceux où l’on présente <strong>de</strong>s œuvres d’art, <strong>de</strong>s œuvres architecturales<br />
ou <strong>de</strong>s objets, exigent une fiche technique pour accompagner et décrire ces différents éléments. Cette<br />
fiche technique est la pièce d’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> l’œuvre et elle prend la même forme qu’une notice bibliographique.<br />
Pour être complète, elle doit comporter les éléments suivants, selon les catégories d’œuvres.<br />
B.1 LES PEINTURES, ESTAMPES ET AFFICHES<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
(année <strong>de</strong> naissance, année <strong>de</strong> décès),<br />
2. Titre <strong>de</strong> l’œuvre,<br />
3. année(s) <strong>de</strong> création,<br />
4. matériaux,<br />
B.2 LES SCULPTURES<br />
5. dimensions (cm ou po s’il y a lieu) : hauteur x largeur,<br />
6. Ville, musée où est conservée l’œuvre<br />
(collection, s’il y a lieu),<br />
7. notice bibliographique <strong>de</strong> la source où a été puisée<br />
l’image, numéro <strong>de</strong> page.<br />
Exemple<br />
Figure B.13 Le café, le soir<br />
VAN GOGH Vincent (1853-1890), Le Café, le soir, 1888, huile sur toile, 81 x 65,5 cm,<br />
Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller, tirée <strong>de</strong> KRAUSSE Anna-Carola, Histoire <strong>de</strong> la<br />
peinture <strong>de</strong> la Renaissance à nos jours, Paris, Gründ, 1995, p. 79.<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
(année <strong>de</strong> naissance, année <strong>de</strong> décès),<br />
2. Titre <strong>de</strong> l’œuvre,<br />
3. année(s) <strong>de</strong> création,<br />
4. matériaux,<br />
5. dimensions (cm ou po s’il y a lieu)<br />
(la hauteur habituellement),<br />
6. ville, musée où est conservée l’œuvre<br />
(collection, s’il y a lieu),<br />
7. notice bibliographique <strong>de</strong> la source où a été puisée<br />
l’image, numéro <strong>de</strong> page.<br />
Exemple<br />
Figure B.14 L’oiseau dans l’espace<br />
BRANCUSI Constantin (1876-1957), L'oiseau dans l'espace, 1928, bronze, 137,2 cm, New York, MoMA,<br />
tiré <strong>de</strong> MoMA, The Museum of Mo<strong>de</strong>rn Art, www.moma.org/collection/browse_results.php?<br />
object_id=81033, 27 juin 2007.
NORMES DE PRÉSENTATION ANNEXE B 27<br />
B.3 LES ŒUVRES ARCHITECTURALES<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
(année <strong>de</strong> naissance, année <strong>de</strong> décès),<br />
2. Nom du bâtiment,<br />
3. ville, pays où est situé le bâtiment,<br />
4. année(s) <strong>de</strong> construction,<br />
5. point <strong>de</strong> vue montré sur l’illustration<br />
(faça<strong>de</strong> ouest, vue aérienne, plan, etc.),<br />
6. notice bibliographique <strong>de</strong> la source où a été puisée<br />
l’image, numéro <strong>de</strong> page.<br />
Exemple<br />
Figure B.15 L’Hôtel Lambert<br />
LE VAU Louis (1612-1670), L’Hôtel Lambert, Paris, France, 1639-1645, plan, tiré <strong>de</strong> MIGNOT Clau<strong>de</strong>,<br />
« Palladio et l’architecture française du XVII e siècle, une admiration critique », Centro Internazionale di<br />
Studi di Architettura Andrea Palladio, http://www.cisapalladio.org/annali/pdf/a12_08_saggio_mignot.pdf,<br />
21 mai 2007, 9 p<br />
B.4 LES OBJETS<br />
1. NOM et prénom <strong>de</strong> l’auteur<br />
(année <strong>de</strong> naissance, année <strong>de</strong> décès),<br />
2. Nom ou titre <strong>de</strong> l’objet,<br />
3. année(s) <strong>de</strong> création,<br />
4. matériaux,<br />
5. dimensions (cm ou po s’il y a lieu) : hauteur x largeur,<br />
6. ville, musée où est conservée l’œuvre,<br />
(collection, s’il y a lieu),<br />
7. notice bibliographique <strong>de</strong> la source où a été puisée<br />
l’image, numéro <strong>de</strong> page.<br />
Exemple<br />
Figure B.16 Vase <strong>de</strong> Tiffany<br />
TIFFANY Louis Comfort (1848-1933), Vase, vers 1900, verre irisé, hauteur 45 cm, Munich,<br />
Bayerisches Nationalmuseum, tiré <strong>de</strong> SEMBACH Klaus-Jürgen, L’art nouveau : L’utopie <strong>de</strong><br />
la réconciliation, Cologne, Taschen, 1999, p. 14.
28 NORMES DE PRÉSENTATION<br />
Heidi BAUMANN<br />
Florence BOUCHARD<br />
Adora MARCHAND<br />
Jean ROSTAND<br />
Groupe 0024<br />
Les effets physiologiques <strong>de</strong> l’aspirine<br />
Travail présenté à madame Rita VALLÉE<br />
Activité d’intégration<br />
101–FZZ–03<br />
Département <strong>de</strong> biologie<br />
Programme Sciences <strong>de</strong> la nature<br />
<strong>Cégep</strong> <strong>de</strong> <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong><br />
29 février 2008<br />
LISTE DES ABRÉVIATIONS<br />
AAS Aci<strong>de</strong> acétylsalicylique<br />
AINS Anti-inflammatoires non stéroïdiens<br />
AS Aci<strong>de</strong> salicylique<br />
BSA Albumine sérique <strong>de</strong> bœuf<br />
COX Cyclo-oxygénase<br />
CML Culture mixte <strong>de</strong> lymphocytes<br />
CPM Coups par minute<br />
GLN Glutamine<br />
PG Prostaglandine<br />
PHA Phytohémagglutinine<br />
TX Thromboxane<br />
ANNEXE C<br />
MODÈLE DE PRÉSENTATION D’UN TRAVAIL ÉCRIT<br />
ii<br />
TABLE DES MATIÈRES<br />
RÉSUMÉ ---------------------------------------------------------------- 1<br />
INTRODUCTION ----------------------------------------------------- 1<br />
1. L’histoire <strong>de</strong> l’aci<strong>de</strong> acétylsalicylique--------------------- 2<br />
1.1 Les premières découvertes---------------------------------- 2<br />
1.2 La découverte <strong>de</strong> l’AAS par Félix Hoffmann----------- 2<br />
1.3 L’évolution <strong>de</strong> l’AAS jusqu’à aujourd’hui-------------- 2<br />
2. La composition chimique <strong>de</strong> l’AAS ----------------------- 3<br />
2.1. Les formules chimiques------------------------------------- 4<br />
2.2. Les groupements fonctionnels ----------------------------- 4<br />
2.3. Les facteurs humoraux -------------------------------------- 4<br />
3. Les effets physiologiques <strong>de</strong> l’aspirine------------------- 5<br />
3.1 Les rôles <strong>de</strong>s prostaglandines dans l’organisme-------- 5<br />
3.1.1 Les prostaglandines et le système cardio-vasculaire--- 5<br />
3.1.2 Les prostaglandines et le système respiratoire---------- 5<br />
3.1.3 Les prostaglandines et l’inflammation ------------------- 5<br />
DISCUSSION---------------------------------------------------------- 6<br />
La super-aspirine------------------------------------------------- 6<br />
L’évolution <strong>de</strong>s recherches------------------------------------- 6<br />
L’hypertension---------------------------------------------------- 7<br />
CONCLUSION -------------------------------------------------------- 7<br />
BIBLIOGRAPHIE ---------------------------------------------------- 8<br />
LISTE DES ABRÉVIATIONS ------------------------------------- ii<br />
LISTE DES FIGURES<br />
Figure 1 L’aci<strong>de</strong> salicylique ---------------------------------------- 3<br />
Figure 2 La synthèse <strong>de</strong> l’aci<strong>de</strong> acétylsalicylique--------------- 3<br />
RÉSUMÉ<br />
Duis autem vel eum iriu re dolor in hendrerit in vulputate velit esse<br />
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero<br />
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent<br />
luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam<br />
liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet<br />
doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum<br />
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh<br />
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.<br />
INTRODUCTION<br />
Selon DOROZYNSKY (1996, p. 120), lorem ipsum dolor sit amet,<br />
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod<br />
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. « Ut wisi<br />
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper<br />
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat ».<br />
MOINET (1998, p. 48) rapporte que duis autem vel eum iriure dolor in<br />
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore<br />
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio<br />
dignissim. […] Qui blandit praesent luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis<br />
dolore te feugait nulla facilisi. Selon elle, «lorem ipsum dolor sit<br />
amet, consectetuer adipiscing (sic) elit, » sed diam nonummy nibh<br />
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.<br />
Quant à WEISMANN (1991, p. 34), il prétend que wisi enim ad minim<br />
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut<br />
aliquip ex ea commodo consequat. Il rajoute plus loin (p. 37) que<br />
« duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse<br />
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. » On<br />
peut donc penser que at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim<br />
qui blandit praesent luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore te<br />
feugait nulla facilisi.<br />
i<br />
1
NORMES DE PRÉSENTATION ANNEXE C 29<br />
1. HISTOIRE DE L’ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE<br />
1.1 Les premières découvertes<br />
HASS (1999, p. 2) rapporte que uis autem vel eum iriure dolor in<br />
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore<br />
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio<br />
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis<br />
dolore te feugait nulla facilisi. Il faut cependant tenir compte <strong>de</strong><br />
l’interprétation suivante <strong>de</strong> LEMELIN (1996, p. 27) : « nam liber<br />
tempor cum soluta nobis eleifend (sic) option congue nihil imperdiet<br />
doming id quod mazim placerat facer possim assum. » Il ajoute aussi<br />
(p. 29) que lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,<br />
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna<br />
aliquam erat volutpat.<br />
DOROZYNSKY (1996, p. 125) nuance cette interprétation ainsi :<br />
« Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse<br />
molestie consequat, vel illum dolore. […] Eu feugiat nulla facilisis at<br />
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent. »<br />
On en conclut que luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait<br />
nulla facilis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit..<br />
1.2 La découverte <strong>de</strong> l’AAS par Félix Hoffmann<br />
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam<br />
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam<br />
erat volutpat (figure 1). Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud<br />
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea<br />
commodo consequat.<br />
1.3 L’évolution <strong>de</strong> l’AAS jusqu’à aujourd’hui<br />
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation<br />
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo<br />
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate<br />
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.<br />
2.1. Les formules chimiques<br />
Voici comment HASS (8 juin 1999, p. 2) a interprété ses<br />
observations : « ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,<br />
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna<br />
aliquam erat volutpat. » On se rend compte que ut wisi enim ad<br />
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit<br />
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.<br />
2.2. Les groupements fonctionnels<br />
Ces groupements, comme le mentionne ANDERSON (janvier 1999,<br />
p. 7) sont autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit<br />
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at<br />
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent<br />
luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Il<br />
mentionne également que nam liber tempor cum soluta nobis eleifend<br />
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer<br />
possim assum.<br />
Accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril<br />
<strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor<br />
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh<br />
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.<br />
2.3. Les facteurs humoraux<br />
Ces facteurs, comme le mentionne ANDERSON (janvier 1999, p. 6)<br />
ont une très gran<strong>de</strong> importance. En effet, « enim ad minim veniam,<br />
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip<br />
ex ea commodo consequat. » Il ajoute (p. 7) que duis autem vel eum<br />
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,<br />
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.<br />
2<br />
4<br />
Source : HASS, @home, La classe <strong>de</strong> science, p. 2.<br />
Figure 1 L’aci<strong>de</strong> salicylique<br />
2. LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L’AAS<br />
Selon HASS (8 juin 1999, p. 2), ut wisi enim ad minim veniam, quis<br />
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea<br />
commodo consequat (figure 2). Duis autem vel eum iriure dolor in<br />
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore<br />
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio<br />
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis<br />
dolore te feugait nulla facilisi.<br />
Source : HASS, @home, La classe <strong>de</strong> science, p. 3<br />
Figure 2 La synthèse <strong>de</strong> l’aci<strong>de</strong> acétylsalicylique<br />
LEMELIN (avril 1996, p. 27) ajoute un point intéressant à l’effet que<br />
orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam<br />
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam<br />
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci<br />
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commod0..<br />
On peut en déduire que autem vel eum iriure dolor in hendrerit in<br />
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat<br />
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui<br />
blandit zzril <strong>de</strong>lenit. augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<br />
3. LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE L’ASPIRINE<br />
3.1 Les rôles <strong>de</strong>s prostaglandines dans l’organisme<br />
3.1.1 Les prostaglandines et le système cardio-vasculaire<br />
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse<br />
molestie consequa. WEISMANN (mars 1991, p. 38) explique en effet<br />
que vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan<br />
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril <strong>de</strong>lenit<br />
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<br />
3.1.2 Les prostaglandines et le système respiratoire<br />
Selon WEISMANN (mars 1991, p. 39-40), )« duis autem vel eum<br />
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel<br />
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto<br />
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis<br />
dolore te feugait nulla facilisi. » Selon lui, nam liber tempor cum<br />
soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod<br />
mazim placerat facer possim assum. Cependant, nous pensons que<br />
l’accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril<br />
<strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<br />
3.1.3 Les prostaglandines et l’inflammation<br />
MOINET (août 1998, p. 47) propose une hypothése très intéressante<br />
au sujet <strong>de</strong> l’influence <strong>de</strong>s prostaglandines sur le processus<br />
inflammatoire : « lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing<br />
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore<br />
magna aliquam erat volutpat. » À son avis, ut wisi enim ad minim<br />
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut<br />
aliquip ex ea commodo consequat<br />
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam<br />
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.<br />
3<br />
5
30<br />
La super-aspirine<br />
DISCUSSION<br />
Comme l’explique MOINET (août 1998, p. 50), autem vel eum iriure<br />
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum<br />
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio<br />
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis<br />
dolore te feugait nulla facilisi. Mais à notre avis, il faut aussi<br />
comprendre que ;orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing<br />
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore<br />
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.<br />
Ajoutons aussi l’interprétation <strong>de</strong> WEISMANN (mars 1991, p. 38) qui<br />
est d’avis que nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option<br />
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim<br />
assum. Comme il le dit plus loin (p. 39), « lorem ipsum dolor sit<br />
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod<br />
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. » Nous<br />
pensons qu’il faut interpréter ceci <strong>de</strong> la façono suivante : ut wisi enim<br />
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit<br />
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel<br />
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie<br />
consequat.<br />
Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip<br />
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in<br />
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore<br />
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.<br />
L’évolution <strong>de</strong>s recherches<br />
HASS (juin 1999, p. 3) est <strong>de</strong> l’avis que « nostrud exerci tation<br />
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo<br />
consequat. » Selon lui, en effet, duis autem vel eum iriure dolor in<br />
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat. Nous ajoutons<br />
que vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et<br />
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril<br />
<strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<br />
6<br />
ANNEXE C NORMES DE PRÉSENTATION<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et<br />
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril<br />
<strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor<br />
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh<br />
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut<br />
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper<br />
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.<br />
L’hypertension<br />
ANDERSON Geoffrey (27 janvier 1999), « L’aci<strong>de</strong> acétylsalicylique et<br />
la prévention primaire <strong>de</strong>s maladies cardio-vasculaires », Santé<br />
Canada, www.hcsc.gc.ca, 8 p.<br />
DOROZYNSKY Alexandre (juin 1996), « Le siècle <strong>de</strong> l’aspirine »,<br />
Science et vie, n o 945, p. 120–125.<br />
HASS Bruno (8 juin 1999), « Aci<strong>de</strong> salicylique », @home, La classe<br />
<strong>de</strong> science, www.ping. be/at_home, 3 p.<br />
LEMELIN André (avril 1996), « La pilule du siècle », Québec<br />
Science, p. 27–28.<br />
MOINET Marie-Clau<strong>de</strong> (août 1998), « La super-aspirine : révélations<br />
sur le médicament du siècle prochain ». Science et vie, n o 971,<br />
p. 45–51.<br />
WEISMANN Gérald (mars 1991), « L’aspirine », Pour la science,<br />
n o 161, p. 34–41.<br />
MOINET (août 1998, p. 47) nous rappelle que « vel eum iriure dolor in<br />
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore<br />
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio<br />
dignissim qui blandit praesent. » Nous pensons que luptatum zzril<br />
<strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor<br />
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh<br />
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.<br />
CONCLUSION<br />
Wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper<br />
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis<br />
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse<br />
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero<br />
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent<br />
luptatum zzril <strong>de</strong>lenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.<br />
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam<br />
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam<br />
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.<br />
8<br />
7
NORMES DE PRÉSENTATION 31<br />
ANNEXE D<br />
EXEMPLES DE COMPOSITION DE DIFFÉRENTS NIVEAUX DE TITRE<br />
On suppose que la police <strong>de</strong> caractères utilisée pour le texte courant est le Times ou Times New Roman en<br />
12 points.<br />
Exemple <strong>de</strong> composition <strong>de</strong>s titres avec la même police que le texte courant<br />
Hiérarchie Composition Exemples<br />
1 Times, 12 points, capitales, gras 1. LA PHYSIOLOGIE BACTÉRIENNE<br />
2 Times, 12 points, capitales, non gras 1.1 LES BESOINS PHYSICOCHIMIQUES<br />
3 Times, 12 points, gras 1.1.1 L’oxygène<br />
4 Times, 12 points, gras italique Les bactéries anaérobies<br />
5 Times, 12 points, italique Les bactéries anaérobies pathogènes<br />
Remarque Le titre <strong>de</strong> premier niveau peut être centré lorsqu’il ne contient pas <strong>de</strong> jalon<br />
énumératif . C’est le cas du titre <strong>de</strong> la table <strong>de</strong>s matières, du résumé, <strong>de</strong><br />
l’introduction et <strong>de</strong> la conclusion, par exemple.<br />
Exemple <strong>de</strong> composition <strong>de</strong>s titres avec une police sans empattements (Helvetica ou Arial par exemple)<br />
et une hiérarchie comportant six niveaux.<br />
Hiérarchie Composition Exemples<br />
1 Arial, 12 points, capitales, gras 1. LA PHYSIOLOGIE BACTÉRIENNE<br />
2 Arial, 11 points, capitale, gras 1.1 LES BESOINS PHYSICO-CHIMIQUES<br />
3 Arial, 11 points, cap., non gras 1.1.1 L’OXYGÈNE<br />
4 Arial, 11 points, gras Les bactéries anaérobies<br />
5 Arial, 11 points, gras italique Les bactéries anaérobies pathogènes<br />
6 Arial, 11 points, italique Les bactéries anaérobies pathogènes et sporulées<br />
Pour une même taille <strong>de</strong> caractère (12 points), le <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong>s caractères Times ou Times New Roman est plus<br />
petit à l’impression que celui d’Arial. C’est pourquoi la taille <strong>de</strong> la police a été réduite d’un point pour éviter une<br />
trop gran<strong>de</strong> différence entre la taille <strong>de</strong> la police <strong>de</strong>s titres et la police du texte courant, soit Times ou Times<br />
New Roman, 12 points.
32 NORMES DE PRÉSENTATION<br />
A. LES ACCENTS ET SIGNES DIACRITIQUES<br />
ANNEXE E<br />
QUELQUES RÈGLES DE TYPOGRAPHIE<br />
Il faut mettre les accents et autres signes diacritiques sur toutes les lettres qui doivent en avoir, à l’exception<br />
du I et du J qui n’ont pas <strong>de</strong> point. Par exemple, QUÉBEC, ÎLE JÉSUS, L’HAŸ-LES-ROSES, Î.-P.-É., etc.<br />
B. L’APOSTROPHE<br />
Pour une meilleure qualité typographique, il convient <strong>de</strong> remplacer l’apostrophe dite ASCII ( ' ) par<br />
l’apostrophe typographique ( ’ ) 57 . Notez qu’il n’y a pas d’espace avant ni après l’apostrophe.<br />
C. L’APPEL DE NOTE<br />
L’appel <strong>de</strong> note est un chiffre en exposant ou un symbole qui renvoie à une note infrapaginale, placée au bas<br />
<strong>de</strong> la page. Cet appel est placé après et contre le mot auquel il se rapporte.<br />
Dans le cas d’une phrase ou d’un paragraphe, l’appel <strong>de</strong> note se place toujours avant la ponctuation finale<br />
d’une phrase, d’un paragraphe ou d’une citation et à l’intérieur du guillemet fermant. Selon le même<br />
principe, si la note porte sur le contenu d’une parenthèse, l’appel se situe avant la parenthèse fermante 58 .<br />
D. LES DATES<br />
Deux métho<strong>de</strong>s sont proposées pour l’écriture <strong>de</strong>s dates avant ou après le début <strong>de</strong> notre ère. La première,<br />
plus classique, propose d’écrire les dates <strong>de</strong> la façon suivante : av. J.-C. et apr. J.-C. (avant et après Jésus-<br />
Christ).<br />
Cependant, étant donné que cette connotation est historiquement incorrecte, le Christ étant né en l’an 4–5<br />
av. J.-C., et aussi parce que <strong>de</strong> nombreux événements ne concernent pas les peuples chrétiens 59 , une autre<br />
métho<strong>de</strong> propose que l’on écrive plutôt AEC (avant l’ère chrétienne) et EC (ère chrétienne).<br />
E. LES ESPACES<br />
On connaît, en typographie, toutes sortes d’espaces. Celles qui retiendront notre attention sont les espaces<br />
justifiantes 60 (ou variables) et les espaces insécables (ou fixes).<br />
Les espaces entre les mots, tapées avec la barre d’espace, sont dites espaces justifiantes 61 . Quand le texte<br />
apparaît avec une pleine justification (gauche et droite, comme dans le paragraphe ci-<strong>de</strong>ssous), ces espaces<br />
ont pour fonction <strong>de</strong> donner à toutes les lignes la même longueur.<br />
Les espaces insécables sont comme <strong>de</strong>s caractères blancs, <strong>de</strong> largeur invariable, qui évitent que <strong>de</strong>s<br />
caractères ou <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> caractères soient séparés. Par exemple, si on écrit 2 000 000 $, on aura intérêt à<br />
taper <strong>de</strong>s espaces insécables dans ce montant à la place <strong>de</strong>s espaces habituelles, pour éviter que <strong>de</strong>s zéros ou<br />
le symbole $ se retrouvent isolés sur la ligne suivante. (Dans les notices bibliographiques, il faut prendre la<br />
précaution <strong>de</strong> taper une espace insécable entre p. et un numéro <strong>de</strong> page pour éviter <strong>de</strong> trouver les chiffres<br />
isolés sur la ligne suivante. Pour la même raison, taper aussi une espace insécable entre les chiffres et les<br />
unités <strong>de</strong> mesure ; par exemple, 1 cm, 5 ml, 3 km/h, etc.)<br />
Les doubles espaces<br />
Il faut remplacer toutes les occurrences <strong>de</strong> doubles espaces par une seule espace. En effet, les <strong>de</strong>ux espaces<br />
que certains ont appris à taper après le point découlent d’une pratique nord-américaine. L’utilisation<br />
volontaire <strong>de</strong>s doubles espaces révèle une typographie fautive.<br />
57. Généralement, Word remplace automatiquement l’apostrophe ASCII par l’apostrophe typographique.<br />
58. Voir aussi les exemples au milieu <strong>de</strong> la page 7.<br />
59. Stephen Jay GOULD, Millénium, p. 70.<br />
60. Non, ce n’est pas une faute d’orthographe : en typographie, le terme espace est féminin.<br />
61. Obtenues en enfonçant les touches alt–barre d’espace (sur Mac) ou majuscule–alt–barre d’espace (sur PC).
NORMES DE PRÉSENTATION ANNEXE E 33<br />
Les espaces avant et après les signes typographiques<br />
Le tableau ci-<strong>de</strong>ssous résume les conventions typographiques concernant les catégories d’espace à placer<br />
<strong>de</strong>vant et après les principaux signes typographiques.<br />
Tableau E.3 Les espaces avant et après les signes typographiques<br />
Ponctuations basses<br />
Point 62<br />
Virgule<br />
Points <strong>de</strong> suspension<br />
Ponctuations hautes<br />
Guillemets<br />
Point-virgule<br />
Deux-points<br />
Point d’interrogation<br />
Point d’exclamation<br />
Parenthèses<br />
Autres signes<br />
Ouvrants<br />
Fermants<br />
Ouvrantes<br />
Fermantes<br />
Dollars<br />
Pourcentage<br />
Premier tiret<br />
Deuxième tiret<br />
Degré<br />
Degré 63<br />
Espace<br />
avant<br />
0<br />
0<br />
0<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
+<br />
*<br />
+<br />
0<br />
*<br />
*<br />
+<br />
*<br />
0<br />
*<br />
Signe<br />
.<br />
,<br />
…<br />
;<br />
:<br />
?<br />
!<br />
«<br />
»<br />
(<br />
)<br />
Espace<br />
après<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
*<br />
+<br />
0<br />
+<br />
Exemples<br />
Voilà. Tout est dit.<br />
Je suis venu, j’ai vu, je suis parti.<br />
J’ai trouvé ça… dans ce livre.<br />
Voici ta part ; es-tu content ?<br />
À apporter : fromages et vin.<br />
Quand arrivent-elles ? Dans un mois.<br />
Surprise ! Me voilà !<br />
En cette belle journée, il m’a dit :<br />
« Va donc jouer <strong>de</strong>hors. »<br />
Légen<strong>de</strong> : 0 = aucune espace + = une espace ordinaire * = espace insécable<br />
$<br />
%<br />
—<br />
—<br />
º<br />
º<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
0<br />
Le virus <strong>de</strong> la varicelle (une maladie<br />
cutanée) cause aussi le zona.<br />
Ce livre coûte 8,95 $ ; le prends-tu ?<br />
Il y a une réduction <strong>de</strong> 20 % sur tout.<br />
Ce livre — c’est le mien — tu me le<br />
rends ?<br />
Il fait 40º à l’ombre ; c’est trop chaud !<br />
Il fait 40 ºC à l’ombre ; c’est trop chaud !<br />
62. Exceptions : entre les <strong>de</strong>ux chiffres d’un nombre, il n’y a pas d’espace avant et après le point (2.30), la virgule<br />
(75,4 cm) et le <strong>de</strong>ux-points (il est 16:00). En outre, dans les adresses URL <strong>de</strong>s sites Web, il n’y a jamais d’espace avant<br />
et après le point et le <strong>de</strong>ux-points.<br />
63. Si l’échelle <strong>de</strong> mesure n’est pas précisée, le signe <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré s’appuie contre le <strong>de</strong>rnier chiffre. Sinon, il est précédé<br />
d’une espace insécable et suivi immédiatement <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> mesure.
34 ANNEXE E NORMES DE PRÉSENTATION<br />
F. LES EXPOSANTS COURANTS<br />
Tableau E.4 Exemples <strong>de</strong> composition <strong>de</strong> quelques exposants courants<br />
Formes correctes Formes tolérées Formes fautives<br />
Numéro n o no #<br />
Premier 1 er 1er 1ier<br />
Première 1 re 1re 1ère, 1 ière<br />
Deuxième 2 e 2e 2ème, 2 ème<br />
Troisième 3 e 3e 3ème, 3 ème<br />
G. LES GUILLEMETS<br />
Dans un texte français, utilisez les guillemets « et ». Les guillemets “ et ” servent à encadrer une citation à<br />
l’intérieur d’une autre citation 64 .<br />
H. LES LIGATURES<br />
En français, certaines lettres doivent être ligaturées (ou liées), les principales étant : œ, æ, Œ et Æ. On écrira<br />
donc, par exemple, cœur, œil, cæcum, Œsophage, Œil, curriculum vitæ. Toutefois, ce ne sont pas tous les oe<br />
qui sont ligaturés : pensons à coefficient ou à Groenland par exemple.<br />
I. LES NUMÉROS<br />
Il ne faut jamais utiliser le dièse # (appelé aussi carré sur nos appareils téléphoniques) comme abréviation <strong>de</strong><br />
numéro. Écrivez numéro tout au long ou bien <strong>de</strong> façon abrégée (n o ou n os ) en suivant la règle ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
N’abrégez ce mot que s’il est immédiatement précédé du nom auquel il se rapporte et suivi d’un nombre en<br />
chiffres.<br />
• Le microscope n o 12 est rangé dans l’armoire centrale.<br />
• C’est le numéro A–12345 qui gagne le voyage à Paris.<br />
Dans le cas <strong>de</strong>s notices bibliographiques <strong>de</strong> périodiques, l’abréviation est permise.<br />
• SIGAL Pierre-André, « Compostelle : mille ans <strong>de</strong> pèlerinage », L’Histoire, n o 193, nov. 1995, p. 52–57.<br />
J. LES POINTS DE SUSPENSION<br />
Il existe une combinaison <strong>de</strong> touches pour les points <strong>de</strong> suspension (…) qui donne un aspect différent <strong>de</strong>s<br />
trois points tapés à la suite l’un <strong>de</strong> l’autre (...). On ne met pas <strong>de</strong> points <strong>de</strong> suspension après etc.<br />
K. LES PARENTHÈSES ( ), CROCHETS [ ] ET ACCOLADES { }<br />
Il n’y a pas d’espaces entre ces signes et leur contenu. Par exemple, on écrira (signes typographiques) et non<br />
( signes typographiques ).<br />
L. LE SOULIGNÉ<br />
Dans les tapuscrits composés à l’ordinateur, ne soulignez le texte qu’au compte-gouttes, c’est-à-dire à peu<br />
près jamais. Notez qu’il est très rare <strong>de</strong> voir du texte souligné dans les imprimés, quel que soit le type <strong>de</strong><br />
publication, à moins que <strong>de</strong>s effets visuels spéciaux ne soient recherchés. Ne soulignez surtout pas <strong>de</strong>s mots<br />
en caractères gras ou italiques <strong>de</strong> même que du texte en capitales : ce sont <strong>de</strong>s « pléonasmes typographiques<br />
».<br />
64. Ce matin, Jacques m’a raconté l’anecdote suivante : « Hier, j’ai remarqué André au cinéma. Il était assis <strong>de</strong>ux sièges<br />
<strong>de</strong>vant moi et il a dû s’endormir et faire un mauvais rêve, car on l’a entendu s’écrier : “Au ! Au feu !” ».
NORMES DE PRÉSENTATION ANNEXE E 35<br />
M. LES RÈGLES DE CAPITALISATION DES TITRES D’ŒUVRES<br />
Des règles précises régissent l’écriture <strong>de</strong>s titres d’œuvres littéraires et artistiques, que ce soit <strong>de</strong>s films, <strong>de</strong>s<br />
journaux, <strong>de</strong>s revues, <strong>de</strong>s tableaux, <strong>de</strong>s pièces <strong>de</strong> théâtre, <strong>de</strong>s romans, <strong>de</strong>s sculptures, etc. Rappelons-nous<br />
que, dans un texte, ces titres sont toujours composés en italique.<br />
En français 65<br />
A. Seul le premier mot prend une capitale initiale. Les noms propres conservent bien sûr la capitale.<br />
• J’ai lu La guerre <strong>de</strong> Troie n’aura pas lieu.<br />
• Une belle œuvre très connue du XV e siècle est Les très riches heures du duc <strong>de</strong> Berry.<br />
• As-tu lu Quand les poules auront <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts et Comme les huit doigts <strong>de</strong> la main <strong>de</strong> GOULD ?<br />
• J’ai lu le même article dans Le Devoir et La Presse 66 .<br />
• Cette série d’articles du Soleil 67 était très intéressante.<br />
B. Un sous-titre est séparé du titre par un <strong>de</strong>ux-points et le premier mot <strong>de</strong> chaque élément prend la capitale.<br />
• Je viens <strong>de</strong> terminer Les Eygletières : La faim <strong>de</strong>s lionceaux <strong>de</strong> TROYAT.<br />
En anglais 68<br />
On met une capitale au premier et au <strong>de</strong>rnier mot. Tous les autres mots sont également capitalisés, sauf les<br />
prépositions (comme at, before, by, during, for, from, in, on, since, with, etc.), les articles (a, an, the) et les<br />
conjonctions and, not et nor. To prend la majuscule, sauf <strong>de</strong>vant un infinitif.<br />
• The Coming Plaque by Laurie GARRETT is a fascinating book on newly emerging diseases.<br />
• Have you read Einstein : The Life and Times by Ronald W. CLARK ?<br />
• Sais-tu qui a écrit How to Build an Empire ?<br />
N. LES SIGLES ET ACRONYMES : O.N.U., ONU ou Onu 69 ?<br />
Un sigle est une abréviation formée <strong>de</strong>s lettres initiales <strong>de</strong> noms <strong>de</strong> pays, d’organisations, <strong>de</strong> sociétés, d’associations,<br />
etc. comportant plusieurs mots et dont on ne retient que les premières lettres : par exemple, ONU<br />
pour Organisation <strong>de</strong>s Nations Unies ou OQLF pour Office québécois <strong>de</strong> la langue française. Toutes les<br />
lettres d’un sigle sont prononcées séparément. Notez que vous <strong>de</strong>vez donner la signification d’un sigle ou<br />
d’une abréviation la première fois que vous les écrivez dans un travail. Si <strong>de</strong> nombreux sigles et abréviations<br />
sont utilisés, il est important <strong>de</strong> les présenter dans une liste au début <strong>de</strong> votre travail (voir l’annexe C, p. 28).<br />
Pendant longtemps, la coutume voulait que chaque lettre soit suivie d’un point abréviatif. Cependant, dans<br />
l’usage actuel, le point <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> plus en plus facultatif <strong>de</strong> sorte que la composition sans point se généralise.<br />
Quand un sigle, comme ONU, peut se prononcer comme un mot ordinaire (o-nu), c’est un acronyme. Celuici<br />
peut alors se composer avec une capitale initiale et <strong>de</strong>s minuscules. On pourra donc écrire Aléna (Accord<br />
<strong>de</strong> libre-échange nord-américain), Bénélux (Belgique, Ne<strong>de</strong>rland, Luxembourg), Onu, etc.<br />
De nombreux acronymes sont également <strong>de</strong>venus <strong>de</strong>s mots communs ; par exemple, cégep (collège d’enseignement<br />
général et professionnel), ovni (objet volant non i<strong>de</strong>ntifié), sida (syndrome d’immunodéficience<br />
acquise), etc.<br />
Pour répondre à la question posée dans le titre, il faut reconnaître que certains sigles sont lus ou prononcés en<br />
épelant les lettres (oh-ènne-u, u-ère-ès-ès, par exemple) ou comme un mot ordinaire (o–nu, urse). On peut<br />
donc écrire ces abréviations sous forme <strong>de</strong> sigles (ONU, URSS) ou d’acronyme (Onu, Urss). Dans<br />
l’incertitu<strong>de</strong>, il est préférable d’utiliser <strong>de</strong>s lettres capitales.<br />
65. Adapté <strong>de</strong> A. RAMAT, op. cit., p. 114-115 et <strong>de</strong> Noëlle GUILLOTON et coll., Le français au bureau, p. 131.<br />
66. Devoir et Presse sont ici <strong>de</strong>s noms propres et les titres complets <strong>de</strong> ces quotidiens sont Le Devoir et La Presse.<br />
67. À l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> cet exemple, notons ici que l’article défini d’un titre (Le Soleil) doit être contracté au besoin. Ne jamais<br />
écrire « <strong>de</strong> Le Soleil ».<br />
68. Adapté à partir <strong>de</strong> M. MALO, op. cit., p. 286 et <strong>de</strong> Diana HACKER, A Canadian Writer’s Reference, p. 144.<br />
69. Adapté <strong>de</strong> A. RAMAT, op. cit., p. 54.
36 NORMES DE PRÉSENTATION<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
ARMS Karen et Pamela S. CAMP (1993), Biologie générale, Montréal, Étu<strong>de</strong>s vivantes.<br />
BAUDELAIRE Charles (1961), « Recueillement », Les fleurs du mal, Paris, Gallimard, coll. Le livre<br />
<strong>de</strong> Poche, n o 677.<br />
CÉGEP DE SAINTE-FOY (2003), Politique d’évaluation <strong>de</strong>s apprentissages, <strong>Cégep</strong> <strong>de</strong> <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong>,<br />
<strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong>.<br />
DROUIN Christian A. (avril 2007), « Encore plus sur la vitamine D », Québec Science, vol. 45, n o 7,<br />
p. 5.<br />
FONTAINE Jules (1993), Gui<strong>de</strong> pratique <strong>de</strong> Word 5.1 pour le Macintosh, <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong>,<br />
Éditions du Verger.<br />
GOULD Stephen Jay (1998), Millénium, Paris, Éditions du Seuil.<br />
GUILLOTON Noëlle et Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE (1996), Le français au bureau, <strong>Sainte</strong>-<strong>Foy</strong>,<br />
Publications du Québec.<br />
GUIOMAR Marie-Germaine et Daniel HÉBERT (1995), Repères méthodologiques, Montréal,<br />
Éditions du Renouveau pédagogique.<br />
HACKER Diana (1991), A Canadian Writer’s Reference, Scarborough, Nelson Canada.<br />
LAVOIE Johanne (5 juin 2007), « Exemples <strong>de</strong> plagiat », www.bibliotheques.uqam.ca/<br />
recherche/plagiat/exemples.html, 1 p.<br />
LECLERC Jacques (1989), Qu’est-ce que la langue ?, Laval, Mondia Éditeurs, 2 e édition.<br />
Lexique <strong>de</strong>s règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale (1975), Paris,<br />
Imprimerie nationale.<br />
MALO Marie (1996), Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> la communication écrite au cégep, à l’université et en entreprise,<br />
Montréal, Éditions Québec/Amérique.<br />
PELCZAR Michael J. et E. C. S. CHAN (1982), Éléments <strong>de</strong> microbiologie, Montréal, Éditions<br />
HRW.<br />
PRÉVERT Jacques (1963), Histoires, Paris, Éditions Gallimard, coll. Le livre <strong>de</strong> poche, n o 1525.<br />
PROVENCHER Jean (1982), C’était l’été : La vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-<br />
Laurent, Montréal, Éditions du Boréal Express.<br />
RAMAT Aurel (2005), Le Ramat <strong>de</strong> la typographie, Montréal, Aurel Ramat éd.<br />
RICHAUDEAU François (1979), Conception <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s manuels scolaires : Gui<strong>de</strong> pratique,<br />
Paris, Unesco.<br />
SAINT-EXUPÉRY Antoine <strong>de</strong> (1959), « Terre <strong>de</strong>s Hommes », Œuvres d’Antoine <strong>de</strong> Saint-Exupéry,<br />
Paris, Gallimard, Bibliothèque <strong>de</strong> la Pléia<strong>de</strong>.