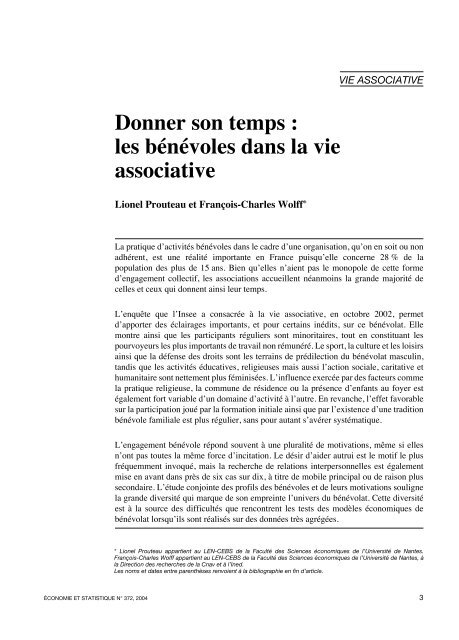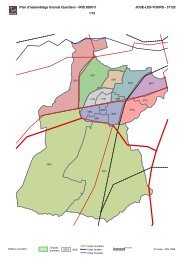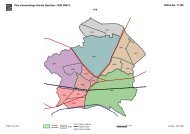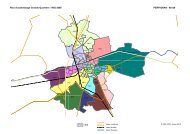Donner son temps : les bénévoles dans la vie associative - Insee
Donner son temps : les bénévoles dans la vie associative - Insee
Donner son temps : les bénévoles dans la vie associative - Insee
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Donner</strong> <strong>son</strong> <strong>temps</strong> :<br />
<strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />
<strong>associative</strong><br />
Lionel Prouteau et François-Char<strong>les</strong> Wolff *<br />
VIE ASSOCIATIVE<br />
La pratique d’activités bénévo<strong>les</strong> <strong>dans</strong> le cadre d’une organisation, qu’on en soit ou non<br />
adhérent, est une réalité importante en France puisqu’elle concerne 28 % de <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion des plus de 15 ans. Bien qu’el<strong>les</strong> n’aient pas le monopole de cette forme<br />
d’engagement collectif, <strong>les</strong> associations accueillent néanmoins <strong>la</strong> grande majorité de<br />
cel<strong>les</strong> et ceux qui donnent ainsi leur <strong>temps</strong>.<br />
L’enquête que l’<strong>Insee</strong> a consacrée à <strong>la</strong> <strong>vie</strong> <strong>associative</strong>, en octobre 2002, permet<br />
d’apporter des éc<strong>la</strong>irages importants, et pour certains inédits, sur ce bénévo<strong>la</strong>t. Elle<br />
montre ainsi que <strong>les</strong> participants réguliers <strong>son</strong>t minoritaires, tout en constituant <strong>les</strong><br />
pourvoyeurs <strong>les</strong> plus importants de travail non rémunéré. Le sport, <strong>la</strong> culture et <strong>les</strong> loisirs<br />
ainsi que <strong>la</strong> défense des droits <strong>son</strong>t <strong>les</strong> terrains de prédilection du bénévo<strong>la</strong>t masculin,<br />
tandis que <strong>les</strong> activités éducatives, religieuses mais aussi l’action sociale, caritative et<br />
humanitaire <strong>son</strong>t nettement plus féminisées. L’influence exercée par des facteurs comme<br />
<strong>la</strong> pratique religieuse, <strong>la</strong> commune de résidence ou <strong>la</strong> présence d’enfants au foyer est<br />
également fort variable d’un domaine d’activité à l’autre. En revanche, l’effet favorable<br />
sur <strong>la</strong> participation joué par <strong>la</strong> formation initiale ainsi que par l’existence d’une tradition<br />
bénévole familiale est plus régulier, sans pour autant s’avérer systématique.<br />
L’engagement bénévole répond souvent à une pluralité de motivations, même si el<strong>les</strong><br />
n’ont pas toutes <strong>la</strong> même force d’incitation. Le désir d’aider autrui est le motif le plus<br />
fréquemment invoqué, mais <strong>la</strong> recherche de re<strong>la</strong>tions interper<strong>son</strong>nel<strong>les</strong> est également<br />
mise en avant <strong>dans</strong> près de six cas sur dix, à titre de mobile principal ou de rai<strong>son</strong> plus<br />
secondaire. L’étude conjointe des profils des bénévo<strong>les</strong> et de leurs motivations souligne<br />
<strong>la</strong> grande diversité qui marque de <strong>son</strong> empreinte l’univers du bénévo<strong>la</strong>t. Cette diversité<br />
est à <strong>la</strong> source des difficultés que rencontrent <strong>les</strong> tests des modè<strong>les</strong> économiques de<br />
bénévo<strong>la</strong>t lorsqu’ils <strong>son</strong>t réalisés sur des données très agrégées.<br />
* Lionel Prouteau appartient au LEN-CEBS de <strong>la</strong> Faculté des Sciences économiques de l’Université de Nantes.<br />
François-Char<strong>les</strong> Wolff appartient au LEN-CEBS de <strong>la</strong> Faculté des Sciences économiques de l’Université de Nantes, à<br />
<strong>la</strong> Direction des recherches de <strong>la</strong> Cnav et à l’Ined.<br />
Les noms et dates entre parenthèses renvoient à <strong>la</strong> bibliographie en fin d’article.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 3
D<br />
ans le rapport qu’elle consacrait aux<br />
« Associations régies par <strong>la</strong> loi de 1901 »,<br />
<strong>la</strong> mission du Conseil National de l’Information<br />
Statistique (Cnis) soulignait, à <strong>la</strong> fin des années<br />
1990, l’importance du poids économique du<br />
secteur associatif, aussi bien en matière<br />
d’emplois qu’en termes de flux financiers.<br />
Notant que « <strong>les</strong> associations mettent en œuvre<br />
d’importants facteurs de production non<br />
rémunérés », <strong>la</strong> mission ajoutait à ce propos que<br />
« <strong>la</strong> mesure de cette activité organisée aux marges<br />
de <strong>la</strong> sphère des échanges monétarisés est<br />
aussi un enjeu essentiel pour <strong>la</strong> reconnaissance<br />
du secteur associatif, comme pour <strong>les</strong> autorités<br />
qui mettent à disposition des moyens publics »<br />
(Neyret et al., 1998, p. 103).<br />
Au registre des facteurs de production non<br />
rémunérés, le bénévo<strong>la</strong>t occupe une p<strong>la</strong>ce de<br />
tout premier ordre sur un p<strong>la</strong>n aussi bien quantitatif<br />
que symbolique. Quantitativement, le don<br />
de <strong>temps</strong> constitue un apport indispensable au<br />
fonctionnement de bon nombre d’associations.<br />
Même si sa valorisation monétaire est une entreprise<br />
délicate dont <strong>les</strong> résultats restent approximatifs<br />
et doivent être appréhendés avec précaution,<br />
elle n’en a pas moins l’intérêt de montrer<br />
qu’il s’agit d’une contribution considérablement<br />
plus importante que <strong>les</strong> dons monétaires,<br />
en France comme à l’étranger (Archambault,<br />
1996 ; Salomon et Sokolowski, 2001). Symboliquement,<br />
c’est du bénévo<strong>la</strong>t que <strong>la</strong> <strong>vie</strong> <strong>associative</strong><br />
tire une part essentielle de sa légitimité, ne<br />
serait-ce que parce que l’association est le produit<br />
de l’initiative bénévole (1).<br />
Bien qu’elle se soit progressivement améliorée<br />
en France au cours des années 1990, <strong>la</strong> connaissance<br />
du bénévo<strong>la</strong>t requiert un approfondissement<br />
que <strong>la</strong> mission du Cnis appe<strong>la</strong>it de ses<br />
vœux. En effet, <strong>les</strong> travaux pionniers du LES<br />
(Laboratoire d’économie sociale) portent sur<br />
des échantillons restreints qui limitent <strong>les</strong> possibilités<br />
d’investigation, notamment en ce qui<br />
concerne <strong>les</strong> engagements par domaine d’activité<br />
(Archambault et al., 1991 ; Archambault et<br />
Boumendil, 1994 ; Archambault et Boumendil,<br />
1997). L’étude de Prouteau (1998) prend en<br />
compte des effectifs plus conséquents, mais<br />
l’enquête Emploi du <strong>temps</strong> 1985-1986 de<br />
l’<strong>Insee</strong> qui lui sert de source n’accorde qu’un<br />
intérêt secondaire au bénévo<strong>la</strong>t, ce qui explique<br />
l’absence de certaines informations importantes<br />
(en particulier <strong>les</strong> durées consacrées aux activités<br />
bénévo<strong>les</strong>).<br />
Ces travaux ont toutefois le mérite de suggérer <strong>la</strong><br />
grande variété des comportements bénévo<strong>les</strong>, qui<br />
se traduit notamment par <strong>la</strong> pluralité des terrains<br />
d’engagement. Ceux-ci ne sauraient être réduits à<br />
l’action sociale et au domaine caritatif qui ont<br />
profondément marqué l’image du bénévo<strong>la</strong>t au<br />
point d’en constituer, encore aujourd’hui, <strong>la</strong><br />
figure emblématique. Le sport, <strong>la</strong> culture, <strong>les</strong> loisirs,<br />
pour n’en citer que quelques-uns, <strong>son</strong>t également<br />
des secteurs fortement utilisateurs de bénévo<strong>les</strong>,<br />
leurs besoins en <strong>la</strong> matière ayant crû avec<br />
<strong>la</strong> demande de services qui leur est adressée par<br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Peut-on cependant, sans plus de<br />
précaution, tenir pour identiques l’engagement<br />
sportif et l’engagement social ? La diversité du<br />
bénévo<strong>la</strong>t s’exprime également au travers de <strong>la</strong><br />
différence d’intensité et de fréquence des pratiques,<br />
dont le spectre s’étend d’une participation à<br />
quasi plein-<strong>temps</strong> – rare mais néanmoins rencontrée<br />
– à un service très ponctuel rendu une fois<br />
<strong>dans</strong> l’année. Les travaux antérieurs <strong>la</strong>issent<br />
pressentir que le bénévo<strong>la</strong>t présente ainsi des<br />
« géométries multip<strong>les</strong> » (Ferrand-Bechmann,<br />
2000, p. 21) et repose sur des motivations qui<br />
<strong>son</strong>t, selon toute probabilité, très hétérogènes. (1)<br />
En consacrant une part substantielle de <strong>son</strong><br />
questionnaire au bénévo<strong>la</strong>t, l’enquête que<br />
l’<strong>Insee</strong> a conduite, en octobre 2002, sur <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />
<strong>associative</strong> constitue une opportunité sans précédent<br />
<strong>dans</strong> notre pays pour enrichir l’analyse<br />
du don de <strong>temps</strong> encadré, ou formel (2), et mieux<br />
en documenter <strong>la</strong> diversité. L’enjeu n’est pas<br />
purement académique. Car, outre <strong>les</strong> chercheurs<br />
en sciences socia<strong>les</strong>, <strong>les</strong> animateurs de <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />
<strong>associative</strong> comme <strong>les</strong> pouvoirs publics, s’ils<br />
souhaitent promouvoir cette forme d’engagement<br />
collectif, ont un intérêt certain à mieux en<br />
cerner l’étendue et <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s.<br />
Toutefois, même si l’examen du comportement<br />
bénévole est un des objectifs majeurs de cette<br />
enquête, <strong>son</strong> repérage n’est pas immédiat. Plusieurs<br />
problèmes rencontrés <strong>dans</strong> le traitement<br />
1. Exception doit ici être faite des associations para-commercia<strong>les</strong><br />
et des associations para-administratives, dont il est coutumier<br />
de dire qu’el<strong>les</strong> dénaturent <strong>la</strong> logique <strong>associative</strong>, précisément<br />
parce qu’el<strong>les</strong> n’ont pas une origine bénévole mais <strong>son</strong>t le fruit<br />
d’un entrepreneuriat lucratif déguisé ou de <strong>la</strong> volonté d’agents<br />
publics <strong>dans</strong> l’exercice de leurs fonctions.<br />
2. Le bénévo<strong>la</strong>t formel, appelé encore encadré, est celui qui est<br />
réalisé <strong>dans</strong> un organisme, qu’il soit associatif ou d’une autre<br />
nature. Il se distingue du bénévo<strong>la</strong>t informel qui renvoie aux services<br />
spontanément rendus entre ménages ou directement à <strong>la</strong><br />
collectivité, en dehors de toute structure. Il peut s’agir de dons de<br />
<strong>temps</strong> à des voisins, à des amis, voire, mais ce point ne fait pas<br />
consensus, à d’autres ménages de <strong>la</strong> famille. Le périmètre du<br />
bénévo<strong>la</strong>t informel est discuté <strong>dans</strong> Prouteau et Wolff (2003) qui<br />
étudient également l’importance de ce comportement en France<br />
à partir d’une exploitation de l’enquête Emploi du <strong>temps</strong> réalisée<br />
par l’<strong>Insee</strong> en 1998-1999. La confusion ne pouvant être faite ici,<br />
puisque l’enquête Vie <strong>associative</strong> n’a pas pour objet d’étudier de<br />
tels services informels, le terme de bénévo<strong>la</strong>t se référera par <strong>la</strong><br />
suite à <strong>la</strong> participation encadrée.<br />
4 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
des données collectées conduisent, en effet, à<br />
opérer des choix auxquels <strong>son</strong>t sensib<strong>les</strong> <strong>les</strong><br />
résultats obtenus. La nature de ces choix explique<br />
que certaines estimations présentées ici,<br />
notamment cel<strong>les</strong> re<strong>la</strong>tives au nombre de bénévo<strong>les</strong>,<br />
diffèrent quelque peu de cel<strong>les</strong> auxquel<strong>les</strong><br />
<strong>son</strong>t parvenus d’autres auteurs à partir des<br />
mêmes sources (Febvre et Muller, 2004a). Il est<br />
donc nécessaire, <strong>dans</strong> un premier <strong>temps</strong>, de présenter<br />
et justifier ces choix. Il sera ensuite possible<br />
d’étudier <strong>les</strong> profils des bénévo<strong>les</strong>, puis<br />
leurs motivations, l’objectif poursuivi étant plus<br />
particulièrement d’appréhender le degré de crédibilité<br />
que tirent de cet exercice <strong>les</strong> hypothèses<br />
comportementa<strong>les</strong> avancées par <strong>les</strong> modè<strong>les</strong><br />
économiques du bénévo<strong>la</strong>t.<br />
Identifier <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong><br />
D<br />
eux volets du questionnaire de l’enquête<br />
ont servi à l’identification des bénévo<strong>les</strong><br />
(cf. encadré 1). Dans le premier d’entre eux, qui<br />
s’adressait aux adhérents associatifs, le répondant<br />
se voyait demander s’il lui était arrivé au<br />
cours des 12 derniers mois « de travailler sans<br />
être rémunéré ou de rendre des services en tant<br />
que bénévole » <strong>dans</strong> <strong>son</strong> association. Il devait<br />
également indiquer, à l’occasion d’une question<br />
ultérieure, s’il était sa<strong>la</strong>rié ou indemnisé hors<br />
remboursement de frais pour ses activités <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong>dite association. La première difficulté à<br />
résoudre <strong>vie</strong>nt des per<strong>son</strong>nes qui, ayant répondu<br />
avoir réalisé des services bénévo<strong>les</strong>, ont déc<strong>la</strong>ré<br />
néanmoins être sa<strong>la</strong>riées ou indemnisées pour<br />
leurs activités <strong>associative</strong>s. Dans l’échantillon,<br />
31 individus <strong>son</strong>t <strong>dans</strong> ce cas, ce qui correspond<br />
à 34 participations bénévo<strong>les</strong> puisqu’un même<br />
individu, dès lors qu’il est multi-adhérent, peut<br />
avoir plusieurs engagements.<br />
Le cas des bénévo<strong>les</strong> sa<strong>la</strong>riés<br />
et des bénévo<strong>les</strong> indemnisés<br />
Deux situations méritent d’être distinguées :<br />
celle des bénévo<strong>les</strong> qui <strong>son</strong>t sa<strong>la</strong>riés de leur<br />
association et celle des bénévo<strong>les</strong> qui se déc<strong>la</strong>rent<br />
indemnisés. Les premiers expriment très<br />
probablement une réalité assez banale <strong>dans</strong> le<br />
milieu associatif, à savoir <strong>la</strong> réalisation par le<br />
per<strong>son</strong>nel rémunéré d’activités plus ou moins<br />
nombreuses à titre gracieux, au nom d’une<br />
adhésion au projet collectif qui est fortement<br />
souhaitée par <strong>les</strong> employeurs. On comprend<br />
bien que ces derniers souhaitent que leurs sa<strong>la</strong>riés<br />
ne soient pas seulement des « mercenaires »<br />
et puissent « s’investir de façon militante <strong>dans</strong><br />
l’association » (Alix, 1999, p. 68). Il n’en<br />
demeure pas moins que cette proximité entre<br />
sa<strong>la</strong>riat et bénévo<strong>la</strong>t peut être, comme le souligne<br />
le Conseil d’État (2000, p. 277), « source de<br />
confusion ou de difficulté concernant le statut<br />
social des per<strong>son</strong>nes travail<strong>la</strong>nt pour <strong>la</strong> même<br />
association » et traduire un respect assez<br />
approximatif du Code du travail. Si le milieu<br />
associatif est davantage exposé à ce mé<strong>la</strong>nge<br />
des genres, il n’en a pas le monopole. Nombre<br />
de sa<strong>la</strong>riés donnent de leur <strong>temps</strong> <strong>dans</strong> le cadre<br />
de leur activité professionnelle.<br />
Mais <strong>la</strong> question se pose alors de savoir <strong>dans</strong><br />
quelle mesure ces activités non rémunérées <strong>son</strong>t<br />
bien volontaires et non le fruit d’une contrainte<br />
dictée par l’état de subordination qui est constitutif<br />
de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion sa<strong>la</strong>riale. Pour ne pas entretenir<br />
l’ambiguïté entre bénévo<strong>la</strong>t et surtravail réalisé<br />
sous l’effet de <strong>la</strong> sujétion, il est généralement<br />
admis d’exclure le lieu d’exercice de l’activité<br />
professionnelle du périmètre de l’engagement<br />
bénévole (Cheroutre, 1989). En conséquence, le<br />
choix a été fait ici de soustraire <strong>les</strong> observations<br />
en question de l’échantillon. La validité d’une<br />
telle option est renforcée par l’hypothèque qui<br />
pèse sur <strong>la</strong> nature des informations communiquées<br />
par <strong>les</strong> répondants concernés en matière de<br />
<strong>temps</strong> consacré à leurs activités <strong>associative</strong>s.<br />
S’agit-il de <strong>la</strong> durée de leur bénévo<strong>la</strong>t ou de celle<br />
de leur activité professionnelle ? La confrontation<br />
des réponses apportées <strong>dans</strong> le questionnaire<br />
de <strong>la</strong> partie Vie <strong>associative</strong> de l’enquête à cel<strong>les</strong><br />
collectées <strong>dans</strong> <strong>la</strong> partie fixe et re<strong>la</strong>tives à<br />
l’emploi montre que, <strong>dans</strong> certains cas au moins,<br />
ce <strong>son</strong>t <strong>les</strong> <strong>temps</strong> de travail rémunéré qui ont été<br />
communiqués. La position de ces individus à<br />
l’égard du bénévo<strong>la</strong>t apparaît <strong>dans</strong> ces circonstances<br />
vraiment peu lisible.<br />
Les bénévo<strong>les</strong> indemnisés soulèvent un problème<br />
un peu différent. La question qui était<br />
posée cherchait à éviter de confondre ces indemnisations<br />
avec <strong>les</strong> remboursements des frais<br />
encourus par <strong>les</strong> per<strong>son</strong>nes qui s’engagent (3).<br />
Ces indemnisations se rapportent-el<strong>les</strong> aux activités<br />
déc<strong>la</strong>rées comme bénévo<strong>les</strong> ou à des activités<br />
additionnel<strong>les</strong> réalisées au sein de <strong>la</strong> même<br />
association ? Rien <strong>dans</strong> l’enquête ne permet<br />
d’éc<strong>la</strong>irer ce point. Mais le premier cas de figure<br />
ne saurait être écarté. L’existence de rétributions<br />
modestes et plus ou moins forfaitaires versées par<br />
3. Même si, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> réalité, il peut être délicat de tracer une frontière<br />
bien nette entre ces deux pratiques. Environ le tiers des individus<br />
concernés déc<strong>la</strong>rent, par ailleurs, ne pas être remboursés<br />
de leurs frais associatifs.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 5
Encadré 1<br />
LE BÉNÉVOLAT DANS L’ENQUÊTE VIE ASSOCIATIVE DE L’INSEE<br />
L’enquête Vie <strong>associative</strong> d’octobre 2002 s’inscrit <strong>dans</strong><br />
le cadre des enquêtes permanentes sur <strong>les</strong> conditions<br />
de <strong>vie</strong> des ménages (EPCVM). Cel<strong>les</strong>-ci visent à étudier<br />
un ensemble d’indicateurs sociaux, répartis en trois<br />
groupes, chacun d’entre eux donnant lieu à une<br />
enquête annuelle. Trois enquêtes <strong>son</strong>t donc réalisées<br />
tous <strong>les</strong> ans, en jan<strong>vie</strong>r, en mai et en octobre. Chacune<br />
d’entre el<strong>les</strong> comporte une partie fixe et une partie<br />
variable, cette dernière concernant un domaine particulier<br />
du comportement des ménages. Ainsi ont pu être<br />
étudiées des questions aussi diverses que <strong>les</strong> nouvel<strong>les</strong><br />
technologies (octobre 2001), <strong>les</strong> comportements vis-àvis<br />
de <strong>la</strong> santé (mai 2001), <strong>les</strong> transmissions familia<strong>les</strong><br />
(octobre 2000), <strong>les</strong> départs en vacances (octobre 1999)<br />
ou bien encore <strong>les</strong> réseaux de parenté et l’entraide<br />
(octobre 1997). L’enquête Vie <strong>associative</strong> représente <strong>la</strong><br />
partie variable d’octobre 2002. L’échantillon est constitué<br />
de 5 799 ménages. Un seul individu de plus de<br />
15 ans par ménage est interrogé.<br />
La partie fixe de l’enquête<br />
Dans <strong>la</strong> partie fixe, <strong>la</strong> composition du ménage est<br />
communiquée : sexe et âge de chaque membre, <strong>son</strong><br />
état matrimonial, <strong>son</strong> niveau d’études, sa situation par<br />
rapport à l’activité professionnelle. Le répondant y<br />
donne également des informations assez détaillées sur<br />
<strong>son</strong> emploi éventuel, l’ancienneté de celui-ci, <strong>les</strong> horaires<br />
et conditions de travail, <strong>la</strong> formation professionnelle<br />
éventuellement sui<strong>vie</strong> au cours des 12 derniers mois. En<br />
cas de chômage, l’ancienneté de recherche d’emploi<br />
est précisée. Le questionnaire de <strong>la</strong> partie fixe renseigne<br />
également sur <strong>la</strong> pratique religieuse et <strong>la</strong> participation<br />
électorale du répondant. Ce dernier est aussi interrogé<br />
sur ses contacts professionnels, quand il exerce un<br />
métier, et sur ses contacts avec <strong>les</strong> membres de sa<br />
famille, ses amis et ses voisins. Une rubrique porte particulièrement<br />
sur <strong>la</strong> <strong>vie</strong> <strong>associative</strong>. Elle figure régulièrement<br />
<strong>dans</strong> l’enquête permanente sur <strong>les</strong> conditions de<br />
<strong>vie</strong> des ménages, afin d’appréhender <strong>les</strong> éventuel<strong>les</strong><br />
évolutions des comportements en <strong>la</strong> matière. Mais elle<br />
n’apporte qu’un nombre restreint d’informations pour<br />
chaque enquêté : nombre d’associations d’appartenance,<br />
degré de participation (simple adhérent, participant<br />
régulier, exercice d’une responsabilité), fréquence<br />
de participation (mais non <strong>les</strong> durées qui y <strong>son</strong>t consacrées)<br />
et domaines d’activité des associations. Il reste<br />
donc de <strong>la</strong>rges zones d’ombre que <strong>la</strong> partie variable de<br />
l’enquête se proposait d’éc<strong>la</strong>irer.<br />
La partie variable de l’enquête<br />
Dans cette partie variable, <strong>les</strong> répondants étaient invités<br />
à indiquer leur adhésion éventuelle à une ou plusieurs<br />
associations. Aux adhérents était présenté un premier<br />
volet du questionnaire qui <strong>les</strong> invitait à donner de nombreuses<br />
précisions sur leur participation à chacune de<br />
leurs associations d’appartenance, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> limite de<br />
deux. Lorsque <strong>les</strong> adhésions étaient plus nombreuses,<br />
un tirage au sort était effectué. Le répondant devait indiquer<br />
s’il était <strong>dans</strong> l’association en tant que « cotisant »,<br />
« participant aux activités ou bénéficiaire des activités »,<br />
« assistant ou accompagnateur, entraîneur, formateur<br />
ou autre fonction d’animateur », ou bien encore comme<br />
« dirigeant, trésorier ou autre élu ». Des questions<br />
étaient posées sur <strong>les</strong> motifs de l’adhésion, <strong>les</strong> activités<br />
proposées par l’association, l’assiduité aux réunions qui<br />
rythment <strong>la</strong> <strong>vie</strong> de cette dernière (assemblées généra<strong>les</strong>,<br />
etc.), <strong>les</strong> cotisations versées, etc. Il était demandé<br />
également si, au cours des 12 derniers mois, il était<br />
arrivé à l’adhérent « de travailler sans être rémunéré ou<br />
de rendre des services <strong>dans</strong> le cadre de cette association<br />
en tant que bénévole (y compris des activités en<br />
tant que dirigeant, animateur ou chargé de tâches diverses<br />
non rémunérées) ». Par ailleurs, il devait également<br />
préciser s’il était sa<strong>la</strong>rié ou indemnisé (hors remboursement<br />
de frais) par l’association <strong>dans</strong> l’exercice des activités<br />
qu’il y réalisait. La confrontation des réponses à<br />
ces différentes questions a révélé, chez un certain nombre<br />
d’enquêtés, quelques surprises dont le traitement<br />
est discuté <strong>dans</strong> le corps de l’article.<br />
Chaque per<strong>son</strong>ne ayant rendu des services non rémunérés<br />
indiquait si elle le faisait « régulièrement » ou<br />
« seulement à certaines périodes ». C’est à partir de<br />
cette information qu’a été opérée <strong>la</strong> distinction entre<br />
bénévo<strong>les</strong> réguliers et bénévo<strong>les</strong> occasionnels. Sont<br />
également documentés <strong>la</strong> durée consacrée à ses services,<br />
<strong>la</strong> nature des compétences exercées, et <strong>les</strong> transferts<br />
éventuels de compétences entre activité professionnelle<br />
et activité <strong>associative</strong>. Ce premier volet du<br />
questionnaire constitue une des deux sources de documentation<br />
sur l’engagement bénévole. Une source<br />
complémentaire est représentée par un deuxième volet<br />
du questionnaire qui s’adressait à deux publics :<br />
- <strong>les</strong> répondants qui, en fonction de leur nombre élevé<br />
d’adhésions, n’avaient pu renseigner toutes leurs participations<br />
<strong>dans</strong> le premier volet et qui déc<strong>la</strong>raient faire<br />
du bénévo<strong>la</strong>t <strong>dans</strong> d’autres organismes, associatifs ou<br />
non ;<br />
- ceux qui, adhérents ou non, s’adonnaient au bénévo<strong>la</strong>t<br />
<strong>dans</strong> un organisme sans en être membres.<br />
Les intéressés devaient alors déc<strong>la</strong>rer le nombre des<br />
engagements concernés. Ils étaient interrogés sur deux<br />
d’entre eux au maximum (avec, au besoin, de nouveau<br />
un tirage au sort), sur <strong>la</strong> base de questions assez simi<strong>la</strong>ires<br />
à celle du premier volet. On notera néanmoins que<br />
<strong>dans</strong> ce second volet, plusieurs informations re<strong>la</strong>tives à<br />
<strong>la</strong> structure d’accueil font défaut. Tel est le cas notamment<br />
de <strong>la</strong> taille de l’organisme et de <strong>la</strong> présence de<br />
sa<strong>la</strong>riés. Tout juste demandait-on à <strong>la</strong> per<strong>son</strong>ne d’indiquer<br />
si elle pratiquait <strong>dans</strong> une association ou <strong>dans</strong> un<br />
organisme d’une autre nature. En effet, <strong>dans</strong> ce second<br />
volet, à <strong>la</strong> différence du premier qui ne concerne que <strong>les</strong><br />
associations, <strong>les</strong> organisations concernées <strong>son</strong>t plus<br />
composites. On peut notamment trouver des organismes<br />
publics (municipaux par exemple). L’information<br />
sur le statut de l’organisme est recueillie à un niveau<br />
général et non à celui de chacun des engagements qui<br />
font l’objet de questions. Dès lors que <strong>la</strong> per<strong>son</strong>ne interrogée<br />
déc<strong>la</strong>re avoir des activités <strong>dans</strong> plusieurs organismes<br />
dont <strong>les</strong> statuts <strong>son</strong>t distincts, il est impossible<br />
d’opérer un appariement entre <strong>les</strong> statuts et <strong>les</strong> engagements.<br />
Cette situation fait obstacle à une délimitation<br />
précise du seul bénévo<strong>la</strong>t associatif en matière de<br />
domaines d’engagement et de durées consacrées à <strong>la</strong><br />
participation.<br />
�<br />
6 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
Encadré 1 (suite)<br />
En sus de ces deux volets, le questionnaire demandait<br />
aux non-adhérents <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s qui <strong>les</strong> conduisaient à ne<br />
pas être membres d’une association. Ils indiquaient<br />
également s’ils avaient, par le passé, été membres<br />
d’une association quittée depuis et, <strong>dans</strong> ce cas, ils<br />
étaient invités à donner <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s de ce départ. Tous<br />
<strong>les</strong> enquêtés répondaient également à une rubrique<br />
concernant leurs éventuels dons monétaires et en<br />
nature au profit d’associations ou d’autres organismes,<br />
qu’ils en aient été ou non membres, ainsi qu’au recours<br />
aux services associatifs en tant qu’usagers. Les principaux<br />
résultats descriptifs de cette enquête <strong>son</strong>t présentés<br />
<strong>dans</strong> Febvre et Muller (2003) (1).<br />
Dans le premier volet du questionnaire, on repère l’intégralité<br />
du bénévo<strong>la</strong>t réalisé en tant qu’adhérents par <strong>les</strong><br />
individus qui <strong>son</strong>t membres d’une ou de deux associations.<br />
Il n’en est plus de même lorsque <strong>les</strong> adhésions <strong>son</strong>t<br />
plus nombreuses. En effet, comme <strong>les</strong> associations sur<br />
<strong>les</strong>quel<strong>les</strong> porte le questionnaire <strong>son</strong>t alors tirées au sort,<br />
certaines des participations échappent au repérage. Ce<br />
bénévo<strong>la</strong>t sera identifié <strong>dans</strong> le deuxième volet, pour<br />
autant qu’il soit bien déc<strong>la</strong>ré comme tel, et à concurrence<br />
de deux engagements. Toutefois, quelques-unes des<br />
participations bénévo<strong>les</strong> des per<strong>son</strong>nes, pratiquant <strong>dans</strong><br />
un nombre élevé d’associations ou d’organismes d’une<br />
autre nature, échappent à l’enquête. Cette perte d’information<br />
est sans conséquence sur le calcul des taux de<br />
participation bénévole au niveau agrégé, mais elle affecte<br />
ceux qui concernent le type d’engagement, régulier ou<br />
occasionnel, puisque cette précision n’est connue que<br />
pour <strong>les</strong> participations dûment renseignées. Le calcul<br />
des durées consacrées au bénévo<strong>la</strong>t se trouve également<br />
perturbé puisque évidemment on ne connaît pas<br />
<strong>les</strong> <strong>temps</strong> affectés aux participations sur <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>les</strong><br />
enquêtés ne <strong>son</strong>t pas interrogés.<br />
Il est cependant très probable que, si biais il y a, il reste<br />
mineur. Car au total, le nombre de participations sur<br />
lequel l’enquête ne fournit aucune indication reste<br />
limité. Il est en effet possible de croiser le nombre de<br />
participations déc<strong>la</strong>rées et le nombre de participations<br />
documentées par l’enquête (cf. tableau). Sur <strong>les</strong> effectifs<br />
originels, c’est-à-dire avant élimination des quelques<br />
observations dont <strong>les</strong> informations prêtes à discussion,<br />
31 individus <strong>son</strong>t concernés par un nombre<br />
d’engagements renseignés inférieur au nombre d’enga-<br />
gements déc<strong>la</strong>rés. Ce<strong>la</strong> correspond à 51 engagements<br />
ignorés par l’enquête, soit 2,4 % du total. (1)<br />
S’agissant du <strong>temps</strong> consacré à l’activité bénévole, <strong>les</strong><br />
questions posées aux enquêtés ne permettaient pas de<br />
<strong>les</strong> connaître spontanément. Deux situations doivent à<br />
cet égard être distinguées. Pour <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> occasionnels,<br />
il était demandé pendant combien de jours,<br />
semaines ou mois ils avaient rendu des services non<br />
rémunérés, et à rai<strong>son</strong> de combien d’heures par jour,<br />
par semaine ou par mois. Les questions posées ont parfois<br />
donné lieu à des réponses qui n’étaient pas très<br />
cohérentes ou du moins insuffisamment explicites. Par<br />
exemple, tel bénévole indiquait qu’il s’était consacré à<br />
<strong>son</strong> activité pendant 10 jours à rai<strong>son</strong> de 5 heures par<br />
mois. Ces cas, heureusement peu nombreux, ont<br />
donné lieu à des estimations qui ont été guidées par le<br />
souci de ne pas surestimer <strong>les</strong> durées déc<strong>la</strong>rées. Ainsi,<br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> situation ci-dessus évoquée, le nombre d’heures<br />
imputées au bénévole a été de 5, l’hypothèse ayant<br />
été faite que <strong>les</strong> 5 heures n’ont pas été réparties sur<br />
plus d’un mois. Si donc il y a approximation, elle est<br />
faite ici délibérément par défaut plutôt que par excès.<br />
Pour <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> réguliers, seule <strong>la</strong> question « À rai<strong>son</strong><br />
de combien d’heures par jour, par semaine ou par<br />
mois ? » était posée, sans que le nombre de jours, de<br />
semaines ou de mois <strong>dans</strong> l’année soit explicite. Le calcul<br />
des durées annuel<strong>les</strong> nécessite donc certaines<br />
hypothèses sur le rythme de <strong>la</strong> <strong>vie</strong> <strong>associative</strong>. Un<br />
répondant ayant déc<strong>la</strong>ré une fréquence journalière de<br />
<strong>son</strong> bénévo<strong>la</strong>t a été supposé se consacrer pendant<br />
5 jours par semaine au bénévo<strong>la</strong>t, durant 40 semaines<br />
au cours de l’année. Si donc il a déc<strong>la</strong>ré une heure par<br />
jour, il lui sera compté 200 heures par an. Si c’est<br />
l’horaire hebdomadaire qui a été indiqué, il est multiplié<br />
par 40. Si l’enquêté indique <strong>son</strong> horaire mensuel, il est<br />
multiplié par 10. Là encore, c’est le souci d’éviter une<br />
surestimation qui a prévalu en considérant que <strong>la</strong> durée<br />
de « l’année <strong>associative</strong> » était inférieure à celle de<br />
l’année civile.<br />
1. Le questionnaire complet de l’enquête peut être trouvé<br />
<strong>dans</strong> le document de travail de Febvre et Muller (2004b), qui<br />
comporte des résultats descriptifs supplémentaires.<br />
Répartition des effectifs de l’enquête Vie <strong>associative</strong> selon <strong>les</strong> engagements bénévo<strong>les</strong><br />
déc<strong>la</strong>rés et <strong>les</strong> engagements documentés par cette enquête<br />
Nombre d’engagements déc<strong>la</strong>rés<br />
Nombre d’engagements documentés<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 14 Total<br />
0 4 193 0 0 0 0 0 0 0 0 4 193<br />
1 0 1 201 0 0 0 0 0 0 0 1 201<br />
2 0 0 320 7 4 1 0 0 0 332<br />
3 0 0 0 51 11 2 0 0 0 64<br />
4 0 0 0 0 3 3 1 1 1 9<br />
Total 4 193 1 201 320 58 18 6 1 1 1 5 799<br />
Lecture : le tableau prend en compte l’ensemble des effectifs de bénévo<strong>les</strong> avant retrait d’observations du fait des problèmes soulevés<br />
par <strong>les</strong> déc<strong>la</strong>rations de certains répondants. Il se lit de <strong>la</strong> manière suivante : 7 répondants de l’enquête Vie <strong>associative</strong> ont<br />
deux engagements documentés alors qu’ils en ont déc<strong>la</strong>rés trois.<br />
Source : enquête Vie <strong>associative</strong>, <strong>Insee</strong>, 2002.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 7
certaines associations à leurs bénévo<strong>les</strong> est une<br />
pratique connue, même si elle n’est pas fréquente<br />
et même si elle expose au risque de requalification<br />
en contrat de travail qui entraîne alors le<br />
paiement des charges socia<strong>les</strong> et des taxes re<strong>la</strong>tives<br />
à l’emploi d’un sa<strong>la</strong>rié. Faut-il, <strong>dans</strong> ces conditions,<br />
intégrer <strong>les</strong> services concernés <strong>dans</strong> le<br />
champ du bénévo<strong>la</strong>t ? La réponse ne fait pas consensus<br />
(Cnaan et al., 1996).<br />
Dans une acception stricte du terme, le bénévo<strong>la</strong>t<br />
ne tolère aucune contrepartie monétaire, hors<br />
compensation des frais que l’activité induit.<br />
Certains auteurs, plus particulièrement anglosaxons,<br />
<strong>son</strong>t toutefois enclins à introduire une<br />
marge de tolérance envers l’existence d’une<br />
rétribution, dès lors qu’elle est « minime » (4).<br />
Il est alors question de « bénévo<strong>les</strong> appointés »<br />
(stipended volunteers), <strong>les</strong>quels ont fait l’objet<br />
d’études spécifiques (Mesch et al., 1998 ;<br />
Tschirhart et al., 2001). Dans cet article, c’est<br />
une définition stricte du comportement bénévole<br />
qui a été retenue et, de ce fait, <strong>les</strong> observations<br />
dont il <strong>vie</strong>nt d’être question <strong>son</strong>t écartées.<br />
Au regard des effectifs en cause, ce choix a des<br />
conséquences limitées puisqu’il concerne un<br />
peu plus de 2 % des engagements bénévo<strong>les</strong><br />
déc<strong>la</strong>rés <strong>dans</strong> le premier volet du questionnaire<br />
(5). Il n’en va pas de même pour le second<br />
problème rencontré <strong>dans</strong> <strong>la</strong> construction de<br />
l’indicateur de participation bénévole.<br />
Être bénévole sans le déc<strong>la</strong>rer<br />
Parmi <strong>les</strong> per<strong>son</strong>nes qui ne se <strong>son</strong>t pas identifiées<br />
comme bénévo<strong>les</strong>, il s’en trouve qui reconnaissent<br />
néanmoins, à l’occasion d’une autre<br />
question, se consacrer, sans être ni sa<strong>la</strong>riés ni<br />
indemnisés, à des tâches d’assistance ou<br />
d’accompagnement, d’entraînement, de formation<br />
ou d’animation, d’administration ou de<br />
direction. Les durées passées à ces activités, au<br />
cours des 12 derniers mois, <strong>son</strong>t alors dûment<br />
renseignées, ce qui exclut qu’il s’agisse d’engagements<br />
anciens qui auraient été abandonnés<br />
depuis lors. 153 per<strong>son</strong>nes <strong>son</strong>t <strong>dans</strong> ce cas, ce<br />
qui représente 14 % des bénévo<strong>les</strong> qui se <strong>son</strong>t<br />
déc<strong>la</strong>rés comme tels. Comment expliquer<br />
l’apparente incohérence de leurs réponses ?<br />
Une telle situation a peut-être, au moins partiellement,<br />
une origine lexicale. Parler de bénévo<strong>les</strong> et<br />
de bénévo<strong>la</strong>t, c’est « utiliser un vocabu<strong>la</strong>ire<br />
chargé d’images » (Porte et Ni<strong>son</strong>, 1975). La<br />
charge symbolique que véhicule ce vocabu<strong>la</strong>ire<br />
est souvent attractive, quand le mot est associé au<br />
dévouement, à <strong>la</strong> disponibilité, au souci d’autrui,<br />
mais elle peut être aussi répulsive lorsqu’il évo-<br />
que <strong>les</strong> « dames patronnesses » de jadis, l’inclination<br />
au paternalisme et au moralisme ou tout<br />
simplement l’amateurisme. O’Neill (2001), se<br />
référant à une étude réalisée à San Francisco,<br />
note ainsi que des termes comme charité, phi<strong>la</strong>nthropie,<br />
don ou bénévo<strong>la</strong>t (volunteering) <strong>son</strong>t<br />
peu prisés des communautés de gens de couleur<br />
qui leur préfèrent <strong>les</strong> termes de partage ou d’aide.<br />
La réticence à l’égard du mot de bénévo<strong>la</strong>t peut<br />
ne pas procéder des dispositions de <strong>la</strong> per<strong>son</strong>ne,<br />
mais plutôt de <strong>la</strong> culture de l’association. Dans<br />
certaines structures, on préfèrera parler de militant<br />
ou de volontaire plutôt que de bénévole.<br />
Sous l’angle de leurs caractéristiques sociodémographiques,<br />
<strong>les</strong> individus de l’enquête Vie <strong>associative</strong><br />
qui réalisent des activités non rémunérées<br />
pour leur association sans se dire bénévo<strong>les</strong> ne<br />
présentent pas de différences notab<strong>les</strong> par rapport<br />
à ceux qui se déc<strong>la</strong>rent comme tels. Ils <strong>son</strong>t toutefois<br />
plus fréquemment engagés <strong>dans</strong> le<br />
domaine éducatif ou <strong>dans</strong> celui de <strong>la</strong> défense des<br />
droits (<strong>dans</strong> plus de quatre cas sur dix pour <strong>les</strong><br />
premiers contre un peu plus d’un cas sur quatre<br />
pour <strong>les</strong> seconds). Or ces domaines recouvrent<br />
certains engagements (<strong>dans</strong> l’éducation popu<strong>la</strong>ire<br />
ou <strong>les</strong> groupements syndicaux par exemple)<br />
plus propices que d’autres à cultiver <strong>la</strong> référence<br />
au militantisme plutôt qu’au bénévo<strong>la</strong>t. (4) (5)<br />
On ne peut exclure non plus que certains répondants<br />
ne se soient pas identifiés comme bénévo<strong>les</strong><br />
du fait du caractère ponctuel des services<br />
qu’ils rendent. L’aide apportée serait alors trop<br />
épisodique et modeste pour revêtir à leurs yeux le<br />
caractère de bénévo<strong>la</strong>t. Effectivement, <strong>les</strong> participations<br />
non déc<strong>la</strong>rées comme bénévo<strong>les</strong> <strong>son</strong>t<br />
plus fréquemment irrégulières que <strong>les</strong> participations<br />
reconnues comme tel<strong>les</strong> (deux tiers contre<br />
56 %). Leur durée moyenne annuelle est également<br />
plus faible (58 heures contre 86 heures).<br />
4. Le problème, <strong>dans</strong> ce cas, est de préciser ce qui est entendu<br />
par « minime ». En général, il s’agit d’émoluments inférieurs à une<br />
valeur de référence. Mais cette dernière n’est pas toujours aisée<br />
à estimer. Pour Menchik et Weisbrod (1987, p. 172, note 9), il y a<br />
activité bénévole dès lors que <strong>la</strong> rémunération perçue est inférieure<br />
au coût d’opportunité de l’individu. Pour Smith (1981,<br />
p. 23), <strong>la</strong> valeur qui sert de référence est celle du service rendu<br />
s’il devait être acquis sur le marché. Knapp (1990, p. 9) souligne,<br />
pour sa part, que « le bénévo<strong>la</strong>t n’a pas besoin d’être confiné à<br />
ces choses faites sans rémunérations financières » car il peut<br />
tout aussi bien concerner des activités qui se voient affectées un<br />
faible sa<strong>la</strong>ire, « quelque peu inférieur au sa<strong>la</strong>ire courant du<br />
marché ».<br />
5. Ce <strong>son</strong>t <strong>les</strong> seu<strong>les</strong> participations correspondant aux situations<br />
ici évoquées qui ont été éliminées et non pas nécessairement <strong>les</strong><br />
individus qui s’y consacrent. Ceux-ci ont été conservés chaque<br />
fois qu’ils signa<strong>la</strong>ient d’autres engagements bénévo<strong>les</strong> qui<br />
n’étaient pas sujets à ces ambiguïtés.<br />
8 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
Exclure ces dons de <strong>temps</strong> du bénévo<strong>la</strong>t au<br />
motif qu’ils ne <strong>son</strong>t pas identifiés sous ce terme<br />
par ceux qui <strong>les</strong> réalisent, alors même qu’ils en<br />
présentent toutes <strong>les</strong> conditions, ne serait guère<br />
justifiable. Ce serait soumettre <strong>la</strong> construction<br />
de l’indicateur de participation aux seu<strong>les</strong> perceptions<br />
spontanées des acteurs. S’il est impossible<br />
d’échapper complètement à cet effet de<br />
subjectivité (il est inévitable que <strong>les</strong> activités<br />
déc<strong>la</strong>rées par <strong>les</strong> enquêtés portent peu ou prou<br />
l’empreinte des représentations qu’ils s’en<br />
font), il reste utile d’en limiter <strong>la</strong> portée <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
mesure où ce<strong>la</strong> s’avère réalisable. Ainsi, <strong>les</strong><br />
enquêtes spécifiques sur le bénévo<strong>la</strong>t réalisées<br />
en Grande-Bretagne par le National Centre of<br />
Volunteering excluent systématiquement de<br />
leurs questionnaires toute évocation des termes<br />
« bénévole » et « bénévo<strong>la</strong>t ». El<strong>les</strong> multiplient<br />
plutôt <strong>les</strong> questions sur <strong>la</strong> nature des activités<br />
non rémunérées des répondants et le contexte de<br />
leur déroulement, ce qui permet au chercheur de<br />
construire ex post un indicateur de participation<br />
bénévole en fonction de <strong>la</strong> définition qu’il<br />
entend en retenir (Lynn et Davis Smith, 1992 ;<br />
Davis Smith, 1998).<br />
En accord avec cette approche, le choix a été fait<br />
d’intégrer ces activités non rétribuées <strong>dans</strong> le<br />
périmètre du bénévo<strong>la</strong>t. L’enjeu statistique n’est<br />
pas négligeable puisque <strong>les</strong> écarter re<strong>vie</strong>ndrait à<br />
diminuer le nombre de bénévo<strong>les</strong> repérés <strong>dans</strong><br />
l’échantillon de 112 unités, soit 7 % de l’effectif<br />
total des participants finalement retenu. Extrapolée<br />
à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale à partir des coefficients<br />
de pondération, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion bénévole en<br />
ressortirait amoindrie d’environ 900 000 per<strong>son</strong>nes<br />
(6).<br />
Pour conclure ces considérations sur <strong>la</strong> constitution<br />
de l’indicateur de participation bénévole, il<br />
con<strong>vie</strong>nt de noter que le deuxième volet du<br />
questionnaire utilisé <strong>dans</strong> cet exercice n’offre<br />
pas tout à fait <strong>les</strong> mêmes informations que le<br />
premier et ne permet donc pas de soumettre <strong>les</strong><br />
réponses obtenues aux mêmes vérifications.<br />
D’une part, tous <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> identifiés <strong>dans</strong> ce<br />
second volet <strong>son</strong>t, par construction du questionnaire,<br />
des bénévo<strong>les</strong> qui se déc<strong>la</strong>rent en tant que<br />
tels. On peut donc supposer, là encore pour des<br />
rai<strong>son</strong>s simi<strong>la</strong>ires à cel<strong>les</strong> déjà évoquées, que<br />
certains enquêtés ne se <strong>son</strong>t pas signalés comme<br />
bénévo<strong>les</strong> et ont échappé au repérage. D’autre<br />
part, il n’est pas possible de savoir si <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong><br />
concernés par ce second volet <strong>son</strong>t également<br />
sa<strong>la</strong>riés de l’association ou <strong>son</strong>t indemnisés<br />
par elle. On ne peut exclure que tel soit le cas<br />
pour certains d’entre eux. Au regard des conventions<br />
adoptées ici, il aurait alors fallu <strong>les</strong><br />
écarter. Il est évidemment impossible d’évaluer<br />
l’impact de ces deux facteurs sur le chiffrage de<br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion bénévole, le premier jouant <strong>dans</strong><br />
le sens de <strong>la</strong> sous-estimation et le second <strong>dans</strong> le<br />
sens contraire. Mais au regard de l’importance<br />
de chacun de ces facteurs révélée <strong>dans</strong> le premier<br />
volet du questionnaire, il est p<strong>la</strong>usible de<br />
penser qu’au total <strong>les</strong> effectifs de bénévo<strong>les</strong> calculés<br />
ici <strong>son</strong>t plutôt minorés par rapport à <strong>la</strong><br />
situation réelle. (6)<br />
Un portrait des bénévo<strong>les</strong><br />
ne fois le champ du bénévo<strong>la</strong>t ainsi circonscrit,<br />
il reste à en estimer l’importance<br />
telle qu’elle apparaît <strong>dans</strong> l’enquête Vie <strong>associative</strong>.<br />
Le taux de participation des plus de<br />
15 ans, calculé sur <strong>les</strong> effectifs pondérés, est de<br />
27,6 % (cf. tableau 1). Plus d’une per<strong>son</strong>ne de<br />
plus de 15 ans sur quatre fait donc du bénévo<strong>la</strong>t<br />
Ce<strong>la</strong> représente, par extrapo<strong>la</strong>tion à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
totale de même âge, 13 millions de per<strong>son</strong>nes<br />
(7).<br />
En moyenne, un don de <strong>temps</strong><br />
de 2,5 heures par semaine<br />
Le <strong>temps</strong> moyen annuel consacré par chaque<br />
bénévole à rendre ces services non rémunérés<br />
est d’environ 100 heures ce qui, au regard des<br />
conventions retenues pour ce calcul, représente<br />
2,5 heures par semaine (cf. encadré 1). Mais on<br />
notera <strong>la</strong> forte dispersion de ces <strong>temps</strong> autour de<br />
<strong>la</strong> moyenne, ce qui se manifeste au travers de<br />
l’importance des écarts-types. Ainsi, tandis que<br />
<strong>les</strong> deux tiers des bénévo<strong>les</strong> se consacrent à<br />
leurs activités pendant tout au plus une heure<br />
par semaine, 11 % leur consacrent au moins<br />
6 heures. La contribution des premiers ne représente<br />
que 8 % du <strong>temps</strong> global voué au bénévo<strong>la</strong>t<br />
encadré tandis que celle des seconds s’élève<br />
à près de 60 %.<br />
Les trois quarts des bénévo<strong>les</strong> n’ont qu’un seul<br />
engagement, un sur cinq en a deux et un sur<br />
vingt en a au moins trois. Comme l’intuition le<br />
<strong>la</strong>isse présager, le <strong>temps</strong> affecté au bénévo<strong>la</strong>t<br />
croît avec le nombre de participations.<br />
6. Si 153 individus <strong>son</strong>t concernés par cette situation, 41 d’entre<br />
eux auraient néanmoins été retenus en tant que bénévo<strong>les</strong> car<br />
déc<strong>la</strong>rant des engagements identifiés comme tels <strong>dans</strong> d’autres<br />
associations. 112 auraient donc échappé à <strong>la</strong> mesure.<br />
7. Pour cette extrapo<strong>la</strong>tion, ce <strong>son</strong>t <strong>les</strong> poids de <strong>son</strong>dage qui ont<br />
été utilisés, sans que ces derniers n’aient été corrigés du fait de<br />
l’élimination de quelques observations de l’échantillon des individus<br />
(28 au total).<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 9<br />
U
Un engagement plus masculin que féminin<br />
Afin d’examiner l’effet propre, toutes choses<br />
éga<strong>les</strong> par ailleurs, de certaines caractéristiques<br />
sociodémographiques sur le comportement bénévole,<br />
des investigations économétriques ont été<br />
menées, d’une part sur <strong>la</strong> participation et d’autre<br />
part sur <strong>les</strong> durées qui lui <strong>son</strong>t dédiées. S’agissant<br />
du premier aspect, un modèle Probit dichotomique<br />
est estimé sur l’ensemble de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />
Tout comme <strong>la</strong> participation <strong>associative</strong> en géné-<br />
Tableau 1<br />
La participation au bénévo<strong>la</strong>t<br />
ral (Prouteau et Wolff, 2002), l’engagement<br />
bénévole s’avère être plus masculin que féminin,<br />
du moins au niveau agrégé considéré ici <strong>dans</strong><br />
cette phase de l’étude (cf. tableau 2, colonne 1).<br />
Le profil par âge de <strong>la</strong> participation présente une<br />
allure en cloche avec un maximum à 46 ans.<br />
Vivre en couple augmente <strong>la</strong> probabilité de<br />
l’engagement, mais le coefficient associé à cette<br />
variable n’est significatif qu’au seuil de 10 %.<br />
A priori, le rôle des enfants sur <strong>la</strong> pratique du<br />
bénévo<strong>la</strong>t est ambivalent. D’un côté, par <strong>les</strong><br />
Variab<strong>les</strong> Fréquence (en %)<br />
Durée annuelle par participant<br />
(en heures)<br />
Moyenne Écart-type<br />
Participation (en % de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale)<br />
Bénévo<strong>la</strong>t 27,6 99,9 204,9<br />
Bénévo<strong>la</strong>t régulier 12,1 175,9 275,7<br />
Bénévo<strong>la</strong>t occasionnel<br />
Répartition des bénévo<strong>les</strong> selon le nombre d’organismes<br />
<strong>dans</strong> <strong>les</strong>quels ils pratiquent<br />
18,6 33,0 58,9<br />
Un organisme 75,3 72,5 151,8<br />
Deux organismes 19,5 168,8 287,3<br />
Plus de deux organismes<br />
Bénévo<strong>la</strong>t par domaine d’activité (en %)<br />
5,2 243,8 344,6<br />
Sport 26,2 78,8 125,2<br />
Culture et loisirs 32,6 86,0 206,0<br />
Éducation 13,8 45,7 87,8<br />
Défense de droits 18,5 79,7 149,9<br />
Action sociale, sanitaire et humanitaire 15,5 110,1 259,7<br />
Religieux 7,5 110,3 220,8<br />
Autres domaines<br />
Bénévo<strong>la</strong>t régulier par domaine d’activité (en %)<br />
7,1 75,1 149,7<br />
Sport 21,6 154,1 166,7<br />
Culture et loisirs 27,2 178,3 309,2<br />
Éducation 11,4 95,3 124,2<br />
Défense de droits 18,2 145,8 201,2<br />
Action sociale, sanitaire et humanitaire 14,2 216,4 375,2<br />
Religieux 10,8 158,4 242,6<br />
Autres domaines<br />
Bénévo<strong>la</strong>t occasionnel par domaine d’activité (en %)<br />
5,9 147,0 192,8<br />
Sport 26,2 33,3 57,7<br />
Culture et loisirs 32,3 30,1 50,3<br />
Éducation 12,8 15,0 23,5<br />
Défense de droits 15,6 27,6 47,0<br />
Action sociale, sanitaire et humanitaire 14,3 34,8 57,1<br />
Religieux 4,3 25,0 49,3<br />
Autres domaines 7,0 31,1 92,1<br />
Lecture : <strong>les</strong> informations contenues <strong>dans</strong> ce tableau ont été obtenues à partir des effectifs pondérés. Les durées consacrées aux activités<br />
bénévo<strong>les</strong> <strong>son</strong>t calculées sur <strong>les</strong> seuls participants aux activités concernées. Les taux de participation par domaine <strong>son</strong>t obtenus<br />
à partir des popu<strong>la</strong>tions qui pratiquent le type de bénévo<strong>la</strong>t (global, régulier, occasionnel) dont <strong>la</strong> répartition sectorielle est envisagée.<br />
La somme de ces taux sectoriels de participation est supérieure à 100 du fait des engagements multip<strong>les</strong>. On lira ainsi que 27,6 % de<br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale de plus de 15 ans fait du bénévo<strong>la</strong>t encadré, <strong>la</strong> durée moyenne consacrée à cet engagement étant de 99,9 heures<br />
par an et par participant. 26,2 % des bénévo<strong>les</strong> s’adonnent à leurs activités <strong>dans</strong> le domaine sportif, <strong>la</strong> durée moyenne annuelle de ce<br />
type de bénévo<strong>la</strong>t étant de 78,8 heures par participant.<br />
Source : enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.<br />
10 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
Tableau 2<br />
Les déterminants du bénévo<strong>la</strong>t<br />
Variab<strong>les</strong> Participation au bénévo<strong>la</strong>t Temps bénévole (log)<br />
Coef. t-test Coef. t-test<br />
Constante - 2,081 *** - 13,74 3,247 *** 7,11<br />
Sexe féminin - 0,180 *** - 4,75 - 0,213 *** - 2,62<br />
Âge 0,032 *** 5,48 0,030 ** 2,20<br />
Âge au carré (10E-2) - 0,034 *** - 6,04 - 0,024 * - 1,72<br />
En couple 0,075 * 1,65 - 0,252 *** - 2,58<br />
Enfants 0 Réf. Réf.<br />
1, moins de 3 ans - 0,351 *** - 2,90 - 0,142 - 0,52<br />
1, plus de 3 ans 0,053 0,84 - 0,189 - 1,44<br />
2, 1 de moins de 3 ans - 0,215 ** - 1,98 - 0,088 - 0,38<br />
2, plus de 3 ans 0,099 1,50 - 0,407 *** - 3,06<br />
3 et plus, 1 de moins de 3 ans - 0,120 - 0,81 0,084 0,26<br />
3 et plus, plus de 3 ans 0,301 *** 3,01 - 0,123 - 0,64<br />
Formation Sans diplôme Réf. Réf.<br />
CEP 0,174 ** 2,38 - 0,086 - 0,48<br />
CAP - BEP - BEPC 0,299 *** 4,85 0,170 1,10<br />
Bac 0,563 *** 7,84 0,482 *** 2,65<br />
Bac + 2 0,473 *** 5,82 0,203 1,05<br />
Supérieur à Bac + 2 0,650 *** 8,30 - 0,054 - 0,28<br />
Revenu annuel Moins de 12 195 € Réf. Réf.<br />
De 12 195 à 18 293 € 0 1,48 - 0,163 - 1,21<br />
De 18 293 à 27 439 € 0,131 ** 2,26 0,018 0,14<br />
De 27 439 à 45 732 € 0,174 *** 2,81 0,095 0,72<br />
Plus de 45 732 € 0,228 *** 2,77 - 0,173 - 1,06<br />
Propriétaire de <strong>son</strong> logement 0,132 *** 3,05<br />
Religion Pratique régulière 0,344 *** 5,43<br />
Pratique occasionnelle - 0,014 - 0,26<br />
Appartenance sans pratique - 0,051 - 1,10<br />
Ni appartenance, ni pratique Réf.<br />
Père bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,382 *** 7,45<br />
Mère bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,258 *** 3,98<br />
Résidence Commune rurale 0,263 *** 5,05<br />
Urbaine < 20 000 h. 0,170 *** 3,01<br />
De 20 000 à 100 000 h. 0,103 * 1,67<br />
Plus de 100 000 h. Réf.<br />
Région Région parisienne Réf.<br />
Bassin parisien 0,077 1,10<br />
Nord 0,154 * 1,79<br />
Est 0,157 ** 1,98<br />
Ouest 0,280 *** 3,94<br />
Sud-Ouest 0,232 *** 3,10<br />
Centre-Est 0,300 *** 4,07<br />
Méditerranée 0,079 1,06<br />
Corré<strong>la</strong>tion des résidus - 0,175 1,63<br />
Nombre d’observations 5 771 5 771<br />
Nombre de bénévo<strong>les</strong> 1 578 1 578<br />
Log vraisemb<strong>la</strong>nce - 3070,0 - 5981,8<br />
Lecture : <strong>la</strong> participation bénévole est estimée à partir d’un modèle Probit, <strong>les</strong> <strong>temps</strong> bénévo<strong>les</strong> <strong>son</strong>t obtenus à partir d’un modèle de<br />
sélection à <strong>la</strong> Heckman estimé par maximisation de <strong>la</strong> vraisemb<strong>la</strong>nce. Les seuils de significativité <strong>son</strong>t respectivement égaux à 1 % ( *** ),<br />
5 % ( ** ) et 10 % ( * ).<br />
Source: enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 11
tâches additionnel<strong>les</strong> que leur présence entraîne,<br />
ils contribuent à raréfier le <strong>temps</strong> disponible des<br />
adultes, ce qui pèse négativement sur <strong>la</strong> disposition<br />
à s’engager. Mais de l’autre, <strong>les</strong> enfants<br />
peuvent inciter à <strong>la</strong> participation bénévole<br />
parentale si celle-ci vise à réaliser certains services<br />
qui leur <strong>son</strong>t destinés. Pour tenter de dissocier<br />
<strong>les</strong> deux effets, le nombre d’enfants de<br />
moins de 18 ans <strong>dans</strong> le ménage a été croisé<br />
avec l’âge du plus jeune, l’hypothèse étant faite<br />
que l’effet désincitatif devait être plus fort en<br />
présence d’un enfant en bas âge. Les résultats<br />
obtenus valident <strong>la</strong>rgement cette conjecture.<br />
Avoir un enfant de moins de trois ans décourage<br />
<strong>la</strong> pratique du bénévo<strong>la</strong>t sauf <strong>dans</strong> <strong>les</strong> famil<strong>les</strong><br />
nombreuses (d’au moins trois enfants). Dans ce<br />
dernier cas, l’incitation à participer qui apparaît<br />
très c<strong>la</strong>irement et significativement quand tous<br />
<strong>les</strong> enfants <strong>son</strong>t plus âgés neutralise l’impact<br />
défavorable du très jeune enfant.<br />
Le niveau de formation initiale<br />
joue sur l’engagement<br />
L’effet particulièrement discriminant du niveau<br />
de <strong>la</strong> formation initiale sur <strong>la</strong> participation bénévole<br />
est désormais un constat <strong>la</strong>rgement partagé<br />
en France (Prouteau, 1998) comme à l’étranger<br />
(Smith, 1994). La robustesse de ce résultat est<br />
confirmé ici. Néanmoins, l’influence très incitative<br />
du niveau de diplôme tend quelque peu à se<br />
stabiliser à partir du bacca<strong>la</strong>uréat.<br />
Le statut d’occupation du logement a aussi été<br />
introduit parmi <strong>les</strong> caractéristiques socioéconomiques<br />
des enquêtés. Il s’agit de tester<br />
l’hypothèse selon <strong>la</strong>quelle être propriétaire incite<br />
à être plus attentif à <strong>la</strong> qualité de <strong>son</strong> environnement<br />
résidentiel, donc a priori plus enclin à participer<br />
activement aux associations loca<strong>les</strong> dont<br />
<strong>les</strong> activités <strong>son</strong>t susceptib<strong>les</strong> d’avoir un impact<br />
sur cet environnement. L’incitation peut naître de<br />
coûts de mobilité résidentielle plus élevés que<br />
chez <strong>les</strong> locataires, mais aussi du souhait des<br />
individus concernés de voir s’accroître <strong>la</strong> valeur<br />
marchande de leur bien. Di Pasquale et G<strong>la</strong>eser<br />
(1999) montrent ainsi qu’aux États-Unis et en<br />
Allemagne, <strong>la</strong> propriété du logement encourage<br />
l’investissement en capital social, ce qui se traduit<br />
notamment en termes de participation <strong>associative</strong><br />
plus importante et de bénévo<strong>la</strong>t plus fréquent.<br />
En France, être propriétaire augmente<br />
significativement <strong>la</strong> probabilité de l’engagement.<br />
Résider <strong>dans</strong> une commune rurale ou <strong>dans</strong> une<br />
petite ville, mais aussi habiter l’Ouest, le Centre-Est<br />
ou le Sud-Ouest de <strong>la</strong> France jouent également<br />
<strong>dans</strong> un sens favorable à <strong>la</strong> participation.<br />
L’interprétation de cette sensibilité de <strong>la</strong> pratique<br />
du bénévo<strong>la</strong>t à <strong>la</strong> région de résidence n’est<br />
pas immédiate. On peut toutefois suggérer que<br />
cette dimension spatiale exprime ici d’éventuel<strong>les</strong><br />
différences de dynamisme du mouvement<br />
associatif et traduit l’effet de spécificités historiques<br />
qui ont pu influencer le développement<br />
de ce mouvement. Ainsi, l’effet positif sur<br />
l’engagement bénévole de <strong>la</strong> résidence <strong>dans</strong><br />
l’Ouest de <strong>la</strong> France pourrait être interprété<br />
comme l’empreinte persistante du rôle joué,<br />
<strong>dans</strong> le passé, par le clergé catholique <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
création et l’animation d’associations. Cet effet<br />
devrait être distingué de celui joué par <strong>la</strong> pratique<br />
religieuse hic et nunc du répondant, évoquée<br />
ci-après. Une telle hypothèse reste toutefois<br />
à vérifier <strong>dans</strong> une optique qui est plutôt<br />
celle de <strong>la</strong> sociologie historique du milieu associatif,<br />
pour <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> présente enquête est évidemment<br />
de peu d’utilité.<br />
L’influence de <strong>la</strong> pratique religieuse...<br />
Deux variab<strong>les</strong> voient leur rôle très nettement mis<br />
en évidence <strong>dans</strong> cette investigation. La première<br />
d’entre el<strong>les</strong> concerne précisément <strong>la</strong> pratique<br />
religieuse. Dans <strong>la</strong> partie fixe de l’Enquête permanente<br />
sur <strong>les</strong> conditions de <strong>vie</strong> des ménages, il<br />
était demandé aux enquêtés d’indiquer s’ils<br />
avaient le sentiment d’appartenir à une religion et,<br />
<strong>dans</strong> l’affirmative, s’ils étaient pratiquants et avec<br />
quelle fréquence. La pratique religieuse régulière<br />
s’accompagne d’une probabilité substantiellement<br />
plus élevée d’être bénévole puisque celle-ci<br />
se trouve augmentée de près de 12 points par rapport<br />
à <strong>la</strong> probabilité de participation estimée à <strong>la</strong><br />
moyenne des variab<strong>les</strong> intégrées <strong>dans</strong> <strong>la</strong> régression.<br />
Cette influence d’une pratique religieuse<br />
assidue sur le bénévo<strong>la</strong>t confirme des résultats de<br />
même ordre obtenus à partir des données des<br />
enquêtes du LES (Prouteau, 1999). Elle peut traduire,<br />
chez <strong>les</strong> croyants <strong>les</strong> plus pratiquants, <strong>la</strong><br />
volonté de rendre effective l’attention envers<br />
autrui qui occupe une p<strong>la</strong>ce éminente <strong>dans</strong> le message<br />
religieux. Elle peut également être l’effet de<br />
besoins de services spécifiques induits par cette<br />
pratique religieuse et que l’engagement bénévole<br />
se propose de satisfaire. Le cas de <strong>la</strong> religion<br />
catholique, <strong>la</strong>rgement dominante en France, peut<br />
servir à illustrer le propos (8). En effet, <strong>les</strong> <strong>la</strong>ïcs y<br />
8. S’agissant de l’importance occupée par le catholicisme,<br />
Djider et Marpsat (1990, p. 376) notent que « <strong>la</strong> plus grande partie<br />
des Français exprime avoir un lien avec <strong>la</strong> religion<br />
catholique : autour de 80 % [...] ». L’enquête sur <strong>les</strong> valeurs des<br />
Européens de 1990 présente, pour sa part, <strong>la</strong> répartition suivante<br />
de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion française selon le rapport à <strong>la</strong> religion :<br />
58 % se disent catholiques, 1 % protestants, 3 % d’une autre<br />
religion et 38 % sans religion (Lambert, 1995).<br />
12 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
<strong>son</strong>t régulièrement invités à pallier <strong>la</strong> pénurie<br />
d’effectifs du clergé, non seulement pour des<br />
tâches comme <strong>la</strong> catéchèse, mais aussi parfois<br />
pour des activités à caractère liturgique.<br />
... et de <strong>la</strong> tradition familiale<br />
Le second aspect sur lequel il con<strong>vie</strong>nt de<br />
s’attarder est re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> « tradition » familiale<br />
en matière de bénévo<strong>la</strong>t. Le questionnaire évoquait<br />
<strong>la</strong> pratique <strong>associative</strong> des parents du<br />
répondant lorsque ce dernier avait entre 15 et<br />
18 ans. Dans ce cadre, il était demandé plus particulièrement<br />
si le père et <strong>la</strong> mère s’étaient adonnés<br />
au bénévo<strong>la</strong>t. L’impact de l’engagement<br />
passé des parents sur celui des enquêtés est net,<br />
celui du père paraissant un peu plus élevé que<br />
celui de <strong>la</strong> mère. Ainsi, avoir un père ayant fait<br />
du bénévo<strong>la</strong>t augmente <strong>la</strong> probabilité moyenne<br />
de participer de plus de 13 points (et de près de<br />
9 points lorsqu’il s’agit de <strong>la</strong> mère). Mais un<br />
examen plus fin des comportements selon le<br />
sexe du répondant livre d’uti<strong>les</strong> précisions sur<br />
cette transmission intergénérationnelle à donner<br />
<strong>son</strong> <strong>temps</strong>. En effet, selon une régression sur <strong>la</strong><br />
seule popu<strong>la</strong>tion féminine (non reportée ici),<br />
c’est uniquement le bénévo<strong>la</strong>t de <strong>la</strong> mère qui<br />
joue <strong>dans</strong> ce cas, celui du père n’ayant plus<br />
d’incidence significative. En revanche, pour <strong>les</strong><br />
hommes, c’est effectivement le bénévo<strong>la</strong>t du<br />
père qui a l’effet le plus conséquent sur <strong>la</strong> pratique<br />
de l’enquêté, celui de <strong>la</strong> mère étant plus faible,<br />
bien que demeurant significativement positif.<br />
Les agriculteurs s’engagent plus<br />
que <strong>les</strong> ouvriers<br />
Une investigation de même nature a été réalisée<br />
sur <strong>les</strong> seuls actifs en emploi (cf. tableau 3,<br />
colonne 1). Certains coefficients, tout en restant<br />
de même signe, ne <strong>son</strong>t plus alors statistiquement<br />
significatifs. Tel est le cas de l’effet incitatif<br />
de l’augmentation du revenu domestique.<br />
C’est aussi celui de l’influence défavorable de<br />
<strong>la</strong> présence d’un très jeune enfant <strong>dans</strong> le<br />
ménage, qui n’atteint plus <strong>les</strong> seuils conventionnels<br />
de significativité. En revanche, l’impact<br />
favorable des enfants plus âgés et celui de l’élévation<br />
du niveau de diplôme restent entiers. Il<br />
en est de même pour l’effet de <strong>la</strong> pratique religieuse<br />
régulière, de l’engagement antérieur des<br />
parents, de <strong>la</strong> commune et, <strong>dans</strong> une <strong>la</strong>rge<br />
mesure, de <strong>la</strong> région de résidence.<br />
Sur cette popu<strong>la</strong>tion des actifs, l’effet éventuel<br />
de <strong>la</strong> catégorie socioprofessionnelle d’appartenance<br />
a également été considéré. Les résultats<br />
obtenus montrent que, toutes choses éga<strong>les</strong> par<br />
ailleurs, <strong>les</strong> ouvriers et <strong>les</strong> professions indépendantes<br />
non agrico<strong>les</strong> se distinguent par une propension<br />
à s’engager plus faible que cel<strong>les</strong> des<br />
employés, des professions intermédiaires et des<br />
cadres supérieurs, mais surtout sensiblement<br />
inférieure à celle des agriculteurs. Chez ces derniers,<br />
<strong>la</strong> probabilité de se consacrer au bénévo<strong>la</strong>t<br />
est de près de 7 points supérieure à <strong>la</strong> probabilité<br />
de participation estimée à <strong>la</strong> moyenne des variab<strong>les</strong><br />
de <strong>la</strong> régression. Cette situation peut refléter,<br />
pour partie, une participation syndicale plus<br />
vivace <strong>dans</strong> le monde agricole qu’elle ne l’est<br />
devenue <strong>dans</strong> l’univers sa<strong>la</strong>rié. Elle traduit aussi<br />
probablement l’importance qu’y joue un tissu<br />
associatif, coopératif ou mutualiste plus dense,<br />
lié à l’exercice de <strong>la</strong> profession et dont l’animation<br />
et le fonctionnement repose sur l’engagement<br />
des intéressés.<br />
S’agissant des durées vouées aux activités bénévo<strong>les</strong>,<br />
l’étude économétrique doit tenir compte<br />
de l’important effectif des non-bénévo<strong>les</strong>, pour<br />
qui ces durées <strong>son</strong>t bien évidemment nul<strong>les</strong>. La<br />
mise en œuvre d’un modèle Tobit, souvent utilisé<br />
<strong>dans</strong> ces circonstances, présente l’inconvénient<br />
de contraindre <strong>les</strong> facteurs explicatifs à<br />
avoir des effets à peu près semb<strong>la</strong>b<strong>les</strong> sur <strong>la</strong> probabilité<br />
d’être bénévole et sur <strong>les</strong> <strong>temps</strong> voués à<br />
cet engagement. Il lui a donc été préféré ici un<br />
modèle de sélection à <strong>la</strong> Heckman (1979),<br />
estimé par maximisation de <strong>la</strong> vraisemb<strong>la</strong>nce<br />
(cf. tableau 2, colonne 2). Des restrictions<br />
d’exclusion <strong>son</strong>t nécessaires pour permettre<br />
l’identification du modèle. Plusieurs variab<strong>les</strong><br />
présentes <strong>dans</strong> l’équation de participation ont<br />
donc été exclues de l’équation des durées (9).<br />
Les durées des activités bénévo<strong>les</strong><br />
<strong>son</strong>t peu sensib<strong>les</strong> aux facteurs<br />
qui influencent l’engagement<br />
Les résultats de cette investigation montrent<br />
que <strong>les</strong> durées <strong>son</strong>t rarement sensib<strong>les</strong> aux facteurs<br />
qui influencent <strong>la</strong> disposition à participer.<br />
Le genre est <strong>la</strong> seule véritable exception puisque<br />
<strong>les</strong> hommes, qui affichaient une probabilité<br />
plus forte de pratiquer le bénévo<strong>la</strong>t, s’avèrent y<br />
9. Le choix de ces variab<strong>les</strong> repose sur l’hypothèse qu’el<strong>les</strong><br />
influencent <strong>la</strong> propension à donner du <strong>temps</strong> et non l’importance<br />
de <strong>la</strong> contribution. L’idée consiste à voir <strong>les</strong> variab<strong>les</strong> omises de<br />
l’équation de <strong>temps</strong> bénévole comme des coûts fixes <strong>dans</strong> le fait<br />
de participer ou non à ce type d’activités.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 13
Tableau 3<br />
Les déterminants du bénévo<strong>la</strong>t chez <strong>les</strong> actifs en emploi<br />
Variab<strong>les</strong> Participation au bénévo<strong>la</strong>t Temps bénévole (log)<br />
Coef. t-test Coef. t-test<br />
Constante - 1,706 *** - 4,53 4,178 *** 4,74<br />
Sexe féminin - 0,278 *** - 4,83 - 0,306 *** - 2,58<br />
Âge 0,006 0,32 - 0,004 - 0,11<br />
Âge au carré (10E-2) - 0,004 - 0,18 0,017 0,35<br />
En couple 0,015 0,23 - 0,048 - 0,36<br />
Enfants 0 Réf. Réf.<br />
1, moins de 3 ans - 0,210 - 1,55 - 0,122 - 0,43<br />
1, plus de 3 ans 0,065 0,80 - 0,166 - 1,03<br />
2, 1 de moins de 3 ans - 0,150 - 1,15 0,026 0,10<br />
2, plus de 3 ans 0,200 * 2,41 - 0,421 *** - 2,59<br />
3 et plus, 1 de moins de 3 ans 0,075 0,37 - 0,143 - 0,37<br />
3 et plus, plus de 3 ans 0,447 *** 3,38 - 0,106 - 0,44<br />
Formation Sans diplôme Réf. Réf.<br />
CEP 0,124 0,83 - 0,066 - 0,19<br />
CAP - BEP - BEPC 0,340 *** 3,33 0,148 0,60<br />
Bac 0,478 *** 4,09 0,243 0,88<br />
Bac + 2 0,416 *** 3,30 0,114 0,39<br />
Supérieur à Bac + 2 0,616 *** 4,65 - 0,381 - 1,26<br />
Catégorie Agriculteur 0,470 *** 2,75 - 1,003 *** - 3,33<br />
Sociale Indépendant - 0,062 - 0,48 - 0,394 - 1,44<br />
Cadre supérieur 0,253 ** 2,21 0,176 0,80<br />
Profession intermédiaire 0,291 *** 3,25 - 0,303 * - 1,68<br />
Employé 0,211 *** 2,58 - 0,346 ** - 2,02<br />
Ouvrier Réf. Réf.<br />
Revenu Moins de 12 195 € Réf. Réf.<br />
annuel De 12 195 à 18 293 € 0,020 0,20 0,019 0,09<br />
De 18 293 à 27 439 € 0,115 1,22 0,076 0,40<br />
De 27 439 à 45 732 € 0,101 1,04 0,126 0,65<br />
Plus de 45 732 € 0,157 1,29 - 0,404 * - 1,71<br />
Propriétaire de <strong>son</strong> logement 0,156 *** 2,58<br />
Religion Pratique régulière 0,191 * 1,90<br />
Pratique occasionnelle - 0,013 - 0,17<br />
Appartenance sans pratique - 0,060 - 0,98<br />
Ni appartenance, ni pratique Réf.<br />
Père bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,407 *** 5,96<br />
Mère bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,188 ** 2,22<br />
Résidence Commune rurale 0,281 *** 3,77<br />
Urbaine < 20 000 h. 0,233 *** 2,94<br />
De 20 000 à 100 000 h. 0,179 ** 2,10<br />
Plus de 100 000 h. Réf.<br />
Région Région parisienne Réf.<br />
Bassin parisien 0,177 * 1,91<br />
Nord - 0,003 - 0,02<br />
Est 0,122 1,12<br />
Ouest 0,284 *** 2,95<br />
Sud-Ouest 0,299 *** 2,94<br />
Centre-Est 0,191 * 1,93<br />
Méditerranée 0,006 0,06<br />
Corré<strong>la</strong>tion des résidus - 0,258 - 1,86 *<br />
Nombre d’observations 2 836 2 836<br />
Nombre de bénévo<strong>les</strong> 877 877<br />
Log vraisemb<strong>la</strong>nce - 1600,9 - 3173,9<br />
Lecture : <strong>la</strong> participation bénévole est estimée à partir d’un modèle Probit, <strong>les</strong> <strong>temps</strong> bénévo<strong>les</strong> <strong>son</strong>t obtenus à partir d’un modèle de<br />
sélection à <strong>la</strong> Heckman estimé par maximisation de <strong>la</strong> vraisemb<strong>la</strong>nce. Les seuils de significativité <strong>son</strong>t respectivement égaux à 1 % ( *** ),<br />
5 % ( ** ) et 10 % ( * ).<br />
Source: enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.<br />
14 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
consacrer également plus de <strong>temps</strong>. En revanche,<br />
<strong>la</strong> <strong>vie</strong> en couple qui encourageait plutôt <strong>la</strong><br />
participation, exerce un effet négatif sur <strong>les</strong><br />
durées offertes, ce qui peut être l’expression<br />
d’une tension plus forte sur <strong>les</strong> emplois du<br />
<strong>temps</strong> comparativement à <strong>la</strong> situation des per<strong>son</strong>nes<br />
seu<strong>les</strong>. Si le profil par âge se présente<br />
encore en cloche, le maximum est désormais<br />
plus tardif puisque l’estimation obtenue est de<br />
62 ans. La présence d’enfant(s) au foyer<br />
n’exerce plus d’influence bien lisible, seule une<br />
modalité de cette variable (avoir deux enfants<br />
âgés de plus de trois ans) étant affectée d’un<br />
coefficient négatif et statistiquement significatif,<br />
sans que l’on puisse vraiment avancer à cet<br />
égard une explication convaincante. Aucun<br />
effet du revenu sur <strong>les</strong> durées bénévo<strong>les</strong> n’est<br />
mis en évidence. À l’exception de <strong>la</strong> possession<br />
du seul bacca<strong>la</strong>uréat, qui s’accompagne d’une<br />
plus forte intensité de l’engagement, le diplôme<br />
n’exerce plus le rôle essentiel qu’il jouait sur <strong>la</strong><br />
probabilité de participer, puisqu’il en était <strong>la</strong><br />
dimension explicative <strong>la</strong> plus discriminante.<br />
Les facteurs qui président à <strong>la</strong> participation<br />
paraissent donc, au moins partiellement, distincts<br />
de ceux qui affectent <strong>les</strong> durées des activités<br />
bénévo<strong>les</strong>, ce qui rejoint des observations<br />
de même nature faites sur données étrangères<br />
(Day et Devlin, 1997). Ce constat se confirme<br />
lorsque l’étude est réalisée sur <strong>les</strong> seuls actifs<br />
(cf. tableau 3, colonne 2). On y remarque<br />
notamment que <strong>les</strong> agriculteurs, <strong>les</strong> employés<br />
et <strong>les</strong> professions intermédiaires, qui se distinguaient<br />
par des probabilité de participer plus<br />
élevées que cel<strong>les</strong> des ouvriers, se signalent<br />
désormais par des durées plus courtes. Globalement,<br />
peu des variab<strong>les</strong> considérées exercent<br />
un impact significatif sur <strong>les</strong> <strong>temps</strong> donnés.<br />
L’interprétation d’une telle situation n’est pas<br />
immédiate. On peut penser que <strong>les</strong> durées des<br />
prestations bénévo<strong>les</strong> <strong>son</strong>t soumises aux contraintes<br />
du fonctionnement associatif et de ce<br />
fait échappent davantage au choix discrétionnaire<br />
des individus que <strong>la</strong> décision de s’engager.<br />
Une fois qu’ils ont décidé de pratiquer leur<br />
activité, <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> <strong>son</strong>t en effet assujettis à<br />
certaines règ<strong>les</strong> qui, pour être moins astreignantes<br />
que cel<strong>les</strong> qui prévalent <strong>dans</strong> le milieu<br />
professionnel, n’en existent pas moins. La temporalité<br />
qui rythme <strong>la</strong> <strong>vie</strong> interne de l’association<br />
est d’essence collective et, par conséquent,<br />
elle s’impose, en partie, à chacun. Cette<br />
hypothèse reste néanmoins à étayer pour<br />
mieux appréhender <strong>les</strong> déterminants de l’intensité<br />
du bénévo<strong>la</strong>t.<br />
Bénévo<strong>la</strong>t régulier et bénévo<strong>la</strong>t occasionnel<br />
Pour intéressante qu’elle soit, cette première<br />
approche du profil des bénévo<strong>les</strong> appelle un<br />
supplément de précisions. En effet, menée à un<br />
niveau très global, elle agrège des modes de participation<br />
qui méritent d’être distingués. Le premier<br />
axe sur lequel peut s’opérer cette différenciation<br />
est celui de <strong>la</strong> plus ou moins grande<br />
continuité des activités pratiquées. Le questionnaire<br />
permet d’identifier le caractère régulier ou<br />
au contraire épisodique des services rendus<br />
(cf. encadré 1). Toutefois, l’exploitation de<br />
cette information doit tenir compte de <strong>la</strong> difficulté<br />
à tracer une frontière précise entre ces<br />
deux modalités du bénévo<strong>la</strong>t. <strong>Donner</strong> toute<br />
l’année deux heures par semaine de <strong>son</strong> <strong>temps</strong>,<br />
c’est à n’en point douter se consacrer régulièrement<br />
à sa pratique. Le faire une fois <strong>dans</strong><br />
l’année, <strong>dans</strong> une association de loisirs, sous <strong>la</strong><br />
forme d’un « coup de main » à l’occasion d’un<br />
événement festif, c’est tout aussi indubitablement<br />
consentir une aide très ponctuelle. Mais<br />
donner deux heures par mois pendant toute<br />
l’année, est-ce faire du bénévo<strong>la</strong>t régulier ou<br />
occasionnel ? La réponse est alors moins évidente.<br />
Celle-ci étant <strong>la</strong>issée aux soins des répondants,<br />
il n’est pas sûr que <strong>les</strong> per<strong>son</strong>nes <strong>dans</strong> des<br />
situations de cette nature en aient toutes eu une<br />
perception identique.<br />
En dépit de sa re<strong>la</strong>tive incertitude, <strong>la</strong> distinction<br />
ainsi opérée ne manque pas d’intérêt. Elle fait<br />
apparaître que le bénévo<strong>la</strong>t est, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> majorité<br />
des cas, un bénévo<strong>la</strong>t occasionnel (cf. tableau<br />
1). Le taux de participation au bénévo<strong>la</strong>t<br />
régulier est de 12 %, contre près de 19 % au<br />
bénévo<strong>la</strong>t occasionnel. À l’aune de l’effectif<br />
global de 13 millions d’individus, par ailleurs<br />
probablement sous-estimé pour <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s déjà<br />
évoquées, <strong>les</strong> propos récurrents tenus par le<br />
monde associatif sur <strong>la</strong> pénurie de bénévo<strong>les</strong><br />
pouvaient paraître pour le moins singuliers. La<br />
prise en compte du seul bénévo<strong>la</strong>t régulier, qui<br />
constitue <strong>la</strong> ressource permanente sur <strong>la</strong>quelle<br />
peuvent véritablement compter <strong>les</strong> associations,<br />
tempère le paradoxe. Le « noyau dur » du bénévo<strong>la</strong>t<br />
se réduit en effet à environ 6 millions de<br />
per<strong>son</strong>nes pour <strong>la</strong> France entière.<br />
Les durées consacrées à l’engagement <strong>son</strong>t évidemment<br />
très sensib<strong>les</strong> à cette distinction. Les<br />
bénévo<strong>les</strong> réguliers y vouent annuellement près<br />
de cinq fois et demie plus de <strong>temps</strong> que <strong>les</strong> participants<br />
occasionnels. On pourrait penser que<br />
ces derniers, du fait de leurs contributions plus<br />
modérées, <strong>son</strong>t à même d’apporter leur aide à un<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 15
plus grand nombre d’associations. Les données<br />
ne valident pas cette hypothèse. Ce <strong>son</strong>t, au contraire,<br />
<strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> réguliers qui <strong>son</strong>t plus souvent<br />
des pluri-participants (<strong>dans</strong> près de quatre<br />
cas sur dix contre un sur sept pour <strong>les</strong> occasionnels),<br />
principalement du fait que certains<br />
d’entre eux ont également des participations<br />
plus ponctuel<strong>les</strong>. Toutefois, certains bénévo<strong>les</strong><br />
occasionnels s’avèrent être des donateurs conséquents<br />
puisque 8 % d’entre eux consacrent<br />
plus de 100 heures annuellement aux services<br />
ainsi rendus. Leur contribution annuelle<br />
moyenne est alors de 191 heures et dépasse<br />
celle de bien des bénévo<strong>les</strong> réguliers (10).<br />
L’apport assuré par ces bénévo<strong>les</strong> occasionnels<br />
d’un type particulier augmente bien entendu <strong>la</strong><br />
durée moyenne de l’ensemble de <strong>la</strong> catégorie.<br />
Celle-ci descend de 59 à 19 heures par an si on<br />
ne <strong>les</strong> prend pas en compte.<br />
Les bénévo<strong>les</strong> réguliers <strong>son</strong>t plus âgés<br />
Sous l’angle de leurs caractéristiques sociodémographiques,<br />
<strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> réguliers se distinguent<br />
des occasionnels à plusieurs égards<br />
(cf. tableau 4). Ils ont tendance à être plus âgés,<br />
leur taux de participation maximum se situant à<br />
49 ans contre 42 ans pour <strong>les</strong> participants occasionnels.<br />
Vivre en couple tout comme <strong>la</strong> présence<br />
d’enfants de plus de trois ans n’a d’effet<br />
positif statistiquement significatif que sur le<br />
bénévo<strong>la</strong>t occasionnel, ce qui semble signifier<br />
que <strong>les</strong> coups de main que <strong>les</strong> parents <strong>son</strong>t amenés<br />
à donner <strong>dans</strong> le cadre des activités de leur<br />
progéniture (loisirs, enseignement, etc.) ont surtout<br />
un caractère ponctuel. La nature de <strong>la</strong> commune<br />
de résidence et <strong>la</strong> région n’affectent également<br />
que cette participation occasionnelle.<br />
À l’inverse, celle-ci n’est pas sensible au comportement<br />
en matière de religion, au contraire<br />
du bénévo<strong>la</strong>t régulier qui est fortement encouragé<br />
par une pratique religieuse assidue. C’est<br />
également sur <strong>la</strong> seule participation régulière<br />
que le statut de propriétaire du logement occupé<br />
a une incidence positive.<br />
Sur aucun des deux types de bénévo<strong>la</strong>t, le<br />
revenu ne semble avoir une influence continue.<br />
L’effet positif du revenu domestique sur le<br />
bénévo<strong>la</strong>t régulier se fait sentir <strong>dans</strong> <strong>les</strong> tranches<br />
intermédiaires, <strong>les</strong> revenus <strong>les</strong> plus élevés ne se<br />
distinguant pas significativement des plus faib<strong>les</strong>.<br />
Ce <strong>son</strong>t, en revanche, <strong>les</strong> plus hauts revenus<br />
qui <strong>son</strong>t <strong>les</strong> plus favorab<strong>les</strong> à <strong>la</strong> pratique<br />
occasionnelle (avec un seuil de significativité<br />
du coefficient qui est toutefois de 10 %). Le<br />
genre et le diplôme exercent une influence assez<br />
simi<strong>la</strong>ire <strong>dans</strong> <strong>les</strong> deux cas. Les femmes <strong>son</strong>t<br />
toujours moins enclines à participer. L’élévation<br />
du niveau de formation initiale joue bien<br />
pour <strong>les</strong> deux modes de participation le rôle<br />
incitatif déjà noté. Toutefois, alors que ce <strong>son</strong>t<br />
<strong>les</strong> plus diplômés qui connaissent <strong>la</strong> plus forte<br />
propension à participer au bénévo<strong>la</strong>t occasionnel,<br />
cet impact maximum est atteint au niveau<br />
des titu<strong>la</strong>ires du bacca<strong>la</strong>uréat pour <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong><br />
réguliers. L’engagement antérieur des parents<br />
joue un rôle assez homogène sur <strong>les</strong> deux types<br />
de participation. (10)<br />
Un test d’égalité des coefficients obtenus <strong>dans</strong><br />
<strong>les</strong> deux régressions a été réalisé. L’hypothèse<br />
de leur similitude est rejetée au seuil de 1 %<br />
(avec une statistique du Chi-deux égale à 98,31<br />
pour 35 degrés de liberté), ce qui confirme que<br />
<strong>les</strong> profils des deux popu<strong>la</strong>tions <strong>son</strong>t différents.<br />
Il n’en demeure pas moins que, une fois neutralisé<br />
l’effet des différentes variab<strong>les</strong> considérées<br />
ici, on observe un coefficient de corré<strong>la</strong>tion<br />
positif entre <strong>les</strong> deux types d’engagement (et<br />
significatif au seuil de 5 %), ce qui pourrait<br />
témoigner d’une disposition partagée à donner<br />
<strong>son</strong> <strong>temps</strong>.<br />
Un bénévo<strong>la</strong>t très majoritairement<br />
associatif<br />
Une autre source de diversité du bénévo<strong>la</strong>t<br />
mérite d’être considérée. Elle tient à <strong>la</strong> nature de<br />
l’organisme qui accueille cel<strong>les</strong> et ceux qui donnent<br />
ainsi leur <strong>temps</strong>. Les enquêtés dont <strong>les</strong> activités<br />
bénévo<strong>les</strong> <strong>son</strong>t renseignées <strong>dans</strong> le second<br />
volet du questionnaire indiquaient s’ils pratiquaient<br />
<strong>dans</strong> un cadre associatif, <strong>dans</strong> celui d’un<br />
organisme municipal ou local ou <strong>dans</strong> un autre<br />
cadre (11). Il n’est pas certain que le type exact<br />
de l’organisme soit précisément connu par tous<br />
<strong>les</strong> répondants. Du moins c’est ce que suggère <strong>la</strong><br />
lecture des réponses que certains d’entre eux ont<br />
communiquées quand il leur était demandé de<br />
donner des précisions sur <strong>les</strong> organismes qui ne<br />
<strong>son</strong>t ni associatifs, ni municipaux. Par conséquent,<br />
l’usage de ces données doit rester prudent.<br />
La connaissance de <strong>la</strong> diversité des statuts<br />
des structures d’accueil du bénévo<strong>la</strong>t serait certainement<br />
plus fiable si elle procédait d’informations<br />
collectées auprès des organismes euxmêmes.<br />
10. Il peut s’agir, par exemple, d’une per<strong>son</strong>ne dont le bénévo<strong>la</strong>t<br />
consiste, une seule fois <strong>dans</strong> l’année mais pendant 15 jours consécutifs,<br />
à accompagner un groupe d’enfants en séjour de<br />
vacances.<br />
11. Par construction, tous <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> du premier volet pratiquent<br />
<strong>les</strong> activités qu’ils décrivent <strong>dans</strong> des associations.<br />
16 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
Tableau 4<br />
Les déterminants des bénévo<strong>la</strong>ts réguliers et irréguliers<br />
Variab<strong>les</strong> Bénévo<strong>la</strong>t régulier Bénévo<strong>la</strong>t irrégulier<br />
Coef. t-test Coef. t-test<br />
Constante - 2,575*** - 13,57 - 2,012*** - 12,25<br />
Sexe féminin - 0,179*** - 3,92 - 0,164*** - 3,99<br />
Âge 0,036*** 5,01 0,019*** 3,03<br />
Âge au carré (10E-2) - 0,037*** - 5,16 - 0,023*** - 3,61<br />
En couple - 0,020 - 0,35 0,121** 2,43<br />
Enfants 0 Réf. Réf.<br />
1, moins de 3 ans - 0,374** - 2,36 - 0,214* - 1,68<br />
1, plus de 3 ans - 0,117 - 1,49 0,141** 2,10<br />
2, 1 de moins de 3 ans - 0,104 - 0,81 - 0,233* - 1,95<br />
2, plus de 3 ans - 0,061 - 0,76 0,131* 1,88<br />
3 et plus, 1 de moins de 3 ans - 0,259 - 1,35 0,040 0,26<br />
3 et plus, plus de 3 ans 0,155 1,33 0,259** 2,45<br />
Formation Sans diplôme Réf. Réf.<br />
CEP 0,082 0,88 0,171** 2,10<br />
CAP - BEP - BEPC 0,279*** 3,54 0,238*** 3,49<br />
Bac 0,544*** 6,15 0,418*** 5,28<br />
Bac + 2 0,477*** 4,83 0,383*** 4,32<br />
Supérieur à Bac + 2 0,526*** 5,50 0,636*** 7,49<br />
Revenu annuel Moins de 12 195 € Réf. Réf.<br />
De 12 195 à 18 293 € 0,003 0,04 0,077 1,18<br />
De 18 293 à 27 439 € 0,122* 1,72 0,109* 1,72<br />
De 27 439 à 45 732 € 0,196*** 2,63 0,080 1,18<br />
Plus de 45 732 € 0,124 1,27 0,156* 1,75<br />
Propriétaire de <strong>son</strong> logement 0,150*** 2,83 0,056 1,19<br />
Religion Pratique régulière 0,550*** 7,55 0,045 0,64<br />
Pratique occasionnelle 0,081 1,22 - 0,064 - 1,10<br />
Appartenance sans pratique 0,002 0,03 - 0,089* - 1,78<br />
Ni appartenance, ni pratique Réf. Réf.<br />
Père bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,259*** 4,34 0,321*** 5,95<br />
Mère bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,143* 1,89 0,253*** 3,75<br />
Résidence Commune rurale 0,102 1,62 0,331*** 5,87<br />
Urbaine < 20 000 h. 0,128* 1,90 0,204*** 3,31<br />
De 20 000 à 100 000 h. 0,035 0,47 0,157** 2,35<br />
Plus de 100 000 h. Réf. Réf.<br />
Région Région parisienne Réf. Réf.<br />
Bassin parisien 0,076 0,91 0,048 0,61<br />
Nord - 0,102 - 0,93 0,299*** 3,24<br />
Est 0,074 0,79 0,175** 2,00<br />
Ouest 0,123 1,45 0,309*** 3,96<br />
Sud-Ouest 0,100 1,11 0,269*** 3,29<br />
Centre-Est 0,109 1,24 0,364*** 4,54<br />
Méditerranée 0,019 0,21 0,072 0,87<br />
Nombre de bénévo<strong>les</strong> 703 1 056<br />
Nombre d’observations 5 771<br />
Coefficient de corré<strong>la</strong>tion (t-test) 0,066** (2,08)<br />
Log vraisemb<strong>la</strong>nce - 4 498,0<br />
Lecture : modèle Probit bivarié estimé par maximisation de <strong>la</strong> vraisemb<strong>la</strong>nce. Les seuils de significativité <strong>son</strong>t respectivement égaux à<br />
1 % ( *** ), 5 % ( ** ) et 10 % ( * ).<br />
Source: enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 17
Quoi qu’il en soit, 90 % des bénévo<strong>les</strong> déc<strong>la</strong>rent<br />
participer à leurs activités <strong>dans</strong> un cadre associatif<br />
et 17 % <strong>dans</strong> un autre contexte, certains<br />
d’entre eux pratiquant <strong>dans</strong> <strong>les</strong> deux types<br />
d’organismes. À <strong>la</strong> lumière de ces réponses, et<br />
pour autant qu’el<strong>les</strong> soient pertinentes, il apparaît<br />
bien que si le milieu associatif n’a pas le<br />
monopole du bénévo<strong>la</strong>t formel, il n’en mobilise<br />
pas moins <strong>les</strong> effectifs de très loin <strong>les</strong> plus<br />
importants.<br />
Dans quelle mesure <strong>les</strong> profils des bénévo<strong>les</strong><br />
diffèrent-ils selon <strong>la</strong> nature de l’organisme ?<br />
Pour examiner <strong>la</strong> question, un modèle Probit<br />
bivarié a été estimé sur <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion globale<br />
(cf. tableau 5). La faib<strong>les</strong>se des effectifs pratiquant<br />
<strong>dans</strong> des organismes non associatifs se<br />
traduit par une moindre précision des estimateurs.<br />
L’exercice demeure toutefois intéressant<br />
car s’il montre que nombre de facteurs sociodémographiques<br />
jouent un rôle assez identique sur<br />
<strong>les</strong> deux participations (pratique religieuse, tradition<br />
familiale en matière de bénévo<strong>la</strong>t, commune<br />
et région de résidence), il souligne aussi<br />
que deux d’entre eux n’ont pas du tout le même<br />
pouvoir discriminant. Tout d’abord, c’est uniquement<br />
chez <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> associatifs que <strong>la</strong><br />
participation des femmes se distingue de celle<br />
des hommes par une moindre importance.<br />
Parmi <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> qui fréquentent d’autres<br />
organismes, cette différence liée au sexe ne joue<br />
plus. Ensuite, le niveau de diplôme, très discriminant<br />
pour expliquer <strong>la</strong> propension à pratiquer<br />
<strong>dans</strong> des associations, n’exerce plus aucune<br />
influence sur <strong>la</strong> participation <strong>dans</strong> <strong>les</strong> autres<br />
organismes. Le coefficient de corré<strong>la</strong>tion résiduelle<br />
entre <strong>les</strong> deux types de participation est<br />
toutefois significativement positif (au seuil de<br />
10 %), ce qui peut s’interpréter, là encore, par<br />
une même inclination à donner de <strong>son</strong> <strong>temps</strong><br />
<strong>dans</strong> <strong>les</strong> deux popu<strong>la</strong>tions.<br />
Le sport, <strong>la</strong> culture et <strong>les</strong> loisirs<br />
<strong>son</strong>t <strong>les</strong> domaines privilégiés<br />
de l’action bénévole<br />
Dans le monde des représentations collectives,<br />
le terrain de prédilection du bénévo<strong>la</strong>t est celui<br />
du caritatif et de l’action sociale. Toujours prégnante<br />
aujourd’hui, cette image doit être re<strong>la</strong>tivisée<br />
puisque <strong>les</strong> domaines d’engagement<br />
apparaissent marqués du sceau de <strong>la</strong> diversité.<br />
L’examen de cette question à partir de<br />
l’enquête Vie <strong>associative</strong> est soumis à deux<br />
exigences dont <strong>la</strong> conciliation ne va pas de soi.<br />
D’une part, le degré de désagrégation par<br />
domaine doit être assez fin pour appréhender <strong>la</strong><br />
variété des univers du bénévo<strong>la</strong>t. D’autre part,<br />
<strong>dans</strong> chacun d’entre eux, l’effectif des participants<br />
doit être suffisant pour autoriser des<br />
investigations qui aient une signification et<br />
qui soient envisageab<strong>les</strong> dès lors que l’outil<br />
économétrique est utilisé. Un compromis a<br />
donc été trouvé, qui conduit à retenir six<br />
domaines (ou secteurs) principaux plus un<br />
domaine résiduel qui accueille <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong><br />
dont <strong>la</strong> nature des services rendus n’est pas<br />
précisément connue ou dont <strong>les</strong> effectifs <strong>son</strong>t<br />
insuffisants pour faire l’objet d’un regroupement<br />
spécifique (cf. annexe 1).<br />
Il faut toutefois garder à l’esprit que <strong>la</strong> construction<br />
d’une nomenc<strong>la</strong>ture d’associations reposant<br />
sur <strong>les</strong> secteurs d’activité est toujours un<br />
exercice périlleux. Aucune des tentatives en ce<br />
sens ne peut prétendre être à l’abri d’objections<br />
tant il est vrai que <strong>les</strong> activités <strong>associative</strong>s <strong>son</strong>t<br />
assez fréquemment ma<strong>la</strong>isées à définir simplement<br />
et, partant, à circonscrire précisément.<br />
Ainsi, une association de loisirs créée pour des<br />
ado<strong>les</strong>cents d’un quartier dit « sensible » pourra<br />
tout autant se prévaloir de <strong>son</strong> appartenance au<br />
domaine des loisirs qu’à celui de l’action<br />
sociale si <strong>la</strong> prévention de <strong>la</strong> délinquance est<br />
partie constitutive de <strong>son</strong> projet fondateur. La<br />
variabilité des nomenc<strong>la</strong>tures existantes a conduit<br />
<strong>les</strong> équipes de chercheurs engagées <strong>dans</strong> le<br />
programme international Johns Hopkins de<br />
comparai<strong>son</strong> des organismes sans but lucratif à<br />
arrêter une c<strong>la</strong>ssification commune (Archambault,<br />
1996) (12). Toutefois, elle n’a pas été<br />
reprise ici du fait de <strong>la</strong> faib<strong>les</strong>se des effectifs<br />
<strong>dans</strong> certaines des catégories qui <strong>la</strong> constituent.<br />
La culture et <strong>les</strong> loisirs puis le sport <strong>son</strong>t <strong>les</strong> deux<br />
domaines <strong>les</strong> plus fréquemment cités. Près de six<br />
bénévo<strong>les</strong> sur dix déc<strong>la</strong>rent y exercer leurs activités<br />
non rémunérées (cf. tableau 1). Viennent<br />
ensuite et par ordre d’importance décroissant, <strong>la</strong><br />
défense de droits, l’action sociale, caritative et<br />
humanitaire ainsi que l’éducation. La religion et<br />
le domaine « autre » connaissent enfin des participations<br />
nettement moindres. L’importance des<br />
deux premiers domaines <strong>dans</strong> l’engagement<br />
bénévole a déjà été soulignée <strong>dans</strong> des travaux<br />
antérieurs (Archambault et Boumendil, 1997 ;<br />
Prouteau, 1998). Mais <strong>la</strong> présente recherche<br />
apporte des informations nouvel<strong>les</strong> sur ce bénévo<strong>la</strong>t<br />
désagrégé.<br />
12. Cette c<strong>la</strong>ssification est connue sous le nom d’ICNPO (International<br />
C<strong>la</strong>ssification of Non-Profit Organizations).<br />
18 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
Tableau 5<br />
Le bénévo<strong>la</strong>t selon <strong>la</strong> nature de l’organisme d’accueil<br />
Variab<strong>les</strong> Bénévo<strong>les</strong> en associations<br />
Bénévo<strong>les</strong> <strong>dans</strong> d’autres<br />
organismes<br />
Coef. t-test Coef. t-test<br />
Constante - 2,172 *** - 13,98 - 2,433 *** - 9,68<br />
Sexe féminin - 0,224 *** - 5,80 0,013 0,21<br />
Âge 0,031 *** 5,29 0,012 1,23<br />
Âge au carré (10E-2) - 0,033 *** - 5,62 - 0,020 * - 1,95<br />
En couple 0,058 1,26 0,143 * 1,85<br />
Enfants 0 Réf. Réf.<br />
1, moins de 3 ans - 0,313 ** - 2,55 - 0,369 * - 1,70<br />
1, plus de 3 ans 0,012 0,18 0,092 0,93<br />
2, 1 de moins de 3 ans - 0,250 ** - 2,23 - 0,017 - 0,10<br />
2, plus de 3 ans 0,069 1,02 0,113 1,13<br />
3 et plus, 1 de moins de 3 ans - 0,147 - 0,96 0,107 0,51<br />
3 et plus, plus de 3 ans 0,288 *** 2,83 0,230 1,63<br />
Formation Sans diplôme Réf. Réf.<br />
CEP 0,225 *** 2,97 - 0,077 - 0,62<br />
CAP - BEP - BEPC 0,353 *** 5,49 - 0,042 - 0,43<br />
Bac 0,609 *** 8,19 0,070 0,61<br />
Bac + 2 0,546 *** 6,54 0,017 0,13<br />
Supérieur à Bac + 2 0,736 *** 9,13 0,056 0,44<br />
Revenu annuel Moins de 12 195 € Réf. Réf.<br />
De 12 195 à 18 293 € 0,092 1,52 0,009 0,09<br />
De 18 293 à 27 439 € 0,137 ** 2,31 - 0,018 - 0,18<br />
De 27 439 à 45 732 € 0,165 *** 2,61 0,125 1,24<br />
Plus de 45 732 € 0,187 ** 2,24 0,163 1,24<br />
Propriétaire de <strong>son</strong> logement 0,121 *** 2,74 0,066 0,92<br />
Religion Pratique régulière 0,297 *** 4,59 0,360 *** 3,59<br />
Pratique occasionnelle 0,001 0,02 0,112 1,26<br />
Appartenance sans pratique - 0,044 - 0,92 0,029 0,38<br />
Ni appartenance, ni pratique Réf. Réf.<br />
Père bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,330 *** 6,36 0,279 *** 3,60<br />
Mère bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,268 *** 4,10 0,238 ** 2,50<br />
Résidence Commune rurale 0,251 *** 4,73 0,251 *** 2,97<br />
Urbaine < 20 000 h. 0,165 *** 2,85 0,183 ** 1,99<br />
De 20 000 à 100 000 h. 0,117 * 1,86 0,091 0,88<br />
Plus de 100 000 h. Réf. Réf.<br />
Région Région parisienne Réf. Réf.<br />
Bassin parisien 0,089 1,25 0,015 0,12<br />
Nord 0,106 1,20 0,266 * 1,90<br />
Est 0,112 1,39 0,247 * 1,91<br />
Ouest 0,241 *** 3,33 0,347 *** 2,93<br />
Sud-Ouest 0,218 *** 2,87 0,121 0,92<br />
Centre-Est 0,292 *** 3,90 0,144 1,13<br />
Méditerranée 0,042 0,56 0,129 1,01<br />
Nombre de bénévo<strong>les</strong> 1 414 258<br />
Nombre d’observations 5 771<br />
Corré<strong>la</strong>tion des résidus 0,077 * (1,93)<br />
Log vraisemb<strong>la</strong>nce - 3 906,1<br />
Lecture : modèle Probit bivarié estimé par maximisation de <strong>la</strong> vraisemb<strong>la</strong>nce. Les seuils de significativité <strong>son</strong>t respectivement égaux à<br />
1 % ( *** ), 5 % ( ** ) et 10 % ( * ).<br />
Source : enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 19
Elle permet d’abord de constater <strong>la</strong> disparité<br />
intersectorielle des durées consacrées à l’engagement.<br />
Le bénévo<strong>la</strong>t en matière éducative est<br />
celui qui mobilise le moins cel<strong>les</strong> et ceux qui s’y<br />
consacrent, puisque <strong>la</strong> durée annuelle moyenne<br />
qui lui est dévolue est de 45 heures seulement.<br />
Par contraste, le domaine religieux et celui de<br />
l’action sociale et humanitaire sollicitent beaucoup<br />
plus leurs bénévo<strong>les</strong>, <strong>les</strong> durées moyennes<br />
étant, <strong>dans</strong> ce cas, de 110 heures. La culture et<br />
<strong>les</strong> loisirs, le sport, <strong>la</strong> défense de droits et le<br />
domaine « autre » se situent en position intermédiaire.<br />
L’importance de l’engagement bénévole peut<br />
également être appréhendée au travers de <strong>la</strong> distinction<br />
entre <strong>la</strong> participation régulière et <strong>la</strong> participation<br />
occasionnelle. Sous ce jour, <strong>la</strong> situation<br />
diffère également d’un domaine à l’autre.<br />
Par exemple, 32 % des bénévo<strong>les</strong> occasionnels<br />
pratiquent <strong>dans</strong> le domaine de <strong>la</strong> culture et des<br />
loisirs, mais cette part s’abaisse à 27 % pour le<br />
bénévo<strong>la</strong>t régulier. À l’inverse, alors que 4 %<br />
seulement des bénévo<strong>les</strong> occasionnels <strong>son</strong>t<br />
investis <strong>dans</strong> le domaine religieux, ils <strong>son</strong>t près<br />
de 11 % parmi cel<strong>les</strong> et ceux qui participent<br />
régulièrement.<br />
Cette variabilité intersectorielle des modalités<br />
de <strong>la</strong> participation est confirmée par une investigation<br />
non plus au niveau des individus, mais<br />
à celui des participations (13). Elle permet, en<br />
effet, d’observer que <strong>les</strong> engagements réguliers<br />
<strong>son</strong>t <strong>les</strong> moins fréquents <strong>dans</strong> le secteur de <strong>la</strong><br />
culture et des loisirs et <strong>dans</strong> celui de l’éducation<br />
(un peu plus d’une participation sur trois) et<br />
légèrement plus élevés <strong>dans</strong> le domaine sportif<br />
(38 %). Dans ces domaines, le bénévo<strong>la</strong>t est<br />
donc très majoritairement un bénévo<strong>la</strong>t ponctuel.<br />
En matière de défense des droits et d’action<br />
sociale et humanitaire, le bénévo<strong>la</strong>t régulier est<br />
plus conséquent (44 % des participations). Il<br />
de<strong>vie</strong>nt majoritaire (six cas sur dix) lorsqu’il<br />
s’agit du domaine religieux.<br />
Les bénévo<strong>la</strong>ts d’action sociale, éducatif et<br />
religieux <strong>son</strong>t plus féminins<br />
Les différences entre bénévo<strong>la</strong>ts désagrégés par<br />
domaine d’activité se manifestent également au<br />
niveau des profils de cel<strong>les</strong> et ceux qui <strong>les</strong> pratiquent.<br />
Pour mener à bien cette comparai<strong>son</strong>, des<br />
modè<strong>les</strong> Probit univariés ont été estimés pour<br />
chacun des bénévo<strong>la</strong>ts sectoriels et l’existence<br />
éventuelle de corré<strong>la</strong>tion entre ces participations<br />
prises deux à deux a été examinée à partir<br />
de Probit bivariés (14). L’analyse permet de<br />
mettre en évidence le jeu différentiel d’un cer-<br />
tain nombre de variab<strong>les</strong> sociodémographiques,<br />
ce qui ne pouvait être perçu au niveau agrégé<br />
(cf. tableau 6). L’impact du genre en est une<br />
illustration particulièrement nette. Car le résultat<br />
obtenu au niveau agrégé, montrant que <strong>les</strong><br />
femmes <strong>son</strong>t moins enclines à pratiquer le bénévo<strong>la</strong>t<br />
formel, masque, en réalité, des disparités<br />
importantes au niveau des domaines d’activité.<br />
Le sport, surtout, mais aussi <strong>la</strong> défense de droits,<br />
<strong>la</strong> culture et <strong>les</strong> loisirs ainsi que le domaine<br />
« autre » (qui inclut notamment <strong>les</strong> activités de<br />
défense de l’environnement et <strong>les</strong> partis politiques)<br />
s’avèrent bien être des bénévo<strong>la</strong>ts plus<br />
fortement masculins. Les femmes <strong>son</strong>t, au contraire,<br />
plus disposées à s’engager que <strong>les</strong> hommes<br />
<strong>dans</strong> le domaine éducatif, <strong>dans</strong> celui de<br />
l’action sociale et de l’humanitaire ainsi que<br />
<strong>dans</strong> le bénévo<strong>la</strong>t religieux. La disparité sectorielle<br />
des participations bénévo<strong>les</strong> selon le sexe<br />
n’est évidemment pas sans rappeler le très inégal<br />
degré de féminisation des domaines de <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />
professionnelle. Ces deux constats témoignent<br />
d’un certain degré de continuité entre <strong>les</strong> tâches<br />
dévolues aux femmes par une division sexuelle<br />
du travail domestique encore prégnante et cel<strong>les</strong><br />
qu’el<strong>les</strong> assument hors du foyer. (13) (14)<br />
Avoir des enfants favorise l’engagement<br />
<strong>dans</strong> le domaine éducatif<br />
Il a déjà été souligné que <strong>la</strong> présence d’enfants<br />
<strong>dans</strong> le ménage induisait deux effets de sens<br />
opposé sur <strong>la</strong> participation bénévole : l’un favorable,<br />
puisque <strong>les</strong> parents peuvent être incités à<br />
participer à <strong>la</strong> production <strong>associative</strong> de certains<br />
services spécifiques, l’autre négatif, lié à une<br />
raréfaction du <strong>temps</strong> libre. L’étude des bénévo<strong>la</strong>ts<br />
désagrégés montre, sans grande surprise,<br />
que c’est <strong>dans</strong> le domaine éducatif que l’impact<br />
positif se manifeste fortement. On pense notamment<br />
<strong>dans</strong> ce cas à <strong>la</strong> participation des adultes<br />
aux associations de parents d’élèves, pour le<br />
fonctionnement desquel<strong>les</strong> ils <strong>son</strong>t susceptib<strong>les</strong><br />
d’être sollicités au moins ponctuellement.<br />
13. Il est rappelé qu’un individu peut avoir plusieurs participations.<br />
Dans l’enquête Vie <strong>associative</strong>, on peut ainsi étudier<br />
jusqu’à quatre participations pour une même per<strong>son</strong>ne. Le commentaire<br />
est ici réalisé sur <strong>les</strong> observations brutes, puisqu’il n’est<br />
pas possible d’effectuer de pondérations à ce niveau.<br />
14. Cette façon de procéder a été préférée à l’estimation d’un<br />
modèle Probit multivarié à sept variab<strong>les</strong> endogènes en rai<strong>son</strong><br />
des <strong>temps</strong> très longs de calculs auxquels cette dernière méthode<br />
expose. L’estimation des corré<strong>la</strong>tions deux à deux par des modè<strong>les</strong><br />
bivariés peut être considérée comme le résultat approché que<br />
l’on obtiendrait par une méthode de pseudo maximum de vraisemb<strong>la</strong>nce.<br />
Sous certaines conditions de régu<strong>la</strong>rité, on peut<br />
montrer que cet estimateur est convergent et asymptotiquement<br />
normal.<br />
20 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
Tableau 6<br />
Les déterminants du bénévo<strong>la</strong>t par domaine d’activité<br />
Type de bénévo<strong>la</strong>t Sport<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 21<br />
Culture<br />
Loisirs<br />
Éducation<br />
Action<br />
sociale<br />
Caritatif<br />
Défense<br />
de droits<br />
Religieux<br />
Autre<br />
bénévo<strong>la</strong>t<br />
Constante - 2,010 *** - 2,174 *** - 3,328 *** - 2,816 *** - 3,324 *** - 4,610 *** - 3,205 ***<br />
Sexe féminin - 0,457 *** - 0,160 *** 0,160 ** 0,159 ** - 0,268 *** 0,206 * - 0,341 ***<br />
Âge 0,010 0,008 0,021 0,021 ** 0,065 *** 0,025 0,037 ***<br />
Âge au carré (10E-2) - 0,022 ** - 0,009 - 0,032 ** - 0,021 ** - 0,062 *** - 0,023 - 0,036 ***<br />
En couple 0,199 *** 0,094 0,253 *** - 0,076 - 0,139 * 0,023 - 0,026<br />
Enfants 0 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.<br />
1, moins de 3 ans - 0,161 - 0,238 - 0,522 * - 0,309 - 0,195 - 0,593<br />
1, plus de 3 ans - 0,193 ** - 0,106 0,546 *** - 0,067 0,102 0,080 - 0,109<br />
2, 1 de moins de 3 ans - 0,571 *** - 0,313 ** 0,636 *** - 0,469 ** - 0,145 - 0,325 - 0,143<br />
2, plus de 3 ans 0,109 - 0,106 0,634 *** - 0,366 *** - 0,177 0,218 - 0,129<br />
3 et plus, 1 de moins de 3 ans - 0,177 - 0,194 0,411 * - 0,703 * 0,003 0,136 - 0,357<br />
3 et plus, plus de 3 ans 0,141 0,006 0,907 *** - 0,096 - 0,085 0,626 *** - 0,366<br />
Formation Sans diplôme Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.<br />
CEP 0,181 0,209 ** 0,369 ** 0,061 0,047 0,041 0,039<br />
CAP - BEP - BEPC 0,135 0,200 ** 0,345 ** 0,147 0,255 ** 0,304 * 0,236<br />
Bac 0,346 *** 0,425 *** 0,658 *** 0,315 *** 0,342 *** 0,109 0,377 **<br />
Bac +2 0,187 0,361 *** 0,598 *** 0,339 ** 0,424 *** - 0,119 0,494 ***<br />
Supérieur à Bac +2 0,081 0,544 *** 0,967 *** 0,508 *** 0,398 *** 0,197 0,570 ***<br />
Revenu Moins de 12 195 € Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.<br />
annuel De 12 195 à 18 293 € 0,063 0,163 ** 0,045 0,034 0,054 - 0,087 0,059<br />
De 18 293 à 27 439 € 0,135 0,189 ** 0,043 0,082 - 0,032 0,152 - 0,017<br />
De 27 439 à 45 732 € 0,278 *** 0,029 - 0,034 0,067 0,249 ** 0,058 0,087<br />
Plus de 45 732 € 0,153 0,065 0,115 0,225 * 0,307 ** - 0,263 - 0,086<br />
Propriétaire de <strong>son</strong> logement 0,046 0,104 * 0,086 0,029 0,137 ** 0,134 0,020<br />
Religion Pratique régulière - 0,331 *** 0,031 0,352 *** 0,470 *** - 0,092 1,921 *** 0,180<br />
Pratique occasionnelle - 0,201 ** 0,013 0,010 0,081 0,028 0,826 *** - 0,011<br />
Appartenance sans pratique - 0,097 - 0,096 0,060 0,031 - 0,099 0,278 0,173 *<br />
Ni appartenance, ni pratique Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.<br />
Père bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,295 *** 0,140 ** 0,084 0,427 *** 0,122 0,330 * 0,277 ***<br />
Mère bénévole <strong>dans</strong> le passé 0,097 0,223 *** 0,159 0,086 0,280 *** 0,236 0,030<br />
Résidence Commune rurale 0,369 *** 0,373 *** 0,058 - 0,097 - 0,080 0,238 * 0,252 **<br />
Urbaine < 20 000 h. 0,248 *** 0,290 *** - 0,202 * 0,021 0,101 0,148 0,068<br />
De 20 000 à 100 000 h. 0,146 0,154 * 0,069 0,008 - 0,087 0,218 0,112<br />
Plus de 100 000 h. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.<br />
Région Région parisienne Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.<br />
Bassin parisien 0,122 0,097 - 0,022 0,227 * - 0,140 0,206 - 0,081<br />
Nord 0,169 0,195 * 0,173 0,397 *** - 0,067 0,260 - 0,274<br />
Est 0,370 *** 0,011 0,084 0,095 - 0,135 0,323 0,110<br />
Ouest 0,406 *** 0,194 ** 0,410 *** 0,339 *** - 0,312 *** 0,314 - 0,020<br />
Sud-Ouest 0,336 *** 0,155 0,064 0,096 0,095 0,450 ** - 0,068<br />
Centre-Est 0,356 *** 0,180 * 0,237 * 0,234 * 0,122 0,128 - 0,078<br />
Méditerranée 0,108 - 0,091 0,093 0,221 * 0,081 0,149 - 0,054<br />
Nombre de bénévo<strong>les</strong><br />
Coefficients de corré<strong>la</strong>tion<br />
387 519 227 254 295 114 114<br />
Sportif - 0,069 0,075 - 0,022 0,041 - 0,248 * 0,021<br />
Culturel - 0,068 0,121 ** 0,033 0,084 0,023<br />
Éducation - - 0,008 - 0,002 0,063 0,091<br />
Action sociale, caritative, humanitaire - 0,012 - 0,214 * 0,196 **<br />
Défense des droits - 0,078 0,122 *<br />
Religieux - - 0,067<br />
Autre bénévo<strong>la</strong>t -<br />
Lecture : <strong>les</strong> coefficients reportés <strong>son</strong>t obtenus à partir de modè<strong>les</strong> Probit simp<strong>les</strong> pour chaque type de bénévo<strong>la</strong>t. Les coefficients de<br />
corré<strong>la</strong>tion <strong>son</strong>t obtenus à partir de modè<strong>les</strong> Probit bivariés estimés pour <strong>les</strong> combinai<strong>son</strong>s de bénévo<strong>la</strong>t deux à deux. Les seuils de<br />
significativité <strong>son</strong>t respectivement égaux à 1 % ( *** ), 5 % ( ** ) et 10 % ( * ).<br />
Source: enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.
Les famil<strong>les</strong> nombreuses paraissent également<br />
constituer un contexte favorable au bénévo<strong>la</strong>t<br />
religieux. Là encore, l’hypothèse selon <strong>la</strong>quelle<br />
<strong>les</strong> parents <strong>son</strong>t incités à réaliser certains services<br />
(comme <strong>la</strong> catéchèse) est p<strong>la</strong>usible. En revanche,<br />
l’influence négative des enfants est perceptible,<br />
bien que de manière non systématique, <strong>dans</strong> le<br />
domaine du sport, <strong>dans</strong> celui de <strong>la</strong> culture et des<br />
loisirs ainsi que <strong>dans</strong> celui de l’action sociale et<br />
de l’humanitaire. Toutefois, en ce qui concerne<br />
<strong>les</strong> deux premiers domaines, on remarquera que<br />
<strong>les</strong> membres des famil<strong>les</strong> nombreuses ne se distinguent<br />
plus des ménages sans enfants quant à <strong>la</strong><br />
probabilité d’être bénévole, alors même que <strong>la</strong><br />
pression sur <strong>les</strong> emplois du <strong>temps</strong> y est plus forte.<br />
Tout se passe comme si l’impact négatif était<br />
alors compensé par des incitations de plus en plus<br />
fortes à réaliser des services récréatifs pour <strong>les</strong><br />
enfants en rai<strong>son</strong> de l’obtention « d’économies<br />
d’échelle ». Cet effet de compensation ne joue<br />
pas <strong>dans</strong> le domaine de l’action sociale et humanitaire,<br />
car il est beaucoup moins probable que,<br />
<strong>dans</strong> ce cas, <strong>les</strong> services rendus puissent bénéficier<br />
à ses propres enfants.<br />
Les bénévo<strong>la</strong>ts sportifs ou religieux<br />
peu sensib<strong>les</strong> au niveau de formation initiale<br />
L’importante influence positive du niveau de<br />
<strong>la</strong> formation initiale sur <strong>la</strong> pratique bénévole<br />
s’observe <strong>dans</strong> tous <strong>les</strong> domaines sauf deux :<br />
le bénévo<strong>la</strong>t sportif et le bénévo<strong>la</strong>t religieux.<br />
S’agissant du premier d’entre eux, il n’y a que<br />
<strong>les</strong> titu<strong>la</strong>ires du seul bacca<strong>la</strong>uréat à se distinguer<br />
par une propension plus forte à y participer,<br />
mais <strong>les</strong> diplômés du supérieur ne se différencient<br />
pas des sans-diplôme (15). Dans <strong>la</strong><br />
mesure où l’influence de cette dimension<br />
explicative peut être au moins partiellement<br />
attribuée à un effet de compétence (aussi bien<br />
ressentie subjectivement que reconnue socialement)<br />
qui pousse à s’engager cel<strong>les</strong> et ceux<br />
qui se sentent aptes à satisfaire <strong>les</strong> attentes de<br />
l’association, l’exception sportive se comprend<br />
assez aisément. Car <strong>dans</strong> ce domaine, ce<br />
n’est pas principalement à l’aune de <strong>la</strong> certification<br />
sco<strong>la</strong>ire que <strong>les</strong> capacités se reconnaissent.<br />
En revanche, l’apparente insensibilité du<br />
bénévo<strong>la</strong>t religieux à <strong>la</strong> formation est plus surprenante<br />
et contredit un résultat antérieur<br />
obtenu à partir de l’enquête Emploi du <strong>temps</strong><br />
de l’<strong>Insee</strong> de 1985-1986 (Prouteau, 1998).<br />
Mais le nombre restreint de participants à ce<br />
bénévo<strong>la</strong>t <strong>dans</strong> l’échantillon de l’enquête<br />
Vie <strong>associative</strong> invite à <strong>la</strong> prudence.<br />
Habiter <strong>dans</strong> une zone rurale ou une petite ville<br />
a un effet favorable sur le bénévo<strong>la</strong>t sportif et<br />
celui tourné vers <strong>la</strong> culture et <strong>les</strong> loisirs. Ce<br />
constat est assez cohérent avec l’hypothèse<br />
selon <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> participation est encouragée<br />
par le besoin de pallier, au moyen de l’initiative<br />
<strong>associative</strong>, l’insuffisance de certains biens collectifs<br />
locaux dont l’offre publique, voire marchande,<br />
est plus rare <strong>dans</strong> <strong>les</strong> zones à plus faible<br />
densité démographique. Résider <strong>dans</strong> une commune<br />
rurale rend également plus probable <strong>la</strong><br />
pratique bénévole religieuse (au seuil de significativité<br />
de 10 %), ce qui là encore peut traduire<br />
un besoin plus vif de remédier à <strong>la</strong> pénurie de<br />
clercs <strong>dans</strong> ces zones d’habitat. L’Ouest de <strong>la</strong><br />
France est une région fréquemment associée à<br />
de plus fortes dispositions à participer, sauf en<br />
matière de défense de droits où, au contraire,<br />
<strong>son</strong> influence est alors significativement négative.<br />
(15)<br />
Des facteurs explicatifs ni systématiques<br />
ni univoques<br />
L’impact positif de l’accroissement du revenu<br />
domestique sur <strong>la</strong> participation mis en évidence<br />
sur données agrégées demande à être circonstancié<br />
au niveau sectoriel. Dans le domaine de<br />
l’action sociale et surtout <strong>dans</strong> celui de <strong>la</strong><br />
défense de droits, <strong>la</strong> participation est plus forte,<br />
toutes choses éga<strong>les</strong> par ailleurs, parmi <strong>les</strong> hauts<br />
revenus. Dans le domaine de <strong>la</strong> culture et des<br />
loisirs, l’impact de cette variable disparaît audelà<br />
de <strong>la</strong> 3 ème tranche, <strong>les</strong> hauts et très hauts<br />
revenus ne se distinguant pas des plus faib<strong>les</strong>.<br />
Dans le domaine sportif, <strong>son</strong> rôle est également<br />
circonscrit puisqu’il ne se manifeste que <strong>dans</strong><br />
l’avant dernière tranche.<br />
Cet examen sectoriel conduit également à tempérer<br />
le propos antérieur re<strong>la</strong>tif à l’incidence<br />
d’une pratique religieuse assidue sur le bénévo<strong>la</strong>t.<br />
Son effet d’encouragement n’apparaît en<br />
effet ni systématique ni univoque. Il se manifeste<br />
bien évidemment sur <strong>la</strong> pratique du bénévo<strong>la</strong>t<br />
religieux et paroissial, ce qui était on ne<br />
peut plus prévisible (16). Les bénévo<strong>la</strong>ts d’action<br />
15. Au milieu des années 1980, l’influence maximum du diplôme<br />
sur le bénévo<strong>la</strong>t sportif se situait dès le niveau du BEPC-CAP<br />
(Prouteau, 1998). Le dép<strong>la</strong>cement vers le niveau bac observé ici<br />
est cohérent avec <strong>la</strong> massification de <strong>la</strong> sco<strong>la</strong>risation <strong>dans</strong> le<br />
second cycle de l’enseignement secondaire qui s’est opérée ces<br />
dernières décennies.<br />
16. Le caractère exogène de <strong>la</strong> pratique religieuse par rapport au<br />
bénévo<strong>la</strong>t de ce secteur peut être mis en doute. Son retrait de <strong>la</strong><br />
régression ne modifie pourtant pas substantiellement <strong>les</strong> coefficients<br />
des autres variab<strong>les</strong>, ni leurs seuils de significativité. On<br />
notera au passage que s’agissant de ce bénévo<strong>la</strong>t religieux, peu<br />
nombreux <strong>son</strong>t <strong>les</strong> coefficients qui atteignent <strong>les</strong> seuils de significativité<br />
conventionnels. Outre <strong>la</strong> question des effectifs restreints<br />
déjà évoqués, on peut aussi penser que, pour cet engagement,<br />
ce <strong>son</strong>t <strong>les</strong> convictions (ici inobservées) beaucoup plus que <strong>les</strong><br />
caractéristiques sociodémographiques qui <strong>son</strong>t déterminantes.<br />
22 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
sociale et éducatif y <strong>son</strong>t également sensib<strong>les</strong>.<br />
Mais il ne se manifeste pas <strong>dans</strong> <strong>les</strong> domaines de<br />
<strong>la</strong> culture et des loisirs, de <strong>la</strong> défense de droits, et<br />
l’impact de cette variable de<strong>vie</strong>nt franchement<br />
dissuasif <strong>dans</strong> le domaine sportif.<br />
En revanche, le rôle favorable de <strong>la</strong> tradition<br />
bénévole parentale sur <strong>la</strong> participation de <strong>la</strong><br />
génération suivante est très <strong>la</strong>rgement partagé, à<br />
l’exception du domaine éducatif. Être propriétaire<br />
de <strong>son</strong> logement n’exerce un impact positif<br />
significatif (au seuil de 10 %) sur <strong>la</strong> participation<br />
bénévole que <strong>dans</strong> deux domaines<br />
seulement : <strong>la</strong> culture et <strong>les</strong> loisirs, d’une part, <strong>la</strong><br />
défense de droits, de l’autre. Ce dernier<br />
domaine, il est vrai, inclut des organismes<br />
comme <strong>les</strong> groupements de propriétaires ou de<br />
copropriétaires, ainsi que des conseils syndicaux<br />
de copropriété.<br />
Une fois le rôle de ces différents facteurs sociodémographiques<br />
pris en compte, <strong>les</strong> participations<br />
aux bénévo<strong>la</strong>ts sectoriels apparaissent<br />
assez rarement corrélées (cf. tableau 6). Cinq<br />
coefficients seulement <strong>son</strong>t significatifs, et<br />
encore trois d’entre eux ne le <strong>son</strong>t qu’au seuil de<br />
10 %. Hormis ceux concernant le domaine<br />
« autre bénévo<strong>la</strong>t » qui, de par <strong>son</strong> hétérogénéité,<br />
exclut toute possibilité de commentaire,<br />
on notera <strong>la</strong> corré<strong>la</strong>tion positive entre le bénévo<strong>la</strong>t<br />
d’action sociale et celui qui se manifeste<br />
<strong>dans</strong> le domaine de <strong>la</strong> culture et des loisirs. Le<br />
bénévo<strong>la</strong>t religieux est, quant à lui, négativement<br />
corrélé au bénévo<strong>la</strong>t sportif. Si l’on se rappelle<br />
que ce dernier est également découragé<br />
par <strong>la</strong> pratique religieuse, on est en mesure de<br />
suggérer que <strong>les</strong> deux bénévo<strong>la</strong>ts dont il est<br />
question ici apparaissent assez nettement alternatifs.<br />
Plus surprenante, a priori, est <strong>la</strong> corré<strong>la</strong>tion<br />
négative entre le bénévo<strong>la</strong>t d’action sociale<br />
et le bénévo<strong>la</strong>t religieux. Peut-être ce dernier<br />
est-il l’occasion de pratiquer certaines activités<br />
de nature caritative, ce qui contribuerait alors à<br />
en faire un engagement partiellement substituable<br />
au premier bénévo<strong>la</strong>t. Mais l’hypothèse est<br />
ici purement exploratoire et demande confirmation.<br />
Les motivations du bénévo<strong>la</strong>t<br />
E<br />
n mettant en évidence l’influence de certaines<br />
caractéristiques démographiques et<br />
socio-économiques des individus sur leur disposition<br />
à s’engager, l’examen précédent a permis<br />
d’avancer quelques suggestions sur <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s<br />
qui <strong>son</strong>t au fondement du comportement béné-<br />
vole. Pour stimu<strong>la</strong>ntes qu’el<strong>les</strong> soient, ces suggestions<br />
n’en conservent pas moins une portée<br />
limitée et restent insuffisantes pour apporter un<br />
degré satisfaisant de crédibilité aux modè<strong>les</strong> de<br />
bénévo<strong>la</strong>t proposés par l’analyse économique,<br />
<strong>les</strong>quels se distinguent entre eux par <strong>les</strong> mobi<strong>les</strong><br />
qui <strong>son</strong>t supposés animer <strong>les</strong> agents. Trois<br />
modè<strong>les</strong> peuvent être ainsi distingués à partir<br />
des travaux réalisés <strong>dans</strong> ce domaine d’études<br />
depuis un quart de siècle : un modèle de production<br />
de biens collectifs, un modèle de consommation<br />
de biens privatifs (ou privés) et un<br />
modèle d’investissement (cf. encadré 2). Les<br />
difficultés rencontrées pour tester <strong>les</strong> prédictions<br />
de chacun de ces modè<strong>les</strong>, et par conséquent<br />
pour valider <strong>les</strong> motifs qui <strong>son</strong>t à leur fondement,<br />
invitent à avoir recours à des<br />
indications complémentaires concernant <strong>les</strong><br />
motivations des bénévo<strong>les</strong> (17).<br />
La difficulté de connaître <strong>les</strong> « vraies »<br />
motivations des bénévo<strong>les</strong><br />
L’enquête Vie <strong>associative</strong> offre à cet égard des<br />
informations en provenance des répondants<br />
eux-mêmes, à qui il était demandé, quand ils<br />
déc<strong>la</strong>raient faire du bénévo<strong>la</strong>t, d’indiquer <strong>les</strong><br />
rai<strong>son</strong>s ayant présidé à leur engagement. Une<br />
liste leur était proposée à cette fin et, lorsque<br />
plusieurs motifs étaient communiqués, ils<br />
devaient préciser celui qu’ils tenaient pour être<br />
le principal (cf. encadré 3). Parce que l’utilisation<br />
de ces réponses expose à de sérieuses<br />
objections, il est nécessaire de prévenir tout<br />
malentendu éventuel.<br />
Bien qu’el<strong>les</strong> soient régulièrement collectées<br />
par <strong>les</strong> enquêtes sur le comportement bénévole<br />
(Hodgkin<strong>son</strong> et Weitzman, 1996 ; Davis Smith,<br />
1998), <strong>les</strong> informations de cette nature en provenance<br />
des enquêtés eux-mêmes <strong>son</strong>t souvent<br />
considérées par <strong>les</strong> chercheurs en sciences<br />
socia<strong>les</strong> comme de peu d’intérêt pour connaître<br />
<strong>les</strong> « vraies » motivations des bénévo<strong>les</strong>. Ce<br />
sera le cas, évidemment, si l’on considère avec<br />
Mucchielli (2001) que <strong>les</strong> motivations de <strong>la</strong><br />
conduite humaine ne procèdent ni de <strong>la</strong> rai<strong>son</strong> ni<br />
de <strong>la</strong> volonté, mais qu’el<strong>les</strong> s’inscrivent entièrement<br />
<strong>dans</strong> le domaine de l’inconscient et <strong>son</strong>t<br />
17. Il n’entre pas <strong>dans</strong> le propos de cet article de s’appesantir<br />
sur le concept de motivation, sa difficulté à le définir et <strong>les</strong> débats<br />
qu’il alimente plus particulièrement en psychologie (Vallerand et<br />
Thill, 1993). Dans <strong>les</strong> limites du présent travail, le terme<br />
« motivation » sera utilisé pour signifier <strong>la</strong> rai<strong>son</strong> d’agir de l’individu,<br />
et il sera tenu pour synonyme de « motif » et de « mobile »,<br />
ce qui, <strong>dans</strong> un autre contexte de recherche, pourrait être éventuellement<br />
contesté.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 23
donc inaccessib<strong>les</strong> à <strong>la</strong> perception des acteurs.<br />
Même en accordant un rôle plus conséquent, et<br />
plus conforme à l’hypothèse micro-économique<br />
traditionnelle de rationalité de l’agent, aux fonctions<br />
cognitives de l’individu <strong>dans</strong> <strong>la</strong> formation<br />
Encadré 2<br />
LA MODÉLISATION ÉCONOMIQUE DES MOTIVATIONS DU BÉNÉVOLAT<br />
Chaque modèle économique du comportement bénévole<br />
est fondé sur une motivation censée animer <strong>les</strong><br />
participants. Ainsi, le modèle de « production de biens<br />
collectifs » suppose que le bénévole s’engage uniquement<br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> perspective de contribuer à <strong>la</strong> réalisation<br />
de services associatifs présentant certains attributs de<br />
biens collectifs. Sa participation n’a donc d’intérêt à<br />
ses yeux qu’en tant que facteur de production. Le<br />
bénévo<strong>la</strong>t altruiste peut être considéré comme une<br />
variante de ce modèle, <strong>dans</strong> <strong>la</strong>quelle <strong>les</strong> services <strong>son</strong>t<br />
exclusivement tournés vers autrui. Mais il est également<br />
envisageable que le bénévole (ou sa famille)<br />
compte parmi <strong>les</strong> bénéficiaires de ces prestations réalisées<br />
grâce à <strong>son</strong> travail non rémunéré. Il en sera ainsi,<br />
entre autres exemp<strong>les</strong>, <strong>dans</strong> le cas d’une crèche<br />
parentale qui sollicite <strong>la</strong> contribution des adultes pour<br />
garder plusieurs enfants, dont <strong>les</strong> leurs.<br />
Dans le modèle de « consommation de biens<br />
privatifs », c’est l’engagement en lui-même qui est le<br />
mobile du don de <strong>temps</strong> réalisé par l’individu, indépendamment<br />
de l’usage qu’en fait l’association. En<br />
matière de gratification recherchée, une p<strong>la</strong>ce particulière<br />
a été accordée <strong>dans</strong> <strong>la</strong> littérature économique au<br />
« p<strong>la</strong>isir de donner » (warm glow) étudié par Andreoni<br />
(1990). Quant au modèle d’investissement, il voit <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> participation bénévole une activité permettant<br />
d’améliorer sa formation et <strong>son</strong> expérience professionnelle,<br />
donc un moyen d’accumuler du capital humain.<br />
Ce modèle peut être étendu à l’investissement en<br />
capital social, l’individu cherchant alors à accroître <strong>son</strong><br />
réseau de connaissances pour en tirer bénéfice <strong>dans</strong><br />
certaines circonstances, notamment au cours de sa<br />
<strong>vie</strong> professionnelle. Il peut également être é<strong>la</strong>rgi aux<br />
stratégies de signalement. Faire figurer ses engagements<br />
associatifs sur <strong>son</strong> curriculum vitæ est devenu<br />
une pratique fort recommandée.<br />
Trois modè<strong>les</strong> empiriquement peu discriminants<br />
Ces modè<strong>les</strong> de comportement bénévole <strong>son</strong>t peu<br />
discriminants d’un point de vue empirique. Le modèle<br />
de biens collectifs prédit une substitution entre don<br />
d’argent et bénévo<strong>la</strong>t, l’agent décidant de <strong>la</strong> forme que<br />
doit prendre sa contribution sur <strong>la</strong> base de l’efficacité<br />
comparative des deux concours possib<strong>les</strong>. Il anticipe<br />
également une re<strong>la</strong>tion d’éviction (crowding out) entre<br />
l’engagement bénévole et <strong>les</strong> dépenses publiques<br />
consacrées aux domaines d’activité <strong>dans</strong> <strong>les</strong>quels se<br />
déploie l’initiative <strong>associative</strong> (Duncan, 1999). Certains<br />
auteurs (Steinberg, 1989 ; Schiff, 1990) ont toutefois<br />
nuancé, voire contesté, le caractère systématique<br />
d’une telle éviction. Le modèle de bien privatif se prête<br />
des motivations, rien n’autorise à considérer<br />
que <strong>les</strong> mobi<strong>les</strong> réels coïncident avec <strong>les</strong> mobi<strong>les</strong><br />
déc<strong>la</strong>rés. Ces derniers <strong>son</strong>t exposés au biais<br />
des « rai<strong>son</strong>s socio-culturellement acceptées »<br />
(Smith, 1981) ou de <strong>la</strong> « désirabilité sociale »<br />
pour sa part assez mal à une vérification directe <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> mesure où l’hypothèse de satisfactions intrinsèques<br />
tirées du don, sans précision supplémentaire sur leur<br />
nature, est a priori difficilement « falsifiable ». La crédibilité<br />
de ce modèle est donc généralement inférée de<br />
l’incapacité du modèle de biens collectifs à être pleinement<br />
vérifié. Quant au modèle d’investissement, il prédit<br />
une participation bénévole maximum chez <strong>les</strong> jeunes<br />
puisque l’avancée en âge raccourcit l’horizon<br />
temporel sur lequel l’agent peut espérer percevoir le<br />
rendement de <strong>son</strong> engagement.<br />
Les résultats des travaux empiriques auxquels ont<br />
donné lieu ces modè<strong>les</strong> ne s’avèrent guère décisifs.<br />
Ainsi, l’effet d’éviction postulé entre dépenses publiques<br />
et bénévo<strong>la</strong>t n’est nullement systématique (Menchik<br />
et Weisbrod, 1987 ; Schiff, 1990 ; Day et Devlin,<br />
1997). En matière de re<strong>la</strong>tion don de <strong>temps</strong>/don<br />
d’argent, <strong>les</strong> travaux réalisés essentiellement sur données<br />
nord-américaines concluent majoritairement à <strong>la</strong><br />
complémentarité plutôt qu’à <strong>la</strong> substitution, à de rares<br />
exceptions près (Carlin, 2000 ; Andreoni et al., 1996).<br />
S’agissant du modèle d’investissement, Menchik et<br />
Weisbrod (1987) considèrent que le profil par âge de <strong>la</strong><br />
participation bénévole, mis en évidence sur un échantillon<br />
de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion américaine, lui est plutôt favorable<br />
puisque l’engagement culmine à 43 ans pour décliner<br />
ensuite. Il reste à comprendre pourquoi, <strong>dans</strong> une<br />
perspective d’accumu<strong>la</strong>tion de capital humain, le<br />
maximum de participation est si tardif, ce que remarquent<br />
d’ailleurs <strong>les</strong> auteurs de l’étude.<br />
Ce modèle d’investissement a fait l’objet d’autres tests<br />
qui peuvent paraître l’accréditer. Ils <strong>son</strong>t néanmoins<br />
peu ou prou sujets à caution. Par exemple, Mueller<br />
(1975) trouve que <strong>les</strong> femmes qui ont <strong>la</strong> perspective<br />
d’accéder à l’emploi (ou d’y revenir) font plus de bénévo<strong>la</strong>t<br />
que <strong>les</strong> autres. Mais <strong>son</strong> échantillon, restreint,<br />
n’est guère significatif. Day et Devlin (1998) observent,<br />
quant à el<strong>les</strong>, que <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> canadiens ont des<br />
sa<strong>la</strong>ires plus élevés en moyenne que <strong>les</strong> non-bénévo<strong>les</strong>,<br />
l’avantage sa<strong>la</strong>rial qui leur re<strong>vie</strong>nt étant de l’ordre<br />
de 7 %. El<strong>les</strong> voient <strong>dans</strong> cette « prime » l’effet d’un<br />
comportement d’investissement. Mais <strong>la</strong> méthodologie<br />
employée et <strong>les</strong> conclusions tirées des résultats<br />
ainsi obtenus <strong>son</strong>t discutab<strong>les</strong> (Prouteau et Wolff,<br />
2005). Van Dijk et Boin (1993), quant à eux, constatent<br />
que lorsqu’ils participent, <strong>les</strong> chômeurs néer<strong>la</strong>ndais<br />
consacrent plus de <strong>temps</strong> à leur bénévo<strong>la</strong>t que <strong>les</strong><br />
actifs en emploi. Ils suggèrent d’y voir l’effet d’un motif<br />
d’investissement, mais il pourrait tout aussi bien s’agir<br />
de l’effet d’une moindre tension sur <strong>les</strong> emplois du<br />
<strong>temps</strong>.<br />
24 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
(Heshka, 1983 ; Rubin et Thorelli, 1984 ; Tschirhart<br />
et al., 2001) qui incite l’enquêté à privilégier<br />
<strong>la</strong> rai<strong>son</strong> qu’il pense être attendue parce que<br />
dotée du plus fort capital de légitimité. Dans ce<br />
cadre, <strong>les</strong> motifs altruistes seraient privilégiés<br />
<strong>dans</strong> <strong>les</strong> déc<strong>la</strong>rations au détriment de mobi<strong>les</strong><br />
Encadré 3<br />
traduisant une inclination plus per<strong>son</strong>nellement<br />
intéressée.<br />
Pour <strong>les</strong> psychologues, une motivation est un<br />
« construit théorique » et ne se mesure pas directement.<br />
Elle doit être inférée par le chercheur à<br />
LES MOTIVATIONS DES BÉNÉVOLES DANS L’ENQUÊTE VIE ASSOCIATIVE<br />
Dans l’enquête Vie <strong>associative</strong>, <strong>les</strong> motivations des<br />
adhérents et des bénévo<strong>les</strong> font l’objet de questions<br />
spécifiques. Le premier volet, réservé aux membres<br />
des associations, demandait pour quel<strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s ils<br />
avaient adhéré. Les items suivants étaient suggérés :<br />
1. Pour pratiquer un sport.<br />
2. Pour pratiquer une activité culturelle ou artistique.<br />
3. Pour défendre une cause.<br />
4. Pour faire respecter vos droits ou ceux des autres.<br />
5. Pour rencontrer des per<strong>son</strong>nes qui ont <strong>les</strong> mêmes<br />
préoccupations ou <strong>les</strong> mêmes goûts, pour se faire des<br />
amis.<br />
6. Pour être utile à <strong>la</strong> société, pour faire quelque chose<br />
pour <strong>les</strong> autres.<br />
7. Pour vous épanouir, pour occuper votre <strong>temps</strong><br />
libre.<br />
8. Pour aider, défendre <strong>les</strong> intérêts de vos enfants ou<br />
d’autres membres de votre entourage.<br />
9. Pour avoir accès à des renseignements ou des services<br />
(y compris adhésion obligatoire pour bénéficier<br />
de certaines prestations).<br />
10. Pour une autre rai<strong>son</strong>.<br />
Aux per<strong>son</strong>nes qui se révé<strong>la</strong>ient être responsab<strong>les</strong><br />
d’associations ou bénévo<strong>les</strong>, il était ensuite demandé<br />
si <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s qui <strong>les</strong> avaient décidées à assurer ces<br />
fonctions étaient identiques à cel<strong>les</strong> qui avaient motivé<br />
l’adhésion. Si <strong>la</strong> réponse était négative, il était<br />
demandé alors de préciser ces mobi<strong>les</strong>, sur <strong>la</strong> base<br />
des suggestions suivantes :<br />
1. Enseigner un sport ou une activité culturelle.<br />
2. Défendre une cause.<br />
3. Faire respecter vos droits ou ceux des autres.<br />
4. Rencontrer des per<strong>son</strong>nes qui ont <strong>les</strong> mêmes préoccupations<br />
ou <strong>les</strong> mêmes goûts, pour se faire des<br />
amis.<br />
5. Acquérir ou exercer une compétence.<br />
6. Pour être utile à <strong>la</strong> société, pour faire quelque chose<br />
pour <strong>les</strong> autres.<br />
7. Pour vous épanouir, pour occuper votre <strong>temps</strong><br />
libre.<br />
8. Obligatoire, pour bénéficier des activités de l’association.<br />
9. Pour une autre rai<strong>son</strong>.<br />
Dans le second volet du questionnaire, destiné à étudier<br />
le bénévo<strong>la</strong>t ayant échappé au premier volet, c’est<br />
également sur <strong>la</strong> base de cette dernière liste de motivations<br />
que <strong>les</strong> enquêtés <strong>son</strong>t questionnés. Quand<br />
l’item « autre rai<strong>son</strong> » était choisi, <strong>la</strong> per<strong>son</strong>ne devait<br />
apporter des précisions sur <strong>la</strong> nature du motif en question.<br />
À <strong>la</strong> lecture des réponses alors apportées, il s’est<br />
avéré possible d’en rec<strong>la</strong>sser un certain nombre parmi<br />
<strong>les</strong> autres items proposés.<br />
Les motifs suggérés ont assez souvent un caractère<br />
général ou composite qui ne facilite pas toujours <strong>la</strong><br />
distinction entre eux. Par exemple, pour <strong>les</strong> enquêtés,<br />
<strong>la</strong> proximité peut être grande entre « faire respecter<br />
ses droits » et « défendre <strong>les</strong> intérêts de ses proches ».<br />
Mais <strong>les</strong> items proposés n’ayant pas un caractère<br />
exclusif, <strong>les</strong> per<strong>son</strong>nes interrogées pouvaient indiquer<br />
plusieurs rai<strong>son</strong>s au fondement de leurs engagements.<br />
Si tel était le cas, il leur était demandé de préciser<br />
quelle était <strong>la</strong> rai<strong>son</strong> principale. Il va de soi que<br />
lorsqu’un seul mobile a été cité, il a été considéré<br />
comme <strong>la</strong> rai<strong>son</strong> principale. L’étude porte successivement<br />
sur l’ensemble des motivations et sur <strong>les</strong> seu<strong>les</strong><br />
motivations principa<strong>les</strong>.<br />
Dans le premier cas, dix groupes de motifs ont été<br />
retenus : pratiquer ou enseigner un sport ou une activité<br />
culturelle, défendre une cause, faire respecter ses<br />
droits ou ceux d’autrui, rencontrer des per<strong>son</strong>nes qui<br />
ont <strong>les</strong> mêmes préoccupations ou <strong>les</strong> mêmes goûts et<br />
se faire des amis, acquérir ou exercer une compétence,<br />
être utile à <strong>la</strong> société et aider <strong>les</strong> autres, s’épanouir<br />
et occuper <strong>son</strong> <strong>temps</strong> libre, aider ou défendre <strong>les</strong><br />
intérêts de sa famille ou de <strong>son</strong> entourage, avoir accès<br />
à des renseignements ou des services, autre rai<strong>son</strong>.<br />
Du fait de <strong>la</strong> faib<strong>les</strong>se des effectifs concernés par certaines<br />
motivations principa<strong>les</strong>, des regroupements ont<br />
dû être opérés conduisant à distinguer <strong>les</strong> sept catégories<br />
suivantes : pratiquer ou enseigner un sport ou<br />
une activité culturelle, défendre une cause, faire respecter<br />
ses droits ou ceux d’autrui ainsi que défendre<br />
<strong>les</strong> intérêts de sa famille et de <strong>son</strong> entourage, rencontrer<br />
des per<strong>son</strong>nes qui ont <strong>les</strong> mêmes préoccupations<br />
ou <strong>les</strong> mêmes goûts et se faire des amis, être utile à <strong>la</strong><br />
société et aider <strong>les</strong> autres, s’épanouir et occuper <strong>son</strong><br />
<strong>temps</strong> libre, autre rai<strong>son</strong>. Les catégories « acquisition<br />
ou utilisation de compétences » et « accès à des renseignements<br />
ou des services » ont été intégrées <strong>dans</strong><br />
<strong>la</strong> catégorie « autre rai<strong>son</strong> ».<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 25
partir de ses observations, d’où une marge inévitable<br />
d’imprécision <strong>dans</strong> <strong>son</strong> appréhension<br />
(Vallerand et Thill, 1983). Concrètement, <strong>les</strong><br />
travaux menés <strong>dans</strong> cette discipline sur <strong>les</strong> motivations<br />
des bénévo<strong>les</strong> réalisent ces inférences<br />
au moyen d’analyses factoriel<strong>les</strong>, à partir d’un<br />
certain nombre de réponses des enquêtés re<strong>la</strong>tives<br />
à <strong>la</strong> perception qu’ils ont de leur engagement,<br />
du rôle des associations, et d’autres<br />
aspects de <strong>la</strong> <strong>vie</strong> sociale. Sont ainsi identifiées<br />
des motivations sous-jacentes appelées parfois<br />
motivations primaires (Omoto et Snyder, 1993)<br />
ou, <strong>dans</strong> le cadre d’approches fonctionnalistes,<br />
des « fonctions motivationnel<strong>les</strong> » (C<strong>la</strong>ry et al.,<br />
1998).<br />
Il n’entre pas <strong>dans</strong> nos intentions de mésestimer<br />
<strong>les</strong> biais auxquels expose l’utilisation des réponses<br />
obtenues des bénévo<strong>les</strong>. Mais outre que ces<br />
matériaux <strong>son</strong>t <strong>les</strong> seuls dont on dispose en<br />
matière de motifs <strong>dans</strong> l’enquête, il ne paraît pas<br />
incongru de <strong>les</strong> exploiter dès lors que <strong>les</strong> résultats<br />
de ce travail <strong>son</strong>t utilisés avec précaution<br />
(18). Il con<strong>vie</strong>nt, en particulier, de préciser<br />
que l’objectif poursuivi ici n’est pas de considérer<br />
ces réponses comme devant révéler le fin<br />
mot des motivations bénévo<strong>les</strong>. Il s’agit plutôt<br />
de <strong>les</strong> examiner à <strong>la</strong> lumière des présomptions<br />
qu’a pu faire naître l’étude des profils des participants.<br />
Si réponses et présomptions paraissent<br />
cohérentes, l’exercice pourra, faute de certitudes,<br />
tout au moins fournir un « faisceau<br />
d’indices » de nature à étayer <strong>la</strong> crédibilité de<br />
certaines hypothèses au fondement des modè<strong>les</strong><br />
économiques du bénévo<strong>la</strong>t. Si tel n’est pas le<br />
cas, on se gardera de conclure hâtivement soit à<br />
<strong>la</strong> vanité de <strong>la</strong> démarche inductive à partir des<br />
profils des bénévo<strong>les</strong>, soit à <strong>la</strong> dissimu<strong>la</strong>tion par<br />
<strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> de leurs « vrais » motifs.<br />
Tenir compte de <strong>la</strong> perception subjective<br />
du questionnaire par l’enquêté<br />
Le statut donné à ces informations sur <strong>les</strong> motivations<br />
étant précisé, il faut encore noter trois autres<br />
difficultés rencontrées <strong>dans</strong> leur étude. La première<br />
procède du caractère parfois assez vague<br />
des items qui étaient proposés par le questionnaire<br />
pour déc<strong>la</strong>rer <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s de s’engager en<br />
tant que bénévole. Si <strong>la</strong> volonté de pratiquer ou<br />
d’enseigner une activité sportive ou culturelle ou<br />
celle de défendre <strong>les</strong> intérêts de ses enfants ou de<br />
ses proches ne prêtent guère à ambiguïté, en<br />
revanche une formu<strong>la</strong>tion comme « être utile à <strong>la</strong><br />
société, faire quelques chose pour <strong>les</strong> autres »<br />
reste floue et peut recouvrir aussi bien une disposition<br />
bienveil<strong>la</strong>nte qu’une position éthique de<br />
responsabilité à l’égard de <strong>la</strong> collectivité. Or, si<br />
l’altruisme et <strong>la</strong> morale <strong>son</strong>t parfois tenus pour<br />
identiques, cette assimi<strong>la</strong>tion ne fait guère consensus<br />
(Elster, 1985). Acquérir une compétence<br />
et l’exercer <strong>son</strong>t également deux choses différentes<br />
qui ont pourtant été ici agrégées, tout comme<br />
faire respecter ses droits et défendre ceux des<br />
autres, même s’il s’agit souvent <strong>dans</strong> ce dernier<br />
cas de deux « produits joints ». (18)<br />
La deuxième difficulté découle en partie de <strong>la</strong><br />
première. Il n’apparaît pas toujours aisé de référer<br />
chaque item proposé à un motif envisagé par<br />
<strong>les</strong> modè<strong>les</strong> économiques précités. On peut rai<strong>son</strong>nablement<br />
penser que <strong>la</strong> défense d’une cause<br />
ou le respect des droits <strong>son</strong>t des mobi<strong>les</strong> qui se<br />
rattachent au modèle de bien collectif, puisque<br />
le résultat recherché au travers de cet engagement<br />
associatif est très généralement d’un intérêt<br />
commun. Il peut en être de même, sous<br />
réserve de précisions sur <strong>la</strong> nature de ce motif,<br />
de <strong>la</strong> volonté de « faire quelque chose pour <strong>les</strong><br />
autres » et « d’être utile à <strong>la</strong> société » puisque<br />
l’intérêt porté ainsi à <strong>la</strong> situation d’autrui n’est<br />
probablement pas spécifique au bénévole qui<br />
l’exprime. Pratiquer un sport ou une activité<br />
culturelle, défendre <strong>les</strong> intérêts de <strong>son</strong> entourage<br />
<strong>son</strong>t des motivations qui se rattachent également<br />
au modèle de bien collectif puisque, là encore,<br />
l’objectif poursuivi (s’il est atteint) a toutes <strong>les</strong><br />
chances de bénéficier à plusieurs per<strong>son</strong>nes en<br />
sus du bénévole. Les services sportifs et culturels,<br />
notamment, ont des caractéristiques de<br />
biens collectifs car s’ils peuvent être exclusifs<br />
(il est aisé d’en interdire l’accès aux non-adhérents),<br />
ils présentent, <strong>dans</strong> une certaine mesure,<br />
des attributs de non-rivalité. La pratique commune<br />
est même une condition sine qua non pour<br />
<strong>les</strong> sports collectifs.<br />
En revanche, « rencontrer des per<strong>son</strong>nes qui<br />
ont <strong>les</strong> mêmes préoccupations, se faire des<br />
amis » ainsi que « s’épanouir, occuper <strong>son</strong><br />
<strong>temps</strong> libre » <strong>son</strong>t plus probablement à rattacher<br />
au modèle de consommation de biens privés.<br />
Acquérir une compétence est un motif c<strong>la</strong>irement<br />
assimi<strong>la</strong>ble à l’investissement en capital<br />
humain, mais en exercer une ne s’inscrit pas<br />
nécessairement <strong>dans</strong> le même registre, même<br />
s’il peut s’agir alors d’entretenir ses aptitudes.<br />
Quant à <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>tion « accéder à un renseignement<br />
ou à un service », elle paraît trop floue<br />
pour l’identifier à un modèle. Le choix a été fait<br />
18. Segal et Weisbrod (2002) utilisent également des informations<br />
de ce type en étudiant l’offre de travail bénévole aux États-<br />
Unis <strong>dans</strong> <strong>les</strong> domaines de <strong>la</strong> santé, de l’éducation et de <strong>la</strong> religion.<br />
26 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
ici de ne pas agréger ces items, pour ne pas renforcer<br />
l’incertitude sur <strong>la</strong> nature des catégories<br />
qui résulterait de <strong>la</strong> volonté d’épouser <strong>la</strong> partition<br />
des modè<strong>les</strong> économiques. Au contraire, <strong>les</strong><br />
regroupements ont été limités à ceux rendus<br />
nécessaires par <strong>la</strong> faib<strong>les</strong>se du nombre d’observations<br />
correspondantes (cf. encadré 3).<br />
La troisième difficulté tient au fait que <strong>les</strong><br />
répondants <strong>son</strong>t interrogés <strong>dans</strong> l’enquête sur<br />
<strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s qui <strong>les</strong> ont conduits à devenir bénévo<strong>les</strong>,<br />
alors même qu’un dé<strong>la</strong>i assez conséquent<br />
a pu s’écouler depuis ce moment originel. Aussi<br />
ne peut-on être certain que <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s avancées<br />
<strong>son</strong>t bien cel<strong>les</strong> qui ont présidé au choix de<br />
s’engager plutôt que cel<strong>les</strong> qui incitent à poursuivre<br />
l’engagement. Or, rien ne permet d’affirmer<br />
qu’el<strong>les</strong> <strong>son</strong>t identiques. En effet, plusieurs<br />
travaux ont montré que <strong>les</strong> motivations évoluaient<br />
au cours de <strong>la</strong> « carrière » du bénévole<br />
(Pearce, 1983 ; Gidron, 1984). Cette possible<br />
contamination des motifs initiaux par <strong>les</strong> motifs<br />
courants doit rester à l’esprit par <strong>la</strong> suite.<br />
Aider <strong>les</strong> autres et se faire des re<strong>la</strong>tions<br />
<strong>son</strong>t <strong>les</strong> deux motifs <strong>les</strong> plus souvent cités<br />
L’analyse est tout d’abord conduite au niveau<br />
des participations (ou des engagements) de préférence<br />
à celui des individus (19). Dans <strong>la</strong><br />
Tableau 7<br />
Les motifs déc<strong>la</strong>rés des participations bénévo<strong>les</strong><br />
grande majorité des cas (près de huit sur dix),<br />
plusieurs rai<strong>son</strong>s <strong>son</strong>t avancées pour rendre<br />
compte d’un même engagement (cf. tableau 7).<br />
Dans plus d’un cas sur trois, ce <strong>son</strong>t au moins<br />
quatre motivations qui <strong>son</strong>t ainsi déc<strong>la</strong>rées.<br />
« Être utile à <strong>la</strong> société, faire quelque chose<br />
pour <strong>les</strong> autres » est l’item le plus utilisé par <strong>les</strong><br />
répondant (deux participations sur trois), mais<br />
<strong>les</strong> mobi<strong>les</strong> plus empreints d’intérêt per<strong>son</strong>nel<br />
ne <strong>son</strong>t nullement occultés pour autant.<br />
« Souhaiter rencontrer des per<strong>son</strong>nes ayant <strong>les</strong><br />
même préoccupations et se faire des amis » est<br />
ainsi un motif invoqué <strong>dans</strong> près de six engagements<br />
sur dix. Se trouve ainsi soulignée <strong>la</strong><br />
dimension re<strong>la</strong>tionnelle du bénévo<strong>la</strong>t, dont<br />
l’intérêt a déjà été mise en évidence sur d’autres<br />
données françaises (Prouteau et Wolff, 2004),<br />
mais qui demeure quelque peu négligée par <strong>la</strong><br />
modélisation économique (20).<br />
C’est un autre motif, tourné lui aussi vers <strong>les</strong><br />
satisfactions intrinsèques apportées par l’activité<br />
bénévole, qui est cité en troisième p<strong>la</strong>ce,<br />
puisqu’il s’agit de « s’épanouir, occuper <strong>son</strong><br />
19. Compte tenu de l’impossibilité d’appliquer des pondérations<br />
à ces engagements, le commentaire porte sur le nombre brut de<br />
participations répertoriées par l’enquête.<br />
20. Cet aspect re<strong>la</strong>tionnel mériterait certainement d’occuper une<br />
p<strong>la</strong>ce plus conséquente <strong>dans</strong> <strong>la</strong> littérature économique du bénévo<strong>la</strong>t<br />
que le « warm glow » d’Andreoni (1991) dont l’invocation<br />
paraît souvent ad hoc.<br />
Répartition des participations<br />
bénévo<strong>les</strong><br />
Nombre de motifs déc<strong>la</strong>rés<br />
1 21,2<br />
2 20,1<br />
3 24,5<br />
4 16,2<br />
5 et plus 18,0<br />
Nature du motif déc<strong>la</strong>ré<br />
Pratiquer ou enseigner un sport ou une activité culturelle 26,4<br />
Défendre une cause 32,8<br />
Faire respecter ses droits et ceux des autres 23,2<br />
Rencontrer des per<strong>son</strong>nes ayant <strong>les</strong> mêmes préoccupations, se faire des amis 58,5<br />
Acquérir ou exercer une compétence 8,2<br />
Être utile à <strong>la</strong> société, faire quelque chose pour <strong>les</strong> autres 66,1<br />
S’épanouir, occuper <strong>son</strong> <strong>temps</strong> libre 48,5<br />
Avoir accès à des renseignements ou des services, bénéficier des activités 13,1<br />
Aider, défendre <strong>les</strong> intérêts de ses enfants ou de <strong>son</strong> entourage 16,1<br />
Autres rai<strong>son</strong>s 6,2<br />
Source: enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 27<br />
En %
<strong>temps</strong> libre ». Il est évoqué <strong>dans</strong> presque <strong>la</strong> moitié<br />
des participations. Viennent ensuite, mais<br />
assez loin derrière et par ordre décroissant, <strong>la</strong><br />
défense d’une cause, <strong>la</strong> volonté de pratiquer une<br />
activité sportive ou culturelle, <strong>la</strong> volonté de faire<br />
respecter ses droits et ceux des autres, <strong>la</strong> défense<br />
des intérêts de ses enfants ou de ses proches,<br />
l’accès à des renseignements ou des services et<br />
enfin le désir d’acquérir ou d’exercer une compétence,<br />
qui s’avère être très minoritaire.<br />
Le fait qu’un engagement repose fréquemment<br />
sur plusieurs mobi<strong>les</strong> ne doit pourtant pas conduire<br />
à conclure que tous <strong>les</strong> motifs peuvent<br />
s’apparier de manière équiprobable. Il suffit,<br />
pour s’en rendre compte, de calculer <strong>les</strong> corré<strong>la</strong>tions<br />
deux à deux entre <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s déc<strong>la</strong>rées par<br />
<strong>les</strong> répondants (cf. tableau 8). Ainsi, <strong>la</strong> volonté<br />
de pratiquer un sport ou une activité culturelle<br />
va assez souvent de pair avec <strong>la</strong> recherche<br />
d’épanouissement mais aussi avec un souci re<strong>la</strong>tionnel,<br />
ces deux derniers motifs étant également<br />
nettement corrélés entre eux. La promotion<br />
d’une cause, <strong>la</strong> volonté de faire respecter<br />
ses droits et ceux d’autrui, <strong>la</strong> défense des intérêts<br />
de <strong>son</strong> entourage et le désir d’être utile à <strong>la</strong><br />
Tableau 8<br />
Les corré<strong>la</strong>tions entre <strong>les</strong> motifs cités pour le bénévo<strong>la</strong>t<br />
société <strong>son</strong>t de leur côté c<strong>la</strong>irement associés, <strong>la</strong><br />
corré<strong>la</strong>tion entre <strong>les</strong> deux premiers de ces mobi<strong>les</strong><br />
étant particulièrement forte.<br />
Des motifs d’engagement complexes<br />
Deux sous-ensemb<strong>les</strong> de motivations se signalent<br />
ainsi à l’attention : le premier exprime plutôt<br />
un intérêt porté à soi-même et à <strong>son</strong> bienêtre,<br />
le second étant davantage tourné vers<br />
autrui et vers l’espace public. Ces deux sousensemb<strong>les</strong><br />
s’excluent-ils mutuellement ? La<br />
réponse à cette question mérite d’être nuancée.<br />
D’un côté, <strong>la</strong> pratique d’une activité sportive ou<br />
culturelle et <strong>la</strong> quête d’épanouissement <strong>son</strong>t<br />
bien négativement corrélées avec chacun des<br />
motifs du second sous-ensemble, ce qui incite à<br />
lire le rapport entre <strong>les</strong> deux domaines de motivations<br />
ainsi repérés sur le mode de <strong>la</strong> po<strong>la</strong>rité<br />
(21). Mais de l’autre, le motif re<strong>la</strong>tionnel<br />
joue en quelque sorte le rôle d’un « trait<br />
21. Il est vrai que <strong>la</strong> corré<strong>la</strong>tion négative entre le désir d’être utile<br />
et celui de s’épanouir est d’une importance nettement plus faible<br />
et n’est significatif qu’au seuil de 10 %.<br />
Motif<br />
I. Pratiquer ou enseigner un<br />
I II III IV V VI VII VIII IX X<br />
sport ou une activité culturelle 1,000 - 0,168 - 0,192 0,199 - 0,015 - 0,245 0,366 - 0,091 - 0,046 - 0,090<br />
- (0,000) (0,000) (0,000) (0,512) (0,000) (0,000) (0,000) (0,038) (0,000)<br />
II. Défendre une cause 1,000 0,530 0,118 0,006 0,269 - 0,111 0,240 0,243 - 0,093<br />
III. Faire respecter ses droits<br />
- (0,000) (0,000) (0,784) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)<br />
ou ceux d’autrui 1,000 0,090 0,012 0,132 - 0,161 0,257 0,293 - 0,079<br />
IV. Rencontrer des per<strong>son</strong>nes,<br />
- (0,000) (0,589) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)<br />
se faire des amis 1,000 0,040 0,033 0,400 0,040 0,122 - 0,153<br />
V. Acquérir ou exercer une<br />
- (0,069) (0,132) (0,000) (0,068) (0,000) (0,000)<br />
compétence 1,000 0,106 0,085 - 0,131 - 0,096 - 0,070<br />
VI. Être utile à <strong>la</strong> société,<br />
- (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,002)<br />
aider <strong>les</strong> autres 1,000 - 0,037 0,109 0,040 - 0,175<br />
VII. Occuper <strong>son</strong> <strong>temps</strong> libre,<br />
- (0,090) (0,000) (0,071) (0,000)<br />
s’épanouir 1,000 - 0,117 - 0,051 - 0,128<br />
VIII. Intérêts des enfants ou de<br />
- (0,000) (0,022) (0,000)<br />
proches 1,000 0,278 - 0,030<br />
IX. Obtenir des renseigne-<br />
- (0,000) (0,175)<br />
ments ou des services 1,000 - 0,016<br />
- (0,470)<br />
X. Autres motifs 1,000<br />
-<br />
Lecture : <strong>les</strong> niveaux de significativité <strong>son</strong>t indiqués entre parenthèses sous chaque coefficient de corré<strong>la</strong>tion.<br />
Source : enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.<br />
28 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
d’union » entre <strong>les</strong> deux sous-ensemb<strong>les</strong><br />
puisqu’il est positivement corrélé avec le soutien<br />
d’une cause, <strong>la</strong> détermination à faire respecter<br />
ses droits et ceux d’autrui et, mais <strong>dans</strong> une<br />
moindre mesure, avec <strong>la</strong> volonté de défendre <strong>les</strong><br />
intérêts de <strong>son</strong> entourage. Le souhait d’entretenir<br />
des re<strong>la</strong>tions interper<strong>son</strong>nel<strong>les</strong> est d’ailleurs<br />
le seul motif à n’avoir aucune corré<strong>la</strong>tion négative<br />
avec un autre, si ce n’est celui c<strong>la</strong>ssé <strong>dans</strong> <strong>la</strong><br />
catégorie résiduelle « autre » (22).<br />
Il a déjà été noté que <strong>la</strong> volonté d’accéder à des<br />
renseignements ou à des services est un motif au<br />
contenu incertain, qui prête peu à commentaire<br />
(23). On remarquera ici qu’il présente,<br />
s’agissant des corré<strong>la</strong>tions entretenues avec <strong>les</strong><br />
autres motifs, quelque similitude avec <strong>la</strong><br />
défense des intérêts de ses proches, si ce n’est<br />
qu’il va plus souvent de pair avec le mobile re<strong>la</strong>tionnel<br />
et moins fréquemment avec <strong>la</strong> volonté<br />
d’être utile aux autres. Du fait des liens moins<br />
fréquents qu’elle alimente avec <strong>les</strong> autres motivations,<br />
<strong>la</strong> volonté d’acquérir et d’exercer des<br />
compétences paraît être une rai<strong>son</strong> d’agir assez<br />
particulière. Elle est néanmoins associée positivement<br />
aussi bien à <strong>la</strong> disposition « altruiste »<br />
qui consiste à désirer faire quelque chose pour<br />
<strong>les</strong> autres qu’à <strong>la</strong> quête per<strong>son</strong>nelle d’épanouissement,<br />
et négativement, avec <strong>la</strong> défense des<br />
intérêts de ses proches et le désir d’accéder à des<br />
services et des conseils.<br />
L’examen qui précède montre que <strong>les</strong> rai<strong>son</strong>s de<br />
devenir bénévole se déclinent rarement sur le<br />
mode de l’unicité. Le jeu de leur composition<br />
tend à faire apparaître deux complexes de<br />
motifs assez distincts, l’un tourné vers l’attention<br />
à l’ego, l’autre orienté davantage vers le<br />
souci d’autrui (qu’il soit proche ou qu’il soit<br />
anonyme) ainsi que vers <strong>la</strong> défense de principes.<br />
La recherche de contacts interper<strong>son</strong>nels, mais<br />
aussi le motif qui se rapproche le plus d’une<br />
volonté d’accumuler du capital humain échappent<br />
toutefois à cette distinction. Ne serait-ce<br />
que pour cette rai<strong>son</strong>, il serait très imprudent de<br />
déduire de <strong>la</strong> présente investigation une lecture<br />
binaire des motivations bénévo<strong>les</strong> sur le mode<br />
d’une opposition égoïsme/altruisme.<br />
Isoler <strong>la</strong> motivation principale<br />
On peut se demander si <strong>la</strong> pluralité des motivations<br />
constatée pour chaque engagement se double<br />
de leur différenciation ou de leur convergence<br />
chez <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> qui, rendant des<br />
services <strong>dans</strong> le cadre de plusieurs associations,<br />
ont de ce fait plusieurs engagements. Autrement<br />
dit, <strong>la</strong> multi-activité bénévole traduit-elle une<br />
diversification des mobi<strong>les</strong> ou, au contraire,<br />
s’inscrit-elle <strong>dans</strong> une stratégie de redoublement<br />
concentrée sur <strong>la</strong> poursuite d’objectifs<br />
simi<strong>la</strong>ires ? Pour envisager cette question, le<br />
choix a été fait, à des fins de simplification, de<br />
ne retenir que <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> dont deux engagements<br />
<strong>son</strong>t renseignés <strong>dans</strong> l’enquête, soit<br />
321 individus (24). Pour plus de huit d’entre<br />
eux sur dix, il existe au moins un motif déc<strong>la</strong>ré<br />
commun aux deux engagements (cf. tableau 9),<br />
ce qui paraît militer en faveur de <strong>la</strong> stratégie du<br />
renforcement. On notera toutefois que tous <strong>les</strong><br />
motifs ne <strong>son</strong>t pas enclins à cette récurrence qui<br />
est beaucoup plus fréquente lorsqu’il s’agit<br />
d’être utile à <strong>la</strong> société et d’aider <strong>les</strong> autres, mais<br />
également quand <strong>la</strong> rai<strong>son</strong> avancée évoque <strong>la</strong><br />
recherche de gratifications intrinsèques (se faire<br />
des amis, s’épanouir). (22) (23) (24)<br />
Il reste que déc<strong>la</strong>rer un même mobile pour <strong>les</strong><br />
deux engagements ne signifie pas ipso facto<br />
qu’il a <strong>la</strong> même force d’incitation à chaque fois.<br />
Le questionnaire ne permet pas d’appréhender<br />
l’intensité de <strong>la</strong> motivation déc<strong>la</strong>rée, comme ce<br />
serait le cas si chaque item se présentait sous <strong>la</strong><br />
forme d’une échelle de Likert (25). En revanche,<br />
l’enquête Vie <strong>associative</strong> permet d’identifier le<br />
motif principal de l’engagement. Sous ce jour,<br />
c’est plutôt le constat d’un certain degré de<br />
diversification qui s’impose puisque, pour <strong>les</strong><br />
deux tiers des bénévo<strong>les</strong> ici concernés, le motif<br />
principal diffère pour <strong>les</strong> deux participations<br />
(cf. tableau 9). Là encore, <strong>les</strong> cas de redoublement<br />
de cette même rai<strong>son</strong> principale <strong>son</strong>t surtout<br />
le fait des bénévo<strong>les</strong> exprimant des inclinations<br />
« altruistes ».<br />
L’impossibilité de mesurer l’intensité des<br />
motifs déc<strong>la</strong>rés constitue un handicap lorsqu’il<br />
22. Cette catégorie résiduelle est corrélée négativement avec<br />
presque toutes <strong>les</strong> autres. Elle est <strong>la</strong> seule à être souvent citée à<br />
titre unique, sans aucun autre motif additionnel (<strong>dans</strong> <strong>la</strong> moitié<br />
des cas environ).<br />
23. En particulier, aucune référence n’est faite à <strong>la</strong> nature des<br />
bénéficiaires des services dont il est question.<br />
24. Dans leur immense majorité, ces individus n’ont véritablement<br />
que deux engagements. Ils seront donc désignés du terme<br />
de « bi-participants ». Seuls quelques-uns d’entre eux ont des<br />
participations additionnel<strong>les</strong> non documentés par l’enquête<br />
(cf. tableau en encadré 1). Bien évidemment, <strong>la</strong> portée de l’exercice<br />
reste limitée du fait de <strong>la</strong> faib<strong>les</strong>se des effectifs concernés.<br />
Les résultats obtenus ici n’ont donc qu’une valeur exploratoire.<br />
25. Une échelle de Likert se présente, <strong>dans</strong> une question fermée,<br />
sous <strong>la</strong> forme d’une série d’items ordonnés permettant de<br />
recueillir le degré d’approbation des enquêtés re<strong>la</strong>tivement à des<br />
attitudes, des préférences ou des réactions subjectives. Ainsi,<br />
<strong>dans</strong> l’enquête américaine de The Independent Sector et <strong>dans</strong><br />
celle, britannique, du National Centre for Volunteering, <strong>les</strong> répondants<br />
indiquent, pour chacun des motifs suggérés par le questionnaire,<br />
s’il joue un rôle « très important », « assez important »,<br />
« peu important », « pas important du tout » <strong>dans</strong> l’engagement<br />
(Hodgkin<strong>son</strong> et Weitzman, 1996 ; Davis Smith, 1998).<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 29
s’agit de <strong>les</strong> envisager sous l’angle des modè<strong>les</strong><br />
économiques du bénévo<strong>la</strong>t. Aussi a-t-on choisi<br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> suite de cet article de ne plus considérer<br />
que le motif principal de l’engagement. La fréquence<br />
avec <strong>la</strong>quelle un motif mis en avant par<br />
un répondant est cité à titre principal plutôt qu’à<br />
titre secondaire se révèle assez nettement variable.<br />
C’est <strong>dans</strong> le cas de <strong>la</strong> défense de droits et<br />
du respect des intérêts de ses proches qu’elle est<br />
<strong>la</strong> plus forte (45 %). Le motif altruiste et <strong>la</strong><br />
volonté de pratiquer un sport ou une activité culturelle<br />
suivent de près (respectivement 44 % et<br />
41 %). En revanche, le motif re<strong>la</strong>tionnel et <strong>la</strong><br />
quête d’épanouissement le <strong>son</strong>t plus souvent à<br />
titre secondaire puisque qu’ils ne <strong>son</strong>t indiqués<br />
comme rai<strong>son</strong> prioritaire que <strong>dans</strong> respectivement<br />
25 % et 16 % des cas.<br />
Le choix de privilégier désormais le motif principal<br />
impose quelques regroupements de mobi<strong>les</strong><br />
(cf. encadré 3). En particulier, le désir<br />
« d’acquérir ou d’exercer une compétence »<br />
n’étant plus exprimé à titre principal que pour à<br />
peine 2 % des participations, il a été intégré<br />
avec d’autres motivations de faible occurrence<br />
<strong>dans</strong> <strong>la</strong> catégorie « autres ». Pourtant, au regard<br />
de l’importance que joue le modèle d’investis-<br />
Tableau 9<br />
Les motivations chez <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> engagés <strong>dans</strong> deux associations<br />
sement <strong>dans</strong> l’analyse micro-économique du<br />
bénévo<strong>la</strong>t, il est souhaitable d’accorder quelque<br />
attention à cette rai<strong>son</strong> d’agir. Le commentaire<br />
restera prudent du fait de <strong>la</strong> faib<strong>les</strong>se des effectifs<br />
concernés. Mais l’exercice reste instructif.<br />
Cette motivation est exprimée par des bénévo<strong>les</strong><br />
dont l’âge moyen est nettement inférieur à celui<br />
de l’ensemble des participants (34 ans contre<br />
46 ans). Dans 16 % des cas, <strong>la</strong> participation est<br />
celle d’un chômeur et <strong>dans</strong> 21 % celle d’un étudiant<br />
(contre respectivement 5 % et 8 % pour<br />
l’ensemble des engagements). Les profils des<br />
bénévo<strong>les</strong> concernés par ce motif <strong>son</strong>t donc tout<br />
à fait cohérents avec <strong>les</strong> prédictions du modèle<br />
d’investissement. Mais, du fait de <strong>la</strong> très faible<br />
présence de ce motif exprimé à titre principal,<br />
on comprend mieux pourquoi il s’avère très difficile<br />
de faire apparaître <strong>la</strong> pertinence de ce<br />
modèle lorsque l’investigation empirique est<br />
réalisée sur des données très agrégées.<br />
Cette remarque étant faite, il est possible d’examiner<br />
<strong>la</strong> répartition des engagements selon le<br />
mobile principal déc<strong>la</strong>ré (cf. tableau 10). Dans<br />
trois cas sur dix, il s’agit de <strong>la</strong> volonté d’être<br />
utile à <strong>la</strong> société et d’aider <strong>les</strong> autres. Le motif<br />
re<strong>la</strong>tionnel ainsi que le désir de faire respecter<br />
Tous motifs Motifs principaux<br />
Au moins un motif identique<br />
Oui 84,1<br />
Non<br />
Motifs identiques<br />
15,9<br />
Oui 34,3<br />
Non<br />
Répartition par motif (si cité)<br />
66,7<br />
Pratique sport/culture<br />
Défense d’une cause<br />
Respect de droits<br />
Rencontres<br />
Aider <strong>les</strong> autres<br />
S’épanouir<br />
Cité pour un seul engagement 72,7 85,7<br />
Cité pour <strong>les</strong> deux engagements 27,3 14,3<br />
Cité pour un seul engagement 64,8 80,3<br />
Cité pour <strong>les</strong> deux engagements 35,2 19,7<br />
Cité pour un seul engagement 70,9 85,9<br />
Cité pour <strong>les</strong> deux engagements 29,1 14,1<br />
Cité pour un seul engagement 45,6 84,1<br />
Cité pour <strong>les</strong> deux engagements 54,4 15,9<br />
Cité pour un seul engagement 37,4 65,4<br />
Cité pour <strong>les</strong> deux engagements 62,6 34,6<br />
Cité pour un seul engagement 50,5 82,9<br />
Cité pour <strong>les</strong> deux engagements 49,5 17,1<br />
Cité pour un seul engagement 80,2 89,6<br />
Autre<br />
Cité pour <strong>les</strong> deux engagements 19,8 10,4<br />
Lecture : <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion retenue correspond aux 321 individus dont l’enquête documente deux engagements. 84,1 % des bénévo<strong>les</strong> qui<br />
pratiquent <strong>dans</strong> deux associations déc<strong>la</strong>rent au moins un motif commun à chacun de leurs deux engagements. Lorsque le motif<br />
« Pratique d’un sport ou d’une activité culturelle » est cité, il ne l’est que pour un seul engagement <strong>dans</strong> 72,7 % des cas et pour <strong>les</strong> deux<br />
<strong>dans</strong> 27,3 % des cas. 34,3 % des bénévo<strong>les</strong> reportent le même motif principal pour leurs deux engagements. Lorsque le motif « Pratique<br />
d’un sport ou d’une activité culturelle » est cité à titre principal, il apparaît pour un seul engagement <strong>dans</strong> 85,7 % des cas et pour <strong>les</strong><br />
deux engagements <strong>dans</strong> 14,3 % des cas.<br />
Source : enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.<br />
30 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004<br />
En %
<strong>les</strong> droits (y compris <strong>les</strong> siens) et de défendre <strong>les</strong><br />
intérêts de ses proches <strong>son</strong>t ensuite <strong>les</strong> plus<br />
invoqués, devant <strong>la</strong> volonté de pratiquer une<br />
activité sportive et culturelle et <strong>la</strong> recherche<br />
d’épanouissement.<br />
Les motivations bénévo<strong>les</strong> diffèrent<br />
d’un domaine associatif à l’autre<br />
Les motivations déc<strong>la</strong>rées n’apparaissent pas<br />
liées au caractère régulier ou non de <strong>la</strong> participation,<br />
pas plus qu’el<strong>les</strong> ne le <strong>son</strong>t aux durées consacrées<br />
à l’activité bénévole (cf. tableau 10).<br />
Mais leur répartition diffère nettement selon le<br />
domaine d’activité de l’organisme <strong>dans</strong> lequel<br />
le bénévo<strong>la</strong>t se déroule. Le secteur de l’action<br />
sociale, caritative et humanitaire est celui <strong>dans</strong><br />
lequel <strong>les</strong> engagements <strong>son</strong>t <strong>les</strong> plus fréquemment<br />
animés du souci d’aider <strong>les</strong> autres (six cas<br />
sur dix). Il précède en ce<strong>la</strong> <strong>les</strong> associations religieuses<br />
ou paroissia<strong>les</strong> pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> ce motif<br />
est cité comme prioritaire <strong>dans</strong> quatre cas sur<br />
dix. C’est évidemment <strong>dans</strong> le domaine de <strong>la</strong><br />
défense des droits que le souci de faire respecter<br />
des droits et celui de défendre <strong>les</strong> intérêts de ses<br />
proches <strong>son</strong>t <strong>les</strong> plus présents. La détermination<br />
à soutenir une cause habite plus particulièrement<br />
l’engagement <strong>dans</strong> le domaine social et<br />
humanitaire, mais aussi le bénévo<strong>la</strong>t culturel et<br />
de loisirs, celui qui est consacré à <strong>la</strong> défense de<br />
droits et enfin celui qui est répertorié ici <strong>dans</strong> le<br />
domaine « autre » (dont on rappellera qu’il intègre<br />
notamment <strong>les</strong> associations environnementa<strong>les</strong><br />
et <strong>les</strong> groupes politiques). Le désir de se<br />
faire des amis et <strong>la</strong> recherche d’épanouissement<br />
<strong>son</strong>t plus particulièrement déc<strong>la</strong>rés à titre principal<br />
<strong>dans</strong> <strong>les</strong> associations culturel<strong>les</strong> et de loisirs,<br />
ce qui n’est guère surprenant. Il est également<br />
logique que ce soit <strong>dans</strong> ces associations et<br />
surtout <strong>dans</strong> <strong>les</strong> associations sportives que le<br />
bénévo<strong>la</strong>t soit plus particulièrement animé par<br />
<strong>la</strong> volonté de pratiquer une activité sportive et<br />
culturelle. Les mobi<strong>les</strong> principaux déc<strong>la</strong>rés<br />
n’expriment sans doute pas toutes <strong>les</strong> motivations<br />
profondes des acteurs. L’examen de leur<br />
variabilité intersectorielle montre qu’ils en<br />
constituent tout au moins une rationalisation<br />
assez <strong>la</strong>rgement cohérente avec ce que suggère<br />
l’intuition, même si aucun domaine d’activité<br />
n’a le monopole d’un de ces motifs et que quasiment<br />
aucun de ces derniers n’est exclu d’un<br />
domaine particulier (26).<br />
26. L’exception concerne <strong>la</strong> volonté de pratiquer un sport ou une<br />
activité culturelle, qui n’est jamais citée <strong>dans</strong> <strong>les</strong> engagements<br />
bénévo<strong>les</strong> religieux et paroissiaux.<br />
Tableau 10<br />
Les motivations principa<strong>les</strong> des bénévo<strong>les</strong> selon <strong>les</strong> caractéristiques de l’engagement<br />
Motivation<br />
Pratique<br />
d’activité<br />
Défendre<br />
une cause<br />
Respect<br />
de droits<br />
Se faire<br />
des amis<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 31<br />
Aider<br />
autrui<br />
Occuper<br />
<strong>son</strong> <strong>temps</strong><br />
En %<br />
Autres Total<br />
Type de bénévo<strong>la</strong>t<br />
Régulier 10,8 9,6 14,0 15,4 28,7 7,4 14,1 100<br />
Irrégulier<br />
Durée annuelle de <strong>la</strong> participation<br />
10,9 10,6 14,4 14,4 30,3 8,0 11,4 100<br />
Moins de 40 heures 9,8 9,6 15,3 16,0 27,9 7,8 13,6 100<br />
40 à moins de 120 heures 12,1 9,2 12,9 15,1 29,8 6,8 14,1 100<br />
120 heures et plus<br />
Type d’association<br />
12,7 11,7 12,2 12,0 32,9 8,0 10,5 100<br />
Sportive 31,0 2,7 4,9 15,5 21,9 10,5 13,5 100<br />
Culturelle 13,5 6,9 5,9 26,4 21,1 12,7 13,5 100<br />
Domaine éducatif 3,1 6,1 32,5 5,7 36,4 2,2 14,0 100<br />
Action sociale, caritative 1,1 18,1 6,4 3,6 61,4 2,9 6,5 100<br />
Défense des droits 1,6 12,1 42,7 11,1 16,2 2,6 13,7 100<br />
Religieuse 0,0 10,9 3,4 19,3 40,3 10,1 16,0 100<br />
Autre<br />
Position des bénévo<strong>les</strong> à l’égard<br />
de l’association<br />
3,4 31,3 3,4 10,2 26,3 5,9 19,5 100<br />
Bénévo<strong>les</strong> adhérents 13,8 10,7 18,3 16,8 18,9 8,8 12,7 100<br />
Non adhérents majoritaires 4,7 8,4 5,3 11,0 51,5 5,2 13,9 100<br />
Total 10,9 10,0 14,1 15,0 29,3 7,6 13,1 100<br />
Lecture : 10,8 % des participations bénévo<strong>les</strong> régulières <strong>son</strong>t motivées par <strong>la</strong> pratique d’une activité sportive ou culturelle. 28,7 % de<br />
ces mêmes participations le <strong>son</strong>t par <strong>la</strong> volonté d’être utile à <strong>la</strong> société et d’aider <strong>les</strong> autres.<br />
Source : enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.
On sait que le premier volet du questionnaire à<br />
partir duquel <strong>son</strong>t repérés <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> est<br />
constitué des seuls membres de leur association.<br />
Le second volet concerne à <strong>la</strong> fois des adhérents<br />
et des non-adhérents, mais plusieurs indices<br />
concordants incitent à penser que ces derniers<br />
<strong>son</strong>t majoritaires <strong>dans</strong> <strong>les</strong> réponses collectées.<br />
Or il s’avère que <strong>la</strong> répartition des motifs principaux<br />
invoqués est très distincte selon <strong>la</strong><br />
source. Les réponses données au deuxième<br />
volet font beaucoup plus référence à <strong>la</strong> volonté<br />
d’aider des autres et d’être utile à <strong>la</strong> société :<br />
plus de <strong>la</strong> moitié des participations <strong>son</strong>t guidées<br />
par cette rai<strong>son</strong>, contre moins d’une sur cinq<br />
chez <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> du premier volet (27). On<br />
peut donc risquer l’hypothèse que <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong><br />
non adhérents <strong>son</strong>t plus souvent guidés par des<br />
considérations altruistes que <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong><br />
adhérents. Ce<strong>la</strong> traduit, au moins pour partie, le<br />
fait qu’adhérer à une association est assez fréquemment<br />
une condition sine qua non pour<br />
bénéficier des services offerts. Tel est le cas de<br />
prestations sportives, de loisirs, mais aussi des<br />
services auxquels donnent accès <strong>les</strong> groupements<br />
de nature syndicale ou professionnelle.<br />
Par conséquent, il n’est guère étonnant qu’un<br />
bénévole qui n’a pas jugé bon d’adhérer soit<br />
moins animé de motifs comme <strong>la</strong> pratique<br />
d’activités récréatives ou <strong>la</strong> défense d’intérêts.<br />
Il est également probable qu’un souci d’épanouissement<br />
ou qu’une recherche de re<strong>la</strong>tions<br />
trouve des occasions plus nombreuses de satisfaction<br />
au travers de l’adhésion du fait, entre<br />
Tableau 11<br />
Les motivations principa<strong>les</strong> des bénévo<strong>les</strong> adhérents associatifs<br />
Motivation<br />
Pratique<br />
d’activité<br />
Défendre<br />
une cause<br />
autres, des rencontres et initiatives réservées<br />
aux membres. La prééminence chez <strong>les</strong> nonadhérents<br />
du motif altruiste tiendrait donc à <strong>la</strong><br />
faible prévalence des autres mobi<strong>les</strong>. (27)<br />
Seul le premier volet du questionnaire fournit<br />
des informations assez détaillées sur <strong>la</strong> <strong>vie</strong> de<br />
l’association ainsi que <strong>la</strong> manière dont l’enquêté<br />
l’a découverte. Aussi a-t-on restreint l’examen<br />
qui suit à <strong>la</strong> seule popu<strong>la</strong>tion de ces bénévo<strong>les</strong><br />
adhérents (cf. tableau 11). Lorsque l’association<br />
a été connue par l’intermédiaire d’un membre<br />
de <strong>la</strong> famille, <strong>les</strong> motifs invoqués pour rendre<br />
compte de l’engagement bénévole <strong>son</strong>t plus<br />
fréquemment <strong>la</strong> volonté de s’épanouir et<br />
d’occuper <strong>son</strong> <strong>temps</strong> ainsi que <strong>la</strong> pratique d’une<br />
activité culturelle ou sportive, cette dernière rai<strong>son</strong><br />
étant également plus souvent mise en avant<br />
quand un parent est présent <strong>dans</strong> l’association.<br />
Ce<strong>la</strong> témoigne, <strong>dans</strong> une certaine mesure, du<br />
caractère familial que prennent certaines activités<br />
<strong>associative</strong>s récréatives. En toute logique, le<br />
mobile re<strong>la</strong>tionnel est, quant à lui, plus fréquemment<br />
avancé par <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> qui ont<br />
connu leur association par des amis (ou des voisins,<br />
des collègues, etc.) et lorsqu’un ami en est<br />
également membre. En revanche, le mobile<br />
altruiste est nettement plus présent quand le<br />
bénévole a trouvé <strong>son</strong> association par ses pro-<br />
27. Certains bénévo<strong>les</strong> <strong>son</strong>t interrogés <strong>dans</strong> <strong>les</strong> deux volets du<br />
questionnaire pour des participations évidemment distinctes.<br />
Respect<br />
de droits<br />
Se faire<br />
des amis<br />
32 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004<br />
Aider<br />
autrui<br />
Occuper<br />
<strong>son</strong> <strong>temps</strong><br />
En %<br />
Autres Total<br />
Mode de connaissance de l’association<br />
Par <strong>la</strong> famille 16,5 13,5 10,5 17,0 12,0 18,0 12,5 100<br />
Par des amis, voisins, etc. 13,1 8,9 17,6 20,7 20,4 8,8 10,5 100<br />
Recherche par soi-même 23,1 7,4 15,7 11,1 24,1 5,6 13,0 100<br />
Participation à <strong>la</strong> création 13,3 15,8 14,6 16,4 20,0 5,4 14,5 100<br />
Autre mode 13,9 11,1 19,8 14,5 16,1 10,3 14,5 100<br />
Un ami présent <strong>dans</strong> l’association 14,7 11,0 15,2 19,2 18,4 9,3 12,2 100<br />
Un parent présent <strong>dans</strong> l’association<br />
Présence de sa<strong>la</strong>riés <strong>dans</strong> l’association<br />
17,4 12,4 14,2 17,2 17,3 10,2 11,3 100<br />
Oui 15,4 15,4 18,5 10,4 19,5 7,5 13,3 100<br />
Non<br />
Imp<strong>la</strong>ntation géographique<br />
de l’association<br />
13,5 8,1 18,4 20,1 18,4 9,4 12,1 100<br />
Locale 15,5 7,0 18,0 18,8 18,9 9,2 12,6 100<br />
Régionale, nationale, inter. 10,5 17,7 18,8 13,1 19,0 8,0 12,9 100<br />
Total<br />
Source : enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.<br />
13,8 10,7 18,3 16,8 18,9 8,8 12,7
pres moyens. Mais ce mode de connaissance de<br />
l’association, qui dénote un certain degré de<br />
volontarisme, est également fréquemment associé<br />
au désir de pratiquer une activité sportive ou<br />
culturelle. Participer à <strong>la</strong> fondation d’une association<br />
est une démarche susceptible de traduire<br />
une posture plus militante encore. Il n’est donc<br />
pas étonnant de constater que chez ces<br />
« entrepreneurs associatifs », <strong>la</strong> défense d’une<br />
cause soit plus souvent évoquée comme motif<br />
principal.<br />
Vouloir rencontrer d’autres per<strong>son</strong>nes et se faire<br />
des amis est un objectif qui s’inscrit <strong>dans</strong> le<br />
registre de <strong>la</strong> convivialité à <strong>la</strong>quelle <strong>les</strong> petites<br />
associations « de proximité » <strong>son</strong>t plus particulièrement<br />
propices. Ce motif d’engagement est<br />
en effet plus souvent cité par <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> qui<br />
<strong>son</strong>t membres d’associations sans sa<strong>la</strong>riés et à<br />
rayonnement exclusivement local. En revanche,<br />
<strong>les</strong> causes militantes n’ont aucune rai<strong>son</strong> de se<br />
restreindre à des horizons géographiques<br />
étroits : el<strong>les</strong> peuvent être des « biens<br />
collectifs » autant nationaux, voire mondiaux,<br />
que locaux. Leur défense est effectivement plus<br />
souvent citée chez <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> qui font partie<br />
d’associations régiona<strong>les</strong>, nationa<strong>les</strong> voire<br />
internationa<strong>les</strong>, c’est-à-dire des structures qui<br />
seront aussi de plus grande taille et donc plus<br />
souvent employeurs.<br />
Avoir des enfants stimule<br />
certaines motivations<br />
Dans quelle mesure ces motivations déc<strong>la</strong>rées<br />
portent-el<strong>les</strong> l’empreinte des caractéristiques<br />
sociodémographiques de cel<strong>les</strong> et ceux qui <strong>les</strong><br />
expriment ? Pour répondre à cette question, on a<br />
estimé un modèle Logit multinomial sur <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion des participants, en tenant compte du<br />
fait que certains d’entre eux ont plusieurs engagements<br />
(cf. annexe 2). Re<strong>la</strong>tivement au motif<br />
qui consiste à <strong>la</strong> recherche d’épanouissement et<br />
d’occupation de <strong>son</strong> <strong>temps</strong> libre, pris ici comme<br />
motivation de référence, <strong>les</strong> autres mobi<strong>les</strong><br />
apparaissent peu discriminés par <strong>les</strong> variab<strong>les</strong><br />
retenues, puisque peu de coefficients s’avèrent<br />
être statistiquement significatifs (cf. tableau 12)<br />
(28). Les rares effets qui <strong>son</strong>t révélés n’en ont<br />
donc que plus d’intérêt.<br />
Les femmes bénévo<strong>les</strong> <strong>son</strong>t plus enclines à<br />
déc<strong>la</strong>rer être motivées par <strong>la</strong> volonté de faire<br />
respecter des droits et de défendre <strong>les</strong> intérêts de<br />
leurs proches. Ceci tend à confirmer que l’attention<br />
à <strong>la</strong> famille, quand bien même s’exprime-telle<br />
par des activités réalisées en dehors du<br />
cadre domestique, reste marquée par <strong>la</strong> division<br />
sexuelle traditionnelle des tâches. El<strong>les</strong> <strong>son</strong>t<br />
également plus disposées à s’adonner au bénévo<strong>la</strong>t<br />
pour aider <strong>les</strong> autres. Faut-il y voir chez<br />
el<strong>les</strong> l’indice d’un degré d’altruisme supérieur à<br />
celui de leurs homologues masculins ?<br />
Toujours comparativement à <strong>la</strong> volonté d’occuper<br />
<strong>son</strong> <strong>temps</strong> libre, le désir de pratiquer une<br />
activité sportive et culturelle est un ressort du<br />
bénévo<strong>la</strong>t plus fréquent chez <strong>les</strong> jeunes, ce qui,<br />
s’agissant du sport tout au moins, est assez prévisible.<br />
Il a été noté, lors de l’examen des profils<br />
sectoriels des participants, qu’une pratique religieuse<br />
régulière était défavorable au bénévo<strong>la</strong>t<br />
sportif. Cet effet trouve un écho ici avec<br />
l’influence négative de cette même pratique<br />
religieuse sur le souhait de participer à une activité<br />
récréative de nature sportive ou culturelle.<br />
La catégorie des inactifs est moins disposée à<br />
invoquer le respect des droits et <strong>la</strong> défense des<br />
intérêts de ses proches. Ce<strong>la</strong> témoigne peut-être<br />
de leur manque d’incitation à défendre des<br />
droits et des intérêts que <strong>les</strong> autres enquêtés ont<br />
acquis au travers de l’exercice d’une activité<br />
professionnelle et de ses aspects connexes (29).<br />
Les cadres supérieurs mais aussi <strong>les</strong> professions<br />
intermédiaires expriment davantage des mobi<strong>les</strong><br />
tournés vers autrui et l’espace public. Les<br />
ouvriers ont, pour leur part, une inclination plus<br />
marquée à mettre en avant l’aide aux autres<br />
mais aussi le motif re<strong>la</strong>tionnel. (28) (29)<br />
Au regard des modè<strong>les</strong> économiques du bénévo<strong>la</strong>t,<br />
<strong>la</strong> plus forte participation <strong>dans</strong> <strong>les</strong> zones<br />
faiblement peuplées a conduit à faire l’hypothèse<br />
que l’engagement associatif était stimulé<br />
par <strong>la</strong> volonté de compenser une insuffisance<br />
d’offre publique et marchande de certains services.<br />
L’étude sectorielle des profils bénévo<strong>les</strong><br />
<strong>la</strong>issait penser que tel était plus particulièrement<br />
le cas <strong>dans</strong> <strong>les</strong> domaines du sport, de <strong>la</strong> culture<br />
et des loisirs. On pouvait donc, en conséquence,<br />
s’attendre à ce que le motif tourné vers <strong>la</strong> pratique<br />
de tel<strong>les</strong> activités soit plus fortement invoqué<br />
par <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> des zones rura<strong>les</strong> et des<br />
petites vil<strong>les</strong>. On ne constate pourtant rien de<br />
tel. La taille de <strong>la</strong> commune de résidence n’a<br />
guère d’effet avéré, si ce n’est sur le motif re<strong>la</strong>tionnel.<br />
Résider <strong>dans</strong> une commune rurale (mais<br />
aussi <strong>dans</strong> une ville moyenne) est alors favorable<br />
28. Berger (1991, p. 221) remarque également que <strong>les</strong> motivations<br />
qu’il étudie et qui <strong>son</strong>t el<strong>les</strong> aussi des motivations déc<strong>la</strong>rées<br />
par <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> paraissent peu sensib<strong>les</strong> aux facteurs économiques<br />
et sociodémographiques.<br />
29. Les individus n’exerçant plus de profession <strong>son</strong>t ici rec<strong>la</strong>ssés<br />
<strong>dans</strong> leur catégorie d’origine quand ils en ont une. Les inactifs<br />
<strong>son</strong>t donc ici cel<strong>les</strong> et ceux qui n’ont jamais occupé d’emploi.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 33
à l’expression plus fréquente de ce motif. Certes,<br />
il a été remarqué que ce motif était souvent<br />
corrélé avec <strong>la</strong> pratique d’une activité sportive<br />
ou culturelle, mais ce n’est pas cette dernière qui<br />
est ici invoquée à titre principal. L’hypothèse<br />
d’un bénévo<strong>la</strong>t rural plus particulièrement sensible<br />
au motif « biens collectifs » ne peut donc<br />
ici être confirmée et appelle des investigations<br />
complémentaires.<br />
Tableau 12<br />
Les déterminants socio-économiques des motivations de l’engagement<br />
Motivation Pratique<br />
Ce même motif a été également avancé pour<br />
rendre compte de l’effet positif sur le bénévo<strong>la</strong>t<br />
de <strong>la</strong> présence d’enfants au foyer, du moins s’ils<br />
ne <strong>son</strong>t pas très jeunes. Cette hypothèse se<br />
trouve, quant à elle, renforcée par <strong>les</strong> résultats<br />
de <strong>la</strong> présente investigation économétrique.<br />
Avoir des enfants est en effet nettement et significativement<br />
associé à une invocation plus fréquente<br />
du motif consistant à faire respecter des<br />
34 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004<br />
Défense<br />
cause<br />
Respect<br />
de droits Rencontres<br />
Aider<br />
<strong>les</strong> autres<br />
S’épanouir Autres<br />
Constante 0,760 - 0,910 - 2,281*** - 0,511 0,814 - 0,801<br />
Sexe féminin - 0,260 0,376 0,753 *** 0,399 0,707*** - 0,192<br />
Âge - 0,025** 0,002 0,002 0,004 - 0,004 - - 0,012<br />
En couple 0,263 0,259 0,024 - 0,161 0,126 - 0,129<br />
Enfants 0 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. - Réf.<br />
1 - 0,067 0,114 1,007*** 0,010 0,229 - 0,016<br />
2 0,300 - 0,018 1,198*** 0,282 0,287 - 0,587<br />
3 - 0,463 - 0,373 1,100** - 0,364 - 0,006 - - 0,104<br />
Formation Sans diplôme Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. - Réf.<br />
CEP 0,612 0,639 0,552 0,021 - 0,115 - - 0,485<br />
CAP - BEP - BEPC 0,971* 0,827 0,730 0,088 0,113 - - 0,069<br />
Bac 0,627 0,343 0,159 - 0,199 - 0,283 - - 0,125<br />
Bac + 2 0,534 0,978 0,531 0,272 0,035 - 0,206<br />
Supérieur à Bac + 2 0,401 0,718 0,573 0,567 - 0,096 - 0,263<br />
Catégorie Agriculteur 0,059 0,436 2,055** 0,924 0,279 - 0,961<br />
Sociale Indépendant - 0,158 0,881 2,068*** 0,845 0,330 - 0,645<br />
Profession supérieure 0,924 1,878*** 2,652*** 0,625 1,242** - 1,113*<br />
Profession intermédiaire 0,540 0,951* 2,050*** 0,449 0,803* - 0,452<br />
Employé 0,016 0,016 1,576*** 0,545 0,177 - 0,497<br />
Ouvrier 0,474 0,952 2,377*** 1,134** 0,901* - 0,911*<br />
Inactif Réf. Ref Réf. Réf. Réf. - Réf.<br />
Revenu Moins de 12 195 € Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. - Réf.<br />
annuel De 12 195 à 18 293 € 0,399 - 0,175 0,377 0,439 0,314 - 0,276<br />
De 18 293 à 27 439 € 0,560 - 0,131 - 0,072 0,497 0,026 - 0,357<br />
De 27 439 à 45 732 € 0,861** 0,114 0,401 0,524 0,242 - 0,570<br />
Plus de 45 732 € 0,829 0,018 0,684 0,781 0,382 - 0,488<br />
Propriétaire de <strong>son</strong> logement 0,039 - 0,319 0,160 0,054 - 0,238 - - 0,283<br />
Parents bénévo<strong>les</strong> <strong>dans</strong> le passé - 0,420 0,265 - 0,247 - 0,259 - 0,148 - - 0,095<br />
Religion Pratique régulière - 1,130*** - 0,068 - 0,599 - 0,482 0,031 - - 0,488<br />
Pratique occasionnelle 0,000 0,013 0,547 0,584 0,495 - - 0,026<br />
Appartenance sans pratique - 0,500* - 0,664** - 0,230 - 0,305 - 0,151 - - 0,629**<br />
Ni appartenance, ni pratique Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. - Réf.<br />
Résidence Commune rurale 0,145 0,479 - 0,181 0,758** 0,392 - 0,383<br />
Urbaine < 20 000 h. - 0,449 - 0,051 - 0,301 0,444 0,343 - 0,072<br />
De 20 000 à 100 000 h. 0,598 0,628 0,315 0,877** 0,540 - 0,423<br />
Plus de 100 000 h. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. - Réf.<br />
Nombre de cas 223 204 290 308 601 156 268<br />
Variance de l’effet individuel (t-test) 1,193 (3,30)<br />
Log vraisemb<strong>la</strong>nce - 3582,2<br />
Lecture : modèle Logit multinomial corrigé de l’hétérogénéité individuelle, estimé par une méthode d’intégration numérique. Les seuils<br />
de significativité <strong>son</strong>t respectivement égaux à 1 % ( *** ), 5 % ( ** ) et 10 % ( * ). La motivation de référence est celle qui consiste à rechercher<br />
l’épanouissement et à occuper <strong>son</strong> <strong>temps</strong> libre. Re<strong>la</strong>tivement aux caractéristiques des bénévo<strong>les</strong> qui <strong>son</strong>t principalement motivés par<br />
le désir d’épanouissement, <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> qui expriment à titre principal <strong>la</strong> volonté d’aider <strong>les</strong> autres <strong>son</strong>t plus souvent des femmes, le<br />
coefficient associé à cette variable étant statistiquement significativement positif.<br />
Source: enquête Vie <strong>associative</strong> 2002, <strong>Insee</strong>.
droits et défendre <strong>les</strong> intérêts de ses proches<br />
(cf. tableau 12). On a tout lieu de penser que ce<br />
rôle incitatif des enfants sur le bénévo<strong>la</strong>t des<br />
adultes joue plus particulièrement <strong>dans</strong> le<br />
domaine des services de nature éducative. En<br />
effet, <strong>les</strong> profils sectoriels des participants mettaient<br />
en évidence l’influence stimu<strong>la</strong>nte des<br />
enfants sur le bénévo<strong>la</strong>t éducatif (cf. tableau 6).<br />
Il a également été remarqué que le motif dont il<br />
est question est particulièrement prégnant <strong>dans</strong><br />
<strong>les</strong> associations de ce même domaine<br />
(cf. tableau 10).<br />
De l’étude empirique<br />
aux modè<strong>les</strong> théoriques<br />
À <strong>la</strong> lumière de l’examen conjoint des profils<br />
des bénévo<strong>les</strong> et des mobi<strong>les</strong> qu’ils déc<strong>la</strong>rent,<br />
<strong>les</strong> hypothèses qui fondent <strong>les</strong> modè<strong>les</strong> économiques<br />
du bénévo<strong>la</strong>t apparaissent tout à <strong>la</strong> fois<br />
présenter une certaine crédibilité mais aussi<br />
mériter un enrichissement. Ainsi, le motif re<strong>la</strong>tif<br />
à <strong>la</strong> production de biens collectifs semble bien<br />
être un ressort de l’engagement. On a pu aussi<br />
entrevoir <strong>la</strong> variété potentielle de tels biens, qui<br />
peuvent prendre <strong>la</strong> forme de causes communes<br />
comme celle de <strong>la</strong> pratique d’activités sportives<br />
et récréatives. Leur diversité mérite certainement<br />
d’être mieux documentée. Dans ce cadre,<br />
le résultat le plus robuste acquis ici concerne <strong>la</strong><br />
présence d’enfants <strong>dans</strong> le ménage qui induit<br />
des besoins spécifiques de services, notamment<br />
liés à <strong>la</strong> sco<strong>la</strong>rité. Dans <strong>la</strong> mesure où elle est<br />
satisfaite <strong>dans</strong> un cadre associatif, <strong>la</strong> demande<br />
de tels services encourage bien <strong>la</strong> participation<br />
bénévole des adultes.<br />
Le motif d’investissement en capital humain<br />
n’est pas absent, lui non plus, notamment chez <strong>les</strong><br />
jeunes, ce qui rejoint <strong>les</strong> enseignements d’études<br />
à caractère monographique (Retière, 1994). Mais<br />
s’agissant de ce mobile, on comprend aussi, au<br />
regard du nombre limité de bénévo<strong>les</strong> qui le mettent<br />
en avant, qu’il est assez vain de vouloir le<br />
faire apparaître à partir d’investigations réalisées<br />
sur <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale des participants. Car ce<br />
motif est alors supp<strong>la</strong>nté par <strong>les</strong> autres rai<strong>son</strong>s de<br />
se consacrer au bénévo<strong>la</strong>t, qui ont une prévalence<br />
bien plus forte. Cette remarque en appelle une<br />
autre, plus globale. L’hétérogénéité des motivations<br />
parmi <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> et <strong>la</strong> fréquente pluralité<br />
des mobi<strong>les</strong> chez un même participant rendent<br />
évidemment délicate, à partir de données très<br />
agrégées, <strong>la</strong> vérification empirique de modè<strong>les</strong><br />
qui, faut-il le rappeler, reposent chacun sur l’unicité<br />
d’intention (30).<br />
Il reste que ces modè<strong>les</strong> économiques du bénévo<strong>la</strong>t<br />
ont également besoin d’enrichir leur analyse<br />
des motivations, en accordant notamment<br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce qu’elle mérite à <strong>la</strong> dimension re<strong>la</strong>tionnelle<br />
de ce comportement. De même, et <strong>dans</strong> le<br />
cadre d’un échange nécessairement pluridisciplinaire,<br />
il serait particulièrement intéressant de<br />
confronter <strong>les</strong> présents résultats concernant <strong>les</strong><br />
mobi<strong>les</strong> déc<strong>la</strong>rés par <strong>les</strong> bénévo<strong>les</strong> aux conclusions<br />
qui pourraient être obtenues à partir<br />
d’investigations plus conformes à cel<strong>les</strong> en<br />
vigueur en psychologie et psychosociologie, ce<br />
qui suppose toutefois de disposer de données se<br />
prêtant à de tel<strong>les</strong> approches. ■<br />
Les auteurs remercient deux rapporteurs anonymes de <strong>la</strong> revue pour leur lecture attentive et pour<br />
leurs remarques et suggestions sur une version préliminaire de cet article.<br />
Alix N. (1999), « Les spécificités de l’emploi<br />
associatif sa<strong>la</strong>rié », Les actes des Assises Nationa<strong>les</strong><br />
de <strong>la</strong> Vie Associative, 20-21 février, DIES.<br />
Andreoni J. (1990), « Impure Altruism and Donations<br />
to Public Goods: A Theory of Warm-Glow<br />
Giving », Economic Journal, vol. 100, pp. 464-<br />
477.<br />
Andreoni J., Gale W.G. et Scholz J.K. (1996),<br />
« Charitable Contributions of Time and Money »,<br />
mimeo.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
30. La difficulté de tester <strong>les</strong> modè<strong>les</strong> empiriques du bénévo<strong>la</strong>t<br />
du fait de l’hétérogénéité des motivations est également soulignée<br />
par Ziemek (2003).<br />
Archambault E. (1996), Le secteur sans but<br />
lucratif. Associations et Fondations en France,<br />
Économica.<br />
Archambault E., Bon C. et Le Vail<strong>la</strong>nt M.<br />
(1991), Les dons et le bénévo<strong>la</strong>t en France,<br />
Enquête ISL-Fondation de France-LES.<br />
Archambault E. et Boumendil J. (1994), Les<br />
dons et le bénévo<strong>la</strong>t en France, Laboratoire d’économie<br />
sociale, Fondation de France.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 35
Archambault E. et Boumendil J. (1997), Les<br />
dons et le bénévo<strong>la</strong>t en France, Laboratoire d’économie<br />
sociale, Fondation de France.<br />
Berger G. (1991), Factors Exp<strong>la</strong>ining Volunteering<br />
for Organizations in General and for Social<br />
Welfare Organizations in Particu<strong>la</strong>r, Ph. Dissertation,<br />
Heller School of Social Welfare, Brandeis<br />
University.<br />
Carlin P.S. (2001), « Evidence on the Volunteer<br />
Labor Supply of Married Women », Southern<br />
Economic Journal, vol. 64, pp. 801-824.<br />
Cheroutre M.-T. (1989), L’essor et l’avenir du<br />
bénévo<strong>la</strong>t, facteur d’amélioration de <strong>la</strong> qualité de<br />
<strong>la</strong> <strong>vie</strong>, Rapport du Conseil économique et social,<br />
Journal Officiel.<br />
C<strong>la</strong>ry E.G., Snyder M., Ridge R.D., Cope<strong>la</strong>nd<br />
J., Stukas A.A., Haugen J. et Haugen P.M.<br />
(1998), « Understanding and Assessing the Motivations<br />
of Volunteers: A Functionnal Approach »,<br />
Journal of Per<strong>son</strong>ality and Social Psychology,<br />
vol. 74, pp. 1516-1530.<br />
Cnaan R.A., Handy F. et Wadsworth M. (1996),<br />
« Defining Who is a Volunteer: Conceptual and<br />
Empirical Considerations », Nonprofit and Voluntary<br />
Sector Quarterly, vol. 25, n˚ 3, pp. 364-383.<br />
Conseil d’État (2000), « Les associations et <strong>la</strong> loi<br />
de 1901, cent ans après », in Rapport Public 2000,<br />
pp. 237-422, La Documentation française, Études<br />
et Documents, n˚ 51.<br />
Davis Smith J. (1998), The 1997 National Survey<br />
of Volunteering, Londres, Institute for Volunteering<br />
Research.<br />
Day K.M. et Devlin R.A. (1996), « Volunteerism<br />
and Crowding out: Canadian Econometric<br />
Evidence », Canadian Journal of Economics,<br />
vol. 29, pp. 37-53.<br />
Day K.M. et Devlin R.A. (1998), « The Payoff to<br />
Work Without Pay: Volunteer Work as an Investment<br />
in Human Capital », Canadian Journal of<br />
Economics, vol. 31, pp. 1179-1191.<br />
Di Pasquale D. et G<strong>la</strong>eser E.L. (1999),<br />
« Incentives and Social Capital: Are Homeowners<br />
Better Citizens », Journal of Urban Economics,<br />
vol. 45, pp. 354-384.<br />
Djider Z. et Marpsat M. (1990), « La <strong>vie</strong><br />
religieuse : chiffres et enquêtes », Données socia<strong>les</strong><br />
1990, <strong>Insee</strong>, pp. 376-384.<br />
Duncan B. (1999), « Modeling Charitable Contributions<br />
of Time and Money », Journal of Public<br />
Economics, vol. 72, pp. 213-242.<br />
Elster J. (1985), « Rationality, Morality and<br />
Collective Action », Ethics, vol. 96, pp. 136-155.<br />
Febvre M. et Muller L. (2003), « Une per<strong>son</strong>ne<br />
sur deux est membre d’une association en 2002 »,<br />
<strong>Insee</strong> Première, n˚ 920, septembre.<br />
Febvre M. et Muller L. (2004a), « La <strong>vie</strong> <strong>associative</strong><br />
en 2002. 12 millions de bénévo<strong>les</strong> », <strong>Insee</strong><br />
Première, n˚ 946, février.<br />
Febvre M. et Muller L. (2004b), Vie <strong>associative</strong><br />
et bénévo<strong>la</strong>t en 2002. Tableaux issus de l’enquête<br />
EPCVM « Vie <strong>associative</strong> » et des indicateurs<br />
sociaux, Série des Documents de Travail de <strong>la</strong><br />
Direction des statistiques démographiques et<br />
socia<strong>les</strong>, n˚ F0402, <strong>Insee</strong>.<br />
Ferrand-Bechmann D. (2000), Le métier de<br />
bénévole, Paris, Anthropos-Economica.<br />
Gidron B. (1984), « Predictors of Retention and<br />
Turnover Among Service Volunteer Workers »,<br />
Journal of Social Service Research, vol. 8, pp. 1-16.<br />
Heshka S. (1983), « Situational Variab<strong>les</strong> Affecting<br />
Participation in Voluntary Associations », in<br />
Smith D.H., Van Til J. (edit.), International Perspectives<br />
on Voluntary Action Research, University<br />
Press of America, pp. 138-147.<br />
Hodgkin<strong>son</strong> V.A., Weitzmann M.S. (1996),<br />
Giving and Volunteering in the United States –<br />
1996 Edition, The Independent Sector, Washington<br />
D.C.<br />
Keane M.P. (1992), « A Note on Identification<br />
in the Multinomial Probit Model », Journal of<br />
Business and Economic Statistics, vol. 10,<br />
pp. 193-201.<br />
Knapp M. (1990), Time is Money: The Costs of<br />
Volunteering in Britain Today, Voluntary Action<br />
Research, Paper n˚ 3, The Volunter Centre UK.<br />
Lambert Y. (1995), « Une définition plurielle<br />
pour une réalité en mutation », Cahiers français,<br />
n˚ 273, pp. 3-12.<br />
Lynn P. et Davis Smith J. (1992), The 1991<br />
National Survey of Voluntary Activity in the UK,<br />
Second Series Paper n˚ 1, The Volunteer Centre<br />
UK.<br />
Menchik P.L. et Weisbrod B.A. (1987),<br />
« Voluntary Labor Supply », Journal of Public<br />
Economics, vol. 32, pp. 159-183.<br />
36 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
Mesch D.J., Tschirhart M., Perry J.L. et Lee G.<br />
(1998), « Altruists or Egoists: Retention in Stipended<br />
Service », Nonprofit Management and Leadership,<br />
vol. 9, pp. 3-21.<br />
Mucchielli A. (2001), Les motivations,<br />
6 ème édition, PUF.<br />
Mueller M. (1975), « Economic Determinants of<br />
Volunteer Work by Women », Signs, vol. 1,<br />
pp. 325-338.<br />
Neyret G., Nivlet J.-M. et Rault D. (1998),<br />
« Associations régies par <strong>la</strong> loi de 1901 », Rapport<br />
de <strong>la</strong> Mission du Cnis, n˚ 44, <strong>Insee</strong>.<br />
Omoto A.M. et Snyder M. (1993), « Aids Volunteers<br />
and Their Motivations: Theoretical Issues<br />
and Practical Concerns », Nonprofit Management<br />
and Leadership, vol. 4, pp. 157-176.<br />
O’Neill M. (2001), « Research on Giving and<br />
Volunteering: Methodological Considerations »,<br />
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,<br />
vol. 30, pp. 505-514.<br />
Pearce J.L. (1983), « Participation in Voluntary<br />
Association: How Membership in a Formal Organization<br />
Changes the Rewards of Participation »,<br />
in Smith D.H. et J. Van Til (edit.), International<br />
Perspectives on Voluntary Action Research,<br />
University Press of America, pp. 148-156.<br />
Porte B. et Ni<strong>son</strong> A. (1975), « Des bénévo<strong>les</strong> par<br />
millions », Habitat et <strong>vie</strong> sociale, n˚ 9, pp. 3-27.<br />
Prouteau L. (1998), « Les différentes façons<br />
d’être bénévole », Économie et Statistique, n˚ 311,<br />
pp. 57-73.<br />
Prouteau L. (1999), Économie du comportement<br />
bénévole. Théorie et étude empirique, Paris,<br />
Economica.<br />
Prouteau L. et Wolff F.-C. (2003), « Les services<br />
informels entre ménages : une dimension méconnue<br />
du bénévo<strong>la</strong>t », Économie et Statistique,<br />
n˚ 368, pp. 3-31.<br />
Prouteau L. et Wolff F.-C. (2004), « Re<strong>la</strong>tional<br />
Goods and Associational Participation », Annals<br />
of Public and Cooperative Economics, vol. 75,<br />
pp. 431-463.<br />
Prouteau L. et Wolff F.-C. (2005), « Does<br />
Voluntary Work Pay Off in the Labor Market? »,<br />
Journal of Socio-Economics, à paraître.<br />
Retière J.-N. (1994), « Etre sapeur-pompier<br />
volontaire. Du dévouement à <strong>la</strong> compétence »,<br />
Genèses, n˚ 16, pp. 94-113.<br />
Rubin A. et Thorelli I.M. (1984), « Egoïstic<br />
Motives and Longevity of Participation by Social<br />
Service Volunteers », Journal of Applied Behavioral<br />
Science, vol. 20, pp. 223-235.<br />
Sa<strong>la</strong>mon L.M. et Sokolowski W. (2001), Volunteering<br />
in Cross-National Perspective: Evidence<br />
From 24 Countries, Working Papers or the Johns<br />
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project,<br />
Baltimore, Johns Hopkins University.<br />
Schiff J. (1990), Charitable Giving and Government<br />
Policy. An Economic Analysis, New York,<br />
Greenwood Press.<br />
Segal L.M. et Weisbrod B.A. (2002),<br />
« Volunteer Labor Sorting Across Industries »,<br />
Journal of Policy Analysis and Management,<br />
vol. 21, pp. 427-447.<br />
Smith D.H. (1981), « Altruism, Volunteers, and<br />
Volunteerism », Journal of Voluntary Action<br />
Research, n˚ 10, pp. 21-36.<br />
Smith D.H. (1994), « Determinants of Voluntary<br />
Association Participation and Volunteering: A<br />
Literature Re<strong>vie</strong>w », Nonprofit and Voluntary<br />
Sector Quarterly, vol. 23, pp. 243-263.<br />
Steinberg R. (1989), « Donations, Local Government<br />
Spending, and the ‘New Federalism’ », in<br />
Magat R. (ed.), Phi<strong>la</strong>nthropic Giving, Owford<br />
University Press, pp. 143-156.<br />
Tschirhart M., Mesch D.J., Perry J.L., Miller<br />
T.K., Lee G. (2001), « Stipended Volunteers:<br />
Their Goals, Experiences, Satisfaction, and Likelihood<br />
of Future Service », Nonprofit and Voluntary<br />
Sector Quarterly, vol. 30, pp. 422-443.<br />
Vallerand R.J. et Thill E.E. (dir.) (1993), Introduction<br />
à <strong>la</strong> psychologie de <strong>la</strong> motivation, Vigot.<br />
Van Dijk J. et Boin R. (1993), « Volunteer Labor<br />
Supply in the Nether<strong>la</strong>nds », De Economist,<br />
vol. 141, pp. 402-418.<br />
Ziemek S. (2003), « Economic Theories on Motivations<br />
for Volunteering – A Cross-Country<br />
Analysis », mimeo, ZEF Bonn.<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 37
ANNEXE 1<br />
LES DOMAINES D’ACTIVITÉ DES ASSOCIATIONS ET DES BÉNÉVOLES<br />
La partie fixe de l’enquête permanente sur <strong>les</strong> conditions<br />
de <strong>vie</strong> des ménages (EPCVM) décline, en 14 groupes, <strong>les</strong><br />
types d’associations auxquel<strong>les</strong> <strong>les</strong> répondants <strong>son</strong>t<br />
susceptib<strong>les</strong> d’appartenir. Le volet variable d’octobre<br />
2002 consacré à <strong>la</strong> « Vie <strong>associative</strong> » permet d’affiner<br />
cette catégorisation. La typologie retenue <strong>dans</strong> le présent<br />
article est construite à partir des regroupements<br />
suivants de catégories distinguées par l’enquête :<br />
1. Sport<br />
Associations et clubs sportifs ; fédérations sportives,<br />
etc.<br />
2. Culture et loisirs<br />
Associations culturel<strong>les</strong> ou musica<strong>les</strong> ; associations<br />
artistiques et culturel<strong>les</strong> (musique, <strong>dans</strong>e, photographie,<br />
théâtre, lecture, écriture, arts p<strong>la</strong>stiques, etc.) ; tourisme<br />
social ; scoutisme, centres aérés associatifs et autres<br />
associations de loisirs pour <strong>les</strong> jeunes ; échanges culturels<br />
internationaux ; clubs du 3 ème âge et autres associations<br />
de loisirs pour <strong>les</strong> per<strong>son</strong>nes âgées ; comités des<br />
fêtes et autres associations de loisirs ; associations<br />
d’anciens combattants ou c<strong>la</strong>sses d’année de<br />
naissance ; retraités d’une entreprise ; chasse et pêche.<br />
3. Éducation<br />
Associations de parents d’élèves ; associations de soutien<br />
sco<strong>la</strong>ire, d’aides aux devoirs, d’alphabétisation,<br />
etc. ; formation linguistique, informatique, université<br />
tous âges et autre formation à but non professionnel ;<br />
formation professionnelle et formation continue ; études<br />
et recherche (hors recherche médicale) ; associations<br />
d’anciens élèves ou d’étudiants, bureau des élèves ou<br />
des étudiants ; autres associations <strong>dans</strong> le domaine<br />
éducatif.<br />
4. Action sociale et médico-sociale,<br />
actions humanitaires et caritatives<br />
Aides aux ma<strong>la</strong>des (visites à l’hôpital, prêts de matériel<br />
médical, etc.) ; amicale ou groupement de ma<strong>la</strong>des ;<br />
recherche médicale (lutte contre le cancer, <strong>la</strong> myopathie,<br />
etc.) ; aide à l’insertion de jeunes en difficulté, soutien<br />
aux mères de famil<strong>les</strong> isolées ou autres associations<br />
socio-éducatives ; aide aux migrants ; aide à domicile ;<br />
caritatif (Restos du cœur, Secours catholique, Secours<br />
popu<strong>la</strong>ire, etc.) ; autres associations du domaine social ;<br />
aide internationale (alimentaire, santé, éducation) et<br />
droits de l’homme.<br />
5. Défense des droits (civiques, professionnels, de<br />
consommateurs, de locataires, de propriétaires, etc.)<br />
Défense des consommateurs, des usagers des services<br />
publics ; groupement professionnel ; syndicat ; autres<br />
associations de défense de droits ou d’intérêts<br />
communs ; amicale ou groupement d’habitants d’un<br />
quartier, d’un vil<strong>la</strong>ge ; amicale ou regroupement de locataires,<br />
propriétaires ou copropriétaires ; conseil syndical<br />
de copropriété ; amicale ou groupement de per<strong>son</strong>nes<br />
originaires d’un même pays ou d’une même région ;<br />
développement économique local.<br />
6. Religion<br />
Associations religieuses ou paroissia<strong>les</strong>.<br />
7. Autre<br />
Amis des animaux, défense de <strong>la</strong> faune, de <strong>la</strong> flore ; protection<br />
de sites naturels et autres défenses et interventions<br />
sur le milieu naturel ; protection, valorisation, étude<br />
du patrimoine historique et culturel ; partis politiques ;<br />
autres types d’associations.<br />
Cette typologie diffère de <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification ICPNO (International<br />
C<strong>la</strong>ssification of Non-Profit Organizations) mise<br />
en œuvre <strong>dans</strong> le programme Johns Hopkins de comparai<strong>son</strong><br />
internationale du secteur sans but lucratif, car certains<br />
groupes qui <strong>la</strong> constituent ont ici des effectifs<br />
beaucoup trop réduits pour qu’ils puissent être maintenus<br />
comme tels en assurant à leur étude un caractère<br />
significatif. On notera que <strong>les</strong> associations constituent<br />
une partie essentielle du secteur sans but lucratif<br />
(Archambault, 1996). Mais le programme Johns Hopkins,<br />
pour des rai<strong>son</strong>s de commodité, a exclu de <strong>son</strong> champ<br />
<strong>les</strong> organisations religieuses comme <strong>les</strong> partis politiques,<br />
bien que ces organismes satisfassent aux critères<br />
de définition du secteur étudié. En ce qui <strong>la</strong> concerne,<br />
l’enquête Vie <strong>associative</strong> n’opère pas ces exclusions.<br />
Elle intègre notamment <strong>les</strong> associations cultuel<strong>les</strong>.<br />
38 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004
ANNEXE 2<br />
UN MODÈLE LOGIT MULTINOMIAL AVEC EFFET COMMUN À PLUSIEURS OBSERVATIONS<br />
On cherche à préciser l’effet des caractéristiques individuel<strong>les</strong><br />
sur <strong>la</strong> probabilité qu’un individu reporte une motivation<br />
principale donnée. Pour chaque engagement,<br />
l’enquêté a le choix entre sept possibilités, non ordonnées,<br />
et <strong>la</strong> motivation qu’il exprime est celle dont <strong>la</strong> satisfaction<br />
lui procure le niveau d’utilité le plus élevé. Si l’on<br />
admet que <strong>les</strong> résidus associés à chaque alternative<br />
<strong>son</strong>t distribués selon une loi de Gompertz, alors le<br />
modèle correspondant est un Logit multinomial, dont <strong>les</strong><br />
estimateurs <strong>son</strong>t aisément obtenus par maximisation de<br />
<strong>la</strong> vraisemb<strong>la</strong>nce. Néanmoins, le problème posé par<br />
cette spécification concerne <strong>la</strong> propriété d’indépendance<br />
des alternatives non pertinentes. Cette dernière<br />
restriction ne s’applique pas <strong>dans</strong> le modèle Probit multinomial,<br />
où <strong>les</strong> résidus <strong>son</strong>t distribués suivant une loi<br />
normale multivariée. Si cette spécification est <strong>la</strong> plus<br />
flexible que l’on puisse envisager, <strong>son</strong> recours soulève<br />
de sérieuses difficultés d’estimation lorsque le nombre<br />
d’alternatives est re<strong>la</strong>tivement grand, même par l’usage<br />
de techniques de simu<strong>la</strong>tion appropriées. En outre, cette<br />
spécification soulève aussi des difficultés liées à d’éventuel<strong>les</strong><br />
restrictions d’exclusion pour l’identification<br />
(Keane, 1992).<br />
Tenir compte de <strong>la</strong> corré<strong>la</strong>tion<br />
entre <strong>les</strong> engagements multip<strong>les</strong><br />
Dans le cas présent, le problème s’avère un peu plus<br />
complexe, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> mesure où un bénévole peut avoir<br />
plusieurs engagements. Il est alors très vraisemb<strong>la</strong>ble<br />
que ces choix, pour un individu donné, ne vont pas être<br />
indépendants <strong>les</strong> uns des autres. Afin de tenir compte<br />
de <strong>la</strong> corré<strong>la</strong>tion entre ces engagements multip<strong>les</strong>, on<br />
suppose que le résidu associé à chaque choix se<br />
décompose en un élément inobservé spécifique à<br />
l’enquêté (c’est-à-dire commun à tous ses engagements)<br />
et un terme d’erreur qui, lui, est propre à chaque<br />
engagement. L’écart-type de cette dernière perturbation<br />
aléatoire est normalisé à l’unité, alors que l’écarttype<br />
du terme d’erreur commun est un paramètre à<br />
estimer. Celui-ci est identifié dès lors que l’on dispose<br />
de plusieurs observations par enquêté, au moins pour<br />
un sous-ensemble de l’échantillon. On suppose que cet<br />
effet commun suit une loi normale. Il n’existe alors pas<br />
de solution exacte pour <strong>la</strong> vraisemb<strong>la</strong>nce de ce modèle<br />
Logit multinomial avec effet commun. Celle-ci est estimée<br />
à partir d’une technique d’intégration numérique,<br />
qui repose sur l’usage de méthodes de quadrature de<br />
type Gauss-Hermite. D’un point de vue empirique,<br />
20 points de support <strong>son</strong>t utilisés pour l’intégration<br />
numérique et <strong>les</strong> écarts-types <strong>son</strong>t obtenus à partir de<br />
l’estimation numérique de l’inverse de l’opposée de <strong>la</strong><br />
matrice hessienne. Les données révèlent qu’il importe<br />
de contrôler cette hétérogénéité spécifique, <strong>la</strong> variance<br />
de l’effet individuel étant positive et significative<br />
(cf. tableau 12).<br />
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004 39
Le portrait des trois principaux<br />
secteurs : commerce de détail,<br />
commerce et réparation<br />
automobi<strong>les</strong>, commerce de gros.<br />
> Un zoom thématique sur le tabac,<br />
le commerce électronique,<br />
<strong>les</strong> marchés d'intérêt national,<br />
<strong>les</strong> marchés...<br />
En vente <strong>dans</strong> <strong>les</strong> librairies,<br />
à l’<strong>Insee</strong> et sur www.insee.fr<br />
15 € - Collection Références