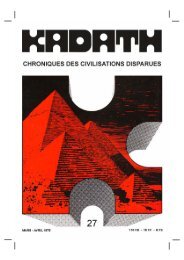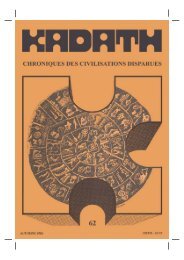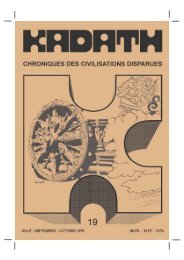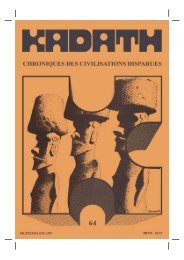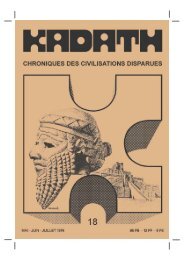Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
COMITE DE REDACTION :<br />
ivan verheyden, rédacteur en chef<br />
patrick ferryn, secrétaire de rédaction<br />
jean-claude berck, robert dehon,<br />
jacques gossart, jacques victoor<br />
AVEC LA COLLABORATION DE :<br />
jacques blanchart, jacques dieu,<br />
guy druart, jacques keyaerts,<br />
pierre méreaux-tanguy,<br />
édith pirson, albert szafarz,<br />
nicole torchet, albert van hoorenbeeck<br />
MAQUETTE DE GERARD DEUQUET<br />
Au sommaire<br />
— notre dossier présence kadath<br />
— l’archéologie devant quelle imposture ?, Ivan Verheyden . . .<br />
— les bricolages de génie, Robert Dehon . . . . . . . . . .<br />
— jade et immortalité dans l’empire du milieu, Patrick Ferryn . . . .<br />
— mégalithes oubliés de corée, Jacques Keyaerts . . . . . . .<br />
— le forgeron venu du ciel, <strong>Eric</strong> <strong>Guerrier</strong> . . . . . . . . . .<br />
— post-scriptum : énoch, adam, stonehenge . . . . . . . . .<br />
3<br />
12<br />
17<br />
26<br />
30<br />
37<br />
1
2<br />
A la recherche<br />
De kadath<br />
Ami lecteur, en ce troisième anniversaire de KADATH, nous vous proposons un numéro de transition.<br />
De grandes énigmes ont été abordées, et il en reste pas mal encore. Des domaines ont été survolés,<br />
et des théories confrontées. Il semble bien, au travers des livres publiés et recensés durant les dix<br />
dernières années, que l’archéologie nouvelle, que nous appelons de nos vœux, n’en soit qu’à ses<br />
balbutiements. Cela ne nous a qu’à moitié surpris. Mais l’audience de KADATH grandissant, nous<br />
avons atteint, maintenant, en maints domaines, la source même des événements. Cela se reflétait<br />
sporadiquement dans de récents numéros, et les gens attentifs n’ont pas manqué de nous en féliciter.<br />
Il semble donc que, outre notre rôle de mise en ordre dans ce méli-mélo incroyable, on attende<br />
de nous autre chose. Nous y sommes prêts, simplement, pareille performance ne s’obtient pas en<br />
quelques mois. Nous poursuivons notre mise en ordre, bien sûr, et c’est le rôle du comité de rédaction.<br />
Mais le comité d’honneur a, pour sa part, pris à cœur d’assumer un rôle plus que figuratif. Ces<br />
gens qui font l’événement en archéologie nouvelle, ont relevé le défi. Défi, car ils ne sont ni journalistes,<br />
ni compilateurs. Ce sont des chercheurs, et avant tout les auteurs d’un ou plusieurs livres. Pour<br />
exposer dans le détail le résultat de leurs travaux, il faut un livre, et le résumer en un article tient souvent<br />
de la gageure. Ils ont pourtant accepté de jouer le jeu. Désormais, à côté des articles de synthèse,<br />
vous trouverez donc une bonne proportion d’analyses, sur un sujet bien déterminé. Après les<br />
inscriptions runiques du Paraguay, vous trouverez bientôt, par son inventeur lui-même, une tentative<br />
de déchiffrement de l’écriture maya. Et voici aussi les traditions se rapportant au cratère du lac<br />
Bosumtwi en pays dogon. Toutes choses destinées à éclairer sous un jour nouveau, tel ou tel aspect<br />
de la recherche archéologique. Nous vous proposerons par la suite une étude inédite sur le mythe du<br />
dieu mexicain Quetzalcoatl, les recherches astronomiques d’Alexander Thom en Bretagne mégalithique,<br />
la controverse d’André Pochan et Jean-Philippe Lauer sur le sens des pyramides d’Egypte, etc.<br />
Et tout cela de première main, par les protagonistes eux-mêmes. Contrairement à ce qu’on trouve<br />
dans les revues d’archéologie classique, où la découverte (ô combien estimable) d’une nouvelle villa<br />
galloromaine ne fait qu’enfoncer des portes largement ouvertes, les études que nous vous proposons<br />
sont autant de coups de boutoir dans la version conformiste des choses. Pour nous, notre conviction<br />
est ferme : ce sont ces pièces-là qui seront, demain, les bases de l’archéologie non réduite à quelques<br />
schémas préétablis.<br />
KADATH<br />
Petite cigale en jade, de l’époque chinoise des Han, et destinée, comme en Mésoamérique, à être<br />
placée sur la langue du défunt.
L’ARCHEOLOGIE DEVANT<br />
QUEL<strong>LE</strong> IMPOSTURE ?<br />
« La science, ce n’est pas l’explication. Et même,<br />
l’explication, ce peut être l’antiscience. Si vous cherchez<br />
des explications, fuyez les savants, occupés<br />
surtout à poser des questions, et rejoignez les faiseurs<br />
de systèmes. Là, vous trouverez toutes les<br />
explications que vous voudrez, vous aurez l’esprit<br />
apaisé et vous crèverez idiots. »<br />
Rémy Chauvin.<br />
Ce numéro est celui de notre troisième anniversaire.<br />
Au risque de décevoir certains, nous n’avons pas<br />
encore trouvé la solution-miracle capable de résoudre<br />
en une équation l’ensemble des énigmes auxquelles<br />
nous nous sommes attelés. Par contre, nos<br />
positions se sont précisées et nous nous démarquons<br />
bien plus nettement, aujourd’hui, par rapport à<br />
d’autres tentatives, et la nôtre gagne ainsi en spécificité.<br />
KADATH s’est acquis une image de marque, et<br />
en ces temps de confusion, c’est déjà un bien beau<br />
résultat. On a pu assister récemment à deux<br />
confrontations qui font réfléchir. Le 28 novembre,<br />
sous le titre « Explorateurs des secrets de l’univers<br />
ou bricoleurs de l’impossible », Bernard Pivot, sur<br />
Antenne 2, présentait le livre de Jean-Pierre Adam,<br />
« L’archéologie devant l’imposture » 1 , et le mettait en<br />
Si le titre de cet éditorial en forme de « ce que<br />
je crois», paraphrase celui du livre de Jean-<br />
Pierre Adam, c’est que celui-ci servit de détonateur.<br />
Nous ne pouvions garder le silence, ni en<br />
faire un bref compte-rendu en post-scriptum.<br />
Nos lecteurs voulaient une réponse. La voici.<br />
Ce livre est une imposture, au même titre que<br />
l’archéomanie à laquelle il s’attaque. Les solutions<br />
préconisées par l’auteur — outre qu’elles<br />
contiennent des erreurs flagrantes — sont des<br />
vues de l’esprit, au même titre que celles faisant<br />
appel à l’antigravitation. Ceci est particulièrement<br />
vrai pour le transport des « grosses pierres<br />
». C’est pourquoi, en guise de couverture,<br />
j’ai proposé à Gérard Deuquet le montage que<br />
vous y voyez, sur le thème de la boutade d’Archimède<br />
: « Donnez-moi un point d’appui, et je<br />
soulèverai le monde ». Cette illustration est, elle<br />
aussi, une vue de l’esprit, mais au moins a-t-elle<br />
l’avantage d’aller jusqu’au bout dans l’absurde.<br />
A usage de ceux qui croient à une technologie<br />
analogue à la nôtre dans le passé, j’ai repris le<br />
« crawler transporter », cette plate-forme de 2<br />
500 tonnes conçue par la NASA pour amener la<br />
fusée lunaire Saturne V de son édifice d’assemblage<br />
jusqu’à l’aire de lancement. Mais comme<br />
les Anciens ignoraient presque tous la roue, il<br />
fallait y atteler des esclaves : 920 à partir des<br />
calculs de M. Adam. Et enfin, la solution extraterrestre<br />
me faisant l’effet d’un autre « deus ex<br />
machina », j’ai remplacé la fusée par un obélisque.<br />
S’il fallait illustrer toutes les aberrations<br />
qu’on peut rencontrer dans ce domaine, le dessin<br />
de couverture aurait été surchargé. Et nous<br />
ne sommes pas une revue surréaliste...<br />
présence de ceux qu’il prétendait dénoncer. J’ai eu<br />
l’occasion depuis de rencontrer l’auteur. Ensuite, le<br />
lendemain soir, nous étions confrontés au « Forum<br />
du Fantastique », organisé par le groupement<br />
GRECE 2 , à deux personnages bien différents en<br />
apparence, Louis-Claude Vincent parlant de la terre<br />
de Mu, et Guy Rachet présenté peut-être à son<br />
corps défendant, comme un tenant de l’archéologie<br />
officielle. Or, dans les deux cas, nous nous sommes<br />
trouvés, avec notre revue, en porte-à-faux. Il nous<br />
fallait dire notre désaccord avec les méthodes de<br />
Jean-Pierre Adam, sur lesquelles je reviens en détail<br />
plus loin dans cet éditorial. Les schématisations à<br />
outrance de l’auteur sont inacceptables, et elles<br />
nous offrent en plus une vision bien morne et triste<br />
de l’archéologie. Quant aux belles théories de Louis-<br />
Claude Vincent, pour présenter une vue fantastique<br />
de l’archéologie, elles n’en reposent pas moins sur<br />
des sables mouvants. Mais les deux avaient au<br />
moins en commun de tenter à tout prix de réduire<br />
l’Histoire à un schéma préétabli, où plus aucune<br />
place n’est laissée à l’imagination créatrice. La<br />
société balbutiante préscientifique pour l’archéologue<br />
classique, les deus ex machina (entendez : les<br />
géants, les habitants de Mu ou les extraterrestres),<br />
pour l’archéologue sauvage.<br />
Le réductionnisme en archéologie.<br />
Dans les pages qui me sont offertes, je voudrais,<br />
exemples à l’appui, démontrer ceci : que l’archéologie,<br />
à l’instar d’autres sciences humaines, est victime<br />
de manœuvres réductionnistes ; que ces manœuvres<br />
sont le fait, aussi bien des tenants de la science<br />
dite officielle que de l’archéologie dite sauvage et<br />
que, à ce niveau, l’une ne vaut pas mieux que l’autre<br />
; que lorsque ces deux réductionnisme sont mis<br />
en présence, l’on assiste à un lamentable dialogue<br />
de sourds se résumant à des joutes oratoires quand<br />
ce ne sont des échanges d’insultes ; que dans cet<br />
étalement de narcissisme nous n’avons aucune place<br />
à revendiquer, persuadés que nous sommes de<br />
ce qu’il existe une troisième voie, celle que nous<br />
préconisons ; que cette voie nous apparaît comme la<br />
seule à même à la fois de désamorcer la bombe, de<br />
chercher un terrain d’entente pour les bonnes volontés,<br />
et de redonner vie aux recherches archéologiques<br />
vraiment passionnantes ; et j’essaierai de faire<br />
ressortir cette voie (que nous appellerons provisoirement<br />
« réactivation archéologique » 3 ), sans longs<br />
discours car notre méthode, telle que décrite dans le<br />
deuxième numéro de notre revue, n’a guère subi de<br />
modifications notables, et doit continuer à servir de<br />
base.<br />
De plus en plus nombreuses sont les voix qui s’élèvent,<br />
enfin, contre cette fâcheuse tendance qu’ont<br />
maints sociologues, historiens, psychologues, économistes<br />
et autres, à réduire la réalité humaine à un<br />
seul de ses aspects, et à confondre la partie avec le<br />
tout. C’est ainsi que le marxisme réduit l’Histoire à la<br />
lutte des classes, tandis que le freudisme ramène<br />
tout à la libido, le plaisir. C’est ce réductionnisme<br />
que dénonçait Louis Pauwels dans son livre « Ce<br />
que je crois », repris d’ailleurs bientôt, comme en<br />
écho, par Maurice Clavel dans un autre ouvrage<br />
3
4<br />
portant le même titre 4 . Quant on sait que<br />
l’ « intelligentsia » s’efforce d’étiqueter l’un à droite et<br />
l’autre à gauche, on voit que le mal est profond. Mes<br />
préférences allant au premier, je citerai un exemple<br />
extrait de son livre : « Je me souviens d’un article sur<br />
les lemmings, dit-il. Ces migrateurs, parfois, se suicident<br />
collectivement en se précipitant dans la mer.<br />
L’énigme demeure. L’auteur tenait une explication.<br />
Les lemmings sont myopes. Il était bien content. Il<br />
terminait en souhaitant que « tous les mystères<br />
soient un jour ramenés à une simple question de<br />
myopie ». (...) La rage d’expliquer le haut par le bas.<br />
(...) A voir l’empressement avec lequel on s’adresse<br />
au monde matériel pour se fournir en explications,<br />
c’est à croire qu’il existe une firme concurrente qu’on<br />
n’aime pas et qu’on veut couler ». Tournez-vous vers<br />
l’archéologie : la firme concurrente, chez l’un, se<br />
nomme « science officielle », chez l’autre « les extraterrestres<br />
». Les griefs sont réels : chacun des protagonistes<br />
tente de réduire l’Histoire à un de ces deux<br />
schémas. Je dis que c’est du réductionnisme. Et je<br />
dis aussi que les méthodes utilisées sont superposables.<br />
La grave accusation du Dr Morlet contre l’Ecole<br />
Bayle (celle qui « démontra » que trois tablettes de<br />
Glozel étaient fausses) mérite une large application<br />
dans les milieux réductionnistes, la voici : « La méthode<br />
consiste à exposer longuement des théories<br />
scientifiques admises par tous... puis à vouloir les<br />
appliquer par un véritable tour de passe-passe, à<br />
l’étude d’objets auxquels elles ne s’appliquent nullement<br />
». Les titres, le jargon scientifique, les anathèmes<br />
: tout cela est très efficace et se montre payant.<br />
Nous rencontrons le procédé quotidiennement en<br />
archéologie sauvage, mais comme ce n’est guère<br />
intéressant, je n’insisterai pas. (J’ai déjà eu l’occasion<br />
de présenter au lecteur le Tartempion du genre,<br />
Herr Von Däniken.) Mais il ne faut pas croire que les<br />
milieux dits officiels en soient dépourvus. Dans son<br />
livre, Jean-Pierre Adam, pour réfuter les mégalithes,<br />
Baalbeck et l’île de Pâques, montre de quoi étaient<br />
capables les Grecs et les Romains. Il démontre que<br />
les pierres d’Ica sont fausses, parce que ce qui est<br />
gravé dessus est impossible !<br />
Je me demande si tout le malentendu actuel ne provient<br />
pas d’une erreur d’aiguillage dès le départ. Le<br />
Matin des Magiciens avait — parmi d’autres effets —<br />
pratiqué la première réactivation archéologique dans<br />
la littérature de langue française. Aucune des questions<br />
soulevées n’a encore reçu, à ce jour, de réponse<br />
définitive. Mais aucune des énigmes relevées<br />
n’était mal posée, non plus : il faut avoir le courage<br />
de le reconnaître. Et le tort de Louis Pauwels et Jacques<br />
Bergier a été, je crois, alors qu’ils disposaient<br />
d’un instrument précieux qui s’appelait Planète, de<br />
laisser le terrain archéologique à d’autres. C’est<br />
Nietzsche qui disait : « Je dois mettre une barrière<br />
autour de ma doctrine pour empêcher les cochons<br />
d’y entrer ». C’est ce qui s’est passé, à peine trois<br />
ans après leur livre-essai. Pour Robert Charroux,<br />
réactivation archéologique signifiait simplement :<br />
remuer dans la vase et ressusciter les anciennes<br />
chimères. Il fut même surpris, dans sa candeur, de<br />
ne trouver aucun écho sous la plume de ceux qu’il<br />
avait si lamentablement plagiés, et la rancœur, depuis,<br />
ne s’est jamais tarie. Aujourd’hui, pratiquement<br />
tout est à refaire : réparer le gâchis, dénoncer les<br />
conclusions hâtives, rectifier les affirmations gratuites,<br />
que sais-je encore ! L’affaire de Glozel en est un<br />
exemple : si Charroux en reparla en 1963, ce n’est<br />
pas qu’un élément neuf le justifiait, c’était simplement<br />
pour dénigrer la science dite officielle. Bien sûr,<br />
on comprend qu’Emile Fradin ait été ravi, lui qui avait<br />
subi les pires injustices. Mais ce n’est qu’en 1973<br />
qu’il était légitime de relancer l’affaire, une nouvelle<br />
technique archéologique ayant — enfin ! — démontré<br />
l’authenticité du site. Et qu’on ne vienne pas dire<br />
que les livres successifs de Robert Charroux y sont<br />
pour quelque chose, ce serait du plus haut comique !<br />
Toujours est-il que, au cours de la décennie, l’archéologie<br />
sauvage a pu faire ses preuves, et révéler<br />
ses constantes, parmi lesquelles je citerai : les attaques<br />
systématiques contre la science officielle et le<br />
refus de tenir compte de ses acquis, le manque d’information,<br />
l’incompétence et les raccourcis dans le<br />
raisonnement, l’utilisation d’arguments ne relevant<br />
pas de l’archéologie mais de l’occultisme ou de l’ésotérisme,<br />
le rapprochement enfin de choses qui<br />
n’ont aucun rapport entre elles.<br />
Il ne faut pas s’étonner, dès lors, que l’archéologie<br />
sauvage des Charroux, Kolosimo et autres Von Däniken<br />
jette le discrédit sur toute recherche sérieuse,<br />
que nous qualifions volontiers de parallèle. Et on<br />
comprend aisément que, obnubilé par cette archéologie<br />
sauvage qu’il voue aux gémonies, Jean-Pierre<br />
Adam m’ait demandé à quoi servait, tout compte fait,<br />
notre revue : il se demandait, en substance, pourquoi<br />
nous jugions utile de faire le point sur des énigmes<br />
qui (selon lui) n’en sont pas, si ce n’est pour<br />
préconiser de l’irrationnel comme le fait Charroux. Il<br />
a donc fallu que je lui explique qu’il existe une autre<br />
archéologie, que je qualifie provisoirement de parallèle,<br />
et qu’elle ne fait pas appel à l’irrationnel, quand<br />
bien même elle ne prétend pas avoir déjà trouvé une<br />
solution aux énigmes qu’elle pose. (Disons tout de<br />
suite, qu’à chacun des exemples que je lui donnais,<br />
il fallait que j’ajoute un mot d’explication, notre chasseur<br />
de sorcières paraissant chaque fois revenir de<br />
Pontoise.) J’énumérerai donc ici quelques exemples<br />
de cette archéologie en marge qui nous passionne,<br />
en m’excusant d’avance pour les innombrables lacunes<br />
: la mise en cause de la chronologie égyptienne<br />
par André Pochan, les contacts transocéaniens<br />
avant Colomb mis en évidence par Heine-Geldern,<br />
Jacques de Mahieu, Cyrus Gordon et d’autres, les<br />
connaissances astronomiques à l’époque des mégalithes<br />
relevées par Gerald Hawkins et Alexander<br />
Thom, les civilisations préincaïques scrutées par<br />
Simone Waisbard, les traces d’une civilisation interglaciaire<br />
analysées par Charles Hapgood à partir de<br />
cartes marines. Et coetera, et coetera. Et je suis sûr<br />
d’en avoir oubliés autant. La moitié de ces ouvrages<br />
ne sont même pas rédigés en français, et ils attendent<br />
toujours un traducteur et un éditeur.<br />
Archéologie « officielle »,<br />
archéologie « parallèle ».<br />
L’énumération de ces recherches appelle deux réflexions.<br />
D’abord, pareils livres n’existaient pratiquement<br />
pas avant les années ’60 : la réactivation archéologique<br />
dont nous parlions plus haut était donc<br />
bien indispensable pour attirer l’attention sur ces<br />
travaux. Ensuite, aucun n’a rallié l’unanimité autour<br />
de son nom, c’est dire qu’ils sont loin de résoudre<br />
définitivement une énigme irritante, et il est donc<br />
d’utilité publique que les recherches se poursuivent.<br />
Mais une chose est certaine : ils ne s’excluent pas<br />
entre eux, ce qui est plutôt bon signe. Et ces archéologues<br />
en marge ne se privent pas de recherches
persévérantes. Lorsque, voici trois ans, je vous parlais<br />
de l’horloge d’Anticythère, je n’avais pratiquement<br />
à ma disposition qu’une seule publication<br />
scientifique datant de juin 1959. Aujourd’hui, quinze<br />
ans après (eh oui !), l’auteur de la découverte, le Dr<br />
de Solla Price consacre un livre entier à cette mécanique<br />
! Il faudrait un livre sur chaque horloge d’Anticythère<br />
du monde, et sur chacune de ces pièces à<br />
conviction qui dorment dans les musées, et sur les<br />
innombrables autres énigmes archéologiques. Et il<br />
faut une revue comme la nôtre pour suivre cela de<br />
près, et avec un respect du lecteur qui passe par le<br />
respect de la vérité dans l’information. La tâche est<br />
même urgente, lorsqu’on voit se profiler, derrière<br />
Jean-Pierre Adam, toute une famille d’esprit dont le<br />
seul souci est de minimiser l’importance de ce genre<br />
de découvertes, et par voie de conséquence, de les<br />
ignorer voire de les étouffer. Et notre rôle n’est pas<br />
de parler de choses qu’on ignore, mais bien de dire<br />
ce qu’on sait sur les choses que les archéologues<br />
prétendent ignorer. Nuance !...<br />
On veut nous faire croire que, devant une nouvelle<br />
découverte, le premier soin de tous les archéologues,<br />
en dignes scientifiques avides de connaissances,<br />
est d’y attacher toute l’importance qu’elle mérite.<br />
Ceci est malheureusement faux. Tout le drame<br />
de Glozel vient de ce que les tablettes furent découvertes<br />
quelques mois à peine après que René Dussaud<br />
avait démontré l’antériorité de l’écriture phénicienne.<br />
Bien sûr, s’il fut un temps où il était nécessaire<br />
d’épingler les cas exemplaires de Galilée, Schliemann<br />
ou Boucher de Perthes, je reconnais volontiers<br />
qu’ils sont devenus trop souvent, depuis, des alibis<br />
servant à justifier n’importe quoi. Mais, il y a bel et<br />
bien un aspect exécrable de l’archéologie classique,<br />
et qui mérite amplement le qualificatif d’ « officiel »<br />
l’archéologie (tout comme l’histoire) n’est pas la même<br />
partout ! Le chauvinisme des archéologues péruviens<br />
est bien connu, accordant la préséance à leurs<br />
sites par rapport à d’autres pays amérindiens. Et<br />
pendant ce temps-là, dans d’autres universités, on<br />
n’hésite pas à envisager une origine cosmique aux<br />
civilisations du plateau bolivien. En Egypte, l’Ecole<br />
du Caire ne voit pas la chronologie des pyramides<br />
sous le même angle que nous. En Inde, des universités<br />
étudient les textes sanscrits dans une optique<br />
bien différente de la nôtre, laquelle est la digne héritière<br />
des explorateurs-esthètes du temps de Marco-<br />
Polo. L’archéologie a ce même défaut — ou cette<br />
même nécessité — que l’histoire : enseignée dans<br />
les écoles, dans les livres et les musées, elle doit<br />
entretenir le nationalisme, justifier pourquoi on fait<br />
partie d’une communauté et pourquoi celle-ci est<br />
meilleure que les autres. Pour ne parler que de notre<br />
société galloromaine, nous sommes héritiers des<br />
splendeurs de la Rome antique (l’enseignement du<br />
latin), et il faut que les Gaulois vaincus ne soient que<br />
de pauvres hères. L’Europe a colonisé l’Amérique et<br />
lui a apporté ses lumières : il faut à tout prix qu’aucune<br />
société précolombienne ne soit antérieure à notre<br />
culture. Et ne parlons pas du racisme qui grève toute<br />
recherche sérieuse sur l’existence d’une quelconque<br />
civilisation autochtone d’Afrique noire. Ce n’est pas<br />
pour rien que, dans nos recherches, les plus grands<br />
obstacles à franchir sont les musées. Ce n’est pas<br />
pour rien non plus que nous trouvons un écho particulièrement<br />
favorable, chez certains instituteurs en<br />
rupture d’orthodoxie. Cela aussi, il fallait le dire.<br />
L’archéologie parallèle n’exclut pas l’archéologie<br />
classique, bien au contraire. Il nous faut également,<br />
à nous, des fouilles aussi approfondies que possible,<br />
avec des données stratigraphiques, chronologiques<br />
et autres. Tant il est vrai qu’il n’y a qu’une science.<br />
Simplement, elle offre des lacunes énormes, il manque<br />
des éléments que nous croyons essentiels, et<br />
qui expliqueraient l’Histoire mieux que les pénibles<br />
amalgames anthropologico-préhistoriques qu’on<br />
nous échafaude. Je crois avoir démontré à suffisance<br />
que KADATH ne relève pas de l’archéologie sauvage<br />
ni de l’archéomanie. Mais nous ne relevons<br />
pas plus de l’archéologie officielle, qu’on le veuille ou<br />
non. J’en veux pour preuve l’écho que nous réserva<br />
après trois ans de silence, le chroniqueur archéologique<br />
d’un quotidien du soir 5 . Pourquoi ce long mutisme<br />
? Parce qu’il nous estimait trop éloignés de l’archéologie<br />
telle qu’il la concevait. Et dès lors, s’il nous<br />
cita, ce fut uniquement à cause des deux articles<br />
dénonçant l’archéologie-fiction, et plus particulièrement<br />
à Bayan-Khara Uula. Nous avions trouvé ces<br />
mises au point importantes mais, et le lecteur en<br />
conviendra, l’essentiel de ce numéro était ailleurs : la<br />
révision du calendrier maya, les inscriptions runiques<br />
du Paraguay, les chevaux blancs du monde celtique.<br />
De ceci, pas un mot, à peine une allusion à M. Vollemaere.<br />
Qu’est-ce à dire ? Que ces sujets ne relèvent<br />
pas de l’archéologie telle que M. Burnet la conçoit ?<br />
Mais pourquoi ? Lorsque les Chinois présentèrent à<br />
la presse leurs dernières découvertes archéologiques,<br />
le même Albert Burnet leur fit un large écho,<br />
en se fiant tout compte fait à très peu de chose : un<br />
communiqué, de mauvaises photos, quelques citations<br />
du président Mao. C’est tout. Même cautionné<br />
par l’Académie des Sciences de Pékin, pareille<br />
« révélation » devait être maniée avec des pincettes.<br />
Alors, pourquoi les momies chinoises et pas les pyramides<br />
? Pourquoi les statues équestres et pas les<br />
disques pî ? Il y a là un apriorisme flagrant. A moins<br />
que ce dont nous parlons ne relève pas de la même<br />
archéologie...<br />
L’archéologie que nous avons jusqu’à présent qualifiée<br />
de parallèle, est en fait une archéologie en marge,<br />
pour ne pas dire marginale. Il faut se représenter<br />
l’archéologie comme un faisceau de flèches, toutes<br />
parallèles et orientées dans le même sens. Selon<br />
qu’elles sont admises par un nombre plus ou moins<br />
élevé de chercheurs, les lignes de recherche seront<br />
situées plus ou moins près du centre de ce faisceau.<br />
Si ces lignes de recherche s’entendent entre elles,<br />
elles seront contiguës, de façon à ne former, au centre,<br />
qu’un bloc homogène, la science dite officielle.<br />
Plus on s’éloigne de ce centre, plus on trouve des<br />
flèches séparées, distinctes. Vues ainsi, elles sont<br />
les éléments d’une science dite parallèle. Les parallèles<br />
ne se rejoignent jamais, mais à la longue elles<br />
vont faire corps avec le courant central. Peut-être<br />
même que, de par leur poids d’un côté ou de l’autre<br />
du bloc monolithique central, elles finiront par infléchir<br />
sa course générale. C’est l’espoir de ces archéologues<br />
en marge. C’est de la science aussi bien<br />
que l’archéologie officielle. Simplement, de par leur<br />
éloignement du centre, il leur faudra un temps plus<br />
considérable pour se faire entendre. C’est tout. Les<br />
archéologues sauvages, eux, constituent des flèches<br />
parasites, qui tirent à hue et à dia, sans espoir de<br />
faire dévier la science (et c’est tant mieux), mais en<br />
courant simplement le risque de se perdre dans le<br />
néant (et de gagner beaucoup d’argent). Aux yeux<br />
de l’archéologie classique, ces recherches marginales<br />
pèchent par un double défaut : ou bien elles ne<br />
5
6<br />
cadrent pas avec les théories en vogue, et on les<br />
condamne sur base du fameux principe de l’économie<br />
des hypothèses ; ou bien elles s’occupent de<br />
sujets où les vestiges sont rares et souvent déclarés<br />
inutilisables par une science qui a déclaré forfait. Je<br />
pense à des sites comme l’île de Pâques, Stonehenge<br />
ou Tiahuanaco. Constatant que l’arsenal des<br />
méthodes de recherche applicables à ces sites est<br />
trop restreint, ces chercheurs proposent une ouverture,<br />
une nouvelle approche de la question. Là où le<br />
bât blesse, c’est quand ils préconisent de faire appel<br />
à d’autres disciplines : l’astronomie, la géologie,<br />
l’étude des traditions, l’analyse de textes négligés,<br />
etc. On n’accepte une approche pluridisciplinaire de<br />
l’archéologie que dans une optique réductionniste :<br />
le carbone-14 ou l’analyse pollinique, à condition<br />
qu’elles viennent confirmer les recoupements historico-archéologiques.<br />
Et à ce sujet, je voudrais attirer<br />
l’attention sur une découverte récente, dont les implications<br />
m’ont beaucoup inquiété.<br />
La dendrochronologie a été maintenant suffisamment<br />
vérifiée, et des tableaux de correction pour les<br />
dates au carbone-14 commencent à être publiés<br />
partout. On sait que la comparaison de radioactivité<br />
dans les anneaux de croissance d’arbres millénaires<br />
comme le séquoia a obligé les savants à corriger<br />
leurs dates, parfois de plusieurs siècles. C’est ainsi<br />
que la dendrochronologie a donné le coup de grâce<br />
à la théorie ô combien adulée du diffusionnisme<br />
d’est en ouest, le fameux mirage de l’Orient. Dorénavant,<br />
au lieu de lui être postérieur, Stonehenge et les<br />
mégalithes par exemple sont bien antérieurs à Mycènes.<br />
(Nous nous en doutions depuis longtemps, mais<br />
ceci est une autre histoire.) Seulement, cette théorie<br />
n’était pas basée uniquement sur le C-14, loin s’en<br />
faut. On date avant tout les pièces par comparaison<br />
avec d’autres cultures, par analogie avec des sites<br />
voisins, par l’étude de l’évolution des arts et des<br />
techniques, etc. Or ! ! ! Toutes ces méthodes<br />
« historiques » étaient en accord avec la datation au<br />
C-14, affirmant que la vieille Europe était l’héritière<br />
de l’Orient. Si, maintenant, la datation scientifique<br />
doit être corrigée, que faut-il penser de toutes ces<br />
autres méthodes qui étaient arrivées au même résultat<br />
? Je suis très inquiet, car il faudrait penser qu’on<br />
a donné là-bas pas mal de coups de pouce dans<br />
tous les sens, pour arriver à cette fameuse corrélation<br />
historico-scientifique chère aux archéologues.<br />
Pauvre séquoia ! Oserait-il mettre en doute la bonne<br />
foi de tant de générations d’honnêtes chercheurs ?<br />
Architecture en chambre.<br />
En ce qui concerne le transport des « grosses pierres»<br />
de l’Antiquité, mégalithes et monolithes (1), on<br />
connaît la réponse réductionniste : des esclaves à la<br />
pelle. Dans le cas des pyramides, et en attendant<br />
mieux, on pourrait, pourquoi pas, se contenter de<br />
cette solution. Je ferai simplement remarquer que<br />
dans les ouvrages d’égyptologie on trouve autant de<br />
techniques de transport qu’il y a d’auteurs, ce qui<br />
(1) Jean-Pierre Adam appelle mégalithe tout ce qui<br />
est « grosses pierres ». S’il se veut archéologue,<br />
il devrait savoir que le terme de « mégalithes<br />
» est réservé aux pierres non taillées ou<br />
mal dégrossies, du genre dolmens et menhirs,<br />
tandis que les colosses taillés et/ou sculptés<br />
sont les monolithes.<br />
prouve que les vestiges à partir desquels on extrapole<br />
ne sont pas aussi démonstratifs qu’on veut bien<br />
nous le faire croire. Cela étant, lorsqu’on constate<br />
que des blocs gigantesques, souvent déjà achevés,<br />
furent ajustés avec une précision extraordinaire et<br />
sans subir la moindre éraflure, on est en droit de se<br />
poser des questions. Devant la résurgence périodique<br />
de celles-ci, et obligés de prononcer le mot<br />
« technique », les archéologues sortent une nouvelle<br />
arme, l’ingéniosité ou plus simplement, le « système-<br />
D ». Première remarque : l’honnêteté élémentaire<br />
obligerait à reconnaître — et explicitement — que la<br />
solution proposée n’est rien de plus qu’un scénario,<br />
autrement dit une invention pure et simple, à partir<br />
d’exemples contemporains. Car on n’a jusqu’à présent<br />
jamais retrouvé de plan de travail, ni de résidus<br />
suffisamment probants pour recueillir la conviction<br />
unanime (c’est d’ailleurs de là que vient tout le problème).<br />
Mais ces messieurs se parent alors volontiers<br />
de leurs titres pour que, noblesse oblige, le<br />
lecteur soit subjugué. Non ! Qualitativement, pareille<br />
procédure ne vaut guère mieux que celle utilisée par<br />
l’autre bord, et qui consiste à se dire grand initié et à<br />
faire appel à des aides occultes quelconques. S’il<br />
fallait un portrait-robot de ce genre<br />
d’ « arrangements », je vous propose le livre de<br />
Jean-Pierre Adam : tout Baalbeck y est « résolu » à<br />
partir d’une technique du XVIII e siècle, le transport<br />
des statues de l’île de Pâques à partir... de l’auteur,<br />
et celui des blocs des pyramides à partir d’une fresque<br />
figurant une statue du Moyen Empire. Il faut que<br />
je m’y attarde pour démonter devant vous le mécanisme.<br />
Je commencerai par le dernier exemple cité.<br />
Sur deux pages entières, l’auteur a redessiné une<br />
fresque de la XII e , dynastie (Moyen Empire), trouvée<br />
dans le tombeau du pharaon Djéhoutihotep. Nous en<br />
reproduisons tirée de Jean-Philippe Lauer 6 , une<br />
réplique exacte, c’est-à-dire où on n’a pas complété<br />
ce qui manque, mais dotée par contre des hiéroglyphes<br />
qui l’entourent (ignorés par J.-P. Adam). Et<br />
voici que commencent les entourloupes (voir le dessin<br />
ci-contre).<br />
1. La hauteur du colosse, il la déduit de la hauteur<br />
des personnages, car, dit-il « les artistes égyptiens<br />
respectaient généralement les échelles sur<br />
ce type de représentation ». Affirmation gratuite,<br />
mais qui sert. De toute façon, ignare en égyptologie,<br />
il ne pouvait pas savoir que la hauteur est<br />
tout simplement inscrite dans les hiéroglyphes<br />
(voir J.-Ph. Lauer, page 271).<br />
2. Ignorant aussi bien quel était le matériau utilisé, il<br />
fait une estimation allant de 54 à 80 tonnes, selon<br />
qu’il s’agit de pierre tendre ou dure. S’il avait<br />
lu ne fût-ce que le livre de Lauer, il saurait que le<br />
colosse est en albâtre. Qu’à cela ne tienne, il<br />
choisit un poids moyen de 72 tonnes (?).<br />
3. Par un calcul rudimentaire, le voilà qui conclut<br />
qu’il fallait 1950 hommes pour le traîner. Ayant<br />
remarqué sur la fresque qu’un des personnages<br />
rend le sol glissant en y déversant un liquide, il<br />
en déduit que l’effort à fournir tombe au sixième<br />
de la charge, soit 480 hommes... Et voici le tour<br />
de passe-passe : sur le dessin ne sont figurés<br />
que 172 ouvriers ! Donc, « seuls le manque de<br />
surface et la simplification de son travail l’ont<br />
amené (l’artiste) à réduire de deux fois et demie<br />
la quantité normalement requise » ! Ran pataplan<br />
! fermez le ban !, selon une expression chère<br />
à l’auteur.<br />
Voilà comment ces gens font de l’archéologie ! Non
Le transport de la statue du pharaon Djéhoutihotep (d’après Jean-Philippe Lauer). Selon Jean-Pierre Adam,<br />
architecte, tout en respectant les proportions pour la taille des personnages, le dessinateur en a délibérément<br />
réduit le nombre. En effet, les calculs de J.-P. Adam montrent qu’il eût fallu 480 hommes, or la fresque n’en<br />
représente que 172.<br />
prévenu, on n’y verrait que du feu. Et pourtant l’arrangement<br />
est là, irréfutable : pour calculer la hauteur<br />
du colosse, on se base sur la fidélité du dessin,<br />
mais dès que les calculs ne vous conviennent plus,<br />
hop, vous arguez d’une schématisation de la part du<br />
même dessinateur, et le tour est joué. Qu’on ne me<br />
fasse maintenant pas dire ce que je n’ai pas dit.<br />
J’admets volontiers que cette statue et d’autres aient<br />
été déplacées de la façon indiquée sur la fresque. Le<br />
contraire serait étonnant quand on voit tous les temples<br />
égyptiens encore debouts. Tout comme on serait<br />
surpris d’apprendre que les anciens Egyptiens<br />
n’auraient jamais traîné le moindre bloc. Mais qu’on<br />
ne présente pas ce genre de calcul comme la panacée.<br />
Et surtout, qu’à partir de ce modeste exemple<br />
datant du Moyen Empire, on ne vienne pas dire (p.<br />
155) que « la méthode utilisée ici pour le déplacement<br />
peut être étendue à la majeure partie des mégalithes<br />
mis en œuvre, tant dans la vallée du Nil que<br />
dans d’autres contrées ». L’extrapolation de Jean-<br />
Pierre Adam à la construction des pyramides<br />
contient d’ailleurs sa propre réfutation. Partant d’une<br />
méthode inventée de toutes pièces, il doit reconnaître,<br />
au fur et à mesure, que tel ou tel ustensile était<br />
inconnu à l’époque, que ce n’est pas d’application<br />
pour tout, bref que la solution n’est pas là. Mais en<br />
attendant, et à l’aide de pleines pages de dessins<br />
parfois très sophistiqués, on a donné au lecteur l’impression<br />
que le mystère est depuis longtemps résolu<br />
et que, de toute façon, vu le contexte du livre, toute<br />
autre explication serait de l’imposture. Mais où est<br />
l’imposture ?<br />
Croit-on que j’exagère ? Il y a mieux. A l’île de Pâques.<br />
Le livre aura au moins eu l’avantage de nous<br />
rappeler qu’on attend de nous un exposé honnête et<br />
complet d’énigmes comme celles-là. Nous préparons<br />
un dossier à ce sujet, et je ne m’attarderai donc pas<br />
trop. Disons simplement que la technique préconisée<br />
par notre architecte en chambre (il reconnaît n’avoir<br />
jamais mis les pieds ni à Nazca, ni à Stonehenge, ni<br />
à l’île de Pâques, ni probablement ailleurs), cette<br />
technique est inventée de toutes pièces, et, quoique<br />
plausible comme toutes les précédentes, ne dispose<br />
pas du moindre début de preuve. Ignorant délibérément<br />
que des dizaines de statues sont encore creusées<br />
dans le flanc d’un volcan presque à pic, et que<br />
d’autres ont été descendues en passant par-dessus<br />
celles-ci, J.-P. Adam découvre malgré tout le colosse<br />
inachevé, long de 20 mètres, qui réduit sa théorie à<br />
néant. Qu’à cela ne tienne, il sort de son chapeau le<br />
bon vieux cliché de tout archéologue réductionniste<br />
qui se respecte : comme à Baalbeck, une fois la<br />
pierre pratiquement taillée, ses constructeurs se sont<br />
rendus compte avec effarement qu’ils ne pourraient<br />
la déplacer ! Car il faut savoir que ces gens étaient<br />
bêtes au-delà de toute imagination ! Pas si bêtes<br />
pourtant que pour laisser traces de leurs gigantesques<br />
rampes de terre : pour l’une des plus grandes<br />
statues, l’auteur a imaginé une rampe de 4 500 m 3 ,<br />
ni plus ni moins, et encore bien inclinée à 20%. Imaginez<br />
le spectacle. Mais ici aussi, ignorant les premiers<br />
mots de l’archéologie pascuane, on ne lui avait<br />
jamais dit que, pour réaliser pareille rampe, avec le<br />
sol volcanique de l’île, il eût fallu en amasser pratiquement<br />
toute la terre. L’ayant appris de Francis<br />
Mazière lors de leur confrontation sur Antenne 2, il<br />
ne faudra à Jean-Pierre Adam qu’un mois pour imaginer<br />
une nouvelle entourloupe. Figurez-vous que si<br />
l’île de Pâques est devenue la terre désolée qu’on<br />
connaît, c’est tout simplement par la faute des Pascuans<br />
eux-mêmes : « Ils ont déboisé complètement<br />
l’île, m’a-t-il dit, et, au déboisement a succédé une<br />
érosion éolienne formidable, qui a retiré la couche de<br />
cendres volcaniques qui se trouvait en surface. On<br />
est donc obligé de raisonner en partant de parallèles<br />
avec le mégalithisme européen notamment, où l’on<br />
trouve du bois et de la terre pour faire des rampes ».<br />
Ran pataplan ! fermez le ban encore une fois ! Et si<br />
les Pascuans ont déboisé, c’est sans doute pour<br />
traîner leurs statues ? Et les rampes étaient faites en<br />
cendres volcaniques ? Vous voyez, on tourne en<br />
rond. Mais comme on n’a jamais trouvé le moindre<br />
indice de pareil phénomène à l’île de Pâques, il est<br />
loisible d’inventer n’importe quoi, personne ne vous<br />
démentira. C’est bien ce que je disais : les archéomanes<br />
procèdent ainsi, mais apparemment aussi<br />
ceux qui se veulent archéologues. Pareille procédure<br />
7
8<br />
est, ni plus ni moins, de l’archéologie-fiction !<br />
Puisqu’on nous renvoie au mégalithisme européen,<br />
j’y suis allé voir de plus près. On sait que les préhistoriens<br />
se sont mis d’accord pour clamer à qui<br />
veut l’entendre, que les dolmens sont des tombeaux.<br />
C’est pourquoi, véritables empêcheurs de tourner en<br />
rond, nous nous faisons un plaisir de vous parler,<br />
dans ce numéro, des mégalithes coréens, où les<br />
squelettes sont extrêmement rares, et probablement<br />
récents, dus à ce que Henri de Saint-Blanquat (sans<br />
partager nos vues) appelle « les attardés du mégalithisme<br />
» 7 . C’est finalement chez Fernand Niel, dans<br />
son livre sur Stonehenge, que j’ai trouvé les plus<br />
beaux exemples de ces syllogismes qui tournent en<br />
rond, et dont on sait qu’ils sont très en usage aussi<br />
chez les archéomanes 8 . Jugez-en plutôt, c’est écrit<br />
page 117 : « Les pierres de Stonehenge peuvent<br />
avoir été dressées sous l’impulsion de l’idéal religieux.<br />
D’ailleurs (c’est moi qui souligne), l’érection<br />
des monuments montre que les hommes de ces<br />
époques avaient l’habitude des grands travaux ». Si<br />
vous pouvez me dire comment l’un découle de l’autre,<br />
écrivez-moi. J’ai trouvé une perle semblable à<br />
Avebury, non loin de Stonehenge, où se dresse une<br />
double enceinte de pierres levées pesant jusque 40<br />
tonnes. On y lit sur une plaquette rédigée à l’usage<br />
des touristes par l’archéologue attitré du site, le Professeur<br />
R.J.C. Atkinson, que ce cromlech de 650<br />
menhirs a été édifié « for unknown religious purpose<br />
», pour des raisons religieuses inconnues. En<br />
littérature, on pourrait admirer la figure de style, mais<br />
c’est paraît-il, de science qu’il s’agit ici. Alors, si les<br />
raisons sont inconnues, comment sait-on qu’elles<br />
sont religieuses ? Là encore, si vous savez, écrivezmoi.<br />
Mais la perle la plus précieuse, celle qu’on voudrait<br />
enchâsser, concerne la construction des dolmens.<br />
Elle est aussi de Fernand Niel, page 239 : « Il<br />
(le système du remblai) fut sans doute adopté pour<br />
la pose des tables des dolmens (...). On a objecté<br />
qu’aucune trace ne restait de tels travaux, mais<br />
pourquoi en resterait-il ? Il ne s’en trouve pas non<br />
plus autour de la plupart des dolmens ». CQFD,<br />
lecteur ne doutez plus, la foi vous sauvera !<br />
Comment arranger les chiffres.<br />
Baalbeck, enfin ! Là, c’est du Cecil B. De Mille, le<br />
sens de l’humour en moins. Si ce dernier utilisait,<br />
pour ses reconstitutions, des blocs en carton-pâte,<br />
Jean-Pierre Adam, de son propre aveu, ne tient nullement<br />
compte, dans son scénario, de la résistance<br />
des matériaux, ce qui résout déjà pas mal de choses.<br />
Un kilo de plumes pèse autant qu’un kilo de<br />
plomb, tout le monde sait ça. Second problème<br />
qu’on escamote : le fait que les blocs du trilithe aient<br />
été soulevés à une hauteur de sept mètres. Vous<br />
imaginez alors, de la carrière jusqu’au temple, une<br />
chaussée longue d’un kilomètre, et vous la rehaussez<br />
jusqu’au niveau de l’assise correspondante ;<br />
comme le temple est en contre-bas de la carrière, on<br />
reste rêveur devant la quantité de terre remuée ; que<br />
cela ne laissa aucune trace, bien sûr, vous ne vous<br />
en préoccupez guère. Et enfin, comme je l’ai dit plus<br />
haut, le bloc encore dans la carrière, vous le laissez<br />
où il est (bien sûr), en laissant entendre que s’il ne<br />
fut jamais transporté, c’est parce qu’il était intransportable,<br />
et que les tailleurs de pierre étaient trop<br />
demeurés que pour s’en rendre compte à temps. Si<br />
je vous réponds qu’il leur aurait suffi d’en scier un<br />
morceau jusqu’à le rendre transportable, vous me<br />
rétorquez, candidement (page 139) que « pour obte-<br />
nir un mètre cube de pierre de construction, il était<br />
plus facile de le réaliser en un seul morceau que de<br />
le fractionner en un grand nombre de moellons dont<br />
la confection aurait multiplié considérablement les<br />
surfaces à tailler ». On n’avait jamais songé à cela si<br />
les hommes se sont, à une certaine époque, mis à<br />
tailler et à traîner des blocs gigantesques, c’est parce<br />
qu’ils étaient paresseux ! Dernier conseil : au<br />
passage, vous ne donnez à ce bloc dans la carrière<br />
que 4 m 30 de large, pour 4 m 80 dans la réalité, ce<br />
qui réduit son volume de 45 m 3 , et son poids de 160<br />
tonnes : c’est toujours ça de pris. Et vous voilà à<br />
pied d’œuvre. Ceux que cela intéresse, je les renvoie<br />
au livre en question, tout y est résolu en une<br />
page.<br />
Nous reproduisons ici simplement le schéma de<br />
Jean-Pierre Adam, destiné à illustrer tout cela, et qui<br />
en dit long sur les dons d’illusionniste de l’auteur.<br />
Remarquez simplement trois choses (2) :<br />
1. Des cabestans comme vous en voyez, il est censé<br />
y en avoir 16, disposés symétriquement. Qu’il<br />
faut de la place pour agencer tout cela n’a apparemment<br />
aucune importance. Qui plus est, la<br />
puissance produite par chaque machine est calculée<br />
une fois pour toutes, et rien n’entamera<br />
l’optimisme de l’auteur. Aucune traction ne s’effectue<br />
droit vers l’avant mais bien plus ou moins<br />
en éventail : par conséquent, la résultante sera<br />
dans chaque cas inférieure aux calculs. C’est de<br />
la mécanique élémentaire qui ne gêne nullement<br />
M. Adam.<br />
2. Trente-deux hommes s’esquintent sur chacun<br />
des cabestans. D’après ses calculs, chaque machine<br />
développe ainsi une force de 35 tonnes.<br />
Trente-cinq tonnes par cabestan Et cette puissance<br />
vient s’appliquer sur un tambour central en<br />
cèdre du Liban de 20 centimètres de diamètre !<br />
Demandez l’avis d’un ingénieur : c’est en acier<br />
massif que devrait être le tambour pour résister.<br />
Qui plus est, dans ce tambour sont plantées huit<br />
barres, également en cèdre, sur lesquelles viennent<br />
s’appuyer les hommes. Là aussi, le bois<br />
devrait au moins être cerclé d’acier.<br />
3. Contrairement à ce qu’on pourrait croire en<br />
voyant le dessin, c’est chaque cabestan qui doit<br />
être ancré dans le sol par une herse. Si on veut<br />
une traction autant que possible vers l’avant,<br />
cela pose un nouveau problème, que l’auteur ne<br />
soulève bien sûr pas. Mais en outre, voyez la<br />
légende, c’est dans du remblai qu’elles se fixent<br />
et toutes à l’avant. Ce remblai, c’est du sol meuble,<br />
qu’on y ajoute autant de pierraille qu’on veut.<br />
Encore une fois, c’est en réalité du béton armé<br />
qu’il faudrait.<br />
Enfin, je ne puis m’empêcher de sourire en constatant<br />
que, après avoir réfuté le transport par 800<br />
bœufs, comme étant trop encombrant, l’auteur trouve<br />
par contre que 512 hommes, maniant 16 cabestans<br />
arrimés par autant de herses, c’est beaucoup<br />
plus plausible et, je suppose, pas encombrant du<br />
tout. Aux innocents les mains pleines... Désolé, mais<br />
ceci n’est pas de l’architecture, mais du travail de<br />
potache. Imaginez le sort qu’on réserverait à un lycéen,<br />
remettant une copie où il laisse entendre que<br />
le déplacement provoqué par une force est toujours<br />
identique, que celle-ci soit appliquée perpendiculairement<br />
à la masse, ou obliquement. C’est pourtant<br />
bien ce qui est dit : 16 cabestans, donc 16 fois la<br />
puissance d’un cabestan... (3).<br />
A l’appui de son système-D, Jean-Pierre Adam men-
Le transport d’un monolithe de Baalbeck, d’après J.-P. Adam. Sans entrer dans les détails, nous avons<br />
reconstitué les bras de forces en présence. Des calculs de l’auteur, on peut déduire que la puissance<br />
résultante appliquée en A par exemple (nous n’avons pas calculé le centre de gravité) sera identique,<br />
que cette force soit presque parallèle comme en B (pour le premier cabestan), ou presque perpendiculaire<br />
comme en C (pour le dernier). En effet, le déplacement obtenu par l’ensemble est, selon J.-P. Adam,<br />
architecte, de 16 fois celui créé par n’importe lequel des 16 cabestans. En médaillon, l’auteur de ce chefd’œuvre<br />
d’archéologie-fiction officielle.<br />
(2) Non content de me remémorer quelques notions<br />
élémentaires de mécanique physique, j’ai aussi<br />
recueilli l’avis des ingénieurs, en l’occurrence Pierre<br />
Méreaux-Tanguy et Alex Pirson, qui m’ont aidé à<br />
souligner quelques-unes des approximations dont<br />
je parle.<br />
(3) A partir de là, on peut aller très loin. Je soumets ce<br />
petit jeu aux ingénieurs, afin de vérifier, par comparaison,<br />
à quelles aberrations on aboutit. On a dit<br />
que le programme Apollo vers la Lune était « la<br />
pyramide du XX e siècle ». La fusée Saturn V pèse,<br />
avec son carburant, 2700 tonnes, mais 170 seulement<br />
à vide. Pour l’amener jusqu’à l’aire de lancement,<br />
à cinq kilomètres de l’édifice d’assemblage,<br />
la NASA avait prévu un « crawler transporter »,<br />
plate-forme de 40 x 35 mètres et pesant 2500 tonnes.<br />
Avec la fusée et sa tour, cela donne approximativement,<br />
trois blocs de Baalbeck. Ceux-ci,<br />
Jean-Pierre Adam les met sur des rondins, et les<br />
voilà qui ne font plus que 1l12 e du poids initial. J’ai<br />
estimé que, sur roues, cela devait faire 1l20 e . Toujours<br />
à partir de ces calculs, il suffirait pour le transport,<br />
d’environ 920 hommes maniant 30 cabestans.<br />
Dommage que la NASA n’ait pas retenu cette solution,<br />
elle aurait fait une économie de plusieurs millions<br />
de dollars. A titre de comparaison, sachez que<br />
le « crawler transporter » avance sur quatre paires<br />
de chenilles, chacune étant mue par huit moteurs<br />
électriques alimentés par deux générateurs Diesel<br />
de 2800 chevaux chacun...<br />
9
10<br />
tionne le transport en 1928 du monolithe de Mussolini<br />
(560 tonnes) et celui, vers 1780, du bloc de Saint-<br />
Pétersbourg (1250 tonnes). Le premier fut descendu<br />
de sa plate-forme d’extraction par un système funiculaire<br />
de câbles d’acier... probablement le même<br />
que celui en usage à l’île de Pâques ! Il fut traîné<br />
ensuite par soixante bœufs, tout au long d’une déclivité<br />
permanente. L’auteur nous dit que la traction<br />
s’exerçait sur trois câbles, mais il prend bien soin de<br />
ne pas nous dire en quoi étaient faits ces câbles,<br />
Même avec l’aide de rondins, c’est une masse de<br />
190 tonnes qui exerce sa traction sur chacun des<br />
câbles : gageons qu’ils n’étaient sûrement pas en<br />
chanvre... Quant au bloc de Saint-Pétersbourg, traîné<br />
par 64 hommes, chacun des câbles passait par<br />
deux palans et trois poulies, procédés complètement<br />
inconnus à l’époque mégalithique. Qui plus est, le<br />
monolithe, à peine dégrossi, roulait littéralement sur<br />
32 billes dans des rails en bois, lesquels étaient renforcés<br />
par un alliage identique à celui des billes.<br />
Nous avons retrouvé la source de ces renseignements<br />
9 de même que l’erreur retranscrite par notre<br />
architecte : il y est bien dit que l’alliage était fait de<br />
cuivre, d’étain et de calamine. Or, le nom de calamine<br />
est donné, soit à une couche d’oxydes de fer<br />
qu’on fait adhérer à de l’acier laminé à chaud par<br />
exemple, mais n’étant pas un métal, l’alliage cuivreétain-calamine<br />
n’existe pas : c’est aussi absurde que<br />
de prétendre faire des pommes-mousseline avec<br />
des pommes de terre enrobées dans leur gangue de<br />
terre ; ou bien la calamine peut être un minerai de<br />
zinc, et l’auteur songeait-il à l’addition de zinc à du<br />
bronze : mais cette fois, pareil alliage diminue la<br />
résistance et la dureté... alors que J.-P. Adam affirme<br />
exactement le contraire. Donc, de toute façon,<br />
c’est une erreur, et M. Adam n’est pas ingénieur, me<br />
direz-vous. Mais à ce moment, par respect du lecteur,<br />
il ferait bien de ne pas colporter les erreurs, de<br />
ne pas en rajouter, enfin et surtout, de fournir tous<br />
les renseignements car dans la référence citée, j’ai<br />
relevé un autre détail soigneusement escamoté par<br />
le même : à chaque fois qu’on était dans l’impossibilité<br />
de poursuivre en ligne droite, on transférait le<br />
bloc sur un châssis à coulisses circulaires, et pour ce<br />
faire, on dut avoir recours à 12 vérins en acier avec<br />
vis et chapeau en cuivre. Autant dire que les constructeurs<br />
de Baalbeck n’avaient jamais entendu le<br />
premier mot de toutes ces techniques industrielles.<br />
En comparant des choses sans rapport entre elles,<br />
on arrive bien sûr à démontrer n’importe quoi. Pour<br />
être plus honnête, il eût fallu remonter à un exemple<br />
se rapprochant plus des moyens de l’époque. C’est<br />
ainsi que pour dresser place Saint-Pierre l’obélisque<br />
de 510 tonnes amené à Rome par Caligula, il fallut,<br />
en 1585, outre les 40 treuils, 75 chevaux et pas<br />
moins de 907 hommes ! Et à l’époque égyptienne (et<br />
d’autres), pareille performance était quotidienne…<br />
Les calculs de Jean-Pierre Adam sont tous des exprapolations<br />
à partir des expériences d’un théoricien<br />
en architecture de l’époque napoléonienne, M. Rondelet,<br />
que lui-même aurait renouvelées sur un chantier<br />
en Turquie (4). On voit dans son ouvrage plusieurs<br />
photos montrant des ouvriers arc-boutés à un<br />
traîneau sur lequel repose un bloc d’apparemment<br />
quelques tonnes. Cinq tonnes, m’a-t-il confirmé. Il<br />
est une constatation de tous les jours, qui m’avait<br />
frappé lorsque je l’ai étudiée dans je ne sais plus<br />
quel cours de physiologie. Si vous soulevez cinq<br />
kilos aisément, et qu’on y ajoute 100 grammes, vous<br />
ne remarquerez pratiquement rien ; prenez un poids<br />
de vingt kilos, ce sera plus pénible, et il se peut même<br />
que, avec 100 grammes de plus, vous n’arriviez<br />
plus à le soulever. Pourtant, dans les deux cas, la<br />
différence n’est que de 100 grammes : il existe donc<br />
une limite à partir de laquelle l’effort à déployer commence<br />
à suivre une progression non plus arithmétique,<br />
mais bien géométrique. Il ne suffit donc pas de<br />
déplacer cinq tonnes, puis de multiplier par 10, 50 ou<br />
100 en disant que c’est la même chose : on oublie<br />
des tas de facteurs, dont les plus importants sont la<br />
résistance des matériaux, celle des hommes, l’encombrement,<br />
l’intendance et j’en passe. Or, ce genre<br />
de calcul est fréquent. Un cas flagrant est la reconstitution,<br />
par la BBC, du transport fluvial de pierres<br />
bleues destinées à Stonehenge. Ces pierres faisaient<br />
cinq tonnes, et, pour la reconstitution, on s’est<br />
contenté de blocs de 1500 kilos. Pourquoi ne pas y<br />
mettre le gros paquet, tant qu’on y était ? Je dis que<br />
c’est parce que les archéologues savaient qu’ils se<br />
heurteraient à des difficultés qu’on pouvait escamoter<br />
de la sorte. Ils n’ont pas manqué pourtant de<br />
calculer à partir de là comment il eût fallu déplacer<br />
les blocs de 50.000 kilos. Or, les cas connus de certains<br />
transports exceptionnels, utilisant les mêmes<br />
techniques — mais effectués sur le terrain et non par<br />
calcul sur le papier — démontrent précisément que<br />
ce genre d’extrapolation relève de la plus haute fantaisie.<br />
Si je reprends l’expérience de la BBC, je peux<br />
calculer, selon M. Adam et consorts, que s’il fallut 12<br />
hommes pour 1500 kilos, il en faudrait 88 pour un<br />
bloc de 11 tonnes. C’est la masse de la dalle de<br />
couverture d’une tombe qu’on a vu déplacer récemment,<br />
aux dires de Henri de Saint-Banquat, quelque<br />
part en Asie du Sud-Est 10 . Eh bien, l’expérience a<br />
montré que ce n’est pas 88 hommes qu’il fallait, mais<br />
bien 550 ! il y a là un coefficient que nos architectes<br />
en chambre feraient bien de rechercher.<br />
Réactivation archéologique.<br />
Quoi qu’il en soit, je doute que tout ceci soit de nature<br />
à ébranler la conviction de gens comme M. Adam.<br />
De la conversation que j’ai eue avec lui, il ressort<br />
clairement que nous n’envisageons pas les choses<br />
sous le même angle. Pour lui, ce genre de problèmes<br />
se résume à ceci : on a réussi à trouver une<br />
explication plausible pour un cas déterminé, on peut<br />
donc l’extrapoler à tous les cas analogues, et il devient<br />
même inutile d’encore chercher plus loin. Et de<br />
(4) Il semble d’ailleurs que ce soit la seule (re)découverte<br />
archéologique qu’ait jamais faite J.-<br />
P. Adam. Il faut dire qu’il n’a que 38 ans. C’est<br />
en vain qu’on chercherait dans sa biographie<br />
une quelconque référence strictement archéologique.<br />
On dit bien qu’il a suivi des cours d’architecture<br />
et qu’il donne cours d’architecture galloromaine.<br />
A part çà, il a « suivi des chantiers de<br />
fouilles, essentiellement en Turquie, en Afrique<br />
du Nord, en Grèce et en Italie. De son propre<br />
aveu, il n’a vu ni Stonehenge, ni Nazca, ni Glozel,<br />
ni l’île de Pâques, dont il parle si bien. Cela<br />
étant, on sait aussi de lui qu’il est le neveu du<br />
ministre français des Finances (ce qui pourrait<br />
expliquer son accès facile aux mass media), et<br />
enfin, que pour lancer son livre comme on lance<br />
des savonnettes, il n’hésite pas à accompagner<br />
un reporter de RTL dans les rues, demandant<br />
partout aux gens s’ils connaissent son nom, et<br />
s’ils ont lu son livre !
plus, en ce qui le concerne, toute autre explication<br />
ne pourrait relever que de l’irrationnel, ce qui n’est<br />
pas du tout notre avis. L’archéologie n’est pas une<br />
science « finie », achevée, et les quelques hypothèses<br />
avancées ne sont pas, j’espère, le dernier mot<br />
de l’intelligence humaine. Celles qu’on veut nous<br />
imposer, sous couvert de rationalisme, ne nous semblent<br />
guère plus convaincantes que celles qu’on<br />
camoufle sous le label d’initiation ou d’imagination.<br />
Et précisément, en disant cela, je me heurte à un<br />
des principes sacro-saints du cartésianisme, à savoir<br />
l’ « économie des hypothèses ». Lorsqu’il est<br />
confronté à des éléments inexpliqués, le premier<br />
objectif de l’homme de science doit être de ramener<br />
chacun de ces éléments dans le cadre d’une théorie<br />
existante. En général, il atteint son but, mais il restent<br />
souvent deux ou trois pièces « en l’air », pour<br />
lesquelles il y a toujours moyen de trouver une explication<br />
à tout crin. Or, cette pièce à conviction est<br />
peut-être le grain de sable, précisément. Et si celui-ci<br />
ne s’explique que par une hypothèse nouvelle, absolument<br />
fantastique pour l’époque, il peut arriver,<br />
comble d’ironie, qu’il s’agit de la pièce maîtresse<br />
d’une tout autre conception. Voire que, à la lueur de<br />
cette pièce à conviction, il faille revoir toutes les autres,<br />
toutes celles qu’à grand peine on avait ramenées<br />
à des théories préexistantes. C’est ainsi que la<br />
gravitation de Newton est devenue un cas particulier<br />
de la théorie plus générale de la relativité d’Einstein.<br />
Si celui-ci avait suivi la méthode cartésienne d’économie<br />
des hypothèses, dans le cadre de la théorie<br />
existante (celle de Newton), jamais il n’aurait découvert<br />
la relativité. Je ne crois pas que l’Histoire entière<br />
soit à réviser, mais bien que certaines incidences<br />
sont complètement tordues, suite aux innombrables<br />
coups de pouce qu’elle a subis au cours du temps.<br />
S’en tenir à des lois, c’est nécessaire, mais il ne faut<br />
pas que cela empêche l’imagination d’encore fonctionner.<br />
Lorsqu’on voit M. Adam présenter le transport<br />
de tous les mégalithes et tous les monolithes du<br />
monde comme résolus, il faut dire bien haut que tel<br />
n’est pas le cas, et qu’il le sait très bien. S’il veut<br />
ainsi couper les ailes aux archéomanes, c’est son<br />
affaire. Mais lire et prendre pour argent comptant ce<br />
qu’il dit, ce serait manquer d’autant d’esprit critique<br />
que de lire et prendre pour argent comptant ce que<br />
dit Charroux.<br />
Tout reste à faire, et il faut être exigeant tant pour les<br />
réponses existantes que pour les nouvelles. La réac-<br />
JEAN-PIERRE ADAM : ... Il a fallu attendre que<br />
les Phéniciens essaiment dans toute la<br />
Méditerranée pour apporter l’écriture.<br />
KADATH : Et un moyen de transmission écrite<br />
A.<br />
K.<br />
A.<br />
K.<br />
A.<br />
K.<br />
A.<br />
K.<br />
A.<br />
Sur quel support ?<br />
François Bordes, vous connaissez ?...<br />
Pas du tout !<br />
... il envisage l’usage de peaux...<br />
Ils auraient spontanément imaginé d’écrire<br />
sur une peau, sans s’exercer d’abord sur<br />
un os, ou sur une pierre ?<br />
Il y a les travaux de Marshack sur les os.<br />
Vous avez lu ?<br />
Pas du tout !<br />
Si vous n’envisagez pas l’hypothèse, vous<br />
n’allez pas chercher après, non plus !<br />
On n’a pas le droit de l’envisager lorsqu’on<br />
a une responsabilité scientifique...<br />
(extraits d’une tentative de dialogue vouée à l’échec).<br />
tivation archéologique est à ce prix. Cette attitude<br />
faite de patientes recherches et de prudence, il s’avère<br />
en fin de compte qu’elle est une de nos caractéristiques.<br />
Elle n’est en tout cas ni celle de M. Adam<br />
ni celle de M. Charroux. Ni de beaucoup d’autres.<br />
Tous ces réductionnistes ont des points communs,<br />
et je vous en soumets quelques-uns. Vérifiez au<br />
hasard de vos lectures archéologiques, vous débusquerez<br />
facilement, je crois, les réductionnistes, en<br />
recherchant les caractéristiques suivantes :<br />
— ils ignorent délibérément certains détails et<br />
schématisent à outrance ;<br />
— ils considèrent leurs théories comme définitives ;<br />
— face aux leurs, on trouve autant de théories qu’il<br />
y a de réductionnistes ;<br />
— ils ne sont compétents qu’en un domaine restreint,<br />
puis extrapolent ;<br />
— ils refusent tout dialogue.<br />
Et j’en reviens aux confrontations dont je parlais en<br />
début d’article. Elle m’ont rappelé un passage<br />
d’Abraham Merritt, cet auteur d’heroic fantasy, qui<br />
était aussi archéologue amateur, ce qui l’avait amené<br />
à jeter un regard assez pertinent sur certains<br />
milieux scientifiques que nous côtoyons aussi. « Et<br />
je me dis, alors, que la science et la religion sont<br />
vraiment proches parentes, ce qui explique en grande<br />
partie pourquoi elles se haïssent si fort, que les<br />
hommes de science et les hommes de religion sont<br />
parfaitement semblables dans leur dogmatisme, leur<br />
intolérance, et que chaque âpre bataille religieuse<br />
sur telle ou telle interprétation de foi ou de culte a<br />
son équivalence dans les batailles scientifiques sur<br />
un os ou sur un rocher » 11 .<br />
IVAN VERHEYDEN<br />
Jean-Pierre Adam : « L’archéologie devant l’imposture<br />
», Robert Laffont éd. 1975. Voir en postscriptum<br />
également.<br />
Groupement de recherche et d’études pour la<br />
civilisation européenne ; s’adresser à Christian<br />
Durante, 130, rue de la Pompe, 75116 Paris.<br />
La notion de « réactivation archéologique », nous<br />
l’empruntons à Bernard Lefèvre, qui nous avait<br />
présentés en ces termes aux lecteurs de l’hebdomadaire<br />
« Pourquoi Pas », le 13 septembre 1973,<br />
sous le titre « Faut-il brûler les livres d’archéologie<br />
? ».<br />
Louis Pauwels : « Ce que je crois », Bernard<br />
Grasset éd. 1974. Maurice Clavel, idem 1975. Lire<br />
aussi à ce sujet « Face au néant », essais d’Arthur<br />
Koestler (Calmann-Lévy, 1975).<br />
Albert Burnet : « Science, apriorisme et fiction »,<br />
dans « Le Soir » du 6 décembre 1975.<br />
Jean-Philippe Lauer : « Le mystère des pyramides<br />
», Presses de la Cité 1974.<br />
Henri de Saint-Blanquat : « Le mégalithe aux 300<br />
morts », Sciences et Avenir. N° 346 de décembre<br />
1975.<br />
Fernand Niel : « Stonehenge, temple mystérieux<br />
de la préhistoire », Robert Laffont éd. 1974.<br />
Stanislas Lami : « Dictionnaire des sculpteurs de<br />
l’époque française au XVIII e Références.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
siècle », Honoré<br />
Champion éd. 1910. Compulsé par Christiane<br />
Piens.<br />
10<br />
Henri de Saint-Blanquat : « Dossier : les mégalithes<br />
», Sciences et Avenir, n° 342 d’août 1975. Il<br />
ne précise pas de quel pays il s’agit.<br />
11<br />
Abraham Merritt : « Les habitants du mirage »,<br />
Collection J’ai Lu, n° 557, p. 292.<br />
11
12<br />
PIECEs A CONVICTIONS<br />
<strong>LE</strong>S BRICOLAGES DE GENIE<br />
Lors d’un passage à la télévision, il y a de cela plusieurs mois, Jacques Bergier exigeait qu’on le mette en<br />
présence d’une machine à laver néolithique. Chose peu simple quand on est pris au dépourvu, même<br />
pour Robert Charroux. Pourtant, d’autres mécaniques étrangement compliquées — au point de vue scientifique<br />
— se remarquent de par le monde. Des assemblages de rouages, pré-transistoriens, peuvent être<br />
aisément saisis, si toutefois le mot est bien choisi : le computer d’Anticythère ne révéla ses derniers<br />
secrets que tout dernièrement, même si nous en parlions déjà en mars 1973.<br />
L’adjectif facile ne s’accorde pas vraiment à la<br />
découverte de tout objet du culte enfoui sous les<br />
vitrines des musées, j’en prendrai pour seul<br />
exemple le cas des piles de Bagdad que nous<br />
vous contions dans KADATH n° 10. Difficile est<br />
réservé aux pièces de collection privée, que les<br />
sectes pseudo-initiatiques se gardent le plaisir de<br />
contempler sinon d’adorer. Partiellement impossible,<br />
qualifie mieux les pièces inestimables protégées<br />
par les parois anti-atomiques du Vatican :<br />
malgré tout, les trésors les plus précieux sont<br />
toujours disponibles aux audacieux.<br />
Me laissant guider par le flair de l’audacieux, j’ai<br />
découvert un livre digne d’intérêt, à Londres, et<br />
de ce fait en langue anglaise, intitulé : « The Ancient<br />
Engineers » de Lyon Sprague de Camp,<br />
publié en poche par Ballantine (Réf. 23783).<br />
Nous survolerons ainsi quelques découvertes<br />
recensées par de Camp et son épouse, transitant<br />
allègrement de l’antiquité au néolithique pour<br />
terminer le voyage dans le temps en Grèce. La<br />
démarche que j’entreprends au travers de cet<br />
article est de convaincre le lecteur, s’il ne l’est<br />
déjà, que les Anciens bénéficiaient d’une science<br />
théorique qu’ils mirent en pratique. Je n’ai pas<br />
encore trouvé la rôtisseuse ultrasonique du néolithique,<br />
encore faudrait-il savoir si ces mêmes<br />
Anciens ne l’avaient pas bannie sous la pression<br />
de l’AMDCPH, ou si vous préférez l’Association<br />
Mondiale de la Défense du Consommateur de la<br />
Proto-Histoire.<br />
Marcus Vitruvius.<br />
Architecte romain, probablement ingénieur militaire<br />
sous César et Auguste, traité « De Architectura<br />
», sans doute un abrégé des œuvres des écri-<br />
vains grecs, principales éditions : celles de Venise<br />
(1497) et de Lyon (1552). Tacite décrivait ainsi,<br />
dans ses « Annales » le jeune Vitruve :<br />
« ... Vitruve voyait son idéal d’architecte comme<br />
un homme de lettres, un dessinateur de talent,<br />
un mathématicien, un familier des études historiques,<br />
un étudiant assidu des philosophes,<br />
connaissant la musique, n’ignorant pas la physique,<br />
érudit dans les lois, familier avec l’astronomie<br />
et les calculs astronomiques ».<br />
On sait peu de choses au sujet de Vitruve, hormis<br />
qu’il travailla pour l’armée romaine — il mit<br />
au point divers progrès techniques pour les catapultes<br />
—, qu’il construisit une basilique à Fanum<br />
et qu’il se décrivait, avec un certain humour, comme<br />
un petit homme affreux. Vitruve semble donc<br />
être un écrivain spécialisé en architecture romaine.<br />
Il emprunta la plus grande partie historique<br />
de son traité à ses prédécesseurs grecs, et discuta<br />
les méthodes architecturales des Hellènes<br />
et des Républicains romains de son temps : le<br />
Colisée et le Mur d’Hadrien n’étaient pas encore<br />
érigés.<br />
Son traité est, encore actuellement, une des<br />
meilleures sources d’information sur l’art, l’architecture<br />
et les techniques de l’époque. Et bien que<br />
Vitruve ne se borna pas au seul traité « De Architectura<br />
», les autres ont malheureusement disparu.<br />
Malgré tout, par divers recoupements, on sait<br />
à présent quels thèmes ils comportaient : le premier<br />
traité énonçait les qualifications d’un architecte,<br />
parlait d’architecture en général et de la<br />
planification des villes. Le deuxième étudiait les<br />
matériaux de construction, leur historique depuis<br />
les temps les plus reculés et les diverses métho-
des d’utilisation de la maçonnerie, des briques et<br />
des ciments. Le troisième décrivait les temples,<br />
les proportions de ces derniers dérivant des proportions<br />
du corps humain. Le quatrième traité<br />
s’attachait aux trois ordres : dorique, ionique et<br />
corinthien. Le cinquième décrivait les bâtiments<br />
publics tels basiliques, théâtres, bains, etc., discutant<br />
également de l’acoustique et de la théorie<br />
de la propagation des sons. Le sixième traité<br />
portait sur les habitations particulières tandis que<br />
le suivant s’intéressait à la décoration. Le huitième<br />
ouvrage concernait l’alimentation en eau :<br />
aqueducs, citernes, fossés etc. Le neuvième<br />
traité parlait de géométrie, d’astronomie, de mesure<br />
et d’études d’horloges à eau, nous verrons<br />
par la suite ce dont il s’agit. Le dixième et dernier<br />
traité s’étendait sur la mécanique : pompes,<br />
roues à eau, système de levage, orgues à eau,<br />
une espèce de taximètre pour mesurer la distance<br />
parcourue etc. Plusieurs chapitres étaient dédiés<br />
aux catapultes, tortues-boucliers ancêtres<br />
de nos chars d’assaut, beffrois et autres pièces<br />
essentiellement militaires.<br />
Les travaux de Vitruve disparurent au Moyen Age<br />
pour réapparaître peu après, au XV e siècle, et<br />
furent alors pris par les érudits comme une infaillible<br />
source de la plus belle autorité. Vitruve vécut<br />
aux environs de 25 avant Jésus-Christ, il avait, à<br />
l’instar de Pythagore, puisé dans les connaissances<br />
plus anciennes. Comme le fait remarquer de<br />
Camp, Vitruve était nimbé d’une culture universelle<br />
difficilement accessible en une vie humaine.<br />
Il avait tout bonnement résumé et mis à profit un<br />
back-ground disponible à l’époque, ce qui nous<br />
permet d’avoir une petite idée de l’état de la technologie<br />
des derniers siècles avant notre ère.<br />
Quelques exemples succincts permettront au<br />
lecteur de se faire également une idée précise de<br />
cet état technologique ; on peut parfois s’étonner<br />
des connaissances acquises il y a deux mille<br />
ans : celles-ci ne sont pourtant pas mensonge,<br />
c’est la Renaissance qui s’accaparera la renommée<br />
de la découverte. C’est d’ailleurs l’esprit de<br />
la Renaissance qui manipule encore toujours nos<br />
réactions vis-à-vis de l’Histoire.<br />
L’orgue de Héron.<br />
Ktesibios vécut de 285 à 247 avant J.-C., sous le<br />
règne de Ptolomée II Philadelphe, et était fils<br />
d’un barbier particulièrement doué en musique et<br />
mécanique. Cet orgue est le résultat d’une expérience<br />
personnelle de Ktesibios et fait appel à<br />
l’hydropneumatique (eau et gaz) et, nous rapporte<br />
Vitruve, consistait en plusieurs parties telles :<br />
une pompe à air de deux cylindres ; un vase<br />
d’expansion dans lequel l’air était admis sous<br />
pression ainsi que de l’eau, servant de régulateur<br />
de sortie d’air tel un vase dit de Mariotte : une<br />
série de tubes communiquant aux pipes de l’orgue<br />
; les pipes proprement dites avec leurs valves<br />
d’admission d’air et, finalement, un clavier<br />
commandant l’admission de l’air sous pression.<br />
Cette invention n’incluait pas seulement l’idée de<br />
base de l’orgue, mais aussi les moyens pneumatiques<br />
et hydrauliques permettant une pression<br />
constante et un clavier sélectionnant les pipes.<br />
De plus, et c’est un brevet, Ktesibios inventait<br />
des valves maintenues en place par les premiers<br />
ressorts métalliques de l’Histoire. Comment ces<br />
ressorts de fer furent-ils manufacturés est un<br />
autre brevet sans doute.<br />
L’horloge parastatique de Ktesibios.<br />
Les moyens de mesure du temps il y a deux mille<br />
ans étaient, selon les critères officiels, relativement<br />
pauvres, les cadrans solaires et autres<br />
clepsydres ne présentaient que peu de détails<br />
dans le fractionnement du temps. Ktesibios fut,<br />
encore une fois, l’inventeur d’un appareil de loin<br />
plus compliqué, tant du côté mécanique que de<br />
sa partie fluidique. Cet objet fut-il réellement utile<br />
dans le calcul du temps ou représentait-il un gadget,<br />
est une autre question lourde de retombées.<br />
Le vase de la clepsydre laissait s’échapper l’eau<br />
par un orifice, plus ou moins rapidement selon<br />
son diamètre, qui déterminait ainsi un temps<br />
« x » quand le récipient était vide. Mais bien des<br />
problèmes se posaient quant à la précision de<br />
l’engin : l’écoulement du liquide n’était jamais<br />
égal, l’obstruction du trou par lequel l’eau s’échappe<br />
empêchait toute régulation, le volume et<br />
la pression faussaient la vitesse du débit. Ktesibios<br />
changea le vase unique de la clepsydre en<br />
un système de trois vases qui formaient l’élément<br />
13
14<br />
de régulation, ces trois pièces étant imbriquées<br />
ingénieusement. Dans le dernier récipient, le plus<br />
important au point de vue contenance, flottait une<br />
pièce de liège qui s’élevait en même temps que<br />
le niveau de l’eau. Une figurine, posée sur le<br />
socle de liège, pointait les heures de la journée<br />
sur une grille appropriée. Du temps de Ktesibios,<br />
le jour était divisé en douze parties depuis le<br />
lever jusqu’au coucher du soleil ; bien entendu, le<br />
jour n’étant pas d’une durée constante suivant le<br />
cycle des saisons, il eut l’idée de régler le débit<br />
de l’eau par une valve ajustable par rapport à<br />
l’époque considérée.<br />
L’horloge anaphorique.<br />
Toujours à la recherche d’une plus grande exactitude<br />
dans le calcul du temps, Vitruve rapporte<br />
l’invention d’une autre horloge à eau dont le mécanisme<br />
présentait un disque de bronze sur lequel<br />
était gravée une carte des cieux. L’écliptique<br />
— cheminement apparent du soleil parmi les<br />
étoiles — était dessinée par un cercle décentré<br />
du disque et dans lequel il y avait 365 petits orifices<br />
; chaque jour, on déplaçait un petit soleil<br />
miniaturisé d’une position afin de corriger l’heure<br />
: c’est de la même manière que Stonehenge<br />
était « réglé ». Les heures étaient, elles, représentées<br />
par une grille de fils de bronze montée<br />
face au disque ; on situait l’heure en repérant la<br />
position du mini-soleil par rapport à la grille. Au<br />
XIX e siècle, un fragment d’une telle horloge fut<br />
trouvé en France et un autre exemplaire près de<br />
Salzbourg.<br />
Le moulin à eau.<br />
Le moulin à eau qui broye le blé, par exemple, a<br />
subi de nombreuses modifications à travers les<br />
âges. Nous en connaissons tous l’image et l’application<br />
; Vitruve, toujours lui, nous décrit une<br />
telle réalisation qui n’a, en rien, à rougir des moulins<br />
modernes. La grande difficulté de la mécanique<br />
du moulin réside dans la transmission de<br />
l’énergie développée par la roue à aubes à la<br />
meule, située, par la force des choses, à un autre<br />
endroit. Les moulins les plus simples étaient du<br />
type à transmission directe, grâce à un arbre de<br />
transmission solidaire à la meule. La force de<br />
l’eau devait alors être très grande comme celle<br />
d’une chute d’eau. Vitruve, quant à lui, décrivit un<br />
système de transmission faisant appel à des tambours<br />
à dents, permettant de transmettre la rotation<br />
de l’arbre horizontal de la roue à aubes à un<br />
autre arbre vertical, celui de la meule. Il semblerait<br />
même qu’un jeu de rouages fut étudié à la<br />
manière d’un mouvement différentiel — nous<br />
verrons plus loin un autre exemple — afin de<br />
ralentir la rotation de la meule. On peut facilement<br />
concevoir la complexité mécanique de l’ensemble,<br />
d’esprit rigoureusement moderne, qui fait<br />
appel à des matériaux lourds, des engrenages<br />
précis et solides et à une élaboration de type<br />
industriel.<br />
Le premier automaton.<br />
Au premier siècle de notre ère, survint un autre<br />
génie, Héron d’Alexandrie. La bibliothèque du<br />
même lieu lui fournit-elle de nombreuses idées,<br />
on peut franchement se le figurer. Inventeur prolixe,<br />
nous lui devons également plusieurs ouvrages.<br />
Connu en son temps sous le nom de Héron<br />
Ktesibios, soit Héron fils de Ktesibios, son patronyme<br />
pose déjà une énigme : en effet, Ktesibios<br />
vécut au troisième siècle avant J.-C. et Héron<br />
sans doute aux environs de 60 de notre ère, ce<br />
qui fut démontré, de Camp le rappelle, par une<br />
description d’éclipse de la lune qui concorde parfaitement<br />
avec l’époque. Peut-être qu’il n’y a là<br />
qu’une vague parenté ou une filiation d’esprit. Il<br />
n’empêche que Héron s’attacha à des travaux<br />
d’ingénieur comprenant « Mécaniques »,<br />
« Pneumatique », « Art de Siège »,<br />
« L’Automatique », un livre de géométrie s’intitulant<br />
« Mesures » et d’optique portant le titre de<br />
« Miroirs ». Les transcriptions d’origine disparurent<br />
pour ne subsister qu’en copies latines ou<br />
arabes. Si Héron, de son propre aveu, n’inventa<br />
pas les procédés qu’il décrit, il ne put s’empêcher<br />
de retranscrire d’anciennes découvertes<br />
« arrangées » à sa manière. Héron était donc le<br />
premier « Japonais » de l’Antiquité. Sans vouloir<br />
me concentrer sur des appareils techniques, je<br />
souhaite plutôt vous fournir quelques renseignements<br />
concernant une machine à sous, à l’apparence<br />
moins sérieuse bien qu’extrêmement malicieuse.<br />
Il s’agissait d’un distributeur d’eau sacrée, automatique<br />
puisqu’il suffisait d’y introduire une piécette<br />
pour recevoir en échange une certaine<br />
quantité d’eau dûment sacralisée : rien n’a changé<br />
en ce bas monde ! Héron utilisa à plein ses<br />
connaissances des combinaisons de vases d’expansion<br />
et siphons pour faire jouer les pressions<br />
et réactions, le résultat, à titre gracieux, étant la<br />
revalorisation des prêtres grecs aux yeux du peuple.<br />
Sprague de Camp remarque, à ce sujet, les<br />
similitudes mécaniques utilisées par Héron et la<br />
légende du vin changé en eau des Noces de<br />
Cana. De même, la description de pompes à<br />
incendie de Héron : il semble exact que Licinius<br />
Crassus, au premier siècle avant J.-C., posséda<br />
une brigade anti-feu, disposant d’un appareil à<br />
deux cylindres, dont une partie était submergée<br />
par le liquide, et qui expulsait l’eau par une lance<br />
orientable. Autant de retombées technologiques<br />
qui s’entremêlèrent, prouvant bien une recherche<br />
active ou un héritage scientifique de la part de<br />
certains érudits.<br />
Les ingénieurs du passé se bornèrent-ils à inventer<br />
ou à monter de toutes pièces des machines<br />
dont l’emploi n’était pas de la plus grande utilité,<br />
ou faut-il suggérer que ces orgues hydrauliques<br />
et autres fontaines automatiques n’étaient plus<br />
que des jeux — habiles certes —, ou des bribes
d’un savoir-faire de loin plus enlevé mais, hélas,<br />
dramatiquement perdu ? Les Vitruve et autres<br />
Héron ne possédaient-ils que les débris épars de<br />
connaissances en physique ou en d’autres sciences<br />
appliquées ; les quelques engrenages ou<br />
leurs descriptions qui nous restent pour fonder<br />
des recherches archéologiques, étaient-ils fabriqués<br />
uniquement pour s’acquérir la faveur des<br />
puissants de l’époque ? On peut se risquer à en<br />
émettre l’hypothèse. Toujours est-il que peu d’objets<br />
ou de travaux sont le fait d’études poussées<br />
et celles-ci prennent du temps sinon de la patience,<br />
j’en prendrai pour exemple l’affaire de la mécanique<br />
d’Anticythère dont nous vous avons entretenu<br />
dans le premier numéro de KADATH.<br />
Retour à Anticythère.<br />
Le Professeur Derek de Solla Price s’était intéressé<br />
à cette mécanique dès 1951. Nous rappelons<br />
que l’objet avait été trouvé par hasard en<br />
1900 à bord d’une épave antique coulée au large<br />
de l’île d’Andikythera (orthographe officielle aujourd’hui),<br />
au sud du Péloponnèse. En 1971, le<br />
Professeur de Solla Price préconisait la radiographie<br />
du système d’engrenages et après reconstitution<br />
partielle, il n’hésita pas à baptiser le mécanisme<br />
du vocable de « computer » : c’était un<br />
ensemble métallique capable de renseigner son<br />
utilisateur sur les mouvements combinés du soleil<br />
et de la lune. Un livre retraçant les recherches et<br />
ses rebondissements vient de paraître — en anglais,<br />
serait-ce la langue véhiculaire en archéologie<br />
? — portant le titre : « Gears From The<br />
Greeks : The Antikythera Mecanism, A Calendar<br />
Computer From Circa 80 BC ». Les études et les<br />
radiographies des quatre fragments de base dont<br />
traitait l’article de KADATH, furent renforcées par<br />
le hasard, encore une fois, de la redécouverte<br />
d’une partie supplémentaire, trouvée dans les<br />
réserves du Musée National d’Athènes (! !). Le<br />
Professeur Ch. Karakolos se chargea de le radiographier<br />
également : ainsi fut révélé le rouage<br />
« D », pièce circulaire dentée quasiment intacte,<br />
qui permit une identification plus fine du nombre<br />
de dents — 64 — et, par voie de conséquence, le<br />
déchiffrage du nombre de dents des autres rouages<br />
en fut d’autant plus accessible. Le dernier<br />
fragment était donc le chaînon manquant qui<br />
donna le coup de pouce nécessaire à de Solla<br />
Price et dont voici les conclusions définitives.<br />
Les rouages de la mécanique, dès identification<br />
des composantes, travaillaient sous forme de<br />
« trains de rouages » autorisant la marche avant<br />
et arrière, ou si vous préférez, l’addition et la<br />
soustraction de données programmables. Au<br />
point de vue purement mécanique, les diverses<br />
manœuvres étaient optimisées par un véritable<br />
Agencement des quatre fragments principaux (et 19 fragment D) de la mécanique d’Anticythère.<br />
15
16<br />
différentiel qui n’a rien à envier à ceux qu’on trouve<br />
actuellement dans les ponts arrières de nos<br />
voitures. C’est aussi là que de Solla Price put<br />
constater le réel savoir des constructeurs du calculateur<br />
: « Le différentiel est certainement la<br />
particularité mécanique la plus spectaculaire de<br />
l’appareil d’Anticythère, à cause de sa sophistication<br />
extrême et l’absence de tout précédent historique<br />
». En effet, ce mouvement différentiel dont<br />
résulte la combinaison de deux mouvements<br />
produits par une même force — ces deux mouvements<br />
étant la somme et la différence — est de<br />
loin plus évolué que celui que nous avons approché<br />
avec Vitruve. Cela dit et grâce aux trains<br />
d’engrenages et au différentiel, il s’avère que le<br />
calculateur offre deux « raisons » ou proportions,<br />
l’une annuelle et l’autre approximativement mensuelle.<br />
Radiographie du fragment D, et le principe du<br />
différentiel.<br />
De Solla Price ajoute : « Les deux choix astronomiques<br />
évidents et auxquels on ne peut se dérober,<br />
seraient associés avec le fait que le mouvement<br />
synodique de la lune — le cycle des phases<br />
de la nouvelle lune à la pleine lune — est la différence<br />
entre les mouvements apparents du soleil<br />
et de la lune sur l’arrière-plan des étoiles fixes.<br />
Le soleil semble tourner à travers les étoiles du<br />
zodiaque en environ 365 jours tandis que la lune<br />
change de place en une période d’environ 27 1l3<br />
jours et change de phases durant son cycle en<br />
environ 29 1l2 jours ». Il est, par ailleurs, confirmé<br />
que les divers rouages introduisent des nombres<br />
compatibles avec le calendrier grec du cycle<br />
de Méton dans lequel 19 années solaires correspondent<br />
exactement à 235 lunaisons ou encore à<br />
254 (235 + 19) révolutions sidérales de la lune ;<br />
c’est le même cycle dit de Méton qui est utilisé à<br />
Stonehenge !<br />
De Sella Price dit encore : « L’appareil contient<br />
des rouages qui correspondent très bien avec les<br />
nombres premiers de 19 et 127 qui sont utilisés<br />
dans le cycle métonique ». Ce qui se vérifie par :<br />
64<br />
38<br />
x<br />
48<br />
24<br />
x<br />
127<br />
32<br />
254<br />
d’où le différentiel est nourri par 254 révolutions<br />
d’un rouage et 19 révolutions inverses d’un autre<br />
rouage, cela dès que l’on tourne la roue principale<br />
de 19 tours, ce qui donne pour résultat 235<br />
demi-révolutions pour le différentiel complet et<br />
tous les rouages y attenant. Les nombres repris<br />
ci-dessus s’accordent aux dents des rouages.<br />
D’autres implications du différentiel sont offertes<br />
aux lecteurs du livre de de Solla Price. Ce dernier<br />
s’attarde aussi aux considérations touchant l’inventeur<br />
d’une telle mécanique, nous n’en retirerons<br />
qu’une seule ligne : « Pour Anticythère, je<br />
pense qu’il est nécessaire d’évoquer l’existence<br />
d’un génie ».<br />
Ainsi, les Anciens nous proposent encore maintes<br />
surprises — surprises car, après tout, nous<br />
ne possédons encore que très peu de données<br />
concernant leur savoir. Dieu seul sait ce qui dort<br />
dans les musées du monde sinon au fond de<br />
l’eau, aussi seule l’information la plus largement<br />
répandue, peut faire prendre conscience aux<br />
chercheurs patentés que les plus belles découvertes<br />
restent à être menées à bien, ceci à titre<br />
d’émulation. Je crois, quant à moi, que les traductions<br />
françaises de livres tels ceux de Sprague<br />
de Camp et de de Sella Price contribueront<br />
efficacement à divulguer les énigmes archéologiques.<br />
Qu’en pensent Messieurs les éditeurs et<br />
autres directeurs de collections ?<br />
ROBERT DEHON<br />
Sources<br />
● Derek de Solla Price : « Gears From The<br />
Greeks ». Science History Publications, 156<br />
Fifth Av., New York, NY 10010.<br />
● Voir également : « La Mécanique d’Anticythère<br />
» in KADATH n° 1, et concernant le<br />
cycle métonique « L’Affaire de Stonehenge »<br />
in KADATH n° 4.<br />
● Lyon Sprague de Camp : « The ancient engineers<br />
». Ballantine books n° 23783, New York<br />
1974.<br />
=<br />
19
ARCHEOLOGIE PARAL<strong>LE</strong><strong>LE</strong><br />
JADE ET IMMORTALITE<br />
DANS L’EMPIRE <strong>DU</strong> MILIEU<br />
Parmi les découvertes archéologiques faites dans<br />
le monde entier, celles en provenance de la République<br />
Populaire de Chine depuis ces vingt dernières<br />
années, sont certainement les plus importantes,<br />
tant par leur qualité que leur quantité. Elles<br />
éclairent d’un jour nouveau l’histoire ancienne de<br />
cette grande culture chinoise et témoignent d’un<br />
raffinement extrême, d’un art somptueux et nous<br />
enrichissent des connaissances scientifiques des<br />
hommes de ces époques très reculées et principalement<br />
sous la toute puissante dynastie des Han<br />
(voir chronologie de la Chine dans KADATH n° 2).<br />
Pour la plus grande joie des amoureux de l’histoire<br />
de l’Empire du Milieu, deux grandes expositions<br />
de ces trésors furent déléguées aux quatre coins<br />
du monde. L’une s’arrêta à Paris en 1973, puis<br />
s’en alla pour Londres, Vienne, Stockholm, Toronto<br />
et Washington. L’autre s’en fut à Tokyo, Bucarest,<br />
Belgrade, Mexico, Amsterdam et enfin, à<br />
Bruxelles où nous pûmes la voir de la mi-février au<br />
début d’avril 1975. Vous êtes impardonnable si<br />
vous l’avez ratée... Chacune de ces deux expositions<br />
comportait une pièce maîtresse spectaculaire,<br />
qui ne manqua pas d’émerveiller et d’intriguer<br />
à la fois les visiteurs : le linceul de jade de la Princesse<br />
Teou Wan (au Petit Palais, à Paris) et celui<br />
d’un haut dignitaire également de la dynastie des<br />
Han (au Palais des Beaux-Arts, à Bruxelles). Ce<br />
curieux linceul épouse parfaitement la forme du<br />
corps, l’habillant ainsi complètement de milliers de<br />
petites plaquettes de jade biseautées, assemblées<br />
par des fils précieux. On lui donne également le<br />
nom de boîte, cotte ou robe de jade.<br />
C’est en juillet et en août 1968 qu’eurent lieu les<br />
fouilles qui conduisirent à la découverte de deux<br />
tombes des Han de l’ouest, dans des grottes aménagées<br />
des monts Lingchan, à Mantcheng, dans<br />
la province du Hopei. Les deux tombeaux sont<br />
formés d’une salle principale, de deux salles auxiliaires<br />
situées au nord et au sud, et d’une salle<br />
postérieure. Elles sont réunies entre elles par des<br />
couloirs qui donnent à chacune des tombes la<br />
forme générale d’une sorte de croix. La première<br />
appartient à Lieou Cheng, frère aîné de l’Empereur<br />
Wou, prince Tsing de Tchongchan, qui mourut<br />
en 113 avant J.-C. La seconde est le sépulcre<br />
de sa femme Teou Wan. Leur volume est considérable<br />
: respectivement 2700 et 3000 mètres<br />
cubes. Elles ont livré plus de 2800 objets funéraires<br />
parmi lesquels des chars, une douzaine de<br />
chevaux, des bronzes, des objets en or, en argent,<br />
en jade, en verre, des poteries, des laques et des<br />
soieries. Et bien entendu les linceuls de jade.<br />
Ceux-ci étaient réservés aux empereurs des Han<br />
et aux nobles de très haut rang. Le linceul de<br />
Lieou Cheng comporte 2690 plaquettes de jade,<br />
pour la plupart rectangulaires, d’une épaisseur<br />
moyenne de trois millimètres, percées chacune de<br />
quatre petits trous et assemblées par 1110 grammes<br />
de fils d’or de grande qualité, qui pour certains<br />
comportent douze brins d’or très fins, souples<br />
et solides. Celui de Teou Wan possède une<br />
sorte de gilet formé de plaques rectangulaires plus<br />
grandes, maintenues par des fils de soie, mais les<br />
autres parties du linceul sont presque identiques<br />
au premier. Au total, 2156 plaquettes et 703 grammes<br />
de fils d’or. Les défunts tenaient dans les<br />
mains un croissant de jade, et leur tête reposait<br />
sur un oreiller de bronze et de jade orné de part et<br />
d’autre d’une tête de dragon en or. Autour des<br />
corps étaient disposés des objets rituels, dont les<br />
disques pî en jade (voir le rôle de ceux-ci dans<br />
KADATH n° 13). Le linceul de Lieou Cheng resta<br />
pour sa part à Pékin. Celui que nous vîmes à<br />
Bruxelles fut exhumé plus tard, en 1970, d’un tombeau<br />
proche de la ville de Siutcheou (ou Hsüchou)<br />
dans la province du Kiang-sou. Le défunt<br />
n’est pas encore identifié ; on sait seulement qu’il<br />
s’agit d’un haut personnage (le linceul le prouve),<br />
peut-être un des descendants de l’Empereur<br />
Ming-ti, et que le tombeau date de Lieou-kong, roi<br />
de Peng-tcheng sous les Han de l’est. Le rang du<br />
17
18<br />
Le linceul de Teou Wan à Paris. Notez le gilet formé de plaques de jades beaucoup plus grandes, et<br />
réunies par des fils de soie.<br />
dignitaire devrait être en principe moins élevé que<br />
celui des deux précédents, car les 2600 et quelques<br />
plaquettes de jade sont assemblées, non<br />
plus avec du fil d’or, mais avec 800 grammes de<br />
fils d’argent. Un texte ancien, le Heou Hanchou,<br />
régit la sorte de fil qu’il fallait employer et qui différait<br />
dans la hiérarchie selon le degré de noblesse.<br />
En fait, l’or n’était réservé qu’à l’empereur ; Lieou-<br />
Cheng et Teou Wan furent donc privilégiés et il fut<br />
certainement tenu compte de leur étroite parenté<br />
avec l’Empereur Wou. L’Homme de jade de la<br />
tombe de Siu-tcheou devrait être un roi. Des annales<br />
disent également que des fils de cuivre étaient<br />
utilisés pour des nobles et des hauts fonctionnaires.<br />
Les archéologues connaissaient donc ces<br />
linceuls par des documents (Thao Hung-Ching en<br />
parlait déjà au cinquième siècle de notre ère) mais<br />
avant 1968, personne ne les avait jamais vus. Il y<br />
a beaucoup de chances pour qu’on en retrouve<br />
d’autres, si ce n’est déjà fait.<br />
Les linceuls témoignent d’une grande habileté<br />
artisanale et d’une technicité élevée : en effet, les<br />
plaquettes de jade ont été découpées à l’aide d’une<br />
scie extrêmement fine, comme le prouve l’intervalle<br />
entre les traits de l’outil, qui n’excède pas 0,3<br />
millimètre. Certains des petits trous situés aux<br />
extrémités des plaquettes ont à peine un millimètre<br />
de diamètre et ont été percés à l’aide d’un foret<br />
tubulaire au sable. Ceci laisse songeur quant au<br />
temps qu’il a fallu pour confectionner un tel vêtement.<br />
On estime qu’un artisan expérimenté aurait<br />
mis dix années... Les trois linceuls se décomposent<br />
en une douzaine d’éléments qui furent ensuite<br />
assemblés autour de la dépouille : le crâne, un<br />
masque, des manches, des gants, le buste, les<br />
jambes, les souliers etc... Au sommet du crâne,<br />
les plaquettes aboutissent à un petit disque percé<br />
qui n’est certainement pas là par hasard car c’est<br />
un parfait petit disque pî de quelques centimètres<br />
de diamètre. La couleur nous fait hélas cruellement<br />
défaut pour vous faire apprécier la grande<br />
beauté et la majesté de ces pièces resplendissant<br />
des teintes fascinantes du précieux minerai.<br />
Les Voies de l’Immortalité.<br />
Si tant de richesses furent utilisées pour les si<br />
nobles défunts, la raison n’est pas seulement le<br />
goût du faste, mais un souci, ô combien plus important,<br />
qui semble avoir été une grande préoccupation<br />
sous les Han : la recherche de l’immortalité<br />
; et dans ce vaniteux défi, le rôle du jade est<br />
primordial. Bien avant les Han déjà, sous les<br />
Chang, le jade remplit une importante fonction. Il<br />
faut avant tout se souvenir — alors qu’en Occident<br />
le mobilier funéraire évoque un sentiment de profonde<br />
tristesse — que la mort n’apparaît pas de la<br />
même manière chez les Chinois. Bien sûr, ils pleuraient<br />
la perte de l’être cher, mais son âme s’en<br />
irait dans l’au-delà à condition que fussent observés<br />
des préparatifs funéraires précis. Il y avait<br />
donc une foi en la résurrection, extension de la vie<br />
après la mort, et le fervent espoir que celui ou<br />
celle qui s’en allait pourrait négocier avec les<br />
dieux, en faveur de ceux qui demeuraient encore<br />
sur terre. Un minutieux et complexe rituel se développa<br />
donc dans le respect du culte des ancêtres<br />
afin qu’ils puissent intervenir de la manière souhaitée.<br />
La tombe était dès lors abondamment remplie<br />
de nourriture, de vin, d’objets précieux, tous les<br />
biens que le disparu aurait appréciés de son vivant.<br />
Le jade était en Chine, dans les temps néolithiques<br />
(avant environ — 1700) la pierre la plus<br />
dure ; sans doute était-ce cette particularité, conjuguée<br />
avec la rareté et les fascinantes colorations
glauques, qui en firent une matière précieuse.<br />
Sous les Chang, elle était utilisée pour les disques<br />
pî (les plus anciens datent de cette période) : un<br />
matériau noble pour un objet sacré dont le symbolisme<br />
deviendra de plus en plus important au fur et<br />
à mesure que son rôle primordial se perdra. Selon<br />
l’archéologue Chêng’ Tê-k’un, c’est aux environs<br />
de cet âge qu’apparaît pour la première fois l’utilisation<br />
funéraire des jades : de petites amulettes<br />
sont cousues sur les vêtements des défunts et<br />
d’autres sont placées dans les orifices naturels du<br />
corps. Elles sont en rapport avec l’énergie vitale<br />
dérivée de l’élément Yang et doivent préserver la<br />
dépouille de la putréfaction. A tout moment, l’âme<br />
peut alors retrouver un corps intact, ainsi qu’il est<br />
écrit dans les livres du Cheu li et du Li ki, qui expliquent<br />
ces principes taoïstes. On plaçait de préférence,<br />
sur la langue, une petite cigale de jade, (1)<br />
dont le symbolisme est la chrysalide se métamorphosant<br />
en cigale, après un long séjour souterrain.<br />
Telle que celle-ci, l’âme ressuscite après le trépas.<br />
Dans le but de parfaire cette protection, on conçut<br />
plus tard le linceul de jade, protégeant tout le<br />
corps assimilé à la chrysalide. Egalement dans<br />
ces cas-là, des pièces de jade fermaient en plus<br />
les orifices de la tête, sous le masque, car on était<br />
persuadé que l’extrême durabilité du jade allait<br />
produire sur le corps un effet semblable. Mais on<br />
est maintenant en droit de se demander si le choix<br />
de cette matière n’était pas, outre ces caractéristiques,<br />
fonction d’un autre facteur...<br />
Il a souvent été retrouvé, adhérant aux objets de<br />
jade, en même temps que la terre du tombeau,<br />
des traces d’un pigment rougeâtre qui se révéla<br />
être du cinabre, sulfure naturel de mercure (2).<br />
Souvent aussi, les cadavres en étaient euxmêmes<br />
recouverts. La coutume remonte au fond<br />
des âges, puisqu’on la retrouve déjà dans les rites<br />
funéraires des hommes de Chou-k’ou-tien, au<br />
paléolithique. Elle est présente chez les peuples<br />
de la Sibérie orientale (5000 à 2000 avant J.-C.) et<br />
dans les tombes de la culture néolithique de Panpo<br />
(4200 à 3600 avant J.-C.). Mais laissons là<br />
pour l’instant le sulfure de mercure, nous y reviendrons.<br />
(1) Cette coutume est connue chez d’autres peuples<br />
anciens tels que les Romains, les Grecs,<br />
les Hindous, qui plaçaient un petit objet de<br />
valeur sur la langue des défunts. Dans l’île de<br />
Bâli, par exemple, il s’agissait d’un anneau<br />
d’or enchâssé d’un rubis. Mais ce qui est certainement<br />
moins connu c’est que parmi certains<br />
peuples amérindiens, il en est qui plaçaient<br />
eux aussi une petite cigale de jade<br />
dans la bouche de leurs morts...<br />
(2) De plus en plus curieux : le même cas se présente<br />
pour des amulettes de jade en Mésoamérique...<br />
Les jades.<br />
Sous cette dénomination générale sont en fait<br />
regroupés plusieurs minéraux de nature différente<br />
parmi lesquels il faut distinguer les vrais jades,<br />
tels que le jade (ou néphrite) et la jadéite, et le<br />
faux jade telle que la serpentine. Ces trois roches<br />
appartiennent cependant au même groupe dit des<br />
asbestes.<br />
Le jade, de la famille des amphiboles, variété de<br />
roches actinotes, est un silicate hydraté de calcium<br />
et de magnésium. Il contient également du<br />
fer qui lui donne sa couleur verte. Le jade est un<br />
minéral huileux. Densité 3 à 3,3. La jadéite, de la<br />
famille des pyroxènes, est un amphibole déshydraté.<br />
C’est un silicate d’aluminium et de sodium.<br />
Au contraire du jade, c’est un minéral vitreux.<br />
Densité 3,3 à 3,5. La serpentine est un silicate<br />
hydraté de magnésium avec parfois un peu de fer<br />
et de nickel. Sa couleur verte en fait une bonne<br />
imitation du jade. Densité 2,2 à 2,6. Elle est donc<br />
moins dure, par conséquent plus facile à tailler.<br />
Polie, elle se vendait jadis sous le nom de verre<br />
antique.<br />
Il existe d’autres roches plus ou moins voisines,<br />
fréquemment prises pour du jade, telles que la<br />
stéatite (silicate hydraté de magnésium) peu dure,<br />
facilement taillée au couteau, et la chloromélanite<br />
(chlorosilicate de calcium, de fer et de titane) généralement<br />
noire mais parfois vert-foncé, qui a<br />
fourni beaucoup de haches polies. Notons encore<br />
la grossularite, faux jade d’Afrique du Sud, d’une<br />
teinte proche de celle du jade.<br />
Le jade étant une roche métamorphique, il n’est<br />
pas impossible qu’il se trouve dans la nature sous<br />
forme de masses de néphrite qui seraient souples<br />
et auraient l’aspect d’une pâte ; ce qui rendrait<br />
vraisemblables les récits alchimiques où il est<br />
question de pâte de jade destinée à être absorbée.<br />
Les sources de jade furent très longtemps discutées,<br />
certains attribuant même aux objets en jade<br />
trouvés dans des sites mégalithiques bretons une<br />
origine asiatique. Le jade chinois provenait, déjà à<br />
l’époque des Chang, des rivières et des montagnes<br />
du Khotan et du Yarkland (province de Sinkiang).<br />
Des textes anciens traitent du commerce<br />
qui s’y déroulait, et des voyageurs décrivirent des<br />
exploitations de jade encore en activité au XIX e<br />
siècle. Quant à la jadéite qui ne serait apparue en<br />
Chine qu’au XVIII e siècle, elle proviendrait de<br />
Haute Birmanie. Du jade à l’état brut fut également<br />
découvert sur les bords du lac Baïkal et était<br />
déjà utilisé au troisième millénaire comme le prouvent<br />
les haches de la culture de Serovo. La station<br />
suisse de Moosseedorf, qui livra des objets<br />
en néphrite, en jadéite et en chloromélanite, amena<br />
la découverte de ces minerais dans les Alpes,<br />
et d’autres gisements français expliquent à présent<br />
les haches polies de la vallée du Petit-Morin<br />
et les anneaux-disques et les bijoux de Bretagne.<br />
Source : Pierre Méreaux-Tanguy.<br />
19
20<br />
Qui dit recherche de l’immortalité, songe pierre<br />
philosophale, élixir de longue vie, alchimie... L’alchimie<br />
: le mot fait encore sourire et évoque irrésistiblement<br />
des charlatans ou des fous. Certes, il<br />
y en eut. Cependant, sans les alchimistes, sans<br />
les Geber, Al Razi, Avicennes, Johan Helvetius,<br />
Roger Bacon, Paracelse, Albert le Grand et autres<br />
Nicolas Flamel, nous ne connaîtrions pas la<br />
chimie. Ces pauvres fous étaient à la quête de la<br />
pierre philosophale dont le pouvoir serait de<br />
transmuter les métaux et de fournir l’élixir de longue<br />
vie. Il n’est pas question ici de prouver ou<br />
d’infirmer s’ils y ont réussi, mais leur rôle dans<br />
l’histoire des sciences est capital. Même un pape,<br />
Jean XXII, s’adonna à cette science occulte,<br />
mais s’empressa en 1317 de l’interdire. On retrouve<br />
l’alchimie dans d’autres sociétés anciennes<br />
telles qu’aux Indes, en Egypte ainsi qu’à<br />
Rome et il est curieux de voir que les éléments<br />
primaires de cet art étaient les mêmes : le soufre<br />
et le mercure... Elle fut connue et pratiquée très<br />
tôt en Chine, ainsi que nous l’apprennent les<br />
textes anciens. En 175 avant notre ère par exemple,<br />
une loi fut promulguée contre la fabrication<br />
de l’or par des méthodes alchimiques. Mais alors<br />
que cette recherche de l’or alchimique était sévèrement<br />
punie, il semble, toujours suivant les chroniqueurs,<br />
que la quête de l’élixir de longue vie<br />
connut un vif succès et fut même largement encouragée<br />
en Chine. Je sens pointer ici le regard<br />
réprobateur de plus d’un honnête rationaliste se<br />
demandant sur quelle pente hasardeuse je vais<br />
l’entraîner en puisant des renseignements dans<br />
des textes fort anciens abordant un pareil sujet.<br />
Le penchant des Chinois pour le merveilleux est<br />
une chose bien connue et tout ce qu’ils ont écrit<br />
n’est bien sûr pas à prendre au pied de la lettre.<br />
Conscient de cela et nanti de cet avertissement<br />
en guise de protection, je vous replonge donc<br />
dans les cornues et les alambics.<br />
Thao Hung Ching écrit dans un texte du cinquième<br />
siècle de notre ère : ... « Lorsqu’un tombeau<br />
d’une époque ancienne est ouvert, et que le<br />
corps est dans un état tel qu’il semble vivant, on<br />
retrouve partout autour de lui, et à l’intérieur, une<br />
grande quantité d’or et de jade. Il est un usage<br />
établi que sous la Maison des Han chaque prince<br />
ou grand vassal était enterré avec des perles (de<br />
jade) et des boîtes de jade afin de prévenir la<br />
putréfaction »... Ce témoignage mentionne donc<br />
la présence d’un linceul de jade et atteste aussi<br />
du parfait état du cadavre, au minimum près de<br />
deux siècles après son inhumation (puisque la<br />
Maison des Han régna jusqu’en 220 après J.-C.).<br />
Ce ne fut plus le cas quinze siècles plus tard<br />
pour les corps de Lieou Cheng, Teou Wan et<br />
celui du tombeau de Siu-tcheou, dont il ne subsistait<br />
plus rien dans les linceuls de jade affaissés<br />
qui gisaient sur le sol lors de leur découverte.<br />
Sans aucun doute les défunts n’étaient-ils pas<br />
assez purs, car la fragile chrysalide s’en était<br />
retournée en poussière... Vaine précaution donc,<br />
que la boîte de jade ? Quinze siècles après, certainement.<br />
Mais à l’époque où Thao Hung Ching<br />
écrivit le texte ci-dessus, le temps assez long qui<br />
s’était écoulé depuis l’ensevelissement pouvait<br />
donner naissance à l’idée que le corps était protégé<br />
de la putréfaction pour l’éternité. De toute<br />
manière, ceux qui établirent ces pratiques funéraires,<br />
et les heureux qui en bénéficièrent, ne<br />
seraient plus là, après « une éternité » pour vérifier<br />
le bien-fondé de la méthode. Ce pouvait donc<br />
n’être qu’une croyance naïve que seul un haut<br />
degré de mysticisme peut justifier. En effet, pour<br />
les taoïstes, l’ordre de la nature réside dans le<br />
Tao dont la manifestation est l’éternel flux et reflux<br />
de deux pôles d’énergie, deux principes naturels<br />
fondamentaux : le Yin et le Yang. Le but<br />
suprême de l’adepte était d’acquérir la Sainteté<br />
et l’Immortalité. Vaste programme qui ne pouvait<br />
lors de la mise en application effective qu’aboutir<br />
aux pratiques les plus curieuses : outre la méditation<br />
visionnaire, les techniques respiratoires et<br />
la transe cataleptique, le taoïste en arriva à se<br />
livrer à d’étranges expériences alimentaires basées<br />
sur des substances des plus inattendues,<br />
telles que notamment, le jade et le cinabre...<br />
La Véritable Essence<br />
de la Sphère Obscure.<br />
Comment absorber du jade ? Un alchimiste du<br />
quatrième siècle, Koh Hung nous renseigne : ...<br />
« La pâte de jade se forme au sein des montagnes<br />
qui recèlent du jade. On ne la trouve qu’en<br />
des lieux escarpés et dangereux. Le jus-de-jade<br />
qui s’écoule de ces montagnes se coagule en<br />
une sorte de pâte après une période de quelques<br />
10.000 années. Cette pâte est fraîche et limpide<br />
comme le cristal. Si vous en trouvez, écrasez-la<br />
et mélangez-la avec du jus d’herbes dépourvues<br />
d’essence. Elle se liquéfiera immédiatement.<br />
Buvez-en alors une pinte et vous vivrez mille<br />
ans... Celui qui absorbe le jade vivra aussi longtemps<br />
que durera le jade ; celui qui absorbe de<br />
l’or vivra aussi longtemps que durera l’or ; celui<br />
qui absorbe la Véritable Essence de la Sphère<br />
Obscure (un des noms du jade) jouira d’une existence<br />
éternelle...».<br />
Un autre récit merveilleux est relaté dans les<br />
Livres de la Maison des Wei et dans l’Histoire du<br />
Nord de l’Empire (période des Trois Royaumes).<br />
Il concerne un homme d’Etat, Li Yü : celui-ci se<br />
livrait avec ardeur à l’absorption de jade. Un jour,<br />
il en découvrit dans un champ une centaine de<br />
morceaux. Il les écrasa, en distribua une partie et<br />
absorba le restant dans le courant de l’année.<br />
Après quoi il mourut ! Mais suite à d’autres causes,<br />
s’empresse d’ajouter l’auteur ! Son corps<br />
n’était pas encore mis en bière après le quatrième<br />
jour qui suivit son décès, et bien que cela se<br />
passait dans le septième mois de l’année, le plus
chaud, il n’avait pas le teint propre au cadavre<br />
(3). Son épouse lui plaça deux perles de jade<br />
dans la bouche et aucune odeur de putréfaction<br />
n’émanait de sa gorge... Et l’auteur de conclure<br />
avec prudence : « Finalement, le jade ne peut<br />
véritablement préserver la vie du trépas, mais par<br />
contre, il peut protéger le corps de la putréfaction<br />
». Ce qui n’est déjà pas si mal.<br />
D’anciens traités de botanique médicinale précisent<br />
que le sage qui sent venir la mort, absorbe<br />
cinq livres d’une solution à base de jade, ce qui a<br />
pour effet durant les trois années qui suivent la<br />
mort, que le teint du défunt ne s’altère pas...<br />
Trois années me paraissent beaucoup plus raisonnable<br />
que l’éternité, et un pareil laps de<br />
temps permet des expérimentations et des<br />
contrôles. On retrouve dans la pharmacopée<br />
chinoise des produits surprenants, parfois extrêmement<br />
dangereux, tels que des composés métalliques<br />
dérivés de l’arsenic, du mercure, du<br />
cuivre, de l’étain, du plomb, du nickel et même de<br />
l’antimoine. Une de leurs fréquentes utilisations<br />
était la préparation d’aphrodisiaques mais aussi<br />
des remèdes contre beaucoup de maux et de<br />
maladies. Leur expérimentation envoya plus d’un<br />
aide-alchimiste en un lieu d’où il ne put jamais<br />
revenir pour rendre compte des résultats ! Une<br />
chose est certaine, et ceci est mentionné dans un<br />
des volumes de l’œuvre magistrale du sinologue<br />
Joseph Needham : on connaît des exemples de<br />
corps demeurés imputrescibles. Certains furent<br />
laqués et vénérés dans des temples, même au<br />
Japon, jusqu’au début de notre siècle. Il y a aussi<br />
l’exemple de Sun Ssu-Mo, décédé en 682 de<br />
notre ère, alors presque centenaire ; aucun signe<br />
d’altération de la dépouille ne fut visible durant<br />
plusieurs semaines. Après plus d’un mois, le<br />
corps intact fut placé dans le cercueil. Ce vénérable<br />
homme était alchimiste, physicien, pharmacien<br />
aussi, et absorba certainement un des élixirs<br />
à base de mercure ou d’arsenic dont il traita dans<br />
ses nombreux ouvrages. Ceci rappelle les Archives<br />
Historiques Shih Chi (premier siècle avant<br />
notre ère) où il est dit que le cinabre pouvait être<br />
transmuté en or et servait en outre à la fabrication<br />
de l’élixir de jouvence...<br />
(3) On ne peut bien sûr attribuer avec certitude ce<br />
prodige au seul effet du jade. Le texte le laisse<br />
évidemment supposer, mais il faut signaler que<br />
l’on sait (dans les textes du Li ki, par exemple)<br />
que dans l’attente de la mise au tombeau, les<br />
corps étaient — dans certains cas — conservés<br />
dans des coffres remplis de glace.<br />
Le jade et le cinabre conduisent-ils vraiment à<br />
l’immortalité ? Certes pas, si l’on prend les textes<br />
pour argent comptant. Mais souvenons-nous de<br />
la prudente conclusion de l’auteur du texte<br />
concernant Li Yü, vu plus haut. Voilà certainement<br />
le sens véritable qu’il convient d’accorder<br />
aux vertus de ces substances : « l’immortalité »<br />
de la dépouille après la mort... Bien sûr, dans le<br />
cas des linceuls de jade, l’expérience n’est pas<br />
concluante, bien qu’il semble qu’elle l’ait été deux<br />
siècles après la mise au tombeau, du temps de<br />
Thao Hung Ching. Par contre, et dans cette même<br />
optique, dans le cas de l’emploi du cinabre,<br />
elle apparaît aujourd’hui concluante, car outre les<br />
textes anciens que l’on ne croit qu’avec une légitime<br />
réserve, deux extraordinaires découvertes<br />
nous apportent la preuve qu’il faudrait considérer<br />
avec un grand intérêt les écrits réputés merveilleux<br />
et parfois fantaisistes des alchimistes.<br />
Le linceul de jade de Lieou Cheng, avec un petit<br />
disque pî au sommet de la tête.<br />
La dame de Tai.<br />
A Mawangtouei, dans la banlieue de Tchangcha<br />
(province du Honan) une découverte, jusqu’à l’an<br />
dernier unique au monde, fut faite au printemps<br />
1972. Du fond d’un tombeau, désormais désigné<br />
sous le nom de tombe Han n° 1, fut ramené le<br />
corps en parfait état de conservation d’une femme<br />
morte il y a 2100 ans... Cet événement fit<br />
bien entendu grand bruit dans le monde de l’archéologie.<br />
On connaissait les corps des sacrifiés<br />
21
22<br />
des tourbières de Tolund dans le Jutland, et qui<br />
datent grosso modo de la même époque, mais<br />
c’est pur accident que ceux-ci traversèrent les<br />
temps et nous parvinrent en si bon état, tannés<br />
par la tourbe. Quant aux momies égyptiennes,<br />
les corps ne sont pas intacts : ils étaient en effet,<br />
dans la période archaïque, démembrés, éviscérés<br />
puis embaumés. On « remontait » ensuite le<br />
plus parfaitement possible le défunt, en empruntant<br />
quelquefois un os ou l’autre au voisin. Plus<br />
tard succéda la momification, moins répugnante,<br />
mais après que le cadavre fut traité au natron et<br />
au bitume, il était cependant encore vidé de ses<br />
viscères. Ce qui fait l’intérêt et l’innovation de<br />
Manwangtouei, est d’une part l’exceptionnel état<br />
d’un corps complet et d’autre part que ce prodige<br />
résulte d’une volonté. La structure même du tombeau<br />
en est une des preuves : sous un tertre de<br />
terre de 20 mètres de haut et 50 mètres de diamètre,<br />
se trouve une fosse d’environ 16 mètres<br />
de profondeur de section rectangulaire, orientée<br />
suivant un axe nord-sud (voir ce qu’il est dit au<br />
sujet de ce type de sépulcre dans KADATH n° 2).<br />
Au fond du puits, un lourd sarcophage de structure<br />
complexe, formé de plusieurs compartiments<br />
de bois, minutieusement assemblés par des tenons<br />
et des mortaises, contenait outre des trésors<br />
inestimables, trois cercueils somptueux emboîtés<br />
les uns dans les autres.<br />
Sur le couvercle du dernier était étalée une re-<br />
marquable bannière de soie peinte, à laquelle il<br />
sera fait allusion plus loin. Toutes les précautions<br />
avaient été prises pour garantir une durée maximum<br />
au corps et au mobilier : cinq tonnes de<br />
charbon de bois entouraient le vaste sarcophage,<br />
en une couche de 30 à 40 cm d’épaisseur. Cette<br />
première enveloppe était elle-même protégée par<br />
une couche d’argile blanche de 60 à 130 cm. Audessus,<br />
près de douze mètres de terre sablonneuse.<br />
Dans le premier cercueil intérieur gisait le<br />
corps de la défunte, allongé sur le dos, tête au<br />
nord, enveloppé dans vingt couches d’étoffes de<br />
soie, ficelé par neuf rubans.<br />
Une autopsie 21 siècles plus tard.<br />
De nombreux renseignements anatomiques, histologiques<br />
et biochimiques ont été recueillis par<br />
une équipe de spécialistes de l’Institut de Médecine<br />
de Pékin, de Changai, du Hounan et de<br />
Kouangtcheou. Avant la dissection, le cadavre fut<br />
soumis à un examen externe et radiologique (les<br />
résultats détaillés de l’autopsie, trop longs pour<br />
être exposés ici, sont publiés dans un article de<br />
la revue « La Chine en Construction »). Le cadavre<br />
mesure 1 m 54 et pèse 34 kilos ; la peau de<br />
couleur jaune-brun est moite et la plupart des<br />
tissus mous conservent une entière élasticité (en<br />
injectant de l’antiseptique dans le corps, on remarqua<br />
que le tissu se gonfla au passage du<br />
liquide qui se dispersa au fur et à mesure). L’exa-
men radiographique montre un squelette intact,<br />
où même les os du nez et les sésamoïdes peuvent<br />
être nettement observés. La dissection des<br />
viscères permet de constater la bonne conservation<br />
de certaines parties délicates. Il fut même<br />
retrouvé dans l’œsophage, l’estomac et les intestins,<br />
des pépins de melon. On suppose donc que<br />
le décès est survenu brutalement. Aucune blessure<br />
ne témoigne cependant d’une mort violente.<br />
Les spécialistes pensent que la mort est due à un<br />
infarctus du myocarde ou à une grave arythmie<br />
conséquence de son athérosclérose coronaire.<br />
Six sachets de soie, trouvés dans la tombe,<br />
contiennent des matières médicinales telles que<br />
graines de xanthoxylum, boutons de magnolia,<br />
écorce de canelle, etc... Ces médicaments, mentionnés<br />
dans un traité médical vieux de plus de<br />
2000 ans, seraient utilisés pour le traitement de<br />
certaines affections du cœur qui rappellent de<br />
par les symptômes décrits, ce que nous nommons<br />
aujourd’hui l’athérosclérose coronaire. La<br />
mort est survenue à l’âge d’environ 50 ans. Grâce<br />
à des inscriptions à l’encre sur des objets funéraires<br />
et à la présence de sceaux d’argile marqués<br />
« Intendant de la Maison du Marquis de<br />
Tai », la défunte put être identifiée. Il s’agit de<br />
l’épouse de Li Tsang, chancelier du prince de<br />
Tchangcha, premier Marquis de Tai.<br />
Vers la fin de 1973, deux autres tombes voisines<br />
furent ouvertes : celle de Li Tsang lui-même, et<br />
celle de son fils. Tous deux sont décédés en 168<br />
avant J.-C. Ces deux derniers tombeaux sont<br />
construits sur le même schéma que celui de la<br />
dame de Tai et de plus, les sarcophages sont<br />
identiques. On s’attend donc à trouver là aussi,<br />
peut-être, des cadavres parfaitement bien<br />
conservés, mais hélas, rien n’est dit à ce sujet<br />
dans les publications chinoises. Du moins pour<br />
l’instant. Heureusement, une toute récente communication<br />
fit part de l’exhumation d’une deuxième<br />
dépouille absolument intacte, dans une autre<br />
fosse des Han de l’ouest, dans les monts Fenghouang,<br />
non loin de Kinan (province de Hopei).<br />
Le corps d’un homme d’une cinquantaine d’années,<br />
enterré en 167 avant J.-C., présente les<br />
mêmes caractéristiques que celui de la dame de<br />
Tai. Nous en saurons certainement plus à ce<br />
sujet d’ici peu. Nous ne sommes d’ailleurs pas au<br />
bout de nos surprises, car cinq autres cas semblables<br />
sont cités dans le Shih Ching Chu et le<br />
Shin Shu, textes antérieurs au septième siècle de<br />
notre ère.<br />
Le contexte alchimique.<br />
Oui mais, me direz-vous, après tout, sans disconvenir<br />
de l’aspect extraordinaire de ces trouvailles,<br />
il est fort possible que cette remarquable<br />
conservation s’explique tout simplement par la<br />
construction soignée du tombeau. Effectivement,<br />
la couche de charbon de bois a dû être placée<br />
pour prévenir le sarcophage de l’humidité. Quant<br />
à l’argile, elle protège le charbon de bois et ne<br />
laisse passer ni air ni eau. De plus, la terre sablonneuse<br />
qui recouvre le tout sur une appréciable<br />
épaisseur, crée aussi de bonnes conditions<br />
d’étanchéité. Les trois cercueils sont de plus<br />
étroitement assemblés et laqués. Tout cela assurant<br />
au corps un milieu dépourvu d’oxygène, ou<br />
quasiment, a ralenti ou arrêté presqu’entièrement<br />
le processus de décomposition. Mais ce n’est<br />
pourtant pas suffisant, car il existe les bactéries<br />
anaérobies du corps et du sol, qui malgré un<br />
milieu dépourvu d’oxygène, vont provoquer la<br />
décomposition des organes. Il faut donc autre<br />
chose et c’est là que nous retrouvons l’empreinte<br />
des alchimistes anciens, par la présence d’un<br />
élément commun chez la dame de Tai et dans le<br />
cas de l’homme dernièrement découvert : dans le<br />
dernier des trois cercueils de bois, les cadavres<br />
étaient tous deux à demi immergés dans un<br />
liquide rougeâtre... Son analyse chimique révéla<br />
qu’il s’agissait d’un composé de plusieurs acides<br />
organiques et... de mercure.<br />
Une autre allusion à cette science de la recherche<br />
de l’élixir de longue vie se trouve sur la magnifique<br />
bannière multicolore de soie peinte qui<br />
recouvrait le cercueil contenant la dame de Tai.<br />
Hormis sa grande beauté et son caractère unique<br />
jusqu’à maintenant, cette pièce de soie peinte est<br />
la plus ancienne connue. En forme de « T », elle<br />
illustre dans toute son ampleur cosmique, l’univers<br />
tel que se le représentaient les Chinois : le<br />
Monde Céleste, le Monde des Humains et le<br />
Monde Souterrain. Les trois régions sont peuplées<br />
d’une foule de créatures imaginaires issues<br />
de la mythologie et des légendes. Parmi les innombrables<br />
symboles, notons au passage un<br />
énorme médaillon figurant un disque pî (symbole<br />
de l’immortalité) au centre duquel se croisent<br />
deux dragons. Dans le coin supérieur gauche de<br />
23
24<br />
la bannière, on peut voir, sous le croissant de la<br />
Lune, une femme chevauchant un dragon ailé ; il<br />
s’agit de Tchang-eh, l’épouse de l’Archer Yi, qui<br />
suivant le mythe, dut s’enfuir dans la Lune pour<br />
avoir dérobé... l’élixir d’immortalité. Un autre clin<br />
d’œil à l’alchimie est encore donné par un petit<br />
lièvre blanc, qui se tient à l’intérieur du croissant<br />
de la Lune ; selon la légende, le lièvre blanc y<br />
réside, fabriquant les drogues qui entrent dans la<br />
composition de... l’élixir de jouvence. Il est souvent<br />
taillé en forme de petites amulettes de jade<br />
et remplit alors la fonction des jades funéraires<br />
décrite plus haut. Ces derniers rapprochements<br />
avec l’alchimie ne semblent pas avoir été soulignés.<br />
Bien sûr, il faut être extrêmement prudent<br />
et ne pas tirer de conclusions hâtives. La médecine<br />
occidentale connaît à la fois les dangers du<br />
mercure et, d’autre part, ses vertus antiseptiques,<br />
mais personne ne s’est jamais demandé quelle<br />
pouvait être l’action d’un minerai comme le jade<br />
sur l’organisme, et cela se conçoit aisément.<br />
Pour terminer (il n’est pas interdit de rêver) je<br />
vous renverrai une dernière fois à l’article sur les<br />
pyramides chinoises, où le chroniqueur Sseuma<br />
Ts’ien nous décrivant l’intérieur du tombeau gigantesque<br />
de l’Empereur Ts’in Che Houang-ti,<br />
précisait: « Un véritable palais souterrain se dressait<br />
là, où des ruisseaux de mercure dessinaient<br />
d’éternelles rivières ; des machines le faisaient<br />
couler et se le transmettaient des unes aux autres...».<br />
Je ne vous cache pas mon impatience<br />
d’en apprendre plus au sujet des fouilles actuellement<br />
en cours dans le tombeau de l’Empereur<br />
Jaune, qui risquent de nous stupéfier une fois de<br />
plus. Comme apéritif il nous a déjà été communiqué<br />
la découverte, dans une fosse géante située<br />
à proximité du tombeau lui-même, de près de six<br />
mille statues (vous avez bien lu !) de guerriers en<br />
armes et de chevaux, grandeur nature…<br />
Ne concluons donc pas et attendons, d’autant<br />
plus qu’ainsi que le déclarait judicieusement<br />
quelqu’un, en raison de ce que nous savons,<br />
mais surtout en raison de l’abondance de ce que<br />
nous ignorons (les milliers de textes anciens non<br />
encore traduits ont de quoi nous plonger dans un<br />
abîme de perplexité) : « Parler de la Chine, c’est<br />
s’exposer à dire des bêtises »...<br />
BIBLIOGRAPHIE.<br />
PATRICK FERRYN<br />
● J.J.M. De Groot : « The Religious System of<br />
China », volume 2, chapitre 3. Leyden 1894.<br />
● B. Laufer: « Jade - a Study in Chinese Archeology<br />
and Religion », Field Museum of Natural<br />
History Publications, Anthropological Series.<br />
Chicago 1912.<br />
● P. Pelliot : « Introduction aux Jades archaïques<br />
appartenant à Monsieur C.T. Loo. van<br />
Oest », Paris-Bruxelles 1925.<br />
● Chêng, Tê-k’un : « Archeology in China »,<br />
volume 3, Chou China 1963.<br />
● William Watson : « La Chine Ancienne», Sequoia-Elsevier,<br />
Paris - Bruxelles 1968.<br />
● Nathan Sivin : « Chinese Alchemy : preliminary<br />
Studies », Harvard University Press -<br />
Cambridge Massachusetts 1968.<br />
● Edmund Capon et William MacQuitty :<br />
« Princes of Jade», Jarrold and Sons Ltd, Norwich.<br />
Cardinal, Sphere Books 1973.<br />
● Joseph Needham : « Science and Civilisation<br />
in China », Volume 5, Chemistry and Chemical<br />
Technology, Part 2. University Press - Cambridge<br />
1974.<br />
● Joan M. Hartman : « Ancient Chinese Jades<br />
from the Buffalo Museum of Science », China<br />
House Gallery. China Institute in America,<br />
New York 1975.<br />
● Revues :<br />
La Chine en Construction, octobre 1973 :<br />
« Autopsie d’un cadavre de femme vieux de<br />
2000 ans ».<br />
Le Courrier de l’Unesco, avril 1974, « La plus<br />
vieille peinture sur soie ».<br />
Pékin Information, numéro 35, septembre<br />
1974. National Geographic Magazine, vol. 145<br />
n° 5, mai 1975 : « A lady from China’s past ».<br />
La Chine, numéro 11, novembre 1975.<br />
● Un très intéressant album illustré en couleurs<br />
ainsi qu’une plaquette qui en a été tirée, peuvent<br />
aisément s’obtenir à l’Association Belgique-Chine<br />
à Bruxelles : « Découvertes Archéologiques<br />
en Chine Nouvelle ».
Mégalithes oubliés de Corée<br />
Une des surprises qu’éprouve le voyageur parcourant certaines régions de Corée est la découverte, à cet<br />
endroit, d’un ensemble de dolmens typiques. Seuls quelques spécialistes sont au courant et l’on ne s’y<br />
attend guère. Il en existe plusieurs milliers inégalement répartis sur tout le territoire, au point qu’on peut y<br />
voir un facteur spécifique du pays : la péninsule est un centre mégalithique important, par rapport aux<br />
contrées avoisinantes, pauvres en constructions de ce genre. On parlera donc des dolmens coréens, comme<br />
on cite ceux de Bretagne auxquels ils ressemblent parfois de manière frappante. En certains lieux, et<br />
avec un peu d’imagination, le touriste se croirait volontiers dans le voisinage immédiat de Locmariaquer ou<br />
de Carnac. Apparence ne signifie bien sûr pas identité. La présence de ces monuments pose une série de<br />
problèmes non résolus à ce jour. Précisons tout au moins que les solutions proposées n’emportent pas<br />
l’adhésion définitive. Afin de permettre au lecteur de situer plus aisément les faits, nous brosserons<br />
d’abord un tableau sommaire de ce passé lointain. Les érudits ne m’en voudront pas si le croquis à peine<br />
esquissé est un peu trop schématique et, par le fait même, incomplet.<br />
Survol de la préhistoire coréenne.<br />
La Corée préhistorique est mal connue malgré<br />
les efforts méritoires des chercheurs autochtones,<br />
parmi lesquels nous citerons les Professeurs<br />
Chewon Kim et Moo-Byong Youn, dont les remarquables<br />
travaux relatifs aux dolmens nous<br />
ont fourni notre meilleure documentation. Plusieurs<br />
découvertes ont permis de tracer quelques<br />
lignes saillantes de cette longue période, mais, il<br />
faut bien l’avouer, la synthèse obtenue à partir<br />
d’éléments épars est restée dans une large mesure<br />
conjecturale, comme en témoigne la diversité<br />
des opinions émises par les auteurs. Dans ces<br />
conditions, nul ne s’étonnera si les conclusions<br />
que nous tirons des données en notre possession<br />
doivent, un jour ou l’autre, faire l’objet d’une<br />
révision. Seuls les faits archéologiques cités présentent<br />
une certaine garantie.<br />
On a pu prétendre que rien ne permettait d’affirmer<br />
l’existence d’un peuplement paléolithique en<br />
Corée. C’est l’avis du Professeur Li Ogg (réf. 2).<br />
Pourtant, en 1963, on exhuma des outils de pierre<br />
qui remontaient indubitablement à cette époque<br />
; ils furent découverts dans la province<br />
d’Hamgyong septentrional, soit à l’extrême nord<br />
du pays. Par après, on déterra des objets similaires<br />
au Ch’ungch’ong méridional, sur les bords du<br />
fleuve Kum, à savoir, pour le lecteur peu familiarisé<br />
avec la géographie coréenne, dans une région<br />
située au sud-ouest. Un fragment de bois calciné<br />
daté au radiocarbone remonte à ± 30.690 ans<br />
(réf. 1).<br />
Il nous faut à présent faire un bond d’environ 250<br />
siècles dans le temps pour atteindre le néolithique<br />
beaucoup mieux attesté. La plupart des vestiges<br />
laissés par cette époque datent du III e millénaire<br />
avant J.-C., mais on admet généralement<br />
que la période peut avoir commencé dans les<br />
deux mille ans qui précèdent. Nul ne sait exactement<br />
à la suite de quelle migration, ces peupla-<br />
des ont occupé la péninsule. L’hypothèse qui les<br />
rattache à une souche comprenant des tribus<br />
sibériennes, mongoles et mandchoues n’emporte<br />
pas l’unanimité des suffrages. Elle repose en<br />
partie sur des similitudes de langage entre le<br />
coréen historique, le turc, le mongol, le toungouse,<br />
le japonais et d’autres idiomes en usage en<br />
Sibérie, mais les résultats des recherches linguistiques<br />
sont bien loin d’être probants. Au départ,<br />
les hommes du néolithique semblent tirer de la<br />
pêche leurs principaux moyens de subsistance ;<br />
les communautés vivent au bord de la mer. A<br />
mesure que les siècles s’écoulent, on assiste à<br />
une pénétration à l’intérieur des terres et l’on voit<br />
apparaître les traces d’autres activités économiques<br />
: chasse et agriculture.<br />
Un fait saillant de l’époque néolithique est la poterie<br />
rayée dont les exemplaires furent principalement<br />
découverts sur les côtes. Il s’agit de vases<br />
décorés en surface par une série de lignes parallèles<br />
incisées, comme si l’on avait gravé l’argile<br />
humide au moyen d’une dent ou d’un peigne<br />
avant de la passer au feu ; cette production artisanale<br />
s’appelle « combware » en anglais et<br />
« Kamm Keramik » en allemand. Fait important :<br />
on a pu établir des rapprochements avec des<br />
objets similaires, associés à des sites néolithiques<br />
dans de nombreuses régions d’Asie et<br />
d’Europe septentrionales, en Mongolie, en Sibérie,<br />
jusqu’en Scandinavie et en Allemagne du<br />
Nord. La filiation exacte de la poterie rayée n’est<br />
certes pas établie, mais la question mérite un<br />
approfondissement. N’est-ce pas le signe d’un<br />
vaste courant d’échanges par le nord, et ce, à<br />
une époque où, chez nous, le mégalithisme est<br />
florissant ?<br />
On situe généralement l’introduction du bronze<br />
en terre coréenne dans le courant du premier<br />
millénaire. C’est approximativement à la même<br />
époque qu’apparaît un nouveau type de vase<br />
25
26<br />
brun-rougeâtre, à parois épaisses et sans aucune<br />
décoration : nous l’appellerons « poterie simple».<br />
On la trouve en général loin des côtes, à<br />
l’intérieur du territoire. Il est permis d’y voir la<br />
trace d’une implantation nouvelle, celle d’un<br />
groupe ethnique différent, qui intéresse particulièrement<br />
notre sujet car la science officielle tend<br />
actuellement à lui attribuer la construction des<br />
dolmens. Je reproduis cette opinion sous toute<br />
réserve. Pour la petite histoire, une ancienne<br />
légende donne le héros mythologique Tan’gun<br />
Wang Gom, qui aurait vécu vingt-quatre siècles<br />
avant Jésus-Christ, comme l’ancêtre du peuple<br />
coréen. Il aurait fondé un premier royaume, celui<br />
de Djo-son, expression qui fut rendue en français<br />
par : «matin calme». Cette jolie locution eut un<br />
certain succès, même si elle ne satisfait pas entièrement<br />
l’étymologie.<br />
Les dolmens.<br />
On classe traditionnellement les dolmens coréens<br />
en deux catégories, selon la technique de<br />
construction : le type nordique et le type méridional.<br />
Au départ, il s’agissait d’une répartition géographique.<br />
En réalité, on a trouvé des exemplaires<br />
du second en Corée du Nord, mais par habitude<br />
et aussi pour la commodité, l’ancienne terminologie<br />
a été maintenue.<br />
<strong>LE</strong> TYPE NORDIQUE.<br />
Le dolmen de type nordique est un ensemble<br />
constitué par quatre blocs de pierre disposés de<br />
manière à former une chambre rectangulaire ; il<br />
est surmonté d’un cinquième servant de couvercle,<br />
« la table». La majeure partie de la structure<br />
s’élève au-dessus du sol, comme c’est généralement<br />
le cas des dolmens européens, et c’est bien<br />
ce dernier aspect qui distingue le plus le modèle<br />
septentrional du type méridional qui, lui, est, dans<br />
une large mesure, enterré. Les parois les plus<br />
longues supportent l’essentiel du poids considérable<br />
que pèse la table. Aussi, les constructeurs<br />
ont-ils choisi à cet effet des rocs particulièrement<br />
massifs et solides. Une base en forme de coin,<br />
parfois arrondi, permet de les planter profondément<br />
dans le sol ; on lui a parfois fait subir une<br />
taille rudimentaire pour lui donner la forme appropriée.<br />
A l’inverse, les blocs constituant les petits<br />
côtés sont plus fragiles et moins enfoncés dans<br />
la terre. C’est le point faible de l’ouvrage et si un<br />
effondrement se produit, c’est évidemment à cet<br />
endroit qu’on le constate le plus souvent. En outre,<br />
on emploie parfois une moins bonne qualité<br />
de pierre pour ces petits supports, bien qu’en<br />
général les mêmes matériaux soient utilisés pour<br />
les quatre parois. Il arrive souvent que les bâtisseurs<br />
aient entassé des galets extraits d’un lit de<br />
rivière tout autour de la base, au point d’ensevelir<br />
entièrement les supports. L’ensemble forme alors<br />
une sorte de cairn ne laissant apparaître que la<br />
surface supérieure de la table.<br />
Seules les plantations et les montagnes nous<br />
assurent que nous ne sommes pas en Bretagne :<br />
dolmen de type nordique, situé dans la province<br />
de Kyonggido, district de Hang Hwa Kien.<br />
<strong>LE</strong> TYPE MERIDIONAL.<br />
Rappelons-le : la caractéristique principale du<br />
modèle méridional est la présence d’une chambre<br />
souterraine. Tout se passe comme si, à une<br />
époque indéterminée, on avait décidé d’enfouir le<br />
dolmen dans le sol, ne laissant que la partie supérieure<br />
à l’air libre. C’est bien sûr une image,<br />
car cette conception nouvelle détermine aussitôt<br />
des modifications profondes dans la structure de<br />
l’ensemble. La principale affecte la partie basse,<br />
celle précisément qui constitue la chambre. Elle<br />
perd en effet sa fonction de soutien, relayée par<br />
le seul terrain, du moins au départ. L’infrastructure<br />
devient plus fragile, sa solidité diminue. Les<br />
bâtisseurs ne sont plus obligés de chercher de<br />
gros blocs pour élever de lourdes parois. Deux<br />
techniques de construction différentes ont permis<br />
une subdivision des mégalithes de type méridional.<br />
— Le dolmen sans supports.<br />
La table repose, en principe, sur le sol et il arrive<br />
qu’on la distingue malaisément d’un simple rocher<br />
naturel gisant là par hasard. Elle doit être
écartée pour que son infrastructure apparaisse.<br />
Cette dernière est construite directement sous la<br />
table qui lui sert ainsi de couvercle. On note évidemment<br />
des variantes que l’on s’est tant bien<br />
que mal efforcé de classifier ; les données cidessus<br />
constituent l’essentiel.<br />
— Le dolmen à supports.<br />
Il procède du premier suite à une évolution que<br />
des impératifs pratiques ont rendue nécessaire.<br />
Les minces parois de la chambre n’opposaient<br />
plus une résistance suffisante à l’énorme mégalithe<br />
qui les recouvrait. La terre étant friable par<br />
nature, des risques d’effondrement menaçaient<br />
l’ouvrage. On en revint donc aux blocs de soutien,<br />
sans pour autant reprendre les procédés qui<br />
avaient donné naissance au type nordique : les<br />
supports ne formaient plus des murs, c’étaient de<br />
simples pierres de soutènement, souvent posées<br />
aux quatre coins. En outre, la cavité souterraine<br />
était plus profondément enfouie dans le sol sans<br />
contact direct avec la table qui perdait ainsi sa<br />
fonction de couvercle ; elle servait désormais de<br />
simple marque extérieure.<br />
Localisation et répartition géographique.<br />
On rencontre des dolmens sur tout le territoire<br />
coréen et même sur les îles côtières telles que<br />
Che judo et Huksando, à l’exception, semble-t-il,<br />
de l’extrême-nord, à savoir la province d’Hamgyong<br />
Pukdo. Il existe cependant des lieux de<br />
prédilection, par exemple les deux provinces méridionales,<br />
le Cholla Pukdo et le Cholla Namdo<br />
situées sur la côte ouest. Ils sont par contre peu<br />
nombreux dans les régions orientales du pays. A<br />
ce propos, notons en passant qu’une erreur s’est<br />
glissée dans l’ouvrage de Fernand Niel:<br />
« Dolmens et Menhirs » (Que sais-je ? n° 764).<br />
La localisation coréenne telle qu’elle est reprise à<br />
la page 74 est erronée. On les trouve en grand<br />
nombre dans les contrées proches de la mer et<br />
aussi le long des fleuves et des rivières. Cette<br />
tendance mise à part, aucune condition géographique<br />
particulière ne semble exigée. Le peuple<br />
des mégalithes a construit ses dolmens en terrain<br />
plat aussi bien que sur des collines, au pied<br />
des montagnes et même dans des passes montagneuses.<br />
Ils ne s’élèvent pas nécessairement<br />
en un endroit qui convient à l’établissement d’un<br />
habitat humain. Bien au contraire, l’environnement<br />
est souvent pauvre. Ils sont habituellement<br />
groupés par deux ou trois, mais on note aussi la<br />
présence de vastes ensembles comprenant plusieurs<br />
centaines d’ouvrages. C’est exceptionnel :<br />
en général, les dolmens assemblés ne dépassent<br />
pas vingt à trente unités, mais il arrive que de<br />
petits groupements constituent une aire plus vaste,<br />
qu’une localisation sur carte fait clairement<br />
apparaître. On remarque aussi des alignements,<br />
le plus souvent selon un axe nord-sud, information<br />
donnée par le Professeur Li Ogg (réf. 2).<br />
Les bâtisseurs.<br />
La thèse officielle attribue la paternité des dolmens<br />
au peuple qui s’est illustré par la poterie<br />
simple au premier millénaire. On constate en<br />
effet que les quelques objets extraits des mégalithes<br />
par les archéologues appartiennent à cette<br />
culture. Parmi les pièces les plus représentatives,<br />
citons d’abord une tête de flèche en pierre polie<br />
dont la section transversale est en losange. Or ce<br />
type d’arme est caractéristique des sites occupés<br />
jadis par les hommes qui ont produit ce type de<br />
vase. A titre de comparaison, la céramique rayée<br />
néolithique est associée à une tête de flèche dont<br />
la coupe transversale est triangulaire et la surface<br />
polie ou parfois grossièrement burinée. Le<br />
second objet confirmant l’hypothèse est une fort<br />
jolie dague à forme singulière : on jurerait qu’il<br />
s’agit d’une copie exécutée d’après un modèle en<br />
métal dont on ne trouve d’ailleurs aucun prototype.<br />
Elle pose un problème dont l’exposé dépasserait<br />
le cadre du sujet. Les mêmes conclusions<br />
s’imposent à son propos et désignent la même<br />
culture.<br />
Deux datations au carbone 14 viennent appuyer<br />
ces données. L’équipe dirigée par les Professeurs<br />
Chewon Kim et Moo-Byong Youn découvrit<br />
un site incendié à Oksokni, en Corée centrale,<br />
dans la province de Kyonggi ; un dolmen y avait<br />
été construit. A l’extrémité du site, on trouva un<br />
morceau de bois calciné et une dague ; l’analyse<br />
donne 2590 ± 105 BP, ce qui nous ramène à une<br />
période s’étendant du milieu du VIII e siècle au<br />
milieu du VI e avant Jésus-Christ. D’autre part, un<br />
squelette enseveli sous le dolmen 13 de Hwangsokni,<br />
dans la province de Ch’ungch’ong Pukdo,<br />
plus au sud, révèle, au radiocarbone, un âge de<br />
2360 ± 370 BP (1). La marge est plus incertaine,<br />
mais elle nous maintient au 1 er millénaire avant<br />
notre ère.<br />
Chronologie des dolmens.<br />
En essayant d’identifier les constructeurs, nous<br />
avons déjà largement empiété sur l’étude de la<br />
chronologie. Tâchons de préciser. De l’avis<br />
quasi-général, les dolmens de type nordique sont<br />
les plus anciens. Dans cette optique, ceux qui<br />
(1) Dans la terminologie du radiocarbone, BP<br />
signifie « before present ». Le « temps présent<br />
» est conventionnellement fixé à l’année<br />
1950, quelle que soit la date de l’analyse, ceci<br />
pour simplifier le calcul.<br />
27
28<br />
appartiennent au type méridional en dérivent.<br />
L’étude comparative des techniques, effectuée<br />
par les spécialistes, sur le terrain même, tend à<br />
démontrer que ces derniers sont des formes dégénérées<br />
du premier modèle. C’est bien cette<br />
conception des choses que nous avons exposée<br />
aux paragraphes précédents. Il résulte des diverses<br />
données exposées ci-dessus que l’on édifiait<br />
encore des dolmens, à l’époque de la poterie<br />
simple, soit au 1 er millénaire. Pour fixer les idées,<br />
les Professeurs Chewon Kim et Moo-Byong Youn<br />
déjà cités assignent comme terminus ad quem, la<br />
fin du IV e siècle ou le début du III e avant J.-C.<br />
pour les mégalithes à structure septentrionale et<br />
le II e siècle avant J.-C. pour les autres. C’est un<br />
point d’aboutissement. Peut-on aussi facilement<br />
déterminer le point de départ ?<br />
Nous l’avons constaté, la chronologie des dolmens<br />
repose presque entièrement sur les objets<br />
exhumés de ces monuments et à ce sujet deux<br />
constatations s’imposent.<br />
1. Les pièces qui ont permis une datation approximative<br />
appartiennent certes à la culture de<br />
la poterie simple ; on en a découvert d’autres<br />
exemplaires sur des sites appartenant à cette<br />
culture. Mais la chronologie de la poterie simple<br />
est bien loin d’être établie avec précision. On<br />
ignore son origine ; nous ne savons pas s’il s’agit<br />
d’une production autochtone ou d’une technique<br />
d’importation. Sa date d’introduction dans l’artisanat<br />
coréen est totalement inconnue.<br />
2. Le produit des fouilles effectuées à l’intérieur<br />
des dolmens est singulièrement maigre. La plupart<br />
ne contiennent rien. A de rares exceptions<br />
près, quand d’aventure on y découvre des objets,<br />
leur nombre est infime par rapport à la tâche<br />
écrasante qu’exige l’édification d’un tel ouvrage.<br />
La datation officielle repose donc un peu sur une<br />
tête d’épingle. Mais si l’on veut pousser l’investigation<br />
dans le temps, c’est vers le dolmen nordique<br />
qu’il nous faut diriger nos regards. Malheureusement,<br />
c’est le plus mal connu. Il serait utile<br />
de savoir si l’un de ces mégalithes se dressant<br />
au nord du 58 e parallèle ne recèle pas quelque<br />
artefact néolithique. Nous l’ignorons, mais la<br />
question reste pendante. Dans ce domaine, on a<br />
bien découvert des fragments de poterie rayée<br />
au sein du dolmen A à Oksokni, mais quand les<br />
chercheurs étendirent leurs fouilles aux alentours<br />
immédiats, ils trouvèrent un site remontant à cette<br />
dernière culture. Le fait n’est donc pas<br />
significatif : un groupe humain peut fort bien avoir<br />
bâti l’ouvrage bien après l’occupation des lieux<br />
par un peuple qui le précédait. En outre, on ignore<br />
à quelle époque la poterie rayée a<br />
disparu.<br />
La destination.<br />
Nous abordons ici un des problèmes les plus<br />
curieux posés par les dolmens coréens. La thèse<br />
officielle y voit des tombes ; les pièces enfouies<br />
seraient ainsi des objets funéraires et nul ne<br />
semble mettre cette destination en question. Le<br />
moment est venu, je crois, de donner quelques<br />
indications sur les dimensions des ouvrages qui<br />
nous intéressent. Il existe bien sûr des dolmens<br />
gigantesques, ceux du nord notamment. Le plus<br />
grand et peut-être le plus célèbre est celui<br />
d’Unyul. C’est un colosse dont la table mesure 8<br />
m 50 sur 6 m ; elle s’élève à une hauteur de 2 m<br />
30, pesant de tout son poids sur de fortes murailles.<br />
Bel ouvrage de type nordique qui contient<br />
une vaste chambre. Mais une envergure pareille<br />
est assez exceptionnelle. En général, la fosse qui<br />
est censée recevoir le cadavre s’avère ridiculement<br />
exiguë. Voici quelques exemples qui permettront<br />
à chacun de se faire une opinion.<br />
Oksokni<br />
Ch’onjonni<br />
Sin’giri<br />
en général<br />
dolmen B V<br />
dolmen A<br />
dolmen 2<br />
dolmen B<br />
moins d’1 m. sur 0,50 m.<br />
0,70 m. sur 0,50 m.<br />
0,50 m. sur 0,35 m.<br />
0,50 m. sur 0,35 m.<br />
0,50 m. sur 0,35 m.<br />
Les plus anciens dolmens de type méridional ont<br />
une chambre dont les dimensions ne dépassent<br />
guère 1 m 30 sur 0,50 m. Il est vrai qu’elles croissent<br />
à mesure que le temps s’écoule, pour atteindre<br />
une longueur d’1 m 50 à 1 m 80.<br />
Dolmen de type méridional à Chagsanni.<br />
Dans les conditions exposées ci-dessus, un ensevelissement<br />
se conçoit mal. On a émis l’hypothèse<br />
que les corps étaient recroquevillés avant<br />
les funérailles, mais cette éventualité même cesse<br />
d’être acceptable quand la fosse prétendument<br />
funéraire n’a pas un mètre de long. S’agirait-il<br />
d’une tombe d’enfant ? Mais le nombre des<br />
petites chambres est trop élevé pour admettre<br />
cette possibilité. Un autre fait vient encore ébranler<br />
l’idée d’un dolmen-caveau préhistorique : l’absence<br />
quasi-totale d’ossements. Nous avons
signalé plus haut qu’on avait effectivement découvert<br />
un squelette complet sous le dolmen 13<br />
de Hwangsokni. Entre parenthèses, il gisait en<br />
position allongée. Le cas n’est pas unique, mais<br />
rarissime. On peut en conclure qu’à une certaine<br />
époque, l’un ou l’autre dolmen a pu servir de<br />
tombe, mais, sous peine de commettre le plus<br />
abominable des latius hos, c’est-à-dire d’émettre<br />
une conclusion qui dépasse largement les données<br />
sur lesquelles elle se base, il est exclu d’en<br />
déduire que tous les monuments du genre ont<br />
été érigés à des fins funéraires et moins encore<br />
qu’une telle destination fut la raison première de<br />
leur apparition. Certes, la conservation des restes<br />
humains dépend largement de la nature du<br />
sol, principalement de son acidité. A ma connaissance,<br />
aucune étude n’a été entreprise dans ce<br />
sens en Corée. Il serait cependant étonnant que<br />
les ossements aient entièrement disparu sur l’ensemble<br />
du territoire péninsulaire. Or, c’est un fait<br />
certain : la plupart des dolmens sont vides. Vides<br />
de squelettes et d’objets ! Le mystère demeure.<br />
Nous ne sommes pas plus renseignés sur<br />
l’origine des dolmens coréens que sur leur destination.<br />
Comparaison.<br />
Existe-t-il un rapport entre le mégalithisme au<br />
pays du Matin Calme et celui que l’on découvre<br />
un peu partout dans le monde ? Le problème est<br />
posé, il n’est pas résolu. Certes, ces monuments<br />
peuvent fort bien être le fait d’une production<br />
nationale. Rien n’empêche deux ou plusieurs<br />
peuples d’avoir eu une idée analogue, sans aucun<br />
contact entre eux. Mais ce n’est qu’une hypothèse.<br />
La possibilité d’une influence doit être<br />
envisagée et quoiqu’en ce domaine, la documentation<br />
soit encore fragmentaire, elle existe cependant<br />
en abondance. Posons donc la question en<br />
termes concrets. Au centre du problème, nous<br />
situons la Corée, foyer mégalithique important. Il<br />
existe de petits dolmens au Japon, dans la partie<br />
septentrionale de Kyu-Syu (prononcer Kyou-<br />
Chou), la petite île qui forme le sud de l’archipel<br />
nippon. Selon toute apparence, il s’agit d’un produit<br />
d’importation venant de Corée. On a signalé<br />
la présence de quelques mégalithes dans la province<br />
chinoise de Shantung, région relativement<br />
proche de la péninsule ainsi qu’au Tchekyang sur<br />
les côtes de la mer de Chine, donc beaucoup<br />
plus au sud. Mais en général, l’Empire du Milieu<br />
passe pour être pauvre en dolmens. L’information<br />
dans ce domaine est très incomplète. Ces<br />
quelques vagues exceptions mises à part, nous<br />
devons effectuer un voyage de plusieurs milliers<br />
de kilomètres pour atteindre d’autres centres<br />
mégalithiques : le Haut-Laos et le Tibet. L’étude<br />
comparative reste à faire.<br />
Conclusion.<br />
A la fin de cette brève enquête sur les dolmens<br />
coréens, une impression se dégage, la même<br />
qu’éprouvent tous ceux qui se sont penchés sur<br />
le mégalithisme en quelque lieu qu’il soit apparu.<br />
Comme le fait remarquer Fernand Niel, ces monuments<br />
se font un malin plaisir d’aller à l’encontre<br />
de toutes les théories possibles. Impression<br />
générale, dis-je, mais à laquelle échappent,<br />
comme il se doit, les bons esprits qui ne doutent<br />
jamais de rien et pour lesquels tout est clair dans<br />
la mesure même où ils refusent obstinément de<br />
reconnaître l’existence d’un problème qui les<br />
dérange. A mon sens, ceux qui se sont donné<br />
pour tâche de scruter un passé trop lointain sont<br />
le plus souvent prisonniers d’une fâcheuse habitude<br />
mentale qui fausse leur étude. On aborde le<br />
fait mégalithique avec des idées toutes faites,<br />
produits d’un cerveau que notre civilisation, c’està-dire<br />
une culture spécifique, a conditionné. Nous<br />
raisonnons comme si les hommes des dolmens<br />
disposaient d’un mental fabriqué comme le nôtre<br />
ou, pis encore, comme celui des prétendus primitifs<br />
vivant à notre époque. C’est une attitude courante<br />
et elle ne repose sur rien. Plusieurs milliers<br />
d’années et bon nombre de kilomètres séparent<br />
les aborigènes australiens des peuples préhistoriques.<br />
Or s’il est une vérité qui apparaît de plus<br />
en plus clairement, c’est l’existence, chez ces<br />
derniers, d’une organisation psychique entièrement<br />
différente, une façon de penser, de sentir et<br />
même de percevoir le monde que nos esprits<br />
cartésiens n’imaginent pas. Peut-être existaientils<br />
entre ces êtres et leur environnement des<br />
liens qui nous sont totalement étrangers. Est-ce<br />
sans espoir ? Non, mais si nous voulons un jour<br />
comprendre leur œuvre, c’est bien leur âme qu’il<br />
nous faudra pénétrer.<br />
JACQUES KEYAERTS<br />
(documentation recueillie par Albert Szafarz)<br />
BIBLIOGRAPHIE.<br />
● L’ouvrage de base est introuvable en Europe :<br />
« Studies of dolmens in Korea » de Chewon<br />
Kim et Moo-Byong Youn, National Museum of<br />
Korea, Seoul 1967. Il comprend un long texte<br />
en coréen, un exposé plus court en anglais<br />
(traduction de la première partie du texte coréen),<br />
et une abondante documentation photographique.<br />
Il nous est parvenu grâce à l’aide<br />
précieuse de M. Kyung-Sik Rhee, attaché<br />
culturel de l’ambassade de Corée.<br />
● Han Woo-Keun : « History of Korea »,<br />
chapitres 1 et 2, Grafton K. Mintz éd. (réf. 1).<br />
J’émets quelques réserves quant à ses conclusions<br />
parfois hâtives et peu fondées.<br />
● Li Ogg : « Histoire de la Corée», Collection<br />
Que sais-je ?, n° 1310 (réf. 2). Le court chapitre<br />
sur la préhistoire est un peu trop succinct.<br />
29
30<br />
ENTRE <strong>LE</strong>S LIGNES<br />
<strong>LE</strong> <strong>FORGERON</strong> <strong>VENU</strong> <strong>DU</strong> <strong>CIEL</strong><br />
<strong>Eric</strong> <strong>Guerrier</strong><br />
Le N° 14 de KADATH a consacré un long article d’Ivan Verheyden à la cosmogonie des Dogon, à la suite<br />
d’un essai que j’avais tenté sur cet extraordinaire monument de la mémoire humaine. Bien sûr, j’avais eu<br />
du mal à résumer en 250 pages les vertiges de cette question difficile d’accès à cause de l’ignorance où<br />
nous sommes de ce que sont les Dogon, de leur mentalité profonde, de leur culture... C’est dire qu’un<br />
article résumant encore ne pouvait que mettre l’eau à la bouche, ou décourager. C’est dire aussi qu’il devait<br />
laisser de côté certains aspects, pour les développer ensuite, parce que valant à eux seuls un autre<br />
article. C’est le cas de toute une partie du mythe actuellement en cours d’exploration par la mission Dieterlen,<br />
concernant le site du lac Bosumtwi au Ghana. (1)<br />
« Après la descente sur la Terre d’une arche qui<br />
supportait presque tous les êtres créés... le forgeron<br />
descendit à son tour, mais dans des conditions<br />
particulières... Le forgeron vint sur Terre<br />
accompagné de sa jumelle... En descendant, il<br />
vola un morceau du soleil, c’est à dire un fragment<br />
brûlant du reste du placenta du Renard.<br />
C’est avec ce feu solaire que l’artisan allumera<br />
celui de sa forge, soulignant ainsi sa puissance<br />
sinon égale, du moins parallèle à celle de son<br />
« jumeau» le Nommo qui lutte victorieusement<br />
contre le fauteur de désordre. Il atterrit en un<br />
point de la Terre où il recueillit un morceau de<br />
« sagala » qu’il devait utiliser pour fabriquer le<br />
premier outillage de fer... Il réalisa un long périple<br />
qui le conduisit au lieu où s’était fichée l’enclume,<br />
et où il installa sa forge... l’eau remplit l’excavation,<br />
creusée par l’enclume, devenue mare : le<br />
Renard s’étant approché pour boire, Amma jeta<br />
du ciel... «une hache de pluie »... Le forgeron fera<br />
de cette pierre céleste son siège de travail. Dès<br />
lors l’artisan fut en possession de son matériel de<br />
base, d’origine céleste : le siège, l’enclume, la<br />
masse, le minerai, les soufflets et la tuyère, le<br />
feu...<br />
« Les événements concernant le forgeron mythique<br />
et certaines de leurs conséquences sont rappelés<br />
symboliquement lors de l’édification d’une<br />
nouvelle forge... « Planter l’enclume » rappelle,<br />
pour les Dogon le repiquage de la masse ardente<br />
venue du Ciel, dans le sol, après un premier impact...<br />
Enrobé dans le pisé a été placé un morceau<br />
de sagala, non extrait du sol mais « tombé<br />
(1) G. Dieterlen - Contribution à l’étude des forgerons<br />
en Afrique Occidentale - Annuaire 1965/<br />
66 ; Tome LXXIII (Ecole Pratique des Hautes<br />
Etudes - V o section : Sciences Religieuses),<br />
pages 12 à 28.
du ciel » (il s’agit donc d’un minerai d’origine sidérale<br />
et vraisemblablement d’un fragment de météorite...)<br />
« Les Dogon ont multiplié sur le territoire où ils se<br />
sont installés, après leur migration depuis leur<br />
pays d’origine, dans des buts initiatiques et rituels<br />
à la fois, des édifices, des aménagements dans<br />
des cavernes et abris sous roches, des pierres<br />
levées, des peintures rupestres, etc... qui, tous, se<br />
rapportent à diverses séquences du mythe dont<br />
nous avons résumé l’essentiel. Ils ont également<br />
interprété les accidents naturels du terrain pour les<br />
assimiler à ce système de représentations. Mais la<br />
plupart de ces aménagements du territoire dogon<br />
en reproduisent ou répètent d’autres — répartis<br />
sur une aire considérable en Afrique Occidentale<br />
— et dont le caractère est international ; ils sont<br />
bien connus des hommes et des femmes instruits<br />
dans les diverses ethnies où nous les avons étudiés,<br />
chez les Malinké, les Sarakollé, les Bambara,<br />
les Bozo, dont la cosmogonie et la religion sont<br />
étayées sur les mêmes principes que ceux des<br />
Dogon. Pour donner un exemple, une table rocheuse<br />
— image de l’arche qui supportait le Nommo<br />
mâle ressuscité et les huit ancêtres des hommes<br />
— érigée aux environs de Sanga est la répli-<br />
que d’une table comparable située au sommet du<br />
mont Gourao au lac Débo, lieu où les Dogon situent<br />
l’impact mythique de l’arche sur la Terre. De<br />
même, le cours de la Gona, rivière temporaire qui<br />
coule sur le plateau des Falaises, représente celui<br />
du Niger ; un certain nombre de « trous d’eau »<br />
sont l’objet de rites de purification semblables à<br />
ceux effectués en certains points du fleuve. (2)<br />
« Les événements relatifs à la chute de l’enclume,<br />
la descente du forgeron, celle de la « hache de<br />
pluie » qui deviendra son siège, font l’objet de<br />
représentations géographiques comparables. D’après<br />
les dires formels de nos informateurs, et ceci<br />
serait valable pour tous les forgerons de l’Afrique<br />
Occidentale, c’est la masse ardente du « sang du<br />
cœur » du Nommo sacrifié constituant l’enclume,<br />
qui a creusé le cratère du lac Bosumtwi au Ghana,<br />
qu’ils nomment « mare du trou de l’enclume descendue<br />
». C’est au sud de ce cratère qu’elle est<br />
allée se « repiquer » après avoir rejailli. Le forgeron<br />
est descendu du ciel au Mandé ; il a ramassé<br />
(2) G. Dieterlen - Mythe et organisation sociale au<br />
Soudan français - Journal de la Société des<br />
Africanistes, Tome XXV, 1955. p. 42 note 4.<br />
Parmi les habitations de l’époque des Tellem, creusées dans la falaise, celle du forgeron, homme-clé du<br />
village dogon, est particulièrement décorée.<br />
31
32<br />
un morceau de sagala céleste — « sang de la rate<br />
du Nommo » —, émigré depuis cette région jusqu’aux<br />
abords du cratère, qui s’était rempli d’eau,<br />
pour édifier la première forge là où se trouvait l’enclume,<br />
effectuant un périple interprété comme la<br />
réplique, sur la Terre, de « la route du sang »<br />
écoulé du Nommo sacrifié, au ciel, « comme pour<br />
remonter à son point d’origine ». C’est au bord du<br />
lac qu’est tombée la « hache de pluie »... Les Dogon<br />
ont rappelé ce fait en diverses régions de leur<br />
territoire. Au flanc sud du massif de Yougo, une<br />
grande excavation a été creusée, qui représente<br />
le cratère devenu « mare », soit le lac. C’est à<br />
Yougo-Dogorou, village perché presqu’au sommet<br />
du massif et au droit de cette excavation, que débutent<br />
les cérémonies soixantenaires du Sigui :<br />
dans cette agglomération, au-dessus des cavernes<br />
où sont abrités les masques et divers objets<br />
rituels, un rocher naturel vertical de grande dimension<br />
figure l’enclume.<br />
« A Arou-près-lbi, où vit le chef religieux — autrefois<br />
politique — le plus important des Dogon, les<br />
aménagements ont été réalisés dans les dépendances<br />
de l’habitation du dignitaire. Dans la cour<br />
une vaste excavation circulaire a été creusée, qui<br />
représente le lac. En face de la demeure, sur un<br />
escarpement qui domine la cour, à côté d’un autel<br />
consacré au créateur Amma, on a dressé un bloc<br />
vertical, l’enclume. On annonce le décès du dignitaire<br />
en attachant au sommet une torche de paille<br />
enflammée — « comme était l’enclume lors de la<br />
descente ». Dans la région de Sanga, trois cavernes<br />
ont été aménagées ; dans l’une est symbolisée<br />
la descente du forgeron ; dans la seconde<br />
figurent les événements « célestes» associés à la<br />
chute de l’enclume ; la troisième, très vaste, ouvre<br />
sur une vallée dans laquelle se trouve la<br />
« mare » : à l’intérieur, des dispositions de blocs<br />
de pierre représentent l’enclume, le siège du forgeron,<br />
sa tombe, etc. ; de très nombreuses peintures<br />
schématiques (dont des masques) exécutées<br />
au plafond rappellent les événements provoqués<br />
par la rébellion du Renard.<br />
« Le lac Bosumtwi est situé à environ 30 km au<br />
sud-est de Koumassi au Ghana (3) ; de forme<br />
circulaire, il occupe le fond d’un cratère aux rives<br />
escarpées recouvertes d’une abondante végétation<br />
(4)... Sa forme, l’aspect de l’enceinte du cratère<br />
ont attiré l’attention des chercheurs quant à son<br />
origine géologique...<br />
« D’autre part, dans la ville de Koumassi et planté<br />
au sommet d’une des collines sur lesquelles elle<br />
est édifiée, on peut voir une sorte de piquet de fer<br />
profondément enfoncé dans le sol, placé au centre<br />
d’une large plaque ovale de même métal qui devait<br />
être autrefois incrustée dans le sol et qui est<br />
actuellement détériorée... Pour ceux qui sont instruits<br />
de la tradition — et pour tous nos informateurs<br />
— cet objet qu’ils nomment « enclume de<br />
Koumassi » est, dans la ville royale, une réplique<br />
et un symbole de l’enclume « repiquée à l’endroit<br />
» après son éjection hors de l’excavation<br />
qu’elle avait creusée (lors de nos premiers séjours<br />
à Koumassi, l’un de nos informateurs dogon qui<br />
nous avait accompagnés, avait déclaré spontanément,<br />
devant le piquet, « qu’ils s’agissait d’une<br />
enclume » ; nos enquêtes ultérieures, avec le forgeron<br />
et nos collaborateurs de Sanga, ont confirmé<br />
cette première information)... S’ils en ont la<br />
possibilité avant leur intronisation, les postulants à<br />
la prêtrise chez les Dogon se rendent à Koumassi<br />
formuler des vœux devant le symbole de<br />
« l’enclume » (ce pèlerinage avait été effectué par<br />
notre informateur, le prêtre totémique Yébéné,<br />
actuellement décédé). Les forgerons, au cours de<br />
leur apprentissage et leur initiation, font de même<br />
et vont visiter le lac sacré.<br />
« Le lac est situé dans une région de roches précambriennes<br />
; la formation du cratère, bien postérieure,<br />
aurait eu lieu au tertiaire récent, peut-être<br />
au niveau du Pléistocène moyen. Les études des<br />
échantillons prélevés permettraient de dater la<br />
formation entre 1,3 et 1,6 millions d’années. Les<br />
résultats des analyses des éléments rares » de<br />
ces divers échantillons confirment le rapport d’origine<br />
entre les verres du Bosumtwi et les tectites<br />
de Côte-d’Ivoire... Un événement naturel gigantesque<br />
doit être considéré comme la cause, et c’est<br />
vraisemblablement la chute d’une météorite…<br />
Il nous paraît du plus haut intérêt de rapprocher<br />
l’hypothèse de la formation du cratère par une<br />
météorite des dires de nos informateurs, qui l’attribuent<br />
sans aucune restriction à l’impact d’une<br />
masse métallique, brûlante et de grande dimension,<br />
« venue du ciel »... Le problème se pose de<br />
savoir comment un pareil fait, d’une telle ancienneté,<br />
aurait pu être observé, son souvenir conservé<br />
et transposé dans les traditions des peuples de<br />
l’Afrique Occidentale (on pourrait envisager l’hypothèse<br />
d’une interprétation a posteriori de l’origine<br />
du lac par analogie avec les effets de chutes de<br />
météorites de bien moindres dimensions, que les<br />
intéressés recueillent et utilisent ». (5)<br />
(3) A près de 800 km du pays Dogon ! (NDLA)<br />
(4) D’après Th. Monod - Contribution à l’établissement<br />
d’une liste d’accidents circulaires d’origine<br />
météoritique (reconnue, possible ou supposée),<br />
cryptoexplosive, etc... - le diamètre du lac<br />
est de quelque 8 km, altitude 100 m, profondeur<br />
73 m.<br />
(5) Madame B. Appia rapporte une information sur<br />
l’usage probable de météorites comme enclumes<br />
dans certains groupes de forgerons du<br />
Foutah Djallon.
Ce nouvel épisode de la cosmogonie des Dogon<br />
est d’un intérêt considérable, car Madame Dieterlen<br />
y voit l’armature centrale du mythe tout entier.<br />
On peut, bien sûr, bâtir l’hypothèse que la découverte<br />
du fer céleste provoqua dans la société primitive<br />
dogon, un choc culturel tel que tout le mythe<br />
en aurait été marqué, s’articulant désormais<br />
autour de ces bolides célestes amenant le métal<br />
sacré. C’est une hypothèse rassurante pour l’orthodoxie<br />
universitaire, mais elle présente l’énorme<br />
lacune de ne donner aucune réponse aux questions<br />
fondamentales que posent les connaissances<br />
des Dogon.<br />
On notera pour commencer que le forgeron mythique<br />
descendu du ciel après le Nommo, était son<br />
« jumeau ». Il était resté en orbite dans l’autre<br />
partie de la « caisse superposée », après le détachement<br />
et la descente de l’arche. Le bolide décrit<br />
dans le mythe du lac Bosumtwi est donc différent<br />
de l’arche, et son atterrissage se passe de façon<br />
notablement différente : l’arche se pose en tournoyant<br />
et elle flottera après que l’eau ait rempli la<br />
dépression formée par son atterrissage ; le bolide<br />
du forgeron percutera le sol et rebondira vers le<br />
sud. Toutefois « le Nommo et le forgeron sont<br />
jumeaux ; tous deux sont rouges comme le cuivre,<br />
comme une boule resplendissante » (6). Mais à<br />
l’inverse du Nommo, qui se trouvait dans l’arche et<br />
qui en dirigea l’atterrissage, le forgeron ne descendra<br />
pas dans le bolide, « mais dans des conditions<br />
particulières : ... le forgeron recevra le pénis<br />
et les testicules vides du sacrifié (le Nommo)...<br />
Après la descente de l’arche, Amma donnera l’ordre<br />
au forgeron de descendre le premier — au<br />
titre de jumeau — en se servant des éléments du<br />
sexe comme d’un support : il mettra ses deux bras<br />
dans les deux testicules, ses jambes le long de la<br />
verge. Ces éléments se tranformeront sur le sol<br />
pour devenir respectivement le pénis, la tuyère, et<br />
les testicules, les soufflets de la forge...» (6)<br />
Le forgeron, donc, utilisera pour descendre sur<br />
Terre un appareil résiduel du train spatial que le<br />
mythe a assimilé au sexe vide du Nommo : pénistuyère<br />
et testicules-soufflet de forge. Y a-t-il image<br />
plus claire pour désigner un engin propulseur à<br />
moitié vide dont le forgeron utilise les dernières<br />
réserves pour se poser ? Il utilisera ensuite l’épave<br />
de cet engin pour construire sa « forge ». « Il<br />
réalisa un long périple qui le conduisit au lieu où<br />
s’était fichée l’enclume et il construisit sa forge ».<br />
Cette «enclume», c’était le corps principal du train<br />
spatial qui fut précipité sur Terre comme un bolide<br />
inerte, à la manière d’une météorite…<br />
« Le dieu Amma, au moment de la résurrection, fit<br />
jeter sur le sol le «sang du cœur » de la victime,<br />
mis « en boule» qui devint ardent. Le « sang »<br />
constitua l’enclume : comme une masse enflammée,<br />
comme « une boule de feu ardente », celle-<br />
ci tomba, à l’envers, creusant dans le sol une gigantesque<br />
excavation. Le fonio impur fut atteint,<br />
mais rejaillit et s’éparpilla autour d’elle. L’enclume,<br />
instrument de purification, ne pouvait rester en ce<br />
lieu souillé ; elle rejaillit hors du trou et alla se repiquer<br />
à l’endroit à l’extérieur, au sud, où elle s’enfonça<br />
profondément dans le sol, la partie émergeant<br />
devant être utilisée par le forgeron lors de<br />
l’édification de la première forge... En même<br />
temps que le « sang du cœur-enclume », Amma<br />
projeta sur le sol le « sang de la rate », qui se<br />
transforma en masse métallique, sagala, que les<br />
forgerons devaient par la suite exploiter, avant<br />
d’extraire le fer des minerais terrestres...» (6)<br />
(6) Opus cité p. 10, 12 et 11.<br />
33
34<br />
Les météorites sont des corps d’origine extraterrestre<br />
(ce fait n’a été accepté que depuis l’étude<br />
de Biot en 1806). Elles se classent principalement<br />
en trois catégories : 6 % sont des bolides<br />
de fer, 92 % des pierres et 2 % seulement un<br />
mélange des deux. Leur taille varie considérablement<br />
et il va sans dire que leur nombre évolue en<br />
proportion inverse de leur volume. La plus grande<br />
dont la Terre ait gardé la trace (ne pas oublier<br />
que les océans couvrent 71 % de la surface du<br />
globe) se trouve en Bavière : le Ries a 30 km de<br />
diamètre et a chuté au Miocène, il y a 22 millions<br />
d’années. Le plus spectaculaire se trouve être le<br />
Meteor Crater en Arizona ; d’un diamètre de 1<br />
200 m, il a été formé par la chute d’une masse de<br />
fer de huit milliards de tonnes il y a 75.000 ans.<br />
Ce cratère a montré qu’une couronne de 8 km<br />
avait été éclaboussée de débris (le plus gros<br />
pesant 20 tonnes). De récentes prospections<br />
magnétiques ont révélé la présence de quatre<br />
blocs de fer enfouis à 570 m sous le fond du cratère,<br />
pesant plusieurs millions de tonnes. (7)<br />
Voilà qui ressemble assez à notre « enclume » et<br />
au « sang de la rate » éparpillé sur le sol, transformé<br />
en fer que les forgerons iront exploiter.<br />
Mais ce n’est pas aussi probant qu’on pourrait le<br />
croire à première vue. La forme des météorites<br />
est en général quelconque, mais il s’en trouve qui<br />
ont un centre de gravité convenablement placé<br />
de telle sorte qu’elles peuvent être maintenues<br />
dans une position d’attaque constante. Elles s’usent<br />
alors au frottement et à l’échauffement suivant<br />
une forme conique, pointe en avant. C’est<br />
ce qui leur permet de se ficher en terre pendant<br />
que leur base éclate. Or les Dogon précisent que<br />
« celle-ci tomba à l’envers », exactement comme<br />
nos capsules qui se présentent la base en avant,<br />
pour augmenter le freinage. Si, donc, le bolide de<br />
Bosumtwi avait une forme conique et qu’il descendit<br />
à l’envers du sens naturel, suivant un angle<br />
incident assez faible, il est possible qu’il ait pu<br />
ricocher après avoir creusé son cratère. Il peut<br />
également s’être retourné dans ce ricochet et<br />
s’être retrouvé « à l’endroit », se fichant dans le<br />
sol la pointe en bas. C’est ce que semble raconter<br />
le mythe. Malheureusement on n’a pas<br />
encore examiné la région du Bosumtwi dans cette<br />
hypothèse, ni recherché au sud un plateauenclume<br />
témoin de cet atterrissage peu orthodoxe<br />
sur le plan de la balistique naturelle. Mais la<br />
plaque de fer symbolique fichée au sommet de la<br />
colline sacrée de Koumassi, n’en est-elle pas la<br />
transposition mythique ? (Il va sans dire que la<br />
chose a pu se passer ainsi, beaucoup plus probablement,<br />
s’il s’est agi d’un bolide artificiel,<br />
qu’Amma aurait envoyé s’écraser sur Terre, comme<br />
nous avons envoyé nos <strong>LE</strong>M s’écraser sur la<br />
Lune en fin de mission.) Mais on peut aussi s’en<br />
tenir à une hypothèse moins difficile à imaginer,<br />
d’un éclat important ayant rejailli au moment de<br />
l’impact, vers le sud. C’est une hypothèse minimum.<br />
Les verres qu’on a trouvés dans le Bosumtwi, on<br />
l’a vu, s’apparentent aux tectites trouvées en<br />
Côte-d’Ivoire. Les tectites forment une catégorie<br />
d’objets célestes complètement différente des<br />
autres météorites. Ce sont des substances vitreuses<br />
(du grec « tectos » fondu) noires ou verdâtres<br />
constituant des masses en forme de boules,<br />
gouttes, baguettes ou disques (de quelques<br />
grammes à trois kilos). On les trouve dans des<br />
alluvions qui excluent toute origine volcanique<br />
terrestre et on n’a jamais observé de chutes de<br />
tectites. « Il est remarquable de constater que<br />
ces substances sont réparties dans diverses<br />
régions du globe (Bohême, Australie, Indochine,<br />
Schéma du ricochet : dans cette hypothèse, le talus A devrait être moins haut que le talus B. Ce qui est le<br />
cas, l’altitude étant de 150 m à l’ouest et de 550 m à l’est : soit trois fois plus ! La trajectoire d’arrivée serait<br />
dans ce cas ouest-est, ce qui est la meilleure trajectoire pour avoir la résistance minimale au frottement de<br />
l’air. Le ricochet peut fort bien avoir été combiné avec un dérapage, ce qui expliquerait le changement de<br />
direction vers le sud.
Insulinde) toutes situées, à l’exception de la Côted’Ivoire,<br />
au voisinage immédiat d’un même grand<br />
cercle de la Terre, ce qui permet de supposer<br />
avec A. Lacroix qu’elles proviendraient d’un même<br />
météore ayant fait le tour du globe à la manière<br />
d’un satellite» (8). Rappelons que nos capsules<br />
spatiales sont protégées par un bouclier en céramique<br />
à très haute résistance thermique, qui fond<br />
lors de l’entrée dans l’atmosphère et doit alors<br />
produire quelque chose comme des tectites. Si<br />
notre « enclume » s’est approchée d’ouest en est<br />
de son impact au Bosumtwi, elle a survolé la Côted’Ivoire<br />
juste avant de prendre contact, au moment<br />
donc où son bouclier pouvait produire des<br />
« tectites ».<br />
Les Dogon ajoutent encore que quand Amma « a<br />
envoyé l’enclume, le monde a grondé », confirmant<br />
ainsi une manifestation connue de tout bolide<br />
(dont les météorites) rentrant dans l’atmosphère<br />
à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde<br />
(40 à 70 pour les météorites classiques). On pourrait<br />
donc conclure en se rassurant : les Dogon<br />
décrivent en fait, la chute d’une gigantesque météorite<br />
de fer, boule incandescente et grondante,<br />
suivie d’une queue de flammes. Après avoir creusé<br />
un cratère, elle a projeté une pluie de fer à l’entour<br />
et un important débris vers le sud. Un homme<br />
de génie ayant eu l’idée d’utiliser ce métal nouveau<br />
pour faire des outils, la mythologie de ce<br />
nouveau maître-artisan a organisé la cosmogonie<br />
de la société transformée. Explication positive,<br />
marquée d’un a priori idéologique dialectique suspect<br />
à force d’être honorable !<br />
On sait que le mot « sidéral » vient du latin<br />
« sidus, sideris » qui veut dire « constellation ».<br />
On sait aussi que, parmi les métallurgies, celle du<br />
fer se nomme « sidérurgie », mot venant du grec<br />
« sideros » qui veut dire « fer ». On voit ainsi se<br />
dessiner nettement, par l’origine des concepts du<br />
langage, l’origine de ce que ces concepts désignent<br />
: le fer était d’origine sidérale, avant d’être<br />
extrait du minerai terrestre. Cela me fait penser à<br />
Nergal, dieu babylonien, associé à la fois à la forge<br />
et à la planète Mars ; planète qui passait, par<br />
sa brillance rouge, pour un astre fait de fer rougi<br />
au feu solaire. Et on a déjà fait le rapprochement<br />
entre Nergal et le Caïn biblique (9). Caïn veut dire<br />
« forgeron » en hébreu, et n’est-ce pas parce qu’il<br />
manipulait une matière tombée du ciel, donc divine,<br />
qu’il fut maudit par les dieux ? On a appris par<br />
l’ethnologie, que les forgerons étaient toujours des<br />
êtres (sinon des tribus) dangereux et tenus à part<br />
dans la société primitive. De même sera toujours<br />
considéré comme maudit, le fer et les outils ou<br />
armes de fer. Avec quelles précautions sacrificielles<br />
les paysans introduisaient-ils, il n’y a pas si<br />
longtemps encore, le soc de fer de leur charrue<br />
dans le premier sillon du labour.<br />
C’est une affaire entendue, l’ « invention » du fer<br />
est liée au mystère céleste de la chute de météorites<br />
ferreuses ; mais c’est oublier d’expliquer l’essentiel<br />
dans notre cas précis : comment les Dogon<br />
sont-ils devenus des « cosmolithologues » aussi<br />
éminents ? La chute de grosses météorites est fort<br />
rare. Celle du Bosumtwi ayant eu lieu il y a un<br />
million et demi d’années, il faut que les Dogon<br />
aient raisonné par analogie, comme nous le faisons,<br />
mais avec tout notre arsenal scientifique en<br />
moins. Pour qu’une telle analogie ait pu devenir<br />
une intuition consciente assez forte pour dominer<br />
la cosmogonie de tout un ensemble de peuples<br />
répartis sur une aire géographique grande comme<br />
plusieurs fois la France et couverte de forêts impénétrables,<br />
il aurait fallu qu’un assez grand nombre<br />
d’hommes aient pu assister ensemble et plusieurs<br />
fois à un phénomène semblable à celui décrit. Or<br />
les météorites ferreuses sont rares (6 %) et les<br />
gigantesques, rarissimes. Il serait tout à fait extraordinaire<br />
que des chutes de petites météorites<br />
ferreuses aient donné l’idée d’aller exhumer le lac<br />
Bosumtwi de son écrin de forêt équatoriale pour le<br />
placer au milieu d’une description mythique particulièrement<br />
pertinente sur le plan astrophysique.<br />
Les Dogon ne disent-ils pas aussi que l’enclume<br />
était le sang du « cœur du Nommo » ? Or on pense<br />
que ces météorites ferreuses sont les témoins<br />
du noyau d’une planète détruite qui occupait la<br />
position de la ceinture d’astéroïdes (entre Mars et<br />
Jupiter)... le « cœur d’un sacrifié » en quelque<br />
sorte !<br />
Peut-on enfin attirer l’attention sur le fait que la<br />
première forge mythique aurait été de dimension<br />
« industrielle » : une enclume de plusieurs kilomètres<br />
de diamètre, tout un arsenal venu du ciel ; et<br />
qui fut allumée avec le feu du Soleil que contenait<br />
le bolide. Ce feu du Soleil est, pour nous, une allusion<br />
à cette fusion lente de l’hydrogène dont les<br />
physiciens cherchent encore de nos jours à maîtriser<br />
la réaction. Cette forge, enfin, employait le<br />
sagala. Certes, dans cette partie du mythe, il est<br />
assimilé au fer sidéral. Mais n’oublions pas que,<br />
par ailleurs, le sagala est la matière extrêmement<br />
dense qui constitue la naine-compagnon de Sirius.<br />
On peut alors se poser une double question en<br />
forme alternative :<br />
— ou bien toute cette histoire n’est que l’archéty-<br />
(7) Pour ce qui concerne les météorites : P. Guérin<br />
- Planètes et Satellites - (Larousse) p. 83<br />
et ss ; — A. de Cayeux - La science de la Terre<br />
- (Bordas) p. 131 et ss ; — A. Beiser - La<br />
Terre - (Life-Jeunesse) p. 20 et ss ; — J. Orcel<br />
- Astronomie - (La Pléiade) p. 1239 et ss.<br />
(8) J. Orcel - L’Astronomie - (La Péliade) p. 1251-<br />
1252.<br />
(9) Alfred Boissier - Les Eléments Babyloniens de<br />
la Légende de Caïn et Abel - Imprimerie Albert<br />
Kündig - Genève 1909.<br />
35
36<br />
pe transcendé de la modeste forge primitive<br />
des tribus africaines d’il y a quelques millénaires<br />
? (et que d’énigmes alors !)<br />
— ou bien un atterrissage en plusieurs temps<br />
d’une complexe mission spatiale sur Terre, at-il<br />
été mémorisé par une identification avec<br />
des accidents naturels connus et des comportements<br />
types ?<br />
On retiendra à l’appui de cette deuxième partie<br />
de l’alternative que les Dogon ont utilisé les accidents<br />
de terrain de leur territoire pour retrouver<br />
les éléments d’une géographie mythique qui était<br />
nécessaire à la mémoire et au fonctionnement<br />
rituel de leur cosmogonie, telle qu’elle était véhiculée<br />
par leur culture à travers leurs différentes<br />
pérégrinations. Ce qui infirme de façon éclatante<br />
les théories animistes grossières (ou subtiles) qui<br />
veulent nous expliquer que les cosmogonies primitives<br />
sont le résultat du culte des forces et reliefs<br />
naturels transcendés. Or il apparaît au<br />
contraire on ne peut plus clairement que les accidents<br />
et forces de la nature n’induisent pas le<br />
culte, mais servent au contraire de support symbolique<br />
à une histoire, au sens strict du terme. Et<br />
quand la nature n’offre pas le support nécessaire,<br />
eh bien, on le fabrique : témoin en est la construction<br />
des collines artificielles que sont les ziggurats<br />
ou les pyramides.<br />
Cependant le cas du lac Bosumtwi résiste aux<br />
deux interprétations, car on oublie un peu vite<br />
que ce cratère a été formé il y a un million et<br />
demi d’années, et qu’aucun phénomène de ce<br />
genre ne s’est produit en Afrique depuis l’époque<br />
de la découverte du fer, il y a peut-être trois à<br />
quatre mille ans seulement. C’est oublier que<br />
l’Afrique d’il y a un million et demi d’années était<br />
peuplée d’australopithécinés, et qu’on imagine<br />
mal comment leur souvenir de la chute du Bosumtwi<br />
aurait pu se transmettre jusqu’à nos<br />
jours ! C’est la seule solution humaniste, mais<br />
son extrémisme la rend insoutenable... à moins<br />
de remettre en cause d’autres postulats humanistes<br />
sur la culture et sa transmission.<br />
Les recherches actuelles de la mission Dieterlen<br />
mettent en lumière l’extraordinaire « mémoire »<br />
des traditions des peuples de cette région : Dogon<br />
bien sûr, mais aussi Bambara, Malinké et<br />
Sarakollé. Tous s’accordent à dire qu’ils sont<br />
issus d’une civilisation (néolithique) vraisemblablement<br />
située dans le Sahara à une époque pas<br />
si ancienne où il était verdoyant ; qu’ils descendirent<br />
il y a quelques 4000 ans environs dans le<br />
Sahel, délogeant les habitants qui y vivaient, les<br />
Tellem, dont les archéologues ont en effet retrouvé<br />
les vestiges ; et enfin qu’avant les Tellem, au<br />
temps de la civilisation saharienne, et bien avant<br />
encore, l’Afrique forestière qui devait recouvrir le<br />
Sahel lui-même et une partie du Sahara, était<br />
peuplée d’une façon très clairsemée par « les<br />
petits hommes rouges », sorte de pygmées qui<br />
disparurent devant l’invasion des hommes. Or ne<br />
voit-on pas sur des objets égyptiens de la période<br />
thinite (10) les envahisseurs nubiens dominer,<br />
culbuter ou tuer de petits hommes qui habitaient<br />
ces régions avant eux (à l’époque où le Sahara<br />
était verdoyant, la vallée et le delta du Nil devaient<br />
être aussi luxuriants et impénétrables que<br />
le cours de l’Amazone).<br />
Madame Dieterlen a trouvé des sanctuaires bambara<br />
où sont conservés les témoins et les mémoires<br />
d’une chronologie des différents âges de la<br />
civilisation humaine avec des outillages de bois,<br />
de pierre et de fer, suivant une séquence que<br />
nous n’avons reconnue que depuis cent ans à<br />
peine (11). Et elle incline à penser que la mémoire<br />
culturelle de l’Afrique remonterait si loin...<br />
qu’on ose à peine envisager les implications psychosociologiques<br />
d’une telle hypothèse ! Mais<br />
dans cette hypothèse même, pour aussi hardie et<br />
révolutionnaire qu’elle soit, on n’explique pas<br />
comment a pu se constituer l’histoire de cette<br />
cosmonautique, a fortiori issue du petit cerveau<br />
de nos ancêtres préhominiens ! On ne s’en sortira<br />
jamais que par des haussements d’épaules,<br />
tant qu’on n’osera pas regarder les choses en<br />
face et sans exclusion a priori sur la nature des<br />
hypothèses à formuler pour expliquer les mythes<br />
d’incursions extraterrestres... de navigations spatiales...<br />
et d’engins célestes...<br />
© <strong>Eric</strong> <strong>Guerrier</strong> et R. Laffont éd., 1975.<br />
« Essai sur la cosmogonie des Dogon »).<br />
(10) Palette prédynastique au British Museum<br />
(Egypte ancienne, Hachette, p. 142) - Palette<br />
prédynastique du Louvre (oc. p. 143) - Palette<br />
du Roi Narmer (Empire thinite, IV e millénaire<br />
av. J.-C.) au Musée du Caire (oc. p. 144) -<br />
Couteau en silex et ivoire dit « de Djebel el-<br />
Arak » du Louvre (env. 3 000 ans av. J.-C.)<br />
(oc. p. 145), par exemple faciles à trouver.<br />
(11) Boucher de Perthes est mort en 1868.<br />
OFFRE<br />
KADATH<br />
Deux ouvrages essentiels cotés 3K<br />
dans la collection<br />
« Les portes de l’étrange »<br />
● ERIC GUERRIER<br />
Essai sur la cosmogonie des Dogon<br />
(256 pages - 340 FB)<br />
● Présenté par FRANCIS MAZIERE<br />
Le Livre d’Enoch<br />
(196 pages - 245 FB)<br />
Par règlement de la somme indiquée, à l’ordre de<br />
Prim’édit (les frais d’envoi sont compris).
Post scriptum<br />
<strong>LE</strong> LIVRE D’ENOCH<br />
(Editions Robert Laffont, 1975)<br />
KADATH n° 3 :<br />
«Heureux qui comme Hénoch… »<br />
Voici l’un des plus insolites et remarquables messages<br />
de la Bible apocryphe, celui du célèbre Patriarche<br />
Enoch, septième après Adam, descendant de<br />
Seth et ancêtre de Noé. Peut-être est-il bon d’expliquer<br />
que les apocryphes (du grec, apokruphos : tenu<br />
secret) sont des textes inspirés, dont la teneur est<br />
réputée suspecte et qui sont rejetés par les docteurs<br />
de la religion qui confectionnèrent le dogme. La structure<br />
des écrits admis à figurer dans le Canon religieux<br />
fut souvent modifiée par les différents Conciles,<br />
notamment par le Concile de Laodicée qui fit défense<br />
de parler des Anges et des hiérarchies divines, d’où<br />
l’exclusion d’un certain nombre de documents. De ce<br />
fait, l’ensemble des apocryphes — où figure notre<br />
Livre d’Enoch — a été écarté du public et il n’est pas<br />
aisé d’y avoir accès, encore moins de pouvoir trouver,<br />
à l’heure actuelle, le recueil complet en librairie.<br />
Pour expliquer ce camouflage, dès le IIIe siècle, Origène,<br />
l’un des plus grands parmi les Pères de l’Eglise<br />
primitive, affirme dans une lettre adressée à Africanus,<br />
que les Docteurs juifs ont pour habitude de<br />
soustraire à la connaissance des fidèles, tout ce qui<br />
risque d’engendrer le doute, l’accusation ou la<br />
contestation à l’encontre du dogme, des prêtres, des<br />
princes et des juges, ce qui, ne les empêche pas, ditil,<br />
de conserver précieusement les ouvrages de ce<br />
genre parmi leurs livres apocryphes ou secrets. Tel<br />
est le sort de ces documents initiatiques, dont le seul<br />
défaut est de bouleverser quelque peu les croyances<br />
établies, d’où l’impitoyable mise à l’index selon l’influence<br />
des opinions et des caprices théologiques.<br />
Mais, en dépit de sa suppression du Canon des Ecritures,<br />
Enoch n’en est pas moins cité plusieurs fois<br />
dans le corpus biblique traditionnel, notamment par<br />
saint Jude dans son Epître (14), puis dans l’Ecclésiastique<br />
ou Siracide (44, 16 ; 49, 14), Luc (3,37),<br />
Hébreux (11, 5). Après le VIII e siècle, le Livre<br />
d’Enoch n’était plus connu que par un petit nombre<br />
de passages conservés dans les anciens auteurs<br />
ecclésiastiques et par deux fragments grecs assez<br />
étendus, insérés dans les œuvres de Cedrenus et de<br />
Georges le Syncelle. Le Livre d’Enoch ne nous fut<br />
révélé en entier que par une version éthiopienne dont<br />
on doit la découverte au célèbre voyageur anglais<br />
Bruce, qui réussit à trouver vers la fin du XVIII e siècle,<br />
trois splendides manuscrits abyssins qu’il ramena<br />
en Angleterre. Un savant anglais, le Dr. Laurence, fut<br />
le premier à faire connaître l’intégralité du Livre<br />
d’Enoch, traduit et publié en 1821, en y joignant une<br />
introduction et des notes. Par la suite, plusieurs éditions<br />
parurent en Angleterre, en Allemagne et en<br />
France, en particulier celle de l’abbé Migne qui reprit<br />
la traduction de Laurence dans sa monumentale Encyclopédie<br />
théologique composée de soixante volumes.<br />
Nous lui sommes redevables de la présente<br />
édition, conforme à celle de son « Dictionnaire des<br />
Apocryphes » (Tome 23), paru en 1856 à Paris.<br />
On s’interroge encore sur l’époque exacte de la rédaction<br />
du Livre d’Enoch. Au XIX e siècle, Laurence et<br />
Hoffmann la situait vers le tout début du règne<br />
d’Hérode le Grand, soit environ 40 ans avant J.-C. Un<br />
autre savant, Boettcher, était d’avis que le Livre<br />
d’Enoch, de même que les Oracles des Sibylles,<br />
n’avait pu être formé qu’au premier siècle avec différents<br />
fragments composés à des époques bien antérieures.<br />
Enfin, pour Ditlman, la date supposée pouvait<br />
être située facilement vers 150 avant l’ère chrétienne.<br />
A l’heure actuelle et de toute évidence, compte tenu<br />
des recherches effectuées sur les manuscrits de la<br />
mer Morte, on est certain que le Livre d’Enoch a été<br />
rédigé à l’origine en hébreu et plus précisément en<br />
hébreu archaïque dit « écriture phénicienne », voire<br />
en araméen. C’est bien à ce dialecte qu’il faut rapporter<br />
tous les noms des anges qui sont cités dans le<br />
Livre. Dans les rouleaux de la mer Morte découverts<br />
en 1947, 1949 et les années suivantes, on a trouvé<br />
plusieurs fragments d’apocryphes rédigés en phénicien<br />
et en araméen. Il semble possible de situer la<br />
rédaction vers l’époque du règne d’Alexandre le<br />
Grand, soit au III e siècle avant J.-C. Il est également<br />
prouvé que le texte était largement connu et commenté,<br />
bien avant le début de l’ère chrétienne, ne<br />
serait-ce que la citation de saint Jude, comme il a été<br />
dit plus haut. Par ailleurs, le « Sepher Ha-Zohar » (Le<br />
Livre de la Splendeur), monumental commentaire<br />
ésotérique du Pentateuque et base de la Kabbale<br />
hébraïque, fait mention à plusieurs reprises du Livre<br />
d’Enoch, comme d’un livre conservé de génération<br />
en génération. On a également avancé l’hypothèse<br />
que le rédacteur pouvait appartenir à la secte des<br />
Esséniens, contemporains du règne d’Alexandre le<br />
Grand. On retrouve effectivement chez les Esséniens<br />
la croyance aux mondes angéliques et les adeptes<br />
devaient obligatoirement connaître le nom des anges<br />
et conserver précieusement les écrits qui en gardaient<br />
le souvenir, tout en menant une vie austère et<br />
contemplative.<br />
Fabricius, dans son « Codex pseudographus Veteris<br />
Testaments » cite plus de vingt auteurs qui font allusion<br />
au Livre d’Enoch. Il expose également les différentes<br />
opinions des Pères de l’Eglise sur ce livre<br />
fameux entre les apocryphes, d’où il ressort qu’il était<br />
connu bien longtemps avant l’avènement de Jésus-<br />
Christ. On reconnaît que divers auteurs juifs postérieurs<br />
à l’ère chrétienne lui ont fait de larges emprunts.<br />
Le Livre d’Enoch est souvent mentionné dans<br />
les Testaments des Patriarches, autres apocryphes,<br />
ce qui confirme encore l’ancienneté du texte. Enfin,<br />
dès le IVe siècle, l’Eglise cesse de s’en occuper. On<br />
en trouve des traces plus prolongées dans l’Eglise<br />
grecque et, bien sûr, dans le Canon abyssin où il<br />
trouve place immédiatement après le Livre de Job.<br />
Indépendamment des considérations d’antiquité, le<br />
Livre d’Enoch est un texte infiniment respectable,<br />
dont le moins qu’on puisse dire, est qu’il nous entraîne<br />
bien au delà des banales croyances, offrant une<br />
vue vertigineuse sur les univers, sur les personnalités<br />
de l’Esprit Infini, enfin sur l’histoire de notre planète et<br />
de ses habitants. De cette lecture se dégage une<br />
impression curieusement troublante, à laquelle on a<br />
peine à se soustraire.<br />
Francis Mazière.<br />
Cote : 3K<br />
(= excellent, digne de servir de référence).<br />
37
38<br />
L’ARCHEOLOGIE DEVANT L’IMPOSTURE<br />
(Editions Robert Laffont, 1975)<br />
Jean-Pierre ADAM<br />
KADATH n° 7 : Spécial Glozel.<br />
Concluant leur mise à jour de ce qui se passe actuellement<br />
à Glozel (KADATH n° 13, mai 1975), nos rédacteurs<br />
émettaient le vœu « que la nouvelle affaire de<br />
Glozel ne quitte pas les limites d’une recherche scientifique<br />
constructive ». Ce souhait est en passe de se<br />
réaliser, grâce aux chercheurs qui se sont retrouvés<br />
tout récemment au congrès d’Oxford. Jean-Pierre<br />
Adam, lui, qui n’est pas au courant, s’est fait un devoir<br />
d’orchestrer une nouvelle cabale antiglozélienne, aussi<br />
rétrograde que ridicule. Et lorsqu’on apprend que cet<br />
homme se prévaut du CNRS, on est en droit de se<br />
demander qui a intérêt à détourner ainsi la recherche<br />
française de ses véritables objectifs. Car de deux choses<br />
l’une : ou bien l’auteur n’est vraiment au courant<br />
de rien, et il ferait mieux de ne pas étaler davantage<br />
son ignorance ; ou bien certains secteurs de la recherche<br />
tentent, par ce biais, d’en discréditer d’autres. Il fut<br />
un temps où, négligeant les travaux des Monod, Jacob<br />
et autres futurs Prix Nobel, l’Union Rationaliste lançait<br />
des pamphlets contre la revue Planète. Il fallut que<br />
celle-ci publiât une bibliographie complète et mise à<br />
jour, à l’usage de ces « messieurs en noir », éteignoirs<br />
de la recherche française. Les temps n’ont guère<br />
changé, et voilà qu’il nous faut prendre la relève en<br />
archéologie. Il est quand même ahurissant de constater<br />
que nous devons recycler quelqu’un qui enseigne à<br />
l’Institut d’Art et d’Archéologie de Paris ! Mais tant pis,<br />
mouchons donc.<br />
Pour M. Adam, l’affaire de Glozel débute en 1963 avec<br />
« Histoire inconnue des hommes » et se termine en<br />
1929 avec le rapport Bayle. Singulier compte à rebours<br />
! Si l’auteur avait lu autre chose, il saurait que, à<br />
part Charroux, personne n’avait parlé d’Atlantes à<br />
Glozel. Il saurait aussi que le rapport Bayle, complètement<br />
truqué, a été réfuté point par point par le Dr.<br />
Morlet dans son « Petit historique de l’affaire de Glozel<br />
». A l’époque de notre numéro spécial, nous n’avions<br />
donc, par manque de place et d’intérêt, accordé<br />
aucune attention à cette pantalonnade. Mais si M.<br />
Adam y tient tellement — au point d’en reproduire 18<br />
pages ! —, voici quelques réponses essentielles qu’il<br />
s’est bien gardé de donner. M. Bayle démontre (!) que<br />
trois (!) tablettes sont fausses et de fabrication récente<br />
:<br />
— un fragment trempé dans l’eau s’y délite. Déjà à<br />
l’époque on savait pourtant que des tablettes assyriennes<br />
avaient subi le même sort ; mais on ne met<br />
pas en doute l’authenticité de tablettes assyriennes.<br />
— Bayle prétend avoir retrouvé des inclusions de chlorophylle,<br />
et compare leur dosage à celui qu’on trouve<br />
dans les herbiers du Museum, ceci pour situer la<br />
date de fabrication de la tablette. Or, ces herbiers<br />
sont, eux, à l’air libre et donc se dessèchent ; et<br />
déjà à l’époque, on n’ignorait pas que la chlorophylle,<br />
soustraite à l’action de l’air, peut se conserver<br />
durant des millénaires.<br />
— Bayle prétend aussi avoir retrouvé des fibres colorées,<br />
non pas naturellement mais à l’aide d’aniline.<br />
J.P. Adam ignore que, par la suite, M. Bayle luimême,<br />
lors d’une entrevue avec M. Bruet, viceprésident<br />
de la Société géologique de France, déclara<br />
avoir renoncé à faire état des filaments qui, de<br />
son propre aveu, pouvaient avoir été véhiculés par<br />
l’atmosphère. D’ailleurs le même M. Bruet ne trouva<br />
aucun débris contemporain dans les tablettes que<br />
lui-même examina, et il démontra que lesdites tablettes,<br />
de cuisson moyenne, avaient bien été cuites<br />
mais s’étaient ramollies suite à un long séjour<br />
dans le sol.<br />
Publier un rapport truqué, sans faire allusion à une<br />
quelconque réfutation, c’est de l’imposture si c’est<br />
délibéré, de l’ignorance ou de la légèreté si c’est involontaire.<br />
Et puisqu’il faut mettre les points sur les « i »<br />
ajoutons que le fameux M. Bayle est mort assassiné :<br />
ayant été chargé d’expertiser un contrat de vente prétendument<br />
falsifié, il l’avait tellement bien analysé que<br />
de la partie litigieuse il ne restait, après son analyse,<br />
plus aucune trace ! Toute contre-expertise était devenue<br />
impossible. L’accusé fut condamné, non pour<br />
falsification du contrat, mais pour meurtre sur la personne<br />
de M. Bayle.<br />
Questionné à ce sujet, à peine deux mois après parution<br />
de son livre, J.P. Adam reconnaît que, au moment<br />
de rédiger son manuscrit, il ignorait qu’on tenterait de<br />
dater Glozel par thermoluminescence. Si je vérifie<br />
dans l’ouvrage que j’ai sous la main, je constate qu’il<br />
fut « achevé d’imprimer le 8 octobre 1975 ». Je veux<br />
bien admettre un délai d’impression, mais veut-on me<br />
faire croire qu’il a été, en l’occurrence, de 18 mois ?<br />
Car déjà en mars 1974, et renvoyant à un éditorial<br />
précédent, la revue Antiquity donnait les premières<br />
datations pour quatre tablettes glozéliennes. Si M.<br />
Adam lisait les revues archéologiques, il aurait su.<br />
Mais apparemment, s’il ne lit pas Antiquity, il ne lit pas<br />
plus Sciences et Avenir : en mai de la même année,<br />
les renseignements y étaient repris par Henri de Saint-<br />
Blanquat. Qu’est-ce à dire ? Que si J.P. Adam était au<br />
courant des derniers travaux sur Glozel, il aurait tout<br />
simplement, par honnêteté intellectuelle, dû retirer ce<br />
chapitre de son manuscrit ! Mais amputer le livre du<br />
cinquième de son contenu, cela eût drôlement réduit la<br />
rentabilité de l’entreprise. Et si tout cela est malgré tout<br />
de bonne foi, c’est-à-dire s’il ne connaît pas Antiquity,<br />
je lui signalerai qu’on peut s’y abonner pour quatre<br />
livres sterling, à adresser à Antiquity Publications,<br />
Kings Hedges road, Cambridge CB42PQ. Et finalement,<br />
s’il ne lit pas l’anglais, je lui conseillerai, en désespoir<br />
de cause, d’essayer d’assister à l’une ou l’autre<br />
conférence de M. Henri Delporte, conservateuradjoint<br />
au Musée des Antiquités Nationales de Saint-<br />
Germain-en-Laye. Celle qu’il donna à Bruxelles le 23<br />
mai dernier, dans le cadre de l’exposition « Hommes<br />
de la Préhistoire », était suivie d’un débat. A son corps<br />
défendant, car ce n’était pas l’objet de son exposé,<br />
Henri Delporte se vit obligé de soutenir un feu croisé<br />
de questions concernant Glozel, auxquelles il répondit<br />
en substance qu’il ne s’agit pas d’être pour ou contre,<br />
que la science c’est autre chose, et que d’autres analyses<br />
devraient être faites, non pour prouver que Glozel<br />
est vrai ou faux, mais pour en préciser la nature. Jean-<br />
Pierre Adam y aurait appris beaucoup de choses. (1)<br />
L’affaire est entendue. Si Glozel poursuit sur sa lancée,<br />
gageons que M. Adam suivra une courbe inverse.<br />
Mais la conclusion, nous la laisserons à Henri François,<br />
chef du service de dosimétrie physique au Centre<br />
d’Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses, qui travaille<br />
précisément à la datation de Glozel. Dans une<br />
lettre datée du 7 avril dernier — qu’Emile Fradin aurait<br />
volontiers soumise à Jean-Pierre Adam s’il s’était fait la<br />
peine de se déplacer jusqu’en Auvergne… —, voici ce<br />
qu’il écrit audit Fradin : « De retour du congrès d’Oxford,<br />
je m’empresse de vous écrire car cette fois toute
la polémique a cessé ! Les explications, les preuves<br />
physiques, les résultats des vérifications que nous<br />
avons présentés ont eu raison des plus entêtés et j’ai<br />
compris que tout allait mieux lorsque nos collègues<br />
britanniques sont intervenus pour discuter sérieusement<br />
l’origine de l’écriture de Glozel sans provoquer en fin de<br />
congrès le moindre remous dans la salle. L’ambiance<br />
était bien différente de ce qu’elle fut l’an dernier. Je<br />
veux vous féliciter et vous dire ma joie. Seuls quelques<br />
attardés mal informés pourront encore prétendre que<br />
vous êtes un faussaire. Les recoupements des mesures<br />
faites indépendamment dans chaque laboratoire sont<br />
parfaits et indiscutables. Toutes les précautions ont été<br />
prises. ».<br />
Parmi ces « quelques attardés mal informés», Jean-<br />
Pierre Adam figure en bonne position. Pauvre Tartuffe,<br />
le voilà revenu à Gozel !<br />
Le Ministère de la Culture abusé par Emile Fradin (ici<br />
devant sa ferme-musée), malgré les mises en garde de<br />
M. Adam ? Vous savez bien, cet « archéologue » français<br />
qui s’attaque à Glozel sans jamais y avoir mis les<br />
pieds...<br />
Enfin, le 4 février dernier, le même Henri François nous<br />
écrivait une longue lettre, dont j’extrais ces quelques<br />
passages : « Dans l’état actuel de la question, on peut<br />
conclure de la façon suivante :<br />
1. Les céramiques et poteries de Glozel ne sont pas<br />
des faux.<br />
2. Elles datent de — 2500 à — 2000 ans à partir de nos<br />
jours.<br />
(1) Remarquons que, pas plus pour Stonehenge que<br />
pour Glozel, Jean-Pierre Adam ne semble se préoccuper<br />
de suivre l’actualité de près. Ainsi, sa seule<br />
référence concernant les travaux de Hawkins à Stonehenge,<br />
renvoie à un article paru dans la « Revue<br />
archéologique » début 1965, alors que la polémique<br />
n’a été (provisoirement) close dans Nature qu’en<br />
1967. Ignorant délibérément les résultats de la dendrochronologie,<br />
il en attribue encore la construction<br />
aux Mycéniens. Mais ce qui est plus grave, pour<br />
minimiser le problème du transport des pierres depuis<br />
leur carrière, il en donne la distance... à vol<br />
d’oiseau ! Alors que par voie de mer, il faudrait trois<br />
fois plus, et en trajet combiné terre-mer, le double.<br />
3. Les inscriptions sont réellement contemporaines des<br />
tablettes et des objets en céramique qui les portent,<br />
et n’ont pas été gravées après que les tablettes aient<br />
été cuites.<br />
4. On attend la confirmation des résultats déjà obtenus<br />
sur des ossements. Les travaux sont en cours.<br />
5. Les résultats obtenus par Madame le Docteur Lemercier<br />
du Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble,<br />
qui a tracé des courbes isomagnétiques sur le<br />
Champ des Morts et sur des terrains voisins, font<br />
apparaître des « anomalies ». Ceci implique l’ouverture<br />
de nouvelles fouilles ou sondages aux emplacements<br />
détectés magnétométriquement.<br />
6. Les signes de Glozel sont actuellement étudiés en<br />
Angleterre par le Professeur Isserlin.<br />
7. Le laboratoire américain dirigé par le Professeur<br />
Zimmerman a montré que les objets de Glozel n’avaient<br />
pas pu recevoir d’irradiation parasite, éventuellement<br />
faite par un faussaire bien équipé ou très<br />
compétent, en vue de tromper les dosimétristes nucléaires.<br />
Il convient donc d’être patient. La vérité à l’habitude<br />
d’attendre... et il semble qu’en archéologie elle doive<br />
attendre encore plus longtemps. Glozel n’est donc pas<br />
un faux. De nombreux problèmes restent cependant<br />
posés, mais on peut être certain qu’on leur trouvera un<br />
jour une solution. Le mérite de la méthode nucléaire a<br />
été de permettre la réouverture du dossier sur des bases<br />
saines. Nous sommes persuadés que les accusations<br />
passionnées, les hypothèses pseudo-scientifiques,<br />
les expertises scientifiquement dépassées et avancées<br />
lors de la « guerre des briques » feront un peu sourire.<br />
La patience et la sérénité conduisent inéluctablement à<br />
la vérité. Et encore : J’ai lu avec intérêt le livre de Monsieur<br />
Adam, intitulé « L’archéologie devant l’imposture »<br />
et étant, comme vous l’avez été, indigné par les passages<br />
consacrés à Glozel, je lui ai écrit. Monsieur Adam<br />
m’a répondu ; sa bonne foi est entière mais il manquait<br />
d’informations car sa bibliographie a été arrêtée en<br />
1973. Monsieur Adam va venir visiter nos services, mais<br />
le mal est fait : il a envoyé de l’eau au moulin antiglozélien,<br />
ce qui n’était pas nécessaire. L’article lamentable<br />
d’Historia avait fait assez de dégâts, car la mise au point<br />
est passée inaperçue. Monsieur Adam, qui possède des<br />
titres importants, qui bénéficie de la télévision et, en<br />
outre, d’un article sur quatre colonnes dans le Figaro du<br />
31 janvier dernier, aura fait sans le vouloir, beaucoup de<br />
tort. Les expériences de Bayle sur la « solubilité » des<br />
briques feraient rire, si leurs conclusions n’avaient pas<br />
de conséquences dramatiques et anti-scientifiques. Il<br />
est probable que les lecteurs de Monsieur Adam s’émerveillent,<br />
et disent qu’ « il est bon de savoir tant de<br />
choses ». (Fin de citation).<br />
Nous ne pouvions dès lors que sourire, lorsque J.P.<br />
Adam nous confia : « Quand vous saurez la réalité sur<br />
Glozel, vous rirez aux éclats. Je la connais déjà, mais je<br />
n’ai pas le droit de la publier ».<br />
Voilà un air connu chez les archéomanes, qui se disent<br />
grands initiés. Que M. Adam s’attaque à Robert Charroux,<br />
grand bien leur en fasse à tous les deux, mais ne<br />
substituons pas une fausse-monnaie à une autre ! Ou<br />
alors, qu’il lui écrive une lettre ouverte quelconque.<br />
Parce que tout le livre est à l’avenant, et que l’auteur n’a<br />
mis les pieds pratiquement sur aucun site dont il parle,<br />
cet ouvrage d’humeur ne mérite qu’une cote d’humeur.<br />
Ivan Verheyden.<br />
Cote — K<br />
(= brouille les pistes et sème la confusion).<br />
39
40<br />
STONEHENGE<br />
(Ed. Robert Laffont, 1974)<br />
Fernand NIEL<br />
KADATH n° 4 : Spécial Stonehenge.<br />
Je croyais lire un ouvrage d’un autre temps. Paru en<br />
1960, il eût été d’actualité ; aujourd’hui, il ne l’est plus.<br />
On pense à Inigo Jones qui se serait égaré au XX e siècle.<br />
Tout compte fait, voilà la version française du livre<br />
de Mr. Atkinson. Et encore ! Atkinson, poussé par les<br />
nouvelles datations, a été contraint d’amender sa chronologie<br />
; Fernand Niel, lui, s’en tient à la première version.<br />
A le lire, le monde s’est arrêté, à Stonehenge, en<br />
1956. Et Gerald Hawkins, dont les travaux ont suscité<br />
quatre ans de polémiques entre Nature et Antiquity, est<br />
relégué en appendice d’à peine cinq pages. D’ailleurs,<br />
rien que le cycle métonique, auquel Diodore de Sicile fait<br />
pourtant allusion, Niel n’a pas l’air d’en avoir entendu<br />
parler. Et pourtant l’auteur semble avoir l’intuition de<br />
l’aspect fantastique du monument. Mais cela ne l’émeut<br />
guère et ne l’incite pas plus à se poser trop de questions.<br />
En fin de compte, cette intuition relève-t-elle d’autre<br />
chose que d’une certaine poésie un peu surannée ?<br />
En filigrane, on décèle néanmoins la plupart des mystères<br />
de Stonehenge, mais aussi l’indigence des explications<br />
fournies. Voici d’ailleurs quelques-uns de ces défis<br />
et ce que Niel est bien obligé de constater à leur sujet.<br />
Les bords de l’Avenue, sans être toujours visibles depuis<br />
leur point de départ, sont parallèles et rectilignes sur 665<br />
mètres, ce qui prouve que les topographes connaissaient<br />
leur métier ; le système des joints en V pour les-<br />
linteaux relève du travail de charpente et non de la pierre<br />
; aucune table de dolmen connu ne se trouve à plus<br />
de quatre mètres de haut, sauf à Stonehenge, où les<br />
linteaux des trilithes sont tous plus haut que cela et atteignent<br />
même les 6 m 50 ; quel que soit le nombre des<br />
linteaux, ils devaient, une fois mis bout à bout, dessiner<br />
une courbe régulière, ce qui est le cas, et encore bien<br />
avec une longueur identique pour tous les linteaux : or,<br />
se fixer à l’avance la longueur d’une circonférence implique,<br />
qu’on le veuille ou non, la connaissance d’une valeur<br />
de π. (Et combien de paysans, de nos jours, sauraient<br />
diviser une circonférence en trente parties égales<br />
?). Signalons aussi que Pythagore est souvent présent<br />
dans le livre de Fernand Niel, mais j’y vois plutôt<br />
une concession à l’harmonie grecque : Mycènes, n’estce<br />
pas, et son cortège de mirages de l’Orient !<br />
Devant cette avalanche d’impossibilités, un traditionaliste<br />
comme Fernand Niel ne peut qu’appliquer la politique de<br />
l’autruche. Concernant le tracé du site : « On devrait<br />
admettre qu’étant donné une droite, un diamètre quelconque<br />
par exemple, on savait élever une perpendiculaire<br />
à cette droite en son milieu. Il s’agit de notions de<br />
géométrie élémentaire, mais cela supposerait qu’un<br />
« saut » vers la science pure et l’abstraction avait été fait<br />
à cette époque et en ce lieu. Cela nous paraît peu vraisemblable<br />
de la part des hommes du néolithique secondaire<br />
» (p. 204). Concernant l’astronomie mégalithique<br />
: « Cependant, nous n’osons guère songer (c’est<br />
moi qui souligne) qu’il en fut ainsi, car Stonehenge eût<br />
été alors le plus précis des observatoires solaires du<br />
monde ancien. Nous ne connaissons rien d’équivalent<br />
» (p. 258). Il faut lire ce qu’il envisage rien que pour<br />
la construction d’un « henge monument » en terre : c’est<br />
à peine si le terrassement n’est pas déjà au-dessus des<br />
forces de ces peuplades armées de bois de cerfs et<br />
d’omoplates. Quant au monument en pierre... Surtout<br />
que la solution par les remblais de terre ne tient pas, il le<br />
reconnaît : « Tous les trous n’ont pas une telle rampe ;<br />
c’est le cas pour les montants du trilithe 57-58... Pour le<br />
dressement de ces monolithes, il nous est impossible<br />
d’imaginer quoi que ce soit. Les difficultés à vaincre<br />
durent être si grandes, que nous considérons l’opération<br />
comme un véritable tour de force » (p. 236). Et il ne reste<br />
à Fernand Niel qu’une solution extrême : « Bien entendu,<br />
dit-il, ce peuple (des gobelets) aurait simplement<br />
fourni la main-d’œuvre, la confection du monument venant<br />
d’ailleurs » (p. 98). On s’en serait douté, et c’est<br />
très bien ainsi. Mais si c’est pour appeler Mycènes à la<br />
rescousse, non ! Comme deus ex machina, c’est aussi<br />
réussi que les extraterrestres... Si c’est çà la science<br />
officielle !...<br />
D’un conformisme désespérant donc en ce qui concerne<br />
les interprétations, ce livre est néanmoins remarquable<br />
de par la somme de renseignements fournis. En particulier,<br />
les 70 pages sur l’historique de Stonehenge, que<br />
nous avions dû réduire à trois, et qui se lisent comme un<br />
roman. Bref, un livre honnête, bien fait, gentil, et qui peut<br />
être mis entre toutes les mains. Nos maîtres d’école ne<br />
risquent pas de se voir poser des questions embarrassantes<br />
par des lycéens piqués au vif. Une source de<br />
contrariété aussi : la précision de mesures qui ne le sont<br />
pas en réalité. Je m’explique : en convertissant les pieds<br />
et les pouces anglais en mètres et centimètres, puis en<br />
faisant des moyennes à trois décimales, Fernand Niel<br />
arrive à des « 3,096 mètres pour la longueur d’un montant<br />
plus l’intervalle ». C’est du travail en chambre :<br />
tâchez de faire sur place des mesures à un centimètre<br />
près, et je vous promets bien du plaisir ! Rien que<br />
la rugosité des arêtes rend cela aléatoire. Et en tout<br />
état de cause, il est mathématiquement erroné d’aboutir<br />
à des précisions de l’ordre du millimètre, à<br />
partir de chiffres qui ne le sont qu’à un centimètre<br />
près. Etant donné que la bibliographie brille par son<br />
absence — hormis la brève allusion aux dépliants<br />
vendus un shilling aux touristes... — nous ne pourrons<br />
plus guère parler d’un ouvrage de référence au<br />
sens strict sauf, comme je l’ai dit, pour les descriptions<br />
techniques qui en font l’objet. S’il faut lire un<br />
autre ouvrage, prenez « Stonehenge decoded » de<br />
Gerald Hawkins (Fontana Books, n° 2315). Mais si<br />
vous voulez une analyse contradictoire des interprétations,<br />
de toutes les interprétations, achevez votre<br />
tour d’horizon en relisant le numéro 4 de KADATH,<br />
Spécial Stonehenge : il n’a pas vieilli.<br />
Ivan Verheyden<br />
Cote : 2K<br />
(= bon, à condition d’en lire d’autres).<br />
P.S. S’il vous arrive, à juste titre, de vous plaindre<br />
que les vandales sont dans nos murs, apprenez qu’à<br />
la fin de la Première Guerre, un aérodrome fut aménagé<br />
près d’Amesbury, et que les autorités militaires<br />
demandèrent la destruction du cromlech, sous prétexte<br />
qu’il constituait un danger pour les avions volant<br />
à basse altitude... Stonehenge l’a échappé belle !<br />
Source des illustrations : China Institute in America - Joan M. Hartman, p. 2 — Jean-Philippe Lauer,<br />
p. 7 — d’après Jean-Pierre Adam, p. 9 — Sprague de Camp, d’après Diels, p. 13 — American Philosophical<br />
Society - de Solla Price, p. 15-16 — Vadime Elisseeff, p. 18 — William Mac Quitty, p. 21 — National Geographic<br />
Society - Davis Meltzer, p. 22 — China Pictorial, p. 23-24 — © Albert Szafarz, p. 26 — National Museum of<br />
Korea, p. 28 — Le Million - Pierre-A. Pittet, p. 30 — Atlas - C. Lefèvre. p. 31 — © <strong>Eric</strong> <strong>Guerrier</strong>, p. 34 et d’après<br />
Griaule-Deterlen, p. 33 — Elie Rousseau, p. 39.