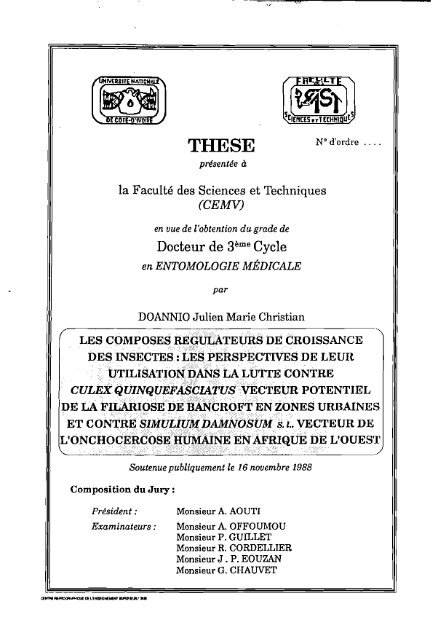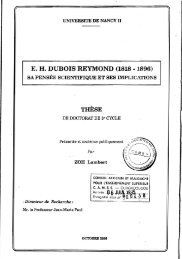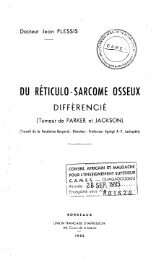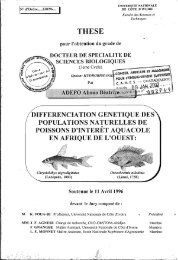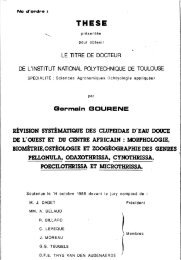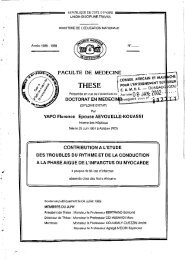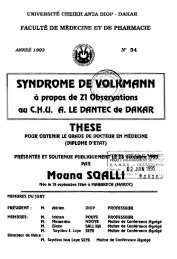tt151'
tt151'
tt151'
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AVANT PROPOS<br />
==============================
- 1 -<br />
Dans les régions tropicales et singulièrement en Afrique, de nombreuses<br />
maladies sont transmises par des insectes (paludisme, filariose de Bancroft, trypanoso<br />
miase, onchocercose etc••••). La chimiothérapie parfois inexistante ou difficilement<br />
applicable en campagne de masse fait de la lutte contre les vecteurs la principale<br />
arme contre ces maladies. Cette lutte antivectorielle peut être menée de diverses ma<br />
nières dont principalement la lutte écologique, la lutte génétique, la lutte chimique<br />
et la lutte biologique.<br />
Avec l'avènement du DDT et ultérieurement de nombreux autres composés<br />
chimiques (organochlorés, organophosphorés, carbamates et pyréthrinoYdes) la lutte chi<br />
mique a été pendant longtemps la méthode la plus efficace. Malheureusement ces der<br />
nières années, l'utilisation de ces insecticides chimiques se heurte au double problème<br />
de la résistance des insectes aux produits utilisés et de la pollution des écosystèmes.<br />
Cette situation compromet dangeureusement de nombreux programrres de lutte anti<br />
vectorielle et impose "ipso facto" la recherche de nouveaux types d'insecticides à mo<br />
de d'action différent.<br />
C'est dans ce cadre que se situe le présent travail. Des formulations diffé<br />
rentes de douze (12) composés d'une nouvelle famille d'insecticides, les régulateurs de<br />
croissance ou inhibiteurs du développement des insectes, ont été testées sur des popu<br />
lations préimaginales (larves et nymphes) de deux importants vecteurs dans les condi<br />
tion naturelles : Culex quinquefasciatus Say 1823, vecteur potentiel de la Filariose de<br />
Bancroft ou éléphantiasis et Simulium damnosum s.l. vecteur de l'onchocercose ou céci<br />
té des rivières en Afrique de l'Ouest.<br />
Ce travail a été réalisé en Côte d'Ivoire à l'Institut Pierre RICHET de<br />
l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la lutte contre les Grandes<br />
Endémies (OCCGE).<br />
Au cours de cette étude, nous avons pu bénéficier de subventions sous forme<br />
de contrats de recherches passés entre l'OCCGE et l'Organisation Mondiale de la<br />
Santé et plus précisément le Programme Spécial de Recherche et de Formation sur les<br />
maladies tropicales (OMS/TOR) et le Programme OMS de Lutte contre l'Onchocercose<br />
en Afrique de l'Ouest.<br />
Nous avons également pu bénéficier tout au long de ce travail de l'aide<br />
morale et matérielle de nombreuses personnes, aide sans laquelle cette étude n'aurait<br />
pu aboutir. Il m'est donc particulièrement agréable de remercier ici :
- 2 -<br />
- Monsieur Le Ministre de la Santé Publique du Burkina Faso pour mon<br />
détachement à l'OCCGE.<br />
- Monsieur Le Ministre de la Santé Publique et de la Population de Côte<br />
d'Ivoire pour l'intérêt particulier qu'il accorde aux travaux de recherches de l'Institut<br />
Pierre RICHET.<br />
- Monsieur le Docteur E. AKINOCHO, Secrétaire Général de l'OCCGE qui<br />
a bien voulu m'autoriser à rédiger ce travail à l'Institut Pierre RICHET.<br />
- Monsieur le Docteur T. C. NCHINDA, Directeur du Programme Spécial<br />
de Recherche et de Formation concernant les Maladies Tropicales de l'Organisation<br />
Mondiale de la Santé (OMS/TDR), pour l'intérêt particulier qu'il accorde à nos travaux.<br />
- Monsieur le Docteur G. QUELENNEC de l'Unité "Biologie et Contrôle<br />
des Vecteurs" de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour sa constante sollici<br />
tude et son étroite collaboration.<br />
- Monsieur le Professeur B. TOURE, Recteur de l'Université Nationale de<br />
Côte d'Ivoire, qui a bien voulu m'autoriser à soutenir cette Thèse à la Faculté des<br />
Sciences et Techniques.<br />
- Monsieur le Professeur J. DIOPOH, Doyen de la Faculté des Sciences<br />
et Techniques de l'Université Nationale de Côte d'Ivoire, pour les facilités adminis<br />
tratives qu'il m'a accordées.<br />
- Monsieur le Professeur A. AOUTI, Responsable du Laboratoire de Zoolo<br />
gie de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Nationale de Côte d'Ivoire<br />
pour sa grande sollicitude, ses encouragements et qui m'a fait l'honneur de présider<br />
le Jury de cette Thèse.<br />
- Monsieur P. GUILLET, du Programme OMS de Lutte contre l'Onchocer<br />
cose en Afrique de l'Ouest, ancien Responsable de l'Unité "Insecticides" de l'Institut<br />
Pierre RICHET, qui malgré ses nombreuses occupations a accepté d'assurer la Direc<br />
tion scientifique de ce travail. Qu'il trouve ici l'expression de ma vive reconnaissance<br />
et de mon indéfectible attachement.<br />
- Monsieur A. OFFOUMOU, Maître de Conférence, Chef du Département<br />
de Biologie et de Physiologie Animale de la Faculté des Sciences et Techniques de<br />
l'Université Nationale de Côte d'Ivoire, qui a accepté de siéger au Jury de cette<br />
Thèse.
- 3 -<br />
- Monsieur R. CORDELLlER, Directeur de Recherches de l'ORSTOM,<br />
Coordonnateur des Etudes du Centre Universitaire de Formation en Entomologie Médi<br />
cale et Vétérinaire (CEMV) pour l'intérêt particulier qu'il a accordé à ce travail, ses<br />
conseils précieux, ses encouragements et qui a accepté de siéger au Jury de cette<br />
Thèse.<br />
- Monsieur J.P. EOUZAN, Directeur de Recherches de l'ORSTOM, Directeur<br />
de l'Institut Pierre RICHET pour ses conseils, ses encouragements, sa constante sollici<br />
tude et les facilités matérielles qu'il m'a accordées pour la réalisation de ce document.<br />
Qu'il trouve ici l'expression de ma vive reconnaissance et ma profonde gratitude.<br />
- Monsieur M. DAGNOGO, Maître-Assistant, Directeur du Centre Universi<br />
taire de Formation en Entomologie Médicale et Vétérinaire (CEMV) de Bouaké, pour les<br />
facilités administratives et matérielles qu'il m'a accordées.<br />
- Monsieur G. CHAUVET, Directeur de Recherches, Responsable de l'Unité<br />
de Recherches ORSTOM sur les insecticides, qui a bien voulu s'intéresser aux résultats<br />
de nos travaux et accepté de siéger au Jury de cette Thèse.<br />
- Monsieur B. PHILIPPON, Chef de l'Unité de Contrôle des Vecteurs du<br />
Programme OMS de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest pour sa cons<br />
tante sollicitude.<br />
- Monsieur J. BRENGUES, Directeur de Recherches de l'ORSTOM, Chef<br />
du Département Santé de l'ORSTOM, Directeur-Fondateur du Centre Universitaire de<br />
Formation en Entomologie Médicale et Vétérinaire de Bouaké, pour ses conseils, ses<br />
encouragements et l'intérêt particulier qu'il accorde à nos travàux depuis notre sortie<br />
du CEMV.<br />
- Monsieur D. QUILLEVERE, Directeur de Recherches de l'OR5TOM, an<br />
cien Directeur de l'Institut Pierre RICHET qui, au début de ma carrière, m'a prodigué<br />
des conseils utiles et des encouragements.<br />
- Monsieur J.M. HOUGARD, avec qui j'ai eu le plaisir à travailler pendant<br />
deux ans à l'Institut Pierre RICHET.<br />
- Monsieur J. DUVAL, Ingénieur d'Etudes de l'ORSTOM qui, par son ingé<br />
niosité, son expérience et ses qualités humaines m'a permis de réaliser toutes mes<br />
expérimentations dans de bonnes conditions matérielles. Je lui en suis très reconnais<br />
sant.
- 4 -<br />
- Monsieur D. KURTAK, Responsable de l'Unité de Recherches sur les<br />
insecticides du Programme OMS de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest<br />
qui m'a fait bénéficier de son expérience d'homrre du terrain par ses conseils précieux.<br />
qu'il trouve ici l'expression de ma vive reconnaissance.<br />
- Messieurs S. TRAORE, S. DIARRASSOUBA, P.B. DIALLO, A.H. MEDA,<br />
C. LAVEISSIERE, J.J. LEMASSON et P. GREBAUT, Chercheurs et Techniciens à l'Ins<br />
titut Pierre RICHET pour leurs encouragements constants.<br />
- Mon Collègue et Ami J. DOSSOU-YOVO qui a contribué en grande par<br />
tie à la réalisation de ce travail.<br />
- Messieurs V. SANOU, K.B. KOUASSI, B. BAMBA, B. SANOU, S. OUE<br />
DRAOGO, O. TRAORE, A. CISSE, S. DIALLO, et I. K. PASCAL, Auxiliaires, manoeu<br />
vres et chauffeurs, de l'équipe "Insecticides" de l'Institut Pierre RICHET, sans lesquels<br />
cette étude n'aurait pu être menée.<br />
- Monsieur N. DEMBELE, Secrétaire à l'Institut Pierre RICHET qui, avec<br />
amabilité et dextérité a assuré la dactylographie de cette Thèse. Qu'il veuille trouver<br />
ici l'expression de ma grande sympathie.<br />
- Monsieur J. DAUDENS, Chef des Services Administratifs et Financiers,<br />
Madame FERLAT, Secrétaire de Direction et tout le personnel de l'Institut Pierre<br />
RICHET pour leur constante sollicitude.<br />
- Madame A. NYOMBA, ancienne stagiaire du CEMV qui a contribué effi<br />
cacement à la réalisation de nombreuses expérimentations. Je lui exprime ma vive<br />
reconnaissance et ma grande sympathie.<br />
A mes Amis, K.E. N'GORAN, Y. YAPI, T.L. KANGOYE, V. SERY et K.<br />
TOURE, pour leur soutien moral et leurs encouragements constants.<br />
faveur.<br />
A mes parents, pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer en ma<br />
Je voudrais enfin, dédier cette Thèse à la mémoire de Feu le Professeur<br />
Tiémoko DIOMANDE, ex-Directeur du CEMV, qui restera pour moi un exemple de mo<br />
destie et de discrétion mais également de rigueur et d'efficacité au travail.
LES COMPOSES REGULATEURS DE CROISSANCE DES INSECTES :<br />
LES PERSPECTIVES DE LEUR UTILISATION DANS LA LUTTE CONTRE CUf.EX<br />
QU7NQUE1lr.SCltATUS VECTEUR POTENTIEL DE LA FILARIOSE DE BANCROFT<br />
EN ZONES URBAINES ET CONTRE SlMUf.1UM DIr.MNOSUM s. 1. VECTEUR DE<br />
L'ONCHOCERCOSE HUMAINE EN AFRIQUE DE L'OUEST.
SOMMAIRE<br />
=================
Pages<br />
AVANT-PROPOS : 1<br />
INTRODUCTION GENERALE 5<br />
CHAPITRE 1 : GENERALITES : 8<br />
1.1. Eléments d'endocrinologie des insectes : Rôle des hormones dans les<br />
processus de mue et de métamorphose : 8<br />
1.1.1. La mue et la métamorphose chez les insectes 8<br />
1.1.1.1. Définitions : 9<br />
1.1.1.2. RÔle des hormones dans les processus de mue et de<br />
métamorphose chez les insectes : 9<br />
1.1.2. La sexualité et la reproduction chez les insectes 11<br />
1.1.3. Les diapauses : 11<br />
1.2. Généralités sur les régulateurs de croissance des insectes: 13<br />
1.2.1. Nature et structures chimiques des hormones de croissance des<br />
insectes : 13<br />
1.2.2. Analogues naturels ou de synthèse des hormones de croissance<br />
des insectes : 15<br />
1.2.2.1. Les analogues de l'hormone juvénile : 15<br />
1.2.2.2. Les inhibiteurs de mues larvaires ou inhibiteurs de synthèse<br />
de la chitine : 17<br />
1.2.3. Les principaux groupes de composés régulateurs de croissance des<br />
insectes et leurs modes d'action : 21<br />
1.2.3.1. Le groupe des mimétiques de l'hormone juvénile ou des<br />
terpinoldes : 21<br />
1.2.3.2. Le groupe des benzoyl-phenyl-urée substitués ou des<br />
inhibiteurs de mue : 22<br />
1.2.3.3. Le groupe des composés triaziniques : 22<br />
CHAPITRE II : EVALUATION DE L'ACTIVITE BIOLOGIQUE DE CINQ<br />
REGULATEURS DE CROISSANCE SUR DES POPULATIONS<br />
PREIMAGINALES DE CUf.EX QU7NQUE1A.SCM.TUS SAY 1823<br />
EN MILIEU NATUREL 28<br />
2.1. Introduction : 28<br />
2.2. Rappels bibliographiques : biologie et écologie des populations préima-<br />
ginales et imaginaJes de Cu1e.}( quinquefasciatus Say 1823 : 30
2.2.1. Les populations préimaginales et les facteurs écologiques de<br />
Pages<br />
leur développement : 31<br />
2.2.1.1. La nature et la structure des gîtes : 32<br />
2.2.1.2. Le degré de pollution, la quaI ité et la quantité de<br />
nourriture disponible dans les gîtes: 32<br />
2.2.1.3. La température : 32<br />
2.2.1.4. L'importance des précipitations: 32<br />
2.2.1.5. La cohabitation de Culex quinquefasciatus et de Culex<br />
cineteus : 33<br />
2.2.2. Les populations imaginales et les différents facteurs condition-<br />
nant leur dynamique : 33<br />
2.2.3. Les variations saisonnières des densités imaginales de Culex<br />
quinquefasciatus 34<br />
2.2.4. Les lieux de repos des adultes, leurs tendances endo-exophages<br />
et leur cycle d'agressivité: 35<br />
2.2.4.1. Les lieux de repos des adultes : 35<br />
2.2.4.2. Les tendances endo-exophages et le cycle d'agressivité 35<br />
2.3. La distribution géographique de Culex quinquefasciatus Say 1823 37<br />
2.4. L'importance médicale de Culex quinquefasciatus : Rôle vecteur dans<br />
la transmission de Wuchet.et.ia banct.ofti en Afrique et à Madagascar: 39<br />
2.5. Présentation de la zone d'étude : 40<br />
2.5.1. Si tuations géographique et climatologique 40<br />
2.5.2. Le niveau d'urbanisation de la viJJe de Bouaké et ses relations<br />
avec l'implantation de Culex quinquefasciatus : 41<br />
2.5.3. Dynamique des populations préimaginaJes et imaginales de Culex<br />
quinquefasciatus dans la ville de Bouaké : 43<br />
2.6. Matériel et Méthodes d'étude :<br />
2.6.1. Matériel<br />
2.6.1.1. Matériel bioJogique :<br />
2.6.1.2. Composés régulateurs de croissance testés<br />
2.6.2. Méthodologie :<br />
2.6.2.1. Choix des puisards traités :<br />
2.6.2.2. Traitements des puisards sélectionnés<br />
2.6.2.3. Evaluation de l'efficacité de produits testés<br />
44<br />
44<br />
44<br />
45<br />
46<br />
46<br />
46<br />
46
2.7. Résultats de l'évaluation de l'efficacité et de la rémanence des<br />
formulations des cinq composés régulateurs de croissances dans les<br />
Pages<br />
gîtes à Culex quinquetasciatus : 47<br />
2.7.1. Modes dl action des composés testés : 47<br />
2.7.2. Efficacité et rémanence des composés et formulations testés 48<br />
2.7.2.1. Les juvéno"fdes : OMS 3007, Otv'S 3010, OMS 3019,<br />
OMS 1697 : 48<br />
2.7.2.2. L'ecdyso"fde : OMS 3009 52<br />
2.8. Discussion - Conclusion : . 54<br />
CHAPITRE III : EVALUATION A ECHELLE REDUITE DE L'ACTIVITE BIO<br />
BIOLOGIQUE DE DOUZE COMPOSES REGULATEURS<br />
DE CROISSANCE SUR DES LARVES DU COMPLEXE<br />
S1MUr.n1M lM.MNOSUM : 56<br />
3.1. Introduction : 57<br />
3.2. Rappels bibliographiques 60<br />
3.2.1. Position systématique du complexe S.damnosum : 60<br />
3.2.2. Distribution géographique du complexe S.damnosum 61<br />
3.2.3. Biologie et écologie du complexe S.damnosum : 61<br />
3.2.3.1. Cycle biologique : 62<br />
3.2.3.2. Bio-écologie des populations préimaginales 62<br />
3.2.3.3. Bioécologie des adultes: 64<br />
3.2.4.Importance médicale et vétérinaire des simulies Rôle vecteur<br />
du complexe S.damnosum : 65<br />
3.3. Présentation des stations d'étude 67<br />
3.3.1. La station dl Akakro (Dabou) : 67<br />
3.3.2. La station de N'Golodougou (Touba) 68<br />
3.3.3. La station de Monneko"f (Alépé) 68<br />
3.4. Matériel et Méthodes d'étude : 69<br />
3.4.1. l'\.Jature des composés et formulations testés : 69<br />
3.4.1.1. Ecdyso"fdes ou inhibiteurs de synthèse de la chitine 69<br />
3.4.1.2. Juvéno"fdes ou analogues de l'hormone juvénile: 71<br />
3.4.1.3. Autres composés testés comrT'e régulateurs de croissance n.
Pages<br />
3.4.2. Matériel biologique 73<br />
3.4.3. Méthodes d'étude : 73<br />
3.4.3.1. Description de la méthodologie des tests : 74<br />
3.4.3.1.1. La colonisation des supports artificiels par des larves: 74<br />
3.4.3.1.2. L'exposition des larves à l'insecticide: 76<br />
3.4.3.1.3. La mise en observation des larves après exposition à<br />
l'insecticide 77<br />
3.4.3.1.4. L'évaluation de l'efficacité des produits testés<br />
vis-à-vis des larves de simulies et l'exploitation des<br />
résultats : 80<br />
3.4.3.2. Etude des paramètres pouvant conditionner l'efficacité des<br />
composés régulateurs de croissance vis-à-vis des larves de<br />
simulies : 81<br />
3.5. Résultats des essais : 82<br />
3.5.1. Les ecdysoYdes : 82<br />
3.5.2. Les juvénoYdes : 92<br />
3.5.3. Autres composés testés 97<br />
3.6. Discussion - Conclusion : 111<br />
CONCLUSION GENERALE: 114<br />
ANNEXES : 116<br />
RESUME: 135<br />
BIBLIOGRAPHIE 138
INTRODUCTION GENERALE<br />
---------------------------
- 5 -<br />
L'avènement du DDT (1939) et des insecticides organiques de synthèse a<br />
été une révolution dans la lutte contre les insectes nuisibles pour l'homme en agri<br />
culture et en santé publique. La lutte antivectorielle par des méthodes physiques ou<br />
mécaniques céda très rapidement le pas à la lutte chimique et l'homme crut un temps<br />
disposer de moyens très efficaces qui permettraient l'éradication de certains arthro<br />
podes vecteurs de maladies ou de nuisances. Cet espoir fut malheureusement très<br />
rapidement anéanti avec la résurgence d'un phénomène anciennement connu mais un<br />
peu tombé dans l'oubli : la résistance des insectes aux substances toxiques.<br />
Alors que de 1908 à 1945 on n'avait signalé que 13 cas d'insectes ayant<br />
acquis une résistance aux divers insecticides utilisés jusqu'alors, en 1963 on en citait<br />
137 et ce nombre n'a depuis cessé de croître (PESSON, 1968).<br />
De nos jours, le phénomène est devenu si aigu qu'une des préoccupations<br />
majeures des Entomologistes est la recherche de nouveaux moyens de lutte et de<br />
nouveaux types d'insecticides. Parmi ces nouveaux moyens de lutte envisageables figu<br />
rent en bonne place la lutte écologique, la lutte génétique, la lutte biologique, l'utili<br />
sation d'attractifs sexuels (phéromones) et de mimétiques d'hormones de croissance<br />
des insectes.<br />
Nous nous limiterons ici à une définition très succincte de chacun de ces<br />
différentes moyens de lutte envisageables contre les insectes.<br />
La lutte écologique s'inspire des méthodes anciennement utilisées<br />
contre les insectes. EHe est basée sur l'aménagement de l'environnement visant à<br />
réduire les gîtes larvaires. Bien associée à une éducation san.itaire, elle pourrait être<br />
efficace, mais dans certains cas elle nécessite la mise en oeuvre de grands moyens<br />
(JOURDHEUIL, 1979).<br />
La lutte génétique constitue une forme sélective d'intervention particu<br />
lièrement originale. Elle consiste à provoquer l'extinction d'une population naturelle<br />
d'insectes en y introduisant des individus de la même espèce, soit préalablement<br />
stérilisés par des rayons X ou des chimiostérilisants, soit porteurs d'anomalies généti<br />
ques, qui en s'accouplant avec des individus sauvages donnent naissance à une descen<br />
dance non viable, (JOURDHEUIL, Loc. ciL). La faisabilité de cette méthode a été<br />
étudiée sur divers insectes mais les essais n'ont jamais dépassé le stade expérimen<br />
tal et n'ont souvent eu qu'un succès partiel ou temporaire.
- 6 -<br />
Quant à la lutte biologique, elle est définie comme étant l'utilisation<br />
d'organismes vivants ou leurs produits pour lutter contre les insectes nuisibles. En<br />
effet, les arthropodes comme tous les êtres vivants sont victimes de nombreux enne<br />
mis naturels souvent très spécifiques appartenant à divers embranchements du règne<br />
animal ou végétal. Parmi les agents les plus actifs, on distingue d'une part des micro<br />
organismes (virus, bactéries, champignons, protozoaires) et d'autre part des métazoai<br />
res, tels que des vertébrés (oiseaux, batraciens, reptiles, poissons), des nématodes entomopa<br />
rasites, et surtout de nombreux insectes à régime strictement entomophage (prédateurs).<br />
Plusieurs micro-organismes ont été identifiés comme agents potentiels<br />
de lutte dont certains sont pathogènes pour les larves de moustiques, de simulies et<br />
de phlébotomes. Deux bactéries, Bacillus thuûngiensis sérotype H-14 et BacUlus sphae<br />
ûcus se sont particulièrement illustrées ces dernières années par leur usage' dans des<br />
programmes de lutte antivectorielle. Diverses souches ont été identifiées et le génie<br />
génétique a permis de nos jours l'obtention de mutants asporogènes dotés d'un poten<br />
tiel toxinogène plus élevé.<br />
On connaît des substances naturelles ou synthétiques qui agissent soit sur<br />
le comportement, soit sur la croissance, soit sur la reproduction des insectes. Il ne<br />
s'agit pas de substances toxiques proprement dites comme les insecticides classiques<br />
mais de composés chimiques qui interviennent dans le déterminisme des activités<br />
comportementales ou physiologiques de l'insecte.<br />
Ces substances ou leurs analogues de synthèse constituent une arme chimi<br />
que mais à portée biologique: on distingue d'une part les phéromones et d'autre part<br />
les hormones de croissance des insectes.<br />
En effet, un aspect de la biologie de l'insecte qui a retenu l'attention de<br />
nombreux chercheurs est celui de son comportement sexuel. On sait que les femelles<br />
de certaines espèces d'insectes, les lépidoptères en particulier, attirent les mâles à<br />
une distance pouvant atteindre parfois plusieurs kilomètres. BUTENANDT, en 1960,<br />
est parvenu à extraire de la femelle du ver à soie une substance qu'il nomma "Bom<br />
by-Kol". Une étude de la nature et la composition chimique de cette substance a<br />
permis la synthèse d'un analogue.<br />
A la même époque, JACOBSON BEROZA et JONES isolèrent une substance<br />
identique de Bombyx dispatate, ravageur forestier de première importance, substance<br />
qui ils nommèrent "Giplure". Des chercheurs Australiens ont utilisé avec succès cet<br />
attractif sexuel associé à un insecticide pour lutter contre Cacus ttyoni, une mouche<br />
de fruits. Ils obtinrent une importante réduction de la sex-ratio par élimination sélec<br />
tive des mâles, avec pour conséquence une moindre fertilité des femelles.
- 7 -<br />
Outre les attractifs sexuels, on a démontré l'importance de divers compo<br />
sés chimiques excrétés par le corps des insectes. Ces substances absorbées par d'au<br />
tres individus de la même espèce, règulent certains aspects de leur physiologie ou de<br />
leur comportement. Leur rôle est en effet comparable à celui des hormones dans la<br />
régulation fonctionnelle des di vers organes du corps. Ces substances jouent le rôle de<br />
message chimique émis par certains individus (mâles ou femelles) et déclenchent<br />
des comportements instinctifs particuliers chez les partenaires qui perçoivent ces mes<br />
sages par olfaction ou par gustation. Ainsi par exemple, la reine d'abeille sécrête<br />
une substance di te substance de la reine qui, absorbée par les ouvrières, maintient<br />
leurs ovaires en état d'inhibition. Cette substance a été isolée, analysée et même<br />
synthétisée (acide céto 9 - décène 2 transoYque ou acide F. 55). On a testé ses effets<br />
et ceux de nombreuses substances analogues sur des moustiques (o1edes aegypti), il<br />
s'est révélé que ces produits sont toxiques pour le stade nymphal mais sans action sur<br />
les stades larvaires.<br />
On connaît par ailleurs chez les arthropodes d'une manière générale les<br />
hormones qui agissent en modifiant les mécanismes endocriniens régulant la croissan<br />
ce, la ponte, la mue et la métamorphose. Ces hormones ont fait l'objet d'études très<br />
sérieuses dont les résultats très intéressants ont permis d'envisager leur utilisation en<br />
agriculture dans la lutte contre les insectes ravageurs de plantes. Les succès enregis<br />
trés en agriculture ont considérablement stimulé les recherches sur l'utilisation des<br />
hormones de croissance pour la lutte contre les insectes vecteurs de maladie et de<br />
nuisance. Les chimistes et les biochimistes ont proposé aux entomologistes une large<br />
gamme de composés susceptibles d'inhiber la croissance ou la reproduction des insec<br />
tes et dont l'utilisation pourrait représenter une solution au problème de la résistance.<br />
Cette étude a porté sur l'évaluation de l'activité biologique de douze (12)<br />
composés de cette nouvelle famille d'insecticide sur des populations préimaginales de<br />
CuLex quinquefasciatus vecteur potentiel de la filariose de Bancroft, et des popula<br />
tions préimaginales de simulies vectrices de l'Onchocercose humaine en Afrique de<br />
l'Ouest. Après quelques rappels sur l'endocrinologie des insectes, sur les principaux<br />
types de régulateurs de croissance et leur mode d'action, et enfin sur la bioécologie<br />
tant de CuLex quinquefasciatus en milieu urbain que des simulies du complexe SimuLium<br />
damnosum, nous exposerons les résultats des essais réalisés sur le terrain avec ces<br />
12 composés régulateurs de croissance.
CHAPITRE 1 GENERALITES.
Cerveau d'un insecte (vue latérale gauche) Un Précis de Zoologie).
- 8 -<br />
1.1. Eléments d'endocrinologie des insectes Rôle des hormones dans les processus<br />
de mue et de métamorphose.<br />
Chez les arthropodes et singulièrement chez les insectes, la croissance, la<br />
mue, la métamorphose, la sexualité, la reproduction et les diapauses sont contrôlées<br />
à divers degrés par un complexe endocrinien analogue du système hypothalomo-hypo<br />
physaire des vertébrés. Ce complexe endocrinien comprend plusieurs glandes sécrétant<br />
des hormones spécifiques :<br />
- les cellules neurosécrétrices de la pa'ts inLe'tcéLé6'talis, situées<br />
dans la partie dorsale du protocérébron entre les corps pédonculés;<br />
- les glandes prothoraciques ou glandes ventrales localisées comme leur<br />
nom l'indique dans le prothorax ou dans la région ventrale;<br />
cerveau;<br />
- les co'tpo'ta allaLa ou corps allates, glandes situées juste derrière le<br />
- les cO'tpo'ta ca'tdiaca ou corps cardiaques sont deux corpuscules pairs<br />
fusionnés ou associés aux cO'tpo'ta allaLa.<br />
Nous allons succinctement définir les phénomènes de mue, de métamorpho<br />
se et de diapause dans le processus général de la croissance des insectes tout en si<br />
tuant l'intervention des glandes endocrines sus-citées dans le déroulement de leurs<br />
"mécanismes respectifs et de ceux de la sexualité et de la reproduction.<br />
1.1.1. La mue et la métamorphose chez les insectes.<br />
1.1.1.1. Définitions:<br />
La vie post-embryonnaire chez les insectes peut être divisée en deux gran<br />
des périodes : une période de croissance larvaire et une période de di fférenciation<br />
imaginale.<br />
- Période de croissance larvaire : Les arthropodes d'une manière générale<br />
se caractérisent par un exosquelette rigide appelé cuticule. Pour croître l'individu doit<br />
abandonner périodiquement cette enveloppe devenue trop étroite. Ce processus com<br />
mun à tous les arthropodes est appelé phénomène de mue.<br />
La croissance en longueur se fait par stades successifs et d'une manière<br />
discontinue; le nombre de stades pour chaque espèce étant fixe et chacun d'entre<br />
eux séparé par une mue.
- 9 -<br />
L'insecte, entre deux mues, augmente de poids jusqu'au moment où il<br />
cesse de se nourrir avant la mue suivante, période pendant laquelle son poids dimi<br />
nue. Le processus de mue est consécutif à une dissolution de la partie profonde de<br />
l'endocuticule sous l'effet de diastases (chitinase et protéase) contenues dans un liqui<br />
de exuvial sécrété par des glandes dermiques ou par l'ensemble des cellules hypoder<br />
miques.<br />
La plus grande partie du tégument dissout est ensuite réutilisée pour l'édi<br />
fication de la nouvelle cuticule. La jeune endocuticule au cours de sa formation est<br />
protégée des diastases par la présence d'une nouvelle épicuticule sécrétée précocé<br />
ment. Le nouveau tégument souple, mou et très plissé au moment de la mue durcit<br />
rapidement et se pigmente au contact de l'air. Le rejet de la vieille cuticule se fait<br />
par rupture de lignes de moindre résistance prédéterminées (in Précis de Zoologie).<br />
Le déclenchement de ce mécanisme de la mue est sous la dépendance des<br />
facteurs hormonaux de glandes endocrines, comme nous le verrons plus loin.<br />
- Période de différenciation imaginale : métamorphose: Les métamorpho<br />
ses chez les arthropodes et chez les insectes en particulier, se caractérisent par des<br />
changements morphologiques de l'individu, notamment les passages du stade larvaire<br />
au stade nymphal puis à l'imago. Elles se traduisent par l'édification d'organes nou<br />
veaux, la destruction d'organes larvaires différenciés et des remaniements d'organes<br />
larvaires qui persisteront chez l'imago. Le déterminisme de la métamorphose comme<br />
celui de la mue est dominé par des actions hormonales.<br />
1.1.1.2. Le rôle des hormones dans les processus de mue et de métamorpho<br />
ses chez les insectes.<br />
De nombreux chercheurs ont mis en évidence l'intervention de deux types<br />
d'hormones dans le processus du développement post embryonnaire des insectes. Ainsi<br />
la mue serait sous la dépendance d'une hormone sécrétée par les glandes prothoraci<br />
ques, elles mêmes activées par une neurosécrétion qui dépend de stimuli sensoriels<br />
ou de facteurs humoraux.<br />
La nature et la qualité de la mue (larvaire, nymphale ou imaginale) sont<br />
déterminées par le taux d'une autre hormone produite par les corpora allata qui par<br />
sa présence inhibe la manifestation des caractères adultes: cette hormone est appe<br />
lée hormone juvénile.
- 10 -<br />
KOPPEE en 1922, fut le premier à avoir mis en évidence l'existence d'un<br />
phénomène hormonal dans le processus de mue des insectes. Les travaux de WIGGLES<br />
WOR TH en 1934 et de FRANKEL en 1935 sur Callipho'la e'lyth'lOcephaLa Meigen, et<br />
'Rhodnius p'lOli:x.us Stal, vinrent étayer l'hypothèse de KOPPEE Un HERVE, 1972).<br />
WIGGLESWORTH (1940) attribua également au phénomène de la métamor<br />
phose l'intervention d'un second facteur hormonal. Il parvint à situer la source de<br />
cette hormone au niveau des CO'lpO'la aLLata(in HERVE Loc. dt.).<br />
BOUI\IHIOL en 1947 confirma les résultats de WIGGLESWORTH sur le ver à<br />
soie Bomby:x. moti L•• L'ablation des CO'lpO'la aLLata chez cet insecte provoqua une<br />
métamorphose anticipée (in HERVE Loc. ciL).<br />
ROLLER, BJERKE, BOWERS et bien d'autres auteurs confirmèrent ces résul<br />
tats. En 1940, le même WIGGLESWORTH établit sur des larves de 'Rhodnius p'lOli:x.us<br />
le rôle des pa'lS inte'lcétéb'lalis dans le processus de mue chez les insectes. Il réussit<br />
à induire la mue chez des larves décapitées 24 heures après la prise de nourriture en<br />
leur implantant dans l'abdomen la partie dorsale du protocérébron enlevée à d'autres<br />
larves durant la période critique. La greffe d'autres parties du cerveau n'induit pas<br />
de mue. L'intervention d'un troisième type de glandes, les glandes prothoraciques a<br />
été établie par HACHLOW (1931) et FUKUDA (1940) (in HERVE, Loc. ciL).<br />
WILLIAMS en 1950 sur un ver à soie (JiyaLopho'la ceaopia L.) par des<br />
ligatures, démontra le fonctionnement de l'ensemble cerveau glandes prothoraciques.<br />
Les cellules neurosécrétrices des pa'lS inte'lcétéb'lalis, par un stimulant hormonal dé<br />
clencheraient au niveau des glandes prothoraciques la sécrétion d'hormones de mue,<br />
appelées ecdysones (in HERVE Loc. ciL).<br />
Ainsi l'hormone juvénile des CO'l.pO'la aLLata et les ecdysones des glandes<br />
prothoraciques interviennent à la fois dans les processus de la mue et de la métamor<br />
phose. Leur rôle est de maintenir les caractères larvaires lors des mues successives<br />
que doit subir l'insecte. Elles interviennent à des taux rigoureusement ajustés aux<br />
phases cruciales du développement. L'absence de l'hormone juvénile permet le déclen<br />
chement du processus de maturation de l'individu.<br />
En résumé: le déterminisme de la mue et de la métamorphose est dominé<br />
par des actions hormonales. Le développement post embryonnaire des insectes est en<br />
fait comrrandé par deux systèmes d'hormones. Chaque mue et par conséquent chaque<br />
période de croissance se plaçant entre 2 mues, serait préparée par l'activité des cel<br />
lules neurosécrétrices des centres cérébroYdes (pa'ls inte'lcétab'lalis) productrices de
- 13 -<br />
ou élevation de température, déshydratation, nourriture non appropriée. Toutes les<br />
diapauses n'ont pas le même mécanisme, certaines semblent de nature héréditaire<br />
et faire partie du cycle ontogénique de l'insecte. Ces diapauses héréditaires sont<br />
alors subordonnées à l'arrêt de la sécrétion des cellules neurosécrétrices de la pa'lS<br />
inte'lcé'léb'lalis des glandes prothoraciques et des CO'lpO'la ailata.<br />
WIGGLESWORTH en 1953 et 1957, WILLIAMS en 1956 et 1960, puis<br />
TELFER et WILLIAMS en 1960, démontrèrent que dans l'état de diapause} caracté<br />
risé par une présence de très peu de mitochondries dans les cellules épidermiques,<br />
l'apport de l'hormone juvénile par implantation des CO'lpO'la ailata provoque la forma<br />
tion d'acides nucléiques et un accroissement du nombre de mitochondries, rétablissant<br />
ainsi la synthèse des protéines et la croissance (in HERVE, loc. cit.).<br />
1.2. Généralités sur les régulateurs de croissance des insectes.<br />
1.2.1. Nature et structures chimiques des hormones de croissance des insectes.<br />
Plusieurs équipes de recherches stimulés par les intéressantes propriétés<br />
des hormones de croissance des insectes (ecdysone et hormone juvénile) entreprirent<br />
dès 1950 de les isoler et de caractériser leurs nature et structures chimiques. Des<br />
substances naturelles ou de synthèse présentant des propriétés analogues à celles des<br />
hormones naturelles furent découvertes.<br />
WILLIAMS en 1956, obtint à partir de l'abdomen d'un imago mâle de<br />
J'latysamia cec'lOpia L. les premiers extraits de l'hormone juvénile ou néoténine.<br />
SCHNEIDERMAN en 1961, puis ROLLER et BJERKE en 1965, réalisèrent<br />
l'extraction et la purification de cette hormone chez le même J'latysamia (in<br />
HERVE, loc. ciL).<br />
En 1967, ROLLER et un groupe scientifique de l'Université de Wisconsin<br />
(USA) ont identifié sa structure chimique.<br />
L'hormone juvénile est constituée de molécules carbonées renfermant des<br />
doubles liaisons avec un cycle orixane, de poids moléculaire égale à 294.
Poids Moléculaire = 464<br />
Formule Brute =<br />
OH<br />
- 15 -<br />
STRUCTURE CHIMIQUE DE L'ECDY<br />
SOI\IE DE Bombyx moû<br />
(HOPPE et HUBER 1965, in HERVE,<br />
Loc. ciL).<br />
1.2.2. Analogues naturels ou de synthèse des hormones de croissance des<br />
insectes.<br />
Lorsque la nature et les structures de l'hormone juvénile ou néoténine et<br />
de l'hormone de mue ou ecdysone furent établies, plusieurs chercheurs s'intéressèrent<br />
au problème de leur synthèse en raison des propriétés particulières de ces deux subs<br />
tances et la possibilité de leur utilisation dans la lutte contre les insectes nuisibles<br />
en agriculture et en santé publique.<br />
1.2.2.1. Les analogues de l'hormone juvénile.<br />
Dès 1956, WILLIAMS a testé avec succès l'hormone juvénile extraite d'un<br />
mâle de 'JLatysamia cec'l.opia sur différents ordres d'insectes : 'Jieûs b'l.assicae L.<br />
(Lépidoptères), Tenebûo molito'l. L. (Coléoptères) 'Rhodnius p'l.Olixus Stal (Hétéroptères),<br />
'JeûpLaneta ameûcana L. (Dictyoptères). Il a démontré que l'hormone juvénile est<br />
capable de traverser la cuticule des insectes immatures et qu'appliquée à des doses<br />
efficaces, elle empêche de manière irréversible la métamorphose. Cette propriété de<br />
pénétration permit d'envisager une utilisation simple des composés de ce type dans<br />
la lutte contre les insectes nuisibles.<br />
En 1961, SCHMIALEK isola une substance appelée farnesol des fèces du<br />
coléoptère Tenebûo molito'l. L., et WIGGLESWORTH en 1964 trouva ses propriétés<br />
comparables à celles de l'hormone juvénile sur 7?.hodnius p'l.oLixus (in HERVE, Loc.cit.).<br />
larves de moustiques.<br />
En 1964 LEWALLEN démontra l'action juvénilisante du farnesol sur des
- 16 -<br />
De nombreux chercheurs constatèrent par la suite que l'aldéhyde du farne<br />
sol, le farnésal et divers esters de cet alcool sesqui terpenorde présentaient la même<br />
activité.<br />
En 1966, LAW, CHING YUAN et WILLIAMS réussirent à synthétiser par<br />
traitement à l'acide chlorydrique d'une solution d'acide farnésoYque dans l'ethanol une<br />
substance qui est 1000 fois plus active que l'extrait naturel obtenu de l'abdomen du<br />
papillon mâle de J'Latysamia cectopia (in HERVE, Loc. ciL).<br />
SLAMA et WILLIAMS en 1966, constatèrent que certains papiers fabriqués<br />
à partir du Sapin baumier (o1bies baLsamea) induisaient un effet similaire à celui de<br />
l'hormone juvénile sur des larves de J'yuhocotis aptews; ils parlèrent de "Paper<br />
factor".<br />
Mais dans la même période BOWERS isola de la pulpe de o1bies baLsamea<br />
la substance active qu'il nomma "juvabione". Il montra par la suite qu'il s'agit de<br />
l'ester méthylique de l'acide todomatuique, acide déjà isolé de la pulpe de o1bies<br />
sachalinensis. C'est un sesquiterpène monocyclique. Toutefois la juvabione bien que<br />
présentant une analogie structurale avec l'hormone juvénile, est spécifique des Pyrrho<br />
corides.<br />
STRUCTURE DE LA JUVABIONE. R = CH 3<br />
ou H.<br />
COOR<br />
CAREY et aL. (1968) puis JONHSOI\l et aL. (1968) réussirent à synthétiser<br />
par des techniques différentes une molécule absolument identique à celle de l'hormo<br />
ne juvénile de J'Latysamia cectopia (in HERVE, Loc. cit.).<br />
Des dérivés terpénoYdes amides ont été testés avec succès sur la blatte<br />
germanique (BLatella getmanica L.) (CRUICKSHANK et PALMERE, 1971; CRUICK<br />
SHANK, 1971) et sur des larves de CuLex pipiens et d'o1edes aegypti (CRUICKSHANK,<br />
Loc. ciL)<br />
amide.<br />
- 10, 11 - epoxy - 3, 7, 11 trimethyl 2 - 6 - dodecadieonic acide.<br />
- 7, 11 - dichloro - N - methyl - 3, 7, 11 - trimethyl - 2 - dodecadien
- 17 -<br />
Une application topique de ces deux dérivés de l'acide terpénique a provo<br />
qué chez des larves de Musca domestica une inhibition de l'éclosion des pupes à la<br />
dose de 0,01 g/asticot. Le mélange des deux composés est encore plus actif,<br />
(CRUICKSHANK, Loc. dt.).<br />
Un composé dénommé MON - 0585 (2, 6 di-t-butyl - 4 - dimethylbenzyl<br />
phenol) a été testé sur 14 espèces de moustiques dont certaines étaient résistantes<br />
aux organophosphorés. A la dose de 0,1 ppm 92% des larves testées sont mortes au<br />
quatrième stade larvaire au moment de l'apolyse.<br />
L'activité de ce composé se caractérise donc par un effet léthal lors du<br />
passage du stade larvaire au stade nymphal ou peu de temps après. Le MON - 0585<br />
ne provoque aucune mortalité larvaire et a donc uniquement une action juvénilisante,<br />
(SACHER, 1971).<br />
Deux autres composés, (Je méthy1 - trans, trans - c is 10 - 11 epoxy - 7<br />
ethyl 3, 11 - dieméthyl - 2, 6 - tridecadienoate et le C 17 méthyl - ester) ont été<br />
testés sur des asticots de Sa'lcopnaga buLLata. L'injection de ces deux composés dans<br />
les asticots a arrêté la métamorphose et empêché la formation de pupes, ou leur<br />
développement. Une application topique sur l'abdomen d'une jeune pupe a provoqué la<br />
formation d'une seconde cuticule pupale, (SRIVASTANA et GILBERT, 1968).<br />
De nos jours plusieurs substances naturelles ou de synthèse, présentant<br />
des propriétés juvénilisantes sont connues. Il serait difficile d'en donner une liste<br />
exhaustive. Des essais expérimentaux ont été réalisés avec bon nombre d'entre elles<br />
sur diverses famille d'insectes, (cf. schémas 2, 3 et 4).<br />
1.2.2.2. Les inhibiteurs de mues larvaires ou inhibiteurs de synthèse de la<br />
chitine.<br />
Des composés de structure semblable à celle de l'ecdysone furent décou<br />
verts chez de nombreuses plantes, notamment chez une fougère du genre 'Jolypodium,<br />
(NAKANISHI et al., 1966, in HERVE, Loc. dt.).<br />
Toute une série d'hormones a également été isolée à partir de crustacés,<br />
(cf. HORN in Naturally Occuring Insecticides 1971). Des tests réalisés avec ces com<br />
posés sur divers ordres d'insectes ont révélé leur activité inhibitrice des mues<br />
larvaires.
Hormone juvénile<br />
Rli..LER et coll. 1967<br />
.>Jvabione ("Facteur papier")<br />
BOWER5 et coll. 1966<br />
- 18 -<br />
. pm= 294 Structure de l 'hormone juvénile (Rli..LER et coll. 1967)<br />
COOCH3<br />
Analogue synthétique<br />
OOWERS ET CQL 1965<br />
CL<br />
Analogue synthétique<br />
RCJ4AtU< et coll. 1967<br />
schéma 2: Structures chimiques de la néoténine ou honrone juvénile et<br />
ses oérivés. in (Hervé, lac. cit.).
- 21 -<br />
Outre les extraits naturels, en 1962, CRETILLAT découvre fortuitement la<br />
toxicité de ZIRAM (dimethyldithiocarbamate de Zinc) pour les larves de Culicidae au<br />
cours de tests sur les propriétés molluscicides de ce produit. Il effectue des essais au<br />
laboratoire sur des larves de Culex pipiens fatigans Say, et constate que outre une<br />
toxicité immédiate à 1,5 ppm, le ZIRAM provoque une inhibition des mues larvaires<br />
aboutissant à la formation de formes naines et de nymphes non viables.<br />
Divers agents perturbateurs des mécanismes de synthèse de la cuticule des<br />
insectes ont été découverts. La cuticule constitue la partie essentielle de l'exosquelet<br />
te des insectes. Elle est constituée d'une part, d'une proteine, Oa sclérotine) dont le<br />
tannage est réalisé par une orthoquinone sous le contrôle d'une hormone particulière,<br />
le bursicon et d'autre part, d'un polysaccharide, Oa chitine) qui est un polymère de<br />
l'anhydro - N - acétylmannosamine (chitinosamine). Il a été démontré que la griseful<br />
vine ou les cétostéro"fdes en général bloquent les mécanismes de la sclérotisation en<br />
inhibant l'élaboration du bursicon et que le diflubenzuron et de nombreux autres déri<br />
vés de l'urée (benzoylurea) inhibent la chitinogénèse, (ANONYME, 1983).<br />
1.2.3. Les principaux groupes de composés régulateurs de croissance des insectes<br />
et leurs modes d'action.<br />
Durant la dernière décennie de nombreux composés ont été testés pour<br />
leur effet régulateur de croissance sur un certain nombre d'insectes d'intérêt médical.<br />
Outre les analogues de l'hormone juvénile, certaines molécules de structures différen<br />
tes, tels que les butylphénols substitués et les carbamates, ont été trouvées comme<br />
possédant des propriétés perturbatrices de la morphogénèse chez les moustiques et<br />
d'autres insectes.<br />
Un second groupe, celui des inhibiteurs de mues larvaires et imaginales<br />
constitué par les benzoylphénylurées, a été découvert plus récemment.<br />
Un troisième groupe formé par les composés triaziniques a fait l'objet de<br />
nombreuses études de laboratoire sur des larves de moustiques et de mouches.<br />
Nousempruntons à MIAN et MULLA (1982) la liste de quelques composés<br />
testés comme régulateurs de croissance des insectes, (tableaux 1a à 3).<br />
1.2.3.1. Le groupe des mimétiques de l'hormone juvénile ou des terpino"ï'des.<br />
Il est représenté par un grand nombre de composés différents par la varié<br />
té des radicaux substitués et ayant en commun un squelette terpino"fde. A ceux-ci<br />
s'ajoutent les butylphénols substitués et les carbamates, (tableaux 1a, 1b, 2a, 2b et 3).
- 22 -<br />
Plusieurs de ces composés ont présenté une bonne activité insecticide<br />
vis-à-vis des larves de moustiques.<br />
Ce sont pour la plupart des huiles lipophiliques avec une faible solubilité<br />
dans l'eau et qui sont rapidemert dispersées par adsorption sur des particules organi<br />
ques ou inorganiques. En général ce sont des composés biodégradables, très peu sta<br />
bles en milieu ensoleillé; cependant de bonnes techniques de formulation peuvent ga<br />
rantir une stabilité de la matière active.<br />
Appliqués à des doses efficaces les mimétiques de l'hormone juvénile indui<br />
sent des effets morphogénétiques chez l'insecte. Il agissent essentiellement sur les<br />
derniers stades larvaires en perturbant de manière irréversible les mécanismes de la<br />
métamorphose, engendrant une mortalité larvaire au moment de l'apolyse, une morta<br />
lité nymphale et la formation d'individus intermédiaires non viables. Ils peuvent égale<br />
ment affecter la fécondité et provoquer un effet ovicide, (ANONYME, 1983).<br />
1.2.3.2. Le groupe des benzoylphenyl -urée substitués ou inhibiteurs de mue.<br />
Ces composés sont connus pour leurs propriétés inhibitrices de la synthèse<br />
de la chitine chez les insectes, aboutissant à un blocage de la formation de la cuti<br />
cule au moment de la mue larvaire (POST et MULDER, 1972). L'inhibition de la<br />
synthèse de ce polyssacharide entrant dans la composition de la cuticule serait liée à<br />
l'inactivation des enzymes qui régissent son élaboration notamment la phénol-oxydase<br />
et autres enzymes du métabolisme de l'ecdysone (ANONYME, 1983). En plus de leur<br />
effet larvicide extemporé ils peuvent présenter un effet ovicide (CROSSCURT,<br />
1977, 1978). Le plus connu de ces composés est le di flubenzuron, (tableau 3).<br />
1.2.3.3. Le groupe des composés triaziniques.<br />
Il a retenu l'attention ces dernières années. Toutefois l'activité biologique<br />
de ces composés ne semble pas supérieure à celle des deux premiers groupes. Cette<br />
activité se manifeste par une prolongation de la durée de vie larvaire aboutissant à la<br />
formation d'individus nains non viables. Les composés les plus connus sont le CGA<br />
19255 et le CGA 72662 (MIAN et MULLA, 1982, (tableau 3).
Tableau 2b : Liste de composés But yI Phenol substitués testés comme régulateurs de croiLsance sur divers ordres d'insectes.<br />
(in MIAN et MULLA, 1982).<br />
===================================.===================:==================================================%=============================<br />
Composé XVI<br />
Composé XV II<br />
Compesé XVIII<br />
Compe.sé XIX<br />
Composé XX<br />
Composé XXI<br />
Composé XXII<br />
Composé XXIII<br />
Composé XXIV<br />
Composé XXV<br />
Composé XXVI<br />
Composé XXV 11<br />
Composé XXVIII<br />
Compesé XXIX<br />
Composé XXX<br />
Composé XXXI<br />
Composé XXX 11<br />
Composé XXXIII<br />
Composé XXXIV<br />
Groupe's 1 Noms chimiques des composés 1 Références Bibliographiques<br />
2,6-di-tert-butyl-isopropyl carbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-tert-butyl carbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-cyclohexylcarbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-3, 4-methylene dioxyphenylcarbonyl phenol<br />
2,6-di-tert-butyl-methoxycarbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-ethoxy carbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-propoxy carbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-n-butoxy-carbonyl phenol<br />
2,6-di-tert-butyl-sec-butoxy carbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-isobutoxy carbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-tert-butoxycarbonyl phenol<br />
2,6-di-tert-butyl-cyclo pentoxy carbonyl phenol<br />
2,6-di-tert-butyl-cyclo hexoxy carbonyl phenol<br />
2,6-di-tert-butyl-n-octanoxy carbonyl phenol<br />
2,6-di-tert-butyl-cyclo hexothiocarbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-4-morpholino carbonylphenol<br />
2,6-di-tert-butyl-4 ( -methyl-benzylaminocarbonyl) phenol<br />
Bis (4 hydroxy-3, 5-di-tert-butyl phenol) méthane<br />
2,6-di-tert-butyl-4 toluensulfonylphenol<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAL TON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAL lUN et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAL TON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAll ON t t al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
wAllON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
WAllON et al. (1979).<br />
===================================±======================================================================±=============================<br />
'v cr,
Tableau 3 : Autres groupes de composés régulateurs de croissance testés sur divers ordres d'insectes.<br />
(in MIAN et MULLA, 19B2).<br />
===================================.======================================================================.=============================<br />
Groupes 1 Noms chimiques des compcsés 1 Références Bibliographiques<br />
CARBAMATES<br />
HE-2410B<br />
HE-24734<br />
BENZOYLPHENYL UREE DISUBSTITUES<br />
Bay Sir 6874<br />
Bay Sir 8514<br />
Di flubenzuron<br />
DU-19111<br />
TH-6038<br />
COMPOSES TRlAZlNlQUES<br />
CGA 19255<br />
CGA 34296<br />
CGA 72662<br />
3-butyn-2-yl-N-(p-chlorophenyl)carbamate<br />
3-butyn-2-yl-N-(3, 4-dichlorophenyl)carbamote<br />
1-(3,5-dichloro-4) 4-nitro-phenoxyphenyl)-3-(2 chloro benzoyl)urea<br />
1-(4-trifluoro'rnethoxy phenyl)-3-(2 chlorobenzoyl(urea<br />
1-(4-chloro phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea<br />
1-(2,6-dichoro benzoyl) 3-(3,4-dichloro phenyl urea<br />
1-(4-chloro phenyl)-3-(2,6-dichloro benzoyl) urea<br />
6-azido-N-cyclopropyl-N'-ethyl-1, 3, 5 - triazine, 4 diaminE<br />
2', 4-azido (cyclopropylamino)-1, 3, 5 - triazine-2-yl aminopropanenitrile<br />
N-cyclopropyl-1, 3, 5 triazine-2, 4, 6 triomine<br />
MULLA et al. (1974).<br />
MULLE et al. (1974).<br />
MULLA et DARWAZEH (1979).<br />
MULLA et DARWAZEH (1979).<br />
MULLA et DARWAZEH (1979).<br />
VAN DAALEN (1972).<br />
MULLA et al. (1974).<br />
MULLA et DARWAZEH (1979).<br />
BREEDEN et al. (1977).<br />
HALL et rOESHE (1980).<br />
===================================±=======================================================================:============================<br />
N<br />
-J
CHAPITRE II: EVALUATION DE L'ACTIVITE BIOLOGIQUE DE CINQ COMPOSES<br />
REGLJLATEURS DE CROISSANCE SUR DES POPULATIONS<br />
PREIMAGINALES DE CUf.EX QUINQUE1Jt.SCltA.TUS SAY 1823 EN<br />
MILIEU NATUREL.
- 29 -<br />
Les premiers cas de résistance de CuLex quinquefasciatus au Malathion et<br />
au Diazinon (Organophosphorés) ont été observés 8 Douala (au Sud du Cameroun) en<br />
1958 (MOUCHET et al., 1960), à Freetown (Sierra Leone) en 1963 par THOIVAS in<br />
BROWN et PAL, Loc. ciL. A Dar-es-Salam (Tanzanie) (CURTIS et PASTEUR, 1981)<br />
et dans le Midi de la France (SINEGRE et al., 1977), on a observé une résistance au<br />
Chlorpyriphos (Dursban(R» ainsi qu'à d'autres organophosphorés (Fenthion, Pyrimiphos<br />
Methyl, Chlorfenvinphos, Malathion, Téméphos) (CURTIS et al., 1984).<br />
Une résistance aux pyréthroYdes a déjà été obtenue par sélection au labo<br />
ratoire (ANONYME, Loc. ciL).<br />
Cette généralisation du phénomène de résistance aux insecticides chimiques<br />
chez les culicidés et en particulier chez CuLex quinquefasciatus a conduit à rechercher<br />
de nouveaux moyens de lutte et des insecticides à mode d'action différent, parmi les<br />
quels les agents de lutte biologique et les composés régulateurs de croissance.<br />
Dans le domaine de la lutte biologique contre les vecteurs, la liste des<br />
organismes pathogènes et des parasites prometteurs est désormais relativement étof<br />
fée. Le Bacillus tflUtingiensis sérotype H-14 et plusieurs souches de Bacillus sphaeticus<br />
toxiques pour les larves de Diptères figurent en première place parmi ceux qui ont<br />
fait l'objet d'études intensives au cours des dernières années.<br />
Si la rémanence du Bacillus thutingiensis H-14 vis-à-vis de CuLex quinque<br />
fasciatus s'est avérée inférieure à 10 jours quelle que soit la concentration utilisée<br />
(HOUGARD et aL., 1983; SUDOMO et aL., 1981), il n'en a pas été de même pour<br />
Bacillus sphaeticus.<br />
Des essais réalisés en Côte d'Ivoire avec la souche 1593-4 ont montré que<br />
la rémanence de cette bactérie augmentait avec la concentration pour atteindre plus<br />
de trois semaines à 10 gr/m 2 (HOUGARD et al., 1985). Une suspension concentrée<br />
de la souche 2362 (BSP 1) étudiée contre CuLex quinquefasciatus en milieu urbain<br />
(puisards) à Bouaké (Côte d'Ivoire) a présenté l'avantage de sédimenter lentement en<br />
traînant une rémanence supérieure à un mois à 10 gr/m 2 (NICOLAS, 1986).<br />
Cependant, cette persistance du Bacillus sphaeticus dans les gîtes larvaires<br />
à CuLex quinquefasciatus n'est pas suffisante pour concurrencer les insecticides chimi<br />
ques tant qu'il n'y a pas de résistance.
- 30 -<br />
Parmi les nouvelles substances récemment développées par l'industrie, les<br />
insecticides régulateurs de croissance des insectes (analogues d'hormones de croissance)<br />
prennent une place de plus en plus importante.<br />
Nous avons évalué sur le terrain l'activité biologique de cinq composés de<br />
cette famille sur des stades préimaginaux de Culex quinquefasciatus. Avant de présen<br />
ter les résultats et les conclusions de ces essais de terrain, nous proposons des rap<br />
pels somlT'aires de la biologie et de l'écologie de Culex quinquefasciatus, sa distribu<br />
tion géographique et son importance médicale.<br />
2.2. Rappels bibliographiques : biologie et écologie des populations préimaginales<br />
et imaginales de Culex quinquefasciatus Say 1823 (= Culex pipiens fatigans<br />
Wiedmann 1928).<br />
Culex quinquefasciatus Say 1823 (= Culex pipiens fatigans Wied. 1928) est<br />
un moustique cosmotropical appartenant à la famille des Culicidae, à la sous famille<br />
des Culicinae et au genre Culex. Il vit essentiellement en milieu urbain où il est<br />
dans la plupart des cas l'espèce dominante des populations culicidiennes. Son implan<br />
tation dans la sous région Ouest africaine est plus ou moins récente, et son expansion<br />
date d'après la seconde guerre mondiale. Avant cette période Culex quinquefasciatus<br />
était présent seulement dans quelques localités côtières. En 1902, DUTTON a signa<br />
lé sa présence à Bathurst en Gambie, LAVERAN en 1902 en a récolté à Conakry en<br />
Guinée (in SUBRA, 1981). SIMPSON en 1914 puis MACFIE et INGRAM en 1916 en ont<br />
signalé à Accra au Ghana. En 1919 à Kaduna au Nord du Nigeria, JOHNSON a trouvé<br />
que cette espèce représentait seulement 0,16% du total des moustiques du groupe<br />
Culex récolté. Son abondance à Monrovia (Liberia) et à Dakar (Sénégal) a été signa<br />
lée respectivement par BEQUAERT en 1926 et MAT HIS en 1935 (ln SUBRA, loc.cit.).<br />
De nos jours il est présent dans toutes les grandes villes et quelques agglo<br />
mérations secondaires. Sa prolifération est intimement liée au degré d'urbanisation et<br />
dépend de la mauvaise organisation de l'évacuation des eaux usées et de l'approvision<br />
nement des populations humaines en eau. Il est rare dans les zones à sol très perméa<br />
ble ne permettant pas une accumulation d'eau. Nous verrons successivement la biolo<br />
gie et l'écologie des populations préimaginales et la dynamique des populations imagi<br />
nales.
- 31 -<br />
2.2.1. Les populations préimaginales et les facteurs écologiques de leur<br />
développement.<br />
CuLex quinquefasciatus Say 1823 se développe à l'état larvaire dans les<br />
eaux plus ou moins polluées riches en ammoniaque (CHAUVET et RASOLONlAlNA,<br />
Loc. ciL). En milieu urbain, d'une manière générale dans les zones tropicales, il domi<br />
ne en nombre et en répartition toutes les autres espèces de moustiques. L'installation<br />
des populations préimaginales est d'abord déterminée par l'attraction qu'exerce l'eau<br />
des gîtes sur les femelles gravides (SUBRA, Loc. cit.).<br />
Les femelles gravides pondent les oeufs en nacelles à la surface de l'eau;<br />
chaque nacelle peut comprendre 200 oeufs. L'éclosion des larves intervient un ou<br />
deux jours après la ponte. Le développement des larves s'effectue en quatre stades<br />
successifs séparés par des mues et une croissance en taille. La durée moyenne du<br />
développement larvaire est de 6 à 8 jours, temps au bout duquel intervient la nym<br />
phose qui dure 40 à 48 heures (SUBRA, Loc. ciL). Les nymphes à l'éclosion libèrent les<br />
imagos qui prennent leur envol.<br />
Les caractéristiques physico-chimiques des eaux condi tionnent énormément<br />
le développement des populations préimaginales. Les résultats des études faites en<br />
laboratoire et sur le terrain ont démontré que, la quantité et la qualité de matières<br />
en suspension (nourriture) ou le degré de pollution et la température sont deux fac<br />
teurs écologiques qui influencent le développement des larves de CuLex quinquefascia<br />
tus (CLEMENTS, 1963; SUBRA, 1971). Dans les conditions naturelles ces paramètres<br />
sont liés à la nature des gîtes. L'importance du facteur quanti té de nourriture dispo<br />
nible dans les conditions naturelles est difficile à déterminer selon SUBRA, car elle<br />
semble se superposer à d'autres facteurs biotiques notamment la teneur en ammoniaque de<br />
l'eau qui est un facteur limitant du développement des populations préimaginales<br />
(SUBRA, Loc. cit.). Les matières organiques et inorganiques en suspension dans les<br />
eaux déterminent le degré de pollution des gîtes.<br />
En résumé la dynamique des populations préimaginales de CuLex quinque<br />
fasciatus est conditionnée par plusieurs paramètres à divers degrés:<br />
- la nature et la structure des gîtes;<br />
- le degré de pollution de l'eau des gîtes;<br />
- la quantité de nourriture disponible dans les gîtes;<br />
- la température de l'eau;<br />
- l'importance des précipitations;<br />
- les actions de l'homme ou la coexistence de CuLex quinquefasciatus avec<br />
d'autres espèces.
- 32 -<br />
La nature et la structure des gîtes, l'importance des précipitations en tant<br />
qu'agent mécanique, le degré de pollution, la qualité et la quantité de nourriture dis<br />
ponible sont donc les facteurs limitants les plus importants de la dynamique des popu<br />
lation préimaginales de CuLex quinquefasciatus dans la mesure où ils conditionnent<br />
l'établissement de ces populations.<br />
2.2.1.1. La nature et la structure des gîtes.<br />
En milieu urbain les principaux gîtes sont constitués par les puisards (trous<br />
creusés .dans le sol), les fosses septiques et, les caniveaux non curés<br />
recueiHant les eaux usées et une partie des eaux de pluies. Les cani veaux ne sont<br />
colonisés par CuLex quinquefasciatus qu'en début et en fin de saison des pluies. Les<br />
puisards constituent les gîtes les plus riches en matières organiques, parce que re<br />
cueillant les eaux usées .tout au cours de l'année. Leurs structures, profon<br />
deur, ouverture, et volume d'eau, sont extrêmement variables (SUBRA, Loc. cU.).<br />
2.2.1.2. Le degré de pollution, la qualité et la quantité de nourriture<br />
disponible dans les gîtes.<br />
Les eaux excessivement polluées ne sont pas favorables au déve<br />
loppement de CuLex quinquefasciatus; dans ce type de gîtes c'est une autre espèce<br />
qui s'y développe très bien: CuLex cine'leus Theobald, 1901. Néanmoins selon SUBRA<br />
(Loc. cit.), ces gîtes restent attractifs pour les femelles gravides de CuLex quinquefas<br />
ciatus qui viennent y pondre sans que les pontes ne puissent s'y développer norma<br />
lement. Le degré de pollution est donc un facteur limitant des populations de CuLex<br />
quinquefasciatus.<br />
2.2.1.3. La température.<br />
EHe conditionne la durée du développement des formes préimaginales. Une<br />
baisse de la température ( .(.25 0 C) entraîne une surpopulation larvaire dans les gîtes,<br />
en revanche une hausse de température ( ) 30 0 C) provoque une accélération de la<br />
vitesse de développement larvaire et d'apparition des nymphes. Ce phénomène joue un<br />
rôle important dans la dynamique des populations préimaginales (saison sèche froide,<br />
saison sèche chaude, saison des pluies), (SUBRA, Loc. cit.).<br />
2.2.1.4. L'importance des précipitations.<br />
En saison des pluies un certain nombre de gîtes, les puisards en particulier<br />
sont peu productifs. I1s se remplissent pratiquement d'eau de sorte que des précipi<br />
tations, même peu importantes,balaient régulièrement les pontes et les jeunes larves.<br />
Dès la fin de la saison des pluies la productivité des gîtes augmente considérablement.<br />
Ce facteur n'est cependant pas prépondérant (SUBRA, Loc. cit.).
- 33 -<br />
2.2.1.5. La cohabitation de Culex quinquefasciatus et de Culex ciner.eus.<br />
La coexistence de C.quinquefasciatus et de C.cine'Leus pourrait donner lieu<br />
à une compétition trophique et à l'influence du cycle de l'un sur l'autre. Ce qui ne<br />
semble pas être le cas pour ces deux espèces lorsqu'elles se retrouvent dans un même<br />
gîte (SUBRA, Loc. cit.; DOSSOU-YOVO, corn. pe'Ls.).<br />
2.2.2. Les populations imaginales et les différents facteurs conditionnant leur<br />
dynamique.<br />
Selon SUBRA (Loc. cit.) la dynamique des populations imaginales dépend<br />
outre les facteurs liés à la phase préimaginale, d'un certain nombre de facteurs liés<br />
à la phase adulte du moustique: la dispersion ou le déplacement, la fécondité des<br />
femelles et la longévité.<br />
- La dispersion ou le déplacement des imagos est dans certains cas un des<br />
éléments fondamentaux qui conditionnent la dynamique des populations d'insectes. Ce<br />
phénomène est peu important chez CuLex quinquefasciatus et joue un rôle négligeable<br />
dans cette dynamique. Les déplacements des adultes sont de très faible amplitude<br />
(quelques centaines de mètres tout au plus comme l'ont montré les études de SUBRA,<br />
effectuées en milieu urbain durant la saison des pluies, période où l'espèce est très<br />
abondante.<br />
La fécondité des femelles est conditionnée par plusieurs données la<br />
nourriture larvaire, l'origine des repas de sang, et l'âge des individus.<br />
• L'influence de la nourriture sur le développement larvaire a été<br />
abordée dans le paragraphe relatif à la dynamique des populations préima<br />
ginales.<br />
• D'une manière générale chez le complexe CuLex pipiens, selon de<br />
nombreux auteurs, le choix de l'hôte sur lequel est pris le repas sanguin influe sur<br />
la fécondité des femelles. Ainsi ROUBAUD et MEZGER en 1934 (in SUBRA, Loc. cit.)<br />
ont observé que chez CuLex pipiens moLestus Forskal, 1775, le nombre d'oeufs pondus<br />
est 2 à 3 fois plus élevé chez les femelles nourries sur oiseau que chez celles gor<br />
gées sur homrre. Des observations analogues ont été faites chez CuLex pipiens par<br />
TATE et VINCENT en 1936 et CuLex pipiens fatigans par KRISHNA-MURTI et PAL<br />
en 1958 (in SUBRA, Loc. cit.). En règle générale donc, le sang d'oiseau entraîne chez<br />
ces femelles une fécondité plus grande que celui des mammi fères. Si l'origine du<br />
repas sanguin est un paramètre important conditionnant la fécondité des femelles de
- 34 -<br />
Culex. quinquefasciatus plusieurs auteurs dont HAMON en 1967 et SUBRA en 1970<br />
ont réalisé des études qui ont démontré qu'en Afrique de l'Ouest, elles se gorgent<br />
essentiellement sur homme, bien que MATHIS en 1935 ait estimé que le poulet est<br />
l'hôte de choix. En conséquence le nombre d'oeufs pondus par les femelles de Culex.<br />
quinquefasciatus ne représente pas les possibilités maximum de l'espèce. La fécondi<br />
té des femelles varie également avec le nombre d'ovipositions, la quantité d'oeufs<br />
diminuant chez les individus âgés. Le nombre moyen d'oeufs pondus par les femelles<br />
composant une population est donc la plus élevé lorsque cette population comprend<br />
une majorité d'individus jeunes (SUBRA, Loc. cit.).<br />
• La longévité des adultes: SUBRA, à partir des résultats des études<br />
qu'il a réalisées sur la longévité des adultes, a démontré par différentes méthodes que<br />
la longévité était maximum en saison des pluies, la survie étant plus courte en sai<br />
son sèche, (SUBRA, Loc. cit.).<br />
2.2.3. Les variations saisonnières des densités imaginales de Culex quinquefas<br />
ciatus.<br />
En règle générale, les variations saisonnières des densités imaginales de<br />
Culex. quinquefasciatus sont étroitement liées à la pluviométrie. L'espèce est généra<br />
lement abondante en saison des pluies ou dans la période sui vant les dernières préci<br />
pitations (SUBRA, Loc. ciL).<br />
L'espèce est peu abondante durant la saison sèche. Les densités augmen<br />
tent en début de saison des pluies.<br />
Les variations des densités imaginales de Culex. quinquefasciatus peuvent<br />
donc se mettre en parallèle avec celles des densités préimaginales, exception faite<br />
de la saison froide en zone de savane guinéenne ou soudanienne. Ces densités préima<br />
ginales sont, nous le rappelons sous la dépendance des précipitations. Des pluies modé<br />
rées diminuent fe degré de pollution de l'eau des gîtes et permettent la colonisation des<br />
puisards et des caniveaux. Les très fortes précipitations détruisent de nombreuses lar<br />
ves et nymphes mais créent des gîtes supplémentaires qui contribuent à la pullulation<br />
de l'espèce lorsque la saison des pluies se termine (SUBRA, Loc. cit.).<br />
Le comportement des femelles gravides dans les gîtes les plus favorables<br />
et l'abondance de nourriture dans ces gîtes sont les conditions de vie qui permettent<br />
à un grand nombre de larves d'atteindre Je stade nymphal. Selon SUBRA l'accroisse<br />
ment des populations est limité dans les puisards du fait des substances toxiques
- 35 -<br />
émises par les formes préimaginales âgées (vraisemblablement au moment de la nym<br />
phose) créant ainsi un état d'équilibre naturel entre les possibilités qu'offrent les gîtes<br />
larvaires et les densités imaginales, (SUBRA, Loc. ciL).<br />
2.2.4. Les lieux de repos des adultes, leurs tendances endo-exophages et leur<br />
cycles d'agressivité.<br />
2.2.4.1. Les lieux de repos des adultes.<br />
Les phases actives de la vie des femelles de moustiques (repas de sang,<br />
oviposition, dispersion) sont entrecoupées de périodes de repos généralement plus lon<br />
gues. La durée de ces dernières couvre la plus grande partie du cycle gonotrophique<br />
et partant de la vie des femelles. La connaissance précise des lieux de repos des<br />
adultes est donc un des éléments fondamentaux de l'étude biologique des moustiques,<br />
(SUBRA, 1970).<br />
A leur éclosion, les femelles à jeun se réfugient soit dans les habitations,<br />
soit plus volontiers dans les abris extérieurs. Après la prise de repas sanguins la plu<br />
part d'entre elles demeurent dans les maisons. La tendance exophile semble liée à<br />
l'âge physiologique des individus. Plus la femelle est physiologiquement âgée, plus elle<br />
a tendance à avoir un comportement exophile pendant la phase de digestion. Beaucoup<br />
de moustiques constituant la tranche exophile de la population, se réfugient dans les<br />
puits dont la structure conditionne le rendement (SUBRA, Loc. cit.).<br />
En général les mâles se réfugient très peu à l'intérieur des habitations<br />
probablement parce qu'ils se nourrissent de repas non sanguins (jus sucré). Ils y sont<br />
exceptionnellement rencontrés en nombre important. Leurs lieux de repos sont consti<br />
tués par les abris sombres (divers types d'abris ont été repertoriés).<br />
2.2.4.2. Les tendances endo-exophages et le cycle d'agressivité.<br />
La connaissance des tendances endo-exophages et du cycle d'agressivité<br />
des différentes espèces de moustiques apporte des éléments importants dans l'appré<br />
ciation de leur rôle vecteur de certaines maladies tropicales.
- 36 -<br />
Les tendances endo-exophages et le cycle d'agressivité de CuLex quinque<br />
fasciatus ont été étudiés à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) au moyen de captures effectuées<br />
pendant 21 mois (1966 - 1967) sur appâts humains. Ces captures ont montré que les<br />
femelles se gorgent durant la nuit et manifestent des tendances nettement endophages<br />
quelle que soit la période d'observation. Ces tendances endophages sont constantes<br />
pendant toute l'année mais plus marquée durant la saison froide, (SUBRA, 1972). Elles<br />
ont pu être mises en relation à certaines saisons, avec des facteurs particuliers com<br />
me l'âge des femelles et la température extérieure.<br />
Le déclenchement de l'activité de piqûres des moustiques est sous la dé<br />
pendance de stimuli externes(variation de la luminosité par exemple) mais ne se ma<br />
ni feste que dans le cadre d'un rythme circadien endogène réglé par une "horloge bio<br />
logique" ("endogenous clock" des auteurs anglosaxons). MA TTINGLY (1969) in SUBRA,<br />
(Loc. ciL), rapporte à ce sujet que chez a1nopheLes gambiae l'activité est déclenchée<br />
par la baisse de la luminosité et que ce stimulus n'est efficace que s'il intervient<br />
suivant un rythme de 24 heures (SUBRA, Loc. ciL).<br />
Selon BATES (1949) dans les conditions naturelles, le rythme d'activité<br />
d'une population possède des caractéristiques propres à l'espèce (diurne, nocture, cré<br />
pusculaire) modifiables par les conditions écologiques locales et dans certains cas, par<br />
l'âge des femelles.<br />
Pour CuLex quinquefasciatus, il ressort des travaux de SUBRA (Loc. ciL)<br />
que pendant toute l'année, le cycle d'agressivité des femelles aussi bien à l'intérieur<br />
qu'à l'extérieur des habitations se caractérise par une courbe en cloche avec un pic<br />
à 1 heure ou 2 heures du matin. L'aspect de cette courbe varie légèrement au cours<br />
de l'année. Pendant la saison froide notamment, le pic de la courbe est beaucoup<br />
plus marqué qu'aux autres époques. Une telle variation peut être liée aux températu<br />
res relativement basses qui caractérisent cette saison, toutefois l'influence du facteur<br />
température sur le cycle d'agressivité est apparue comme secondaire tout comme<br />
celle de l'âge des femelles. La pluie et le vent ont une influence nette mais très<br />
épisodique.<br />
Le rôle vecteur d'une espèce à tendance nettement endophage piquant<br />
la nuit lorsque les humains sont à l'intérieur de leurs habitations sera plus important<br />
que celui d'une espèce chez laquelle cette tendance sera moins marquée. Il sera en<br />
core plus marqué s'il y a coincidence entre le rythme de piqûres de l'insecte et la<br />
périodicité du parasite qu'il transmet comme DE MEILLON et SEBASTIAN (1967)<br />
l'ont observé pour CuLex quinquefasciatus et Wuche'leûa banc'l.Ofti Cobbold, 1877<br />
à Rangoon (in SUBRA, Loc. ciL).
- 37 -<br />
2.3. Distribution géographique de C.uLzx. quinquetasdatus Say, 1823 :<br />
CuLex quinquefasciatus se retrouve dans toutes les régions tropicales et<br />
subtropicales du mcnde et même dans certaines zones néarctiques (Sud des Etats<br />
Unis d'Amérique) et paléarctiques (Sud du Japon) (SUBRA, 1981).<br />
En Afrique, CuLex pipiens pipiens et CuLex quinquefasciatus sont tous deux<br />
présents. Le premier occupe habituellement les régions montagneuses et très rarement<br />
les zones de basses altitudes (Mauritanie et Cameroun) (HAMOI\J etaL., 1967 in<br />
SUBRA, Loc. cit.).<br />
CuLex quinquefasciatus est un moustique commun sur l'ensemble du conti<br />
nent africain, hormis la zone nordique où sa présence est contestée. Toutefois<br />
KNIGHT et MALEK en 1951 ont retrouvé des larves de moustiques appartenant au<br />
complexe pipiens dans la région du Caire (Egypte); VERMEIL en 1955 en a retrouvé<br />
en Tunisie. Des larves assimilées à celles de CuLex quinquefasciatus ont été récoltées<br />
à 32 km d'Alexandrie par GAABOUB et aL. en 1971.<br />
Dans la région éthiopienne, CuLex quinquefasciatus est largement répandu<br />
dans les pays situés au Sud du Sahara (HAMON et aL., Loc. cit.) et dans les îles avoi<br />
sinantes (Madagascar, les îles Mascareignes, et l'Archipel des Comores (BRUNHES, Loc.<br />
cit.), les Seychelles et l'Archipel de Chagos dans l'Océan Indien (LAMBRECHT, 1971)<br />
et dans les îles du Golf de Guinée (SAO TOME et FERNANDO-PO) et les îles de<br />
l'Océan Atlantique (Cap Vert).<br />
C.quinquefasciatus occupe toutes les zones bioclimatiques des régions fores<br />
tières aux régions semi-désertiques. L'altitude ne semble pas être une barrière à sa<br />
distribution. Ainsi a-t-il été retrouvé à 2770 mètres d'altitude en Inde (BHAT, 1975<br />
in SUBRA, Loc. cit.) et à 2130 mètres au Srilanka (ABDULCADER et aL., 1965 in<br />
SUBRA, Loc. ciL).<br />
Cependant il n'est pas retrouvé à très haute altitude en région éthiopien<br />
ne et la limite supérieure de sa distribution serait de l'ordre de 1600 à 1680 mè<br />
tres dans le Pacifique Sud (DOBROTWORSKY, 1967) et 1600 mètres dans l'île de la<br />
Réunion (HAMON et aL., Loc. cit.).<br />
La répartition de C.quinquefasciatus sur le continent africain retient<br />
l'attention depuis les quelques dernières décennies.<br />
En Afrique de l'Ouest avant la seconde guerre mondiale, la présence de ce<br />
moustique était limitée aux seules régions côtières où il représentait un faible pour<br />
centage de la faune culicidienne (MAC FIE et INGRAM, 1916 in SUBRA, Loc. ciL).
- 38 -<br />
Puis, on a assisté à sa prolifération et de nos jours il constitue l'espèce<br />
dominante en milieu urbain. Il reste rare en milieu rural.<br />
En Afrique Centrale,C.quinquefasciatus qui était connu dans quelques loca<br />
li tés au début du siècle est devenu commun avant 194 J particulièrement le long du<br />
fleuve Congo. Les années qui suivirent, il prolifera pour occuper largement un grand<br />
nombre de zones urbaines et aussi certains gros villages du Cameroun, ce dernier cas<br />
ne semble pas généralisé. Des études plus récentes effectuées en République Centra<br />
fricaine ont montré que C.quinquefasciatus est présent seulement dans les grandes<br />
villes, comme en Afrique de l'Ouest.<br />
La situation est tout à fait différente en Afrique de l'Est particulièrement<br />
dans les zones cotières et dans certaines îles de l'Océan Indien. Les auteurs qui ont<br />
réalisé les premiers travaux sur les insectes dans cette zone au début du siècle, ont<br />
remarqué l'expansion rapide de C.quinquefasciatus dans les îles Mascareignes (D'EM<br />
MEREZ DE CHARMOY, 1908 - 1909) et à Zanzibar (ADERS, 1917). Depuis cette<br />
période C.quinquefasciatus s'est largement répandu dans ces régions. Sa distribution<br />
ne s'est pas limitée aux seules zones urbaines mais il est devenu abondant dans un<br />
grand nombre de localités rurales notamment dans les gros villages construits sur des<br />
plans analogues à ceux des villes avec des rues, villages dans lesquels un certain pour<br />
centage de la population ne s'adonne pas entièrement à des activités traditionnelles<br />
telles que l'agriculture et la pêche. L'urbanisation par manque d'espace contraint<br />
les populations à construire des latrines et des fosses septiques pour la collecte des<br />
eaux usées. Dans les petits villages où l'évacuation des eaux usées ne pose pas de<br />
problèmes, Culex quinquefasciatus demeure rare ou même inexistant.<br />
Le cas des Seychelles retient spécialement l'attention. En effet dans ces<br />
îles C.quinquefasciatus était peu répandu il y a 25 ans et se retrouvait dans les en<br />
virons de Port Victoria la Capitale (MATTINGLY et BROWN, 1955 in SUBRA, loc.<br />
dt.). De nos jours il abonde dans l'Archipel où il colonise non seulement les gîtes<br />
ou habitats classiques mais d'autres types de gîtes.<br />
En Afrique de l'Est comme en Afrique de l'Ouest, les densités de C.quin<br />
quefasdatus ne se sont pas encore stabilisées. Une analyse faite sur les années 1954<br />
à 1971 à Dar-es-Salam par exemple a démontré un accroissement annuel des densités<br />
(BANG et al., 1973b in SUBRA, loc. dt.).
- 40 -<br />
C.quinquefasciatus y est plus récente qu'ailleurs et limitée au seul milieu urbain.<br />
Selon SUBRA, il semble exister un parallélisme entre l'occupation complète par<br />
C.quinquefasciatus d'un milieu donné (Afrique de l'Est, pays de l'Océan Indien) et le<br />
rôle joué par ce moustique dans la transmission de la maladie. Si une telle situation<br />
devait se réaliser en Afrique de l'Ouest, il serait alors probable que la filariose soit<br />
transmise par ce moustique (SUBRA, Loc. ciL).<br />
L'importance numérique des zones urbaines ne cesse de croître par sui te<br />
des forts courants de migration en provenance des régions rurales. La population à<br />
risque potentiel s'accroît d'année en année. Ce risque est d'autant plus grand que<br />
l'activité humaine même lorsqu'elle se veut bénéfique pour l'homme favorise presque<br />
toujours la pullulation de C.quinquefasciatus.<br />
La transmission de la filariose en Afrique de l'Ouest ne doit donc plus<br />
être considérée seulement comme un problème des zones rurales mais aussi des zones<br />
urbaines.<br />
Outre W.banctOfti, des virus ont été retrouvés chez CuLex quinquefasciatus<br />
dont le virus Chikungunya en 1953 en Tanzanie au cours d'une épidémie. Plus récem<br />
ment au Sénégal, WILLS et al., en 1976 ont démontré la présence du virus de l'hépa<br />
tite B chez ce moustique. En Egypte le virus "Rift Valley Fever" a été isolé<br />
chez des spécimens de CuLex quinquefasciatus capturés chez un malade atteint de<br />
R.V.F. (OMS, 1978).<br />
Les programmes de lutte insecticide contre CuLex quinquefasciatus se sont<br />
plus ou moins rapidement heurtés à des problèmes de résistance. De nouvelles formes<br />
d'intervention dont la lutte biologique et l'utilisation des analogues ou mimétiques<br />
d'hormones de croissance des insectes pourraient représenter une solution.<br />
2.5. Présentation de la zone d'étude.<br />
2.5.1. Situations géographique et climatologique.<br />
Notre étude a été réalisée dans des quartiers de la ville de Bouaké en<br />
Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest). Après Abidjan la Capitale Economique, Bouaké est<br />
la seconde ville. Elle est située au centre du pays dans l'axe du " V " baoulé (7° 45'<br />
Latitude Nord et 4° 59' Longitude Ouest).
- 41 -<br />
Située entre 4 0 30' et 10 0 30' Latitude Nord et 2 0 30' et 8 0 30' Longitu<br />
de Ouest, la Côte d'Ivoire connaît des climats chauds qui font la transition entre les<br />
climats équatoriaux humides et les climats tropicaux secs. Les températures moyennes<br />
varient peu d'une saison à l'autre. Par contre, l'importance des précipitations permet<br />
de souligner les différences saisonnières d'une part et régionales d'autre part. Le pays<br />
se caractérise par quatre zones climatiques: le Sud, le Centre, le Nord-Est et l'Ouest<br />
ou la région montagneuse de Man.<br />
Pour ce qui est du Centre qui nous intéresse particulièrement, cette région<br />
se caractérise par une saison sèche allant de Novembre à Mars. Elle précède la saison<br />
des pluies marquée par deux maxima pluviométriques, l'un en Mai et l'autre en Septem<br />
bre. Toutefois les précipitations du mois d'Août sont relativement faibles, de ce fait<br />
ce mois peut être qualifié de sec. A Bouaké, on a donc un rythme du type bimodal.<br />
Ci-après les données climatologiques de l'année 1987 relevées par le Centre Vivrier de<br />
l'Institut des Savanes de Bouaké ODESSA), (tableau 4).<br />
2.5.2. Le niveau d'urbanisation de la ville de Bouaké et ses relations avec<br />
l'implantation de Culex quinquetasdatus.<br />
La ville de Bouaké est peuplée d'environ 600.000 habitants. Cette popula<br />
tion est composée notamment des autochtones Baoulés et de nombreuses ethnies allogè<br />
nes (les Malinkés, les Tagbanas du groupe Senoufo, les Sarakolés du Mali, les Mossis et<br />
les Dafings du Burkina Faso, les Nagos du Nigeria, les quelques Haoussas et Djermas du<br />
Niger, et des Ashantis du Ghana). La ville présente un aspect non homogène avec de<br />
nombreux quartiers dont les plus anciens et plus populaires sont Koko,<br />
N'Gattakro, Air France l, Sokoura, Djambourou, Liberté; à ceux-là s'ajoutent des quar<br />
tiers plus récents dont Darressalam, Odienné-Kourani, Belle Ville et II, Air France II.<br />
Air France III, Kennedy et la zone commerciale du Centre ville, sont les quartiers<br />
résidentiels. De larges rues bordées de caniveaux traversent les quartiers. Avec la<br />
croissance économique de la Côte d'Ivoire, les habitations en "banco" (boue séchée)<br />
ont disparu des quartiers populaires au profit de celles construites avec des parpains<br />
et recouvertes de tôles ondulées. Ces habitations sont généralement regroupées autour<br />
d'une cour centrale ou "cour commune". Les repas sont préparés dans les cours. Ces<br />
cours sont généralement alimentées en eau par des puits ou par le système d'adduc<br />
tion d'eau. L'eau, à divers degrés de salubrité, sert dans de nombreuses activités hu<br />
maines. Elle peut être stockée dans des canaris où elle se conserve fraîche, ou dans
- 43 -<br />
des fûts qui servent de citernes. L'eau sert également à la macération du riz dans<br />
des demi-fûts ou de grandes jarres et à la fabrication de l'attiéké (couscous de ma<br />
nioc). Tous ces récipients utilisés à diverses tâches domestiques constituent de bons<br />
gîtes potentiels pour l'oviposition des femelles de Culex quinquefasciatus.<br />
Une seule concession "cour commune" peut abriter une trentaine à une cin<br />
quantaine de personnes, y compris les enfants, avec un ou deux lieux de toilettes,<br />
généralement si tués dans un coin de la cour. Les points de collection des eaux usées<br />
sont alors creusés à l'extérieur de la concession en bordure des rues. Les progrès de<br />
l'urbanisation n'ayant pas été suivis par la mise en place de systèmes rationnels<br />
d'évacuation des eaux. Ces points de collections des eaux usées sont généralement de<br />
simples trous aux contours plus ou moins bien délimités et creusés profondément dans<br />
le sol (1,50 à 2 mètres). Les ouvertures sont parfois entourées d'une bordure en ciment<br />
ou en pierres et le plus souvent obstruées par divers objets (tôles ondulées, planches<br />
de bois, dalles en ciment, etc••..) qui ne les isolent pas entièrement de l'extérieur.<br />
Aussi, en saison des pluies, d'importantes quantités d'eau de ruissellement sont recueil<br />
lies par ces puisards.<br />
Dans de telles conditions, ces puisards constituent des gîtes particulièrement<br />
favorables au développement des formes préimaginales de Culex quinquefasciatus.<br />
Notre étude a été réalisée dans les quartiers à fortes densités humaines<br />
car ils sont les plus importants du point de vue de la surface qu'ils occupent et c'est<br />
dans ces quartiers populaires où pullule Culex quinquefasciatus que le problème de<br />
l'implantation et la transmission éventuelle de la filariose de Bancroft pourrait se<br />
poser avec acuité. En effet, cette situation est à craindre dans la mesure où on<br />
assiste à des mouvements incessants de migration des populations humaines des zones<br />
rurales endémiques vers les zones urbaines.<br />
Dans les quartiers résidentiels par contre, le problème ne se pose pas dans<br />
la mesure où les puisards et les fosses septiques sont généralement scellés.<br />
2.5.3. Dynamique des populations préimaginales et imaginales de Culex quinque<br />
fasciatus dans la ville de Bouaké.<br />
La dynamique des populations préimaginales et imaginales de Culex quin<br />
quefasciatus au niveau de la ville de Bouaké est superposable à celle de la ville de<br />
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) où une étude approfondie a été réalisée par SUBRA,<br />
loc. ciL.. Ceci n'est guère surprenant dans la mesure où les deux villes sont prati<br />
quement situées dans la même zone climatique.
- 44 -<br />
En saison sèche chaude, la grande majorité des puisards n'hébergent pas de<br />
larves de Culex. quinquefasciatus mais regorgent de celles de Culex. cineteus qui s'ac<br />
commodent volontiers d'eaux excessivement polluées, très riches en ammoniaque.<br />
Culex. quinquefasciatus fait son apparition avec les premières pluies. Le nombre de<br />
gîtes potentiels augmente considérablement en saison des pluies; les fossés et les<br />
caniveaux non ou mal curés deviennent des gîtes positifs.<br />
Au fur et à mesure que s'avance la saison des pluies on assiste à une<br />
réduction importante des densités des populations préimaginales dans les gîtes et no<br />
tamment dans les fossés et les caniveaux; cela est dû à l'importance des précipi<br />
tations. En effet les pluies trop rapprochées provoquent un lessivage des pontes et<br />
des larves. Seuls les puisards demeurent des gîtes positifs. La fréquence et la violen<br />
ce des précipitations empêchent donc la colonisation des gîtes autre que les puisards.<br />
En fin de saison des pluies ou au début de la saison sèche on assiste à nou<br />
veau à une prolifération de Culex. quinquefasciatus dans divers types de gîtes dont<br />
principalement les fossés, les caniveaux et les puisards.<br />
Avec la saison sèche les densités préimaginales vont en diminuant du fait<br />
de l'augmentation du degré de pollution des eaux dans les puisards liée à l'évapora<br />
tion. La réduction des densités imaginales de Culex. quinquefasciatus s'en suit avec<br />
celle des gîtes favorables (assèchement des fossés, caniveaux et puisards peu profonds),<br />
Culex. cineteus devient l'espèce dominante. La réapparition de Culex. quinquefasciatus<br />
se fait avec les premières pluies.<br />
2.6. Matériel et méthode d'étude.<br />
2.6.1. Matériel.<br />
2.6.1.1. Matériel biologique.<br />
La cible biologique de nos expérimentations est constituée par les popula<br />
tions préimaginales (larves et nymphes) de Culex. quinquefasciatus dans un des gîtes natu<br />
rels (puisards) des quartiers à fortes densités humaines de la ville de Bouaké. Il est<br />
bon de signaler que dans ces puisards, d'autres espèces de moustiques vivent souvent<br />
en association avec Culex. quinquefasciatus. Culex. cineteus y est fréquemment ren<br />
contré et plus rarement Culex. ttigtipes Grandpré et Charmoy, 1900 et Culex. decens<br />
Theobald, 1901. Ces trois dernières espèces sont sans intérêt médical parce qu'elles<br />
ne sont pas anthropophiles.
- 45 -<br />
2.6.1.2. Composés régulateurs de croissance testés.<br />
Nous avons testé hui t formulations de cinq composés enregistrés par l'Orga<br />
nisation Mondiale de la Santé sous les numéros de code suivants : OMS 3007, OMS<br />
3009, OMS 3010, OMS 3019 et OMS 1697.<br />
- OMS 3007 : Proprionaldéhyde oxime 0 - 2 (4-phenoxyphenoxy) ethyl<br />
ether).<br />
Deux formulations de ce composé produites par la firme jamonaise SUMI<br />
TOMO CHEMICAL, des granulés à 0,5% et une poudre mouillable à 5%, ont été tes<br />
tées dans des puisards aux doses de 0,1 et 1 g/m 2 .<br />
- OMS 3009 : 1 - (3,5 dichIoro - 2,4 - difluoro-phenyI) - 3(2,6 <br />
difluoro-benzoyI) urea (Téflubenzuron).<br />
La formulation testée est un concentré émulsifiable à 10% produite par<br />
CELAMERCK GmbH. Ce produit a été testé à trois doses 0,1; 0,5 et 1 mg/I.<br />
- OMS 3010 (phenoxycarbamate) : Ethyl - 2 - (p. phenoxy-phenoxy) ethyl <br />
carbamate.<br />
Nous avons reçu deux formulations de ce composé produites par MAAG Ro:<br />
un concentré émulsifiable à 12,5% et une microémulsion à 10%. Ces deux produits<br />
ont été testés dans des puisards à deux doses (0,1 et 1 g/m 2 ).<br />
- OMS 3019 : 2 - 1 methyl - 2 (4 - phenoxy-phenoxy) - ethoxy pyridine.<br />
Deux formulations de ce composé produites par la firme japonaise SUMI<br />
TOMO CHEMICAL ont été testées. Des granulés à 0,5% et une poudre mouillable<br />
à 5%.<br />
- OMS 1697 : Methoprène - Altosid(R) : Isopropyl (2 Ethyl, 4 EthyI) - 11 <br />
methoxy - 3, 7, 11 Trimethyl - 2 - 1,4 dodécadienoate.<br />
Commercialisé sous l'appellation ALTOSID, ce composé a la formule brute<br />
suivante C 19 H 34 03' son poids moléculaire est 310,0.<br />
duites par SANDOZ.<br />
Nous avons testé des briquettes de 5,4 grammes à relargage progressif pro
2.6.2. Méthodologie.<br />
- 46 -<br />
2.6.2.1. Choix des puisards traités.<br />
Une prospection dans les quartiers a permis de recenser un grand nombre<br />
de puisards. Le choix des puisards traités a été effectué en tenant compte d'une part<br />
de l'abondance des populations préimaginales de Culex quinquefascïatus et d'autre part<br />
de leur accessibilité. Pour les besoins d'une évaluation de l'efficacité des produits<br />
nous avons dû exclure les puisards peu profonds et ceux ayant des bordures mal déli<br />
mitées dont les trop-pleins s'épandaient dans des crevasses environnantes.<br />
2.6.2.2. Traitement des puisards sélectionnés.<br />
Le dosage des insecticides dans les puisards sélectionnés a été réalisé d'une<br />
part en fonction de la surface de l'eau et la dose exprimée en quantité de matière<br />
active par unité de surface (gramme par mètre carré) et d'autre part en fonction du<br />
volume d'eau et la dose exprimée en quantité de matière active par litre (milligram<br />
me par litre). L'une ou l'autre unité de dosage a été utilisé selon la formulation. Dans<br />
la pratique, la première unité est apparue plus réaliste. En effet, dans l'éventualité<br />
d'une utilisation opérationnelle d'un des produits il serait fastidieux de traiter les gîtes<br />
en fonction de leurs volumes d'eau dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des varia<br />
tions du fait d'apports d'eau de toilette quotidienne et de l'évaporation.<br />
2.6.2.3. Evaluation de l'efficacité des produits testés.<br />
Avant le traitement nous avons, dans quelques gîtes choisis au hasard, réa<br />
lisé un échantillonnage des populations préimaginales de Culex quinquefascïatus par<br />
la technique du "dipping" (trois à cinq coups de louche). Les échantillons prélevés<br />
(larves et nymphes) ont été mis en observation au laboratoire pour une estimation du<br />
pourcentage naturel de réduction d'émergence.<br />
Après le traitement, des nymphes prélevées dans les puisards traités à<br />
intervalle de temps régulier (1 semaine) ont été également mises en observation dans<br />
de l'eau distillée jusqu'à l'émergence des adultes. L'évaluation de l'efficacité des pro<br />
duits testés a été basée sur le pourcentage des adultes obtenus. Le nombre des adul<br />
tes viables correspond au nombre d'exuvies nymphales flottant à la surface de l'eau.<br />
Les adultes morts à la surface de l'eau ou incapables de prendre leur envol ont été<br />
considérés comme non viables. L'efficacité de chaque produit est exprimée en pour<br />
centage de réduction d'émergence des adultes. Ce pourcentage est calculé selon la<br />
formule suivante :
ou<br />
- 47 -<br />
Nymphes mortes après la mise en observation + adultes non viables x 100<br />
Nombre total de nymphes récoltées<br />
100 -<br />
Nombre d'exuvies nymphales<br />
Nombre total de nymphes mises<br />
en observation<br />
x 100<br />
Pour vérifier la fiabilité de la méthode d'évaluation adoptée, nous avons<br />
déposé pendant 24 heures sur quelques puisards traités à des doses efficaces des cages<br />
afin de capturer d'éventuels adultes à la sortie des regards. Une dissection à la loupe<br />
binoculaire des femelles capturées a permis de déterminer leur âge physiologique (fe<br />
melles pares, femelles nullipares et femelles gravides). Les résultats de ces captures<br />
et dissections ont montré que les moustiques qui s'échappent par le regard des pui<br />
sards lors des échantillonnages hebdomadaires sont des moustiques venant de l'exté<br />
rieur du gîte ou des adultes néonates.<br />
L'évaluation de l'efficacité des ecdyso"fdes ou inhibiteurs de mue a été<br />
effectuée directement dans les puisards traités avec ce type de produit. Cette évalua<br />
tion a été basée sur une estimation des densités de chaque stade larvaire et de la<br />
densité des nymphes avant et après traitement. L'estimation des densités a été réali<br />
sée par la technique d'échantillonnage dite du "dipping" utilisant une louche à manche<br />
long. Cinq prélèvements à la louche sont effectués en cinq points différents du gîte.<br />
L'absence (0), la faible présence (+), les fortes (++) et très fortes (+++) présences des<br />
stades larvaires sont alors appréciées.<br />
2.7. Résultats de l'évaluation de l'efficacité et de la rémanence des formulations des<br />
cinq composés régulateurs de croissance dans les gîtes à CuLex quinquefasciatus.<br />
2.7.1. Modes d'action des composés testés.<br />
La mise en observation au laboratoire de larves et de nymphes récoltées<br />
dans les gîtes traités et l'observation directe dans les puisards ont permis de préciser<br />
le mode d'action de chaque composé testé.<br />
Quatre des cinq composés, l'OMS 3007, l'OMS 3010, l'OMS 3019 et l'OMS<br />
1697, sont des juvéno"fdes. Ils ne présentent pas une toxicité immédiate mais exercent<br />
une action léthale sur le dernier stade larvaire (stade 4) au moment de l'apolyse, et<br />
sur les nymphes.
- 48 -<br />
Nous avons remarqué la formation de quelques individus intermédiaires en<br />
tre le stade 4 et les nymphes. Ces stades surnuméraires présentent un gros céphalo<br />
thorax semblable à celui des nymphes et sont de plus grande taille que les larves<br />
normales du stade 4.<br />
La majorité des larves parvient au stade nymphal sans aucune modifica<br />
tion morphologique notable. Toutefois aux doses efficaces les nymphes formées ne<br />
produisent pas d'adultes viables. Plusieurs anomalies ont été observées. La plus fré<br />
quente a été la mortalité des nymphes sans éclosion d'adultes.<br />
De nombreux cas d'émergences incomplètes des adultes ont été observés.<br />
Les quatre pattes antérieures ou seulement les deux postérieures, les ailes seules ou<br />
avec l'abdomen et les pattes postérieures restent bloquées dans l'exuvie nymphale.<br />
Des imagos bien que complètement libérés de l'exuvie nymphale restent immobiles à<br />
la surface de l'eau incapables de prendre leur envol et meurent noyés.<br />
Aucune de ces anomalies morphologiques et physiologiques n'a été observée<br />
avec des larves et des nymphes récoltées dans les puisards avant les traitements et<br />
dans les deux puisards que nous avons retenus comme témoin durant toute la période<br />
d'expérimentation. Dans ces puisards non traités cette réduction s'est traduite par une<br />
mortalité nymphale variant entre 0 et 40%. Il est à noter que les plus forts pourcentages de<br />
réduction d'émergence enregistrés sont liés à la saison sèche chaude, période pendant<br />
laquelle certains puisards deviennent très pollués et donc défavorables au bon dévelop<br />
pement des larves de Culex quinquefasciatus, (graphiques 1 et 2 en Annexe).<br />
Le cinquième composé testé, l'OMS 3009 est un ecdysoYde ou inhibiteur<br />
des mues larvaires. Il a présenté une activité essentiellement larvicide. Aux doses<br />
efficaces, les larves des quatre stades et particulièrement les stades 3 et 4 ont été<br />
tuées. Il n'a présenté aucun effet sur les pontes et sur les nymphes.<br />
2.7.2. Efficacité et rémanence des composés et formulations testés.<br />
2.7.2.1. Les juvénoldes : OMS 3007, OMS 3010, OMS 3019 et OMS 1697.<br />
- OMS 3007 : granulés à 0,5% et poudre mouillable à 5%.<br />
Granulés à 0,5% : que ce soit à la dose de 0,1 ou de 1 g/m 2 , l'efficacité<br />
de cette formulation a été totale pendant seulement deux semaines (graphiques 3 et<br />
4 en Annexe).<br />
Poudre mouillable à 5% : avec cette formulation, aux doses de 0,1 et<br />
1 g/m 2 la durée de l'efficacité totale n'a également pas excédé deux semaines (gra<br />
phiques 5 et 6 en Annexe).
- 49 -<br />
- OMS 3010 (phenoxycarbamate) concentré émulsifiable à 12,5% et<br />
micro-émulsion à 10%.<br />
Concentré émulsifiable à 12,5%: l'efficacité de ce produit a été totale<br />
aux doses de 0,1 et 1 g/m 2 pendant neuf semaines. On a noté une bonne rémanence<br />
à la dose de 0,1 g/m 2 (graphiques 7 et 8). Le seul puisard traité à la dose de 1 g/m 2<br />
a été vidé par son propriétaire à notre insu à la 12ème semaine et nous avons dû<br />
arrêter le suivi à cette période.<br />
Micro-émulsion à 10% : seul le puisàrd trai té à la dose de 1 g/m 2 a pu<br />
être suivi pendant vingt-quatre semaines. A cette dose nous avons enregistré une effi<br />
cacité totale pendant onze semaines soit deux semaines de plus que pour la formula<br />
tion précédente (graphiques 9 et 1° en Annexe).<br />
- OMS 3019 : granulés à 0,5% et poudre mouillable à 5%.<br />
Granulés à 0,5% : dans les cinq puisards traités à la dose de 0,1 g/m 2 ,<br />
l'efficacité de cette formulation a été totale pendant dix semaines en moyenne (gra<br />
phiques 11, 12, 13, 14 et 15). A la dose de 0,5 g/m 2 elle a été de l'ordre de treize<br />
semaines (graphiques 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22). Les résultats des essais réalisés<br />
avec ce composé sont résumés aux tableaux 5 et 6.<br />
Poudre mouillable à 5% : à la dose de 0,1 g/m 2 , son efficacité a été tota<br />
le pendant quatre semaines (graphique 23). En revanche à la dose de 1 g/m 2 sa forte<br />
rémanence a permis d'obtenir une réduction totale des émergences pendant quarante<br />
semaines soit dix mois dans cinq puisards.<br />
- OMS 1697 (Methoprène-Altosid) (SANDOZ) briquettes de 5,4 grammes<br />
à 426,6 mg de matière active.<br />
Dans les cinq puisards traités à la dose unique d'une briquette pour 300<br />
litres d'eau soit 1,422 mg/l, l'efficacité de ce produit a été totale pendant douze<br />
semaines en moyenne (trois mois) (graphiques 24, 25, 26, 27 et 28). Les résultats<br />
obtenus avec ce composé sont résumés au tableau 7.<br />
2.7.2.2. L'ecdyso"lde : OMS 3009 CTéflubenzuron) à 10% 'Celamerck).<br />
Cet ecdyso"fde a été testé dans sept puisards aux doses de 0,1, 0,5 et<br />
1 mg/l. Les résultats obtenus sont résumés au tableau 8. A la dose de 0,1 mg/l,<br />
dans les deux puisards traités nous avons observé un faible effet larvicide du pro-<br />
dui t. Tous les stades préimaginaux sont restés présents toutefois on a noté une légère<br />
baisse de la densité des populations préimaginales dès les premiers jours du traitement<br />
(graphiques 29 et 30 en Annexe).
- 54 -<br />
A la dose de 0,5 mg/l nous avons enregistré une réduction importante des<br />
populations larvaires et nymphales 4 à 5 jours après les traitements. Dans le premier<br />
des deux puisards traités, les nymphes et les stades larvaires 3 et 4 ont disparu du<br />
gîte pendant toute la durée de l'expérimentation; seuls les stades larvaires 1 et 2 ont<br />
été retrouvés. L'activité larvicide du produit a été remarquable dans ce gîte. Par<br />
contre dans le second puisard après la forte réduction des populations durant les cinq<br />
premiers jours on a assisté à une rapide réapparition de tous les stades larvaires et<br />
des nymphes après le dix septième jour (graphiques 31 et 32 en Annexe).<br />
A la dose de 1 mg/l dans les trois puisards traités nous avons obtenu des<br />
résultats variables d'un puisard à l'autre. Dans le premier, c'est seulement au 6ème<br />
jour que l'on a observé une regression de la densité des populations préimaginales et<br />
cela jusqu'au 24ème jour où la réduction a été totale. La réapparition s'est faite pro<br />
gressivement et c'est seulement au 45ème jour que la présence de tous les stades<br />
larvaires et des nymphes a été notée (graphique 33). Dans le second puisard, l'activité<br />
du produit a été perceptible pendant les dix premiers jours. Nous n'avons malheureuse<br />
ment pas pu suivre le puisard jusqu'à la réapparition de tous les stades préimaginaux;<br />
en effet au 38ème jour ce gîte s'est asséché (graphique 34 en Annexe).<br />
Dans le troisième puisard, l'effet larvicide a été particulièrement remarqua<br />
ble. Dès le 3ème jour on a noté une forte mortalité larvaire. Du 5ème au 10ème<br />
jour nous n'avons observé que des larves du stade I. Du 10ème au 17ème jour c'est<br />
à-dire pendant une semaine les larves de Culex quinquefasciatus ont été absentes de<br />
ce puisard. C'est à partir du 17ème jour que les stades larvaires I et II ont réapparu<br />
puis ce sont maintenus jusqu'à l'arrêt de notre expérimentation (graphique 35).<br />
2.8. Discussion - Conclusion.<br />
Les huit formulations des cinq composés testés ont présenté à divers de<br />
grés une bonne efficacité dans les gîtes urbains à Culex quinquefasciatus que consti<br />
tuent les puisards dans la ville de Bouaké (tableau 9).<br />
Tous les juvénoYdes, à l'exception de l'OMS 3007 en poudre mouillable à<br />
5%, ont été efficaces et suffisamment rémanents aux doses testées. La formulation<br />
ne semble pas être un facteur limitant de l'activité de ces composés. Les performan<br />
ces de l'OMS 3019 (en granulés à 0,5% et en poudre mouillable à 5%) ont été impres<br />
sionnantes avec 10 et 14 semaines d'efficacité totale respectivement aux doses de<br />
0,1 et 0,5 g/m 2 pour les granulés et 40 semaines à 1 g/m 2 pour la poudre mouilla<br />
ble.
- 56 -<br />
Les résultats obtenus avec le seul ecdysorde testé (OMS 3009 en concen<br />
tré émulsifiable à 10%) ont été également satisfaisants à la dose de 1 mg!1 avec 6<br />
à 8 semaines de rémanence.<br />
L'utilisation opérationnelle des composés tel que l'OMS 3019, l'OMS 3010,<br />
l'OMS 1697 et l'OMS 3009 peut être favorablement envisagée. Toutefois des expéri<br />
mentations à plus grandes échelles restent nécessaire pour mieux apprécier les poten<br />
tialités réelles de ces produits. Les performances de ces insecticides régulateurs de<br />
croissance semblent liées à la stabilité de leurs molécules dans les eaux polluées des<br />
gîtes à Culex quinquefasciatus et à leur maintien dans la zone de nutrition des larves<br />
par adsorption sur les particules organiques en suspension.<br />
La combinaison d'un ecdysorde efficace et d'un excellent juvénorde pourrait<br />
donner de meilleurs résultats, l'un exerçant pleinement son activité sur les premiers<br />
stades larvaires et l'autre sur les larves du dernier stade. Par ailleurs, une telle asso<br />
ciation permettrait de minimiser le risque de développement d'une résistance des lar<br />
ves de moustiques à ces produits quand on sait que contrairement à l'hypothèse soute<br />
nue par de nombreux chercheurs ces insectes peuvent développer des mécanismes de<br />
résistances aux analogues de leurs hormones de croissance (GEORGHIOU, 1974) ou<br />
peut être même une résistance croisée avec les insecticides chimiques classiques<br />
(CERF et GEORGHIOU, 1974b; OPPENOORTH et VAN DER PASS, 1977; PIMPRIKAR<br />
et GEORGHIOU, 1979).<br />
Il n'en demeure pas moins que l'emploi généralisé des composés de cette<br />
nouvelle famille d'insecticide dans des programmes de lutte semble très prometteur.<br />
Ils peuvent valablement être utilisés en remplacement des larvicides conventionnels en<br />
rotation avec des agents de lutte biologique tels que le Bacillus sphaeûcus et le<br />
Bacillus thuûngiensis.
3.1. Introduction.<br />
- 57 -<br />
L'Onchocercose humaine est une filariose due au développement dans le<br />
derme d'une filaire Oncnocer..ca volvulus Leuckart, 1893. En Afrique de l'Ouest, ce<br />
parasite est transmis par la piqûre des femelles de simulies appartenant au complexe<br />
SimuLium damnosum. La simulie s'infecte lors d'un repas sanguin sur un hôte parasité.<br />
Cette filariose est la deuxième cause mondiale de cécité et touche environ 30 millions<br />
d'individus dont près de 99% se trouvent en Afrique Intertropicale et le reste au Yé<br />
men, en Arabie Saoudite et en Amérique Centrale et du Sud.<br />
En Afrique de l'Ouest cette maladie sévit à l'état endémique le long des<br />
vallées fertiles. Les foyers les plus importants se situent généralement dans les régions<br />
de savane.<br />
L'inexistence d'une chimiothérapie de masse appropriée fait de la lutte<br />
contre le vecteur la seule arme efficace pour combattre l'Onchocercose. La stratégie<br />
du Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest mis sur pied en<br />
1973, a été fondée essentiellement sur l'interruption de la chaine de transmission du<br />
parasite par destruction du vecteur. Celle-ci est obtenue par des traitements répétitifs<br />
aux insecticides des biefs à courant rapide des rivières où se développent les larves de<br />
SimuLium damnosum s.l..<br />
Le DDT (organochloré) a été utilisé avec succès à grande échelle dans la<br />
campagne FED* de 1963 à 1973. Une résistance à cet organochloré fût observée chez<br />
SimuLium damnosum en 1975 et 1976 au Togo, au Bénin, au Mali et en Côte<br />
d'Ivoire (GUILLET et aL., 1977). Par ailleurs le banissement de ce produit a été pro<br />
noncé à la suite d'observations faites dans les pays tempérés sur sa non-dégradabilité<br />
et son accumulation dans les chaines trophiques.<br />
Le métoxychlore, un autre organochloré utilisé avec succès en Amérique<br />
du Nord a donné des résultats insuffisants en Afrique de l'Ouest (GUILLET et al.,<br />
1979).<br />
Le téméphos, un organophosphoré en concentré émulsifiable à 20% de ma<br />
tière active a été sélectionné parmi un grand nombre de produits puis employé dans<br />
toute l'aire du programme jusqu'en 1979 date à laquelle les populations d'espèces<br />
forestières du complexe Simulium damnosum (S.soubr..ense et S.sanctipauliJ ont dévelop<br />
pé une résistance à cet insecticide (GUILLET et al., 1980). Sa grande efficacité et<br />
la facilité de son épandage permettaient de traiter tous les cours d'eau y compris<br />
les fleuves à gros débit.<br />
* : Fonds Européens de Développement.
58 -<br />
Le chlorphoxim, un autre organophosphoré a été utilisé en remplacement<br />
du téméphos dans les zones de résistance, mais les larves ont très rap idement déve<br />
loppé une résistance à cet autre composé. Simultanément une résistance croisée a<br />
été mise en évidence à la plupart des organophosphorés utilisables en santé publique<br />
(KURTAK et al., 1982).<br />
Un insecticide de remplacement sûr devait être impérativement trouvé pour<br />
les zones de résistance aux organophosphorés. Le seul moyen de faire face à la résis<br />
tance étant l'emploi d'un autre produit de préférence d'une autre classe ou famille<br />
qui ne présente pas de résistance croisée avec le premier.<br />
Cet écueil enregistré par le Programme OMS de Lutte contre l'Onchocerco<br />
se est à l'origine de la création d'un programme accéléré de recherche de nouveaux<br />
larvicides. Ce programme de recherche placé sous la double responsabilité du Bureau<br />
OMS de Contrôle de la Biologie des Vecteurs (VBC) et du Programme OMS de Lutte<br />
contre l'Onchocercose (OCP) répond à deux objectifs<br />
ment utilisés;<br />
- disposer de produits plus performants et moins chers que ceux actuelle<br />
- disposer de produits ou de méthodes de lutte de remplacement en cas de<br />
développement de la résistance aux organophosphorés des populations savanicoles de<br />
Simulium damnosum s.l••<br />
Ces recherches ont été orientées vers des familles d'insecticides autres<br />
que les organochlorés et les organophosphorés. Ainsi plusieurs formulations de pyré<br />
thrinoYdes et de carbamates ont été testées sur des larves de simulies. Les premiers<br />
ont donné des résultats intéressants mais se sont avérés très toxiques pour la faune<br />
aquatique non cible. Les seconds ont par contre présenté une activité larvicide très<br />
limitée. Aucun larvicide chimique n'a jusqu'à ce moment atteint le stade opérationnel<br />
à l'exclusion de la perméthrine (pyréthrinoYde) qui est utilisée sporadiquement dans les<br />
zones de résistance au téméphos en saison des pluies.<br />
L'utilisation d'un agent de lutte biologique, le Bacillus thutingiensis H-14<br />
a été la seule alternative. Les recherches sur les possibilités d'emploi de cette bacté<br />
rie comme larvicide ont connu un développement rapide. Depuis 1983, des formulations<br />
à base de Bacillus thutingiensis H-14 sont utilisées comme larvicides antisimulidiens<br />
dans les zones de résistance au téméphos. Très actif contre les larves de simulies et<br />
très sélectif, le Bacillus thutingiensis H-14 représente un produit idéal, toutefois les<br />
formulations actuellement disponibles posent non seulement des problèmes techniques
- 59 -<br />
au moment de leur utilisation mais sont d'un coût élevé. Des recherches se poursui<br />
vent en étroite collaboration avec les firmes productrices dans l'optique de mettre<br />
au point des formulations plus performantes que celles actuellement utilisées.<br />
Tenant compte des extensions sud et sud-ouest de l'aire du Programme OCP,<br />
il était souhaitable de disposer d'au moins deux insecticides de réserve. Ainsi, outre<br />
les familles d'insecticides classiques (larvicides) la recherche des nouveaux produits<br />
s'est orientée également vers d'autres composés utilisables dans la lutte contre les<br />
vecteurs de l'Onchocercose notamment les régulateurs de croissance des insectes.<br />
De nombreux composés régulateurs de croissance sont produits par II indus<br />
trie depuis les années 1970. Certains d'entre eux ont été utilisés avec succès dans la<br />
lutte contre les insectes ravageurs de plantes et également contre les larves de mousti<br />
ques (ANONYME, 1983). Les essais sur larves de simulies étaient jusque là très limi<br />
tés.<br />
Le composé le plus connu est le méthoprène (Altosii R )), un mimétique<br />
d'hormone juvénile utilisé avec succès depuis quelques années pour lutter contre des<br />
populations de moustiques résistants aux organophosphorés (SCHAEFER et WILDER,<br />
1972, 1973; SCHAEFER et DUPRAS, 1973; MATHIS et al., 1975; SELF et al., 1978;<br />
RODRIGUES et WRIGHT, 1978; TEN HOUTEN et al., 1980; AXTEL et al., 1980, in<br />
GUILLET et al., 1985). Un autre composé assez connu est le diflubenzuron (Dimilin(R)).<br />
Il appartient au second groupe important des régulateurs de croissance, les inhibiteurs<br />
de mue. Les régulateurs de croissance ne présentent généralement pas de résistance<br />
croisée avec les composés appartenant à d'autres familles d'insecticides. Ils sont donc<br />
apparus comme étant à priori utilisables pour la lutte contre Simulium damnosum s.l.•<br />
Ils ne présentent généralement pas une toxicité immédiate mais agissent à retardement.<br />
Leur activité est par conséquent plus difficile à évaluer que celles des insecticides<br />
chimiques classiques à action rapide. Une méthodologie appropriée a dû être mise au<br />
point afin de permettre une évaluation d'un grand nombre de composés. Les premiers<br />
essais ont été réalisés avec le Diflubenzuron (Dimilin(R)) (GUILLET et al., 1985). Un<br />
programme de criblage a alors été mis en place pour tenter de sélectionner les compo<br />
sés les plus efficaces susceptibles d'être utilisés comme antisimulidiens. Un grand nom<br />
bre de composés a été testé à ce jour. Nous exposons les résultats et les conclusions<br />
que l'on peut d'ores et déjà tirer sur les potentialités d'utilisation des formulations de<br />
composés régulateurs de croissance dans la lutte contre les vecteurs de l'Onchocercose<br />
humaine en Afrique de l'Ouest. Pour une meilleure compréhension de ce travail nous<br />
proposons des rappels bibliographiques sur la position systématique du complexe Simu<br />
lium damnosum, sa biologie et son écologie, son importance médicale et son rôle vec<br />
teur.
J.2. Rappels bibliographiques.<br />
60 -<br />
J.2.1. Position systématique du complexe SimuUum damnosum.<br />
Les simulies sont des diptères nématocères de petite taille appartenant à<br />
la famille des Simuliidae. Plus de 1300 espèces ont été décrites dans le monde dont<br />
150 dans la région éthiopienne. En Afrique de l'Ouest une trentaine d'espèces et de<br />
formes ont été trouvées dont la plus largement répandue est Simulium damnosum<br />
Théobald 1903 (PHILIPPON, 1978).<br />
Selon la classification de CROSSKEY (1969) la famille des Simuliidae peut<br />
être divisée en deux sous familles: 'Ja'l.asimuliinae et Simuliinae. La sous famille des<br />
'Ja'l.asimuliinae exclusivement néarctique est représentée par un seul genre: 'Ja'l.asimu<br />
lium Malloch, 1914. Celle des Simuliinae est composée de deux tribus : 'J'l.Osimuliini<br />
et Simuliini.<br />
La tribu 'J'l.Osimuliini comprend cinq genres<br />
- gymnopais Stone.<br />
- Twinnia Stone et Jamback.<br />
- 'J'l.Osimulium Roubaud.<br />
- c.'l.ozetia Davies.<br />
- gigantodax Enderlien.<br />
La tribu Simuliini comprend quatre genres<br />
- Simulium Latreille.<br />
- o1ustto simulium Tonnoir.<br />
- o1lto simulium Crosskey.<br />
- Metacnephia Crosskey.<br />
Toutes les espèces connues en Afrique appartiennent au genre Simulium qui<br />
selon CROSSKEY comprend 17 sous genres. L'espèce Simulium damnosum Théobald<br />
1903 est rangée dans le sous genre Edwa'l.dsellum Crosskey (PHILIPPON, 1978, loc.ciL).<br />
Simulium damnosum Théobald 1903 regroupe un certain nombre de formes<br />
très proches morphologiquement les unes des autres. Vingt huit (28) cytotypes ont été<br />
décrits dans le complexe Simulium damnosum, dont une dizaine est présente en Afri<br />
que de l'Ouest parmi lesquelles : Simulium damnosum s.s•• Simulium sitbanum. Simulium<br />
dieguetense. Simulium squamosum. Simulium yahense. Simulium soub'l.ense et Simulium<br />
sanctipauli (VAJIlVIE et DUI\IBAR, 1975; DUNBAR et VAJIME, 1981).
- 61 -<br />
Toutes les espèces du complexe mentionnées ont été identifiées à partir de<br />
l'examen des caractères chromosomiques larvaires (d'où leur dénomination de "cyto<br />
type" et l'appellation utilisée par certains auteurs de "cyto-espèce".<br />
3.2.2. Distribution géographique du complexe Simulium damnosum.<br />
Selon PHlLIPPON (1980), la répartition du complexe Simulium damnosum<br />
dans l'hémisphère Nord est à peu près superposable à celle de la maladie; en Afrique<br />
Occidentale sa limite septentrionale oscille entre 12° 30' et 15° 30'; en Afrique Orien<br />
tale cette limite s'étend vers le Nord le long du l\Jil jusqu'au 19ème parallèle, tandis<br />
que la limite méridionale (34° Sud) dépasse très largement celle des foyers d'Onchocer<br />
cose (environ 15° Sud). Rappelons enfin l'extension du complexe dans le Sud-Est de la<br />
péninsule arabique. La répartition des cytotypes en Afrique de l'Est reste mal connue.<br />
Celle des espèces présentes à l'Ouest du Nigeria a été beaucoup mieux étudiée (GARMS<br />
et VAJIME, 1975; VAJIME et QUILLEVERE, 1978; PHILIPPON, 1978a et 1978b; QUlLLE<br />
VERE, 1979) et apparaît relativement hétérogène. S.si'l.6anum est très caractéristique<br />
des savanes sèches septentrionales et pratiquement absent dans les zones préforestières<br />
et forestières; dans les savanes humides elle coexiste avec S.damnosum s.s., mais sa<br />
fréquence relative décroît du Nord au Sud.<br />
S.damnosum s.s. s'étend assez loin vers le Sud, encore qu'il soit peu fréquent<br />
dans les massifs forestiers. Malgré des extensions vers le Nord dans les savanes humides<br />
des régions accidentées de Guinée et des confins ivoiro-guinéen, S.sanetipauli et S.ya<br />
nense sont inféodés aux régions forestières ouest africaines. S.sou6'l.ense est moins<br />
exclusivement forestière et capable de se développer en savane humide.<br />
Simulium squamosum enfin montre une répartition en mosaYque au Sud du<br />
dixième parallèle Nord et colonise surtout les régions montagneuses.<br />
Si, une zonation Nord-Sud des espèces du complexe apparaît assez<br />
nettement dans la région considérée, il n'en existe pas moins un important chevauche<br />
ment des aires de distribution des six espèces principales.<br />
3.2.3. Biologie et Ecologie du complexe Simulium damnosum.<br />
Les grands traits de la biologie et de l'écologie du complexe S.damnosum<br />
en Afrique de l'Ouest sont connus depuis les travaux de LE BERRE (1966). Les résul<br />
tats de nombreux autres travaux sont venus approfondir nos connaissances dans ce<br />
domaine notamment ceux de PHILIPPON (1977) et de QUILLEVERE (1979) sur les<br />
espèces composant le complexe S.damnosum et leur répartition.
3.2.3.1. Cycle biologique.<br />
- 62 -<br />
Le développement biologique des simulies d'une manière générale et celui<br />
du complexe S.damnosum en particulier comprend deux phases dont l'une est aquati<br />
que et l'autre aérienne.<br />
Les adultes femelles pondent des oeufs sous forme de cordons gélatineux<br />
juste à la limite de l'eau dans la zone humidifiée par les embruns, les remous et les<br />
vagues des rapides des rivières. Ces cordons gélatineux s'entremêlent et forment des<br />
amas sur les supports végétaux ou minéraux submergés. A l'éclosion les jeunes larves,<br />
par dérive, colonisent les supports en aval des points de ponte.<br />
Le développement larvaire s'effectue en sept stades successifs séparés par<br />
des mues. La durée est inversement proportionnelle à la température ainsi qu'à la<br />
quantité de nourriture charriée par le courant. Dans les conditions naturelles en ré<br />
gion de savane les valeurs extrêmes de cette durée sont de 5 à plus de 12 jours<br />
(5ECHAN, 1980).<br />
Au terme du développement du septième stade larvaire, un cocon nymphal<br />
est tissé par la larve et suivi d'une mue nymphale à l'intérieur du cocon. Au cours<br />
de cette étape survient la métamorphose qui se caractérise par l'édification des carac<br />
tères imaginaux. La durée de vie nymphale varie de 2 à 5 jours, toutefois elle est<br />
conditionnée par la température de l'eau. Elle est le plus souvent de 3 à 4 jours. De<br />
ces nymphes éclosent des adultes qui prennent leur envol. Les femelles après accouple<br />
ment avec un mâle prennent des repas sanguins sur divers hôtes pour la maturation<br />
de leurs oeufs qu'elles viennent pondre dans les rivières.<br />
3.2.3.2. Bio-écologie des populations préimaginales.<br />
Les populations préimaginales (larves et nymphes) du complexe Simulium<br />
damnosum sont généralement ancrées sur des supports végétaux ou des rochers immergés<br />
dans les quarante premiers centimètres en dessous de la surface de l'eau. Elles ont<br />
cependant été trouvées jusqu'à quatre mètres de profondeurs mais on ignore la fré<br />
quence de cette répartition et la viabilité des spécimens vivant à de telles profondeurs<br />
(LE BERRE, 1966; EL5EN, 1977, EL5EN et HEBRARD, 1977).<br />
Les larves vivent préférentiellement dans des courants de 0,70 à 2,00 mè<br />
tres/seconde mais elles ont été observées dans des courants moins rapides de 0,10<br />
mètre/seconde et plus rapide de 2,50 mètres/seconde. Les di fférentes espè.ces ne se<br />
di fférencient pas par des rhéopréférendums, toutefois, S.si'l.6anum peut coloniser des<br />
courants assez lents dans la partie septentrionale de son aire de répartition (EL5EN<br />
et HEBRARD, loc. cit.; LE BERRE, loc. cit.J.
- 63 -<br />
La durée du cycle préimaginal varie suivant les saisons, les régions et les<br />
espèces. Il est en général d'autant plus rapide que la température de l'eau est plus<br />
élevée (ANONYME, 1984).<br />
Les larves se nourrissent en captant passivement à l'aide de leurs soies<br />
prémandibulaires, les particules naturelles (organiques et inorganiques) charriées par le<br />
courant. Cette captation et ingurgitation des particules se fait de façon ininterrompue<br />
et la progression du bol alimentaire s'effectue par bourrage.<br />
La taille maximum des particules ingérées varie de 13 à 150 microns,<br />
(EL SEN, lac. cit.). Toutefois les particules de petites -tailles ( 3 microns) et des<br />
éléments colloYdaux de 0,2 à 1 micron constituent une partie importante du bol ali<br />
mentaire (LOCK et al., 1977) ces particules sont captées par adhésion sur le mucus<br />
qui recouvre les pièces buccales (ROSS et CRAIG, 1980).<br />
La dynamique des populations préimaginales du complexe S.damnosum est<br />
influencée par un certain nombre de facteurs<br />
- Les fluctuations saisonnières du niveau des cours d'eau déterminent en<br />
effet directement la surface des gîtes larvaires utilisables par S.damnosum s.I., c'est<br />
à-dire le nombre de supports au niveau desquels la profondeur de l'eau et la vitesse<br />
du courant sont satisfaisantes. Le nombre des gîtes favorables est accru avec la mon<br />
tée des eaux et diminue avec la décrue. Les variations brutales du niveau des cours<br />
d'eau sont cependant défavorables à l'implantation des larves du complexe S.damnosum<br />
(PHILIPPON, lac. cit.).<br />
- La disponibilité d'éléments nutritifs dans le courant est un facteur limi<br />
tant des populations larvaires. Le courant doit véhiculer une quantité suffisante de<br />
matières organiques en suspension. Toutefois, le seuil minimum est difficile à estimer<br />
(PHILIPPON, lac. cit.).<br />
- La vitesse du courant de l'eau est un facteur déterminant de<br />
l'établissement des populations préimaginales du complexe S.damnosum et ce en dehors<br />
des limites admises (0,5 et 2 mètres/seconde). Les vitesses les plus favorables (pour<br />
lesquelles se rencontrent les plus fortes densités larvaires) sont comprises entre 0,7 et<br />
1,2 mètre/seconde. Dans un gîte préimaginal donné, il existe une relation entre la<br />
vitesse du courant et la quantité d'éléments nutritifs charriés par ce courant, (PHI<br />
LIPPON, lac. cit.).
- 64 -<br />
- La concurrence interspécifique entre S.damnosum s.l. et d'autres organis<br />
mes peut être observée au niveau des supports et constituer un facteur limitant. Par<br />
exemple la colonisation rapide des supports par des algues filamenteuses du genre<br />
Spi'l.ogY'l.a peut gêner et retarder considérablement l'installation des larves du complexe<br />
S.damnosum. Et lorsque les populations simulidiennes commencent à se substituer aux<br />
algues, S.damnosum s.l. ne se réinstalle généralement qu'après d'autres espèces simuli<br />
diennes plus ubiquistes telles que S.na'l.g'l.ealJesi, S.cewicotnutum, S.adetsi, S.gtiseicoLLe<br />
et S.ttidens (in PHILIPPON, Loc. ciL).<br />
- La température de l'eau n'a aucune influence sur la densité des popula<br />
tions préimaginales du complexe S.damnosum. En Afrique de l'Ouest les variations<br />
annuelles de température de l'eau ne sont accentuées que dans les zones septentriona<br />
les. Les températures ne sont toutefois jamais assez basses pour empêcher le dévelop<br />
pement larvaire. Les fluctuations annuelles influent seulement sur la durée de dévelop<br />
pement des larves.<br />
- Les parasites et les prédateurs peuvent avoir un effet régulateur certain<br />
sur l'abondance des populations préimaginales ou imaginales.<br />
- Les facteurs anthropiques: l'homme peut volontairement ou involontaire<br />
ment modifier le milieu où se développent les populations préimaginales de S.damnosum<br />
s.l.• Cette action peut être bénéfique ou non pour les populations simulidiennes :<br />
• L'influence bénéfique à l'implantation des larves peut être produite<br />
par la construction des déversoirs de barrages, de vannes, d'écluses, de ponts, de ra<br />
diers, de barrages de pêche etc• ••••<br />
• L'influence néfaste à l'implantation des larves peut être produite par<br />
la création de lacs de retenue supprimant tout courant, la pollution des rivières, l'em<br />
poisonnement accidentel ou systématique des eaux, et les campagnes larvicides (in<br />
PHILIPPON, Loc. ciL).<br />
3.2.3.3. Bio-écologie des adultes.<br />
A l'émergence, les adultes prennent leur envol pour une vie aérienne. Cette<br />
émergence se produit le matin et le soir avec une préférence pour l'une ou l'autre<br />
période suivant les saisons (BELLEC et HEBRARD, 1983).<br />
Les mâles forment des essaims composés de quelques centaines d'individus.<br />
La copulation se produit au sein de ces essaims lorsque les femelles s'en approchent<br />
peu après l'émergence. Les femelles ne s'accouplent qu'une seule fois au cours de leur<br />
existence.
- 65 -<br />
Les mâles et plus de 50% des femelles (nullipares ou pares), se nourrissent<br />
de jus sucré (nectar de fleurs en généra!). Les repas sanguins des femelles sont pris<br />
pour assurer la maturation des oeufs. Ces repas de sang fournissent à la femelle les<br />
éléments protidiques nécessaires au développement des oeufs. On désigne par cycle<br />
gonotrophique la combinaison du cycle de développement des ovaires avec celui des<br />
repas sanguins.<br />
Les espèces du complexe Simulium damnosum sont généralement amphophi<br />
les mais certaines espèces sont fortement anthropophiles.<br />
S.damnosum s.s. et S.sitbanum sont amphophiles sur la plus grande partie de leur<br />
aire de répartition encore qu'en cas d'absence d'hôte humain elles peuvent être<br />
saisonnièrement exclusivement zoophages.<br />
3.2.4. Importance médicale et vétérinaire des simulies rôle vecteur du complexe<br />
SimuUum damnosum.<br />
Dans de nombreuses régions du monde la pullulation des simulies est une<br />
cause considérable de nuisance pour les communautés humaines et les animaux domes<br />
tiques, notamment en Siberie, en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, à Mada<br />
gascar, en Afrique dans les régions forestières, dans le Pacifique aux Iles Marquises et<br />
en Europe Centrale.<br />
La toxicité des piqûres de simulies liée à la salive peut être à l'origine de<br />
graves accidents allergiques tant chez l'homme que chez le bétail. C'est le cas en<br />
Europe Centrale avec S.columbaczensis, au Soudan avec S.gtiseicolle et en Amérique<br />
du Nord avec S.a'l.eticum (in PHILIPPON, 1978).<br />
Plusieurs espèces de simulies sont impliquées dans la transmission de para<br />
sites (virus, protozoaires et filaires) aussi bien chez l'homme que chez les animaux.<br />
Ainsi, Simulium melatum est impliqué dans la transmission du virus de la<br />
myxomatose des lapins en Australie et le virus"EEV"(Eastew Encephalitis Viws) a été<br />
isolé à partir de Simulium johannseni et de Simulium metidisnale aux Etats Unis<br />
(PHILIPPON, loc. ciL).<br />
Simulium f7enustum est le vecteur de [eucocytozoon simondi, hématozoaire<br />
parasite des carnards du Canada.<br />
dons aux USA.<br />
Simulium jenningsi et Simulium occidentale transmettent Lsmithi aux din
- 66 -<br />
Simulium or.natum, Simulium e'l.yth'l.OcephaLum et Simulium exiguum trans<br />
mettent la filaire Onchoce'l.ca guttu'l.osa agent de l'Onchocercose bov ine en Europe et<br />
en Amérique Centrale.<br />
Simulium damnosum s.l. et Simulium neavi sont les vecteurs de l'Onchocer<br />
cose humaine en Afrique dont l'agent pathogène est Onchoce'l.ca voLvuLus. En Amérique<br />
cette filaire est transmise par Simulium och'l.aceum, Simulium metallicum et Simulium<br />
callidum.<br />
C'est O'NEIL qui, en 1875 fit la découverte des microfilaires d'onchocerque<br />
chez l'homme. L'identification de la filaire adulte fut faite par LEUCKART en 1893.<br />
Il a fallu attendre 1928 pour que BLACKLOCK au terme de longues investigations<br />
en Sierra Leone, établisse le rôle vecteur de Simulium damnosum Theobald 1903 dans<br />
la transmission de ce parasite chez l'homme en Afrique de l'Ouest.<br />
Seules les femelles de Simulium damnosum s.l. s'infestent puis transmettent le<br />
parasite au moment de la prise des repas sanguins nécessaire à la maturation des<br />
oeufs.<br />
Chez la simulie, les microfilaires ingérées avec le sang subissent d'impor<br />
tantes modi fications morphologiques et anatomiques et se transforment après sept<br />
jours en moyenne en larves infectieuses qui migrent dans la tête et les pièces bucca<br />
les de la simulie. Ces larves sont ensuite inoculées à l'homme lors d'un repas sanguin<br />
ultérieur chez l'homme; ces larves infectieuses se transforment en filaires adultes qui<br />
s'accouplent et dont les femelles émettent des microfilaires dans l'organisme humain.<br />
Le constat de l'existence dans l'Onchocercose de différents degrés de gravi<br />
té, géographiquement superposables à la distribution des diverses formes du complexe<br />
Simulium damnosum a suscité de très nombreuses études de laboratoire et de terrain,<br />
pour déterminer le rôle vecteur actuel et potentiel de chacune des espèces du comple<br />
xe (ANONYME, Loc. cit.) et la présence éventuelle de différentes formes d'onchocer<br />
ques. Les résultats des études des transmissions expérimentales permettent de conclure<br />
que les six espèces du complexe S.damnosum sont de bons vecteurs des souches d'on<br />
chocerque de leur région d'origine et éventuellement celles d'autres régions.<br />
Les transmissions "croisées" ont montré que :<br />
- S.sou6'l.ense/S.sanetipauli, espèces forestières transmettent très bien, dans<br />
leur biotope originel, les parasites de savanes.
- 67 -<br />
- S.yaIJense/S.squamosum espèces rencontrées en Côte d'Ivoire dans les<br />
petites rivières de forêt, transmettent mal les parasites associés aux grandes rivières<br />
de forêt et encore moins bien les "onchocerques de savanes".<br />
- S.damnosum s.s. et S.siz.banum n'ont qu'un très faible rendement parasi<br />
taire lorsqu'ils se gorgent sur des onchocerquiens contaminés aux abords des rivières<br />
de forêt.<br />
La paire S.soubz.enselS.sanctipauli est intrinsèquement le meilleur vecteur<br />
du complexe Simulium damnosum en Afrique de l'Ouest.<br />
3.3. Présentation des stations d'étude.<br />
Toutes les expérimentations ont été réalisées dans trois stations en Côte<br />
d'Lvoir.e Akakro (Dabou), N'Golodougou CT ouba) et MonnekoY (Alépé). Le choix de ces<br />
stations a été guidé par un certain nombre de facteurs :<br />
- la présence en abondance et pendant une longue période de l'année de<br />
larves du complexe Simulium damnosum;<br />
- la "non contamination" des rivières par des insecticides;<br />
- la possibilité d'installation des dispositifs d'évaluation à échelle réduite<br />
de l'activité biologique des insecticides;<br />
- secondairement les facilités d'accès.<br />
3.3.1. La station d'Akakro (Dabou).<br />
La grande majorité de nos expérimentations a été réalisée dans cette sta<br />
tion. Elle est située dans la Sous-Préfecture de Dabou à environ 10 kilomètres du<br />
village d'Akakro dans le Sud de la Côte d'Ivoire (5° 29 Nord - 3° 30 Ouest) dans une<br />
zone forestière fortement entamée par des exploitations agricoles de café, de cacao<br />
et de palmiers à huile. Les gîtes préimaginaux du complexe S.damnosum sont consti<br />
tués par une série de petites cascades sur la rivière N'Pedo un affluent de l'Agnébi<br />
qui se jette dans la lagune Ebrié. Ces gîtes sont essentiellement colonisés par des<br />
espèces simulidiennes de petites rivières de forêt dont principalement S.yaIJense<br />
(GUILLET, com. pez.s.). La saison des pluies y débute fin Mars début Avril pour s'ache<br />
ver en Juillet. Puis s'installe une petite saison sèche de Juillet à mi-Septembre et une<br />
petite saison des pluies de mi-Septembre à Novembre. La grande saison sèche s'étend<br />
de Décembre à Mars.
- 68 -<br />
Tout au cours de l'année la température de l'eau est plus ou moins cons<br />
tante (25° + 1). Le débit du cours d'eau est le plus souvent de l'ordre de 1 à 2 m 3/s,<br />
mais peut être beaucoup plus élevé pendant la saison des pluies. Les gîtes sont pro<br />
ductifs de Septembre à Février et permettent donc la réalisation des expérimentations<br />
pendant 6 mois.<br />
3.3.2. La station de N'Golodougou CTouba).<br />
Elle est située à proximité du village N'Golodougou dans la Sous-Préfec<br />
ture de Touba au Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire (8° 24 Nord - 7° 38 Ouest) sur<br />
l'axe routier Touba-Borotou.<br />
Les gîtes préimaginaux du complexe Simulium damnosum y sont constitués<br />
par trois bras de la rivière Férédougouba ou Bagbé parcourant un relief accidenté<br />
dans cette région.<br />
Située en zone de savane guinéenne, la végétation y est caractérisée par<br />
de hautes herbes et des galeries forestières continues peuplées de plusieurs essences<br />
où prédominent 'J andanus sp. et :Raphia sp..<br />
Les gîtes préimaginaux sont colonisés principalement par des espèces simu<br />
lidiennes de savane (S.damnosum s.s./S.sÎ'l6anum) en saison sèche et mélangées à des<br />
espèces forestières (S.sou6z.ense/S.sanetipauli) en saison des pluies (VAJIME et QUILLE<br />
VERE, 1978).<br />
La température de l'eau y est variable, tout au cours de l'année. Elle peut<br />
atteindre en saison sèche 30° C, mais elle descend rarement en dessous de 25° C<br />
en saison des pluies. Les gîtes ne sont accessibles qu'en période de basses eaux de<br />
Décembre à Juin.<br />
3.3.3. La station de Monnekol (Alépé).<br />
Cette station est située près de la localité de MonnekoY dans la Sous-Pré<br />
fecture dl Alépé dans le Sud de la Côte d'Ivoire en zone forestière (5° 32 Nord - 3°<br />
41 Ouest) sur le Kossan, un affluent de la Comoé. La forêt y a fai t place à des plan<br />
tation de caféiers, de cacaoyers et de palmiers à huile.<br />
La région connaît quatre saisons, une grande saison des pluies d'Avril à<br />
mi-Juillet, une petite saison sèche de mi-Juillet à mi-Septembre, une petite saison des<br />
pluies de mi-Septembre à Novembre et une grande saison sèche de Décembre à Mars.
- 72 -<br />
- OMS 3007 S-21149 (Sumitomo Chemical Company (Japon).<br />
Formule brute: C 17 H 19 NO y<br />
Formule développée<br />
Nom chimique : Propionaldehyde oxime 0 - 2 - (4 - Phenoxy-phenoxy) ethyl ether.<br />
Deux formulations ont été testées un concentré émusifiable à 10% et<br />
une suspension de microcapsules à 5%.<br />
- OMS 3019 S-31183 (Sumitomo Chemical Company - Japon).<br />
Formule brute: C 20 H 19 N0 3<br />
Formule développée<br />
Nom chimique : 2 - 1 - Methyl - 2 - (4 - Phenoxy-phenoxy) ethoxy pyridine.<br />
Deux formulations liquides ont été testées sur larves de simulies un con<br />
centré émulsifiable à 10% et une suspension de microcapsules à 5%.<br />
3.4.1.3. Autres composés testés agissant comme régulateurs de croissance.<br />
- OMS 2016 et OMS 2017 :<br />
Ces deux composés ont été fournis par la Firme Schering : le premier en<br />
poudre mouil1able à 50% et le second en poudre mouil1able à 25%. Aucune indication<br />
ne nous a été donnée sur la nature chimique de ces composés et leur mode d'action.<br />
- Avermectine MK 936 B1 :<br />
Ce composé appartient à un type d'insecticides tout à fait nouveau. Ce<br />
sont des lactones macrocycliques obtenues par fermentations d'un actinomycète<br />
(St'leptomyces alJe'lmitilis); substances remarquables toxiques vis-à-vis des nématodes,<br />
des acariens et des insectes (KATCHANSKY et al., 1983; PUTTER et al., 1981;<br />
CHABALA et al., 1980; BURG et al., 1973).
73-<br />
La formulation testée est un concentré émulsifiable à 18 g/l de matière<br />
active contenant environ 80% d'Avermectine B 1 a et 20% de B 1 b. Cette formula<br />
tion destinée à l'usage agricole s'est révélée très toxique pour les larves d'o'ledes<br />
aegypti (CL 50 = 0,012 mg/l), ayant un effet régulateur de croissance avec<br />
une forte mortalité au cours du stade nymphal.<br />
3.4.2. Matériel biologique.<br />
Toutes les expérimentations effectuées avec les différentes formulations<br />
des composés sus-cités ont été réalisées sur des larves de simulies des di fférentes<br />
espèces du complexe Simulium damnosum en fonction des stations utilisées.<br />
3.4.3. Méthodes d'études.<br />
L'impossibilité d'élever des simulies au laboratoire impose la réalisation de<br />
tous les essais d'insecticides antisimulidiens sur le terrain. Des méthodologies pour<br />
évaluer l'efficacité des produits adaptés à chaque type de formulation ont été mises<br />
au point (GUILLET et al.. 1985 in Thèse).<br />
L'évaluation de l'activité biologique des formulations de composés régula<br />
teurs de croissance vis-à-vis des larves du complexe Simulium damnosum a d'emblée<br />
posé un problème d'ordre méthodologique.<br />
En effet ces composés agissent lentement sur le développement des larves<br />
tandis que le biotope privilégié des larves de simulies (rapides des rivières) est un mi<br />
lieu instable. L'évaluation de l'effet de ce type d'insecticide est donc plus difficile<br />
que celui des insecticides classiques à toxicité immédiate.<br />
En Amérique du Nord, des essais de laboratoire et de terrain réalisés avec<br />
certains composés en l'occurrence le diflubenzuron (Dimilin(R)) et le méthoprène (Alto<br />
sii R )) sur des espèces néarctiques (Simulium CJitatum. Simulium CJenustum. Simulium<br />
CJe
- 74 -<br />
Trois différentes méthodes ont été testées sucessivement (GUILLET corn.<br />
pets.); la dernière donnant les meilleurs résultats. Elle a été utilisée pour l'évaluation<br />
de plusieurs produits; (GUILLET et al., 1984, 1985), mais présentait quelques insuffi<br />
sances. Des améliorations lui ont été apportées avec la conception et la construction<br />
de deux nouveaux dispositifs. Ces améliorations se traduisent par une plus grande faci<br />
lité d'exécution des tests, une plus grande fiabilité des résultats grâce à des taux éle<br />
vés d'éclosion des adultes dans les lots témoins et une réduction importante des pertes<br />
de larves par dérive. Elles ont permis d'accroître sensiblement nos capacités de cri<br />
blage des formulations.<br />
3.4.3.1. Description de la méthodologie des tests.<br />
Des méthodologies ont été développées pour évaluer l'activité des formula<br />
tions de larvicides chimiques (dispositif des "Troughs") et des formulations à base de<br />
B.thuûngiensis H-14 (dispositif des minigouttières). Elles ont permis de tester de nom<br />
breuses formulations proposées par l'industrie et d'en sélectionner quelques unes pour<br />
des essais. Ces dispositifs adaptés aux conditions de terrain permettent l'exécution des<br />
tests dans des conditions normalisées et la comparaison de différents résultats (GUIL<br />
LET 1985 in Thèse). La méthodologie a été adaptée à l'évaluation des régulateurs de<br />
croissance et comprend quatre phases :<br />
- La colonisation de supports artificiels par des larves de simulies prélevées<br />
dans les gîtes avec leurs supports naturels.<br />
donné.<br />
- L'exposition des larves à différentes doses d'insecticides pendant un temps<br />
- La mise en observation des larves dans un dispositi f approprié pour étu<br />
dier leur survie et leur nymphose et pour récupérer vivants les adultes émergeant des<br />
nymphes.<br />
L'évaluation de l'efficacité des produits testés est basée sur les pourcenta<br />
ges de réduction d'émergence des imagos calculés par comparaison entre le nombre<br />
d'imagos obtenus et le nombre de larves initialement traitées.<br />
3.4.3.1.1. La colonisation des supports artificiels par des larves.<br />
La colonisation des supports artificiels (plaquettes métalliques de 18 x 6,5<br />
cm peintes en blanc laqué) par les larves est réalisée à l'aide d'un dispositif de "dé<br />
versoir". Cet appareil spécialement conçu, permet en un temps assez court de coloni<br />
ser les plaquettes par une dérive naturelle sans manipulation des larves, évitant ainsi<br />
une perturbation de leur comportement (HOUGARD et al., 1986) (voir schéma 5).
\ .<br />
- 75 _<br />
1<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j<br />
j
- 76 -<br />
Ce dispositif décrit par HOUGARD, est entièrement construit en contre<br />
plaqués "marine" et se compose de 3 parties principales concentriques<br />
- Un collecteur central rectangulaire (54 cm x 36 cm x 8 cm) amovible<br />
et alimenté par gravité avec de l'eau de rivière à l'aide d'un tuyau en aluminium ou<br />
en P.V.c. (diamètre = 6 cm).<br />
- Un réservoir rectangulaire (96 cm x 78 cm x 6,5 cm) d'une capacité<br />
d'environ 50 litres dans lequel l'eau du collecteur central est redistribuée dans sa<br />
partie inférieure sans turbulence.<br />
- Quatre plans inclinés à 15° situés sur les quatre côtés du réservoir et<br />
sur lesquels on peut fixer une cinquantaine de plaquettes (supports artificiels).<br />
Le dispositif est installé sur une table placé à l'horizontale. Une fois le<br />
réservoir plein, l'eau se déverse sur les plans inclinés créant un courant suffisant pour<br />
les larves.<br />
Des larves prélevées avec leurs supports naturels sont placées dans le réser<br />
voir d'eau où elles se retrouvent dans un milieu à faible turbulence défavorable à<br />
leur survie. Elles se détachent et sont entrainées ou migrent vers les plans inclinés<br />
où le courant est plus élevé, et là se raccrochent sur les plaquettes métalliques.<br />
Deux à trois heures suffisent pour obtenir des plaquettes entièrement cou<br />
vertes de larves. Selon que l'on désire exposer différents groupes de stades larvaires<br />
à l'insecticide (larves âgées = stades larvaires 6 et 7, larves jeunes = stades larvaires<br />
3, 4 et 5) on procède à un tri des larves sur les plaquettes en éliminant à l'aide de<br />
pinces souples les stades larvaires non désirés. Une fois cette dernière manipulation<br />
achevée, les plaquettes sont alors prêtes à être exposées à l'insecticide.<br />
3.4.3.1.2. L'exposition des larves à l'insecticide.<br />
L'exposition des larves à l'insecticide est réalisée à l'aide du dispositif des<br />
"troughs" ou auges dérivant de celui décrit par JAMBACK et FREMPONG-BOADU<br />
(1966). Ce dispositif couramment utilisé pour l'évaluation des larvicides chimiques<br />
s'adapte bien au traitement des larves avec les composés régulateurs de croissance<br />
(GUILLET et al., Loc. cit.; GUILLET et al., 1985).<br />
Entièrement construits en contreplaqués "marine", les "troughs" (longueur :<br />
42 cm, largeur: 22 cm, profondeur: 10 cm) ont un côté sur lequel est fixé un plan<br />
incliné (15°) ayant deux compartiments (longueur: 18,5 cm, largeur: 7,5 cm, profon<br />
deur : 3,5 cm).
- 77 -<br />
Ces "troughs" sont disposés sur une table placée à l'horizontale. Chaque<br />
"trough" est alimenté par une pompe électrique, elle-même rattachée à un réservoir<br />
d'eau d'une capacité supérieure ou égale à 60 litres. Lorsque les pompes, sont mises<br />
en marche, les "troughs" sont alimentés en eau et leur trop-plein se déverse sur le<br />
plan incliné à deux compartiments et retombe dans le réservoir placé juste en des<br />
sous. L'écoulement de l'eau dans les deux compartiments du plan incliné se fait à une<br />
vitesse favorable aux larves de simulies (0,6 à 0,8 m/sec) (schéma 6).<br />
Aux 60 litres d'eau du réservoir est ajoutée une quantité d'insecticide<br />
pur ou dilué pour obtenir une concentration donnée. Cinq à dix minutes suffisent<br />
pour obtenir un mélange adéquat de l'insecticide à l'eau. Une fois le mélange effectué,<br />
les plaquettes colonisées de larves sont alors transférées dans les "troughs" deux à<br />
deux, chaque "trough" ne pouvant prendre que deux plaquettes. Les larves sont ainsi<br />
soumises au traitement insecticide pendant un temps donné (10 minutes, 20 minutes<br />
ou 60 minutes).<br />
3.4.3.1.3. La mise en observation des larves après exposition à<br />
l'insecticide.<br />
Après l'exposition des larves à l'insecticide, les plaquettes sont rapidement<br />
transférées dans le dispositif de mise en observation. Ce dispositif spécialement conçu<br />
permet le suivi du devenir des larves. Il dérive de celui utilisé pour la colonisation<br />
des supports artificiels ci-dessus décrit. Leurs dimensions et principes de fonctionne<br />
ment sont identiques. A la différence du dispositif du déversoir, les quatre plans in<br />
clinés sont compartimentés. Chaque compartiment forme une minigouttière (longueur =<br />
38 cm, largeur = 8 cm, profondeur = 4,5 cm) ayant à son extrémité inférieure un<br />
filet en toile de nylon (BLUTEX GG(R)) ) mailles fines (500 u); chaque dispositif en<br />
comporte 42 (schéma 7).<br />
C'est dans ces minigouttières alimentées en eau que sont fixées les plaquet<br />
tes portant les larves traitées. Le filet permet de retenir toutes les larves qui décro<br />
chent des plaquettes. Il est à noter que l'eau de rivière alimentant les gouttières est<br />
filtrée à travers un voile de nylon (200 fJ) fixé sur le collecteur central et aux bouts<br />
des quatre tuyaux d'alimentation, retenant ainsi les débris végétaux et inorganiques de<br />
grosse taille et d'éventuelles larves de simulies dérivant depuis l'amont.<br />
Une fois les plaquettes placées dans les gouttières, une élimination des<br />
stades larvaires non désirés est effectuée à l'aide de pinces souples et le nombre de<br />
larves sur chaque plaquette compté.
- 81 -<br />
l'activité de produit testé. Cette ligne est une droite à pente assez forte à partir<br />
de laqueIJe on peut déterminer graphiquement les concentrations léthales caractéristi<br />
ques qui sont généralement ceIJes entrainant 50% et 95% de mortalité et leurs inter<br />
vaIJes de confiance calculés par une méthode d'analyses statistiques (Méthode Finney<br />
Analyse Probit incluant le test du X 2 ).<br />
Avec les régulateurs de croissance, l'hétérogeneité des résultats, ou le man<br />
que de corrélation dose/pourcentage de réduction d'émergence observée dans la plupart<br />
des cas ne permet pas une application de cette méthode d'analyse. Aussi, nous sommes<br />
nous contentés des valeurs corrigées des pourcentages. de réduction d'émergence des<br />
adultes.<br />
3.4.3.2. Etude des paramètres pouvant conditionner l'efficacité des composés<br />
régulateurs de croissance vis-à-vis des larves de simulies.<br />
Avec certains composés, en l'occurrence l'OMS 1804 et l'OMS 3019 nous<br />
avons étudié l'influence des paramètres susceptibles de conditionner l'efficacité de ces<br />
produits: la concentration, le temps de contact, la formulation et le stade larvaire.<br />
Dans certains traitements insecticides le temps de contact est un facteur<br />
déterminant de Pefficacité. D'une manière générale avec les régulateurs de croissance<br />
de meiIJeurs résultats sont obtenus avec de longs temps de contact.<br />
La concentration est également un facteur déterminant. Dans la pratique<br />
des traitements antisimulidiens il est difficile d'obtenir un temps de contact prolongé<br />
entre les larves et l'insecticide, et nous avons cherché à savoir si avec la durée théo<br />
rique des applications des insecticides antisimulidiens (10 mn) on pouvait obtenir de<br />
bons résultats en augmentant les concentrations.<br />
Pour ce faire, les larves ont été traitées soit en maintenant constant le<br />
produit"temps de contact"x "concentration", soit en maintenant le temps de contact<br />
constant et en augmentant la concentration. Dans le premier cas la quantité d'insecti<br />
cide reste constante, dans le second cas elle augmente proportionnelJement à la con<br />
centration.<br />
La sensibilité des larves jeunes aux insecticides est généralement plus gran<br />
de que ceIJe des larves âgées. Compte tenu de l'asynchronisme du développement lar<br />
vaire chez les simulies, nous avons étudié l'influence du stade larvaire sur l'efficacité<br />
des régulateurs de croissance en testant simultanément aux mêmes doses deux groupes<br />
d'âges; d'une part de jeunes stades larvaires (3 - 4 - 5) et d'autre part des larves<br />
âgées (derniers stades : 6 - 7).
- 82 -<br />
L'efficacité des larvicides antisimulidiens classiques peut dépendre étroite<br />
ment de la formulation utilisée (GUILLET et al., Loc. cit.). Il pourrait en être de mê<br />
me avec les composés régulateurs de croissance. Pour vérifier ce phénomène nous<br />
avons testé comparativement plusieurs formulations de trois composés: l'OMS 1804<br />
(diflubenzuron) (ecdysoYde), l'OMS 3007 et l'OMS 3019 (juvenoYdes).<br />
3.5. Résultats des essais.<br />
3.5.1. Ecdyso"ldes.<br />
- OMS 1804 (Diflubenzuron)<br />
Avec ce composé nous avons dans un premier temps étudié l'influence des<br />
différents paramètres susceptibles de conditionner son efficacité vis-à-vis des larves<br />
de simulies :<br />
• Influence de la concentration :<br />
Le Diflubenzuron a présenté même aux fortes concentrations une<br />
efficacité médiocre avec un temps de contact court (10 minutes). On a observé un<br />
manque de corrélation dose/mortalité aux fortes concentrations et des pourcentages de<br />
réduction d'émergence qui n'ont jamais excédé 80%, (tableau 10).<br />
• Influence du temps de contact :<br />
Le temps de contact est un facteur très important dans le cas des<br />
traitements antisimulidiens en eau courante, le contact insecticide/larves généralement<br />
court doit être suffisant pour que le produit soit efficace.<br />
Les résultats de trois séries d'essais réalisés laissent apparaître une augmen<br />
tation de l'efficacité du Diflubenzuron avec le temps de contact. Pour une même quan<br />
tité de produit appliqué, le pourcentage de réduction d'émergence est passé respective-<br />
ment de 9,6 à 81,9% et 17,6 à 77,1 % lorsque le temps de contact a augmenté de<br />
10 à 80 mn et de 80 à 320 mn, (tableaux 11, 12, 13 et 14).<br />
• Influence de la formulation :<br />
Les quatre formulations testées ont présenté une efficacité médiocre<br />
pour la même dose et le même temps de contact. Les meilleurs résultats ont été obte<br />
nus avec le "f1owable" à 48% et la poudre mouillable à la plus forte concentration<br />
testée. Par contre l'efficacité de la suspension liquide a été médiocre même aux fortes<br />
concentrations (tableau 15).
- 83 -<br />
Tableau 10 Influence de la concentration sur l'efficacité du Difluben<br />
zuron (poudre mouillable à 25% de matière active).<br />
=========================-=====-=====-=====-=====-====:-=====-===== -----<br />
Concentration (mg/l/10mn) 0 0,1 0,25 0,5 1 1,5 2 4<br />
Pourcentage<br />
corrigé de<br />
réduction<br />
Série 1 : 27,5 - 16,1 40,5 14,5 - 0 0<br />
Touba 06/83 (131) (93) (119) (172) (77) (83)<br />
Série 2 : 35,2 10,1 - 9,6 - 63,4 - -<br />
Akakro 01/84 (91) (154) (198) (188 )<br />
Série 3 : 23,3 - - 16,0 5,2 - 25,9 2,5<br />
d'émergence<br />
Touba 02/84 (116) (45) (55) ( 57) ( 51)<br />
-----------<br />
------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----<br />
( ) = Nombre de larves testées (stades larvaires 6 et 7).
- 86 -<br />
Douze formulations ont été comparées du point de vue efficacité; les résul<br />
tats obtenus ont été très variables d'une formulation à une autre. Une seule s'est dis<br />
tinguée du lot avec 69,5% et 82,4% de réduction d'émergence respectivement aux do<br />
ses de 0,05 mg/l et 0,25 mg/l pour un temps de contact de 20 minutes (tableau 16).<br />
• Influence du stade larvaire.<br />
Une comparaison des résultats obtenus avec la poudre mouillable à<br />
25% sur des larves des stades 6 et 7 (tableau 1) et ceux obtenus avec la même for<br />
mulation sur des larves des stades 3 à 5 (tableau 17) ne permet pas de conclure à une<br />
efficacité du diflubenzuron en fonction du stade larvaire. Théoriquement les plus jeunes<br />
larves devraient être plus sensibles au produits; ce que nous n'avons pas vérifié.<br />
Dans un second temps nous avons réalisé des tests complémentaires avec<br />
une formulation de Diflubenzuron, le "Flowable" à 5% (FUN 83 J 19C) apparue comme<br />
la plus efficace des 12 formulations testées. Les résultats comparés à ceux obtenus<br />
antérieurement indiquent bien la nette supériorité de cette formulation du point de<br />
vue efficacité sur larves de simulies (stades 6 et 7) avec 91 à 96% de réduction<br />
d'émergence à 0,5 et 1 mg/l pendant 20 mm (tableau 18).<br />
Un concentré émulsifiable à 1% de Diflubenzuron produi t par Dow Chemical<br />
Company a été testé. Cette formulation n'a été guère plus performante que les autres<br />
et le même manque de corrélation dose/mortalité a été observé (tableau 19).<br />
- OMS 2015 (Triflumuron) SIR 8514 Alcystin(R).<br />
Les résultats obtenus avec le concentré émulsifiable à 6,5% de matière<br />
active n'ont pas été satisfaisants. Deux séries d'essais ont été réalisées mais dans<br />
tous les cas à forte dose le pourcentage de réduction des émergences n'a jamais excé<br />
dé 80%, (tableau 20)<br />
- OMS 3009 (Téflubenzuron).<br />
Les résultats enregistrés avec cet autre inhibiteur de mue n'ont guère été<br />
meilleurs. Même pour une forte dose (1 mg/}) et pour un temps de contact prolongé<br />
(60 minutes) le pourcentage de réduction d'émergence n'a pas excédé 80%. Avec un<br />
temps de contact moindre (10 mn) les résultats ont été médiocres, (tableaux 21 et<br />
22).
Tableau 21<br />
- 91 -<br />
Résultats du criblage préliminaire de l'OMS 3009<br />
(Téflubenzuron) en suspension concentrée à 150 g/l<br />
(Celamerck) sur larves de Simulium yahense stades<br />
6 et 7; (temps de contact 60 minutes - Akakro <br />
Janvier 1986.<br />
============================= ------- -----------------------<br />
------- ------- ------- -------<br />
Concentration (mg/!)<br />
Temps de contact (mn)<br />
°<br />
°<br />
0,1 0,33 1 ,°<br />
60 60 60<br />
Nombre de larves testées 297 204 135 277<br />
Pourcentage de nymphose 94,94 71,07 79,25 85,92<br />
Pourcentage corrigé de<br />
réduction d'émergence<br />
22,90 56,38 74,82 81,29<br />
==============--------------- ------- ------- ------- -------<br />
Tableau 22 Résultats de deux séries d'essais de l'OMS 3009 (Téfluben<br />
zuron) en suspension concentrée à 150 g/l (Celamerck) sur<br />
larves de Simulium yahense stades 6 et 7 : temps de contact<br />
10 mn - Akakro - Janvier et Février 1986.<br />
-----------------============-===========------------ -----------------<br />
Essai 1 Essai II<br />
Concentration (mg/l)<br />
Temps de contact (mn)<br />
° 0,1 0,33 1,° 0,1 0,33 1,°<br />
°<br />
10 10 10 10 10 10<br />
Nombre de larves testées 110 218 313 240 121 138 153<br />
Pourcentage de nymphose 99,09 90,82 59,42 74,16 99,17 98,55 90,84<br />
Pourcentage corrigé de<br />
réduction d'émergence<br />
18,19 50,92 50,16 52,09 71,08 55,80 30,07<br />
===================-:--------<br />
----- -------------------- ----- ----- ------------ ----- -----
- 92 -<br />
- OMS 3013 (Chlorfluazuron).<br />
Les essais réalisés avec ce produit ont également donné des résultats peu<br />
satisfaisants même avec un long temps de contact (60 mn) et à une dose aussi forte<br />
que 1 mg/I. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus avec l'OMS 3009 (Téflu<br />
benzuron), (tableaux 23 et 24).<br />
- OMS 3031 XRD 473 CE 5%.<br />
Un seul essai a été réalisé avec ce produit. Comme avec tous les autres<br />
inhibiteurs de mue testés, les résultats obtenus avec un temps de contact court (10<br />
minutes) et une dose de 1 mg/l, ont été insuffisants (50 à 60% de réduction d'émer<br />
gence). On a pu noter une grande hétérogenéYté au niveau de ces résultats qui confir<br />
me l'absence de corrélation dose/mortalité observée avec tous les ecdysoYdes, (ta<br />
bleau 25).<br />
3.5.2. Juvéno·'des.<br />
- OMS 1697 Méthoprène (Altosii R ».<br />
L'étude de l'influcence du temps de contact effectuée avec la formulation<br />
"Slow release" à 10% a révélé que l'efficacité du méthoprène augmente proportionnelle<br />
ment au temps de contact. A la dose de 1 mg/I pendant 40 mn nous avons obtenu<br />
une efficacité totale (100% R.E.), (tableau 26).<br />
Les formulations SR 10 et PS 10 ont présenté· sensiblement la même effi<br />
cacité avec respectivement 60,6% et 50,8% de réduction d'émergence à 1 mg/I pour<br />
10 minutes seulement de contact (tableaux 26 et 28).<br />
Avec un produit "temps de contact x concentration"constant, l'efficacité a<br />
augmenté avec le temps de contact (tableaux 27 et 28).<br />
- OMS 3010 (Phenoxycarbamate)•<br />
• Concentré émulsifiable à 12,5%.<br />
Trois séries d'essais ont été réalisées avec cette formulation. Les résultats<br />
enregistrés ont été assez satisfaisants avec 100% de réduction d'émergence à une<br />
dose acceptable (0,4 mg/I pour un temps de contact de 10 minutes), (tableau 29). Ces<br />
résultats encourageants nous ont amené à demander au producteur de nous fournir des<br />
formulations avec un pourcentage de matière active plus élevé.
Tableau 23<br />
- 93 -<br />
Résultats du criblage préliminaire de l'OMS 3013 (Chlor<br />
fluazuron) en concentré émulsifiable à 5% sur larves de<br />
Simulium yanense stades 6 et 7 (temps de contact 60 mi<br />
nutes)- Akakro - Janvier 1986.<br />
============================= ------- --------------- -------<br />
------- ------- ------- -------<br />
Concentration (mg/1) 0 0,1 0,33 1 ,0<br />
Temps de contact (mn) 0 60 60 60<br />
Nombre de larves testées 297 148 191 186<br />
Pourcentage de nymphose 94,94 68,24 71,72 66,12<br />
Pourcentage corrigé de<br />
réduction d'émergence<br />
22,90 65,90 64,40 81,73<br />
----------------------------- ------- ------- ------- -------<br />
Tableau 24 Résultats de deux séries d'essais de l'OMS 3013 (Chlor<br />
fluazuron) en concentré émulsifiable à 5% sur larves de<br />
Simulium yanense stades 6 et 7 (temps de contact 10 mi<br />
nutes)- Akakro - Janvier et Février 1986.<br />
=============================-============----------= -----------------<br />
Essai 1 Essai II<br />
Concentration (mg/l) 0 0,1 D,33 1 ,0 0,1 0,33 1 ,0<br />
Temps de contact (mn) 0 10 10 10 10 10 1D<br />
Nombre de larves testées 110 228 210 175 119 173 138<br />
Pourcentage de nymphose 99,09 69,29 67,14 68,07 72 ,26 74,56 80,43<br />
Pourcentage corrigé de<br />
18,19 60,09 61,91 56,00 52,95 47,40 50,73<br />
réduction d'émergence<br />
----------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tableau 25 Résultats d'un essai réalisé avec l'OMS 3031 XRD 473 en concentré émulsifiable<br />
à 5% (Dow Chemical Company) sur des larves de Simulium yahense - Akakro <br />
Octobre 1986.<br />
============================= ===============================-===============================<br />
Stades larvaires 6 - 7 Stades larvaires 3 - 4 - 5<br />
Concentration (mg/l) 0 0,1 0,5 1,0 0 0,1 0,5 1,0<br />
Temps de contact (mn) 0 10 10 10 ° 10 10 10<br />
Nombre de larves testées 122 173 183 191 71 145 188 211<br />
Pourcentage de mortalité<br />
larvaire<br />
10,65 16,76 21,31 13,08 ° 50,34 42,02 54,02<br />
Pourcentage nymphose 89,34 83,23 78,68 86,91 100 48,96 57,97 22,74<br />
Pourcentage corrigé de<br />
réduction d'émergence<br />
20,50 62,90 51 ,16 40,15 32,40 55,36 54,86 54,79<br />
----------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------<br />
'Û<br />
.po
- 95 -<br />
Tableau 26 Etude de l'influence du temps de contact sur l'efficacité du<br />
Méthoprène (SR 10 Altosid) vis-à-vis des larves du complexe<br />
Simulium damnosum.<br />
(Concentration constante, temps de contact croissant).<br />
=========================== -----------------------<br />
------- ------- ------- ------- ------- --------------- -------<br />
Concentration (mg/l) 0 1 1 1 1 1<br />
Temps de contact (mn)<br />
Nombre de larves testées<br />
Pourcentage de nymphose<br />
0 5<br />
48 76<br />
83,3 63<br />
10<br />
106<br />
78<br />
20 40 80<br />
83 50 52<br />
63,9 86 44<br />
Pourcentage corrigé de<br />
27<br />
réduction d'émergence<br />
44,1 60,6 88,6 100 100<br />
===========================-----------------=======-=======-=======-=======<br />
------- -------<br />
Tableau 27 Etude de l'influence du temps de contact sur l'efficacité<br />
du Méthoprène (SR 10 Altosid) vis-à-vis des larves du<br />
complexe Simulium damnosum.<br />
(Concentration x temps de contact = constant).<br />
===========================-=======-=======-=======-=======-=======<br />
Concentration (mg/l) o 0,25 0,125 0,0625 0,0312<br />
Temps de contact (mn) o 10 20 40 80<br />
Nombre de larves testées 83 77 120 75 82<br />
Pourcentage de nymphose 89,2 70,1 51,6 85,3 63,4<br />
Pourcentage corrigé de<br />
réduction d'émergence<br />
15,1 54,1 80,3 71,7 72,7<br />
===========================-=======-=======-=======-=======-=======<br />
Tableau 28 Etude de l'influence du temps de contact sur l'efficacité<br />
du Méthoprène (PS 10 Altosid) vis-à-vis des larves du<br />
complexe Simulium damnosum.<br />
(Concentration x temps de contact = constant).<br />
--------------------------- ------- ----------------------- ------- ------- ------- -------<br />
Concentration (mg/l) 0 1 0,5 0,25 0,125<br />
Temps de contact (mn) 0 10 20 40 80<br />
Nombre de larves testées 83 91 107 78 64<br />
Pourcentage de nymphose 89,2 81,3 80,3 67,9 71,9<br />
Pourcentage corrigé de<br />
réduction d'émergence<br />
15,1 50,8 67 68,3 81,6<br />
:---:---:------------------ ------- ------- ------- ------- -------
- 97 -<br />
• Concentrés émulsifiables à 20%.<br />
Cinq formulations à 20% ont été testées comparativement. Les excellents<br />
résultats observés lors des premiers essais ont permis de sélectionner trois d'entre eux<br />
pour des essais complémentaires: ACR 5289 B (M3), ACR 5289 0 (M1), ACR 5289 E<br />
(M1), (tableau 30).<br />
Les résultats de ces essais ont été très satisfaisants du moins avec les lar<br />
ves âgées (stades 5, 6 et 7) avec 100% d'efficacité totale à la dose de 0,1 mg/l<br />
pour un temps de contact de 10 minutes pour la formulation ACR 5289 E (M1), (ta<br />
bleau 31).<br />
- OMS 3007 S-21149 et OMS 3019 S-31183.<br />
Une comparaison de l'efficacité des quatre formulations de ces deux compo<br />
sés a révélé une légère supériorité des concentrés émulsifiables à 10% par rapport aux<br />
suspensions de microcapsules à 5% (tableau 32).<br />
Par ailleurs, les concentrés émulsifiables ont présenté le même niveau<br />
d'efficacité sur les larves âgées (tableau 33). Nous avons retenu le concentré émulsi<br />
fiable de l'OMS 3019 pour la suite de nos expérimentations.<br />
Celles-ci ont permis de confirmer la plus grande sensibilité des larves âgées<br />
par rapport aux larves jeunes (tableaux 34 et 35).<br />
Le temps de contact s'est donc révélé être un facteur conditionnant l'effi<br />
cacité de l'OMS 3019 CE 10%. Avec 60 minutes de contact, le pourcentage de réduc<br />
tion d'émergence a été de 98,40% à la dose de 0,1 mg/l contre 59,53% pour 20 mn<br />
et 57,88% pour 10 mn à la même dose (tableau 36).<br />
3.5.3. Autres composés testés.<br />
- OMS 2016 (Poudre mouillable à 5%) et OMS 2017 (Poudre mouillable à<br />
25%) (Schering).<br />
L'efficacité de l'OMS 2016 a été médiocre. A la concentration de 1 mg/l<br />
pour un temps de contact de 60 minutes la réduction d'émergence a été seulement de<br />
70 à 80% (tableau 37). Ce composé agit essentiellement sur les larves et non sur les<br />
nymphes.
- 106 -<br />
L'OMS 2017 a provoqué 100% de réduction d'émergence lors du premier<br />
essai à la dose de 1 mg/I/60 mn. Avec un temps de contact plus court (10 mn) pour<br />
la même dose, son efficacité a été réduite à 50% (tableau 38). La mortalité survient<br />
surtout au stade nymphal.<br />
-Avermectine MK 936 B1.<br />
L'Avermectine a présenté une très forte toxicité immédiate pour les larves<br />
du complexe Simulium damnosum et particulièrement pour les jeunes larves. On a<br />
obtenu 100% de mortalité larvaire à 0,001 mg/l/l0mn contre 30% de mortalité pour<br />
les larves âgées (stades 6 et 7) (tableau 39).<br />
Outre sa toxicité immédiate, l'Avermectine aux faibles doses, a présenté<br />
un effet régulateur de croissance. De fortes mortalités nymphales ont été enregistrées<br />
aux doses de 0,0024 mg/l/l0mn et 0,0048 mg/l/l0mn (tableaux 40 et 41) pour les<br />
larves de S.damnosum s.s. et S.soubtense résistantes aux organophosphorés. Toutefois,<br />
la firme Merk Sharp and Dhome (MSD) n'entend pas développer ce produit pour une<br />
utilisation comme larvicide antisimulidien.
Tableau 38 Efficacité de l'OMS 2017 (poudre mouillable à 25% de matière active) sur des larves des<br />
stades 5 - 6 - 7 du complexe Simulium damnosum, Akakro - Touba, 1984.<br />
=============================.=======================.======================= -----------------------------<br />
Essai 1 Essai II Essai III<br />
Concentration (mg/l)<br />
Temps de contact (mn)<br />
Nombre de larves testées<br />
Pourcentage de nymphose<br />
Pourcentage corrigé de<br />
réduction d'émergence<br />
°<br />
°<br />
0,1<br />
60<br />
0,3<br />
60<br />
1<br />
60<br />
°<br />
°<br />
0,1<br />
60<br />
0,3<br />
60<br />
69 1 38 1 123 1 57 1 137 1 52 1 72 1 114 1 60 1 90 1 140 1 80 1 94<br />
92,2136,8153,7184,2199,3196,11100189,4180,3191,01 72,11 68,8178,7<br />
37,71 62,01 89,61 100 1 21,21 31,7143,71 31,41 27,3\ 22,01 32,21 51,91 22,4<br />
0,9<br />
60<br />
°<br />
°<br />
0,1<br />
10<br />
0,3<br />
10<br />
1<br />
10<br />
2<br />
60<br />
o -J
- 108 -<br />
Tableau 39 Activité immédiate de l'Avermectine sur les larves de<br />
Simulium yahense.<br />
(Temps de contact 10 minutes, lecture après 48 heures,<br />
température 24° C, turbidité de l'eau 5 JTU).<br />
================-===============================================<br />
Concentration<br />
Pourcentage corrigé de mortalité des larves<br />
(mg/l/10mn) Larves jeunes Larves<br />
A<br />
agées<br />
Total<br />
stades 4 et 5 stades 6 et 7 stades 4 à 7<br />
0,001 100 ( 11 ) 30 (200) 34,9 (211)<br />
0,0033 92,9 (75) 38,2 (151 ) 57,1 (226)<br />
0,01 94,9 (42) 87,5 (118 ) 89,5 (160)<br />
0,033 100 (37) 99,2 (138) 99,4 (175)<br />
0,1 100 (5) 99,3 (167) 99,4 (172)<br />
0 6,1 (33 ) 12,2 (82) 10,4 (115 )<br />
CL 50 0,0038 0,0029<br />
(43-43) (24-35)<br />
-----===========-=-------------- ---------======-===========----<br />
( ) = Nombre de larves testées.
Tableau 40 Activité de l'Avermectine sur des larves de stades 6 et 7 de Simulium damnosum s.s.<br />
sensibles et Simulium soubz.ense résistantes aux insecticides organophosphorés.<br />
(Lecture en fin d'émergence).<br />
CL réduction d'émergence à 50% = 0,00097 mg/l/10mn (0,00095 - 0,0010).<br />
----------------------------- ---------- ---------- ---------- -------------------------------<br />
----------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------<br />
Concentration (mg.l) 0 0,0003 0,0006 0,0012 0,0024 0,0048<br />
Temps de contact (mn) 0 10 10 10 10 10<br />
Nombre de larves testées 86 154 63 83 107 118<br />
Pourcentage de nymphose 90,7 74 63,5 28,9 10,3 0,8<br />
Pourcentage de mortalité<br />
nymphale<br />
Pourcentage corrigé de<br />
réduction d'émergence<br />
15,4 15,8 32,5 29 72,7 100<br />
23,3 18,6 43,9 73,1 89,9 100<br />
----------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------<br />
o '-Ü
3.6. Discussion - Conclusion.<br />
- 111 -<br />
D'une manière générale, les résultats enregistrés avec les formulations tes<br />
tées des composés régulateurs de croissance ne sont pas encourageants. A l'exception<br />
de deux composés l'OMS 3010 (phenoxycarbamate) et l'OMS 3019 (tous deux des<br />
juvénoYdes), tous les autres produits testés ont présenté un niveau d'efficacité insuffi<br />
sant vis-à-vis des larves du complexe Simulium damnosum.<br />
L'absence de corrélation entre les concentrations et les pourcentages de<br />
réduction d'émergence obtenus avec les régulateurs de croissance et la forte variabili<br />
té des résultats d'une série de tests à une autre, rendent difficile l'interprétation.<br />
Les ecdyso"ï"des se sont révélés très peu efficaces. Il faut un temps de con<br />
tact relativement long pour obtenir une certaine efficacité qui en dépit des concentra<br />
tions élevées n'a jamais excédé 80%. Par ailleurs ces inhibiteurs de mue ne semblent<br />
pas plus actifs sur les premiers stades larvaires que sur les derniers. Ces observations<br />
sont en contradiction avec celles obtenues sur Simulium IJittatum (LACEY et MULLA,<br />
loc. ciL). L'efficacité du Diflubenzuron dépend de la formulation utilisée toutefois<br />
elle demeure dans le meilleur des cas nettement trop faible pour que son utilisation<br />
puisse être envisagée dans la lutte contre les vecteurs de l'Onchocercose en Afrique<br />
de l'Ouest.<br />
Aucun des cinq ecdysoYdes testés n'a présenté une efficacité suffisante sur<br />
les larves du complexe Simulium damnosum, même avec des temps de contact prolon<br />
gés (20 à 60 minutes), pour faire l'objet d'essais en rivières.<br />
Les juvénoYdes par contre, ont donné des résultats plus intéressants. Deux<br />
d'entre eux, l'OMS 3010 (phénoxycarbamate) et l'OMS 3019, qui sont des concentrés<br />
émulsifiables, ont été retenus pour des essais en rivières.<br />
L'un des facteurs limitants de l'efficacité des juvénoYdes reste leur manque<br />
d'activité sur les premiers stades larvaires. Deux hypothèses peuvent expliquer ce phé<br />
nomène :<br />
- la plupart des composés agissant par ingestion, la rapidité du transit<br />
intestinal des larves de simulies et notamment chez les larves jeunes pourrait limiter<br />
l'adsorption de la matière active (GUILLET in Thèse);<br />
- les jeunes larves auraient le temps au cours de leur vie larvaire de méta<br />
boliser ou d'excréter ces substances juvénilisantes excédentaires. Une prolongation de<br />
la durée de vie a été observée chez les larves traitées avec la plupart des juvénoYdes<br />
étudiés.
- 112 -<br />
Un essai en rivière réalisé avec l'OMS 3019 à la dose de 0,1 mg/I pour<br />
une durée d'épandage de 20 minutes a donné des résultats peu satisfaisants. Le pro<br />
duit a présenté une assez bonne portée mais n'a pas été suffisamment efficace au<br />
premier gîte (moins de 80% de réduction d'émergence). En revanche il a été plus<br />
efficace dans les gîtes les plus distants du point d'épandage (80 à 99% de réduction<br />
d'émergence). Cette situation pourrait s'expliquer par le passage lent du produit sur<br />
les derniers gîtes avec pour conséquence une longue mise en contact de l'insectici<br />
de et des larves à de faibles doses.<br />
L'efficacité limitée des formulations de composés régulateurs de croissance<br />
vis-à-vis des larves de S.damnosum s.1. n'est nullement imputable à la méthodologie<br />
et au protocole d'essais utilisé. Les rares essais en rivières réalisés avec le Difluben<br />
zuron en poudre mouillable à 25% et avec l'OMS 3019 en concentré émulsifiable à<br />
10% ont donné des résultats comparables à ceux obtenus avec les dispositifs d'évalua<br />
tion à échelle réduite (GUILLET in Thèse; DOANNIO et al., non publié). Le temps de<br />
contact et le stade larvaire sont deux facteurs importants qui conditionnent l'efficaci<br />
té des composés régulateurs de croissance vis-à-vis des larves du complexe S.damno<br />
sumo Leur utilisation dans la lutte contre les vecteurs de l'Onchocercose n'est cepen<br />
dant pas inconcevable. Il faudrait pour cela mettre au point des techniques d'applica<br />
tion lente des produits de manière à maintenir longtemps une faible concentration<br />
d'insecticide dans la rivière.<br />
De tels traitements de longue durée, et répétés, auraient certainement pour<br />
conséquence une longue mise en contact des larves avec les produits et par ailleurs<br />
les jeunes larves n'auraient pas le temps de métaboliser toutes les substances. Les<br />
ecdysoldes étant plus actifs sur les jeunes larves, une combinaison d'un ecdyso'îde avec<br />
un juvénolde dans une même formulation pourrait éventuellement représenter une solu<br />
tion. Une telle association mériterait d'être testée.<br />
Dans l'état actuel des choses, la poursuite des essais de nouveaux composés<br />
régulateurs de croissance est à encourager car il est toujours possible que l'on puisse<br />
sélectionner de nouvelles formulations qui se révèleraient utilisables dans la lutte contre<br />
les vecteurs de l'Onchocercose.<br />
Une étude approfondie de l'endocrinologie des larves de simulies permet<br />
trait peut être d'expliquer la faible efficacité de la plupart des composés testés jus<br />
qu'à présent sur les larves du complexe S.damnosum. Une identification de l'ecdysone<br />
et de l'hormone juvénile impliquées dans la croissance des larves du complexe S.dam<br />
nosum permettrait peut être également d'orienter les Firmes dans la production des<br />
composés synthétiques analogues.
- 113 -<br />
Sur le plan pratique, si des régulateurs de croissance devaient être utilisés<br />
dans un programme tel qu'OCP, l'évaluation de leur efficacité serait plus difficile<br />
que celle des insecticides classiques à action immédiate qui provoquent un détachement<br />
des larves.Cette évaluation devrait être basée, dans le cas des juvénoYdes, sur les taux<br />
d'émergence des nymphes prélevées et mises en observation dans des cages et dans le<br />
cas des ecdysoYdes sur l'absence de nymphes bien formées. Dans les deux cas, elle<br />
pourrai t être basée sur la capture de femelles piqueuses sur appât humain ou sur piè<br />
ges du type plaque dl aluminium.
CONCLUSION GENERALE<br />
-------------------------
- 115 -<br />
Par contre l'emploi de ces substances dans la lutte contre les populations<br />
préimaginales du complexe Simulium damnosum pose quelques problèmes. Les régula<br />
teurs de croissance sont d'une part actifs sur les larves de simulies à des doses rela<br />
tivement élevées et d'autre part nécessitent un temps de contact larves/produits beau<br />
coup plus long qu'avec les insecticides à action immédiate. De ce fait leur utilisation<br />
opérationnelle nécessite des techniques particulières d'application lente des produits<br />
qui n'existent pas encore et à fortiori des techniques d'application nouvelles. Des for<br />
mulations qui relargueraient progressivement la matière active dans l'eau<br />
(plaquettes et briquettes) seraient probablement plus adaptées. Un des problèmes<br />
non moins importants qui doit être élucidé reste l'effet de ces substances hormonales<br />
sur les autres insectes aquatiques des rivières, les crustacés et les poissons.<br />
Quoi qu'il en soit, le criblage de ces composés doi t être poursuivi (car il<br />
est probable que l'on puisse dans l'avenir) afin de sélectionner des produits suffisamment<br />
actifs à de faibles doses et utilisables opérationnellement. Pour l'instant seul dans le groupe<br />
des juvénoYdes, des composés comme l'OMS 3010 (Phenoxycarbamate) et l'OMS 3019<br />
ont présenté une assez bonne activité sur larves de simulies respectivement aux doses<br />
de 0,1 mg/I/10mn et 0,5 mg/I/ZOmn.<br />
Les régulateurs de croissance pourraient constituer un moyen de lutte effi<br />
cace contre les populations préimaginales de CuLex quinquefasciatus si l'on n'observe<br />
pas des résistances croisées avec les insecticides classiques (organochlorés, organophos<br />
phorés, carbamates et pyréthrinoYdes). Dans l'éventualité de leur utilisation dans un<br />
programme de lutte contre des populations résistantes aux insecticides chimiques le<br />
suivi de la sensibilité de ces populations aux produits utilisés devrait être renforcé.<br />
Il est souhaitable que les composés qui se sont révélés efficaces lors des<br />
essais expérimentaux à petite échelle puissent être testés à plus grande échelle dans<br />
des programmes de lutte antivectorielle. Des applications répétées de ces produits<br />
dans les gîtes à CuLex quinquefasciatus et dans les rivières abritant les gîtes à simu<br />
lies pourraient donner des résultats satisfaisants du point de vue de la réduction des<br />
populations imaginales vectrices.
A N N E X E
o 10 R.E.<br />
100 t"f-----------,<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
(:Jo.1S 3019<br />
Granules à 0,5 %<br />
2<br />
Dose : 0,1 g/m<br />
o 1 » • • • • • • • •<br />
5<br />
10 • " 15<br />
20 24<br />
Semaines<br />
1 • • • • • • • • •• •• ...<br />
Graphique 15 : Efficacité et rémanence de 1'(:Jo.1S 3019 (Granules à 0,5 % m.a. SUMITOMO CHEMICAL)<br />
dans les gîtes à Culex quinquefasciatus : Evolution des pourcentages de<br />
réduction d"énergence dans un gîte traité à la dose de 0,1 g/m2.<br />
N<br />
'-"
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0, R.E.<br />
o 0, R.E.<br />
o<br />
100 1 ....<br />
Puisard nO 16<br />
OMS 3019 Granules à 0,5 S m.a.<br />
2<br />
Dose : 0,5 g/11I<br />
o .1 • • • • •• •• ••••••• • ,.. ...<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
24<br />
100tl--------·-----•<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Puisard nO 17<br />
OMS 3019 Granules à 0,5 % m.a.<br />
2<br />
Dose : 0,5 glm<br />
o l •• """.,.."..."".... .".. •<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20 24<br />
Semaines Semaines<br />
Graphiques 16' & 17 : Efficacité et rémanence de l'OMS 3019 (Granules à 0,5 % m.a. SUMI1OMO CHEMlCAL) dans les gîtes à<br />
Culex guinguefasciatus ; Evolution des pourcentages de réduction d"énergence dans deux (2) gîtes<br />
traités à la dose de 0,5 glm2.<br />
......<br />
N<br />
./-'
o ;'0 R.f.<br />
100<br />
80<br />
60 Puisard nO 23<br />
.40<br />
20<br />
OMS 3019 poudre mouillable à 5 %<br />
2<br />
Dose : 0,1 g/m<br />
o1 • • • • J • • • • • • • • • • .» ••••••• ..<br />
5<br />
10<br />
20 25<br />
15<br />
Semaines<br />
Graphique 23 : Efficacité et rémanence de l'OMS 3019 (poudre mouillable à 5 % m.a. SUHITOMO CHEMICAL)<br />
dans les gîtes à Culex guinguefaciatus : Evolution des pourcentages de réduction d'émergence<br />
dans un (1) gite traité à la dose de 0, 1 g/m2.<br />
hl<br />
CD
Jensité 20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
Jensité 20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
3<br />
3<br />
"*<br />
4 5<br />
6<br />
6<br />
10<br />
10<br />
17<br />
17<br />
24<br />
24'<br />
31<br />
31<br />
- 132 -<br />
38<br />
38<br />
45<br />
45<br />
52<br />
52<br />
59<br />
59<br />
66 Jours<br />
66 Jours<br />
Graphiques 31 ci 32 Etude de l'activité biologique et de la rémanence dans deux (2)<br />
gîtes larvaires (puisards) à Culex quinquefasciatus de l 'CMS<br />
3OJ9 (TéflUJenzuron) en concentré éoulsifiable à 10 % de rn.a.<br />
(Œl.JlH3O)<br />
Quartier liberté<br />
Dynamique des populations préimaginales<br />
Dose de traitement 0,5 mg/l. (Quartier Liberté).
RESUME<br />
-------------
- 135 -<br />
La lutte contre les insectes vecteurs de maladies tropicales se heurte depuis<br />
quelques années au problème de la résistance aux insecticides. Cette situation a suscité<br />
un regain d'intérêt pour la recherche de nouveaux types d'insecticides et de nouvelles<br />
méthodes de lutte susceptibles de remplacer ou venir en appoint aux insecticides con<br />
ventionnels.<br />
Parmi ces nouveaux moyens figure en bonne place l'utilisation des hormones<br />
naturelles de croissance des insectes ou de leurs analogues de synthèse. Ces molécules<br />
inhibent le développement préimaginale des insectes et plusieurs d'entre elles se sont<br />
révélées très actives sur de nombreuses espèces nuisibles en agriculture et en santé pu<br />
blique. Par ailleurs, elles présentent l'avantage d'être biodégradables et de ne pas être<br />
toxiques pour les vertébrés.<br />
L'activité biologique de douze composés de cette nouvelle famille d'insectici<br />
des a été évaluée sur des populations préimaginales de deux importants vecteurs de ma<br />
ladies en Afrique : Culex quinquefasciatus Say 1823 et les simulies du complexe Simu<br />
lium damnosum.<br />
Cette étude a été menée dans l'optique de sélectionner des composés et for<br />
mulations utilisables à grande échelle dans des campagnes de lutte antivectorielle. Le<br />
travail est présenté en trois chapitres, dont le premier est consacré à des généralités<br />
sur l'endocrinologie des insectes, particulièrement le rôle des hormones dans les proces<br />
sus de croissance, de mue et de métamorphose. La nature et la structure chimique de<br />
ces hormones sont précisées et les différents groupes d'analogues de ces hormones sont<br />
présentés. Deux groupes ont retenu notre attention : les ecdysoYdes ou inhibiteurs de<br />
mues larvaires et les juvénoYdes ou mimétiques de l'hormone juvénile.<br />
Le second chapitre se rapporte aux essais expérimentaux réalisés avec cinq<br />
composés régulateurs de croissance sur des populations préimaginales de Culex quinque<br />
fasciatus en milieu urbain. Ce moustique est l'un des vecteurs de la filariose de Ban<br />
croft dans plusieurs régions tropicales notamment en Afrique de l'Est. La lutte menée contre<br />
cet insecte s'est heurtée ces dernières années à de sérieuses difficultés suite au déve<br />
loppement de la résistance aux insecticides chimiques utilisés et il est apparu indispen<br />
sable de rechercher d'autres moyens de lutte efficaces tels que l'utilisation des hormo<br />
nes de croissance ou de leurs analogues de synthèse.<br />
Nous avons testé cinq nouveaux produits dans des puisards et fosses septiques<br />
qui constituent en milieu urbain d'excellents gîtes à Culex quinquefasciatus.
- 136 -<br />
Après des généralités sur la biologie et l'écologie de ce moustique, sur sa<br />
distribution géographique et son rôle vecteur, la zone d'étude est présentée (ville de<br />
Bouaké) ainsi que la méthologie utilisée.<br />
L'évaluation de l'efficacité de ces composés vis-à-vis des populations préima<br />
ginales de Culex quinquefasciatus a été basée d'une part sur les taux de réduction ou<br />
d'inhibition de l'émergence des adultes et d'autre part sur la réduction des densités<br />
larvaires et nymphales. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux (5 à 9) et<br />
de graphiques (1 à 35).<br />
Quatre des cinq composés testés ont présenté une bonne efficacité dans les<br />
puisards à des doses acceptables (0,1, 0,5 et 1 mg/!) et une assez longue persistance<br />
malgré la forte pollution des eaux. Ceci dénote une grande stabilité des molécules et<br />
constitue indéniablement un avantage. Des essais à plus grande échelle mériteraient<br />
d'être réalisés avec les composés OMS 3009 (Téflubenzuron), OMS 1697 (Méthoprène)<br />
et OMS 3019 (S - 31183) et sur une période plus longue pour mieux apprécier les quali-<br />
tés réelles de ces produits très prometteurs.<br />
Le troisième chapitre a trait aux essais réalisés avec 12 composés régula<br />
teurs de croissance sur les larves du complexe Simulium damnosum. La lutte contre<br />
l'Onchocercose humaine ou "cécité des rivières" est basée jusqu'à présent essentielle<br />
ment sur la lutte antivectorielle par épandage d'insecticides dans les courants des cours<br />
d'eau constituant les gîtes larvaires des simulies. Depuis quelques années cette lutte<br />
chimique se heurte également au problème de la résistance des larves aux insecticides<br />
utilisés (organophosphorés). Dès lors la recherche de nouveaux insecticides utilisables<br />
a été renforcée. Dans ce contexte, outre les autres familles d'insecticides classiques<br />
(carbamates et pyréthrinoYdes) et les agents de lutte biologique (Bacillus thutlngiensis<br />
H-14 et Bacillus sphaetlcus), les composés régulateurs de croissance présentaient à prio<br />
ri un grand intérêt. Un programme de sélection des produits et des formulations les<br />
plus actives a été initié.<br />
Pour tester l'efficacité des nombreuses formulations proposées par l'industrie<br />
et comparer leurs performances respectives, il a fallu mettre au point une méthodologie<br />
adaptée, tenant compte de la biologie des larves du complexe S.damnosum et du mode<br />
d'action des composés régulateurs de croissance. Ceux-ci, contrairement aux insecticides<br />
classiques, exercent une action léthale retardée d'où la nécessité de mettre les larves<br />
en observation après leur traitement.
- 137 -<br />
De nombreuses formulations d'ecdysoYdes et de juvénoYdes ont été testées et<br />
les facteurs essentiels pouvant conditionner leur efficacité ont été étudiés (formulation,<br />
concentration, temps de contact, et stade larvaire). Les résultats sont présentés sous<br />
forme de tableaux (10 à 41).<br />
ContrairemEnt aux résultats obtenus avec les moustiques, ceux enregistrés<br />
sur larves de simulies sont décevants. Deux molécules, l'OMS 3010 (Phenoxycarbamate)<br />
et l'OMS 3019, tous deux juvénoYdes, ont présenté une certaine efficacité. Toutefois<br />
ils offrent des perspectives limitées car ils sont actifs surtout sur les derniers stades<br />
larvaires et à des doses relativement élevées (0,1 mg/l/10mn et 0,5 mg/l/ZOmn, respec<br />
tivement).<br />
La faible efficacité des régulateurs de croissance sur les larves de simulies<br />
est liée à deux facteurs essentiels: le temps de contact et le stade larvaire. Leur uti<br />
lisation comme larvicides antisimulidiens n'est cependant pas totalement inconcevable.<br />
Elle supposerait des applications lentes et rapprochées de ces produits pour lesquels des<br />
techniques d'application nouvelles devraient être mises au point.<br />
Les formulations associant ecdyso"fdes et juvéno"fdes mériteraient d'être tes<br />
tées. Les essais de nouveaux composés régulateurs de croissance devraient se poursuivre<br />
car il n'est pas exclu que l'on puisse sélectionner des formulations efficaces et<br />
utilisables.<br />
Les régulateurs de croissance constituent un outil utilisable dans la lutte con<br />
tre Culex quinquefasciatus. Les résultats obtenus avec l'OMS 3009, l'OMS 1697 et<br />
l'OMS 3019 l'attestent. Toutefois pour Simulium damnosum vivant en eau courante la<br />
nécessité d'un temps de contact prolongé entre la larve et le produit limite considéra<br />
blement leurs perspectives d'utilisation, du moins avec les formulations et les méthodes<br />
d'application actuellement disponibles.
BIBLIOGRAPHIE<br />
===========================
- 138 -<br />
ABDULCADER (W.H.N.), RAJAKONE (P.), THARUMARAJAH (K.) and MAHADEVA<br />
(R.), 1965 - Vectorial capacity of Culex pipiens fatîgans in Ceylon.<br />
J. T'Wp. Med. Hyg., 68, 254-256.<br />
ANONYME, 1981 - Résistance des vecteurs de maladies aux pesticides point de la<br />
si tuation. Cn'Wnique OMS, 35, 162-168.<br />
ANONYME, 1983 - InformaI consultation on insect growth regulators. '!:Joc. miméo.<br />
OMS, WHO/VBC!83.883.<br />
ANONYME, 1984 - Dix ans de lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest:<br />
Bilan des activi tés du Programme de Lutte contre l'Onchocercose dans la<br />
Région du Bassin de la Volta. OC'J/84.3.<br />
AXTELLL (R.C.), RUTZ (D.A.) and EDWARDS (T.D.), 1980 - Field tests of insecticides<br />
insect grawth regulators for the control of Culex quinquefasciatus in anaero<br />
bic annual waste lagoons. J. Amer. Mosquito Control Assac. 40, 36.<br />
BANG (Y.H.), SABUNI CI.B.) and TONN (R.J.), 1973b - Mosquito control service in<br />
Tanzania III. The effects of mosquito control and urbanization on mos<br />
quito population in Dar-Es-Salaam from 1954 to 1971. '!:Joc. OMS, WHO/<br />
VBC/73.440.<br />
BELLEC (C.) et HEBRARD (G.), 1983 - Les heures d'activité de vol des adultes du<br />
complexe Simulium damnosum en secteur préforestier de Côte d'Ivoire.<br />
Cano O'RSTOM, sér. E.nt. méd. et 'Jarasitol., 21 (4), 261-273.<br />
BHAT (H.R.), 1975 - A survey of hematophagous arthropods in Western Himalaya,<br />
Sikkin and Hill districts of West Bengal : records of mosqui toes collected<br />
from Himalaya region and Uttar Pradesh wi th ecological notes.<br />
7nd. Med. 'Res., 63, 1583-1608.<br />
BRENGUES (J.), 1975 - La filariose de Bancroft en Afrique de l'Ouest.<br />
Mém. O'RSTOM, 'Jaûs 79, 299 pp..<br />
BRENGUES (J.), 1978 - Culex pipiens fatîgans Wiedemann en Afrique tropicale<br />
sOfl importance et son contrôle. '!:Joc. Tecnn. OccgE., N° 6679/78.<br />
BROWN (A.W.A.) et PAL (R.), 1973 - Résistance des arthropodes aux insecticides.<br />
Org. Mond. Santé, Séûe Monogr., N° 38, 541 pp..<br />
BRUNHES (J.), 1975 - La filariose de Bancroft dans la sous région malgache (Como<br />
res - Madagascar - Réunion). Mém. O'RSTOM, 'Jaûs 81, 212 pp..
- 139 -<br />
BURG (R.W.) et al., 1979 - Avermectins, a new family of potent anthelmintic<br />
agent : producing organism and fermentation. Antimicrobial agents and<br />
Chemotherapy. 15 0), 361-367.<br />
CERF (D.C.) and GEORGHIOU (G.P.), 1974b - Cross resistance to an inhibition of<br />
chi tin synthesis, TH 6040 in insecticide resistance strains of the house<br />
fly. 'J. d'igz.. 100d Chem., 22, 1145.<br />
CHABALA (J.C.) et al., 1980 - Ivermectin, a new broad spectrum antiparasitic<br />
agent. 'J. of Medical Chemestz.y, 23 (0), 1134-1136.<br />
CHAUVET (G.) et RASOLONIAINA (L.), 1968 - Culex pipiens fatîgans en milieu<br />
urbain à Madagascar. Cah. O'RSTOM, sé.z.. E.nt. méd. et 'J'az.asitol., 6,<br />
145-159.<br />
CLEMEI\JTS (A.N.), 1963 - The physiology of mosquitoes. 'J'ez.gamon 'J'z.ess. Oxfoz.d.,<br />
393 pp•.<br />
CRUICKSHANK (P.A.), 1971 - Insect juvenile hormone analogue : effects of some<br />
terpenoYde amide derivatives. Bull. Oz.g. Mond. Santé, 44 (1,2,3),<br />
395-396.<br />
CRUICKSHANK (P.A.) and PALMERE (R.M.), 1971 TerpenoYde amine as insect<br />
juvenile hormones. Natuz.e Land., 233 (5320), 488-489.<br />
CURTIS (C.F.) et PASTEUR (N.), 1981 - Organophosphate resistance in vector popu<br />
lations of the complex of Culex pipiens L.. Bull. E.nt. 'Res., 71, 153-161.<br />
CURTIS (C.F.), KETO (A.), RAMJI (B.D.) et IOSSON (l.), 1984 - Assessment of the<br />
impact of chlorpyrifos resistance in Culex quinquefaseiatus on a conscheme.<br />
lnsect. Sei. d'ipplic., 5, 263-267.<br />
DAVIES (J.B.), SEKETELI (A.), WALSH (J.F.), BARRO (T.) et SAWADOGO (R.), 1981 <br />
Studies of biting Simulium damnosum s.l. at a breeding site in the Oncho<br />
cerciasis Control Programme area during and after in erruption of insec<br />
ticidal treatment. Tz.openmed. 'J'az.asit., 32, 17-24.<br />
DOBROTWORSKY (N.V.), 1967 - The problem of the Culex pipiens complex in the<br />
South pacifie Oncluding Australia). Bull. Wld. Jllth. Oz.g., 37, 251-255.
- 140 -<br />
DOVE (R.F.) et Mc KAGUE (A.B.), 1975 - Effect of Insect development inhibitors on<br />
adults emergence of blackflies (Diptera, Simuliidae). Canad. EntomoL••<br />
107, 1211-1213.<br />
DUNBAR (R.W.) et VAJIME (C.G.), 1981 - Cytotaxonomy of the Simulium damnosum<br />
complex in Blackflies. [ai'l.d. Jl:cad. 'hess•• 31-44.<br />
ELSEN (P.), 1977 - Méthodes d'échantillonnage des populations préimaginales de Simu<br />
lium damnosum s.l. Theobald 1903, en Afrique de l'Ouest. 1. Distribution<br />
verticale des larves et des nymphes : observations préliminaires.<br />
T'l.Openmed 'Ja'l.asit •• 28, 91-96.<br />
ELSEN (P.) et HEBRARD (G.), 1977 - Méthodes d'échantillonnage des populations<br />
préimaginales de Simulium damnosum s.l. Theobald 1903 en Afrique de<br />
l'Ouest. II. Observations sur le choix des couleurs, l'évolution des peuple<br />
ments et la répartition horizontale au moyen de rubans de plastique.<br />
T'l.Openmed. 'Ja'l.asit •• 28, 471-477.<br />
GAABOUB (I.A.), MANSOUR (N.A.) and KAMEL (F.M.), 1971 Evaluation of nine<br />
insecticides with three pyrethrin synergists against the mosquito CuLex<br />
pipiens quinquefasciatus. Z. Jl:ng. Ent.. 68, 432-438.<br />
GARMS (R.) et VAJIME (C.G.), 1975 - On the ecology and distribution of the sibling<br />
species of Simulium damnosum in different bioclimatic zones of Liberia<br />
and Guinea. T'l.Openmed. 'J'a'l.asit •• 26, 377-383.<br />
GEORGHIOU (G.P.), LIN (C.S.) and PASTERNAK (M.E.), 1974 - Assessment of poten<br />
tiality of CuLex ta'l.salis for development of resistance to carbamate<br />
insecticides and insect growth regulators. 'J''l.oc. Calif. Mosq. Cont'l.. Jl:ssoc ••<br />
42,117.<br />
GRASSE (P.P.), POISSON (R.A.) and TUZET (O.), 1970 - Précis de Zoologie (Tome 1).<br />
Edition Masson et Cie EditeU'l.s. 120 BouLeaa'l.d St ge'l.main 'J'aûs X7.<br />
GRETILLAT (S.), 1962 - Un molluscicide (Ziram) actif contre les formes larvaires de<br />
Culicidae. BuLL. O'l.g. Mond. Santé. 26, 67-74.<br />
GROSSCURT (A.C.), 1976 - Ovicidal effects of diflubenzuron on the house fly (Musc a<br />
domestica). Med. 1 ae. [andbouww. 'Rii!
- 141 -<br />
GROSSeURT (A.C.), 1977 - Mode of action of diflubenzuron as an ovicide and some<br />
factors inf1uencing its potency. 'J'wc. Bût. Cwp. 'J'wt. Conf. on 'J'ests and<br />
Diseases, 141 pp••<br />
GROSSeURT (A.C.), 1978 - Diflubenzuron : some aspects of its ovicidal and larvici<br />
dal mode of action and an evaluation of its pratical possibilities.<br />
'J'estic. Sei., 9, 373-386.<br />
GUILLET (P.), 1985 - La lutte contre les vecteurs de l'Onchocercose en Afrique de<br />
l'Ouest: Etude de la résistance et recherche de nouveaux larvicides.<br />
Thèse Doctoz.at ès-Sciences, UniIJez.sité de 'J'aûs Sud - Centz.e d'Oz.say,<br />
1z.ance. 444 pp••<br />
GUILLET (P.) et ESCAFFRE (H.), 1979 - La recherche de nouvelles formulations<br />
d'insecticides utilisables contre les larves des vecteurs de l'Onchocercose<br />
en Afrique de l'Ouest. C.'R. Congz.ès SUl. la lutte contz.e les insectes en<br />
milieu tz.opical, Maz.seille, 1979, 1169-1178.<br />
GUILLET (P.) ESCAFFRE (H.), OUEDRAOGO (M.) et QUILLEVERE (O.), 1980 -<br />
Mise en évidence d'une résistance au téméphos dans le complexe Simulium<br />
damnosum (S.sanctipauli et S.soubz.enseJ en Côte d'Ivoire (zone du Program<br />
me de Lutte contre l'Onchocercose dans la Région du Bassin de la Volta).<br />
Cah. O'RSTO M, séz.. Ent. méd. et 'J'az.asitol., IJol. XV777, N° 3" 1980 :<br />
291-299.<br />
GUILLET (P.), HOUGARD (J.M.), DOANNIO (J.), ESCAFFRE (H.) et DUVAL (J.), 1985 <br />
Evaluation de l'activité de cinq insecticides régulateurs de croissance sur<br />
les larves du complexe Simulium damnosum. 7n Thèse, UniIJez.sité de 'J'aûs<br />
Sud, CentI.e d'Oz.say, 1z.ance, 181-195. 444 pp••<br />
GUILLET (P;), HOUGARD (J.M.), DOANNIO (J.), ESCAFFRE (H.) et DUVAL (J.), 1985 <br />
Evaluation de l'activité d'un insecticide régulateur de croissance, le Dif1u<br />
benzuron, sur les larves du complexe Simulium damnosum. I. Etude de<br />
quelques facteurs conditonnant l'efficacité. 7n Thèse, UniIJez.sité de 'J'aûs<br />
Sud, Cenhe d'Oz.say, 1z.ance, 153-168. 444 pp••<br />
GUILLET (P.), HOUGARD (J.M.), DOANNIO (J.), ESCAFFRE (H.) et DUVAL (J.),<br />
1985b - Méthodologie pour tester l'activité des larvicides sur les simulies<br />
du complexe Simulium damnosum., I. Insecticides conventionnels et agents<br />
de lutte biologique. 7n Thèse, UniIJez.sité de 'J'aûs Sud, Cenhe d'Oz.say,<br />
1 z.ance - 1985. 444 pp.•
- 142 -<br />
GUILLET (P.), HOUGARD (J.M.), DOAI\JNIO (J.), ESCAFFRE (H.) et DUVAL (J.),<br />
1985 - Méthodologie pour tester l'efficacité des formulations d'insectici<br />
des sur les larves du complexe Simulium damnosum. II. Composés régula<br />
teurs de croissance. 7n Thèse Doctorat ès-Sciences, UnilJersité de 'Jaûs<br />
Sud, Centre d'Orsay, 1rance. 444 pp..<br />
GUILLET (P.), HOUGARD (J.M.), ESCAFFRE (H.) et DUVAL (J.), 1984 - Evaluation<br />
de l'activité des composés régulateurs de croissance sur des larves du<br />
complexe Simulium damnosum. 1. Evaluation à échelle réduite : Rapport<br />
préliminaire. Doc. OCCgE./O'RSTOM, N° 19/7'RTO/'Rap/84.<br />
GUILLET (P.), MONOET (B.) et GREBAUT (S.), 1977 - La résistance au DDT chez<br />
Simulium damnosum s.l. (Diptera : Simuliidae) en Afrique de l'Ouest.<br />
Doc. Mim. OMS, WHO/VBC/77.678.<br />
HAMON (J.), BURNETT (G.F.), ADAM (J.P.), RICHENBACH (A.) and GRJEBINE (A.),<br />
1967 - Culex pipiens fatigans Wiedemann. Wuchereûa banCl.ofti Cobbold<br />
et le développement économique de l'Afrique tropicale. Bull. Word. Health<br />
Org., 37, 217-237.<br />
HAMON (J.) et MOUCHET (J.), 1967 - La résistance aux insecticides chez Culex<br />
pipiens fatigans Wiedemann. Bull. Orge Mond. Santé, 37, 277-286.<br />
HERVE (J.P.), 1972 - Les hormones chez les insectes : leur utilisation dans la lutte<br />
contre les insectes d'intérêt médical. Dipl;me O'RSTOM, 67 pp.•<br />
HOUGARD (J.M.), DARRIET (F.) et BAKAYOKO (S.), 1983 - Evaluation en milieu<br />
naturel de l'activité larvicide de Bacillus thuûngiensis H-14 sur Culex<br />
quinquefasciatus Say et Anopheles gambiae Giles 1902 s.l. (Diptera :<br />
Culicidae) en Afrique de l'Ouest. Cah. O'RSTOM, séz.. E.nt. méd. et<br />
'Jarasitol., 21 (2) : 111-117.<br />
HOUGARD (J.M.), DUVAL (J.), ESCAFFRE (H.) et PENCHENIER (L.), 1986 - Evalua<br />
tion à échelle réduite des larvicides antisimulidiens en Afrique de l'Ouest.<br />
1. Colonisation naturelle de supports artificiels par des larves du complexe<br />
Simulium damnosum : Description et possibilités d'utilisation de l'appareil:<br />
(sous presse).
- 144 -<br />
LACEY (L.A.) et MULLA (M.S.), 1979 - Field evaluation of Diflubenzuron against<br />
Simulium lawae. J. Amel.. Mosquito Control Assoc., 39, 86.<br />
LAMBRECHT (F. L.), 1971 - Notes on the ecology of Seychelles mosquitoes.<br />
Bull. Ent. 'Res., 60, 513-532.<br />
LE BERRE (R., 1966 - Contribution à l'étude biologique et écologique de Simulium<br />
damnosum Theobald 1903. Mem. O'RSTOM, N° 17, 'Jatis, 204 pp.•<br />
LEWALLEN (L.L.), 1964 - Effects of fainesol and Ziram on mosquito larvae.<br />
Mosq. News, 24 (1), 43-45.<br />
LOCK (M.A.), WALLIS (P.M.) et HYNES (H.B.N.), 1977 - Coloidal organic carbon in<br />
running waters. Oil
- 146 -<br />
PHILIPPON (B.), 1980 - Acquisitions entomologiques récentes dans l'étude de<br />
l'Onchocercose humaine. Etudes Médicales N° 2. Juin 1980, 81-103.<br />
POST (L.C.) and MULDER (R.), 1974 - Insecticidal properties and mode of action<br />
of 1-(2,6-dihalogenbenzoy1)-3-phenylureas. o1meZ-. Chem. Soc. Nat. Altg.<br />
Los o1ngeles C.o1••<br />
POST (L.C.) et VINCENT (W.R.), 1973 - A new insecticide inhibits chi tin synthesis.<br />
NatuZ-wissen Schaften. 60, 431-432.<br />
PUTTER (I.), Mc CONNELL (J.G.), PREISER (F.A.), HAID RI (A. A.), RICnCH (S.S.)<br />
et DYBAS (R.A.), 1981 - Avermectins : novel insecticidies, acaricides<br />
and nematicides from a sail micro-organism. Expeûentia. 37, 963-964.<br />
QUILLEVERE (O.), 1979 - Contribution à l'étude des caractéristiques taxonomiques,<br />
bioécologiques et vectrices des membres du complexe Simulium damnosum<br />
présents en Côte d'Ivoire. Twaux et 7:Jocuments 07?.STO M. N° 109, 296 pp.<br />
RODRIGUES (C.S.) and WRIGHT (R.E.), 1978 - Evaluation of the insect growth regu<br />
lators methoprene and Diflubenzuron against floodwater mosquitoes (Dipte<br />
ra : Culicidae) in Southwestern Ontario, Canada. Cano Entomologist. 110,<br />
319.<br />
ROLLE.R (H.) and BJERKE (J.S.), 1965 - Purification and isolation of juvenile hormone<br />
and its action in Lepidopteran Larvae. Life Sei. {OxfoZ-d}. 4, 1617-1624.<br />
ROSS (R.H.) et GRAIG (O.A.), 1980 - Mechanism of fine particles capture by larval<br />
black flies. Canad. 'J. Zool•• 58 (6), 1186-1192.<br />
SACHER (R.M.), 1971 - A mosquito larvicide with favorable environnemental proper<br />
ties. Mosq. News. 13 (4), 513-516.<br />
SCHAEFER (C.H.) and DUPRAS (E.F.), 1973 - Insect developmental inhibitors<br />
persistence of ZR-515 in water. 'J. Econ. Entomol•• 66, 923.<br />
SCHAEFER (C.H.) and WILDER (W.H.), 1972 - Insect developmental inhibitors<br />
a pratical evaluation as mosquito control agents. 'J. Econ. Entomol•• 65<br />
(4), 1066-1071.<br />
SCHAEFER (C.H.) and WILDER (W.H.), 1973 - Insect developmental inhibitors :<br />
Effects on target mosquito species. 'J. Econ. Entomol•• 66 (4), 913-916.
- 148 -<br />
SUBRA (R.), 1981 - Biology and control of Culex pipiens quinquefaseiatus Say, 1823<br />
(Diptera, Culicidae) with special reference ta Africa. insecte Sc. Appl.,<br />
vol. l, N° 4, 319-338.<br />
SUDOMO (M.), AMINAH (S.), MA THIS (H.) et BANG (Y.H.), 1981 - Small scale field<br />
trials of Baeillus thutingiensis H-14 against different mosquito vector<br />
species in Indonesia. 'Doc. miméo. OMS, WHO/'UBC!81.836, 10 pp..<br />
TEN HOUTEN (A.), SIlI AMINAH (N.), GRATl and MA THIS (H.L.), 1980 - Pilot trial<br />
with methoprene (OMS 1697) against Aedes aegypti in Jakarta, Indonesia.<br />
'Doc. Mim. OMS, WHO/'UBC!80.796.<br />
THOMSON (B.N.) et ADAMS (B.G.), 1979 - Laboratory and field trials using Altosid<br />
insect growth regulator against black flies (Diptera : Simuliidae) of New<br />
F oundland, Canada. 'J. Med. EntomoL., 16, 536.<br />
VAJIME (C.G.) and DUNBAR (R.W.), 1975 - Chromosomal identification of eight<br />
species of the subgenus Edwardsellum near and including Simulium damno<br />
sum Theobald (Diptera : Simuliidae). Ttopenmed. 'J atasit., 26, 11-138.<br />
VAJIME (C.G.) and QUILLEVERE (O.), 1978 - The distribution of the Simulium damno<br />
sum complex in West Africa with particular reference ta the Onchocerciasis<br />
Control Programme area. Ttopenmed. 'Jatasit.<br />
VERMEIL (C.), 1955 - Nouvelle contribution à l'étude du complexe 'Jipiens en Tunisie:<br />
sur un biotope rencontré dans le secteur sub-saharien de ce pays.<br />
Bull. Soc. Sei. Nat. Tunis., 8, 33-35.<br />
WILLS (W.), SAIMOT (G.), BROCHARD (Ch.), BLUNBERG (B.S.), LONDOI\J (W. T.),<br />
DECHEI\JE (R.) and WILLMAN (P.), 1976 - Hepatits B surface antigen<br />
(Australia antigen) in mosquitoes collected in Senegal, West Africa.<br />
Am. 'J. TtOp. Med. C]yg., 25, 186-190.<br />
WORLD HEALTH ORGANIlATION, 1978 - Rift Valley Fever. W!