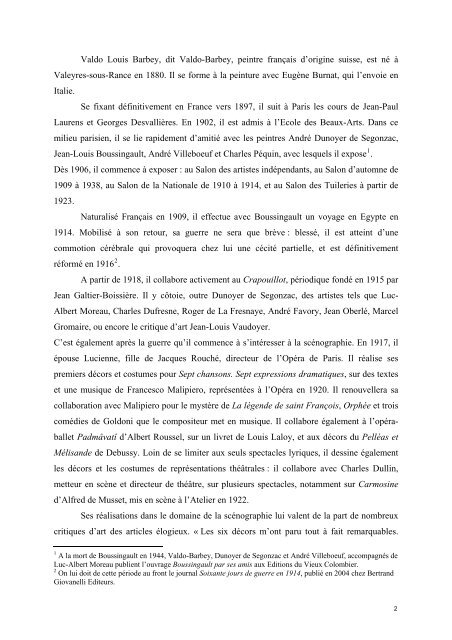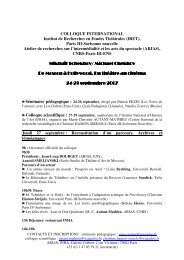Inventaire Valdo-Barbey - Institut National d'Histoire de l'Art
Inventaire Valdo-Barbey - Institut National d'Histoire de l'Art
Inventaire Valdo-Barbey - Institut National d'Histoire de l'Art
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Valdo</strong> Louis <strong>Barbey</strong>, dit <strong>Valdo</strong>-<strong>Barbey</strong>, peintre français d’origine suisse, est né à<br />
Valeyres-sous-Rance en 1880. Il se forme à la peinture avec Eugène Burnat, qui l’envoie en<br />
Italie.<br />
Se fixant définitivement en France vers 1897, il suit à Paris les cours <strong>de</strong> Jean-Paul<br />
Laurens et Georges Desvallières. En 1902, il est admis à l’Ecole <strong>de</strong>s Beaux-Arts. Dans ce<br />
milieu parisien, il se lie rapi<strong>de</strong>ment d’amitié avec les peintres André Dunoyer <strong>de</strong> Segonzac,<br />
Jean-Louis Boussingault, André Villeboeuf et Charles Péquin, avec lesquels il expose 1 .<br />
Dès 1906, il commence à exposer : au Salon <strong>de</strong>s artistes indépendants, au Salon d’automne <strong>de</strong><br />
1909 à 1938, au Salon <strong>de</strong> la <strong>National</strong>e <strong>de</strong> 1910 à 1914, et au Salon <strong>de</strong>s Tuileries à partir <strong>de</strong><br />
1923.<br />
Naturalisé Français en 1909, il effectue avec Boussingault un voyage en Egypte en<br />
1914. Mobilisé à son retour, sa guerre ne sera que brève : blessé, il est atteint d’une<br />
commotion cérébrale qui provoquera chez lui une cécité partielle, et est définitivement<br />
réformé en 1916 2 .<br />
A partir <strong>de</strong> 1918, il collabore activement au Crapouillot, périodique fondé en 1915 par<br />
Jean Galtier-Boissière. Il y côtoie, outre Dunoyer <strong>de</strong> Segonzac, <strong>de</strong>s artistes tels que Luc-<br />
Albert Moreau, Charles Dufresne, Roger <strong>de</strong> La Fresnaye, André Favory, Jean Oberlé, Marcel<br />
Gromaire, ou encore le critique d’art Jean-Louis Vaudoyer.<br />
C’est également après la guerre qu’il commence à s’intéresser à la scénographie. En 1917, il<br />
épouse Lucienne, fille <strong>de</strong> Jacques Rouché, directeur <strong>de</strong> l’Opéra <strong>de</strong> Paris. Il réalise ses<br />
premiers décors et costumes pour Sept chansons. Sept expressions dramatiques, sur <strong>de</strong>s textes<br />
et une musique <strong>de</strong> Francesco Malipiero, représentées à l’Opéra en 1920. Il renouvellera sa<br />
collaboration avec Malipiero pour le mystère <strong>de</strong> La légen<strong>de</strong> <strong>de</strong> saint François, Orphée et trois<br />
comédies <strong>de</strong> Goldoni que le compositeur met en musique. Il collabore également à l’opéraballet<br />
Padmâvatî d’Albert Roussel, sur un livret <strong>de</strong> Louis Laloy, et aux décors du Pelléas et<br />
Mélisan<strong>de</strong> <strong>de</strong> Debussy. Loin <strong>de</strong> se limiter aux seuls spectacles lyriques, il <strong>de</strong>ssine également<br />
les décors et les costumes <strong>de</strong> représentations théâtrales : il collabore avec Charles Dullin,<br />
metteur en scène et directeur <strong>de</strong> théâtre, sur plusieurs spectacles, notamment sur Carmosine<br />
d’Alfred <strong>de</strong> Musset, mis en scène à l’Atelier en 1922.<br />
Ses réalisations dans le domaine <strong>de</strong> la scénographie lui valent <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> nombreux<br />
critiques d’art <strong>de</strong>s articles élogieux. « Les six décors m’ont paru tout à fait remarquables.<br />
1<br />
A la mort <strong>de</strong> Boussingault en 1944, <strong>Valdo</strong>-<strong>Barbey</strong>, Dunoyer <strong>de</strong> Segonzac et André Villeboeuf, accompagnés <strong>de</strong><br />
Luc-Albert Moreau publient l’ouvrage Boussingault par ses amis aux Editions du Vieux Colombier.<br />
2<br />
On lui doit <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> au front le journal Soixante jours <strong>de</strong> guerre en 1914, publié en 2004 chez Bertrand<br />
Giovanelli Editeurs.<br />
2